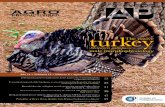Le phénomène pionnier agro-céramiste antillais : vers une vision archipélique
-
Upload
univ-antilles -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Le phénomène pionnier agro-céramiste antillais : vers une vision archipélique
Dossier A rc h é o l o g i e d e s d é p a r t e m e n t s f ra n ç a i s d ' A m é r i q u e
70 Les Nouvelles de l’archéologie n° 108-109 – Juillet 2007
Les cultures agro-céramistes se développent dans les Antilles au cours de ladeuxièmemoitiédupremiermillénaireavantnotreère.Elless’étendenttrèsrapi-
dementdescôtesduVenezuelaàPortoRico.Ellessontassociéesàdeuxensembles,leSaladoïdecedrosanancienetleSaladoïdehuecan,dontlaparentéculturelleainsiquel’articulationgéographiqueetchronologiquesontaucentredenombreusesdiscus-sionsdepuisprèsdetrenteans.Cesgroupesquiintroduisentdanslesîlesuncertainnombredeplantesetd’animauxoriginairesducontinent(chien,agouti,iguane)ontuneéconomiebaséesurlaculturedumanioc.
Il y a deuxmillénaires et demi, quelques canots quittent les côtes du delta del’Orénoqueetpartentà laconquêtede l’archipelantillais.Leursoccupantset leursdescendants, progressant d’îles en îles, fondent dans cet espace géographiquementmorcelé une société originale marquée par une insularisation progressive, visibleentre autres dans le passage d’une économie de type «forestier» à une économie«maritime».
Cette vision «traditionnelle» du phénomène pionnier agro-céramiste antillaisestfortementmarquéeparl’importancedel’effetdefondation,quirenddifficilelareconnaissanced’unediversitéculturelleauseindecespremiersgroupesagro-céra-mistes.Ellesesignaleaussi,commetoutel’archéologieantillaise,paruneattentionparticulièreaccordéeàlanotiond’insularitéquiestliéeàunevisiontrèsterriennedel’espaceaudétrimentd’unevisionplusmaritime.
C’est autour de la remise en question de cette vision sans doute un peu tropsimplisteques’articulentlesdébatsactuelssurlephénomènepionnieragro-céramisteantillais.
Lestravauxquenousavonsconduitsdepuisunedizained’annéesenMartiniquepuis en Dominique (fig.1) avaient pour objectif d’aborder un certain nombre deces questions. Il s’agissait d’évaluer les mécanismes socioéconomiques liés à cephénomènepionnieretdetenterd’aborderlanotiondeterritoireafind’êtreàmêmede discuter des liens ayant existé entre les différentes composantes de l’ensembleculturel,fruitdecettemigration.
La Martinique 1
NosrecherchesenMartiniqueontdébutéen1996aveclafouilleprogramméedusitedeVivésousladirectiondeJ.-P.Giraud,alorsconservateurrégionaldel’archéologie.Ellessesontpoursuiviesjusqu’en2003avecentreautres,en1999,dessondagessurlessitesdeMoulinl’ÉtangetFond-Brûlé(fig.1).CesgisementssontbienconservéssousunecouchederetombéesvolcaniquesduesàuneéruptiondelamontagnePeléedatéedelafinduivesiècledenotreère.LesitedeVivésedistinguetoutparticuliè-rementauseindecetensembleparsonabandonprécipitéaudébutdel’éruption.Iloffreainsiàlafouilleuninstantanéuniquedelavied’unvillageamérindiendelafindelapremièrephasedel’occupationagro-céramistedel’ArcAntillais(fig.2).
Nos travaux ont porté principalement sur la datation de l’occupation, lemodedegestiondel’espaceinsulairemartiniquaisetl’analysedelaproductionartisanale(céramique,outillagelithiqueetparure).Lagrandeaciditédessédimentsvolcaniquesn’ayantpaspermis laconservationdes restesosseuxetconchyliens,aucuneétudeconcernantl’exploitationdesressourcesanimalesn’apuêtreréalisée.
L’ensembledesoccupationsagro-céramistesanciennesenMartiniqueestassociéau Saladoïde cedrosan ancien. Aucun site saladoïde huecan n’a été identifié aucours de nos travaux. Ces occupations ont fait l’objet d’un important programme
Le phénomène pionnier agro-céramiste antillaisVers une vision archipélique
Benoît Bérard*
* Maître de conférences, Université des Antilles et de la Guyane, EA 929 « Archéologie industrielle, histoire et patrimoine de la Caraïbe », membre associé de l’UmR 8096 du CnRs « Archéologie des Amériques », chef de la mission archéologique Sud-Dominique du ministère des Affaires étrangères, [email protected].
1. Pour une présentation détaillée de l’ensemble des travaux concernant la Martinique voir Bérard 2004.
Benoît Bérard | Le phénomène pionnier agro-céramiste antillais
Les Nouvelles de l’archéologie n° 108-109 – Juillet 2007 71
Fig. 1 – Localisation des différents sites cités dans le texte.
Dossier A rc h é o l o g i e d a n s l e s d é p a r t e m e n t s f ra n ç a i s d ' A m é r i q u e
72 Les Nouvelles de l’archéologie n° 108-109 – Juillet 2007
de datation radiocarbone. Nous disposons ainsi d’une sériede29dates (2714Cet2TL).Ellesnouspermettentde situerl’occupation saladoïde cedrosane ancienne de l’île au toutdébutdenotreère,sil’onneprendencomptequelesdata-tionsrécentes(datecalibréelaplusancienneBeta-19906510-150apr.J.-C.),etdelafaireremonterdequelquessièclesenarrièresil’onprendencompteunesériededatationsréaliséesdanslesannées1970pourl’occupationdusitedeFond-Brûlé.Ainsi,laMartiniquecorresponddecepointdevueauxdata-tionsobtenuesdansl’ensembledesAntillespourlespremièresoccupationsagro-céramistes.
D’un point de vue géographique, les sites saladoïdescedrosananciensdeMartinique témoignentd’une étonnanteconcentrationspatialesurunetrentainedekilomètresaunorddelacôteatlantiquedel’île(fig.1).Cettelocalisation,parfoismise en relation avec la direction éventuelle dumouvementmigratoire,sembleplutôtêtreliéeàlarecherchedeconditionsenvironnementalesparticulières.Eneffet,cesecteurestcarac-térisépardebonnesterresagricolesdontl’irrigationestassuréeparunefortepluviométrieliéeàlaproximitédelamontagnePelée, par un couvert végétal mésophile et par la proximitéde la grande forêt humide. Enfin, l’ensemble des gisementssetrouveprèsd’unerivièrepérenneetprochedelamer,sansêtredirectementsurlerivage.Cescritèresquisemblentavoirprésidéauchoixdes lieuxd’installationdesvillagesdoiventtrèsvraisemblablementêtremisenrelationaveclefaitqu’uncertainnombred’îlesbasses,etdoncplussèchesont,elles,étéexcluesdecepremiermouvementmigratoire.
Les informations dont nous disposons sont troplimitées pour tirer une quelconque conclusion surl’organisation interne de ces villages. Cependant, ilssemblentavoirétéaucœurd’unsystèmecentralisédegestiondel’espace.Eneffet, l’ensembledesactivitésde transformationetdeconsommationsembles’êtredéroulédansleurenceinte.Celanousestmontréparl’absence de sites spécialisés correspondant à cettephasechronologiqueetparlemoded’introductiondesmatières premières lithiquesqui,malgréuneorigineparfoislointaine,arriventbrutesdedébitage.
Le fait que ces sites soient constitués par unesuccessiond’occupations légèrement décalées dans le tempset parfois dans l’espace doit vraisemblablement êtremis enrelationavecunemobilitédesvillages,dueàlapratiqued’uneagricultureitinérantesurbrûlis.
Ces éléments – choix rigoureux des lieux d’installation,gestion centralisée des activités, circuit de déplacementdes villages – sont complétés par l’introduction d’espècesanimalesetvégétalesoriginairesducontinent.Cetensemblesembleconstituerunesortedemodèleéconomiquesurlequels’estfondélephénomènepionnieragro-céramisteantillais.
C’est l’analyse de la céramique qui a servi de base à ladéfinition de l’ensemble saladoïde cedrosan ancien. C’estelle qui a permis aussi d’identifier l’origine continentale decesgroupes.Ils’agitd’uneproductiontoutàfaitexception-nelle,caractériséeparunetrèsgrandequalitétechniqueainsiqueparunegranderichessedesformesetdesdécors(fig.3)associantpeinturepolychrome,modelage,incisionetgravure(prèsde40%des tessonssontporteursd’undécordans lessériesmartiniquaises).
L’intérêt et le caractère exceptionnels des collectionsmartiniquaisesestliéaufaitquenousavonspureconstituerune série de plus de trois centsformes archéologiquementcomplètes.Ilnousaainsiétépossiblederéaliserlapremièretypologiemorpho-décorativedesrécipientscompletspourcetensemble culturel. Au cours de cette analyse, il est apparuque la grande diversité de l’expression céramique saladoïdecedrosaneanciennen’étaitenaucuncasliéeàl’existenced’undegré de liberté important laissé aux artisans potiers mais
Fig. 2 – Site de Vivé, zone 1, couche 3 décapage 1.
Ci-contre : Fig. 3 – Site de Vivé, zone 1 : exemple de production céramique.
Benoît Bérard | Le phénomène pionnier agro-céramiste antillais
Les Nouvelles de l’archéologie n° 108-109 – Juillet 2007 7�
Dossier A rc h é o l o g i e d a n s l e s d é p a r t e m e n t s f ra n ç a i s d ' A m é r i q u e
7� Les Nouvelles de l’archéologie n° 108-109 – Juillet 2007
bien, au contraire, à l’application rigoureuse d’un systèmecomplexe. En effet, chez les groupes saladoïdes cedrosansanciens,lacéramiquesembleavoirfaitl’objetd’unsurinves-tissement technique et symbolique témoignant de la hautevaleursocialeaccordéeàcetteproduction.
L’industrie lithique offre un contraste saisissant parrapport à la céramique en ce qui concerne l’investissementtechnique.Ainsi,l’outillagepoli(haches,meules,molettes)etlesoutilsdepercussion(percuteurs,marteleurs,enclume)sontpeu caractéristiques et appartiennent à un fonds communguyano-amazonico-antillais.
Demême,lesrestesdedébitagescorrespondentàdeschaînesopératoires relativementsimplesdont laprincipaleoriginalitéestl’utilisationdelapercussionposéesurenclume,entreautrespourlaproductiondetoutpetitséclatstrèsvraisemblablementdestinésàêtretransformésendentsderâpesàmanioc.
Laforteexpressiondanslaculturematérielledel’identitésaladoïde cedrosane ancienne se retrouve en revanche danslesélémentsdeparure(fig.4).Ilssont,commelacéramique,le fruit de l’expression rigoureuse d’une norme culturelleperceptible dans la relation qui peut exister entre la naturedesmatièrespremièresutiliséesetletypedeparuresréalisées.De plus, la valeur accordée à ces éléments estmarquée parl’origineparfoistrèslointainedesmatièrespremièresutilisées(continent,GrandesAntilles,autresîlesdesPetitesAntilles).
Ainsi, les premiers groupes agro-céramistesmartiniquaissont caractérisés par un système économique prédéterminéassocié à la matérialisation, omniprésente et très contrôlée,deleuruniversmagico-religieuxdansleurculturematérielle,tout particulièrement dans la céramique et dans la parure.Ces deux éléments pourraient faire partie des conditionsnécessaires au développement et à la réussite d’un phéno-mènepionnieragro-céramiste.Ontrouveainsideséchosdecette réalité dans le phénomène Lapita en Mélanésie et enPolynésieoccidentale(Sand1996),voiredansl’extensiondesculturesrubanéesenEurope,pourlesquelleslagrandemaisondanubienne constitue à la fois l’expression d’une identitéculturelleetlamatérialisationlaplusévidentedeleursystèmeéconomique(Coudart1998).
On le voit, les travaux que nous avons menés enMartiniqueontaboutià laconstructiond’outilsconceptuelsimportants.Cependant,pourletraitementd’uncertainnombredequestionsrelativesàlaconstitutioninternedel’ensemblecéramiqueancienantillaisoumêmeàlanotiondeterritoireculturel et/ou économique, nous nous sommes rapidementheurtésauxlimitesinhérentesàl’approcheinsulaire.Lamiseenévidencedel’importancedeséchangesinter-insulairesnepouvaitquenousinciteràtenterdefaireéclatercecadretroprestreint.
Vers une vision archipélique
En effet, malgré quelques frémissements (Watters et Rouse1989), l’archéologieprécolombiennedanslesPetitesAntillesest essentiellement construite selon une approche que l’onpourrait caractériser de «terrestre» et fondée sur la notiond’île.Cephénomèneaétéamplifiépar la situationgéopoli-tiqueetlinguistiquepost-colonialequiatropsouventincitéleschercheursànetravaillerquedansuneseuleîleou,danslemeilleurdescas,dansdifférentesîlesàlasuitemaissansdévelopperd’approcheglobale.C’estafinderompreaveccettelogiquequenousavonsentaméunprogrammederechercheàlaDominique.
La mission archéologique Sud-Dominique du ministèrefrançais desAffaires étrangères a vu le jour en 2005. Fruitd’une collaboration internationale entre des chercheurs del’université des Antilles et de la Guyane, de l’University ofthe West Indies, de Florida University et de l’University ofVermont, elle prolonge directement les travaux que nousavons menés en Martinique entre 1996 et 2003. En effet,l’ensemble des occupations agro-céramistes anciennes de laMartiniqueestlocalisédanslequartnord-estdel’île,faceàlaDominique, quin’en est séparée quepar unbras demer(le canal de laDominique) d’une quarantaine de kilomètresdelarge.Bienquecetespacefûtquasimentviergeenmatièrede recherche archéologique (Honnychurch 2001), quelquesprospections réalisées dans les années1970 avaient mis enévidence l’existence de sites saladoïdes cedrosans anciensdans le Sud de l’île, face aux sites martiniquais contempo-rains: sites de Soufrière, de Canefield et de Pointe Michel(PetitjeanRoget1978).Notreobjectifétaitdoncdedévelopperunprogrammederecherchecompletconcernantcesoccupa-tionssurlesmêmesbasesquecequenousavionsréaliséenMartinique.
Ceprogrammedevaits’appuyertoutd’abordsurd’impor-tants travauxde terrain, avecaumoins la fouille extensived’ungisement, laréalisationdesondagesdansd’autressitescontemporainsetlaconduited’uneprospectionsystématiquedanslazonegéographiquequinousintéressait.Laréalisationd’une vaste fouille en aire ouverte devait nous permettred’obtenir les éléments nécessaires à la compréhension del’organisationdesactivitésauseindesvillagesdecesgroupespionniersagro-céramistes,etsupporteruneétudecomparativeaveclesdonnéesissuesdelafouilledessitescontemporainsde Vivé (Martinique), Trants (Monserrat) (Heckenberger etPetersen 1998) et Hope Estate (Saint-Martin). De plus, elle
Fig. 4 – Site de Vivé, zone 1 : éléments de parure.
Benoît Bérard | Le phénomène pionnier agro-céramiste antillais
Les Nouvelles de l’archéologie n° 108-109 – Juillet 2007 7�
devait nous offrir lematériel nécessaire à la caractérisationculturelle précise de ces populations sur la base d’ana-lyses typo-technologiquesmaisaussi iconographiques.Noussouhaitionsainsitesterlesoutilsconceptuelsquenousavionsdéveloppés à partir de l’étude des sites martiniquais. Leprogrammedesondagesetlaprospectionavaitpourobjectifde réaliser une étude micro-régionale (intra-insulaire) desgisements liés à cette phase chronologique. Nous espérionsainsidégagerlescritèresprésidantauchoixdulieud’implan-tationdesvillages ainsi que lemodedegestionde l’espaceinsulaire dominiquais choisi par ces groupes. Enfin, l’étudede l’origine desmatières premières lithiques exogènes, dontlaprésencenombreuseestcaractéristiquedessitessaladoïdesanciens,devaitnouspermettredereplacercetensembledomi-niquaisauseindel’espacecaraïbe.
L’objectif final de nos recherches était de discuter de lanaturedesmécanismeséconomiquesetsociauxàl’origineduphénomènepionnieragro-céramisteauseindel’ArcAntillais,etdenousinterrogersurlastructureinterneduvasteensembleculturelissudecettemigration,notreambitionétantd’aboutir,entreautres,àunerévisiondelanotionde«complexe»,quiest l’unité chrono-géographique minimale «traditionnelle-ment» utilisée dans l’archéologie antillaise. Jusqu’à présent,cesunitéssontétroitementcorréléesàchaqueîledesPetitesAntillessansquecettehypothèseaitjamaisfaitl’objetd’uneréelle validation. Par la redéfinition d’ensemble culturelsintégrantdesespacesmaritimes,nousespérionspouvoirréin-tégrer l’occupation agro-céramiste ancienne antillaise dansuncadregéographiqueauseinduquell’élémentmaritimeneconstitueraitplusunefrontièremaisunlien.
Depuis2005,deuxcampagnesdeterrainontétéconduitesparlamissionarchéologiqueSud-Dominique(latroisièmesedérouleraenjuillet2007).Nostravauxsesontconcentréssurla prospection systématique du Sud de l’île et la fouille dusitedeSoufrière.
Dans la zoneprospectée,oùonzegisements étaientdéjàconnus, cinqnouveaux sitesont étédécouverts.Cet échan-tillonnous a servi de support pour une étude paléogéogra-phique préliminaire des sites saladoïdes cedrosans anciens.Ils sont au nombre de cinq (fig.1) auxquels il faut ajouterun indice d’occupation ancienne dans un gisement ayantfait l’objet d’une occupation tardive plus intense ou mieuxconservée (site de Pointe Mulâtre). Différents éléments ontété pris en compte pour caractériser leur environnement:distance par rapport à la mer et par rapport à une sourced’eaudoucepérenne,pluviométrie,natureducouvertvégétal,qualité des sols, position topographique. L’étude est encoreencours(notammentpourlanatureducouvertvégétal)maisquelques informations préliminaires peuvent être détaillées.L’ensemble des gisements se situent à proximité de la mer(moinsde400m)sanspourautantêtredirectementinstalléssurlerivage,etproches(moinsde200m)d’unesourced’eaudouce pérenne (rivière ou source). Du fait de son caractèremontagneux, la Dominique bénéficie sur toute sa super-ficie d’une pluviométrie importante et les sites saladoïdesanciens sontassociés àunepluviométrie annuellequivarieentre1270mmet3810mm;lecouvertvégétalestconstitué
d’un ensemble littoral sur les côtes et d’une forêt tropicalemésophile (sempervirente saisonnière tropicale) en allantvers l’intérieur des terres. À l’exception du site douteux dePointeMulâtre,lesvillagessaladoïdescedrosansanciensontété installés surdes solsvolcaniques jeunes,essentiellementprésentsdansleSuddel’île.Ilscorrespondentauxterresagri-coleslesplusriches(Lang1967).L’ensembledecesdonnéesestparfaitementidentiqueauxrésultatsacquisenMartinique.La seule différence identifiée quant à l’occupation agro-céramisteanciennedecesdeuxîlestientàlaprésencedesites«d’altitude» en Dominique. En effet, Destouches se trouveà une centaine de mètres au-dessus du niveau de la mer.Il semble s’agir d’une caractéristique propre à l’occupationamérindienne de la Dominique, où d’autres gisements plustardifsontétédécouvertsàplusde200md’altitude.Celaesttrèsvraisemblablementliéàl’extrêmeétroitessedelabandecôtière.Enfin,alorsqu’avantnostravauxleNorddel’îleavaitfaitl’objetdeprospectionsarchéologiquesplusintensesqueleSud,aucunsitecéramiqueancienn’yaencoreétédécouvert.LeNorddel’îleestcaractériséparunclimatlégèrementplussec et surtout des terres agricoles de moins bonnes qualité(laprospectionde lazonenordde l’îleen juillet2007nouspermettradevérifiercetteinformation).
Le site de Soufrière (fig.1) a été découvert en 1975 lorsde travaux préparatoires à la réalisation d’un lotissement.En 1976, des sondages avaient livré une intéressante sériesaladoïdeancienne(PetitjeanRoget1978).Nousavonsreprisl’étudedecegisementen2005.SituésurlepiedmontnordduMornePatate,ilestaujourd’huirecouvertdanssaplusgrandepartieparlevillageactueldeSoufrière.Ilnousacependantétépossibled’intervenirdansuncertainnombredeparcellesencorenonloties.Lesiteaainsiétéfouillésurunevingtainedemètres carrés. Il a livré les restesd’uneoccupation sala-doïde cedrosane ancienne datée de 1800±40BP, soit entre120et 340apr.J.-C. (Beta-211896). Elle est couverte paruneépaissecouchededépôtsvolcaniques (ignimbrite)datéedu viesiècle (Lindsay et al. 2005). La surface explorée estbienentendutroplimitéepourquedesinformationsd’ordrespatialpuissentêtredégagées.Cependant,l’analysestratigra-phiquesembledémontrerquelesiteafaitl’objetd’aumoinsdeuxoccupationssuccessivesrattachéesàlaphasesaladoïdeancienne. Le programme de datation nous permettra de lescalerchronologiquement(ladateprésentéeplushautcorres-pondauniveaud’occupationleplustardif).Nousnousretrou-vonsdonccommeenMartiniquefaceàunsiteàoccupationsmultiples.
Par ailleurs, nous avons rassemblé une série céramiquedeprèsde3000pièces.Sonétuden’estpasencoreachevée,mais les résultatspréliminaires témoignentd’une incroyablesimilitude entre cette collection et les séries martiniquaisescontemporaines, tant au niveau des formes et des modulesdes récipients, qu’au niveau des caractères technologiqueset iconographiques (fig.5). Cette grande proximité entre lesexpressions céramiques saladoïdes cedrosanes anciennesmartiniquaisesetdominiquaisesestconfirméeparl’étudedessériesissuesdessondagespluslimités,réalisésdanscertainssites(Geneva)etparl’étudedesériesanciennes(Canefield).
Dossier A rc h é o l o g i e d a n s l e s d é p a r t e m e n t s f ra n ç a i s d ' A m é r i q u e
7� Les Nouvelles de l’archéologie n° 108-109 – Juillet 2007
0 5 cm
a.
b.
Fig. 5 – Exemple de similarité entre la production céramique des sites saladoïdes cedrosans anciens de : a) Vivé (Martinique), b) Soufrière (Dominique).
Benoît Bérard | Le phénomène pionnier agro-céramiste antillais
Les Nouvelles de l’archéologie n° 108-109 – Juillet 2007 77
Enfin, la présence de silex provenant de l’île d’Antiguaainsiqued’uneperlediorite(rocheexogèneàlaDominique)dans les séries dominiquaises témoigne une fois de plusde l’intensité des relations ayant existé entre les différentsgroupes agro-céramistes anciens dispersés au sein de l’ar-chipelantillais.
Lanotionde complexea étédéveloppéepar I.Rouse, lepère de l’archéologie antillaise (Rouse, Allaire et Boomert1985poursadernièreversion).Uncomplexeregroupeainsidesensemblesayantdescaractéristiquesvéritablementiden-tiquesetappartenantàunespacegéographiqueréduit(parfoisunseulsite).Ilestdéfiniparquelquestraitsculturelsquisontcensés permettre d’identifier un groupe humain particulier.Dans les PetitesAntilles, pour chaque phase chronologique,un complexe a été défini dans chacune des îles (contrai-rement aux Grandes Antilles où I.Rouse a insisté sur lesliensexistantentre lesgroupes localisésdechaquecôtédescanauxséparantlesîlesettoutparticulièremententrel’Ouestd’Hispaniolaetl’EstdePortoRico).Celalaissesous-entendreque les canaux étroits séparant les îles constituaient desfrontièresgéographiquesetculturelles.Lestravauxquenousmenonsdepuisunedizained’annéesdesdeuxcôtésducanalde laDominique tendentàdémontrer le contraire.Même silesétudesnesontpasencoreachevées,elles indiquentpourl’instant une parfaite similarité des expressions saladoïdescedrosanesanciennesdansleNorddelaMartiniqueetdansleSuddelaDominique.Cetteconstatation,associéeàlamiseenévidencedelapratiqued’uneagricultureitinérantesurbrûlis,laissesupposerquecetespaceapuêtrefréquentéparlemêmegroupehumain,lecanaldelaDominiquefaisantpartieinté-granteduterritoiredecegroupe.Cependant,si laréalitédelaparentéexistantentrelessitesmartiniquaisetdominiquaisne semble pas devoir être remise en question, l’individuali-sationdecetensemblenécessiteradanslesannéesàvenirlapoursuitedenosrecherchesdansd’autresîlesdel’archipeletentoutpremierlieuenGuadeloupeetSainte-Lucie.Cetravailnous permettra de distinguer ce qui appartient à un fondscommunculturelliéàlaphaseagro-céramisteanciennedanslesAntilles (et donc caractéristique du phénomène pionnierquiluiestassocié)decequirelèvedel’identitéd’ungroupehumainparticulier.C’esttrèsvraisemblablementparcettevoiequepourraaussiêtre résolu le longdébatquianimedepuistrente ans l’archéologie antillaise concernant les relationsayant pu exister entre les deux ensembles agro-céramistesanciens(SaladoïdecedrosanancienetSaladoïdehuecan).
On le voit face aux questions complexes que se posentaujourd’hui les archéologues de la Caraïbe, une approchegéographiquelargefaisantéclaterlecadreinsulaireestseuleàmêmedenousapporterlesréponsesquenousrecherchons.
L’archéologie antillaise, et tout particulièrement dans lesdépartements français d’Amérique, a connu au cours desvingt dernières années un très fort développement lié à denombreux facteurs (développement de l’archéologie préven-tive, intervention d’équipes universitaires européennes etnord-américaines, rôle des Sra,etc.). L’un d’entre eux estspécifiquement lié à la situation sociale dans les Antilles.
En effet, l’histoire pour le moins douloureuse des Antilles(extermination quasi totale des populations amérindiennes,esclavage,colonisation)faitquelesquestionsidentitairessontaucœurdesdébats.Onaainsiassistéaucoursdescinquantedernières années à une évolution rapide de la conceptionidentitaire aux Antilles depuis un modèle colonial assimi-lationniste à la construction contemporaine d’une identitéspécifiquementantillaise(créole)enpassantparlaremiseenvaleurderacinesafricainesàlafaveurdumouvementdelanégritudeaucoursdesannées1960.
De ce fait, beaucoupde travauxarchéologiques (histori-ques comme précolombiens) ont un intérêt et un écho toutparticulierspourlespopulationsantillaises(c’estcetteréalitéqui a largement favorisé la création d’un poste de maîtrede conférences en archéologie antillaise à l’université desAntillesetdelaGuyane).Lesrecherchesquenousavonsiciprésentéesnesontpasdétachéesdececontexteparticulier.Iln’estguèreétonnantquedestravauxportantsurl’importancedes relations inter-insulairesdans laCaraïbe sedéveloppentalorsquelespopulationsantillaisestententdeconstruireouplutôt de reconnaître leur identité commune. Le développe-mentd’uneperspectivearchipéliqueet ladécouvertedufaitque,pourlespopulationsamérindiennes,lesAntillesconsti-tuaientunespacegéographiqueunifiénepeuventque fairel’objet d’un intérêt particulier dans une région qui tente dese construire une histoire et une identité autocentrée alorsqueOrlyouHeathrowsontencorebientropsouventperçuscommesesplusprochesvoisins.
Bibliographie
bérArD, B. 2004. Les premières occupations agricoles de l’Arc Antillais, Migrations et insularité. Oxford, Archaeopress (British Archaeological Reports, International serie 1299, Paris monographs in american archaeology 15, E. Taladoire ed.), 214 p., 140 fig., 38 tabl.
couDArt, A. 1998. Architecture et sociétés néolithiques : l’unité et la variance de la maison danubienne. Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme (DAf 67), 242 p.
hecKenberger, M. et J. petersen. 1998. « Concentric Circular Village Patterns in the Caribbean : Comparisons from Amazonia », in : Actes du Seizième congrès International d’Archéologie de la Caraïbe, Basse-Terre, 24-28 juillet 1995. Basse Terre, vol. 2 : 379-390.
honnychurch, L. 2001. The Ecology and Archaeology of Dominica in relation to the Lesser Antilles. Roseau, The Dominica Institute, 22 p., 8 fig.
lAng, D. M. 1967. Soils and Land Use Surveys. Trinidad, University of the West Indies (Soil Survey 21), 59 p., 2 cartes.
linDsAy, J. M., A. L. smith, M. J. roobol et M. V. stAsiuK. 2005. « Dominica », in : J. M. linDsAy, R. E. A. robertson, J. B. shepherD et S. Ali (ed.), Volcanic Hazard Atlas of the Lesser Antilles. Trinidad et Tobago, Seismic Research Unit, The University of the West Indies : 1-48.
petitjeAn roget, H. 1978. « Reconnaissance archéologique à l’île de la Dominique (West Indies) », in : J. benoist et F. M. Meyer (dir.), Compte-rendu des communications du septième congrès international d’études des civilisations précolombiennes des Petites Antilles, 11-16 juillet 1977, Universidad Central de Venzuela, Caracas. Montréal, Centre de recherches caraïbes de l’université de Montréal : 81-97.
Dossier A rc h é o l o g i e d e s d é p a r t e m e n t s f ra n ç a i s d ' A m é r i q u e
78 Les Nouvelles de l’archéologie n° 108-109 – Juillet 2007
rouse, I., L. AllAire et A. boomert. 1985. « Eastern Venezuela, the Guianas and the West Indies », in : W. meighAn clement (ed.) Chronologies in South Américan Archaeology. New Haven, Yale University, Department of Anthropology. [Manuscrit préparé pour un ouvrage non publié.]
sAnD, C. avec la participation de J. bolé et A. ouetcho. 1996. Le début du peuplement austronésien de la Nouvelle-Calédonie. Données
archéologiques récentes. Nouméa, Département archéologie, Service territorial des musées et du patrimoine (Les Cahiers de l’archéologie en Nouvelle-Calédonie, vol. 6), 162 p.
WAtters, D. et I. Rouse. 1989. « Environmental Diversity and Maritime Adaptations in the Caribbean Area », in : P. E. siegel (ed.), Early Ceramic Populations Lifeways and Adaptive Strategies in the Caribeean. Oxford, BAR International Series 506 : 129-144.
L’économie des sociétés précolombiennes des Petites AntillesContribution des données sur l’exploitation des invertébrés marins et terrestres
Nathalie Serrand*
L’archéologieantillaiseaaccordétrèstôtdel’importanceauxvestigesfauniques.Dès les années1940, Rainey à Porto Rico (1940) signalait des variations dans
desensemblesdefauneassociésàdeuxassemblagescéramiquesrapportés,depuis,àdeuxphasesdelapériodecéramique.Cesobservations,bienqueschématiques–lafameusedichotomieCrab / Shell Cultures(Goodwin1980;Keegan1989)–,promou-vaientlestémoinsdesubsistanceaurangdevestigesmajeurspourlacompréhensiondel’histoiredessociétésprécolombiennesantillaises.Lamultiplicationdesanalysesarchéozoologiquesàpartirdesannées1960,combinéeàl’affinementdesséquenceschrono-culturelles (Rouse1952a, b, 1986) lesmit ensuiteaucentredesdébats surl’évolution de ces sociétés et leur adaptation aux espaces insulaires antillais. Lesdivers modèles interprétatifs proposés s’appuyaient sur des facteurs tant d’ordrepaléo-environnemental (Carbone 1980) que théoriques économiques, démographi-quesetculturels (Goodwin1980; Jones1985;Levin1983;Keegan1989). Ils sontdepuisunedizained’annéesredessinésàlafaveurdel’accroissementdesfouillesetdesdonnées,descollaborationsinterinstitutionnellesetdeséchangesinternationaux,etdel’harmonisationdesanalysesdefaunequipermettentunemeilleureconfron-tationdesobservations(WingetWing1995;DeFrance,KeeganetNewsom1996;Petersen1997;Grouard2001;Wing2001;Serrand2002;NewsometWing2004).Ledéveloppementde l’archéologiedans lesdépartementsd’outre-mer (DOM)participeconsidérablementàcetenrichissementdesdonnées.Lesacquisrécentssurlamanièredont les sociétés précolombiennes ont exploité et géré les espaces et ressourcesnaturelsantillaisfavorisentlerenouvellementdesproblématiquessurcespratiquessocioéconomiques.
Les invertébrés marins et terrestres : une ressource à multiples valences
Parmi lepanelde ressourcesnaturellesexploitéespar lessociétésprécolombiennesantillaises,lesinvertébrésmarinsetterrestres(essentiellementmollusques,crustacésetéchinodermes)ontjouéunrôlenotabletantdupointdevuedelasubsistancequedeceluidesproductionsartisanales.Ilétaitrenforcéparlefaitquelesîles,enparticu-lierdesPetitesAntilles(fig.1),secaractérisaientparunefauneterrestre,notammentmammalienne, peudiversifiée, vulnérable et dépourvuede taxons de grande taille–rongeurs,oiseaux,reptilesetcrustacés(Wing2001)–etparunerépartitiondispa-ratedesmatièrespremièresdures–desgîtesdesilexnesontattestésquesurtroisîles(Knippenberg2006).Lesinvertébrésétaientdoncintégrésàpartentièredansdeséconomiescombinantparailleurslachasse,lapêche,lacollecteetlamaintenancederessourcesanimales,végétalesetminérales,terrestresetmarines,localesmaiségale-
* UmR 5197-cnRs, Muséum national d’histoire naturelle, département Écologie et gestion de la biodiversité, archéozoologie, histoire des sociétés humaines et des peuplements animaux, [email protected].