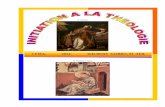THEOLOGIES CONTEXTUELLES: THEOLOGIE DE LIBERATION & THEOLOGIE FEMINISTE, 2013 DR. WILBERT GOBBO
Transcript of THEOLOGIES CONTEXTUELLES: THEOLOGIE DE LIBERATION & THEOLOGIE FEMINISTE, 2013 DR. WILBERT GOBBO
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 1
St.
CFMA, 2013 WILBERT GOBBO, M. AFR.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 2
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION GENERALE ............................................................................................................. 4
1 THEOLOGIES CONTEXTUELLES ................................................................................................... 4
1.1 ORIGINE DE THEOLOGIES CONTEXTUELLES ................................................................................. 4
1.2 THEOLOGIES CONTEXTUELLES ET LES VALEURS HUMAINES ................................................... 6
1.2.1 LE DILLEME IMMANENCE/TRANSCENDANCE .............................................................................................. 7
1.2.2 LE DILEMME CONTINUITE/CHANGEMENT ................................................................................................... 7
1.2.3 LE DILEMME UNITE/DIVERSITE ....................................................................................................................... 7
1.2.4 LE DILEMME AUTORITE/LIBERTE ................................................................................................................... 7
1.3 DIFFERENTES THEOLOGIES CONTEXTUELLES .............................................................................. 8
1.3.1 LA THEOLOGIE DE LA LIBERATION (D’AMERIQUE LATINE) ................................................................... 8
1.3.2 LA THEOLOGIE FEMINISTE ............................................................................................................................... 8
1.3.3 LA THEOLOGIE AFRICAINE ............................................................................................................................... 8
1.3.4 LA THEOLOGIE D’INCULTURATION ................................................................................................................ 8
1.3.5 LA THEOLOGIE DU MINISTERE DE LA COLLABORATION ......................................................................... 8
1.3.6 LA THEOLOGIE DES RELIGIONS ...................................................................................................................... 8
1.3.7 LA THEOLOGIE ASIATIQUE ............................................................................................................................... 8
2 THEOLOGIE DE LIBERATION ........................................................................................................ 8
2.1 THEOLOGIE DE LIBERATION : ORIGINE, METHODE ET CRITIQUE ............................................ 9
2.1.1 ORIGINE ................................................................................................................................................................. 9
2.1.2 METHODE THEOLOGIQUE ............................................................................................................................... 10
2.1.3 CRITIQUE THEOLOGIQUE ................................................................................................................................ 11
2.2 DIFFERENTS THEOLOGIENS DE LIBERATION ............................................................................... 11
2.2.1 EXPOSE 1 : DIEU OU L’OR DES INDES OCCIDENTALE PAR GUSTAVO GUTIERREZ ........................... 11
2.2.2 EXPOSE 2 : EGLISE, CHARISME ET POUVOIR PAR LEONARDO BOFF ................................................... 16
2.2.3 EXPOSE 3 :ÉVANGILE ET PRAXIS DE LA LIBÉRATION PAR GUSTAVO GUTIERREZ ET THEOLOGIE
ET SCIENCES SOCIALES PAR JON LOUIS SEGUNDO ............................................................................................. 23
2.2.4 EXPOSE 4 : JESUS CHRIST EN AMERIQUE LATINE : SA SIGNIFICATION POUR LA FOI ET LA
CHRISTOLOGIE PAR JON SOBRINO .............................................................................................................................. 29
2.2.5 EXPOSE 5 : LA NOICEUR DE DIEU PAR JAMES H. CONE ............................................................................... 34
2.2.6 EXPOSE 6 : LE CHRIST NOIR AMERICAIN PAR BRUNO CHENU .................................................................. 40
2.2.7 EXPOSE 7: POURQUOI LA THEOLOGIE DE LA LIBERATION ? PAR RENE MARLE, MARIO
CALDERON ET GUY PETITDEMANGE .......................................................................................................................... 46
2.2.8 EXPOSE 8 : LIBRES PAROLES D’UN THEOLOGIEN RWANDAIS : JOYEUX PROPOS DE BONNE
PUISSANCE PAR NTEZIMANA LAURIEN ..................................................................................................................... 52
3 THEOLOGIE FEMINISTE .............................................................................................................. 57
3.1 LA MISOGYNIE ET L’ORIGINE DE LA THEOLOGIE FEMINISTE ................................................. 58
3.1.1. LA MISOGYNIE DANS LA BIBLE ET DANS LA TRADITION CHRETIENNE ............................................... 58
3.1.2 FEMINISME ET ANTIFEMINISME DANS LA TRADITION DE L’EGLISE ..................................................... 59
3.1.3 L’ORIGINE DE LA THEOLOGIE FEMINISTE ...................................................................................................... 60
3.2 DIFFERENTES THEOLOGIENNES FEMINISTES .............................................................................. 67
3.2.1 EXPOSE I : EN MEMOIRE D’ELLE : ESSAI DE RECONSTRUCTION DES ORIGINES CHRETIENNES
SELON LA THEOLOGIE FEMINISTE PAR ELIZABETH SCHUSSLER FIORENZA.............................................. 67
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 3
3.2.2 EXPOSE 2 BRISER LE SILENCE DEVENIR VISIBLES PAR E. S. FIORENZA ET L’HISTOIRE DE LA
CLÔTURE DANS LA VIE DES RELIGIEUSES PAR MARGARET BRENNAN ......................................................... 73
3.2.3 EXPOSE 3 : LES THEOLOGIES FEMINISTES DANS UN CONTEXTE MONDIAL PAR ELIZABETH
SCHUSSLER FIORENZA ET LES FEMMES POUR LA PRETRISE DANS L’EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
PAR TERESIA MBARI HINGA ........................................................................................................................................... 79
3.2.4 EXPOSE 4: DIFFERENCE ET EGALITE DE DROITS DES FEMMES DANS L’EGLISE ................................ 84
PAR ROSEMARY RADFORD RUETHER ET LA MASCULINITE DU CHRIST PAR ELIZABETH JOHNSON .. 84
3.2.5 EXPOSE 5 : ALICE DERMIENCE, « FEMMES ET MINISTERES DANS L’EGLISE PRIMITIVE » ET
JANINE HUARCADE, « DANS LA TRADITION ET AUJOURD’HUI » ....................................................................... 89
3.2.6 EXPOSE 6 : L’EGLISE EST-ELLE MISOGYNE ? PAR JANINE HOURCADE ................................................. 95
3.2.7 EXPOSE 7 : LA PAUVRETE ET LA MATERNITE PAR MARY AMBA UDUYOYE AND DIEU-MERE PAR
SALLIE MACFAGUE ......................................................................................................................................................... 101
3.2.8 EXPOSE 8 : L’APPAUVRISSEMENT ECONOMIQUE DES MERES EST L’ENRICHISSEMENT DES
PERES PAR HANNELORE SCHRÖDER ET L’OPTION POUR LE PAUVRE COMME OPTION POUR LA
FEMME PAR IVONE GEBARA ........................................................................................................................................ 107
CONCLUSION EN GENERALE ....................................................................................................... 112
BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................................. 113
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 4
INTRODUCTION GENERALE
La théologie chrétienne est-elle une ou multiple ? Si la théologie est un discours ‘de’ Dieu (c'est-à-dire que
Dieu est le sujet du discours) on peut parler d’une théologie. Si la théologie est un discours ‘sur’ Dieu (c'est-
à-dire que Dieu en est l’objet) on peut parler de plusieurs théologies. Si la théologie chrétienne est le
‘chemin’ ou bien ‘l’orientation’, les théologies contextuelles sont les ‘sentiers’ qui font que le ‘chemin’
devienne une réalité.
S. B. Bevans, dans son livre « Contextual Theology as a Theological Imperative », va plus loin. Il affirme
qu’il n’y a pas une chose comme la « théologie » ; il y a que des théologies contextuelles : théologie
féministe, théologie de la libération, théologie des Philippines, théologie asiatique, théologie américaine, etc.
Faire de la théologie contextuellement n’est pas une option.
Ce séminaire a un double objectif : approfondir notre connaissance des théologies contextuelles
(situationnelles) en générale, et plus spécialement de la théologie de la libération et de la théologie féministe.
Nous allons privilégier la méthode de Paulo Freire afin de favoriser une discussion participative, consciente
et active.
Paulo Freire (1921-1997) est un pédagogue basilien. Il a beaucoup travaillé pour l’alphabétisation des
adultes. Pour lui, l'éducation est un processus de conscientisation et de libération. Son magnum opus est
Pédagogie des opprimés où il expose ses idées relatives à l'alphabétisation, à l'éducation des adultes et
l'aspect politique de l'éducation. Il écrit, « « Personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque seul, les
hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. »
Il a beaucoup écrit, plus que trente livres et articles (cf. Paul Freire Institute (PFI), University of California,
Los Angeles). Parmi ses nombreux ouvrages, il y a : L'Éducation comme pratique de la liberté (1964) ;
Pédagogie des opprimés (1969) ; Education for Critical Consciousness,(1973) et La Pédagogie de
l'autonomie (1991) ; Il a reçu plusieurs distinctions : prix Roi-Baudoin (1980) ; prix UNESCO de
l'éducation pour la paix (1986) et prix Andrès-Bello de l'Organisation des États américains comme éducateur
du continent (1992).
Nous allons approfondir notre connaissance des théologies contextuelles en générales et de la théologie de
libération et la théologie féministe en particulière. Nous allons privilégier des exposés des écrits des
théologiens de libération et des théologiennes féministes.
1 THEOLOGIES CONTEXTUELLES
Toute théologie est contextuelle! C'est à dire que personne ne fait de la théologie en dehors
de sa culture, de son vécu, de sa langue et de son éducation. Autrement dit,
on ne peut pas sortir de son contexte! Est-il possible de faire la théologie dans un contexte d’autrui ?
Mais, on appelle théologie contextuelle, une théologie qui s'inscrit délibérément
dans un contexte donné sans prétendre à l'universalité.
Le point de départ de la théologie contextuelle est formé par les conditions résultant des réalités
sociopolitiques, religieuses, économiques et écologiques d'une société, qui constituent la réflexion en tant
que cadre de référence inévitable qui détermine la réflexion. La variété des points de référence du cadre de
vie mène à un pluralisme théologique. Au centre de la scène se trouvent les expériences de gens dont la
situation est déterminée par la pauvreté, la marginalisation et la discrimination.
1.1 ORIGINE DE THEOLOGIES CONTEXTUELLES
Questions Nature Genre/Sexe Classe Race/Cultur
e
Religion Eglise
QUOI ? Anthropocentr Sexisme : Classicisme Racisme, L’exclusivis Autoritaris
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 5
Critique de
la théologie
classique
(qui
n’adresse
pas les
nouvelles
situations et
les contextes
d’aujourd’hu
i)
isme
Destruction de
la terre.
Soumettez-la
terre :
destruction de
la couche
d’ozone,
érosion,
pollution,
destruction de
l’écosystème,
Besoin :
guérison de la
terre.
Misogynie,
patriarche,
androcentris
me,
« Kyriachie
» (E. S.
Fiorenza)
Oppression
des
femmes,
La majorité
qu’on a
faire taire.
Les
hommes
aussi sont
frustrés
dans le
processus.
Besoin :
l’équilibre
et la
libération.
Crises de
capitalisme
et
socialisme,
Pays
Pauvres
Très
endettés, La
misère ; Les
pauvres
deviennent
plus
pauvres ;
Les riches
deviennent
davantage
riche ;
« kyriarchie
» ;
privatisatio
n de
religion
Besoin :
distribution
équitable de
richesse.
Ethnocentri
sme, Âgisme Conflits
ethniques et
génocide,
préjugés et
discriminatio
n de
minorités,
conflits de
générations,
problèmes
des refugiés,
migration,
xehophobie,
« Kyriachie
»
Besoin :
justes
relations
parmi tous
les hommes.
me religieux
Guerre de
religions,
« Pas de paix
parmi les
nations sans
la paix parmi
les
religions »
(Hans Küng)
Besoin :
comprendre
et apprécier
la foi de
l’autre. Les
autres
régions
peuvent
conduire au
salut.
Ouverture et
inclusion
me
Un modèle
d’une Eglise
patriarcale,
pyramidale,
hiérarchique,
juridique,
cléricale.
Besoin : de
partager la
responsabilit
é (ministère
de la
collaboration
)
RESULTA
T
« Nouvelles
théologies »
Ecothéologies
(Eco -
Théologie
écologique
Théologie
féministe
Féminisme)
Théologie
Mujerista
Femme-
Théologie
Théologies
de
libération
Théologie
politique
Minjung
Théologie
(Korea)
Théologies
des races et
culture
Théologie
Asiatique,
Africaine,
noire,
Américaine.
Théologie de
Religions
Théologies
du pluralisme
religieux
Théologie du
ministère
partagé
Disciples des
égaux
Théologie de
CCB.
POURQUO
I ?
L’Evangile,
Le royaume
de Dieu
COMMUNION=(KOINΩNIA) ENTRE DIEU LA CREATION
Solidarité, mutualité, partenariat, dialogue, interdépendance, interpénétration,
interconnexion, joie, tolérance, paix, intégrité de création, amour, inclusion, justes relations,
la VIE
LE ROYAUME DE DIEU AVEC ET POUR TOUS
OBSTACL
ES
Les motifs de
profit : âge
nucléaire,
Militarisme, les
manipulations
génétiques,
désertification,
urbanisation
non-contrôlée,
industrialisatio
n, etc.
Mâle ego :
sens de
inadéquate,
la peur,
l’orgueil, la
solitude.
La psychè
femelle :
blessée par
l’oppression
,
Division
parmi les
pauvres, la
guerre,
analphabéti
sme,
acceptation
des
situations
de
l’oppression
Races et
cultures
divisées,
manque
d’éducation,
le sud divisé,
préjugés,
clichés,
humiliation à
travers les
lois
Le fanatisme
religieux, les
guerres,
fondamentali
sme,
l’orgueil,
Théologies
de
l’exclusivism
e religieux,
prosélytisme,
L’arrogance
male et
cléricale,
« kyriarchie
», manque de
la distinction
entre la foi et
l’idéologie,
cultes de
personnalité,
groupes
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 6
l’humiliatio
n, la
marginalisat
ion.
La
soumission
: le rôle de
genre
prescrit par
la société.
, les
humiliation
s et les
préjugés, le
Nord
néglige le
Sud,
L’Europe le
fort,
réfugié, les
lois
d’immigrati
ons
d’immigratio
n, conflits
ethnique et
génocide.
écclésiocentri
sme et le
triomphalism
e religieux.
néoconservat
eurs, négliger
le ministère
prophétique
dans l’Eglise.
COMMEN
T ?
« Herméneut
ique d’un
étranger » :
Comment
peut-on être
nourri par ce
qui est
étranger,
différent ?
Comment
acceptons-
nous les
autres dans
leur altérité ?
Interdépendanc
e et
interconnexion
de toute la
création :
Travailler pour
l’harmonie
entre les
humains et la
création non-
humaine, la
guérison de la
terre
contribuant à la
conscience que
l’homme fait
partie de la
nature, notre
survie dépend
de la survie de
la terre.
Histoire→
Elle aussi,
est son
histoire,
partenariat
et mutualité
entre les
femmes et
les
hommes,
les hommes
aussi ont
besoin être
libérés pour
leur survie,
ils doivent
découvrir la
dimension
féminine
dans leur
vie, les
mouvement
s de
libération,
redécouvrir
le corps,
redécouvrir
la
dimension
féminine de
Dieu
« Le
Pouvoir des
sans
pouvoir »,
Libération
des
opprimés et
opprimants,
la justice
sociale et la
démocratie,
les pauvres
découvrent
leur
potentialité
à changer
leur
situation, Ils
deviennent
des sujets
de leur
histoire,
transformati
on,
libération et
évangélisati
on, de la
non-
personne à
la personne.
Une
inculturation
et inter
culturation
authentique,
tolérance,
une
communauté
de
générations,
une justice
raciale et
muti-
culturalité,
lutter contre
la pauvreté
anthropologi
que, de la
non personne
à la
personne, Le
Nord doit
réaliser sa
position
culturelle
privilégié
d’être en
partenariat
avec le Sud.
Dialogue
inter-
religion,
dialogue de
la vie, la
tolérance,
inclusion,
éviter le
prosélytisme,
reconnaitre
les
différences
not comme
une menace
mais un défi
et une
richesse,
éviter un
vague
pluralisme
(toutes les
religions sont
pareilles),
ouverture
sans nier son
identité.
COLLEGIA
LITE
Subsidiarité,
coresponsabil
ité, les
responsables
d’écouter les
peuple,
« Ekklesialog
ie », dignité
des femmes,
développer la
communion,
mutualité à la
base et tous
les niveaux,
CCB,
Vocation des
laïcs (laos).
1.2 THEOLOGIES CONTEXTUELLES ET LES VALEURS HUMAINES1
DIFFERENTIA DIFFERENTIA INTERGRATION+DIFFERE INTERGRA INTERGRAT
1 Cf. Jane Collier et Rafael Esteban, From complicity to encounter: The Church and the culture of economisme, Christian
Mission and Modern Culture Series , London, Continuum, 1999.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 7
TION QUI
S’ENFUIT
TION NTIATION TION ION
FORCEE
EXCES VALEURS SYNERGIE (VALEUR PAR
EXCELLENCE-Agora
platonicienne)
VALEURS EXCES
PROGRESSIF CONSERVAT
EUR
Une résistance
violente à la
mission
Destruction des
systèmes
religieux
alternatifs
Local
Changement
(devenir)
Interdépendance
Libération
Global
continuité
Centralisation,
control de
mission comme
une
implantation
Complicité
avec le
colonialisme.
Acculturation
Schisme
Destruction de la
diversité
culturelle
Diversité
Inculturation Unité
universel
Universalisme,
Uniformité
Dissension
radicale
Exclusion dans
les décisions
Liberté Participation,
Ministère de la collaboration
Autorité Autoritarisme,
Cléricalisme
Un féminisme
radical
Marginalisation
des femmes
Féminin
Sentiment
Dignité humaine
Dignité des femmes
Masculin
Raison
Patriarchie,
Mâle
domination
OPPRIMES OPPRESSEUR
S
NB : Mutation des paradigmes (Métanoia) : De autorité (exousia) au service (diakonia).
1.2.1 LE DILLEME IMMANENCE/TRANSCENDANCE
D’une « religion du salut » à « une religion de structure », une religion qui est important dans les structures
de la vie quotidienne ?
Du salut vu comme l’au-delà au salut qui demande une transformation historique continue (l’au-deçà).
De la foi comme un « dépôt » à la foi comme une révélation continue.
1.2.2 LE DILEMME CONTINUITE/CHANGEMENT
Il faut lire les signes de temps
Une Eglise que prend au sérieux son contexte
1.2.3 LE DILEMME UNITE/DIVERSITE
D’une exclusion d’un peuple élu au signe du salut universel
De « extra ecclesiam nulla salus » au « extra mundum nulla salus »
Du Dieu de l’Eglise au Dieu de l’histoire ?
Du conquérir au partenariat et à la rencontre
1.2.4 LE DILEMME AUTORITE/LIBERTE
Du control clérical à la participation des laïcs.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 8
Du control monarchie à la collégialité
D’une Eglise « descendante » à une Eglise « ascendante ».
D’une Eglise qui enseigne à une Eglise qui apprend
De l’hiérarchie à la communauté
De « objet » au « sujet » de l’évangélisation
De l’autoritarisme à la collaboration
Du control à la coresponsabilité
D’un caractère hiérarchique à la responsabilité de l’hiérarchie.
1.3 DIFFERENTES THEOLOGIES CONTEXTUELLES
Il y en a plusieurs théologies contextuelles. Voici quelques-uns :
1.3.1 LA THEOLOGIE DE LA LIBERATION (D’AMERIQUE LATINE)
Cf. Gustavo Gutiérrez et Clovis Gutiérrez, Leonardo Boff, Ignacio Ellacuria, Jon Sobrino, etc.
1.3.2 LA THEOLOGIE FEMINISTE
Cf. Rosemary Radford Ruether, Elisabeth Schüssler-Fiorenza, Mary Daly, Elizabeth Johnson, Mercy Amba
Oduyoye. Les autres sont Anne Carr, Alice Dermience, Marianne Katoppo, Josée Ngalula, Ursula King,
Marie-Bernadette Beya Mbuy, etc.
1.3.3 LA THEOLOGIE AFRICAINE
Cf. Jean Marc Ela, Kä Mana, F. L. Kabasele, Fabien Eboussi-boulaga, John Mbiti, Laurent Magesa, Bénézet
Bujo, Bimenyi-Kweshi, Kwame Bediako, Engelbert Mveng, Vicent Mulago, J. N. K. Mugambi, V. Y.
Mudimbé, Tinyiko Maluleke, J. A. Malula, Charles Nyamiti, Desmond Tutu, Tshibangu Tchichiku, Anselm
Sanou, Ngindu-Mushete, Meinrad Hebga, Manas Buthelezi, Allan A. Boesak, etc.
1.3.4 LA THEOLOGIE D’INCULTURATION
Cf. C. F. Starkloff, P. Schinelier, J. Metz, E., Alberich, S. Bevans, E. Doidge, Robert Schreiter, G. H.
Stassen, D. M. Yeager, H. H. Yoder, H. Franck, etc.
1.3.5 LA THEOLOGIE DU MINISTERE DE LA COLLABORATION
Cf. K. Rahner, L. Sofield, C. Juliano, R. G. Duch, P. Jones, etc.
1.3.6 LA THEOLOGIE DES RELIGIONS
Cf. K. Rahner, John Hick, Paul F. Knitter, J. Dupuis, G. D’Costa, M. barnes, J. S. O’Leary, F. Whaling, etc.
1.3.7 LA THEOLOGIE ASIATIQUE
Cf. Aloysius Pieris, Raimundo Pannikar, S. J. Samartha, K. N. Jayatilleke, T. Balasuriya, I. Jesudasan,
Virginia Fabella, B. Senécal, J. B. Cobb, K. Pathil, etc.
2 THEOLOGIE DE LIBERATION
Théologie de la libération, un terme d'abord utilisé en 1973 par Gustavo Gutiérrez, un péruvien prêtre
catholique, est une école de pensée parmi les catholiques latino-américains selon lequel l'Evangile du Christ
exige que l'Eglise concentre ses efforts sur la libération du peuple du monde de la pauvreté et l'oppression.
Le mouvement de libération-théologie a été en partie inspiré par le Concile Vatican II et l'encyclique papale
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 9
1967 Populorum progressio. Ses principaux représentants sont Gutierrez, Leonardo Boff du Brésil, et Juan
Luis Segundo de l'Uruguay. Les partisans de la libération ont reçu les encouragements de l'épiscopat latino-
américain, en particulier dans les résolutions adoptées lors d'une conférence en 1968 à Medellin, en
Colombie, d'autres dans l'Église catholique romaine se sont opposés à leur utilisation des idées marxistes,
leur soutien aux mouvements révolutionnaires, et leurs critiques de la traditionnelle institution religieuse.
Deux membres de la direction du Nicaragua sandiniste appartenu au clergé catholique romain, un Maryknoll
et un jésuite. Autorités du Vatican censuré Boff en 1985, mais dans un document de 1986 Rome a soutenu
une forme modérée de la théologie de la libération. 2
2.1 THEOLOGIE DE LIBERATION : ORIGINE, METHODE ET CRITIQUE 3
2.1.1 ORIGINE
Ce n'est plus un mouvement qui tente d'unir la théologie et les préoccupations sociopolitiques d'une nouvelle
école de théorie théologique. Il est plus exact de parler de théologie de la libération, au pluriel, pour ces
théologies de la libération trouver une expression contemporaine chez les Noirs, les féministes, les
Asiatiques, les Américains hispaniques, et les Amérindiens. L'expression la plus significative et d'articuler à
ce jour a eu lieu en Amérique latine. Thèmes théologiques ont été développés dans le contexte latino-
américain qui ont servi de modèles pour les autres théologies de la libération.
Il ya au moins quatre grands facteurs qui ont joué un rôle important dans la formulation de la théologie
libération en Amérique latine. D'abord, il s'agit d'un mouvement post-renaissance théologique. Les
principaux promoteurs, tels que Gustavo Gutierrez, Juan Segundo, José Miranda, sont sensibles aux
perspectives épistémologiques et sociales de Kant, Hegel et Marx. Deuxièmement, théologie de la libération
a été grandement influencé par la théologie politique européenne de trouver dans JB Metz et Jurgen
Moltmann et Harvey Cox perspectives qui ont critiqué le caractère anhistorique et individualiste de la
théologie existentielle.
Troisièmement, il est la plupart du temps un mouvement catholique de théologie. Avec des exceptions
notables comme José Miguez Bonino-(méthodiste) et Rubem Alves (presbytérienne) la théologie de
libération a été identifiée avec l'Eglise catholique romaine. Après Vatican II (1965) et la conférence de
l'épiscopat latino-américain (CELAM II) à Medellin, Colombie (1968), un nombre important de dirigeants
latino-américains au sein de l'Église catholique romaine s'est tourné vers la théologie de libération comme la
voix théologique pour l’Eglise de l'Amérique latine. Le rôle dominant de l'Eglise catholique romaine en
Amérique latine en a fait un véhicule important pour la théologie de libération à travers le continent sud-
américain.
Quatrièmement, il est un mouvement théologique spécifique et unique située dans le contexte latino-
américain. Théologiens de la libération affirment que leur continent a été victime par le colonialisme,
l'impérialisme et des multinationales. Économique "développementalisme" a placé les sous-développées
nations du Tiers Monde dans une situation de dépendance, résultant en des économies locales de l'Amérique
latine étant contrôlé par des décisions prises à New York, Houston, ou à Londres. Afin de perpétuer cette
exploitation économique, partisans de la libération soutiennent, les pays capitalistes puissants, surtout aux
États-Unis, apporter un soutien militaire et économique pour sécuriser certains régimes politiques de soutien
du statu quo économique.
Ces quatre facteurs se combinent pour apporter une méthode particulière de théologie et d'interprétation.
2 Cf. Phillip BERRYMAN, Théologie de la Libération, Philadelphia, Temple University Press, 1987; P. E. SIGMUND, Théologie
de la Libération à la croisée des chemins, 1990. 3 Cf. C. E ARMERDING, éd, Evangéliques et de la Libération; H. ASSMANN, Théologie pour une Eglise Nomad; L. BOFF,
Jésus-Christ Libérateur; J. MIGUEZ-BONINO, Faire de la théologie dans une situation révolutionnaire; R. M BROWN,
Théologie dans une nouvelle clé.: Répondant à la Libération Thèmes; I. ELLACURIA, Liberté Made Flesh: La mission du Christ
et son Église; A. FIERRO, L'Evangile militant:. A Critical Introduction aux théologies politiques; R. GIBELLINI, éd, Frontiers of
Theology en Amérique latine; G. GUTIERREZ, Théologie de la libération; J. A KIRK, Théologie de la Libération: Un
évangélique Vue du tiers monde; J. P MIRANDA, Marx et la Bible.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 10
2.1.2 METHODE THEOLOGIQUE
Gustavo Gutiérrez définit la théologie comme «une réflexion critique sur la praxis historique. » Faire la
théologie exige le théologien à être immergé dans son histoire intellectuelle et sociopolitique propre. La
théologie n'est pas un système de vérités intemporelles, engageant le théologien dans le processus répétitif
de systématisation et de l'argumentation apologétique. La théologie est une dynamique, de l'exercice en
cours impliquant idées contemporaines dans la connaissance (l'épistémologie), l'homme (anthropologie), et
l'histoire (l'analyse sociale). «Praxis» signifie plus que l'application de la vérité théologique à une situation
donnée. Cela signifie que la découverte et la formation de la vérité théologique sortir d'une situation
historique donnée par la participation personnelle dans la lutte américaine classe de latin pour une nouvelle
société socialiste.
Théologie de la libération accepte les deux volets «défi du siècle des Lumières» (Juan Sobrino) et
herméneutique biblique. Ces deux éléments de la théologie critique de libération forme le premier défi vient
à travers la perspective philosophique commencée par Immanuel Kant, qui a plaidé pour l'autonomie de la
raison humaine. La théologie est plus élaborée en réponse à Dieu la révélation de soi à travers la paternité
divine et humaine de la Bible. Cette révélation de «l'extérieur» est remplacée par la révélation de Dieu
contenue dans la matrice d'interaction humaine avec l'histoire. Le deuxième défi vient à travers la
perspective politique fondée par Karl Marx, qui fait valoir que la plénitude de l'homme peuvent être
réalisés que grâce à surmonter les structures aliénantes politique et économique de la société. Le rôle du
marxisme dans la théologie de la libération doit être honnêtement compris. Certains critiques ont laissé
entendre que la théologie de libération et le marxisme sont indiscernables, mais ce n'est pas totalement
exact.
Théologiens de la libération sont d'accord avec la fameuse déclaration de Marx: «Jusqu'ici les philosophes
ont expliqué le monde, notre tâche est de le changer. » Ils soutiennent que les théologiens ne sont pas censés
être des théoriciens, mais des praticiens engagés dans la lutte pour apporter une transformation de la société.
Pour ce faire, la libération théologique emploie une analyse de classe de style marxiste, qui divise la culture
entre les oppresseurs et les opprimés. Cette analyse sociologique conflictuelle vise à identifier les injustices
et l'exploitation dans la situation historique. Marxisme et théologie de la libération condamner la religion
pour soutenir le statu quo et de légitimer le pouvoir de l'oppresseur. Mais à la différence du marxisme,
théologie de la libération se tourne vers la foi chrétienne comme un moyen pour amener la libération.
Marx n'a pas vu l'émotion, la force symbolique et sociologique de l'Eglise pourrait être dans la lutte pour la
justice. Théologiens de la libération prétendent qu'ils ne sont pas au départ de l'antique tradition chrétienne
quand ils utilisent la pensée marxiste comme un outil pour l'analyse sociale. Ils ne prétendent pas à utiliser le
marxisme comme une conception du monde philosophique ou d'un plan global pour l'action politique. La
libération de l'homme peut commencer par l'infrastructure économique, mais elle ne s'arrête pas là.
Le défi du siècle des Lumières est suivi par le défi de la situation latino-américaine dans la formulation de
l'herméneutique théologie de la libération de la praxis. La clé herméneutique importante émergeant du
contexte latino-américain est résumée dans la référence de Hugo Assmann au «privilège épistémologique
des pauvres. » Sur un continent où la majorité est à la fois pauvre et catholique romaine, théologie de la
libération affirme le combat est avec inhumanité de l'homme à l'homme et non pas avec incrédulité.
Théologiens de la libération se sont taillé une place particulière pour les pauvres. » Le pauvre homme,
l'autre, révèle l'autre totalement à nous" (Gutierrez). Tous communion avec Dieu est fondée sur optant pour
les classes pauvres et des exploités, l'identification avec leur sort, et partager leur sort. Jésus « sécularise les
moyens de salut, ce qui rend le sacrement de « l'autre » un élément déterminant pour l'entrée dans le
Royaume de Dieu » (Leonardo Boff). « Les pauvres sont l'épiphanie du Royaume ou de l'extériorité infinie
de Dieu » (Enrique Dussel). Théologie de la libération détient que dans la mort du paysan ou de l'Indien
natif nous sommes confrontés à « la puissance monstrueuse du négatif » (Hegel). Nous sommes obligés de
comprendre Dieu de l’intérieure médiation d’histoire à travers la vie des êtres humains opprimés. Dieu n'est
pas reconnu analogiquement en beauté de la création et la puissance, mais dialectiquement dans la
souffrance de la créature et le désespoir. La tristesse « déclenche le processus de la cognition », nous
permettant de comprendre Dieu et le sens de sa volonté (Sobrino). Combinant post-Lumières réflexion
critique avec une conscience aiguë des résultats en Amérique latine histoire conflictuelle dans plusieurs
importantes perspectives théologiques.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 11
2.1.3 CRITIQUE THEOLOGIQUE
La force de théologie de la libération en est à sa compassion pour les pauvres et sa conviction que le chrétien
ne doit pas rester passif et indifférent à leur sort. Inhumanité de l'homme à l'homme est le péché et mérite le
jugement de Dieu et de la résistance chrétienne. Théologie de la libération est un plaidoyer pour disciple
coûteux et un rappel que suivre Jésus a la pratique des conséquences sociales et politiques.
La faiblesse théologie de la libération découle de l'application de principes herméneutiques trompeurs et un
départ de la foi chrétienne historique. Théologie de la libération condamne à juste titre une tradition qui tente
d'utiliser Dieu pour ses propres fins, mais il nie tort l’auto communication définitive de Dieu dans la
révélation biblique. Prétendre que notre conception de Dieu est déterminée par la situation historique est
d'accord avec la laïcité radicale dans l'absolutisation processus temporel, ce qui rend difficile la distinction
entre la théologie et l'idéologie.
Le marxisme peut être un outil utile pour identifier la lutte de classe qui est menée dans de nombreux pays
du Tiers Monde, mais la question se pose si le rôle du marxisme est limité à un outil d'analyse ou si elle est
devenue une solution politique. Théologie de la libération expose à juste titre le fait d'oppression dans la
société et le fait qu'il ya des oppresseurs et des opprimés, mais il est faux de donner cet alignement presque
un statut ontologique. Cela peut être vrai dans le marxisme, mais le chrétien comprend le péché et
l'aliénation de Dieu comme un dilemme face à la fois les oppresseurs et les opprimés. L'accent sur la
théologie de la libération des pauvres donne l'impression que les pauvres ne sont pas seulement l'objet de
préoccupation de Dieu, mais le sujet salvifique et révélatrice. Seul le cri des opprimés est la voix de Dieu.
Tout le reste est projeté comme une vaine tentative de comprendre Dieu par quelque moyen d'auto-service.
Ceci est une notion confuse et trompeuse. La théologie biblique révèle que Dieu est pour les pauvres, mais il
n'enseigne pas que les pauvres sont l'incarnation réelle de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Théologie de la
libération menace de politiser l'Evangile, au point que les pauvres se voient offrir une solution qui pourrait
être fourni avec ou sans Jésus-Christ.
Théologie de la libération attise les chrétiens à prendre au sérieux l'impact social et politique de la vie de
Jésus et la mort, mais échoue à la terre de Jésus unicité dans la réalité de sa divinité. Il prétend qu'il est
différent de nous par degré, et non par nature, et que sa croix est le point culminant de son identification
indirecte avec l'humanité souffrante plutôt que d'une mort expiatoire offert en notre nom à détourner la
colère de Dieu et le triomphe sur le péché, la mort, et le diable. Une théologie de la croix qui isole la mort de
Jésus de sa place particulière dans la conception de Dieu et se détournant de la divulgation de son sens
révélé est impuissante à nous amener à Dieu, et donc en assurant la pérennité de notre abandon théologique.
2.2 DIFFERENTS THEOLOGIENS DE LIBERATION
2.2.1 EXPOSE 1 : DIEU OU L’OR DES INDES OCCIDENTALE PAR GUSTAVO GUTIERREZ
INTRODUCTION
En 1492, des Européens ont débarqué sur les terres qui constituent ce qu’on appelle aujourd’hui
l’Amérique. Ils avaient pour mission d’annoncer l’Evangile de Jésus Christ. En écrivant Dieu ou l’or des
Indes occidentales, Las Casas et la conscience chrétienne, 1492-1992, Gutiérrez veut remonter l’histoire
pour nous dire ce qui s’est réellement passé il y a cinq cents ans avec les habitants de ces endroits du monde.
En rappel, Gustavo Gutiérrez est né au Pérou, à Lima en 1928. Ordonné prêtre en 1959, il est titulaire d’un
diplôme de Médecine de l’Université Nationale du Pérou à Lima (1950). Il étudie également la philosophie
et la psychologie à l’Université Catholique de Louvain et la théologie à l’université grégorienne de Rome
ainsi qu’à l’université catholique de Lyon où il obtient un doctorat en 1985. Prêtre de paroisse à l’Eglise du
Christ Rédempteur à Rimac, un quartier pauvre de Lima, il fonde et prend la tête de centre de soin pour les
pauvres, l’Institut Bartolomé-de-Las-Casas, en 1974. Il donne des cours à l’université pontificale de son
pays, en Amérique et en Europe.
Nous nous proposons de rendre compte ici d’un extrait de l’ouvrage en question. Il s’agit des deux
derniers chapitres de l’œuvre : l’or : médiateur de l’Evangile (Chapitre 3) et les Christs flagellés des Indes
(Chapitre 4). Dans la première partie, l’auteur analyse un document à savoir le parecer de Yucay de Garcia
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 12
de Toledo. Ce dernier « veut développer une réflexion théologique qui soutienne à la fois le droit de la
couronne sur les Indes et ceux des conquistadores et encomenderos sur l’exploitation des richesses de ces
régions »4. Son développement nous conduira à voir comment l’or est devenu ce qui a permis
l’évangélisation dans ces territoires. Sans l’or il n’y aurait pas eut de conversion. La deuxième partie, les
Christs flagellés des Indes scrute la plus grande partie de l’œuvre laissé par le Dominicain Bartolomé de Las
Casas. Ce dernier avait fini par se faire l’ami des Indiens et des pauvres. Il voyait en eux le Christ souffrant.
Quand il prit conscience de la valeur de l’Indien aux yeux de Dieu il prit tous les moyens pour leur redonner
la dignité.
Pour notre part nous allons reprendre le plan qui nous est proposé par l’œuvre du Père de la
théologie de la libération. Nous chercherons d’abord à comprendre en quoi « l’or est médiateur
d’Evangile », ensuite nous verrons le contenu de la partie sur les « Christs flagellés des Indes ». Enfin nous
terminerons par une petite critique.
1. L’or : médiateur de l’Evangile
1.1. La belle (blanche) et la vilaine (indienne)
Gutiérrez montre dans cette partie que l’auteur du parecer de Yucay comme d’autres en son temps
considère que les terres des Indes sont des dons reçus de Dieu lui-même en contrepartie de la péninsule
Ibérique qu’ils avaient reconquise au nom de la foi. Il tire la conclusion : « il y eut, par conséquent, quelque
chose comme une réciprocité historique entre Dieu et les souverains d’Espagne ».5 En parlant d’échange
avec Dieu, il y a une légitimité qui s’instaure. Le terrain était déjà préparé pour eux puisque les Incas avaient
déjà soumis les peuples qui s’y trouvaient. De plus quand bien même il y avait cette soumission, il n’y avait
pas une véritable autorité sur ces terres. Ce qui permit à l’Eglise de prendre possession de son règne de
mieux en mieux. Gutiérrez cite un extrait de l’œuvre : « On admire aussi, écrit-il la sagesse de Dieu qui a su
maintenir longtemps ces royaumes sans pouvoir légitime, pour permettre aux souverains espagnols d’y
exercer une autorité plus large et mieux justifiée que toute autre partout ailleurs dans le monde. »6 Le texte
va jusqu’à dire plus loin qu’il n’y a pas eu le moindre péché véniel dans la conquête des terres des Indes.
L’auteur de notre ouvrage nous explique pourquoi il ya ce désir de justifier la conquête : « la
justification se situe dans la lutte séculaire pour la défense de la chrétienté européenne qui avait atteint un
point culminant à cette époque. »7 Il y avait au fait le besoin de ressource pour défendre la foi catholique et
l’annonce de l’Evangile. Et pour ce faire il fallait des richesses. Et pour Guttiérez, l’exploitation des mines
du Pérou était visée de toute évidence. Il cite ici Y, 140 : « je crois et tiens pour avéré, dit-il, que cela justifie
le travail dans les mines et la main mise sur les trésors ». L’or du Pérou servirait ainsi à « défendre la
propagation de la foi chrétienne ».8
Pour Gutiérrez, les arguments apportés pour cette justification sont dirigés contre Bartolomé de Las
Casas. Pourquoi contre lui : « ce dernier considérait comme une spoliation une telle exploitation des mines ;
et d’ailleurs il suggérait aux Indiens de les soustraire à l’avidité des Espagnols, en leur disant que ceux-ci
étaient venu pour l’or et l’argent ».9
Le théologien de la libération perçoit que les mines ont, pour les envahisseurs, une sainte odeur ; la
sainte odeur des mines. C’est pourquoi ces métaux si précieux ne peuvent rester entre les mains d’individus
si vulgaires et si proche de l’animalité. Et Gutiérrez donne la parabole de Toledo qui lui fait comparés les
Indiens à une fille laide qui a besoin de beaucoup de dot pour se marier. Mais les blancs sont comme une
belle fille qui n’a pas besoin d’être dotée. Voici la conséquence qui en résulte : « les apôtre et évangélisateur
purent aisément unir nos âmes à Jésus Christ par la foi du Baptême. En revanche, ces nations-ci étaient aussi
des créatures de Dieu, et, pour leur bonheur, aptes à un tel mariage avec Jésus Christ, mais elles étaient
laides, et il leur fallait grande dot » (Y, 142-143) 10
.
4 Gustavo GUTIERREZ, Dieu ou l’or des Indes occidentales, Las Casas et la conscience chrétienne, 1492-1992, trad. De
l’espagnol (Pérou) par Lucile et Martial LESAY, Paris, Cerf, 1992, p. 85.
5 Idem, p. 86.
6 Idem, p. 87.
7 Idem, p. 89.
8 Idem, p. 89.
9 Idem, p. 90.
10 Cf. Idem, p. 91
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 13
Ainsi, l’or du Pérou était vu comme la dot qui servirait au mariage avec Jésus. Notre auteur fait alors
ressortir que « l’or peut décider du salut ou de la perdition des êtres humains. Gutiérrez montre qu’il en
ressort toute une théologie, une manière de comprendre la foi chrétienne. Mais c’est une fausse théologie
parce qu’elle fonde la diffusion de l’Evangile sur la présence de l’or. On peut donc dire que sans l’or il n’y
aurait pas de Dieu.
1.2. Sans or, pas de Dieu
Le théologien de la libération poursuit son analyse en montrant que l’or a pris une place très
importante, elle est même devenue une chose sainte. Il dit en effet : « ce que Jésus appelait fumier du démon
est devenu chose sainte, le dilemme entre adorer Dieu et les richesses a été éliminé (voir Mt 6, 24) ».11
Cette
inversion des valeurs conduit à percevoir Las Casas comme « instrument évident du démon ». En effet
Bartolomé de Las Casas demandait aux Indiens de cacher leur trésor. Mais pour le Yucay, en les trompant
ainsi, Las Casas les envoyait aux enfers. Puisque le démon voyant que l’or est un instrument efficace pour
l’annonce de l’Evangile dans ces endroits a fait de lui son « allié » pour réaliser son plan infernal.
Mais Gutiérrez voit une contradiction quand Toledo affirme que sans or il n’y aurait ni Roi ni Dieu.
Toledo affirme que c’est par charité que sa Majesté accepte d’annoncer l’Evangile et de maintenir sa garde
mais il oublie que cette charité est limitée par l’or. De plus il dit qu’il n’y aurait pas de Dieu tout en oubliant
qu’ils ont fait dépendre le spirituel du temporel. Notre auteur déduit que pour ces soi disant apôtres, « l’or
devient le vrai médiateur de la présence de Dieu dans les Indes ». Mais penser ainsi c’est renverser la
théologie. Bartolomé de Las Casas attaque cette « christologie » déformée en se situant dans la perspective
évangélique : « celle du Christ présents dans le pauvre, celle du Christ martyrisé des Indes ».12
Mais avant
de revenir sur la Christologie lascasienne, Gutiérrez aborde un autre point du document de Yucay.
1.3. Terre de personne
Avant de dire de quoi il s’agit, il faut dire qu’au-delà des mines, il y a des sépultures et
lieu appelés gucas, de l’or enfoui avec les défunts. Garcia de Toledo en parle mais aussi Las Casas dans
Tesoros del Perú. Ce dernier y affirme que l’or et l’argent qu’on trouvait dans les sépultures n’étaient pas
des richesses sans maîtres. Tous ceux donc qui se jetteront sur ces richesses pècheront mortellement et
seront obligés de se repentir pour réparer leurs fautes. S’ils ne le font pas ils n’obtiendront pas le salut. Mais
en quoi consistent ces fautes.
Las Casas cite le pillage même de l’or, la profanation des tombes qui est une atteinte à la dignité
des morts comme des vivants. (Cf. Tesoros, p. 35-37) comme fautes graves contre Dieu et contre les pauvres
des Indes. Mais pour Toledo, les richesses étaient sans maîtres et ne devaient pas rester ainsi. Notre
Théologien en parle : « en effet l’or et l’argent « ne doivent pas rester abandonnés et il leur faut avoir
quelque maître » ; celui-ci ne peut être ni le diable, ni une idole, et encore moins « l’Indien qui est déjà dans
l’autre vie », et, et l’auteur d’ajouter sarcastique, précise, selon sa théologie particulière : « ou dans l’autre
mort, c’est-à-dire en enfer… » (Y, 146) ».13
Il constate alors que pour Toledo, tout ce qui est en Inde et
même toute l’Inde n’est à personne, terre de personne. Il était dès lors permis aux chrétiens et leurs envoyés
d’exploiter à fond tout ce qui était richesses sur ces terres. Et selon eux en agissant ainsi, il délivre les
Indiens de l’idolâtrie et détruisent les erreurs qui sont professés chaque jour dans les sépultures.14
(Cf. Y,
151-152).
Par la suite, Gutiérrez affirme que les déclarations de l’auteur et sa lettre adressée à son
‘’Excellentissime Seigneur’’ est d’une absurdité élevée. Et l’époque ne peut être d’une excuse puisqu’on
trouve à cette période des exemples de grands missionnaires : Pedro de Montesinos, Vasco de Quiroga, Juan
del Valle, Soto, Suarez...15
Il souligne qu’il y a « un abîme entre leurs réflexions et la Théologie du
document de Garcia. Il rend compte alors d’un débat entre Las Casas et Giné Sepulveda à Valladolid. Pour
Sepulveda, il fallait le soutient des Conquistadores pour qu’il y ait une bonne propagation de la Bonne
Nouvelle. Il fallait d’abord soumettre les Indiens.
11
Idem, p. 97. 12
Idem, p. 100. 13
Idem, p. 102-103. 14
Cf. Idem, p. 104. 15
Cf. Ibidem
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 14
Gutiérrez rapporte les dires de Sepulveda : « Et même s’ils (les Indiens) n’avaient pas été tués, leur
prédication n’aurait pas eu en cent ans autant d’effets qu’elle n’en a eu quinze jours, une fois que les Indiens
ont été soumis, car ils ont alors la liberté de prêcher librement et de convertir quiconque le désir… »
(Prólogo del doctor Sepulveda a los señores de la congregatión », 1552 ; V, 317b ; c’est nous qui
soulignons) ».16
Il pose alors la réplique de Las Casas qui non sans ironie affirme ne pas être contre
Sepúlveda sur la question de l’or et de l’argent en lien avec l’Evangile. Mais il affirme : « car ce qui les
conduit n’est pas l’honneur de Dieu ni le zèle de leur foi, ni le souci de porter secours et de sauver leur
prochain, ni le service de leur roi, ce dont ils se prévalent toujours faussement, mais seulement leur
convoitise et leur ambition… » (1552 ; V, 347-348) ».17
Notre auteur n’hésite pas à apporter le témoignage
de Guamán Poma18
pour confirmer ce constat.
2. Les Christs flagellés des Indes
Cette partie expose surtout la Théologie du Frère Bartolomé de Las Casas. L’auteur commence
cette partie en montrant la grande influence de Las casas sur son époque. Cette influence est surtout dû au
fait qu’il défendait le droit des Indiens. Celui-ci développa une amitié pour J. Friede qui parlait de « parti
indigéniste » à côté du « parti colonialiste ». Las Casas selon Gutiérrez fut un point de confluence pour
beaucoup : « beaucoup se rapprochèrent de Bartolomé de Las Casas, parce qu’ils se sentaient animés par un
même Evangile, la Bonne Nouvelle de Jésus Christ lue avec le regard du pauvre ».19
2.1. L’appel d’un prophète
L’auteur de Dieu ou l’or dans les Indes Occidentales montre comment le sang du pauvre a coulé dans
ces territoires des Indes Occidentales. Mais tout commence par ce qui a pu déclencher la conversion du
dominicain : il s’agit d’un refus d’absolution : « … Un frère dominicain lui avait refusé l’absolution à cause
du manquement à ses devoirs envers les Indiens qu’il avait à son service (II, 356b) ».20
Dans Historia de las
Indias, Bartolomé de Las Casas raconte les mauvais traitements infligés aux habitants de l’Ile. Il parle
notamment de la tuerie de Caonao en 1513. Selon Gutiérrez, c’est cette expérience qui « l’aida à comprendre
que participer au système colonial revient à l’approuver » (P. 115).
Par ailleurs notre auteur reproduit un passage de Siracide 34,18-2221
qui a toute son importance dans
la vie de Las Casas. C’est en relisant les sermons passés que le frère fut amené à méditer sur ce passage.
Pour le Théologien de la libération, ce texte est « clair et rude » mais ne frappe sa conscience qu’en ce
moment précis suite à tout ce qu’il a vécu. Il souligne alors que « Ecriture et réalité s’éclaire
mutuellement ».22
Las Casas prit donc conscience de l’injustice et de la tyrannie contre les Indiens.
De plus, Gutiérrez montre comment à partir du même texte de l’Ecclésiastique, Las Casa fut amené à
réfléchir sur les Portugais qui prirent les Africains pour les vendre en esclavage. Il le cite : « c’est ainsi,
commente Las Casas avec tristesse et indignation, que, du sang répandu et de la captivité injuste et
abominable de ces innocents, ils voulaient donner à Dieu sa part, comme si Dieu était un tyran injuste et
inique, susceptible d’accepter et d’approuver les tyrannies en raison de la part qui lui était offerte ; ils
ignoraient, ces misérables, ce qui était écrit. »23
L’Ecclésiastique lui permettait toujours de se rendre compte
de la mauvaise compréhension qu’avaient les autres sur Dieu. Pour lui Dieu ne peut accepter en offrande
16
Cf. Idem, p. 106. 17
Cf. Idem, p. 107. 18
Felipe Guamán Poma de AYALA (1530-1614) est un chroniquer indigène du Pérou à l’époque de la conquête des Amériques.
Selon Gutiérrez, il a été l’un des premiers à rejeter au nom de la foi chrétienne, la souffrance des Indiens ses frères. Cf. Idem, p. 4. 19
Idem, p. 111. 20
Idem, p. 113. 21
« Sacrifier un bien mal acquis, c'est se moquer, les dons des méchants ne sont pas agréables. Le Très-Haut n'agrée pas les
offrandes des impies, ce n'est pas pour l'abondance des victimes qu'il pardonne les péchés.
C'est immoler le fils en présence de son père que d'offrir un sacrifice avec les biens des pauvres.
Une maigre nourriture, c'est la vie des pauvres, les en priver, c'est commettre un meurtre.C'est tuer son prochain que de lui ôter la
subsistance, c'est répandre le sang que de priver le salarié de son dû ». Si 34, 18-22.
22
Gustavo GUTIERREZ, op.cit. p. 115. 23
Cf. Idem, p. 116
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 15
« le bien volé et mal acquis ». Pour notre auteur tout cela conduira Las Casas à « rejeter l’esclavage des
Noirs ».
A la pensée qui circule que le Dominicain a fait venir les premiers esclaves noirs, Gutiérrez dit :
non ! Pour rappel, en 1516, Las Casas dans son premier écrit acceptait comme tous ces contemporains
l’esclavage des Noirs, et il le recommandait comme moyen d’amélioration des conditions de vie des Indiens
dans les Antilles. Gutiérrez corrige la déduction qui valu à Las Casas le titre d’esclavagiste. D’abord le trafic
existait déjà depuis 1501. De plus Las Casas s’est repenti d’avoir donné de tels conseils. Notre auteur nous
dit : « Dans l’historia de las Indias, (…) il condamne avec indignation la manière dont les Portugais
s’appropriaient des esclaves parmi les peuples noirs d’Afrique par des incursions en dehors de tout droit et
de toute morale ».24
La même analyse est faite sur l’incursion des Portugais dans les îles Canaries.
Las Casas pris alors une décision, celle de s’engager contre l’injustice en commençant par libérer les
Indiens sous sa tutelle. Notre auteur nous montre par la suite comment celui-ci fut résolu à quitter le système
de l’encomienda. Pour Gutiérrez cela va de soi car le Seigneur a proclamé l’Evangile « non seulement en
parole mais d’abord en acte ». Et cette cohérence est selon lui le pilier de l’enseignement de Jésus. Mais un
dilemme se posait à Las Casas : comment libérer les Indiens sans se faire critiquer ? Comment les libérer
sans que d’autres ne les récupèrent pour les maltraiter ? Il prit alors le risque de démissionner afin d’être
libre de ces actions et de ces points de vue qui différaient désormais de ces frères dominicains. Et le
Théologien de la libération d’affirmer : « invariablement, l’Evangile apparaîtra nouveau quand on le lit avec
les yeux du pauvre ».25
2.2. La convoitise est une idolâtrie
L’auteur de Dieu ou l’or des Indes occidentales poursuit son analyse de l’histoire avec Las Casas. Il
donne deux constats qui ont participé à la maturation de la pensée de l’ami des Indiens : le premier est la
relation terrible entre l’or et la mort, la seconde est l’adoration de l’or à la place du Christ. Cet intérêt placé
dans l’or fait des envahisseurs une engeance avide et voleuse. Las Casas donne son point de vue sur la
mission dans les Indes dans le Mémorial de remedios ; « pour lui la plupart de ceux qui sont venus dans les
Indes, « qui s’appelaient et se faisaient appeler chrétiens », l’ont fait « dans le seul but de gagner de
l’argent ». Il ne se préoccupe aucunement ni de l’annonce de l’Evangile, ni des Indiens dont la mort est le
prix à payer pour obtenir l’or ».26
Tout cela entraine une destruction. Ce mot capital pour Las Casas d’après notre auteur manifeste la
mort prématuré des Indiens et la dévastation de l’environnement. Ceci est entrainé par la soif de l’or.
Gutiérrez convoque alors un autre auteur qui le confirme. Guamán Poma envoie en enfer tous ceux qui
exploitent l’or et l’argent du Pérou.27
Finalement la convoitise de l’or est une idolâtrie. Notre auteur donne la
synthèse en ces termes : « l’or est le vrai Dieu de ceux qui maltraitent les Indiens ». (Cf. 129). Et quand les
Indiens ont compris que c’était l’or qui causait leur malheur, certains indiens jetaient l’or à la mer pour avoir
la paix.
2.3. Le Christ n’est pas venu mourir pour l’or
Gutiérrez propose une analyse du texte de Las Casas « Entre los remedios ». Quels raisons fallaient-ils
trouver pour mettre fin au système encomiendas ? Il trouve qu’il faut attirer l’attention sur le désordre que
crée l’or. En voyant dans l’Indien le pauvre dont parle l’Evangile, Las Casas adresse une lettre à Pie V pour
défendre le droit des Indiens. Pour lui les Espagnols devrait s’engager pour une vraie liberté de l’Indien
fondée sur l’Evangile et toute l’Ecriture. Car cette vie que l’ont fait mener aux Indiens est « contraire à
l’intention du Christ et à l’exigence de la charité ».28
Cette souffrance que vivent les Indiens finit par les identifiés au Christ « qui n’est pas venu mourir pour
l’or mais pour le pauvre ». Et notre auteur rapporte que Las Casas alla jusqu’à investir de l’argent pour
obtenir « le bien, la liberté et la conversion des Indiens ».29
Le père de la Théologie de la libération fait
ressortir également l’amour de Las Casas pour Jésus Christ vivant, flagellé, souffleté, crucifié et mort, des
24
Cf. Idem, p. 118. 25
Idem, p. 122. 26
Idem, p. 124. 27
Cf. Idem, p. 126. 28
Cf. Idem, p. 138-140. 29
Cf. Idem, p. 141.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 16
milliers de fois dans les pauvres captifs des Indes.30
Gutiérrez, de tout ce qui précède, constate que de tous
les théologiens du XVIe siècle Las Casas fut celui qui put considérer les Indiens comme ses frères, percevoir
que le Christ s’est identifié aux Indiens opprimés. Voici selon notre auteur le « point central » de sa
théologie dont la pratique rejoint le pauvre. A une christologie fondée sur l’or, il a opposé une christologie
basée sur l’Evangile. Selon Gutiérrez, Las Casas fut un prophète car plus tard l’Eglise a compris qu’il avait
bien agit. Notre auteur a donc voulu se faire le chantre d’une telle théologie pour un Pérou inclus dans une
Amérique en proie à l’oppression.
3. Critiques
Gustavo Gutiérrez a eu le mérite de reprendre en un seul ouvrage l’essentiel de l’histoire de
l’annonce de l’Evangile dans les Indes Occidentales. Au milieu de l’oubli du passé par les historiographes, il
se propose de rendre témoignage à la vérité et de restaurer tous ces Indiens qui ont participé à la croix du
Christ. Cela nous fait penser à ce que disait Benoît Awazi Mbambi Kungua dans Le Dieu crucifié en
Afrique : « le souvenir dangereux de la croix du Christ ne signifie nullement un retour nostalgique et
traditionnel au passé. (…) En tant que processus anamnétique de solidarité avec les morts, les vaincus et
toutes les victimes des guerres impériales et coloniales, le souvenir de la mort de Jésus de Nazareth devient
le lieu d’une forte résistance théologique et politique contre le triomphe d’une historiographie unilatérale et
évolutionniste écrite par les seuls vainqueurs de la conquête du monde par l’idéologie scientifique et
politique de la modernité occidentale ».31
De plus notre auteur avait pris le soin de prévenir que c’est à partir d’un passage de
l’Ecclésiastique que Las Casas avait trouvé le déclic de son engagement auprès des Indiens, pauvres et
opprimés. Le Péruvien souligne alors que l’Evangile apparait autrement quand on le lit avec les yeux du
pauvre. Cela nous fait penser à ce que disait Thomas SANKARA lors d’un sommet de l’OUA à Addis
Abéba, le 27 Juillet 1987 : « la Bible, le Coran ne peuvent pas servir de la même manière celui qui exploite
le peuple et celui qui est exploité. Il faudra qu’il y ait deux éditions de la Bible et deux éditions du Coran »32
.
Ceci dit, l’Evangile ne peut être ni entendu, ni proclamé, ni vécu de la même manière par ceux qui, comme
Las Casas, partagent les conditions des pauvres et par ceux qui veulent les exploiter.
CONCLUSION
Pour mettre fin à ce travail, disons que cette exploration des deux derniers chapitres de Dieu ou l’or
des Indes Occidentales nous a permis de voir l’engagement de Las Casas dans le sens de la libération des
peuples opprimés. Il montre comment dans l’histoire on a remplacé Dieu par l’or dans l’annonce de
l’Evangile. Aussi il a montré comment les Indiens ont soufferts pour que l’Espagne et ces missionnaires
aidés par les Dominicains aient assez d’or pour la propagation de la Bonne Nouvelle. Partant de Las Casas,
Gutiérrez pense aussi à tous ceux que l’Eglise a maltraités dans l’histoire de l’évangélisation des Indes
occidentales et dont on a oublié exprès la mémoire. En écrivant donc cette œuvre, le père de la théologie de
la libération veut rendre témoignage à la vérité au sens de l’Evangile. Il veut libérer la vérité embrigadée
depuis cinq siècles. Par ailleurs, notre auteur permet aux peuples opprimés aujourd’hui au Pérou et dans le
reste de l’Amérique de prendre conscience de l’oppression qu’ils vivent. Par la suite une brève critique nous
a permis de citer d’autres personnes qui ont eut à penser la libération à leur manière. Après avoir parcouru ce
livre, nous nous sommes posés une question : Gutiérrez ne cherche-t-il pas à agir comme Bartolomé de Las
Casas qui s’est engagé aux côtés des pauvres ?
Par YAMEOGO Nabalemwende Urbain
2.2.2 EXPOSE 2 : EGLISE, CHARISME ET POUVOIR PAR LEONARDO BOFF
INTRODUCTION
30
Cf. Idem, p. 142. 31
Benoît AWAZI MBAMBI KUNGUA, Le Dieu crucifié en Afrique, Paris, L’Harmattan, 2008. 32
Thomas SANKARA, Discours prononcé au sommet de l’OUA (Organisation de l’Union Africaine), le 29 Juillet 1987 à Addis
Abéba, http://thomassankara.net/spip.php? (23/02/2013 à 21h03).
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 17
La théologie de la libération est un courant de pensée théologique venu d’Amérique latine. Elle vise
à rendre dignité et espoir aux pauvres et aux exclus. Elle est un cri prophétique pour plus de justice et pour
un engagement en faveur du « Règne de Dieu » commençant déjà sur terre. La théologie de la libération
prône la libération des peuples et entend ainsi renouer avec la tradition chrétienne de solidarité.
Parmi les pionniers de ce courant, Leonardo Boff semble l’un des plus célèbres. Il est né en 1938 à
Concordia au Brésil. Il fera des études de philosophie et de théologie au Brésil, puis en Allemagne. Il rejoint
l’ordre des Frères Mineurs en 1959 et reçoit son doctorat en philosophie et en théologie à l’université de
Munich en 1970. Sa thèse, l’Eglise comme sacrement dans l’expérience du monde, fut dirigée par Karl
Rahner. Après sa formation, Leonardo Boff sera professeur de théologie à l’Institut Théologique Franciscain
de Petrópolis et dans plusieurs universités Brésiliennes. Il sera rédacteur en chef de plusieurs revues
nationales et internationales. Il sera aussi membre de la commission théologique de la conférence épiscopale
du Brésil.
Il est auteur de plusieurs œuvres. La dernière, Eglise : charisme et pouvoir, fera l’objet d’une enquête
instruite par la Congrégation Romaine pour la Doctrine de la Foi. Après les enquêtes, Boff sera sanctionné
en 1985 par les autorités doctrinales du Vatican à cause du lien organique entre théologie de libération et
marxisme. Il se voit imposer silence et obéissance. Il peut donc rester prêtre et demeuré actif au sein de
l’Eglise du Brésil. En 1992, avant d’être définitivement interdit d’exercer la prêtrise, à cause de ses attaques
répétées envers le Saint Siège et sa désobéissance à ses supérieurs Franciscains, il quitte le sacerdoce de lui-
même et passera le reste de sa vie avec Marcia Maria Monteiro de Mirada, sans toute fois se marier.
Son œuvre Eglise pouvoir et charisme qui fut la source de sa sanction est l’objet de notre exposé.
Cette œuvre est structurée en Treize chapitres et fut traduite du Brésilien par Didier Voïta et Jane Lessa et
publiée à Lieu Commun en 1985. Les chapitres V et XIII pour lesquels nous consacrerons ce bref travail
traite respectivement du pouvoir et de l’institution dans l’Eglise d’une part et d’autre part, du charisme
comme principe alternatif d’organisation dans l’Eglise. Pour être plus méthodique, nous présenterons dans
un premier temps le résumé des deux chapitres susmentionnés et dans un second temps nous porterons un
regard critique sur ceux-ci.
1. RESUMÉ DES CHAPITRES V ET XIII
Dans le chapitre V, Leonardo Boff porte un regard très critique sur l’institution de l’Eglise et
l’exercice centralisé du pouvoir. Ainsi, exprime t-il l’urgence d’un changement, d’une transformation
radicale, pour revenir au principe premier de l’Eglise qui est le Christ ami des pauvres. Ce chapitre compte
six points dont le dernier semble être une note d’espérance. Le chapitre XIII quant à lui, est du même ton
critique. Tout en suggérant une structure possible d’organisation pour faire de l’Eglise signe et sacrement du
royaume. Ainsi, propose t-il la collégialité, la collaboration et la valorisation des charismes dans l’Eglise.
Car le charisme est le signe de la présence de l’Esprit et du Ressuscité. Ce chapitre compte sept points très
condensés.
1.1. CHAPITRE V : LE POUVOIR ET L’INSTITUTION DANS L’EGLISE PEUVENT-ILS
ETRE CONVERTIS ?
Cette interrogation est la problématique à laquelle Boff s’évertuera á répondre tout au long de ce
chapitre. Tout en portant un regard critique sur l’exercice du pouvoir dans l’histoire de l’Eglise, depuis
l’époque apostolique jusqu'à sa forme actuelle ; il soutiendra par ailleurs la nécessite et la possibilité du
changement en vue de laisser émerger une nouvelle Eglise.
1.1.1. L’Eglise comme institution
De l’extérieur l’Eglise apparait comme une totalité homogène et tout à fait cohérente. Au regard du
monde extérieur l’Eglise est modèle et source d’espérance, « elle inspire confiance et produit ce qui est le
propre de l’Evangile: la joie de vivre »33
. Mais de l’intérieur, l’on constate « des tensions, des conflits, des
manifestations d’autoritarisme »34
. De ce regard elle est souvent source de frustration et de perte
33
Leonardo BOFF, Eglise: Charisme et Pouvoir, Paris, Lieu Commun, 1985, p. 89. 34
Idem., p. 90.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 18
d’espérance, à cause du mauvais exercice du pouvoir hiérarchique. Il y a certes la nécessité de garantir la
stabilité et de promouvoir la propagande de l’Evangile par l’Eglise institution, mais l’excès et l’exagération
dans la gestion du pouvoir peut conduire à un conservatisme et provoquer une perte du rythme de l’histoire.
Ainsi, toute institution selon Boff, a tendance à se transformation en système de pouvoir et de répression
contre la créativité et la critique. Ce qui peut provoquer la rupture entre Eglise peuple de Dieu et Eglise
Hiérarchie, entre celle qui parle et n’agit pas et celle qui ne doit pas penser, ne peut pas parler mais agit35
. Or
l’institution dans son fond n’est pas un en-soi et ne doit pas l’être, mais plutôt doit être un service de la
communauté de foi. Au risque donc d’être un petit monde dans le monde fermé sur soi, l’Eglise institution
doit se convertir au service du salut pour le monde. Car l’Eglise « est au service du salut, elle y participe,
mais elle n’en a pas la possession »36
.
Le regard porté sur l’histoire de l’Eglise permettra de montrer que l’Eglise n’a pas échappé à ce
dérèglement fonctionnel.
1.1.2. De l’Eglise primitive à l’Eglise d’aujourd’hui : l’épreuve du pouvoir
L’Eglise est selon Boff, le fruit d’une rupture. Les Chrétiens des deux premières générations ont
perçu avec foi et conviction la nouveauté apportée par le Christ. La rupture avec le judaïsme fut radicale.
Ainsi, l’Eglise primitive a eu pour tâche la justification théologique de la chrétienté et de la nouveauté
apportée par le Christ. Celle de la troisième génération avait pour tâche d’organiser correctement la
communauté et de préserver l’intégrité de la doctrine.37
L’élément capital dans l’Eglise des trois premiers
siècles ne fut donc pas l’aspect institutionnel. L’unité étant garantie moins par l’institution que par une
unanimité devant la foi et un courage identique devant le martyre publique38
. On pourrait certes voir
l’exercice d’une certaine autorité dans l’Eglise primitive, avec la détermination du canon du Nouveau
Testament et la ligne de la succession apostolique. Toutefois, cette autorité est perçue dans une conception
mystique qui voit le Christ ressuscité se rendant présent dans les personnes qui assument les fonctions de
service et d’unité dans la communauté. C’est la conséquence d’une vie exemplaire et non le fait d’une
investiture sacrée39
.
Cette situation va radicalement changer avec Constantin, le Christianisme passe alors d’un statut de
religion illicite à celui d’une religion officielle et même de religion d’Etat. Ce fut le début de la grande
aventure culturelle et politique pour l’Eglise. Selon Boff, l’Eglise semble ne pas être préparée à cela. Au lieu
d’abolir l’ordre existant, elle s’est adaptée à elle. On assiste à une paganisation du Christianisme qu’à une
christianisation du paganisme. Ainsi, le Christ devient l’imperator, le Seigneur cosmique et non plus le
serviteur souffrant. L’exousia néotestamentaire est politisé et inséré dans des catégories juridiques au
bénéfice du détenteur du pouvoir sacré. L’on assiste à une soif incessante de pouvoir et de domination. Car
telle est la logique du pouvoir.40
Au XIe siècle Grégoire VII, dans son Dictatus papae (1075), inaugurera le
pouvoir absolu du pape. Ainsi, le pape est compris mystiquement comme l’unique reflet du pouvoir divin. Il
en est le vicaire et le lieutenant. C’était la dictature du pape, la tête considéré comme plénitude de sens et de
pouvoir.41
Ainsi, jusqu'à Vatican II, l’Eglise qui est née comme une rupture avec la synagogue, commet le
risque de se transformer elle-même en synagogue, fermée sur elle-même et contrôlée en tout par les Clercs.
L’exercice concret du pouvoir de l’Eglise institution semble de fait s’écarter de son origine divine, pour ne
s’inscrire que dans la logique de n’importe quel pouvoir humain. L’on peut par ailleurs faire le
rapprochement entre la forme du gouvernement dans l’Eglise et celle pratiquée au sein du parti communiste
soviétique. Ce rapprochement permet de mettre en lumière la logique interne de tout pouvoir centralisateur.
Cette centralisation peut provoquer le manque de créativité et d’esprit critique, à cause des rappels à
l’obéissance, à la soumission et au renoncement.42
35
Idem., p. 92. 36
Idem., p. 91. 37
Idem., p. 93. 38
Idem., p. 94. 39
Ibidem. 40
Idem., p. 95. 41
Idem., p. 96-97. 42
Idem., p. 97.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 19
L’Eglise institution selon Boff, n’agit pas prophétiquement. Contrairement à l’Eglise primitive qui
affrontait le martyre pour rester fidèle à l’Evangile, l’Eglise institution interprète la doctrine à sa guise. Elle
est préoccupée d’elle-même et indifférente aux grands problèmes humains. La nécessité permanente de la
conversion de l’Eglise selon Vatican II est juste, mais ne change pas la position de l’autorité. Les membres
sont invités à se convertir, mais l’institution reste intacte. Or sans une telle conversion de l’institution, on ne
peut parler de conversion évangélique. « Il ne suffit plus de conserver, tout en l’adaptant, ce qui a existé, il
faut reconstruire »43
.
1.1.3. Les valeurs susceptibles de conduire à une reforme de l’histoire
Après l’aperçu historique, l’on remarque l’échec de l’Eglise à l’épreuve du pouvoir. Cet échec a
conduit à un Christianisme superficiel avec des aspects antichrétiens. Ainsi, selon Boff, l’Eglise avec son
pouvoir est à son terme. Le Christianisme apparait comme une idéologie de moins en moins indispensable à
la société moderne. La conscience Chrétienne est devant l’évidence de l’impasse dans laquelle se trouvent
les institutions religieuses. Les hiérarques s’épuisent à conserver une Eglise investie de pouvoir et de
domination, présente auprès des puissances et non des pauvres, serait un contre témoignage et ne répond
plus aux besoins du moment. L’Eglise en effet, se trouve devant une nouvelle société et de novelles choses
lui sont offertes. La reforme s’impose donc, mais comment y parvenir ? Devant la nouvelle situation, le
Chrétien doit aller au-devant du nouveau. La préoccupation de Boff est donc de nous tourner vers le présent
et le futur. « Notre certitude d’aujourd’hui n’est plus le passé mais l’avenir »44
. Tous les Chrétiens doivent
assumer ce passé pour devenir coresponsable de l’avenir de la foi dans le monde.
1.1.4. Le retour au sens évangélique de l’autorité
La nécessité de la conversion de l’autorité est indispensable pour que l’Eglise retrouve son sens
évangélique et prophétique45
. Ainsi, pour y parvenir, il s’impose une relecture des sources de la foi. C'est-à-
dire la figure historique de Jésus pauvre. Car pour une Eglise qui recherche une présence nouvelle au
monde, il est absolument indispensable de retourner, aux sources les plus pures du message de Jésus-Christ
et de la conception évangélique de la structure du pouvoir. En effet, le message fondamental du Christ se
résume dans l’effectivité du royaume de Dieu (Mc 1,15), compris comme libération pour les pauvres,
Justice, Paix, Pardon et Amour. Il a donné une conception nouvelle de l’exercice de l’autorité dans
l’humilité et le service et non la domination. Ainsi, celui qui prétend être témoin du Christ et de son exousia,
doit être un serviteur comme lui Jésus l’a été. Il faut revenir à Jésus, c'est-à-dire à la diaconie, fait de respect
de l’autre comme entre frère et non comme entre maître et esclave. Afin que l’Eglise, devienne un espace de
liberté, de fraternité, et de communication libre entre tous.46
Il est par ailleurs urgent qu’une Eglise nouvelle naisse de l’ancienne. Il faut que l’ancien monde
meure pour que surgisse le monde nouveau. Car la lecture théologique des signes des temps et le défi du
monde présent, conduit à l’apparition d’une Eglise nouvelle. Une Eglise qui a renoncé au pouvoir politique
pour adopter l’axe centrale de l’Eglise peuple de Dieu. Cette Eglise nouvelle est proche des pauvres et des
milieux marginalisés. Elle se comprend davantage comme signe et sacrement du Christ pour le monde. Elle
n’existe pas pour elle-même, mais pour le Christ.47
Selon Boff, l’avenir de l’Eglise institution réside dans ce petit germe constitué par l’Eglise nouvelle
qui nait dans les milieux pauvres et privés de pouvoirs. Par elle, l’Eglise Institution deviendra le signe de
l’Incarnation de l’Evangile dans le monde, dans la société et le pouvoir n’aura qu’une pure fonction de
service. Mais la question qui nait de telles réflexions, à la fois révolutionnaires et nobles est de savoir, si
l’Eglise nouvelle pourra t- elle remporter la lutte ? Ainsi, Boff semble terminer sur une note d’espérance. De
même que Sara, la stérile a conçu, ainsi « une nouvelle Eglise est en train de naitre dans les bas-fonds de
43
Idem., p. 105. 44
Idem., p. 109. 45
Idem., p. 110. 46
Idem., p. 114. 47
Idem., p. 115.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 20
l’humanité».48
La flamme de l’espérance est en train de se ravir, pour donner un sens nouveau à notre
avenir.
1.2. Chapitre XIII : Une structure alternative : le charisme, principe d’organisation
Pour répondre à sa vocation de signe et de Sacrement, l’Eglise selon Boff doit adopter le Charisme
comme principe d’organisation. Valoriser l’action de l’Esprit dans la communauté et donner la possibilité à
chacun des membres d’exercer selon son charisme. Car l’Esprit qui fonde l’Eglise, est le souffle de sa
réalisation dans l’histoire.
1.2.1. Le charisme et l’Esprit comme don accordé a l’Eglise peuple de Dieu
Dans un sens théologique et originelle, l’Eglise est la rencontre de la communauté des fidèles,
suscitée par le christ et par l’Esprit, pour approfondir sa foi et discuter de ses problèmes à la lumière de
l’Evangile. De cette compréhension, l’Eglise va bien au-delà de l’institution. En tant que peuple de Dieu,
l’Eglise a son histoire et son organisation interne dans une perspective surnaturelle, transcendante et
religieuse. Dans cette organisation, tous sont égaux, frères, jouissant d’un même privilège.
Ainsi, dans la communauté, la mission est confiée à tous. Tous les membres sont envoyés pour porter
la bonne nouvelle de l’avènement du royaume. L’apostolicité comme la collégialité constitue une
caractéristique de toute l’Eglise et pas seulement de quelque membres. Car le peuple de Dieu est marqué par
l’égalité absolue. Nul n’est supérieur à son frère et nous sommes tous bénéficiaire du Saint Pneuma. La
présence de l’Esprit se perçoit en effet à travers la pluralité des dons. Pour répondre de façon concrète et
pratique à des nécessités conjoncturelles et structurelles. C’est sur ce modèle que peut s’esquisser un modèle
alternatif d’organisation communautaire différente des communautés primitives, plus fraternelle, valorisants
les charismes et permettant la participation de tous.49
1.2.2. De la compréhension du Charisme
Le charisme, désigne depuis l’Ancien Testament, la gratuité, la bienveillance, le don de Dieu qui
s’ouvre et se livre à l’homme.50
Selon Saint Paul, c’est l’action de l’Esprit agissant dans la communauté. Le
charisme constitue de fait la structure de la communauté. La communauté comme corps à plusieurs membres
(Rm 12, 5). De par cette structure originelle, l’on peut admettre la critique de l’attitude de l’institution de
l’Eglise qui semble se détourner de son origine fondée sur les apôtres. La Hiérarchie qui est un état
charismatique doit donc considérer les autres charismes que l’Esprit suscite dans la communauté. Il faut
donc remettre en cause l’absolutisation du pouvoir et la domination qui a des conséquences sur l’Eglise,
peuple de Dieu. Les conséquences telles que la rigidité et l’absence de joie évangélique ; l’appauvrissement
de l’Eglise toute entière étouffant l’émergence d’éventuels charismes et suscitant la peur et la médiocrité. Ce
qui n’est le cas dans une Eglise où l’Esprit n’est pas étouffé, où fleurissent les divers charismes et où
s’épanouit la créativité qui donne vitalité à l’Evangile.51
Une telle communauté conserve sa puissance
d’intégration et se garde de toute domination. L’amour comme le montre Saint Paul dans ses communautés
est ce qu’il y a de fondamentale. Tout est subordonné à l’amour. Et le charisme est exercé pour le bien de
toute la communauté.
1.2.3. L’origine et la portée du charisme dans l’Eglise peuple de Dieu
Dieu est le fondement de tout charisme. Le charisme ordinaire, comme extraordinaire tirent leur
essence de Dieu et de l’Esprit. Ainsi, doit-il être « toujours rapporté à l’acte de l’Esprit et non à une auto-
affirmation de soi ».52
Il doit rechercher l’intérêt de la communauté et non l’intérêt personnel. Car le
charisme est un service dans la communauté. Chacun en effet, joue un rôle particulier dans la communauté
quelque soit son statut. Le charisme par ailleurs déborde les limites de l’institutionnalisation sacramentelle.
48
Idem., p. 119. 49
Idem., p. 270. 50
Idem., p. 271. 51
Idem., p. 273. 52
Idem., p. 274.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 21
Les sacrements accordent certes des charismes mais ne sont pas les seuls lieux où l’Esprit est à l’œuvre. Il y
a donc une simultanéité de charisme. Car dans une communauté, il peut avoir en même temps plusieurs
dons, et chacun à sa place, selon sa capacité, se met au service des autres. Le charismatique est au service de
tous et ouvert à tout. Ce n’est pas un don pour soi, mais un don-pour, ouvert-à et toujours déjà donné à
l’autre.
Dans l’exercice des charismes, il y a une forte expérience de l’altérite, et de la fraternité. Dans cette
communion, il n’y a pas d’acteur passif. Il n’y a pas de figurants, chacun a un ou plusieurs dons qu’il met au
service de tous. Cependant, personne ne peut prétendre posséder tous les charismes, chacun à besoin de
l’autre, c’est un service de complémentarité. Et la diversité des charismes fait la richesse et la force de toute
la communauté. Le charisme est de fait, indispensable à la structure de l’Eglise. Selon Boff « il n’y a pas
d’Eglise sans charisme, c'est-à-dire sans la présence de l’Esprit et du ressuscité se manifestant concrètement
dans ses membres et dans leurs fonctions».53
Car elle serait sans grâce, sans salut et par la même sans vie.
Ainsi, au lieu d’écouter la parole du ressuscité ; elle devient une communauté qui « n’entend que dogme,
lois, rites, prescriptions canoniques, exhortations édifiantes »54
.
1.2.4. La reconnaissance du véritable charisme
Devant la triste réalité de l’exercice du pouvoir dans l’Eglise, l’on est en droit de procéder à une
réévaluation afin de savoir, si tel charisme vient de Dieu ou non. Ce qui fait du charisme, un charisme, selon
Boff, c’est son lien avec l’Esprit qui est un esprit d’unité et non de division.55
Un autre critère est celui du
service communautaire, désintéressé et vainqueur de l’égoïsme. Ainsi, l’on peut distinguer les charismes des
talents humains. Le charisme et le talent sont étroitement liés. L’un comme l’autre est un don de grâce.
Cependant, la particularité du charisme c’est qu’il est vécu sans rupture avec l’origine divine. Le talent
devient charisme lorsqu’il est vécu comme don de Dieu.
Le charisme tire sa source en Dieu et provient de l’Esprit, cependant, il doit servir à l’édification de
la communauté. Ainsi, revêt-il une dimension verticale et une dimension horizontale. Chaque dimension est
nécessaire et indispensable pour que le charisme vive. Les deux dimensions rappellent et précisent le critère
de base, du service, ”du décentrage de son propre soi56
. Dans la violation de cette norme normative, on
assiste par rapport à l’hiérarchie de l’Eglise, au carriérisme, les servilités qui en découlent, les déclarations
diplomatiques, le non engagement, l’occultation de la vérité, le renoncement à tout esprit prophétique. Ainsi,
la conséquence est plus qu’évidente, au lieu d’avoir des pasteurs qui édifient leur communauté, nous ne
trouvons que des esprits médiocres, inconsistants et plus préoccupés de l’image de marque que de la vérité
de l’Evangile, sans amour pour les hommes et pour les peuples.57
Lorsque le charisme est coupé de son origine et de son essence, il devient nuisible. Le problème de
l’unité et de la cohésion interne semble fondamental, lorsqu’il y a des fauteurs de division. C’est aussi un
charisme qui veille à l’harmonie des autres. Cette charge impute à l’instance dirigeante, à la hiérarchie. Cette
hiérarchie n’est pas d’abord vue dans un sens sacré, mais pris comme service de la vigilance, de la
surveillance et de la conduite. Elle a pour tâche d’intégrer, de favoriser l’unité et l’harmonie entre
les différents services et entre les membres de la communauté.
2. REGARD CRITIQUE SUR L’OEUVRE
2.1. Points positifs
La lecture des chapitres V et XIII, permet de relever quelques points essentiels de ce best-seller de
Leonardo Boff. Comme presque dans toutes ses œuvres et dans toute sa théologie, Leonardo semble montrer
ici son option préférentielle pour la libération des pauvres. En effet, selon lui l’Evangile du Christ exige que
l’Eglise concentre ses efforts sur la libération du monde à partir des pauvres et des opprimés. Car, le Christ
lui-même avait fait l’option pour des pauvres (Mt 5, 11). Ainsi, l’Eglise ne doit pas faire du Christ un
imperator mais revenir à la figure évangélique de serviteur. Tout son développement semble de fait, remettre
53
Idem., p. 277. 54
Ibidem. 55
Idem., p. 279. 56
Idem., p. 281. 57
Idem., p. 282.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 22
en cause la mission évangélisatrice de l’Eglise institution. Car l’Eglise au lieu de prêcher le royaume et d’en
être le sacrement, semble s’absolutiser dans ses autorités. Cette Eglise qui a échoué à l’épreuve du pouvoir,
doit revenir à la source qui est le Christ et l’Esprit. C’est cette forte idée révolutionnaire qui s’échelonne tout
au long de ces deux chapitres.
Ce travail semble être le fruit d’une longue expérience religieuse. Ce sont des critiques pertinentes
traduites dans un langage clair et logique. Loin d’être une simple réflexion théorique, l’œuvre de Boff, va
jusqu'à être source d’action pratique. Elle ne peut pas laisser son lecteur indifférent. Elle interpelle et invite
implicitement à l’exercice de l’autorité dans le service pour le bien de toute la communauté. De ce point de
vue, selon Bartolomé de las casas : « la mission que nous avons reçu ne nous élève pas au-dessus des autres
hommes, ne nous donne aucun pouvoir sur eux. Tous nous sommes enfants de Dieu. Nous devons seulement
nous mettre au service de nos frères »58
. Autrement dit, chacun dans l’Eglise doit aimer sans exclusion. Le
service doit toujours déjà être empreint de l’amour. Un amour toujours ouvert et près à se donner à l’autre.
Cette vision Boffenienne semble très noble pour une meilleure compréhension de la mission de
l’Eglise, cependant, elle fait preuve de quelque exagération.
2.2. LES LIMITES DE LA VISION DE BOFF
La première remarque est la compréhension de l’Eglise comme royaume pour les pauvres. En effet, il
est juste et même normal de soutenir que notre Eglise est une Eglise de pauvre, dans la mesure où elle est
source de salut, pour l’annonce du royaume. Cependant, cette Eglise est universelle. Elle n’est pas seulement
pour la libération du pauvre et de l’opprimé, mais pour le salut de tout homme, riche y compris. Son action
n’est pas limitée à une tranche de la société, mais à tous les enfants de Dieu.
Par ailleurs, Boff, semble inviter l’Eglise à une intervention concrète dans la réalité sociale de
souffrance de l’Amérique latine. Mais contre une telle vision, Jean Paul II répond dans sa lettre adressée aux
Evêques Brésiliens que ce n’est pas le rôle de l’Eglise et des Evêques de proposer une solution concrète en
matière d’organisation sociale ou de modèle économique. Mais elle a pour tâche de toujours rappeler à tous,
les principes éternels, les critères d’actions et les exigences morales qui doivent gouverner la vie sociale,
politique et économique à l’intérieur des nations et dans le monde.59
Autrement dit, l’Eglise n’a pas pour
tache de prendre partie dans une lutte sociale. Elle n’est pas à identifier à un parti socialiste, car elle va au-
delà de cette réalité historique. Elle doit éclairer et tracer les sillons pour une marche résolue vers le
royaume.
Enfin, l’une des failles essentielles du travail de Boff, c’est qu’au lieu d’être source de fortification
de la foi dans l’Eglise, elle semble être source de révolution qui mal gérée pourrait être cause de division et
de schisme. Ce qui ressort clairement dans la notification de la congrégation pour la doctrine de la foi
adressée à Boff. Selon celle-ci, « les options de L. Boff sont telles qu’elles mettent en péril la saine doctrine
de la foi »60
.
CONCLUSION
L’exposé du livre : Eglise : pouvoir et charisme, de Boff et son analyse critique, nous ont permis
d’avoir une large connaissance de sa vision théologique qui s’inscrit dans une conception de libération. Son
travail qui est très critique n’en demeure pas moins pour nous source de révolution, de transformation et de
changement. Loin d’être une simple réflexion, elle invite à l’action, au dynamisme, au changement de
mentalité. La réalité sociale des pauvres au Brésil semble être sa source d’inspiration. Il lutte pour les
pauvres et les victimes de la société. C’est la trame de fond de sa théologie de libération.
Dans cette investigation, sa tâche de théologien semble le conduire à porter un regard critique sur
l’action concrète de l’Eglise vis-à-vis de cette réalité. Ainsi, il remet en cause l’exercice de l’autorité dans
l’Eglise et annonce la naissance d’une Eglise nouvelle plus charismatique, plus évangélique qui sera signe et
symbole du royaume de Dieu dans le monde. Le travail abattu par le théologien Brésilien est très noble et
58
Bartolomé de las casas, De l’unique manière d’évangéliser le monde, paris, Cerf, 1990, cité par Nicolas Buttet, Aimer et faire
connaitre l’Amour, Paris, Edition de l’Emanuel, 1993, p.53. 59
Jean Paul II, lettre adressée aux Evêques Brésiliens, Oss. Rom. N° 42, 22 Octobre 1991. 60
Congrégation pour la doctrine de la foi, lettre de notification et de la sanction de Léonardo Boff publiée le 11 mars 1985 à
Rome.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 23
peut favoriser le changement dans l’Eglise, cependant, trop critique et est susceptible de causer des
dommages pour la foi des fideles.
Koffi Django Avalange Parfait
2.2.3 EXPOSE 3 :ÉVANGILE ET PRAXIS DE LA LIBÉRATION PAR GUSTAVO GUTIERREZ
ET THEOLOGIE ET SCIENCES SOCIALES PAR JON LOUIS SEGUNDO
INTRODUCTION
La théologie de la libération est un courant de pensée théologique chrétienne venu d’Amérique latine, suivi
d’un mouvement socio-politique (la « praxis »), visant à rendre la dignité et l’espoir aux pauvres et aux exclus
et les libérant d’intolérables conditions de vie. Enracinée dans l’expérience biblique du peuple juif guidé par
Dieu au-delà de la mer Rouge et à travers le désert - d’une terre d’esclavage (Égypte) à la Terre promise
(Exode, ch. 12 et suivants) elle est un « cri » prophétique pour plus de justice et pour un engagement en faveur
d’un « Règne de Dieu » commençant déjà sur terre. La réflexion théologique part de la base : le peuple
rassemblé lit la Bible et y trouve ressources et inspiration pour prendre en main son destin. L’expression
« théologie de la libération » fut utilisée une première fois par Gustavo Gutierrez lors du congrès de Medellin
de la CELAM, en 1968. Il développa et articula sa pensée dans un livre Théologie de la libération paru en 1972
qui est largement considéré comme le point de départ du courant théologique.
Pour la « pratique » (« praxis » théologique) l'instrument d'analyse et d'observation utilisé est inspiré du
marxisme, même si les théologiens de la libération se distancent quasi tous de l'idéologie marxiste. Elle prône
la libération des peuples et entend ainsi renouer avec la tradition chrétienne de solidarité. Parmi ses
représentants les plus célèbres, on compte les archevêques Hélder Câmara et Oscar Romero ou encore le
théologien Leonardo Boff, Gutierrez, Segundo et bien d’autres.
Dans la tradition chrétienne, les pauvres ont tenu depuis les origines une place particulière : ils sont à la
fois des modèles (« Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume de Dieu est à vous » Lc 6, 20) et des sujets
de compassion et de charité. La théologie de la libération dépasse ce point de vue, et propose non seulement de
libérer les pauvres de leur pauvreté, mais en plus d'en faire les acteurs de leur propre libération. Elle dénonce
dans le capitalisme la cause de l'aliénation à la pauvreté de millions d'individus.
L’œuvre soumis à notre étude s’inscrit dans ce grand débat qui choc et dérange plus d’un. Intitulée « les
luttes de libération bousculent la théologie », elle est le chef d’œuvre de quelques pionniers de la théologie de
libération que sont Gutierrez, Segundo auteurs respectifs du premier et dernier chapitre et E. Dussel. Les
textes de base sont le premier et dernier chapitre. De quoi s’agit-il dans ces deux textes ?
Dans le premier texte, intitulé « Evangile et Praxis de la Libération » Gutierrez s’appuie sur les aspects
sociaux, politiques économiques que religieux dans la réflexion théologique pour rendre efficace la théologie
de libération. Le fait historique est un élément nécessaire qui, à bien considérer doit permettre au croyant de
s’approcher de Dieu.
Quant au dernier chapitre, intitulé « Théologie et sciences sociales » Segundo insiste sur les différents
passages des faits sociaux à des faits concrets et spécifiques dans la lutte de la libération en Amérique Latine et
l’approche de l’idéologie marxiste à cette théologie.
CHAPITRE I : ÉVANGILE ET PRAXIS DE LA LIBÉRATION
Le processus de libération est caractérisé en théologie par un processus libératoire, généralement définit
comme le "prajna", conduisant à une "libération" effective. Le fait historique est nécessaire pour le croyant
pour tendre vers Dieu. En effet histoire et salut sont liés à tel enseigne que la foi prend obligatoirement en
compte la vie concrète de l’homme.
A- LE POINT DE DÉPART
Née sur le continent Américain, la théologie de libération met en cause l’ordre social économique, politique
et les différentes formes d’expressions de sa conscience sociale. La théologie de libération met l’accent sur le
comment le chrétien doit vivre sa foi, comment la comprend et la pense t- il ? Pour Gutierrez il s’agit d’une
intelligence de la foi posée à partir de la praxis de la libération, praxis qui normalement construit une société
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 24
autre et « qui forge une nouvelle manière d’être chrétien et d’être homme »61
. Ce processus suit plusieurs
étapes.
1- Les premiers pas
Le problème social intéresse les chrétiens de l’Amérique Latine. La pauvreté et la misère ne font qu’animer
en nous une interrogation. Pourquoi certains sont riches e d’autres non ? Pour répondre à cette question, les
chrétiens regardent l’organisation sociale qu’il juge injuste. La théologie de libération vise donc une
amélioration des conditions de vie de l’homme par l’édification et l’établissement d’une société juste, marquée
par les valeurs évangéliques qui ont des conséquences sur la vie quotidienne. Mais au fur et à mesure, le
langage de la lutte est « devenu agressif et l’action un plus efficace »62
. Elle est devenue un combat réel contre
l’ordre social. Devant donc des difficultés, cette lutte va prendre une allure révolutionnaire63
. Ainsi la foi
devient un élément qui pousse à l’engagement. L’Evangile n’est pas révolution mais il exige un changement de
mentalité et d’action comme le dit Mt 5, 13-14 « Sel et lumière du monde ». De là, naitra une théologie de
révolution qui soutient cet engagement révolutionnaire et qui voudrait bien détruire l’idée d’une foi inopérante
et passive, favorisant l’injustice sociale. Cependant avec la tournure qu’elle prend fait qu’elle est tend à
devenir « une idéologie chrétienne révolutionnaire »64
2- Vers une nouvelle expérience
L’expérience que nous faisons est charité vers les pauvres, le prochain65
. Comprenons que le pauvre n’est
qu’un homme que la société a rendu ainsi. En effet il est celui envers qui la société a commis une injustice et
enfin de compte marginalisé66
. Et cette expérience nous emmène à prendre soin du pauvre puisqu’il est de notre
responsabilité ou encore c’est l’exigence d’une construction d’un ordre social. Si le pauvre est membre d’une
classe sociale exploitée, une attention envers lui s’avère nécessaire pour refaire l’équilibre du monde ; c'est-à-
dire, lui rendre ce qu’on lui a volé. C’est pourquoi aimer le pauvre ne saurait s’éloigner de compatir à ses
souffrances mais plus encore s’engager dans une lutte de revendication en sa faveur. En aidant le pauvre en
difficulté, c’est le Christ qu’on aide et qu’on imite puisque selon le fils de l’homme, l’amour du pauvre est la
manifestation de l’amour du Père. C’est ainsi que notre conversion évangélique qui est un processus pourra être
agréable à Dieu67
3- La politique
Aujourd’hui avec la théologie de la libération, la politique est comprise comme un engagement dans la
libération de l’homme et plus encore comme dimension total prenant en compte tout l’homme, sa vie, son
projet, son travail. La vie humaine ne peut s’entendre sans la vie politique puisqu’elle est organisation et
gestion de la cité. Le chrétien doit comprendre qu’il doit s’engager pour participer à relever l’homme en
difficulté. Cette prise de conscience est donc nécessaire pour tous car c’est un combat objectif. Il faut donc
s’attaquer au mal à sa racine. Le chrétien doit donc s’engager activement aux coté de ceux qui souffrent. Il faut
faire un changement radical. Le cas de l’Amérique Latine est le terrain de ce combat contre les ennemis de
l’homme qu’il faut combattre et mettre fin à l’injustice sociale. Mais Gutierrez tient à préciser : « Nous
devons apprendre à vivre et à penser la paix dans le conflit »68
4- Et Spirituelle
La praxis de la libération qui prend en compte plusieurs aspects de la vie de l’homme, prend aussi le coté
spirituelle. C’est donc en s’engageant dans ce combat que le chrétien pense et vit sa foi, une foi active qui nous
emmène à faire advenir le Royaume de Dieu. Le chrétien en s’engageant au coté de ceux-ci montrera et
manifestera la présence de Dieu. Mais de quelle pauvreté parle le Christ dans l’Evangile ? C’est la pauvreté
évangélique réservée à tous. Avant elle était proclamé comme un idéal chrétien. La pauvreté matérielle ne
peut être en aucun cas une valeur à encourager puisque « la gloire de Dieu c’est l’homme debout » disait St
Irénée. C’est cette pauvreté réelle du peuple Latino Américain qu’il faut combattre. Une articulation plus
heureuse de la théologie et de la réalité s’impose. Si la pauvreté est annoncée par l’Eglise, il est regrettable de
61
G. GUTIERREZ, « Evangile et praxis de libération » in les luttes de libération bousculent la théologie, Paris, Cerf, p.12. 62
Idem, P14. 63
Idem, p15. 64
Idem, p.15. 65
Idem, p.16. 66
Idem p.16. 67
Idem, p. 17. 68
Idem, p. 19.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 25
constater qu’elle-même ne la vit pas. Des éléments tels que la solidarité envers les pauvres, l’engagement dans
la libération des classes exploités nous emmène à une relecture de l’Evangile. Pour Gutierrez, la pauvreté n’est
pas à encourager puisque sa cause, c’est le péché, le mal. Engagé dans cette lutte de libération, le chrétien est
parfois confronté aux doctrines chrétiennes69
. Si donc le chrétien n’est pas capable de s’engager dans cette
théologie, c’est nier la force de l’Evangile. Le message chrétien doit être incarné aux réalités et difficultés de
l’homme. L’engagement dans pour la libération de l’homme s’avère être une nécessité conformément à une vie
chrétienne authentique. La réalité chrétienne dans nous impose donc une nouvelle réflexion théologique qui
s’appuie sur une véritable vie spirituelle70
.
B- UNE REFLEXION THOLOGIQUE NEUVE
L’engagement pour la théologie de libération ne pourrait s’entendre sans une « praxis » de la foi qui aboutit
à une « praxis » de la libération.
1- Un saut qualificatif
Gutierrez pense que s’engager à relever le pauvre, la classe exploitée, à prendre en compte une
amélioration des conditions de vie, passe par une redécouverte de la pauvreté évangélique71
qui nous permettra
d’avoir une compréhension autre que ce qui maintient l’Eglise à être complice de ce malheur des peuples. La
solidarité s’impose donc. De cette nouvelle compréhension naitra un nouvel engagement. En effet la misère et
l’injustice en Amérique Latine sont des faits qui nécessitent une réaction active, une révolution active. Sur ces
présupposés et sur cette dimension de la pastorale vont s’élaborer les thèmes clés de la théologie de la
libération. On y prend les thèmes bibliques traditionnels qui relèvent l’action de Dieu pour le salut de l’homme,
en réinterprétant par rapport à la réalité latino-américaine. Le monde entier devra donc s’engager dans ce
combat d’indépendance et encore plus la théologie. Quelles sont les bases de cette société juste ? Il ya « le
dépassement d’une société divisée en classe, un pouvoir politique au service de la majorité populaire,
l’élimination de l’appropriation privée de la richesse »72
. Ainsi cette nouvelle société prendra la forme d’un
socialisme propre à l’Amérique Latine. Pour y arriver, cette lutte doit s’appuyer sur l’homme nouveau c'est-à-
dire l’homme libéré de la servitude et engagé dans son destin, acteur de sa propre histoire. Les valeurs des
peuples opprimés doivent être nécessaires dans cette lutte. Aussi faut-il reconnaitre qu’aujourd’hui encore,
l’évolution des sciences a joué un rôle important puisque l’homme loin d’être passif est actif et donne une
orientation à son histoire. Voilà pourquoi « La connaissance est ainsi liée à la transformation »73
. C’est ainsi
que Gutierrez soutient que pour connaitre l’histoire, il faut la transformer et ainsi on se transforme soi même74
.
Ainsi en tenant compte des réalités du moment et du milieu l’homme est invité à maitriser et transformer la
société et cela passe par u travail théologique.
2- Le travail théologique
Le travail théologique devra penser la foi selon la réalité actuelle puisque la parole du Seigneur est toujours
d’actualité. Si l’herméneutique est bien orientée la foi doit sortir des chaines de pensées fondamentalistes qui
retiennent l’homme captif et s’oppose à toute libération. La pensée théologique devra prendre en compte les
nouvelles données de connaissances actuelles. Elle s’appuiera sur l’histoire des peuples pour s’engager dans un
processus de libération et d’espérance. L’histoire du salut et l’histoire profane sont considérées comme une
seule, de telle sorte que le salut se joue les processus actuels de l’évolution latino américaine. Pour cela, la
tâche fondamentale que se propose la théologie est d’expliciter la relation intrinsèque qu’il ya dans le plan de
Dieu, entre la libération sociopolitique, économique, culturelle et le salut en Jésus Christ. Voici quelques pistes
de réflexion : la relation entre création et Rédemption par conséquent entre humanisation, développement,
libération et salut eschatologique, l’Espérance comme certitude de l’avènement du Royaume dont les valeurs
et les conditions sont appelées à se faire jour dans la société. La thématique théologique du Dieu libérateur qui
se fait jour dans les signes précaires de la libération socio politique et culturelle est très large et elle a encore
69
Idem, p .23. 70
Idem, p. 26 71
Idem p. 27. 72
Idem, p.28. 73
Idem, p28. 74
Idem, p. 29.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 26
besoin de se compléter et de s’approfondir. Si le Christ nous apporte la libération par sa mort et sa
résurrection, nous devrons donc au nom de cet amour transformer notre société et encourager les valeurs
évangéliques. La théologie a le devoir de s’engager dans les combats quotidiens à réaliser le règne de Dieu. La
théologie de libération devient dès lors théologie de salut75
et alors elle s’intéresse selon l’expression de
Lebret : « le développement de l’homme, de chaque homme, de chaque groupement d’hommes jusqu’à
l’humanité tout entière »76
. Bref, la théologie de libération se veut être une théologie solidaire, qui défend les
pauvres et les opprimés77
.
CHAPITRE II : THEOLOGIE ET SCIENCES SOCIALES PAR JON LOUIS SEGUNDO
A- Les différents passages de sciences sociales à la théologie
La théologie de libération trouve son fondement dans le message chrétien et non dans un système marxiste78
.
Cette théologie doit s’appuyer sur les faits de société. En s’appuyant sur la sociologie, elle n’épuise pas
totalement ses objectifs car ses fondements varient en fonction des rapports de société et du sociologue. Si la
théologie de libération a connu des difficultés c’est bien parce que ces fondements n’étaient pas souvent
solides. Dans cette partie nous exposerons la manière dont Veron caractérise cette évolution de la sociologie en
l’évacuant puis nous mettra en relation avec quelques uns des problèmes théologiques les plus importants
d’Amérique latine et comment cela peut être résolu79
.
1- Passage d’un vaste champ de faits à leur fragmentation
Veron relève que le problème sociologique vient d’une fragmentation des faits de société et cela n’aboutit
pas à une totalité. Alors que l’interdisciplinarité s’avère être un élément qui permet une vue d’ensemble pour
poser une théologie plus réelle, plus concrète. La pastorale doit tenir compte de cet élément afin qu’elle puisse
pénétrer « la totalité sociales» de la vie de l’homme80
.
2- Passage de l’abstraction théorique à la vie quotidienne
La vie quotidienne est le lien privilégié d’une théologie qui prend en compte les vraies données81
. Très
souvent les notions abstraites influencent le système socio économique. Les idées abstraites ne jouent pas le
rôle qu’il faut, mais peut être le système symbolique inclut en elle pourrait elle servir. Il faut une méthode
sociologique concrète qui va du symbole à la réalité. La religion telle qu’elle est vécue dans son contexte
emprunte le chemin du dépassement. La théologie en s’appuyant sur l’impact social s’ouvrira au plan global,
de libération mais plus encore en se fondant sur « le plan global de libération de Dieu »82
.
3- Passage des idéologies globales à des opinions spécifiques
Les premiers sociologues faisaient plus une interpellation, prenant en compte l’enjeu de liberté. Il faut que
la société s’appuie que des systèmes spécifiques. Il faut que la société s’appuie sur des systèmes globaux.
4- Passage de catégories de connaissance à des dimensions évolutives
La question de l’interprétation théologique de la vie chrétienne en Amérique Latine est délicate. Le lien
entre l’orthodoxie et l’orthopraxies nous a révélé que le critère de référentiel est l’opinion du peuple. La
question de la vérité oppose les chrétiens eux-mêmes et entre les athées posent problème à cette théologie de
libération puisque c’est un fait subjectif. La théologie pour bien mener ce combat doit s’appuyer sur la
sociologie et aussi sur le problème d’unité des chrétiens, qui est un fait de société83
.
.5- Passage de « système d’idées » à des opinions isolées.
Il faut tenir compte des contradictions idéologiques qui touchent la pastorale. Dans ce passage nous
constatons que le choix de la liberté prônée par l’Eglise doit être un choix qui l’engage à libérer les pauvres et
les opprimés. Ce qui est bien dommage est que l’Eglise a eu en son sein des complices et des oppresseurs.
L’Eglise doit donc s’appliquer les exigences de la foi et être attentive de toute idéologie de libération. Ainsi elle
75
Idem, p.32. 76
L.J. Lebret, O.P., Dynamique concrète de développement, Paris, Economie et Humanisme, les éditions ouvrières, 1961, p.28. 77
G. GUTIERREZ, « Evangile et praxis de libération » in les luttes de libération bousculent la théologie, Paris, Cerf, p37. 78
. J-Louis SEGUNDO, « Théologie et sciences sociales» in les luttes de libération bousculent la théologie, Paris, Cerf, p.167 79
Idem, p.169. 80
Idem, p.170-171. 81
Ibidem. 82
Idem, p.173. 83
Idem, p176.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 27
joue sur deux dimensions, le radicalisme des exigences évangéliques et le salut universel. Ces deux dimensions
doivent être conciliées mais en réduisant le radicalisme évangélique84
.
6- Passage de l’inconscient à la conscience.
Ce passage permet de partir d’une sociologie opératoire à un champ idéologique qui détermine les
représentations sociales. Il faut donc que la théologie utilise des moyens qui sont propres à elles et qui met la
révélation au service de l’homme. Ainsi donc si on y prend garde « la théologie bureaucratique » continuera
d’être un moyen d’oppression, d’assujettissement tant qu’elle ne s’engage pas à fond dans les faits
sociologiques réels. L’idée de d’une théologie qui prend en compte la réalité pour libérer l’homme s’impose.85
7- Passage de la sociologie à la psychologie
Dans la sociologie actuelle, il faut noter des efforts qui vont au-delà de faits conscients et qui font appel aux
principes psychologiques. C’est en faisant une véritable étude psychologique que l’on aboutira à des résultats
sociaux qui prennent en compte l’ordre social. Veron souligne que la théologie doit faire attention de suivre de
façon évidente la sociologie puisque celle-ci remet en cause les interprétations religieuses. Mais surtout aussi
parce que sa sociologie ressemble à une psychologie.86
La logique sociologique n’est celle de la théologie.
Enfin de compte la pastorale latino-américaine doit aller en profondeur des faits pour mieux les comprendre et
aider les peuples opprimés.
B- LA RELATION ENTRE SYSTÈME MARXISTE ET SYSTÈME RELIGIEUX.
Pour Veron, la religion selon Marx est une superstructure c'est-à-dire un idéal. La religion contrairement aux
autres disciplines est appelée à disparaitre avec le temps. Marx pense que la société peut exister sans certaine
structure telle que la religion qu’il faut supprimer avec l’avènement du socialisme. Déjà ce système joue le rôle de la
religion en proposant la fin de la souffrance de l’homme exploité. Pour Marx, la sociologie ne favorise pas une
libération concrète en Amérique latine. Veron soutient que dans cette lutte il faut bien évidemment associer le
chrétien, faire de lui un allié afin que celui-ci s’engage dans le combat politique. La sociologie marxiste ne s’intéresse
pas aux phénomènes religieux et ne donne aucun élément aux théologiens pour qu’il quitte le stade de l’idéologie.
Pour Marx il ya un mariage entre infrastructures et superstructures, et cette dépendance est appelée matérialisme.
Toute superstructure a la force de jouer un rôle déterminant dans le changement social87
.
CHAPITRE III : QUELQUES CRITIQUES
A- CRITIQUES POSITIVES
La théologie de la libération n’est pas une école uniforme mais un courant pluraliste et dans un cadre de bas
de mieux être. Les uns privilégient davantage les aspects religieux, d’autres les avantages temporels
(spécialement politiques et culturels) de libération. Elle situe les limites sociales et idéologiques de son discours
de rupture religieuse. Loin d’être une théologie laïque, de rupture avec le pouvoir clérical traditionnel, elle est
plutôt constitutive d’un pouvoir religieux engagé dans une foi qui libère les peuples opprimés et pauvres. Cela
exige « une lutte assumée avec des moyens évangéliques, en d’autre terme être combattant de l’Evangile ou je
lutte pour la libération de mes frères »88
. Cette théologie est orientée vers l’évangélisation et non vers la
politique et se réfère essentiellement au péché et au salut intégral de l’homme en Jésus Christ c'est-à-dire être
affranchis de la misère, trouver plus sûrement leur subsistance, la santé, un emploi stable et participer
davantage aux responsabilités, hors de toute oppression »89
. Cette nouvelle façon de faire la théologie tient
compte des témoignages de notre monde qui sont de plus en plus abondants90
. La foi traduit ici un engagement
concret qui pousse l’Eglise et les chrétiens sortir de leur conception ancienne et à œuvrer pour la construction
d’une société de justice et de solidarité où loin d’être complice l’Eglise joue son rôle auprès des peuples en
détresse91
. Mais nous pensons avec Jacques Elul, « que le christianisme est une anti idéologie »92
, mais
84
Idem, p176-177 85
Idem, p178. 86
Idem,p179. 87
Idem, p. 180-185. 88
Leonardo BOFF, « Que signifie théologiquement peuple de Dieu et Eglise populaire » in concilium 196, 1984, p153. 89
Paul VI, lettre encyclique populorum progressif, 2e Ed. , Apostolat des Editions, Lyon, 1967, N°6.
90 Gustavo GUTIERREZ, « Travail théologique et expérience ecclésiale » in concilium 196, 1984, p.103.
91 Idem, p.105.
92 Jacques ELLUL, l’idéologie marxiste chrétienne, Paris, Centurion 1979, p. le résumé du livre.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 28
l’Eglise n’a pas oser souvent faire ce dépassement. Il s’agit bien d’une théologie, c’est-à-dire d’un discours sur
Dieu. Cependant, la démarche est spécifique, car elle est explicitement contextuelle. On pourrait dire que toute
théologie est contextuelle, puisqu’elle est produite dans une culture et dans des conditions précises. Ce qui
différencie la théologie de la libération d’autres courants de pensée, c’est le fait de reconnaître explicitement
que sa démarche est liée au contexte socioculturel dans lequel elle s’exprime. La théologie de la libération
prend comme point de départ la situation des opprimés. C’est ce qu’on appelle un "lieu théologique", c’est-à-
dire la perspective au départ de laquelle se construit le discours sur Dieu. Donc, comme le disait un théologien
récemment, il s’agit d’une théologie qui ne se demande pas si Dieu existe, mais où il se trouve ? L’autre
nécessité est celle d’une herméneutique, c’est-à-dire la recherche du sens des documents fondateurs et de
l’histoire du groupe chrétien et de ses traditions. En fait nous pensons que la théologie de libération pourrait
avoir du crédit avec la doctrine sociale de l’Eglise qui précise que « la pastorale sociale qui est l’expression
vivante et concrète de l’Eglise pleinement consciente de sa mission d’évangéliser les réalités sociales,
économiques, culturelles et politique du monde »93
B- CRITIQUES NEGATIVES
La Congrégation pour la doctrine de la foi publia en 1984 l’ « Instruction sur quelques aspects de la
théologie de la libération » - rédigée par le cardinal Ratzinger. Le document rend justice à l’expression et
aux buts de la théologie de la libération, mais avertit les chrétiens d’un risque inhérent à une acceptation
sans critique du marxisme comme un principe dominant de l’effort de réflexion théologique. D’autre part, le
Vatican condamne un certain éloignement de la foi : « Certains sont tentés devant l'urgence du partage du
pain, de mettre entre parenthèses et de remettre à demain l'évangélisation : d'abord le pain, la parole plus
tard ». La vision des évangiles d'un Jésus trop politique, déclarant que « cette conception d'un Jésus
politique, révolutionnaire, du dissident de Nazareth, n'est pas en harmonie avec l'enseignement de l'Église ».
Au cours du voyage le pape critiqua l'idéologie marxiste : « L'Église n'a pas besoin de faire appel à des
systèmes ou à des idéologies pour aimer et défendre l'homme, pour contribuer à sa libération »94
, s'opposant
par ailleurs « à toutes les formes d'esclavage et de domination, à la violence, aux atteintes à la liberté
religieuse, aux actes d'agression contre l'homme et la vie humaine »95
. Il faut reconnaitre qu’il ya des
théologies de libération de tendance « idéologisant » soit par le point de départ soit par une certaine analyse
idéologique de la réalité. Ainsi la théologie perd ses caractéristiques « catholiques » parce qu’elle traduit
seulement la pensée des chrétiens révolutionnaires. Beaucoup ont condamné cette tendance marxiste de
cette théologie qui tend vers « l’horizontalisme » le positivisme et un humanisme purement temporel.
CONCLUSION
En Amérique latine, où naît la théologie de la libération, la situation est celle de l’oppression sociale. A cette
époque, c’est-à-dire à la fin des années 1960, la théorie critique principale d’analyse est celle de la
dépendance, de la lutte pour les pauvres et opprimés. Il s’agit d’analyser et d’expliquer les phénomènes
sociaux latino-américains, à la lumière de la situation de périphérie du continent, vis-à-vis d’un capitalisme
central, égoïste. La théologie de la libération s’appuya sur ce courant analytique, pour construire sa propre
démarche. La pauvreté, la misère, l’oppression en Amérique latine ne pouvaient pas être détachés d’un
ensemble plus vaste, dont les logiques se situaient dans le rapport centre - périphérie. C’était un choix, non
arbitraire, car considéré comme la meilleure manière de lire la réalité sociale et de la comprendre, pour,
ensuite, l’exprimer en termes théologiques. Au contraire, la théologie de la libération part d’une démarche
inductive, qui l’amène à construire une pensée spécifique religieuse, en partant du réel et de la pratique
sociale. Un tel trajet intellectuel introduit inévitablement un élément de relativité dans le discours
théologique. Il ne réduit pas ce dernier au statut épistémologique des sciences humaines, mais il se construit
au départ de ces dernières, impliquant par-là que la quête du sens religieux peut changer d’orientation selon
les situations et la manière dont on les analyse. Le discours n’est donc plus dogmatique, il part d’une réalité
empirique.
Par ADEA CHRISTIAN FABRICE
93
Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise, CEDA/NEI Abidjan 2008, n°524 94
Carl Bernstein, Marco Politi, Sa Sainteté Jean Paul II, Edition Plon, 1996, p.178-179 95
Carl Bernstein, Marco Politi, Sa Sainteté Jean Paul II, Edition Plon, 1996, p.181-182
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 29
2.2.4 EXPOSE 4 : JESUS CHRIST EN AMERIQUE LATINE : SA SIGNIFICATION POUR LA
FOI ET LA CHRISTOLOGIE PAR JON SOBRINO
INTRODUCTION
Le discours théologique du XX siècle, tenu à la « gloire de Dieu » s'est développé de plus en plus
comme un discours à la défense du genre humain, conférant ainsi une importance capitale à l'homme dans le
processus de sa libération. C'est bien dans cette optique qu’affirme Christian Duquoc : « la réflexion
théologique s'enracine dans l'expérience de la misère des masses due à l'exploitation et dans la lutte de ces
masses pour s'affranchir de leur situation intolérable »96
. Notamment, ce courant théologique de libération,
dont la préoccupation première porte sur les conséquences d'une pauvreté structurelle et destructrice
croissante, s’inscrit dans cette manière de vivre l'Evangile dans la proximité et la solidarité avec les
personnes exclues, appauvries et opprimées.
Une telle approche suscite des questionnements à savoir : comment interpréter théologiquement la
misère des peuples opprimés? Que peut-on entreprendre au nom de la foi chrétienne en vue de remédier à
cette situation ? Toutes ces interrogations contribuent à la définition du champ d’action de la théologie de la
libération. Il s’agit d’une praxis en vue de la libération politico-sociale des peuples opprimés, qui peinent
sous le joug de la domination et de l’injustice sociale. C’est donc conscient de cette vocation à contribuer à
la rédemption de l'être, de toutes les sortes de servitude et de misère, que ce cours de théologie contextuelle,
dans le cadre de ces exposés nous invite à l’étude d’une ouvres contextuelle. L’occasion pour nous de
revisiter la pensée d’un auteur du courant de la théologie de libération, en vue d’analyser la quintessence de
sa réflexion théologique et libératrice. Ainsi donc, pour la réalisation de ce présent travail notre intérêt se
porte sur Jon Sobrino, dont le choix de son œuvre : Jésus-Christ en Amérique latine. Sa signification pour la
foi et la christologie, nous permettra de scruter les tréfonds de sa pensée, pour en saisir tant soit peu, son
apport, son originalité et son application à la situation actuelle du peuple l’africain presqu’identique à la
souffrance des peuples latino-américains.
Par ailleurs, conscient de ce que nos investigations ne pourront présenter un résultat exhaustif sur
toute la théologie qui se déploie de l’œuvre, ce présent travail s'articulera autour de trois axes à savoir :
Bibliographie et pensée théologique de Jon Sobrino ; l’approche analytique de l’œuvre et une évaluation
critique de sa pensée.
1. BIBLIOGRAPHIE ET PENSEE THEOLOGIQUE DE JON SOBRINO
1. 1. BIBLIOGRAPHIE DE JON SOBRINO
Jésuite salvadorien d'origine espagnole, Jon Sobrino est né le 27 décembre 1938 à Barcelone dans
une famille basque. Entré très jeune, à 18 ans, dans la Compagnie de Jésus, il quitte son pays d'origine pour
rejoindre, en 1957, le Salvador où il réside habituellement comme enseignant à l'Université Centraméricaine
« José Simeón Cañas » (UCA). Ordonné prêtre en 1969, licencié en philosophie et lettres de l’université de
Saint Louis en 1963, master en Ingénierie en 1965, docteur en théologie en 1975 à Francfort en Allemagne.
D’où sa thèse inédite sur le sens de la croix et de la résurrection de Jésus dans les christologies
systématiques de W. Pannenberg et de Jürgen Moltmann. Auteur prolifique, il enseigne la christologie et
l'ecclésiologie, opposant, la conception d'une christologie descendante (venant de Dieu, par l'Esprit) et une
christologie ascendante (conduisant des pauvres vers Dieu).
En matière de publications, Sobrino est auteur d’une abondante œuvre qui traite en toute perspicacité
de son engagement dans la lutte pour les droits des défavorisés. Sans toutefois prétendre énumérer
exhaustivement ses écrits, nous rappelons que l'impressionnante œuvre léguée par le défenseur des opprimés
n'est pas entièrement connue du public du fait qu’elles sont peu traduites en diverses langues. Néanmoins,
nous retenons de ses ouvres majeures : Jésus-Christ en Amérique latine. Sa signification pour la foi et la
christologie, qui est soumise à notre étude.
96
Christian DUQUOC, Libération et progressisme, Pris, Cerf, 1987, p. 118.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 30
1. 2. L’IMPLICATION DE SOBRINO DANS LA THEOLOGIE DE LA LIBERATION
Face à la situation de dépendance économique, sociale, politique et culturelle, ressentie comme
injuste et aliénante des pauvres de l'Amérique latine, Sobrino s’engage à l’élaboration d’une réflexion
théologique en faveur des pauvres opprimés. Partageant aussi comme tant d’autre théologiens de la
libération, cette conviction, selon les expressions de Mélano Couch du « pouvoir de Dieu de transformer en
faveur de ceux qui ne peuvent rien des situations concrètes d'oppressions »97
. Dans la même ligne d’idée que
Couch, affirme Leonardo Boff : « la théologie de la libération trouve sa source dans la foi confrontée à
l'injustice infligée aux pauvres »98
. La pensée sobrinienne s’inspire alors de la situation concrète de l'homme
afin de protester contre les mesures arbitraires et contre les spoliations en Amérique latine. Sa réflexion
christologique exposée dans cette œuvre, surgit de cette expérience évangélique, et de sa découverte de ce «
lieu théologique » que sont les pauvres. Pour Sobrino, la christologie est liée à une praxis de libération
ecclésiale et historique, et son intention consiste à aider chrétiennement cette praxis. Voilà pourquoi sa
pensée christologie s’élabore à partir de l’histoire de Jésus, car sa résurrection, ne peut pas être comprise
déliée de sa vie, son message, sa prédication, sa praxis, sa partialité envers les pauvres.
2. APPROCHE ANALYTIQUE DE L’OEUVRE
2. 1. CONTEXTE REDACTIONNEL ET PRESENTATION GENERALE DE L’ŒUVRE
Jésus en Amérique Latine, est l’une des œuvres majeurs de Sobrino, pour étayer sa pensée des suites
de réactions suscitées par la publication du précédent ouvrage : Christologia desde América Latina en 1976 ;
dans lequel il affirme que la seule voie qui mène à la compréhension du Christ est celle de « Jésus de
l’histoire ». Parut en 1982, Jésus en America Latina, traduit en français sous le titre : « Jésus en Amérique
Latine », atteste de la fidélité de Sobrino à sa pensée. Il y explique le pourquoi de sa recherche sur Jésus à
partir de son histoire, car non seulement la « Divinité », mais aussi l’« humanité » peut bien servir à la
compréhension de Jésus.
En effet, le Christ n’est autre que Jésus, autrement dit, ce Jésus qui se présente comme un prophète
itinérant, en Palestine au tout début de notre ère, le sauveur de l’humanité99
. Là, se situe l’originalité de la
pensée sobrinienne dans sa façon de prendre en compte le cheminement historique de Jésus, dont-il en fait le
principe de sa réflexion théologique. Tel que soutenu par notre auteur en ces termes : « Jésus, du fait qu’il
est homme, a une histoire et, à travers cette histoire il dévoile peu à peu ce qu’il est depuis toujours. Mais cet
être eternel, à son tour n’est pensable qu’à partir de dévoilement historique »100
. En outre Jésus en Amérique
latine, constitue à la fois un prolongement et un approfondissement par rapport à la christologie latino-
américaine ; l’expression de la nécessité de revenir au Jésus historique. L’auteur y relève la reconnaissance
en Jésus d’une présence fraternelle capable de soutenir et d’animer la lutte des opprimés pour une libération
intégrale.
Toutefois, dans le souci de mener à bien nos investigations et en vue d’éclairer de fond en comble
l’originalité de la pensée sobrinienne dans cet ouvrage, nous entendons nous limiter à ses deux derniers
chapitres, à savoir les chapitre septième et huitième portant respectivement sur : « Le ressuscité est le
crucifié » et « la foi dans le Fils de Dieu à partir d’un peuple crucifié ».
2. 2. LE RESSUSCITE EST LE CRUCIFIE
2. 2. 1. LE TRIOMPHE DE LA JUSTICE DE DIEU ET L’ESPERANCE DES CRUCIFIES EN LA RESURRECTION
La résurrection de Jésus est présentée par Sobrino comme la réponse de Dieu à l’action criminelle
des hommes. Comprise de cette manière, elle affirme directement, le triomphe de la justice de Dieu sur
l’injustice. La résurrection de Jésus se converti en bonne nouvelle, dont contenu central, est qu’une fois pour
toutes et en plénitude, la justice a triomphé de l’injustice et la victime du bourreau. Dans cette perspective, la
résurrection exige et rend possible tout ensemble, le courage de l’espérance dans la survie. Et la question qui
97
Mélano Couch « Libération, une vision biblique » in Concilium, n° 270, Paris, Beauchesne, 1997, p. 35. 98
Léonardo BOFF, Qu-est-ce que la théologie de la libération ?, Cerf, Paris, 1987, p. 15.
99
Cf. Jon SOBRINO, Jésus en Amérique latine : sa signification pour la foi et la christologie, Paris, Cerf, 1986, p 24. 100
Idem., p 86.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 31
nous est adressée en rapport à la résurrection, est de savoir si nous participons nous aussi, au scandale de
l’injustice de mettre le juste à mort, si nous sommes du coté de ceux qui l’assassinent ou du coté de Dieu qui
lui donne la vie. Néanmoins, nous retenons l’espérance chrétienne de la foi en la résurrection de Jésus
comme futur bienheureux pour notre propre personne, passe par la pratique de l’amour historique qui
consiste à donner la vie à ceux qui meurent dans l’histoire101
.
Eclairé et consolidé par cette interprétation que fait l’auteur de la résurrection de Jésus, nous pouvons
soutenir avec lui que la résurrection de Jésus est espérance pour les crucifiés. Car, ceux-ci trouve en Jésus le
courage d’espérer leur propre résurrection et de continuer à vivre dans l’histoire cette catégorie de pro-
existence. En fait, telle qu’énoncé par l’auteur, du moment où « Dieu à ressuscité un crucifié et, dès lors, il y
a espérance pour les crucifié de l’histoire »102
. Cette espérance se fonde dans l’existence du peuple crucifié
vécue comme un « être-pour-les-autres » et « pour-le-tout-Autre » où la vie se comprend comme une
« existence pour les autres ». IL convient alors de rappeler qu’ils sont des millions dans le monde à mourir
de diverses manières, comme Jésus, aux mains des païens, aux mains des idolâtres modernes de la richesse
absolutisée. Beaucoup d’hommes meurent réellement crucifiés, assassinés, torturés, portés disparus à cause
de la justice. Bien d’autres encore, par millions, meurent de la lente crucifixion de l’injustice
structurellement établie. Il y a aujourd’hui des peuples entiers que les convoitises d’autres hommes
convertissent en rebuts et en déchets humains, des peuples sans visage ni figures comme le crucifié103
.
Cette situation, malheureusement, n’est pas simple métaphore, mais bien réalité quotidienne. Et ce
qui donne aujourd’hui, véritable crédibilité à la résurrection de Jésus, c’est le fait qu’elle peut apporter
l’espérance aux crucifiés de l’histoire. La résurrection de Jésus se convertit alors, en symbole universel
d’espérance, dans la mesure où les peuples crucifiés participent en quelque manière à la crucifixion. Et, du
moment où la mort des opprimés a la qualité de crucifixion. C’est à partir de ce type mort, fût-ce de manière
analogique, que l’on possède l’espérance chrétienne en la résurrection.
2. 2. 2. CREDIBILITE DE LA PUISSANCE DE DIEU A TRAVERS LA CROIX
Ce que la croix dit en langage chrétien, c’est que rien dans l’histoire ne peut poser de limites à la
proximité de Dieu envers les hommes. La croix de Jésus constitue l’expression la plus achevée de l’amour
immense de Dieu pour les crucifiés. Croix de Jésus dit, d’une manière digne de foi, que Dieu aime les
hommes, que Dieu prononce à leur égard une parole d’amour et de salut. Et que, Lui-même se donne comme
amour et comme salut. Fort de cette saisie de la présence de Dieu sur la croix de Jésus, les crucifiés de
l’histoire comprennent quelque chose de fondamentale : Dieu à passé avec succès l’épreuve de l’amour. Dès
lors, ils sont poussés à croire en son pouvoir, tel qu’affirme Sobrino, à savoir que « le pouvoir de Dieu n’est
pas oppresseur, mais sauveur, qu’il n’est pas pure altérité envers eux, mais proximité amoureuse »104
.
De cette manière la résurrection de Jésus se converti pour les crucifiés en symbole d’espérance, les
appelant à l’obstination de l’espérance, par ce qu’elle est manifestation non seulement du pouvoir, mais de
l’amour de Dieu. Amour divin, qui transforme les expectatives en espérance. Le Crucifié rend croyable le
Dieu qui donne la vie aux morts, parce qu’il le présente comme un Dieu d’amour et, par conséquent, comme
une espérance pour les crucifiés.
2. 3. LA FOI DANS LE FILS DE DIEU A PARTIR D’UN PEUPLE CRUCIFIE
2. 3. 1. LE SERVITEUR DE YAHVE ET LE PEUPLE CRUCIFIE A partir de la ressemblance qui s’établie entre le peuple crucifié et le Fils de Dieu qui a pris forme de
serviteur105
, le peuple crucifié est considéré dans la réflexion christologique sobrinienne comme la continuité
historique du serviteur souffrant de Yahvé. Il s’agit bien évidement, du peuple latino-américain, qui vie une
réalité de crucifixion exprimée dans la misère qui marginalise de grands groupes humains. Situation
d’inhumaine pauvreté dans laquelle vivent de million de personnes en Amérique latine, qui les asservit, les
prive de leur dignité. C’est l’expression d’une société matérialiste et déshumanisant qui fait que les riches
101
Cf. Jon SOBRINO, Jésus en Amérique latine : sa signification pour la foi et la christologie, Op.cit., p. 249. 102
Idem., p. 250. 103
Cf. Jon SOBRINO, Jésus en Amérique latine : sa signification pour la foi et la christologie, Op.cit., pp. 250-251. 104
Idem., p. 253. 105
Cf. Jon SOBRINO, Jésus en Amérique latine : sa signification pour la foi et la christologie, Op.cit., p. 264.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 32
sont toujours plus riches, et les pauvres toujours plus pauvres106
. De cette réalité de pauvreté injuste, se
détermine toute la réalité du peuple crucifié. Et, c’est à partir de cet état qu’il faut discerner la ressemble du
peuple crucifié au serviteur souffrant de Yahvé. C’est-à-dire à Jésus crucifié. C’est ce cri d’un peuple qui
soufre et qui demande justice, liberté, respect des droits fondamentaux de l’homme et des peuples ; qui
exprime le désir véhément d’émancipation totale, de libération de toute servitude qui retenti sans cesse au
cœur de Sobrino de manière tumultueuse et impressionnante, dont-il s’engage à la défense107
.
Certes, il s’avère difficile de déterminer avec exactitude en quel sens un peuple crucifié est
aujourd’hui la continuation du serviteur de Yahvé, mais il est sans ignorer que bien des peuples d’Amérique
latine reproduisent des traits caractéristiques du serviteur souffrant de Yahvé. Ce sont des peuples qui sont
tout d’abord, privés de visage humain, des peuples que l’on dépouille de toute justice, dont les droits
fondamentaux sont violés et le droit à la vie foulé aux pieds. Ce sont des peuples, qui comme le serviteur
cherche à établir la justice et le droit, qui lutte pour la libération du peuple des pauvres. Des peuples, qui non
seulement exprime une oppression de fait, mais qui sont activement réprimés et poursuivis. Précisément,
lorsque comme le serviteur, ils tentent d’instaurer la justice et le droit. Ce sont des peuples, enfin, qui se
savent élus pour que le salut passe à travers eux et qui interprètent leur propre oppression et répression
comme chemin pour la libération108
. C’est donc dans la ligne de Jésus comme serviteur souffrant de Yahvé
que le peuple crucifié réalise cette présence du Christ dans l’histoire et se détermine comme porteur d’une
sotériologie historique.
2. 3. 2. LA FOI DANS LE FILS DE DIEU
Jon Sobrino, entend formuler dans la terminologie de Fils de Dieu, la réalité de ce Christ qui est ainsi
cru, à travers ce témoignage de l’efficacité historique de la foi dans le Christ. Comme le traduit Sobrino :
« La simple réalité historique d’un peuple crucifié est un cri poussé vers Dieu, avant même que ces
gémissements ne s’explicitent de manière réfléchie »109
. Car ce peuple bien que crucifié, qui maintien en
même temps sa marche à la suite de Jésus donne déjà une réponse chrétienne à sa souffrance. Bien
évidement, la foi des crucifiés se caractérise dans le fait même qu’ils maintiennent simultanément le Dieu
libérateur de l’Exode et le Dieu de la croix. Ils disent par là même qu’ils croient en Dieu et ce qu’ils
entendent par ce Dieu auquel ils croient110
. Le « Dieu » dont Jésus est le « Fils ».
Et, si le peuple crucifié croit en Jésus comme étant le Fils, c’est parce que, en lui, la vérité et l’amour
du mystère qu’est Dieu se sont manifestés de manière unique et irréversible. D’où, l’acceptation de la
relation unique de Jésus avec Dieu, de sorte que le peuple crucifier peut bien aller jusqu’à le confesser en
vérité le Fils de Dieu. Ils croient réellement et pleinement en Jésus comme Fils de Dieu d’une véritable foi
qui devient victoire à travers les épreuves, foi dans le Dieu de la défense des pauvres, le Dieu de la
libération111
.
3. EVALUATION CRITIQUE DE L’OEUVRE
3. 1. ORIGINALITE ET PORTEE DE LA PENSEE SOBRINIENNE
Dans le contexte de la théologie latino-américaine de la libération, Jon Sobrino soutien qu’il y a dans
l’histoire humaine un continuateur de l’œuvre salvifique réalisée de manière définitive par le Fils. Il affirme
avec véhémence que le « peuple crucifié est la continuation historique du serviteur de Yahvé, qui continue à
être dépouillé de tout par le péché du monde, à qui l’on continue à arracher jusqu’à la vie »112
. Par ailleurs,
la vision selon laquelle la divinité de Jésus se montre justement dans sa solidarité avec les plus pauvres est
fondamentale à la réflexion théologique de Sobrino. Fort de cette conviction, il fait le choix prioritaire des
opprimés, d’où son engagement en faveur des pauvres. Cette praxis libératrice de Sobrino est le témoignage
106
Cf. Jon SOBRINO, « Amérique Latine, lieu de péché lieu de pardon », in Concilium n°204, Paris, Beauchesne, 1986, pp. 61-
62. 107
Cf. Idem., p. 62. 108
Cf. Jon SOBRINO, Jésus en Amérique latine : sa signification pour la foi et la christologie, Op.cit., pp. 266-267. 109
Jon SOBRINO, Jésus en Amérique latine : sa signification pour la foi et la christologie, Op.cit., p. 272. 110
Cf. Ibidem 111
Cf. Jon SOBRINO, « Amérique Latine, lieu de péché lieu de pardon », Op.cit., p 64. 112
Jon SOBRINO, Jésus en Amérique latine : sa signification pour la foi et la christologie, Op.cit., p. 264.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 33
de son option préférentielle pour les pauvres, selon que : dans les pauvres, c’est Dieu même qui s’est fait
présent dans l’histoire.
En outre, Sobrino initie un projet social qui vise à transformer la société et à triompher des
conditions de pauvreté, d'oppression et de violence. Pour lui, les pauvres représentent le véritable lieu
théologique de la compréhension de la vérité et de la praxis chrétienne. Il se propose comme tant d’autres
théologiens latino-américains à promouvoir la libération des pauvres de leur pauvreté et à de dénoncer dans
le capitalisme, la cause de l’aliénation à la pauvreté de millions d’individus.
Sa réflexion théologique se veut alors porteuse d’une espérance, pour ces personnes bafouées dans
leur dignité et dans leurs droits. Sobrino s’engage positivement dans la lutte contre le péché en s’attaquant
aux structures d’oppression et de violence, pour de nouvelles structures encore plus juste. Il appelle à la
conscientisation, à l’organisation politico-sociale, pastorale et aux mouvements de libération, pour un
acheminent vers le changement de structure. Ceci dit, la finalité pratique de son engagement et de toute
abnégation, vise à substituer, à l’anti-règne le règne de Dieu, à l’injustice la justice, à l’oppression la liberté,
à l’égoïsme l’amour, à la mort la vie113
.
Aujourd’hui encore, tant d’hommes et de femmes et de femme sont dépouillés de leurs droits,
bafoués et méprisés par leurs frères. Les pauvres sont écrasés par les puissants et les faibles pâtissent des
plus forts. On leur enlève leurs terres, on achète à bas prix leur travail, on piétine leur droit. Nous tairons
nous encore longtemps face à cette situation qui sévi non seulement en Amérique latine, mais aussi d’une
manière beaucoup plus alarmante en Afrique ? Ce modèle de penseur pour la libération que représente
Sobrino ne susciterait-il pas un engagement de notre part, de sorte que notre bouche crie justice, que nos
mains sèment le droit, afin que tout homme soit revêtu de dignité.
3. 2. QUELQUES FAIBLESSES DE LA PENSEE SOBRINIENNE
Il est surtout reproché à Sobrino d'avoir davantage décrit Jésus-Christ comme un accompagnateur des
hommes que comme un sauveur divin. Il aurait d’avantage insister sur la dimension humaine du Christ plus
que sur sa dimension divine. En plus de cela, un autre problème se pose dans sa considération du peuple
crucifié comme porteur de sotériologie historique, puisque à partir de cette considération, la réalité injuste et
inhumaine du peuple crucifié peut être facilement justifiée en cherchant de « bons » arguments théologiques
dans la Croix de Jésus.
Par ailleurs l’on décèle aussi certaines discontinuités dans la façon de considérer que le peuple
crucifié rend historiquement présent le Christ crucifié. Notamment, lorsqu’il se centre seulement sur la
crucifixion pour trouver les ressemblances et la continuité entre le peuple souffrant et le Christ, crucifié.
L’auteur oublierait par là que, Jésus-Christ comme événement dans l’histoire, est un fait unique : sa vie, sa
Croix, sa mort, sa résurrection ont un caractère définitif, une fois pour toutes. A cet effet, il faut préciser que,
malgré se discours christologique qui à pour source de réflexion le point de vue du pauvre et de l'opprimé.
Dieu ne doit pas apparaître comme Celui qui a besoin des sacrifices humains, de la douleur et de la
souffrance pour accomplir et réaliser sa volonté ultime et salvifique dans l’humanité. D’ailleurs, nonobstant
la ressemblance qu’il puisse établir entre le peuple crucifié et le serviteur souffrant de Yahvé, aucun signe
historique n’épuisera ce mystère salvifique manifesté de manière définitive en Jésus-Christ. Quelque soit,
l’aspect positif et salvifique des croix des peuples, leurs crucifixions n’auront jamais l’efficacité, la valeur
universelle et définitive présente dans la vie, la mort et la Croix du Christ.
CONCLUSION
En somme, il ressort de nos investigations que la théologie de libération apparaît comme un
engagement religieux dans la lutte contre la pauvreté et l’oppression. Ceci etant, plus qu’une une simple
réflexion sur la pauvreté, ou une réflexion en faveur des pauvres et à la place des pauvres, la théologie de
libération se présente comme une réflexion avec les pauvres. C’est bien pour cette noble cause que Sobrino
apporte un soutien sans faille à la lutte des pauvres. Il s’adonne à la libération des pauvres, du joug de la
servitude et de l'exploitation à travers ses œuvres qui visent à aider et à soutenir de tels chrétiens dans la
défense de la cause des pauvres et des opprimés. Efforts conjugués, en vue d’une société dans laquelle
113
Cf. Jon SOBRINO, « Amérique Latine, lieu de péché lieu de pardon », Op.cit., p. 63.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 34
chacun — et non seulement ceux qui ont la richesse, la puissance et l'influence — ait sa place dans la dignité
et le respect.
Par ailleurs, les crucifiés de l’histoire nous offrent, selon Sobrino, le privilège d’une compréhension
purement chrétienne de la résurrection de Jésus114
. Pour ce faire, il établit ainsi une certaine ressemblance
entre le peuple crucifié et le ressuscité, qui n’est autre que Jésus de Nazareth. Cette démarche vise à donner
une forme chrétienne concrète à quelques aspects de la résurrection de Jésus en partant de sa réalité de
crucifié, laquelle, à son tour, se laisse mieux découvrir à partir des crucifiés de l’histoire115
. Tout cela
témoigne d’une véritable expression de foi en Jésus, lorsqu’il arrive que, le « Libérateur »116
produise sur
des personnes concrètes une impression si décisive que celles-ci en reçoivent le courage de se livrer
inconditionnellement a Jésus dans la vie et dans la mort, en vue du salut.
Mais, sans toute fois prétendre à la plénitude du salut déjà donné par le Fils, l’effort du théologien de
la libération se veut porteuse d’une espérance pour ces personnes bafouées dans leur dignité et dans leurs
droits. Sobrino, s’engage alors pour la libération intégrale de tout l’homme. Il cherche à donner plus de
lucidité et de courage aux chrétiens qui suivent Jésus et qui son en quête de conversion, qui luttent pour la
justice et contre l’oppression, qui défende la cause du pauvre et de l’opprimé, qui souffrent persécution et
qui parfois meurent comme Jésus crucifié. Ainsi, Dieu participe et s’incarne dans l’histoire humaine en
bâtissant un projet libérateur et d’amour.
Par TANO ARSENE
2.2.5 EXPOSE 5 : LA NOICEUR DE DIEU PAR JAMES H. CONE
INTRODUCTION
L’histoire de la Révélation de Dieu avec le peuple d’Israël se situe dans une ambiance de délivrance.
Il fait sortir le peuple d’Israël sous le joug de l’esclavage d’Egypte en affirmant : « Je suis Yahvé, ton Dieu,
qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » (Exode 20.1.) Dieu est ainsi identifié à un
Être Sauveur, celui qui vit et fait vivre les êtres en leur donnant une véritable liberté. Comme le peuple
d’Israël, un certain nombre d’Africains ont connu la dure épreuve, avec les colons anglais d’Amérique du
Nord qui, pour résoudre leur déficit en main-d’œuvre, se sont tournés graduellement vers l’Afrique pour
faire de ses fils et filles vigoureux des esclaves à partir du XIVe siècle. Le peuple noir vivant alors en
diaspora ayant constaté qu’au-delà de la traite négrière et du trafique triangulaire dont ils sont les enjeux, il y
a une déshumanisation de leur dignité par leurs maîtres, car cela est perceptible à travers l’oppression, la
barricade par un long calvaire de corvée, de travaux forcés et une vie dans des ghettos au milieu des ordures
et des rats en dépit de leur effort physique quotidien.
Face à tous ces tares qui infligent peine et détresse, il devient nécessaire pour ceux qui ont perdu leur
culture, leur religion, voire leur histoire de se créer une Théologie à partir du besoin qu’ils éprouvent de se
libérer des oppresseurs. Dès lors, naît la Théologie Noire avec James Cone. Elleest une théologie de
libération parce qu’elle émane d’une identification avec les Noirs opprimés en Amérique, cherchant à
interpréter l’Evangile du Christ à la lumière de la condition noire. C’est la raison des efforts pour analyser la
nature de l’Evangile de Jésus-Christ à la lumière des Noirs opprimés de telle sorte que les Noirs puissent
voir l’Evangile comme inséparable de leur condition humiliée, et leur procurant la force nécessaire pour
briser les chaînes de l’oppression.
Le Théologien James Hal Cone est né le 5 Août 1938 à Fordyce aux Etats Unis d’Amérique. Pasteur de
l’Eglise African Methodist Episcopal Church à l’âge de seize ans, James Cone est docteur en théologie
systématique et enseigne dans la Faculté de l’Union Theological Seminary de New York. Il a lu les signes
de son temps et a jugé bon de mettre en place une théologie systématique Noire pour la libération de son
peuple opprimé par les tares de l’esclavage, de la ségrégation et d’autres maux qui dominaient le monde
occidental. Il a mis en place aussi une théologie chrétienne qui a été basée sur l’expérience afro-américaine,
l’histoire et la culture. Il est auteur de plusieurs œuvres, dont La Théologie Noire et du Black Power (1969),
Une Théologie Noire de la libération (1970), For My People : La Théologie Noire et l'église noire (1984),
Martin & Malcolm & Amérique : Rêve ou cauchemar (1992) et Dit la vérité : L’œcuménisme, la libération
114
Cf. Jon SOBRINO, Jésus en Amérique latine : sa signification pour la foi et la christologie, Op.cit., p. 246. 115
Cf. Ibidem 116
Idem, p. 273.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 35
et la Théologie Noire (1999). Cône continue sa pensée et reste un théologien, écrivain, prédicateur,
enseignant éminent et influant.
Ainsi dit, notre travail s’articulera autour de deux parties majeures. Nous évoquerons en premier lieu les
idées fortes de La Noirceur de Dieu qui englobe à la fois le sens de la libération et la libération divine avec
la souffrance noire. En second lieu, nous aborderons la partie critique de l’œuvre pour faire ressortir les
aspects positifs de la théologie de Cone ainsi que les faiblesses de sa pensée.
1. LES IDEES FORTES DE LA NOICEUR DE DIEU
Dans ce résumé de l’ouvrage, nous avons sélectionné deux chapitres denses de la pensée de l’auteur pour
effectuer notre étude. C’est le chapitre 7 du livre qui est intitulé sens de la libération et le chapitre 8 qui traite
de la libération divine et souffrance noire.
1.1. Le sens de la libération
Dans cette section, Jésus-Christ est le fondement de la libération. La libération de Jésus donne sens à
la liberté d’être en relation avec Dieu, soi-même et avec les opprimés. C’est aussi une libération qui
s’affiche comme étant un projet de liberté dans l’histoire et dans l’espérance.
1.1.1. Auteur et raison de la libération
Pour Cone, « la libération humaine est l’œuvre divine du salut en Jésus Christ »117
. Jésus-Christ dans sa
double nature humaine et divine est le point alpha, le point de départ de la théologie de libération. Dès lors
qu’elle est une œuvre supra-humaine, la libération est conditionnée par l’être réel de Jésus, comme être
concret, historique et être d’une puissance de foi. C’est pour cela qu’elle est vue par l’auteur comme un
« don divin accordé à ceux qui luttent dans la foi contre la violence et l’oppression »118
.Puisque dans les
conditions difficiles de la vie menées par des hommes, Dieu ne peut qu’octroyer à ceux qui ont raison et qui
ont foi en lui un pouvoir pour détruire les puissances avilissantes de l’oppression. C’est la liberté qui est un
droit et un devoir venant du Créateur Lui-même pour soutenir les efforts de ses fils.
Le fait que Dieu, le Père de Jésus est liberté en soi, et que cette nature libératrice de Dieu se laisse voir dans
les faits concrets de l’Exode, il donne pouvoir à son Fils par l’Incarnation d’être la libération et le salut de
ceux qui croit en lui. Ainsi dit, « le Dieu biblique est le Dieu dont le salut est libération »119
. Dieu n’est plus
celui qui est caché dans les cieux mais celui qui lutte et combat pour nous et avec nous contre l’oppression.
La raison de la liberté christique est que Jésus qui connait bien notre condition humaine veut redonner la vie
à ceux qui sont désespérés. En fait, dans son agonit sur la croix, Jésus a senti la douleur de l’abandon. Ce qui
explique que c’est Dieu qui souffre avec nous, avec le peuple noir dans son contexte, dans l’optique de le
libéré de ses vicissitudes. C’est le sens de sa lutte en faveur des faibles, des pauvres et malheureux pour
renouveler leur existence. C’est une lutte salutaire à visée proleptique mais qui fait déjà irruption dans
l’aujourd’hui, par Jésus renversant les puissances oppressives du mal120
.
1.1.2. Les bénéficiaires et les moyens de la libération
L’acteur principal dans cette conquête de la liberté dans l’histoire des hommes est Dieu. Il lutte pour
que l’homme soit en communion avec lui121
mais une communion qui est basée sur la foi. Cela dans la foi.
Cette communion avec Dieu chez l’homme de foi s’effectue par sa réponse à l’Evangile, sa conversion, ses
prières et le culte communautaire qui sont la force de l’homme noir qui se tourne vers Dieu, se remet à lui
tout en espérant à sa grande bonté. C’est une rencontre métamorphique du Dasein même de l’homme que
l’auteur décrit ainsi : « rencontre entre l’humain et le divin entrainant la mort d’un être à son ancienne vie et
son accession par la libération à une nouvelle forme d’existence ».122
Cette conversion, cette adhésion sans
faille à Dieu a pour effet la libération totale.
117
James H. CONE, La noirceur de Dieu, Genève, Labor et Fides, 1989, p. 167. 118
Ibidem. 119
Idem, p. 168. 120
Idem, p. 169. 121
Cf. Idem, p. 171. 122
Idem, p. 171.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 36
Le bénéficiaire de cette grâce divine l’accède quand il reste en intimité avec Dieu. Cela d’abord par
le biais de la prière qui est « le commencement de la pratique chrétienne de la libération ».123
Le rapport
orant de l’homme avec son Dieu est le fondement de la véritable lutte historique pour la libération. Aussi,
par le moyen du culte communautaire, le témoignage de ceux qui ont fait l’expérience de la présence de
Dieu dans leur vie libère et réconforte les autres. En somme, « par la prière, le témoignage, le chant et le
sermon, le peuple dépasse les limitations de son histoire immédiate et rencontre la puissance divine ».124
C’est le moment fort d’une rencontre libératrice avec l’Esprit divin, la célébration de la liberté, la
communion avec Dieu qui résulte de la rédemption christique.
1.1.3. Ce que Dieu les a libéré
Selon James, la liberté a un sens lorsqu’il y a des opprimés, le Christ lui-même a lié son œuvre de
libérations aux luttes des malheureux de la terre.125
Paradoxalement, le théologien
blancs affirment qu’ils sont aussi opprimés en dépit de l’évidence de contradiction de la vie de leurs églises
avec l’Evangile de libération prêché par Jésus. C’est pourquoi Cone dira qu’en réalité, sans le savoir, ils sont
aussi opprimés et doivent lutter « pour se libérer de leur culture, et se solidariser avec la liberté culturelle des
pauvres ».126
La lutte pour la libération est pour tous, dans la mesure que l’accès au Royaume des cieux
nécessite la pauvreté spirituelle, le devenir esclave de tous (cf. Mc 10, 42-45), l’humilité, le bon rapport
humain et l’abolition des désires de domination. C’est pourquoi « les opprimés devront donc combattre les
oppresseurs afin de lutter pour eux ».127
Car il n’y a pas de liberté sans engagement révolutionnaire contre
l’injustice, l’esclavage, l’oppression.
La libération de Dieu est la délivrance des opprimés, des pauvres par des actes de puissances,
restauration même de l’intégrité physique et spirituelle. La conscience qu’a les opprimés que Dieu les a
libéré est perceptible à travers « le contexte historique de la réflexion et de l’action que les opprimés se
rendent compte que Dieu se bat à leurs côtés dans leur lutte de la libération ».128
Son combat est une réalité
terrestre exprimable par les actes même qu’ont posés Jésus sur terre. Bien vrai qu’il y a le pas encore dans la
libération, puisqu’il y a l’attente d’une promesse libératrice de Dieu, mais dans la résurrection de Jésus, le
déjà-là est plausible,
du fait que, « Dieu nous a libérés pour que nous luttions contre les structures sociales et politiques sans en
être déterminé… »129
. La libération divine est au-delà de la temporalité, c’est une libération même de la mort
pour plonger le croyant dans les réalités eschatologiques.
1.2. Libération divine et souffrance noire
Pour comprendre le sens de la souffrance des noirs, le théologien Cone nous renvoi à l’étude
compréhensive du sens de la souffrance dans la Bible, dans la tradition théologique occidentale et dans la
tradition religieuse noire.
1.2.1. Fondements théologiques et expérience de la souffrance
Dans les Saintes Ecritures, la souffrance du peuple élu a été oblitérée par Dieu qui a combattu pour
eux contre les puissants et les orgueilleux. L’Exode devient ainsi un évènement capital dans la foi
vétérotestamentaire. Mais la foi des Israélites va connaître une défaillance, cela dans la distribution
inéquitable de la souffrance. En fait, certains souffrent atrocement et d’autres se réjouissent ; pire, les
méchants prospèrent tandis que le juste, le fidèle de Dieu souffre.130
Dès lors, ils vont donner une condition
indue à la souffrance comme
étant une peine infligée par Dieu à ceux qui l’ont offensé : « La souffrance comme juste punition du
péché »131
. Mais étant donné que le méchant ne souffrait pas toujours de ses mauvaises actions et que le
123
Idem, p. 173. 124
Ibidem. 125
Idem, p. 177. 126
Idem, p. 178. 127
Idem, p. 181. 128
Idem, p. 186. 129
Idem, p. 188. 130
Idem, p. 195. 131
Idem, p. 196.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 37
juste ne devenait pas aussi prospère comme il se le doit selon la justice de Dieu, Habaquq et Jérémie vont
plaidoyer par des prières contre ce phénomène. (Cf. Jr 12, 1 et Ha 1, 13).Finalement, le peuple de Dieu
comprendra que la souffrance est réelle et malgré son existence, la justice souveraine de Yahweh est
évidente avec sa volonté d’établir l’équité dans l’humanité.132
Même de l’épreuve endurée par Job, il n’y a pas de lien nécessaire entre la souffrance et l’adversité
avec la justice et la méchanceté. (Jb 42, 3-5). Il convient donc d’admettre des réponses bibliques face à la
souffrance du juste : elle peut être d’abord destinée à éprouver la foi. C’est le cas de Job, (Jb 1, 6-12) ou la
ligature d’Isaac (Cf. Gn 22, 1-19). Elle peut avoir aussi un motif de rédemption (Cf. Jb 42, 12 ; Es 53, 11).
En substance, la souffrance qu’a expérimentée Israël en dépit de son élection par Dieu montre qu’il a une
mission, celle « d’être le peuple de Yahweh dans ce monde en exprimant la présence libératrice de Dieu
parmi les nations »133
. Israël est alors appelé à collaborer avec Dieu en tant que partenaire pour établir la
justice.
Dans le Nouveau Testament, le thème de serviteur souffrant susmentionné est évident. Plusieurs
échos illustrent que Jésus est le serviteur souffrant: « Jésus s’identifie sans ambiguïté avec le serviteur
souffrant d’Isaïe 53 à travers ses logia qui se trouvent dans Mc 10, 45, dans Jn 1, 29. 36 et dans 1 Co 15,
3 »134
. Dieu s’est fait homme en Jésus-Christ dont la vie, la mort et la résurrection a remporté la victoire sur
les puissances nuisibles, accordant ainsi une liberté pour lutter contre la souffrance destructrice de
l’humanité.
1.2.2. L’avènement de la Théologie Noire face à sa souffrance
Pour James Cone, la théologie occidentale est marquée par une pure cogitation philosophique qui
l’éloigne des implications directes face aux réalités de la souffrance des humbles : « Ils passent plus de
temps à débattre de l’origine du mal à coup de spéculations
Métaphysiques qu’à montrer ce que les autres devront faire pour éliminer les structures sociales et politiques
qui sont à sa racine »135
. Dès lors, James Cone met les pensées des grands théologiens occidentaux comme
John Hick, Iréné et Augustin sur les bancs des accusés car sont-elles incapable de débusquer les structures
politiques qui soutiennent la souffrance des
hommes : « Bien vrai qu’Augustin et Iréné diffèrent effectivement sur de nombreux points, ni l’un ni l’autre
n’ont beaucoup à dire sur le fait que Dieu donne aux opprimés la force de lutter contre l’injustice. (...) Même
John Hick, qui paraît conscient des limitations des analyses théoriques du mal, n’y ajoute rien concernant la
libération des opprimés. »136
Face à ce délaissement théologique occidental, le contexte de la lutte pour la
libération des Noirs naît contre les multiformes d’esclavage, d’oppression, d’asservissement, et d’injustice
que le peuple Noir de foi est victime en Amérique du Nord.
La force pour la lutte contextuelle à sa source dans la Bible, elle dérive du fait que « de même que
Dieu avait délivré Moïse et les Israélites de l’esclavage d’Egypte, Daniel de la fosse aux lions, et les jeunes
hébreux de la fournaise, il délivrerait aussi les Noirs de l’esclavage américain »137
. Mais certaines personnes
plongées dans le désarroi total nient la capacité de Dieu à les délier de la souffrance. C’est le cas des
Seculars des esclaves, des Blues, des œuvres de Harlem Renaissance, le mouvement Black Power et la
philosophie de William Jones qui estiment que le combat pour la libération de la tyrannie raciale sera
l’œuvre des Noirs eux-mêmes et non pas Dieu138
. Le Dieu de Jésus-Christ est vu comme un opium pour
endormir le peuple noir et non l’ultime solution qui décante la situation dramatique dans laquelle il est
plongé. Dès lors, la foi chrétienne considérée comme la religion du Blanc utilisée pour justifier
idéologiquement la passivité des Noirs envers l’oppression fut sévèrement attaquée par l’intelligentsia
noire139
.
132
Ibidem. 133
Idem, p. 201. 134
Idem, p. 203. 135
Idem, p. 209. 136
Idem, p. 210. 137
Idem, p. 214. 138
Cf. Idem, p. 215. 139
Cf. Idem, p. 217.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 38
D’aucuns diront aussi que c’est par la seule activité politique qu’ils buteront la souffrance or de leurs
cités. Dès lors, ils érigent des associations comme le Congrès pour l’Égalité Raciale (C.O.R.E.),
l’Association Nationale pour l’Avance des Peuples de Couleur (N.A.A.C.P.)140
. Toutefois, il y a une
majorité chrétienne Noire qui croit à l’impact de Dieu sur leur vie dans la société blanche. Ainsi, William
Jones devient une figure emblématique de cette lutte chrétienne par sa pensée théologique qui attire
l’attention sur ses enjeux.141
Il n’est pas seul dans sa lutte, les prédicateurs noirs comme l’Evêque
Méthodiste Payne Daniel et Nathaniel Paul sont torturés par ce problème de souffrance et font monter leur
ras-le-bol au Seigneur qui ne tarda pas a leur donné des réponses positives.142
1.2.3.Interventions de Dieu
Dans l’expérience douloureuse de cette vie de servitude, le peuple noir était incapable de donner des
réponses adéquates sur le motif de leur esclavage, sur le pourquoi il leur est-il permis de souffrir tant. Mais
des explications n’y manqueront pas, puisque derrière l’histoire universelle, il y a un Maître qui dirige tout.
Premièrement, le mystère de l’esclavage noir est perçu comme une providence divine. Selon les
tenants de cette position, « Dieu a voulu l’esclavage des Africains en Amérique afin que les Noirs
américains puissent éventuellement retourner dans leur pays d’origine pour soulever le voile d’obscurité qui
enveloppe leurs frères moins fortunés, et ouvrir le continent africain au développement moderne… »143
.
Selon cette théorie, les noirs sont venus chez les blancs par la providence de Dieu dans l’optique
d’apprendre de leur civilisation pour l’appliquer chez eux et avancer ainsi leur peuple dans tous les
domaines divers et cela de concert avec les autres peuples du monde.
Deuxièmement, Nathaniel Paul et Daniel Payne conçoivent le mystère de l’esclavage noir et de la
libération divine comme trouvant son fondement dans la justice de Dieu et sa volonté d’agir comme Dieu, en
établissant la justice selon ses saintes voies.144
Cette expérience de la bonté justificatrice de Dieu trouve sa
raison d’être dans l’abolition de l’esclavage légal en Amérique du Nord. Cette action est perçue comme un
signe libérateur de Dieu en faveur des esclaves noirs.145
Dieu qui agit en faveur des déclassés pour les libérer
de l’oppression.
Troisièmement, pour les théologiens noirs américains libérés, l’évènement décisif de la libération est
Jésus-Christ. En effet, face à cette souffrance atroce que le peuple vivait, les chrétiens ont rencontré Jésus,
celui là-même qui a vécu avec eux, solidaire dans leur souffrance en leur donnant le courage et la force pour
lutter et tenir bon jusqu’au bout de la lutte victorieuse. C’est ce qui leur ferra dire que : « Jésus-Christ ! Il est
l’Alpha et l’Omega, celui qui est mort sur la croix et qui est ressuscité pour que nous soyons libres de lutter
pour affirmer l’humanité noire »146
. La liberté a désormais un acteur principal, Jésus de Nazareth. En claire,
étant venu vers eux comme un ami, Jésus s’est montré le secours des faibles, des sans défenses ; sa présence
dans leur vie est le signe vrai de l’œuvre de Dieu pour la libération des opprimés.
2. CRITIQUES DE L’OUEUVRE
Cette deuxième partie de notre travail nous offre l’opportunité de donner notre vision globale sur
l’œuvre de James Cone. Nous l’avons scindé alors en deux parties antagonistes.
2.1. Les aspects positifs de la théologie de James Cone
Apparue dans les années 60, la Théologie Noire de James Cone a été un moyen de libération pour les Noirs
américains. Elle a été utilisée pour analyser le sens de sa libération, de telle sorte que les opprimés puissent
savoir que leur lutte pour la justice politique, sociale et économique est compatible avec 1’Evangile de
Jésus-Christ. La relecture de la Bible permettait une interprétation de ce qu’ils vivaient : conditions de vie
difficiles, aspirations, effort d’auto-organisation, répressions, prise en compte par Dieu de leur cause,
perception de Dieu comme le libérateur des opprimés et le garant du droit des pauvres.
140
Cf. Idem, p. 219. 141
Cf. Idem, p. 220. 142
Cf. Ibidem. 143
G. WILMORE, « Black Religion and Black Radicalism », in James H. Cone, op. cit., p. 221. 144
James H. Cone, op. cit., p. 222. 145
Cf. Ibidem. 146
Idem, p. 224.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 39
Dans le combat contre le mal, l’injustice, les théologiens noirs utilisent la méthode dialectique pour
démasquer les erreurs. Etant donné que la dialectique est critique, cette méthode utilisée par James Cone suit
le processus tripartite : « négation, conservation et transformation. »147
Elle a permis aux théologiens noirs
de dénoncer les erreurs classiques pour que tous les opprimés trouvent un sens dans l’Evangile.
James Cone par ses pensées soutenues par la foi en un Dieu libérateur a engagé toute l’Eglise noire dans la
lutte de la libération. A ce propos, Cornel WEST dans un article intitulé Théologie Noire et pensée marxiste,
stipule ceci : « En essayant de comprendre le sort des Noirs à la lumière de la Bible, les théologiens noirs
privilégient la vérité biblique qui place Dieu du côté des opprimés et qui Le fait intervenir en leur faveur.
Ensuite, il ya osmose entre l’expérience historique noire et la Bible, chacune éclairant l’autre. »148
Cette
pensée soutient bien que la lutte pour la libération est évangélique, elle est raisonnable.
James Cone tout en dénonçant l’inégalité entre les races, l’injustice au niveau des partages équitables des
biens et de l’emploi, le manque de chances égales au niveau de l’éducation et des affaires, critique aussi
farouchement la présence impérialiste occidentale dans les Tiers Monde, leur système capitaliste de
production et leur rusé économique149
.Aussi, son analyse du sous-développement et de l’émancipation du
peuple noir, en lien avec la Bonne Nouvelle annoncée aux pauvres comme message de libération et appel à
la construction d’un monde juste et fraternel sont un pan considérable de la Théologie Noire.
La Théologie Noire reconstruit la politique sous l’autorité de Jésus. Par la prière et la praxis, sa réflexion
répercute l’appel que Dieu lance aux chrétiens noirs de se joindre aux autres peuples du Tiers Monde pour la
révolution sociale, de rejeter toute structure de
domination et d’injustice en réponse au ministère de Jésus-Christ.150
Une autre forme de sa politique est que
la rencontre des noirs avec Dieu les plongent dans l’histoire, implique des jugements, des décisions éthiques
qui concernent la libération du racisme, de la pauvreté151
, de la domination culturelle et politique et de
l’exploitation économique.
2.2. Les faiblesses de la pensée de Cone
Comme toute œuvre rationnelle de l’humain, la Théologie Noire bien vraie qu’elle utilise les grandes
valeurs cognitives et spirituelles, connait des imperfections liées à la nature humaines. D’abord, elle incite à
critiquer férocement l’Amérique capitaliste et libérale. Mais elle ne dénonce pas la richesse, le pouvoir,
l’influence des multinationales qui monopolisent la production grâce à l’aide publique et paupérise ainsi le
bas peuple.
La Théologie Noire au lieu de se pencher sur les tares qui engendrent l’inégalité sociale, « les
théologiens noirs attirent l’attention sur le comportement raciste de la société américaine »152
. Or, les
interprétation racistes de l’Evangile favorisent et encouragent le rôle que joue le racisme à savoir le
renforcement du système de production, l’injustice politico-économique. Elle ne devrait pas critiquer aux
autres ce qu’elle vit en se séparant des autres.
La Théologie Noire n’évoque pas tellement les vertus évangéliques, comme la pratique de l’amour,
la charité, la miséricorde, elle se focalise sur un seul fait à dimension socio-politico-économique. Or, comme
le stipule le pape Paul VI sur la libération évangélique, disant qu’« elle ne peut pas se cantonner dans la
simple dimension économique, politique, sociale ou culturelle, mais elle doit viser l’homme tout entier, dans
toutes ses dimensions, jusques et y compris dans son ouverture vers l’absolu, même l’Absolu de Dieu »153
.
En effet, la libération véritable est celle qui ouvre l’homme à la transcendance de Dieu d’abord avant de
faire face l’immanence, aux réalités temporelles.
147
Cornel WEST, « Théologie Noire et pensée marxiste », in COLLECTIF, La théologie Noire Américaine, Lyon, Essais et
recherches de la Faculté de Théologie de Lyon, 1982, p. 40. 148
Ibidem. 149
Idem, p. 42. 150
Déclaration de la commission théologique de la Conférence nationale des chrétiens noirs, « La Théologie Noire en 1976 », in
COLLECTIF, La théologie Noire Américaine, Lyon, Essais et recherches de la Faculté de Théologie de Lyon, 1982, p. 8 151
Ibidem, p. 7. 152
Cornel WEST, « Théologie Noire et pensée marxiste », in op. cit., p. 43. 153
PAUL VI, « La libération évangélique » in COLLECTIF, Théo encyclopédie catholique pour tous, Paris, Droguet-Ardant/ Fayart, 1992, p. 861.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 40
Outre cet aspect, il y a l’absence de l’implication de la Théologie Noire dans l’émancipation de la
femme. En effet, Jacquelyn Granten se basant sur le devoir de la Théologie Noire de James Cone qui veut
analyser la nature de l’Evangile à la lumière des
Noirs opprimés, stipule que cette théologie ne libère pas totalement : « Il y a des oppressions qui ont des
liens avec le racisme mais qui n’en découle pas : la discrimination des sexes est l’une de ces oppressions.
Les hommes noirs cherchent à se libérer des stéréotypes et des conditions de l’oppression sans tenir compte
des stéréotypes parallèles que subissent les femmes »154
. Ainsi dit, toute théologie doit tenir compte de
l’intégralité composante de sa communauté, car marginaliser un groupe de personne, c’est vivre l’injustice
qu’elle combat.
CONCLUSION
Au terme de notre travail qui a consisté en premier lieu à faire le résumé du livre « la noirceur de Dieu » de
James Hal Cone, et en second lieu de faire ressortir une critique rationnelle sur l’état de l’ouvrage, nous
pouvons affirmer que la Théologie Noire existe. Elle est une science logique dans le domaine de la foi, qui
utilise les méthodes scientifiques modernes pour découvrir ses vérités, analyser les situations existentielles
d’une communauté opprimée, et lutter pour instaurer la justice, la paix, la solidarité entre les races. Sur le sol
Américain, plusieurs inventions ont eux lieux. C’est dans cette optique que le christianisme était devenu le
garant du pouvoir des dominateurs, des maîtres. La théologie dominante devient alors oppressive et
idéologise les textes bibliques en sa faveur. Plus tard avec la même capacité innovatrice, le christianisme est
devenu l’expression de la lutte noire avec une théologie à connotation libératrice. D’où l’affrontement
libération-domination. Cependant, les arguments soutenus dans les articulations des idées de James Cone
montrent que la Théologie Noire affirme la condition noire comme le premier critère de la réalité avec
lequel l’on doit compter, mais elle affirme la révélation absolue de Dieu en Jésus-Christ. C’est une théologie
christocentrique, partant de son Incarnation jusqu’aux évènements de son ministère pascal.
Par ailleurs, notre critique a dévoilé les faiblesses que cette théologie doit faire face, à savoir la
considération des sexes, de l’âge et le niveau social de ses membres. Elle doit éviter les interprétations
racistes de l’Evangile, chercher la réconciliation avec la théologie classique car la Réforme a engendré des
séquelles qui restent une préoccupation majeure de l’œcuménisme. Elle doit faire en sorte que Blanc et Noir
se considèrent non plus par la couleur de la peau mais par la dignité humaine devant Dieu, par la justice et la
droiture.
En substance, notre auteur en tant que l’un des Pères de la Théologie Noire a fait montre d’une
ingéniosité spirituelle qui dérive certes de son intimité avec le Christ. Il reste à universaliser cette théologie
en mettant à l’écart les dénominatifs discriminatoires et racistes.
Par Soumpougdou Guy Modeste
2.2.6 EXPOSE 6 : LE CHRIST NOIR AMERICAIN PAR BRUNO CHENU
INTRODUCTION
Bruno Chenu est un prêtre assomptionniste. Il est né en 1942. Ayant séjourné à plusieurs reprises et
de long temps aux Etats-Unis, il s’est particulièrement intéressé à la théologie noire américaine. Son ouvrage
Le Christ noir américain est donc le fruit de ses contacts avec l’histoire du peuple noir américain. En effet,
Bruno Chenu découvre que les noirs américains étaient soumis à l’expérience d’une oppression terrible due
au racisme blanc. Et pourtant, c’est au cœur de cette expérience douloureuse que ce peuple a rencontré
Jésus. Un Jésus proche et sur le visage duquel chacun des fils noirs pouvaient lire ses propres traits, son
propre calvaire et son ardente espérance. Ce peuple noir américain a donc expérimenté Jésus comme un
messie libérateur vers qui il fait monter son cri, à travers ses chants, ses prières, ses prédications et ses prises
de position155
. C’est donc cette expérience noire américaine de Jésus que l’ouvrage de Chenu atteste.
Ensuite, Chenu cherche à mettre en relief le fil christologique qui se dégage de cette trame historique du
peuple noir américain : il s’agit en fait d’un cri et d’un rythme ; sortis de l’expérience d’un passage. Et la
question essentielle qui s’y pose est de savoir si, réellement, Jésus marche avec son peuple ; s’il s’identifie
au nègre humilié, en un mot s’il est noir. 154
Jacquelyn GRANT, « La théologie Noire et la femme », in op. cit, p. 28. 155
Cf. Bruno Chenu, Le Christ noir américain, Paris, Desclée, 1984, p.14–15.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 41
Dans son approche, Chenu procède en quatre étapes : il y a d’abord la longue nuit de l’esclavage ;
après un nouveau système d’oppression : la ségrégation raciale ; ensuite la promotion de la négritude qui
amène à une formalisation plus grande de la foi noire sous l’appellation de « théologie noire » ; Et enfin
l’ouverture au tiers monde. Dans notre travail, nous nous contenterons de donner un résumé de la troisième
partie de cet ouvrage concernant la promotion de la négritude : une lutte du pouvoir noir pour faire entrer les
noirs américains dans l’alliance de la fraternité. De cette lutte nait alors une christologie noire à travers une
théologie dite « théologie noire. »
I. LE MESSIE NOIR
I.1. Christ américain et Dieu nègre
Dans ce mouvement du pouvoir noir, certains penseurs – comme Albert Cleage – affirment la
négritude physique de Jésus. Une telle affirmation vise à dénoncer l’assimilation du Christ à l’entreprise
esclavagiste et impérialiste américaine. La blancheur du Christ n’est plus supportable. Seule sa négritude lui
rendra une coloration évangélique.156
En effet, la foi chrétienne est considérée comme la religion de l’homme blanc ; un outil idéologique
qui a servi à ce dernier d’asservir des millions de non-blancs à travers le monde entier. Pendant que « les
fusils réalisaient la conquête physique, la Bible assurait la domination spirituelle. »157
Ce christianisme
obligeait le pauvre peuple noir à aimer tout ce qui est blanc, lui proposant l’humilité comme idéal de vie
pour l’amener à accepter sa condition misérable, à obéir aux maîtres blancs. Le racisme se fraye alors un
chemin à travers cette religion et la discrimination dans le temple du Seigneur devient insupportable à
beaucoup. L'instrumentalisation de la religion a servi aux « maîtres » pour renforcer les liens de
subordination des Noirs. C’est dans cette logique que Malcom X fait la différence entre le christianisme et le
Christ avec bien sûr la figure prophétique respectée de Jésus dans l’Islam. Pour lui le Christianisme blanc a
trahi la personne de Jésus et son message d’amour ; d’où il propose le coran (l’Islam) comme seul lieu où le
peuple noir peut rencontrer un Dieu Noir qui agit directement à travers le peuple noir, et qui anéanti la
superbe des blancs. Cette critique de Malcom X a été approuvée par tous les militants du pouvoir noir, mais
tous ne l’ont pas suivit dans l’Islam.
A la suite de Malcom X, les critiques devenaient plus aigues et virulentes ; les militants du pouvoir
noir se sont désolidarisés d’un Christ mêlé de trop prêt à leur asservissement. L’interpellation du pouvoir
noir invitait tout chrétien à opérer un choix entre la mort avec le Christ blanc américain et la vie avec le
serviteur souffrant de Dieu. Dès lors s’exprime la fierté du peuple noir. Les noirs se réjouissent en effet de la
couleur de leur peau, de leur chevelure, du rythme et de la vigueur de leurs chants et de leurs danses.158
Ils
expriment leur mépris du Christ blanchi qui a dépouillé le pauvre Afrique et les africains. Les noirs ne
veulent donc plus de ce Christ défiguré.
Déjà dès le XIXème siècle, la négritude de Dieu avait été affirmée bien avant même celle du Christ,
par le célèbre évêque Henry Mc Neal Turner. Pour lui, les noirs ont aussi le droit de croire que Dieu est noir.
Car si dès les origines, toutes les races ont essayé de décrire leur Dieu par des mots, des peintures ou des
sculptures, ou toute autre forme de représentation ; ont véhiculé l’idée qu’elles étaient l’image de Dieu qui
les a créées et qui a modelé leurs destinées, alors pourquoi les noirs ne croiraient-ils pas qu’ils ressemblent à
leur Dieu comme les autres ? De son côté, l’évêque Georges Alexander Mc Guire de l’Eglise orthodoxe
africaine, demandait aux noirs d’oublier les « dieux blancs » et de les déraciner de leurs cœurs, au nom
même de leur ressemblance avec le Créateur, pour adorer le Christ noir comme pierre de touche de la foi
dans ce mouvement de retour à l’Afrique qui fit long feu.
En partant de Jésus blanc et du Dieu noir, l’auteur nous introduit immédiatement à l’antagonisme
raciale qui a existé en occident surtout. En effet, la race blanche évoque la pureté et la grâce, la lumière et la
beauté. Par contre le noir symbolise la souillure et le péché ; les ténèbres et la laideur. Cet antagonisme
racial a généré chez les noirs américains des conséquences psychologiques catastrophiques, au point que
ceux-ci se résolvent à un complexe d’infériorité et surtout avec un sentiment de culpabilité vis-à-vis des
blancs. Mais avec le mouvement du pouvoir noir, il y a renversement des termes. Le noir devient le
156
Cf. Idem, p.171. 157
Ibidem. 158
Idem, p.173.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 42
symbole du bien et le blanc le symbole du mal, car l’histoire réelle a mis du côté de la blancheur
l’exploitation et le racisme dont a été victime la race noire en Amérique du nord. Le salut ne peut donc en
effet se trouver que du côté de la négritude souffrante et militante.
I.2. Un message nationaliste révolutionnaire
La figure d’Albert Cleage resurgit ici comme celui qui a plus approfondi le sens de la négritude
physique du Christ. C’est dans cette logique qu’il publie en 1968 Le Messie Noir, « où il montre que le
christianisme noir est la seule postérité légitime de la religion d’Israël et de la religion de Jésus, les deux
étant d’origine africaine. »159
Voilà une interprétation nationaliste, par laquelle Cleage convainc les
militants du pouvoir noir du rôle important de l’Eglise noire dans la lutte pour la justice et la liberté. A la
base de la réflexion de Cleage se pose une affirmation de départ selon laquelle le Christ, Fils de Dieu était
noir, il était un messie noir né de Marie, une juive de la tribu de Juda, et donc une femme noire160
, car
d’ailleurs, Dieu lui-même est noir et il a créé l’homme à son image. Il est donc important de signaler que
lorsque Cleage parle de noir, il fait allusion à ce qui est non-blanc. Ainsi donc, ce Dieu a envoyé son Fils
noir (ou non-blanc) à un peuple noir ou non-blanc. Sa mission étant de conduire les enfants d’Israël dans une
lutte révolutionnaire de libération. Et donc ce Jésus réel est un leader révolutionnaire, un zélote, une menace
pour Rome en ce sens qu’il a mis le peuple en situation de combattre l’ennemi. Pour Cleage, une telle
découverte de Jésus comme un Messie noir est une partie de redécouverte des noirs eux-mêmes ; ce qui peut
susciter en eux un dépassement du mépris de soi et surtout un grand courage pour envisager la construction
d’une nation noire.161
En outre, selon Chenu, la base théologie de l’Evangile de libération s’enracine dans la vie même et
les enseignements de ce Jésus noir, plutôt que dans la mort et la résurrection du Christ. Jésus enseignait alors
« que chacun quitte son individualisme et rejoigne ses frères pour construire à nouveau une nation noire dont
il sera fier. »162
Il mit sur pied un mouvement révolutionnaire composé de zélotes qui vont continuer son
œuvre jusqu’à la rupture totale avec Rome. A travers les paraboles et les enseignements de leur maitre,
ceux-ci découvrent des stratégies pour combattre les blancs ; tous les faits et gestes du maitre ont une
signification révolutionnaire au sein d’un peuple désespéré, soumis à l’occupant romain. L’envoyé de
Dieu voulait faire d’une collection d’individus repliés sur eux-mêmes une nation. Mission dangereuse, aussi
soit-elle, elle lui coutera sa propre vie qu’il va offrir en sacrifice pour que la nation qu’il a fondée puisse
vivre. C’est dans ce sens que la résurrection est considérée comme résurrection de la nation noire que Jésus
a inaugurée, la résurrection de ses idées et de son enseignement. Ainsi est faite la lecture de l’évangile par
les tenants du pouvoir noir qui récusaient le christianisme blanc comme une religion sur Jésus, une religion
détournée de sa propre mission. Dans cette logique de réflexion, la pentecôte sera comprise comme
l’effusion de l’Esprit sur le peuple des sans-pouvoir, comme renaissance miraculeuse de la nation noire. Le
saint Esprit est une puissance divine révolutionnaire qui soulève les opprimés et en fait un peuple
combattant. Désormais, l’Eglise noire devient le centre de la lutte de libération noire. Les adeptes de cette
Eglise prient non pour avoir la force de supporter les oppressions, mais surtout pour avoir la force de
combattre héroïquement.163
I.3. Noir parce que juif
Ici Chenu nous montre que tous les théologiens noirs, même s’ils ne sont pas d’accord sur certains
points, ne discutent pas quand à l’affirmation de la négritude du Christ. A l’unanimité, ils reconnaissent que
Jésus est le « messie noir et le libérateur noir. »164
Selon les termes de Chenu, cette négritude du Christ doit
être comprise en rapport avec la communauté des noirs opprimés aux États-Unis à cause de sa couleur de
peau. En ce sens, la négritude met en relief la forme d’humanité qui a le plus souffert dans la société
américaine. C’est donc cette forme d’humanité que le Christ a revêtu dans la logique de sa mission de
159
Idem, p. 177-178. 160
Cf. Albert Cleage, The Black Messiah, New York, Sheed and Ward, 1968, p. 42 161
Cf. Bruno chenu, Le Christ noir américain, Paris, Desclée, 1984, p. 179. 162
Ibidem. 163
Cf. Bruno Chenu, Le Christ noir américain, Paris, Desclée, 1984, p. 182. 164
Idem, p. 183.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 43
serviteur souffrant. Il s’est fait un avec les noirs opprimés, prenant leur souffrance et les rassurant sa
proximité dans leur histoire de lutte, le récit de leur douleur et le rythme de leur corps.
En outre, on peut donc affirmer selon les termes de James que « Jésus est noir parce qu’il fut juif »165
en ce sens que Jésus le nazaréen, qui a revêtu la condition nègre, était purement juif ; il n’était pas un peu
juif et un peu romain ; c’est pourquoi il ne peut être aujourd’hui un peu blanc et un peu noir. La particularité
passée de sa judéité se traduit parfaitement dans la particularité présente de sa négritude. Dans le premier
cas, il s’agit d’une logique de salut comme libération et dans le second cas, ce Christ qui a libéré le peuple
élu d’Israël est celui la-même qui s’identifie aux pauvres et leur donne une vie nouvelle à travers le mystère
de sa pâques. Ainsi Jésus s’est situé définitivement du côté des pauvres et des exclus. S’il désertait la
communauté noire, son grand œuvre perdrait sa vérité.166
La négritude serait donc la perspective appropriée
pour saisir, aux États-Unis, la pertinence de la présence actuelle de Jésus.
II. L’OPPRIME LIBERATEUR
II.1. Une christologie noire
Notre auteur clarifie ici l’expression de la négritude du Christ, qui est plus qu’une couleur de peau,
même s’il faut nécessairement considérer ce trait physique dans la situation des Etats Unis. Il s’agit donc de
comprendre cette expression comme un symbolisme ontologique, étant la condition vitale de tous ceux qui
font mouvement de l’oppression à la libération, qu’ils soient opprimés eux-mêmes ou qu’ils se solidarisent
avec les opprimés. La négritude dans ces conditions est plus qu’une couleur de peau. Bien qu’étant
historiquement parlant, ce symbole désigne au-delà de la simple couleur, la solidarité dans la souffrance et la
lutte des descendants de tous les peuples esclaves et colonisés. Dans ce sens, la négritude du Christ veut le
désigner comme la manifestation d’un Dieu qui ne laisse pas les écrasés à leur triste sort, qui s’engage aux
côtés des laissés-pour-compte. La négritude du Christ exprime donc sa mission libératrice auprès de tous les
opprimés. Il est l’homme Dieu opprimé et libérateur : il s’agit donc d’une christologie de libération.
Dans cette approche christologique, Chenu s’inspire d’une figure la plus représentative de la
théologie noire américaine : James Hal Cone qui est un grand théologien noire à qui on doit l’expression
« théologie noire »167
. James s’emploie le mieux à mettre en œuvre une réflexion articulée à l’expérience de
la négritude aux Etats unis. Ne faisant pas l’unanimité parmi ses collègues noirs, James semble cependant
être le premier dogmaticien chrétien noir, dans une perspective éminemment christologique. En effet, pour
James, l’essence du christianisme tient en deux mots : Jésus Christ ; il est le point de départ de tout ce qui
pourra être dit de Dieu, de l’homme et du monde en christianisme. C’est pourquoi « la théologie chrétienne
commence et fini avec Jésus Christ. »168
Elle élabore la signification universelle de la vie, de la mort et de la
résurrection de Jésus.169
Cette centralité du Christ chez James a été critiquée par d’autres théologiens noirs
qui l’accusent de ne réaliser qu’un noircissement de la théologie chrétienne blanche. En réponse à cette
critique, James dira que la théologie noire n’est théologie chrétienne qu’en étant centrée sur le Christ ; car
l’expérience des noirs est elle-même focalisée sur le Christ et la respecter conduit immanquablement à la
confession de foi en Jésus. A travers cette réponse de James, l’on peut percevoir la démarche d’une
christologie noire. En effet, il y a là une articulation du centre du message chrétien avec le cœur de
l’expérience noire ; il y a une compatibilité jusqu’à l’identité entre l’essence de l’Evangile et la lutte des
noirs pour leur libération ; la question de l’Evangile rencontre et épouse la question du peuple noir. Cette
christologie noire de James consiste dès lors à aller vers l’Evangile à partir de l’expérience de foi de la
tradition noire à travers laquelle Jésus a été rencontré et vécu par les noirs, qui se sont tournés vers
l’Evangile pour avoir la force de résister à la discrimination raciste et de conquérir leur humanité.
II.2. Les sources de la christologie
En partant sur l’expérience de foi du peuple noir, James H. Cone va étudier la relation entre les trois
sources de la christologie : le contexte social, la Bible et la tradition.
165
James H. Cone, God of the Oppressed, New York, Seabury Press, 1975, p. 134. 166
Cf. Bruno Chenu, Le Christ noir américain, Paris, Desclée, 1984, p. 183. 167
Il est le premier à utiliser cette expression. 168
James H. Cone, A Black Theologie of Liberation, op. cit., p. 197. 169
Cf Bruno Chenu, Le Christ noir américain, op. cit. p.189.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 44
Le contexte social : pour la théologie noire, ce contexte est évidemment l’expérience noire, l’histoire
et la culture du peuple africain sur le sol des Etats Unis. La christologie noire examine donc les récits, les
chants, les contes des noirs qui se rapportent au Christ. Car toute vérité pour et sur le peuple noir ne peut
émerger que de son expérience propre. Cependant, ce contexte social ne doit pas être absolutisé ; il doit
s’ouvrir à une autre source supérieure : l’Ecriture, car la valeur du contexte vient de sa mise en œuvre
concrète de l’Evangile, de sa pleine cohérence avec l’Ecriture.
L’Ecriture : Son témoignage oblige à regarder au-delà de l’expérience immédiate et signifie une
altérité féconde et décisive. C’est grâce à l’Ecriture que nous savons que Dieu est un Dieu de Libération.
C’est grâce à leur accueil de la Parole de Dieu que les esclaves ont pu affirmer un Dieu différent de celui des
maîtres. En outre, dans son approche de la Bible, James montre qu’il s’agit d’une « révélation de Dieu en
Christ comme celui qui libère les opprimés de l’oppression sociale pour la lutte politique, au sein de laquelle
les pauvres reconnaissent que leur combat contre la pauvreté et l’injustice est non seulement compatible
avec l’Evangile mais est l’Evangile de Jésus Christ.»170
Tel est selon James le principe de lecture qu’il faut
adopter pour les saintes Ecritures
La tradition : Pour James, la tradition désigne cette « réflexion théologique de l’Eglise sur la nature
du Christianisme depuis le temps de l’Eglise primitive jusqu’à aujourd’hui. »171
En outre, au sein du grand
fleuve de la tradition chrétienne, la théologie noire veut révéler l’existence et la pertinence d’un courant
noire, qui nait en terre africaine dans le cadre de la religion traditionnelle. En ce sens, le christianisme noir
américain serait donc le fruit de cette rencontre entre les récits africains et le récit chrétien. Il représente
alors une tradition chrétienne unique au monde. C’est pourquoi James dira que « le Christ passif du
christianisme blanc, combiné avec la culture africaine, est devenu le libérateur des opprimés. »172
En somme, selon l’analyse de James, l’identité véritable de Jésus se trouve à la confluence de ces
trois qui fonctionnent de façon complémentaire : le Jésus de l’expérience noire n’est autre que le Jésus de
l’Ecriture. Et le Jésus de l’Ecriture se réfléchit dans une tradition qui est aussi noire. Bref, les trois sources
nous conduisent irrésistiblement à Jésus, mais elles ne sont pas Jésus, car le christ reste au-delà de toute
parole prononcée sur lui.
II.3. l’Identité de Jésus
Jésus est celui qui était : Pour James, on ne peut pas comprendre le Jésus ressuscité en se passant du
Jésus de l’histoire.173
En effet, c’est en approfondissant ce que Jésus était dans son histoire terrestre que les
noirs peuvent saisir ce qu’il est aujourd’hui au milieu d’eux. Il y a donc une continuité entre le Jésus
historique et le Jésus kérygmatique. Le noyau historique qui demeure dans l’Evangile est donc la
manifestation de Jésus comme l’opprimé de Dieu dont l’existence terrestre a été liée aux opprimés de la
terre. La christologie noire met l’accent sur l’humanité de Jésus dans l’histoire. Comprendre le Jésus de
l’histoire, c’est voir son identification avec les pauvres comme décisive.
Jésus est celui qui est : Le pont que Dieu a posé entre l’hier et l’aujourd’hui est celui de la
résurrection de Jésus.174
Et la foi en cette résurrection selon James signifie que le Jésus historique dans ses
dires et ses gestes libérateurs pour les pauvres, était le surgissement de Dieu dans l’histoire des hommes,
pour les racheter de l’injustice et de la violence et pour conférer aux petits le pouvoir dans leur lutte pour la
liberté.175
La résurrection tisse donc un lien entre l’histoire passé et l’engagement présent de Jésus aux côtés
des noirs dans leur lutte quotidienne pour la liberté. Dès lors l’identité de Jésus pour les noirs ne peut être
séparée de sa présence à leur côté dans l’actualité. Mais en même temps, il faut noter que cette présence de
Jésus ne fournit pas une belle échappatoire à la difficulté de la souffrance ; plutôt il accompagne les
opprimés et leur donne le courage de tenir bon, sans accepter passivement l’injustice. Et dans ce combat,
Jésus se révèle à travers la prise de responsabilité du peuple noir, n’acceptant pas la négation de son identité.
170
James Hal Cone, God of the oppressed, op. cit., p. 81-82. 171
James Hal Cone, A Black Theology of Liberation, op. cit., p. 69. 172
James Hal Cone, God of the oppressed, op. cit., p.114. 173
Cf. Idem, p. 115. 174
Cf. Idem, p. 205. 175
James Hal Cone, God of the oppressed, op. cit., p.120.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 45
Jésus est celui qui sera : Cela signifie que le Jésus crucifié-ressuscité est aussi le Seigneur du futur
qui reviendra pour accomplir pleinement la libération qui germe dans l’actualité.176
En effet, la théologie
noire est une théologie de l’espérance ; Elle ne l’est que parce qu’elle est d’abord politique de l’espérance.
Une politique que les noirs ont mise en œuvre dans leur mouvement de lutte pour leur libération et dont ils
ont parlé à travers leurs sermons, leurs prières et leurs chants.177
Pour les noirs, l’espérance chrétienne est
extrêmement concrète et elle s’atteste dans la praxis libératrice de la communauté opprimée. C’est pourquoi
les chrétiens noirs ont toujours agi à partir de l’espérance, avec un regard confiant vers l’avenir de Dieu
comme moteur de leur entreprise de toutes les luttes nécessaires dans le présent. En confessant le Christ à
venir, les noirs reconnaissent donc qu’aucune lutte n’a sa fin en elle-même, car la liberté plénière excède les
possibilités de l’histoire. Les opprimés sont donc appelés à marcher vers un futur qui n’est pas fait de mains
d’homme, parce qu’il s’enracine dans les promesses libératrices de Dieu dans le Christ. Ils sont donc libres
de lutter contre les structures politiques et sociales sans se laisser déterminer par elles.
III. EVALUATION DE LA PENSEE DE BRUNO CHENU
D'un point de vue proprement théologique, Bruno Chenu est le seul théologien occidental à avoir
accordé autant d'attention aux Noirs américains, mêlant recherche historique et réflexion théologique. Il s’est
montré vraiment touché par leur souffrance et il a voulu, par sa démarche, montrer l'égalité entre les
hommes. Dans ce sens, il est aussi un grand chantre des droits de l'homme, puisqu'il a travaillé à la
reconnaissance des noirs. En outre, Bruno Chenu par sa démarche atteint les zones sombres de la conscience
humaine et chrétienne au fil de l'histoire de l'asservissement de l'homme par l'homme. C'est un message
décisif qu'il livre et qui appartient en propre à l'humanité comme telle, parce que ce dont il est question n'est
rien moins d'autre que la dignité de la personne, seule ou en groupe, qui s'affirme envers et contre ceux qui,
par leurs exemples, ont pu se loger dans une conscience pourtant dite chrétienne, mais aveuglée par les
conditionnements mondains. Bruno Chenu se situe donc à « un haut-lieu d'humanité et d'anthropologie pour
laisser retentir une parole multiple sur la condition humaine. »178
. Il s’est investi pas moins dans
l'œcuménisme, l'ecclésiologie etc. Mais, on peut vraiment dire que sa grande passion fut la passion des Noirs
américains car il a éprouvé lui-même la souffrance dans la rencontre de la souffrance des Noirs américains.
Il s’est fait la voix des sans voix
Cependant, sans toutefois remettre en cause l’engagement de Chenu en faveur de la théologie noire,
nous pensons qu’il ait côtoyé une théologie séparatiste extrême. Celle-ci a considéré l’homme blanc comme
un animal féroce et le christianisme comme une religion bâtarde, sans messie et sans Dieu. N’est-ce pas là
une autre forme de racisme plus aigüe ? N’aurait-elle pas été plus efficace si la théologie noire fournissait un
instrument de réconciliation entre les races, entre les opprimés et les oppresseurs au lieu de constituer un
instrument de libération pour les noirs ?
CONCLUSION
Quand nous considérons tout le travail que Bruno Chenu a fait sur les Noirs américains, on peut dire
qu'il les a fait sortir de leur "solitude". Parce que, écrit Bruno, « Au long de l'exploitation esclavagiste, le
Noir a ressenti douloureusement sa solitude... »179
Il a été la voix des Noirs dans le monde francophone pour
faire connaître leur souffrance et la force spirituelle qui en a résulté. Il s’est particulièrement intéressé à la
question de Comment le christianisme occidental, historiquement lié aux idéologies et aux structures
dominantes, peut-il renaître selon l'Evangile en s'engageant réellement aux côtés des pauvres et en répondant
à la quête de sens de nos contemporains ?
Mais aujourd’hui encore, ce problème crucial continue de se poser en termes de la réalité des gens
qui sont menacés et qui souffrent dans leur personne. Les hommes souffrent à cause de la maladie, de
176
Cf. Bruno Chenu, Le Christ noir américain, op. cit., p. 211. 177
Ibidem. 178
G. H. MASSON, "Le grand livre des Negro Spirituals. L'aventure d'une libération et d'une foi", in La Vie Spirituelle, décembre
2000, p. 602. 179
Bruno Chenu, "Le spiritual, un peuple en mouvement vers son Dieu" in Lumière et vie, n°140, novembre-décembre 1978, p.
69.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 46
l'injustice sociale, du mal qu'ils se font réciproquement. Cette réalité est grave et nous place devant le
problème de la nature du rapport qu'il peut y avoir entre l'humanité qui souffre et l'Eglise
En y pensant, il peut sembler d'un point de vue théologique que cette question du rapport entre
l'humanité qui souffre et l'Eglise est vraiment au cœur de la vie et de la pensée de Bruno Chenu. Beaucoup
d'hommes et de femmes se sentent exclus de notre l'humanité, refoulés aux marges de la société, de l'Eglise.
De l'expérience profondément humaine de ces personnes émergent des questions. Questions auxquelles
Bruno Chenu s'est rendu sensible en se faisant la voix des sans voix.
Par SIMFEYA Bogmsa Badiligma Wilfried
2.2.7 EXPOSE 7: POURQUOI LA THEOLOGIE DE LA LIBERATION ? PAR RENE MARLE,
MARIO CALDERON ET GUY PETITDEMANGE
INTRODUCTION
La théologie de la libération est un courant de pensée théologique chrétienne venu d’Amérique
latine, suivi d’un mouvement socio-politique, visant à rendre la dignité et l’espoir aux pauvres. En effet, le
concept de « théologie de la libération » fut utilisé pour la première par Gustavo Gutierrez lors du congrès
de Medellin de la CELAM (Conseil Episcopal Latino-Américain), en 1968180
. Il développe sa pensée dans
un livre « Théologie de la libération » paru en 1972, considéré comme son point de départ. Par suite, elle
s’impose l’usage radical de la vérité évangélique en essayant d’y trouver un sens. Ce livret intitulé :
« Pourquoi la théologie de la libération » ? dont l’étude constitue le point focal de ce travail, a pour objectif
de faire la lumière sur la nouvelle théologie. Il est un assemblage de quatre études présentées lors de la
session organisée par le Centre culturel les Fontaines de Chantilly les 14 et 15 décembre 1984. Les deux
premières sont du français Jésuite, René Marlé. Elles traitent des thèses des théologiens de la libération et
fait écho de son avis sur ces thèses. La troisième est du Jésuite colombien, Mario Calderon, qui fait
comprendre l’importance du rôle joué par cette théologie dans le continent latino-américain à travers les
communautés ecclésiastiques de base et le témoignage sur leurs œuvres. Enfin, la quatrième étude est de
Guy Petitdemange. Il semble faire le rapport entre la théologie de libération et le marxisme, le système sur
lequel pèsentd’énormes soupçons. Alors, quelle articulation existe-t-il entre ces études pour comprendre le
bien-fondé de cette théologie?Quel est le rôle joué par les communautés de base en Amérique Latine et son
rapport avec le marxisme. Ce travail fera cas de « l’analyse marxiste » pour un chrétien qui est une lettre
du père Pedro Arrupe, supérieur général de la compagnie de Jésus rapportée à l’annexe de ce document.
I. UN PROJET THEOLOGIQUE ORIGINAL ET LA CONCEPTION (René Marlé)
1.1 Un sous-produit de la théologie de libération européenne
Si l’histoire retient que la théologie classique la considérait très peu, il convient de retenir que la
théologie de libération est bien distincte. Ce nouveau paradigme est né de la manifestation de l’éveil général
du tiers monde à l’intérieur de l’Eglise catholique. L’auteur qualifie ce fait d’une « révolution
copernicienne ». Car le bassin méditerranéen n’est plus centre du nouveau monde chrétien. Dans le même
sens, Juan LuidSegundo parle de deux « Théologies de libération ». Il s’agit en premier de celle
universitaire ou des milieux bourgeois intellectuelsvéhiculant des idées construites au laboratoire. La
seconde est celle de du sol populaire venant d’une réalité culturelle. Si la validité de ce nouveau-né pose
problème, surtout soupçonné d’être la recherche d’une quelconque liberté comme un sentiment humain, il
suffisait de recourir à l’ouvrage de Gustavo Gutierrez181
, « la Théologie de libération » pour se convaincre
de son originalité. Il y présente une nouvelle manière de faire de la théologie.
1.2 Une nouvelle manière de faire de la théologie
Gutierrez montre que la théologie de libération se présente plus comme « une nouvelle manière de
faire de la théologie », qu’un nouveau thème de réflexion. C’est une « reflexion critique sur la praxis
180
Jullien, Claude-François, « Théologie de la libération et Réelle politique », in : Politique étrangère n°4 - 1984 - 49e année, pp.
893-905. 181
René Marlé, Mario Calderon, Guy Petitdemange, « Pourquoi la Théologie morale ? », in : Cahier de l’actualité religieuse et
sociale, 293,1984, p.6.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 47
historique »182
Quand àClodovisBoff dans son ouvrage « Théologie et pratique. Théologie du politique et ses
médiations »,c’est une étude d’esprit ou un style particulier pour penser la foi183
, d’ailleurs Guitierrez pense
que cette théologie n’est pas une discipline d’où on peut déduire une politique, mais elle se laisse juger par
la Parole du Seigneur.184
Aussi,l’auteur parlant de la manière dont se fait ce « nouveau-né », précise qu’elle
n’est pas une manière de chercher à justifier dans la Bible la situation de vie d’un peule ou d’en tirer une
doctrine applicable à des situations particulières. Même si ces ratés sont enregistrés dans l’histoire, il
convient de retenir que la nouvelle science cherche à modifier cette pratique comme le voit Gutierrez.
1.3 Au terme d’une histoire originale
La théologie classique se doit aujourd’hui de revoir sa méthodologie, car toute doctrine humaine est
liée à un contexte et à une culture. D’ailleurs selon l’histoire, la théologie, depuis les Père de l’Eglise en
passant par le contexte des monastères d’où elle reste la lecture pacifique de la Bible, s’ajuste. Et ceci,
lorsqu’elle passe dans les milieux universitaires au Moyen Âge. La théologie de Saint Thomas s’est ajustée à
la philosophie d’Aristote en donnant les sommes théologiques. C’est le cas de celle latino-américaine.
Ce continent laisse voir des contrastes de vie entre l’opulence des privilégiés et les conditions infrahumaines
de la grande masse sans oublier les mécanismes socio-économiques. Alors la théologie exprimera ce que
l’Evangile signifie pour ce peuple selon ses réalités. L’Argentin Enrique Dussel, un laïc théologien justifie
l’urgence de cette théologie. Il affirme que « Bien que Christophe Colomb, déclarait-il dans une séries de
conférences, soit arrivée en Amérique en 1492, il ne serait pas trop hasardeux d’affirmer que c’est seulement
aujourd’hui que nous sommes en train de découvrir l’Amérique »185
. Il qualifie le Christianisme qu’a connu
ce continent, de celui de l’étranger, « colonial et dominant. Il pense qu’il serait mieux de penser à partir de
sa situation « dominés » pour voir vers le haut. Entre autre après avoir montré la démarcation entre le
développement et le contexte socio-économique, il montre le souci de la théologie de libération de se battre
pour restaurer l’identité, la dignité, et la vocation de la dignité de l’homme. Certes, cette contrée en a fait la
mauvaise expérience comme les « réductions » du Paraguay organisées par les Jésuites selon la référence
qu’il fait à Bartolomé de Las Casas, le premier prophète latino-américain186
. Si toute théologie va au secours
des situations en périls pour les rénover, celle latino-américaine parait plus spéciale, selon Gutierrez, car il
est l’unique continent à majorité chrétienne parmi les peuples opprimés suite au phénomène de métissage.
Alors que Léonardo Boff le voit comme l’avenir de l’Eglise.
II. LA CONCEPTION DE DIEU, DU CHRIST ET DE L’EGLISE DANS LA THEOLOGIE DE
LIBERATION (René Marlé)
2.1 Dieu
La question qui se pose ici est en même temps celle de l’existence et de sa vraie identité. Dieu n’est
pas de la conception égoïste de l’homme mais des réalités de nos sociétés. Malgré l’effort du crédo de Nicée
Constantinople de montrer un Dieu par son altérité et lié à l’histoire des hommes, son sens est galvaudé.
Selon Segundo dans le son « ouvrage, Catéchismepour aujourd’hui », la théologie classique semble
effectuer une projection en Dieu des limites de la société occidentale qui conduit à un système de
domination. Car, même si Dieu est unité, Il est communauté. D’où le système unitaire, hiérarchique avec des
lois implacables est mal vupar cette nouveauté théologique
2.2 Le Christ
L’auteur de cet article parlant de la christologie dans cette théologie, montre qu’elle est basée sur
Jésus de l’histoire en lien avec le Dieu de libération de l’Ancien Testament comme le montre l’épopée de la
libération d’Israël. Ici, il restitue le Jésus de l’histoire afin qu’il soit proche de ce monde comme l’initiateur
d’une conduite pratique. Aussi, a-t-il cité Boff qui disait que « Jésus n’a ni prêché Lui-même, ni l’Eglise,
mais le royaume. Ce dernier est le monde nouveau de Dieu qui s’insinue dans le monde des hommes pour le
182
Ibidem. 183
.Ibidem. 184
Idem, p.7. 185
Enrique Dussel, Histoire de la théologie de libération Buenos Aires, 1972, trad. Français Ed. Ouvrières, 1974. 186
Idem, p.12.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 48
transformer »187
. René ne pense point à une rénovation exagérée, sinon on risque d’oublier la dimension
spirituelle de cette histoire. Elle ouvre à un Dieu qui déloge des situations établies, qu’elles soient
intellectuelles ou institutionnelles, pour tout remettre en orbite. C’est la crainte du Pape Bénoît XVI, alors
Cardinal Ratzinger dans sa conférence de Paris et de Lyon sur la catéchèse en 1984. Aussi, Réné semble
rassurer le pape en montrant d’un autre point de vue que cette christologie n’est point une incitation à la
violence du fait que Jésus n’a jamais été révolutionnaire à la manière des zélotes face à la domination. Mais
il se fonde sur un intérêt primordial porté au Jésus de l’histoire, Celui qui a partagé les conditions des
opprimés.
2.3 L’Eglise
Les théologiens de la libération mettent à profit les enseignements de Vatican II. L’Eglise comme « Peuple
de Dieu » se propose d’apporter une touche originale dans la rénovation ecclésiologique. Ils se proposent de
repenser toute la structure de l’Eglise de l’intérieur en se basant sur la foi, ils pensent « recréer l’Eglise »
selon ces termes de l’auteur empruntés à Boff et Segundo. Ils se basent sur les communautés de bases et
l’église populaire. Ces communautés surtout Brésiliennes sont une composition populaire venant de
plusieurs communautés vastes et dispersées mais réunies dans la même foi. Elles affrontent solidairement
les problèmes sociaux et économiques. C’est d’elles que sortira le concept d’ « église populaire » qui est
une cellule qui suscite la crainte des autorités de peur qu’elle soit insoumise. Malgré tout, elle obtiendra le
droit de cité, même s’il est vu parfois comme un « front » ou la « démocratie » populaire. C’est une église
qui naît entièrement du peuple.
III. LES THEOLOGIES DE LA LIBERATION ET LES COMMUNAUTES ECCLESIALES DE
BASE ( MarioCalderon)
3.1 La « chrétienneté » d’origine
Dans cet article, Mario la définit comme le rapport existant entre l’état et l’Eglise. Alors, quand l’état
apporte son soutien matériel, l’Eglise doit tout compenser par une caution morale. Cette relation qui existe
ici depuis le temps colonial subsiste après l’indépendance de (1920-1930). Ce contexte qui prévalait met mal
à l’aise l’Eglise plus tard devant ses actions de libérations dans le continent latino-Américain dans les années
1920.
3.2 Cuba et Vatican II
Dans l’Eglise de nouveaux problèmes apparaitront malgré son entente avec les Etats socialistes.
C’est le cas de Cuba en 1950. Du fait que ses efforts n’atteignent point les résultats escomptés dans son aide
au développement vers la fin la guerre. Elle n’a non plus promu davantage la justice. Dans ces condition un
groupe d’économistes créent la théorie de dépendance selon laquelle « le sous-développement serait lié au
développement des riches. Alors, l’Eglise propose par sa doctrine sociale et promeut des organisations
chrétiennes pour résoudre les problèmes sociaux. C’est ainsi qu’en 1958 au Chili et au Venezuela, la
démocratie chrétienne commence à participer aux élections, avant la révolution cubaine. Cela fut l’origine
de la formation des communautés de base pour faire face aux problèmes de société à travers la catéchèse et
l’éducation de base, d’abord au Brésil en 1960. Ceci entraine la révolution de la société même dans sa
structure qui n’est pas toujours pacifique. L’effectivité de ces organisations ecclésiales est renforcée par le
concile Vatican surtout à la suite de la création du CELAM en 1956 à Rio de Janero.
De même la conférence de Medelin ouverte en 1968, donnera un nouvel élan à la théologie de
libération. Elle a évoqué même le changement des structures. Or cela ne manquera pas d’entrainer parfois la
violence.
En outre en 1970, la Chili connaît un gouvernement d’unité populaire qui entraine des chrétiens
socialistes. Le pays devient un foyer des initiatives nouvelles. Les rencontres de Mexique et d’Espagne en
1975 et 1971 entrainent deux classes de théologiens appelées générations classées selon l’ordre des travaux
effectués. La première regroupe des éminents comme :Gustavo Gutierrez, Hugo Assmann, Juan Louis
Segundo, Ruben Alves, et la deuxième les penseurs comme Léonardo Boff et Jon Sobrino. Ceux-ci parlent
187
Idem, p.19.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 49
de la théologie de la captivité du fait que tous ces pays sont sous domination militaires avec la monté de
l’oppression qui engageait toutes les couches sociales et même le clergé.
IV. THEOLOGIE DE LA LIBERATION ET LE MARXISME (GuyPetitdemange)
4.1 Ambiguïté du regard des Européens
L’observation fait par l’Occident sur la théologie de libération est la pratique du système marxiste, de
même que l’usage de certains termes du marxisme, même dans leurs théories retravaillées. On peut citer la
« lutte des classes », la praxis », « aliénation » vus comme une « marxiologie ambiante »188
. Si le milieu
d’application de la théologie de libération est plus la politique du fait de son objectif, la transformation
structurale, alors le chemin ici emprunté reste à désirer. Notre auteur énumère quelques soupçons à son
égard : « le soupçon d’un archaïsme épistémologique, car en relation au courant marxiste, elle serait en
retard à la manière du progressiste français à l’époque de la main tendue », ensuite, « le soupçon d’un grave
manque de liberté »189
. Quel est le vrai contexte de la réception de la pensée marxiste ?
4.2 Contexte et étapes de la réception marxiste
Les contextes varient selon la période. Ainsi de 1960-1973, on note l’émergence d’une théorie
« fascinante » avec un développement relatif de ces certains pays comme le Pérou, le Brésil, la
Chili…Cette période de l’industrialisation coïncidait avec l’émergence des transnationales, c’est l’essor de
la bourgeoisie locales ayant pour corolaire, l’aggravation de la misère de la basse classe. Dans cette situation
l’opposition a formé un creuset conduit par la théorie dite « de la dépendante » qui entraine la
recentralisation de la notion d’impérialisme190
. Dès lors apparait le dualisme proletariat/bourgeoisie qui n’est
jamais resté sans péril comme le rapporte Guy Petitdemange. C’est dans cette ambiance que surgira le
premier engagement chrétien massif caractérisé par : l’action des intellectuels ( jeunesse estudiantine)
auxquels s’ajoutent quelques prêtres en milieux pauvres, l’adhésion au marxisme sous l’influence de Label
Althusser, un théoricien français qui lui donne sa dignité universitaire et un principe neuf de rigueur au
marxisme, la fascination qui entraine une radicalisation en tout surtout en pratique , c’est le cas de Mapu
Chilien qui se sépare de la démocratie chrétienne en 1968 avec l’essor des groupes chrétiens pour le
socialisme en 1970. Le marxisme fascinant et la théologie de libération s’accordent sur la révolution
politique sur la libération, comme l’espérance chrétienne, ayant pour conséquence le rejet de l’action
catholique par la jeunesse intellectuelle de Brésil en 1966191
. Elle deviendra militante jusqu’à la lutte armée.
Après suivra un travail silencieux qui conduit à l’élaboration de théologie latino-américaine comme celle de
libération.
Par contre, la période allant de 1973-1980 fut celle de l’élargissement et de maturation. Et ceci pour
cause, la chute d’Allende en 1973 qui annonce le renversement de la révolution. On note en plus l’extension
des régimes militaires et la dégradation des conditions de vie sociale. C’est ainsi que s’amorce le temps de
conscientisation et d’approfondissement de la méthode. Désormais le marxisme perdra toute légitimité
d’action. Pour se faire, la théologie de libération accordera plus d’attention à la religion populaire. Les
rencontres ne seront plus intellectualisées, mais elles vont au-delà afin de permettre un engagement réel au
côté des hommes en situation de misère. Guy Petitdemange souligne que « La symbiose ambiguë du
christianisme et du marxisme » sera repensée. Même si autre fois, le marxisme fournissait une grille
hypothétique de l’action sociale, la doctrine sociale de l’Eglise sera un éclaireur de conscience par des
actions modeste et éducative.
4.3 Réception du marxisme à l’intérieur de la théologie de la libération
L’histoire retient que la faiblesse du Congrès du Parti communiste d’Union Soviétique (PCUS) et le
schisme chinois au XXème
siècle ont entrainé le marxisme même s’il était sans autorité et souple. Il donne la
possibilité d’action sur le les structures dirigeantes comme s’était le cas de la révolution cubaine en 1959.
Les termes de ce système furent empruntés, c’est des concepts d’aliénation, la lutte des classes, l’historicité
188
Idem, p.39. 189
Idem, p .42. 190
Idem, p.42. 191
Idem, p.44.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 50
et l’organisation. Cette théologie qui fait route avec les sciences sociales, utilise le marxisme comme une
médiation. Cependant, il n’y a pas de rapport synonymique entre ce système et l’Evangile, mais le dire ainsi
est bien préjudiciable. En effet, sa proximité avec la théologie de libération ne l’éloigne point de la
spiritualité. Elle est restée au contraire très attachée à la religion des Pères de l’Eglise en exigeant la
libération immédiate. Il ne serait point l’objet d’une rupture avec la communion de l’Eglise, car l’objectif
poursuivi est la libération qu’une lutte contre les idoles, telles que l’argent et le pouvoir qui crèvent les
yeux. Guy se posera dans ce contexte deux questions. D’une part il veut savoir si la nouvelle chrétienté
pouvait avoir des relents de réformes ? Ou, si l’Eglise mystère est aussi visible, quelle critique serait
recevable ? Et d’autre part le dialogue vaut- il ?192
Dans tous les cas il retient que si l’engagement politique
venait à s’installer, il faut agir dans le sens éthique.
4.4 « Analyse marxiste » pour un chrétien : Lettre du Père Pedro Arrupe
L’auteur était le Supérieur, Général de la Compagnie de Jésus aux Provinciaux l’Amérique Latine
le 8 Décembre 1980. Il répondait à ces confrères sur l’ « analyse marxiste » suite aux directives données par
les évêques par le document de Puebla. Elle se veut un appui pastoral. Car, le contenu de ce concept varie
selon les contrés, surtout ceux qui ont de longue tradition marxiste, impliquant même les prêtres ouvriers et
sa clarification vaut pour un vrai discernement de la foi. En effet, sur l’ « analyse marxiste », le père
présente des points de vue non exclusifs et considère le système tel que l’ont fait certains en l’admettant
comme une méthodologie. Car, il constate que le corpus marxien est accepté a priori sans vérification sur les
réalités sociales. De plus, leur adoption à notre temps sans précaution frise une confusion abusive avec
« l’option évangélique pour les pauvres », du fait que tout le social y compris la politique, la culture et même
la religion est basé sur l’économie, ce qui est préjudiciable à la foi. Il fustige également les manifestations
doctrinales et sociales de l’Eglise et certaines « critiques radicales de l’Eglise, qui sont bien au-delà de la
juste correction fraternelle dans l’Ecclesia semper reformanda »193
. Au sujet de la lutte des classes, le père
Pédro ne reste point indifférent. Cependant, si le christianisme reconnaît la légitimité de certaines luttes et
n’exclut la révolution dans certain cas extrêmes et tyranniques194
, il prise d’autres moyens comme la
persuasion, le témoignage, la réconciliation, et ne désespère jamais de la conversion et ne recourant qu’au
dernier lieu à la lutte, surtout celle qu’entraine la violence195
. Car même, Selon le témoignage des chrétiens
partisans de cette pratique, même si elle n’est point l’adhésion au marxisme, reste un choix facile pour
parvenir à ses fins. Ils donnent raison au père Pedro qui cite le Pape Paul VI quand –il-affirmait qu’il
« serait illusoire et dangereux […] d’accepter les éléments de l’analyse marxiste sans reconnaitre leur
rapport avec l’idéologie ».Car la dissociation est plus malaisée qu’on ne le suppose parfois196
.
En conclusion, il reconnait l’importance de cette analyse qui cherche la libération des opprimés.
Aussi propose-t-il l’abandon de tout moyen simpliste pour y parvenir Ensuite, il souligne que toute analyse
sociale doit être en lien avec l’Evangile et la recherche du bien commun selon la vision de Vatican II (Cf.
GS n°21§6), le dialogue. Pour lui, le message de foi, est incompatible et plus riche que tout système
etconcept quelconque ne fut-il utile comme l’analyse marxiste. Il propose en outre d’être équilibriste.
V. CRITIQUE
5.1 Quelques points positifs de cet ouvrage
Somme toute, ces articles nous ont permis d’avoir une idée de ce qu’est la théologie de libération en
Amérique-Latine. Ils ont du mérite en présentant l’écho que ces théologies avaient suscité chez les
intellectuels de la théologie classique comme le Français RénéMarlé. De même le Jésuite Colombien Mario
Calderon, fort de son expérience pastorale, nous a montré que la théologie de libération dans les pays de
l’Est n’aurait point cette ampleur n’eut-été le rôle prépondérant qu’avaient joué les communautés de bases.
Aussi, l’incursion dans l’histoire de ce continent nous a permis d’avoir un aperçu sur la corrélation qui
existait entre ce nouveau paradigme et le marxisme. D’ailleurs Comme l'a dit le Cardinal Brésilien Dom
192
Idem, p.51-52. 193
Ibidem. 194
Cf. Paul VI, Populorumprogressio, N°31. 195
René Marlé, Mario Calderon, Guy Petitdemange, Op. cit., p.57. 196
Idem, p.58.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 51
Helder Câmara: « Aussi longtemps que je demandais aux gens d'aider les pauvres, on m'appelait un saint.
Mais lorsque j'ai posé la question: pourquoi y a-t-il tant de pauvreté ? On m'a traité de communiste ... »197
Ce jugement porté sur le Cardinal semble montrer combien de fois il était impossible de faire l’option pour
la défense des pauvres en Amérique Latine sans pourvoir côtoyer le communisme. Nous en voulons pour
preuve l’exemple fort fourni de l’article du P clavez dans Etudes cité par Guy Petitdemande où l’auteur
reconnaît un indéniable apport de Marx à la maîtrise des questions sociales, l’usage de la notion de force de
travail, de plus-value198
. Enfin la lettre du père Pedro est bien judicieux, car par les inquiétudes que
pourraient engendré l’analyse marxisme ont été clarifiées. Ce fut un guide de discernement pour tout
pasteur dans leur mission au côté des chrétiens de conviction marxiste, mieux des « Chrétiens-marxistes»199
selon les propos du père.
5.2 Points Négatifs
A la lecture de ces articles, on constate que les auteurs ont fait un compte rendu sur le contexte
d’émergence de la théologie de libération en Amérique latine. Dans leurs écrits, ne transparaissent points
certains éléments pour mieux comprendre en général toutes les implications de cette théologie, même si le
champ de ce travail est bien circonscrit. Aussi, ces articles ne permettent point d’établir nettement une
analogie entre les conditions d’élaboration de la théologie de libération en Amérique Latine et celle
développée dans le reste du monde. De même, la transition de l’interprétation de la Bible adaptée à la réalité
sociale dans ce contexte ne nous a point paru si évidente comme cela devrait l’être, or la Commission
Biblique Pontificale a affirmé clairement que « une analyse aussi engagée de la Bible comporte des risques.
[…] et en voulant insérer le message biblique dans le contexte socio-politique, des théologiens et des
exégètes ont été menés à recourir à des instruments d’analyse de de la réalité sociale »200
. On en déduit que
la réalité sociale est plus en vue, telle que l’action des communautés de base que l’interprétation de la Bible
adaptée aux réalités contextuelles. Aussi la lettre du père Pedro sans être trop juge et partie est resté bien
critique que prudent, or l’Eglise n’est pas toujours moins regardant sur les déviations et la violence qu’a
entrainé l’usage de certains principes marxistes dans le combat de la libération. Pire, elle soupçonne la
mauvaise interprétation de la Bible pour parvenir à ces fins, donc sans critique objective comme le souligne
Paul VLADIER : « sans elle, justement les écritures deviennent trop vite un instrument entre nos mains, un
outil de plus pour servir à la construction de notre histoire, utilisées ainsi comme autant de balles dans nos
combats, elles deviennent captives de nos intérêts au lieu de nous en libérer.201
De toute façon, toute bonne
pastorale dans de pareil contexte demande de la vigilance et l’étude au cas par cas. Et le père en donne la
preuve.
CONCLUSION
En somme, à la sortie de l’étude de cet ouvrage, on comprend mieux que la théologie de libération
dans le contexte latino-américain est bien complexe qu’émouvant. L’histoire du rôle prépondérant des
communautés de base dans son élaboration reste une particularité. Contrairement au principe d’élaboration
des autres théologies de libérations basée que sur le travail des intellectuels théologiens, ici la réalité sociale
joue un rôle déterminant. Car, le courant marxiste a beaucoup influencé cette théologie qui se veut
libératrice du genre humain dans le contexte de domination, d’injustice, d’oppression, de misère ou du
moins de pauvreté. La restructuration de l’Eglise énoncée dans les orientations de Vatican II en constitue un
ferment. En outre, avec les références faites aux grands théologiens qui ont travaillé ce thème tel que
Gustavo Gutierrez, Hugo Assmann, Juan Louis Segundo, Ruben Alves, Léonardo Boff et Jon Sobrino, de
pareilles luttes en vaut le coup. Aussi, la lettre du père Pedro reste une réponse précise à l’étude d’une
« analyse marxiste » en montrant le bien-fondé de la relation existante entre l’héritage marxiste et la lutte de
libération de ces peuples opprimés. Il montre comment aucune« analyse de société » dans le contexte latino-
197
http://www.fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ologie_de_la_lib%C3%A9ration (09/03/2013) 198
Idem, p.40. 199
Ibidem. 200
Marcel Dumais, L’interprétation de la Bible dans l’Eglise, Paulines, Montréal, 1994, p.57-58. 201
Paul Valadier, « La libération et Evangile », in : Etudes, revue mensuelle fondée en 1856 par les Pères de la Compagnie de
Jésus, t. 338, Paris,1973,p.450.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 52
américain ne saurait se faire sans « l’analyse marxiste ». Les pasteurs sont avertis sur les précautions à
prendre pour réussir leur mission selon les réalités de ce continent. Mais quelle est la réceptivité de cette
théologie dans l’Eglise de notre temps ?
Par Jean-Paul Sakoto
2.2.8 EXPOSE 8 : LIBRES PAROLES D’UN THEOLOGIEN RWANDAIS : JOYEUX PROPOS
DE BONNE PUISSANCE PAR NTEZIMANA LAURIEN
INTRODUCTION
Dans cet ouvrage qui fait l’objet de notre travail, nous allons prendre la partie qui parle sur la stabilité. Cette
partie soumise à notre travail comporte deux parties essentielles : la pensée et la pratique. Pour ce faire, dans
le premier point Laurien va développer une pensée théorique qui ébauchera au second point où il va
proposer la pratique de sa pensée. En effet, Laurien propose ce cheminement pour conduire toute personne à
atteindre une vie de stabilité autrement dit l’état de bonheur permanent.
L’expression « la bonne puissance » qui va être au centre de la réflexion, exige que, nous ayons la même
compréhension et l’entendement. Il l’explique à partir d’un exemple en disant que « la bonne puissance » est
cette maturité de ne plus faire de différence entre être riche et être pauvre, être puissant et être faible, être
connu et rester obscur, savoir beaucoup de chose et être réputé ignorant. La bonne puissance dont il parle
dans ce livre, c’est celle du Christ, les autres étant de fausses puissances, c’est-à-dire des leurres qui égarent
les malheureux qui s’y fient. La bonne puissance est un trinôme dont le premier aspect est assurance ou
non-peur, la seconde force de vivre ou non-résignation et le troisième accueil absolu d’autrui ou non-
exclusion. Pour ce faire, l’homme qui a atteint cette maturité dit-il, ne se laisse pas faire ; il refuse toute
oppression et toute pression d’un « il faut » extérieur et se laisse instruire et guider par la jubilation de son
être interne, autrement dit sa conscience.
Au fur de mouvement de sa pensée, il montre les bienfaits et les limités des structures sociales, religieuses et
coutumières. En fait, au sommet de sa pensée sur la stabilité, il fera voir au lecteur que Jésus Christ est
libérateur par excellence et le modèle à imiter pour atteindre la stabilité. Dans ces divers articles –
témoignages issus d’un des plus terribles enfers contemporains – il livre la « poétique » de son action, la
quintessence qui en est la source jaillissante.
BIOGRAPHIE
NTEZIMANA Laurien, premier théologien laïc rwandais202
est né le 24 octobre 1955 au Diocèse de Butare,
marié et père de quatre enfants. Il a rompu avec la théologie académique lorsqu’à l’issue de sa formation à
Kinshasa et à Louvain, il a écrit son « a-thèse » en 1990 : « Libres paroles d’un théologien rwandais :
joyeux propos de bonne puissance » qui a remplacé sa thèse de doctorat qu’il devait présenter en théologie.
Depuis octobre 1990, il travaille à éveiller la conscience de ses concitoyens rwandais à la dimension
verticale de la vie. Il va le faire au sein du Service d’Animation Théologique (SAT) du Diocèse Catholique
de Butare où le Prix de la Paix de Pax Christi International de 1998 est venu reconnaître la valeur universelle
de ce travail. Le principe de bonne puissance l’a permis de fonder l’Association Modeste et Innocent
(www.ami-ubuntu.org) qui, depuis février 2000, malgré la prison et d’autres tribulations, travaille avec
succès à la réconciliation de la société rwandaise.
PARTIE I : LA PENSEE
1. L’interprétation englobante
Dans ce premier point, Laurien va montrer l’importance et la nécessité de la loi ainsi que sa limité. Et
pourtant la limité et la frontière que trace la loi, sont utile pour une bonne vie en société. En ce sens, il dit :
« cette limité et ces possibilités constituent pour l’homme un monde habitable, une demeure, … »203
.
202
NTEZIMANA Laurien, Libres paroles d’un théologien rwandais : joyeux propos de bonne puissance, Paris, éditions Karthala,
1998, p.8.
203
Ibid, p.76.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 53
1.1. L’endroit de l’englobante
L’interprétation englobante est l’ensemble des lois transmises de génération en génération. En ce sens,
chaque groupe de personnes, chaque société a cette « interprétation englobante ». En effet, le groupe ou la
société se veut à une visée universelle et hors de ce groupe ou cette société, pas de salut. Toute fois,
l’ « interprétation englobante » se veut comme une pratique qui unifie et ordonne l’ensemble des pratiques
pour donner le sens à toute la vie de chaque membre de la société ou le groupe.
En effet, l’englobante se veut concrète, singulière et collective car elle se vit dans tout le groupe et
individuellement par le fait que le membre se force à tout temps et tout lieu à se conforme à celle-ci. Elle est
un processus qui est inévitable pour que l’homme atteigne l’état de la stabilité, de la maturité sociale et la
plénitude de la vie humaine. En somme, par cette structure englobante, l’homme devient meurtrier car au
nom de l’englobante, il exclut et anéantit l’autre qui ne répond pas aux normes de l’englobante.
1.2. L’envers de l’englobante
L’englobante confronte de tempête et l’opposition des autres englobantes, elle a tendance à durcir en
imposant ce qu’il faut penser et ce qu’il faut faire d’où le « dogmadiscipline » pour designer le discours
supposé vrai et qui s’impose avec une autorité absolue. Ce dogmadiscipline se vit dans tous les aspects de la
vie humaine en société avec motif d’exclure du souffre nouveau qui indique la limite de l’englobante et son
incapacité à remplir la fonction de stabilité.
1.3. L’autre endroit de l’envers
Les faiblesses structurelles du système stabilisateur de l’homme pointent vers ce qu’il faudrait comme
« l’englobante nouveau modèle » : c’est cela « l’autre endroit de l’envers ». La véritable stabilité n’est pas
celui qui s’enferme et enferme les autres dehors mais celle qui libère l’homme de tout ce qui pourra le
retenir captif. En ce sens, Laurien dit que « l’homme atteint sa stabilité quand il peut tout recevoir sans se
laisser déséquilibrer sous choc ». La rigidité du dogmadiscipline dit-il, est l’envers de la quête d’un sol
solide, un appui qui ne vacille pas, qui contrairement de l’idée du dogmadiscipline est Dieu lui-même, le
Roc éternel. L’ouverture de l’englobante permet à l’homme à atteindre la stabilité et l’accessibilité à ce qui a
été si longtemps inaccessible.
2. Le passage du Christ
Jésus de Nazareth est né dans l’englobante juive mais Il a grandi avec une certaine démarcation et le
dépassement. C’est celui qui va introduire le nouveau cheminement vers la stabilité autrement dit, la
plénitude de l’homme. De l’englobante païenne à celle de juive, Jésus de Nazareth inaugure une nouvelle
entreprise pour le bonheur permanent de l’homme.
2.1. L’englobante du païen et le passage du juif
Etant donné que la religion comme tant d’autres groupes des personnes ont des règles et doctrine pour une
bonne vie d’ensemble. Nous devons se rendre compte que ces doctrines et règles séparent les humains de
l’inhumain et elles se veulent mettre fin toutes les angoisses et les violences.
Dans le monde païen, les mythes fondateurs et les croyances sont fournis pour vivre en communion avec
l’Eternel et pour garder la stabilité, le bien vivre dans la société204
. En ce sens, Laurien donne un exemple de
la culture rwandaise qui a dans son ensemble des croyances et les mythes pour garder unité et le bien vivre
au sein de la société. Pour ce faire, la culture rwandaise avait des éléments fondamentaux pour la pratique de
la croyance à savoir : « le Kuraguza » qui signifie divination, « le Guterekera » qui veut dire culte des
ancêtres et « le Kubandwa » qui signifie être prise en possession par l’esprit de Ryangombe205
. A partir de
l’expérience de sa propre culture, Laurien explique qu’avant la violence de juifs et des chrétiens, les dieux
du monde dite païen, ne sont pas des idoles vaines mais les figures où se disent l’ordre premier, le rapport du
céleste et du terrestre.
204
Cf. Walbert BÜHLMANN, Les peuples élus, Paris, Médiapaul, 1985, pp 192- 195. 205
Cf. MULAGO gwa CIKALA, « Initiation africaine et initiation chrétienne » in LYANGOMBE mythe et rites, Actes du 2ème
Colloque du CERUKI du 10 au 14 mai 1976, BUKAVU, éditions du CERUKI, 1976, p.33.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 54
L’histoire montre que la religion juive va poser un regard de méfiance envers les pratiques de païens, en se
disant la religion des peuples élus par le Vrai Dieu, elle menace l’englobante païenne et annonce un péril
grave pour son habitat ; le jour de YHWH. En effet, il est à noter que le judaïsme est né au milieu du monde
païen et les partisans de cette religions vont s’imposer et impose leur comportement comme le seul modèle
valable ; de ceci, ils vont exclure d’autres englobantes. Et pourtant, l’histoire montre que ce peuple au désert
a marqué un attachement tout particulier au monde païen par la nostalgie des oignons d’Egypte et la
séduction des filles de Canaan. Quel paradoxe de la vie ?
2.2. L’ailleurs du païen et du juif
C’est dans ce peuple juif que naîtra Celui qui se veut Vérité : Jésus de Nazareth, par rapport à la demeure du
païen renvoyée à l’illusion. Jésus va s’attaquer non seulement aux pratiques païennes mais aussi celle des
juifs notamment attachement à la loi mosaïque, au temple, le sabbat, la terre sainte, la circoncision, etc. en
effet, chacun dans sa propre langue va entendre l’apparition de Jésus. Contrairement au judaïsme, Jésus ne
menace pas ; Il replace le mépris juif par un amour ; un amour qui donne à éprouver ce qu’il apporte. Jésus
aime tout le monde sans distinction, pauvre comme riche, juste comme pécheur ; cette maturité que Jésus de
Nazareth réalise, c’est ce que Laurien appelle la « bonne puissance ». Il est à noter que cet amour est tout ce
qu’il y a de plus mortel pour les dieux. Jésus se positionne comme celui qui veut nous apprendre le moyen
d’atteindre le bonheur permanent ou la stabilité en nous proposant l’amour du prochain et celui de l’ennemi
La proclamation du Règne de Dieu par Jésus trouble tout le monde ; plus rien n’est en place, plus
rien n’est reconnaissable : les publicains et les prostituées passent avant les honnêtes gens au ciel.
L’indicible et inconnaissable YHWH est devenu « Papa » qui vient du mot hébreux « Abba » (qui est un mot
familier de la langue hébraïque, celui que les petits enfants utilisaient en se jetant dans les bras de leur papa ;
quelque chose comme « petit papa chéri ! »206
). Jésus dit qu’Il est le chemin du Royaume car « Nul ne vient
au Père sinon par moi. » (Jn 14,6).
2.3. Le passage du Christ
Le passage du Christ inaugure une nouvelle vision du Royaume de Dieu. Il dit que le royaume est déjà là et
n’est pas encore arrivé ; d’où la demande de hâter l’arrive du Royaume de Dieu dans le « Pater » que Jésus
Christ a appris à ses disciples. Le peuple vit en Jésus Christ le Royaume de Dieu en pleine marche vers
l’éternité. La fracture du monde païen inaugure le commencement de la naissance d’une nouvelle englobante
ouverte sur le sans appui. Dans ce sens, Israël va œuvrer pour ce monde nouveau que déclare le Christ, et
comme Saint Paul le dit que « le Salut vient de Juifs ». Dans cette ouverture du monde nouveau par où nait
l’homme nouveau, la Croix est le chiffre et le témoin.
En effet, Jésus de Nazareth se présente à l’humanité comme la voie et la lumière qui éclaire pour le salut de
l’humanité. Sans lui, cette naissance nouvelle est parfaitement impossible comme le dit Jésus : « Pour
l’homme c’est impossible mais pour Dieu tout est possible » (Mt 19,26). Le passage du Christ révèle la
puissance de Dieu capable de maintenir l’englobante ouverte sans folie. Laurien affirme que pour rejoindre
cette puissance, il faut traverser le grand désert, où l’homme est tout seul face à l’ennemi de tout genre
humain ; en ce sens, il est à noter que sans la présence agissante de la puissance de Dieu, la traversée est
impossible.
Toute la vie terrestre de Jésus était dirigée vers cette mission d’amener l’humanité vers son Père. Il a fait
tout pour sa gloire et pour la manifestation de son Royaume sur la terre et Il l’a manifesté jusqu’au dernier
souffre où le Père enlève au Fils le dernier « contrôle » de sa vie. Cette perte du contrôle est en même temps
le véritable passage du Christ de ce monde à son Père. Une trouée dans la clôture de l’englobante juif ouvre
le paradis au monde entier. En somme, par sa mort et sa résurrection ; Jésus conduit à l’éternité tous ceux et
celles que le Père a attiré à son Fils.
3. La Bonne Nouvelle
206
Noël QUESSON, Parole de Dieu pour chaque jour. Jalon pour les lectures de semaine. Les évangiles, Tome 1, 6ème
édition,
Paris, Droguet& Ardant, 1995, p. 109.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 55
Toutes les englobantes prescrivent toujours le programme de la vie de l’homme nouveau. Les morales et
disciplines de toutes sortes mettent au commencement ce qu’il faut que l’homme fasse pour mériter la vie
bonne et le pardon de péché. Avec le Christ, la vie bonne et le pardon sont données en premier et sans
condition. Voilà, le salut et la Bonne Nouvelle pour le peuple de Dieu. Le salut est offert à tous et celui qui
sait recevoir reçoit sans rien payer en retour. Jésus vient aider tout le monde à atteindre la perfection et la vie
éternelle. Il faut se laisser toucher par Lui et sa Parole car Il est venu libérer ceux qui étaient tenu en
esclavage par la peur de la mort (Hb2, 15).
3.1. Voici l’homme
Jésus de Nazareth a laissé une lumière incomparable sur la révélation de l’homme et de Dieu. En effet,
toutes les choses sont prescrites dans la société par l’englobante et l’homme fait tout ce qu’il peut. Le peuple
d’Israël en devenant le peuple élu et saint face aux nations païennes, il dépeuple le monde païen et il
construit une excellente englobante avec des rites que Jésus va exploser en transmutant un par un de ses
piliers : le Temple ? C’est désormais le corps de l’homme. Le Sabbat ? Pour l’homme et non l’inverse. La
loi et les Prophètes ? Aimer son prochain comme soi-même. La Terre Sainte ? Jusqu’aux extrémités de la
terre. La Circoncision ? Désormais ce sera la conversion du cœur. L’indicible YHWH est désormais Abba,
Père.
Jésus, est ce juif qui a osé à opérer un grand changement dans la vie sociale et religieuse dans l’englobante
juive comme de païen. Une englobante qui épouse la vision de Jésus dans sa totalité, est la seule capable à
faire naitre l’homme à la bonne puissance.
3.2. Le sur-vivant
La pointée du passage du Christ consiste à marcher sans appui, puisqu’on évolue en deçà au delà des
sécurités de l’englobante et compte sur l’inouï pour en sortir vivant. C’est en ce sens que le passage du
Christ et sa Bonne Nouvelle, sont les seuls moyens capable à franchir la limité déclarée infranchissable par
l’englobante juive comme celle des païens.
3.3. Vita hominis, visio Dei
Jésus nomme l’indicible YHWH : Abba, Père. Le « Dieu des armées » est révélé par son Fils comme le
« Père aimant ». En effet, il est à noter que toute perversion commence quand l’homme vient à perdre la
confiance originaire. En ce sens, chacun d’entre nous peut se demander la qualité de sa confiance en Dieu et
en Jésus Christ car on juge l’arbre par ses fruits. Cette confiance aide à recommencer la vie bonne par delà
de l’échec ou l’impasse ; c’est cela précisément le chemin du meilleur. La Bonne Nouvelle est qu’il est
toujours possible à l’homme de vivre. C’est le message de Jésus Christ quand il mangeait et buvait avec les
pécheurs et se laisse traiter de glouton, d’ivrogne, ami des pécheurs et des publicains. Oui, pour Dieu la vie a
du grand prix à ses yeux que d’autres choses existantes.
Conclusion : Le Roc de la stabilité
L’amour de Dieu pour l’homme est le fondement de notre assurance. Cet Amour est la condition sine qua
none de la stabilité et aspect fondamental de la bonne puissance. Par la vie en pleine intimité avec Dieu,
l’homme parvient à la stabilité. Pour y arriver, il faut passer par le feu car il ne suffit pas de se présenter au
Temple ou à l’Eglise, d’être circoncis où être un chrétien mais plutôt la pratique de la charité de tout cœur
envers Dieu, le prochain et par-dessus l’ennemi. En ce sens, Laurien dit que dans l’enseignement de Jésus
sur l’amour est le point culminant et la base de toute vie en Dieu car l’amour de Dieu s’étend sur tout être
humain méchant comme bon, juste comme injuste en fait sur toute créature. Jésus l’a témoigné en
disponibilisant toute sa vie à la proclamation de l’amour de Dieu et son sacrifice au Golgotha pour devenir
ainsi le chemin qui mène tout homme au salut.
PARTIE II : LA PRATIQUE
Dans le monde actuel est plein de discordes, de conflits, de guerres de haines ; l’unité se perd de jour à jour ;
pour ce faire, il est difficile d’arriver à la stabilité. L’humanité de l’homme est mise à rude épreuve par cette
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 56
civilisation dominée par le technicisme, le matérialisme et l’intellect. Dans cette conjoncture, Laurien
affirme qu’il est inutile de construire des bonnes et excellentes théories théologiques mais plutôt chercher
les voies et moyens pour restaurer l’unité, la paix, la justice dans l’amour. En effet, Laurien à partir de son
expérience habituelle de la danse de Tao, il propose cette danse comme une source de la stabilité ou une vie
de bonheur permanent car la voie proposée par Jésus et la danse de Tao pour atteindre le bonheur permanent
ont en commun l’insistance de redevenir comme un petit enfant.
1. Modèle Tai Ji de la stabilité
Il est question de concentration, relaxation, axe, équilibre pour la stabilité dans le mouvement de Tai Ji.
Cette sorte de méditation dite « Ours » ou « mapa » se fait debout, jambes à l’aplomb de hanches, le bassin
bousculé, la colonne vertébrale droite et non rigide, la tête poussant le ciel, les épaules lâchées, les bras
lourds le long du corps, les jambée légèrement pliées et décontractées, le corps relaxé du visage aux orteils
avec la sensation de s’ancrer dans le sol tout en s’étirant vers le ciel.
Ce modèle de Tai Ji implique une entreprise de longue haleine car l’équilibre n’est possible que si on trouve
l’axe qu’on trouve par une pratique patiente et passionnée de l’exercice. L’axe est trouvé quand le corps est
totalement relaxé pour flotter librement autour de son axe. En effet le corps relaxé est bien disposé pour
déposer le fardeau des soucis et pour se concentrer sur ce qui se passe en soi, à chaque instant de la vie.
Par cette pratique de Tai Ji, on arrive à la respiration embryonnaire qui fait que l’homme parvient non
seulement à sentir le corps mais aussi à entrer dans la vacuité ; c'est-à-dire, dans la présence non-discursive à
la totalité de son propre corps et à ce qui l’entoure. Ce modèle de faire doit amener la personne à l’instant
vivant, en se reprenant sur les extériorités qui dispersent et empêchent à vivre.
2. Modèle « bonne puissance » de stabilité
Laurien dit que l’équilibre est la fameuse « paix du Christ » qui n’est pas celle du monde car elle demeure
même aux moments les plus troubles de la vie. Dans la pratique de Tai Ji, cette paix vient quand l’homme
trouve son axe qui est « relation originaire » qui établit l’homme en la Schekinah. Cette paix est l’objet la
plus recherche au monde entier car elle est la source jaillissante de l’humain dans l’homme.
Pour être établi en cette relation, il faut qu’il soit rétabli la confiance originelle qui permet de s’abandonner
au rien de tout ce que nous connaissons comme assurance. Cette confiance est rétablie quand l’homme
parvient à faire taire tous les bruits et se concentre sur l’Esprit, ce souffle qui est le Chi de la Schekinah. En
somme, en arrivant de faire taire tous les bruits et s’habiter en plénitude, on peut dire comme un
gamin : « Abba » d’une manière authentique ; en ce sens, on entre dans le Royaume de sans soucis.
3. Conseils stabilisants
Dans la société actuelle, les hommes accordent de l’importance à ce qui n’en a pas. Ils perdent la mesure et
l’équilibre en abandonnant leur bonne puissance pour s’inféoder aux puissances qui mènent le monde entier.
Comment peuvent-ils ressaisir leur bonne puissance ?
3.1. Prendre la vie par le bon bout
Laurien dit « tout est vanité » (Qo1, 2). En ce terme, il rappelle l’homme à reprendre sa liberté. Vu ce qui se
passe dans la société, il dit quel profit pour l’homme de s’échiner pour réussir et s’élever dans l’échelle
sociale en écrasant tout sur son passage, si c’est pour finir par rejoindre ses victimes connus et inconnus au
cimetière ? En effet, ce qu’il reste c’est prendre la vie par le bout de la gratuite par la crainte de Dieu. Il
affirme que craindre Dieu et écouter sa parole veut dire en Tai Ji rester centre sur la respiration de la
schekinah.
3.2. Habiter le Royaume de sans Soucis
Pour habiter ce royaume, il faut redevenir comme un tout petit enfant : « Quiconque n’accueille pas le
Royaume en petit enfant n’y entrera pas » (Lc18, 17). Le propre de l’enfant, c’est de vivre sans souci. Le
jeu, l’imagination récréative, voilà son domaine. Comment pouvons –nous proposer l’homme adulte ne
cesser de soucier du manger, du boire du vêtement et du reste comme le dit Jésus dans son évangile ? C’est
cela l’invitation de laisser demain au bon soin de lui-même car chaque jour suffit sa peine.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 57
Le faible, c’est l’homme non centré, qui a perdu son axe ; il s’aventure seul dehors, et prétend se tenir
debout en dehors de la schekinah. Le faible, l’orphelin, le malheureux, l’indigent, le pauvre, l’opprime, c’est
toujours d’abord toi et moi quand nous nous prenons pour des adultes. En agissant ainsi, nous sortons du
Royaume se sans Soucis pour entrer dans un pays étranger où, forcément, nous rencontrons mille soucis.
Pour vaincre ces milles soucis et problèmes, il faut redevenir enfant ! C'est-à-dire, accepter sans fausse honte
que ce combat est au dessus des forces humaines et chercher l’appui du Père. Quand l’homme est recentré
sur le Père qui est dans les Cieux, c’est alors son énergie à lui qui agit. C’est pareil dans le Tai Ji avec Wu-
Wi, le non-faire où le pratiquant bien centré laisse agir à travers lui l’énergie cosmique.
3.3. Le mode de vie « repos »
L’homme d’aujourd’hui vit dans une civilisation de bruit et d’agitation où tout est bâclé même le plaisir.
Beaucoup d’hommes et femmes s’adonnent tout temps au travail pour gagner disent-ils, la vie. En effet, en
travaillant ainsi, ils manquent un tout petit temps pour jouir la vie gagnée si durement. Il faut qu’ils prennent
du temps de se retirer pour un repos en vue de jouir de la vie gagnée et de refaire la vie du corps ainsi que de
l’âme en se recueillant à l’intérieur de leur être profond.
4. Plaisanteries à l’usage des âmes révolutionnaires
Il faut nous rappeler tout temps que personne ne nous a chargés de porter les poids du monde car nous ne
sommes pas le sauveur du monde. L’unique est le Sauveur et le rédempteur du monde Jésus Christ, ainsi il
faut nous éloigner des illusions de nous faire passer en sauveur. Si une fois ou plusieurs, on sent qu’on a
beaucoup d’énergies et de zèles de changer le monde, il faut se rassurer que leur usage pourra faire de mal.
Pour se libérer pour le bon : il faut se relaxer, se détendre ainsi les chaines tomberons toutes.
CONCLUSION
De l’englobante juive comme celle des païens, Dieu est présent en œuvre au cœur de l’homme car ces
englobantes sont des moyens d’exprimer la croyance à une divinité. Pour Jésus, la pratique de l’amour vainc
et libère l’humanité de toutes les entraves de la vie pour l’éternité. En devenant comme petit enfant,
l’homme parvient à vivre dans le bonheur permanent ; d’où la proposition de Laurien de la danse de Tao qui
l’a permis d’entrer dans le royaume des sans soucis. Redevenir comme un enfant : chemin de la joie
éternelle.
HABINEZA Pascal
3 THEOLOGIE FEMINISTE
Alice Dermience définit la théologie féministe comme une théologie de femmes pour les femmes fondée sur
leur expérience d’oppression, de discrimination, et de marginalisation ayant pour but de dénoncer, critiquer
et combattre le patriarcat dans la société, dans les relations interpersonnelles et dans l’Eglise.207
La théologie féministe n'est pas une théologie du génitif, qui est, ce n'est pas une théologie «de» ou «sur» les
femmes. Elle n'est pas non plus une simple affirmation de « la féminité dans la théologie, ou la théologie
dans une perspective de genre ». Et, bien sûr, la théologie féministe et la théologie de la femme ne
doivent pas se confondre, dans les paroles du théologien espagnol Mercedes Puerto Navarro, la théologie de
la femme, « en général, se réfère à la pensée que renforce une féminité présumée ontologique et, plutôt que
les femmes en supposant, pluriel et différents, suppose l'existence de les femmes et le féminin, plutôt que
d'assumer les femmes, pluriel et divers, comme communément perçus aux hommes ».
Par conséquent, les théologies féministes surgissent lorsque les femmes se constituent dans un thème
théologique et ils commencent à faire de la théologie de leur expérience et avec une perspective critique de
deux manières: d'abord, concernant les concepts, les valeurs, normes et les stéréotypes dans une société
patriarcale et exclusive, et deuxième, sur les conséquences de la théologie patriarcale dans la vie des femmes
dans l'Église et dans la société.
207
Cf. Alice DERMIENCE, La question féminine et l’Eglise catholique, approaches biblique, historique et théologique,
Bruxelles, Peter Lang, 2008, p. 139.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 58
En outre, les théologies féministes, se réapproprient la tradition religieuse et la reconstruisent de façon
créative dans un cadre d'interprétation qui n'est pas patriarcale. Elles veulent contribuer à une réflexion
véritablement universelle théologique et œcuménique, capable d'intégrer les expériences et de langues
différentes au sujet de Dieu, sans imposer une seule adresse et une expérience unique comme normative.
Comme le souligne l'historien de la théologie Rosino Gibellini, « théologie féministe introduit dans le cercle
herméneutique [...] à l'autre moitié de l'humanité et l'Eglise, en enrichissant l'expérience de foi, leur
formulation et leurs expressions [...]. Non destiné à être unilatérale, mais pour répondre efficacement à la
théologie et la praxis unilatérale ecclésiale dominante et est présentée comme une contribution à la «
dimension incomplète de la théologie » [...], vers la « théologie holistique 'un véritable ». Par conséquent, les
théologies féministes supposent la création d'un paradigme théologique inclusif, nouveau et libérateur pour
toute l'humanité, donc affirmant l'expérience et la pensée des autres que les mâles, riches, blancs et
occidentaux, afin de générer de nouvelles opportunités pour tous.
3.1 LA MISOGYNIE ET L’ORIGINE DE LA THEOLOGIE FEMINISTE
3.1.1. LA MISOGYNIE DANS LA BIBLE ET DANS LA TRADITION CHRETIENNE
3.1.1.1 La misogynie dans la Bible
La misogynie dans l’Ancien Testament
Gn 1-2 : Création de la femme après l’homme.
Gn 3 : La chute.
Qo 7, 26 : « Et je trouve plus amère que la mort, la femme, car elle est un piège, son cœur un filet, et ses
bras des chaînes. Qui plaît à Dieu lui échappe, mais le pécheur s'y fait prendre. »
Si 42, 14 : « Mieux vaut la malice d'un homme que la bonté d'une femme une femme cause la honte et les
reproches. »
Pr 30, 19-20 : « le chemin de l'aigle dans les cieux, le chemin du serpent sur le rocher, le chemin du vaisseau
en haute mer, le chemin de l'homme chez la jeune femme. Telle est la conduite de la femme adultère : elle
mange, puis s'essuie la bouche en disant : " Je n'ai rien fait de mal! " »
La misogynie dans le Nouveau Testament
1 Co 11, 3.7.8.9 : « Le chef de tout homme c’est le Christ, le chef de la femme, c’est l’homme…
L’homme… est l’image de la gloire de Dieu, mais la femme est la gloire de l’homme. Car ce n’est pas
l’homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l’homme. Et l’homme n’a pas été créé pour la femme,
mais la femme pour l’homme. »
1 Co 14, 34-35 : Comme cela se fait dans toutes les Eglises des saints, que les femmes se taisent dans les
assemblées ; elles n’ont pas la permission de parler ; elles doivent rester soumises, comme dit aussi la loi. Si
elles veulent s’instruire sur quelque détail, qu’elles interrogent leurs maris à la maison. Il n’est pas
convenable qu’une femme parle dans les assemblées. »
Col 3, 18-19 : « Epouses, soyez soumises à vos maris, comme il se doit dans le Seigneur. Mari, aimez vos
femmes... »
Ep 5, 21-23 : « Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Que les femmes le soient à leurs
maris comme au Seigneur : en effet, le mari est chef de sa femme, comme le Christ est chef de l'Église, lui le
sauveur du Corps. »
1 Tm 2, 8-15 : « Ainsi donc je veux que les hommes prient en tout lieu, élevant vers le ciel des mains
pieuses … Que les femmes, de même, aient une tenue décente… Pendant l'instruction, la femme doit garder
le silence, en toute soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de faire la loi à l'homme. Qu'elle
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 59
garde le silence. C'est Adam en effet qui fut formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui se laissa
séduire, mais la femme qui, séduite, se rendit coupable de transgression. Néanmoins elle sera sauvée en
devenant mère, à condition de persévérer avec modestie dans la foi, la charité et la sainteté. »
2 Tm 3, 6-7 : « des femmelettes chargées de péchés, entraînées par toutes sortes de passions et qui, toujours
à s'instruire, ne sont jamais capables de parvenir à la connaissance de la vérité. »
Tt 2, 3-5 : « jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être réservées, chastes, femmes d'intérieur,
bonnes, soumises à leur mari… »
P 1, 3, 1 : « Pareillement, vous les femmes, soyez soumises à vos maris, afin que, même si quelques-uns
refusent de croire à la Parole, ils soient, sans parole, gagnés par la conduite de leurs femmes. »
3.1.2 FEMINISME ET ANTIFEMINISME DANS LA TRADITION DE L’EGLISE 208
Pasteur d’Hermas (140-154) présente l’Eglise comme une femme à la foi jeune et vieille, prostrée et belle.
St. Justin (+c. 165) fait une comparaison entre Marie et Eve.
St. Irénée (+c. 200) reprend la comparaison de Justin.
Tertullien (+c. 225) avait des idées misogynes :
« Vous devez toujours porter le deuil, aller en haillons et se vautrer dans la repentance, pour racheter le
défaut d'avoir été le fléau de l'humanité ... » En outre, « Femme, tu enfanteras dans les douleurs et les
angoisses, tu seras sans cesse attirées vers ton mari, et il te dominera. Et tu ne veux pas reconnaitre En en
toi ? La sentence de Dieu sur ce sexe vit encore de nos jours. En bien, oui, qu’elle vive ; il faut que ce crime
demeure un opprobre éternel. O femme ! tu est la porte par où le démon est entré dans le monde ; tu as
découvert l’arbre la première ; tu as enfreint la loi divine ; c’est toi qui as séduit celui que le Démon n’eut
pas le courage d’attaquer en face ; tu as brisé sans efforts l’homme, cette image de Dieu ; c’est enfin pour
effacer la peine que tu as encourue, c'est-à-dire la mort, que le Fils de Dieu lui-même dut mourir »
(Tertullien, De l’Ornement des femmes, I,1).
Clément d’Alexandrie (+c. 215) était pour l’égalité entre l’homme et la femme.
Origène (185-253) avait une vision homme-femme assez équilibrée.
Jean Chrysostome (349-407) considérait le mariage comme un résultat du péché. La beauté de la femme
est un sépulcre blanchi rempli d’immondices à l’intérieur. Il affirme que de « toutes les bêtes sauvages la
plus nuisible est la femme ». La femme n’est pas créée à l’image de Dieu. L’analogie de l’opposition
homme-femme est spirituel-matériel. Malgré ses idées misogynes, Jean Chrysostome avait une grande
estime pour la virginité.
St. Ambroise (333-397) avait une vision positive de la femme.
St. Grégoire de Nysse (335-394) avait une vision positive des femmes. Elles pouvaient être des modèles
dans la vie chrétienne. Pourtant, il ne voyait pas les femmes comme prêtres ou évêques.
208
Cf. Henri ROLLET, La condition de la femme dans l’Eglise : Ces femmes qui ont fait l’Eglise, Paris, Fayard, 1975 ; Alice
DERMIENCE, La question féminine et l’Eglise catholique : Approaches biblique, historique et théologique, Bruxelles, Peter
Lang, 2008 ; Rosemary Radford RUETHER, Women and Redemption : A Theological History, Minneapolis, Fortress Press,
1998 ; George H. TAVARD, Woman in Christian Tradition, University of Notre Dame Press, Notre dame, 1973.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 60
St. Jérôme (347-420) avait des idées misogynes. Il pouvait considérer l’amour excessif d’un mari à sa
femme comme adultère. Il avait une haute estime pour la virginité.
St. Augustin (345-430) avait une vision de la femme venant de deux premiers chapitres du livre de la
Genèse et la lettre de St. Paul aux Ephésiens (5, 21-33). Il considère la femme étant subordonnée à l’homme.
Ceci n’est pas dans le sens de l’infériorité mais de l’amour. St. Augustin avait une haute estime pour la
virginité plus que pour le mariage.
St. Thomas d’Aquin (1225-1274) avait des idées misogynes. Il affirme que dans la reproduction l’homme
un rôle actif tandis que la femme un rôle passif. Pour Thomas d’Aquin la femme est inférieure à l’homme
non seulement au niveau corporel mais aussi au niveau de l’âme. La femme est créé pour aider l’homme
dans la procréation et non pas come une fin en soi. Il voit le péché d’Eve à deux niveaux : désobéissance à
Dieu et séduction de l’homme. Sa punition est double : douleurs de l’enfantement et être dominée par
l’homme.
3.1.3 L’ORIGINE DE LA THEOLOGIE FEMINISTE 209
La relation entre la théologie et les femmes depuis des siècles a été problématique. Jusqu'à récemment, il a
nié aux femmes leur statut de sujets théologiques. Pendant près de deux mille ans, par conséquent, ont été
des consommateurs passifs d'une interprétation théologique et la proclamation de la foi exclusivement
masculine et, pour la plupart, membres du clergé.
Cependant, le statut des femmes, il a été l'objet d'une réflexion théologique et le sujet régulier de la
prédication, et ne pas penser au féminin comme une manière d'être humain, mais d'expliquer ces questions
fondamentales pour l'humanité comme source du mal douleur et la mort, associés, comme nous le savons
tous le péché originel et, plus spécifiquement, Eva. Ainsi, les femmes ont été considérées pendant des siècles
comme un agent de Satan, - Eva coupable qui a apporté le mal dans le monde -, et son corps, considéré
comme impur, a été interprétée comme une occasion de péché barrière entre Dieu et les hommes, et en cause
de l'imparfait ressemblance entre la divinité et les femmes. Exemple de cette conception de la femme sont
les mots du théologien Tertullien: «Vous devez toujours porter le deuil, aller en haillons et se vautrer dans la
repentance, pour racheter le défaut d'avoir été le fléau de l'humanité ... Femme, tu es la porte du diable. C'est
vous qui avez touché l'arbre de Satan et le premier à violer la loi divine. » La langue n'est pas à jour, mais
reflète clairement sous-jacente misogynie patriarcale.
Malheureusement, l'interprétation patriarcale des femmes fait la tradition biblique pour apporter de
nouveaux arguments pour la légitimité de la misogynie ambiante dans la culture gréco-romaine, la culture
dans laquelle, justement, née la théologie chrétienne, qui, en quelque sorte, est née et a misogyne.
Par ailleurs, le discours théologique et ecclésiastique, au sujet des femmes considérées comme homme
défectueux, une idée que la théologie a pris de la philosophie grecque. En raison de son défaut et le manque
d'exhaustivité, qui la rendait plus vulnérable au mal et à succomber à la tentation, a plaidé pour un modèle
de la femme gardée par des hommes, à leur charge, et incompétent, finalement devenir un adulte.
D'autre part, la maternité est exaltée comme un objectif et d'épanouissement pour les femmes et que
l'expiation de sa culpabilité. Par conséquent, ils étaient considérés comme des organismes ou à l'Eglise -les
vierges, dont la maternité est considéré comme spirituel-, ou pour la famille -les mères-, mais toujours des
bénéficiaires passifs. Dans ce contexte, ceux qui ont osé prendre un rôle actif - et ont toujours existé - ont été
critiqués, persécutés et même tués pour avoir été les femmes et ne pas rester dans la place assignée à leur
sexe.
Ce discours ecclésiastique sur les femmes est devenu un pilier pour soutenir et renforcer l'ordre social
patriarcal de l'Ouest, et aujourd'hui encore, peut être tracée dans l'imaginaire collectif de la féminité. Il est
vrai que le christianisme n'a pas inventé le patriarcat, mais c'est aussi que les théologies chrétiennes ont
contribué à le nourrir et de le renforcer pendant des siècles. Pourquoi? Peut-être parce que l'Eglise elle-
209
Cf. María José Ferrer ECHAVARRI, Mémoire de l'approche la théologie féministe, Gijón, Juin 2011 ; Lucie RAMON
CARBONELL, « Introduction à l'histoire de la théologie féministe chrétienne» dans Mercedes ARRIAGA FLÓREZ et Mercedes
NAVARRO PUERTO (éd.), La théologie féministe I, Séville, Arcibel, 2007, p. 101-177, Lucie RAMON CARBONELL, Nous
voulons du pain et des roses: Emancipation des femmes et le christianisme, Madrid, CAOS, 2011, pp 141-178.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 61
même adopté l'ordre dans sa structure interne, bien que Jésus a appelé les femmes et les hommes à une
communauté de disciples égaux. Si nous passons en revue l'histoire du christianisme est que, très tôt, a
limité la participation des femmes dans la prédication apostolique, dans les ministères, dans l'éducation et la
théologie, ils ont couru jusqu'à l'exclusion de ces zones. Ainsi, les femmes et la création théologique est
devenu réalités incompatibles et contradictoires.
Pour justifier ces restrictions sur les femmes, l'Église utilisait pendant des siècles une anthropologie
théologique comme une «théologie de la femme» qui reste, à bien des égards, encore en vigueur dans leur
enseignement officiel. Donne généralement la même dignité spirituelle et la même vocation profonde de
l'homme et la femme, mais sont donnés une essence fondamentalement différente à chacun, homme ou
femme. Cette essentialisation de la différence génère différents charismes et les tâches de la femme doit
« faire apparaître cette vie cachée avec Christ en Dieu, qui est l'essence de notre religion » selon les mots du
père Henry, tandis que l'homme « il gouverne, peut être un prêtre, enseigne … » La distribution des cadeaux
et des tâches, en fonction du sexe, les femmes enfermées dans la sphère privée, que ce soit à domicile ou à la
fermeture monastique, et des exclus elle, par décision divine, de la participation dans les domaines de la
production intellectuelle, de décision et de pouvoir dans l'Eglise.
Les théologies de la femme des années 50, pour leur part, bien qu'ils appréciaient davantage les femmes,
considère toujours d'elle un objet de réflexion et a demandé l'éternel féminin, sans se laisser interroger par
les questions et la réalité de vie des femmes individuelles.
Ils ont été « théologie génitif », c'est à dire, les théologies développées autour d'un thème, les femmes dans
ce cas, mais pas de l'expérience de la vie.
3.1.3.1 Le cadre conceptuel et social de la naissance de la théologie féministe chrétienne
D'un point de vue historique, le cadre de référence conceptuelle et sociale de la théologie féministe
contemporaine se compose de quatre traditions et un théologico-ecclésial événement: a) le discours et des
idéaux politiques des Lumières; b) La critique féministe et la reconstruction des paradigmes des sexes; c) La
théologie de la libération; d) Le mouvement œcuménique ; et e) Le Concile Vatican II.
a) Le discours politique et les idéaux des Lumières
Dans l'Ouest, la demande pour des droits égaux pour les femmes et le féminisme, né des idées des Lumières.
Par conséquent, on peut parler d'un féminisme théorique articulée, cohérente et critique à partir du XVIIIe
siècle. Depuis, selon Descartes, le cerveau n'a pas le sexe, la discrimination des femmes - qui, à la lumière
de la raison, était une atteinte arbitraire - aurait dû être rejetée, permettant l'accès des femmes égal à tous les
domaines pour lesquels a été exclu. Mais les promesses émancipatrices universalisantes et illustrées n'ont
pas inclu les femmes. Comment les penseurs des Lumières ont-ils réussi esquiver leurs propres hypothèses
de laisser de côté de ces postulats les exigences de l'égalité des femmes?
Naturaliser les sexes. Ainsi, il a été considéré comme naturel et donc inévitable, la supériorité masculine,
qui fait de lui valaient pour les sciences supérieures et le gouvernement politique et l'infériorité des femmes,
qui les qualifie pour les activités secondaires et de moins de substance. Biologie, par conséquent, a été
renforcée en tant que destination.
Néanmoins, malgré cela, les femmes éclairées, en général, ont défendu la cause égalitaire et émancipateur
des Lumières.
Les idées des Lumières éventuellement ont fourni les fondements du modèle éthique, du développement
social et politique de nos sociétés modernes, mais malheureusement, les contradictions du siècle des
Lumières ont également fait partie de son héritage pour l'avenir et peut être trouvé même dans notre vie
quotidienne.
b) La critique féministe et la reconstruction des paradigmes de genre
Reprenant la tradition des ancêtres illustres, la théorie féministe critique tente de surmonter les
contradictions actuelles de la culture et de la société qui, théoriquement, affirmerait l'égale dignité entre les
sexes, mais en réalité, ne donne pas une valeur égale aux femmes et ne pas leur donne les mêmes chances
que les hommes.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 62
La théorie critique féministe reconnaît que l'égalité juridique - qui n'existe pas encore dans la plupart des
régions du monde - est essentielle, mais insuffisante pour créer une égalité réelle, par conséquent, il exige un
profond changement des valeurs dans les sociétés patriarcales. Pour ce faire, met en question le paradigme
patriarcal et la pensée androcentrique, qui, de toute culture et société, identifie les hommes avec les humains,
la rationalité supérieure et une puissance, et la femelle, avec moins, auxiliaire, l'intuition et la passivité.
La théorie critique féministe met en question également les formes d'organisation et les pratiques socio-
économiques et politiques qui soutiennent et perpétuent les pouvoirs sexuelle des rôles, parce que ces
pouvoirs sont culturelles et, souvent compromise. Ainsi, des théories critiques féministes tentent de
déconstruire le paradigme et l'ordre social patriarcal et leur remplacement par véritablement inclusif, ce qui
n'est pas d'établir une hiérarchie ou des différences dualités essentialiste entre les sexes.
La théologie féministe chrétienne utilise la théorie féministe comme un outil pour l'analyse de la réalité et
une source de la pensée critique capable d’affirmer la dignité non seulement de femmes mais de toute
l'humanité. Elle s'approprie la critique des outils conceptuels de la critique féministe et l'utilisation dans le
domaine de la théologie, le questionnement des aspects de la théologie pour justifier la domination
masculine et la subordination des femmes. Mais comme toute vraie théologie, elle cherche à être non
seulement critique, mais à reconstruire et à réinterpréter d’une manière équitable et inclusive les symboles
théologiques nucléaires: Dieu, l'humanité, homme et femme, le péché, le salut, la création, et ainsi de suite.
Par ailleurs, le féminisme n'est pas une logique sectorielle sur les femmes, mais la pensée critique appliquée
à la réalité sociale dans tous ses aspects. La théologie féministe considère cette vocation universaliste du
féminisme et découvre que les idéaux féministes et les objectifs coïncident avec certains aspirations
chrétiennes fondamentales, parce que la communion de toute l'humanité sans exception et donc la
communauté réconciliée d'hommes et de femmes est une dimension fondamentale du Royaume de Dieu
annoncé par Jésus.
c) Les théologies de la libération
Comme on le sait, la théologie de la libération constitué un nouveau paradigme et une révolution dans la
méthode théologique, une nouvelle façon de faire de la théologie et de lire la réalité dans une manière
critique et libératrice. Il s'agit d'une théologie qui, selon les termes de Gustavo Gutierrez, « ne se limite pas à
une réflexion sur le monde, mais cherche à se positionner comme un moment à travers lequel le monde se
transforme ». Les théologies de la libération par les sciences sociales sont utilisés pour analyser les
mécanismes d'oppression et de chercher des alternatives, mais, surtout, constituent une nouvelle
herméneutique où la praxis de la libération est un moment interne de la connaissance théologique. Comme
on le sait, en théologie de la libération, les pauvres constituent l'excellence lieu socio-théologique qui est
nominal.
Cependant, au début, la théologie de la libération n'est pas venue de trouver pleinement avec les femmes.
Dans les mots de Juan José Tamayo: « Les femmes chrétiennes, qui dès le début jouées un rôle important
dans la praxis libératrice des mouvements populaires et la base de groupes chrétiens étaient absents dans la
configuration de la méthode et d'épistémologie théologique, qui portait la marque de l'homme. Les
expériences de marginalisation des femmes ne sont pas en vue de la nouvelle œuvre théologique... Ce n'est
que lorsque les femmes ont rejoint la théologie et ont participé à la reformulation de la foi dans féministes
clés, elles ont commencé à corriger le caractère androcentrique du discours chrétien de libération, et
l'attention à la discrimination sexuelle et la féminisation de la pauvreté ». Et Ivone Gebara le théologien
explique l'absence de la « place de la femme comme lieu théologique » dans la réflexion théologique de la
libération: « Leurs questions personnelles et de groupe n'existent pas pour la théologie. Leurs corps ont été
manipulés et contrôlés comme si elles étaient la propriété. Leur recherche de libération a dû être reportée à
recherches plus grands, plus générales, c'est à dire, les propositions de ceux qui ont imposé des lois pour le
changement social ».
Les premiers à reformuler la théologie de la libération en clés féministes étaient des théologiens américains
et européens, dont introduit dans son travail théologique et anthropologique des outils d'analyse et les
catégories politiques du féminisme et articulés avec les perspectives ouvertes par la théologie de la
libération, assis, donc les fondements de la théologie féministe contemporaine.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 63
Aujourd'hui, les théologies féministes chrétiennes, la plupart, sont présentées comme théologie critique de
libération. Elles sont théologies contextuelles qui s'écartent de la souffrance réelle des femmes et de leurs
expériences historiques dans leur combat pour la vie, elles analysent les causes de discrimination et
prévoient des mesures pour les éliminer, en proposant une vision alternative et prophétique de l'avenir. Son
idéal moral et politique est la justice pour les femmes et elles veulent contribuer à la langue théologique, afin
d'éliminer l'exclusion systématique et pécheresse des femmes dans les domaines socio-économique,
politique, ecclésiale et théologique. Elles revendiquer la pleine reconnaissance de la dignité des femmes et
leur pleine humanité à l'image de Dieu, et de récupérer leur participation dans toutes les sphères de la société
et l’Eglise. Leur place est épistémologique engagement concret et historique pour la libération des femmes.
Elles considèrent que la politique et la spiritualité sont inséparables. Elles cherchent une réforme de la
théologie, l'Eglise et la société, une transformation-conversion des personnes, des institutions et de la société
en général.
Les théologies critiques de la libération sont également des théologies auto-critiques qui évaluent et jugent
les différentes théories féministes et les différentes idées de la libération des femmes dans le mouvement
féministe.
d) Le mouvement œcuménique
Le mouvement œcuménique a été un terrain privilégié d'habiliter le leadership de l'Eglise et la théologie de
la femme. L'établissement de réseaux locaux et internationaux a contribué de manière décisive à
l'avancement et la richesse des différentes théologies féministes, le dialogue et la co-création.
Il est impossible d'expliquer ici en détail les contributions de divers groupes confessionnels au
développement de la théologie féministe chrétienne, je me contenterai donc de souligner le travail de trois
entités:
- Le Conseil œcuménique des Eglises, dont l'engagement pour l'éducation théologique des femmes
chrétiennes et le réseautage des femmes à travers le monde a contribué à l'émergence de la théologie
féministe en Asie, en Amérique latine, d'Afrique et d'Océanie;
- L'Association Œcuménique des Théologiens du Tiers-Monde,, qui en 1983 a créé la Commission pour
les femmes, visant à développer une théologie de la libération du point de vue des femmes dans le Tiers
Monde;
- Et le Forum œcuménique de femmes chrétiennes de l'Europe, dont l'objectif était de développer une
théologie féministe européen pour transformer l'église et la société.
e) Le concile Vatican II
Dans les milieux catholiques, enfin, ont été décisifs pour la naissance de la théologie féministe les
innovations théologiques et pratiques introduites par le Concile Vatican II et sa réception par les femmes
catholiques. Dans le même temps, le nouvel œcuménisme promue par le Conseil, a permis d'explorer les
possibilités que les femmes des autres familles chrétiennes ont dû travailler en théologie et dans d'autres
domaines et les fonctions des églises.
Dans ses documents officiels, le Concile Vatican II rejette toute forme de discrimination fondée sur le sexe
(Constitution dogmatique Gaudium et spes, n. 29), proclame l'égalité des droits dans le monde du travail (n.
34), la culture (n. 60) et la famille (n ° 49), et souligne l'importance des femmes dans divers domaines de
l'apostolat de l'Église (décret Apostolicam actuositatem, n. 9). Mais il y avait revendications de ce type que
la plupart directement promu le développement de la théologie féministe catholique, mais l'écart entre la
théorie et la pratique, l'absence de progrès réel, et même après les revers de la participation des femmes à la
vie de l'Eglise.
Depuis Vatican II, beaucoup de femmes catholiques ont pris conscience que, si elles-mêmes n'ont pas eu
accès à la réflexion théologique, toujours dépendant d'une seule doctrine développée par des hommes qui,
jusqu'ici, il avait ignoré et exclu.
3.1.3.2 L'histoire Brevisima des théologies féministes Comme l'histoire de la théologie féministe est concernée, il ya eu beaucoup de femmes qui, à travers les
siècles, ont protesté de leur statut inférieur et a fait d'importantes contributions à divers domaines de la
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 64
connaissance, la culture et la politique, les femmes dont l'historiographie féministe est la récupération et le
sauver de l'oubli. Malgré la misogynie ambiante, les femmes ont cherché et trouvé des façons d'exprimer
leur créativité et d'inventer des modes de vie, souvent clandestinement, et s'efforcèrent de conquérir des
espaces pour leur permettre de développer leurs talents au-delà de leur destin biologique. Certains ont même
payé de l'occupation de leur vie dans les zones qu'elles sont interdites. Par conséquent, il est possible de
traquer les traces de ce qu'on pourrait appeler proto-féminisme, à la fois théoriques et pratiques. Cependant,
personne ne peut parler de féminisme vrai et la théologie féministe émergents jusqu'à ce que le XVIIIe et
XIXe siècles, respectivement.
Au milieu du XIXe siècle, l'Amérique est devenue le centre du féminisme, du fait de la naissance du
mouvement des suffragettes. Le vote était une revendication majeure, mais elle était partie d'une lutte plus
large sur lequel les femmes cherchent une société plus juste, qui comprenait sa propre libération. Avant de
revendiquer leurs droits, les femmes ont commencé à préconiser l'abolitionnisme et, ce faisant, a fini par
devenir conscients de leur propre oppression. La Convention de Seneca Falls, organisé par Elizabeth Cady
Stanton et Lucretia Mott en 1848 fut le début d'un mouvement social pour l'émancipation des femmes. Ces
femmes confondus action politique avec une réflexion théologique, qui a pris forme dans la publication de
La Bible pour les femmes, Elisabeth Cady Stanton, publié en 1895 et 1898. Ce travail a été une première
étape dans l'appropriation des femmes de leur droit à la pensée critique et créative et parole libératrice. Ils
ont fait valoir que l'égalité des sexes dans l'image de Dieu, traduit en l'égalité sociale, a été la volonté
originelle de Dieu. Le sexisme est donc interprété comme un péché contre les femmes et contre Dieu, parce
qu'elle fausse la volonté de Dieu pour la création.
Ce fut née dans les années 60 dans les États-Unis et en Europe sous la forme de diverses théologies
comprenant plusieurs disciplines théologiques et servir une variété de méthodes et d'approches théologiques,
selon les différentes trajectoires biographique et intellectuelle. Ainsi, la théologie féministe, de ses débuts, a
la marque de la pluralité. Cependant, il y a des dénominateurs communs chez ces théologiens: approche
inclusive, critique et créative, leur analyse selon le genre, et que toutes étaient des femmes des classes
moyennes blanches. En outre, elles ont du printemps à partir de deux découvertes capitales pour la
théologie: tout d'abord, que ce qui était jusqu'ici considéré comme « l'expérience humaine universelle » était
en fait l'expérience et la compréhension des hommes sur eux-mêmes, le monde et Dieu, et la seconde, qui
doit s'interroger sur la semelle et l’identification exclusive de Dieu avec les hommes, parce que, comme
Mary Daly a dit, « Si Dieu est mâle, puis le mâle est Dieu ».
Concernant le contexte nord-américain en particulier, la théologie féministe a émergé de la confluence de
deux phénomènes: les mouvements civils des années 60 et la relance du mouvement des femmes connu sous
le nom troisième vague du féminisme, des facteurs à laquelle s'est joint à l'accès progressif des femmes
manifestantes de siècle au milieu du XIXe siècle, dans l'éducation théologique et le ministère.
Fait intéressant, les femmes catholiques américains, qui étaient beaucoup plus difficiles à développer une
carrière dans l'Église, ont été plus fécondes que les protestants en leurs développements théologiques, peut-
être pour deux raisons: 1) la majorité des femmes protestantes qui ont reçu la formation théologique dans le
dernier tiers du XXe siècle, consacré leurs efforts à la pastorale, et 2) le refus de la capacité des femmes
d'être ordonnées prêtres légitimes a encouragé la recherche théologique des femmes catholiques et a nourri
leur besoin d'analyser la cohérence et la validité des arguments théologiques du refus.
Malgré les difficultés dans leurs églises respectives, la théologie féministe est maintenant établie en
Amérique du Nord dans le domaine académique. Entre autres choses, il y a beaucoup d'écoles théologiques
de différentes confessions, qui ont été fondamentaux pour l'éducation théologique de la femme et de
développer leur carrière professionnelle dans la théologie.
En ce qui concerne l'Europe, la conscience féministe théologique a également commencé à se développer
après 1960, grâce au travail de théologiens de plusieurs pionniers qui ont abordé des questions comme la
nécessité de changer la loi de l'Eglise, la morale sexuelle et les valeurs humaines. Elles analyser de manière
critique l'expérience des femmes, a postulé la nécessité d'une nouvelle terminologie, a critiqué l'idéologie
patriarcale et l'attribution patriarcale de Dieu, et a étudié le rôle des femmes dans la tradition chrétienne.
Depuis 1975, Année internationale de la femme, l'intérêt porté sur l'anthropologie théologique, l'éco-
féminisme, de la théologie politique, la théologie systématique, de la méthode théologique et la spiritualité
féministe.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 65
Durant cette période, a été fondé les associations fondamentales pour le développement de la théologie
féministe en Europe comme Les femmes et les hommes dans l'Eglise, la Société Européenne de femmes
chercheurs dans la théologie et du Forum œcuménique de femmes chrétiennes européenne. Tous ces ont
lieu régulièrement et ont publié leurs recherches. Il y a eu également deux synode européen des femmes en
1996 et 2003, très important pour la réunion, le dialogue et la diffusion de la théologie féministe.
Dans le sud de l'Europe, il est remarquable de la création en Espagne du mouvement femmes et la théologie,
le Collectiu de Dones en l'Esglesia, et l'Association des théologiens espagnols (ATE), qui favorisent les
journées d'études, des réunions annuelles, les cours et les publications qui ont joué un rôle fondamental pour
diffuser de la théologie féministe en Espagne. L'École de théologie féministe de l'Andalousie (EFETA),
fondée en 2006, marque un jalon dans l'histoire de la théologie féministe, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de
l'Espagne, comme la première école de online de la théologie féministe dans le monde pour le moment seul.
Au stade actuel de développement des théologies féministes en Europe, est devenu un dialogue important
avec les études de genre et qui sont florissantes dans de nombreuses disciplines au niveau universitaire.
Ressentir le besoin d'un nouveau pluralisme, ce qui implique de réduire la domination de la théologie
chrétienne et soulignent le dialogue avec les savants juifs, musulmans et d'autres religions. Dans le même
temps, les théologiennes européennes sont conscientes du racisme en Europe et de l'héritage de
l'impérialisme européen. Ainsi, l'ordre du jour de la théologie féministe vise à renforcer la solidarité
européenne globale chez les femmes qui respectent les différences.
Dans les années 80, l'émergence de voix théologiques de la femme des marges avertit d'un autre danger:
celui de l'identification de l'expérience particulière d'un groupe de femmes à des «femmes» en général.
Africaines et afro-américaines, latines et d'Amérique latine, d'Asie, les femmes amérindiennes et indigènes
d'autres continents ont exprimé leur inquiétude que les blanches, femmes euro-américaines, sont
suffisamment représentatives de l'expérience de toutes les femmes. Elles croient que la domination des
femmes blanches est un reflet de la domination de la culture occidentale blanche sur les autres, et ont
développé leurs propres réflexions théologiques, ouvrant un nouveau chapitre dans la théologie féministe,
qui est enrichie par les perspectives d'autres contextes culturels et d'équilibrer les complexités des relations
d'oppression, menant à diverses théologies féministes.
La womaniste est la théologie féministe chrétienne qui est développé à partir de la perspective d'afro-
américaine. Les théologiennes womanistes considèrent la famille et la communauté comme des valeurs
fondamentales et elles s'identifient avec les luttes de toute la communauté noire contre l'oppression. Elles
ont affirmé continuer une longue tradition de la pensée religieuse des femmes noires américaines, dont leur
voix tente de récupérer et être de retour à l'abolitionnistes du XIXe siècle. Elles veulent repenser la
théologie, les études bibliques, éthique, sociologie de la religion et le ministère de la perspective et
l'expérience des femmes noires. Elles critiquent le sexisme de ces deux théologies de la libération noire
développée par les hommes, comme le racisme dans les théologies féministes de femmes blanches, tout en
reconnaissant sa dette envers eux. Son expérience particulière d'oppression devient le critère pour juger de
toute la théologie herméneutique et théorie de l'éthique. Et même si elle est une théologie de la décision, ses
pionniers s'installent dans les plus complexes questions théologiques et offrent des nouvelles perspectives
sur des questions centrales telles que la christologie, le mal, la souffrance et de rédemption.
La théologie Mujerista provient de l’expérience propre foi des femmes Latines. Pour les femmes
hispaniques aux Etats-Unis, les préjugés ethniques et l'oppression économique sont ajoutés à l'expérience
accablante de sexisme. Dans cette perspective, les théologiens mujerist sont ces femmes hispaniques que, à
partir de leur réflexion théologique, leur lutte contre cette triple oppression ont fait une option préférentielle
pour les Latines et leur libération. La théologie Mujerist est considérée comme une praxis libératrice.
Le but de la théologie Mujerist est la formation des femmes latines, leur développement moral et de leur
prise de conscience de la valeur et l'importance de ce qu'elles sont, pensent et font. Les théologiennes
mujeristes ont une haute estime pour la communauté, au point qu’elles développent souvent sa théologie
dans la communauté et lors des séances de travail en groupe.
Les théologies latino-américaines féministes découlent de femmes qui ont rejoint les communautés de
base et la théologie de la libération, mais que, depuis les années 80, ont perçu l'absence d'une contribution
spécifique des femmes dans la production théologique, et ont commencé à développer des théologies
féministes critiques de la libération dans la perspective latino-américaine. L'objectif de la théologie latino-
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 66
américaine féministe, selon les mots de Maria Pilar Aquino, « d'encourager et d'accompagner les initiatives
et les processus développés par les femmes à transformer les structures et les théories qui nient, limitent ou
empêchent le plein développement et de l'intégrité et la dignité de les femmes en termes anthropologiques,
politiques, sociales et religieuses ».
La théologie féministe d’Amérique latine, a été spécialement dédiée aux études bibliques, en soulignant les
aspects qui ont échappés à la lecture androcentrique. Leur champ théologique et herméneutique est les
femmes pauvres. La théologie est ainsi devenue liée à la praxis de libération, et à un engagement à rendre
visible la situation et les expériences spécifiques des femmes pauvres. Maria Pilar Aquino, affirme que la
réalité historique « est le point de départ et d'arrivée de la théologie, et les deux sont reliées par le
principe de la transformation ».
Les théologies féministes asiatiques, également né dans les années 80. Elles ont examiné tous les aspects
de la théologie chrétienne: étude de la Bible, Dieu, la christologie, l'Église... Dans le Tiers Monde, et en ce
jour les théologiennes asiatiques ont beaucoup écrit, bien que leurs travaux soient moins connus dans
l’occident. En raison de la pluralité religieuse de l'Asie et ses traditions spirituelles anciennes, les
théologiennes asiatiques féministes travaillent dur dans le domaine du dialogue interreligieux et
interculturel.
Elles sont bien conscientes que le christianisme est un nouveau venu à la mosaïque multiraciale,
multiculturelle et multi-religieux qui sont des pays asiatiques, dont beaucoup souffrent aussi de l'héritage du
colonialisme européen, américain et japonais, un militarisme forte, l'exploitation par les multinationales, la
propagation d'exploitation sexuelle et le SIDA, qui façonnent profondément les théologies asiatiques
féministes.
En Corée du Sud, par exemple, parmi les questions spécifiquement abordés par les théologiennes féministes
sont: l'unification des deux Corées, le traité des femmes, le tourisme sexuel et la demande de la justice pour
les femmes coréennes qui ont été contraintes à la prostitution et l’esclavage sexuel pour l'armée japonaise en
Seconde Guerre mondiale.
En tout cas, la conception négative des femmes et leur sexualité est présente dans toutes les cultures et les
religions de l'Asie et est une préoccupation commune à toutes les théologies asiatiques.
Les théologies féministes africaines sont nées à la fin des années 80 lorsque un groupe appelé Cercle des
théologiennes africaines engagées est fondé. Dès le début, ces théologiennes ont mises, l'accent sur la
spécificité du développement social, économique et culturelle dont elles parlent, irrévocablement marqué par
le colonialisme la pauvreté et le néocolonialisme. Les femmes africaines ont conclu que leurs expériences
sont significativement différentes des autres femmes, donc elles doivent briser ce qui a été jusqu'ici un
silence contraint et parler d'elles-mêmes. Elles insistent pour que ce droit de parler pour elles-mêmes soit
une condition nécessaire pour leur propre émancipation.
Les sources de leur théologie, comprise comme une praxis libératrice, comme un engagement pour la
justice, la vie et la liberté de l'oppression, sont les traditions de la théologie chrétienne, mais ils ajoutent de
l'expérience des femmes africaines, l'Afrique et de l'histoire culturelle des religions et de leurs propres
sources de spiritualité. L'inculturation du christianisme dans le contexte multi-religieux et multiculturel de
l'Afrique est l'une des principales préoccupations des théologiennes africaines, aidées par l'herméneutique
culturelle et de l'herméneutique biblique. Elles considèrent la communauté comme un don de Dieu, mais
elles sont critiques du sexisme latent dans leurs cultures et du rôle joué par les interprétations bibliques
comme une source de la théologie d'oppression pour les femmes.
Cette lecture prophétique de la Bible les met en situation de conflit avec leurs communautés culturelles et
avec leurs et les autorités religieuses. Autres sujets d'intérêt pour les théologiennes africaines sont
christologie, ecclésiologie et anthropologie. Pour elles, la religion et la culture sont comme deux facettes qui
jouent sur la vie des femmes africaines.
Ces dernières années, a aussi émergé une théologie féministe de noires et indigènes latino-américains.
Excursus : N'importe qui regarde le monde dans la perspective de la justice, découvre une réalité choquante à l'égard
des femmes. Les chiffres sont renversants: depuis 1990 ont fait plus de cent millions de femmes qui
devraient être nés, et ils n'ont pas fait de la préférence enfant de sexe masculin et par conséquent
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 67
l'avortement sélectif, 67% des pauvres sont des femmes, représentant 80% de malnutrition, 70% d'adultes
analphabètes et 67% des enfants de l'école, leur travail représente 52% du total, mais seulement possèdent
1% de la terre et 10% de l'argent dans l'immobilier, et n'occupent que 10% des postes de responsabilité et de
représentation politique. Une femme sur trois souffre d'abus ou de violence sexuelle, des milliards de
femmes ont été battues, contraintes à des rapports sexuels non désirés, ou maltraités dans leur vie.
Amnesty International dans son rapport sur les droits de l'homme, un droit des femmes, fournit des données
alarmantes et déclare: «La discrimination est une maladie mortelle Chaque jour, plus les femmes et filles
meurent à la suite de diverses formes de violence et de discrimination fondées sur le sexe par toute autre
forme d'abus des droits de l'homme ».
Et, comme Elisabeth Schüssler Fiorenza, dit: « Il essaie d'exposer les structures de péché d'articles
déshumanisation et mettre en évidence et les perspectives de libération contenue dans la foi, la tradition et la
communauté chrétienne. Par conséquent, [...] ne concerne pas seulement les femmes, mais ceux qui
s'intéressent à la prospérité et la survie de notre monde et la race humaine ».
3.2 DIFFERENTES THEOLOGIENNES FEMINISTES
3.2.1 EXPOSE I : EN MEMOIRE D’ELLE : ESSAI DE RECONSTRUCTION DES ORIGINES
CHRETIENNES SELON LA THEOLOGIE FEMINISTE PAR ELIZABETH SCHUSSLER
FIORENZA
APPRROCHE INTRODUCTIVE
Marc 14,9 a fait l’objet de certaines recherches. Ce verset a été vachement développé par E.
Schüssler Fiorenza à travers son œuvre : En mémoire d’elle, Essai de reconstruction des origines
chrétiennes selon la théologie féministe. Pendant que pour d’autres disciples hommes, les noms sont cités,
l’histoire de cette femme qui parfume Jésus par amour reste oubliée. Pourtant on se rappelle le nom du
traître ou encore de Pierre qui renie son Maître. Le quatrième évangile identifie ladite femme à Marie210
de
Béthanie qui, en tant qu’amie de Jésus lui manifeste son amour. Le geste de la femme semble provoquer des
objections dans le rang des disciples. Par ricochet, Fiorenza apporte, à travers son approche, une correction à
la figure des hommes présents à la dernière cène et qui dénaturent les symboles, la ritualisation et la qualité
de disciple.
En mémoire d’elle, est un ouvrage qui cherche à reconstituer l’histoire chrétienne primitive comme
une histoire féministe et une théologie féministe. Nous situons cette théologie contextuelle dans le cadre
d’oppression des femmes comme dit Fiorenza : « tant que les histoires des femmes des débuts du
christianisme ne seront pas conceptualisées théologiquement comme partie intégrante de la proclamation de
l’Evangile, les traditions et les textes bibliques formulés et codifiés par les hommes resteront une source
d’oppression pour les femmes. »211
Fiorenza estime que la reconstruction féministe de l’histoire des débuts
du christianisme vise la critique culturelle et religieuse et au même moment la reconstruction de l’histoire
des femmes à l’intérieur du christianisme. C’est une critique envers la communauté chrétienne et ses
traditions. Il s’agit de lire les sources bibliques sous un regard féministe. Le but de cette étude est donné par
Fiorenza quand elle affirme : « la théologie féministe comme critique de la libération s’est développée au-
dessus et contre l’androcentrisme symbolique et la domination patriarcale à l’intérieur de la religion
biblique, tout en cherchant en même temps à reprendre possession de l’héritage biblique des femmes, dans
le but de leur donner le pouvoir, l’énergie nécessaire à leur lutte de libération. »212
Pour exhiber les méandres du sujet, nous subdivisons le travail en trois parties dont le mouvement Jésus
comme mouvement de renouveau dans le Judaïsme, la deuxième partie sera focalisée sur la maison
patriarcale de Dieu et l’ « Ekklèsia » des femmes et enfin nous donnerons notre critique négative et positive.
210
Cf. Elisabeth Schüssler FIORENZA, En mémoire d’elle, Essai de reconstruction des origines chrétiennes selon la théologie
féministe, Paris, Cerf, 1986, p. 10-26. 211
Elisabeth Schüssler FIORENZA, En mémoire d’elle, Essai de reconstruction des origines chrétiennes selon la théologie
féministe, Paris, Cerf, 1986, p. 13. 212
Idem, p. 24.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 68
I. MOUVEMENT JESUS COMME MOUVEMENT DE RENOUVEAU DANS LE JUDAISME
En effet, Fiorenza initie, en tant qu’exégète, une réinterprétation du Nouveau Testament. Cette
réinterprétation est basée sur l’égalité des disciples. Elisabeth Fiorenza213
pose une question de taille lorsqu’
elle demande comment est ce que nous pouvons reconstruire les origines du mouvement chrétien primitif, de
manière à reprendre possession de l’histoire des femmes juives. Elle s’inscrit sans doute dans les racines
féministes juives. Avec un regard réaliste sur le mouvement chrétien qui date d’au moins deux millénaires
maintenant, l’on peut remarquer des changements dans la vie courante. Ces changements ne sont pas pour
autant appliqués à l’essentiel du message chrétien. En tant que mouvement religieux missionnaire, le
mouvement chrétien s’est imposé à l’éthos (c'est-à-dire habitude ou coutume) religieux et culturel patriarcal,
alors que le mouvement Jésus, en tant que mouvement de renouveau alternatif du judaïsme, entrait en
conflit avec l’éthos patriarcal dominant de sa propre culture. On peut aussi voir qu’il y avait au début un
sérieux problème lié au manque d’uniformité dans l’observance des prescriptions de la loi juive. A cet effet,
les non juifs se sentaient écartés suite à ce comportement qui serait qualifié d’anomique dans ce contexte
juif. Certains groupes du mouvement Jésus ont, cependant, décidé de ne pas se limiter plus longtemps aux
juifs et ont, dans ce canal, admis les gentils comme membres à part entière du groupe, sans exiger leur
conversion au judaïsme.
1. Les femmes dans le judaïsme avant 70 : perspectives214
Bien qu’il soit évident que Jésus, n’a en aucune manière, renforcé le patriarcat, il n’est pas non plus
évident qu’il ait fait quoi que ce soit de radical pour le rejeter. De cette vision une autre question surgit : les
féministes chrétiennes peuvent-elles pour être considérées comme antijuives, cesser d’analyser de manière
critique et de dénoncer les structures et les traditions patriarcales de la foi et de la communauté chrétienne ?
Néanmoins, d’une manière analogue, les premiers membres du mouvement Jésus et du mouvement chrétien
missionnaire étaient des femmes juives ainsi que des hommes.
Toute approche, féministe ou patriarcal, dans notre contexte se réclame avoir Jésus comme fondement.
Il est cependant délicat de redécouvrir Jésus féministe au-delà et contre ces racines juives du christianisme
primitif, ne peut conduire qu’à renforcer et à prolonger un antijudaïsme. Dans la voie similaire, redécouvrir
Jésus féministe au-delà et contre les Juifs, et non pas au-delà et contre le patriarcat chrétien, ne ferait que
signifier un renforcement du patriarcat religieux occidental. Cela étant, la question reste posée. E. Fiorenza
la reformule avec clarté quand elle dit : « la question qui se pose n’est pas de savoir si oui ou non Jésus a
renversé le patriarcat, mais si le judaïsme contenait les éléments d’un élan critique féministe qui a pris forme
dans la vision et le ministère de Jésus. La reconstruction du mouvement Jésus comme communauté de
disciples égaux n’est historiquement plausible que dans la mesure où il est pensable que de tels éléments
critiques existaient dans le contexte de vie et de foi juives. »215
Plutôt que de lire les textes au sujet des femmes dans le judaïsme comme des informations exactes sur le
statut et le rôle des femmes dans la vie réelle, Fiorenza propose de les soumettre à une critique
méthodologique féministe dont elle fait usage elle-même. Ainsi, dit-elle : « (…) dans la mesure où le passé
chrétien est intrinsèquement lié par ses racines au judaïsme pré rabbinique, nous devons chercher à
reconstruire l’expérience historique de ces femmes juives qui sont présentées à l’ombre du christianisme. » 216
Avec un ton aigu, ce ténor du féminisme nous fait savoir que les textes ou encore les sources historiques
juifs et chrétiens doivent être lus comme des textes androcentriques. Tout simplement parce que tels qu’ils
sont, ils reflètent l’expérience, les opinions personnelles de l’auteur mâle (parlant de l’homme, Fiorenza
n’hésite pas de l’appeler mâle). Ils ne reflètent pas la réalité historique et l’expérience des femmes.
Toutefois, Fiorenza tente de nuancer son idée en la précisant et la situant dans son contexte. Elle poursuit en
disant que des telles affirmations isolées ne devraient pas être interprétées comme tradition positive ou
négative concernant les femmes du judaïsme. Elle considère donc que toute glorification ou encore tout
213
Cf. Idem, p. 155-157. 214
Cf. Idem, p. 164-170. 215
Elisabeth Schüssler FIORENZA, En mémoire d’elle, Essai de reconstruction des origines chrétiennes selon la théologie
féministe, Paris, Cerf, 1986, p. 166. 216
Idem, p. 167.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 69
dénigrement et toute marginalisation des femmes dans les textes juifs doivent être compris comme une
construction sociale de la réalité dans des termes patriarcaux ou comme une projection de la réalité mâle.
Le statut des femmes semble complexe à définir. Bien que dans le judaïsme rabbinique, les femmes
soient classées parmi les esclaves et les enfants lorsqu’il s’agit des questions religieuses ou légales, les récits
bibliques concernant les femmes montrent qu’elles n’étaient perçues ni comme des mineurs ni comme des
esclaves dans la vie quotidienne. Par ailleurs, le statut socio religieux des femmes dépendait aussi de leur
degré d’autonomie économique et de leur importance dans la vie sociale.
2. L’éthos dominant : la nation sainte et le royaume d’Israël 217
E. Fiorenza montre que certaines femmes pouvaient bénéficier d’une indépendance ou d’une
autonomie selon qu’elles ont un rôle prépondérant dans la vie sociale ou selon qu’elles appartiennent à une
certaine classe. Les femmes juives ont, elles aussi, les privilèges et les limites fixées pour d’autres femmes
dans la culture dominante de leur époque. Certaines femmes pouvaient se faire militaires et d’autres
pouvaient contribuer aux finances du temple. Par contre, la littérature apocalyptique et celle la sagesse ont
aussi répandu une conception négative des femmes. Elles les ont présentées comme une occasion de péché
pour les anges et pour les hommes, tout particulièrement les sages.218
Dans ce sens, des hommes de classe
moyenne ont été prévenus d’être prudents à l’égard des femmes auxquelles ils avaient à faire. Cette attitude,
estime Fiorenza, se retrouve à différentes époques et dans diverses sociétés. C’est donc des termes culturels.
Quelques soient ces conditions, Fiorenza dit : «(…) le mouvement Jésus a refusé de définir la sainteté du
peuple élu de Dieu en des termes culturels, le redéfinissant, au contraire, comme la plénitude à laquelle est
déterminée la création. »219
Un certain regard teinté de négligence est porté sur les femmes au sein de la culture juive et au
prélude du christianisme. En l’occurrence, nous avons le récit de la décapitation de Jean Baptiste en Marc 6,
17-29. Ce récit a un fondement historique, mais il a été entouré des détails supplémentaires moins fiables
selon Fiorenza. Hérode n’était pas roi et il était totalement dépendant de Rome. En outre, une jeune
femme220
d’un statut social aussi élevé que celui de Salomé fille d’Hérodiade n’aurait pas été conviée à se
produire comme simple danseuse déterminée à plaire aux convives durant les réceptions d’Hérode. Et la
présentation d’Hérodiade comme étant la femme de Philippe, frère d’Hérode, reste vague et ambigüe étant
donné qu’Hérode avait deux frères nommés Philipe. Des passages similaires on en trouve comme : « Aucun
essénien ne prend de femme parce qu’une femme est une créature égoïste, excessivement jalouse et prompte
à détourner son mari de la morale et à le séduire par des artifices continuels. »221
Ce point de vue est plutôt
contre le mariage qu’indirectement contre les femmes. La conception et le regard négatifs sur les femmes
sont énormes. Elles sont même considérées comme occasion de péché pour les anges et pour les hommes.
Notons que les femmes sont souvent réduites à leur féminité. Néanmoins, elles s’en démarquent
comme cela est le cas de Judith.222
Il est avéré que Judith se bat avec les armes d’une femme. Elle
n’accepte pas d’être enfermée dans sa beauté ou dans un comportement féminin, elle les utilise contre les
hommes qui la réduisent à sa beauté de femme et qui sous estiment son pouvoir. Pourtant elle a une sagesse
intelligente, une fidélité à la piété, un dévouement à la cause du peuple et des atouts qui la définissent mieux.
Alors dans cet angle les hommes voient les femmes comme des accessoires ou des atouts pour eux-mêmes.
Judith résiste d’assumer ce rôle de victime. Cependant, il est à noter que des femmes à l’instar de Judith
saisies par la grâce de Dieu ont accompli des actions dignes des hommes.
Par ailleurs, la vision du royaume proposée par Jésus trouve ces femmes sur la voie de sortie de l’écart à
l’intégrité inclusive. Ainsi on peut lire la parabole du festin nuptial (cf. Mt 21, 1-14) comme ce qui force
l’auditeur à reconnaître que le royaume inclut tout le monde. Ce n’est pas la sainteté des élus, mais
217
Cf. Elisabeth Schüssler FIORENZA, En mémoire d’elle, Essai de reconstruction des origines chrétiennes selon la théologie
féministe, Paris, Cerf, 1986, p. 171-182. 218
Cf. Idem, p. 177. 219
Idem, p. 175. 220
Cf. Idem, p. 176. 221
PHILON, hypothetica 11, 14-17, cité par E. FIORENZA in En mémoire d’elle, Essai de reconstruction des origines
chrétiennes selon la théologie féministe, Paris, Cerf, 1986, p. 177. 222
Cf. Elisabeth Schüssler FIORENZA, En mémoire d’elle, Essai de reconstruction des origines chrétiennes selon la théologie
féministe, Paris, Cerf, 1986, p. 181.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 70
l’intégrité de tous qui est au cœur de cette vision de Jésus. C’est pourquoi ses paraboles prennent aussi des
exemples dans le monde des femmes et rendent la dignité aux femmes. Il prend l’exemple de la profonde
pauvreté des femmes illustrée par la veuve qui donne tout ce qu’elle a pour vivre dans le trésor du
Temple.223
Dans cette optique, la promesse du Royaume aux pauvres, parmi lesquels beaucoup sont les
femmes ne devrait pas être interprétée de façon inexacte, ou comme un futur prix de consolation, mais
perçue comme une proclamation de la justice divine. Jésus dit que beaucoup des derniers sont devenus
premiers, des affamés rassasiés, des laissés pour compte invités, beaucoup parmi eux étaient des femmes.
3. Le Dieu-Sophia de Jésus et la condition de disciple des femmes
Le passage du créancier qui remet gratuitement les dettes à ceux qui ne parviennent pas à rembourser
rejoint les pécheresses publiques qui, désormais pouvaient être admises dans le mouvement Jésus dans
l’assurance de l’aimer davantage. La sagesse de Jésus considère tous les Israélites comme ses enfants et
chacun le sait. Les femmes sont conscientes de cette approche de Jésus et pendant que les juifs sont contre
l’admission des gentils dans le mouvement Jésus il y a une femme qui insiste pour que cette position soit
bannie. Elle sait qu’elle est opprimée et considérée comme un chien. Elle dit que les petits chiens sous la
table peuvent manger des miettes qui tombent de la table du patron. Jésus est convaincu par son argument et
délivre sa fille du démon.
En effet, les femmes 224
qui avaient fait l’expérience de la bonté miséricordieuse du Dieu de Jésus ont été
les premières à étendre le mouvement Jésus en Galilée et à développer, à partir des traditions Jésus, les
raisons théologiques pour lesquelles accès à la puissance Dieu de Jésus. Ces femmes n’ont pas fini après
l’arrestation de Jésus, ont assisté à sa mort et sa sépulture. Elles ont été les premières au tombeau et ont
constaté qu’il était vide. Elles sont les premières à voir le Ressuscité.
Au moment de la naissance du mouvement Jésus, les veuves et les orphelins étaient considérés comme le
prototype des pauvres et des exploités. Et pourtant dans la théologie chrétienne on parle du pauvre Lazare et
non de la veuve indigente qui était devenu le modèle exemplaire de la pauvreté. Nous avons donc négligé
d’exprimer l’expérience théologique de l’espérance de Jésus pour femmes qui sont pauvres et démunies. E.
Fiorenza225
s’écrit contre toute direction de la théologie chrétienne qui permet aux femmes de s’identifier
aux catégories et aux groupes généraux tels que les isolés, les frères, les pauvres, mais qui ne leur donne de
s’identifier à eux en tant que femmes solidaires des autres femmes. Par ce canal les femmes sont invisibles.
Même si la réponse convient pour les hommes et pour les femmes, certaines questions sont androcentriques
(est-il permis à un mari de répudier sa femme ?) Le mariage patriarcal semble maintenir les structures
économiques patriarcales et religieuses qui ne sont plus nécessaire car on doit vivre dans le monde de Dieu.
Ceci revient à dire que dans le monde de Dieu les hommes et les femmes ne sont plus en relation de
domination les uns envers les autres. La dépendance patriarcale est finie. D’ailleurs, une femme voulait dire
les éloges de la mère de Jésus quand celui intervint aussitôt. Il fit savoir que l’important réside dans la
fidélité et l’application de la parole. Un rôle de disciple fidèle et non de maternité biologique est la vocation
eschatologique des femmes. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l’observent. On voit
aussi que les opprimés ont maintenant la liberté puisque l’enfant ou l’esclave qui occupaient la place la plus
basse dans les structures patriarcales sont maintenant pris pour modèles. Ils deviennent ainsi des paradigmes
du disciple. Jésus dit que si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n’entrerez pas dans le Royaume
des cieux (Mc 10, 14-15).
II. LA MAISON PATRIARCALE DE DIEU ET L’ « EKKLESIA » DES FEMMES
De prime abord, tous les disciples avaient reçu différents dons de l’Esprit et avaient exercé diverses
fonctions d’autorité. Tous les membres de la communauté avaient, par voie de conséquence, un pouvoir
spirituel et dans cette dynamique, ils avaient accès à n’importe quelle responsabilité communautaire. Le don
de l’Esprit n’opérait pas un choix basé sur l’origine ou le sexe ou la race des membres de la communauté
primitive.
223
Cf. Idem, p. 188. 224
Cf. Idem, p. 211-212. 225
Cf. Idem, p. 215-222.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 71
1. La patriarcalisation de l’Eglise et du ministère
Nous voyons que les choses sont modifiées sans grande transition. Alors que le don de l’Esprit ne tenait
pas compte du sexe ou du statut social, certaines attitudes commencent à se faire observer face aux femmes.
Des textes viennent enfoncer ce clou. C’est le cas de 1Tm 2, 10-15 qui dit : « Une femme / épouse doit, ainsi
qu’il convient à son statut, garder silence, en toute soumission pendant l’instruction. Il ne lui est pas permis
d’enseigner ni de faire la loi à l’homme/mari, car cela irait à l’encontre de l’ordre de soumission. »226
Effectivement, en interdisant à une femme d’enseigner et l’empêchant d’avoir une quelconque autorité sur
un homme, peu importe que ce soit son mari ou un autre homme, cela éloigne des femmes toute possibilité
d’être élues aux fonctions de surveillant ou d’évêque. Même si les femmes éminentes sont autorisées
d’enseigner, leur enseignement est restreint sur d’autres femmes. Ainsi on peut voir que l’ordre patriarcal de
la maison s’applique aussi à l’Eglise et maintient par ce fait même les femmes dans une exploitation sociale
par les hommes. Cela s’élargie sur la communauté chrétienne.
Dans cette perspective, on passe donc d’un partage local de la responsabilité basée sur les dons spirituels
à une domination patriarcale. Il est connu que le Paraclet a été envoyé à tous les disciples et Fiorenza
souligne qu’il n’est pas un hasard pour le quatrième évangile de préciser par des récits frappant, la présence
des femmes disciples comme Marthe, Marie et Marie de Madeleine. Chaque fois que la congrégation se
rassemblait, ses membres tiraient au sort pour désigner celui ou celle qui devait assurer la fonction de
presbytre ou célébrer comme évêque, ou pour lire et expliquer les Ecritures et au même moment s’adresser
au groupe comme le faisait un prophète. A ce propos Fiorenza dit : « Tous les membres, femmes et
hommes, pouvaient aussi faire fonction d’évêque, de presbytre, de docteur et de prophète. »227
Néanmoins, il
a fallu un long temps pour réprimer progressivement l’autorité des femmes prophètes et enseignantes
officielles dans l’Eglise. Ce processus ne s’est jamais achevé, puisque des femmes continuent à revendiquer
une autorité d’enseignement dans l’Eglise.
Il est dommage de constater que le christianisme patristique minimise l’importance des femmes
disciples à l’instar de Marie Madeleine pour insister sur des figures d’apôtres hommes comme Pierre ou Paul
ou les douze. Parlant de l’autorité apostolique, des sources apocryphes relatent une vraie rivalité entre Pierre
et Marie Madeleine.228
Par surcroît, Marie Madeleine est citée comme premier témoin de l’événement
pascal. Malheureusement, le troisième évangile affirme que les paroles des femmes semblaient pour les onze
à du radotage et ils ne les crurent pas (Luc 24, 9-12).
2. La sexualité des fonctions ecclésiales
La patriarcalisation du mouvement chrétien primitif n’a non seulement exclu les femmes responsables
dans l’Eglise, mais elle a aussi établi une forte ségrégation, car le rôle des femmes a été limité au monde
féminin et il est passé sous le pouvoir de l’évêque. La ségrégation229
est notoire puisque pour choisir
l’évêque, son statut de chef de maison et de chrétien confirmé compte comme essentiel. En revanche, pour
inscrire une veuve toute une liste des devoirs est énoncée. Les jeunes veuves sont accusées bavardes et
oisives et parlant à tort et à travers. Pourtant on ne dit pas ce qu’elles racontent lors de leurs visites de
maison en maison. On voit bien que les injonctions des lettres pastorales sexualisent les ministères locaux et
les mettent sous le contrôle direct de l’évêque. Ce contrôle est perçu comme une contre indépendance des
femmes dans l’Eglise. L’accent est mis sur la soumission patriarcale et sur l’ordre de l’Eglise, elle engendre
la sexualisation de ministère chrétien.
3. Les femmes comme paradigme du vrai disciple
La vision des lettres postpauliniennes semblent insister sur la domination patriarcale et sur les structures
de soumission aussi bien dans la maison que dans l’Eglise. Au contraire les évangiles et surtout Marc et Jean
226
Elisabeth Schüssler FIORENZA, En mémoire d’elle, Essai de reconstruction des origines chrétiennes selon la théologie
féministe, Paris, Cerf, 1986, p. 399. 227
Elisabeth Schüssler FIORENZA, En mémoire d’elle, Essai de reconstruction des origines chrétiennes selon la théologie
féministe, Paris, Cerf, 1986, p. 414. 228
Cf. Idem, p. 422. 229
Cf. Idem, p. 431-438.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 72
cherche un équilibre social. Ils insistent sur le comportement et le service altruiste, éléments moteurs
convenants à un leadership chrétien.
L’évangile de Marc230
a été écrit à la même époque que l’épître aux Colossiens qui accentue la morale
domestique patriarcale. Elle exhorte les esclaves et les enfants à l’obéissance et à la soumission. Par contre
Marc exhorte ceux qui sont premiers à devenir des serviteurs. Ainsi les chefs doivent devenir les égaux et
les serviteurs des membres les plus modestes et faibles socialement. L’égalité se réalise à travers l’altruisme
et le souci des autres. Fiorenza voit que le cercle des disciples hommes ont trahit et renié Jésus par crainte de
risquer leur vie sur le chemin de croix. Les femmes, par contre, se démarquent et manifestent la qualité de
vrai disciple. C’est une femme qui oint Jésus en vue de sa sépulture et se laisse réprimander par les disciples
hommes. Ici elle reconnaît sa messianité. C’est aussi une servante qui provoque Pierre à agir selon la
promesse de ne pas trahir Jésus. Elles sont préoccupées pour la sépulture et reçoivent les premières la
nouvelles de la résurrection en tant que paradigme du vrai disciple.
En outre, l’approche similaire se retrouve chez l’évangéliste Jean231
qui concentre les instructions
concernant les disciples sur l’amour et le service altruistes et non sur la domination ou la soumission. Dans
les lettres pastorales il est demandé aux veuves de laver les pieds des saints et pour Jean le lavement des
pieds est une action d’amour de Jésus qui doit être imitée par tous les disciples. La notion de disciple est
inclusive des femmes et des hommes. Le ministère public de Jésus commence et se termine par une femme
Marie, la mère de Jésus et Marie de Béthanie. Le Temple qui a une dimension de domination patriarcale
n’est plus le vrai lieu d’adoration. Marthe fait appel à Marie sa sœur pour voir Jésus de la même manière
qu’André et Philippe ont appelé Pierre et Nathanaël. Etant donné que l’auteur du quatrième évangile n’est
pas connu, Fiorenza estime que c’est probablement Marthe qui fit sa confession de foi comme disciple bien-
aimée. Fiorenza l’affirme lorsqu’elle dit : « comme disciple bien-aimée, elle est la porte-parole de la foi
messianique de la communauté. »232
III. ANALYSE CRITIQUE DE LA PENSEE DE SCHUSSLER FIORENZA
1. Critiques négatives
Nous constatons que l’auteur, en luttant pour la cause des femmes, exclue les hommes qui risquent
d’occuper la place des femmes. Ce qui renverrait à une autre oppression que Fiorenza veut pourtant
dénoncer. Nous trouvons la démarche discriminatoire lorsque l’on veut parler uniquement de la cause des
femmes et les extraire du monde global. Même si elles sont opprimées ou soumises, Fiorenza les voit
comme des femmes et pourtant elles sont avec des enfants dans ces conditions et quelques esclaves
hommes. Fiorenza parlant de l’auteur du quatrième évangile, emploie le féminin et estime que le disciple
que Jésus aimait est une femme, Marthe, pourtant sur la croix Jésus s’était adressé à sa mère lui disant voici
ton fils et non ta fille. Sur ce sujet l’approche de Fiorenza nous semble peu fiable.
Tout de même, elle semble lutter contre la domination patriarcale. Elle montre que les femmes sont
souvent oubliées et mis au dernier plan, n’est ce pas encore elle qui affirme que les derniers sont devenus
premiers ? En plus, elle insiste sur l’aspect des femmes qui ont reçu, les premières, la Bonne Nouvelle de la
résurrection et oublie la parabole des ouvriers de la dernière heure. Elle montre l’innocence des femmes sur
le chemin de croix et leur fidélité à Jésus alors que, selon elle, les disciples gravés dans la mémoire des
chrétiens ont non seulement renié mais aussi trahit Jésus. Elle qui parle de la bonté miséricordieuse de Dieu
compte les fois que les disciples hommes ont failli dans leur marche de foi. Elle ignore que les hommes ont
à leur tour expérimenté la miséricorde de Dieu. En somme, l’évangile n’explique pas le choix des disciples
sur base de masculinité ou de féminité.
2. Critiques positives
Nous ne pouvons pas fermer les yeux aux mérites de Fiorenza. Sa contribution à la théologie est
vraiment élogieuse. En mémoire d’elle est le premier essai d’herméneutique féministe qui rompt avec
l’étiquetage culturel et religieux du féminin et du masculin. En tant qu’exégète, elle permet de ressortir
230
Cf. Idem, p. 439- 448. 231
Cf. Idem, p. 449-458. 232
Elisabeth Schüssler FIORENZA, En mémoire d’elle, Essai de reconstruction des origines chrétiennes selon la théologie
féministe, Paris, Cerf, 1986, p. 458.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 73
certains regards posés sur la femme contemporaine à partir de la femme juive. Elle tire notre attention sur
l’histoire de l’administration de l’Eglise à partir du mouvement Jésus. Elle nous a montré l’importance et le
rôle des femmes dans la naissance du christianisme et elle souhaite qu’elles participent autant au progrès de
l’Eglise d’aujourd’hui à travers l’enseignement. Elle œuvre pour la promotion de l’égalité des fils et filles de
Dieu au sein de l’Eglise. Elle nous permet de voir clairement comment les femmes, les esclaves et les
enfants étaient pris dans la classe des pauvres. Par son explication nous comprenons la délicatesse d’être soit
veuve soit orphelin.
CONCLUSION
E. Fiorenza est partie du geste prophétique de la femme qui parfume Jésus pour montrer tout le
compagnonnage des femmes dans le ministère de Jésus. Il est transmis à l’Eglise par succession apostolique.
Cette pratique des femmes qui ont servi dans la communauté des disciples égaux et qui ont agi dans la
mouvance de l’Esprit du Ressuscité sont désormais devenues une force de transformation qui doit guider et
orienter les femmes d’aujourd’hui à l’action au sein du christianisme en général et dans l’Eglise en
particulier. Ainsi, nous sommes priés de relire l’histoire des femmes depuis l’antiquité chrétienne.
Néanmoins, à en croire Fiorenza, extraire les femmes du ministère de l’enseignement de l’Eglise est assimilé
à un geste d’effacement de l’histoire de la femme chrétienne.
Par MAPENDANO
3.2.2 EXPOSE 2 BRISER LE SILENCE DEVENIR VISIBLES PAR E. S. FIORENZA ET
L’HISTOIRE DE LA CLÔTURE DANS LA VIE DES RELIGIEUSES PAR MARGARET
BRENNAN
INTRODUCTION
Elisabeth Schüssler Fiorenza, catholique, professeur de Nouveau Testament à l'université Notre
Dame, a marqué son époque et est citée aussi bien par les féministes que par leurs contradicteurs comme une
référence incontournable233
. Elle se différencie du modèle interprétatif des autres féministes. Quant à elle,
elle propose une herméneutique critique féministe qui part de textes patriarcaux non pas pour arriver à un
noyau essentiel de libération anhistorique et séparable, mais pour remonter au contexte historique et social
des textes, en vue d'une reconstruction féministe des origines chrétiennes.
Margaret Brennan, docteur professeur en théologie, est supérieure de son ordre, présidente de la
conférence des supérieures majeures, et conseillère de l’Union internationale des supérieures générales. Elle
a énormément travaillé avec les religieuses dans le domaine du renouveau, du ministère et de la spiritualité.
Ses idées à cet égard ont été communiquées dans des allocutions importantes à un certain nombre de
sociétés et de congrégations religieuses et dans des articles publiés dans plusieurs ouvrages et périodiques.
Ses centres d’intérêt particuliers sont la théologie féministe, le ministère et le rapport de la spiritualité à la
culture.
I. PROBLEMATIQUE DE FIORENZA DE SON ARTICLE ‘’BRISER LE SILENCE DEVENIR
VISIBLES’’
Selon elle, les textes bibliques ne sont pas une révélation inspirée littéralement, ni des principes
doctrinaux, mais des formulations historiques dans le contexte d'une communauté religieuse. Ils sont en
l'occurrence le produit d'une culture et d'une histoire patriarcales et androcentriques. Il ne faut pas prendre
les textes androcentriques et les représentations linguistiques de la réalité pour des documents indiscutables
et dignes de foi lorsqu'il s'agit de l’histoire, de la culture et de la religion humaines. Et le principe de base de
toutes les théologies de la libération, y compris de la théologie féministe, est de reconnaître que toute
233
La position d’Elisabeth Schüssler Fiorenza est développée en particulier dans son livre En mémoire d’elle. Essai de
reconstruction des origines chrétiennes selon la théologie féministe, Paris, Cerf, 1986 (édition originale en 1983, In Memory of
Her).
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 74
théologie, qu'elle le veuille ou non, est par définition toujours engagée pour ou contre les opprimés. La
neutralité intellectuelle n'est pas possible dans un monde d'exploitation et d'oppression. La Bible a été
utilisée comme source d'oppression pour les femmes, il faut que cela change. Les théologies de la libération
insistent sur le fait que la révélation et l'autorité biblique se trouvent dans la vie des pauvres et des opprimés
dont la cause a été adoptée par Dieu, leur avocat et leur libérateur.
Fiorenza résume elle-même sa démarche herméneutique en indiquant qu'elle recourt aux méthodes critiques
de la science historique, en visant les objectifs des théologies de la libération.
I.1 PATRIARCAT SOCIETAL ET ECCLESIASTIQUE
Tous les textes bibliques sont potentiellement oppressifs, et sont le produit d'une culture patriarcale ;
il ne faut pas a priori leur attribuer d'autorité, d'autant que la définition du canon elle-même a été marquée
par les luttes patriarcales contre la libération des femmes mise en œuvre dans le christianisme primitif. Si la
Bible ne doit pas continuer à être utilisée comme un outil de l'oppression des femmes, seuls auront l'autorité
théologique de la révélation les textes qui passent à travers la critique de la culture patriarcale. Les textes
androcentriques ne peuvent prétendre à être parole révélée de Dieu. Une telle attitude critique doit être
adoptée envers tous les textes bibliques, leur contexte historique et les interprétations théologiques qui en
ont été faites, et non pas seulement envers les textes sur les femmes234
. Elle doit aussi être adoptée vis-à-vis
de l'histoire de l'interprétation. Le critère à adopter, pour l'évaluation des traditions bibliques
androcentriques et des interprétations qui les prolongent, ne peut provenir de la Bible elle-même et ne peut
être formulé que dans et par la lutte des femmes pour leur libération de toute forme patriarcale. La prise de
position en faveur des opprimés doit être maintenue à la pointe de l'évaluation critique féministe des textes
et des traditions bibliques, et de leur prétention à l'autorité235
. L'expérience d'oppression et de libération
personnellement et politiquement vécue doit devenir le critère de justesse de l'interprétation biblique et de sa
prétention à l'autorité théologique.
La théologie féministe lance un défi à la science biblique théologique, la pressant d'élaborer un
paradigme pour la révélation biblique qui ne conçoive pas le Nouveau Testament comme un archétype mais
comme un prototype. L'archétype est une forme originale qui définit un schéma immuable et éternel, tandis
qu'un prototype est ouvert à la possibilité de sa propre transformation. Une telle conception de l'Ecriture peut
reconnaître positivement le processus dynamique de l'adaptation236
biblique, du défi ou du renouveau des
structures conceptuelles et socio-ecclésiales en fonction des conditions changeantes des situations socio-
historiques de 1'Eglise237
. Cette conception de la Bible comme prototype ne permet pas d'identifier la
révélation biblique et le texte androcentrique, mais elle implique que c'est dans la vie et dans le ministère de
Jésus que l'on trouve cette révélation ainsi que dans la communauté des disciples égaux238
qu'il a suscitée.
Ainsi, le centre et le lieu herméneutique de l'interprétation biblique ne sont pas la Bible ni la tradition d'une
Eglise patriarcale, mais c'est l'église des femmes239
, c'est-à-dire la communauté de disciples égaux,
l'assemblée de libres citoyens qui décident de leur propre bien être spirituel.
Une herméneutique critique féministe de libération définit comme lieu de révélation non seulement
l'oppression des femmes mais aussi leur pouvoir. La Bible est source de pouvoir religieux pour les femmes
de même qu'elle est pour elles source d'oppression religieuse. Une théologie chrétienne féministe doit cesser
de chercher à sauver la Bible de ses critiques féministes, elle doit soutenir que la source de notre pouvoir est
aussi la source de notre oppression240
.
I.2. THEORIE FEMINISTE ET IDEOLOGIE ANDROCENTRIQUE
La théologie féministe doit se garder d'attribuer la souffrance de la colonisation des femmes à la
volonté formelle de Dieu, et doit se garder de faire appel à la révélation divine et à l'action du Saint-Esprit
pour justifier théologiquement une telle souffrance. Dans la mesure où les textes bibliques androcentriques
234
Elisabeth SCHUSSLER FIORENZA, « Briser le Silence devenir visibles », Concilium, 202, 1985, p. 16. 235
Idem., p. 18. 236
Elisabeth SCHUSSLER FIORENZA « L’herméneutique féministe », Fac-Réflexion n°48-mars 1999 pp. 21-30. 237
Elisabeth SCHUSSLER FIORENZA, « Briser le Silence devenir visibles », Concilium, 202, 1985, p. 19. 238
Idem., p. 22. 239
Idem., p. 25. 240
Idem., p. 29.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 75
se prêtent à la perpétuation et à la légitimation de cette oppression patriarcale, de cet oubli de la souffrance
des femmes, ces textes doivent être démythologisés comme des codifications androcentriques du pouvoir et
de l'idéologie patriarcaux, qui ne peuvent prétendre être la parole révélée de Dieu.
La reconstruction historique, le langage androcentrique mentionne les femmes uniquement quand elles sont
exceptionnelles ou causes de problèmes. En d'autres termes, si nous prenons au sérieux le caractère
conventionnel et idéologique du langage androcentrique, nous pouvons affirmer que les femmes étaient des
leaders et des membres à part entière de la religion biblique, et ce jusqu'à preuve du contraire.
Qu'est-ce que tout cela signifie concrètement ?
La première tâche féministe consiste à étudier autant que possible les aspects patriarcaux destructeurs et les
éléments d'oppression dans la Bible. Par ailleurs, il s'agit aussi de détecter les éléments et facteurs anti-
patriarcaux des textes bibliques, qui sont obscurcis et rendus invisibles par un langage androcentriques. Il
faut apprendre à lire les silences des textes androcentriques de telle manière qu'ils fournissent des pistes
nous permettant de rejoindre la réalité égalitaire du mouvement chrétien primitif. Il s'agit aussi de
reconnaître que tous les textes bibliques ne reflètent pas l'expérience d'hommes au pouvoir ni n'ont été écrits
pour légitimer le statut que du patriarcat. Il s'agit, pour une herméneutique qui est orientée vers une
évaluation critique de la tradition, de mettre en lumière et rejeter tous les éléments qui, dans tous les textes et
traditions241
bibliques, perpétuent, au nom de Dieu, la violence, l'aliénation et la subordination patriarcale, et
éliminent les femmes de la conscience théologico-historique. En même temps, cette herméneutique doit
reprendre possession de tous les éléments qui, dans les textes et traditions bibliques, rendent compte des
expériences libératrices et des visions d'avenir du peuple de Dieu.
Dans la mesure où les textes bibliques androcentriques ne reflètent pas seulement leur environnement
culturel et patriarcal, mais permettent aussi d'entrevoir les premiers mouvements du christianisme basés sur
l'égalité des disciples242
, la réalité de l'engagement des femmes et de leur rôle de leader dans ces
mouvements précède les ordres androcentriques concernant leur place et leur comportement ; La théologie
féministe doit développer des modèles interprétatifs historiques qui puissent intégrer les traditions et textes
prétendus contre-culturels, hérétiques et égalitaires, dans sa reconstruction d'ensemble de l’histoire et de la
théologie scripturaires. Bien que le canon ne contienne plus que de faibles restes de l'éthique non patriarcale
du christianisme naissant, ces traces nous permettent pourtant de reconnaître que le processus de
patriarcalisation n'est pas partie intégrante de la révélation chrétienne. C'est pourquoi, une herméneutique
féministe chrétienne doit reprendre possession de la théologie et de l'histoire du christianisme primitif pour
les rendre aux femmes auxquelles elles appartiennent. Les femmes étaient investies du pouvoir et de
l'autorité de l'Evangile.
Il s'agit donc de prêter attention d'une part aux textes patriarcaux (où l'influence patriarcale touche jusqu'au
contenu des affirmations théologiques), d'autre part à l'interprétation patriarcale des textes par la tradition
ecclésiastique, et enfin à l'histoire de la transmission du texte et de ses traductions. Quels sont les objectifs
visés ?
Il s'agit non seulement de faire de l'action des femmes une catégorie interprétative clef, mais aussi de
transformer la recherche et le savoir androcentriques en une recherche et un savoir vraiment humains, c'est-
à-dire qui englobent toutes les personnes.
Il faut trouver des modèles théoriques de reconstruction historique qui situent les femmes non pas à la
périphérie, mais au centre de la vie et de la théologie chrétiennes. Le but n'est pas simplement la pleine
humanité des femmes, mais leur auto-affirmation religieuse, leur pouvoir et leur libération de toute
aliénation patriarcale, marginalisation et oppression.
CONCLUSION
La théologie féministe comme théologie critique de libération à la manière d’Elisabeth Schüssler
Fiorenza ; dit que la théologie chrétienne, la tradition biblique et les Églises chrétiennes sont coupables du
péché structurel du patriarcat sexiste, raciste..., qui perpétue et légitime l'exploitation et la violence
sociétales des femmes. Elle doit, par ailleurs, savoir montrer que la foi, la tradition et l'Eglise chrétiennes ne
sont pas intrinsèquement racistes, sexistes, en tentant de dépasser de manière critique les textes
241
Elisabeth SCHUSSLER FIORENZA « L’herméneutique féministe », Fac-Réflexion n°48-mars 1999 pp. 21-30. 242
Elisabeth SCHUSSLER FIORENZA, « Briser le Silence devenir visibles », Concilium, 202, 1985, p. 30.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 76
androcentriques. Une théologie féministe critique de libération n'appuie pas le fait de demander l'intégration
des femmes dans les structures ecclésiales patriarcales, ni une stratégie séparatiste, mais elle travaille à la
transformation des symboles chrétiens, de la Tradition et de la communauté aussi bien qu'à la transformation
des femmes. Une telle théologie ne tire pas sa vision libératrice d'une nature féminine spéciale ou d'un
principe métaphysique féminin, mais elle revendique le droit pour les femmes d'être Église, membres
responsables du Corps du Christ, d'être sujet de leur vie religieuse et de leur spiritualité et cela dans une
ekklesia des femmes où elles peuvent être participantes, actives, leaders dans l'Église. Enfin, cette théologie
est en lien avec la lutte des femmes contre le patriarcat; elle interpelle toutes les théologies de la libération à
être cohérentes et universelles en intégrant les femmes; objective et neutre comme elle incite la théologie
ecclésiastique, cléricale, à devenir vraiment ecclésiale.
Cette théologie féministe critique de libération veut devenir une théologie chrétienne catholique libératrice
en proclamant la « bonne nouvelle du salut » à tous et à toutes ; à cause de cela, elle est subversive pour
toutes les formes de patriarcat sexiste, raciste, capitaliste. Voilà ce qui retient l'attention de Fiorenza dans
son travail d'interprétation biblique : l'analyse du patriarcat et la promotion d'une alternative dans l’ekklesia
des femmes sont au cœur du modèle féministe critique qu'elle ne cesse d'améliorer depuis quelques années.
II. PROBLEMATIQUE DE BRENNAN DE SON ARTICLE ‘’ LA CLÔTURE ’’
Margaret BRENNAN commence son article avec la déclaration « les femmes dans les communautés
ecclésiastiques, en général, bien que désignées aujourd’hui de manière ambiguë du nom de religieuses, sont
les personnes qui font profession publique des conseils évangéliques de pauvreté, chasteté et obéissance
dans des institutions canoniquement établies par l’autorité ecclésiastique compétente dans l’Eglise.243
» pour
montrer comment le sort des religieuses dépend de l’autorité de l’Eglise ; or c’est l’Esprit de Dieu qui
inspire de manière particulière des modes vie et de service qui témoignent de la sainteté et de la mission de
l’Eglise. Pour canaliser et contrôler ces charismes, l’Eglise en fait l’une de sa première préoccupation. Les
femmes perçoivent comment ces attitudes sexistes limitent leur faculté d’exister pleinement et leurs
participations dans l’Eglise et dans la société. Unanimement par la théologie féministe, elles essaient de
rejeter le patriarcat et l’androcentrisme comme idéologie qui banalise leurs personnes.
Malgré que toutes les sociétés civiles suppriment l’inégalité des sexes, l’Eglise qui prône la dignité
humaine et la liberté de toutes les personnes, demeure constante et statique à institutionnaliser l’infériorité
des femmes. Pour Brennan, c’est aberrant que le concile de Vatican n’ait pas pu inciter les femmes dans les
communautés ecclésiales à rénover leur mode de vie et à l’adapter aux modèles culturels en évolution et aux
circonstances changeantes.244
Pour comprendre cette portée de ces affirmations, Brennan retrace l’histoire de la clôture et son impacte sur
la vie des religieuses.
II.1. L’HISTOIRE DE LA CLÔTURE DANS LA VIE DES RELIGIEUSES
Dès le début de la consécration totale de la femme pour la mission de Dieu, il lui a été imposé les
normes de la clôture. Pour les femmes qui se sentent appelées à témoigner de l’amour total de Dieu par une
vie de prière et de contemplation, une certaine forme de clôture ou de retrait du monde de l’activité est un
choix librement posé.245
Ces normes et obligations de la clôture deviennent un obstacle et un facteur
dissuasif nuisible au sens même de la vocation de celles qui se sentent appeler au service d’autrui pour
l’avancement du Royaume de Dieu. Cette obligation de clôture s’est imposée aux femmes par les
responsables ecclésiastiques dans le but de leur assurer une forme de sécurité à cause de leur situation
culturelle faible dans la vie publique. On les considérait comme inférieures, immatures, sentimentales,
incapables de raisonner logiquement, faible et inconstantes… les femmes, perçues comme ayant besoin de
protection et de surveillance, furent placées sous la houlette et la direction d’hommes.246
Malgré le nouveau
243
Margaret BRENNAN, « LA CLÔTURE : Institutionnalisation de l’invisibilité des femmes dans les communautés
ecclésiastiques », Concilium, 202, 1985, p. 57. 244
Idem., p. 58. 245
Idem., p. 59. 246
Idem., p. 60.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 77
enseignement de Jésus cette vision androcentrique persiste toujours et justifiée théologiquement dans
l’Eglise. Elle acquière même la législation canonique avec plusieurs écrits des Pères de l’Eglise qui montrent
et démontrent cette faiblesse des femmes, qu’elles ont besoin de la protection d’hommes. En ne voyant que
la faiblesse de cette créature de Dieu, elles sont considérées comme des sources de tentation et responsables
de l’état de déchéance de l’humanité. Du coup, elles ne peuvent pas vivre librement leur engagement dans
une Eglise promotrice du Royaume de Dieu. A cet effet dès le début l’autorité ecclésiastique se charge de
les guider et prévit des structures pour préserver leur célibat et les soustraire aux distractions mondaines.247
A l’époque, les monastères se multipliaient et deviennent des centres d’études, et ceci influence un
développement rapide des intelligences et l’affirmation d’autonomie de ces femmes. En même temps, cette
influence était diminuée par de strictes réglementations imposées par les évêques qui limitaient leur mobilité
et leurs contacts en dehors du monastère.248
De même, une bulle officielle de suppression condamnant les
Dames anglaises, institut fondé par Mary Ward en 1614 pour l’éducation des filles, témoigne amplement
des attitudes androcentriques profondément ancrées qui se durcirent en efforts permanents pour refréner
l’influence des femmes dans le service ecclésial et pour assurer leur invisibilité.249
Ces règlements étaient
beaucoup plus sévères que ceux des monastères des hommes ; or beaucoup d’elles entraient au monastère
pour obtenir un statut sociale et un mode de vie acceptable. Pour les hommes, c’est inconcevable de voir ces
femmes profondément enracinées dans la doctrine c'est-à-dire éclairées par l’herméneutique biblique. Alors
l’autorité ecclésiastique endurcit les règlements de clôture avec des arguments comme : « c’est l’ordre
naturel chez les humains que les femmes soient soumises à leur mari (…) la femme n’a pas été faite à
l’image de Dieu.250
»
De plus « il semble donc tout à fait évident que l’homme est le chef de la femme. A ce titre, elle n’a pas le
droit sans sa permission de faire à Dieu des vœux d’abstinence ou de nature religieuse.251
»
Cette obligation acquière une portée universelle et devient de plus en plus sévère pour les femmes
avec la constitution periculosa du Pape Boniface VIII promulguée en 1298 qui imposait le cloître comme
élément essentiel et n’admettant aucune exception. Face à cela beaucoup adopte une règle de vie, dérivée
des ordres mendiants masculins et se mettant au service de tous hors de la clôture ; c’est le début des
congrégations religieuses actives. Une fois devenu Pape, Pie V est plus exigent et dure avec des sanctions.
« Pour appliquer les décrets du concile concernant la place du cloître dans les communautés
féminines, Pie V en 1566, promulgua la constitution Circa pastoralis. Les normes de ce document
s’appliquaient à toutes les communautés féminines et prescrivaient des règles strictes de clôture
ainsi que des sanctions et peines extrêmes pour les infractions. Il était déclaré que dorénavant toutes
les femmes s’adonnant à la vie religieuse prononceraient des vœux solennels impliquant l’obligation
du cloître. Celles qui avaient vécu une vie de communauté sans clôture et avec des vœux simples
étaient condamnées à l’extinction, car il ne leur était plus permis de recevoir de novices ni de faire
profession.252
»
Tout ceci anéantisse tous les efforts des femmes. Malgré que le Pape Léon XIII en 1900, promulgua la bulle
Conditae a Christo qui leur reconnaissait un statut plus acceptable et libre, la promulgation du Code de Droit
Canonique de 1917 retint et imposa des normes contenant de nombreux éléments de clôture, qui non
seulement continuaient à restreindre leur mobilité et leur visibilité, mais les empêchaient effectivement
d’être une force influente dans l’Eglise et dans la société.253
II.2. L’ACTUELLE LEGISLATION CONCERNANT LES COMMAUTES
ECCLESIASTIQUE
L’Eglise se réinstaure avec la reforme. Ce renouveau avec le concile de Vatican a eu des effets
positifs et libérateurs sur la vie des femmes dans les communautés ecclésiastiques. Ceci était un accueil avec
247
Ibidem. 248
Idem., p. 61. 249
Ibidem. 250
Ibidem. 251
Ibidem. 252
Idem., p. 62. 253
Idem., p. 63.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 78
enthousiasme tant par les moniales cloîtrées que par les ordres féminins actifs sur leur nouveau statut,
malgré que les documents du concile concernant les religieuses contiennent des assertions et des
recommandations qui reviennent à la croyance séculaire que l’authentique vie religieuse pour les femmes
comporte une notion de consécration exigeant des éléments claustraux pour en sauvegarder le sens et la
réalité.254
A partir de cette affirmation elle (l’autorité) se pose une question: est ce que de telles affirmations
ne présument pas un mode de vie cloîtrée ?
Nonobstant tout pour une certaines harmonisations avec cette déclaration, il y a toujours une
résistance de la Congrégation romaine des religieux et instituts séculiers. Elle publia des documents ayant
force de loi pour ces religieuses. Pourtant la constitution apostolique Sponsa Christi du Pape Pie XII en 1950
et Perfectae Caritatis décret de Vatican II sur ce renouveau de la vie religieuse qui demandaient des
modification de la clôture papale et la suppression des coutumes surannées, le poids et la force séculaires
de l’image intangible et inaltérable de la moniale contemplative continuent de prévaloir comme la position
existentielle de l’Eglise.255
De plus Venite Seorsum de la Sacrée Congrégation des religieux de 15 août 1969
vient lui donné un statut juridique. Certaines (Communautés des religieuses comme les Carmélites
déchaussées), s’efforcent de réviser leurs constitutions en s’accord avec la consigne du concile de Vatican ;
mais l’autorité leur exige le maintien des éléments fondamentaux de ces constitutions surtout la préservation
des règles de la clôture avec une « exactitude diligente.256
» les raisons données pour cette intervention
directe du Vatican sont de préserver la vie contemplative et d’en assurer le caractère central dans la vie et
dans la mission de l’Eglise.257
De même les religieuses des instituts actifs n’ont pas échappé à ces
amplifications ultérieures des principes régissant la vie religieuse. En août 1966, Pape Paul VI publia la
lettre apostolique Ecclesiae sanctae qui donnait des lignes de conduite détaillées et un délai spécial pour
s’acquitter de l’expérimentation demandée par le concile.258
Par la suite le nouveau Code de Droit
Canonique fut édicté en Janvier 1983, ayant force de loi et le 22 Juin de la même année la Sacrée
Congrégation publia « Éléments essentiels dans l’enseignement de l’Eglise sur la vie religieuse.259
» qui
contiennent des normes qui maintiennent la vigueur de la clôture avec son pouvoir de surveiller la vie et
l’influence des femmes. S’il est vrai que ces mêmes normes s’appliquent aussi bien aux hommes qui vivent
dans les communautés ecclésiastiques, la vigilance et l’intervention de la Congrégation dans les affaires de
leur vie et de leur ministère n’ont pas manifesté le même degré de mainmise.260
II.3. CHANGEMENT DE PARADIGMES DANS LA VIE RELIGIEUSE
Ce renouveau de statut des religieuses actives comme contemplatives se fait et s’adapte dans un
monde marqué d’essor scientifique et culturel et selon la reforme de l’Eglise. Ces changements modifient
leur expérience et les acheminant vers une vision de leur vie religieuse pleine et totale. Même si le Canon
576 du nouveau Code confère à l’autorité compétente dans l’Eglise de veiller à ce que les instituts croissent
et se développent selon l’esprit des fondateurs et les saines traditions, qu’elle soit un peu tolérante envers le
combat créatif que mène ces femmes. Car elles sont conscientes de ces changements de paradigme dans
l’Eglise comme dans la société. Aujourd’hui l’Eglise est toujours vue en tout de façon hiérarchique et non
une Eglise qui témoigne d’une communauté du peuple de Dieu dont la commune consécration découle du
baptême.
CONCLUSION
Le thème examiner par Brennan est celui de facteur fondamental et essentiel pour institutionnaliser
l’invisibilité des femmes en tant que telles dans les communautés ecclésiales. Et tel que le Code de Droit
Canonique édicte des normes juridiques relatives à leur clôture et à la législation qui règlemente leur
vêtement, leur mobilité, leurs relations et leur influence. Pour Brennan c’est, en quelque sorte, une
254
Idem., p. 64. 255
Idem., p. 65. 256
Ibidem. 257
Idem., p. 66. 258
Ibidem. 259
Ibidem. 260
Ibidem.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 79
métaphore de la condition féminine dans l’Eglise.261
Or selon elle le besoin pour les ordres religieux d’aider
à libérer ces énergies pour faire progresser la mission de guérison et de libération de l’Eglise est une raison
suffisante pour mettre en question et contester tous les aspects de la clôture ou de la séparation matérielle qui
ne servent pas et ne renforcent pas cet appel de l’Esprit aujourd’hui.262
Pour elle ce qu’il faut regretter, c’est
le manque de confiance en la femme.
Yao Elisée ATTIOGBE
3.2.3 EXPOSE 3 : LES THEOLOGIES FEMINISTES DANS UN CONTEXTE MONDIAL PAR
ELIZABETH SCHUSSLER FIORENZA ET LES FEMMES POUR LA PRETRISE DANS
L’EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE PAR TERESIA MBARI HINGA
INTRODUCTION
Ce Concilium est une revue internationale de théologie qui nous stipule qu’Elizabeth Schussler
Fiorenza se veut l’auteur principal de Les théologies féministes dans un contexte mondial. De cette revue
sont extraits deux chapitres à savoir Les théologies féministes en Afrique écrit par Teresia Mbari Hinga et
Les femmes pour la prêtrise dans l’Eglise catholique romaine dont l’auteur est Jacqueline Field Bibb. C’est
bien ces deux chapitres qui feront l’objet de notre étude. Dans ces deux chapitres en effet, il est question de
la pensée théologique féministe débuté depuis l’occident et déportée sur le continent Africain par les
femmes dans l’optique de lutter contre l’absence de leur voix dans le discours théologique et du sexisme.
Cependant, comment faire comprendre le contenu de ces deux chapitres ? Ainsi pour donner suite à cette
préoccupation, il nous serait opportun de faire mention de deux grands points qui feront ressortir chacun
deux sous points. Le premier point concerne les théologies féministes africaines, leur volonté de se dresser,
leurs préoccupations et les défis qui en découlent. Ensuite, nous énumérerons le deuxième grand point qui
fait cas des femmes pour la prêtrise dans l’Eglise catholique romaine ainsi que l’usage de l’herméneutique
pour la reconstruction de la réalité féministe et enfin nous achèverons avec quelques critiques ou
évaluations vis-à-vis de cette ordination féministe.
1. ENTRE COLONIALISME ET INCULTURATION:
1.1 Les théologies féministes en Afrique
A la suite de plusieurs années de floraisons des théologies féministes en Occident, celles-ci regagnent le
continent Africain dans la perspective de se faire dans le cas du possible un espace sans pour autant
s’afficher au préalable. C’est en 1989 que les réalités de ces théologies vont s’étendre à la lumière. C'est-à-
dire vont être officielles avec une rencontre de femmes d’environ soixante dix au Ghana dans l’optique de
mener des recherches ; d’analyser et de réfléchir sur leurs expériences de vie vis-à-vis du colonialisme et de
l’inculturation. Fort de toutes ces analyses, ces femmes visaient également d’autres luttes ayant leurs sens
dans l’émancipation religieuse A la suite de leur rencontre, elles instituent un groupe qu’elles nomment le «
cercle des théologiennes africaines concernées.» Ce cercle devient donc un cadre de travail pour décrire la
nature et la direction de l’expression de la femme en Afrique ainsi que sa place dans le christianisme. Les
raisons sont telles que les femmes, estiment qu’elles ont le même droit que les hommes et leur sont égales
devant la loi divine. Il n’y a donc pas lieu de faire de discrimination dans le contexte religieux ou de
marginaliser la race féminine.
1.2. «La volonté de se dresser»
Né en Afrique en 1989, le projet des femmes n’avait pas encore reçu l’étiquette de« féministe» dans la
mesure où il cherchait à donner un poids analytique aux expériences des femmes. Poussées par « la volonté
de se dresser»263
, celles-ci ne prônaient pas le souci de demeurer toujours dans leur ancienneté (situation de
frustrée, de marginalisée) sinon de parvenir à leur but qui consiste pour elle le mérite d’être considérées dans
261
Idem., p. 59. 262
Idem., p. 68. 263
Teresia Mbari HINGA, « Entre colonialisme, les théologies féministes en Afrique», in Concilium n° 263, revue internationale
de théologie, Les théologies féministes dans un contexte mondial, Paris, Beauchesne, 1996, p. 42.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 80
le corps social. Pour les théologies féministes, il fallait que les africaines prennent en main leur
responsabilité et qu’il leur soit attribuer le droit qui leur convient. Il fallait trouver tous les moyens qui
pourraient contribuer à leur indépendance.
Au demeurant, les théologies féministes africaines sont battantes vis-à-vis des problèmes du tiers monde.
C’est pourquoi elles sont dites théologies de l’action dans le sens où elles sont engagées pour la vie, la
justice et la libération de l’oppression. Elles sont dites concernées car elles passent par une volonté
indéterminée de résoudre des problèmes concrets capables de poser entorse aux valeurs humaines dont la
morale réclame la protection (la liberté, la vie humaine, la santé.).
1.3. Les préoccupations et les défis
En mettant en place un tel « cercle », les femmes avaient maintes préoccupations étant donné que celles-ci,
menaient de nombreuses difficultés dans leur vie et qu’il fallait nécessairement y remédier. Au fil du temps
la période de l’émancipation avait sonné son glas de réclamation consistant à taire les asservissements
africains et accorder à la femme le droit de l’expression. Ces femmes théologiennes rêvaient d’une mutation
dans la société à travers leur projet longtemps forgé en espérant voir émerger une vie nouvelle.
Pour ce faire, ces femmes avaient si bien le souci de concentrer leurs efforts sur la production dans
leur projet, de décrire ou dénoncer toutes les failles occidentales (ce que les occidentaux faisaient subir aux
africaines) tant dans la religion que dans la culture. Cela est d’autant vrai dans la mesure où en Afrique à la
suite de la colonisation, les africains étaient confrontés à de cultures diverses et de religions constituées de
trois types d’héritages laissés par le colon. Nous avons la religion indigène, le christianisme et l’Islam. Ce
qui parait plus intéressant ici est le fait qu’il soit question pour les femmes dans leur projet d’instituer un
système de dialogue leur permettant de mieux cerner leur culture et de l’assumer à la culture occidentale.
Cela dans le but d’obtenir une nouvelle culture.
Dans l’histoire, les occidentaux adoptaient certaines attitudes caractérisant chez eux des traits de
personnes réticentes. Ces attitudes consistaient pour eux un moyen pour marquer leur autorité. Et pourtant
ces attitudes jouaient sur la vie des africains. Elles étaient possibles d’être constatées dans les sociétés
laïques en Afrique certes mais aussi se manifestaient davantage dans l’Eglise. Toutes ces banalisations à
l’endroit des africains suscitèrent dans le milieu théologique l’irruption des femmes 264
(apparition soudaine
de nouvelles réalités.)
Aujourd’hui plus que jamais, les théologies féministes demandent à ce que les africaines soient
écoutées du fait d’être témoins de différentes expériences. Faut-il ajouter que sommes nous à califourchon
entre deux Afriques : L’Afrique des hommes qui commandent et l’Afrique des femmes qui obéissent.
Prenant conscience de la situation qui sévit dans leur vie, les africaines s’évertuaient pour la recherche
d’autres systèmes plus efficaces permettant de mettre fin au sexisme. Que ces femmes soient chrétiennes ou
non, leur interprétation critique leur donnait la possibilité de porter des analyses importantes sur l’effet qu’a
le christianisme sur leur vie. Toutefois, ce qui est déplorable est le fait que même le christianisme ait
participé à l’asservissement des femmes au point de légitimer le colonialisme et voire, le sexisme. C’est
donc avec force que certaines africaines ont acquis l’évangile comme moyen de base ou bonne nouvelle. Il
faut dire que le christianisme leur avait été imposé. Ainsi il fallait en faire usage pour un objectif qui
concerne la conversion. Egalement, la critique du christianisme par les femmes, leur conduit à une
réévaluation de la Bible comme source de la théologie chrétienne.
Il va donc sans dire que le souci capital des théologies africaines ou du moins leurs préoccupations
consistait à exprimer leur protestation contre le sexisme et ses racines dans la religion et la culture. Cette
protestation adopte un double système dans la mesure où elle vise la culture africaine et le christianisme.
Toutefois quels sont les défis envisagés par ces théologies des féministes ?
Au parcours de ce qui précède, il faut dire que les théologies féministes ne sont pas à leur terme. Elles
continuent et continueront toujours leur marche puisque les africaines ne cessent pas de rencontrer des
difficultés existentielles dans les sociétés. Ces difficultés ont suscité chez les femmes le désir de mettre en
place une théologie qui ne soit nécessairement celle qui fasse la promotion des femmes mais une théologie
de lutte. Cela dire, le défi des femmes prend son envol dans le fait de résister à toutes les tentations de
privilégier les expériences de certaines femmes considérées comme normes pour la théologie. Il se porte
264
Idem. p. 45.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 81
garant de veiller au danger de réduire au silence la masse des femmes en prétendant a priori parler en leur
nom.
En réalité, les théologies féministes ne concernent pas uniquement le domaine social féminin ou ne
s’attèlent pas catégoriquement à l’idée féminine. Celles-ci s’étendent jusqu’aux domaines des Eglises
missionnaires (L’Eglise catholique romaine, l’église protestante etc.) Le défi des femmes prend en compte
en effet, la volonté de respecter les autres traditions. Il lui convient pour ce faire de considérer les idées et
les expériences des religions non chrétiennes comme les expériences musulmanes. Pour réussir à leur
engagement, les femmes devraient chaque fois procéder par un système de dialogue, en évitant le modèle
christocentrique pour prendre en considération la pluralité des religions ainsi que les expériences
religieuses.
Les théologies féministes sont sans doute perçues comme des avocates auprès des femmes. Dans ce
sens, elles s’évertuent à trouver des solutions pratiques aux maintes problèmes des femmes. Dans leurs défis,
les femmes font l’effort de nouer des relations solides avec d’autres théologiennes pour être davantage
fortes. Cette procédure des femmes crée une ambiance communautaire et familiale.
Désormais, il nait une véritable expérience de vie entre elles même et les autres races. Jusque là, il
serait capital de savoir que dans leurs défis, les femmes ont proposé à que leurs théologies soient
voyageantes et non statiques. Cela dans le but de connaître le monde en passant par les autres continents
dans l’intention d’aider les autres africaines souffrantes des mêmes réalités. Les femmes détiennent le seul
espoir d’être soutenues dans leur engagement par des personnes de bonnes volontés. Comme un pêcheur qui
a jeté son épervier en eau profonde prenant assez de poissons sans se lasser; il en est de même pour ces
dernières car si dans certains pays leurs revendications ont eu du succès cela constituera pour elles une
source de motivation. C’est en cela qu’elles pourront continuer leur défi pour la reconstruction d’un monde
désormais susceptible d’intégrer la femme dans le corps social. Suite à cette première partie de notre exposé,
il serait opportun d’aborder le deuxième niveau qui siège le débat convenu dans la question de la prêtrise des
femmes.
2 PRAXIS CONTRE IMAGE
2.1 Les femmes pour la prêtrise dans l’Eglise catholique romaine
Il demeure sans souci de souligner au préalable que la question de la revendication des femmes pour
leur admission à la prêtrise n’a été sans succès. Il faudrait réaliser que l’étude de ce projet propre aux
femmes fut présentée à Rome car pour les femmes, il leur fallait une insertion dans le sacerdoce ministériel.
D’où leur revendications à l’ordination sacerdotale et même religieuse. Pour cette raison, il fallait remonter
jusqu’à l’origine pour voir si le fait pour les femmes d’accéder au sacerdoce ne pourrait déteindre l’image
non seulement de l’Eglise catholique mais aussi des chrétiens en général. La logique de leur discours
s’inscrivait sur le fait que beaucoup de femmes possèdent de grandes qualités.
Lors de ce débat, Mary Daly avait souhaité la création d’une communauté johannique pendant que
d’autres estimaient faire venir au jour une Eglise institutionnelle qui prônerait son autorité sur les autres
Eglises. Les écrits de Mary rejoignent ceux de Jean XXIII qui juge que les êtres humains ont le droit de
choisir librement l’état de vie qu’ils préfèrent. Pour lui ils ont le droit de fonder une famille avec les droits et
les devoirs égaux pour les hommes et pour les femmes et aussi le droit de suivre une vocation au sacerdoce
ou à la vie religieuse.
Cette assertion fut soutenue par l’Eglise d’Angleterre. Ce qui ressort dans cette progression, c’est
que deux tendances s’opposent sur ce fait. Nous avons: ceux qui militent pour l’ordination des femmes en
occurrence l’Eglise de l’Angleterre. Ainsi, pour la première fois le monde entier a entendu l’expression:«
femme prêtre». Car il eut une femme ordonnée selon le canon de l’Eglise de l’Angleterre promulgué le 22
février 1994. Cette ordination des femmes a véritablement eut lieu à Bristol le 12 Mars. Cela a suscité chez
Jean Paul II l’importance de publier le 10 Juillet 1995, une lettre aux femmes pour signifier que les hommes
doivent prendre en compte les femmes dans tout ce qu’ils exercent dans l’Eglise. Pour cela, les femmes ne
devraient plus s’entêter pour la lutte de leur place dans l’Eglise.265
265
. Jacqueline Field Bibb, «Les femmes pour la prêtrise dans l’Eglise catholique romaine»,in Concilium n° 263, revue
international de théologie, Les théologies féministes dans un contexte mondial, Paris, Beauchesne, 1996, p.112.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 82
Cette question de l’ordination des femmes a trouvé sa solution lors de l’arrivée du Vatican II. Ce qui
a constitué une mise à jour des affaires ecclésiales. Pour lui en effet, l’on ne peut ordonner les femmes. La
question donc de l’ordination des femmes a été reprise et argumentée par l’Eglise catholique romaine. Pour
elle, il demeure rationnelle de toujours se référer à l’argument christologico-théologique qui souligne qu’une
femme ne peut devenir prêtre du fait que le sacerdoce appartient au Christ. Or le Christ est un homme. La
femme chrétienne est appelée à refléter en elle-même et à révéler l’identité de l’Epouse-Eglise, dont le type
suprême est une femme nommée Marie. Telle serait une consolation pour la femme dans sa théologie à
savoir qu’elle n’est pas oubliée si elle se rapporte à la vierge Marie. Elle doit donc connaître sa place pour
laisser l’homme à l’exercice de ce que de droit. Comme dit l’Evangile de laisser à César ce qui est à César et
à Dieu la part qui lui revient. Dans l’optique de ces réflexions, la question du sacerdoce ministériel avait déjà
été mûrie dans la conception de Martelet qui argue qu’il faudrait reconnaître à ce ministère la valeur qui lui
revient au point de faire une distinction de sexe. (Ne peut l’exercer que le sexe masculin.) Chose qui engage
la pensée humaine à savoir et comprendre le respect profond qui lui est dû. Ce qui devient finalement une
indication au moment de la communication complète entre l ’Epoux qui est le Christ et l’épouse qui est
l’Eglise mère. L’argument Marteléen fait le cas tout en signifiant que ce ministère se caractérise par une
perspective historique capable de reconnaître les différences qui s’opèrent entre les femmes et les hommes.
Ce qui parait encore plus surprenant est le fait que c’est 10 ans après Martelet que Mary Daly était
convaincu que le Christianisme était sexiste.
2.2 L’usage de l’herméneutique pour la reconstruction de la réalité féministe
A la suite de cette phase qui a fait écho dans l’ordination des femmes et qui a causé un grand débat
historico-théologique, il faut mentionner qu’un théoricien allemand et philosophe appelé Habermas avait
mis au jour, une certaine méthode qu’il avait nommé l’herméneutique critique266
à la suite de la conception
faite par Mary Daly sur le fait que le Christianisme soit sexisme et qu’il faut une reconstruction de la pensée
théologique féministe africaine 267
. Habermas avait proposé cette herméneutique au monde de la théologie
pour une meilleure interprétation des œuvres tant philosophiques, théologiques que sociologique etc. Son
herméneutique traite surtout pour la plus grande part les textes bibliques. Habermas souligne lui-même que
son herméneutique détient le seul souci de déterminer et d’analyser tout sens caché dans le langage des
textes.
Cette méthode jugée meilleure a été utilisé par Fiorenza pour également repenser ou reconstruire les
théologies féministes. Cependant cette reconstruction ne concerne pas uniquement la lutte féminine en
milieu social, culturel et religieux mais prend aussi en compte la question du discours porté sur Dieu. Ainsi,
puisque Dieu comporte le père, le fils et l’Esprit saint, nous ne pouvons parler de Dieu sans porter de débat
théologique sur le Christ sur la vie du Christ. Fiorenza estime que cette reconstruction exprime le culte du
Christ. Désormais, il faut que, Dieu par le Chris, passe par un culte communautaire en accueillant tout le
monde même les marginalisés. Cette reconstruction de Fiorenza aborde également de la question d’une
trajectoire patriarcale des communautés après la mort de Jésus. Étant donné que succombent de nombreuses
communautés aux influences patriarcalisantes or l’évangile de Jésus Christ et celui de Jean indiquent une
vision différente de la communauté au point de mettre l’accent sur l’amour et le service comme étant au
cœur même du ministère de Jésus. Avec Fiorenza, les théologies féministes doivent faire une certaine
relecture de l’origine des chrétiennes dans la lutte de leur droit.
Mais aussi force est de savoir qu’il faut que l’on se rende compte de l’objectif que veut atteindre
l’auteur qui se joue dans un élan inspiré des vécus quotidiens sans distinction de sexe. Du coup, leur vie
pouvait se concevoir comme la vie du Christ:« Dieu qui s’est fait homme. » Il aborde la condition humaine
qui constitue la racine fondamentale de l’argument in persona Christi268
. Cet exemple de vie que nous
intitule le Christ vécu dans les communautés primitives serait l’idéal de vie. Ce faisant, Jésus et ses disciples
montrèrent de part leur manière de vivre une vie de témoigne liée à la trinité. C'est-à-dire le père, le fils et le
Saint Esprit. Ce qui va constituer pour l’Eglise elle-même une projection dans l’avenir. Une référence
266
Jacqueline Field Bibb, «Les femmes pour la prêtrise dans l’Eglise catholique romaine»,in Concilium n° 263, revue
international de théologie, Les théologies féministes dans un contexte mondial, Paris, Beauchesne, 1996,p. 115. 267
Ibidem. 268
Idem. p. 114.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 83
parfaite de vie pour le peuple de Dieu. Selon l’Eglise institutionnelle cette manière de mener la vie constitue
pour elle un moyen de parvenir à la conversion des cœurs.
A l’époque de son règne, étaient contestées les structures impériales et tout ce qui pouvait poser
entorse à la société religieuse. Cela avait suscité de nombreux ennemis de sorte qu’il y avait comme une
sorte de renversement de l’Eglise primitive. Et cela au sens négatif du terme. Car les structures patriarcales
influencèrent la communauté en référence à ce que Jésus a vécu avec ses disciples. En réalité, les désordres
menés par les structures patriarcales prêtaient la confusion et constituait une sorte d’interrogation sur la
présence de Dieu dans cette communauté primitive. Pour certains, il fallait comprendre que sa présence
devra susciter une crainte au point d’éviter des attitudes parfois ignobles. Cette situation avait comme réalité
de susciter deux possibilités dialectiquement liées. L’on assiste alors d’une part le prototype des
communautés gnostiques (c’est-à-dire que la commuanté est vue dans ce cas comme fondée à l’image d’un
sect.) et d’autre part nous devons accepter cette communauté en se construisant une théologie et une
christologie politisées. L’essentiel des choses est de voir que malgré tout ce qui se vit, le chemin doit se
situer au côté du Christ en tant que révélation. Savoir que Dieu se révèle dans le Christ et c’est par le Christ
que l’humanité atteint sa perfection.
3 EVALUATIONS
3.1 Evaluation positive
En tenant compte de tout ce qui a été dit, il ressort que la femme possède des droit pareils à l’homme
et de nombreux talents susceptibles d’être appliqués dans le sacerdoce ministériel C’est en cela que Mary
Daly écrivait que’’ les êtres humains ont des droits et des devoirs égaux; allant de l’homme à la femme. Ils
ont aussi le droit de suivre une vocation au sacerdoce ou à la vie religieuse.’’269
Alors faire une
discrimination à l’endroit de la femme c’est se détourner de l’amour de Dieu. Ainsi donc le service pour
Dieu ne devrait tenir compte du sexe; dans la mesure où Dieu inscrit l’Homme dans son dessein de
l’économie du salut. En réalité, ordonner les femmes pour la proclamation de l’évangile consisterait à la
conversion de nombreuses âmes dans le monde. C’est certainement cette conception qu’avait l’Eglise de
l’Angleterre au point de promulguer son canon le 22 février 1994. Et cela a suscité pour la première fois, un
évènement évènementiel. C’est à dire celui de l’ordination de la femme, lieu à Bristol le 12 mars270
.
Toutefois, la pratique du sacerdoce ministériel chez la femme n ‘est elle pas péjorative vis-à-vis de l’Eglise
elle-même et de ses fidèles ? N’est elle pas contre l’image du Christ ? Ces préoccupations conduiront à une
évaluation négative.
3.2 Evaluation négative
Selon l’argument christologico-théologique, une femme ne peut être l’image du Christ car le prêtre, au
moment de consécration, agit in persona Christi. Dans cette optique, le bienheureux souverain poncif
Jean Paul II, exprimait au nom de l’Eglise Catholique que l’ordination des femmes ne saurait être acceptée
du fait que la Sainte Écriture à travers le Christ a choisi des apôtres uniquement parmi des Hommes.
Ainsi, la pratique constante de l’Eglise qui imite la passion du Christ a été toujours provenu des hommes. Du
coup, l’exclusion des femmes au sacerdoce vient s’accorder avec le plan de Dieu sur l’Eglise 271
CONCLUSION
Au terme de notre étude, il convient de retenir que les théologies féministes ont été influentes dans le
monde. Cela dire, le combat des femmes pour la résolution de leur injustice, du sexisme, de leur
marginalisation dans le corps social avait trouvé quelque part du succès. Partant de l’occident en Afrique.
Même elle continue sa marche parce que les difficultés sévissent toujours chez les femmes du fait d’être un
peu comme oubliées, mis à l’écart. Toutefois les retombées positives de toutes ses actions menées par les
femmes donnent de constater des femmes occupant aujourd’hui, de hautes fonctions dans les
269
Cf. Jean XXIII, Pacem in terries, encyclique du 11 Avril 1963,§15, cité par Daly, 1968, n°119. 270270
Cf. Jacqueline Field Bibb, «Les femmes pour la prêtrise dans l’Eglise catholique romaine»,in Concilium n° 263, revue
international de théologie, Les théologies féministes dans un contexte mondial, Paris, Beauchesne, 1996, p. 112. 271
Cf. Jean Paul II, Lettre apostolique ordinatio sacerdotalis, dans la documentation catholique, 19 Juin 1994, n° 2096, 551-552.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 84
gouvernements africains. Et même dans l’Eglise catholique plusieurs charges religieuses sont confiées aux
femmes.
Par Yamoa Appou Paul
3.2.4 EXPOSE 4: DIFFERENCE ET EGALITE DE DROITS DES FEMMES DANS L’EGLISE
PAR ROSEMARY RADFORD RUETHER ET LA MASCULINITE DU CHRIST PAR
ELIZABETH JOHNSON
INTRODUCTION
A l’abord de ce travail, il est question de l’égalité de droits des femmes dans les Eglise chrétiennes,
dont Rosemary lutte surtout pour la participation des femmes aux fonctions dirigeantes, au ministère ou à
l’ordination, et de la masculinité du Christ mal interprétée et son abus historique dont traitera Elizabeth
Johnson. Rosemary montre que la nature de l’être de Dieu et de l’homme a été traditionnellement exprimée
en genre masculin, de manière à subordonner les femmes et à les exclure des fonctions dirigeantes. Elle part
de la lettre pastorale des évêques américains sur les préoccupations des femmes pour montrer le conflit qui
oppose l’anthropologie d’équivalence et de partenariat à l’anthropologie de complémentarité;
l’anthropologie biblique en faveur de Rome. Cette anthropologie qui divise les hommes et les femmes en
deux ontologies psycho-symboliques opposées, utilisée par Jean Paul II pour défendre la différence
essentielle entre les rôles des hommes et des femmes dans l’Eglise. Cette affirmation est en contradiction
avec l’assertion de l’égalité dans la création et dans le Christ; et elle est la marque d’une profonde
incohérence dans la théologie catholique.
Elizabeth Johnson, traite de la masculinité du Christ et de l’abus historique de ce fait dans la
théologie et la pratique chrétiennes. En même temps, elle montre l’ouverture de cette masculinité. Elle
soutient que le principe d’une nature humaine unique dans une interdépendance de différences multiples va
au-delà des modèles de dualité ou d’identité sexuelle d’individus abstraits pour célébrer la diversité comme
entièrement normale. Par la mort et la résurrection du Christ, tous ont été rachetés. Elle montre enfin
l’inclusion des femmes dans le ministère du Christ par le baptême et le martyre.
Ainsi, notre travail se divise en deux grands points: différence et égalité de droits des femmes dans
l’Eglise et la masculinité du Christ. Chaque point contient de petits sous points et une conclusion bouclera
notre travail.
I. DIFFERENCE ET EGALITE DE DROITS DES FEMMES DANS L’EGLISE
Par Rosemary Radford Ruether
I.1.Début de problème
La pleine intégration ou l’incorporation des femmes dans le ministère des Eglises chrétiennes est
devenue objet de critique pour le christianisme dans ce dernier siècle. Alors on se demande si, avec cet œil
critique, les Eglises pourront survivre demain comme options régulières valables. Le fait de se référer à son
passé historique, le christianisme se trouve devant une contradiction contradictoire. Comment? D’un coté, le
christianisme, dès ses débuts a proclamé un salut universelo-égaliste, c’est-à-dire un salut pour tous les
humains, sans distinction de sexe, de classe, d’ethnie et j’en passe.
D’un autre coté, la notion chrétienne de la nature de Dieu, du Christ voire même de l’humanité était
exprimée en termes du genre masculin. Ce denier mot constitue le nœud du problème. Cette notion
masculine a servi à subordonner les femmes, aussi bien en tant que membres de l’humanité que personnes
capables d’exercer une autorité et de représenter Dieu et le Christ. C’est pourquoi Rosemary dit que si les
femmes se trouvaient exclues du ministère ordonné et de toute fonction publique de direction dans les
sociétés chrétiennes, c’est parce que Dieu et le Christ ont été identifiés comme des êtres masculins.
Pour arriver à contester ces exclusions dans des postes de direction des Eglises, il faudrait attendre
quelques siècles plus tard, que les femmes aient accès aux droits politiques, qu’elles fassent des études
supérieures théologiques qui leur donneront les armes ou arguments pour être capables de contester.
I.2.Admission des femmes au sacerdoce dans les Eglises protestantes libérales
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 85
Tout d’abord il sied de dire qu’avant l’Eglise et la société étaient une seule et même entité, la
séparation est venue plus tard. Après l’indépendance de chacune d’elles, les sociétés libérales ont procédé à
la reconnaissance des droits des femmes comme personnes pleinement humaines. A cet effet, certains
conservateurs se serviront de ce fait pour proclamer que toute la question du droit des femmes dans l’Eglise
est mal venue. Le féminisme à ce qu’ils prétendent est l’importation dans les Eglises d’un problème
séculier272
.
A cette affirmation, Rosemary réagit en disant que cette séparation de la religion et de la société
séculière en matière de sexisme est fallacieuse273
, car le modèle dominant masculin dans le christianisme
remonte à une époque où l’Eglise et la société patriarcale étaient intégralement liées, où l’Eglise empruntait
ses modèles d’organisations et les étayait par un symbolisme et des arguments théologiques. Elle ajoute que
le problème de la subordination des femmes est à la fois social et religieux. Il fait partie de l’héritage des
idéologies séculières et théologiques274
.
Ensuite, les Eglises protestantes libérales, depuis quelques années, ont changé de vision et ont
accepté les femmes au ministère sacerdotal. Mais après cette admission, ces Eglises se sont rendues compte
qu’elles ne s’étaient pas préparées et n’ont pas prévu que cela devait exiger de revoir le symbolisme
théologique et l’organisation ecclésiastique. Raison pour laquelle, les femmes acceptées, sont en nombre
symbolique et surtout nommées dans des postes marginaux mal rémunérés, dans un système qui symbolise
encore l’être humain, masculin.
Toute fois, les femmes sont assez considérées dans la société car dit-on que mieux ‘vaut quelque
chose plutôt que rien’. Alors se posera la question, si les Eglises protestantes ont pu associer les femmes au
ministère sacerdotal, qu’en est-il pour l’Eglise catholique?
I.3.L’Eglise catholique face à l’ordination des femmes
Le fait que le système du ministère soit lié au célibat clérical, a mis le catholicisme dans l’embarras;
car les laïques, les religieuses en particulier constituent une portion importante de ce ministère dans l’Eglise,
cependant sans être officiellement reconnues comme ministres ordonnées. En plus, le Vatican s’oppose
farouchement à la procréation et à leur ordination.
Les évêques américains de leur coté, se trouvent entre le marteau et l’enclume c’est-à-dire pris par la
conscience de la présence active des femmes dans l’Eglise et cette intransigeance de Vatican. D’une part, les
évêques sont bien conscients qu’ils ne peuvent rien faire sans les femmes. Elles constituent à la fois la
majorité des pratiquants actifs et la majorité des travailleurs bénévoles dans l’Eglise; une portion croissante
du ministère professionnel, c’est-à-dire rémunéré, est accompli par elles275
s’exprime Rosemary. D’autre
part, les évêques sont liés au Vatican par un système de juridiction universelle et de dominations
épiscopales. Ce qui signifie que les évêques manquent d’indépendance nécessaire ou d’autorité pour
contester Vatican sur des sujets critiques touchant l’enseignement doctrinal ou moral dans des domaines tels
que les droits de procréation et d’ordination.
Vu la forte position de Vatican et certains évêques conservateurs, et comme il apparaissait d’après la
Déclaration sur « la nature et la vocation de la femme » en Septembre 1988, le pape est favorable à une
anthropologie de complémentarité qui divise les hommes et les femmes en deux anthropologies psycho-
symboliques opposées.
Ainsi, les évêques n’ont pas pu contester une si grande décision. Tout ce qu’ils pouvaient apporter
n’était qu’une participation accrue des femmes dans le ministère des laïcs. Quant au clergé ordonné, il reste
un domaine réservé au tout masculin. Tous ont adopté la position de la Déclaration du Vatican de 1976,
(réaffirmée par Jean Paul II dans sa lettre) contre l’ordination des femmes, qui déclarait les femmes
ontologiquement inaptes à l’ordination, parce qu’elles ne peuvent être l’image du Christ276
.
272
Rosemary Radford RUETHER, « différence et égalité de droits des femmes dans l’Eglise » in la femme a-t-elle une
nature spéciale? Paris, Beauchesne, 1991, p. 26. 273
Ibidem 274
Ibidem 275
Idem, p. 27. 276
Idem, p. 28.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 86
Pourtant, les évêques avaient pris le texte du livre de Genèse au chapitre 5, 27 qui dit « Dieu créa
l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, homme et femme » comme pour souligner l’égalité des
hommes et des femmes. Et aussi, dans leur première rédaction, les évêques n’avaient pas tenu compte des
anthropologies de subordination et de complémentarité. Ils avaient plutôt parlé d’une anthropologie
d’équivalence et de partenariat entre hommes et femmes égaux dans la famille, dans la société et dans
l’Eglise. Rosemary trouve ce langage incohérent, et se dit que cela étant, parce que l’histoire de la tradition
chrétienne a été interprété ce texte de façon dissymétrique.
Frappée par cette décision, la théologienne se plait du pape et des évêques conservateurs qui ne
semblent pas voir une contradiction entre cette prise de position et leur propre point du départ théologique,
qui est celui d’égalité des hommes et des femmes à l’image de Dieu277
. Ainsi, elle se pose la question,
comment est-il possible que les évêques, qui prétendent être les premiers maîtres de l’enseignement
théologique dans l’Eglise, ne peuvent-ils pas percevoir cette fragrante contradiction entre leur anthropologie
théologique et leur christologie ?
I.4.Anthropologie de création et christologie
Tout est partir de la fameuse déclaration du Vatican de 1976, qui faisait une séparation entre
anthropologie et christologie. Elle tentait de séparer la question de l’égalité civile des femmes dans la société
de celle de l’ordination. L’Eglise catholique (le Magistère), affirmait-elle, a toujours soutenu l’égalité civile
des femmes, mais la question de leur ordination n’est pas de droits civils ou d’égalité dans l’ordre naturel;
elle relève d’un plan à part, supérieur, celui des relations sacramentelles entre l’Eglise et Dieu278
.
De cette affirmation, on aboutira à séparer l’ordre créé ou naturel et l’ordre surnaturel ou l’ordre de la grâce,
établissant deux sphères sans rapports l’une avec l’autre. Le Vatican et les évêques insistent que les femmes
sont dites égales dans l’ordre naturel de la création, mais cela n’a pas d’implications pour l’ordre ecclésial
ou sacramentel du salut279
.
A ce sujet, Rosemary relève une contradiction dans le langage du christianisme entre son
anthropologie de la création et sa christologie. Il affirmait que les femmes étaient inégales par nature. Par
ailleurs, il dit que sur le plan sotériologique, cette hiérarchie patriarcale de l’homme au-dessus de la femme a
été annulée. Perplexe devant ce langage incohérent, Rosemary se demande comment se fait-il que nous
aboutissions, dans l’enseignement catholique moderne, à une version inverse, où les femmes deviennent
égales dans la nature ou la création (société séculière), mais inégales en grâce (dans le Christ et dans
l’Eglise) ? Malgré ce questionnement et cette inquiétude, cela n’a pas changé la décision du Magistère
catholique qui insiste toujours sur l’ordre naturel et surnaturel.
I.5.La femme parle
Rosemary ne cesse de manifester son inquiétude du fait que l’Eglise sépare l’anthropologie (nature)
de la christologie (grâce). Son étonnement tourne autour de deux questions. Elle dit que si l’inaptitude des
femmes à être image du Christ réside dans le domaine de la grâce, et non dans la nature, cela signifie-t-il que
la grâce acquise par le Christ a cessé d’inclure les femmes à égales? Si les femmes ne peuvent représenter le
Christ, comment le Christ représente-t-il les femmes280
?
De ces questions, Rosemary conclut que l’Eglise est au défi de donner une explication cohérente à
son anthropologie, sa christologie et sa sotériologie. Proclamer les femmes égales tant à la nature qu’à la
grâce, c’est courir le risque de leur accorder de représenter le Christ sacramentellement. Telle est la peur de
l’Eglise. C’est pourquoi les évêques américains ont préféré parler de l’anthropologie de complémentarité
que de l’anthropologie de l’équivalence dans leur deuxième rédaction du projet de la lettre pastorale.
Est-il que l’Etat admettait déjà les femmes dans la société, l’Eglise change de stratégie; elle va
sacramentaliser un système patriarcal et monarchique. Elle va asseoir son autorité sur le dogme de
l’infaillibilité du Souverain Pontife promulgué en 1870.
277
Cf. Ibidem 278
Idem, p. 29. 279
Ibidem
280
Idem, p. 31.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 87
Face à l’opposition de l’Eglise à l’égard des femmes, Rosemary se dit que les femmes doivent
chercher les moyens de participer à la vie des Eglises locales, des paroisses et des congrégations
religieuses281
. Elle ajoute que vu les efforts ambigus et limités des évêques américains, les femmes doivent
essayer de faire quelque chose pour élargir l’espace à leur ministères. Elles doivent occuper tout espace de
ministère qui s’ouvre à elles et en faire un espace habitable.
Elle propose de l’emploi en insistant sur les conditions juridiquement et humainement décentes,
c’est-à-dire avoir des contrats et des rémunérations raisonnables et partage de la prise de décision. Et aussi
créer des communautés de substitution, des libres communautés d’entretien et de soutien spirituel282
. Voici
ce qu’elle propose:
-la mise en interaction des communautés institutionnelles et libres pour qu’elles se stimulent mutuellement
sans s’exclure.
-les Eglises institutionnelles n’auront aucun choix entre les deux types de communautés; toute alternative
sera rejetée.
-garder une bonne relation entre les deux communautés.
-utiliser les ressources institutionnelles pour développer les communautés libres. Elle prévient ses collègues
que les rapports de force oppressifs ne finiront jamais, nous sommes tous en voie de conversion continuelle.
Elle finit en disant que ce dont nous avons besoin pour travailler ici et maintenant, ce n’est pas de la
perfection, mais d’un bon espace de travail et de vie pour nous-mêmes et autrui283
.
II.LA MASCULINITE DU CHRIST: Par Elizabeth Johnson
II.1.La masculinité de Jésus comme obstacle à la Bonne Nouvelle L’histoire de jésus de Nazareth, crucifié et ressuscité constitue le centre de notre foi chrétienne. C’est
à travers le Christ, avec son enseignement que Dieu décida de sauver et racheter tous les peuples du monde
entier. Cependant, cette Bonne Nouvelle se voit étouffée lorsque la masculinité de Jésus, qui appartient à son
identité historique, est interprétée comme essentielle à sa fonction de rédemption et à son identité christique.
En ce sens, le Christ est vu comme un instrument religieux qui marginalise et exclut les femmes. Elizabeth
s’exprime ce terme: le fait que le Christ de Nazareth fut un être humain de sexe masculin n’est pas mis en
question. Son sexe était un élément constitutif de sa personne historique, en même temps que d’autres
particularités comme son identité raciale juive, sa collocation dans le monde galiléen du 1er
siècle…doit être
respecté en tant que tel284
. Elle comprend cette difficulté du fait que la masculinité de Jésus a été interprétée
dans la théologie androcentrique officielle et dans la praxis ecclésiale.
Ainsi, elle donne trois éléments qui font obstacle à la Bonne Nouvelle ou qui excluent les femmes à
ce ministère.
1. le fait d’appeler Dieu ‘Père’ et Jésus ‘Fils’, pour interpréter la relation de Jésus à Dieu.
2. le fait que le Logos s’est fait chair et a habité parmi nous en tant qu’humain de sexe mâle indique que,
grâce à leur ressemblance corporelle naturelle, les hommes jouissent d’une identification plus étroite que les
femmes avec le Christ. Ainsi, les hommes sont parmi les êtres humains aptes à représenter pleinement le
Christ. Et les femmes, incapables d’identité christique malgré la théologie du baptême et de la création.
3. est-il qu’il y ait un dualisme entre l’humanité masculine et l’humanité féminine, la masculinité du christ
compromet automatiquement le salut des femmes. Parce que la masculinité est essentielle au coté christique,
les femmes sont mises hors circuit du salut car la sexualité féminine n’a pas été assumée par le Verbe fait
chair.
C’est dans cet horizon que la question de Rosemary est revenue: un Sauveur masculin peut-il sauver
les femmes ?285
La réponse de la masculinité ne peut être que non, malgré la foi chrétienne en l’universalité
du dessein salvifique de Dieu. Elizabeth finit par conclure qu’il est bien claire de remarquer comment
l’histoire effective du symbole du Christ prouve de manière frappante la vision mal réglée de la masculinité
281
Idem, p. 32. 282
Idem, p.33. 283
Ibidem 284
Elizabeth Johnson, « La masculinité du Christ » in la femme a-t-elle une nature spéciale ?, Paris, Beauchesne, 1991, p. 145. 285
Idem, p. 147.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 88
déforme et dénature la théologie de Dieu, l’anthropologie et la Bonne Nouvelle du salut286
. Pour ce faire, il
est nécessaire de repenser l’anthropologie qui a conduit à cette réflexion sur la masculinité et le sens
théologique du symbole du Christ.
I.2.Anthropologie: d’une dominance du masculin à une célébration de la différence Au regard de cette discussion apparemment infinie, Elizabeth remarque que le lieu où se déroule
cette palabre c’est la communauté ecclésiale, où la parole officielle, la décision et la visibilité
n’appartiennent qu’aux hommes. Au lieu de construire une anthropologie androcentrique valorisant un seul
sexe, envisageons plutôt un type de communauté différent, une communauté liée par des relations de
mutualité et de réciprocité, permettant aux femmes de dessiner une anthropologie de forme égalitaire, à
teneur pratique et critique; la masculinité du Christ sera plus libératrice propose Elizabeth. Elle évite le
dualisme dominant qui classe les hommes et les femmes comme des opposants polaires. Mais elle souhaite
que le masculin et le féminin soient liés par la notion de complémentarité, avec les qualités que chacun doit
cultiver et les rôles que chacun peut jouer.
A l’encontre de l’anthropologie dualiste, elle propose une anthropologie unique qui accepte la
différence sexuelle comme étant biologiquement importante pour la reproduction et non déterminante des
personnes en tant telles. Le but de cette anthropologie à la nature unique est de permettre à chacun (chacune)
d’assumer les rôles publics et privés selon ses dons et atteindre sa plénitude en tant qu’être humain. De ce
fait, l’accent sera mis sur la similarité fondamentale plutôt que la différence, au point que les différences
deviennent sans conséquences.
De là, se pose un problème explique Johnson, d’un coté il ya la pensée binaire marquée par la
polarité sexuelle qui conduit au schéma dominant/ subordonnée, d’un autre coté la réduction à une égalité de
similitude en ignorant la différence sexuelle est inacceptable. Que faire ? Elle adopte une seule nature
humaine célébrée dans une interdépendance de multiples différences. Non pas une vision binaire de deux
natures masculine et féminine à jamais prédéterminée, ni réduit à un idéal unique, mais diversité de manières
d’être humains; un jeu multipolaire de combinaisons d’éléments humains, dont la sexualité n’est qu’un
parmi d’autres. Le sexe est l’un des éléments constitutifs de la personne. C’est pourquoi Elizabeth dit que
c’est être myope que d’isoler la sexualité comme étant toujours et partout plus fondamentale pour
l’existence historique concrète que n’importe laquelle des autres constantes287
.
En ce sens, fixer l’attention sur la sexualité seule à l’exclusion des autres éléments constitutifs, serait
de considérer le sexe au seul et unique élément constitutif. La sexualité doit être intégrée dans une vision
historique des personnes humaines, au lieu d’en faire la pierre de touche de l’identité personnelle et, ainsi de
la dénaturer288
. Pour elle, le modèle anthropologique d’une seule nature humaine représentée dans la
multiplicité des différences est mieux que le modèle dualiste. Car cela nous arrangerait dit-elle à avoir une
anthropologie multipolaire qui permet à la christologie d’intégrer la masculinité du Christ en utilisant
l’interdépendance de la différence comme catégorie première, au lieu de mettre l’accent sur la sexualité
d’une manière idéologique, fausse289
.
I.3.Les femmes comme image du Christ
L’égalitarisme fondamental des traditions du baptême et du martyre confirme le caractère d’image du
Christ des femmes. Unes dans le Christ Jésus, les baptisées ont précisément dans leur existence corporelle de
femmes, et non en dehors d’elle, revêtu le Christ. (Ga3, 28). Saint Paul reprendra le sens de cette
identification en utilisant l’idée de l’Image/Icône…Ainsi, par la puissance de l’Esprit « nous tous…sommes
transformés » en cette image toujours plus glorieuse (2Co 3, 18). L’apôtre veut rappeler que le ‘nous tous’
inclusif montre bien que c’est à la communauté tout entière, aux femmes aussi bien qu’aux hommes qu’est
accordée la transformation en cette image.
Etre christique n’est pas un don distinctif du sexe dit Elizabeth. Car l’image du Christ ne réside pas
dans la ressemblance avec la forme narrative de sa vie dans le monde, miséricordieuse, libératrice, par la
286
Ibibem 287
Idem, p. 149. 288
Idem, p.150. 289
Ibidem
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 89
puissance de l’Esprit. Ce christomorphisme s’explique clairement lorsque Saul alla demander les lettres pour
torturer les adeptes du Christ, il allait pour les femmes comme pour les hommes. Les deux sont identifiés à
l’image du Christ sans distinction. Vatican II reprendra cette image en parlant de martyre qui transforme le
disciple en une forte image du Christ, car le martyr « devient semblable à lui dans l’effusion du sang »290
. La
tradition du martyre reconnait que, dans le don de leur vie, les femmes sont christomorphiques d’une
manière très vive et très profonde. L’effet pratique et critique de cette vérité évangélique rompt tout lien
intrinsèque entre masculin et Christ et aboutit à une contestation de la souveraineté patriarcale.
I.4.Jésus masculin dans l’histoire et non dans la communauté chrétienne
Sans les œillères de l’anthropologie dualiste, le symbole du Christ lui-même sera interprété en un
sens inclusif et eschatologique. Dans la puissance de l’Esprit, l’histoire de Jésus déclenche une histoire de
communauté de disciples faite aussi bien des femmes que des hommes. Parmi la multiplicité de différences,
la masculinité de Jésus est jugée intrinsèquement importante pour son identité personnelle historique et le
défi historique de son ministère, car dans son temps ce n’est pas tous les hommes qui avaient l’audace et le
courage de parler devant les grands prêtres sans crainte. Mais théologiquement cette masculinité est non
déterminante quant à son identité de Christ et non normative quant à l’identité de la communauté chrétienne.
Idéalement, si l’égale dignité humaine des femmes est reconnue dans la théorie et la praxis ecclésiale, cette
discussion sur la masculinité du Christ s’éteindra d’elle-même. Dans une Eglise juste, jamais ce ne serait
devenu un tel problème291
note la théologienne.
CONCLUSION
Au soir de ce travail, il a été question de la lutte pour l’égalité de droits des femmes, lesquelles sont
marginalisées et exclues dans les sociétés et dans les Eglises chrétiennes, surtout concernant la participation
aux fonctions dirigeantes publiques, au ministère ou l’ordination et de montrer que la masculinité du Christ
est un fait normal, qui ne doit pas créer de tentions dans la vie des chrétiens. Rosemary explique ce
phénomène du fait que la nature de l’être de Dieu et de Jésus a été exprimée traditionnellement en termes de
genre masculin. Alors il faudrait attendre jusqu’à ce que les femmes accèdent à l’éducation supérieure et aux
études théologiques pour être en mesure de contester ce modèle de dominance dans le cadre social et
ecclésial. Par ailleurs, dit Rosemary, les Eglises protestantes libérales ont accepté la critique féministe de la
tradition théologique chrétienne et ont admis les femmes au ministère, mais pas l’Eglise catholique romaine.
L’anthropologie biblique, divisant les hommes et les femmes en deux ontologies psycho-symboliques, était
la base de tout le problème et de toute contradiction. Cela a poussé Rosemary à trouver une incohérence
profonde dans la théologie catholique sur le plan théorique et pratique.
De sa part, Johnson dit que la masculinité de Jésus ne doit pas poser de problème dans l’annonce de
la Bonne Nouvelle, car elle fait partie des éléments constitutifs de son identité en tant qu’humain. Elle
montre que dans le Christ, il n’y a ni homme ni femme. Au lieu de parler d’une anthropologie dualiste, elle
préfère plutôt une seule nature humaine, acceptant les différences comme fait normal. La connexion dans la
différence est capitale, plutôt que l’identité par l’opposition ou l’uniformité, s’exprime Johnson. Le baptême
et le martyre sont pour elle des exemples pour une christologie inclusive.
MPETE Ebalaling Patrick
3.2.5 EXPOSE 5 : ALICE DERMIENCE, « FEMMES ET MINISTERES DANS L’EGLISE
PRIMITIVE » ET JANINE HUARCADE, « DANS LA TRADITION ET AUJOURD’HUI »
INTRODUCTION
Accueillir la parole de Dieu et y réfléchir, ne peut avoir de sens que si les théologiens tirent les
conséquences de ce qu’il découvre pour la vie pratique. C’est ainsi que dans une société pluraliste la
théologie ne peut être que pluraliste. Car les recherches théologiques sont faites en rapport avec des
personnes, suivant les cultures (les instruments de compréhension du monde), et dans des contextes
particuliers. Le fait donc qu’aucun discours sur Dieu ne peut se soustraire à la situation réelle du théologien 290
LG n° 42. 291
Idem, p. 154.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 90
et du contexte concret dans lequel, il élabore son discours, a fait naître plusieurs théologies contextuelles à
partir des années 1955. C’est dans ce contexte qu’est née les courants de théologies féministes. La théologie
féministe est née aux U.S.A avant de se propager en Europe dans les années 1970. La théologie féministe
peut être en général définie comme une théologie des femmes pour les femmes fondée sur leur expérience
d’oppression de discrimination, et de marginalisation ayant pour but de dénoncer, critiquer et combattre le
patriarcat dans la société, dans les relations interpersonnelles et dans l’Eglise292
. Tout revient donc a
déterminé le rôle, la place et le statut de la femme de la société et de l’Eglise. Dans la suite de notre travail
nous essayerons d’étudier la place qu’occupaient effectivement les femmes dans l’Eglise primitive, à partir
d’un article de la théologienne Alice Dermience. Ensuite nous verrons à partir de l’article de la théologienne
Janine Hourcade, la place des femmes dans la tradition et dans l’aujourd’hui de l’Eglise.
I. FEMMES ET MINISTERES DANS L’EGLISE PRIMITIVE (PAR ALICE DERMIENCE)
Alice Dermience, s’inscrit dans le courant de « relecture de la Bible par les femmes » dont le but est
d’équilibrer certaines interprétations trop masculines de la Bible. Dans son article : « femmes et ministères
dans l’Eglise primitive », elle cherche donc à partir de l’Ecriture d’analyser la problématique du ministère
des femmes.
Pour notre auteur, le Nouveau Testament est effectivement le seul document par lequel nous avons
accès au témoignage de la première évangélisation, mais aussi à l’image des toutes les premières
communautés. Parmi ces communautés, on note que certains frères et sœurs assument des responsabilités
particulières au service de l’évangile et de la communauté : « Outre les « Douze », les disciples, les apôtres,
on y relève la présence d’épiscopes, de presbytres, de diacres »293
. Au début, ces tâches sont assignées selon
les circonstances et nécessités pastorales. A notre époque marquée par la percée du féminisme, on pourrait
bien s’interroger avec Alice Dermience sur la place faite aux femmes dans ces premières communautés :
malgré le contexte défavorable, y ont-elles assumé des services et des ministères ?
I .1 FEMMES ET MINISTERES DANS LES EPITRES ET LE LIVRE DES ACTES DES APOTRES
Dans les lettres de Saint Paul
Alice Dermience aborde d’abord les épîtres authentiques de saint Paul dans lesquels il reconnaît aux
femmes, comme aux hommes le droit de prophétiser dans les assemblées, fût-ce la tête couverte (cf.1 Co 11,
5-6). Tout prophète étant établi dans l’Eglise par Dieu (cf.1 Co 12, 28), ils ou elles (les prophètes) ont pour
tâche, sous l’inspiration de l’esprit, de révéler au nom de Dieu, le mystère de son dessein (cf.1 Co 13, 22), sa
volonté dans les circonstances présentes. Ainsi pour sa mission, Paul s’entoura d’un grand nombre de
collaborateurs et de collaboratrices. Ces collaboratrices de Paul se verront attribuer dans les communautés
des ministères qu’on pourrait qualifier de diaconaux294
. En effet Alice Dermience remarque que Paul lui-
même se plaît à souligner l’importance de l’engagement de ses collaboratrices au service du Christ et de
l’Eglise. Dans les salutations finales adressées aux Romains, un grand nombre de femmes travaillant avec
lui sont reconnues et leurs noms transmis à l’histoire. Phoebé est saluée en premier : « Je vous recommande
phébée, notre sœur, diaconesse de l’Eglise de cenchrées …aussi bien fut-elle une protectrice pour nombre de
chrétiens et pour moi-même. » (Rm 16, 1-2). Pour notre auteur, même si le titre de « diacre » a une fonction
ministérielle instituée, il n’en évoque pas moins la durée et la reconnaissance publique d’un rôle particulier
dans la communauté.
« Remarquons en effet que, dans le cas phoebé, ‘‘diakonos’’ est un titre évoquant un
service bien concret, et pas seulement le service de Dieu en lequel consiste toute vie
chrétienne en général. Ce titre est donné dans un premier temps comme intelligible par lui-
même…Comme l’indique le génitif de l’Eglise de ‘‘de l’Eglise de cenchrées’’, le ministère
qui le justifie est reconnu comme tel, comme une fonction au sein de la communauté, méritant
à celle qui l’exerce honneur et considération »295
.
292
Cf. Loïc MBEN, Cours sur l’Eglise et la question féministe, Abidjan, CFMA, 2012, p.4. 293
Alice DERMIENCE, « femmes et ministères dans l’Eglise primitive », in : Joseph Gross, dir, Spiritus, femmes et mission, n°
137, Paris, 1994, p. 382. 294
Cf., Marie Josèphe AUBERT, Des femmes diacres, un nouveau chemin pour l’Eglise, Paris, Beauschesne, 1987, p. 68. 295
Alice DERMIENCE, o.c., p.384.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 91
Dans la suite du chapitre 16 de l’épître aux Romains, Paul relève la présence du couple Prisca et
Aquilas qu’il appelle « ses compagnons de travail dans le Christ Jésus » (Rm 16, 3). Dans ce couple Prisca
est nommée la première, ce qui semble indiqué qu’elle soit la personnalité dominante. Andronicus et Junias,
un autre couple, qui ont des liens de parenté et de captivité avec Paul sont tous deux engagé dans l’œuvre
d’évangélisation (Rm 16,7). Paul salue aussi d’autres femmes : Marie, Tryphène, Thryphose et Persis qui se
sont donné de la peine dans le Seigneur. Dans la lettre aux philippiens, Paul parle aussi d’Evodie et
Syntyché qui ont participé activement à l’évangélisation tout en acceptant les risques que comportait la
mission dans un monde hostile. Paul mentionne donc les « services » assumés par certaines femmes, de
manière publique et durable.
Dans les épîtres deutéro-pauliniennes et pastorales
Alice Dermience, souligne dans son analyse que l’égalité entre l’homme et la femme, proclamé dans
la lettre aux Galates (cf. Ga 3, 27-28) semble étrangère aux épitres deutéro-pauliniennes (Col et Ep) et des
lettres pastorales (Tt I et II Tm). Ces écrits plus tardifs montrent déjà une Eglise structurée où les presbytres
et les épiscopes jouent un rôle déterminant. La participation à la vie communautaire n’est pas reconnue aux
femmes. Elles n’ont pas droit de prendre la parole dans les assemblées culturelle, de prier publiquement et
d’enseigner (1 Tm 2, 8-15). En Col 3, 18 et Ep 5, 22-24, elles sont appelés à être soumises à leur maris.
Dans les épîtres catholiques
Alice Dermience note la même tendance discriminatoire à l’égard des femmes dans les épîtres
catholiques attribués à Pierre, Jacques, Jean et Jude.1 P 3, 1-7 va donc dans le même style que les deutéro-
pauliniennes exigeant la soumission de la femme afin de gagner les maris au Christ. Il n’est donc nulle part
question d’un « ministère », service exercée par une femme.
Dans les Actes
Dans les Actes, on retrouve la présence de Priscilla et son mari Aquilas, un couple juif expulsé
d’Italie chez qui Paul avait trouvé travail et collaboration apostolique (Ac 18, 2-3) ; ils avaient eux aussi
suivis l’apôtre de Corinthe à Ephèse (Ac 18, 8). En Actes 21, 9, on note la présence de Philippe, un des sept
(diacre) dit « l’évangéliste », qui avait quatre filles exerçant la fonction prophétique : « elles exerçaient donc
le charisme-ministère que Paul reconnaît aux hommes (1 Co 11, 5) »296
.
Dans l’analyse de notre auteur il ressort que les deux sources (les épitres pauliniennes et les actes)
qui évoquent la première expansion missionnaire du christianisme sont donc convergentes : « il en ressort
que cette époque semble ignorer les discriminations sexistes dans la vie ecclésiale, conformément au
principe de Ga 3, 27-28 : il n’ y a ni Juif ni Grec, il n’ y a ni esclave ni homme libre, il n’ y a ni homme ni
femme ; car tous vous ne faites qu’un dans le Christ Jésus »297
.
I .2 FEMMES ET MINISTERES DANS LES EVANGILES
Alice Dermience souligne que l’attitude de Jésus à l’égard des femmes y est décrite dans les
Evangiles. Notre auteur note d’abord que parmi les ennemis de Jésus, les Evangélistes ne mentionnent
aucune femme. Les Evangiles nous rapportent la présence des femmes tout au long de la vie de Jésus, et
contrairement aux usages de son temps, Jésus n’a pas eu la moindre parole péjorative envers elles. Les
Evangélistes témoignent aussi que Jésus remet en question la famille patriarcale de son temps (Mc 10, 29-
30 ; Mt 10, 37 par. Lc 14, 26). Quelques femmes prennent leurs distances vis-à-vis des contraintes familiales
et même les Evangélistes évoquent leur présence dans le groupe restreint des disciples qui vont jouer un très
grand rôle dans l’événement de pâques.
Dans l’Evangile de Marc (Mc 15, 41), nous apprenons rétrospectivement que des femmes suivaient
et servaient Jésus en Galilée. Notre auteur fait remarquer que Marc n’aurait pas rapporté plus tôt leur
présence pour éviter de relater un souvenir compromettant pour Jésus. D’autres exégètes pensent donc que
ce soit une influence du milieu emprunt à la pression antiféministe. Tout compte fait, on note la présence des
femmes au cours de la passion de Jésus alors que les disciples eux avaient fuient. Elles seront aussi présentes
296
Idem, p. 386. 297
Idem, p. 387.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 92
à la croix (Mc 15, 40), au tombeau (Mc 15, 47). Elles sont les premières à recevoir la résurrection mais elles
se dérobent devant le témoignage actif qui leur est demandé (Mc 16, 8).
En Mathieu, on retrouve à quelques détails prêt les péricopes Marcien qui rappelle la présence des
femmes à Golgotha (Mt 27, 55-56), au tombeau (Mt 27, 61) et leur retour au tombeau vide (Mt 28, 2, 5-7).
Contrairement à Marc, Alice Dermience note qu’ici les deux femmes à leur retour du tombeau s’empressent
d’accomplir la mission que Dieu leur a confié (Mt 28, 8). Notre auteur souligne le fait que Mathieu répète et
cautionne l’envoie en mission : « allez annoncer à mes frères… » (Mt 28, 9-10). Cette insistance
s’expliquerait par le fait que Mathieu avait sans doute à l’esprit les préjugés antiféministes difficiles à
extirper de la communauté. C’est pourquoi il fait intervenir le Christ en personne pour confier à deux
femmes un ministère intra-ecclésial et légitimer une pratique contestée.
Dans l’Evangile de Luc, on y retrouve la présence des femmes au cours des événements de la
passion-mort-résurrection (Lc 23, 45-49 ; 24, 1-7), mais déjà aussi bien avant ces événements (Lc 5, 2-3).
Sans ordre explicite, elles annoncent aussi la résurrection aux apôtres qui refusent de croire et les accablent
de leur mépris (Lc 24, 9-11). Elles ne bénéficient pas de la confiance des apôtres. De même, elles se verront
exclu lors du choix du « douzième témoin officiel »298
. Luc au fond veut donc critiquer implicitement
l’antiféminisme de son Eglise en s’en prenant à la mysoginie des autorités qui refusent aux femmes le droit
d’exercer le ministère du témoignage.
Dans l’Evangile selon saint Jean, nous notons en dehors des femmes qui figurent déjà dans les
synoptiques, la présence de la samaritaine (Jn 4, 7) et la femme adultère (Jn 8, 3). Dans cet Evangile, on voit
Jésus bravant les interdits, les convenances élémentaires et qui interpelle la samaritaine et s’engage dans un
dialogue. Ensuite la femme ira témoigner à la ville, ce qui amène les samaritains à croire en Jésus (Jn 4, 1-
42). Il s’agit déjà là selon Alice Dermience de l’abolition des barrières ethniques et sexistes. Dans le récit de
Lazare, Jean nous propose un autre exemple de promotion féminine. Elle souligne ensuite que le fait qu’on
affirme que Jésus aimait Marthe et Marie, reviendrait à les assimiler aux disciples. En plus la confession de
Pierre (Mc 8, 29 et par.) est mise sur les lèvres de Marthe, sœur de Lazare (Jn 11, 27). Ces femmes n’ont
jamais suivie Jésus, mais il les a rencontré dans une relation interpersonnelle. Pour notre auteur, les
« femmes-disciples » n’étaient pas présent au cours du dernier repas de Jésus (Jn 13, 1-2) ; ni même au cours
du lavement des pieds (Jn 13, 3-17). Mais Alice Dermience souligne curieusement que dans les synoptiques
l’absence des femmes est exploité pour les écarter à tout jamais du sacerdoce. Or saint Jean, lui ne parle
même pas de leur absence pendant la dernière cène. Alice conclue alors qu’il est vrai qu’il n’y avait pas de
femmes parmi les douze ; mais Jésus ne les a jamais exclue.
I . 3 EVALUATION DE LA PENSEE D’ALICE DERMIENCE
Le travail d’Alice Dermience nous paraît très louable dans le sens où elle a sondé l’Ecriture pour
nous relater la place et le rôle de la femme dans l’Eglise primitive à partir d’une lecture critique et non
littérale des textes sacrés. Ainsi en sondant l’Ecriture de manière critique, elle nous a permis de voir que les
femmes ont été bien présentes dans la vie des premières communautés. Cependant dans certaines premières
communautés, la femme a été aussi victime des tendances discriminatoires dues donc à l’influence du milieu
social. Même si les femmes étaient dépouillées de tout rôle officiel à la synagogue et dans la vie publique,
elles provoquent l’admiration lorsqu’elles se mettent au service du verbe fait chair, Jésus-Christ. Avec Paul,
les femmes ont participé effectivement à la diffusion de l’Evangile. Certes parmi les apôtres de Jésus il n’y
avait pas de femmes, mais ces dernières ne sont pas pour autant exclues de la mission. Nous pouvons certes
nous référer aux textes sacrés pour réfléchir sur la place des femmes dans les communautés primitives, mais
il faudrait une actualisation concrète et efficace des données bibliques avec notre réalité d’aujourd’hui. On
ne peut donc pas simplement utiliser l’Ecriture pour justifier légalement des pratiques. Alors comment
pouvons-nous comprendre la place de la femme aujourd’hui à partir de ce qu’elle a été par le passé ? C’est
ce que nous verrons dans le deuxième article avec Janine Hourcade.
II. LA PLACE DE LA FEMME DANS TRADITION L’AUJOURD’HUI DE L’EGLISE (PAR
JANINE HOURCADE)
298
Il s’agit de l’élection de celui qui devait remplacer Judas. Les femmes-disciples, elles aussi, malgré qu’elles remplissaient les
conditions seront exclues (Ac 1, 15-16).
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 93
Nous abordons dans cette partie la réflexion sur la place de la femme selon l’analyse de Janine
Hourcade à partir de son article : « Dans la tradition et aujourd’hui ». Janine Hourcade exprime son point de
vue sur la place de la femme dans l’Eglise à partir de la tradition et qu’elle a développé dans son livre :
« Des femmes prêtre ? ». Elle présente donc de nombreux domaines où la femme peut intervenir dans la
mission de l’Eglise.
Comme préliminaires, elle pose deux remarques. Elle souligne d’abord que la notion de la mission de
l’Eglise a changé. Il ne s’agit donc plus des missions à l’extérieur comme à l’époque colonial, mais de
mission à l’intérieur du vieil occident qui s’essouffle et a besoin d’un nouvel élan. Ensuite, elle fait
remarquer que en se référant au passage de la Genèse : « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu
il le créa, homme et femme il les créa. » (Gn 1, 27) ; on note une égalité dans la semblance de Dieu mais
aussi la différence homme et femme. Et les deux choses sont difficiles à articuler et à appliquer dans la
réalité concrète. Pour elle, contrairement au féminisme développé en France sous le règne de Simone
Beauvoir299
, être femme ne relève pas du domaine culturel car la femme a une certaine spécificité. La
femme a donc une manière d’être qui n’est pas celle de l’homme. Elle a donc des attitudes qui lui sont
propres aussi dans la mission de l’Eglise. Cette spécificité n’annule guère l’égalité de la même façon que les
personnes de la sainte Trinité sont différentes mais aussi égales.
II.1. LA PLACE DE LA FEMME DANS L’EGLISE DES PREMIERS SIECLES
Pour Janine Hourcade, il faut d’abord se débarrasser en premier lieu du problème de l’accession des
femmes à la prêtrise. Cela ne signifie pas pour l’Eglise dit-elle que la femme en soit incapable, mais parce
qu’il y a des raisons théologiques, symboliques, anthropologiques et surtout des raisons de tradition. Elle
souligne en effet que dans la tradition judéo-chrétienne, on ne trouve pas de femmes prêtres. Cette position
tient de l’essence même de l’Eglise qui ne peut changer son interdit si ce n’est par contournement.
Dans l’Eglise des premiers siècles, les ministères non ordonnés sont nombreux et manifestent la
vitalité des femmes au service de l’Eglise. A cette époque ont joué un rôle important et Janine Hourcade
énumère les fonctions qu’elles remplissaient. Elles ont œuvré dans le domaine de l’instruction religieuse à
savoir dans le catéchuménat, la préparation au baptême, l’annonce de l’Evangile aux païennes etc… Ensuite
Janine note qu’elles ont œuvré dans l’ensemble des fonctions relatives au culte. On note leur assistance à
l’évêque pendant le baptême des femmes ; la fonction de portier ; le droit de déposer le calice ; dans les
monastères en l’absence du prêtre et du diacre, la diaconesse a le droit de lire l’Evangile ; distribution de la
communion aux femmes et aux enfants en l’absence du prêtre. Notre auteur souligne aussi que les femmes
étaient beaucoup au service des autres femmes malades. Dans la prière liturgique, les veuves représentent la
prière et le chant choral des moniales sera une forme de développement de cette participation des femmes à
la prière officielle de l’Eglise.
II. 2 LA PLACE DE LA FEMME DANS L’EGLISE D’AUJOURD’HUI
Janine Hourcade. souligne qu’en conformité du Code de droit Canon de 1983 : « tout ce que peut
faire un laïc, s’il n’est pas précisé que cela est réservé aux hommes, peut être accompli par une femme »300
.
C’est ainsi que plusieurs femmes reçoivent des missions de la part de leur évêque et participe de plus en plus
à la mission de l’Eglise. Ainsi pour notre théologienne le rôle de la femme doit trouver son expression
spécifique dans ce qui est son charisme essentiel : le don de la vie.
Selon Janine Hourcade, c’est ce don de vie qui caractérise par excellence la femme. En donnant la
vie, la femme demeure l’éducatrice par excellence. Et c’est la femme en tant qu’éducatrice qui transmet la
culture. Les manières de vivres et de penser, les mœurs sont transmis par les femmes. De cette même
manière la femme joue aussi un rôle essentiel dans la transmission de la foi en lien avec son charisme du don
de la vie. Janine Hourcade constate que dans bien de diocèses en occident, les femmes sont responsables de
la catéchèse et même catéchistes, qui sont des tâches qu’elles jugent souvent subalternes. Alors que bien au
299299
Simone de Beauvoir disait en effet qu’on ne nait pas femme, on le devient. Alors sous son règne on prônait
l’interchangeabilité des sexes. 300
Janine HOUCARDE, « Dans la tradition et aujourd’hui », in : Joseph Gross, dir, Spiritus, femmes et mission, n° 137, Paris,
1994, p. 431.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 94
contraire la mission de transmission de la foi est très capitale pour l’avenir de l’Eglise et de l’humanité.
Ainsi la catéchèse s’apparente à un travail d’enfantement. La femme a donc un rôle éminent et irremplaçable
à jouer dans la mission de l’Eglise qui est de susciter de nouvelles générations de témoins, qui annonceront
la Bonne Nouvelle aux pauvres.
En se référant à l’histoire, notre auteur relève que dans les pays occidentaux la femme a été toujours
à l’origine de l’évangélisation. C’est le cas par exemple de Clotilde chez les francs, Hedwige en Pologne,
Berthe de Kent en Angleterre, Olga en Russie. Toutes ces femmes ont construit l’Europe chrétienne.
Dans le prolongement de son charisme du don de la vie, et son autre charisme vital, la maternité, la
femme peut jouer aussi un rôle non seulement la naissance de la foi, mais aussi pour son développement.
Elle peut exercer la maternité spirituelle en conseillant ceux qui cherchent Dieu, en les soutenant, en leur
donnant l’espérance pour vivre. Dans le prolongement aussi du don de la maternité spirituelle, Janine
Hourcade. souligne que la femme a un rôle très précieux dans la formation des prêtres. Elle donne dans ce
cas l’exemple de l’expérience séculaire des Compagnons du Tour de France, où dans la vie des apprentis, la
« mère » non seulement joue un rôle de nourricière, mais participe aux décisions. Cette coutume contribue
certainement à la formation psychologique des jeunes hommes qui découvrent les composantes de leur
identité, à savoir les polarités féminines et masculines de leur personnalité.
Enfin Janine Hourcade, insiste sur la nécessité pour la femme d’assumer son rôle dans la mission de
l’Eglise. Cette mission qui consiste à annoncer Jésus ressuscité, en portant la Bonne Nouvelle aux pauvres,
et en suscitant la foi dans l’union à Dieu et dans la sainteté. La femme a donc un rôle formidable et
irremplaçable.
II. 3 EVALUATION DE LA PENSEE DE JANINE HOURCADE
La réflexion de Janine Hourcade mérite une attention très particulière. Elle a su bien abordé la
question de la place de la femme dans la mission de l’Eglise. En dissipant certaines erreurs, elle a bien
souligné que la question d’ordination des femmes n’est pas pour elle sujet de discussion, car l’Eglise n’a
jamais dit que la femme en soit incapable, mais plutôt à cause des raisons théologiques et surtout de la raison
de tradition. Alors refuser l’accession des femmes à la prêtrise ne relève donc pas d’une ségrégation sexiste.
Mais au-delà de la question de l’ordination, il faut redéfinir leadership et le ministère dans l’Eglise.
Janine Hourcade a su bien souligné que la femme a une spécificité. Elle est porteuse de vie et en tant
que telle elle doit prendre place à la mission de l’Eglise en tenant compte de leur spécificité. On ne peut
donc pas prétendre que la femme peut tout faire, ni l’homme peut tout faire. Chacun y tient une place
particulière dans l’exercice de la mission.
Le risque ici, c’est penser le ministère en terme de prééminence, alors qu’il s’agit d’un service. Mais
nous pouvons noter qu’il y a un risque de vouloir trop peindre l’image de la femme en l’idéalisant si bien
que finalement la femme aura du mal à se reconnaître.
CONCLUSION
Au cours de l’histoire la femme a toujours quelque fois selon les contextes culturelles variables
émanent de la société, dans un statut d’infériorité. Mais la lutte faite pour rétablir l’égalité entre l’homme et
la femme fut de tout les temps. Ainsi au cours de l’histoire beaucoup de femmes ont joué des rôles très
importants dans l’Eglise. L’Eglise elle-même souhaite donc que les femmes chrétiennes prennent
pleinement conscience de la grandeur de leur mission : « leur rôle sera capital aujourd’hui aussi bien pour le
renouvellement et l’humanisation de la société que pour la redécouverte, parmi les croyants, du vrai visage
de l’Eglise »301
. Si la position de l’Eglise a considérablement varié sur la femme, il n’en demeure pas moins
que certains points demeurent en suspens. Même si au plan spirituel et métaphysique l’égalité entre l’homme
et la femme est reconnue, sur le plan pratique on affirme la différence de la femme afin de mieux la
cantonner dans certains rôles prédéfinis. Les femmes ne sont pas consultées lors des procès canoniques et
des lois de l’Eglise que néanmoins elles auront à observer dans leur propre vie. Les femmes doivent être
bien présentent et participer à la vie de l’Eglise sans aucune discrimination, même dans la consultation et
l’élaboration, des décisions, des documents pastoraux et des initiatives missionnaires et doivent être
301
Inter Insigniores, n° 41, Déclaration de la sacré congrégation de la doctrine de la foi sur la question de l’admission des femmes
au sacerdoce ministériel.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 95
reconnues comme collaboratrice de la mission de l’Eglise dans la famille, dans la société. Car, « quant à ce
qui est de la participation à la mission apostolique de l’Eglise, il est certain que, en vertu du baptême et la
confirmation, la femme, autant que l’homme, participe au triple office de Jésus-Christ : Prêtre, Prophète et
Roi ; et, à cause de cela, elle est habilitée et engagée dans l’apostolat fondamental de l’Eglise :
l’évangélisation »302
. Il est donc tout a fait légitime que des femmes, elles même s’engagent dans cette lutte
et cela même doit amener l’Eglise à sa propre autocritique.
Par Donatien D. KOUMANTEGA
3.2.6 EXPOSE 6 : L’EGLISE EST-ELLE MISOGYNE ? PAR JANINE HOURCADE
INTRODUCTION L’Église dispose-t-elle d’un ministère qui répond aux aspirations les plus profondes de la femme ?
Telle est la question au cœur de l’ouvrage L’Église est-elle misogyne ? par la théologienne française Janine
Hourcade. Publié tout juste après la décision inédite du synode anglican d’ouvrir le sacerdoce aux femmes,
ce livre malgré son titre provocateur se lance dans un sens tout à fait distinct. Au lieu de critiquer l’Église
catholique pour son manque d’égalité dans les ministères à la portée des femmes, Hourcade ne revendique
pas un féminisme qui milite pour l’effacement de toute différence d’ordre ministérielle entre l’homme et la
femme. Au contraire, pour elle la vocation qui correspond aux soifs les plus intimes de la femme est déjà
présente au sein de l’Église et l’a été depuis le début du christianisme, à savoir, la virginité consacrée. La
vocation de la vierge consacrée constitue un charisme privilégié de la femme chrétienne et représente son
véritable ministère au cœur de l’Église. En plus, cet état de vie s’offre comme une forme de plein
épanouissement et de libération pour la femme chrétienne dans le monde moderne.
1. LA VIRGINITÉ CONSACRÉE : LES FONDEMENTS SCRIPTUAIRES
Vécue dès le deuxième siècle et attestée par les Pères de l’Église, mais abandonnée à partir du 15ème
siècle, la vocation de la vierge consacrée ne fut remise en valeur qu’après le Concile Vatican II. Le 31 mai
1970 que l’Église promulgua un nouvel Ordo virginum qui en effet restaura le rite liturgique de consécration
des vierges qui existait dans l’Église primitive303
. Cet Ordo n’est pas destiné qu’aux religieuses cloîtrées
mais s’adresse aussi aux femmes qui vivent seules dans le monde. Car, cette vocation de la virginité
consacrée, peut être vécue par toute femme qui désire « mener une vie consacrée dans le monde (comme) un
moyen à la fois très ancien et très moderne de réaliser une plénitude de consécration »304
.
1.1 La virginité dans l’Ancien Testament
Dans la Bible et surtout dans le Nouveau Testament, on se trouve en face de plusieurs versets bien
connus qui parlent de la virginité. Par exemple, l’Évangile de Matthieu désigne l’existence des « eunuques
qui se sont rendus tels en vue du Royaume des Cieux » (Mt 19, 12). Puis, saint Paul écrit ceci aux
Corinthiens : « Pour ce qui est des vierges je n’ai pas d’ordre du Seigneur (…) Es-tu lié à une femme ? Ne
cherche pas à rompre. N’es-tu pas lié à une femme ? Ne cherche pas de femme » (1 Co 7, 25.27). Ensuite,
dans l’Apocalypse de saint Jean on trouve le verset : « Ceux-là, ils ne se sont pas souillés avec des femmes,
ils sont vierges » (Ap 14, 4). Ces versets donnent l’impression que la virginité est plutôt une affaire de
l’homme que de la femme. Cependant, selon Hourcade même si au fond la virginité de l’homme est
identique à celle de la femme, « la virginité est profondément inscrite dans la nature profonde et éternelle de
la femme, sa nature à la fois biologique et psychologique »305
. La nature même de la femme comporte un
élément du « déjà là » avec le « pas encore » à tel point que notre auteur affirme qu’ « il semble bien que la
femme apporte, dans la réalisation de la virginité, des possibilités et des dons plus éclatants »306
.
302
Christifidelis laici du 31 janvier 1989, n° 50, in : Maria Teresa ponsile SANTISO, la femme espace de salut, Paris, Cerf, 1999,
p. 64. 303
Cf. Janine HOURCADE, L’Église est-elle misogyne? Une vocation féminine, antique et nouvelle, Paris, Éditions Tequi, 1990,
p. 11. 304
Ibidem. 305
Idem, p. 14-15. 306
Idem, p. 15.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 96
Dans l’Ancien Testament, la femme est celle qui donne la vie et s’accomplit en devenant épouse et
mère. Sa fonction primaire s’inscrit dans celle d’Ève qui était appelée « la mère de tous les vivants » (Gn 3,
20). Chez les juifs, la fécondité constituait un signe de bénédiction divine et la stérilité indiquait une marque
de malheur et de péché. En même temps, une grande importance était accordait à la virginité de la fiancée.
Une jeune fille qui n’était plus digne du titre de vierge se trouvait fortement dévalorisée. Au fil de temps et
selon les manières dont Israël concevait sa relation avec Dieu, le peuple élu a graduellement pris conscience
du symbole des épousailles entre Dieu est son peuple. Dans cette optique, Israël reçoit le nom de vierge et
se met à l’attente de la venue proche du fiancé dans le contexte des Promesses et de l’Alliance. En effet,
chez les juifs la virginité portait un sens religieux de fidélité et d’exclusivité qui s’exprimait surtout à travers
la figure de la femme.
1.2 La virginité dans le Nouveau Testament
Ce sens religieux de la virginité, préparé par la foi et l’histoire du peuple d’Israël, trouvera sa
plénitude avec l’avènement de Jésus Christ. C’est la virginité de Marie, la mère du Sauveur, qui « donne
tout son sens à la virginité des femmes chrétiennes »307
. Marie, comme toute autre jeune fille juive de son
époque ne dédaignait guère le mariage. Elle se prêtait à s’y engager avec Joseph lorsqu’elle a accueilli
l’Annonciation. Toutefois, Hourcade souligne que la gloire de Marie ne réside pas essentiellement dans sa
conception virginale ou sa maternité physique, mais bien plus dans « l’amour avec lequel elle a répondu à sa
vocation »308
. En fait ce sera la virginité perpétuelle de Marie, c’est-a-dire, son engagement profond « dans
la voie de la virginité consacrée par amour du Seigneur incarné »309
, qui constituera une source d’inspiration
pour tant de femmes qui répondront à sa suite en se consacrant librement, dans toute leur personne y
compris leur sexualité, à l’amour exclusif du Christ.
C’est surtout dans les lettres de saint Paul que ressort le caractère eschatologique de la virginité ou du
moins du célibat. Dans ces derniers temps, ceux qui restent vierges sont détachés du monde présent en
anticipation de celui qui viendra au jour de la Parousie. Cependant, même si l’appel à la continence sexuelle
dans l’attente semble être lancé à tous les fidèles sans distinction, saint Paul ne se vacille pas lorsqu’il fait
allusion à la féminité de l’Église comme l’épouse du Christ. Dans sa deuxième épître aux Corinthiens, Paul
parle de l’Église comme « une jeune fille vierge et pure » qu’il présente à son unique époux le Christ (2 Co
11, 2). Ce symbole de l’Église comme la fiancée vierge du Christ représente encore un autre indice biblique
qui relie la virginité de façon préférentielle à la femme.
2. ANTHROPOLOGIE ET CONCEPTION DE LA VIRGINITÉ CHEZ LES PÈRES DE L’ÉGLISE
Outre les fondements scripturaires, le fait de rattacher la virginité à la femme est attesté dès le début
de la tradition apostolique, comme témoignent les écrits des Pères de l’Église. Presque tous les Pères
préféraient à réserver le terme « vierge » exclusivement aux femmes et à designer les hommes voués à Dieu
par les termes « ascètes » ou « anachorètes »310
. Dès le deuxième siècle les Pères louaient la virginité et lui
octroyaient un sens théologique profond, à savoir, la vierge consacrée comme la Sponsa Christi.
Tandis que la plupart de Pères se référaient à la virginité dans son expression féminine, il y en eut
deux, qui en parlaient de façon indifférente de celle de l’homme. Grégoire de Nysse concevait la virginité
comme une affaire de l’âme plutôt que du corps. Pour lui, l’archétype de la virginité se situe en Dieu et
celle d’ici-bas ne constitue qu’un reflet du mystère de la génération éternelle dans la Trinité où le Père
engendre le Fils selon le mode virginal311
. Mais selon une dualité platonique, le corps ne jouait grand rôle
dans cette vision, et la pureté de la vierge subsistait dans le fait de vivre par l’âme seule. Origène aussi
aimait parler de « toute âme vierge »312
. Tandis que lui considérait la virginité comme un état supérieur au
mariage et applicable indifféremment aussi bien aux hommes qu’aux femmes, il n’a laissé aucun écrit qui
307
Idem, p. 25. 308
Ibidem. 309
Idem, p. 24. 310
Cf. Idem, p. 33. 311
Cf. Idem, p. 32. 312
Ibidem.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 97
explicite comment la vivre dans le quotidien. En dehors de Grégoire de Nysse et Origène, les autres Pères
de l’Église lient la virginité toujours à la femme.
Parmi les Pères, saint Augustin et saint Jean Chrysostome relèvent inséparabilité de l’aspect corporel
de la virginité en insistant sur l’intégrité du corps, la chasteté de l’âme et la consécration au Christ. Saint
Jean Chrysostome précisa ceci : « la vierge ne doit pas seulement être pure dans son corps » mais aussi dans
son âme « pour être prête à recevoir le divin Époux »313
. Ainsi, ressort un approfondissement théologique
du sens de la virginité attribué en premier lieu à Tertullien. C’est à lui qu’on doit l’expression « sponsa
Christi », une appellation débordante de sens qui accorde à la vierge consacrée le titre exalté de l’épouse du
Christ.
3. L’HISTOIRE DES VIERGES CONSACRÉES
L’histoire de l’Église, depuis ses origines témoigne des chrétiens, hommes et femmes, qui se sont
donnés à la suite de « l’idéal de perfection auquel conviaient les paroles du Christ et les conseils de saint
Paul »314
. Hourcade affirme que « très certainement, au sein de la communauté primitive, une élite de
chrétiens pratiquaient la virginité »315
. Déjà dans les Actes des Apôtres, la présence de « quatre filles
vierges » (Actes 21, 9) démontre non seulement l’existence de personnes vouées à la virginité, mais aussi
leur caractère spécifiquement féminin.
3.1 L’essor de vierges consacrées dans l’Église primitive
Hourcade maintient avec conviction qu’ « il n’y a pas d’interruption historique entre l’Écriture et
l’histoire des vierges consacrées »316
. L’histoire des vierges consacrées dans les premiers siècles du
christianisme montre définitivement la précellence de la virginité par rapport à d’autres vocations féminines
au sein de l’Église primitive, à savoir celle des veuves et des diaconesses. D’après des sources chrétiennes
et païennes qui datent du deuxième siècle, les vierges ne s’habillaient pas de façon distinctive et ne vivaient
pas en commun, mais jouissaient plutôt d’une grande liberté et indépendance dans la société317
. Hourcade
souligne qu’elles « demeuraient dans leurs familles selon toute vraisemblance, et il est probable que rien ne
les distinguait des autres chrétiennes. Ce qu’il y a de frappant, c’est qu’on ne leur demandait rien d’autre
que la virginité. »318
Rien de spécial ne leur était demandé dans le culte, aux réunions, ou dans les œuvres
pastorales de la communauté. Les seuls facteurs qui distinguaient ces femmes chrétiennes des autres étaient
leur état de vie de vierge et une voile qu’elles portaient en public comme toute autre femme mariée de
l’époque.
À partir du troisième siècle, les vierges chrétiennes peuvent être trouvées partout dans le monde
chrétien, en Orient aussi bien qu’en Occident. En guise d’exemple, la vierge de l’antiquité qui incarne
l’image idéale de la femme chrétienne libre et indépendante est sainte Geneviève de Nanterre. Elle n’a
jamais vécu dans une communauté religieuse ; au contraire, elle menait une vie hautement affranchie,
possédant un vaste domaine lequel elle-même administrait. Elle jouissait d’un haut degré de liberté dans sa
vie sociale et privée : « Elle achetait des outils, des matériaux, payait des ouvriers, affrétait une flottille,
passait des marchés. Avec de telles possibilités, elle pouvait parler avec autorité puisqu’elle n’avait de
comptes à rendre à personne. »319
Ce genre d’autonomie, cependant, n’était pas bien apprécié par tous,
surtout par quelques saints hommes de l’époque, dont saint Cyprien, qui reprochèrent aux vierges d’avoir
l’habitude d’assister aux bains mixtes, aux noces et aux danses320
.
3.2 Le rite de consécration des vierges dans l’histoire
Il y a en évidence des documents qui décrivent le déroulement d’une cérémonie liturgique, pratiqué à
Rome du quatrième au neuvième siècle, par laquelle des vierges se consacraient à Dieu dans la virginité. Au
313
Idem, p. 34. 314
Idem, p. 37. 315
Ibidem. 316
Idem, p. 38. 317
Cf. Ibidem. 318
Ibidem. 319
Idem, p. 45-46. 320
Cf. Idem, p. 41.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 98
cours de ce rite, une jeune fille, âgée normalement de seize à vingt-cinq ans, après avoir été soumise à un
long examen et admise par l’évêque, prononçait d’abord un vœu privé qui entamait une période de
probation, après laquelle elle passait à la consécration proprement dite321
.
Il est impossible de comprendre ce rite sans appréciation du symbole de sponsa Christi. La liturgie
de consécration des vierges comportait une forte connotation de mariage où « l’état de la vierge chrétienne
est assimilé à l’état matrimonial. Aussi les lois qui régissent le mariage sont appliquées à l’union de la
vierge au Christ : unité, fidélité, indissolubilité. »322
Au cours du rite la vierge recevait la voile d’une femme
mariée et l’Église primitive se montrait très sévère envers des vierges délinquantes. Ce rite, si proche d’une
cérémonie de mariage, se faisait habituellement devant la communauté chrétienne au cours de la messe un
jour de fête comme Pâques ou l’Épiphanie.
3.3 La disparition graduelle des vierges consacrées vivant en plein monde
À part du sixième siècle les femmes chrétiennes consacrées par la virginité commencent à vivre de
plus en plus en communauté. Selon Hourcade, cette évolution d’une vie indépendante menée au sein de la
famille en plein monde vers la vie commune de plus en plus institutionnalisée contribuait à une réduction de
la signification de la virginité consacrée. Ce mouvement vers le couvent se poursuivrait et donc, à partir de
l’onzième siècle, « les liturgistes romains ne faisaient plus de distinction entre la consécration des vierges
cloîtrées et la consécration des vierges vivant dans le monde »323
. En fait, à partir de cette période on trouve
difficilement de traces des vierges consacrées vivant seules au plein monde. Cette évolution vers la vie
communautaire sera officialisée lors du Concile du Latran I qui, en 1139 décrétera l’abolition de l’ancienne
pratique de la consécration des vierges en proclamant : « Envers cette habitude pernicieuse et détestable de
certaines femmes qui, bien qu’elles ne vivent ni sous la règle de saint Benoît, ni de Basile, ni d’Augustin,
souhaitent cependant être tenues publiquement pour saintes moniales, nous décidons de l’abolir. »324
Pourtant, le symbole de la moniale comme l’épouse du Christ subsistera dans l’époque médiévale,
même si les consécrations des vierges étaient devenues extrêmement rares. Tout au long de cette période,
l’hiérarchie considérait le couvent comme la demeure appropriée pour la femme professée car la clôture
constituait un rempart pour « la conservation de (sa) pureté »325
. Hourcade voit en cette mentalité une perte
du sens de la virginité de la femme, laquelle pour elle ne peut pas être séparé d’une certaine liberté et
indépendance consonantes avec une vie menée au cœur du monde. Ce ne serait que dans la deuxième moitié
du 19ème
siècle que la consécration des vierges sera réadmise, mais seulement pour les moniales cloîtrées.
L’Église aurait à attendre l’aggiornamento amené par Vatican II avant que l’ancienne tradition de la
consécration des vierges vivant en dehors de communautés religieuses soit restaurée.
4. LE NOUVEL ORDO DE LA CONSÉCRATION DES VIERGES
4.1 La restauration de la consécration des vierges
Promulgué dans l’esprit du renouvèlement forgé par le Concile Vatican II, l’Ordo virginium du 31
mai 1970 simplifie et élargit le rite de la consécration des vierges pour ainsi inclure des femmes vivant
seules dans le monde. Hourcade témoigne que « cela mettait fin à une législation très sévère, et ramenait le
rite de la consécration des vierges à une situation à celle des vierges consacrées de l’Église primitive »326
.
Au-delà de la restauration de ce rite, le canon 604 §2 du nouveau Code de Droit Canon de 1983 légalise la
vocation des vierges consacrées en spécifiant : « À ces formes de vie consacrée (celles avec les trois vœux)
s’ajoute l’ordre des vierges qui, exprimant le propos sacre de suivre le Christ de plus près, sont consacrées à
Dieu par l’évêque diocésain selon le rite liturgique approuvé, épousent mystiquement le Christ Fils de Dieu
et sont vouées au service de l’Église. » 327
Tout comme dans l’Église primitive, les vierges consacrées ne
sont tenues qu’à garder le saint propos (propositum) de la virginité en vertu de leur union mystique avec
321
Cf. Idem, p. 49. 322
Idem, p. 50. 323
Idem, p. 53. 324
Ibidem. 325
Ibidem. 326
Idem, p. 57. 327
Idem, p. 62.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 99
l’Époux. Cet état de vie n’implique aucune fonction ecclésiastique officielle, sauf ce qui leur serait confié
par l’évêque diocésain ou ce qui pourrait être confié aux fidèles « ordinaires ».
Hourcade soutient que la réapparition de l’ordre des vierges met en relief que « le véritable ministère
de la femme est bien la virginité consacrée »328
. Le fait que les vierges consacrées existaient partout dans le
monde chrétien dès le début et que l’Église a toujours été plus à l’aise avec la vocation de la vierge par
rapport à celle des diaconesses ou des veuves confirment cet argument. L’Église contemporaine, en
restaurant ce rite et en l’élargissant aux vierges vivant seules en plein monde confirme la précellence
toujours accordée à la virginité comme la véritable vocation de la femme chrétienne et ainsi propose aux
femmes une voie authentique de libération dans la société moderne. L’auteur explicite :
Cette situation de la vierge consacrée en plein monde répond donc à ce que l’on
entend généralement par laïc (…) Les vierges consacrées ne prononcent pas de vœux,
(…) n’ont pas de règles et enfin elles ne doivent pas obéissance à une supérieure.
Elles ne sont pas encadrées par une institution, comme cela se passe pour les instituts
séculiers329
.
Ces vierges vouées pleinement à Dieu et vivant pleinement dans le monde redécouvrent et revivifient la
forme originelle de la vie consacrée féminine de l’Église primitive330
.
4.2 La spiritualité de la vierge consacrée
La vierge consacrée est « totalement laïque et totalement livrée »331
. La vocation des vierges
consacrées n’est pas un simple retour au passé, mais plutôt un chemin tout à fait approprié pour la femme
chrétienne moderne. Houcarde explique :
De nos jours, il y a une convergence de conditions historiques exceptionnellement
favorables à la vie des femmes laïques consacrées dans le monde : l’évolution du
monde féminin confie à la femme, avec des professions de plus en plus reconnues,
des responsabilités de plus en plus étendues. D’autre part, la société actuelle, avec la
désagrégation de la famille patriarcale, multiplie l’existence des femmes vivant
seules332
.
La banalisation de la sexualité et la déchristianisation des sociétés occidentales exigent un témoignage
profond et contre-culturel au milieu de la société. En même temps, la forte baisse de vocations à la vie
religieuse requiert une certaine souplesse et innovation dans la manière de concevoir et assumer la vie
consacrée.
C’est justement la virginité consacrée qui répond à ces besoins actuels, indique Hourcade. La vierge
consacrée, puisqu’elle n’est pas encadrée par un institut, est censée assumer son état de vie de façon
personnelle, responsable et libre. Vivant en plein monde, les vierges consacrées sont pleinement laïques
« dans la réalité de leur vie qui garde les mêmes activités, les mêmes soucis, la même insécurité, les mêmes
responsabilités, les mêmes manières d’être que celle de tout le monde »333
. Toujours liée à l’évêque, elles
mènent une vie de prière et de service, alimentée par les célébrations eucharistiques de la communauté. Le
monde et ses réalités deviennent un lieu privilégié pour rester en communion avec ses frères et sœurs. Ainsi,
les vierges consacrées sont « pleinement humaines pour rester près des hommes et les présenter à Dieu, mais
en même temps totalement données à Dieu pour le transmettre à leurs frères »334
.
4.3 La vierge consacrée, femme libérée pour le service de l’Église
328
Idem, p. 58. 329
Idem, p. 59-60. 330
Cf. Idem, p. 63. 331
Une formule prononcée par le cardinal Guyot lors d’une consécration d’une vierge en 1974, dans Janine HOURCADE, op. cit.,
p. 66. 332
Idem, p. 65-66. 333
Idem, p. 69. 334
Ibidem.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 100
Le don libre et total de soi à l’autre présuppose une attitude positive et désintéressée. Jean Paul II,
dans sa lettre apostolique Mulieris Dignitatem approfondit le sens du « oui » de la femme qui se consacre à
Dieu dans la virginité :
On ne peut pas comparer cela au simple fait de rester célibataire, parce que la
virginité ne se limite pas au seul « non », mais elle comporte un « oui » profond dans
l’ordre sponsal : le don de soi pour aimer de manière totale et sans partage335
.
En s’offrant à Dieu comme l’épouse de son Fils par un « oui » d’abandon total, la vierge engage la
dimension tout à fait intime et féminine de sa sexualité.
La vierge consacrée qui assume son état de vie comme une vraie épouse du Christ et qui vit en plein
monde est bien une femme libérée dans la société actuelle tout comme elle l’était dans l’antiquité. Cette
consécration affirme son autonomie de décision, l’aide à sortir de la subordination de l’homme et actualise
sa liberté personnelle, tout en défiant la société actuelle par son témoignage prophétique. Hourcade avoue
que cet état de vie n’est pas pour de « femmelettes fragiles et frustrées »336
. Par conséquent, Hourcade lance
deux questions phares : « Quoi de plus libéré qu’une femme seule, ayant choisi sa solitude, assumant avec
une totale indépendance une vie laïque avec toutes les responsabilités professionnelles et matérielles qu’elle
comporte ? N’y a-t-il pas là de quoi faire pâlir d’envie nos féministes les plus impénitentes ? »337
L’amour
sponsal de la vierge consacrée la rend éminemment disponible au service de ses frères et sœurs et donne un
sens plénier à sa relation avec Dieu. Ainsi, c’est justement au sein de l’Église, aujourd’hui comme hier, que
la femme trouve sa vraie libération, son plein épanouissement féminin et la réalisation de ses aspirations
spirituelles et sociales les plus profondes. Ceci étant le cas, l’Église est loin d’être misogyne.
5. ÉVALUATION CRITIQUE En guise d’évaluation critique de l’ouvrage L’Église est-elle misogyne ? nous pouvons apprécier le
souci de l’auteur, qui elle-même s’est consacrée à Dieu dans la virginité338
, de récupérer cette ancienne
tradition de la virginité consacrée et la présenter comme le véritable ministère de la femme dans l’Église. À
vrai dire, il semble juste que la virginité comporte un caractère plutôt féminin que masculin. De surcroît, ses
raisonnements sont tout à fait concordants avec le discours officiel de l’Église suite au Concile Vatican II.
La restauration du rite de la consécration des vierges et son extension à celles qui vivent seules en plein
monde correspondent au désir des pères conciliaires de redécouvrir des traditions de l’Église primitive qui
pourraient répondre aux aspirations des fidèles dans la modernité.
En même temps la vocation de la vierge consacrée nous aide à comprendre qu’en fait, l’Église est
elle-même vierge et éminemment féminine. La présence et la valorisation des vierges consacrées au sein de
la communauté renforcent l’identité spécifique et féminine de l’Église qui est à la fois l’Épouse du Christ et
notre Mère. Si des vierges consacrées parviennent à assumer leur vocation saintement au centre de la
communauté chrétienne, cela ne pourra qu’amener une rénovation de l’image patriarcale de l’Église
institutionnelle qui porte rarement un visage doux et tendre à l’instar de la femme.
Mais une des défaillances de l’argument de Hourcade est que cette vocation paraît plus adaptée à la
femme vivant en Occident où beaucoup mènent déjà des vies indépendantes en dehors de la structure
familiale et avec des qualifications professionnelles qui favorisent un travail bien rémunéré. Les sociétés
occidentales ont déjà fait leur paix avec l’existence de la femme célibataire et professionnelle. Cela ne
surprend plus de voir une femme pleinement réalisée dans son travail professionnel et ses engagements
sociaux même si elle n’a pas forcement de mari et d’enfants. À ce genre de femme, la vocation de la vierge
consacrée pourrait convenir. Cependant, dans d’autres contextes culturels, en Afrique par exemple, la
question se pose : cet état de vie serait-il accepté de la même manière ? Si la réponse est négative, comment
pourrions-nous dire que cette vocation-ci constitue le véritable ministère de la femme dans l’Église et la voie
authentique de son épanouissement féminin ? Un « ministère » qui ne correspond pas aux aspirations de
toute femme serait difficilement affirmé comme tel s’il néglige une vaste proportion des femmes chrétiennes
335
JEAN PAUL II, Mulieris Dignitatem. La dignité de la femme et sa vocation, Paris, Éditions du Cerf, 1988, n0 20.
336 Idem, p. 97.
337 Idem, p. 90.
338 Cf. Idem, p. 65.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 101
non-occidentales. Dans certaines de ces cultures, les liens familiaux combinés avec l’aspiration personnelle
de se marier et d’avoir des enfants sont toujours intégrales à l’épanouissement de la femme et sa réussite
dans la société. Dans cette optique, l’argument de Hourcade semble fortement limité à l’Occident qui a déjà
intériorisé un changement de valeurs par rapport à la place de la femme dans la société.
Puis, la vocation de la vierge consacrée est-elle un « état de vie » ou un « ministère », deux termes
que Hourcade emploie de manière interchangeable ? À notre avis, cette vocation semble correspondre plutôt
à un état de vie. Bien qu’elle soit instituée par un rite liturgique, le rôle spécifique de la vierge consacrée
reste ambigu. Si Hourcade a comparé la situation de la vierge consacrée à celle du diaconat permanant non
marié de l’homme, on se demande quel serait l’empêchement à ce que la vierge consacrée remplisse les
mêmes fonctions ecclésiastiques ? Comme c’est vécu actuellement, la vocation de la vierge consacrée ne
semble pas comporter une fonction ministérielle différente de celle qui est déjà à la portée de toute femme
engagée à la vie de l’Église.
Enfin, nous restons assoiffés quant à la raison pour laquelle une religieuse vivant sa vocation selon
les trois conseils évangéliques dans une communauté ne pourrait pas parvenir à un vrai épanouissement de
sa féminité et une authentique libération. Est-ce que l’histoire ne nous a pas montré autrement à travers les
vies des nombreuses saintes moniales et missionnaires comme Catherine de Sienne, Thérèse de Lisieux et
Mère Theresa de Calcutta entre autres ? Ne pourrions-nous pas dire que ces femmes nous ont laissé un
témoignage de foi et de vie chrétienne aussi rayonnante et libérée que celles des saintes vierges de
l’antiquité ? Or, tandis que la vocation de la vierge consacrée est certainement louable et ancienne,
prétendre qu’elle représente le véritable ministère de la femme dans l’Église semble s’approcher de
l’exagération.
CONCLUSION L’Église est-elle misogyne ? Selon Janine Hourcade la réponse est sûrement négative. Pour elle,
c’est bien l’Église qui offre la voie authentique de la vraie libération de la femme. Bien fondée dans
l’Écriture, la vocation de la vierge consacrée permet à la femme de parvenir au plein épanouissement de sa
féminité dans un don total et désintéressé d’amour sponsal au Christ. Ce don de soi est reconnu de manière
officielle par l’Église par un rite de consécration tout comme il l’était dans les premiers siècles du
christianisme. La vierge consacrée assume sa vocation en plein monde, libérée de la structure
institutionnelle des congrégations religieuses traditionnelles. Vivant et travaillant parmi ses frères et sœurs,
elle est « totalement laïque et totalement livrée », et mène une vocation prophétique dans un monde où la
sexualité a perdu toute référence. Cependant, quelques questions demeurent : est-ce que cette vocation
répond aux aspirations des toutes les femmes chrétiennes du monde entier ? Combien de femmes seraient
réellement attirées à l’assumer ? Est-elle un véritable ministère ecclésiastique ? Le fait que l’Église
continue à proposer à la femme une vocation qui la place toujours en dehors du sanctuaire n’est-il pas un
indice au moins d’une certaine exclusivité masculine, pour ne pas invoquer le terme « misogynie » ? La
discussion se poursuivra.
Par Paul Reilly
3.2.7 EXPOSE 7 : LA PAUVRETE ET LA MATERNITE PAR MARY AMBA UDUYOYE AND
DIEU-MERE PAR SALLIE MACFAGUE
INTRODUCTION
Mary Amba Oduyoye, dans son article : « Pauvreté et Maternité », explique pourquoi en Afrique
subsaharienne, les mamans, malgré leur lourde tâche dans les foyers et dans la société (nourrir, soigner et
protéger les enfants) sont les plus touchées par la pauvreté. Amba donne son témoignage concret de la réalité
qui appauvrit les mères. Son témoignage s’inspire d’un cas vécu dans une ethnie spécifique, mais qui est
analogue à celle de beaucoup de femmes africaines.
1.
Mary Amba Oduyoye est une Ghanéenne méthodiste de l’ethnie Akan. Les Akans sont matriarcaux,
c’est-à-dire qu’ils attribuent un rôle prépondérant à la femme et à la mère. Elle est l’aînée d’une famille de
neuf enfants. Elle est mariée mais sans enfant biologique. Toutefois, en tant qu’aînée, elle sait ce que
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 102
signifie la ‘maternité’ car elle accompagnait sa maman tout au long de sa maternité. Chez les Akan, la vie
communautaire prime sur celle de l’individu. Les enfants appartiennent à la famille et à l’ensemble de la
communauté. Les joies et les peines d’une personne sont partagées par toute la communauté. Elle se sent
considérée parce qu’elle a une communauté dans laquelle elle tient une place particulière. Voilà pourquoi
elle dit : « Je ne suis pas mère mais j’ai des enfants »339
.
Notre travail consistera donc à donner un résumé de cet article et puis donner notre point de vu vis-à-
vis de cet article.
1. LA PAUVRETE ET LA MATERNITE
Elle présente son témoignage dans quatre volets à savoir : la maternité pénalisée, l’appauvrissement
des femmes, l’enfant appartient à la mère et l’économie de Dieu.
1.1 La maternité pénalisée
Selon Amba, les changements économiques en Afrique sont à la base de la pénalisation de la
maternité. Car, explique-t-elle, ces changements nous ont apporté premièrement l’individualisme et la
compétition qui détruisent l’aspect communautaire de la société Akan. Les enfants n’appartiennent plus à la
famille et à l’ensemble de la communauté ce qui fait qu’être pauvre devient la conséquence d’engendrer340
.
Ces changements économiques nous ont aussi apporté l’idée de l’adoption. L’adoption considère la
femme comme « femme seule » alors que sa maison est pleine des êtres humains à élever, à éduquer et à
aimer. L’idée androcentriques d’adoption refuse à reconnaître les mères le titre de chef de famille ; d’où les
surnoms de mères seules, ‘single mothers’, pour dire qu’en restant single mothers, les femmes transgressent
la norme de soumission à l’autorité masculine341
. Cette mentalité est étrange à l’Afrique, puisqu’il n’y a pas
de parent seul, homme ou femme. Ils sont tous membres de la famille. Par ailleurs, il y a des foyers où les
conjoints sont séparés pour des raisons de travail ou d’autres facteurs comme la guerre. Ceci mène les
femmes à élever seules les enfants.
1.2 L’appauvrissement des femmes
Le manque de pouvoir et de savoir chez les femmes les rend pauvres et vulnérables. Il est impossible
pour elles d’influer sur les décisions qui conditionnent leur vie. Cela maintient les femmes dans l’ignorance
et la dépendance. Elles ignorent les arrangements politiques, militaires et économiques et la manière de
parvenir aux instances qui statuent342
. Elles ignorent également les effets secondaires des produits
pharmaceutiques qu’on leur prescrit. Elles sont traitées comme des objets dans les recherches de la
biotechnologie par exemple, la reproduction in vitro343
. Ce manque de pouvoir et de savoir fait qu’on les
exploite dans les domaines agricoles et industrielles sans les payer ou en les payant de façon insignifiante.
Les exigences culturelles traditionnelles privent les femmes de leur dignité. C’est pour cela qu’Amba
est contre ceux qui disent que les cultures africaines accordent de la valeur aux femmes. Pour elle, il n’y a
aucune valeur, car cette pensée est peut-être liée à la chrétienté occidentale, à l’Islam et aux cultures arabo-
africaines qui les encouragent à être des bonne mères, dociles et soumises à leur mari344
.
1.3 L’enfant appartient à la mère
L’enfant appartient à la mère, ce n’est qu’après la naissance que l’enfant appartient à la communauté.
Celle-ci, à travers les tabous, aide et protège la future mère et l’enfant, lui assure un accouchement sans
danger ainsi que sa santé. Cette ancienne sagesse n’a pas pu être transformée en termes socio-économique et
technologique entraînant ainsi la marginalisation des mères. Les systèmes économiques mettent le « profit
avant les gens et les intérêts avant la production»345
c’est-à-dire que, dans la hiérarchie des besoins humains,
339
Mary Amba ODUYOYE, « la maternité : expérience, institution et théologie » in Concilium n° 226, Paris, Beauchesne, 1989,
p. 30. 340
Cf. Idem, p. 31. 341
Cf. Idem, p. 32. 342
Cf. Idem, p. 33. 343
Cf. Idem, p. 34. 344
Cf. Ibidem. 345
Idem, p. 35.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 103
la maternité ou la reproduction n’est pas prioritaire. Les états et les institutions n’arrivent pas à humaniser
l’économie pour une communauté humaine, pourtant, les mères continuent à procurer les soins maternels à
la race humaine malgré leur condition.
1.4 L’économie de Dieu
Dieu a créé les ressources de la terre et Il a établi l’interdépendance de toute la création. Il n’y avait
pas d’exploitation : « nul n’était ou ne se sentait exploité »346
. De nos jours, la gestion économique de la
terre ne se soucie plus de la nature, du bien-être de l’homme et ainsi du confort de la mère au-delà de ses
besoins de génitrice. Pour Mme Amba, c’est une injustice envers elles car cela signifie que les mères ne sont
humaines que dans la mesure où elles remplissent la fonction biologique d’enfanter347
. L’exploitation
indécente de la terre est une injustice non seulement aux mères, mais aussi envers la génération à avenir.
Les mères en Afrique sont également appauvries par des règles de l’organisation de l’économie
mondiale. Par ici, Amba nous indique que les prescriptions de la Banque mondiale et du Fond monétaire
International sont exigeantes pour les pays pauvres. Ceux-ci sont contraints à s’adapter à ces prescriptions
d’exportation. Pour exporter davantage vers les pays riches, les pays pauvres s’emparent de la terre de
pauvres surtout des femmes pour planter ce dont le nord a besoin et non ce dont le sud a besoin pour se
nourrir.
2. CRITIQUE SUR L'ARTICLE « PAUVRETE ET MATERNITE »
Après avoir présenté un résumé de l’article « pauvreté et maternité », nous donnerons dans les lignes
qui suivent les points forts et faibles de la pensée de Mary Amba Oduyoye.
2.1 Les forces
Il est vrai que le manque de pouvoir et de savoir ne rend pas les femmes heureuses et épanouies.
L’idée de l’éducation est pertinente car, ce n’est que par elle que l’être humain peut s’épanouir. Je pense
qu’en éduquant (en instruisant), on responsabilise les femmes. Elles arriveront à prendre les décisions qui les
concernent pour le bien des enfants, de la famille et de la communauté toute entière. Elles parviendront à
réclamer et à faire valoir leurs droits et leur dignité. Vu que la femme tient l’économie de base en Afrique,
son développement serait un atout pour la société entière. L’éducation contribuera également à changer la
place que les traditions africaines, le Christianisme et l’Islam attribuent aux femmes.
La stabilité favorise un bon système socio-politique et économique basé sur la conception maternelle,
mieux dit, dans lequel tous les citoyens sont pleinement humains et se soucient d’eux-mêmes, des autres et
de l’environnement. Ces facteurs sont nécessaires pour le développement socio-économico-politique. Si une
nation agit comme une mère en donnant la première place, dans le budget national, à l’éducation, la santé et
au bien-être des enfants, les mères contribueront activement au développement de la nation. Le
développement économique, y compris ses valeurs, doit s’adapter aux valeurs positives africaines, l’aspect
communautaire par exemple. Il est vrai que l'économie antinataliste (l'absence délibérée d'enfant) n'est pas
une solution.
2.2 Les faiblesses
Je pense que le développement socio-économique et technologique ainsi que la mondialisation
influencent nos cultures. Les facteurs modernes sont inévitables et nécessaires pour améliorer les conditions
de vie (par exemple en améliorant les secteurs agricole et sanitaire, de transport et d’éducation).
L’investissement étranger est important pour le développement en Afrique quand bien même les salaires
seraient insignifiants. Je pense que les racines d’appauvrissement des mères en Afrique se trouvent surtout
dans les traditions africaines que dans les cultures occidentales matérialistes. Il nous faut avoir un regard
plus large à savoir la socialisation des femmes au sein de nos traditions.
CONCLUSION
346
Idem, p. 36. 347
Cf. Ibidem.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 104
Notre parcours à travers l’article « Pauvreté et Maternité », nous fait constater qu’il est temps de
revoir la place des femmes dans nos pays africains et émergeants. Nous sentons le besoin d’aider les femmes
dans leur processus vers l’émancipation tangible en créant les conditions nécessaires pour leur
épanouissement. Elles ont besoin de l’éducation, du savoir qui leur permettra de s’engager pleinement dans
le développement de leurs pays. Les états et les institutions sont appelés à trouver les moyens concrets pour
‘maternaliser’ la communauté humaine. En développant la femme on développe la famille et par là on
développe le pays, les religions et les communautés respectifs. L’article nous invite, non seulement à
honorer les mères mais à s’engager pour qu’elles soient émancipées. Cela aidera les femmes à être non
seulement des bonnes mères mais aussi des actrices du développement économique en Afrique.
INTRODUCTION
Le comportement de beaucoup de chrétiens est influencé par la représentation imaginaire de Dieu et
de la relation entre Dieu et le monde. L’image la plus ancienne et la plus forte est celle de la métaphore
parentale. Dans la tradition chrétienne, un seul parent a été retenu, le père, pour donner une image de Dieu.
Cette image d’un Dieu paternelle présente Dieu comme chef dominateur, roi ou maître de la famille. Cela
influence l’homme à tous les niveaux. Toute organisation familiale et sociale prend cette forme paternelle où
l’homme est le chef autoritaire. Autrement dit, le langage et la mode de la pensée patriarcale est une
fondation à partir de laquelle les constructions sociales se sont construites en faveur de l’homme. La
conception d’un Dieu-chef et dominateur a également fait naître les autres dualismes hiérarchiques tels
que : masculin/féminin, divin/humain, riche/pauvre, chrétien/non-chrétien. Selon cette conception, l’homme
est supérieur à la femme et du reste de la création. C’est cette image masculine qui explique l’exploitation
des femmes et de la terre. Une telle conception, conduit à l’exploitation de la catégorie supposée inférieure.
Mais alors comment concilier cette vision dominante de Dieu à un Dieu tendresse ?
Sallie Macfague, dans son article, « Dieu Mère », cherche à donner des pistes qui suggèrent une autre
image de Dieu dans la conception des humains qui, sans doute, changera les relations entre l’homme et la
femme et entre l’homme et la nature. Pour Sallie, la métaphore ou le modem de « Dieu mère »348
est une
vision qui aidera à décentrer le modèle patriarcal. Elle croit que ce déplacement de modèle aidera à ré-
contextualiser le modèle paternel dans le sens parental, contrairement à sa direction patriarcale traditionnelle
qui présente Dieu roi, maître et Seigneur. Cela, elle explique, n’est pas du tout pour inverser les rôles et
établir un nouveau dualisme hiérarchique avec un modèle matriarcal de Dieu. Son intention est plutôt
d’examiner une source d’expression riche pour expliquer une relation d’amour de Dieu envers sa création
qui se traduit par une interdépendance et une solidarité en vers toute la création.
L’hypothèse est que la conception de ‘Dieu mère’ renforce une relation mutuelle de tous les vivants
où la dignité de tous et le respect de la création priment. Cela nous aidera à faire face à la détérioration
écologique et l’holocauste nucléaire qui accompagnent la mondialisation. Pour Sallie, le modèle de Dieu
comme mère de la terre et de tous les êtres encouragera fortement une sensibilité fondée sur les réalités de
l’existence mutuelle.
Pour expliquer ce modèle « Dieu Mère », elle fixe son attention sur les choses les plus fondamentales
que font les femmes en tant que mères. Les mères humaines (1) donnent naissance à des jeunes, (2) les
nourrissent et les protègent, (3) elles désirent que les jeunes s’accomplissent. Cette nature de mères
correspond directement à la nature même de Dieu. Attention, l’usage de la langue maternelle peut être
dangereux et opprimant. Lorsqu’elle suppose que celles qui n’ont pas d’enfants ne sont pas de femmes
accomplies et leur donne un unique rôle d’enfanter.
1. DIEU MERE
Les mères sont fondamentalement impliquées dans l’acte physique de donner naissance, d’entretenir
la vie, et de veiller à l’accomplissement de cette vie.
1.1 L’acte physique de donner naissance
348
Sallie McFAGUE, « Dieu Mère », in Concilium, Revue international de Théologie, n° 226,1989, p. 166.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 105
Dieu, comme donateur de vie, peut être bien imaginé à travers la métaphore de la mère et du père.
Pour Sallie, l’amour parental est une expérience la plus forte de l’amour qui se donne sans « calcul, sans
escompter d’amour en retour. »349
L’amour parental se traduit dans le don de vie aux autres. Le modèle Dieu
mère trouve sa force dans l’acte physique de donner la vie. Puisque par cet acte, les mères rejoignent le
« réservoir des grands symboles de la vie et de la continuité de la vie : le sang, l’eau, le souffle, le sexe et la
nourriture. »350
Ces symboles sont tous impliqués dans l’acte de la conception, la gestion et la naissance.
Le modèle de Dieu mère nous inspire d’une création différente dans laquelle la dépendance radicale
de toute chose par rapport à Dieu est vivement soulignée. Cela veut dire que la mère nous offre les
meilleures chances de concevoir la création comme issu de l’être divin, et comprendre le monde étant en
Dieu. Puisque une telle vision de la gestation, de l’accouchement et d’allaitement de la mère, donne une
image qui indique que la création dépende de Dieu et elle est soignée par Lui351
. L’effet de donner
naissance, de porter et de contenir la vie, présente l’image de Dieu mère en qui toute vie trouve sa cause.
Tous, sans distinction, nous avons eu le sein maternel pour première demeure ; nous sommes tous nés d’une
mère et nous fûmes nourris par une mère. C’est une image qui exprime la dépendance totale de toute la
création en Dieu.
1.2 L’entretien de la vie
Ce sont des parents qui prennent soin de leurs enfants, les permettant ainsi de devenir les humains
indépendants. Ce sont eux qui nourrissent les jeunes pour assurer l’existence d’une nouvelle vie. Les parents
ne désirent que la continuité de la vie. Ce désire, dans la grande partie du monde, est une lutte épouvantable
et quotidienne à laquelle les parents font face puisqu’ils n’ont pas d’aliment nécessaire pour les nourrir352
.
L’effet que les parents se donnent pour nourrir leurs enfants, malgré les difficultés qu’ils rencontrent, donne
une image forte qui exprime le don de vie que les parents désirent accomplir.
Le souci alimentaire a une grande centralité dans la tradition chrétienne. Jésus nourrissait les foules,
il mangeait avec les pécheurs jusqu’au repas eucharistique, notre sacrement de prédilection. Mais, Sallie
observe que l’Église a trop spiritualisé l’imagerie alimentaire, oubliant ainsi à prendre au sérieux la nécessité
physique de la nourriture. Pour elle, adoptant le modèle maternel de Dieu, cette idée signifierait
«la restauration de la nourriture comme une nécessité pour tous les enfants de Dieu »353
.Cette image d’un
Dieu mère entraîner à une théologie qui voit en Dieu le père et la mère qui nourrissent les jeunes, les faibles,
et les vulnérables. L’image Dieu mère nous aidera à comprendre Dieu comme celui qui se souci des besoins
les plus essentiels de la vie pour assurer la continuité de la vie. Elle souligne également que le modèle
maternel implique directement l’éthique de justice qui dit qu’il faut que tous les enfants soient nourris.
1.3 L’épanouissement et l’accomplissement de la vie
Une mère désire que ses enfants croissent, s’épanouissent et deviennent adultes. De même, « Dieu,
en tant que mère, veut que tous s’épanouissent »354
. Toute existence (les êtres et l’écosystème) a Dieu pour
mère qui le soutient. Le Dieu mère est infiniment impartial et universel contrairement aux humains qui sont
partiaux et sélectifs. Dieu mère entretient sa création et veille à son accomplissement et à sa croissance ainsi
qu’à son bien-être.
Cela met en cause notre vision du monde (anthropocentrique) qui nous fait voir le reste de la création
comme des instruments à notre usage. Pour Sallie, il nous faut adopter un point de vue théocentrique
puisque la mère créatrice de tout, aime toute la création.
Par ici, Sallie voit également Dieu mère comme juge de tous. En tant que juge, « Dieu mère juge ceux qui
font obstacle à l’entretien et à l’accomplissement de sa création bien aimée »355
.
349
Idem, p. 167. 350
Ibidem. 351
Cf.Ibidem. 352
Cf.Sallie McFAGUE, « Dieu Mère », p. 169. 353
Ibidem. 354
Ibidem. 355
Sallie McFAGUE, « Dieu Mère », Idem, p. 170.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 106
Dieu mère est donc irrité par l’effet que certains êtres créés désirent tout pour eux-mêmes et ne voient pas la
valeur intrinsèque des autres êtres. Avec cette conception, le péché est donc un refus de faire partie d’un
ensemble écologique dont «le maintien dans l’existence et le succès dépendent de la reconnaissance, de
l’interdépendance et de la corrélation de toutes les espèces »356
. La mère divine est donc la créatrice de tout
et s’implique dans la gestion et assure une juste distribution des biens pour tous les êtres.
2. ANALYSE CRITIQUE DE LA PENSEE DE SALLIE McFAGUE
Apres avoir résumé l’article sur « Dieu Mère », nous contribution portera sur deux appréciations :
d’une part, nous relèverons les points positifs et de l’autre, les points négatifs.
2.1 Les points positifs
Sallie Mcfague a bien souligné l’importance du changement de la conception d’un Dieu masculin à
un Dieu féminin. En effet, Le modèle ‘Dieu mère’ renverse le dualisme hiérarchique du masculin et du
féminin sans créer une autre hiérarchie. L’égalité des êtres humains sera assurée et la création ne sera plus
considérée comme un événement intellectuel et artistique, mais comme un événement physique issu de
Dieu. Il est utérus d’où procède tout, Il entretient et veille sur l’accomplissement de toute créature. De la
même importance, l’image de Dieu mère oblige, en quelque sorte, l’homme à ne plus considérer la création
comme l’instrument pour ses fins égoïstes car toutes les espèces ont une valeur intrinsèque devant Dieu
mère. L’idée de combattre l’exploitation de la terre est pertinente. La métaphore parentale maternelle est
juste pour développer une conscience profonde de la vulnérabilité de la vie reçue, surtout de notre terre.
Dieu mère nous invite, en retour, à entretenir l’écosystème. Une telle vision est centrale dans le contexte
contemporain et elle est bienvenue. L’image de Dieu mère élève, en changeant la conception, le statut des
femmes qui deviennent incontournable dans le projet de Dieu pour l’accomplissement de la création. Cette
prise de conscience aide l’humanité à reconnaitre chez les femmes la lourde charge d’assurer la continuité de
la vie souvent dans des conditions difficiles.
2.2 Les points faibles
Le modèle de Dieu mère peut poser un problème au niveau de la relation entre les êtres humains dans
leur relation avec Dieu. Cela peut arriver si on n’emploie que le modèle parental (maternel ou paternel) pour
designer Dieu. Cette image, en conséquence, nous place toujours dans le rôle d’enfants. L’enfant attend que
ses parents prennent soin de lui et subviennent à ses besoins. Le monde d’aujourd’hui a besoin des êtres
adultes qui prennent la responsabilité de protéger et d’assurer le bien-être de l’humanité et de l’écosystème.
Il est de la responsabilité de chacun de nous de s’engager pour éradiquer la pauvreté, la discrimination, et la
détérioration de l’écosystème.
L’image maternelle exagère en présupposant que toutes les mères sont naturellement aimantes,
réconfortantes et portées à se sacrifier. Cela donne une belle image de Dieu mais ce n’est pas toutes les
femmes qui ont ces qualités. Ensuite, la création est faite ex nihilo. Dieu ne crée pas à partir de quelques
éléments préexistants comme une femme engendre un enfant. Et considérer Dieu comme une femme qui
prend soin de son enfant, c’est réduire la capacité de l’être humain à travailler pour se réaliser et
s’accomplir. De peur de réduire la responsabilité que Dieu confie à l’homme, l’homme doit se dépasser,
jouir de sa liberté et de son autonomie, à la différence de l’enfant qui dépend totalement de sa maman, pour
son accomplissement. Cette autonomie comme cette liberté sont toujours en vue du bien commun et non
pour un bien égoïste. Enfin, la femme n’est pas que celle qui donne vie, liée à la progéniture.
CONCLUSION
En dépit de ce qui vient d’être dit, nous nous rendons compte qu’à travers l’article « Dieu Mère », le
comportement de bien des gens est fortement influencé par la représentation imaginaire de Dieu et sa
relation avec le monde. Dieu mère, est une image forte qui met, dans l’esprit des femmes et des hommes
contemporains, la réalité de l’amour de Dieu sans discrimination ni oppression. Cette image d’un Dieu mère,
356
Ibidem.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 107
change notre vision de Dieu et ainsi nos relations entre humains et envers les autres créatures. Avec cette
nouvelle image, peut-on dire, les femmes ont droit à un traitement digne au genre humain dans la société et
dans l’Église. L’image de Dieu mère assurera la réduction des menaces de notre planète puisque cette image
met en exergue que toute vie sur la planète est radicalement dépendante des autres créatures. Cela nous
conduira à un juste partage des biens nécessaires et élémentaires à la vie.
Par Paul Makambi KITHA
3.2.8 EXPOSE 8 : L’APPAUVRISSEMENT ECONOMIQUE DES MERES EST
L’ENRICHISSEMENT DES PERES PAR HANNELORE SCHRÖDER ET L’OPTION POUR LE
PAUVRE COMME OPTION POUR LA FEMME PAR IVONE GEBARA
INTRODUCTION
La question du rôle de la femme dans la société n’est pas un sujet récent. Depuis toujours, les débats
tournent autour de l’importance de la femme dans la société.
En effet, l’expérience humaine a toujours montré que tant dans l’Eglise que dans les sociétés, les
femmes bénéficient moins de certains privilèges. Elles sont très souvent défavorisées dans leurs milieux de
vie, voire considérées comme des sous-hommes. L’image de la femme est ternie ou reléguée au second rang.
Ce phénomène se retrouve presque dans toutes les couches sociales où la femme a peu d’importance par
rapport à l’homme. Ainsi naquit l’expression « théologie féministe ».
Pendant que la théologie féministe réclame le plein développement personnel de la femme avec
toutes les conséquences qui s’y rattachent dans la vie sociale, économique, politique et religieuse, elle se
heurte à des difficultés qui exposent constamment le rôle de la femme comme essence de la femme.
Une telle approche pose le problème suivant : Quelle est la place de la femme dans la société ? En
d’autres termes, que faut-il faire pour sauvegarder l’image de la femme dans nos sociétés ou dans nos
institutions ?
Dans leurs différents articles qui feront l’objet de notre exposé, Hannelore SCHRÖDER et Ivone
GEBARA abordent la question de la position de la femme dans la société. La première (Hannelore
SCHRÖDER) dénonce les formes d’injustice que subissent les femmes dans la plupart des sociétés. La
seconde (Ivone GEBARA) propose quelques pistes ou perspectives pour sauvegarder la dignité de la femme.
Hannelore SCHRÖDER naquit en Allemagne en 1935. Docteur en philosophie de l’Université de
Francfort, elle fit des études féministes aux Universités de Francfort, Göttingen et Hambourg et devint
maître des conférences et première enseignante d’études féministes à la faculté de philosophie de
l’Université d’Amsterdam. Elle a publié plusieurs ouvrages notamment La théorie féministe de la société en
1983, Les droits des personnes de sexe féminin en 2000.
Quant à Ivone GEBARA, elle vit le jour en 1944 à Sao Paulo au Brésil. Faisant partie des principaux
théologiens d’Amérique latine, elle est docteur en Philosophie de l’Université Catholique de Sao Paulo et en
Sciences religieuses de l’Université Catholique de Louvain. Elle a enseigné pendant plusieurs années à
l’Institut théologique de Recife jusqu’à sa fermeture décidée par le Vatican. Elle a également participé à la
période de la théologie de la libération.
Notre travail consistera dans un premier temps, à résumer l’article de Hannelore SCHRÖDER
intitulé : « L’appauvrissement économique des mères est l’enrichissement des pères ». Dans un second
temps, il sera aussi question de résumer l’article d’Ivone GEBARA intitulé : « L’option pour le pauvre
comme option pour la femme pauvre ». Une brève évaluation conclura chacune des deux parties de notre
exposé.
I. L’APPAUVRISSEMENT ECONOMIQUE DES MERES EST L’ENRICHISSEMENT DES PERES
(par Hannelore SCHRÖDER)
Il faut dire que le titre « L’appauvrissement économique des mères est l’enrichissement des pères »
selon Hannelore SCHRÖDER est le fait que les mères soient vues comme une classe des ouvrières sans
salaire par rapport aux hommes. Dans la plupart des sociétés, les femmes sont considérées comme des
esclaves. Pour aborder son thème, l’auteure élabore quatre points :
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 108
1.1 Données empiriques de l’appauvrissement des mères
Hannelore SCHRÖDER argumente cette première partie de son article en faisant allusion à une
évaluation faite par les Nations Unies en 1980. Cette rapport a montré que sur le plan mondial, ce sont les
femmes qui reçoivent un revenu mondial très maigre soit 10% malgré leur travail intense par rapport aux
hommes qui travaillent moins, et pourtant, ils ont un revenu mondial très considérable soit 90%. Ce qui
revient à dire que les femmes gagnent seulement un dixième du revenu mondial.
En effet, Hannelore SCHRÖDER fait remarquer dans cet article que depuis les années 60s le nombre
des femmes ne fait qu’augmenter. Plusieurs études d’ailleurs, montrent que leur nombre va sans cesse
croissant. D’après une statistique réalisée aux Etats-Unis, ce sont les femmes qui occupent la moitié de la
population mondiale. Et pourtant, elles constituent une classe des ouvrières sans salaire. Les données se
limitent aux familles à mère seule. Les mères qui ne vivent plus avec leurs maris, dans la plupart des cas,
font face à de multiples difficultés. Elles doivent avoir une qualification plus haute et travailler plus. Elles
ont, en réalité, un double travail à accomplir : De façon concomitante, elles doivent assumer leur
responsabilité de mères au sein de la famille et elles doivent aussi travailler pour assurer la survie de leurs
enfants. Ce qui revient à dire qu’avec un salaire misérable, les mères portent la charge financière des
enfants. Ainsi, elles tombent dans la misère, elles deviennent pauvres parce qu’elles sont mères. Elles n’ont
même pas de privilège économique. De leur côté, les pères disparaissent avec leur argent. Libérés de la
charge de la maison parce qu’ils n’ont pas d’enfants à entretenir, les pères jouissent calmement de leur haut
salaire. Ainsi les pères deviennent riches parce qu’ils sont pères. Force est de constater que d’un côté il y a
l’extrême pauvreté et de l’autre il y a la richesse puissante.
Dans la communauté économique européenne, 4 millions de familles à mère seule vivent dans la
pauvreté. Leur nombre augmente sans cesse. L’auteure ne manque pas signaler que c’est cette vie misérable
qui est à la base de la prostitution des femmes dans le monde. Les hommes peuvent acheter des femmes qui,
du coup, deviennent pour eux objet de plaisir sexuel.
1.2 Sur le rapport de l’ONU : le sexe, catégorie relevant premièrement de l’économie
Il est bien vrai que le travail apparait comme la seule source de toute richesse. Seul le travail peut
rendre l’être humain riche et il a droit à tout le fruit de son travail. Selon notre auteure, cette idée a poussé
les hommes à établir un principe de travail : celui de s’enrichir sur le travail accompli par les femmes.
L’enrichissement des pères se réalise aux dépens des mères. Plus les femmes travaillent, plus elles
deviennent pauvres. Et plus elles deviennent pauvres, plus riches et puissants deviennent les hommes. Dans
une telle relation, soutient l’auteure, le sexe féminin comme tel, devient le critère de la plus extrême
discrimination économique. Moins les hommes travaillent, plus ils deviennent riches. 1/3 de leur travail leur
rapporte 90% de revenu, ce qui les amène à devenir maîtres du monde. En ce sens, selon les termes de
Hannelore SCHRÖDER, ils sont considérés, comme des propriétaires du monde. Le travail double des
femmes est comme la source de la richesse des propriétaires du monde. Les femmes accomplissent un
double travail pour un dixième de salaire, ce qui les entraîne dans une extrême pauvreté. Elles travaillent
doublement, tandis que les hommes ne travaillent qu’à temps partiel. Pendant une grande partie de leur
temps, les hommes ne travaillent pas, ils laissent les femmes travailler pour eux. Les femmes deviennent
pauvres par leur grande charge de travail. Leur travail mène à la richesse des patriarches.
Ainsi, la forme patriarcale de la société de classes a fait de la femme un être inégal de droits,
subordonné à l’homme et dépendant de l’homme. Tant dans la société que dans la famille, les fonctions
accomplies par la femme sont considérées comme des fonctions de second ordre. Elles n’ont donc pas de
valeur.
Comme nous pouvons le constater, au processus d’appauvrissement, d’un côté, correspond un
processus d’enrichissement, de l’autre. Selon notre auteure, les non-travailleurs, bien entendu, les pères,
blessent à un degré extrême les droits humains des femmes. Car leur puissance repose sur le double travail
accompli par les femmes. D’où le refus de droit et l’impuissance politique des femmes, depuis des siècles
jusqu’à nos jours.
1.3 Les rapports de travail dans l’économie domestique
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 109
Selon les idées de SCHRÖDER, dans la plupart des sociétés et particulièrement en Allemagne, les
femmes sont le plus souvent considérées comme étant sous le pouvoir des patriarches. A la maison, les
patriarches dominent leurs femmes. Le rapport patriarches-femmes est d’abord un rapport de travail où les
hommes s’approprient exagérément tous les produits du travail de leurs femmes. C’est ce que l’auteur de
notre article appelle principe patriarcal de brigandage.
En effet, on a l’impression que ce sont les femmes qui vivent du travail des hommes. Or en réalité, ce
sont les patriarches qui vivent du travail des femmes. Ils exploitent les femmes au maximum. Non seulement
ils s’approprient leurs biens (leur salaire qui devrait leur appartenir) ils les épuisent aussi par des grossesses
annuelles, des naissances et de bien trop nombreux enfants. Et cet épuisement entraine le plus souvent la
mortalité en masse des mères et des enfants.
Au demeurant, le travail des femmes, puisqu’il n’est pas libre, n’apparaît pas comme un travail. Du
coup, l’image des femmes est réduite à rien. Elles ne sont pas considérées comme des êtres humains.
1.4 Postulats pour la recherche féministe en économie
Hannelore SCHRÖDER précise dans son article que les femmes jouent un rôle capital dans
l’économie. En ce sens, elles ne peuvent pas laisser aux hommes le domaine de l’économie. Mais le constat
est amer si l’on voit de près les conditions et les contraintes sous lesquelles les femmes travaillent. Encore
moins, elles n’ont pas les privilèges économiques et juridiques des pères de famille. Ainsi, elles deviennent
une classe d’esclaves domestiques, dominées par la classe des pères de famille. Ces conditions sont, depuis
longtemps, marquées par la souveraineté des pères dans l’économie domestique. Mais toutefois, l’auteure ne
manque pas d’insister sur l’apport de la femme dans le domaine de l’économie. Selon Hannelore
SCHRÖDER, les femmes ne doivent pas laisser aux hommes le domaine de l’économie. Compte tenu du fait
que les femmes n’ont pas les privilèges économiques et juridiques des pères de famille, il ne faut cependant
pas les ranger dans leurs classes. Une telle classification ne correspondrait pas à leur situation économique et
juridique réelle.
1.6 Evaluation de l’article de Hannelore SCHRÖDER
Avec un langage simple et accessible, Hannelore SCHRÖDER nous aide à comprendre les difficultés
que traversent les femmes dans la plupart de nos sociétés.
En effet, la spécialiste de la théologie féministe a pris la peine de nous livrer des informations sur
l’injustice sociale dont les femmes font l’objet. Elle soutient la part des femmes dont les droits sont bafoués.
Pour elle, les femmes qui en principe, constituent la base de toute vie de famille se voient négligées. Elles
sont considérées comme des esclaves. Son article vise à redonner à la femme sa dignité, ses droits. Car elle
ne fait que soutenir la part des femmes.
Par ailleurs, nous avons constaté dans cet article de Hannelore SCHRÖDER une certaine exagération
quant à sa position vis-à-vis des hommes. Son article est un document qui paraît révoltant parce qu’elle
s’attaque aux hommes. Il est bien vrai que, nombreux sont les hommes qui bafouent les droits de leurs
femmes en les traitant comme des esclaves ou comme des sous hommes. Mais il y en a aussi qui font preuve
de l’humanisme envers leurs femmes, ils ont du respect envers leurs femmes. Aussi, en jetant un regard
synoptique sur le monde d’aujourd’hui, il n’est pas rare de constater que les femmes bénéficient en même
que les hommes de certains privilèges. De nos jours, les femmes ont bien leur place sur la scène politique.
Parmi elles, il n’est pas aussi rare de trouver des hauts cadres, des dirigeantes et des militantes. L’œuvre de
Hannelore SCHRÖDER, finalement, est un document de référence parce qu’elle permet une claire vision sur
les situations difficiles que traversent les mères dans certaines sociétés. Cependant, cette œuvre est à
considérer avec beaucoup de recul. Car d’une certaine manière le thème de « l’appauvrissement
économique des mères est l’enrichissement des pères » ne présente qu’une image dégoutante de l’homme en
tant que responsable de famille.
II. L’OPTION POUR LE PAUVRE COMME OPTION POUR LA FEMME PAUVRE
(Par Ivone GEBARA)
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 110
Dans cet article intitulé : « L’option pour le pauvre comme option pour la femme », Ivone GEBARA
partage son expérience de l’annonce de l’Evangile aux pauvres et particulièrement aux femmes d’Amérique
latine.
En effet, l’option pour le pauvre, d’après notre auteure, traduit le fait que dans les différentes
cultures, le pauvre doit être vu comme celui à partir duquel quelque chose de nouveau doit naître. Aussi bien
dans l’Ancien Testament que dans le Nouveau, le concept « pauvre » a toujours eu un sens concret.
Aujourd’hui encore, la foi exige que dans nos relations les uns avec les autres, nous accordions une grande
place aux pauvres qui sont un groupe social dépourvu de biens matériels ou un groupe de personnes qui
cherchent une reconnaissance élémentaire dans la société. Dans ce groupe de personnes, on peut inclure les
femmes qui apparaissent comme des personnes sans voix.
2.1 L’option de la femme pour elle-même
Ivone GEVARA note dans cet article que le premier pas de la femme pour changer les différentes
structures mises sur place par les sociétés, c’est essentiellement l’option de la femme pour elle-même. Cette
question se situe au niveau de l’être profond de la femme-même, c’est-à-dire son for interne. Cet aspect est
très souvent négligé, alors qu’il est d’une importance capitale. La première démarche à faire, c’est que la
femme doit accepter la réalité d’être femme. Elle doit accepter sa condition de femme. Cela est une
démarche de conversion à soi, car les femmes ont intérêt à faire un pas intérieur vers elles-mêmes. C’est en
fait, l’acceptation profonde de la merveille de son être, de son corps, de sa pensée. Pour l’auteure, travailler
l’intérieur veut dire que les femmes doivent combattre de l’intérieur les fausses images qu’elles ont d’elles-
mêmes. C’est seulement cet effort de conversion qui peut faire d’elles des créatures nouvelles, c’est-à-dire
des femmes capables de s’accepter et de s’accueillir simplement comme femmes. Tout se passe donc au
niveau de l’être intérieur. C’est pourquoi selon Ivone GEBARA, l’être profond ou l’être intérieur est
différent de l’être extérieur. Et c’est au niveau de l’être profond que se situe le vrai combat. Certaines
femmes vivent dans une certaine dichotomie, un manque d’unité entre l’intérieur et l’extérieur. GEBARA
invite toutes les femmes à renaître de nouveau, à s’accepter, à accueillir leurs racines. Ainsi, l’option de la
femme pour elle-même est un acte personnel. Elle est ouverture et accueil de l’autre. D’où la deuxième idée
de cette réflexion.
2.2 L’option pour l’autre
Ivone GEBARA s’appuie ici sur la parabole du bon samaritain en Luc 10, 29-37 pour expliquer
combien l’option pour l’autre ne doit pas être réduite seulement aux proches mais elle doit s’élargir à
l’autre, au pauvre, à une présence concrète d’amour miséricordieux. Il s’agit de l’option pour un groupe
humain en détresse. L’auteure note qu’en Amérique latine, le terme pauvre a multiples faces : les ouvriers,
les paysans, les mendiants, les enfants abandonnés. Ce sont des hommes et des femmes mais parmi eux, le
groupe à privilégier est celui des femmes. La femme pauvre est aujourd’hui pauvre entre les pauvres. Elle
est la femme de ménage, la mère, la fille. En Amérique latine, depuis vingt ans, les femmes se sont rendu
compte que le combat pour leur vie et la vie de leurs enfants se joue aussi en dehors de leur maison. Elles
ont pris conscience de la valeur du travail. Pour GEBARA, la femme aujourd’hui fait partie du nouveau
sujet historique de changement. Elle est un personnage clé pour toutes les transformations qui se font dans le
monde. Les femmes ont pris conscience de la valeur du travail domestique jamais reconnu comme travail.
Elles ont lutté pour sa vraie reconnaissance et sa vraie valorisation.
Ivone GEBARA dans son article insiste aussi sur la liberté pour les femmes. Le mouvement de
libération des femmes est un mouvement de liberté théologique c’est-à-dire de recherche de Dieu. Selon
notre auteure, parler de liberté pour les femmes, surtout les pauvres d’Amérique latine, c’est vivre et parler
de Dieu autrement. C’est dire que, pour un bon nombre de femmes, la liberté est comme l’expérience d’une
vie avec Dieu. Dieu est, il est en toute femme et celle-ci le vit dans l’originalité de son être de femme, de son
histoire et de ses limites. A travers son Esprit, Dieu devient force ou énergie qui pousse les femmes vers
elles-mêmes et vers les autres en vue de quelque chose de nouveau, de plus grand.
Comme nous pouvons le constater avec GEBARA, l’option de l’autre ou l’amour de l’autre ne peut
que construire un avenir meilleur.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 111
2.3 L’option pour un avenir nouveau de justice et d’amour
L’espérance est toujours au cœur de toute vie. Elle est comme un souffle qui fait vivre la personne et
qui lui donne sens. Et cette espérance doit être nourrie, partagée, soutenue car elle est le désir d’un monde
nouveau et meilleur qui fait partie intégrante de l’humain. Dans cette dynamique, les femmes d’Amérique
latine, pense Ivone GEBARA, ont un rôle important à jouer dans la société. En effet, dans bien de
mouvements populaires en Amérique latine, les femmes ont montré leur capacité d’aimer la vie et d’espérer
malgré la souffrance et la pauvreté. Elles ont pu vivre le partage et la solidarité entre elles. Pour notre
auteure, au milieu d’une théologie non exprimée systématiquement, ce sont des signes du Royaume, des
signes qui disent aux femmes qu’il faut encore espérer malgré le désespoir. L’amour de Dieu ne se laisse pas
enfermer. Il se trouve là où on ne l’attend pas. C’est cet amour qui a tressailli dans le cœur de Marie. C’est
aussi cet amour qui a fait vibrer le ventre d’Elisabeth. Ce même amour a fait pleurer Marie-Madeleine et l’a
remplie de joie et de tendresse. C’est enfin un amour qui prend l’être entier de la femme et qui s’exprime de
multiples façons. Les femmes d’Amérique latine, poursuit l’auteure, vivent plusieurs annonces des signes de
la justice dans leur lutte quotidienne pour la vie et pour leurs droits. Elles sont les « veilleurs » de
l’espérance, celles qui attendent l’aurore à leur façon, certaines qu’au-delà de la nuit il y a la lumière
éclatante du soleil et qu’au milieu de la nuit on peut trouver de petites étoiles. Les femmes, en un mot, sont
le modèle d’espérance au sein de la société.
2.4 Evaluation de l’article d’Ivone GEBARA
« L’option pour le pauvre comme option pour la femme pauvre ». Cet article d’Ivone GEBARA
subdivisé en trois grands points, montre l’essentiel que la femme doit faire pour sauvegarder son image, son
statut de femme. En se référant à la Sainte Ecriture, l’auteure met en relief les obligations de la femme pour
qu’elle soit en harmonie avec le monde. Le langage simple utilisé par l’auteure permet d’accéder facilement
à la compréhension du texte. Contrairement à Hannelore SCHRÖDER qui du long en large défend la cause
des mères au détriment des pères, Ivone GEBARA apporte sa pierre de construction dans le processus du
genre et du développement de la femme. Elle propose des pistes, des canevas à suivre pour qu’une femme
devienne femme à proprement parler. La lecture de cet article permet de réaliser combien les défis à relever
pour sauvegarder l’image de la femme doivent toujours partir de la femme elle-même. C’est donc d’abord à
la femme qu’il revient la première démarche à entreprendre pour qu’elle retrouve sa dignité de mère.
CONCLUSION
Notre étude sur « l’appauvrissement économique des mères comme enrichissement des pères » de
Hannelore SCHRÖDER et sur « l’option pour le pauvre comme option pour la femme pauvre » d’Ivone
GEBARA fut une exploration qui nous a permis de découvrir d’une part les difficultés que traversent les
femmes dans certaines sociétés, et d’autre part, les défis que les femmes doivent relever pour leur propre
épanouissement. Nous avons compris à travers ce travail que la femme est celle dont le statut est très
souvent relégué au second rang dans la société. La femme fait aujourd’hui l’objet de discrimination. Elle a
toujours tort parce qu’elle est femme. On l’accuse d’être la cause de la misère sociale ou familiale.
La réalité de certaines des situations concrètes des femmes et de leur travail révèle comment la
domination du patriarcat s’étend de la maison aux autres institutions. En fait, si la femme est mère, son
travail quotidien est de seize heures, en regard des huit heures de travail du patriarche ou du père.
L’analyse de Hannelore SCHRÖDER montre bien combien les mères ont aujourd’hui moins de
sommeil par rapport aux patriarches. Car elles se lèvent tous les jours plus tôt et se couchent plus tard dans
leur effort pour accomplir le travail exigé par leurs situations.
Ainsi donc, les structures patriarcales, profondément inscrites dans certaines familles et sociétés sont
indiscutablement à la source du dénigrement du travail des femmes. Pour cela, comme le pense Ivone
GEBARA, la femme d’aujourd’hui doit se lever pour s’affirmer en tant que femme et donc coresponsable de
la famille. Elle doit jouir pleinement de ses droits, de ses privilèges sociaux. C’est dans cet ordre d’idée que
le pape Jean XXIII, dans son Encyclique Pacem in terris affirme : « De plus en plus consciente de sa
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 112
dignité humaine, la femme n’admet pas d’être considérée comme un instrument ; elle exige qu’on la traite
comme une personne aussi bien au foyer que dans la vie publique »357
.
Par YARKAÏ Marie-Paulin
CONCLUSION EN GENERALE
Dans ce cours, le nous avons appris beaucoup des choses sur les théologies contextuelles en générale. Aidés
par les exposés des écrits des théologiens et théologiennes, nous avons approfondi notre connaissance sur la
théologie de libération et la théologie féministe. Avons-nous épuisé sur la théologie de libération et la
théologie féministe ? Certainement non. La théologie, qui est intrinsèquement contextuelle en une affaire
non-close.
357
Jean XXIII, Pacem in terris, éd. Du Centurion, 1967, P. 245.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 113
BIBLIOGRAPHIE
Armerding, C. E., éd, Evangéliques et de la Libération.
Assiman, H, Théologie pour une Eglise Nomad.
Aubert, M. J., Des femmes diacres, un nouveau chemin pour l’Eglise, Paris, Beauschesne,
1987.
Bernstein, C. et al., Sa Sainteté Jean Paul II, Edition Plon, 1996.
Berryman, P., Théologie de la Libération, Philadelphia, Temple University Press, 1987;
Bibb, J. F., «Les femmes pour la prêtrise dans l’Eglise catholique romaine», in
Concilium, n° 263, Paris, Beauchesne, 1996.
Boff, L., Eglise: Charisme et Pouvoir, Paris, Lieu Commun, 1985.
Boff, L., Qu-est-ce que la théologie de la libération ?, Cerf, Paris, 1987.
Boff, L., « Que signifie théologiquement peuple de Dieu et Eglise populaire » in
concilium, no 196, 1984.
Boof, L., Jésus-Christ Libérateur.
Brennan, M., « La clôture : Institutionnalisation de l’invisibilité des femmes dans les
communautés ecclésiastiques », in Concilium, no 202, 1985.
Brown, R. M., Théologie dans une nouvelle clé: Répondant à la Libération Thèmes.
Bühlmann, W., Les peuples élus, Paris, Médiapaul, 1985.
Buttet, N., Aimer et faire connaitre l’Amour, Paris, Edition de l’Emanuel, 1993.
Carbonell, L. R., Nous voulons du pain et des roses: Emancipation des femmes et le
christianisme, Madrid, Caos, 2011.
Carbonnell, L. R., « Introduction à l'histoire de la théologie féministe chrétienne» dans Flórez, M.
A., et Puerto, M. N. (éd.), La théologie féministe I, Séville, Arcibel, 2007.
Chenu, B., "Le spiritual, un peuple en mouvement vers son Dieu" in Lumière et vie,
Chenu, B., Le Christ noir américain, Paris, Desclée, 1984.
Cikala, M., « Initiation africaine et initiation chrétienne » in Lyangombe mythe et rites,
Actes du 2ème Colloque du Ceruki du 10 au 14 mai 1976, Bukavu, éditions du
Ceruki, 1976.
Claude-François, J., « Théologie de la libération et Réelle politique », in Politique étrangère, n° 4,
1984, 49e année, pp. 893-905.
Cleage, A., The Black Messiah, New York, Sheed and Ward, 1968.
Collier, J. et Estaban, R., From complicity to encounter: The Church and the culture of economisme,
Christian Mission and Modern Culture Series, London, Continuum, 1999.
Cone, J. H., A Black Theologie of Liberation.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 114
Cone, J. H., God of the Oppressed, New York, Seabury Press, 1975.
Cone, J. H., La noirceur de Dieu, Genève, Labor et Fides, 1989.
Congrégation pour la doctrine de la foi, Lettre de notification et de la sanction
de Léonardo Boff publiée le 11 mars 1985 à Rome.
Couch, M., « Libération, une vision biblique » in Concilium, n° 270, Paris, Beauchesne,
1997.
De Las Casas, B., De l’unique manière d’évangéliser le monde, paris, Cerf, 1990, cité par
Dermience, A., « Femmes et ministères dans l’Eglise primitive », in : Joseph Gross, dir, in
Spiritus, n° 137, Paris, 1994.
Dermience, A., La question féminine et l’Eglise catholique : Approaches biblique, historique
et théologique, Bruxelles, Peter Lang, 2008.
Dermience, A., La question féminine et l’Eglise catholique, approaches biblique, historique et
théologique, Bruxelles, Peter Lang, 2008.
Dumais, M., L’interprétation de la Bible dans l’Eglise, Paulines, Montréal, 1994.
Duquoc, C., Libération et progressisme, Pris, Cerf, 1987.
Dussel, E., Histoire de la théologie de libération, Buenos Aires, 1972, trad. Français Ed.
Ouvrières, 1974.
Echavarri, M. J. F., Mémoire de l'approche la théologie féministe, Gijón, Juin 2011.
Ellicuria, I., Liberté Made Flesh: La mission du Christ et son Église.
Ellul, J., L’idéologie marxiste chrétienne, Paris, Centurion 1979.
Fierro, A., L'Evangile militant:. A Critical Introduction aux théologies politiques.
Fiorenza, E. S., « Briser le Silence devenir visibles », Concilium, no 202, 1985.
Fiorenza, E. S., « Briser le Silence devenir visibles », in Concilium, no 202, 1985.
Fiorenza, E. S., « L’herméneutique féministe »,in Fac-Réflexion, n° 48-mars 1999.
Fiorenza, E. S., En mémoire d’elle, Essai de reconstruction des origines chrétiennes selon la
théologie féministe, Paris, Cerf, 1986.
George H. Tavard, G. H., Woman in Christian Tradition, University of Notre Dame Press, Notre dame,
1973.
Gibellini, R., éd, Frontiers of Theology en Amérique latine.
Gutiérrez, G., Théologie de la libération.
Gutiérrez, G., « Evangile et praxis de libération » in Les luttes de libération bousculent la
théologie, Paris, Cerf.
Gutiérrez, G., « Evangile et praxis de libération » in Les luttes de libération bousculent la
théologie, Paris, Cerf.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 115
Gutiérrez, G., Dieu ou l’or des Indes occidentales, Las Casas et la conscience chrétienne,
1492-1992, trad. De l’espagnol (Pérou) par Lucile et Martial LESAY, Paris,
Cerf, 1992.
Guttiérrez, G., « Travail théologique et expérience ecclésiale » in concilium, no 196, 1984.
Hinga, T. M., « Entre colonialisme, les théologies féministes en Afrique », in Concilium, n°
263, Paris, Beauchesne, 1996.
Houcarde, J., « Dans la tradition et aujourd’hui », in : Joseph Gross, dir, Spiritus, n° 137,
Paris, 1994.
Hourcarde, J., L’Église est-elle misogyne? Une vocation féminine, antique et nouvelle, Paris,
Éditions Tequi, 1990.
Jean Paul II, Christifidelis laici, 1989.
Jean Paul II, Lettre adressée aux Evêques Brésiliens, Oss. Rom. N° 42, 22 Octobre 1991.
Jean Paul II, Lettre apostolique ordinatio sacerdotalis, 1994.
Jean Paul II, Mulieris Dignitatem. La dignité de la femme et sa vocation, Paris, Éditions du
Cerf, 1988.
Jean XXIII, Pacem in terries, 1963.
Jean XXIII, Pacem in terris, éd. Du Centurion, 1967.
Johnson, E., « La masculinité du Christ » in La femme a-t-elle une nature spéciale ?, Paris,
Beauchesne, 1991.
Kirk., J. A, Théologie de la Libération: Un évangélique Vue du tiers monde.
Kungua, B. A. M., Le Dieu crucifié en Afrique, Paris, L’Harmattan, 2008.
Lebret, L. J., Dynamique concrète de développement, Paris, Economie et Humanisme, les
éditions ouvrières, 1961.
Marlé R. et al., « Pourquoi la Théologie morale ? », in Cahier de l’actualité religieuse et
sociale, n° 293,1984.
Masson, G. H., "Le grand livre des Negro Spirituals. L'aventure d'une libération et d'une foi",
in La Vie Spirituelle, décembre 2000.
McFague, S., « Dieu Mère », in Concilium, Revue international de Théologie, n° 226,1989.
Miguiez-Bonino, J., Faire de la théologie dans une situation révolutionnaire.
Miranda, J. P., Marx et la Bible.
n°140, novembre-décembre 1978.
Ntezimana, L., Libres paroles d’un théologien rwandais : joyeux propos de bonne puissance,
Paris, éditions Karthala, 1998.
Oduyoye, M. A., « La maternité : expérience, institution et théologie » in Concilium, n° 226,
Paris, Beauchesne, 1989.
Théologies contextuelles: Théologie de libération & Théologie féministe, W. GOBBO, CFMA 2013 116
Paul VI, Populorum progressio.
Paul VI, « La libération évangélique » in Théo encyclopédie catholique pour tous, Paris,
Droguet-Ardant/ Fayart, 1992.
Paul VI, Lettre encyclique populorum progressif, 2e Ed. , Apostolat des Editions, Lyon,
1967.
Quesson, N., Parole de Dieu pour chaque jour. Jalon pour les lectures de semaine. Les
évangiles, Tome 1, 6ème
édition, Paris, Droguet& Ardant, 1995.
Rollet, H., La condition de la femme dans l’Eglise : Ces femmes qui ont fait l’Eglise,
Paris, Fayard, 1975.
Ruether, R. R., « Différence et égalité de droits des femmes dans l’Eglise » in La femme a-t-
elle une nature spéciale? Paris, Beauchesne, 1991.
Ruether, R. R., Women and Redemption : A Theological History, Minneapolis, Fortress Press,
1998.
Sankara, T., Discours prononcé au sommet de l’OUA (Organisation de l’Union Africaine),
le 29 Juillet 1987 à Addis Abéba, http://thomassankara.net/spip.php?
(23/02/2013 à 21h03).
Segundo, J. L., « Théologie et sciences sociales» in Les luttes de libération bousculent la
théologie, Paris, Cerf.
Sigmund, P. E., Théologie de la Libération à la croisée des chemins, 1990.
Sobrino, J., « Amérique Latine, lieu de péché lieu de pardon », in Concilium, n°204, Paris,
Beauchesne, 1986.
Sobrino, J., Jésus en Amérique latine : sa signification pour la foi et la christologie, Paris,
Cerf, 1986.
Valadier, P., « La libération et Evangile », in : Etudes, n° 338, Paris, 1973.
West, C., « Théologie Noire et pensée marxiste », in La théologie Noire Américaine,
Lyon, Essais et recherches de la Faculté de Théologie de Lyon, 1982.
XXX, Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise, CEDA/NEI Abidjan 2008
XXX, « Déclaration de la commission théologique de la Conférence nationale des
chrétiens noirs : La Théologie Noire en 1976 », in La théologie Noire
Américaine, Lyon, Essais et recherches de la Faculté de Théologie de Lyon,
1982.
XXX, « Déclaration de la sacrée congrégation de la doctrine de la foi sur la question
de l’admission des femmes au sacerdoce ministériel » in Inter Insigniores.































































































































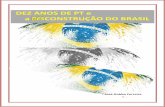
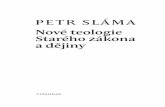
![Die Didache [Theologie]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6325a09b545c645c7f09cc1a/die-didache-theologie.jpg)