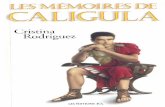Sciences Po Degree Dissertation, 1998, Le centre historique minier de Lewarde. Ressorts et enjeux...
-
Upload
univ-lille2 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Sciences Po Degree Dissertation, 1998, Le centre historique minier de Lewarde. Ressorts et enjeux...
Fabien DESAGE Institut d’Etudes Politiques 3POS3 de LILLE
Mémoire de rechercheMémoire de recherche
Sous la direction de Frédéric SAWICKI
Année 1997-1998
Le Centre Historique Minier de Lewarde :
Ressorts et enjeux d’un lieu de mémoire en
Bassin Minier.
- 2 -
Remerciements A Frédéric SAWICKI, qui a dirigé ce mémoire, pour ses encouragements et ses précieux conseils. Ce travail lui doit beaucoup. A Bruno VILLALBA, pour ses remarques avisées et sa confiance. A Julien FRETEL et Astrid VON BUSEKIST pour leurs indications nombreuses. A M. DUBUC, Directeur du Centre Historique Minier, pour son aide et sa bienveillance. A Frédérique, employée aux archives du Centre pour son aimable coopération. A Mme BECQUART, Conseiller musée à la DRAC, M.BEMBENEK, Secrétaire Général de la CGT mineurs, M.BOURGE, Direction de l’Action Culturelle au Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais, M.DOLEZ, Député du Nord et ancien Président de l’Association du Centre Historique Minier, M.NOTTEZ, Maire de Lewarde, Mlle PARIS, Conservateur du CHM, M.RACLE, Directeur de l’Association Nationale de Gestion des Retraites, M.TURBELIN, retraité, ancien responsable du service de Relations Publiques des Houillères du Bassin du Nord et du Pas de Calais, M.WAEGHMACHER, Mission Culturelle du Conseil Général du Nord, qui ont accepté gentiment de répondre à nos questions. A ma mère et à mon frère pour leur soutien indispensable et leur tolérance. A Charlotte.
- 3 -
Introduction…………………………………………………….……………………………8
I. GENESE D’UN LIEU DE MEMOIRE CONSACRE A LA MINE ............................11
A. QUELQUES ELEMENTS DE CONTEXTE ............................................................................12
1. Un nouvel objet : le patrimoine industriel ..................................................................12 2. Les pesanteurs de l’esthétisme ....................................................................................15 3. Des musées de société au musée de la mine de Lewarde .............................................17 4. Une nouvelle politique culturelle : mythes et réalité d’un discours d'Etat....................21
B. ETAPES ET JALONS DE L’EDIFICATION DU CENTRE HISTORIQUE MINIER.........................25
1. De l’intuition d’Alexis Destruys à la naissance de l’Association du Centre Historique Minier (68-82) ...............................................................................................................26 2. De l’arrivée des nouveaux acteurs au désengagement des Houillères (82-90).............30 3. Nouvelle donne et crise de croissance (90-97) ............................................................33
II. MEMOIRES ET ENTREPRENEURS DE MEMOIRE............................................38
A. DECONSTRUIRE L’INVESTISSEMENT PATRIMONIAL ........................................................40
1. L'enjeu de la muséification.........................................................................................40 2. Lieu de mémoire, lieu de pouvoir ? .............................................................................45 3. Un anti-écomusée ? ....................................................................................................51
B. LA MEMOIRE AU PLURIEL.............................................................................................55
1. Derrière le paravent du consensus… ........................................................................55 2. …une mémoire de la mine à géométrie variable.........................................................58 3. Le Centre Historique minier et les autres lieux de la mémoire de la mine ...................71
III. LE MUSEE, UN DISCOURS SUR LA MINE.........................................................76
A. LE « CENS CACHE» DE LA MEMOIRE .............................................................................78
1. Qui parle ? .................................................................................................................78 2. Qui visite ? .................................................................................................................83
B. PROPOSITION D’EXEGESE .............................................................................................86
1. Pour une « géographie de l’éliminé » .........................................................................86 2. Images sociales de la mine et du mineur : « la beauté du mort ».................................92
C. LA QUESTION DE LA TRANSMISSION..............................................................................95
1. Visibilité externe du CHM...........................................................................................96 2. Le CHM vu par ses visiteurs : quelques pistes de recherche........................................99
- 4 -
« Tout est bien, par conséquent. En apparence. Des sites décrassés prospèrent. Des éclopés du travail ouvrier meublent leur retraite. Des fossoyeurs d’entreprises contribuent à l’enrichissement patrimonial de la nation. Des historiens font feu de tout bois. Mais les morts, eux, sommes-nous si sûrs qu’ils dorment en paix ? »
Rioux (Jean-Pierre), «L’usine au musée » in L’histoire, n°195 janvier 1996, pp. 97-98
« On ne donne réellement accès à la connaissance d’objets qui sont le plus souvent investis de toutes les valeurs du sacré qu’à condition de livrer les armes du sacrilège : sauf à croire en la force intrinsèque de l’idée vraie, on ne peut rompre le charme de la croyance qu’en opposant la violence symbolique à la violence symbolique et en mettant, quand il le faut, les armes de la polémique au service des vérités conquises par la polémique de la raison scientifique. »
Bourdieu (Pierre), Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n°1, 1975
- 5 -
Avant propos
Pour que notre démarche soit bien comprise et afin d’éviter tout malentendu, nous
avons souhaité l’expliciter ici, avant toute chose.
Appréhender le Centre Historique Minier de Lewarde comme une entreprise1
culturelle, produit de transactions institutionnelles, sociales et politiques, ne va pas sans un
certain désenchantement de l’objet ainsi étudié.
Nombre de constructions historiques aiment en effet à se naturaliser a posteriori, à se
défaire des conflits qui les ont engendrées, bref à se donner à voir et à penser comme les
unités homogènes et inévitables qu’elles sont devenues, force de persuasion et d’amnésie2.
Partant, l’institué ne fait plus problème. Il « va de soi » et finit par s’autonomiser de
ses propres modalités d’édification, pour « revêtir les valeurs du sacré »3. Toute mise en
question devient alors superflue, voire incongrue.
C’est ici même qu’intervient le premier travail du chercheur ou de l'apprenti
chercheur: déchirer le voile de la naturalité, et donner à l’institué son statut d’objet de
recherche4.
Cette démarche, impliquant d’objectiver les motivations de chaque acteur, de révéler
les artefacts du discours, de souligner des divergences parfois refoulées, ne va pas sans mal.
Comme le font très justement remarquer Jean Clément Martin et Charles Suaud5,
confrontés à certaines incompréhensions lors de la parution de leur étude6 : « l’exposition des
mécanismes sociaux et des processus historiques peut vite être assimilée à un jugement sur les
institutions ou les personnes. »
Aussi, pour prévenir toute méprise, nous réaffirmons le sens de nos recherches, à mille
lieux de tout procès d’intention.
1 Au sens d’un dessein. 2 Sur ce point nous ne pouvons que faire nôtre l’avis de J.M Léniaud sur les pesanteurs de l’évolutionnisme: « Trop souvent l’histoire reste partisane en adoptant le point de vue du vainqueur dont elle cherche de façon déterministe dans le passé les raisons et le bien-fondé de sa victoire », Leniaud (Jean Marie), « Nation et patrimoine », in Revue Administrative, n°285 et 286. 3 P.Bourdieu, op.cit. 4 C’est une « opération intellectuelle laïcisante », selon la terminologie utilisée par Joël Candau pour décrire le travail de l’historien sur la mémoire ; Candau (Joël), Anthropologie de la mémoire, Paris, PUF, collection Que sais-je n°3160, 1996. 5 Dans leur maître livre, Le puy du Fou, en Vendée ; l’histoire mise en scène, Paris, L’Harmattan, 1996, PP. 12-17. 6 Une monographie du spectacle du Puy du Fou
- 6 -
Nous pensons, en effet, que « le sens des pratiques sociales peut dépasser celui que les
individus engagent dans leur action »7. Dès lors, considérer les ressorts et les enjeux de cette
entreprise comme le résultat ou l’émanation de volontés individuelles ou de décisions
maîtrisées8, devient parfaitement réducteur.
Ajoutons que s’il nous a fallu nous déprendre, c’est plutôt d’un sentiment de
sympathie, à l’égard des animateurs d’un projet culturel par bien des côtés attachants.
A l’inverse d’un réquisitoire, ce travail entend donc poser des questions, suggérer des
hypothèses et ouvrir des pistes de réflexions sur un champ9 (celui du patrimoine et de la
mémoire collective), dans lequel les antiennes10 tiennent parfois lieu de tout débat. « Au lieu
d’une évidence il faut faire de la mémoire collective un problème »11.
Pour cela, nous avons constitué un corpus diversifié mais loin d’être exhaustif, à la
mesure du temps (réduit) qui nous était imparti.
Le premier travail a consisté à dépouiller les archives relatives à l’histoire du CHM12.
Tous les procès verbaux des Conseils d’Administration13 et Assemblées Générales de 1982
(date de création de l’association) à 1996 ont ainsi été examinés. Sources d’indications
précieuses sur les événements et décisions marquantes, ils sont aussi à prendre avec prudence.
Emanations de l’administration du musée, ils ne rendent compte que partiellement des prises
de parole et des débats. Cette caractéristique est accentuée pendant la période de présidence
Houillères (82-90) où ils s’apparentent souvent à de pures formalités et sont la voix de la
Direction. Ainsi, d’autres sources écrites ont été nécessaires afin d’éclairer des enjeux parfois
latents dans les comptes-rendus. Les correspondances entre les membres du C.A, les HBNPC
et le CHM, les documents de demande et d’octroi de subventions furent autant d’éléments
décisifs pour saisir les étapes importantes de l’édification du musée et les logiques
d’intervention de ses acteurs.
Des entretiens14 réalisés auprès des membres du C.A., représentant les
7 Ibidem. 8 Par quelque esprit retors. 9 Au sens de Pierre Bourdieu. 10 Doit-on se contenter de l’affirmation redondante d’un « besoin de mémoire » ? 11 Selon les mots de Gérard Noiriel, précurseur incontournable d’une réflexion sur les musées de l’industrie à l’heure de la crise, dans son remarquable article : « Le pont et la porte, les enjeux de la mémoire collective », in Traverses, n°36, Janvier 1986. 12 Qui figuraient parmi le fond d’archives du Centre. 13 On utilisera fréquemment le sigle C.A. 14 Semi-directifs enregistrés. Cf. annexe n°26 pour les grilles d’entretien.
- 7 -
différents partenaires15 du musée, sont venus prolonger ce travail d’investigation visant à
mettre à jour les enjeux, interprétations et conflits éventuels de mémoire. Peu d’acteurs des
débuts ont pu être rencontrés16. Soit qu’ils n’habitaient plus la région, soit qu’ils étaient
décédés ou trop âgés pour nous répondre, soit encore qu’il nous en ait manqué le temps. Cette
absence, souvent « compensée » par la mémoire des acteurs actuels, nous force parfois à
proposer des hypothèses sur leur rôle, au regard des traces écrites nombreuses qu’ils ont pu
laisser ici et là. D’autre part, rencontrer les acteurs actuels présentait quelques avantages. De
nombreuses problématiques que nous aborderons intéressent en effet le présent.
Concernant l’étude de l’image du musée à l’extérieur, une partie importante du travail
a consisté en une revue de presse et de Guides17, qui n’a pu épuiser, cependant, la totalité de
la couverture dont a bénéficié le musée18.
Pour ce qui est de la perception du CHM par ses visiteurs, les sources employées
furent diverses. Les « livres d’or » ou les rares enquêtes réalisées par le musée ont été mis à
profit notamment. Leurs biais nombreux méritent un commentaire. On peut douter, en effet,
de la représentativité des visiteurs qui signent le livre d’or et les enquêtes ont porté sur de trop
petits échantillons pour être utilisées sans garde-fous. C’est peut-être le manque le plus
important de notre investigation que de ne pouvoir compter sur une source quantitative fiable
qui aurait permis de mieux comprendre, à la fois les motivations et le regard du public sur le
Centre, et l’intérêt des habitants du Bassin Minier pour le musée19. Ce travail d’enquête et de
traitement aurait nécessité un investissement lourd, peu compatible avec les contraintes de
temps. Son absence regrettable ne nous empêchera pas de formuler des hypothèses, à la
lumière des données disponibles, mais nous imposera la prudence. D’autre part, les
présupposés sur lesquels le Centre perçoit son public pourront toujours être remis en cause,
alors même qu’il ne dispose pas des éléments qui nous font défaut.
En dernier lieu, insistons sur la place importante accordée aux lectures d’ouvrages et
d’articles20. Elles nous ont familiarisé avec l’objet d’étude et fourni des grilles d’analyse
indispensables. Si l’on y ajoute le temps réservé à la découverte et à l’exploration du musée,
on aura fait le tour de ce qui a constitué l’essentiel de nos recherches.
15 Environ 10 heures d’entretiens ont été réalisées auprès de dix interlocuteurs différents dont on trouvera la liste en annexes. 16 A l’exception notable de M.Turbelin, ingénieur retraité chargé des Relations publiques aux HBNPC et longtemps secrétaire du Centre Historique Minier. 17 Nous utiliserons la majuscule quand il s’agira des guides « papier » pour les distinguer des guides mineurs du musée. 18 Près de 500 articles par an selon le service de communication du Centre. 19 A travers deux enquêtes distinctes. 20 Voir la bibliographie.
- 8 -
Introduction
Le 21 décembre 1990, les Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais (HBNPC)
fermaient leur dernier puits encore en activité à Oignies, mettant fin à trois siècles
d’extraction charbonnière dans la région.
Cet épisode pouvait paraître anecdotique au regard de la récession qui avait frappé le
Bassin Minier depuis les années 60. De 200000 mineurs dans les années 1950, les effectifs
étaient tombés à 0. En moins de quarante ans.
En 1991, le Centre Historique Minier de Lewarde, installé en lieu et place de la fosse
Delloye arrêtée en 1971, accueille son 500000ème visiteur et connaît une affluence annuelle de
120000 visiteurs par an qui en fait le premier musée de la Région. Chacun s’accorde pour y
voir un succès.
Quelle relation entre ces deux événements, entre ces deux dynamiques qui paraissent à
la fois contraires et si inextricablement liées ?
Notre problématique pourrait se résumer à cette question si elle n’était si complexe.
Sous les faux jours de l’évidence, il y a là, en effet, bien plus qu’un simple lien de
cause à effet21. Ici comme ailleurs l’explication téléologique aveugle et rend inintelligible les
mécanismes qui sont en jeu.
Aussi, notre première hypothèse22 fut qu’il était inconcevable d’expliquer un fait
patrimonial en dehors de sa construction institutionnelle et sociale ( I. ), sauf à le considérer
comme une réponse univoque et spontanée à un stimulus social23, introuvable.
La mémoire collective24 de la mine, loin d’être une donnée objective et immanente,
apparaît bien comme un enjeu dont se saisissent des acteurs (les entrepreneurs de mémoire),
aux interprétations du passé et aux motivations fort différentes. Derrière le discours fédérateur
21 Où la cause serait la fermeture des puits et l’effet l’édification d’un musée de la mine. 22 A la suite des travaux de Charles Suaud et Jean Clément Martin sur le Puy du Fou, op. cit., et de F. Jeannot sur l’intérêt pour les maisons traditionnelles en Franche-Comté, « Tisser des liens patrimoniaux », Genèses II, Mars 1993, pp. 5-24. 23 Frédéric Jeannot l’exprime très justement dans son texte(ibidem) : « L’image usuelle de la construction sociale, avec ce qu’elle évoque de briques, de béton ou de barres d’aciers permet mieux de caractériser l’activité d’institutionnalisation d’une politique patrimoniale que l’émergence dans le corps social d’un sentiment ». 24 Selon l’expression consacrée et définie par Maurice Halbwachs dans son ouvrage célèbre : La mémoire collective, Paris, PUF, 1950, 204 P.
- 9 -
de la sauvegarde du patrimoine et de la réhabilitation de la culture ouvrière se cache une
grande diversité d’usages sociaux de cette mémoire collective. Il s’agit dès lors de les
déchiffrer, de retracer les conflits inhérents à cette entreprise de mémoire, exprimés ou
refoulés ( II. ).
Cette approche revêt ici un intérêt particulier, lié au territoire d’étude.
Le Bassin Minier est en effet le lieu où se rencontrent des acteurs institutionnels
« récurrents »25, autour de questions décisives souvent liées à la fin de l’exploitation
charbonnière26. Ainsi, la transmission de la mémoire constitue un champ propice à
l’observation de ce milieu décisionnel et des logiques d’action de ses diverses composantes.
On peut d’ores et déjà signaler27 qu’à l’inverse des écomusées, Le CHM fut une pure
création de celui-ci28, initiée par le haut, dont furent totalement absents habitants et autres
acteurs périphériques (associatifs notamment).
De ce fait, l’étude de son édification participe également à une meilleure
compréhension des phénomènes de mobilisation ou de non-mobilisation autour des enjeux
patrimoniaux et identitaires de ce territoire29.
L’autre question centrale, directement liée à celle des entrepreneurs de mémoire, est
tout aussi complexe. C’est celle du discours produit par le CHM ( III. ).
Quelles images de la mine et des mineurs « exhume »-t-on à Lewarde ? Ce patrimoine,
post mortem, n’est-il pas voué à véhiculer une mémoire désincarnée, vidée de son historicité
propre par les nouvelles fonctions et valeurs symboliques30 qu’on lui attribue ?
Que poursuit donc ce nouveau lieu de mémoire autoproclamé ? Est-il appelé à devenir
un sanctuaire, tombeau symbolique d’un passé ainsi exorcisé ou, au contraire, le ferment
d’une identité collective réaffirmée, fut-elle construite sur des mythes surinvestis ? Quel est
donc le sens de sa montée en grâce et qu’en attendent ses « apôtres » ?
Cette dernière interrogation nous conduit à formuler une deuxième hypothèse qui
servira de fil conducteur à notre propos : ce patrimoine et cette mémoire réifiée31 jouent un
25 L’Etat, les collectivités locales, les structures héritières des Houillères ( SOGINORPA pour le logement, FINORPA pour l’aide à la création d’activités, ANGR pour les retraites, etc.), les communes, l’Association des Communes Minières, et enfin les syndicats. 26 La gestion du parc de logement, propriété des Houillères mais dont bénéficient de nombreux ayants droit ou encore la pérennité des pensions et du régime spécifique de sécurité sociale étant parmi les plus conflictuelles. 27 On développera ce point en III.A.3 28 Avec un rôle particulier dévolu aux HBNPC. 29 A ce sujet voir les travaux en cours sur les mobilisations liées au cadre de vie dans le Bassin Minier, menées par une équipe de recherche du Centre de Recherche Administrative, Politique et Sociale de LILLE II (CRAPS), à laquelle nous étions associé pour ce travail. 30 Ces fonctions et valeurs symboliques feront l’objet de plusieurs parties à l’intérieur de notre développement. 31 Car devenue musée.
- 10 -
rôle évident de « matrices du présent » 32. Toute réflexion implique donc de les considérer,
non comme des reflets stériles et inertes du passé, mais comme des discours sur celui-ci,
comme des allégories33 du présent.
En ce sens, ce patrimoine industriel, cette muséification, expriment la construction
sociale d’un rapport au passé qui donne également sens au présent et s’inscrit finalement dans
des problématiques contemporaines.
Partant, quels sont les effets (escomptés et objectifs) d’un musée comme celui de
Lewarde sur le présent et l’avenir du bassin minier ? En quoi ses différents acteurs
s’accordent-ils ou divergent-ils sur les « leçons de l’histoire » de la mine et sur ses usages ?
Il faut enfin aborder la question fondamentale des absents de cette mémoire célébrée.
La fréquentation et la renommée du CHM tendent à en faire le lieu d’une mémoire
légitime de la mine. Pourtant, on peut s’interroger sur la partialité de cette mémoire. Quels en
sont les médiateurs ? Peut-on considérer qu’ils sont représentatifs du monde de la
mine comme le CHM aime à le répéter en valorisant le rôle de ses trente guides mineurs, ainsi
investis des souvenirs de centaine de milliers d’hommes et de femmes ?
Considérant l’étendue des questions posées, cette étude devra se situer, autant que
possible, « à la charnière de l’utilisation du passé et de l’avenir, à l’articulation de la mémoire
et de l’histoire, au croisement de la sociabilité héritée et de la construction politique34 ». C’est
ainsi que nous l’entendons.
32 Selon l’expression employée par Françoise Choay dans son livre l’Allégorie du patrimoine, Paris, Seuil, 1992., 33 Ibidem. 34 Suaud, Martin, op. cit.
- 11 -
I. Genèse d’un lieu de mémoire consacré à la mine
Dès le début des années 80, Pierre Nora entreprend d’interroger la mémoire de la
société française à travers un inventaire heuristique des lieux où elle « s’incarne ». Des palais
aux monuments aux morts, des dictionnaires aux œuvres d’art, des paysages aux emblèmes,
se dessine une œuvre éditoriale monumentale, quasi encyclopédique : Les lieux de mémoire35.
Les dizaines de contributions rassemblées sous les thèmes génériques de la
République36, de la Nation37 ou des France 38 balisent un nouveau champ de recherche, non
exhaustif par nature39, dans lequel nous allons nous engouffrer.
Le Centre Historique Minier fait partie de ces nouveaux lieux de mémoire, récemment
consacrés. Il peut en effet être considéré comme « une unité significative, d’ordre matériel ou
idéel, dont la volonté des hommes ou le travail du temps a fait un élément symbolique d’une
quelconque communauté »40.
Pourtant, de la Nation ou de la République il n’est point question ici.
La mémoire affichée est celle du travail, du labeur, de l’industrie41. Les ouvriers
auraient donc investi la mémoire collective, aux côtés des gloires nationales ou des « héros »
morts pour la France ?
On peut s’interroger sur le sens et les motifs de cette soudaine
transfiguration patrimoniale ? Quels en sont les événements déclencheurs (prises de
conscience, travaux de recherche, décisions politiques, signes précurseurs) ? Quelle est sa
portée réelle au-delà des déclarations d’intention et des discours incantatoires ? Comment a-t-
elle participé à l’édification d’un lieu de mémoire dédié à la mine, dans le cas de Lewarde?
(A.)
Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre, avant d’envisager les
étapes de développement du Centre proprement dites, en distinguant les phases marquantes
selon les logiques à l’œuvre et les événements décisifs concomitants. (B. )
35 Nora (Pierre) (sous la dir.), Les Lieux de mémoire, Paris, Gallimard, 1984-1992 (7 vol.). 36 Ibidem. Volume I, 1984. 37 Ibidem. Volume I, II, III, 1986. 38 Ibidem. Volumes I, II, III, 1992. 39 Les lieux où s’incarne la mémoire sont infinis. 40 Selon la définition qui en est donnée par le Grand Robert de la langue française, 1993. 41 Louis Bergeron rappelle brièvement les « contours insolites » de ce nouveau patrimoine dans un article du dernier volume des Lieux de mémoire (Ibidem.) : « L’âge industriel », Les France III, emblèmes.
- 12 -
Tous ces éléments participent inextricablement à la compréhension de l’édification
d’un lieu de mémoire en Bassin Minier.
A. Quelques éléments de contexte
Pour commencer, l’édification du CHM42 doit être replacée dans son contexte. La
connaissance de ce dernier permettra de mieux comprendre les facteurs exogènes qui l’ont
encouragée ou influencée et contribué par là même à lui donner sa forme actuelle.
Sans être un produit exclusif ou inévitable43 de ce contexte, la création du musée de
Lewarde ne peut être appréhendée ex-nihilo sauf à devenir absurde. Son intelligibilité requiert
donc sa contextualisation mais ne s’y réduit pas. Il faut l’inscrire dans des réflexions (dans
l’épistémé du patrimoine notamment) et dans des événements plus larges, sans négliger la part
de ses dynamiques propres. Car le CHM, on le verra, se définit souvent par sa singularité.
1. Un nouvel objet : le patrimoine industriel
Pour que l’on décide de rassembler des objets caractéristiques de l’extraction minière
et d’en faire un musée, il faut d’abord prendre conscience de leur intérêt potentiel.
En effet, jusqu’à ces vingt dernières années en France, les bâtiments ou témoignages
représentatifs de l’activité industrielle n’avaient pas droit de cité au titre de patrimoine.
Nombreux, pourfendeurs de ces traces encombrantes d’un passé révolu, les vouaient à la
démolition sitôt achevée la fonction pour laquelle ils avaient été conçus.
La crise qui frappa l’industrie lourde dans les pays anciennement développés finit de
dégrader des sites, désormais réduits à l’état de friche et devenus symboles de la récession. Il
est caractéristique à ce sujet de constater que la fosse Delloye, avant d’accueillir le CHM, fut
d’abord une friche44.
Pourtant, en sonnant le glas d’une activité héritée de la première révolution industrielle
et en affirmant l’obsolescence de certaines de ses forteresses, les années 70 ont aussi coïncidé
en France avec de nouvelles prises de conscience.
D’abord bien esseulés, certains chercheurs (au sein de l’Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales notamment) manifestèrent de l’intérêt pour les témoignages d’une mémoire
technique, sociale et économique menacée d’anéantissement.
42 Ce sigle sera souvent utilisé pour désigner le Centre Historique Minier. 43 Il serait facile et illusoire de reconstruire un déterminisme a posteriori. 44 L’extraction y fut stoppée dès 1971.
- 13 -
Héritiers de l’Ecole des Annales, ces historiens des techniques pour la plupart,
importèrent et développèrent en France une nouvelle discipline45, née depuis les années 1950
au R.U. : l’archéologie industrielle. Avant de revenir sur leur rôle fondamental, précurseur
d’un nouveau regard porté sur les traces matérielles de l’industrie, il faut faire un court détour
par l’Angleterre, berceau du phénomène.
Il n’est pas étonnant que ce pays, qui fut à l’avant-garde de la Révolution Industrielle
dès la fin du 18ème siècle, devint un terrain expérimental privilégié en matière de patrimoine
industriel. Dès les années 1950, les premières initiatives de sauvegarde se font jour. La crise,
plus précoce qu’en France et la mobilisation des habitants, très vite sensibilisés, précipitent les
choses. Ici les stigmates nostalgiques de la grandeur sont réinvestis, et participent à la
pérennisation d'un imaginaire collectif de la puissance, pourtant évanescente. Les traces de
l’épopée industrielle du pays sont assimilées à son passé glorieux. De ce fait, c’est presque
naturellement que ces éléments viennent compléter la mémoire nationale et sont l’objet de
recherches46.
L’identification est moins aisée en France. Tout d’abord parce que la richesse et la
grandeur du pays y sont peut-être moins spontanément associées à l’industrie. La proximité
(réelle mais aussi largement mythique47) d’une histoire rurale y étant probablement pour
quelque chose.
C’est donc par le biais de quelques amateurs « éclairés » et chercheurs en sciences
sociales que s’entreprend la lente sensibilisation.
Pour ces derniers, dont les plus importants sont Maurice Daumas48 et Louis
Bergeron49, « l’archéologie industrielle n’est pas une nouvelle discipline dans le champ
historique mais une nouvelle approche historique de l’industrie »50. Ainsi, elle est l’activité
spécifique qui se donne pour objet d’éclairer les témoignages matériels de l’activité
industrielle, entendus au sens large : immobilier industriel (bâtiments, carreaux de fosse,
logement), mobilier lourd (locomotives, machines outils), mobilier léger (outils), archives
(dessin, plans, photos, fichiers du personnel), patrimoine humain (mémoire ouvrière, histoire
du travail).
Ces témoignages, et c’est ici que l’on retrouve l’héritage de la Nouvelle Histoire,
doivent être considérés comme des outils indispensables à la recherche historique, au même
45 Même s’ils contestent le terme « discipline » ; Cf. infra. 46 Buchanan (R.A.), industrial Archeology in Brittain, Harmondsworth, Penguin Books, 1977. 47 Pour s’en convaincre, il suffit d’apprécier la place qu’occupe encore aujourd’hui dans les esprits, l’imaginaire d’une France rurale, dans un pays pourtant massivement urbain. 48 Daumas, L’archéologie industrielle en France, Paris, Laffont, 1980. 49 Bergeron Louis, Le patrimoine industriel, un nouveau territoire, Paris, Ed. Liris, 1996. 50 Selon Denis Woronoff, « L’archéologie industrielle en France :un nouveau chantier », Histoire économie et société,1990, p.448, cité par Jean-Yves Andrieux in Le patrimoine industriel, Paris, Presse Universitaire de France, collection Que sais-je, 1992.
- 14 -
titre que tout document écrit. Ces chercheurs militent dès lors pour la conservation et la
redécouverte de tous les sites industriels, qui, chacun à leur manière, témoignent des
évolutions techniques et des adaptations d’une organisation à des contraintes sans cesse
renouvelées.
De la proto-industrie rurale aux centrales électriques, les vestiges étudiés rendent
intelligibles les évolutions sur le temps long51, qui ont forgé un système de production
spécifique.
C’est en ce sens que le patrimoine industriel devient progressivement un objet de
connaissance.
Les jalons d’un nouveau territoire52 à explorer sont posés.
Le musée de Lewarde saura tirer partie de ces réflexions. Elles lui fourniront bien
souvent des cadres de légitimation dans un contexte général où le patrimoine industriel suscite
encore bien des réserves, pour ne pas dire de la réprobation.
L’archéologie industrielle, première caution scientifique du Centre, tend alors à
imprimer sa marque sur celui-ci. C’est très net, par exemple, dans le premier projet de
réhabilitation architecturale proposé par l’architecte Henri Guchez (ici l’avant-propos53) au
tout début des années 80. La tentation monumentale en plus : Chaque ère de civilisation qui touche à sa fin se resserre sur elle-
même (…). Sitôt la part faite à l’étonnement, les réactions commencent dans le
respect de la nature humaine (sic), l’idée de vengeance apparaît et, pour assumer une dernière fois une maîtrise chèrement acquise, on se met à détruire, on croit effacer les traces de ce que l’on croit « échec » et, par delà, se rendre disponible, neuf à une autre civilisation(…).
Le moment est venu pour éviter un deuxième échec ; la prise de conscience mondiale pour l’archéologie industrielle est aujourd’hui évidence (c’est nous qui soulignons). Il est nécessaire de sauver, de conserver et d’animer ce qui est et reste valable - ce qui est mémoire de l’histoire- et que cette mémoire ne soit pas que livresque ou simple image en rupture d’environnement, d’ambiance et d’échelle.
Il nous apparaît, après consultation des archives, que cette discipline pionnière, telle
qu’elle fut délimitée par les chercheurs susmentionnés, souvent issus de L’Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociale54, a constitué un cadre de référence privilégié pour de nombreuses
initiatives patrimoniales en site industriel, dont celle de Lewarde. En plus de fournir une base
théorique indispensable, elle a souvent contribué à sensibiliser davantage d’individus, d’abord
dans les cercles restreints des spécialistes puis dans ceux des décideurs, sur le sort des
monuments industriels en péril et sur leur intérêt potentiel, préfigurant l’engagement des
51 Au sens où l’entendait Fernand Braudel. 52 Louis Bergeron, op. cit. 53 Cf. annexe n°3. 54 Encore aujourd’hui le conservateur, Mlle Paris, est une élève de Louis Bergeron.
- 15 -
collectivités. Comme le rappelle M. Chartier de L’EHESS dans une note d’information55
communiquée au CHM et extraite des archives:
Jusqu’à une date récente, la conservation du patrimoine était guidée
par un souci « monumental et esthétique» à la fois, qui n’était jamais remis en question, tant cela semblait aller de soi. Il apparaît pourtant nécessaire de préserver les lieux et les objets laissés par la civilisation industrielle car ils incarnent l’histoire du travail et au total, de la société tout entière, au même titre qu’une cathédrale ou qu’un château.
Or la civilisation industrielle, on le mesure mieux aujourd’hui, est une civilisation de l’éphémère, de l’obsolescence rapide des machines et des produits. Ses traces sont donc particulièrement fragiles. La responsabilité de notre génération est de les recueillir de les préserver, de les valoriser avant qu’elles ne soient complètement effacées. Cela justifie la nécessité de l’archéologie industrielle.
On comprend mieux à la lecture de cet extrait en quoi la création du CHM s’inscrit
dans une extension du champ patrimonial, considéré sous un jour nouveau, à l’aune des
apports de l’archéologie industrielle.
2. Les pesanteurs de l’esthétisme
Si les vestiges industriels sont devenus objets de savoir, les premières expériences
d’investissement patrimonial vont contribuer, de manière beaucoup plus sélective, à créer des
lieux de mémoires sur les débris de l’activité révolue.
Les processus de sélection et de patrimonialisation qui se précisent alors, tracent
bientôt la « carte » d’un patrimoine industriel. C’est à la lumière de cette carte que l’on peut
analyser les spécificités de l’édification du CHM et les tendances lourdes dans lesquelles elle
s’inscrit.
Quels sont ces processus ?
Dans un premier temps, c’est souvent à l’aune de leur intérêt « esthétique » supposé
que certains édifices industriels vont être considérés (ou non) comme des éléments de
patrimoine, susceptibles d’être mis en valeur. L’objectif de témoignage historique est alors
rendu subsidiaire.
Ainsi, les premiers vestiges qui attirent l’attention sont ceux qui reproduisent les
canons de l’architecture bourgeoise ou religieuse. Les « châteaux de l’industrie56 » de style
néo-régionnaliste du Nord de la France captent les regards, non pour l’activité dont ils
témoignent mais pour celle qu’ils singent en quelque sorte. Ce critère décisif (de la conformité
avec l’esthétique académique) explique l’intérêt précoce porté aux gares ou aux grandes 55 Non datée mais rédigée avant 1978 d’après le classement en archives. Cf. annexe n°4.
- 16 -
halles, palais modernes dont l’aspect rappelle celui des édifices civils prestigieux. Les grandes
opérations médiatisées de réhabilitation de la gare d’Orsay ou des Halles de la Villette au
début des années 80 sont symptomatiques de ce nouvel intérêt sélectif, de plus en plus
répandu mais qui exclut les sites d’extraction ou usines sidérurgiques « sans » références
formelles connues57. Ainsi, il prépare plus qu’il ne consacre une dichotomie mal admise entre
valeur esthétique et patrimoniale.
Le cas de Lewarde est exemplaire de cette tension. En effet, tout en participant par
leur initiative à ce nouveau regard patrimonial, les acteurs ne parviennent que partiellement à
se déprendre des critères esthétiques qui sont souvent mis en avant pour justifier le choix de la
fosse Delloye, peu représentative des sites d’extraction58 et excentrée par rapport au centre du
Bassin (région de Lens). Celui-ci, d’abord dicté par les circonstances et la nécessité de trouver
rapidement un endroit où entreposer les objets collectés59, est vite devenu un argument aux
yeux des Houillères dans la constitution d’un musée in situ. Ecoutons les acteurs de l’époque
à ce sujet.
M. Liégeois, chef du service des Relations Publiques des Houillères qui a eu la
responsabilité d’installer le Centre, précise dans une réunion du 1er Mars 1979 organisée par
la conférence permanente des chambres de commerce et d’industrie françaises et belges et
consacrée à l’archéologie industrielle :
Au-delà du danger de passéisme60 (de la mine de Zola à celle
d’aujourd’hui, une longue route a été faite), il faut mettre en valeur ce qui est esthétique, digne d’intérêt, et sauver ce qui risquerait d’être détruit ou oublié.
Aussi, le site de la fosse Delloye, « dans son site dégagé et agréable61 », par « son
caractère typique et son environnement62 », avec ses deux chevalements de type Eiffel et ses
bâtiments de briques rouges, s’accommode mieux de cette conception encore esthétisante du
56 Titre d’un ouvrage précurseur de Lise Grenier et H.Benedetti paru en 1978 aux archives de l’architecture moderne. 57 Seuls quelques architectes, héritiers en cela de l’école fonctionnaliste du Bauhaus, montrent déjà un intérêt pour la fonctionnalité, la rationalité ou l’audace technique dont font preuve certains de ces édifices, déplaçant le référentiel esthétique plus qu’ils ne le remettent en cause. 58 En fait, la fosse Delloye est moins atypique par sa physionomie ( sa configuration à deux chevalements, de taille moyenne, est représentative des sites d’extraction construits pendant l’entre-deux guerre dans le bassin, mais diffère de celle des sites géants du type du 9-9bis de Oignies ou du 11-19 de Loos-en-Gohelle, plus importants en terme de production et de personnel mais bien moins nombreux) que par sa situation. Ni terrils, ni corons mais une fosse en pleine campagne, excentrée, sur un site « pittoresque ». 59 Cette question fera l’objet de notre partie I.B.1 60 On analysera dans la deuxième partie les usages sociaux de la mémoire de la mine que ce jugement implique. 61 « La fosse Delloye présente, dans un site dégagé et agréable, un ensemble complet des techniques d’exploitation caractéristiques des années 20 ». Extrait de l’allocution prononcée par Jacques Ragot, Président des HBNPC, au moment de la création de l’association du Centre Historique Minier en 1982, dont il deviendra président. Cf. annexe n°13. 62 « Après visite des lieux, du site et malgré l’absence de terril et de cité minière accolés à la fosse (car j’aurais voulu un ensemble minier complet) Delloye m’enchanta par son caractère typique, par son environnement. D’où
- 17 -
patrimoine industriel que les fosses plus récentes, construites en béton armé et en tôles, dans
un environnement souvent exclusivement minéral fait de terris et de remblais qui leur donnent
l’aspect de paysages lunaires63.
On retrouve ce dilemme de la conservation dans les propos de M. Turbelin qui a
succédé à M. Liégeois à la tête du service des Relations publiques et qui fut secrétaire du
Centre dans les années 80. Nous l’avons rencontré :
Loin d’être dicté par l’évidence ou des considérations exclusivement pratiques, le
choix de Lewarde comme lieu de mémoire, s’inscrit donc aussi dans les normes
d’investissement patrimonial de son époque64.
L’idée que le patrimoine industriel « court de grands risques à n’être estimé que
d’après des critères utilisés pour la sauvegarde et la conservation d’ouvrages esthétiques »65,
est encore loin d’avoir fait tout son chemin, aujourd’hui encore.
3. Des musées de société au musée de la mine de Lewarde
La création de lieux de mémoire consacrés à l’industrie, de musées in situ, implique
bien plus qu’un simple intérêt porté à des « enveloppes ». Elle relève d’une nouvelle
démarche et d’un nouveau regard. Il ne s’agit plus de créer dans le créé mais de réincarner le
créé. La perspective est bien différente de celle qui vide des usines pour en faire des bureaux
ou des logements. L’usine devient une fin là où elle restait bien souvent un moyen, un
ce choix. » Extrait d’un article rédigé en 1995 par Alexis Destruys, ancien Secrétaire Général des HBNPC, grand initiateur du musée de Lewarde en 1973, à l’attention du bulletin des amis du charbon (AMICHAR). 63 A ce propos voir le bel ouvrage en forme d’inventaire (après fermeture) de Guy Dubois et Jean Marie Minot, Histoire des mines du Nord et du Pas-de-Calais, tome 2 de 1946 à 1992, auto-édition, 1992. Cf. annexe n°1 pour une vue générale du site. 64 En cela nous rejoignons tout à fait Dominique Poulot : « L’histoire de la construction du patrimoine est celle de ce qui est digne d’être conservé, collecté exposé. Comme telle elle relève largement d’une histoire des lieux communs de la rhétorique cultivée et des préjugés davantage qu’elle ne donne prétexte à un récitatif des avancées de la science et de la conscience patrimoniale. » extrait de : « Le patrimoine des musées : pour une rhétorique révolutionnaire », in Genèses II, mars 1993, p. 25-49. 65 Louis Bergeron, op. cit.
F.D - Le choix de la fosse Delloye à Lewarde était-il un bon choix ? M. Turbelin - C’était un bon choix et un mauvais choix à la fois. Un bon choix parce que c’est une structure de vieille fosse qui rappelle beaucoup les structures d’avant guerre, à un moment où le bassin était florissant. Ceci étant, après on a évolué vers des fosses de type 9-9bis d’Oignies. Ce n’étaient plus du tout les mêmes fosses. A la limite, moi j’aime bien Lewarde. Il est dans la nature et puis c’est un truc vachement mignon. Il ne devait pas y avoir beaucoup de charbon mais du point de vue structure, paysage… Il n’est pas représentatif des gros sièges. Mais les gros sièges on les compte sur les doigts de la main. Vous aviez Noeux, Béthune, Lens, Oignies, Gayant, Wallers-Aremberg…voilà les gros sièges. Après les autres c’étaient des sièges avec deux puits, à 1000 mètres. On aurait pu prendre la fosse d’Oignies… mais à cette époque elle marchait encore.
- 18 -
support. On ne se contente pas de préserver la fosse Delloye pour y installer des entreprises
nouvelles, on en fait un musée de l’activité défunte et de ses hommes, un musée de société.
Ce nouvel horizon du patrimoine industriel, ici encore, s’inscrit dans des dynamiques
qui dépassent le simple cadre du musée de Lewarde et qui lui sont parfois bien antérieures.
Les expériences de muséification passées méritent d’être brièvement rappelées. Selon qu’il
s’en démarque ou qu’il s’en rapproche, elles vont contribuer à l’identifier.
Le premier « héritage » est celui des musées des techniques ou de l’industrie. Ils ne
sont pas nouveaux : depuis le conservatoire National des Arts et Métiers, créé en 1794 à Paris
jusqu’au musées industriels (Lille, Lyon, St.-Etienne) qui ont fleuri sous le Second-Empire.
La fonction proclamée de ces derniers, qui rassemblent souvent collections d’objets et de
machines, est claire : exalter le progrès industriel, valoriser le travail, magnifier les inventions.
Ils apparaissent comme des musées de la croissance, bien loin des « musées de la
récession »66. Situés dans des bâtiments dédiés à l’exposition (et qui n’ont jamais servi à la
production) ils glorifient la science et l’industrie plus qu’ils ne la montrent. Toute
ethnographie en est d’ailleurs absente. Ce sont donc avant tout des vitrines de l’économie
française. On perçoit immédiatement tout ce qui distingue ces musées de celui de la mine de
Lewarde, tant du point de vue du contenu que de la forme (Le CHM montre une activité en
déclin67 avec des prétentions ethnographiques). L’emprise (parfois inconsciente) de ce type de
musée ou de ses survivances fut pourtant bien réelle dans l’esprit de certains acteurs du CHM,
notamment à ses débuts68.
L’autre héritage est celui des musées du folklore ou d’ethnographie populaire. Ils ont
connu leur heure de gloire sous la Troisième République. Contrairement aux musées des
techniques, expressions parfaites du positivisme, qui inculquent foi en l’avenir, ces musées
donnent à voir une beauté que nous aurions perdue69. Ils renvoient pour la plupart à un âge
d’or mythique, fait de sociabilité traditionnelle et d’authenticité. Ce discours de la nostalgie70
imprègne les musées des Arts et Traditions Populaires qui ressemblent davantage que les
musées de l’industrie et des techniques, et c’est un paradoxe, au CHM.
Leur point commun est très fort : au commencement, il y a une mort annoncée : ici
celle d’une société rurale déjà disparue, là celle d’une activité minière dont on pressent la fin
66 Comme les qualifia un journaliste de libération au début des années 80. 67 Puis révolue. 68 L’Etat eut longtemps la tentation d’en faire une vitrine des nouvelles technologies du charbon. Nous développerons ce point en II.B.2. 69 Voir le merveilleux texte de M. de Certeau dont nous aurons l’occasion de reparler , « La beauté du mort » in La culture au pluriel, pp. 45-72, Paris, Seuil, 1993 (1ère édition : La beauté du mort : le concept de « culture populaire », in Politique aujourd’hui, déc. 1970). 70 Cf. la communication de Krzysztof Pomian au premier colloque national des musées de société ( Mulhouse, 1991), intitulé : « Musées de société : de la nostalgie à l’anticipation. ».
- 19 -
prochaine. Dans les deux cas, le musée témoigne de ce qui n’est plus ou, davantage, de ce qui
ne sera bientôt plus et qu’il faut donc collecter devant l’imminence de la perte.
La différence tient cependant dans la nature du témoignage : en effet, l’âge industriel
renvoie rarement, dans les imaginaires collectifs, à un âge d’or71. Quand il le fait, c’est
indirectement, à travers une sociabilité au travail ou un courage à la tâche exaltés a posteriori.
Il manque encore une étape dans ce panorama des expériences patrimoniales : celle qui
va légitimer l’intérêt porté par une population à son patrimoine industriel et permettre une
appropriation plus large.
Le développement des écomusées, troisième génération de ces musées du quotidien, à
partir de la fin des années 6072, se fait quasiment en parallèle de celui de Lewarde. Ils vont
initier une véritable révolution muséologique. Ils entendent en effet mettre en évidence les
rapports de l’homme et de son milieu sur un territoire donné. Pour de tels musées, comme
pour les musées communautaires, il ne s’agit plus de délivrer un message universel à l’adresse
d’un public indéterminé, mais de mettre la population locale en contact avec sa propre
histoire. Le discours y est donc identitaire.
Après les premiers expériences au sein de parcs naturels régionaux, se développent
progressivement des écomusées en site industriel. Celui du Creusot, créé sur le site des usines
Schneider en 1972 fera date. L’écomusée de Fourmies-Trélon est créé en 1981, soit un an
avant la constitution de l’association du CHM. L’influence de ces initiatives est décisive dans
l’émergence d’un musée de la mine. Pour s’en convaincre, un extrait de la communication de
Jocelyn de Noblet73, à la première conférence nationale pour l’étude et la mise en valeur du
patrimoine industriel et le développement de la culture technique74, organisée à Lewarde en
juillet 1978 et à laquelle participent les promoteurs du CHM. Nous la reproduisons assez
largement dans la mesure ou elle soulève de nombreuses questions fondamentales qui seront
traitées par la suite :
Il apparaît urgent aujourd’hui que des centres culturels et techniques
soient implantés dans une dizaine de régions industrielles (…). L’écomusée industriel par sa structure éclatée et sa philosophie offre une sorte de schéma directeur assez souple (…). Qu’est-ce qu’un écomusée ? Pour répondre à cette question nous reprendrons des éléments de la définition que Georges-
71 Contrairement par exemple à la société rurale selon l’image réinventée et mobilisatrice de la paysannerie vendéenne telle qu’elle est analysée par J.C Martin et Charles Suaud, op. cit. 72 Pour une chronologie détaillée voir Emilia Vaillant, « Les musées de société en France, chronologie et définition », Actes du colloque de Mulhouse « Musées et société », 1991, pp. 16-37. 73 Intitulée : « la ré-appropriation du phénomène industriel ». 74 Relayée abondamment dans la presse : Edelmann Frédéric, « L’archéologie industrielle en France, un train de retard », Le Monde du 20 juillet 1978 ; « A quand l’ouverture d’un Centre Historique Minier ? », Nord économique, numéro du 21 juillet au 4 août 1978.
- 20 -
Henri Rivière en a donné75, en la modifiant pour qu’elle s’applique aux phénomènes industriels :
Un écomusée, ce n’est pas un musée comme les autres. Un écomusée, c’est une chose qu’un pouvoir et une population conçoivent, fabriquent et exploitent ensemble. (c’est nous qui soulignons)
(…) C’est un miroir où cette population se regarde, pour s’y reconnaître, où elle cherche l’explication du territoire auquel elle est attachée, jointe à celle des populations qui l’y ont précédée.
Un miroir que cette population tend à ses hôtes, pour s’en faire mieux comprendre, dans le respect de son travail, de ses comportements, de son intimité. C’est un musée de l’homme et de l’industrie. L’homme y est interprété dans son milieu industriel.
C’est un musée du temps, quand l’explication remonte en deçà du temps où l’homme est apparu, s’étage à travers les temps préhistoriques et historiques qu’il a vécus, débouche sur le temps qu’il vit. Avec une ouverture sur les temps de demain, sans que, pour autant, l’écomusée se pose en décideur, mais, en l’occurrence, joue un rôle d’information et d’analyse critique.
Un musée de l’espace. D’espaces ponctuels, où s’arrêter. D’espaces linéaires, où cheminer.
Un conservatoire, dans la mesure où il aide à préserver et mettre en valeur le patrimoine industriel de la population concernée.
Un laboratoire, dans la mesure où il est matière à études théoriques et pratiques, autour de cette population et de son milieu.
Une école, dans la mesure où il aide à la formation des spécialistes intéressés à cette population et à son milieu, où il incite cette population à mieux appréhender les problèmes de son avenir.
Certes, tout n’apparaît pas simple, dans cette croissance de l’écomusée. Il y a de la part des responsables, le risque de mettre une population en cage à la façon d’un animal dans un zoo, et le risque de manipuler cette population.(c’est nous qui soulignons)
On perçoit toutes les révolutions contenues dans ce manifeste. Les Houillères sauront
en retenir certaines76 mais pour en oublier combien ? Ainsi, l’exposition permanente du CHM
s’achève par une citation de G.H Rivière77 censée justifier la création du musée. Mais pour
qu’un tel programme ait un sens, il était indispensable que les membres de la communauté ne
soient pas simplement, passifs récepteurs d’un message délivré par des spécialistes étrangers à
elle. C’était le sens profond des trois comités gérant les écomusées à parité : le comité
d’usagers réunissant les associations et les habitants78, le comité scientifique où siègent des
spécialistes, et enfin le comité de gestion laissant une large place aux élus locaux et aux
pouvoirs publics. Rien de tout cela au CHM. Seul le discours mobilisateur élaboré autour des
écomusées et sensibilisant sur les potentialités du patrimoine industriel a été retenu, délaissant
les principes d’organisation pourtant premiers. Les habitants furent complètement absents de
l’édification de ce lieu de mémoire. C’est ce qui nous fait dire, que par nombre des aspects de
75 La muséologie selon Georges Henri Rivière, cours de muséologie/textes et témoignages, Paris, ouvr. coll, Dunod, 1989. 76 Cf. I.B. 77 Reprenant notamment la métaphore du miroir, elle est reproduite p. 50. 78 Jusqu’à 40000 adhérents et 750 associations au Creusot en 1977.
- 21 -
son édification et malgré des tentatives d’ouverture récentes, le CHM doit plutôt être qualifié
d’anti-écomusée79.
La forme prise par le musée de Lewarde a donc directement à voir avec l’évolution
des musées de société et des réflexions qui les sous-tendent. Autant par ce qu’elle leur doit
que par ce dont elle se démarque.
4. Une nouvelle politique culturelle : mythes et réalité d’un discours d’Etat
L’un des dogmes des politiques publiques d’aménagement en matière de traitement
des « restes industriels » s’est longtemps résumé à l’éradication pure et simple. Du côté des
politiques culturelles et muséales, c’est d’abord avec condescendance que l’on s’est penché
sur ces musées du quotidien, auquel on reprochait de ne pas être des musées des beaux-arts
( !) 80. Le moment où se constitue le CHM et surtout où il se développe (de la fin des années
70 aux débuts des années 80) semble celui d’inflexions sensibles, et d’un nouveau regard de
l’Etat, tout au moins dans le discours. Ce retournement (dont on montrera aussi les limites)
n’a pas été sans importance dans l’épopée du Centre. En effet, et comme le rappelle Vincent
Dubois dans le résumé de sa thèse81 : « l’Etat est désormais devenu un lieu central de la
problématisation et du traitement des questions relevant conventionnellement de la catégorie
culture ». On ne peut donc faire l’économie d’une analyse de son rôle, à travers les évolutions
de sa position et de ses engagements en matière de suivi et de mise en valeur du patrimoine
industriel.
Premier élément à mentionner et qui va à l’encontre des idées reçues, la chronologie
de cet intérêt nouveau porté par l’Etat. Nos recherches aux archives du CHM nous ont montré
que les premières études menées par l’Etat central l’avaient été dès la fin des années 70 et
donc bien avant le ministère « Jack Lang », pourtant généralement associé à cette politique
culturelle élargie, en direction des nouveaux musées et patrimoines.
79 On consacrera la partie II.A.3 à la démonstration de cette affirmation. 80 Dans sa version la plus élaborée cette critique oppose la liberté de l’œuvre d’art à la servitude de l’objet, condamné au discours historique. voir l’article d’Edouard Pommier, « prolifération du musée », Le débat, 65, 1991, pp. 144-149 et son antithèse : Léniaud (Jean Michel), « La mauvaise conscience patrimoniale », Le débat, n°65, mai 91. 81 Dubois (Vincent), La culture comme catégorie d’intervention publique, thèse de doctorat, Université Lumière/Lyon 2, décembre 1994.
- 22 -
Dès 1978, Jocelyn de Noblet82 se voit confier une mission de réflexion par le Bureau
National de l’Information Scientifique et Technique du Ministère de l’industrie dont l’objectif
est triple83 : - Faire le point de la situation française en matière d’archéologie
industrielle, cette archéologie n’ayant pas seulement pour objet le lointain passé industriel mais aussi les périodes les plus récentes (c’est l’auteur qui souligne)
- Examiner quelques exemples étrangers et expliquer leur financement. Voir les enseignements que nous pourrions en tirer
- Faire des propositions concrètes d’action à entreprendre rapidement dans plusieurs régions. Pour cela, il semble que le concept d’écomusée, pris dans son sens le plus large, puisse être considéré comme une référence
Jusqu’à une date récente, l’opinion française s’est désintéressée des
moyens de production de notre civilisation industrielle (…). Dans le cadre d’une politique de régionalisation, il est raisonnable de penser que des écomusées installés dans les principales zones industrielles puissent permettre de rendre compte de la personnalité et du développement des techniques, dans toutes leurs diversités et dans leurs interactions avec d’autres domaines culturels.
Ainsi, cette mission84 et ses objectifs avoués annoncent un nouvel intérêt de l’Etat et
en filigranes, d’éventuelles politiques publiques à venir. On peut déjà85 y remarquer la
prégnance d’une approche par la technique du patrimoine, révélatrice de l’administration à
l’origine de la démarche. Le cadre de référence reste cependant celui de l’écomusée.
L’autre événement décisif, précurseur d’un engagement de l’Etat, fut la mission
confiée par le Délégué à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale auprès du
Premier Ministre, à Yves Malecot, président du Comité d’information et de Liaison pour
l’Archéologie, l’étude et la mise en valeur du patrimoine industriel (CILAC)86.
Dans sa lettre de mission87 datée du 30 Novembre 1979, le Délégué déclare : Divers projets ayant trait à la mise en valeur des patrimoines
industriels régionaux et au développement de la culture technique sont en cours d’élaboration dans les régions et font l’objet de demandes de subventions auprès de la DATAR (…).
Au cours de mes déplacements dans les régions j’observe que l’intérêt pour ces thèmes va croissant. Cet intérêt n’est d’ailleurs pas sans rapport avec le projet du futur musée des sciences et techniques de la Villette, et le réseau national d’échanges dont il sera l’élément moteur. (…) J’envisage de réunir dans ce but un groupe de travail associant les représentants des pouvoirs publics à ceux des milieux économiques et scientifiques concernés ainsi que les concepteurs du futur musée de La Villette. Il aurait pour objectif d’identifier les principaux problèmes que posent le choix et la réalisation des projets en cours d’élaboration dans les régions et de proposer des solutions. Ces propositions devraient tenir compte non seulement de l’utilité de sauvegarder in situ certains témoignages des industries et des techniques qui
82 Voir supra. 83 Voir la lettre d’information envoyée au musée de Lewarde et retrouvée en archive. Cf. annexe n°5. 84 Qui aboutira entre autre à la conférence susmentionnée p.19. 85 On développera plus longuement dans la deuxième partie les enjeux de cette appropriation technique. 86 Association nationale créé en 1978, à l’initiative notamment des chercheurs de l’EHESS, dont on a montré (Cf. I. A. 1) le rôle prédominant dans la fondation d’une archéologie industrielle française. 87 Cf. annexe n°6.
- 23 -
ont marqué une région mais aussi de la nécessité de les insérer dans le champ des activités et des intérêts actuels des communautés locales concernées.
L’intérêt de l’Etat s’affirme et se précise. Moins centré sur l’archéologie industrielle,
davantage sur la culture scientifique et technique. Sur ce point, le projet d’installation d’un
musée des sciences à La Villette est déterminant. Il tend en effet à devenir un nouveau cadre
de référence et à imprégner les réflexions en cours. On comprend dès lors pourquoi les
structures liées à l’aménagement du territoire (DATAR, CIAT88) vont jouer un rôle
prépondérant dans ces premières années d’implication de l’Etat : Les musées de régions y
sont perçus avant tout comme des futurs appendices du grand centre parisien en préparation,
qu’il faut coordonner.
A Lewarde, la référence aux Centres de Culture Scientifique, Technique et
Industrielle, suite au rapport Malecot89 rendu en Avril 198190, prend progressivement le pas
sur celle de l’écomusée : Un centre de culture scientifique, technique et industrielle est une
institution assurant les fonctions de recherche, d’étude, de conservation et de présentation d’éléments de culture technique, jusque dans ses aspects les plus actuels, en vue de leur mise en valeur pour contribuer à la transmission des connaissances scientifiques et techniques et favoriser l’innovation dans le cadre d’actions pédagogiques complètes. Il s’appuie le plus souvent pour cela sur un patrimoine constitué par des bâtiments, des collections et des documents relatifs à une ou plusieurs activités techniques ou industrielles dans une région donnée91.
En même temps que la CSTI entre au musée, l’« Homme » passe au second plan et
devient le domaine réservé des musées des Arts et Traditions Populaires. Les nouveaux
musées de société, notamment le CHM, subiront ce nouveau tropisme de la culture
scientifique92.
Ainsi, le gouvernement de l’union de la gauche, loin de « rencontrer » le patrimoine
industriel, hérite de réflexions déjà entamées qu’il poursuivra et concrétisera dans un premier
temps, avant d’innover à la marge. La grande nouveauté va réside surtout dans les moyens
consacrés. La période précédente fut riche, davantage de projets et de déclarations d’intention
que d’engagements financiers de l’Etat. Ainsi le CIAT de 1982, s’il ne fait souvent que
reprendre les recommandations du rapport Malecot, contrairement à ce qu’il affirme93, dégage
des moyens budgétaires pour les mener à bien et qui émanent notamment (là c’est une réelle
nouveauté) du Ministère de la Culture dont le budget a doublé en 1982 et qui s’impose de ce 88 Comité interministériel d’Aménagement du Territoire. 89 Au titre explicite : « Culture technique et aménagement du territoire, pour un réseau de centre régionaux » 90 Soit juste avant l’arrivée au pouvoir de François Mitterrand. 91 Extrait du rapport. 92 Dans lequel on voit déjà poindre quelques-uns uns des enjeux (le passé au service de la reconversion ?) dont le CHM va être le lieu et que nous étudierons dans le détail en II.A
- 24 -
fait comme un nouvel acteur94. Ainsi 20 millions de francs sont programmés en
investissement, qui vont permettre avec l’appoint des collectivités d’entamer des opérations.
Ce n’est pas un hasard si l’association de gestion du CHM voit le jour en 1982, à un moment
où l’Etat peut s’engager aux côtés des HBNPC et du Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais
(par contractualisation à l’intérieur d’une charte culturelle régionale). Parallèlement, est créé
en 1983, sous l’impulsion d’Isaac Chiva à la Direction du Patrimoine, une cellule du
patrimoine industrielle auprès de l’inventaire général des monuments historiques. Les
alternatives à la démolition se multiplient désormais, à l’instigation de l’Etat.
Parfois les initiatives locales de préservation avaient précédé cet engagement inédit95.
Elles prirent une nouvelle dimension avec l’appui de l’Etat.
Le discours produit par « l’Etat culturel 96» est donc celui d’un intérêt croissant à
l’égard des musées de société97. Il faut pourtant relativiser l’ampleur de la révolution
culturelle annoncée. Le budget qui leur est consacré reste bien inférieur à celui alloué aux
musées de beaux-arts. Pis, l’Etat refuse souvent de participer davantage aux budgets des
musées de société, alors que ces derniers s’autofinancent parfois à plus de 50% (65% pour le
CHM en 97), contre 20% à peine pour les musées de beaux-arts. Confronté à des difficultés
financières depuis la perte de la subvention des Houillères98 au moment de leur disparition en
1992, le CHM interpelle l’Etat depuis plusieurs années pour qu’il compense en partie ce
préjudice (les tarifs ne pouvant plus, raisonnablement, être augmentés99). En vain pour le
moment. S’il occupe une place décisive en matière d’expertise et de contrôle100, l’Etat, par
l’intermédiaire de la DRAC, finance finalement assez peu101 le CHM au regard de la
participation des collectivités locales102, qui payent davantage et disposent d’un contrôle bien
93 « La culture scientifique et technique est un enjeu essentiel pour la France et entre désormais dans les priorités de l’action gouvernementale : elle est au centre de réflexions conduites sur la nouvelle politique culturelle… » extrait du compte-rendu du CIAT. 94 Commandé en 1981 par le ministère de la Culture, le rapport de François Querrien, pour une nouvelle politique du patrimoine, appelant à considérer l’héritage culturel comme une « génétique sociale », fait date de cet engagement. 95 C’est le cas à Lewarde, bien sûr, où les Houillères interviennent dès 1973 mais également dans de nombreux sites investis pour leur potentiel touristique par des municipalités comme les Forges de Buffon en Bourgogne. 96 Titre polémique du pamphlet de Marc Fumaroli, L’Etat Culturel, Essai sur une religion moderne, Editions de Fallois, 1992. 97 Voir comme illustration récente l’entretien avec Françoise Cachin, Directeur des musées de France, « Musées : du patrimoine à l’éducation », Le débat, numéro spécial sur le patrimoine, avril-juin 1998, pp. 94-112. 98 Qui représentait un quart de son budget. 99 Ils s’élèvent à 60F /personne en saison pleine (plein tarif). 100 Lewarde est un musée contrôlé sous l’autorité de l’inspection des musées de France et son conservateur dépend de la Direction des musées de France. 101 La part de l’Etat dans le financement du Centre atteint à peine 7% du budget avec 550000 F/an 102 C’est le résultat de la déconcentration culturelle, qui voit l’Etat central se désengager et les collectivités obligés de prendre le relais.
- 25 -
moindre103 (C’est ce qui fit dire à certains de nos interlocuteurs « que l’Etat tenait le beau
rôle »).
Les propos de M. Bourge, de la Direction de l’Action Culturelle au Conseil Régional
sont assez explicites concernant le désengagement financier de l’Etat :
Il faut encore ajouter que parmi les 38 musées nationaux complètement pris en charge
par l’Etat, se trouve un seul musée de société, qui plus est le plus ancien (musée des Arts et
Traditions populaires de Paris créé en 1937). A ce jour, le CHM, qui souhaiterait devenir
musée national, se voit répondre par la négative104. Si les restrictions budgétaires y sont pour
quelque chose, la priorité absolue accordée aux beaux-arts dans les faits, révèle aussi les
limites d’un discours d’Etat et le poids de cultures administratives anciennes. Ecoutons encore
M. Bourge :
B. Etapes et jalons de l’édification du Centre Historique Minier
L’histoire du Centre Historique Minier n’a jamais été un long fleuve tranquille. Des
débuts jusqu’à aujourd’hui se sont succédés, administrateurs, dirigeants, partenaires qui ont
influé sur le développement du Centre et lui ont donné sa forme actuelle.
En fonction du contexte de chaque époque, dont on vient de mettre en évidence
quelques éléments déterminants, mais aussi des personnalités aux commandes, s’est façonné
un lieu de mémoire qui aurait bien pu être différent.
103 Cf. p.34 pour un aperçu des parts relatives des différents partenaires dans le budget du CHM. 104 Voir en annexe (n°11) l’extrait du Journal officiel relatant l’intervention de M. Dolez à l’assemblée nationale (novembre 97), interrogeant le ministre de la culture et de la communication à ce sujet, et sa réponse.
F.D. – Aujourd’hui quelle est la politique du Conseil Régional en direction des musées dits de société ou techniques ? M. Bourge – Nous nous investissons de plus en plus en Culture Scientifique, Technique et Industrielle, étant donné que « l’Etat culture » se désengage totalement. C’est surtout le ministère de la Recherche (Direction de la recherche et de la technologie) qui aide au niveau CSTI, mais la Culture de moins en moins.
F.D. – Est-ce qu’il y a eu des réticences au sein de la Région s’agissant de soutenir les musées techniques ? M. Bourge – Non. Euh…les réticences on les sent surtout dans la corporation des conservateurs qui sont un peu plus élitistes. Nous soutenons aussi l’Association des conservateurs et ils ont un peu tendance à être portés sur les musées des beaux-arts plutôt que sur les musées de société. Ça se ressent à la DRAC aussi. Bon, nous nous trouvons que les musées des beaux-arts ils ont un peu trop privilégiés par rapport aux musées de société.
- 26 -
Avant d’entrer dans l’analyse de ses enjeux, il nous faut rappeler l’histoire de
l’édification du CHM à travers ses phases successives. En plus de constituer des balises
indispensables à la compréhension des enjeux passés et actuels, elles montreront l’importance
des acteurs, des événements, et écarteront toute tentation évolutionniste.
On a choisi de délimiter trois périodes qui correspondent à des mutations majeures du
Centre, tant dans sa forme muséographique et dans les problèmes qui se posent à lui, que dans
sa gouvernance.
1. De l’intuition d’Alexis Destruys à la naissance de l’Association du Centre Historique Minier (68-82)
A la fin des années 60, le Bassin entre dans sa phase de « récession active ». De
nombreux puits commencent à être démantelés. Cette nouvelle situation impose une réforme
des structures administratives des Houillères qui sera menée sous la présidence du Directeur
Général de l’époque, Max Hecquet, et s’avérera indirectement déterminante dans la
constitution d’un CHM sur initiative de l’entrepreneur.
Jusqu’à cette réforme, chaque groupe de production (Douai, Lens-Liévin, Béthune)
possède une large autonomie de gestion. Dans un souci de rationalisation on décide donc de
regrouper certaines fonctions administratives, jusque là assumées par chacun des groupes, en
une seule unité (les Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais), directement rattachée
à la Direction Générale. Cette concentration pose brutalement la question du devenir des
archives industrielles. En effet, chaque groupe qui disparaissait avait les siennes, désormais
menacées d’abandon. Comme le rappelle M. Turbelin, ancien directeur du service des
Relations Publiques des Houillères à la retraite et actuel secrétaire du CHM représentant
Charbonnages de France au C.A., l’initiative de sauvegarde fut d’abord loin d’apparaître
comme une évidence:
M.Turbelin - Il a fallu trouver des lieux pour stocker tout cela. A l’époque je peux vous garantir d’une chose, c’est que les exploitants ils s’en foutaient un peu. C’était pas leur problème. Je dirais, que même au niveau de la Direction Générale, beaucoup de Directeurs disaient que ça n’était pas la priorité. Il y avait pourtant au sein de la Direction Générale, un homme, Alexis Destruys, qui avait une autre idée de la chose. Pour moi c’est l’homme qui a fait le CHM, qui s’est dit qu’il était dommage que ce Bassin en voie de disparition ne garde pas son histoire. Destruys s’est dit "il faut faire quelque chose". Il est allé à l’assaut d’Hecquet (le directeur général de l’époque), je vous passe les conflits entre les deux personnages pendant un certain temps, puis enfin, Hecquet lui a dit si vous voulez le faire faites-le, mais je ne vous donne rien. Destruys s’est trouvé dans la nécessité de trouver rapidement un endroit pour stocker des archives puis du matériel.
- 27 -
C’est donc, dans un premier temps, face à une disparition programmée des archives
qu’intervient Alexis Destruys, en sa qualité de Secrétaire Général et donc de n°2 des
Houillères. Il entreprend d’abord de sensibiliser le Directeur Général, sur le sort des éléments
en péril (bientôt s’ajoutent aux archives, machines et outils).
Contrairement à ce qui a pu être affirmé par la suite105, l’idée de créer un musée de la
mine et même de stocker le matériel promis à la démolition, rencontre d’abord de nombreuses
réticences106 pour ne pas dire de « l’hostilité »107 au sein de l’entreprise et il faut attendre 1973
et une décision du Conseil d’Administration, pour qu’elle apporte son concours à Alexis
Destruys. Jusqu’à cette date, on préfère souvent ferrailler le matériel inutile pour en tirer
quelques sous et la préoccupation de conservation est encore bien loin d’être une conviction
partagée108. Elle s’imposera à partir du moment où les chefs de siège n’auront d’autre choix
que de collaborer et de se soumettre aux ordres de la Direction comme le rappelle M. Racle,
directeur de l’Association Nationale de Gestion des Retraites des agents des Mines (ANGR),
membre du conseil d’administration du CHM, représentant Charbonnages de France :
105 Voir par exemple le document diffusé par le CHM (annexe n°12 ) qui indique : « A la même époque (en 1971 à la fermeture de la fosse Delloye), la direction des Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais était déjà persuadée de l'importance de la création d’un Centre Historique Minier qui apporterait aux générations suivantes le témoignage de près de trois siècles d’activité minières. » 106 Nous en préciserons les raisons dans notre partie consacrée à l’enjeu de la muséification. 107 Selon les propres mots d’Alexis Destruys qualifiant, ainsi, dans un article éclairant publié en Avril 1995 dans le bulletin de l’associations des amis du Charbon (AMICHAR), le pouls de l’opinion et des dirigeants des HBNPC de l’époque. 108 Contra Louis Thbaut qui dans son article, « Un monument d’archéologie industrielle : le centre historique minier des Houillères Nord-Pas-de-Calais à Lewarde », in revue du Nord, n°241, avril-juin 1979 affirme à tort : « A quel point cette initiative répondait aux vœux profonds du personnel, on en a l’idée en constatant l’enthousiasme qui l’accueillit et le zèle qui anima d’un bout à l’autre du Bassin, les hommes qui expédièrent vers le Centre, très rapidement, tout ce qui leur semblait digne d’intérêt, bien que désormais hors service ».
F.D - Au sein des Houillères est-ce qu’il y au des réticences au moment de la création de ce musée ? M. Racle - A l’intérieur des Houillères il ne pouvait pas y avoir de réticences, n’est-ce pas. C’était comme à l’armée, on obéissait aux ordres (…). C’était marche ou crève donc il n’y avait aucun problème. Le commandement des Houillères tant qu’il y a eu des fosses n’a jamais laissé le choix aux gens, c’eût été trop grave. Donc il n’y avait pas de discussions, c’était une décision. Le premier qui se mettait en face, il se faisait dégommer. Pour vous donner un exemple, un chef de service juridique de Lens était appelé par le Directeur général qui disait Lundi vous allez à Lens, Lundi il changeait de poste et il allait à tel endroit. A fortiori un ingénieur de fosse ou un chef de siège d’extraction. F.D - C’est comme ça que ça a été géré donc, au moment de la mise en place ? M. Racle - Je ne dis pas que…Personne ne pouvait traîner des pieds ou mettre des bâtons dans les roues pour répondre à votre question. Maintenant qu’il n’y ait pas eu quelques chefs d’établissements, qui parce qu’ils étaient plus prêts de la fermeture, ont participé plus que d’autres…ça par contre c’était permis mais pas l’inverse.
- 28 -
Alexis Destruys organise donc le sauvetage seul, ou aidé de ses subalternes directs. Le
30 novembre 1972, il prend l’initiative d’envoyer aux directeurs et à tous les ingénieurs et
cadres supérieurs une note intitulée « Centre Historique Minier »109 : Il me semble nécessaire de penser dès maintenant à la création d’un
Centre Historique Minier du Nord et du Pas-de-Calais qui apportera aux générations qui nous suivront, le témoignage de plus de deux siècles d’activité minière industrielle et sociale.
Tout est à sauver : Livres, rapports, manuscrits, photos, cartes-plans, maquettes, œuvres d’art, mobilier, outils, machines spécifiques…
Une maison est réquisitionnée pour entreposer les récupérations.
La prochaine étape décisive aura pour cadre le Conseil d’administration des HBNPC
du 6 Novembre 1973, qui, sur proposition d’Alexis Destruys, approuvera la création d’un
Centre Historique Minier, incitant le personnel à participer à l’entreprise. Cette décision
annonce une nouvelle étape : celle de l’édification.
On peut s’interroger sur cette « volte-face » des Houillères qui ne doit pas seulement à
l’opiniâtreté de Destruys mais aussi, au changement de contexte. A partir du moment où la fin
programmée de l’activité est admise par tous, à la direction, ce qui n’était pas encore le cas
cinq ans plutôt, l’intérêt d’édifier un musée l’emporte sur le tabou de la fermeture qu’il vient
signifier110. Ce n’est pas un hasard, d’ailleurs, si cette mission sera confiée dès 1975 au
service des Relations publiques. Les dirigeants perçoivent, cinq ans après Destruys, le
bénéfice que l’entreprise peut en retirer en terme d’image et de communication. A partir de
cette date, les Houillères piloteront seules le projet, ce jusqu’en 1982, et la création de
l’association. Cette période incarne donc « une reprise en main directe du CHM par les
HBNPC »111 qui succède à l’initiative solitaire d’un de ses dirigeants.
C’est aussi l’époque des premiers projets :
L’étendue des collections déjà amassées implique de trouver des bâtiments et des
terrains pour les entreposer. Le site de la fosse Delloye à Lewarde, dont le démantèlement
était commencé, attire l’attention des pères fondateurs. Il est conforme à leurs canons de
l’esthétique industrielle112. S’ajoute l’opportunité d’un site peu dégradé, où l’exploitation
vient de s’achever et la proximité du siège des HBNPC de Douai. Il fera l’affaire.
109 Nous verrons l’importance du nom retenu en II.A. 110 Cet enjeu fondamental de la fin de l’activité en toile de fond de la création du CHM, sera étudié dans le détail dans la deuxième partie. 111 comme l’a qualifiée le conservateur actuel du musée, Mlle Agnès Paris, dans l’entretien qu’elle nous a accordé. 112 A ce propos l’article d’Olivier Kourchid, mémoire de la mémoire : quatre initiatives de conservation du patrimoine dans le Bassin Nord-Pas-de-Calais paru dans le Bulletin de l’IFRESI (n°3-4, Décembre 1997) est particulièrement éclairant (P.31): «Située en zone de campagne boisée et potentiellement touristique, sans aucun environnement minier autour, Delloye correspond bien, comme l’écrivent les promoteurs, à la « vulgarisation la plus fréquente (géographie à l’usage des enfants) d’une exploitation houillère : chevalement, bâtiments plantés dans la mer des champs ». L’argument est de faire une « présentation typique d’une époque révolue » ».
- 29 -
Le premier projet muséographique est révélateur de leur état d’esprit, ambitieux. Où
l’on parle déjà d’une « mine-image », reconstituant en surface113 des galeries et chantiers
d’extraction, telle qu’on peut quasiment la voir aujourd’hui. La direction refusera cependant
de budgéter les 10 millions de francs nécessaires à sa réalisation. Il faudra attendre dix ans
pour qu’elle se donne les moyens de ses projets.
Les interventions initiales consisteront donc essentiellement en la remise en état des
bâtiments et en la réinstallation des éléments du site déjà démantelés.
En 1975, le Centre Historique Minier est rattaché au service Relations Publiques, sous
la direction de René Liégeois. Ce dernier est chargé de prendre les premiers contacts avec les
collectivités locales. Le lien ne sera effectif qu’en …1982. Aux difficultés de communication
évidentes de M.Liégeois, qui avait réussi à s’attirer les foudres de tout le milieu culturel
régional selon nos interlocuteurs, s’ajoute le scepticisme des collectivités ou de
l’Etablissement public régional à l’égard du projet114. L’après-1975 se caractérise donc par la
poursuite des travaux de réfection et de la collecte d’objets, en plus d’un pré-classement des
archives. Le centre est ouvert au public de façon ponctuelle à partir de 1976.
L’autre l’héritage important de cette époque relève d’une toute autre logique qui
dépasse le simple souci de conservation. Un projet d’aménagement architectural est confié en
1980 à l’architecte belge Henri Guchez dont l’intervention spectaculaire sur les bâtiments du
Grand-Hornu115 avait convaincu les HBNPC116 de lui laisser carte blanche à Lewarde. La
volonté affichée d’Henri Guchez était de faire de Lewarde une nouvelle cathédrale117, de lui
donner tous les attributs d’un monument118. Derrière l’allégorie, la glorification d’une certaine
image transfigurée de la mine est patente. Le conservateur actuel revendique depuis un droit
d’inventaire sur certaines de ses interventions, menées sans projet d’ensemble et sans
accompagnement scientifique. D’autre part, les altérations apportées (verrière centrale,
nouveau bâtiment) ont rendu impossible un éventuel classement du site.
A la « modeste » ambition de stockage des débuts se substitue donc, dès cette époque,
un parti pris muséographique, sous la houlette exclusive du service des Relations Publiques
des Houillères.
113 L’idée d’organiser des visites de chantiers sur site (en sous-sol) avait du être rapidement abandonnée en raison des contraintes de sécurité et des frais de maintenance colossaux. 114 Nous verrons pourquoi ensuite. 115 Ensemble industriel et social édifié près de Mons, en 1825, sous le mot d’ordre « d’attirer la main d’œuvre par l’appât d’un bien-être inouï » selon l’expression de l’industriel, rapportée par Alexis Destruys dans son article, op. cit. 116 Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais. 117 Le local industriel qui accueille le restaurant du musée fut d’ailleurs complètement remanié, à la façon d’une chapelle de Sainte Barbe. 118 Il reprend d’ailleurs fréquemment et hors contexte une citation attribuée à Foucault : « L’histoire c’est ce qui transforme les documents en monuments ».
- 30 -
2. De l’arrivée des nouveaux acteurs au désengagement des Houillères (82-90)
Depuis 1978119, l’idée de créer une association loi 1901 pour gérer et animer le Centre
a fait son chemin. La charge financière qui pèse sur les Houillères est très lourde (déjà plus de
10 millions de francs investis) et l’ouverture au public nécessite qu’une véritable structure se
mette en place qui ne soit pas seulement composée de quelques personnes du service des
Relations Publiques. Le nouveau statut associatif permettrait au Centre de recevoir des
subventions de la part de l’Etat (et des nouvelles collectivités locales issues des lois de
décentralisation de 1982) voire d’obtenir du personnel supplémentaire en détachement.
En 1982, le contexte semble favorable120 pour que les houillères essaient d’associer
d’autres acteurs au projet, déjà bien entamé et qui doit désormais « s’inscrire dans une
ambition régionale » 121. Le dernier CIAT122, du 6 Mai 82, vient de définir le cadre d’une
politique de l’Etat en matière de Centres de Culture Scientifique et Technique et les
collectivités décentralisées peuvent désormais mener de nouvelles politiques culturelles (à
travers les chartes culturelles régionales). Les dirigeants du Centre Historique Minier (René
Liégeois retraité des Houillères qui s’est vu attribuer une mission de suivi du Centre à plein
temps et Jaques Ragot, directeur général du Bassin depuis 80) multiplient dès lors les contacts
avec les représentants de ces collectivités et des pouvoirs publics, en leur proposant de
participer à la création d’une association du CHM et par la même au financement et à la
gestion du Centre.
L’Assemblée constitutive de l’association se réunit donc le 4 juillet 1982. Ses
membres fondateurs sont le Préfet, commissaire de la République du département du Nord et
de la Région Nord-Pas-de-Calais, le Préfet, commissaire de la République du département du
Pas-de-Calais, le Président du Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais, le Vice-Président de
la commission éducation, formation, culture du Conseil économique et social régional, Le
Président du Conseil Général du Nord, le Vice-Président du Conseil Général du Pas-de-
Calais, le Président de l’Association des communes minières, le Maire de Lewarde et enfin le
Président du conseil d’administration des Houillères, Jacques Ragot, qui devient sans surprise
le premier président de l’association, élu à l’unanimité.
Le Centre Historique Minier, après avoir été porté par les Houillères de façon
complètement autonome pendant dix ans, entre donc dans l’espace public par le « haut ».
Aucune association, aucun habitant, aucun syndicaliste ne sont associés à sa fondation,
119 Cf. annexe n°7. 120 Cf . supra. 121 Selon les propres mots employés dans la lettre envoyée par les HBNPC aux institutions conviées. 122 Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire.
- 31 -
directement impulsée par le « milieu décisionnel central » régional. Il faut bien l’admettre, si
lieu de mémoire il y a, ce fut d’abord un lieu de mémoire par décret123.
L’absence des syndicats fut la première palliée.
La presse de l’époque, tout en rapportant l’événement de la création du CHM, s’était
faite l’écho du mécontentement des syndicats de n’avoir pas été associés au projet. Libération
du 22 juillet 1982, parle à ce sujet de « l’amertume de la CGT et de la CFDT qui déplorent
que les organisations syndicales n’aient pas été invitées en tant que telles à rejoindre les rangs
de l’association chargée de mener à bien le projet » et rapporte les propos d’un responsable
syndical CGT : « Nous n’avons même pas été consultés. Après tout nous sommes encore les
mieux placés pour parler de la mine et des mineurs. » Suite à ce premier camouflet, le
nouveau président de l’association proposera au conseil l’ouverture du deuxième collège aux
organisations syndicales. Là encore, cependant, la décision d’accorder une place
d’administrateur par organisation (CGC, CFTC, FO, CGT, CFDT) peut surprendre. Elle fait fi
de toute représentativité, au détriment notamment de la CGT, syndicat majoritaire chez les
mineurs. La réponse de Marcel Barrois124 (Secrétaire Général de l’union des syndicats des
mineurs, similaires et retraités CGT) au Président Ragot, qui lui demandait de désigner un
représentant, est cinglante : Si nous nous félicitons de la décision de créer un centre historique
minier et une association permettant d’en assurer la gestion et l’animation, nous nous sommes par contre étonnés que l’intérêt historique d’y associer, dès son origine les organisations syndicales n’ait pas été perçu.
Nous voulons rappeler que si le charbon a permis à la région du Nord-Pas-de-Calais de connaître l’essor économique, les organisations syndicales, et la CGT en particulier, y ont joué un rôle économique et social non négligeable, les désignant de fait comme actrices à part entière de l’histoire indissociable de l’exploitation charbonnière et du mouvement ouvrier de cette région.
Ce bref rappel historique étant effectué, nous tenons à faire remarquer que la procédure consistant à inviter les organisations syndicales des mineurs à siéger paritairement ignore totalement leur représentativité réelle dans la corporation minière et leur part historique. Par ailleurs, cette procédure a pour conséquence de placer les organisations syndicales devant un fait accompli : les statuts de l’association sont élaborés et adoptés, sans leur concours, le bureau est élu et mis en place sans leur participation.
Dans ces conditions, vous comprendrez nos interrogations quant au rôle exact des organisations syndicales dans l’activité de l’association du Centre Historique Minier.
Si le Conseil d’administration avalise finalement l’entrée de représentants syndicaux
en son sein le 13 octobre 1982, il leur octroie cependant la portion congrue, les cantonnant à
123 On développera cette affirmation dans la partie intitulée: un anti-écomusée ? 124 En date du 11 décembre 1982. Cf. annexe n°8.
- 32 -
un rôle de faire-valoir125. A titre de comparaison, les Houillères comptent alors huit
administrateurs à elles seules126.
On peut s’interroger sur la manière de faire des Houillères, si l’on méconnaît la
« culture » de direction qui y prévaut. M. Racle, directeur de l’A.N.G.R., nous en livre
quelques éléments :
Ce conflit des origines a été oublié par les acteurs, au profit d’une lecture plus irénique
revendiquant l’ouverture comme pratique fondatrice.
Qu’en est-il justement de cette ouverture proclamée, pour la période qui nous intéresse
ici (82-90) ?
Elle se traduit essentiellement par la participation au budget des nouveaux partenaires
institutionnels. Le Centre est désormais financé conjointement par l’Etat la Région, le
Département du Nord et les HBNPC.
La place des Houillères dans les orientations et la gestion du musée reste cependant
prédominante. Elles détiennent la présidence de l’association (aux nombreux pouvoirs
délégués), la direction administrative du Centre, une proportion très importante du nombre
total d’administrateurs (environ 1/3) et enfin une compétence technique et des moyens
d’action qui leur confèrent un monopole de l’expertise. En dépit de la création de
l’association, dont les effets en terme de contrôle du budget par les partenaires ne sont quand
même pas négligeables, les Houillères gardent l’essentiel de l’initiative pendant toute cette
période (82-90), même si la seconde présidence de Jean Perier127, à partir de 1984, contribuera
à associer davantage les élus aux décisions stratégiques.
125 L’absentéisme chronique des représentants syndicaux au conseil, et notamment du représentant de la CGT (deux présences de 1982 à 1990 à raison de trois conseils par an environ), a pu trouver sa source dans ce sentiment. 126 Sur 27 en tout. 127 Contrairement à son prédécesseur J. Ragot, J.Perier ancien Préfet de police de Paris, nommé président des HBNPC pour gérer la fermeture programmée est un « homme du sérail » comme le définit le secrétaire de l’époque M.Turbelin. Son ethos de Haut fonctionnaire et non d’ingénieur, son entregent, favoriseront les contacts avec les pouvoirs publics et leur implication plus grande (même si jusqu’à 1990 elle se résume souvent au « tiroir-caisse » ; les comptes rendus de C.A. témoignent d’ailleurs de la pauvreté des débats et d’une apathie manifeste des représentants des collectivités, bien souvent sans force de proposition ; sans exclure que des jeux d’influence puissent avoir lieu en coulisses).
F.D. - Pourquoi les syndicats n’ont-ils pas été associés dès le départ à la création du musée, mais une fois l’association constituée ? M. Racle - A cette époque là, il était hors de question que le Directeur Général condescende à demander l’avis des syndicats. Ici, je préside tous les jours une commission logement avec les syndicalistes du bassin. Ses articles ont été examinés un par un avec les syndicats mais c’était la première fois. En 1992, le précédent règlement de 86 ou 88 était exposé à la commission logement du comité d’entreprise et que les gens soient d’accord ou pas il était appliqué. Les Houillères n’ont jamais rigolé avec ces choses là. Ça a peut-être expliqué quelques grèves dures jusqu’à 48, 56, 63.
- 33 -
En terme muséographique, la période est marquée par trois événements majeurs
auquel la forme actuelle du musée doit beaucoup: l’ouverture au public en 1984, la réalisation
de la « mine-image » (circuit minier reconstitué) en 1987 et de l’exposition permanente
« mine et mineurs » en 1989128. La fréquentation du Centre va croissante (se stabilisant au-
delà de 100.000 visiteurs après 88) imposant le CHM comme " musée de référence sur la
mine", ce qui était l’ambition affichée des Houillères au départ.
A l’instar de la période précédente (73-82), cependant, ce sont les Houillères qui
continuent de piloter la politique muséale, et c’est un pilotage à vue, sans contrôle de l’Etat129
ni projet global. Un conservateur du patrimoine est bien recruté en 1984, mais il est placé sous
l’autorité de l’administrateur délégué, M.Liégeois et on lui précise pour commencer que « les
actions engagées ne peuvent être remises en cause aussi bien dans le domaine des expositions
que dans les travaux en cours de consultation 130». C’est dire sa marge de manœuvre… Cette
collaboration a d’ailleurs tourné court et les chargés de mission se sont ensuite succédés,
entrecoupant de longues périodes pendant lesquelles le poste fut vacant. Le conservateur
actuel, Mlle Paris, nous fit remarqué lors de l’entretien combien cette époque avait été
« difficile sur le plan scientifique ». Il faudra attendre le désengagement des Houillères et
l’arrivée de Marc Dolez pour que soit entamée une réflexion prospective « établissant des
priorités d’action131 », à la demande du Ministère de la Culture, notamment, qui y voyait la
condition d’un soutien accru.
Avant cela, les rênes du musée vont devoir changer de mains.
3. Nouvelle donne et crise de croissance (90-97)
Fin 1990, l’extraction du charbon est arrêtée. Les jours des HBNPC sont comptés.
Pourtant depuis 1984, l’échéance ne faisait déjà plus de doute aux yeux des exploitants.
L’arrivée à la présidence de Jean Perier fut interprétée comme un signe. M.Turbelin s’en
souvient : « Quand Perier est arrivé, pour les exploitants, c’était la fin du bassin. Parce que
c’était un « politique » alors que jusque là, on avait toujours eu des gens du sérail (des
ingénieurs des mines ayant fait leur carrière dans le nord). Perier, lui, c’était un parisien. »
Dès 1988, se prépare en coulisses la succession des Houillères à la tête du CHM. Les contacts
pris avec la Région vont aboutir et Marc Dolez, Député du Nord, Conseiller Régional,
128 Nous commenterons ces deux réalisations, aujourd’hui inchangées, mais dont la restructuration est programmée, dans notre partie consacrée à l’analyse du discours sur la mine (III). 129 La DRAC est invitée à participer aux C.A. à titre consultatif à partir de 1985 et ne devient membre de droit qu’après le départ des Houillères. 130 Compte-rendu du Conseil d’Administration du 3 Avril 1984. 131 Compte-rendu du C.A du 10/05/90.
- 34 -
administrateur du Centre (pour le Conseil Régional) depuis 85, s’imposer comme le
successeur de Jean Perier, démissionnaire, à la présidence de l’association. Son élection132 ne
sera plus qu’une formalité133. Cette « nouvelle donne » se traduit en 1990134 par la nomination
d’un nouveau Directeur M. Dubuc, détaché de l’éducation nationale au Conseil Régional et
chargé de mission au CHM. Une nouvelle équipe se met en place qui sera complétée par
l’arrivée en 1994 d’un nouveau conservateur du patrimoine, Mlle Agnès Paris. M. Dolez,
parlera à ce titre de la « deuxième phase de l’existence du Centre Historique minier et des
débuts d’une nouvelle épopée »135. L’assemblée extraordinaire du 9 janvier 1993 enregistre la
disparition des HBNPC et modifie les statuts en conséquence. Leurs huit administrateurs
deviennent deux, attribués à Charbonnages de France (CdF).
Déjà entamée par le départ de Jean Perier, la gestion essentiellement « Houillères » du musée
est désormais consommée.
En deux ans, leur subvention (en investissement et fonctionnement) passe ainsi de 1,6
millions de francs à 0. Le Centre se voit dans l’obligation de compenser cette perte de
ressources qui s’élève à un quart de son budget. Les partenaires institutionnels, sollicités, ne
répondent pas à l’appel136. Le musée est donc obligé d’accroître ses ressources propres, en
augmentant les tarifs de visite notamment. Le graphique montre très nettement cette
évolution :
132 Au C.A. du 14 septembre 1989. 133 On en analysera les modalités et les conséquences politiques dans la partie intitulée « lieu de mémoire, lieu de pouvoir ». 134 C.A. du 13 décembre 1990. 135 Propos rapportés dans le compte-rendu du C.A. du 13 décembre 1990. 136 Les budgets culturels, après une période de croissance continue, stagnent.
- 35 -
Cette augmentation importante des tarifs (de 45 à 60 francs par personne en tarif
plein), décidée par le Conseil d’administration du 25 février 1994, n’est pas sans poser
problème et « doit interpeller les pouvoirs publics afin qu’ils prennent leurs responsabilités »
selon M. Dubuc, le Directeur du Centre, qui nous a confié son sentiment sur la question. Il
insista lourdement sur le fait que des prix « prohibitifs » pouvaient remettre en cause l’accès
au musée de certains publics, défavorisés. A ses yeux, la participation des collectivités
concourrait à garantir un « service public de la Culture » dont il se montre fervent partisan.
Pour cela, les ressources propres du Centre qui représentent actuellement près de 70% de son
budget137 devraient s’établir à 50%, les autres 50% incombant alors aux différents partenaires.
Il nous fit remarquer que pour les dix dernières années, ces ressources propres avaient été
multipliées par 18 pendant que les subventions stagnaient.
Cette période récente voit aussi l’Etat prendre la place qu’occupaient les
Houillères sur le plan de l’expertise138 (le musée devient musée contrôlé), sans que cela ne se
soit traduit par une participation financière supplémentaire de sa part. Cette situation révèle
bien des limites de la décentralisation culturelle. Les collectivités, faute de compétences
137 C’est un record en France. 138 On en évaluera les conséquences muséographiques majeures dans la deuxième et surtout troisième partie.
0,6
0,9
0,33
1,23
2,22
0,65
0,95
0,36
0,6
2,85
0,7
1,05
0,42
0,5
3,2
0,83
1,05
0,56
4,39
0,4
0,83
1,05
0,23
5,5
0,07
0
1
2
3
4
5
6
7
8
millio
ns d
e f
ran
cs
1990 1991 1992 1993 1994
Evolution des ressources du musée de 1990 à 1994
subventions spécif iques
(Feder)
Ressources propres musée
HBNPC
Etat
conseil Général du Nord
conseil régional
- 36 -
suffisantes (elles ne disposent pas d’une fonction publique culturelle ou de corps d’inspection
comparables aux conservateurs et à l’inspection générale des musées de France), participent
largement au financement139 alors même que les pouvoirs de mise en œuvre et de suivi
scientifique leur échappent totalement. Accepteront-elles encore longtemps ce rôle de second
couteau derrière un plus mauvais payeur qu’elles ?
Le Centre assiste aussi à un afflux de visiteurs. Le cap des 150000 est même dépassé
largement en 1993 (167920) et atteint en 1994 (149066). Une fois passé l’effet Germinal140, la
fréquentation se stabilise tout de même au-delà de 125000 visiteurs, marquant un gain net de
25000 visiteurs par an, environ.
Cet engouement, s’il permet d’augmenter les ressources propres, s’avère aussi
préjudiciable dans l’état actuel des installations. Ces dernières, inadaptées pour recevoir une
telle affluence, multiplient les coûts de fonctionnement induits. Il faut donc envisager un plan
de restructuration qui permette de recevoir 200000 visiteurs dans de bonnes conditions et sans
que cela ne soit source de déficit141. La première tranche de travaux (rationalisation du
parcours, réaménagement de l’accueil, extension du site et du parking) est chiffrée à 35
millions de francs. Si les partenaires semblent d’accord pour financer l’investissement, ils
refusent142 jusqu’à présent d’augmenter leur participation annuelle au budget de
fonctionnement du Centre pourtant appelé à croître en conséquence. Cette incertitude
budgétaire compromet pour le moment tout projet d’extension. C’est tout l’enjeu de la
campagne de presse143 menée par le Centre depuis le début de l’année 98, attirant l’attention
de tous sur les hypothèques que ce statu quo ferait peser sur la pérennisation et le
développement du CHM.
Cette période se traduit aussi par la multiplication des politiques de communication et
de médiation culturelle en direction des publics.
Priorité est donnée aux expositions et à la création d’événements autour du Centre
(salon de la mine où des artistes exposent). Une philosophie d’animation culturelle144 prévaut
désormais sur celle des réalisations de prestige, qui a largement marqué l’époque précédente.
Pourtant, l’héritage des Houillères reste largement contraignant : la « mine-image », les
réaménagements architecturaux, l’exposition permanente « mine et mineurs » constituent
autant de legs « encombrants » et signifiants qui limitent peut-être la portée et la force de
suggestion des nouvelles propositions.
139 Même si dans le cas de Lewarde, elles n’ont pas véritablement compensé la défaillance des Houillères. 140 On en dira mot dans la sous partie consacrée à la transmission. 141 C.A. du 25 février 1994. 142 A l’exception du Conseil Régional. 143 Pour exemple, voir l’article « Le musée de Lewarde fait grise mine » dans La Croix du Nord-Pas-de-Calais du 6 février 98, ou encore les deux articles sur le sujet dans la Voix du Nord et Nord Eclair du 24 janvier 98. 144 Dont on essaiera plus loin de décrypter la logique.
- 37 -
Autre point nouveau sur le plan muséographique, la direction du musée revendique
davantage de place consacrée à la vie du mineur. M. Dubuc l’explique :
Pour commencer, on peut relativiser la division historique des tâches définies par M.
Dubuc. Si jusqu’aux débuts des années 80 la préoccupation des Houillères et de M.Destruys
est bien la collecte, elle change totalement avec la constitution d’un musée et s’élargit
sensiblement. Ainsi, le parti pris architectural du premier réaménagement va bien au-delà de
simples mesures conservatoires145. De même, les nombreuses expositions réalisées pendant
cette période (« la mine au début du siècle », « la silicose », « le charbon, une aventure de 345
millions d’années » et surtout l’exposition permanente) démontrent une ambition irréductible
à la préservation d’objets.
Les choix muséographiques qui laissent effectivement peu de place à l’homme,
jusqu’en 1990, doivent donc, être interprétés selon nous comme les prémices d’une logique
d’appropriation patrimoniale et mémorielle propre à ses promoteurs, et non comme
l’expression de priorités muséographiques incontournables. C’est de cela dont nous allons
parler maintenant.
145 Cf. infra..
M. Dubuc - Autre chose qu’on peut dire : Quand j’ai pris le Centre en 1990, rien encore n’avait été consacré au mineur lui-même, ou très peu. Les Houillères avaient d’abord eu une préoccupation de conservation du patrimoine, du matériel (outils, machines, etc.). Ce qui se conçoit parfaitement. On ne va pas faire un procès d’intention en disant : ils ont mis de côté les mineurs et se sont préoccupés de l’aspect technique. Ça serait une interprétation qu’on ne va pas faire. C’est un constat. Je sais que dans l’urgence, on a été obligés d’accorder un certain nombre de priorités. La priorité de sauvegarder le patrimoine dans la mesure où les mineurs étaient là. Le changement intervenu en 1990 a été que l’aspect technique étant réalisé, j’ai pu davantage axer la programmation du Centre sur l’aspect humain. A partir de 1990 on s’est préoccupé plus du mineur que des machines puisque ça avait été fait. La première « expo » inaugurée en juin 91, 6 mois après mon arrivée, c’est l’estaminet, qui retrace l’évolution des revendications sociales et la naissance du syndicalisme. Depuis on a mis en place la collection « mémoire de gaillette », tournée vers l’homme avec comme premier thème l’habitat minier, comme deuxième la colombophilie et comme troisième la Sainte-Barbe. Le grand changement en terme de contenu est que nous avons pu nous tourner vers le mineur. Mais si on voulait constituer une collection de lampes aujourd’hui, on ne les trouverait plus. Les priorités sont à établir en fonction de ce qui peut disparaître. C’est ce qui a été fait.
- 38 -
II. Mémoires et entrepreneurs de mémoire
« Le disparu, si l'on vénère sa mémoire, est plus précieux et plus puissant que le vivant.» Saint-Exupéry (Antoine de), Citadelle (Gallimard).
Quelle est donc cette mémoire de la mine dont le Centre Historique Minier se prétend
dépositaire ?
Face aux stéréotypes qui saturent les rhétoriques patrimoniales146 dans le sens de
l’identité naturelle il faut bien se résoudre à poser cette question.
Le patrimoine et la mémoire, loin des oripeaux du réalisme platonicien147, traduisent
autant de rapports au passé construits socialement. Notre approche sera donc résolument
nominaliste. Chaque individu, chaque groupe, selon des cadres sociaux148 qui lui sont propres
est entrepreneur de mémoire. La mémoire collective n’est donc jamais une mémoire univoque
mais plutôt à géométrie variable. B. Crettaz résume parfaitement cette perspective149 : « La
mémoire n’est pas une faculté plus ou moins fidèle, mais une activité complexe qui selon les
enjeux et les conflits personnels et sociaux, conserve, transmet, oublie, abandonne, éjecte,
détruit, censure, enjolive ou encore sublime le passé. ». Le sens de la mémoire n’est rien
d’autre que les façons qu’on a de s’en servir.
Dans le cas de Lewarde, la question n’est donc plus de savoir « quelle est « la »
mémoire de la mine », mais « qui l’instaure », « avec quelles motivations » et « sous quelle
forme ».
De même, il n’y a pas d’acte de mémoire véritable qui ne soit ancré dans le présent.
Françoise Choay le rappelle justement : « le passé invoqué, incanté n’est pas quelconque. Il
est sélectionné et localisé à des fins vitales, dans la mesure où il peut directement contribuer à
maintenir et préserver l’identité150 d’une communauté ethnique ou nationale, religieuse,
146 « Besoins de mémoire, d’enracinement, etc.» Voir à ce sujet le très bon article de Marc Guillaume : « Invention et stratégies du patrimoine », in Jeudy (Henri-Pierre), Patrimoines en folie, Paris, Ed. de la Maison des sciences de l’Homme, 1990, pp. 13-21. 147 Qui se traduirait ici par l’existence d’une mémoire authentique, existant en dehors des individus soit d’une mémoire comme essence. 148 Voir l’ouvrage fondateur de cette approche anthropologique de la mémoire : Halbwachs Maurice, Les cadres sociaux de la mémoire, op. cit. 149 B. Crettaz, Confessions d’un conservateur de musée sur la perfection et l’enfermement de la suisse et des Alpes, Ed. Zoé, 1993, p.27, cité par Joël Candau, op. cit. 150 Les travaux de Eric Hobsbawn ( The invention of tradition, Cambridge, Cambridge University Press, 1992 (1ère édition 1984) ) ou d’Anthony Smith ont ouvert la voie de cette nouvelle appréhension des formes de recours au passé ou aux traditions.
- 39 -
tribale ou familiale. » La mémoire n’apparaît plus comme une exploration désuète du passé
mais comme une « matrice du présent », entre histoire et pouvoir.
Dès lors, c’est par une histoire sociale de la construction du Centre Historique Minier
( comprenant l’étude de ses enjeux et de ses acteurs notamment) qu’il nous faut commencer
(A.).
Le concept d’entrepreneur de mémoire prend ici tout son sens.
Frédéric Jeannot montre bien, à travers l’exemple de l’intérêt pour la maison rurale en
Franche-Comté, comment un patrimoine historique se trouve mis en scène par des groupes
successifs151, selon des logiques d’appropriation distinctes voire contradictoires152. Cette
approche rompt avec l’image répandue mais fallacieuse de la redécouverte patrimoniale
comme continuum. J.C. Martin et C.Suaud153 parlent quant à eux d’une « construction en
tuiles de toit qui est la règle de toutes les mémoires collectives. Chaque groupe prenant en
charge, à un moment donné des éléments de la mémoire avant qu’un autre n’intervienne
ensuite avec de nouveaux matériaux. » Ces deux grilles d’analyse du phénomène patrimonial
et mémoriel insistent, chacune, sur la diversité de ses promoteurs et sur la nécessité d’analyser
leurs logiques d’action respectives si l’on veut en comprendre la forme présente.
L’édification du CHM, de par la diversité de ses acteurs154 mais aussi leurs
divergences connues sur d’autres terrains, semble se prêter à ce type d’approche
compréhensive, susceptible de révéler des enjeux et conflits de mémoire sous-jacents.
Derrière la sauvegarde tardive du patrimoine minier et la réhabilitation (sélective) de la
culture ouvrière, se cache, en effet, une grande diversité d’usages sociaux et d’interprétations
de ce qu’est la mémoire collective de la mine(B.).
Le Centre Historique Minier devient alors un lieu privilégié d’étude, où se cristallise
cette confrontation inégale entre des interprétations concurrentes de la mémoire, dont l’une
(qui peut être le produit de plusieurs) finit par triompher.
Ajoutons que ces clivages dans la restitution d’une mémoire historique, trouvent
souvent leur point de départ dans des désaccords sur les problèmes contemporains, avec
lesquels la mémoire ne cesse d’interférer155.
151 D’abord par des syndicats d’initiative, puis après 1945, par des prêtres et des instituteurs et plus récemment par des universitaires et amateurs éclairés. 152 Respectivement : posture touristique, régionaliste contestataire, ethnologique. 153 Le Puy du Fou en Vendée, op. cit. 154 Cf. introduction. 155 Charles Suaud et J.C Martin décrivent bien ce processus : « L’histoire devient alors une carrière dans laquelle chacun vient puiser les arguments qu’il lui faut pour bâtir sa démonstration », op. cit..
- 40 -
On essaiera donc, autant que possible, d’objectiver les liens qui se sont tissés entre les
usages du passé et les enjeux présents dans l’édification du CHM et de mettre à jour quelques-
unes des opérations intellectuelles qui ont commandé cet intérêt nouveau pour la mémoire.
A. Déconstruire l’investissement patrimonial
L’investissement patrimonial, à l’instar de toute autre pratique sociale, n’est exempt ni
de conflits ni d’enjeux, qu’ils soient directement perçus par les acteurs156 ou refoulés. Aussi,
l’étude des archives comme les entretiens réalisés auprès des différents partenaires du Centre,
visait à en reconnaître quelques-uns, suffisamment manifestes ou récurrents pour être
considérés comme décisifs.
1. L’enjeu de la muséification
« Nul ne consent volontiers à être enterré tout vif, et la magnificence du tombeau n’en fait pas trouver le séjour plus sain ». C.Nisard, Histoire des livres populaires, 1864.
L’acte de création d’un musée de société n’est pas anodin.
C’est une activité, une culture, des pratiques sociales que l’on met au musée. La
muséification intervient à un moment où l’on pressent la disparition prochaine de ce dont on
va parler. C’est l’imminence de la perte qui légitime l’entreprise de sauvegarde157, lui donne
la force de l’évidence. Rares sont les musées qui témoignent de pratiques sociales vivantes.
On trouverait probablement absurde, aujourd’hui, de créer un musée de la banque ou de la vie
urbaine. En ce sens, l’entreprise patrimoniale vient signifier, symboliquement, la fin de ce
qu’elle semble consacrer.
On ne peut comprendre l’édification du CHM et la participation des différents acteurs
si l’on n’y intègre cette dimension symbolique fondamentale : le musée est globalement perçu
comme le lieu où s’exposent les choses qui appartiennent au passé, à l’histoire. C’est un
conservatoire.
Rappelons que cette représentation est accentuée, dans les années 1970, par les formes
historiques de musées qui ont jusqu’alors prévalues158. Les Centres de Culture Scientifique et
Technique159, davantage orientés vers la pédagogie, datent des années 80. Avant cette période, 156 Les acteurs ont parfois une perception incertaine ou décalée de ces enjeux et il faut donc se méfier des analyses purement stratégiques. Manipuler la mémoire n’est pas chose si aisée qu’il y paraît. On parlera plus volontiers d’usages sociaux de la mémoire, considérant que les acteurs, dans le cas de Lewarde, croient plus souvent en la justesse de la mémoire qu’il promeuvent, qu’ils ne souhaitent réellement la manipuler. 157 Cf. I.A.3 158 Cf. supra. 159 Du type de la Cité des Sciences de la Villette.
- 41 -
les exemples de muséification hors beaux-arts sont peu nombreux et concernent
exclusivement les Arts et Traditions Populaires, témoignant des sociétés rurales disparues.
Aussi, dans de nombreux esprits, créer un musée de la mine revient à enterrer
symboliquement la mine, à la mettre au même niveau que tous les métiers et savoirs-faire
obsolètes dont les musées du quotidien regorgent.
Or, aux débuts des années 1970, il commence à être sérieusement question de la fin de
l’extraction, à brève échéance. Les débats sur le devenir de l’activité dans le Bassin du Nord-
Pas-de-Calais sont vifs et passionnés entre ingénieurs, exploitants, élus locaux, représentants
des pouvoirs publics et syndicalistes. La mine, longtemps mono-industrie (on parlait de la
« trilogie charbon-acier-textile »), continue à employer directement plusieurs dizaines de
milliers de personnes160. Les emplois induits se comptent également par milliers. C’est donc
un sujet brûlant et la seule idée de fermeture suffit à attiser les polémiques.
C’est dans ce contexte qu’apparaît le projet d’un « musée de la mine ». On perçoit
aisément quel signal a pu y être associé : le temps est désormais venu de gérer l’après-
charbon.
Dés lors, l’histoire de la participation des différents acteurs au musée de la mine est
aussi celle de leur résignation à la fin de l’exploitation.
Cette prise de conscience de l’inéluctabilité de la fermeture des puits interviendra à des
moments très différents selon l’identité des acteurs.
Tant que la fermeture reste un enjeu, l’objet de divergences, de combats politiques, la
création d’un musée est perçue comme une prise de position à l’intérieur de ce débat,
accréditant l’idée de la fin prochaine. Elle est donc rejetée par ceux qui s’y opposent.
Le père fondateur du musée de Lewarde, Alexis Destruys, n’est pas par hasard l’un
des premiers à avoir pris conscience de la fin probable de l’extraction. Il l’explique dans
l’article qu’il a consacré au CHM, dans le bulletin des amis du charbon : Dès mon arrivée à Douai, à la fin de 1968 et ma nomination au poste
de Secrétaire Général du Bassin, je pris connaissance de la gravité d’une récession mal perçue au niveau des exploitants et des groupes d’exploitation. Et cela grâce à la connaissance des programmes de fermeture des établissements de l’ensemble du Bassin et des réflexions menées sur la suppression des groupes…et sur la date de fermeture définitive des HBNPC.
C’est convaincu de l’issue de la récession en cours, qu’il juge opportun de préparer un
musée de la mine, conservatoire de matériels, d’archives et d’objets menacés
d’anéantissement161.
160 Même si les Houillères n’embauchent déjà plus. 161 Il parle à ce propos de « récession destructrice ».
- 42 -
Pourtant, au tout début des années 70, peu ont pris conscience de la gravité de la crise
qui touche le charbon français. Selon A.Destruys, c’est d’ailleurs la raison essentielle du
mauvais accueil reçu par son idée dans un premier temps : La création d’un musée ne pouvait qu’accréditer davantage l’idée de
fin très prochaine des HBNPC, fin que personne dans les milieux politiques, économiques et syndicaux ne voulait admettre. Cette création pouvait être considérée comme une provocation !
Il insiste sur « la négation de la fin du bassin » qui imprégnait encore de
nombreux esprits (salariés, population, élus) et qui rendait incongrue toute idée de
préservation. M. Turbelin ne dit pas autre chose :
« Faire ça discrètement »… Courant 1972, A. Destruys prend une décision dans ce
sens et révèle par la même la prééminence de l’enjeu de la fermeture, qui, tant qu’il apparaît
en filigrane, paralyse son initiative. Il s’en sort par un tour de passe-passe, déterminant par la
suite: Pourquoi s’entêter à parler d’un musée qui fait peur ? Pourquoi ne
pas l’appeler Centre Historique Minier, appellation rassurante162 qui ne peut avoir aucun caractère de provocation, au contraire : on étudie aussi bien l’avenir que le passé…
Ce premier débat autour de l’appellation163 montre à lui seul l’inanité d’une réflexion
patrimoniale qui se satisferait des discours de la spontanéité ou de la naturalité et annonce,
nous semble-t-il, l’une des principales découvertes de nos recherches qui lie la participation
au musée à l’acceptation implicite de la fin de l’activité.
C’est d’abord la Direction Générale des Houillères qui, une fois convaincue de la fin
prochaine de l’extraction, soutient l’initiative de conservation (pourvue qu’elle soit discrète
dans un premier temps) par un vote du C.A. en 1973164.
La création d’un musée était compatible avec une nouvelle logique de direction
considérant comme inéluctable la récession charbonnière. Il est possible que les Houillères y
aient même vu un moyen de communiquer : Montrer la pénibilité du travail permettait de
162 Le conservateur, Mlle Paris, qui nous avait signalé l’origine de l’appellation parla de « politique de l’autruche des Houillères ». 163 Il sera suivi par d’autres dans les années 80 qui traduiront cette fois-ci autour de l’appellation, des usages sociaux différents de la mémoire. On les évoquera en II.B.3. 164 Cf. supra.
F.D. - Ne pensez-vous pas qu’une partie de la Direction ne voulait pas entendre parler de la fin de l’activité et que faire un musée, c’était marquer celle-ci ? M. Turbelin - Peut-être. A l’époque j’étais chef de siège, en 1975. Quand j’ai quitté le siège en 78, j’avais tenu à dire aux gens qu’il y avait 10 ans de vie du siège. Il y avait déjà des ingénieurs qui savaient que ça évoluait. Ceci étant, il est vrai que du côté ouvrier, syndical, de la base, dès qu’on parlait d’un musée ça voulait dire fermeture. L’ambiance n’était pas d’envelopper cela dans du beau papier mais de faire ça discrètement. Ça c’est vrai.
- 43 -
légitimer la fermeture auprès de l’opinion, fût-elle guidée par des motifs économiques avant
d’être philanthropiques. Le Maire communiste de Lewarde nous donne son avis :
A cette époque les autres soutiens sont rares. Ecoutons encore A. Destruys, en
n’oubliant pas sa position partiale de retraité de la Direction des Houillères : Pendant plus d’une décennie, les dirigeants des HBNPC ont tenté de
faire entrer dans les esprits le caractère irréversible de la récession puis de la fin relativement prochaine de l’extraction.
Mais le jeu des politiques, de tous (c’est l’auteur qui souligne) les politiques, a été de nier ce qui devenait une évidence. Combien d’entre eux ont été élus puis réélus en jouant ce jeu !
Plus grave encore, certains milieux économiques et industriels ont refusé, par insouciance ou par paresse intellectuelle, de voir les réalités en face.
Quant à l’opinion publique, elle a été, comme toujours, conservatrice.
Au-delà du ton dénonciateur, retenons le constat : la position des élus locaux vis à vis
du CHM a pendant longtemps été conditionnée par un discours de promotion de l’activité
d’extraction et d’opposition à la fermeture. Celui-ci s’accommodait mal du soutien à un
musée, riche de sous-entendus. C’est aussi l’avis de M. Turbelin qui précise la situation de
l’époque:
F.D. - Les Houillères n’ont-elles pas eu la volonté, en créant le musée de communiquer sur la fin de la mine ? M. Nottez - Oui, je crois qu’il ne faut pas négliger cet aspect là. Certainement. On ne peut pas dire qu’il n’y avait que ça. Les cadres des Houillères réagissaient en fonction d’une réflexion de récession charbonnière. Leur soin n’était pas d’augmenter la production mais de savoir comment ils allaient terminer. De gérer la crise, d’aller jusqu’à la fin. Tiens, on aurait un musée, ça serait bien ! C’est peut-être un petit peu facile mais c’était l’idée.
F.D. - Et les élus, comment ont-ils réagi ? M.Turbelin - Ah ! Les élus. Il faut revivre les années 80. Au moment de l’arrivée de la gauche au pouvoir on annonce un changement de politique charbonnière. Je vous passe les dérives que j’ai vécues à l’époque. J’ai vécu une semaine de septembre 1981 ahurissante. A cette époque, on faisait 3,8 millions de tonnes de charbon par an. L’inflation (de la part des élus) d’une semaine de septembre nous a ramené à 10 millions ! Il y a eu une surenchère formidable entre Marché et Mauroy. En une semaine, la production du Bassin était passée de 3 millions à 10 millions de tonnes ! J’étais devant les journalistes qui me demandaient ce que j’en pensais. Je savais qu’on était incapable de faire cette production. Il y avait des gens comme Marché qui disait des bêtises mais en même temps des choses vraies. Marché disait : « Il y 40 milliards de tonnes dans ce bassin ». Mais dans tout ça, il y a des veines de moins d’un mètre. Quand on fait l’analyse des veines susceptibles d’être exploitées, on s’aperçoit qu’on divise par au moins dix ou quinze. Moi j’expliquais ça aux journalistes pendant cette semaine démentielle. 1981 avait laissé beaucoup d’espoirs. Et là je dois reconnaître qu’il y a eu quelque chose de très positif au niveau de la Région. Noël Josephe (Président du conseil Régional), à l’époque, a eu l’idée, simple mais qui a débloqué la situation, de mettre les gens autour d’une table et de faire une enquête. Au moins, comme ça, toutes les parties prenantes auront eu la possibilité de vérifier la réalité du fond. Il y eut des syndicats, il y eut des exploitants, il y eut des politiques et puis on a fait l’étude des sièges pour vérifier les données. On a constaté qu’il restait 13 millions de tonnes de charbon exploitables. Ça faisait six ans. Là, ça a décongestionné l’affaire. Entre 81 et 84 on a tout entendu, tout dit, mais après 84 les choses se sont calmées et là il n’y avait plus de problèmes. On savait où on allait. Et là l’enjeu, c’était de reconvertir nos gens et de faire la mémoire de ce qu’on avait vécu. A partir de ce moment là les chose se sont passées beaucoup mieux. F.D. - Et dans les premières années ça a donc été difficile d’associer certains élus ? M.Turbelin - A l’époque ils nous ont dit : « on va voir ». Oh oui. On a commencé à prendre des contacts en 82 mais je ne sais pas si on a pas commencé à travailler sérieusement en 1984. Au départ il n’y avait pas beaucoup d’enthousiasme.
- 44 -
Le basculement idéologique -d’une défense de la poursuite de l’extraction à
l’acceptation de sa disparition- s’effectue chez de nombreux élus et représentants des
pouvoirs publics au début des années 1980. La table ronde de 1984 (dont parle M.Turbelin) a
représenté un tournant à cet égard, même si les positions avaient déjà évolué depuis 1982. A
partir de là, les élus s’impliquent dans l’association et soutiennent plus ouvertement le Centre
Historique Minier.
Se développent alors des discours de transition qui tout en intégrant la nouvelle donne
annoncée persistent à envisager de nouvelles perspectives pour l’activité et ménagent ainsi les
susceptibilités. Il faut rappeler que la fermeture définitive ne sera annoncée officiellement, par
le Directeur Général M. Verlaine, qu’en 1987 ! Les conditions que pose l’Etat à sa
participation, dans la note confidentielle adressée au centre le 11 Mai 1983165 par le chargé de
mission auprès du Préfet, sont symptomatiques de cette phase transitoire.
Je me suis interrogé sur les dispositions à prendre et les actions à
mener pour que le Centre de Lewarde constitue maintenant rapidement un véritable centre de culture scientifique et technique et réponde aux besoins du Nord-Pas-de-Calais. Je vous propose de livrer ces réflexions au conseil, dans la mesure où la poursuite de l’effort de l’Etat pourrait être conditionnée par les réponses qu’il déciderait de leur apporter (c’est nous qui soulignons).
Bien au-delà d’un Centre d’archives et de présentation de matériel, davantage encore qu’un musée, un Centre de Culture Scientifique et technique constitue un pôle de recherche, de création et d’animation à partir de la mémoire collective de ce que peut être l’avenir technologique de l’activité concernée (c’est nous qui soulignons) tout en permettant l’appropriation sociale. Assises sur la connaissance du passé, ses préoccupations doivent donc être résolument tournées vers l’avenir166. (…) L’équipe de permanent devrait être renforcée par un conservateur scientifique. Le cursus de ce conservateur scientifique devra lui permettre d’appréhender tant les questions scientifiques, historiques ou culturelles du passé que celles relatives aux technologies futures dans le domaine vaste de l’exploitation et de l’industrie charbonnière(c’est nous qui soulignons), de la vie et de l’aménagement des zones minières, etc.
Les derniers acteurs qui se rallieront au projet du Centre Historique Minier seront les
syndicalistes, notamment de la CGT, majoritaire dans la corporation minière. Ils seront
également les derniers à accepter l’inéluctabilité de la fermeture. Louis Bembenek, Secrétaire
Général de la CGT mineurs, résume la position qui fut d’abord celle de son syndicat à l’égard
du Centre et la lente évolution jusqu’au soutien actuel :
165 Cf. annexe n°9 166 Nous reviendrons sur ce point par la suite, notamment avec l’étude des usages sociaux de la mémoire (Cf. II.B.)
- 45 -
En dépit de son représentant (symbolique167) au Conseil d’administration depuis 1982,
la CGT n’apporte son plein soutien au musée qu’à partir du début des années 90. Le
désengagement des Houillères, facilitera les choses.
Nous espérons avoir convaincu de la relation essentielle qui s’est nouée pendant ces
années, entre la perception de l’avenir de l’activité d’extraction par les différents acteurs et
leur implication dans le musée. Ceci corroborant l’hypothèse selon laquelle il n’est pas de
muséification qui n’engage par son coût symbolique, enjeux et débats.
2. Lieu de mémoire, lieu de pouvoir ?
L’enjeu de la muséification, une fois les mines fermées se déplace. Il passe de la
question de l’activité à celle de la transmission de la mémoire de l’activité.
Le CHM s’est imposé, par le nombre de ses visiteurs et sa renommée, comme un pôle
d’attraction et de visite unique, dans tout le bassin minier. En tant que lieu de mémoire
proclamé, il prétend tisser un lien entre une population et son territoire, suggérer une identité
commune, un passé partagé. Pour toutes ces raisons, il ne peut laisser indifférents les élus du
territoire et ceux qui l’administrent. De nombreux profits, symboliques et réels, sont en jeu.
F.D. - Y a-t-il eu des réticences au sein de la CGT s’agissant de soutenir le musée au moment de sa création? M. Bembenek - Oui, au moment de la création de ce musée par les Houillères on était encore en pleine bagarre pour la continuité de l’industrie charbonnière, ici, dans la région. On se battait encore pour que le Bassin Minier puisse continuer à travailler. Et à cette époque là, justement, dans les années 80, on se battait très fort pour relancer l’emploi et l’extraction charbonnière. Donc, naturellement on était contre la mise en place de ce musée. Parce que pour nous, faire un musée, c’était déjà nous enterrer. F.D. - Et maintenant, ça n’est plus le cas ? M. Bembenek - Ce n’est plus le même contexte. Il faut reconnaître qu’aujourd’hui, malheureusement, les puits de mine ont fermé en 1990, avec la fosse 9 de Oignies. Bon, des mineurs il n’y en a plus. Il y a des retraités et des veuves et on estime, nous aussi, peut-être qu’on a évolué j’en sais rien, que ce musée n’a plus la même signification qu’il y a quelques années en arrière. Les choses sont ce qu’elles sont et justement ce musée, il faut que les gens viennent le voir, surtout les jeunes générations. Parce que ça fait partie de la mémoire des gens du Nord-Pas-de-Calais, de la mémoire des mineurs. (…) F.D. - Est-ce que ce musée marque la fin d’une époque ? M. Bembenek - Oui, la fin de l’extraction charbonnière. C’est pour cela qu’on s’y était opposé en tant que CGT, en disant que la mine pouvait continuer.
- 46 -
Il nous faut identifier ces profits en même temps que les conflits d’intérêts et stratégies
d’acteurs auxquels ils ont pu donner lieu et donnent encore lieu.
Le désintéressement168, toujours revendiqué par les acteurs, ne saurait être considéré
comme le seul moteur de leur investissement patrimonial.
Chronologiquement, le premier conflit de pouvoir entre acteurs à propos du musée
survient très tôt. Il oppose, en coulisses, l’Etablissement Public Régional (EPR) et la
Préfecture de Région, soit l’Etat.
Dès 1977, et malgré une prudence dont on a abondamment parlé, certains élus locaux
commencent à envisager, à terme, la réalisation d’un musée de la mine, en réponse à celui de
Lewarde, mais aussi parce que de nombreux puits ont déjà fermé et que certaines communes
ont d’ores et déjà rassemblé des objets.
Une note, en date du 19 décembre 1977169, est rédigée à l’attention du Préfet de
Région par un chargé de mission afin d’attirer son attention sur la question. Elle stipule que
deux projets de musée sont actuellement possibles. Un musée de niveau national, à partir du
CHM, et un musée de niveau régional dont « les rapports avec le CHM seraient à définir ». Le
chargé de mission propose que l’Etat prenne la décision de soutenir le CHM, devant le risque
de voir Pierre Mauroy170 et « son goût pour les réalisations de prestige », préférer la solution
d’un vaste musée régional à celle de quatre, cinq musées intermédiaires (préconisée par l’Etat,
pour traiter des questions thématiques, en dessous d’un CHM de plus grande ampleur). Il
ajoute : M. Delmon (Président du C.A. des HBNPC à l’époque) souhaiterait
pouvoir, dans une réunion en tout petit comité faire le point avec vous sur ce projet.
Sans exclure a priori la collaboration avec l’E.P.R., il semble que l’éclairage qui serait donné sur l’activité minière dans un « musée régional », serait différent de celui qu’il souhaite lui-même donner à travers le CHM171. C’est pourquoi il est favorable à une prise en compte nationale permettant de renforcer l’importance de l’apport (…).
L’Etat entend donc ne pas laisser l’initiative à l’E.P.R et à Pierre Mauroy. En jouant la
carte du CHM (les Houillères ne l’oublions pas sont sous sa tutelle), il « coupe l’herbe sous le
pied » à un projet régional qui aurait pu lui échapper davantage.
167 Cf. supra. 168 Voir les travaux de Luc Boltanski sur les registres de justification et de Pierre Bourdieu ( « Le désintéressement comme passion », Raisons pratiques, Paris, Seuil, 1994, pp. 161-164) qui montrent comment le discours du désintéressement s’inscrit toujours dans un contexte où le désintéressement est socialement valorisé. C’est notamment le cas du champ politique. 169 Cf. annexe n°10. 170 Président de l’E.P.R. à l’époque. 171 A travers l’analyse des usages sociaux de la mémoire (II.B.2), on aura l’occasion d’appréhender la logique des Houillères.
- 47 -
On peut avancer plusieurs hypothèses sur les motifs de cette concurrence, mais une
semble essentielle : Un musée régional traduirait une prééminence de l’E.P.R. dans
« l’éclairage qui serait donné sur l’activité charbonnière ». Rappelons que la majorité
présidentielle d’alors est à droite (gouvernement Barre), pendant que la « Région » est
socialiste. L’épineuse question de la fermeture les oppose encore puisque les socialistes
défendent à ce moment la poursuite de l’exploitation. D’autre part, on peut imaginer que les
autorités de l’Etat aient craint un traitement « par trop » social ou identitaire de la question de
la mine.
Il faut attendre 1982172 et la création de l’association du CHM pour voir l’Etat et la
Région soutenir ensemble173 (financièrement) le musée de Lewarde.
Alors que les lois de décentralisation viennent doter la région de nouvelles
prérogatives, Noël Josephe le président du Conseil Régional, perçoit l’intérêt de l’associer à la
commémoration d’une activité emblématique de son territoire. Comme le suggère Yvon
Lamy174, l’autonomisation des collectivités naissantes suppose un socle identitaire
suffisamment légitime pour les faire apparaître comme des entités culturelles à part entière.
Le musée en tant que médiateur d’une mémoire commune contribue à poser les bases
culturelles de l’affirmation politique en cours. C’est ce qui transparaît dans l’allocution
prononcée par Noël Josephe, le 28 novembre 1983, concernant la politique culturelle du
Conseil Régional. Il y affirme « sa volonté de sauvegarder et de mettre en valeur le
patrimoine, les traditions locales, la mémoire collective, comme ressort essentiel de
nombreuses actions ». En soutenant un lieu de mémoire consacré à la mine175, la Région,
entité administrative abstraite promue au rang de territoire, s’incarne. Elle acquière
consistance affective et historique.
La Région en dépit de son faible poids sur les décisions (jusqu’en 1990 et la
présidence de M. Dolez) a donc trouvé avantage à soutenir très tôt un musée de la mine,
fragment d’une identité introuvable..
L’autre révélateur des enjeux de pouvoir que recouvre une telle entreprise culturelle,
tient dans la position du département du Pas-de-Calais vis à vis du CHM. Très tôt appelé à
soutenir le Centre, qui, bien qu’en dehors de son territoire avait vocation à raconter l’histoire
de tout le Bassin Minier, le département refusa longtemps d’apporter son concours.
Aujourd’hui encore, sa participation financière est modeste au regard des autres partenaires176.
172 Les majorités régionales et nationales d’alors convergent (Pierre Mauroy est premier ministre) ce qui contribua probablement à cette nouvelle conjonction de volontés. 173 Avec des logiques de participation distinctes. Cf. infra. 174 Lamy (Yvon), « Patrie, patrimoines », in Genèses II, mars 1993, p. 2-4. 175 Entres autres. 176 Environ 500.000 francs en investissement contre plus d’1 million pour le département du Nord et 0 en fonctionnement contre presque 1,5 million pour le Nord.
- 48 -
Comme nous le confirma Marc Dolez, les élus du Pas-de-Calais ont considéré comme
une aberration que le CHM soit implanté dans le Nord. Le centre du Bassin, de par
l’importance de l’activité, se situait dans la région lensoise et non dans le douaisis177. Alexis
Destruys avait d’ailleurs pensé, dans un premier temps, intégrer la fosse 19 de Lens au projet
de musée (en complément du site de Lewarde). Il dut rapidement abandonner cette idée
devant la levée de boucliers que suscitait la simple évocation de la fin de l’activité dans la
région lensoise.
Dans mon esprit, à la fosse Delloye, image des houillères
traditionnelles, devait être ajoutée une fosse moderne du bassin comme témoignage de l’étape ultime du progrès dans l’entreprise. J’avais pensé à la fosse 19 de Lens, ce « beffroi minier » de la plaine de Lens correspondant bien à cette idée et surtout, était située dans le département du Pas-de-Calais.
Car, pour les élus et aussi l’opinion publique, il fallait compenser le choix d’un puits dans le Nord par celui d’un autre dans le département rival…
Cette seconde idée avait plu. Mais il ne fallait pas en parler, car il n’était pas question d’évoquer la fin de l’extraction …à Lens178.
« Paradoxalement », c’est parce que le charbon y a tint une plus grande place et plus
tardivement que dans le Nord que le Pas-de-Calais ne fut pas retenu comme site
d’implantation du CHM179. Une fois l’enjeu de la fermeture dépassionné, il était trop tard. Les
contraintes budgétaires avaient contribué à concentrer les crédits sur Lewarde.
A ce titre, la création du musée de la mine de Bruay-La-Buissière180 peut être
considérée comme une réponse (riposte ?) du Pas-de-Calais au Centre Historique Minier.
L’édition locale de la voix du Nord, du Mercredi 6 décembre 1989, relate l’événement sous le
titre : « Le musée de la mine de Bruay s’inscrit dans les grandes réalisations du Pas-de-
Calais »181. Le discours que prononce Roland Huguet, président (P.S.) du département, lors de
son inauguration est explicite, même si le nom de Lewarde n’est jamais mentionné.
S’adressant au Président du musée : « Le Conseil Général doit vous aider dans votre
entreprise qui s’inscrit, à sa juste valeur, parmi les projets du département comme les musées
du papier, du marbre, de l’Eurotunnel ». Soutenir un lieu de mémoire n’est pas suffisant, il
faut aussi en être l’initiateur.
Une fois la fin de l’activité admise, le statut d’entrepreneur de mémoire devient source
de profits symboliques pour les élus locaux. Porter ou soutenir un projet qui trouve un écho
favorable dans la population, qui en appelle à ses racines, à sa culture, c’est aussi un moyen
177 Cf. I.A.2. 178 Extrait de l’article paru dans le bulletin des amis du charbon. 179 Nous avons déjà longuement parlé des effets symboliques de la muséification. 180 Soutenu cette fois-ci par le département du Pas-de-Calais. 181 Cf. annexe n°24.
- 49 -
de publiciser son attachement à un territoire, à son histoire, à ses habitants. C’est un moyen
de s’implanter.
Ajoutons que si l’influence positive de ces politiques patrimoniales sur la popularité de
l’institution ou de l’élu qui les met en œuvre reste incertaine182, elle n’est que très rarement
négative. Elles représentent ainsi des lieux privilégiés de l’intervention publique (« sans »
risques ), où élus et institutions médiatisent et valorisent leur action, sans trop s’exposer183.
Enfin, la création d’emplois184 liée à une nouvelle activité touristique rejaillit favorablement
sur ses promoteurs. Le maire de Lewarde nous le confirma :
Nombreux sont les exemples dans le bassin minier de personnalités politiques locales
dont le nom est associé à un grand projet autour du patrimoine minier ou du traitement des
restes : Jean François Caron185 et le réaménagement des terris186, Jacques Villedary, le Maire
de Noeux-Les-Mines et la piste de ski de Loisinord187, etc. Comme si l’intérêt pour ce
patrimoine, longtemps fustigé, était désormais devenu l’un des ressorts essentiels d’une
implantation politique locale réussie. En ce sens, la présidence d’une structure de
l’importance du CHM peut être considérée comme un enjeu politique.
L’élection en 1989 de Marc Dolez, élu important du Douaisis (député), représentant de
la collectivité la plus engagée dans le Centre ( le Conseil Régional), personnalité du parti
socialiste, comme successeur de Jean Perier à la présidence de l’association du Centre, en
témoigne188.
Elle fut d’abord le résultat d’un compromis, produit des « rapports de force » qui
prévalaient alors au sein de l’association. Si le rapport de force entre institutions était plutôt à
l’avantage de la Région et du département du Nord189, on peut penser que d’autres critères
sont intervenus dans le choix du président parmi les tous « présidentiables ».
182 On pourrait s’interroger sur l’effectivité du lien qui s’établit dans l’esprit des visiteurs entre le lieu visité et ses promoteurs. 183 J.C. Martin et Charles Suaud vont même plus loin dans ce sens : « l’invention des traditions semble bien devenue le lieu commun de toutes les politiques en mal de développement » ; Le Puy du Fou en Vendée, op. cit. 184 Le CHM, en incluant les 35 guides payés à la vacation compte presque 60 employés, soit l’équivalent d’une PME de taille respectable. 185 Conseiller régional Vert. 186 Notamment à Loos-En-Gohelle. 187 A ce propos voir le travail en cours de Charlotte Quelton sur les politiques publiques de requalification de terris, dans le cadre d’un mémoire de DEA de sciences politiques à l’IEP de Lille. 188 Les présidents issus des houillères étaient aussi politiquement marqués, mais pas comme élus, remettant en jeu leur mandat devant des électeurs. 189 Ce sont les deux plus gros financeurs.
F.D. - Est-ce que le fait d’être président d’une structure culturelle comme Lewarde, qui marche, qui est renommée… quels effets ça a sur la personne qui la dirige ? M. Nottez - Je pense que ça a un effet positif. De par les manifestations culturelles qui s’y déroulent. Et puis quand même les créations d’emplois. Il y a quand même un bilan qui est là et qui n’est pas négatif.
- 50 -
Marc Dolez, par son implantation locale, son appartenance au parti majoritaire, sa
stature nationale (en tant que député), son implication ancienne dans le musée190, s’est imposé
rapidement comme l’homme de la situation.
Bénéficiant en outre de l’indispensable soutien des Houillères, ici évoqué par M.Racle,
tout était réuni pour qu’il soit désigné:
Marc Dolez, est également apparu comme une solution « modérée »191, capable de
satisfaire tout le monde. M. Turbelin ne dit pas autre chose quand il analyse ce choix et évalue
les alternatives possibles:
Aujourd’hui, Marc Dolez a annoncé qu’il démissionnerait de sa fonction de conseiller
régional192 et ipso facto de celle de président du CHM. Le poste est donc à pourvoir.
190 Il représente la région au C.A depuis 1984 et détient probablement le record d’assiduité si l’on s’en tient à l’état de présence qui figure dans les comptes rendu de C.A. . 191 « Réformiste » selon l’un de nos interlocuteurs. 192 Il risquait d’être touché par la loi sur le cumul des mandats.
M. Racle - M. Dolez a remplacé M. Perier parce que les Houillères l’ont bien voulu. (…) La désignation ne s’est pas seulement effectuée par M. Verlaine, le Directeur Général, mais il aurait voulu que ce soit un autre, c’eût été quelqu’un d’autre. F.D. - Pourquoi ont-ils choisi M. Dolez alors ? M. Racle - Parce qu’il était d’abord en bon terme avec M. Verlaine, c’est un homme qui est assez ouvert, qui est en fait un socialiste très modéré, qui d’ailleurs, bien souvent fait équipe avec Hage pour le PC qui est modéré aussi et avec Vernier pour le RPR lorsqu’il s’agit des intérêts du coin. Le président Perier ayant pris avec M. Verlaine des contacts avec les autorités de tutelle, n’ont pas vu de mal à ce qu’on propose le Président Dolez. M. le Député n’ayant pas dit non…Il y a des décisions du C.A. qui sont préparées à l’avance, je ne vais pas vous faire un dessin. F.D. - A votre avis, est-ce que cela apporte à un homme politique local de présider un équipement culturel qui marche ? M. Racle - Ça a apporté à M. Dolez et au CHM.
F.D. - Pourquoi Marc Dolez a-t-il été choisi ? M. Turbelin - Parce qu’il était sur place. On aurait pu choisir Vernier (maire RPR de Douai) aussi. Je ne sais pas si Perier n’est pas allé voir l’un et l’autre. Il est probable qu’il ait pris des contacts. Je ne suis pas sûr que Perier n’est pas fait la démarche. F.D. - Et les communistes, il n’en a jamais été question ? M. Turbelin - Je ne sais pas si la Direction Générale aurait accepté cela. On a un souvenir épouvantable d’un Directeur-adjoint communiste en 1945. Ça avait marqué fortement les ingénieurs. F.D. - La solution Dolez était une sorte de compromis alors ? M. Turbelin - C’est un bon choix pour moi. Il avait ses entrées au Conseil Régional, était de la mouvance majoritaire. C’est un garçon calme, posé. Ça n’est pas un révolutionnaire Dolez. C’est quelqu’un qui fait avancer les chose avec beaucoup de volonté. Le choix d’un communiste personne n’y a pensé. Ça aurait fait la révolution dans le Bassin et entraîné une réaction des cadres importante.
- 51 -
Le contexte politique semble différent de celui de son élection en 89 et de ses
réélections successives193 (93, 97). Le parti communiste, deuxième force politique représentée
au conseil d’administration et fort implantée localement, peut-il prétendre à la succession ?
Rien n’est moins sûr selon le maire communiste de Lewarde :
Les socialistes tirent avantage de leur position politique « centrale » dans le contexte
politique du bassin minier mais aussi de leur force électorale194. Le prochain président du
CHM sera donc socialiste. Marc Dolez tout en préservant les apparences (« C’est le C.A. qui
élit le président donc tout est possible, tous les administrateurs ont vocation à être
président »), le reconnaît à demi-mot quand on l’interroge sur l’éventualité d’une présidence
communiste : « Celui qui sera désigné, devra apparaître d’une manière ou d’une autre,
légitime à l’ensemble du C.A…». Au regard de la diversité des partenaires, tout est dit.
3. Un « anti » écomusée ?
Le Nord-Pas-de-Calais ne saurait oublier son passé. Dans ce passé, la mine tient une place essentielle car elle a été non seulement une activité dominante mais encore un cadre de vie, une forme d’organisation sociale, une composante des mentalités. Elle demeure et pour longtemps, une part de l’esprit et du cœur des habitants de cette région. C’est pourquoi, il convenait de leur tendre un miroir, pour les aider à se reconnaître et pour permettre aux autres de mieux les comprendre. Tel est l’objet du Centre Historique Minier de Lewarde.
Cette « justification » apposée sur un dernier panneau conclut l’exposition
permanente195. La référence au miroir dont parlait G.H. Rivière196 est ici explicite. Elle traduit
toutes les contradictions qui caractérisent le CHM de Lewarde, tiraillé entre son édification,
193 Marc Dolez a été réélu deux fois, à l’unanimité, alors qu’il n’y avait pas d’autres candidats. 194 Toutes les grandes institutions présentes au Centre sont aujourd’hui dirigées par des socialistes. 195 Intitulée « Mine et mineurs ». 196 Cf. supra ; la muséologie selon G.H. Rivière, op. cit.
F.D. - Est-ce que la succession de M. Dolez à la présidence va être un enjeu entre P.C. et P.S ? Le PC pourrait prétendre à diriger le Centre ? M. Nottez - Je ne sais pas. Il y aura un consensus là dessus mais je ne peux pas vous dire si ça sera un enjeu politique. F.D. - Le PCF n’a jamais revendiqué la présidence du Centre ? M. Nottez - Non. On a la vice-présidence quand même. C’est M. Lefebvre (conseiller général) qui est vice-président. Il y a des accords tacites qui ont été faits comme ça. F.D. - Et cette fois-ci, ça sera un socialiste ou un communiste ? M. Nottez - Je pense sincèrement que ce sera un socialiste. Ça m’étonnerait que ça soit un communiste. Je serais surpris.
- 52 -
purement institutionnelle, et sa prétention participative (associer les habitants à l’œuvre de
mémoire).
Il faut prendre au mot ceux qui brandissent les miroirs … et aller voir de l’autre côté
du miroir.
On a déjà insisté sur le basculement de référentiel qui s’est opéré chez les promoteurs
du Centre, dans les années 80, du modèle de l’écomusée à celui du Centre de Culture
Scientifique et Technique. Ce basculement ne fit pourtant qu’entériner une situation qui
prévalait, dans les faits, depuis le début. A savoir que le CHM n’a, à aucun moment, tendu
vers l’organisation de l’écomusée, sinon dans les discours. En effet, jamais, les habitants ou la
population, n’ont été associés à sa gestion ou à son édification et toutes les tentatives pour
intéresser durablement des scientifiques sont pour l’instant restées vaines197. Si l’on reprend la
définition de l’écomusée fournie dans le document qui leur sert de charte de référence,
« Principes d’organisation », l’incompatibilité de nature est patente:
L’écomusée est une institution culturelle assurant, d’une manière
permanente sur un territoire donné, avec la participation de la population198 (c’est nous qui soulignons), les fonctions de recherche, conservation, présentation, mise en valeur d’un ensemble de biens naturels et culturels, représentatifs d’un milieu et des modes de vie qui s’y succèdent. La spécificité des écomusées se traduira par la mise en place de trois comités199 devant garantir la qualité scientifique de l’entreprise et assurer la participation effective de tous les intervenants.
Aussi, le terme de lieu de mémoire par décret que nous avons déjà employé ne semble
pas exagéré pour qualifier l’édification du Centre et son fonctionnement, même si une
ouverture (encore toute relative) en direction de la population est perceptible depuis le
désengagement des Houillères.
197 La direction du Centre avait bien tenté de réunir un comité scientifique, sous la pression de l’Etat, notamment, (Cf. II.B.2), mais l’entreprise a fait long feu. Finalement, une seule réunion des commissions ( formation, culture ; histoire et sciences sociales ; commission architecture et cadre de vie ; sciences de la mine et technologies nouvelles), présidée par Bertrand Schwartz (qui démissionna très vite de sa fonction), s’est tenue en 1985. Il y aurait d’ailleurs beaucoup à dire sur leurs compositions où la cooptation a joué un rôle important et où les représentants de l’entreprise apparaissaient en force. La création d’un comité scientifique est toujours en chantier aujourd’hui ( Olivier Kourchid, chercheur à l’IFRESI participa à une tentative de réanimation qui n’a pas duré). 198 La définition qu’en donnait G.H. Rivière dans son cours (op. cit.) allait dans ce sens : « Un écomusée est un instrument qu’un pouvoir, une population conçoivent, fabriquent et exploitent ensemble. » 199 Un comité scientifique : reflet de l’interdisciplinarité propre aux écomusées il se compose de spécialistes de sciences fondamentales et appliquées utiles à l’action de l’écomusée. Il élabore le programme scientifique de l’écomusée, il veille à la rigueur des propositions émanant du comité des usagers. Un comité d’usagers : il se compose des représentants des associations et autres organismes qui font un usage régulier de l'écomusée et acceptent de collaborer à ses activités. Il propose un programme d’actions, procède à l’évaluation et à l’appréciation des résultats obtenus. Un comité de gestion : il se compose des représentants des organismes qui financent l’écomusée. Le comité examine le budget de l’écomusée, en contrôle l’administration et la gestion.
- 53 -
Contrairement, donc, à ce que préconisait J. De Noblet, dans les années 70200, ici
comme ailleurs, les ouvriers ne sont jamais devenus « copropriétaires de leur histoire » mais
en sont restés spectateurs.
Cet état de fait pose la question plus large de la non-participation de la population et
de ses raisons. Une partie des réponses réside peut-être dans la démarche de projet, dont on a
montré201 tout ce qu’elle devait à la « culture autocratique » des Houillères. M. Turbelin en
donne quelques rouages :
Cette réponse révèle en creux quels sont les acteurs dont la présence semblait
incontournable. Les associations en sont exclues202.
Quand la population ou les habitants sont associés, c’est essentiellement à titre de
« soutien sans participation ». L’initiative de création d’une association des amis de la mine et
des mineurs203 (en plus d’être symptomatique d’un fonctionnement où tout est initié par le
haut) est caractéristique du mode de relation qu’on entend instaurer avec la population.
Ainsi, son modèle s’apparente plutôt à celui d’une association du type « amis des
musées de beaux-arts » et ne saurait correspondre à la vocation associative des écomusées.
Cette association ne verra finalement même pas le jour. M. Turbelin nous précisant à ce
propos que « deux choses avaient été ratées, l’association et le comité scientifique et
technique ».
Le rôle des habitants et des associations reste encore plus que modeste aujourd’hui,
quand il n’est pas carrément confondu avec celui des visiteurs204.
Nous avons interrogé le Maire de Lewarde sur la question de la participation:
200 La ré-appropriation du phénomène industriel, J. De Noblet, op. cit. 201 Cf. I.B. 202 Le travail actuellement mené par le groupe de recherche du CRAPS, susmentionné, nous en dira probablement plus sur la réalité et les causes de cette absence, à travers l’étude approfondie de ses manifestations dans le champ des mobilisations autour du cadre de vie. 203 Note d’intention, jointe au Procès verbal du Conseil d’Administration du 1er Octobre 86. 204 La réponse de M. Racle à la question de savoir si le musée était assez ouvert aux habitants, et aux associations est éloquente : « Je sais que le directeur en tient fort compte. Ils ont une sorte de livre d’or à la buvette. (…) Chaque fois qu’un livre d’or est achevé, il est épluché. Rien qu’un exemple : au début les visites duraient trois heures, elles ont été ramenées depuis à deux ».
F.D - Est-ce que le musée, quand il a été créé, était assez ouvert sur l’extérieur ? A-t-on laissé suffisamment la place aux associations d’habitants, d’anciens mineurs, d’anciens cadres. Est-ce que ça ne s’est pas fait en vase clos ? M. Turbelin - Je pense que nous étions ouverts à l’arrivée de gens qui souhaitaient participer et que finalement il n’y a pas eu… Alors est-ce que c’est le fait que Lewarde soit un petit peu dans un coin perdu ? C’est possible. Bon, on n’a pas fait d’efforts. On n’a pas recherché les associations. On a dit : il faut que les syndicats soient là. Après on a pensé aux élus, ensuite aux pouvoirs publics. A part ça on n’a pas pensé…ça ne nous est pas venu à l’idée.
- 54 -
La collecte annuelle d’objets de la mine, plus qu’à un hypothétique enrichissement du
Centre, contribue bien à ce que les habitants se rencontrent et discutent ensemble de leur
passé. Cependant les autres exemples comme celui-ci sont peu nombreux où la population se
transforme en acteur de sa mémoire205 et plus simplement en récepteur. Une ouverture
indéniable s’est produite depuis la fin de l’époque Houillères, à l’instigation de M. Dubuc le
nouveau Directeur. Malgré tout, la collecte d’objets s’apparente encore à l’arbre qui cache la
forêt, en l’occurrence l’absence d’une véritable réflexion sur ce que pourrait être le rôle des
habitants et des associations, en tant qu’acteurs permanents du CHM. La volonté affichée par
M. Dubuc présage peut-être celle-ci :
Le « modèle » du Centre de Culture Scientifique et Technique206, sous une forme
incomplète (sans comité scientifique), a donc prévalu jusqu’à maintenant sur celui de
l’écomusée. Ces deux modèles s’opposent par plusieurs aspects, notamment celui de la place
dévolue à la population207. Rappeler la prédominance du premier sur le second dans le cas de
Lewarde contribue à démystifier le discours dominant car socialement légitimé d’un
investissement patrimonial en écho aux aspirations d’une population partie prenante.
Il est encore trop tôt pour dire si s’amorce aujourd’hui une nouvelle phase, intégrant
pleinement la dimension participative, inhérente aux écomusées.
205 Il y a bien le salon de la mine, où sont présentées des œuvres ayant trait à l’univers de la mine, mais les artistes exposant sont peu nombreux et sélectionnés. 206 Invention des politiques culturelles du début des années 80. Cf. I.A.3. 207 Voir supra.
F.D. - Est-ce que la population participe à l’œuvre de mémoire ? M. Dubuc - L’objectif premier( de la collecte), c’est de dire à la population : cette mémoire est la vôtre. Vous pouvez venir la trouver mais aussi la constituer. Un musée comme le nôtre, qui est un musée de société n’existe que si la société s’y implique. On ne constitue pas un écomusée (contre ça serait idiot) à côté de la population. La mémoire de la mine appartient à la population du Bassin Minier.
F.D. - Est-ce que le musée est assez ouvert aux habitants ? Est-ce qu’ils participent comme ça se fait dans un écomusée par exemple ? M. Nottez - Non de ce côté là…On ne pas dire que ce soit assez ouvert. C’est plutôt ouvert vers d’autres institutions comme le comité scientifique, vers les chercheurs. De ce côté là d’accord. Mais vers les habitants…à part les guides qui sont d’anciens mineurs, qui sont rémunérés, attention ! Ça n’a rien à voir avec un petit musée associatif où des bénévoles viennent donner un coup de main. F.D. - Il n’y a pas d’associations de la commune qui participent par exemple aux réflexions du Centre ? M. Nottez - Non, non. C’est peut-être dommage. Mais il y a une tentative d’ouverture quand même, même si actuellement ça n’existe pas.
- 55 -
B. La mémoire au pluriel
« L’histoire est la Reine des batailles d’idées ». F.Nietzche
L’analyse des ressorts d’un lieu de mémoire comme le CHM est indissociable de
l’identification de ses entrepreneurs et des enjeux sous-jacents à leur implication.
La deuxième étape consiste à comprendre selon quelles modalités et logiques
distinctes, les acteurs s’approprient la mémoire de la mine. Cette approche compréhensive
nous conduit à reconnaître des logiques d’investissement patrimonial qui tout en convergeant
vers le même objet (le CHM) sont porteuses d’interprétations de mémoire distinctes.
Le CHM apparaît dès lors comme un creuset, réceptacle privilégié des affrontements
(et des compromis) qui se nouent autour de la mémoire de la mine et des usages sociaux de
cette mémoire.
1. Derrière le paravent du consensus…
Le CHM nous est d’abord apparu comme le lieu d’un surprenant208 consensus. La
condition préalable à celui-ci était la fermeture des mines. Une fois effective, la création d’un
musée et son corollaire, le « devoir de mémoire », paraissent naturels, voire nécessaires à tous
les acteurs du territoire. C’est une constante qui ressort très nettement des entretiens réalisés
auprès des différents protagonistes. Ils s’étonnent même, parfois, qu’on puisse leur poser la
question209 des raisons de leur investissement patrimonial.
Ainsi, loin de « faire de la mémoire collective un problème », ils en font une évidence.
La caractéristique principale de ces discours, c’est leur propension à considérer la mémoire,
non comme un produit, comme une reconstruction présente du passé, mais comme une
donnée objective qu’il suffirait de mettre à jour. La mémoire collective est réifiée,
autonomisée. Elle n’est pas construite mais énoncée. Ainsi définie, elle est rarement perçue
par les acteurs eux-mêmes comme un enjeu. Elle devient réponse, en soi. Les propos de M.
Bourge sont significatifs de cette « déproblématisation », appréhension de la mémoire au
singulier :
208 Au regard de la diversité des acteurs en présence. 209 Voir l’encadré, extrait de l’entretien avec M. Bourge page suivante.
- 56 -
A la lecture des comptes-rendus des conseils d’administration, on se rend bien compte
de l’unanimisme qui prévaut parmi les membres, concernant le contenu du musée. Les débats
relatifs au contenu ou au sens de la mémoire collective210 y sont quasiment absents.
On retrouve la trace de ce consensus dans nos entretiens. D’abord Louis Bembenek,
représentant la CGT :
M. Racle, représentant Charbonnages de France dit presque la même chose :
210 Alors que c’est de la compétence du conseil de valider les expositions proposées par le conservateur (qui garde une grande autonomie cependant) et que ses membres sont autorisés à faire des propositions en la matière.
F.D. - Donc il n’y a pas eu de débats ces dernières années au Conseil Régional concernant le soutien aux musées techniques ? M. Bourge - Si, il y a eu un grand débat culture l’année dernière, il en est ressorti que les élus voulaient préserver la mémoire. F.D - Pourquoi selon vous ? M. Bourge - Pourquoi ? Je vous l’ai dit parce que tout est en train de disparaître. Je vous ai parlé tout à l’heure des terris, que les populations étaient bien contentes de voir partir « toutes ces horreurs » qui servaient de soubassements pour les TGV, pour les routes, etc. et maintenant il y a des comités de défense pour les préserver. Ça fait partie du paysage et de la mémoire collective.
F.D. - Quels sont exemples de désaccords que vous auriez pu avoir avec les autres membres du C.A. concernant le musée? M. Bembenek - Bon, les points de divergence c’est plutôt au niveau du fonctionnement financier. Le ministère devrait aider en fonctionnement. Tout le monde est d’accord sur le prix des entrées qui nous paraît trop fort, surtout pour les enfants. F.D. - Y a-t-il des débats sur le plan muséographique ? Est-ce que des discours divergents s’expriment ? M. Bembenek - Non, en toute honnêteté. Même si on ne partage pas les mêmes idéaux, je crois que les gens qui participent à ce conseil ont une opinion unanime pour dire qu’il faut qu’on travaille ensemble. Des contestations…bon c’est vrai qu’on est peut-être pas d’accord sur la forme, mais si on est d’accord sur le fond c’est déjà très important.
F.D. – Pouvez-vous me parler des débats entre les différents partenaires du musée ? Les partenaires sont quand même très divers. Il y a des syndicalistes, des membres de C.d.F, des représentants des collectivités locales…Quelle différence ? M. Racle - Quasiment nulle. Les différences, elles n’ont pas lieu à ce niveau là. Les syndicalistes sont d’anciens mineurs, les représentants de C.d.F sont d’anciens mineurs, à ce niveau là, à part d’échanger quelques histoires d’anciens combattants vous savez le reste…Le problème est au niveau de ceux qui ont le fric ou de ceux qui doivent le demander. Ce qui doivent le demander trouvent qu’il n’y en pas assez et ceux qui le donnent trouvent qu’il y en a déjà de trop. La polémique, elle est là dessus et pas ailleurs. F.D. - Il n’y a pas de différences de vue ? Quand il y a un projet les gens se retrouvent spontanément sur ce qu’il faut montrer ? M. Racle - (…) Je ne dis pas que, de temps en temps, sur une queue de cerise, il n’y en pas un qui est d’accord et un qui n’est pas d’accord, mais c’est presque rien. Le fond du problème c’est que tout le monde est d’accord pour dire qu’il faudrait plus d’argent pour mieux tourner. Tous les administrateurs sont plutôt unanimes pour dire "il faut défendre le musée" (…).
- 57 -
Enfin, M. Bourge du Conseil Régional, à l’unisson:
Un consensus se réalise donc autour d’ « une » mémoire collective qu’il faudrait
préserver et dont le musée serait le dépositaire, sans que les acteurs ne définissent jamais
précisément ce qu’ils incluent dans cette « mémoire de la mine » 211, utilisant le concept tel un
slogan212.
On pourrait presque parler de consensus autour d’un quiproquo : personne
n’explicitant véritablement cette mémoire collective, elle devient une coquille vide que tout le
monde remplit à sa guise en lui prêtant des caractères différents mais qu’il croit partagés et
évidents pour tous. Chacun croît reconnaître la mémoire collective dans ce qui n’est que sa
mémoire particulière. Dès lors, la mémoire collective n’est plus un enjeu puisque ses
contradictions, ses multiples formes possibles ne sont pas réellement perçues par les acteurs.
Les entretiens que nous avons réalisés auprès des différents partenaires montrent
d’ailleurs que le contenu du musée (invariant) donne lieu aux interprétations les plus diverses
et contrastées213. Prédisposition au syncrétisme de celui-ci et phénomènes d’attention
sélective des visiteurs donnent le sentiment à chacun de voir représentés au CHM les éléments
de sa propre mémoire, transfigurée en mémoire collective.
Ce sont les raisons essentielles du consensus (fictif) qui s’établit spontanément autour
du musée et de son contenu.
D’autre part, l’image sociale du mineur donne lieu à des appropriations multiples qui
ont en commun leur forme stéréotypée. De l’ouvrier modèle décrit par les employeurs au
militant dévoué des syndicalistes il n’y a parfois qu’un pas214, les deux figures
s’accommodant d’une représentation exaltée de la réalité.
L’autre facteur de cet unanimisme apparent tient aux nombreux discours convenus,
chargés des poncifs habituels de la rhétorique patrimoniale215, qui contribuent à faire de la
mémoire collective un prêt-à-penser.
211 On verra ensuite que les acceptions de cette mémoire diffèrent bien entendu. 212 « Devoir de mémoire », « garder la mémoire », etc. 213 Cf. II.B.2 214 On précisera ce point dans la partie consacrée aux images sociales de la mine et des mineurs 215 Sur cette rhétorique et ses figures voir l’article de Marc Guillaume, « Invention et stratégies du patrimoine », pp. 13-21, in Patrimoines en folie (dir. H.P. Jeudy), Paris, Ed. de la Maison des sciences de l’Homme, Cahiers, collection ethnologie de la France, 1990.
F.D. - Est-ce que l’interprétation de la mémoire de la mine est la même au Conseil Régional et au Conseil Général(la majorité est à droite au moment de l’entretien) ou au Conseil économique et social ? M. Bourge - Je n’ai pas remarqué qu’il y ait beaucoup de divergences. Tout le monde concourt à une seule et même préservation de la mémoire. C’est surtout la façon de la préserver et d’apporter des moyens à sa préservation qui amène à débattre. Quant à la mémoire elle-même, non.
- 58 -
Faute de discuter du sens qu’ils accordent à l’investissement patrimonial, les acteurs
revendiquent la « fidélité au passé », le « besoin d’enracinement » comme justifications de
leur action. Ces lieux communs fédérateurs masquent d’autres motivations plus conflictuelles.
A rebours du lieu de confrontation « attendu », le CHM s’est d’abord présenté à nous
paré des atours du consensus216. Pourtant, le recours à une mémoire de la mine ne va pas
d’amble.
2. …une mémoire de la mine à géométrie variable
Traiter de cette question nécessiterait, à soi seul, d’y consacrer un mémoire de
recherche. Partant du principe qu’il y a probablement autant de mémoires de la mine qu’il y a
d’individus, le champ qui s’ouvre à nous paraît infini.
Nous choisirons donc de parler avant tout des usages sociaux de la mémoire de la
mine.
En effet, comprendre la fonction, l’utilité que les différents partenaires du Centre
attribuent à l’œuvre de mémoire au présent permet plus sûrement que tout inventaire, de
décrypter et de dénaturaliser l’investissement patrimonial.
Rappelons-le ici: le sens de la mémoire n’est rien d’autre que les façons qu’on a de
s’en servir. Par conséquent, il nous faut concentrer notre attention sur les enjeux présents qui
vont conditionner, selon les acteurs, des interprétations et des modalités d’appropriation du
passé distinctes. Comme le note très justement Gérard Noiriel217 : « derrière la sauvegarde du
patrimoine, la réhabilitation de la culture ouvrière (revendiquée par tous) se cache une grande
diversité d’usages sociaux de la mémoire collective ».
Il s’agit donc de contextualiser le discours patrimonial et l’implication des différents
partenaires du Centre en mettant en exergue les enjeux auxquels ils étaient confrontés au
moment de leur implication.
Le premier acteur de l’investissement patrimonial, chronologiquement, furent les
Houillères. Au moment où l’activité d’extraction périclitait le musée a joué un rôle évident de
« communication » autour de la fermeture. Nous en avons déjà largement fait état218.
Ce sur quoi nous voudrions insister ici, c’est sur un autre non-dit de leur investissement
patrimonial.
216 « Tout allant pour le mieux dans le meilleur des musées possible » pourrait-on ajouter. 217 Noiriel (Gérard), le pont et la porte, op. cit. 218 Cf. II.A.1
- 59 -
Il faut bien comprendre la perspective dans laquelle se trouvent les Houillères quand
elles décident de créer le CHM. Leur disparition prochaine paraît inéluctable. Par la création
d’un musée, elles se donnent l’occasion de participer à la construction de leur propre image
posthume, en rendant grâce si possible à ce qui a été fait219. Ainsi, le passé minier peut être
magnifié et glorifié (emprunts au registre de l’épopée). Les exemples de ces discours d’auto-
célébration ne manquent pas chez les anciens exploitants :
Cet usage de la mémoire de la mine est également palpable dans l’extrait du discours
que prononça J. Ragot, premier président du CHM et Président des HBNPC, à l’occasion du
premier C.A. de l’association du musée220: Pendant 250 ans la mine a constitué le support et le symbole de la
prospérité industrielle du Nord-Pas-de-Calais. En 1925 – année de la mise en exploitation de la fosse Delloye où nous nous trouvons – l’exploitation charbonnière constituait l’activité économique dominante de la Région. L’organisation sociale qu’elle y a imposée n’a pas d’équivalent ailleurs par son étendue et sa force.
Aujourd’hui, l’épopée de la mine prend sans doute une dimension beaucoup plus modeste. L’évolution du Bassin, les mutations en cours risquaient de vouer aux friches et à l’oubli, si rien n’avait été fait pour transmettre cet immense héritage culturel, technique et humain.
Le CHM dont l’Association responsable est aujourd’hui officiellement constituée répond à ce besoin. Grâce à lui, non seulement les multiples élément portant témoignage de l’extraction du charbon seront conservés, valorisée mais, également, la mémoire collective de toute une région sera exaltée.
On comprend dès à présent ce qui fut longtemps la limite intrinsèque du musée :
Edifié par les Houillères et contrôlé par ses représentants, il ne pouvait que leur rendre grâce.
Jusqu’en 1990, les thèmes des expositions ainsi que leurs maîtres d’œuvre221 sont
révélateurs de cette situation, où l’ancien exploitant est juge et partie222. Plus qu’une volonté
219 L’un des derniers panneaux de l’exposition permanente s’intitule : « l’héritage minier…gage d’avenir». 220 Cf. annexe n°13. 221 Les exemples les plus éloquents seront les expositions consacrée à la silicose en 1987et à l’habitat, en 1989. La première, réalisée par le docteur responsable de la santé aux Houillères et qui ne faisait pas mention des difficultés que connaissaient les silicosés à faire reconnaître leur maladie professionnelle par les HBNPC, fera l’objet d’une révision dès l’arrivée du nouveau Directeur (M. Dubuc), avec la publication d’une plaquette. Quant
F.D. - Pourquoi un musée de la mine ? M. Turbelin - Je crois quand même qu’on a marqué la région de manière très profonde. Il faut imaginer que le pays dans lequel on est, en 1700 et quelques, c’était que des marais. Je pense qu’il fallait garder un souvenir des mines qui ont marqué profondément la Région. Il faut quand même imaginer qu’il y deux siècles il n’y avait rien. Que toutes les entreprises qui se sont implantées, les tuileries, les sucreries, les usines de briques…Tout ça c’est dû au fait qu’on avait de l’énergie (…). Ça c’est nous qui l’avons fait. C’est l’exploitation minière qui l’a fait. Bon ça, quand même il ne faut pas que dans deux siècles ou trois siècles on n’en parle plus (…). F.D. - Comment expliquez-vous le succès du musée ? M. Turbelin - Ça représente un métier qui a disparu récemment, donc c’est quand même une belle histoire que l’histoire de ces deux siècles d’exploitation. Ça a fait quand même la richesse de la région pendant deux siècles et demi. Ça a été une des premières matière première qu’on a développée mondialement. Je crois aussi que c’est une façon de montrer que c’était un métier qui avait de la valeur.
- 60 -
délibérée de manipuler la mémoire ( dans le sens où ils auraient été conscients de réécrire
l’histoire en dépit de la vérité) nous voyons là les effets de la mainmise des dirigeants des
Houillères sur le musée, laissant place libre à leur interprétation de l’histoire de la mine, qu’ils
considéraient, souvent de bonne foi, comme mémoire collective légitime.
Marc Dolez nous a confié son sentiment sur cette période Houillères, tout en
l’illustrant d’un exemple significatif, selon nous, de leur état d’esprit:
Il faut donc rechercher ce que les acteurs mettent en jeu de plus précieux dans leur
investissement patrimonial.
Il nous semble que pour les HBNPC et ses dirigeants, il s’agissait de leur image
posthume.
Qu’en est-il pour les organisations syndicales de mineurs223 ?
Leur approche du passé n’est peut-être pas tant éloignée de celle des Houillères, qu’on
aurait pu le penser a priori. Leurs situations objectives par rapport à l’investissement
patrimonial comportent en effet des points communs.
A l’instar des HBNPC en leur temps, les organisations syndicales savent qu’elles vont
disparaître, en même temps que les retraités ou les veuves de mineurs qui les composent
aujourd’hui.
à la deuxième elle fut presque totalement réalisée par la … SOGINORPA et fait partie, aujourd’hui encore, de l’exposition permanente. 222 L’exposition permanente actuelle, installée étonnamment quelques mois avant l’arrivée des nouveaux dirigeants extérieurs aux Houillères, est sur ce point exemplaire. On l’analysera dans la troisième partie. 223 Nous nous limiterons essentiellement à la CGT, n’ayant pu, faute de temps, rencontrer des représentants d’autres organisation, même si les comptes-rendus du C.A consignent leurs interventions.
F.D. - La transition que vous avez effectuée, qu’a-t-elle changé de profond dans la gestion du Centre, par rapport à la gestion Houillères ? M. Dolez - Je crois, en deux mots, que tant que le Président du C.A du Centre était en même temps le Président des Houillères, sachant qu’à cette époque là il n’y avait pas de directeur mais un administrateur délégué, ancien responsable des Houillères (M. Liégeois),tant qu’on était dans cette situation, Lewarde était perçu comme le lieu et l'endroit où l'on pouvait, a posteriori, justifier toute cette histoire. Le fait qu’on tourne la page, avec un Président qui soit un élu, avec aussi l’arrivée d’un Directeur qui n’est pas du tout lié aux Houillères, mais qui dirige avec la grande rigueur scientifique qui est la sienne, je crois que d’un musée des Houillères, entre guillemets, on passe à un Centre de Culture Scientifique de la Mine et de l’énergie qui, avec toute la rigueur qui est nécessaire par rapport à cette période qui a profondément marqué notre histoire, s’autorise le recul nécessaire dans l’analyse de cette période. Pour vous donner un exemple, qui est loin d’être anecdotique et un petit peu symbolique, il n’y a pas encore tout à fait prescription puisqu’il y a encore des gens en activité dans le circuit, quand je suis arrivé, fin 1989, l’arrêt des deux deniers puits de mine du Nord-Pas-de-Calais était programmé pour les mois qui suivent. Et j’ai trouvé dans les cartons, un projet où les Houillères avaient vaguement imaginé, sans que ça ne soit très précis, une grande manifestation un petit peu festive à Lewarde, à l’occasion de la fermeture, ce qui aurait été l’occasion de toute cette justification de la manière dont les choses s’étaient produites. Je n’ai évidemment pas donné suite à un tel projet.
- 61 -
Leurs « heures de gloire » sont derrière elles, et leurs jours sont comptés. Même si
l’échéance est encore relativement lointaine224, les effectifs syndicaux de certaines branches
sont appelés à décroître progressivement.
De ce fait, elles sont dès à présent concernées par ce que l’on dira d’un passé dont
elles furent l’un des principaux protagonistes. La création par la CGT de l’association
« Mémoire et Cultures »225 traduit pour partie ce souci de prendre part à l’œuvre de mémoire.
Celle-ci entend en effet défendre les pans sociaux et syndicaux de la mémoire de la mine. Des
éléments de divergence avec Lewarde sur ce sujet se font jour dans les propos de M.
Bembenek, relativisant le consensus de mauvais aloi d’abord affiché:
Cette mémoire particulière dont se sentent investis les syndicalistes, rejaillit sur la
nature de leurs interventions ou de leurs propositions au C.A. du CHM. Ainsi M. Lempereur,
représentant la CFDT à la fin des années 80, fut peut-être le plus enclin226 à y défendre une
« optique syndicale ». Ainsi, dès 1987227 il suggère que le Centre consacre une place plus
224 De nombreux anciens mineurs, préretraités du fait de la fermeture des puits, sont encore relativement jeunes. 225 Cf. annexe n°25. 226 Par le nombre de ses propositions. 227 Proposition faite au Conseil du 3/02/87.
F.D - Quelle est votre attitude par rapport au musée de la mine ? M. Bembenek - Notre attitude est très positive parce que le musée représente la mémoire des mineurs, les conditions dans lesquelles ils ont travaillé. Au début de notre entretien, je vous ai dit que l’on avait mis en place une association « Mémoire et Cultures ». Aujourd’hui, on travaille en partenariat avec le CHM. C’est tout à fait naturel. Il y a une complémentarité entre nous deux. Le CHM a un rôle plutôt sur la technique, sur comment les mineurs ont travaillé, il y a eu des galeries reconstituées. Bon, c’est plutôt la technique qui est là-bas. Nous, notre rôle c’est le social et la place de l’homme. Parce qu’il faut le dire, s’il n’y avait pas l’homme, tout cela n’aurait jamais existé. (…) F.D - Peut-on tout dire sur la mine dans un musée de la mine. Est-ce qu’on peut montrer les conflits par exemple ? M. Bembenek - Il le faudrait. Mais là-dessus, dans la conception actuelle du musée ce n’est pas tellement dans sa logique. C’est pour cela qu’il y a ce partenariat entre le CHM et l’association « Mémoire et Cultures ». F.D - Vous êtes satisfaits du traitement des luttes sociales ? M. Bembenek - Je pense qu’elles sont montrées de façon assez superficielles, on ne va pas au fond des choses. F.D - En tant que syndicat, vous avez poussé ou incité à réfléchir là-dessus ? M. Bembenek - Oui, on a poussé pour que le mouvement social soit mieux représenté, mais ça n’a pas tellement été retenu et aujourd’hui, dans le contexte actuel, ce n’est peut-être pas la vocation du musée non plus. (…) F.D - Est-ce que la mémoire de la mine est utile pour le présent ? M. Bembenek - Je crois en tant que syndicaliste que la mémoire de la mine est utile pour le présent. Sur les luttes qu’il y a eu au niveau des mineurs, sur la solidarité qu’il y a eu dans ce métier et une fraternité. (…) Ça doit servir. Surtout dans les luttes très fortes qu’il y a eu pendant des décennies pour l’amélioration des conditions de vie ou tout le monde prenait sa part.
- 62 -
importante à l’histoire des mineurs. Le Président, J. Perier, charge en réponse le Directeur du
Centre de prévoir la réalisation d’un bureau du délégué mineur228. Ce dernier ne verra
cependant jamais le jour…229 De même, M. Lempereur est à l’origine d’une proposition
d’exposition230 ayant pour thème « l’histoire du syndicalisme et des luttes ouvrières dans le
bassin minier Nord-Pas-de-Calais ». Jusque-là, personne n’avait semble-t-il jugé bon d’en
parler. Elle aboutira cette fois ci à une exposition, « Le temps des révoltes »231, toujours en
place actuellement sous la forme d’un estaminet de 1884 reconstitué.
Il y aurait beaucoup à dire sur les liens entre la personnalité et les convictions
syndicales du promoteur de cette exposition, M. Lempereur, et son contenu232. A l’intérieur
même du champ syndical, la mémoire est un enjeu.
L’autre point essentiel est ailleurs. Comme le rappelle Guy Baudelle233, « L’héroïsme
et le dévouement dont a fait preuve la population minière au cours de son histoire assure la
légitimité des revendications du personnel politique et syndical».
Une fois les mines fermées, c’est essentiellement la mémoire fétichisée de l’activité et
des actions passées qui légitime l’existence des organisations syndicales et de leurs
revendications. La réactivation/reconstruction du passé devient également pour elles une
ressource politique essentielle, propre à mobiliser la population autour des questions liées à la
fin de l’exploitation ou à la gestion de son héritage (gratuité du logement, système spécifique
de sécurité sociale entre autres).
Louis Bembenek, nous parle de quelques-uns des combats d’aujourd’hui, nouvelles
matrices des usages sociaux de la mémoire de la mine:
228 Depuis quelques années, existaient sur ce modèle un bureau du directeur et un bureau du géomètre qui reconstituaient ces lieux tels qu’ils pouvaient se présenter dans les sièges d’extraction en activité dans les années 30. 229 Un bureau comptable accompagné d’une exposition, sera cependant réalisé en 1993, et relatera un jour de paye en 1935 et les difficultés du quotidien pour une famille de mineur. 230 Cf. annexe n°14. 231 Inaugurée en 1991, soit après le départ des Houillères. 232 La période dont il est question (1793-1914) est celle d’un réformisme syndical dominant (dont M. Lempereur est l’héritier) à l’intérieur de la corporation minière et l’exposition met fortement l’accent sur les acquis de ce type de luttes.
- 63 -
Ainsi, ce que les organisations syndicales mettent en jeu dans leur investissement
patrimonial, c’est leur légitimité à agir encore aujourd’hui, au nom du passé et de l’héritage
des mineurs.
Pour les élus locaux ou l’Etat, la perspective est différente.
Les premiers hésitent, à première vue, entre une fétichisation du passé et sa
conjuration. La mémoire est à la fois perçue comme le ferment d’une identité collective 234,
propice au développement d’un sentiment d’appartenance, et comme une entrave à la
reconversion du territoire. La tentation est grande de lui réattribuer des valeurs compatibles
avec une marche en avant.
On a déjà dit quelques mots235 sur l’usage à des fins politiques, d’une mémoire
affectivement surinvestie. Son exaltation a parfois servi (volontairement ou de fait) à souder
une population236 autour d’un élu237 ou d’une institution. On peut parler ici de mémoire
étendard. Les collectivités locales et la Région notamment, ne se sont pas impliquées pour
rien dans le CHM à un moment où il leur fallait s’affirmer en tant qu’institutions légitimes.
Un sentiment d’appartenance à une communauté, pour imprégner durablement les esprits, a
besoin de repères tangibles. Les lieux de mémoire font partie de ces repères où une identité
prend forme et s’incarne. Dans le droit fil de cette perspective, Noël Josephe, Président du
Conseil Régional déclare en 1982, lors de la première réunion du C.A. : « Ce musée, ce n’est
pas pour enterrer le Bassin Minier, mais au contraire, pour magnifier ce passé exemplaire sur
233 Baudelle (Guy), « L’enjeu patrimonial dans les bassins houillers d’Europe », Les Annales de la Recherche Urbaine n°72, dossier patrimoine et modernité. 234 Que l’on contribue ainsi à créer. 235 Dans la partie intitulée « lieu de mémoire, lieu de pouvoir ». Cf. II.A.2. 236 Guy Baudelle, dans son article (op. cit.), cite une étude (Dubar, 1982) qui a montré comment la municipalité communiste de Sallaumines, en soudant la communauté autour de la mine, a créé un handicap pour imaginer une reconversion. 237 Il y aurait un très beau travail de recherche à engager sur les usages et les profits de cette mémoire par les leaders politiques du bassin minier.
F.D - Est-ce que l’existence d’un musée de la mine signifie que le monde de la mine est enterré ? M. Bembenek - Non, le monde de la mine pour nous il est toujours vivant avec ce qu’il a laissé en héritage : ce musée, les institutions qui sont en place. Par exemple le patrimoine immobilier, c’est une bagarre qu’on mène encore pour essayer de le conserver parce que, bon, je ne sais pas si vous avez suivi les derniers événements, les déclarations du secrétaire d’Etat au logement qui ne vont pas dans notre sens. Bon et puis il y a une autre institution qui s’appelle la sécurité sociale minière. On ne veut pas simplement la conserver pour les retraités et les veuves, parce qu’aujourd’hui il y a une population de retraités et de veuves ; il y a à peu près dans la région encore 130000 personnes qui sont issues de la mine. On sait très bien que ces personnes disparaissent naturellement. Donc dans x années, il n’y aura plus rien. Mais c’est un héritage que l’on veut laisser aux jeunes générations. Par exemple le patrimoine immobilier nous disons qu’il doit rester pour les générations futures mais que ça soit des logements sociaux qui servent aux populations de la Région. Parce que si aujourd’hui il y a ce patrimoine, c’est quand même grâce au travail des mineurs. Et sur l’autre institution, la sécurité sociale minière, on ne veut pas la conserver pour nous. On dit "on a un outil formidable" avec ses œuvres sociales, ses dispensaires, ses hôpitaux, son personnel et dans une région en queue de peloton sur le plan de la santé.
- 64 -
lequel il faut s’appuyer pour bâtir demain ». Le ton est encore celui de l’exaltation, plein
d’emphase, mais la thématique du passé au service de l’avenir est déjà présente.
C’est un point important à préciser ici : L’opposition, la tension supposée entre
l’intérêt pour le passé et le souci de préparer l’avenir n’est qu’apparente. Quand le passé est
exalté, c’est toujours dans la mesure où les élus y voient un moyen de discourir sur le présent
ou sur l’avenir238 et rarement par pure délectation passéiste. Les enjeux d’un recours à celui-ci
ont donc nécessairement à voir avec le présent.
Quand l’Etablissement Public Régional décide en 1979 de confier à l’Office Culturel
Régional l’organisation d’un colloque sur le patrimoine industriel, il impose le thème :
« stratégies pour un avenir ». On aurait tort de prendre l’investissement patrimonial des
collectivités locales pour de la simple nostalgie239. En plus du pôle d’attraction touristique240
et économique241 qu’il représente, le musée est perçu comme le médium potentiel d’une
nouvelle image du bassin minier. Le passé est d’autant plus facilement investi que cet
investissement est supposé rompre avec l’image négative de la Région.
Le souci de faire le deuil d’une période (celle de l’exploitation charbonnière) qui
stigmatise encore le territoire transparaît dans les propos des représentants des collectivités
locales. Pour rester dans le registre de la psychanalyse, on y décèle les syndromes d’un
« complexe des terrils »242. Dans cette optique, le CHM contribue à une thérapie collective.
M. Bourge du Conseil Régional :
238 L’avenir recouvre d’ailleurs des acceptions très diverses qui dépendent de la vision du monde de celui qui s’y projette. Il faut donc éviter de ne l’envisager qu’à travers le prisme positiviste. Voir la note 239. 239 De même Suaud et Martin ( op. cit.) montrent qu’on aurait tort de réduire le spectacle du Puy du Fou comme à une célébration réactionnaire. Les valeurs que diffuse le spectacle sont autant d’éléments d’une « utopie conservatrice » qui prétend répondre, à l’instar du mouvement de P. De Villiers, aux « maux de la société modernes ». C’est donc aussi une allégorie de programme politique. 240 Le tourisme industriel est actuellement en plein essor. Cf. les article du Monde « Le tourisme industriel intéresse de plus en plus de vacanciers »(18 juillet 1996) et de l’Usine Nouvelle « Le Nord-Pas-de-Calais exploite le filon » (3 juillet 1997) ; Cf. annexe n°15. Le CHM a d’ailleurs reçu le trophée EDF 1997 du tourisme industriel et technique. 241 Non négligeable au niveau local mais tout relatif au niveau régional. Aucune entreprise n’est venue s’installer à Lewarde suite à l’implantation du musée et les effets touristiques induits continuent d’être limités selon le maire. Environ 50 emplois sont directement ou indirectement liés au musée, auxquels s’ajoutent les recettes fiscales liées à la Taxe Professionnelle pour la boutique et le restaurant. 242 Essai de conceptualisation…
- 65 -
L’autre point intéressant à relever dans cette réponse et qui revient chez beaucoup de
nos interlocuteurs, c’est l’insistance sur le sacrifice réalisé par les mineurs (et par extension
commode, la Région) au profit de la nation tout entière243. On perçoit aisément la ressource
politique que peut représenter un tel argument244 pour les collectivités locales dans leurs
négociations avec l’Etat.
Les propos de M. Waeghmacher, chargé de mission au Conseil Général du Nord pour
les musées de société, résument bien la position des collectivités locales :
243 Le directeur, M. Dubuc, utilise le même argument pour justifier le fait que le musée devienne musée national et que l’Etat accroisse sa participation financière. 244 Demandes de compensations.
F.D. - Comment expliquez-vous le succès du musée ? M. Bourge - J’ai des amis qui habitent le sud de la France et qui ont une philosophie assez marxisante. Pour eux, le symbole du travailleur, c’était le mineur. Ils en ont un très grand respect et quand ils sont remontés dans le Nord, la première chose qu’ils ont demandé à visiter, c’était le centre historique minier. Et en plus, il ne faut pas oublier que c’est de l’énergie qui a été donnée au pays. La Région a beaucoup donné au pays et ça n’a pas toujours été bien reconnu. En plus, il y a un retour d’image qui était assez négatif. Vous le savez très bien, les médias parisiens, à chaque fois qu’ils montrent le Nord-Pas-de-Calais, c’est les corons, les courées, c’est toujours les images négatives, le ciel gris, les gens qui boivent parce qu’ils ont souffert… Et nous, nous essayons maintenant de détruire cette image. F.D. - Et Lewarde, c’est un médiateur de cette nouvelle image ? M. Bourge - Oui, je pense. F.D. - Dans quel sens ? M. Bourge - Lewarde ne présente pas le côté misérabiliste. Vous êtes allé le visiter, vous avez vu. Il montre que les mineurs avaient quand même certaines distractions. Il y avait les ducasses, la Sainte-Barbe, de grande fêtes des jeux. Il y avait les « coulonneux ». Il y avait une convivialité, une vie en commun. Ils serraient les rangs. Tout cela aidait à supporter la dureté du travail. Donc, je pense que Lewarde, par sa présentation, contribue à donner une image positive de la mine.
F.D. - Comment définiriez-vous un musée de société ? M. Waeghmacher – C’est un reflet d’une société telle qu’elle a pu être et telle qu’elle est. A la fois un miroir et un musée actuel (…). C’est un témoignage mais j’espère que c’est aussi un ressourçage. F.D. - Est-ce qu’un musée comme Lewarde participe à la construction d’une identité régionale ou départementale ? M. Waeghmacher – C’est un élément. Ce n’est pas l’élément mais c’est un élément. Bien sûr. Le passé industriel du Nord est extrêmement présent et le passé minier, si on le partage avec nos amis du Pas-de-Calais, est un élément déterminant qui a fait l’essor et le développement industriel du Nord et on ne peut pas ignorer ce côté là. Même s’il y a ce côté image d’Epinal du Nord. Le Nord=la mine=les gueules noires. Bon il faut assumer, c’est bien, on assume. Mais bon, ce n’est pas que les gueules noires le Nord. Et puis quitter peut-être cette image d’Epinal, aller plus profondément dans l’analyse de ce qui s’est passé et ne pas rester uniquement à des surfaces, au bon vieux temps. Aller plus loin dans la démonstration de ce qu’a pu être une société. Ça, ça me semble effectivement intéressant.
- 66 -
Une exploitation « ingénieuse » du passé devient donc l’occasion de dépasser les
pleurs et les deuils et l’investissement patrimonial, le lieu d’un compromis possible entre
l’oubli « nécessaire » et la mémoire « utile ».
Dans leur investissement patrimonial, les collectivités locales mettent d’abord en jeu
la promotion du territoire qu’elles ont à gérer et affirment par là même, leur rôle spécifique
sur ce territoire.
L’un des derniers panneaux de l’exposition permanente, intitulé « La région minière
de demain », abondamment illustré de photos « conquérantes », pourrait résumer cet état
d’esprit : Le Nord c’était les corons. C’est maintenant : - des moyens de communication modernes, un réseau autoroutier
dense, le TGV, le lien transmanche - un carrefour européen majeur - un marché de 4 millions de consommateurs - des équipements collectifs de haut niveau - un effort considérable pour la formation des hommes, un nouveau
tissu industriel diversifié et dynamique
L’Etat voit très tôt dans le Centre Historique Minier un vecteur potentiel de
reconversion plutôt qu’un lieu dédié à l’histoire de la mine245.
Au moment de la création de l’association du CHM, la récession est largement
entamée. Rappelons que les Houillères sont nationalisées (même si elles bénéficient d’une
large autonomie depuis 1945). L’Etat, par sa tutelle, se trouve directement confronté à la fin
de l’extraction et à la gestion de l’après-charbon. C’est dans cette perspective, dans un
premier temps, qu’il s’associera à l’entreprise.
L’œuvre de mémoire est d’abord considérée comme subsidiaire. Elle est même
souvent perçue comme un frein potentiel à la reconversion. Ce qui compte avant tout pour les
représentants de l’Etat, c’est de recréer un tissu économique et industriel sur ce territoire en
crise. Une note246 que nous avons retrouvée, envoyée en 1983 par un chargé de mission de la
Préfecture du Nord Pas-de-Calais à l’administrateur délégué du musée (M. Liégeois) est
édifiante à ce sujet. Elle prend même la forme d’un ultimatum dont on peut être sûr qu’il a eu
des conséquences sur l’évolution du musée par la suite, notamment dans sa référence
croissante aux Centres de culture scientifique et technique: Je me suis interrogé sur les dispositions à prendre et les actions à
mener pour que le Centre de Lewarde constitue maintenant rapidement un véritable Centre de Culture Scientifique et réponde aux attentes du Nord-Pas-de-Calais (c’est nous qui soulignons). Je vous propose de livrer ces réflexions au Conseil, dans la mesure où la poursuite de l’effort de l’Etat
245 Pour une version actualisée de cette vision du patrimoine au service de la reconversion Cf. le document publié par la Préfecture de Région : Des villes et des Hommes, le devenir de l’ancien Bassin Minier, Préfecture du Nord-Pas-de-Calais, Secrétariat Générales aux affaires Régionales (centre d’études et de prospectives), 1995. 246 Cf. annexe n°9.
- 67 -
pourrait être conditionnée par les réponses qu’il déciderait de leur apporter. (c’est nous qui soulignons).
Bien au-delà d’un Centre de conservation d’archives et de présentation de matériel, davantage encore qu’un musée (c’est nous qui soulignons), un Centre de Culture Scientifique et technique constitue un pôle de recherche, de création et d’animation à partir de la mémoire collective de ce que peut-être l’avenir technologique de l’activité concernée tout en permettant l’appropriation sociale. Assises sur la connaissance du passé, ses préoccupations doivent être résolument tournées vers l’avenir (C’est nous qui soulignons). Comme l’exprime le rapport Malecot247, un Centre de culture scientifique et technique est « l’humus » par lequel peut naître une nouvelle vocation industrielle (c’est nous qui soulignons) et peuvent évoluer les mentalités en harmonie avec le développement culturel, le progrès social et l’aménagement de l’espace.
Lorsqu’on connaît l’influence des mentalités et des pesanteurs sociales dans l’ouverture des jeunes aux formations technologiques de haut niveau, nécessaires pour l’avenir, et dans les freins à la conversion économique, le Centre de Culture Scientifique et Technique de Lewarde apparaît comme un outil essentiel dans le dispositif de sensibilisation, d’incitation et d’animation à la réindustrialisation et de l’aménagement du bassin minier et de la Région Nord-Pas-de-Calais. Contribuer à la renaissance du bassin minier doit être l’objectif prioritaire du Centre Historique Minier (c’est nous qui soulignons). Il convient de mettre en œuvre les dispositions permettant d’atteindre ces objectifs.
Le patrimoine se veut pédagogique, utile248. On sent l’empreinte du rapport Malecot
dont on a déjà parlé249.
Ce que l’Etat met en jeu dans son investissement patrimonial est lié dans un premier
temps à son action pour la reconversion.
C’est seulement plus tard (à partir du début des années 90) qu’il optera pour un
accompagnement culturel250 du musée, facilité par son monopole de l’expertise scientifique.
Une politique de la culture supplante progressivement une politique d’aménagement
du territoire et de réindustrialisation qui emprunte, désormais, d’autres canaux.
Le dernier usage social de la mémoire de la mine que nous analyserons est celui des
milieux économiques et de leurs représentants. N’ayant pu rencontrer le représentant du
Conseil économique et social régional au CHM, nous nous appuierons sur des documents
d’archives. Précisons d’ores et déjà que leur poids institutionnel au sein du musée est
relativement faible, dans la mesure où ils ne participent pas au financement. C’est davantage
247 Cf. supra. 248 Gérard Noiriel (op. cit.) cite dans son article (« Le pont et la porte ») un extrait de texte, tiré d’un ouvrage réalisé par le Ministère de la culture (R. Perrinjaquet et R. Rotmann, Espace et culture au travail, Ministère de la Culture, Paris, Dalloz, 1983), révélateur de cette logique : « Pour peu qu’elle ne soit pas perçue et traitée comme un frein à la reconversion et au développement, cette identité sociale collectivement assumée peut au contraire s’avérer un ressort de redéploiement industriel et par conséquent un patrimoine réel à condition de connaître une reconnaissance et une valorisation. » 249 op. cit. 250 Le rôle de la DRAC au CHM s’est accru depuis les années 90.
- 68 -
à travers leur influence sur les dirigeants des Houillères qu’il faut appréhender leur rôle, non
négligeable dans le structuration du musée, notamment à ses débuts251.
La requalification patrimoniale est ici essentiellement perçue comme un levier du
développement économique. Nous avons trouvé de nombreux documents de la Conférence
Permanente des Chambres de Commerce et d’Industrie Françaises et Belges qui en attestent.
Dans une lettre252 adressée aux entrepreneurs de la Région, le Président de la CCI expose : Parmi les problèmes économiques, culturels et sociaux communs
aux territoires situés des deux côtés de la frontière que nous étudions dans le cadre de la Conférence Permanente, il en est un qui a pris au fur et à mesure des mutations industrielles une plus grande place.
Il s’agit de la sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine industriel comme du maintien et du développement de la culture technique. Les hommes de l’ère industrielle comme ses bâtiments, ses machines, ses produits, sont des faits de culture essentiels. Quant au niveau de la culture technique du grand public, il est indiscutablement très lié aux capacités de développement économiques d’une région (c’est nous qui soulignons).
Or, à l’heure actuelle, usines, machines, témoignages, archives disparaissent rapidement dans l’indifférence générale.
Le souci d’une tradition industrielle, tout comme celui d’un investissement justifient que l’on cherche à conserver trace des techniques de fabrication anciennes et à en reconstituer l’évolution dans l’intérêt même du progrès technologique (c’est nous qui soulignons).
Gérard Noiriel le dit très bien, « la nostalgie du passé n’est pas contradictoire mais
complémentaire du discours sur la modernisation »253. C’est ce qui apparaît dans le document
diffusé par la Conférence Permanente concernant la mise en valeur du patrimoine
industriel254 : Quelques raisons essentielles de cette prise de conscience : - l’importance de la culture technique dans une société fondée
largement sur la technologie et dont les chances de développement passent par la connaissance de cette technologie.
- Le fossé existant entre le monde scolaire/universitaire et celui de l’entreprise que l’on peut partiellement combler par une meilleure connaissance du patrimoine industriel.
Ce discours sur le patrimoine empreint de productivisme et de positivisme atteint son
paroxysme dans une note d’étude réalisée par la C.C.I255 à propos de la mise en valeur du
patrimoine industriel. Morceaux choisis : Proposition 1 : l’archéologie industrielle, une nouvelle mode ? a) La préoccupation nouvelle de conserver les témoignages du passé
industriel, peut apparaître comme une préoccupation d’intellectuel (universitaire notamment) n’envisageant pas l’industrie dans sa dimension économique, mais seulement historique et culturelle. A ce titre, le monde économique serait en droit de se désintéresser du phénomène ou même d’en craindre certaines conséquences (c’est nous qui soulignons).
251 Un groupe de travail composé d’industriels s’était d’ailleurs réuni pour élaborer des recommandations sur la mise en valeur du patrimoine industriel. 252 Non datée mais de la toute fin des années 70 d’après le classement archives; Cf. annexe n°16. 253 « Le pont et la porte », op. cit. 254 Voir note 252. 255 Voir note 252.
- 69 -
b) l’archéologie industrielle pourrait aussi apparaître, pourquoi pas ?, comme une manifestation de décadence, au crépuscule d’une civilisation mécanique qui a beaucoup vieilli depuis trente ans, et qui cherche seulement à se souvenir de ses moments les plus flamboyants ; les exemples européens le montrent puisque sont, en premier lieu, mis en évidence, l’épopée de la mine, les grandes heures de la sidérurgie ou de l’industrie textile, trois secteurs particulièrement frappés dans l’évolution contemporaine de l’Europe.
c) Cette archéologie industrielle, enfin, est sans doute une marque supplémentaire d’un goût pour le passéisme et du refus inconscient du progrès chez certaines élites ; l’intérêt pour les techniques du passé, pour les savoir-faire et pour l’artisanat et les métiers d’art, serait d’abord le refus de la grande industrie, des technologies écrasantes et de la société industrielle née au XIXème siècle (c’est nous qui soulignons).
Proposition 2 : l’archéologie industrielle, une prise de conscience a) les français n’aiment pas leur industrie : la tradition en est
ancienne, qui privilégie l’idée au détriment de l’acte, l’intellectuel au détriment du manuel (…). On a sans doute été trop loin dans cette phase, et, (…) les villes réclament à nouveau une activité industrielle et les chefs d’entreprise sentent le moment venu d’une action de réhabilitation de leur activité (c’est nous qui soulignons).
(…) Proposition 3 : conserver mais surtout promouvoir (…) b) Il est indéniable, en effet que la civilisation de l’Ouest de
l’Europe est éminemment technologique et que cet aspect doit bénéficier des mêmes attentions que d’autres, dans la mise en valeur de notre patrimoine ; en particulier, un effort en ce sens permettrait de faire adopter à l’opinion publique une attitude plus constructive vis-à-vis de sa machine économique et en particulier, de ses grandes entreprises industrielles. Ceci permettrait aussi de mieux faire comprendre et accepter au public les grands desseins inévitablement très coûteux qui s’imposent à la recherche scientifique et technique d’aujourd’hui (c’est nous qui soulignons).
c) Une action de promotion de l’industrie, auprès des différents publics (scolaires, fonctionnaires, consommateurs, chercheurs, élus…), est paradoxalement plus difficile et plus importante dans une région traditionnellement vouée à l’industrie comme le Nord-Pas-de-Calais, la Belgique ou la Lorraine. En effet, les populations peuvent y être amenées, soit à ne plus voir certains éléments de leur environnement par habitude, soit même à refuser cet environnement par une réaction ingrate (sic), mais compréhensible.
Cet extrait est riche de sens. Ce que les milieux économiques mettent en jeu dans leur
investissement patrimonial répond à leur volonté de réhabiliter et de promouvoir l’activité
industrielle pour mieux arguer de la nécessité de son développement.
Comme on pouvait s’y attendre, pour une même mémoire collective revendiquée,
combien d’usages sociaux de cette mémoire !
Pour finir cette sous-partie, plus longue que les autres mais dont la place nous paraît
centrale, un exemple s’impose, tant il résume à merveille ce qui vient d’être exposé. C’est du
débat autour du nom du musée256 dont nous voulons parler. Il surgit en 1984, à un moment où
256 On en a trouvé la trace en épluchant les procès verbaux des Conseil d’administration et les documents qui y sont annexés.
- 70 -
l’ouverture au public est programmée et où, de ce fait, le besoin d’une appellation
« officielle » se fait sentir.
M. Liégeois, l’administrateur délégué du Centre, propose aux membres du C.A. de
retenir : « Centre de Culture Scientifique et Technique de la Mine et de l’Energie ».
Les réponses qui lui sont adressées par ces derniers sont éloquentes. Elles nous en
disent beaucoup sur le sens que confère les acteurs à leur investissement patrimonial.
Pour le représentant du Préfet, le terme énergie est trop vague (car il supposerait que
soit présentée la filière électronucléaire par exemple) et en même temps trop restrictif car
Lewarde doit être selon lui, « une vitrine pour les nouvelles techniques et doit participer à la
mutation technologique qui permettra de développer de nouvelles activités économiques ».
D’où l’intérêt, selon lui, d’insister sur d’autres activités industrielles comme l’automobile,
l’informatique, en plus des activités dérivées du charbon.
Le représentant des Houillères consulté insiste quant à lui pour que l’appellation
traduise la vocation charbonnière du Centre. Il propose « Centre de culture scientifique et
technique des industries minières », en porte-à-faux avec le représentant de l’Etat.
Le représentant de la CGT se demande « dans quelle mesure, on pourrait associer
davantage la part de l’homme dans l’histoire de la mine et en particulier dans son évolution. »
Il propose comme dénomination « Centre de culture scientifique, technique et humaine de la
mine et de l’énergie ». Le syndicaliste de la CFTC regrette lui aussi que le nom avancé ne
fasse pas référence « d’une manière plus précise à l’aspect humain ».
Enfin, la Chambre de commerce et d’industrie trouve l’appellation très bonne dans son
esprit mais très longue dans sa définition. Elle lui paraît de ce fait « difficilement exploitable
par un sigle reprenant les premières lettres des mots ».
Les élus consultés sont dans l’ensemble favorables à la première appellation proposée.
Ce débat resurgit avec la fin de la présidence Houillères. Au C.A. d’octobre 1992,
alors que M. Lempereur (représentant la CFDT) se dit partisan de changer le nom « qui le
choque », lui préférant celui de « musée de la mine », Marc Dolez, Président de l’association,
représentant la Région, député du Nord, rétorque : « la fonction du musée est la plus
importante mais ce n’est pas la seule, le Centre renfermant également un Centre de Culture
scientifique et technique, à développer à l’avenir257 ».
A travers ce débat, faussement anodin, autour du nom du musée, chacun fait valoir un
usage social particulier de la mémoire de la mine, reflet de sa position et des enjeux auxquels
il est confronté dans le présent.
Rendre compte des relations complexes qui s’établissent entre des entrepreneurs de
mémoire et un passé, implique d’abord de poser ces enjeux, tout en gardant à l’esprit, qu’à la
257 qui se limite encore aujourd’hui à un centre d’archives.
- 71 -
mesure de l’infinité du monde social, une partie de ceux-ci échappe nécessairement à
l’observateur.
3. Le Centre Historique minier et les autres lieux de la mémoire de la mine
Nous ne dresserons pas ici un inventaire, même sommaire, des lieux de mémoire de la
mine258. Il nous semble en revanche pertinent d’interroger la place spécifique du musée de
Lewarde au sein de ces lieux de mémoire, et d’envisager la nature de leurs interactions.
Dans quelle mesure et par quels processus, le CHM est-il devenu un lieu central259 de
la problématisation et de l’instauration du mémorable dans le bassin minier ? Yvon Lamy260
pose la question d’une façon qui nous semble particulièrement pertinente : « Comment opérer
la rencontre entre d’un côté l’institution officielle des objets patrimoniaux (à laquelle
l’édification du CHM s’apparente261) et, de l’autre, les formes singulières, identitaires ou
territorialisées d’instauration du mémorable262 ? Y a-t-il un « salut patrimonial » hors du
CHM ?
Pour commencer, il faut situer le CHM dans la constellation d’initiatives muséales
autour de la mine.
Pour dire, tout d’abord, que par sa dimension, son audience et ses moyens il est sans
commune mesure avec les autres263.
Le CHM, du mot même de nos interlocuteurs, ne semble pas « jouer dans la même
catégorie » avec ses 125000 visiteurs par an et ses 10 millions de francs de budget annuel là
où les petits musées accueillent rarement plus de 10000 visiteurs par an (composés de
scolaires pour la plupart) et fonctionnent grâce à la bonne volonté de bénévoles..
Plusieurs raisons historiques sont à l’origine de cette prééminence de Lewarde :
- C’est d’abord l’aptitude inégalable du promoteur du musée, les HBNPC, à
rassembler du matériel et des archives en utilisant la voie hiérarchique (ordres donnés aux
258 Un travail de thèse (Hélène Melin) est actuellement en cours sous la direction d’Olivier Kourchid (IFRESI), qui entend traiter de la conservation et de la valorisation du patrimoine minier. Université de Lille I. 259 Sur son site Internet (http://www.nordnet.fr/lewarde), il se définit lui-même comme le « véritable conservatoire de la mémoire de la Mine dans la région ». 260 Lamy (Yvon), « Patrie, patrimoines », in Genèses II, mars 1993, p. 2-4. 261 Nous pensons l’avoir démontré. 262 Même si ces formes singulières finissent souvent par s’institutionnaliser en se raccrochant à l’aide d’une collectivité locale. Les musées de la mine de Bruay (Conseil Général du Pas-de-Calais), Auchel (municipalité), Noeux-les-Mines (municipalité) sont autant d’exemples d’initiatives privées qui se sont ensuite institutionnalisées tout en restant territorialisées. Voir à ce propos les entretiens des promoteurs de ces projets, réalisés par Olivier Kourchid et publiés dans l’article « la mémoire de la mémoire », op. cit. 263 Les plus importants de ces petits musées de la mine sont : Anzin (musée Théophile Jouglet), Auchel (mine image, musée de la mine), Bruay-La-Buissière (mine image, écomusée de la mine), Bully-Les-Mines (mine image), Denain (mine image, musée municipal), Escaudain (musée municipal), Harnes (musée de la mine), Noeux-Les-Mines (mine image, musée de la mine), Oignies (mine image).
- 72 -
chefs de siège) qui a permis la constitution d’une collection unique (en quantité comme en
diversité). Non seulement les petits musées n’ont pas bénéficié de cet appui logistique mais ils
se sont même souvent heurtés à une logique d’obstruction de la part des Houillères, ne
souhaitant pas voir se développer des musées qui pourraient, à leurs yeux, concurrencer le
CHM.
Olivier Kourchid264 rapporte les propos de l’un des créateurs du musée de la mine de
Noeux-Les-Mines qui vont dans ce sens: En projets, il y une phase à remplir : c’est une explication
pédagogique de l’évolution de la mine et de l’utilité du matériel ; c’est compliqué et cher car il faut du matériel et de l’éclairage. Pour cela, hormis de la part de la mairie, on a eu d’aide de personne, ni d’aide des Houillères (de ce côté là, il y a même eu quelques freins). Les Houillères dans les années 1975-1980 disaient : « nous allons faire un musée (à Lewarde), donc on ne va pas se disperser ».
Même constat de la part de l’un des acteurs du musée de Bruay : Dans le cas présent, un musée de la mine devait être fait au siège 6
d’Haillicourt, mais on s’est rendu compte que c’était trop cher de faire des galeries reconstituées en surface ; on ne pouvait pas fixer les cadres de soutènement de façon stable. Et puis les Houillères ont renâclé ; jamais on a été encouragé. On voulait faire le musée de la mine dans les Grands Bureaux (des mines de Bruay) ; on a eu une certaine opposition et les Grands bureaux ont été cédés à un garagiste juste après une visite des lieux par M. Liégeois à l’époque directeur des Relations Publiques aux HBNPC, maintenant directeur de Lewarde. Car à l’époque, les Houillères s’investissaient dans Lewarde et ne voulaient pas de concurrence.
- C’est ensuite la particularité « topographique » du CHM d’être installé, in situ, sur un
carreau de fosse complet, alors que les petits musées doivent souvent se contenter de locaux
municipaux réaménagés (Denain) ou au mieux d’un morceau de site, ayant résisté au
démantèlement. De nombreuses « mine-image » , reconstitutions de galeries en surface qui
servaient à l’apprentissage du métier de mineur après 1945, furent ainsi reconverties en musée
(Auchel, Bruay, …).
- C’est aussi les moyens financiers importants dégagés par les Houillères qui permirent
des investissements lourds. La réhabilitation des bâtiments et surtout la reconstruction
complète de galeries sur 400 mètres de long ont probablement coûté, cumulées, plusieurs
dizaines de millions de francs. Cette avance prise par le CHM sur ses concurrents potentiels265
sera décisive. Elle lui permettra d’attirer les financements des grandes collectivités locales et
de l’Etat avant les autres.
- L’autre élément déterminant est d’un autre ordre. En se positionnant très tôt266
comme un Centre de Culture Scientifique et Technique et non comme un simple musée, le
264 Olivier Kourchid, op. cit. 265 L’idée de créer un musée de la mine à Auchel date du tout début des années 80. 266 En 1984.
- 73 -
CHM « légitime sa centralité à l’égard du saupoudrage sollicité par les petits musées »,
précise justement Olivier Kourchid267. On notera un paradoxe de taille : c’est grâce à un
objectif affiché (devenir un Centre de culture scientifique et technique), mais loin d’avoir été
atteint268, que le CHM s’est imposé comme le lieu central et officiel de la mémoire de la
mine.
Au point d’être devenu aujourd’hui un centre de référence, ayant également pour objet
d’intégrer ou de fédérer les autres projets patrimoniaux « territorialisés ». Tous nos
interlocuteurs ont insisté sur ce rôle de « tête de réseau » que le CHM était appelé à jouer. M.
Bourge du Conseil Régional a été clair là-dessus :
Agnès Paris, le conservateur du CHM, adhère pleinement à ce dessein :
Lorsque l’on pose la question à M. Waeghmacher, chargé de mission « musées de
société » au Conseil Général, la volonté d’octroyer une place centrale (d’expertise ?) au CHM
est encore plus manifeste :
Le soutien des collectivités locales à toute initiative patrimoniale ne se conçoit plus
que si elle entre en complémentarité avec le CHM, excluant de fait tous les projets qui, sur le
même thème, pourraient proposer une approche alternative.
267 Ibidem. 268 « Seul » le centre d’archives répond à ce label (et encore leur pérennité au sein du centre pourrait être remise en cause à moyen terme pour des raisons de coût de fonctionnement. Elles pourraient rejoindre le Centre
M. Bourge - Nous tendons à ce que Lewarde devienne la tête de réseau vis à vis de petits musées comme Harnes, Bruay-La-Buissière, Marles-les-Mines, la maison syndicale des mineurs à Lens et même le 9-9bis d’Oignies puis Wallers Aremberg. On va essayer de mettre en synergie. Ce ne seront pas des musées. De toute façon on a plus les moyens de faire des musées. C’est Lewarde vraiment la tête de réseau. C’est un Centre de ressources et de recherche. En plus il ne faut pas oublier qu’il y a un aspect archives très important (…). On renvoie toujours sur Lewarde. Actuellement on va aider à la restructuration de la maison syndicale des mineurs mais on veut que cela soit fait en articulation avec Lewarde.
F.D - Est-ce que le Conseil Général pourrait soutenir d’autres musées de la mine ? M. Waeghmacher - Oui, pourquoi pas s’il y a symbiose avec Lewarde. Par exemple, on a aidé Rieulay, le musée du terril. Je leur ai demandé: "Est-ce que vous êtes en contact avec Lewarde?" Si on a l’aval de Lewarde, pourquoi pas. Des sites spéciaux peuvent très bien ne pas avoir été traités.
F.D. - Est-ce que le CHM laisse de la place pour d’autres mémoires de la mine ? Mlle Paris - Oui. En fait, l’idée qui est depuis longtemps celle du Centre et de la Région, c’est que Lewarde soit à la tête d’un réseau, où certains autres lieux aborderaient d’autres thèmes, mais à condition que ça ne soit pas les mêmes, mais des choses qui nous complètent. Par exemple, le musée d’Anzin, pourrait être une antenne de ce réseau, en sachant qu’Anzin va développer le thème de la mine dans les œuvres d’art, parce qu’ils ont des collections extrêmement intéressantes de tableaux sur le thème de la mine et c’est clair que nous à Lewarde, on n'abordera jamais le côté artistique des choses. Alors après on a le site d’Oignies qui traiterait davantage de l’aspect sécurité au fond (…). Effectivement, la DRAC comme le Conseil Régional souhaitent que Lewarde soit la tête de réseau pour un certain nombre de choses.
- 74 -
D’autre part, l’argument de la scientificité et de la rigueur du CHM, qui s’opposerait à
l’improvisation de certains musées associatifs, revient souvent dans les propos des acteurs
institutionnels comme justification de leur investissement patrimonial sélectif et circonscrit.
Mme Becquart, conseiller musées à la DRAC :
Partant, on peut se demander si le Centre Historique Minier n’est pas devenu une
vitrine de l’investissement patrimonial des acteurs du territoire, prétexte (alibi ?) brandi pour
ne pas avoir à s’impliquer ailleurs, à un moment où les crédits culturels se réduisent comme
une peau de chagrin:
Pour toutes ces raisons, le CHM est désormais considéré par de nombreux acteurs
comme le lieu légitime de la mémoire de la mine.
Cette prépondérance incontestable n’est pas sans effet sur la manière dont s’édifient
les autres lieux de mémoire. Elle leur impose souvent de se définir et de se légitimer par
rapport à lui269. Il y aurait probablement beaucoup à dire sur les logiques d’édification
d’archives du monde du travail à Roubaix, où se trouvent déjà de nombreux documents sur la mine). Le comité scientifique et technique, quant à lui, n’a jamais véritablement pris corps. 269 L’un des promoteurs du musée de Noeux-les-Mines déclara par exemple à O. Kourchid (op. cit.) : « Lewarde s’est développé parallèlement à Noeux ; j’entendais dire qu’à Lewarde c’est le patron minier qui avait eu
F.D. – Y a-t-il eu des réticences au sein du ministère de la culture ou de la DRAC s’agissant de soutenir les musées techniques ? Mme Becquart - C’est à dire qu’il y a eu un mouvement qui s’est fait qui était la plupart du temps porté par une association. Dans ces associations, il y avait différentes qualités de personnes et c’est de la qualité de des personnes et du regard porté sur le patrimoine et la manière de le conserver et de le restituer que s’est positionné le Ministère. Il y a un nombre de musées associatifs en France qui est énorme pour protéger des activités, garder témoignage d’activités en voie de disparition. Nous ce qui nous préoccupe c’est une vraie démarche scientifique, un vrai projet, un regard sur ce qu’il faut conserver et ce qu’il est impossible de conserver et puis un vrai projet scientifique pour monter un projet. Parce que vous savez, il y a quand même pas mal de gens qui protègent plus pour eux pour garder leur propre mémoire. Si vous regardez la liste des musées, les publications les plus importantes et qui arrivent à 7000 musées en France, vous constaterez que l’on essaie de tout garder, mais souvent ce sont des associations de gens liés à une activité et qui ne veulent pas perdre cette mémoire, ils n’ont pas de scientifiques, ils n’ont pas de professionnels pour les aider et finalement c’est de la délectation morose sur un passé que l’on est en train de dire merveilleux, ce qui n’est pas le propos je crois. On ne peut pas traiter le passé comme une période idyllique, disparue et jouer la nostalgie du temps passé, ce n’est pas un propos suffisant.
F.D. - Pourquoi la DRAC n’a-t-elle pas accepté, pour l’instant, de soutenir d’autres projets de « muséification » relatifs à la mémoire de la mine ? Parce qu’ils ne remplissaient pas les critères ou parce que ça faisait beaucoup ? Mme Becquart - Parce qu’on ne peut pas jalonner le territoire français de x musées de la mine, que pour ce qui concerne la Région Nord-Pas-de-Calais, Nous, nous avons un rôle d’aménagement du territoire en terme de musée. Et que dans la mesure où il y a un établissement de référence à Lewarde, il n’y a aucune raison de multiplier les lieux qui répètent ce que dit Lewarde, la connaissance que Lewarde est capable de diffuser auprès de la population. On ne va pas…Bon moi ça m’est complètement égal qu’il existe x musées, de la mine tenus par les associations issues de la mine et qui font parfois un travail tout à fait honorable, mais il est hors de question de démultiplier à l’infini les lieux alors qu’un seul établissement pose déjà des problèmes à tout point de vue pour l’avenir.
- 75 -
particulières de ces musées associatifs , sur ce qui les différencie du CHM et sur les relations
qu’ils entretiennent (concurrence, imitation, référence, complémentarité,… ? ). Ce sera pour
une autre fois.
l’initiative, et voulait contrôler ; donc à Noeux on voulait essayer de montrer autre chose…, montrer que des objets c’est pas suffisant ; je ne sais pas si on a réussi ! »
- 76 -
III. Le musée, un discours sur la mine
Hempty Dupty - Lorsque moi j’emploie un mot, il signifie exactement ce qu’il me plaît qu’il signifie. Alice - La question est de savoir si vous avez le pouvoir que les mots signifient autre chose que ce qu’ils veulent dire. Hempty Dupty - La question est de savoir qui est le maître. Un point c’est tout. Alice au pays des merveilles, Lewis Caroll cité par Michel Hastings dans son cours « Imaginaire et Politique » donné en troisième année à l’IEP de Lille.
Cette partie, apparaît comme la plus délicate parce qu’elle se penche sur le contenu270
même du musée. Parce qu’il procède de choix, de coupures, de mises en valeur, inhérents à
l’exercice muséographique, nous postulons que, loin d’une introuvable expression de la
mémoire collective, ce contenu relève de l’ordre du discours271 (quoi que puisse en dire
l’équipe dirigeante du CHM qui se réfugie souvent derrière une prétendue objectivité des faits
ou neutralité des objets quand on l’interroge sur le sens du musée et du discours sur le passé
qui y est produit272).
Une fois cela écrit, la suite devient problématique.
D’abord la question du lien entre les entrepreneurs de mémoire et le discours du musée
sur la mine.
Il est ambigu et protéiforme. Si pour la première période (jusqu’en 1990)
l’interventionnisme des Houillères ne fait aucun doute, la réponse est plus incertaine ensuite.
Les arrivées d’un conservateur et d’un directeur ont garanti une véritable indépendance en
270 Celui-ci peut être décomposé en trois ensembles relativement distincts qui forment le parcours à l’intérieur du musée (Cf. plan ; annexe n°2 ): la première étape de ce parcours consiste en la visite des bâtiments du « carreau de fosse ». A l’intérieur, en plus de la « salle des pendus » où les mineurs se douchaient et suspendaient leurs vêtements avant de descendre au fond, les visiteurs peuvent contempler l’exposition permanente composée de plusieurs volets (formation géologique du charbon, l’aventure de l’exploitation, reconstitution d’un estaminet et surtout une exposition de plus de cent panneaux intitulée « mine et mineurs »). A ces éléments fixes, s’adjoignent des expositions temporaires tournantes (« Le cheval et la mine », la mine des artistes au temps d’Emile Zola, « le football et la mine », etc. ;Cf. annexe n°20 pour la liste des expositions temporaires). Le parcours se poursuit par la visite, sous la conduite d’un guide mineur, de la « mine-image » où sur 400 m, dans une galerie reconstituée en surface, sont présentés dix chantiers du fond, représentatifs des différentes époques de l’extraction. D’autres bâtiments abritent différentes expositions animées (sur le triage criblage du charbon, l’extraction, les machines). 271 La référence au titre de l’ouvrage de Michel Foucault n’est pas fortuite. Nous faisons nôtre sa description des cadres et processus inconscients qui ordonnent le discours, en dépit de son apparente autonomie. 272 M. Dubuc, le Directeur : « Pour le public, pour tout le monde, on est garant d’une authenticité, d’une vérité. On travaille dans la vérité et tant qu’on travaille dans la vérité, personne ne peut nous reprocher telle ou telle prise de position (…). On évite d’aller à l’interprétation, c’est pas notre métier. On met à disposition de ceux qui veulent interpréter les éléments pour le faire. (…) Nous n’avons pas à entrer dans des problématiques ou dans des polémiques, on donne des faits. A partir de ces faits, on laisse le visiteur se faire sa propre opinion et c’est la raison pour laquelle on est dans une démocratie, il faut que le peuple ait un esprit critique. »
- 77 -
matière de choix muséographiques et muséologiques273. En même temps, des partenaires
comme l’Etat ou le Conseil Régional (par l’intermédiaire du président du Centre) gardent un
droit de regard non négligeable sur ce qui s’y fait sans que l’on puisse déceler dans leur
pratique les traces d’un interventionnisme flagrant.
Disons que les contraintes qui pèsent sur le discours ressortent davantage de
l’implicite, voire de la violence symbolique274. Les acteurs275, aussi convaincus de leur
indépendance et de leur objectivité qu’ils peuvent l’être, intériorisent des contraintes, des
tabous, qui restreignent leur autonomie, sans qu’ils ne le perçoivent toujours276. Pour
exemple, les entretiens nous ont montré que le thème de la collaboration dans les mines, très
polémique277, donne lieu à des mécanismes d’autocensure. Il ne vient pas à l’idée de traiter ce
thème, soit parce qu’on décrète qu’il ne ressort pas spécifiquement du domaine de la mine278,
soit parce qu’on considère qu’il doit davantage faire l’objet de colloques, plutôt que de figurer
dans une exposition généraliste279.
Ensuite, la question de la transmission du discours : ce dernier ne prend sens qu’au
travers des interprétations qu’en font les visiteurs. Pour un même contenu muséographique,
elles peuvent fluctuer largement280. Il faut prendre en considération cette subjectivité du
regard sans tomber, cependant, dans l’illusion de son autonomie absolue281. Le cadre de
l’exposition, sa forme, ses problématiques sont autant de bornes qui balisent dans la plupart
des cas (même de façon lâche) ces interprétations.
Comment faire la part, dès lors, entre ce qui est transmis au visiteur au cours de sa
visite ( les bornes) et ce qui relève du « déjà acquis » (éminemment personnel), structurant a
priori son regard sur le musée et sur l’histoire de la mine?
Etant donnée la complexité de cette question (et l’ambition théorique démesurée qu’il
faudrait pour y répondre), nous analyserons de préférence les modalités de production (par le
273 Même s’ils continuent d’être validés par le Conseil d’Administration . 274 Dans le sens où l’emploie P. Bourdieu. 275 Directeur et Conservateur. 276 On est loin, on le voit, d’interprétations simplistes qui feraient des acteurs des agents rationnels, élaborant des stratégies de manipulation de la mémoire dont les enjeux et les bénéfices leur apparaîtraient clairement. 277Rappelons que les compagnies ont été nationalisées en 1946 suite à leur collaboration avec l’occupant. Elles avaient fourni aux nazis de nombreuses listes de meneurs syndicaux qui furent ensuite déportés. Pour beaucoup, l’occupation fut l’occasion de prendre une revanche sur 1936 et de s’enrichir. Voir Joël Michel, « Elan national et revanche sociale », in La Mine dévoreuse d’Hommes, Paris, Gallimard, 1993. 278 Dans ce cas les mouvement sociaux le sont-ils davantage ? 279 Nous reviendrons sur ce point et sur d’autres dans la partie consacrée à la « géographie de l’éliminé » ; Cf. III. B. 1. 280 Les mécanismes d’« attention sélective » bien étudiés par la sociologie politique (sur l’influence des campagnes électorales notamment) jouent également ici. Un visiteur accordera une attention particulière à des éléments qui viendront conforter une opinion déjà constituée. 281 Nous ne rejoignons pas tout à fait l’interprétation du conservateur. Elle compare le musée à une « auberge espagnole où chacun pique ce qu’il veut ». Soit, mais si l’on considère que le choix des plats n’est quand même pas illimité…
- 78 -
musée) et de réception (par les visiteurs) du discours 282 (A.) avant de dégager quelques-uns
uns de ses traits marquants (B.), faute de pouvoir énoncer de façon catégorique et univoque ce
qu’il signifie ou comment il est perçu par chaque visiteur (C.).
A. Le « cens caché283» de la mémoire
Ce titre importé caractérise assez bien les processus de sélection inconscients qui
interviennent dans la médiatisation publique d’une mémoire collective. Une fois admis qu’il
existe une multitude de mémoires de la mine ( propres à des individus et à des groupes), il
faut identifier les absents du CHM en même temps que les individus habilités à y diffuser
« la » mémoire. Nous rejoignons ainsi Annie Collovald et Frédéric Sawicki284, quand ils
avancent qu’ « un des préalables à toute étude des pratiques populaires réside dans
l’historicisation et la sociologisation des porte-parole et des porte-plume du peuple ».
Le deuxième temps consistera en une ébauche de sociologie des visiteurs. Elle aura
pour objectif de mettre en doute quelques idées-reçues sur le sujet, plus qu’elle ne proposera
d’état des lieux définitif.
1. Qui parle ?
La visite de la mine-image est sans aucun doute possible le temps-fort de la visite du
CHM. Par sa durée (2h sur moins de 3h de visite), mais surtout par sa force de suggestion. La
reconstitution de galeries et la présence de guides marquent les visiteurs à nul autre pareil.
Louis Bembenek de la CGT résume bien la place impartie aux guides dans la transmission de
la mémoire:
282 Nous faisons nôtre la recommandation de Pierre Bourdieu dans son article « Vous avez dit « populaire » ?, Actes de Recherches en Sciences Sociales, n°46, 1983 : « la sociologie de la production du discours sur la classe populaire fait partie des préalables absolus de tout discours sur les classes populaires. » 283 D’après le titre de l’ouvrage célèbre de Daniel Gaxie, Le cens caché ( Paris, Seuil, 1978) dans lequel l’auteur montre les mécanismes de remise de soi qui viennent limiter l’exercice effectif de la citoyenneté par tous. 284 Collovald (Annie), Sawicki (Frédéric), « Le populaire et le politique (1) : quelques pistes de recherche », Politix, n°13, 1er trimestre 1991, Presse de la Fondation Nationale des Sciences Politiques.
F.D. - Qu’est-ce qu’un visiteur qui va voir le musée devrait retenir de la mine ? M. Bembenek - Je me mets à la place du visiteur. Je connais le métier de mineur mais dans un musée, je retiens d’abord ce que je vois, ce qu’on me dit et quand je vous parlais tout à l’heure du rôle du guide il est très important, surtout vis à vis des jeunes. Un adulte, il peut continuer ses recherches par d’autres méthodes, par des livres. Mais les écoliers qui vont dans un musée, ce qu’on leur dit, pour eux, c’est la vérité, même si parfois ça ne l’est pas. Je ne peux pas voir autre chose si je n’ai pas d’autres repères.
- 79 -
Karine Girard, dans son travail de monographie à l’école du Louvre285, a réalisé une
enquête286 auprès des visiteurs afin d’avaluer, entre autres, quelle était la place des guides
dans le dispositif muséographique. Cette dernière confirme, en les étayant, les propos de M.
Bembenek. D’abord, sur 120 personnes interrogées, 53 affirment être venues spécifiquement
pour bénéficier d’une visite guidée par un mineur. La force d’attraction est patente.
L’autre élément concerne la satisfaction accordée à ce procédé de visite. La totalité des
personnes répondent par l’affirmative à la question « Ce système de visite vous a-t-il plu ? ».
Autre chiffre impressionnant, 95, 8% des gens interrogés répondent « oui » à la question « les
anecdotes aident-elles à se représenter le travail du fond ? ». Enfin, et peut-être l’élément le
plus intéressant à commenter, 89,9% des personnes interrogées considèrent que les anecdotes
racontées par les mineurs sont authentiques.
Karine Girard soulève bien le problème qui se pose quant à ce dernier résultat mais
rate selon nous l’essentiel, faute d’une approche suffisamment sociologique de la question :
La dernière question soulève néanmoins un problème réel. 90% des
gens pensent que l’authenticité du discours est garantie parce qu’il est transmis par des mineurs. Je ne dirai pas qu’il y a là un manque d’esprit critique, mais plutôt une confiance aveugle dans le mineur qui raconte. Or, il arrive que le mineur ne dise pas toute la vérité, comme par exemple qu’il ne dise pas que la cage est une simulation, ou qu’il oublie de préciser que telle anecdote lui a été racontée. Cela n’est pas grave en soi, car cela ne porte que sur des choses bénignes et ces oublis sont le plus souvent involontaires. Il n’empêche qu’à partir du moment où un des éléments du discours s’avère faux, il remet en cause la crédibilité de l’ensemble du discours. C’est évidemment un problème qui existe avec tous les guides, quel que soit le site, mais il est rendu plus aigu à Lewarde, par le fait que l’étiquette attachée aux guides « d’anciens mineurs qui représentent leur métier » donne à leur propos un caractère irréfutable, garantie que n’accorde pas les connaissances livresques. Et avec 90% des visiteurs qui prennent pour « parole d’évangile » tout ce que leur dit le guide, le pouvoir qu’ils ont sur le public de leur faire croire ce qu’ils veulent est une arme redoutable. Il s’agit de contrôler fermement qu’il n’y ait pas de dérapages. Heureusement la majorité des guides n’a pas comme intention de mentir au public, mais simplement de lui faire partager l’atmosphère du fond de la mine et ce qu’a été sa vie.
Le problème n’est pas de savoir si les guides ont « l’intention » de mentir ou pas. Cette
approche, en réduisant l’analyse de leurs discours à un dualisme moralisateur
« mensonge/vérité », s’interdit de penser leurs spécificités sociologiques et la façon dont ils
s’inscrivent dans une vision du monde de la mine propre à leurs auteurs. Il est fort probable
que les guides croient en la véracité de leur discours (et de leurs anecdotes), autant que les
autres acteurs que nous avons pu rencontrer croient en la véracité du leur.
285 Girard (Karine), le Centre Historique Minier de Lewarde, monographie de l’école du Louvre, 1996. 286 Qui n’est pas sans poser quelques problèmes méthodologiques, dont elle est consciente ( seulement 120 personnes interrogées, pas d’échantillonnage), mais qui dégage quelques tendances lourdes ou idées-forces.
- 80 -
La question « qui parle ? » semble donc un préalable absolu à la question « que disent-
ils ? » ou « disent-ils justes ? ».
Les guides287 sont devenus les porte-parole légitimes de la mémoire de la mine sans
que jamais, leur position singulière par rapport à cette mémoire ne soit interrogée.
Le qualificatif lâche d’ « anciens mineurs » revient, sans cesse, dans la bouche des
acteurs comme gage incontestable et suffisant de l’authenticité de leur message. Pareillement
pour les articles de presse sur le Centre, qui font tous de leur présence une garantie de vérité et
d’intérêt.
Cette croyance repose sur une imposture (dans son acception symbolique on entend)
de taille. D’abord, parce que le vocable de « mineur » est un terme suffisamment vague pour
recouvrir des réalités sociales très diverses. Il n’est pas rare, dans nos entretiens, que les
ingénieurs sollicités (qui furent aussi chefs de siège, soit le plus haut échelon hiérarchique
dans l’extraction) se soient présentés ainsi.
Ainsi, les visiteurs du Centre croient avoir affaire à des ouvriers mineurs, là où les
guides sont presque exclusivement d’anciens porions288 ou chefs porion. S’ils ont parfois été
ouvriers avant d’appartenir au personnel d’encadrement, la plupart ont fait l’essentiel de leur
carrière comme tels289. On peut supposer que cette différence de statut (entre agents de
maîtrise et ouvriers) est suffisamment significative pour influer sur la nature de leur
mémoire290. Non que l’une soit plus juste que l’autre, mais qu’elles procèdent tout simplement
de cadres sociaux291 et de vécus différents.
Louis Bembenek de la CGT avait attiré notre attention sur cette question de l’identité
des guides, sur laquelle il semblait critique :
287 Ils sont une trentaine. 288 Terme employé pour désigner les agents de maîtrise. 289 D’après les entretiens réalisés par K. Girard auprès des guides. 290 Surtout quand on connaît la hiérarchisation extrême qui était celle de la mine. Le titre de l’ouvrage de Michel Foucault, surveiller et punir ne semble pas exagérer pour qualifier la nature des des rapports hiérarchiques au fond. Voir l’ouvrage de Joël Michel, La mine dévoreuse d’hommes, op. cit. 291 Pour une approche épistémologique des cadres sociaux de la mémoire, voir l’ouvrage fondateur de M. Halbwachs, op. cit.
F.D. - Quelles sont les imperfections du musée, les points sur lesquels vous auriez aimé être associés ? M. Bembenek - Sur les guides. Ceux qui sont en place, ce sont des anciens agents de maîtrise. Là-dessus, nous, la CGT, on n'était pas d’accord que ça soient que des anciens agents de maîtrise. On disait qu’il y avait des anciens mineurs qui pouvaient l’expliquer, je ne vais pas dire mieux, mais tout aussi bien que les agents de maîtrise. F.D. – Y a-t-il des syndicalistes parmi les agents de maîtrise qui font la visite ? M. Bembenek - Je connais un ancien syndicaliste de la CFDT qui est guide. Mais… j’ai déjà parcouru avec des groupes et généralement, ils n’abordent pas le problème du syndicalisme. J’ai remarqué certaines imperfections. Dans la majorité des cas, les guides se bornent à expliquer la technique, le travail. Je l’avais fait remarquer plusieurs fois au C.A.. Qu’ils parlent du métier de mineur mais aussi de l’homme. Comment le mineur ressentait…j’ai été agent de maîtrise moi aussi, mais je reconnais que certains ouvriers arrivent à mieux exprimer cette sensibilité.
- 81 -
Ainsi, la mémoire de la mine véhiculée à Lewarde l’est par l’entremise d’une
« aristocratie » ouvrière292.
Cette dernière s ‘affirme comme un médiateur privilégié, parce que mieux dotée en
capital culturel et social293, elle détient les ressources suffisantes pour prétendre à la parole
publique294.
Le CHM, par les modes de sélection qu’il a institué dans le recrutement de ses guides,
a contribué involontairement à asseoir le monopole de cette aristocratie295 dans la
transmission de la mémoire. Ces modes de sélection datent de la période Houillères, puisque
l’idée de faire visiter le site sous la conduite d’anciens mineurs leur revient, comme le
rappelle M. Turbelin :
Dès le départ, l’accent est mis sur la compétence supposée, au regard de la
qualification professionnelle antérieure. Ainsi, les Houillères vont jouer un rôle très important
dans la sélection des guides dont une majorité est encore en fonction aujourd’hui.
Quand il s’agit de remplacer un départ en retraite, c’est Charbonnages de France296 qui
se charge de proposer à la direction du CHM un panel d’anciens mineurs, susceptibles
d’occuper le poste à leurs yeux. Le Directeur du Centre fait son choix après l’organisation
d’une visite guidée factice (sans visiteurs) où sont appréciées les qualités d’éloquence et 292 Dominique Méguet, cité par Louis Bergeron dans Le patrimoine industriel, op. cit., disait à ce propos : « Pour la mémoire aussi il y a les pauvres et les nantis ». 293 Au sens où Pierre Bourdieu emploie ces termes. 294 Un beau travail de recherche pourrait être entrepris sur les « porte-plume » des mineurs. Augustin Viseux ou Jean Marie Lempereur, auteurs d’ouvrages sur la mine (Mineur de fond. Fosse de Lens, soixante ans de combat et de solidarité, Paris, Edition Plon, 1991, 592p. et Mémoire des ouvriers des ténèbres, 1996) par leur parcours atypique (du galibot à l’ingénieur), font partie des cas intéressants à étudier. 295 Entendons-nous bien : le terme « aristocratie » nous sert ici à identifier une certaine élite ouvrière et doit être pris dans cette seule acception. D’ailleurs, cette position n’exclut pas une grande proximité possible avec le monde des ouvriers et leurs revendications. Seulement, leur statut, leur rôle au fond les en distingue objectivement parce qu’il implique un pouvoir de commandement et une plus grande proximité de la direction.
F.D. - Concernant les guides mineurs, comment étaient-ils choisis ? M. Turbelin - C’était du volontariat au départ, puis du bouches à oreilles. On a commencé à faire des guides bien avant d’avoir créé l’association. Dans les années 80, il m’arrivait d’emmener des journalistes. A l’époque, on s’était dit qu’il serait bon d’avoir quelques chefs porions. On a fait appel à quelques-uns uns puis ça s’est répandu. F.D. - Pourquoi ne pas avoir fait appel à des ouvriers ? M. Turbelin - La raison c’est qu’il faut quand même avoir une certaine maîtrise pour conduire un groupe de trente personnes. Je connaissais mieux les agents de maîtrise que les ouvriers. Je pense qu’il y a du y avoir des ouvriers dans le tas, mais je ne sais pas la proportion. On a d’abord pensé aux agents de maîtrise parce qu’ils avaient l’habitude de commander, de conduire des groupes.
- 82 -
l’aisance en public des différents candidats. Ce test de recrutement représente une barrière
infranchissable pour beaucoup et avantage ceux dont le capital culturel est le plus important.
Le responsable des guides, M. Radojewski, en a dit quelques mots à Karine Girard297,
suffisamment explicites : K.G. - Qu’est ce que les gens de votre entourage pensent de votre
travail à Lewarde ? M.R. - Ça c’est une question délicate. C’est une question délicate
parce que, comme je vous l’ai dit, on est des retraités, alors il y a des mauvaises langues qui se disent « Qu’est-ce qu’ils vont faire là-bas ? ». Ça existe mais vous ne pouvez pas l’éviter (…). Et quand on me fait ces remarques, je dis toujours : « Ben viens un petit peu expliquer ton vécu et on verra comment tu vas arriver à t’en sortir ». Parce que c’est pas évident. Le Directeur le sait très bien et il a entièrement confiance quand on recrute de nouveaux guides, parce que c’est arrivé que parfois, on refuse. C’est douloureux comme décision, mais on ne peut pas non plus laisser dire n’importe quoi, c’est pas possible. Il y a une image à défendre, il y a surtout une image à faire découvrir et lorsqu’on recrute, il faut absolument que le gars soit capable de conduire une visite, surtout pour les élèves. Faut pas oublier qu’on est là, un peu aussi, pour faire le travail d’un pédagogue. En fin de compte, le guide qui ne sait pas intéresser un groupe d’élèves, c’est pas possible.
L’ouvrier est souvent relégué de fait, jugé inapte à transmettre la mémoire. Précisons
que cette situation n’est pas propre au CHM mais caractérise de nombreuses initiatives
patrimoniales dans le bassin minier. La réponse du promoteur principal du musée de la mine
de Bruay à Olivier Kourchid298 est revélatrice : O.K. - Comme ailleurs, c’est la tradition, ce sont les porions qui
organisent ? - On ne peut pas demander cela au mineur de la base, mais je dois
reconnaître que j’ai été beaucoup aidé par des ingénieurs, sympathisants, même si au départ certains étaient très sceptiques et que d’autres me disaient que j’étais un rêveur.
L’autre facteur de relégation du «mineur de la base » tient au mode de diffusion de
l’information. Il apparaît que de nombreux guides du CHM ont appris cette opportunité de
reconversion par d’anciens collègues, agents de maîtrise notamment, travaillant déjà au
Centre299. Dès lors, le capital social et l’intégration à un réseau ont joué un rôle non
négligeable dans la probabilité de devenir guide.
A cela, un dernier élément s’ajoute, ressortant davantage de la violence symbolique.
On peut supposer, en effet, à la lumière des « acquis » de la science politique, que des
mécanismes de « remise de soi300 » sont à l’œuvre chez les ouvriers (davantage que chez les
cadres) qui inhibent l’idée même de l’engagement.
296 Par l’intermédiaire de l’association Nationale de Gestion des Retraites (ANGR). 297 Op. cit. 298 Kourchid (Olivier), La mémoire de la mémoire, op. cit. 299 La cooptation apparaît en filigrane. 300 Sentiment d’incompétence.
- 83 -
Résultat de ces mécanismes de sélection, aucun mineur marocain parmi les guides,
alors qu’ils ont représenté l’essentiel de la main d’œuvre du fond, à partir des années 60. Par
contre, la moitié des guides sont d’origine polonaise. Cette proportion importante semble
corroborer nos dires : Alors que la première génération de mineurs polonais fut
essentiellement ouvrière, la seconde, acculturée, accéda à de nombreux postes
d’encadrement301.
La mémoire de la mine est donc essentiellement portée par les mineurs les mieux
intégrés, qui par leur capital culturel et social sont les plus à même de se faire investir et
reconnaître comme médiateurs de mémoire. « Elle se présente comme mémoire unifiée de la
classe ouvrière alors qu’elle est au mieux celle de l’une de ses fractions » rappelle justement
Gérard Noiriel302. Tous les modes de sélection susmentionnés contribuent à accentuer la
visibilité de ceux qui sont en position de force au sein de cette classe populaire303, au
détriment des autres, qui ne laissent pas de traces, ne témoignent pas et en sont de fait réduits
au silence.
Les conséquences de ce fait social sur le contenu des discours produits sont forcément
importantes. La volonté manifeste chez les guides de témoigner de la pénibilité du travail
(d’après les entretiens réalisés par K. Girard) s’accompagne la plupart du temps d’une
valorisation du métier de mineur, souvent emprunte de fierté304. Le discours n’est jamais celui
d’un rejet total, peut-être incompatible d’ailleurs, avec ce retour au fond (même reconstitué)
délibéré305.
2. Qui visite ?
Comme pour les guides mineurs, la réalité semble plus incertaine et complexe que ne
veulent bien l’entendre les promoteurs du musée. Pour ces derniers, le musée, « miroir tendu à
une population », accueillerait celle-ci, soucieuse d’y retrouver ses racines et son passé. Ainsi,
les mineurs ou leurs familles seraient « naturellement » parmi les plus concernés et les plus
intéressés par cette œuvre de mémoire. Cet intérêt présumé de la population minière306,
301 Après la seconde guerre mondiale. Voir sur la question de l’immigration polonaise Ponty (Janine), Les Polonais du Nord ou la mémoire des corons, Paris, Ed. Autrement, 1995, -123p. 302 Noiriel (Gérard), op. cit. 303 Ibidem. 304 Cette situation pose un véritable problème de jugement pour le visiteur: Peut-on considérer à la seule foi du témoignage de guides volontaires qui appartenaient, qui plus est, au personnel d’encadrement, que les mineurs, en général, aimaient leur métier? 305 Le souvenir d’une souffrance insoutenable, le rejet absolu d’un passé honni n’impliquent-ils pas des stratégies d’oubli plus que de mémoire ? Ces discours sur la mine ne sont-ils pas absents par nature des lieux de mémoire ? 306 Cette croyance est entretenue par le fait qu’aucune étude sérieuse portant sur un grand échantillon, n’ait été réalisée pour le moment.
- 84 -
constituant en dernier ressort, le gage incontestable de l’utilité et de la légitimité du musée. La
métaphore du miroir307 se trouve ainsi réifiée, la boucle bouclée.
Marc Dolez, Président de l’association du Centre Historique Minier:
Mme Becquart, Conseiller musée à la DRAC, insiste également sur le Centre
Historique Minier, comme lieu de rencontre entre une population et son histoire :
Est-on bien sûr que ceux qui ont été « marqués par l’histoire de la mine » visitent le
CHM ? Quelle proportion représentent-ils réellement dans la masse des visiteurs? Pour le dire
autrement, les mineurs ou leurs familles viennent-ils au musée308 ?
Oui, mais pas autant qu’on pourrait le penser a priori ou que les acteurs semblent le
croire.
Plusieurs éléments nous incitent à formuler cette hypothèse.
Premièrement l’origine géographique des visiteurs. C’est une source fiable puisqu’elle
fait l’objet d’un recensement systématique, en même temps que l’acquittement du droit
d’entrée. En 1990, seulement 11% des visiteurs309 provenaient du Pas-de-Calais, contre 13%
de la Région parisienne. Le Nord arrive en tête avec 34%310. Ajoutons que parmi les visiteurs
du Pas-de-Calais, une forte proportion provient du Littoral ! Ainsi, le département le « plus
minier » envoie relativement peu de visiteurs, en sachant que le taux déjà faible de 11% 307 Inventée par G.H Rivière et réemployée par le CHM ; Cf. p. 49. 308 La prudence est ici de circonstance. Ne disposant pas d’une enquête quantitative fiable pour tracer avec certitude le profil des visiteurs du Centre (pas plus que le Centre lui-même, d’ailleurs) nous nous contenterons de faire quelques hypothèses, au regard des informations disponibles qui nous poussent à mettre en question quelques idées reçues. 309 Hors scolaires, qui représentent presque 50% du nombre total de visiteurs.
F.D. - Pourquoi un musée de la mine ? M. Dolez - Parce qu’il fallait qu’on ait un endroit, dans le bassin et dans la Région qui soit la mémoire de cette période qui a profondément marqué notre histoire, les hommes et les femmes qui l’ont vécue, mais qui, aussi, marque les hommes et les femmes qui sont les héritier de cette histoire. C’est là que se trouvent nos racines. Il fallait un tel endroit. Dans le Nord-Pas-de-Calais nous baignons dans cette culture, mais je ne suis pas sûr que l’histoire soit forcément bien connue. Beaucoup de femmes de mineurs, d’enfants ou de petits enfants de mineurs qui viennent à Lewarde ne découvrent pas un monde inconnu puisqu'ils avaient un père ou un grand-père à la mine, mais découvrent bien des aspects qu’ils ne soupçonnaient pas, notamment la dureté du métier.
F.D. - Comment expliquez-vous le succès du Centre Historique Minier auprès du public, quelles sont les clefs de sa réussite ? Mme Becquart - En terme de public, je crois que les clefs de sa réussite, sont liées à la marque indélébile qui a frappé une population très importante. Il y a le bouche à oreille (…). (…) Je crois qu’il y a un réel consensus sur l’importance de ce centre entre les acteurs (…). Parce que c’est le moment clef, c’est le rite de passage, je dirais, de ce musée, d’une époque de constitution de collection à une époque qui doit envisager l’avenir et l’extinction petit à petit des témoins de la mine et de leurs héritiers. Et donc se positionner face à un public, un jour, beaucoup moins marqué que celui d’aujourd’hui par l’histoire de la mine. C’est une des questions que l’on peut se poser.
- 85 -
comprend probablement des publics ayant un lien très éloigné avec le monde de la mine. Ce
chiffre étonnant nous incite à la prudence concernant l’attrait supposé du musée auprès des
populations minières311. En comptant large, il est probable que le nombre de visiteurs
originaires du bassin minier du Pas-de-Calais n’ait pas dépassé les 1500 en 1990 sur un total
de 100000 visiteurs accueillis au Centre312. Chiffre à comparer aux dizaines de milliers
d’habitants qui ont été concernés directement par la mine sur ce territoire313.
L’autre élément plus récent, qui nous amène à mettre en doute cette place de choix
attribuée aux « populations minières » parmi les visiteurs, ressort du travail d’enquête réalisé
par Karine Girard dans sa monographie314. Malgré la petite taille de l’échantillon et ses limites
méthodologiques315, quelques tendances lourdes méritent l’attention.
Sur les 120 personnes interrogées, 76 (64%) disent n’avoir aucun lien avec le monde
de la mine. Autre critère intéressant, la formation scolaire des visiteurs. Leur niveau moyen
d’étude est largement supérieur à celui que l’on peut retrouver dans la population française,
qui plus est dans le bassin minier316. Sur 109 personnes qui ont accepté de répondre, 31 sont
titulaires d’un diplôme supérieur à bac +2, 21 d’un bac +2 et 13 d’un baccalauréat. Seules 10
personnes reconnaissent n’avoir aucun diplôme. Ajoutons que parmi les visiteurs ayant un
lien avec la mine, le personnel d’encadrement semble bien plus nombreux que les ouvriers. Le
livre d’or en témoigne317. Plusieurs guides signalèrent d’ailleurs à Karine Girard318, dans les
entretiens qu’ils lui ont accordés, le petit nombre d’anciens mineurs présents dans les groupes
de visite. Le maire de Lewarde, M. Nottez fournit un élément de réponse qui mérite attention:
310 Données provenant du bilan d’activité annuelle de 1989, diffusé au C.A. du 10/05/90. 311 On entend par là les individus qui ont travaillé à la mine ou les conjointes de mineurs (qui pouvaient aussi occuper des postes « au jour »). 312 Si l’on considère que les visiteurs du Pas-de-Calais représentent environ 10% des 50000 visiteurs hors scolaires, que ces 10% se découpent approximativement en trois tiers, le premier habitant le Littoral, le second le Bassin minier et le dernier le reste du département, on obtient environ 1500 visiteurs originaires du bassin miniers du Pas-de-Calais. Notons que le lien direct entre ces visiteurs et l’activité minière est plus qu’incertain et que le total exact si l’on considère exclusivement cette dernière population se situe probablement en dessous de 1000. 313 L’association Nationale de Gestion des Retraites, issue de Charbonnages de France sert aujourd’hui encore des prestations à environ 200000 ayants-droit, pour tout le bassin minier. (source M. Racle, Directeur). 314 Girard (Karine), op. cit., pp. 58-70. 315 Cf. supra. 316 Voir à ce propos, Des villes et des Hommes, le devenir de l’ancien Bassin Minier, SGAR (centre d’études et de prospectives), 1995 qui rend bien compte du déficit de formation que connaît aujourd’hui ce territoire. 317 Même si nous sommes conscients que les cadres signent peut-être plus facilement le livre d’or que les ouvriers. 318 Ibidem
F.D. - Comment les habitants de la commune perçoivent-ils le musée ? M. Nottez - Ça dépend des catégories de personnes. Si vous prenez les anciens mineurs, eux ils disent : « moi, j’irai plus jamais dans ce puits parce que j’ai trop souffert. J’y ai passé toute mon activité professionnelle. » C’était la génération du départ ça. Mais maintenant, les jeunes veulent savoir ce qu’a été l’industrie charbonnière de la Région. C’est vrai que les anciens mineurs qui terminaient leur carrière silicosés il fallait plus leur en parler.
- 86 -
Ces informations parcellaires interrogent et appellent une recherche plus approfondie
afin d’identifier quels sont réellement les visiteurs du CHM, au-delà du mythe
complaisamment entretenu.
Une grande partie de la population minière pourrait bien s’avérer absente des lieux de
mémoire qui lui sont « consacrés », investis par d’autres319 qu’elle, ou par les membres de son
élite.
C’est le deuxième visage du « cens caché de la mémoire », du côté de la réception
cette fois.
B. Proposition d’exégèse
De nombreuses difficultés sont inhérentes à cet exercice320. En effet, quel intérêt pour
la recherche d’attribuer un sens au contenu du CHM qui ne serait, en fin de compte, que notre
propre interprétation de ce sens ? De même, nous avons suffisamment insisté sur le caractère
intrinsèquement subjectif de la mémoire pour nous méfier maintenant d’une analyse, qui
jugerait du contenu du CHM en référence à une mémoire authentique, véritable, posée par
nous321.
Cette partie interrogera davantage le traitement des différents sujets en évaluant la
place qui leur est réservée et les éventuelles absences qui s’y font jour. Il s’agira donc de
décomposer le contenu et d’en faire un problème. Ensuite, seulement, on pourra se risquer à
quelques interprétations d’ordre sémiologique et symbolique, en s’appuyant notamment sur
les images sociales de la mine et des mineurs véhiculées par les acteurs du CHM.
Ainsi, le CHM apparaîtra pour ce qu’il est : un discours sur la mine dont le sens n’est
pas certain mais où s’observent quelques tendances lourdes.
1. Pour une « Géographie de l’éliminé »322
Précisons en guise d’introduction, que cette étude de contenu porte sur le dispositif
muséographique actuel du CHM et notamment sur les expositions permanentes. Ces
319 Nous essaierons de comprendre les raisons de cette attirance du public plus loin ; Cf. III.B.2 320 Cf. p. 72. 321 Même si le recours à un idéal-type mémoriel est parfois nécessaire pour ne pas tomber dans un relativisme absolu. 322 D’après le titre d’une des sous partie du très beau texte « La beauté du mort » (De Certeau (Michel), écrit en collaboration avec Dominique Julia et Jacques Revel, in La culture au pluriel, pp. 45-72, Paris, Seuil, 1993 (1ère édition : La beauté du mort : le concept de « culture populaire », in Politique aujourd’hui, déc. 1970) dans lequel les auteurs s’interrogent sur les thèmes absents de l’étude du populaire.
- 87 -
dernières, si elles n’épuisent pas la totalité des thèmes abordés au Centre323, constituent son
cœur discursif, puisque tout visiteur peut les découvrir avant la visite guidée de la mine-image
et qu’elles sont invariables.
L’exposition la plus importante324 par son volume, s’intitule « mine et mineurs ». Elle
a été réalisée en 1989, pendant la période de direction Houillères mais juste avant leur
désengagement. Son contenu s’en ressent fortement selon nous. Le projet de restructuration
muséographique325 qui devrait intervenir prochainement, prévoit une refonte de cette
exposition, plus pour des questions de forme que de fond d’ailleurs. Il est donc difficile de
prédire, à l’heure actuelle, si la future exposition prolongera ou infléchira l’ancienne. Notons
simplement la tendance : le conservateur semble privilégier « une présentation généraliste »
du monde de la mine, accentuant la place des objets ou des films d’archives, réservant les
sujets plus polémiques ou plus pointus, aux colloques et aux expositions temporaires. Il est
donc peu probable que l’on assiste à un bouleversement sur le fond, l’exposition étant surtout
critiquée pour sa présentation, voire la place excessive qu’elle accorde aux techniques :
Une étude des commentaires des guides pendant les visites serait à mener, en
complément, puisqu’on a dit leur importance dans la transmission de la mémoire. Etant donné
l’effectif de 30 guides en activité, c’était une œuvre de longue haleine, impossible à mener
dans le cadre de ce travail. Nous sommes convaincus cependant de son intérêt scientifique
potentiel.
Qu’entendons-nous par « géographie de l’éliminé » ?
Nous pensons que la nature de la mémoire transmise au CHM est autant, sinon
davantage, à rechercher dans ce qui n’y est pas présent que dans ce qui y figure. Ainsi, son
contenu pourrait être analysé en creux, à travers ce dont on ne parle pas à Lewarde.
Dès lors, l’intérêt pour la mine pourrait bien apparaître comme l’envers d’une censure,
« une intégration raisonnée »326.
Quelles plages de silence peut-on déceler au CHM ?
323 S’y ajoutent environ trois expositions temporaires par an. 324 Cf. annexe n°17. 325 Désormais pilotée par le Conservateur. 326 M. de Certeau (op. cit.) disait cela à propos de l’intérêt pour le folklore sous la Troisième République, suggérant que la culture populaire était devenue objet d’intérêt, une fois ses dangers écartés.
Mlle Paris - (…) L’exposition permanente actuelle a été aménagée en 1988, mais à l’époque, elle avait déjà 15 ans de retard sur la présentation. J’ai compté qu’il y avait 114 panneaux de texte qui sont assez justes sur le plan du contenu, si ce n’est que ça parle beaucoup plus des techniques de travail que des conditions des mineurs au fond.
- 88 -
La première omission de taille concerne la violence sociale. M. de Certeau327 avait
déjà attribué cette spécificité à la littérature folkloriste du 19ème siècle, faisant totalement
l’impasse sur les révoltes et les conflits dans sa description irénique du populaire. Les
« classes dangereuses » s’étant muées du même coup en classes heureuses.
Le propos tenu au CHM n’est pas si caricatural. Les luttes sociales sont bien présentes
dans l’exposition permanente (même si la place qui leur est impartie est faible328). Seulement,
elles sont essentiellement montrées sous un jour réformiste qui ne correspond qu’à la première
et à la dernière période du syndicalisme miner, survalorisées.
Ainsi, l’exposition le « temps des révoltes 329» ne couvre, étonnamment, que la période
de 1793 à 1920 et ignore de ce fait les mouvement de masse plus durs de la corporation
(grèves de 1930, 36, 47-48, voire 63). Les revendications jusqu’aux années 20 portent
exclusivement sur l’amélioration des conditions de travail et ne sont pas révolutionnaires
même si les Compagnies y répondent souvent par une répression brutale330, faisant même
parfois appel à la troupe331. La CGT, anarcho-syndicaliste, est boudée par les mineurs qui lui
préfèrent le « vieux syndicat332 » et voient essentiellement dans la grève le moyen de négocier
des améliorations salariales.
Le visage du syndicalisme change pourtant radicalement après la première guerre
mondiale. Les nouvelles méthodes de travail mécanisé (vite assimilées à un progrès333…)
modifient l’organisation du travail et le déqualifient, entraînant un ressentiment croissant dans
la population. Le syndicalisme traditionnel laisse peu à peu la place à un communisme
révolutionnaire. L’agitation devient endémique. Rien n’est dit de cette période.
Ce qui étonne encore davantage, c’est le traitement réservé à la grève de 1948334. Un
demi-panneau lui est consacré (photos comprises), dans la partie « la mine : creuset social et
syndical » de l’exposition permanente. Aucune référence particulière à la violence
exceptionnelle de cette grève, qui fût, aux dires de Joël Michel, la seule insurrectionnelle
qu'ait connue le pays. La CGT, largement majoritaire, donna l’ordre pour la première fois
327 Ibidem. 328 4 panneaux sur les 114 de l’exposition. L’estaminet reconstitué, où le propos sur les luttes n’occupe d’ailleurs que quelques panneaux, est situé dans la partie la moins accessible du musée. 329 Inaugurée en 1991. 330 Zola, pour Germinal, s’est inspiré de la grève des mineurs de la Compagnie d’Anzin en 1884, qui a abouti, après 50 jours de conflit, au renvoi de 2000 ouvriers écrasant le syndicalisme pour 20 ans. 331 L’exemple le plus connu est celui de 1906, où, suite à la catastrophe de Courrières qui a déclenché une grève générale, Clémenceau envoie la troupe (21000 hommes) pour rétablir l’ordre et arrêter les meneurs. 332 Voir Joël Michel, La Mine dévoreuse d’Hommes, Paris, Gallimard, 1993, pour une présentation de ces enjeux syndicaux. 333 Elles accentuent en réalité la course aux rendements, installent de ce fait une division du travail déqualifiante, une déresponsabilisation des mineurs mal ressentie et multiplient certaines nuisances (bruit, poussière). 334 Qui fait suite à la « bataille du charbon » et aux espoirs déçus des mineurs (et de la CGT. Les communistes ont été renvoyés du gouvernement en 1947).
- 89 -
d’abandonner les installations de sécurité. Face à l’insurrection, la troupe est envoyée et
utilise des grenades offensives, tire sans sommations. Il y aura 2783 ( !) condamnations.
Ce mouvement laissera des traces dans les esprits. L’«Etat patron » sera désormais
logé à la même enseigne que les Compagnies. On peut comprendre que les Houillères335,
lorsqu’elles dirigeaient le musée, n’aient pas souhaité insister sur cette période336 pourtant
décisive de leur histoire.
L’autre période importante dont il n’est pas fait état est celle de l’occupation. Sans
s’étendre sur la question, ce n’est pas le sujet, on doit rappeler que les Compagnies ont été
nationalisées après la guerre337, suite à leur collaboration avec l’occupant. De nombreux
meneurs syndicaux furent arrêtés et déportés sur dénonciation des Compagnies qui « se
seraient appuyées sur Hitler pour prendre leur revanche de 1936 »338. De cette époque trouble,
il n’est point question, sinon pour rappeler les actes de résistance (avérés) de nombreux
mineurs.
Enfin, le dernier élément passé sous silence est celui de la discrimination qui toucha
les mineurs d’origine étrangère, voire le racisme dont ils furent victimes, en porte-à-faux avec
l’image communautaire et égalitaire du monde de la mine souvent répandue.
D’abord les polonais : Venus en nombre après la première guerre mondiale, leur
intégration n’apparaît pas souhaitable aux gouvernants de l’époque et leur particularisme est
entretenu339. Premières victimes de la crise, ils peuvent être contraints à rejoindre leur pays en
48 heures. Antoine de Saint-Exupéry340 fut témoin de cette discrimination : Les voitures de troisième classe abritaient des centaines d’ouvriers polonais
congédiés (…) Tout un peuple enfoncé dans les mauvais songes et qui regagnait sa misère (…). Ils me semblaient avoir perdus qualité humaine (…), arrachés à la petite maison du Nord, au minuscule jardin, aux trois pots de géranium que j’avais remarqués autrefois à la fenêtre des mineurs polonais. Ils n’avaient rassemblé que les ustensiles de cuisine, les couvertures, les rideaux, dans les paquets mal ficelés et crevés de hernies.
Mais tout ce qu’ils avaient caressé ou charmé, ce qu’ils avaient réussi à apprivoiser en quatre ou cinq années de séjour en France, le chat, le chien et le géranium, ils avaient dû les sacrifier.
Les mineurs français leur font grief de leur catholicisme et de leur attitude à la mine
où ils travaillent sans rechigner341.
La place laconique réservée dans l’exposition aux mineurs nord-africains (marocains
notamment) est, elle aussi, symptomatique342. Cette question semble, aujourd’hui encore, faire
335 Voire la CGT qui s’est depuis ralliée au réformisme. 336 Même si nos interlocuteurs nous ont affirmé qu’aujourd’hui, il ne verrait pas de problème à ce que le musée parle de ces événements, la distance aidant. 337 Pour être regroupées dans Charbonnages de France. 338 Joël Michel, op. cit. 339 On fait venir des prêtres et des instituteurs de Pologne. Voir Ponty (Janine), Les Polonais du Nord ou la mémoire des corons, Paris, Ed. Autrement, 1995, -123p. 340 Terres des Hommes, 1939, cité par Joël Michel, op. cit. 341 Ils ne se rapprocheront des français et ne se syndiqueront (massivement) qu’avec le Front Populaire. 342 Rien n'est dit sur leur statut particulier ou sur les méthodes de recrutement à la limite de l’humanité.
- 90 -
l’objet d’un tabou343. Recrutés dans les années 60, alors que la main d’oeuvre manquait, ils
ont souvent servi de variable d’ajustement, permettant aux Houillères de gérer la crise et les
fluctuations de l’extraction. Yamina Benguigui, dans son très beau travail d’entretiens filmés,
Mémoires d’immigrés344, a rencontré l’un de ces mineurs marocains. Il raconte345 son
recrutement au Maroc, les fausses promesses, la souffrance au fond346 puis l’accident, la
menace de renvoi, la prise de conscience de l’inégalité de traitement entre mineurs français et
étrangers, la lutte…
Les ouvriers maghrébins n’avaient pas le statut de mineur347 mais celui d’ « agent de
fond », beaucoup plus précaire, et étaient embauchés par contrat de 18 mois renouvelables à la
discrétion de l’employeur.
Ces trois absences (luttes sociales violentes, collaboration, discrimination à l’égard des
immigrés) sont significatives d’un mode de commémoration répandu348 qui ignore la violence
passée et néglige ce qui peut entretenir la division sociale au profit d’un rassemblement
consensuel, où l’optimisme mémoriel l’emporte sur le pessimisme. De ce fait, de nombreux
lieux de mémoire restent oublieux et très sélectifs. Tout devient prétexte à commémoration,
pourvu qu’il ne remette pas en cause le présent.
L’autre pan de cette géographie de l’éliminé tient à l’identité même de l’entrepreneur
de mémoire. Ainsi, il est patent de constater que tout l’ « esprit critique » de l’exposition
« mine et mineurs » se concentre sur l’époque des Compagnies, exonérant les Houillères de
toute mise en question. Quoi de moins étonnant dans une exposition qu’elles ont elles-mêmes
supervisée ! L’œuvre de mémoire participe de ce fait à la restauration de leur image et fait
l’impasse sur de nombreux aspects controversés de leur héritage.
Pour exemple, la partie consacrée à la silicose tait complètement les difficultés qu’ont
rencontrées de nombreux mineurs pour faire reconnaître par les Houillères l’origine
professionnelle349 de leur maladie350. De même, la question de la prévention de la maladie est
abordée sous un angle favorable à l’entreprise, évacuant toutes les polémiques à ce sujet.
343 La proposition faite par M. Bouin, au C.A. du 27 Mai 1994, de réaliser une exposition consacrée à la communauté marocaine n’a donné lieu à aucune suite. 344 Benguigui (Yamina), Mémoires d’immigrés, l’héritage maghrébin, Paris, Canal + Editions, 1997, pp. 34-42. 345 Voir un extrait de cet entretien en annexe (n°18 ) 346 De nombreux marocains étaient abatteurs, soit la tâche la plus pénible et la plus dangereuse du fond (Nombreux silicosés). 347 Créé en 1946 il offre de nombreux avantages (logement, maladie, retraite). 348 Loin d’être spécifique au CHM. L’article de Thierry Gasnier en apporte la preuve en décortiquant la frénésie commémorative et ses trous noirs: « La France commémorante », in Le Débat, n°58, janvier 90 349 Donnant lieu à une indemnisation et aux versement de prestations sociales. 350 On peut supposer, au vu des entretiens, que cette omission sera comblée dans la prochaine exposition.
- 91 -
Le discours, positiviste, insiste davantage sur la modernisation de la production, sans
rappeler qu’elle ne s’est pas toujours accompagnée, loin de là, d’améliorations des conditions
de travail351.
La pénibilité de la tâche étant indéniable, l’exposition prend soin de valoriser sa
« contrepartie » : les acquis sociaux des mineurs. Les centres de vacances sont mis en exergue
dans la rubrique consacrée aux institutions de la mine. Le château de La Napoule, sur la côte
d’Azur, fait partie de ces lieux de villégiature emblématiques, mis en avant par l’entreprise
dès la bataille du charbon, pour inciter les mineurs à produire plus. C’étaient oublier la
longueur des listes d’attente et le nombre de places dérisoire au regard des effectifs ! Ainsi, de
nombreuses traces du discours propagandiste des Houillères, largement diffusé au moment de
la « bataille du charbon », apparaissent en filigrane dans l’exposition. Ce discours, a même
fini par devenir un simili de discours officiel sur la mine, progressivement assimilé par tous,
les ouvriers compris.
Les mérites de la promotion interne, qui permettait au mineur courageux de gravir les
échelons de la hiérarchie interne (des panneaux montrent les classes de formation mises en
place par les Houillères), sont allègrement vantés. Estelle Caron, dans son analyse des
documentaires cinématographique de l’après-guerre352, a bien identifié cette figure récurrente
du mineur, qui grâce à la modernisation passe de la condition de simple manœuvre à celle de
technicien.
Sont donc mis en avant les effets positifs353 de l’exploitation du charbon354 sur
l’économie, la protection sociale355, la formation356. Rien par contre sur ses conséquences
désastreuses en matière d’environnement357, de niveau d’étude358, ou de santé. Rien non plus
sur la crise sociale de l’après-charbon.
Un lieu de mémoire est-il par essence un non-lieu de débats ?
351 L’arrivée du marteau piqueur à air comprimé, loin de soulager l’abatteur provoqua de nombreuses maladies (surdité, silicose due au poussières plus nombreuses, séquelles articulaires) et accrut la pénibilité du travail. Les pertes de personnels sont ainsi 23% plus élevées en 1946 qu’en 1938. Les mineurs paieront un lourd tribut humain à la bataille du charbon, fût-elle mécanisée. 352 Caron (Estelle), images sociales : le travailleur de la mine, séminaire de D.E.A. « le documentaire français (1945-1955), Université Paris III, U.F.R d’Etudes Cinématographiques et Audiovisuelles, 1995 353 Présentés comme tels. 354 Extrait de l’un des derniers panneaux : « La production charbonnière a permis le développement d’industries nombreuse : centrales électriques, cokeries, usines, briqueterie ; ainsi que la naissance d’activités diverses : logement, services hospitaliers et sociaux, formation, informatique, ingénierie mécanique, etc. Avec la fin de l’exploitation, les HBNPC se sont engagées à préserver, sinon développer, ce potentiel ». 355 Une partie importante de l’exposition permanente est consacrée aux institutions sociales des mines et à la sécurité sociale minière. 356 Des panneaux présentent les différentes formations et métiers de la mine. 357 Un colloque s’est tenu récemment (26-28 novembre 97) à la faculté de droit de Douai sur la question des environnements juridiques du Bassin Miner, qui a abordé la question des responsabilités de remise en état ou de traitement des restes, après l’exploitation. 358 De nombreux jeunes quittaient l’école prématurément pour rejoindre les Houillères.
- 92 -
Ainsi pour le logement : l’exposition (réalisée en grande partie par la
SOGINORPA359), si elle se montre volontiers critique sur l’utilisation du logement par les
Compagnies pour fixer la main d’œuvre, tourne ensuite au discours promotionnel sur les
réhabilitations en cours (maquettes à l’appui), évacuant les enjeux et débats présents.
Rappelons que l’avenir et la gestion de l’habitat minier apparaissent comme des questions
politiques centrales, autour desquelles s’affrontent les principaux acteurs du territoire360.
De même, les interrogations concernant les sorties de concessions minières (remise en
état des sites et responsabilité de Cdf en cas de cession aux collectivités) ont jusqu’à présent
été escamotées de l’exposition. Peut-on imaginer que les choses évoluent avec le
désengagement des Houillères ?
La difficulté de la réponse tient à la spécificité des musées de société, qui plus est,
quand ils traitent d’une activité industrielle révolue. Les principaux partenaires de ces musées
sont les mêmes qui sont confrontés, en tant qu’acteurs institutionnels, aux problèmes de
reconversion posés par la récession de l’activité muséifiée. La tentation est grande de
considérer le musée comme un outil de communication sur la politique de reconversion mise
en œuvre ou d’en faire un outil de promotion du territoire dont ils ont la charge.
Gageons que le CHM saura se déprendre des carcans (souvent inconscients mais
puissants) de la mémoire utile, ersatz d’un authentique travail de mémoire.
2. Images sociales de la mine et du mineur : « la beauté du mort »361
On a dit maintes fois, combien il nous semblait hasardeux de répondre d’un trait à la
question : « Quelles images de la mine et des mineurs le Centre Historique Minier véhicule-t-
il ? ». Elle implique en effet une approche complexe qui s’accommode mal des réponses
génériques et globalisantes. Nous avancerons donc par hypothèses prudentes, en essayant
d’abord d’identifier les opérations intellectuelles qui commandent cet intérêt pour le métier de
mineur et la culture populaire des mines.
« Au commencement, il y a un mort », disait Michel de Certeau362. L’intérêt pour la
culture populaire ayant pour « condition de possibilité, l’élimination d’une menace
populaire ». Empiriquement, on peut constater que les collecteurs de mémoire collective
359 SOciété de Gestion Immobilère du NOrd-PAs-de-Calais. Filiale de Charbonnages de France qui gère le colossal patrimoine immobilier issu des Houillères (environ 80000 logements pour le bassin). 360 Gratuité, politiques de rénovation, entrée dans le parc locatif privé une fois les ayants droit disparus, propriété des logements (l’association des communes minières revendique un transfert de propriété de l’Etat, aux collectivités locales) figurent parmi ces questions. Voir l’article de Guy Baudelle : « Le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais après le charbon : la difficile gestion de l’héritage spatial », in Hommes et Terres du Nord, 1994-1, pp. 3-12. 361 D’après le titre de l’article de M. de Certeau ; op. cit. 362 Ibidem.
- 93 -
portent davantage attention à ceux dont on a programmé la disparition prochaine. Le mineur
est ainsi devenu le paysan d’hier, au chevet duquel se penchaient les folkloristes d’alors,
persuadés de son agonie. Le beau mineur363 est un mineur mort364.
L’intérêt pour les cultures populaires procède même parfois d’une logique
d’éradication de celles-ci : par le recensement des patois en 1792, l’Abbé Grégoire entend
avant tout promouvoir l’usage de la langue française, en reléguant les idiomes au folklore. De
même pour les folkloristes du Second Empire. Leur manie des cultures populaires
s’accompagne d’une répression politique féroce, exorcisant les dangers révolutionnaires
auxquels elles sont encore associées365. Délestées de leur dimension politique et sociale, elles
perdent toute leur subversivité et finissent par participer à une logique d’intégration, de
consensus. Les cultures populaires sont d’autant plus exaltées qu’elles ne sont plus contre-
cultures. Il en résulte, selon M. de Certeau, une « disqualification de l’objet ainsi classé, re-
situé et désormais rassurant ».
C. Suaud et J.C. Martin366 étendent cette analyse aux nouvelles formes patrimoniales
« particularistes », type Puy du Fou. Selon les auteurs, « la spécificité des spectacles
mémoriels de ce genre serait de permettre à des pans de mémoire enfouis ou refoulés par des
savoirs légitimés de surgir et de s’exprimer sous la forme acceptable, parce que politiquement
neutralisée, de l’histoire théâtralisée ».
Nous avons choisi de présenter ces hypothèses parce qu’elles rendent compte, selon
nous, de quelques ressorts symboliques de la mise au musée de la culture minière et rappellent
que l’intérêt pour les cultures populaires s’est souvent accompagné d’une violence à leur
égard, jamais éloignée d’une volonté d’éradication.
Le musée de Lewarde ne participe-t-il pas lui aussi, à sa manière, à l’« acclimatation
d’une culture populaire »367 de la mine, rendue compatible avec le présent et dès lors
désincarnée ?
Reléguée dans un lieu de mémoire, la culture de la mine n’est-elle pas conjurée en
même temps qu’exaltée ? Car c’est sur un geste de séparation que se construisent les lieux de
mémoire. Le passé muséifié est rendu distant en même tant que distinct du présent368. Le
363 B. Pudal parle de « peuple en beauté » pour décrire cet attrait du populaire sous condition : in « Le populaire à l’encan », Politix, n°14 Le populaire et le politique (2), 2eme trimestre 1991, pp.53-64, Presse de la Fondation Nationale des Sciences Politiques. 364 A ce titre, nous ne résistons pas à la tentation de citer le numéro spécial de Nord (revue d’information du département) consacré aux musées de société. En préambule : « Nord vous emmène dans des musées consacrés à l’économie, à la société, aux sciences ou à la nature. Pour tout savoir sur la mine et les mygales, le verre et les dockers, les fossiles et les filatures ». Des mineurs aux ammonites, il n’y a qu’un pas… 365 M. de Certeau parle à ce propos d’un « culte castrateur ». 366 Le Puy du Fou, op. cit, p.211 367 Selon l’expression utilisée par Bernard Pudal : « Le populaire à l’encan », in Politix, n°14 Le populaire et le politique (2), 2eme trimestre 1991, pp.53-64, Presse de la Fondation Nationale des Sciences Politiques 368 Comme le montre très bien Marc Guillaume : « Invention et stratégies du patrimoine », in Jeudy (Henri-Pierre), Patrimoines en folie, Paris, Ed. de la Maison des sciences de l’Homme, 1990, pp. 13-21
- 94 -
musée devient alors le point de départ d’un travail de deuil369. La culture vécue, immanente,
déjà atteinte par la fin de l’activité, s’apprête à devenir une culture morte, nostalgique, bientôt
remplacée. Le lieu de mémoire devient sanctuaire370.
Cette logique de muséfication post mortem rencontre une image du mineur sublimée,
déjà constituée.
En effet, l’histoire de la mine est aussi celle de la construction d’une représentation
sociale du mineur. Figure mythique du travailleur par excellence, objet de tous les archétypes
et stéréotypes, il semblait intéressant d’en dire deux mots. Comment les partenaires du musée
et le musée lui-même gèrent-ils cet héritage imaginaire dans leur approche du passé ?
Rappelons d’abord quelques éléments de cette mythologie371. Elle est forgée par la
grande presse, dès la fin du 19ème siècle. Le mineur est surtout connu à travers les risques qu’il
affronte et les luttes qu’il mène. Du côté du patronat, se développe bientôt un archétype du
mineur ouvrier modèle, courageux, dévoué. Ses compétences, son habileté sont
complaisamment vantées. M. Turbelin, qui fut l’un des fondateurs de l’association du Centre,
nous a tenu un discours encore imprégné de cet archétype :
C’est finalement de stéréotypes assez proches dont se nourrit l’imaginaire
communiste. L’ouvrier modèle se mue en militant modèle et en avant-garde du prolétariat.
Les productions artistiques et littéraires du réalisme socialiste en feront un Stakhanov avant
l’heure. Une sculpture monumentale en bronze, caractéristique de ce style pompeux
(représentant un mineur transfiguré en colosse « prométhéen »), trône dans l’espace réservé
aux expositions du CHM. Le texte d’André Stil « le mot mineur, camarades »372 représente le
pendant littéraire de cette mystique. Cette dernière, abondamment utilisée comme outil de
propagande pendant la « bataille du charbon » pour encourager à la production, finira par
imprégner les esprits. Jusqu’à être assimilée par les mineurs eux-mêmes, qui considéreront
comme valorisantes ces images d’eux, projetées dans la sphère publique. D’où la difficulté
369 Les lieux de mémoire sont aussi des lieux de l’oubli. 370 Un article sur le musée ( « Une mine de souvenirs », Patrick Francès, Le Monde 27 septembre 1986) compare même la visite à un pèlerinage « avec le recueillement qui s’y attache ». 371 Voir la très intéressante partie « Témoignages et documents » (pp. 98-102), in Michel (Joël), La Mine dévoreuse d’Hommes, Paris, Gallimard, 1993. 372 Stil (André), le mot mineur, camarades, La bibliothèque française, 1949.
F.D. - En quoi le musée peut-il servir l’avenir de la région ? M. Turbelin - En montrant que chez nous, on a des gens qui savent travailler. C’est important et on l’oublie souvent. Ce sont des gens qui voient clairs, qui sont persévérants, intelligents, disciplinés contrairement à ce que l’on peut penser, souvent organisés. Ce ne sont pas des indépendants les mineurs. Ce sont des gens qui aiment travailler en groupe. Je crois, que ça, pour une grande entreprise qui s’installe, c’est quand même quelque chose de positif. Et contrairement à ce que l’on pense, ce ne sont pas des illettrés. Quand on a travaillé au fond, il faut avoir de la jugeote.
- 95 -
aujourd’hui de reconnaître dans les discours des mineurs sur leur métier ce qui tient du mythe
collectif intériorisé et ce qui relève du point de vue personnel373.
Le CHM et ses acteurs ont parfois du mal, aujourd’hui encore, à se déprendre de
certains éléments de cette mythologie. Ils considèrent souvent, sans plus d’investigations374,
que les mineurs aimaient (ou étaient fiers de) leur métier. Ce à quoi de nombreux mineurs
rétorquent, relativisant l’idée communément admise, que jamais un mineur n’était heureux de
voir son fils devenir mineur.
Le discours du « mineur qui a relevé la France » reste lui aussi récurrent et devient
même un argument de négociation pour obtenir des aides de l’Etat375. De plus, la corporation
minière est souvent appréhendée comme un tout, relativement homogène, où le collectif et la
solidarité organique priment sur les individus. Olivier Schwartz a bien montré, pourtant,
l’importance du « monde privé des ouvriers »376, en marge du référent collectif. Cet espace
privé occupe encore peu de place au Centre, même si l’exposition sur les « coulonneux377 »
organisée en 1996 a marqué un premier pas dans cette direction. Pendant longtemps, les
mineurs ont été exclusivement perçus à travers leur métier, auquel ils étaient identifiés378. Le
musée ne s’est intéressé que tardivement à leur condition sociale ou familiale et encore
aujourd’hui, le rôle des femmes de mineurs n’est quasiment pas abordé par exemple.
Il est encore trop tôt pour dire si la muséification véhiculera à l’avenir les stéréotypes
du mineur qui l’ont précédée ou si elle ouvrira la voie vers une approche plus complexe. Nous
penchons plutôt vers la deuxième hypothèse, au regard des évolutions actuelles et du temps
qui apportera davantage de recul aux acteurs, même si pour le moment, l’image sociale des
mineurs reste fortement marquée par trois grandes figures en tension : le mort, le héros de la
production, le camarade379.
C. La question de la transmission
La finalité avouée du CHM, dans sa partie musée, est de proposer à un public, le plus
large possible, de découvrir des éléments de la mémoire de la mine à travers ses collections et
la visite du site. Nous l’avons déjà dit : Il est illusoire de considérer ce contenu comme une
simple juxtaposition d’objets, de témoignages, auquel chacun serait libre de donner le sens
373 Si tant est qu’on puisse les autonomiser. 374 Et souvent à la seule foi des témoignages des guides du Centre. Voir note n° 282. 375 Cf. II.B.2. 376 Schwartz (Olivier), Le monde privé des ouvriers, Paris, PUF, 1990. 377 Mot de patois qui désigne les colombophiles. 378 D’où la place importante consacrée aux techniques. 379 Dans ses deux acceptions : marxiste et non-marxiste.
- 96 -
qu’il souhaite. Un musée s’apparente davantage à un discours semi-directif qu’à un discours
non-directif. Les expositions, la visite guidée, ordonnent, même de façon lâche,
l’interprétation des visiteurs. Reste à savoir dans quelle mesure et dans quel sens.
Les Guides touristiques (type Michelin), documents de communication du musée ou
articles de presse, jouent un rôle non négligeable dans l’image préalable que les visiteurs se
font du CHM et parfois, dans leur envie d’y venir. Ils sont donc un premier vecteur
(préparatoire) de la transmission et méritent en tant que tels d’être étudiés : Comment le
Centre y est-il décrit ? Peut-on percevoir des modes de descriptions redondants, stéréotypés ?
Quels sont les éléments de la visite mis en avant ?
Autant de questions qui nous conduisent directement à celle de la motivation des
visiteurs : Pourquoi viennent-ils au Centre Historique Minier ? Que connaissent-ils du Centre
et de la mine avant d’y venir380 ? Qu’en attendent-ils ? Qu’en retiennent-ils ?
Comme auparavant, nous avancerons dans nos réponses avec la plus grande prudence.
Une enquête quantitative, voire qualitative auprès du public permettrait sûrement de dissiper
quelques doutes. Ce travail n’ayant pu être mené faute de temps, nous avons choisi de nous
limiter à la présentation des éléments les plus remarquables, en réservant une place
particulière à des pistes de recherches prometteuses mais qui demanderaient à être
expérimentées sous la forme d’une enquête par questionnaire. C’est notamment le cas pour la
toute dernière sous-partie, qui se penche sur la perception du public stricto sensu. C’est donc
un chantier ouvert.
1. Visibilité externe du CHM
D’après l’enquête réalisée auprès de 187 personnes en 1991, la majeure partie des
visiteurs ont connu le Musée de Lewarde par l’intermédiaire de leur famille ou de leurs amis
(115/187). En second viennent la presse écrite et les Guides381 touristiques (48/187). Ces
derniers tiennent donc une place non négligeable dans le premier contact des visiteurs avec le
Centre, sinon dans leur motivation. Ajoutons que le « bouche à oreille » peut donner lieu à
une recherche d’informations complémentaires, qui renforce l’importance de ces supports.
Quel discours tiennent-ils sur le CHM ? D’abord les Guides.
Etant donné la multitude en circulation, nous nous limiterons à l’analyse de quelques-
uns : Le Guide Michelin 1996 consacré à la Flandre, l’Artois et la Picardie, qui s’adresse
essentiellement aux touristes, le « Guide Casterman des musées du Nord-Pas-de-Calais »,
380 Nous avons déjà proposé quelques réponses à cette question en III.A.2 381 Avec un G majuscule pour les différencier des guides mineurs.
- 97 -
d’approche moins généraliste et le « Chti 98 » (Guide gratuit réalisé par les étudiants de
l’EDHEC sur les loisirs dans la Métropole lilloise et ses environs).
Le Guide Michelin attribue deux étoiles au musée, qui correspondent dans son barème
à « vaut le détour ». La note maximale « mérite le voyage » n’est attribuée à aucun site du
Nord-Pas-de-Calais. A titre de comparaison, la ville de Lille obtient aussi deux étoiles. Ainsi,
on peut considérer que l’appréciation est très bonne. Une photo est insérée dans la page qui lui
est consacrée. Elle représente le circuit minier. On aperçoit un guide en bleu de travail dans le
fond de la galerie de mine reconstituée. Notons que les galeries reconstituées, peut-être parce
qu’elles incarnent la mine dans l’imaginaire collectif, sont souvent préférées en illustration
aux bâtiments du carreau, pourtant « authentiques ».
La présence d’anciens mineurs est signalée avec insistance dans deux des trois Guides
mais n’apparaît pas dans le Guide Casterman. Cette omission mérite d’être signalée car elle
est une exception au vu de tous les documents que nous avons pu consulter sur le CHM. Cela
démontre la place centrale de cet élément382 qui est souvent le premier avancé pour justifier de
l’intérêt de la visite.
La description du dispositif muséographique et notamment de la « mine image »
appelle quelques commentaires. Si deux des guides précisent que la descente à 450 mètres est
« simulée », le guide Michelin est sibyllin sur la question : Un petit train mène ensuite au puits n°2 où la « descente » s’effectue
en ascenseur vers les galeries. Là un parcours de 450 mètres de galeries (animation audiovisuelle et reconstitution de scènes de taille) permet de comprendre l’évolution du travail de mineur de 1930 à nos jours.
Seuls les guillemets de « descente » peuvent, à la limite, entretenir des soupçons sur
son effectivité.
De nombreux visiteurs pensent ainsi qu’ils vont visiter une galerie « au fond », le
doute n’étant jamais clairement dissipé avant la visite383. Les guides jouent d’ailleurs de cette
ambiguïté et précisent rarement au préalable qu’il s’agit d’une descente simulée384.
Pis, le prospectus du Centre385 reproduit la même imprécision en se contentant lui
aussi de mettre des guillemets :
Les visiteurs sont accueillis dans la « salle des pendus » par les
anciens mineurs qui les emmènent en train minier jusqu’au puits où ils « descendent » dans les 450 mètres de galeries. Ils pénètrent alors dans les dix chantiers du fond où le guide leur explique l’évolution de l’extraction du
382 Pour une analyse critique voir la partie III.A.1. 383 Ce fut d’ailleurs notre cas lors de notre première visite. 384 Karine Girard le montre bien dans sa monographie, op. cit. 385 Cf. annexe n°19.
- 98 -
charbon et recrée l’ambiance de travail en remettant les machines en fonctionnement.
Il ne nous semble pas excessif de considérer cet artifice comme un argument de
« vente » potentiel misant sur une attirance pour l’insolite386. Dans le même sens, la plaquette
réalisée à l’attention du grand public est exclusivement illustrée de photos représentant les
parties « reconstitutions » des expositions et insiste largement sur tout ce qui relève de
l’animation dans la visite387.
Le summum de cette promotion « spectacle », désormais rejetée par l’équipe
dirigeante388, est atteint dans un article publicitaire389 (Sous le titre : « Le CHM de Lewarde,
ne ratez pas la visite… ») publié dans le Galibot en 1988, journal gratuit de petites annonces.
Extrait choisi : Ce circuit minier –on y entre et on en sort par un petit train- est
depuis le mois dernier entièrement sonorisé. Le visiteur assiste ici à un véritable spectacle son et lumière390. En passant d’un chantier à l’autre, les spots lumineux illustrent le commentaire diffusé sur un bruit de fond…de fond de la mine ! (sic) Le dépaysement est total et cette animation permet de comprendre les contraintes de la mine, cette usine en perpétuel déplacement.
La mine comme nouvel exotisme ? Tristes tropiques !
A un degré moindre, les guides touristiques comme les plaquettes de promotion que
publie le Centre n’hésitent donc pas à mettre en avant les aspects les plus spectaculaires et
dépaysants de la visite, au détriment du reste.
Les médias participent également à la visibilité externe du Centre.
Pour l’année 1994, en sachant que 1993 fut une année assez exceptionnelle pour le
musée391, le service communication avait recensé 445 interventions médias sur le CHM. Soit,
respectivement, 409 articles de presse écrite, dont 79 dans la presse nationale et 11 dans la
presse étrangère, 18 émissions de radio et 18 reportages de télévision.
Une analyse exhaustive, qui porterait sur les quinze dernières années était donc hors de
notre portée et nécessiterait probablement un mémoire de recherche à elle seule.
386 C’est l’objet de la sous partie suivante. 387 Cf. annexe n°19. 388 M. Dubuc comme Mlle Paris, nous ont affirmé pendant les entretiens qu’ils considéraient le modèle « parc d’attraction » ( le terme de « Mineland » a été employé ironiquement à plusieurs reprises) comme un repoussoir, qu’il fallait absolument éviter. 389 Cf. annexe n°21. 390 La référence n’est pas sans faire penser au spectacle du Puy du Fou. Cf. Suaud et Martin, op. cit. 391 La sortie en salles du film Germinal de Claude Berri a attiré l’attention des médias sur le Centre.
- 99 -
Plutôt que de spéculer sur le sens de ces discours sans avoir pu en dresser l’inventaire,
nous avons choisi de soulever des questions majeures qui se posent à leur égard.
La multiplicité et la diversité des interventions médiatiques imposent de recourir aux
typologies. Il faut tenir compte à la fois de l’identité du médium et du contexte dans lequel il
produit son discours.
Les médias régionaux portent-ils le même regard sur le musée que les médias
nationaux ? A quels stéréotypes différents ont-ils recours ? Le Centre est-il traité de la même
manière dans les journaux généralistes et dans les journaux spécialisés ? Le regard porté sur le
Centre a-t-il évolué depuis 1982 ? L’évolution de l’activité charbonnière jusqu’à la récession
a-t-elle changé les discours journalistiques sur le musée ? Quelle a été l’influence du film
Germinal ? Quelles sont les parties du musée mises en avant ? Quels sont les registres
lexicaux utilisés ( historique, funèbre, industriel, touristique, économique, culturel,
sacré,…) ? Existe-t-il un discours médiatique autonome392 sur le musée ? Quelle y est la
place du pittoresque ou de l’insolite ?
Autant de problématiques, parmi d’autres, qui pourraient composer la trame d’une
approche heuristique de ces sources médiatiques, lesquelles contribuent sans aucun doute à
construire l’image du Centre et sa renommée.
2. Le CHM vu par ses visiteurs : quelques pistes de recherche
Pourquoi vient-on au Centre Historique Minier ? Qu’en retient-on ? Ces deux
questions pourraient résumer la perspective ambitieuse de cette dernière sous-partie. Là
encore, les réponses sont complexes, ambivalentes, irréductibles à une explication
monocausale. Il faut peut-être se résoudre, avec un tel sujet, à poser plus de questions qu’on
ne pourra y répondre.
Comment expliquer l’attractivité du CHM ? La curiosité et « l’envie de s’enrichir
intellectuellement »393 jouent probablement un rôle important dans les motivations du public.
Les acteurs du musée se satisfont souvent de cette explication gratifiante. Mais suffit-elle pour
autant à expliquer l’ampleur de l’engouement ? Car après tout, d’autres lieux, par leur intérêt,
mériteraient probablement le même enthousiasme populaire394. Certains rétorqueront que la
mine occupe une place à part dans l’histoire de la Région. C’est indéniablement l’un des
facteurs de succès du Centre. Cependant, nous avons montré que la proximité supposé entre
392 La plupart des articles ( presse régionale notamment) que nous avons rencontrés dans nos recherches se contentaient de reprendre des arguments figurant dans les documents du Centre (des dossiers de présentation sont remis sur demande). 393 Selon les propos du Directeur, M. Dubuc. 394 Nous pensons notamment à l’écomusée de Fourmies-Trélon ou au musée des dockers à Dunkerque.
- 100 -
les visiteurs et le monde de la mine était loin d’être évidente395. Ceux qui ont été en prise
directe avec lui (par leur activité passée) ne semblent pas majoritaires parmi les visiteurs.
Il faut donc proposer d’autres explications au succès du musée, parfois refoulées car
moins légitimes socialement pour un lieu qui se veut culturel. Nous pensons que le goût pour
l’insolite participe aussi au succès du musée396. Nouvelle curiosité, la mine attire tel un
exotisme397. Les anciens mineurs, déguisés de leurs habits de travail désormais obsolètes
(mais un mineur sans casque est-ce encore un mineur ?), ne sont-ils pas devenus des « bons
sauvages » des temps modernes, comme le pense Gérard Noiriel398 ? M. Bembenek,
représentant de la CGT au C.A., propose une interprétation intéressante des raisons du succès
du musée :
Il faut probablement compter sur ces motivations, plus ou moins conscientes, qui font
la part belle à un attrait pour l’inhabituel et pour l’évasion passéiste dans les motivations des
visiteurs. La mine « mise en scène »399 est aussi un spectacle. C’est une dimension essentielle
du CHM qui ne dépend pas de la volonté de ses acteurs400 mais du sujet traité. L’image du
mineur bataillant contre les éléments dans un milieu hostile, en rappelant les plus grandes
figures mythologiques, de Prométhée au Minotaure, est source de fascination. Nous doutons
fortement qu’un musée du textile, dont l’intérêt objectif pour la région n’est pas moindre que
celui d’un musée de la mine, attirerait autant de monde. L’envie de s’enrichir
intellectuellement, ne suffit donc pas à expliquer, seule, le succès du Centre auprès du public.
Probablement s’y ajoutent différents facteurs moins rationnels qui relèvent davantage de
l’imaginaire et des fantasmes. La courbe de fréquentation est intéressante à étudier dans ce
sens :
395 Voir à la page 80. 396 Bernard Pudal dans son article « le populaire à l’encan » (op. cit.) décrit cet intérêt ludique pour le populaire sous la forme d’un jeu de mot : « s’amusée ». 397 Les modes de description qui composent la visibilité externe du musée vont dans ce sens. Cf. supra. 398 « Le pont et la porte », op. cit. 399 D’après le titre de l’ouvrage de Suaud et Martin, Le Puy du Fou, l’histoire mise en scène, op. cit. 400 Même si le Centre, dans sa communication externe, joue parfois de la tension fascination/répulsion que provoque le monde souterrain de la mine. Nous l’avons montré dans la subdivision précédente.
F.D. - Comment expliquez-vous le succès du CHM ? M. Bembenek - C’est un phénomène naturel, peut-être, malheureusement. Quand quelque chose disparaît, on dirait que cela intéresse les gens beaucoup plus. Quand je vous parlais de la fermeture du Bassin Minier, il y a eu à l’époque les journalistes parisiens, la télé…tout le monde s’est intéressé à la mine. Bon, pour le métier de mineur il était un peu tard. Cet engouement vient de là aussi je pense. Aujourd’hui les gens s’intéressent beaucoup plus à ce qui a été fait que pendant, quand les gens travaillaient. Il y a un exemple tout simple. Aujourd’hui, les lampes de mineurs sont recherchées par beaucoup de gens et à l’époque il y en avait des milliers et les gens ça les intéressait beaucoup moins.
- 101 -
Deux événements ont semble-t-il contribué à accroître fortement la fréquentation. Le
premier, en 1987 (soit 3 ans après l’ouverture !), coïncide avec la reconstitution de galeries en
surface. La fréquentation passe en un an de 41000 à presque 75000 visiteurs, puis atteint
107000 visiteurs l’année suivante. La mémoire de la mine ne devient intéressante qu’à partir
du moment où l’on peut faire semblant de s’y plonger. La reconstitution, si elle participe
évidemment au discours pédagogique, contribue aussi au dépaysement recherché. La descente
simulée devient le summum de l’aventure culturelle. Les entretiens menés par Karine
Girard401 auprès des guides sont intéressants sur ce point : K.G. - Est-ce que vous dites au gens qu’il s’agit d’une simulation ? - Non. Au début, quand j’ai commencé à faire le guide je le disais et
puis après j’ai arrêté, parce que des personnes, étant venues au musée et connaissant déjà la chose, étaient venues avec des amis ou de la famille et quand je leur ai dit dans la cabine que c’était une simulation, ils m’ont dit « Non Monsieur, il ne fallait pas le dire ! ». Donc depuis ce temps là, je ne le dis qu’à la sortie des galeries et c’est mieux. C’est mieux de laisser les gens à leur imagination.
L’autre augmentation significative de fréquentation survient en 1993, après la sortie du
film Germinal de Claude Berri. Le bond est éloquent : de 125000 à 168000 visiteurs en un an,
encore 150000 l’année suivante, pour se stabiliser aux alentours de 125000/an ensuite. Ici
encore, l’intérêt pour la mine est déclenché par la fiction, par l’émotion du cinéma. Les guides
insistent dans les entretiens sur les attentes qu’a suscité le film Germinal chez les visiteurs. De
nombreuses personnes sont venues chercher ou vérifier au Centre ce qu’elles y avaient vu . Ce
dernier est ainsi devenu une sorte de référent commun présidant à l’appréhension de la mine.
La référence au spectacle n’est jamais loin.
Le CHM, s’il réfute catégoriquement aujourd’hui toute idée de « parc d’attraction de
la mine402» en a parfois eu la tentation. La visite du circuit minier s’est d’abord faite dans un
petit train. Celui-ci a été arrêté pour des raisons de sécurité à l’intérieur des galeries mais
401 Monographie de l’école du Louvre, op. cit. 402 Le site minier du Trimbleu en Belgique en est une illustration type ; Cf. annexe n° 22.
Fréquentation du Centre Historique Minier de 1984 à
1997
0
50000
100000
150000
200000
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
années
no
mb
re d
e vi
site
urs
- 102 -
continue d’assurer le transport des visiteurs403, du bâtiment administratif aux bâtiments
d’extraction. Le conservateur a reconnu qu’il s’agissait là d’une concession des Houillères à
la logique d’attraction, sans aucun intérêt historique ou pédagogique. Il sera d’ailleurs bientôt
supprimé. Notons encore la proposition d’un représentant des Houillères au C.A. du 28 juin
1990, suggérant la possibilité de simuler une explosion due au grisou dans les galeries… et
qui fut accueillie avec intérêt par les membres de l’assemblée .
Ces éléments composent la face visible d’un référent « parc d’attraction », rejeté
unanimement aujourd’hui par les acteurs du musée, soucieux avant tout de faire valoir leur
crédibilité scientifique, sa face cachée, moins facilement admise par les acteurs, est
intrinsèquement liée à l’activité muséifiée404.
Comment passer maintenant de l’analyse des motivations des visiteurs à celle de leur
perception du contenu du musée ? Les deux sont nécessairement liées.
Parce que les motivations du départ, les attendus et autres présupposés préexistants
contribuent à orienter l’attention et à forger le jugement, une analyse univoque de la
transmission (valable pour l’ensemble des visiteurs) n’aurait aucun sens. Les livres d’or405 en
témoignent, la diversité dans l’interprétation est la règle. Le contenu du musée donne lieu à
des lectures très diverses ou les prédispositions variables selon les visiteurs jouent l’effet
d’autant de prismes.
Faute d’enquêtes quantitatives et qualitatives406 qui permettraient de les recenser avec
précision, les livres d’or ont été utilisés comme source principale d’information. Leur
utilisation, parce qu’elle pose certains problèmes méthodologiques, nécessite des
éclaircissements. Le problème principal de cette source tient à sa représentativité
potentiellement limitée.
Dans le cas précis, si tous les visiteurs ne remplissent évidemment pas les livres d’or à
leur disposition, la colonne réservée à l’identification des signataires montre qu’une grande
diversité de classes d’âge comme de catégories socioprofessionnelles y figurent cependant. Il
n’est pas rare que les visiteurs soient encouragés par les guides à le remplir dès la sortie. Cette
incitation limite à notre avis les disparités sociales habituellement constatées dans la
participation à ce mode d’expression. Il faut donc prendre cette source pour ce qu’elle est : un
moyen d’aborder la question de la perception des visiteurs, imparfait mais utile pour poser les
jalons nécessaires à une future enquête.
403 Il y a deux cents mètres à parcourir… 404 Voir supra (III.C.1). 405 Cf. extraits du livre d’or en annexe (n°23). 406 Une enquête a bien été réalisée mais nous l’utiliserons avec prudence car elle ne porte que sur 200 personnes et n’a fait l’objet d’aucun échantillonnage préalable.
- 103 -
L’autre spécificité de cette source est qu’elle donne à voir un sentiment marquant, une
impression dominante donnée « à chaud » qui ne résume ou n’épuise probablement pas la
totalité du jugement du visiteur. Le questionnaire s’avère donc, dans une perspective de
recherche approfondie, un complément indispensable. Ajoutons enfin, que notre analyse des
livres d’or fut essentiellement statique. Il aurait fallu, avec plus de temps, analyser l’évolution
des remarques du public en rapport aux événements (nouvelles exposition, ouverture des
galeries reconstituées, fin de l’activité d’extraction dans la Région, Germinal, etc.). Ainsi
pourrait-on peut-être isoler les effets de tel dispositif muséographique ou élément extérieur
sur la perception générale de la mine par les visiteurs.
Car la question essentielle est bien de savoir dans quelle mesure la visite du CHM
influe sur leurs interprétations.
Répétons-le, le musée donne lieu aux lectures les plus diverses. La transmission ne
peut être comparée à un endoctrinement à sens unique, c’est une évidence. Les sources dont
nous disposons montrent cependant la force et la récurrence de certaines thématiques qui
pourraient composer un cadre minimal de la transmission. Le musée contribuant plutôt à
construire des cadres généraux (structurants) de l’interprétation, à l’intérieur desquels le
visiteur garderait une autonomie de jugement certaine, mais sous influence.
D’abord le mode de transmission. Premier point remarquable tiré de l’analyse des
« livres d’or », l’hypertrophie des remarques concernant la visite guidée, au détriment de
celles relatives au reste du musée. Elles montrent, s’il le fallait encore, sa place centrale dans
le dispositif muséographique. Pour beaucoup de visiteurs, la visite du Centre se réduit
quasiment exclusivement à celle des galeries. Le temps imparti pour cette dernière, environ
deux heures, et le rythme des départs, laissent à peine une demi-heure pour visiter les
expositions permanentes. Nous estimons qu’il faudrait au grand minimum deux heures pour
en avoir un aperçu correct. Ainsi, les appréciations des visiteurs ne portent quasiment jamais
sur ces expositions à peine entrevues. Beaucoup de thèmes qu’elles abordent échappent donc
à la plupart. Dans l’enquête réalisée le 12 août 1991 auprès de 200 personnes, il leur a été
demandé ce qu’ils avaient trouvé de plus intéressant dans la visite. La quasi-unanimité a
répondu « les galeries ». L’autre vedette (concomitante) de la visite est le guide. 14 personnes
font spontanément une remarque sur la qualité du guide quand on leur demande si elles ont
quelque observation sur le musée. Un grand nombre de remarques du livre d’or va dans le
même sens, laudatives à l’endroit des guides407. Leur rôle est primordial dans la transmission,
c’est une certitude.
407 Une étude intéressante consisterait à déterminer ce que les visiteurs retiennent réellement de leurs propos (éléments techniques, anecdotes, faits historiques, pittoresque… ?).
- 104 -
Concernant le « transmis » cette fois : La grande majorité des commentaires consignés
dans les livres d’or complimente le musée de façon très générale (« très bien », « visite
attrayante », « remarquable » reviennent le plus souvent ). Jamais les remarques ne portent sur
la qualité même du propos ou sur la justesse historique des éléments proposés. Le regard est
très rarement critique.
De même, c’est souvent un sentiment d’admiration, voire de compassion à l’égard des
mineurs qui prédomine408, ce, au détriment de tout sentiment de révolte ou de dénonciation,
quasiment absents des commentaires. Leurs souffrances sont davantage perçues comme un
sacrifice que comme une injustice. On leur trouve toujours une justification (énergie, progrès,
richesse).
La mémoire ne remet pas en cause le passé, elle le rend admirable. Ainsi, il devient
leçon d’humilité et de courage pour le présent409. C’est peut-être là la plus grande victoire
symbolique des Houillères et dans une moindre mesure des acteurs qui lui ont succédé.
Ecoutons M. Racle, représentant de Charbonnages de France au C.A. du CHM :
408 Cf. annexe n°23.
F.D. - Quelles sont les leçons que la mine et les mineurs nous donnent pour le présent et que pourrait par la même, nous donner le musée de Lewarde ? M. Racle - Ça les leçons on ne les écoute plus. Quand j’ai commencé, il y a trente ans de cela, s’il fallait arrêter au minimum la production, l’ingénieur en tête il faisait trois postes et demi au fond. Maintenant on l’enverrait se faire soigner dans un asile. Les gens iraient aux prud’hommes. Ils peuvent au moins relativiser par rapport à leurs conditions de travail qu’ils exigent et trouvent non encore satisfaisantes. Mais enfin, on peut toujours améliorer. La perfection n’est pas industrielle.
- 105 -
Conclusion
Le Centre Historique Minier de Lewarde revêt de prime abord toutes les valeurs du
sacré. Investi sans ambages de la mémoire de la mine et par la même, de son cortège de
souffrances et de morts, il appelle au recueillement et au respect plus qu’à l’esprit critique.
La mémoire collective dont il se prétend le réceptacle (mémoire captée contre
mémoire construite) devient dès lors une réalité ontologique qui ne pose plus problème mais
qu’il s’agit avant tout de conserver, comme on conserve des reliques menacées de disparition.
Une fois ce coup de force réussi tout discours sur les fondements et les acteurs de cette
mémoire collective devient superflu, voire indécent. La mémoire est naturalisée, réifiée en
objet sacré410.
Notre propos fut, a contrario, de montrer les enjeux complexes et les non-dits que
recouvrait cette entreprise patrimoniale, d’essayer modestement de déchirer le voile. Il ressort
de nos recherches que la mémoire de la mine, pas plus que la création d’un musée de la mine,
ne vont d’amble. Loin d’être le lieu d’un consensus spontané, le musée se révèle le moment
d’un échange inédit entre différentes approches du passé minier et du sens à donner à
« l’œuvre de mémoire ».
Plutôt qu’un miroir tendu411 à une population dans lequel elle reconnaîtrait « son »
histoire, le CHM doit être appréhendé comme un miroir, mais où se réfléchissent les questions
qui se sont posées aux acteurs du bassin minier à différents moments de l’après charbon et
leurs réponses à ces questions. Les débats autour de la fin de l’extraction, l’évolution des
rapports de force entre acteurs, les enjeux de pouvoir locaux, les enjeux identitaires de la
mémoire, les divergences autour de la reconversion et de l’héritage minier (logements, acquis
sociaux) apparaissent en filigrane dans l’édification du CHM. Ils sont autant d’enjeux qui
rejaillissent sur les modalités de l’investissement patrimonial des différents partenaires en
même temps que sur la forme du Centre.
Avant d’être un lieu de mémoire, le CHM est un lieu où se rencontrent (et parfois
s’affrontent) interprétations et usages de la mémoire par les acteurs du territoire, devenus
entrepreneurs de mémoire.
Il est donc un reflet du milieu décisionnel du bassin minier au présent.
410 Pierre Nora (op.cit.) disait à ce propos: « Moins la mémoire est vécue de l’intérieur, plus elle a besoin de repère tangibles ». Ainsi, les lieux de mémoire seraient aussi lieux d’oubli. 411 Cf. II.A.3
- 106 -
Bibliographie
Sur le Centre Historique Minier de Lewarde : - « Création d’un Centre Historique Minier », Archéologia, Déc. 1987. - Girard (Karine), le Centre Historique Minier de Lewarde, monographie de l’école du Louvre, 1996. - Heming (Christophe), Lewarde, Centre Historique Minier, La voix du Nord, 1993, -31p. - « Usines-Musées », Musées et collections publiques de France, revue de l’association générale des conservateurs des collections publiques de France, n°203, 1994. - Thbaut (Louis), « Un monument d’archéologie industrielle : le centre historique minier des Houillères Nord-Pas-de-Calais à Lewarde », in revue du Nord, n°241, avril-juin 1979. Sur la mémoire collective : - Benguigui (Yamina), Mémoires d’immigrés, l’héritage maghrébin, Paris, Canal + Editions, 1997, pp. 34-42. - Candau (Joël), Anthropologie de la mémoire, Paris, PUF, collection Que sais-je n°3160, 1996. - Collovald (Annie), Sawicki (Frédéric), « Le populaire et le politique (1) : quelques pistes de recherche » in Politix, n°13, 1er trimestre 1991, Presse de la Fondation Nationale des Sciences Politiques. - De Certeau (Michel), écrit en collaboration avec Dominique Julia et Jacques Revel, « La beauté du mort » in La culture au pluriel, pp. 45-72, Paris, Seuil, 1993 (1ère édition : La beauté du mort : le concept de « culture populaire », in Politique aujourd’hui, déc. 1970). - Gasnier (Thierry), « La France commémorante », Le débat, n°58, janvier 90. - Halbwachs (Maurice), Les cadres sociaux de la mémoire, Paris-La Haye, Mouton Editeur, 1976 (1ère édition, Paris, librairie Félix Alcan, 1925). - Hobsbawm (Eric), The invention of tradition, Cambridge, Cambridge University Press, 1992 (1ère édition 1984). - Noiriel (Gérard), « Le pont et la porte, les enjeux de la mémoire collective », Traverses, n°36, Janvier 1986. - Ouvriers, ouvrières un continent morcelé et silencieux, série mutations n°126, Paris, Ed . Autrement, 1992. - Ponty (Janine), Les Polonais du Nord ou la mémoire des corons, Paris, Ed. Autrement, 1995, -123p. - Pudal (Bernard), Le populaire à l’encan, Politix, n°14 Le populaire et le politique (2), 2eme trimestre 1991, pp.53-64, Presse de la Fondation Nationale des Sciences Politiques. Sur la notion de patrimoine: - Cuisenier (Jean), « Que faire des Arts et traditions Populaires ? », Le débat, mai-août 1992 (numéro spécial sur me patrimoine), p.156-167.
- 107 -
- Entretien avec Françoise Cachin, « Musées : du patrimoine à l’éducation », Le débat, avril-juin 1998, numéro spécial sur le patrimoine, pp. 94-112. - Choay (Françoise), L’allégorie du patrimoine, Paris, Seuil, 1992. - La muséologie selon Georges-Henri Rivière (cours de muséologie/ textes et témoignages), Paris, Ed. Dunod, 1989, p.142, cité par Jean Yves Andrieux, Le patrimoine industriel, Paris, PUF, collection Que sais-je ? n°2657, 1992. - Jeannot (Gilles), « Tisser des liens patrimoniaux », Genèses II, Mars 1993, pp. 5-24. - Jeudy (Henri-Pierre), Patrimoines en folie, Paris, Ed. de la Maison des sciences de l’Homme, Cahiers, collection ethnologie de la France, 1990. - Guillaume (Marc), « Invention et stratégies du patrimoine », in Jeudy (Henri-Pierre), Patrimoines en folie, Paris, Ed. de la Maison des sciences de l’Homme, 1990, pp. 13-21. - Lamy (Yvon), « Patrie, patrimoines », Genèses II, mars 1993, p. 2-4. - Léniaud (Jean Michel), « La mauvaise conscience patrimoniale », Le débat, n°65 (numéro spécial sur le patrimoine), mai 91. - Leniaud (Jean Marie), « Nation et patrimoine », Revue Administrative, n°285 et 286. - Martin (Jean-Clément), Suaud (Charles), « Le Puy du Fou », Actes de la recherche en sciences sociales, 93, juin 1992, pp. 21-37. - Martin (Jean-Clément), Suaud (Charles), Le puy du Fou, en Vendée ; l’histoire mise en scène, Paris, L’Harmattan, 1996. - Poulot (Dominique), « Le patrimoine des musées : pour une rhétorique révolutionnaire », Genèses II, mars 1993, p. 25-49. - Querrien (Max), Pour une nouvelle politique du patrimoine, Rapport au ministre de la Culture, Paris, La documentation Française, 1982, p.6-9, in J.Y. Andrieux, Le patrimoine industriel, Paris, PUF, collection Que sais-je ? n°2657, 1992.
Sur le patrimoine industriel : - Andrieux (Jean-Yves), Le patrimoine industriel, Paris, PUF, collection Que sais-je ? n°2657, 1992 - Baudelle (Guy), « L’enjeu patrimonial dans les bassins houillers d’Europe », Les Annales de la Recherche Urbaine n°72, dossier spécial patrimoine et modernité ». - Bergeron (Louis), Le patrimoine industriel, un nouveau territoire, Paris, Ed. Liris, 1996. - Bergeron (Louis), « L’âge industriel », in les lieux de mémoire (dir. P. Nora), La France III, emblèmes, Paris, Gallimard, 1986 - Kourchid (Olivier), « la mémoire de la mémoire : quatre initiative de conservation du patrimoine minier dans le bassin Nord-Pas-de-Calais », in Sciences sociales, industries techniques et cultures professionnelles, bulletin de l’IFRESI, n°3-4, décembre 1997, pp. 9-35 - Musées et sociétés, Actes du colloque national musées et sociétés Mulhouse-Ungersheim, juin 1991 - Patin (Valéry), « Tourisme et patrimoine », notes et études documentaires, n°5059, Sept. 97, pp. 39-42
- 108 -
Sur la mine ou le Bassin Minier : - Baudelle (Guy), « Le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais après le charbon : la difficile gestion de l’héritage spatial », in Hommes et Terres du Nord, 1994-1, pp. 3-12. - Bruyelle (Pierre), « Le pays minier existe-t-il encore ? », in Hommes et Terres du Nord, 1994-1, pp. 48-54. - Caron (Estelle), images sociales : le travailleur de la mine, séminaire de D.E.A. « le documentaire français (1945-1955), Université Paris III, U.F.R d’Etudes Cinématographiques et Audiovisuelles, 1995. - Compte-rendu de l’atelier « mémoire-mobilisation-transmision », conférence permanente du bassin minier, conseil Régional, 1997. - Des villes et des Hommes, le devenir de l’ancien Bassin Minier, Préfecture du Nord-Pas-de-Calais, SGAR (centre d’études et de prospectives), 1995. - Michel (Joël), La Mine dévoreuse d’Hommes, Paris, Gallimard, 1993.
- 109 -
Plan des annexes :
1) Vues générales du site de la fosse Delloye. Photos K. Girard.
2) Plan du site. Document Centre Historique Minier.
3) Avant-propos du projet de réhabilitation de la fosse Delloye par H. Guchez,
architecte. Archives du CHM ; 1980.
4) Note d’information sur le patrimoine industriel par M. Chartier (EHESS) ; 1978.
5) Note transmise par Jocelyn De Noblet au CHM, dans le cadre de son étude sur le
patrimoine industriel, commandée par le ministère de l’Industrie. Archives du CHM ;
1978.
6) Lettre de mission du Délégué à l’Aménagement du Territoire à Yves Malecot,
président du CILAC, sur la culture scientifique et technique et la mise en réseau du
patrimoine industriel. Archives du CHM ; nov. 1978.
7) Schéma possible pour la création de l’association du CHM par le service Relations
Publiques des Houillères. Archives du CHM ; juin 1978.
8) Réponse de Marcel Barrois, Secrétaire Général de l’Union des syndicats mineurs,
similaires et retraités CGT, à la demande de désignation d’un représentant au C.A.
par le Président de l ‘Association du CHM. Archives du CHM ; déc. 1982.
9) Lettre d’un chargé de mission de la Préfecture de Région à l’attention du Président
de l’Association du CHM. Archives CHM ; mai 1983.
10) Note « musée de la mine », adressée par un chargé de mission de la Préfecture
au Préfet de Région. Archives du CHM ; déc. 1977.
11) Question du Député Marc Dolez au Ministre de la communication et de la culture.
Extrait du journal officiel, Assemblée Nationale ; séance du 12 novembre 1997.
12) Historique de la fosse Delloye et du CHM. Document du CHM.
- 110 -
13) Allocution de Jacques Ragot, Président du C.A. des HBNPC lors de la première
réunion du C.A. de l’association du CHM. Archives du CHM ; juil. 1982.
14) Proposition d’exposition par M. Lempereur, représentant la CFDT au C.A. de
l’Association du CHM. Archives du CHM ; 1989.
15) Articles « Le tourisme industriel intéresse de plus en plus de vacanciers » et « le
Nord-Pas-de-Calais exploite le filon ». Le Monde ; 18 juillet 1996, L’usine nouvelle ; 3
juillet 1997.
16) Lettre adressée aux entrepreneurs de la Région par la Conférence Permanente
des Chambres de Commerce et d’Industrie Françaises et Belges. Archives du CHM ;
1978.
17) Maquette de l’exposition permanente. Archives du CHM ; 1988 ( ?).
18) Extrait de l’entretien réalisé par Yamina Benguigui (pp. 34-42). Mémoires
d’immigrés, l’héritage maghrébin, Paris, Canal + éditions ; 1997.
19) Prospectus de présentation du CHM, à destination du public. Document du CHM.
20) Rappel des principales étapes de développement du CHM. Document du CHM.
21) « Article » publicitaire sur le CHM. Le Galibot (Edition Béthune) ; 28 mars 1988.
22) Extrait d’un dépliant publicitaire sur le site minier du Trimbleu en Belgique.
Bibliothèque de la DRAC Nord-Pas-de-Calais.
23) Extraits choisis des livres d’or. Août 87-juillet 88, 95-97.
24) Article sur l’inauguration du musée de la mine de Bruay. La Voix du Nord (page
Bruay-La-Buissière) ; 6 décembre 1989.
25) Article sur l’association « Mémoire et Culture », La Voix du Nord ; 10 mars 1995.
26) Grilles d’entretiens.
- 111 -
Extrait de Mémoires d’immigrés, l’héritage maghrébin1.
Abdel, agent de fond :
« Là-bas, au pays, j’étais ouvrier agricole, je faisais les travaux des champs, mais ce n’était pas régulier comme activité, alors quand j’ai entendu dire qu’il y avait quelqu’un qui allait venir recruter des gens pour venir travailler en France, dans les mines, j’ai décidé de me présenter (…). Le recruteur m’a tendu la main et je lui ai souri. Ensuite, il m’a serré la main longuement, d’une drôle de façon. Je n’ai su que longtemps après ce que signifiait cette façon de serrer la main. Si la main était calleuse, c’était bon pour la mine et le recruteur nous mettait sur la main un tampon vert. (…) Le recruteur très sympathique, a averti tous ceux qui avaient une bonne santé que l’entreprise allait s’occuper de tout, du contrat d’un an, du transport, de l’arrivée, du logement gratuit avec électricité gratuite et même du billet pour le retour (…). Le jour même de mon arrivée, ici, le contremaître m’a dit : Abdel tu seras abatteur2. (…) Le logement, je ne l’ai vraiment découvert que la nuit, en revenant de la mine. On m’a appris que c’étaient d’anciens baraquements, que les allemands avaient construit pendant la guerre pour y mettre des prisonniers. Nous étions six par chambre. (…) J’ai continué à faire l’abatteur mais j’étais de plus en plus fatigué. Un jour au bout d’un an, j’ai eu un accident. (…) Un mois d’hospitalisation et huit mois de convalescence. Le recruteur a été le seul à me rendre visite. Quand il est rentré dans la chambre, il m’a dit : « Maintenant, comme l’indique ton contrat, l’entreprise ne peut employer ni les accidentés du travail, ni les malades. Ton contrat se termine dans six mois. Tu ne peux pas rester, tu vas repartir au Maroc. » Je ne l’écoutais plus. Je me suis souvenu du jour où il y a eu une grève, organisée pour la CGT, pour protester contre les accords pris avec le Maroc au sujet des contrats de 18 mois. Dix-huit mois, c’était juste le temps nécessaire pour être rongé par la silicose ou être atteint de surdité. Sans qu’il connaisse son état, le mineur immigré était renvoyé au pays. A l’époque, je n’avais pas insisté, surtout que le représentant de l’Amicale des Marocains était venu spécialement à la Houillère et il avait dit à l’intention des grévistes : « Vous êtes venus pour travailler, pas pour faire des manifestations, ni des grèves ! ».
(…) Je n’avais pas eu le temps de repenser à tout ça mais après j’ai eu le temps. Et je me suis aperçu, petit à petit, qu’il y avait beaucoup de différences avec les camarades mineurs français de souche. Pour nous, il n’y avait ni droits, ni pension de retraite ou d’invalidité. »
1 Benguigui (Yamina), Mémoires d’immigrés, l’héritage maghrébin, Paris, Canal + Editions, 1997, pp. 34-42. 2 Travail consistant à abattre le charbon. L’un des plus pénibles et des plus dangereux au fond (silicose).
- 112 -
morceaux choisis des livres d’or :
Août 87-juillet 88
- Bravo pour cette historique d’une vie ouvrière si pénible, qu’il est bon de ne pas oublier. - Plus de lumière dans la mine. - Heureuse de connaître enfin la mine. Je suis fille, petite fille de mineur. - Visite formidable, beaucoup d’émotions et quel courage pour y travailler. - Petit tour en train très appréciable. - Visite très appréciable. On ne parle pas assez de la vie du mineur. - Petite fille de mineur : surtout ne jamais oublier ce qui fit la richesse de notre pays. - Musée exceptionnel. Très rare en France. Manque de fossiles miniers. - Très belle reconstitution. Agent de maîtrise retraité. - Visite très intéressante. A mon goût un peu trop technique quand on est pas du métier. - Regrettons que ne soit pas évoquée la dure vie du mineur. - Visite intéressante, mais le vocabulaire employé par le guide dans la galerie est difficile à comprendre pour des gens non initiés. - Ce serait mieux de descendre dans le puits. - Excellente initiative. C’est toute l’histoire d’une région et ses caractéristiques qui sont mises en valeur. - Que de chemin parcouru et que de souffrances, sans doute. Ingénieur de sécurité. - Très belle visite, très enrichissante, qui peut permettre à l’homme d’aujourd’hui de réfléchir sur les conditions de travail d’autrefois. - La modernisation oublie les exploits du temps passé. - L’éloquence du cœur, la précision des explications nous ont permis de mieux découvrir, comprendre, admirer le dur et merveilleux métier de mineur. - Si l’objectivité dans les discours et si la place réservée à la vie du mineur, ses problèmes, étaient respectés comme il se doit, la visite serait plus intéressante. Ils ont travaillé à la mine, oui. Mais dans des bureaux. - Trouvé merveilleux ces vestiges d’un passé révolu mais tellement évocateur du travail effectué par ces géants de la mine. - J’ai pu revivre le calvaire de mes grands-parents au fond. - Ce musée nous oblige au recueillement. La dure vie du mineur est retracée dans toute sa véracité. Pour eux, pour que subsiste le souvenir de leur dure contribution à notre confort, poursuivez dans la voie que vous avez choisie en faisant vivre ce centre. - Très bien surtout la galerie en surface. - Le Centre Historique Minier mérite d’être connu car il reflète la vie du mineur, son dur labeur, sa sueur pour gagner la vie du foyer et de ses enfants. - Visite agréable, métier du métier admirable. - Pourquoi ne pas reconstituer aussi l’intérieur d’une maison de mineur ? - Très intéressante visite. Dommage que le guide ne fasse pas une visite entière du Centre. - Vous avez préservé un peu de cet horrible et merveilleux à la fois outil de travail. - J’ai apprécié la reconstitution et la visite de la mine. - Nous avons apprécié la visite mais ne pensions jamais que les conditions pouvaient être aussi dures. - Nous avons touché de près la dure vie des mineurs. - Nous avons compris que ce métier était très pénible. Quel amour pour leur profession. - Très intéressée et impressionnée par cette visite. Rend un légitime hommage à la corporation des mineurs dont elle a pu mesurer le courage, l’amour du travail bien fait, allié à une grande solidarité humaine. - Musée qu’il fallait faire pour conserver la mémoire d’une région. N’existe que par la présence d’anciens mineurs.
- 113 -
95- 97 - L’honneur dans le travail. Dure mais belle époque. A faire voir absolument à tous nos jeunes. - Beaux souvenirs, belle reconstitution. Que notre jeunesse était belle. - J’ai été très émotionnée par le travail de tous ces courageux mineurs. - Cette visite nous oblige au respect pour ce dur métier et nous fait prendre conscience du courage du mineur. Un souvenir inoubliable de notre passage et de l’amour du métier que nous a fait partager notre guide. - Reconstitution intéressante et enrichissante. Bonne initiative d’avoir engagé des anciens mineurs en tant que guides. Permet de bien comprendre la visite et surtout le vécu au fond. - La souffrance de l’être humain est terrible. - Très intéressante visite avec un guide authentique. - Visite très intéressante. Plus réaliste et moins romancée que Germinal. - Le site de Lewarde est comparable à ceux relatifs à la souffrance des Hommes. Non pas dans ce que l’homme peut faire de plus horrible (la guerre), mais dans un travail, certes très pénible, mais salutaire et bénéfique à tous. On peut appeler ce site un site « de souffrance humaine industrielle ». - Moi et ma femme nous sommes très heureux d’avoir venu aux centre minier de Lewarde que j’ai trouvé formidable, étant pas mineur mais beaucoup compris la soufrance de ces gens mineurs car le Monde est très personnel et égoiste.