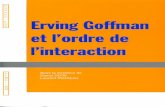REPRESENTACIÓN DE LENGUAJES DE PATRONES DE ANÁLISIS DE DOMINIO
Aperçu historique. Les couvents de l'Ordre Libanais maronite, Province de Jbeil et de Batroun.
Transcript of Aperçu historique. Les couvents de l'Ordre Libanais maronite, Province de Jbeil et de Batroun.
1
Province de Djoubail et Batroun
[2] Chapitre I
Article I : Ordre Baladite ou Libanais.
Province de Djoubail et Batroun
L’émir musulman, Joseph Chehab, gouverneur de cette région fit don à l’Ordre Baladite en 1762, par un acte légal, des couvents ruinés de Notre Dame de Meifouq, de Houb, de Kefifan, de l’Antoche de Djoubail ainsi que des églises situées soit au-dedans soit au dehors des remparts de cette ville et de plusieurs propriétés. Il fit cette donation par l’intermédiaire de Saad El Khouri et Simaan Bittar, ses hommes d’affaires, afin de repeupler la province de Djoubail et Batroun que la plupart de ses habitants maronites avaient abandonnée pour échapper aux vexations qui leur venaient de la part de Métoualis maitres du pays.
Les moines commencèrent à mettre ces propriétés en culture au prix de beaucoup de travaux et de peines. Grâce à leur influence et à leur protection les maronites, prenant courage, vinrent se fixer autour des monastères. Les moines eurent aussi beaucoup à souffrir de la part des Métoualis qui à différentes reprises massacrèrent plusieurs d’entre eux et pillèrent les couvents. Avec une grande générosité ils cédèrent aux maronites qui venaient s’établir autour d’eux une grande partie des propriétés qu’ils avaient reçues de l’émir. Le Patriarche d’alors et l’Evêque diocésain ratifièrent de grand cœur les donations faites par l’émir à l’Ordre.
2
1° Covent de St Antoine à Hoube près Tannourine
Diocèse patriarcal.
Ce couvent fut donné à l’Ordre par l’émir Chehab en même temps que ceux de Kefifan, Meifouq, etc…
Le couvent et l’église ont été reconstruits en 1901. Le couvent forme un carré régulier avec 2 côtés à cloître fermé. Les chambres sont fort convenables, quelques unes vastes, bien éclairées, le tout de bien goût et bien tenu.
L’église de style libanais ordinaire a trois beaux autels en marbre, le maitre autel dédié à St Antoine le Grand, l’autel latéral droit à St Michel et l’autel latéral gauche à la Ste Vierge. Elle est pavée aussi en marbre, l’une des églises les plus propres et les plus convenables du Liban.
Les ornements sont convenables et bien tenus en général, mais portant beaucoup de tâches de cire et quelques déchirures çà et là. Ils sont rangés dans un très beau meuble placé dans l’église. Pas de sacristie.
Les vases sacrés sont irréprochables.
Les messes paraissent célébrées avec dignité et recueillement par les prêtres du couvent.
La communauté se compose de 25 religieux, y compris 2 Ermites, dont 10 Pères et 15 Frères.
La propriété dont la plus grande partie est attenante au couvent et abondamment arrosée par plusieurs sources, comprend des champs de muriers nourrissant 700 drachmes de vers à soie et représentant une valeur de 1.400.000 piastres ;
3
des vignes, terrains de culture, oliviers, moulins de valeur de 1.000.000 piastres.
Valeur totale : 2.400.000 piastres.
Relevé des comptes pour la période : 19 novembre 1904 à 19 août 1908 :
Recettes 274965 Dépenses 508.990.20
Déficit 34025.20 308.990.20
308.990.20
A ce déficit il faut ajouter une dette précédente vis-à-vis de Ibrahim Khouri de 33.000 piastres ce qui porte le montant des dettes du couvent de Houb à la somme de 67.025 piastres 20 paras. Mais le couvent a encore à percevoir comme rentes pour l’année 1908 environ 18000 piastres des affermages de jardins et autres. De plus le couvent a des créances à recevoir pour la valeur de 11.634 piastres 30 paras.
4
2° Couvent de St Chellita à Quettara
En 1848 en vertu d’une décision prise par le conseil généralice le Père Emmanuel Chebabi Général détacha un tiers des propriétés du couvent de Meifouq pour ériger un couvent sous le vocable de Mar Chellita dans l’endroit appelé El Quettara. Son successeur dans la charge de Général le Père Laurent Chébabi fit ériger les bâtiments tels qu’ils sont actuellement.
Le couvent présente un ensemble de constructions très régulières avec rez-de-chaussée et un étage, et cloître sur trois côtés, dont un est fermé. L’ordre et la propreté y règnent sans luxe.
L’église, assez vaste et solide construction, est dédiée à Saint Chellita, pavée en pierre, avec trois autels en bois, dont le principal est dédié à St Chellita, l’autel latéral droit à la Ste Vierge et l’autel latéral gauche à la Ste Famille. Les pierres d’autel sont en bois fixé. Le tout en bon état et propre.
Pas de sacristie ni de confessionnal. Les femmes ne fréquentent pas l’église qui n’a pas de porte extérieure.
Tous les ornements sont en bon état, quelques uns en drap d’or et d’argent assez remarquables, grand nombre de calices et généralement beaux. Deux vieux calices qui servent au commun des religieux ne sont pas dorés à l’intérieur. Nous avons donné l’ordre qu’on les fasse redorer.
On y conserve un reliquaire à colonnes avec une relique insigne de la Vraie Croix au milieu.
5
Comme situation, construction, mobilier, climat, ce couvent est un des meilleurs de l’Ordre Baladite. De plus son état financier qui est assez florissant sans dettes révèle une assez bonne administration, supérieure à celle de la plupart des autres couvents, bien que le Supérieur soit d’une ignorance et simplicité excessives.
A un quart d’heure du couvent on trouve l’ermitage, construction assez simple avec une petite chapelle bien tenue et fréquentée par les personnes qui vont recommander aux prières de l’Ermite, et à côté de l’ermitage un petit enclos planté en vigne que cultive l’Ermite.
La communauté comprend 16 religieux dont 7 Pères, parmi lesquels un ermite, et 9 Frères.
La propriété représente une valeur de 1.600.000 piastres pour les mûriers qui nourrissent 800 drachmes de vers à soie ; et de 800.000 piastres pour les vignes, oliviers, terrains de culture, moulin et forêts. Valeur totale : 2.400.000 piastres.
Comptes du couvent du 28 novembre 1904 au 30 août 1908 :
Recettes 212034.35 Dépenses 187179.30
Reste un actif de
24855.05
212034.35 212.34.35
Note : Une accusation, qui paraît assez fondée, a été avancée par plusieurs religieux contre le Père Ioussaf Provincial et Supérieur effectif du couvent de Quettara, à
6
savoir qu’il fait des dépenses considérables en faveur de sa famille et en cadeaux au Patriarche, aux évêques et aux notables.
Selon les calculs qui nous ont été présentés par le Père Georges de Djadj, intendant des propriétés, le montant des recettes annuel ne serait pas moins de 56930 piastres et le montant des dépenses annuelles ne dépasserait pas 40688 piastres. Il résulterait de ces statistiques que l’actif du couvent au 30 août 1908 devrait s’élever à 65048 piastres au lieu de 24855 piastres. S’il ne se produisait pas de gaspillage et de jeu dans les comptes.
7
3° Couvent de Mar Iacoub El Hosson
En 1859 en vertu d’une décision prise par le Père Général Laurent Chebabi et son conseil les terres de ce couvent furent détachées de celui de Houb dont elles étaient la propriété et on y érigea un couvent sous le vocable de Mar Iacoub de Nisibe. Le but de cette fondation était de secourir les maronites vivant à Douma et dans les villages voisins au milieu d’une population non catholique. Le Général agrandit la propriété du couvent par des achats subséquents.
Le couvent est situé dans un emplacement très salubre. Le climat y est tempéré. Les bâtiments forment un carré selon le style ordinaire des Khans, avec rez-de-chaussée et un étage. Les cellules sont de petites dimensions. L’ordre de la propreté y laisse à désirer.
L’église occupe un côté du carré, elle est de dimensions moyenne, bâtie il y a quelques années, pavée en marbre, avec autel en pierre dédié à St Jacques. Le S. Sacrement n’y était pas conservé jusqu’à l’époque de la Visite.
Les ornements et vases sacrés sont en mauvais état et rangés sans ordre dans un placard placé dans l’église. La propreté des linges d’autel est très négligée.
La communauté ne comprend que 2 Pères et 3 Frères.
La propriété qui est en général très négligée se compose de champs de mûriers nourrissant 70 drachmes de vers à soie et représentant une valeur de 140.000 piastres ; en
8
plus des vignes mal soignées, forêts et terrains de culture valant 300.000 piastres. Valeur totale : 440.000 piastres.
Comptes du triennat 1901-1904 :
Recettes 257.824 Dépenses 248056.25
Déficit 10211.25
248035.25
Le déficit a été couvert par le Supérieur sur son avoir personnel. Quant aux ventes faites par le Père Emmanuel Zouki et les irrégularités des comptes voir le procès relatif à ce Père.
9
4° Couvent des SS. Sergius et Bacchus à Qortaba
En 1815 les habitants de Qortaba se rendirent à Tamiche et prièrent le Père Ignace Blaibel Général de l’Ordre d’accepter un legs pieu consistant en une église et dix charges de feuilles de mûriers pour pourvoir à leur besoin spirituels et ouvrir une école pour l’éducation de leurs enfants. L’offre fut acceptée et le Général se rendant à Qortaba rédigea en présence de l’Evêque diocésain Mgr Germanos Tabeth l’acte officiel d’acceptation. On érigea immédiatement une résidence qui fut placée sous la direction du Père Bernard Dobayé et on organisa une confraternité pour le village. Le Général acheta aux Métoualis pour ce couvent des terres pour la valeur de 359500 piastres qui forment la propriété actuelle de ce couvent.
Les revenus de la maison étant devenus suffisants pour l’entretien d’une communauté la maison fut érigée en couvent régulier et les bâtiments qui existent actuellement furent construits en 1823.
Les moines eurent beaucoup à souffrir à différentes reprises de la part des Métoualis qui leur causèrent de graves dégâts en incendiant le couvent, coupant les arbres etc.
Le couvent de Qortaba, comme la plupart des couvents du Liban, est formé par un carré de bâtiments ayant un rez-de-chaussée et un étage qui se termine en terrasse, avec une cour au centre. Au rez-de-chaussée se trouvent la cuisine, le réfectoire, le cellier, la cave, pièces assez spacieuses et convenables. L’étage comprend une vingtaine de cellules assez petites mais suffisantes.
10
L’église, de dimension moyenne et de style très ordinaire, a 3 autels dont le principal en marbre. Pas de sacristie. Les ornements et vases sacrés sont en nombre suffisant mais rangés en désordre dans des tiroirs étroits. La propreté y laisse beaucoup à désirer, on se sert longtemps des mêmes linges sans les faire laver.
La communauté se compose de 15 religieux dont 8 Prêtres et 7 Frères Convers.
Les propriétés du couvents de Qortaba et de la résidence de Kafr Haial représentent une valeur de 1.600.000 piastres pour les mûriers qui nourrissent 800 drachmes de vers à soie, et de 1.000.000 piastres pour oliviers, vignes, terrains à semer, etc. Soit un total de 2.600.000 piastres.
Relevé des comptes pour le gouvernement du Supérieur actuel c'est-à-dire du 1er novembre 1905 au 23 septembre 1907 :
Recettes 80.728.30 Dépenses 85.480.25
Reste donc un déficit de 4.751 piastres 35 paras qui, selon les dépositions reçues à Qortaba doit être imputé à l’administration irrégulière du Supérieur. La moyenne annuelle des recettes est de 43.900 piastres d’après les comptes présentés par le Supérieur.
11
5° Couvent de St Maron à Annaia
En 1814 Joseph et David d’Ehmedj donnèrent au Père Ignace Blaibel Général l’ermitage des SS. Pierre et Paul qui subsiste encore non loin du couvent. Le même Général acheta des propriétés considérables dans le voisinage aux Cheiks des Métoualis qui peuplaient toute cette région, pour la valeur de plus de 200.000 piastres. Il construisit une partie du couvent de St Maron pour le bien et l’avantage de la religion et en particulier des Maronites de ce pays. Il réserva une somme importante pour achever la construction du couvent, travail qui fut effectué sous le Père Emmanuel Chebabi Général. La religion catholique a été affermie par cette fondation et s’est développée dans la région.
Le couvent est de même style que Qortaba, bâtiments simples et vieux se terminant en terrasses. Les cellules sont petites mais assez propres.
L’église bien située sur un côté du carré dans une situation élevée, est à une seule nef, très propre et peinte à neuf. Il s’y trouve 3 autels en bois avec pierre d’autel en bois fixé, le maître autel dédié à St Maron, le second à la Ste Famille et le troisième à St Georges. L’ornementation des autels est de très bon goût.
Pas de sacristie. Les ornements et les vases sacrés sont en bon état et bien rangés dans deux meubles assez grands placés dans l’église. Le Sacristain est intelligent et a à cœur la propreté.
Les huiles saintes sont conservées avec soin, comme dans toutes les églises, dans des boites en fer blanc.
12
Le pavé de l’église est en pierre très convenable. Un clocher qui contient deux cloches superposées surmonte l’église, il a été construit par le Supérieur actuel.
C’est une des églises les plus propres et les mieux tenues que nous ayons trouvés chez les Baladites.
La communauté se compose de 22 religieux y compris 2 ermites, dont 11 Pères et 11 Frères Convers.
La propriété représente une valeur de 1.600.000 piastres pour les mûriers qui nourrissent 800 drachmes de vers à soie, et de 1.200.000 piastres pour les oliviers, vignes et terrains à semer. Total de la valeur : 2.800.000 piastres.
Comptes pour le triennat de novembre 1904 au 26 septembre 1907 :
Recettes 22.433.15 Dépenses 138.998.30
L’actif de 90.434 piastres 25 paras, résultat de la balance du trimestre, a été consacré à l’amortissement des dettes laissées par les Supérieurs précédents.
Comptes pour la période du 26 septembre 1907, 8 septembre 1908.
Recette 59.216.35 Dépenses 60.165.05
Reste un déficit de 948 piastres 10 paras. Au 8 septembre 1908 le couvent de St Maron est encore obéré d’une dette de 100.000 piastres.
13
6° Couvent de Notre-Dame à Meifouq
Le couvent fut donné à l’Ordre en 1762 par l’émir Joseph Chehab comme il a été dit plus haut. Il a été rebâti à neuf depuis une vingtaine d’années par les différents Supérieurs qui se sont succédé à Meifouq d’après un plan assez grandiose. Il comprend 4 ailes de bâtiments avec une cour au centre, de vastes corridors voutés, des chambres spacieuses à grandes fenêtres, le tout bien conçu et bien proportionné. La propreté et l’ordre y sont bien observés. C’est le plus beau couvent de l’Ordre au point de vue de la structure. La seule chose qui y manque c’est l’église. Une pièce du couvent sert de chapelle provisoire en attendant qu’on mette à exécution le projet qu’on a de bâtir une église à côté du couvent.
Tous les travaux ont été exécutés avec les épargnes faites sur les revenus du couvent et sans contracter aucune dette.
Depuis quelques années on y a installé un scolasticat pour les étudiants de l’Ordre.
La communauté se compose de 48 religieux dont 11 Père, y compris un ermite, 22 Frères Convers et 15 étudiants.
La propriété du couvent comprend des champs de mûriers qui nourrissent 2000 drachmes de vers à soie et représentent une valeur de 4.000.000 piastres, des oliviers, vignes, terrains de culture et immeubles de la valeur de 1.400.000 piastres. Total : 5.400.000 piastres.
14
Comptes pour la période du 28 novembre 1904 au 4 septembre 1908 :
Recette 447.574.25 Dépenses 412.820.30
Il reste donc au 4 septembre 1908 un actif de 34.753 piastres 35 paras.
15
7° Couvent de St Cyprien à Kefifan (Diocèse patriarcal).
L’Ordre Baladite reçut ce couvent de l’émir Chehab en même temps que ceux de Meifouq, Houb etc.
Ce couvent est bâti au complet sur un plan régulier formant un carré parfait avec l’église.
L’église, érigée sous le vocable de St Cyprien martyr, est assez petite mais décorée avec goût, avec 3 autels et le pavé en marbre. Tous ces embellissements ont été exécutés, ainsi que la restauration d’une partie du couvent, par le Père Ignace Tannourine lorsqu’il était Supérieur de ce couvent.
Le maître autel est dédié à St Cypren et Ste Justine, l’autel latéral droit au Sacré Cœur et l’autel latéral gauche à N.D. des sept Douleurs.
Près de l’église, au rez-de-chaussée du couvent on a disposé une chapelle dont la porte donne à l’extérieur, avec un autel consacré à la Ste Vierge, contenant le tombeau du Père Naamtalla Hardini, mort il y a 50 ans, dont le corps conservé intact, est un objet de vénération et de pèlerinage dans le pays.
Le couvent avec une aile ancienne entourée d’un cloître peut loger 50 religieux. En entassant les Novices dans dortoirs le Père Ignace Tannourine avait fait de la place pour 75 religieux qu’il entretenait convenablement des revenus du couvent.
L’église et le couvent ont conservé un air de propreté dû aux travaux du précédent Supérieur, mais bien des détails accusent la négligence de l’administration actuelle. Ainsi les
16
nappes d’autel manquent de propreté, le ciboire contenant les Stes Espèces est en mauvais état à l’intérieur et à l’extérieur.
Le principal noviciat de l’Ordre Baladite se trouve dans ce couvent depuis un certain temps.
La communauté comprend 12 religieux dont 6 Pères et 6 Frères, et en plus 12 Novices.
La propriété comprend des champs de mûriers nourrissant 350 drachmes de vers à soie et représentant une valeur de 700.000 piastres, en plus des champs de culture, oliviers, vignes, forêts, etc. ayant une valeur de 1.000.000 piastres. Valeur totale : 1.700.000 piastres.
Comptes du 18 novembre 1904 au 30 septembre 1907 :
Recettes 140.409.25 Dépenses 12.641
Reste donc un actif de 14.768 piastres 25 paras.
Comptes du triennat sous le supériorat du Père Ignace Tannourine du 19 novembre 1901 au 13 septembre 1904 :
Recettes 130.482.20 Dépenses 126.178.
Reste un actif de 4.304 piastres 20 paras.
Il faut noter que pendant le triennat du Père Ignace Tannourine la communauté compta en moyenne 55 religieux, tant profès que Novices. Pendant une période de temps elle compta jusqu’à 75 religieux.
Pendant ce triennat furent accomplis des travaux importants, tels que réparations, construction d’autels en marbre, pavage de l’église et du couvent, construction d’une grande citerne.
17
8° Couvent de St Abda à Maad
Le Père Marc El Kafahi Général avait acheté pour l’Ordre une propriété à Maad. Les religieux y fondèrent en 1795 un couvent auquel fut annexée une école pour les enfants du village.
Le couvent est situé sur le sommet d’une colline. Bien que la position en paraisse salubre les religieux se plaignent de la violence du vent et de l’humidité.
Les bâtiments formant un carré avec une cour au centre sont très simples, érigés d’après le style ordinaire des khans. Ils comprennent un rez-de-chaussée affecté aux salles communes, telles que le réfectoire la cuisine, ainsi qu’au cellier, à la cave et aux écuries ; au dessus un étage partagé en cellules de petites dimensions avec un corridor du côté de l’intérieur. La propreté et l’hygiène y sont négligées.
L’église est en rapport avec le couvent, de petite dimension, pavée en pierre, avec deux autels sont le principal, dédié à Saint Abda, en plâtre sculpté, est l’ouvrage d’un religieux artiste du couvent qui confectionne aussi des statues.
Les ornements et vases sacrés sont en nombre suffisant, mais rangé sans ordre dans des placards à tiroirs étroits placés dans l’église même.
La communauté compte 15 religieux dont 9 Père et 6 Frères.
La propriété représente une valeur de 1.000.000 piastres pour les mûriers et de 900.000 piastres pour oliviers, terrains de culture et immeubles : total 1.900.000 piastres.
18
Relevé des comptes du 19 novembre 1904 au juillet 1907 :
Recettes 118.759.15 Dépenses 114.759.20
Reste donc un actif de 4000 piastres.
19
9° Couvent de Notre-Dame du Bon Secours (vulgairement Deir El Banate à Djoubail.
Le Cheikh Mansour Dahda, avec l’autorisation de l’émir Joseph Chehab, fit don à l’Ordre Baladite en 1770, par cet acte légal du couvent ruiné de Deir El Banat, sous le généralat du Père Marc El Kafahi. Les religieux réparèrent de leur mieux le couvent et l’occupèrent. En 1903 le Général Père Namatalla El Kafri rebâtit le monastère tel qu’il est actuellement en chargeant la caisse généralice des dettes qu’il avait contractées pour faire cette restauration. Ces dettes ont été soldées par le Général actuel Père Joseph Rafoul.
Ce couvent a été construit à la moderne, couvert en tuiles. Les chambres au nombre d’une quinzaine sont assez spacieuses et convenables.
L’église n’est qu’une très pauvre chapelle comme construction, dimensions et ordre. Il s’y trouve 2 autels en bois grossièrement peints avec pierres d’autel en planches mobiles. Les 2 autels, comme le couvent et l’église, sont consacrés à N.D.Auxiliatrice. Les 2 tableaux représentant la Madone sont médiocres. Pas de sacristie on y trouve des ornements et vases sacrés assez convenables et en nombre suffisant.
D’après une information que nous avons reçue dernièrement du Général on est en train de reconstruire cette église sur un plan plus convenable.
La communauté compte 14 religieux, dont 6 Pères et 8 Frères Convers.
20
La propriété comprend des champs de mûriers, magasins, vignes et terrains de culture. Les mûriers ont une valeur de 600.000 piastres et le reste vaut 200.000 piastres. Valeur totale : 800.000 piastres.
Relevé de comptes du 28 septembre 1907 au 15 juin 1908 :
Recettes 15826 Dépenses 26096
Au 15 juin 1908 le couvent se trouvait donc en déficit de 10270 piastres, mais ce déficit sera couvert par le produit des récoltes de l’année. Le Supérieur actuel à son entrée en charge à Deir El Banat en 1905 trouva un déficit de 11278 piastres.
Les comptes pour 2 ans du 28 novembre 1905, 28 septembre 1907 ont été comme suit :
Recettes 64157.30 dépenses 64157.30
Ne laissant aucune différence.
Le couvent est tenu de célébrer 9 messes par an, à savoir 5 pour Joseph El Hakim de Djoubail et 4 pour Pharès Chahin pour des legs pieux consistant en vignes, boutique et terrains reçus des deux donateurs susmentionnés.
21
10° Antoche de Djoubail
Cet Antoche est situé au milieu de la ville. La maison est spacieuse et bien bâtie, tout à côté de l’église paroissiale qui est desservie par les Pères.
L’église dont une partie a été bâtie par les Croisés est à trois nefs, pavée en marbre avec trois autels en marbres. La propreté et l’ordre y règnent suffisamment. Les ornements et les vases sacrés sont dans un état convenable.
Deux Pères et 1e Frère résident à l’Antoche. Ils desservent la paroisse et vivent des droits d’étole et du produit de quelques petites propriétés.
22
11° Ecole de Bassah
Cette propriété a été détachée du couvent de Houb sous le généralat du Père Ephrem Bcherrani en 1870. Agrandie par les achats faits par l’Ordre et par un petit legs pieux donné par un habitant de Kfour en vue de l’entretien d’une école dans son village. Cette résidence se trouve entre les couvents de Mar Iacoub El Hosson et de Houb, à environ 2 heurs du premier et 1heure ½ du second.
Deux Pères y résident. L’un des deux fait l’école dans le village voisin de Kfour.
Le Père Maron, Vicaire de cette résidence, est en train de construire un couvent complet avec l’autorisation du défunt Général Père El Kafri.
La propriété de la résidence comprend des mûriers nourrissant 70 drachmes de vers à soie, ayant une valeur de 140.000 piastres ; des vignes, terrains de culture, oliviers, moulin, de la valeur de 300.000 piastres, soit une valeur totale de 440.000 piastres.
Comptes de novembre 1904 au 18 août 1908 :
Recettes 90615.25 Dépenses 90620.08
Reste un déficit de 4 piastres 20 paras et en plus les impôts des l’année à payer dont le montant n’est pas connu.
23
12° L’école de Kfar Haial près Qortaba
Cette école a été détachée de Qortaba en 1851, dont elle était jadis la propriété sous le généralat du Père Laurent Chebabi qui agrandit aussi cette propriété par des achats faits aux chefs Métoualis.
Deux Pères et 1 Frère y résident. L’un des deux Père dessert une paroisse voisine située à côté de la résidence est un lieu de pèlerinage assez fréquents.
Relevé des comptes de la résidence pour la période du 25 mai 1905 au 23 septembre 1907.
Recettes 19999.10 Dépenses 22137.10
Reste donc un déficit de 2138 piastres.
24
13° Ecole (résidence) de Saqui-Lehfed
Cette résidence, située dans le village de Saqui-Lehfed, non loin de Quettara, a été fondée sous le généralat du Père Martinos Darouni en 1896 par le Père Emmanuel Maron de Djadj, Vicaire de la résidence, qui, au prix de 50.000 piastres y a acheté une propriété et bâti une maison.
Le Père Emmanuel y réside avec un autre Père qui fait l’école aux enfants du village.
25
14° Monastère de St Jospeh à Djerebta
Ce monastère a été fondé en 1897. Quelques religieuses du monastère de Mar Simaan El Qarn, parmi lesquelles la Mère Ursula Doumeth, Supérieure actuelle de ce monastère, dans le désir de pratiquer la vie commune parfaite, qu’elles ne trouvaient pas à Mar Simaan, et en même temps de s’établir sous un climat moins rigoureux, sollicitèrent de Mgr le Patriarche et du Père Général l’autorisation de faire une nouvelle fondation et l’obtinrent. Elles s’établirent donc à Djerebta s’astreignant à la pratique de la vie commune telle qu’elle est prescrite par la Règle.
Le nombre de religieuses s’est accru peu à peu. Il est actuellement de 11 y compris une Novice.
Le monastère est encore très incomplet. Il comprend un rez-de-chaussée, dont une pièce a été convertie en chapelle provisoire et une autre sert de réfectoire, et au-dessus un étage avec 11 cellules. Le tout est tenu avec beaucoup d’ordre et de propreté.
Les ornements et vases sacrés, dont quelques uns riches et beaux, sont en assez grand nombre et conservés avec soins.
Un Père de l’Ordre, aumônier et confesseur des religieuses, habite dans une maison séparée à côté du monastère avec un Frère chargé des commissions et de la surveillance des propriétés. Ces deux religieux, quant à la pauvreté, mènent la vie commune avec les religieuses.
26
La propriété ne comprend que quelques pièces de terrains cachetées avec les économies de la communauté ou données par les parents de la Supérieure, ne rapportent annuellement que 800 ou, au plus, 1000 piastres.
A l’époque du Chapitre général de 1904 il fut décidé par le conseil du Général et des Assistants, sur la demande du Patriarche, qu’on assignerait au couvent de Djerebta quelques portions des propriétés des monastères de Meifouq, Qortaba, Annaia et Maad. Cette décision ne fut pas exécutée par suite de l’opposition qu’elle rencontra auprès des Supérieurs des susdits monastères.
A la suite de la Visite faite à ce monastère nous avons prié le Général de l’Ordre d’effectuer l’acquisition d’une propriété située dans le voisinage du monastère afin de tirer cette communauté si digne d’intérêt à cause de l’excellent esprit religieux qui l’anime, de la grande gêne financière dans laquelle elle vit. Nous espérons que le Père Général ne tardera pas à réaliser nos désirs.
Relevé des comptes du monastère pendant la période de 3 ans 1/2. Le total des recettes, en y incluant les honoraires reçus par l’aumônier pour messes et funérailles, s’est élevé à la somme de 12036 piastres 20 paras. Les dépenses de la communauté pendant cette période ont été de 49020 piastres 15 paras, somme à laquelle il faut ajouter 21353 piastres dépensées en achats de propriétés. Total des dépenses 70373 piastres 15 paras, d’où résulte un déficit de 58366 piastres 35 paras. Ce déficit a été comblé par les secours que la Mère Supérieure a su obtenir de ses parents et d’autres bienfaiteurs.