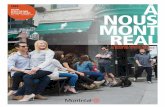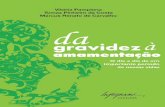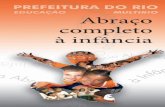Aperçu des céramiques mésohelladiques à décor peint de l' Aspis d'Argos, II. La céramique à...
-
Upload
univ-paris1 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Aperçu des céramiques mésohelladiques à décor peint de l' Aspis d'Argos, II. La céramique à...
Anna Philippa-Touchais
Aperçu des céramiques mésohelladiques à décor peint de l'Aspis d'Argos, II. La céramique à peinture lustréeIn: Bulletin de correspondance hellénique. Volume 127, livraison 1, 2003. pp. 1-47.
Citer ce document / Cite this document :
Philippa-Touchais Anna. Aperçu des céramiques mésohelladiques à décor peint de l' Aspis d'Argos, II. La céramique à peinturelustrée. In: Bulletin de correspondance hellénique. Volume 127, livraison 1, 2003. pp. 1-47.
doi : 10.3406/bch.2003.7121
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bch_0007-4217_2003_num_127_1_7121
AbstractIn the first part of our study of painted pottery from the recent excavations ofthe Middle Helladicsettlement of Aspis at Argos, we presented the Mattpainted Ware locally or imported from Aigina. In thissecond part we set out the preliminary results of the study of the Lustrous Decorated Ware, which ismuch rarer and was produced in a workshop situated most probably in the Southeastern Peloponnese.One of its chief characteristics is the similarities it bears to the Minoan pottery (MM IA-MM III/LM IA),similarities that are not only morphological, but technological, indicating that its centre of production wasvery familiar with the technical methods employed by the Minoan potters. Through a study of thephysical characteristics of this pottery (specialised technology, limited répertoire of shapes, elaboratedecoration) we consider its function (consumption of liquid foodstuffs) and social role (prestige vases),and we furdier attempt a better definition the features of its centre of production. Lasdy, through anexamination of the variability of these two categories of painted ware, we make an attempt to illuminatethe socio-political organisation of the settlement and the successive changes that have affected it : itsrestructuring at the beginning of the period of the Mycenaean shaft graves and its abandonment at theend of this period.
περίληψηΣτο πρώτο μέρος της μελέτης της κεραμικής με γραπτό διάκοσμο από τις πρόσφατες ανασκαφές τουμεσοελλαδικού οικισμού της Ασπίδας του 'Αργούς, είχαμε αναφερθεί στην αμαυρόχρωμη κεραμική(Mattpainted Ware), τοπικής και αιγινήτικης παραγωγής. Στο δεύτερο αυτό μέρος του άρθρουπαρουσιάζονται τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της μελέτης της κεραμικής με στιλπνή βαφή {LustronsDecorated Waré), πολύ σπανιότερης και προερχόμενης από κάποιο κέντρο παραγωγής πουεντοπίζεται πιθανότατα στη ΝΑ Πελοπόννησο. Βασικό χαρακτηριστικό της αποτελούν οι ομοιότητες τηςμε τη μινωική κεραμική (ΜΜ ΙΑ-ΜΜ ΙΠΒ/ΥΜ Ι), ομοιότητες όχι μόνο μορφολογικές αλλά καιτεχνολογικές, γεγονός που δηλώνει την εξοικείωση του εργαστηρίου παραγωγής της με τη μινωικήτεχνογνωσία. Μέσα από τη μελέτη των φυσικών χαρακτηριστικών της (εξειδικευμένη τεχνολογία,περιορισμένο σχηματολόγιο, περίτεχνη διακόσμηση) διερευνάται η λειτουργία της κεραμικής αυτής(κατανάλωση υγρών τροφών) και ο κοινωνικός της ρόλος (ένδειξη κύρους), καθώς και ταχαρακτηριστικά του κέντρου παραγωγής της. Τέλος, μέσα από την κεραμική διαφοροποίηση και τωνδύο κατηγοριών με γραπτό διάκοσμο (αμαυρόχρωμης και με στιλπνή βαφή) γίνεται μια προσπάθεια ναδιερευνηθούν η κοινωνικοπολιτική οργάνωση του οικισμού και οι αλλαγές που σηματοδότησαν τηνπορεία του: η χωροταξική του αναδιάταξη στην αρχή της περιόδου των ταφικών κύκλων των Μυκηνώνκαι η εγκατάλειψη του στα τέλη της ίδιας περιόδου.
RésuméDans la première partie de notre étude des céramiques à décor peint issues des fouilles récentes del'habitat mésohelladique de l'Aspis d'Argos, nous avons présenté la céramique à peinture mate(Mattpainted Ware) de production locale ou importée d'Égine. Dans cette seconde partie, nousexposons les résultats préliminaires de l'étude de la céramique à peinture lustrée (Lustrons DecoratedWare), beaucoup plus rare et produite dans un atelier qui était vraisemblablement situé dans le Sud-Estdu Péloponnèse. L'une de ses principales caractéristiques réside dans les similitudes qu'elle offre avecla céramique minoenne (MM IA-MM III/MR IA), similitudes non seulement morphologiques mais aussitechnologiques, qui prouvent que son centre de production était très familiarisé avec les savoir-fairetechniques des potiers minoens. À travers l'étude des caractères physiques de cette céramique(technologie spécialisée, répertoire des formes restreint, décor élaboré), nous tentons une approche desa fonction (consommation de denrées liquides hors du cadre quotidien) et de son rôle social (vases deprestige) et essayons aussi de mieux cerner les caractères de son centre de production. Enfin, à traversl'examen de la variabilité des deux catégories de céramique à décor peint nous nous efforçonsd'éclairer l'organisation socio-politique de l'habitat et les changements successifs qui l'ont affecté : sarestructuration au début de la période des tombes à fosse de Mycènes et son abandon à la fin de cettemême période.
Aperçu des céramiques mésohelladiques à décor peint
de l'Aspis d'Argos
II. La céramique à peinture lustrée*
par Anna PHILIPPA-TOUCHAIS
La céramique à peinture lustrée (Lustrons Decorated Warê) constitue la seconde catégorie de poterie mésohelladique à décor peint après la céramique à peinture mate. Elle est moins bien connue que la première parce que son identification est relativement plus récente et son étude moins avancée, mais aussi parce que sa distribution est moins étale et le volume de sa production beaucoup plus réduit.
Le présent article fait suite à celui qui a été publié dans le BCH 126 (2002), p. 1-40, sous le titre « Aperçu des céramiques mésohelladiques à décor peint de l'Aspis d'Argos, I. La céramique à peinture mate », désormais cité PHILIPPA-TOUCHAIS 2002. Les remerciements exprimés au début du premier article valent aussi pour le second, mais nous sommes particulièrement redevable, pour celui-ci, à N. Sigalas, qui a réalisé les dessins des vases tf* 5-6, 10, 21-22, 24-25, 34-35, et à G. Touchais, dont la contribution a été décisive, surtout dans la mise au point des conclusions. Aux abréviations bibliographiques utilisées dans le premier article on ajoutera les suivantes : BETANCOURT 1985 = Ph. P. Betancourt, The History ofMinoan Pottery. Coldstream-Huxley 1972 = J. N. Coldstream, G. L. Huxley, Kythera : Excavations and Studies Conducted
by the University ofPennsylvania Muséum and the British School atAthens. Deshayes 1966 = J. Deshayes, Argos. Les fouilles de la Deiras, ÉtPélop IV. KlLIAN-DlRLMEIER 1997 = I. KlLlAN-DlRLMElER, Dos mittelbronzezeitliche Schachtgrab von Âgina, Alt-Àgina IV, 3. MacGillivray 1998 = J. A. MacGillivray, Knossos : Pottery Groups ofthe OU Palace Period, ABSA Studies 5. RUTTER 1976 = J. B. Rutter, S. H. Rutter, The Transition to the Mycenaean. A Stratified MH II to LH IIA
Pottery Séquence front Ayios Stephanos in Lakonia. Taylour 1972 = W. D. Taylour, « Excavations at Ayios Stephanos », ABSA 67, p. 205-270. Wace and Blegen = C. Zerner, P. Zerner, J. Winder (éds), Wace and Blegen. Pottery as Evidence far Trade in
the Aegean Bronze Age, 1939-1989. Proceedings ofthe International Conférence, Held at the American School ofClassical Studies atAthens, Athens, December 2-3, 1989 (1993).
WALBERG 1976 = G. WALBERG, Kamares. A Study ofthe Character of PaUtial Middle Minoan Pottery. WALBERG 1983 = G. WALBERG, Provincial Middle Minoan Pottery. Zerner 1986 = C. Zerner, « Middle Helladic and Late Helladic I Pottery rrom Lerna, Part I », Hydra 2, p. 58-74. ZERNER 1993 = C. Zerner, « New Perspectives on Trade in the Middle and Early Late Helladic Periods on
the Mainland », in Wace and Blegen, p. 39-56.
BCH 127 (2003)
Anna PHILIPPA-TOUCHAIS
Quoique présente sur plusieurs sites mésohelladiques fouillés pendant la première moitié du XXe siècle1, elle n'a été identifiée qu'au début des années cinquante par J. L. Caskey, à la faveur des fouilles de Lerne2. Plus récemment C. Zerner, dans son eflFort pour établir une classification des céramiques HM faisant appel à des critères technologiques, a réétudié cette céramique et présenté une synthèse des données qui la concernent3. Grâce à une série d'analyses chimiques et pétrographiques pratiquées sur des tessons de Lerne4, Zerner a observé que plusieurs classes de poterie décorées à la peinture lustrée, mais dans des styles très différents, partageaient en fait la même technologie. Ces classes, entre lesquelles on n'avait jusqu'alors pas établi de rapport et qui étaient connues sous des noms divers5, ont ainsi été réunies en une seule catégorie appelée Lustrons Decorated (par référence à son décor) et/ou Mudstone and Chert (par référence à la composition de sa pâte). La céramique à peinture lustrée se définit donc essentiellement par sa technologie, qui présente de nombreuses constantes (v. infra, p. 5-6) par-delà la multiplicité des styles décoratifs, à la différence de la céramique à peinture mate, dont l'unité stylistique recouvre en fait une grande hétérogénéité technologique6.
D'autre part, le fait que les traits morphologiques de la céramique à peinture lustrée renvoient souvent à la céramique minoenne lui a valu le qualificatif de « minoïsante ». De fait certaines formes, comme la tasse et la cruche, et certains styles décoratifs (clair-sur-sombre,
1. Notamment à Asinè (O. FRODIN, A. PERSSON, Asine, Results ofthe Swedish Excavations 1922-1930 [1938], fig. 190-192 et pi. coul. I-II), à Aséa (E. J. HOLMBERG, The Swedish Excavations atAsea in Arcadia [1944], fig. 99 c-j, 100), mais aussi à Argos, dans les premières fouilles de l'Aspis (W. VOLLGRAFF, « Fouilles d'Argos. - B. Les établissements préhistoriques de l'Aspis », BCH 30 [1906], p. 21 fig. 25, p. 26 fig. 41, et tessons inédits conservés au musée d'Argos), ainsi que dans celles de J. Deshayes à la Deiras (DESHAYES 1966, pi. XXXVI, 3 au milieu à gauche, 4 au milieu à gauche, pi. XXXVII, 1 en bas, 3 au milieu et en haut à droite, etc.). Certains fouilleurs ne la distinguent pas alors de la céramique à peinture mate, la considérant tout au plus comme une variante de celle-ci (« céramique gris beige sans engobe », DESHAYES 1966, p. 122-123 ; « Matt-Painted with the Surface Covered with aThin White Wash », E. J. HOLMBERG, op. cit., p. 100-101).
2. J. L. CASKEY, « Excavations at Lerna, 1952-1953 », Hesperia 23 (1954), p. 29-30 et pi. 8f ; id., « The Earry Helladic Period in the Argolid », Hesperia 29 (I960), p. 298.
3. Zerner 1978, p. 159-170 ; 1986, p. 66-68 ; 1988, p. 6-10 et fig. 24-41 ; 1993, p. 45-47, 50-51. 4. Zerner 1986, p. 68 ; R. E. Jones, « Pottery as Evidence for Trade and Colonisation in the Aegean Bronze
Age : The Contribution of Scientific Techniques », in Wace and Blegen, p. 1 1-17. 5. White on Lustrous Dark, Lustrons Dark on Light, Purple and White on Lustrons Black, v. D. H. FRENCH, Notes
on Prehistoric Pottery Groupsfrom Central Greece (1972), p. 29, 34, 36 ; Taylour 1972, p. 265. 6. Phiuppa-Touchais 2002, p. 37.
BCH 127 (2003)
APERÇU DES CÉRAMIQUES MÉSOHELLADIQUES À DÉCOR PEINT DE L'ASPIS D'ARGOS Π
polychrome) sont directement imités des poteries MM7. Ces imitations sont parfois même si fidèles que l'on a du mal à les distinguer des importations minoennes8. Cela suggère que ces vases étaient fabriqués dans un atelier spécialisé, qui devait être familiarisé avec la technologie minoenne. Cependant le qualificatif de « minoïsante » ne s'applique pas à toute la céramique à peinture lustrée. Cette dernière comprend en effet plusieurs types de tradition purement helladique, notamment la jarre à col tronconique, qui est directement inspirée de jarres de ΓΗΑ III dont les antécédents remontent au Néolithique9. Les récipients qui trahissent cette inspiration helladique ont été considérés par C. Zerner — qui est la première à avoir noté cette différence — comme les représentants d'une « variante continentale » de la céramique à peinture lustrée10.
Dans l'état actuel des recherches, il semble que l'aire de répartition de cette céramique se limite à la façade Est du Péloponnèse et de la Grèce centrale. Le fait qu'elle abonde dans le Sud-Est du Péloponnèse, notamment à Haghios Stéphanos et dans l'île de Cythère, où la présence minoenne est très marquée dès le début du Bronze Moyen, suggère que son centre de production se trouvait quelque part dans cette région11. Le problème de la localisation de ce centre reste cependant ouvert, de même que, dans une large mesure, la question du statut de cette céramique dans la société mésohelladique.
7. ZERNER (1993, p. 46) note toutefois une tendance à la simplification, tant dans le répertoire des formes, qui est plus restreint, que dans celui des motifs, qui sont moins complexes.
8. Au point qu'il est très difficile, parfois même impossible, de les distinguer macroscopiquement des vases importés. À Lerne, p. ex., les spécialistes qui ont examiné le matériel « minoen » (S. Hood, G. Gadogan et S. Andreou) ne sont pas tous du même avis (ZERNER 1978, p. 170-171, v. aussi ead., 1993, n. 68).
9. Pour l'HA III, v. J. B. Rutter, The Pottery ofLema IV, Lerna III (1995), p. 404-410 (forme XVII, type 1) ; pour le Néolithique, v. K. D. VlTELLI, Franchthi Neolithic Pottery, 2. The Later Neolithic Ceramic Phases 3 to 5, Excavations at Franchthi Cave, Greece 10 (1999), fig. 30 : c. Une jarre de forme identique, décorée en White- on-Red, provient de l'habitat NA de Giannitsa B, v. P. CHRYSOSTOMOU, ΑΕΜΘ 15 (2001) [2003], p. 500, fig. 4.
10. Zerner 1978, p. 159-170, surtout p. 160-162. Dans ses publications ultérieures, l'auteur, voulant souligner l'homogénéité de cette catégorie, a tendance à reléguer cette distinction au second plan, v. ead. 1993, p. 46 et n.34.
11. Rutter 1976, p. 10-13, 63-64 ; Zerner 1978, p. 166-167 ; 1986, p. 67 ; 1993, p. 46-47, 50. J. Rutter, C. ZERNER, « Early Hellado-Minoan Contacts », in R. HAGG, N. MarinatOS (éds), The Minoan Thalassocracy. Myth and Reality, Proceedings ofthe Third International Symposium at the Swedish Insntute in Athens, 31 May-5 June 1982 (1984), ρ 77-79 ; NORDQUIST 1987, p. 62.
£0/127(2003)
Anna PHILIPPA-TOUCHAIS
1. Généralités
Données quantitatives
La céramique à peinture lustrée est très minoritaire sur l'Aspis. La présente étude repose sur l'examen de 470 tessons et profils enregistrés12, sur un total de 1 525 tessons de cette catégorie recueillis dans le secteur Sud-Est. Ceux-ci y représentent, en moyenne, 4 % de l'ensemble du matériel céramique (v. histogramme dans PHILIPPA-TOUCHAIS 2002, p. 4, tableau 1), pourcentage très faible par rapport à celui de la céramique à peinture mate — qui, sur l'Aspis, représente environ le tiers de l'ensemble — mais relativement élevé si on le compare aux taux observés, pour cette céramique, sur d'autres sites du Péloponnèse13.
Il faut cependant préciser que ce pourcentage — à la différence de celui de la céramique à peinture mate, qui demeure à peu près constant14 — varie sensiblement au cours des trois phases d'occupation HM de l'Aspis. Dans la plus ancienne (phase II) il est beaucoup plus élevé (7,37 %) que dans les niveaux postérieurs, où il passe successivement de 2,61 % (phase III) à 2,26 % (phase IV), le niveau le plus récent ayant pourtant été fouillé sur une étendue et une épaisseur nettement supérieures15.
Répartition dans l'habitat
Dans les deux secteurs de l'Aspis qui ont été fouillés, la répartition spatiale de la céramique à peinture lustrée est assez homogène. On a toutefois noté, dans le secteur Sud-Est, une concentration plus forte sous la maison absidale, un « dépôt » qui regroupe le tiers de
12. Les profils complets sont ceux d'une jarre et d'une dizaine de couvercles. Dans la mesure où cette céramique est assez rare et encore mal connue, on en a conservé un nombre de tessons comparativement plus élevé que dans les autres catégories. Sur la base du nombre de fragments de bords recueillis (et tous enregistrés), le nombre minimum de vases à PL dans le secteur Sud-Est peut être estimé à un peu plus d'une centaine (±110).
13. À Asinè, dans le secteur du Barbouna, la céramique à PL représente 2,84 % de l'ensemble de la céramique HM (Nordquist 1987, p. 49, 51 [tableau 5.3], 63), tandis que dans la ville basse le taux semble un peu supérieur : 4 % à ΓΗΜ IIIA et au moins autant (mais le chiffre exact n'est pas donné) à ΓΗΜ IIIB (DlETZ 1991, p. 297). À Égine (Kolona) son taux de fréquence n'est sans doute pas très élevé puisqu'on ne compte en tout pas plus de 200 pièces (surtout des tessons) de céramique minoenne ou minoïsante (St. HlLLER, « Minoan and Minoanizing Pottery on Aegina », in Wace and Blegen, p. 197-199) ; un lot de 138 pièces de ce matériel est publié par KlLIAN-DlRLMElER 1997, p. 136-154. Pour Lerne on ne dispose pas de données chiffrées, mais, si l'on en juge par les « several hundred vases » (J. RUTTER, C. ZERNER, bc. cit. [supra, n. 1 1], p. 77) et le bon état de conservation du matériel déjà présenté (Zerner 1988), le pourcentage de la céramique à PL devait être assez élevé. On ne sait toutefois s'il atteignait les chiffres d'Haghios Stéphanos, qui se situent entre 16 et 22 % de l'ensemble du matériel (Rutter 1976, p. 13 n. 16, tableaux II- V, et p. 63).
14. Philippa-Touchais 2002, p. 4 et 37. 15. Ibid., p. 4. Rappelons que la phase II (HM IB-II) correspond à la couche 4b/c, la phase III (HM IIIA) à la
couche 4a et la phase IV (HM IIIB) aux couches 2 et 3, ibid., p. 3.
BCH 127 (2003)
APERÇU DES CÉRAMIQUES MÉSOHELLADIQUES À DÉCOR PEINT DE L'ASPIS D'ARGOS II
l'ensemble des vases entièrement ou partiellement restaurés. Bien que ce « dépôt » semble résulter, en grande partie, des travaux de nivellement qui précédèrent la construction de ladite maison dans la phase III, le nombre élevé de vases plus ou moins complets (brûlés pour la plupart) fait penser qu'il existait peut-être un important bâtiment de la phase II à cet endroit.
Technologie
1. La pâte
Analyse macroscopique et classes technologiques. La céramique à peinture lustrée est caractérisée par une pâte abondamment dégraissée à l'aide de grains de sable (argilite, chert) assez fins et uniformes. Particulièrement fines dans le cas des petits vases de table, ces inclusions16 donnent à la pâte une texture sableuse très caractéristique, plus facile à observer sur les récipients de fabrique semi-fine ou grossière. La couleur de la pâte est le plus souvent beige clair, mais elle peut varier de beige rosé à rougeâtre ou orangé, selon les conditions de cuisson ; ces teintes claires et la coloration généralement homogène de la surface et du cœur sont révélatrices d'une exposition prolongée à une atmosphère oxydante17. Il faut noter aussi la grande dureté de la pâte, qui tient à la fois à sa composition et à un contrôle efficace de la cuisson, sans doute maintenue à température élevée et constante.
L'étude macroscopique de la pâte a conduit à distinguer trois classes technologiques : — une classe à pâte fine, bien épurée, de couleur claire (beige ou gris), dans laquelle on
trouve les petits vases à boire, tasses et gobelets ; — une classe à pâte semi-fine contenant d'abondantes inclusions et dont la couleur oscille
dans la gamme des tons beige rosé ; elle comprend surtout des vases fermés, amphores et cruches ;
— une classe à pâte grossière avec d'abondantes inclusions de granulométrie variable ; sa couleur est en général un peu plus foncée que celle de la pâte semi-fine, variant de gris beige à gris brun ; la seule forme de vase attestée dans cette pâte est un type de jarre ou pithos à large embouchure.
Analyses microscopiques. Les analyses de pâte ont montré que la distinction entre ces classes, hormis la proportion de dégraissant, ne correspondait pas à des différences essentielles du point de vue physico-chimique. En effet, les quelque vingt-cinq tessons de céramique
16. Particules de couleur blanche, rouge, brune ou noire, sans mica. 17. Sauf pour les vases grossiers, à cœur gris, qui ont apparemment été cuits dans d'autres conditions (oxydation
incomplète) ; Zerner (1978, p. 159 ; 1986, p. 66 ; 1993, p. 46) note que le cœur de la pâte est habituellement gris.
BCH 127 (2003)
Anna PHILIPPA-TOUCHAIS
à peinture lustrée soumis aux analyses chimiques et pétrographiques se sont révélés d'une grande homogénéité, tant du point de vue de leur composition que de leur technologie18.
Les résultats de ces analyses ont d'autre part remis en cause notre hypothèse sur la présence d'importations minoennes, que nous avions cru déceler surtout parmi les vases à pâte fine. Cette hypothèse s'appuyait sur deux observations : d'une part, l'apparente différence technologique entre la classe à pâte fine et les deux autres ; d'autre part, la grande ressemblance morphologique et stylistique entre les vases de la première et les productions du MM. Or les analyses ont montré que les trois classes forment en fait un ensemble très homogène et que, si leur technologie se rattache bien à la tradition minoenne, la composition de leur pâte exclut — sauf dans un cas sans doute — une origine Cretoise.
2. Techniques de fabrication
Outre sa pâte, certaines techniques de fabrication de la céramique à peinture lustrée sont aussi très caractéristiques. Quoique le plus souvent modelés à la main, les vases, notamment les récipients d'assez grande taille comme les amphores ou les jarres, ont les parois très fines. Ces mêmes vases fermés présentent en outre, sur leur face intérieure, des stries faites apparemment à l'aide d'un instrument dur et effilé (grattoir) lors du modelage19 (fig. lb) ; d'autre part, le mode de fixation de leurs anses est particulier : les attaches sont pourvues d'un tenon pointu qui transperce la paroi du vase de part en part20 (fig. 2).
3. Marques de potier
Sur l'Aspis, la céramique à peinture lustrée est la deuxième classe, avec la céramique à pâte micacée (originaire d'Égine)21, sur laquelle se rencontrent des marques de potier. Ces marques sont, là encore, effectuées avant la cuisson, mais uniquement sur des vases fermés, et consistent en des combinaisons de traits incisés (v. infra p. 22-23 et fig. 13). À la différence des marques apposées sur les vases en pâte micacée, qui sont placées sur le bas de la panse ou le fond du vase, celles des vases à peinture lustrée sont toujours situées à un endroit plus visible, généralement sur la face supérieure de l'anse ou juste à côté 22.
18. V. Kilikoglou, E. Kiriatzi, A. Philippa-Touchais, G. Touchais, I. K. Whitbread, « Pottery Production and Supply at Middle Helladic Aspis, Argos : The Evidence of Chemical and Pétrographie Analyses », in K. P. FOSTER, R. LAFFINEUR (éds), Metron. Measuring the Aegean Bronze Age, Proceedings of the 9th International Aegean Conférence, New Haven, Yale University, 18-21 April 2002, Aegaeum 24 (2003), p. 131- 136 ; BCH 125 (2001), p. 563-564 ; 126 (2002), p. 497-498.
19. Rutter 1976, p. 13 ; Zerner 1978, p. 159 ; 1986, p. 67 ; 1993, p. 46. 20. Zerner 1978, p. 161 ; 1986, p. 67 ; 1993, p. 46. 21. Philippa-Touchais 2002, p. 5. 22. Zerner 1978, p. 160 ; 1986, p. 67 ; 1993, p. 46 ; v. aussi M. Lindblom, Marks and Markers : Appearance,
Distribution and Function of Middle and Late Helladic Manufacturer's Marks on Aeginetan Pottery (2001), p. 119 et fig. 20.
BCH 127 (2003)
APERÇU DES CÉRAMIQUES MÉSOHELLADIQUES À DÉCOR PEINT DE L'ASPIS D'ARGOS Π
Kg. 1. — Fragments de vases fermés : face extérieure (a), intérieure (b).
Kg. 2. — Anses à tenon de vases fermés.
BCH 127 (2003)
Anna PHILIPPA-TOUCHAIS
Formes et fonctions
L'étude de la céramique à peinture lustrée de l'Aspis a montré que son répertoire de formes n'est pas très étendu, en tout cas beaucoup moins que celui de la céramique à peinture mate : les types reconnus se limitent à deux vases de table, la tasse et la cruche, et deux récipients de conservation et de stockage, la jarre à embouchure resserrée et la jarre à large embouchure ou pithos. Il faut souligner l'absence de types caractéristiques des séries à peinture mate, notamment la jatte, le canthare et la coupe23.
Dans les séries à peinture lustrée, les vases fermés sont beaucoup plus nombreux que les vases ouverts24, à l'inverse ce que l'on a observé pour les séries à peinture mate25. La forme la plus courante est la jarre à col resserré, munie le plus souvent d'un bord évasé et plus rarement d'un col coupé ou cylindrique. Moins fréquente est la cruche à bec dressé, représentée par une vingtaine de fragments de bec et/ou de bord. Un nombre sensiblement égal de fragments appartient à des petits vases à boire, tasses et gobelets.
Il est intéressant de noter que cette catégorie de céramique comprend presque exclusivement des vases liés à la consommation et à la conservation ou au stockage de denrées liquides. D'autre part, sa relative rareté et sa fabrication très soignée suggèrent qu'on lui attribuait une valeur particulière26, qui n'était peut-être pas indépendante de celle de son contenu. Il s'agit donc, selon toute apparence, de vases qui n'étaient pas destinés à un usage domestique quotidien mais dont la fonction s'inscrivait dans le cadre de pratiques que l'on pourrait qualifier de « spéciales », manifestations sociales à caractère sans doute « officiel ».
Décor
Tous les vases de cette catégorie portent un décor peint. Celui-ci est réalisé à l'aide d'une peinture lustrée27 à base d'oxydes de fer, dont la couleur varie du noir à l'orangé selon la cuisson. On a reconnu quatre styles décoratifs, dont chacun est associé à des types de vases déterminés :
23. Philippa-Touchais 2002, p. 6-21. 24. Sur la totalité des fragments de bord en PL recueillis, 80 environ appartiennent à des vases fermés (jarres, cru
ches) et 30 seulement à des vases ouverts (tasses). 25. Phiuppa-Touchais 2002, p. 5. 26. Autre indice de la valeur accordée à cette céramique, le fait que plusieurs vases en céramique à PL présentent
des trous de réparation (fig. 24), pratique attestée aussi dans d'autres classes (PM, MG, MF) mais dans des proportions nettement moindres.
27- L'aspect plus ou moins lustré de la peinture (qui manque parfois totalement de brillance, d'où la confusion avec la céramique à PM) peut être dû à diverses causes : composition, polissage de la surface, conditions d'enfouissement.
BCH 127 (2003)
APERÇU DES CÉRAMIQUES MÉSOHELLADIQUES À DÉCOR PEINT DE L'ASPIS D'ARGOS II
— le style sombre-sur-dair monochrome (PLM1) : la peinture, généralement noire28, est appliquée sur la surface non engobée29 du vase ; ce style, presque exclusivement associé à la jarre à col tronconique, est le plus courant dans le premier niveau d'occupation HM (phase II) ; ensuite il devient minoritaire ;
— le style sombre-sur-dair bichrome (PLB1) : le décor est constitué de motifs en peinture lustrée de couleur sombre (brun-rouge le plus souvent) appliqués sur la surface bien lissée du vase30, avec des rehauts en peinture blanche et pourpre mate ; ce style, plus rare, illustré seulement sur des jarres à col tronconique, apparaît pendant la phase III et semble être une variante tardive du style PLM1 ;
— le style clair-sur-sombre monochrome (PLM2) : sur l'engobe noir et lustré qui recouvre la totalité ou la plus grande partie de la surface du vase, les motifs sont exécutés à l'aide d'une peinture blanche mate, peu résistante ; ce style, attesté sur tous les types de vases, apparaît dès le premier niveau d'occupation HM mais il est plus fréquent dans le dernier (phase IV) ;
— le style clair-sur-sombre bichrome (PLB2) : sur l'engobe noir ou brun-rouge et lustré de la surface, les motifs sont exécutés dans une peinture blanche et pourpre ; la peinture blanche a souvent disparu, laissant seulement des traces ou son négatif sur l'engobe noir ; ce style, très marginal dans la phase II, devient ensuite plus fréquent.
Dans le style PLM1, les motifs sont toujours rectilignes et s'organisent en zones horizontales (groupes de lignes obliques, files de triangles hachurés), tandis que ceux du style PLB1, tout en suivant la même syntaxe, comportent aussi des éléments curvilignes simples (arcades à champ hachuré ou quadrillé, lignes ondulées, points). Les motifs des styles PLM2 et PLB2 sont, quant à eux, plus variés, souvent curvilignes (spirales, lignes ondulées), ceux du style PLB2 étant les plus élaborés, souvent végétaux (rosettes), et disposés de façon plus libre sur l'épaule ou la panse des vases.
28. Sa couleur varie de noir à brun-noir ou brun-rouge ; par endroits cette peinture peut être assez épaisse, d'un aspect craquelé.
29. En fait, la surface extérieure est plus lisse et un peu plus claire que la surface intérieure. Cela résulte sans doute d'un léger polissage à l'aide d'un chiffon humide créant sur la face externe une sorte d'engobe très dilué (self slip) de même nature que l'argile du vase ; v. aussi ZERNER 1978, p. 159 ; 1986, p. 66.
30. Dans ce cas, l'existence d'un engobe clair est plus vraisemblable, parfois même certaine. On a aussi souvent l'impression que toute la surface a été polie après l'application du décor, mais cela ne pourrait être confirmé que par une étude technologique plus poussée.
£0/127(2003)
10 Anna PHILIPPA-TOUCHAIS
2. Analyse typologique
Formes ouvertes
Tasse (fig. 3 à 5 et 22) Une quarantaine de fragments en tout, dont une vingtaine de bords, appartiennent à de
petits vases à boire de technique très fine, dont il est souvent difficile de préciser s'il s'agit de tasses ou de gobelets. Appelés conventionnellement tasses, ils se présentent sous trois types : tasse carénée, galbée et tronconique.
1. Tasse carénée (1-6) Forme. Parmi la vingtaine de fragments, dont dix bords, illustrant ce type, la grande
majorité est de profil légèrement angulaire avec épaule à parois convergentes, rectilignes (1- 2) ou arrondies (3) ; ce profil est caractéristique des premières tasses « carénées », non tournées31. Le bord non distinct, à lèvre amincie (diam. entre 6 et 8 cm), est parfois muni d'un petit bec verseur32 (4). Certains fragments conservent l'attache supérieure d'une anse verticale en ruban33 (1). Une base fragmentaire plate (5) doit appartenir à une tasse de ce type34. Un seul fragment de paroi provient d'une tasse à carène bien marquée et épaule concave (6), profil typique des vases tournés35.
Décor. La plupart des exemplaires conservés sont décorés à la barbotine36 : sur l'engobe sombre qui recouvre la surface extérieure du vase et l'intérieur de sa lèvre, des points en argile claire forment des lignes horizontales37, généralement au nombre de trois. Ce décor en
31. BETANCOURT 1985, p. 75, 77-78 et fig. 54 (handmade carinatedcup) ; S. ANDREOU, Pottery Groups ofthe Old Palace Period in Crète (1978), p. 36 et fig. 2: 8-14 (angularcups). Pour des parallèles exacts, à Lerne, v. Zerner 1978, p. 167-170, 172-173 ; 1988, fig. 24 : 3-11 {angular cup on lowfoot) et pour un profil plus arrondi, ibid., fig. 24-25 : 12-20 (roundedcup) ; à Cythère, COLDSTREAM-HUXLEY 1972, pi. 21 (deposity) : 7 ; àÉgine, Kilian-Dirlmeier 1997, pi. 14 : 114 ; à Asinè, NORDQUIST 1997, fig. 31 : 1-2.
32. Zerner 1978, p. 168 et fig. 5 : 15 ; 1988, fig. 24 : 5. 33. D'après des parallèles de Lerne, l'anse peut être aussi de section cylindrique [ibid., fig. 24 : 7). 34. Ce type de tasse repose sur un fond plat ou le plus souvent sur une petite base plate, v. ZERNER 1978 et 1988,
supra n. 31, et S. Andreou, op. cit. (supra, n. 31). 35. On soulignera la rareté, sur l'Aspis, de ce type si populaire en Crète protopalatiale (trois autres exemplaires ont
été trouvés dans le secteur Nord) ; il ne semble guère plus fréquent à Lerne, si l'on en juge d'après le peu d'exemplaires illustrés (Zerner 1988, fig. 25 : 21-23) ; il en est de même à Égine (Kilian-Dirlmeier 1997, p. 140 et fig. 79 : 155-161). Il est en revanche très fréquent à Haghios Stéphanos (RuTTER 1976, p. 23-26, 31).
36. Betancourt 1985, p. 83-84 et fig. 58c (prickles) ; le décor à la barbotine est connu en Crète au moins depuis le MA, il est bien attesté au MM IA, mais c'est au MM IB-IIA qu'il est le plus répandu (MacGilltvray 1998, p. 56) ; v. aussi S. ANDREOU, op. cit. {supra, n. 31), fig. 2 : 8, 11 : 24.
37. Dans un seul cas (non illustré), les points forment une ligne incurvée, probablement une spirale (v. Betancourt 1985, fig. 60A).
BCH 127 (2003)
APERÇU DES CÉRAMIQUES MÉSOHELLADIQUES À DÉCOR PEINT DE L'ASPIS D'ARGOS II 11
Fig. 3. —Tasses carénées (éch. 1/3).
léger relief, situé toujours sur la moitié supérieure du vase, est souvent complété par un décor peint : lignes obliques en blanc sur le bord (1-2). L'exemplaire à bec verseur (4) est décoré dans le style clair-sur-sombre bichrome (PLB2) : lignes angulaires verticales blanches et pourpres38, tandis que l'unique tasse à carène marquée (6) est entièrement recouverte d'engobe noir.
Datation. À Lerne, des tasses légèrement angulaires décorées à la barbotine ou peintes, identiques en tout point à celles de l'Aspis, apparaissent dès la première phase de ΓΗΜ Ι (Lerne VI) ; d'après des parallèles en Crète et à Cythère, ces exemplaires pourraient dater du MM IA39 ou au plus tard du MM IB40. Sur l'Aspis, ces tasses « carénées » proviennent toutes de la couche 4b/c (phase II), ce qui suggère, d'une part, que, contrairement à ce qu'on a longtemps cru, cette couche est contemporaine, au moins en partie, du niveau VI de Lerne, d'autre part, que la première phase d'occupation mésohelladique de l'Aspis (phase II) débute au cours de ΓΗΜ I.
38. Taylour 1972, p. 233 et fig. 16. 39. Zerner 1978, p. 169-170, 173 avec bibliographie ; S. ANDREOU, op. cit. (supra, n. 31) ; N. MOMIGLIANO,
« MM IA Pottery from Evans Excavations at Knossos », ABSA 85 (1991), p. 249-251 et fig. 31 ; ead., « Knossos 1902, 1905 : The Prepalatial and Protopalatial Deposits from the Room of the Jars in the Royal Pottery Stores », ABSA 95 (2000), p. 77, fig. 7 : 10 et p. 83, fig. 10 : 49 ; sur les corrélations entre la Crète et le continent, v. ibid., p. 103.
40. MacGiluvray 1998, p. 75 (roundedcup, type lb) et fig. 2.14 ; v. aussi N. MOMIGLIANO 1991, loc. cit. (supra, n. 39), p. 228, à propos des tasses 34 et 70, sur petite base tronconique.
BCH 127 (2003)
12 Anna PHILIPPA-TOUCHAIS
II convient toutefois de rester prudent quant à la date de l'apparition de ces tasses en Grèce continentale ; il nous paraît en effet peu probable qu'elles y aient été diffusées avant d'avoir été vraiment populaires en Crète même, donc pas avant le début du MM IB. Si donc elles marquent le début de ΓΗΜ, c'est que celui-ci doit être sensiblement contemporain de l'extrême fin du MM IA ou du début du MM IB.
La tasse à décor bichrome (4), que sa forme et son motif inviteraient à dater au plus tard de ΓΗΜ II41, provient de la couche 3, ce qui, dans la mesure où le contexte de la trouvaille ne semble pas perturbé, suggère que le type a pu demeurer en usage pendant assez longtemps. Quant à la tasse à carène très marquée (6), typique en Crète de la phase MM IB/II42, elle a malheureusement été trouvée dans la couche de surface.
2. Tasse galbée ou hémisphérique (7-10) Forme. Le type de la tasse galbée ou hémisphérique à petit bord évasé (7-8) est repré
senté par trois exemplaires de bord, dont aucun ne présente la forme typique de cette tasse, habituellement plus large que haute. Le premier (7), dont seule la moitié supérieure est conservée, est assez étroit et sans doute relativement profond (presque aussi haut que large, diam. bord 7 cm), avec le diamètre maximum placé assez bas ; c'est, semble-t-il, à ce type qu'appartiennent la plupart des tasses hémisphériques à décor polychrome de Lerne43. Le deuxième exemplaire (8), ainsi que le troisième (non illustré) ont l'épaule nettement refermée44 formant presque un petit col cylindrique, au point que l'exemplaire (8) est, par son profil, très proche du type de la cruche en forme d'alabastre45. Quatre ou cinq fragments de fond plat (9-10) proviennent probablement de tasses galbées.
41. WALBERG 1983, motif 31(i)37, Early Kamares (MM IB-IIA) ; à Lerne, des vases de ce type à décor polychrome sont datés MHIlater (Zerner 1988, fig. 24 : 16 ; 25 : 17-19).
42. D'après sa forme, notamment le départ très en biais de la vasque suggérant que la partie inférieure était plus courte que la partie supérieure, cette tasse appartiendrait au type 4 ou 5 de MacGillivray 1998, p. 73 (tall- rimmed angular cup), elle serait donc tournée et daterait du MM IIA ; v. aussi N. MOMIGLIANO, D. WlLSON, « Knossos 1993 : Excavations outside the South Front of the Palace », ABSA 91 (1996), fig. 9 : 19, 23 (ex. datés du MM IB).
43. Zerner 1988, fig. 25 : 25 et 26 : 27-28 (plus grande taille), datés de ΓΗΜ II-III ; v. aussi la tasse de la fig. 27 : 1 (gritty), datée de ΓΗΜ III, avec un parallèle à Argos (DlETZ 1991, p. 236 et fig. 75, type MA-1), daté de 1ΉΜ ΠΙΑ ; v. enfin TAYLOUR 1972, p. 220, fig. 12 : 1.
44. Une tasse à épaule nettement refermée figure parmi le matériel HR I de Lerne (ZERNER 1988, fig. 26 : 35) ; v. aussi J. L. Davis, « Late Helladic I Pottery from Korakou », Hesperia 48 (1979), p. 239, fig. 3 : 2.
45. Type attesté aux Cercles A et Β de Mycènes, à Argos, à Myloi Manti et à Lerne, datant de l'HR IA ou IB (DlETZ 1991, p. 209-210 et fig. 65, type ED-1).
BCH 127 (2003)
APERÇU DES CÉRAMIQUES MÉSOHELLADIQUES À DÉCOR PEINT DE UASPIS D'ARGOS II 13
Décor. Tous les exemplaires ont un décor clair-sur-sombre monochrome (PLM2) sauf un (7), dont le décor est bichrome (PLB2). Sur la tasse (10) on aperçoit à peine une spirale (dont l'œil de la volute est plein ?), tandis que les deux fragments de fond plat présentent un décor sous le fond46 : deux lignes perpendiculaires formant sans doute une croix (9) et une ligne diamétrale (10). Tous ces décors (style, motifs) sont plus ou moins caractéristiques de la période MM IIB-III. En revanche, la tasse (8) est décorée, à la naissance du bord, d'une bande foliacée, motif typique de l'extrême fin de ΓΗΜ, voire de l'HR I47.
7 8 9 10
Fig. 4. — Tasses galbées ou hémisphériques (éch. 1/3).
Datation. Quoique peu nombreuses et assez peu caractéristiques, les tasses hémisphériques trouvées sur l'Aspis s'insèrent toutes, en termes de chronologie minoenne, entre le MM IIB et le MR IA. La tasse (7), assignable au MM II48, est la seule qui appartient à la phase III (HM IIIA), ce qui s'accorde bien avec la datation de ses parallèles en Grèce continentale (v. n. 43). Les tasses (9) et (10), que l'on daterait plus volontiers du MM IIB/IIIA, appartiennent au tout début de la phase IV (HM IIIB/HR IA), ce qui peut paraître tardif mais signifie sans doute qu'en Grèce continentale ces types de la phase Camarès classique demeurèrent en vogue jusqu'à une date avancée. Quant à la tasse (8), qui est l'un des vases les plus tardifs de l'Aspis, elle fournit apparemment un terminus ante quem à la phase IV.
46. Le décor sous le fond des tasses est assez commun à l'époque protopalatiale ; les motifs sont simples, comme ici, ou très élaborés (MacGillivray 1998, pi. 13) ; v. aussi Kilian-Dirlmeier 1997, pi. 15 : 152-154.
47. Voir p. ex., dans la tombe Gamma du Cercle B, les vases 18 (bande foliacée simple) et 36 (bande foliacée double), MYLONAS 1973, pi. 42a, 47b et 241. Pour le même motif au MR IA, v. aussi BETANCOURT 1985, fig. 98.
48. Il est très probable que cette tasse s'inspire d'un type minoen {squat rounded cup) connu à Cnossos dès le MM IB mais dont l'usage se répand dans le reste de la Crète au MM II (MacGillivray 1998, p. 74 et fig. 2. 13 : 1).
BCH 127 (2003)
14 Anna PHILIPPA-TOUCHAIS
3. Tasse ou gobelet tronconique (1 1-14)
Forme. De technique particulièrement fine et soignée49, ce type de vase à boire aux parois rectilignes (straight-sided cup), sans doute muni d'une anse en ruban50, n'est lui aussi représenté que par un petit nombre d'exemples : huit en tout, dont six sont des fragments de moitié supérieure (11-13) (diam. bord entre 7 et 10 cm). Bien qu'aucun profil complet ne soit conservé, il semble que tous ces exemplaires appartiennent à la même variante, assez profonde, aux parois presque verticales51. Un fragment de fond plat (14) (diam. 4,5 cm) pourrait provenir d'un vase de ce type52.
Décor. Tous les exemplaires sont entièrement recouverts d'un engobe foncé (brun, brun- rouge et moins souvent noir) sur lequel est appliqué le décor bichrome (PLB2). Outre des bandes horizontales, le répertoire des motifs comprend des frises de festons pleins placées sous le bord53 (11-12), des spirales54 (13), un rameau horizontal avec feuilles pointues55 (14).
H 12 13 14
Kg. 5. — Tasses ou gobelets tronconiques (éch. 1/3).
49. Avec cependant des parois d'épaisseur irrégulière. 50. On avait d'abord songé à rapprocher cette tasse profonde des tumblers minoens, qui sont dépourvus d'anse
(Betancourt 1985, fig. 76A). 51. Elle est assez proche du type 10 de MacGillivray (1998, p. 71 et fig. 2.10), qui est daté du MM IIB-IIIA. 52. Le type 10, ou même le type 9 de MacGillIVRAY (1998, ibid.), dont paraissent s'inspirer les tasses de l'Aspis,
ont normalement le fond biseauté (bevelled). 53. Le motif du feston plein sous le bord est assez fréquent à Lerne, surtout sur des tasses hémisphériques datant
de 1ΉΜ II et III (Zerner 1988, fig. 25 : 25 ; 26 : 27 ; 27 : 5). Le fragment de bord de la fig. 25 : 23, décoré du même motif, est attribué à une tasse carénée de ΓΗΜ II mais il pourrait aussi bien provenir d'une tasse tronconique. Pour ce motif, assez commun sur des tasses cnossiennes de ce type (MM IB-IIIA), v. MacGillivray 1998, pi. 4 : 119 et 7 : 229, pi. 9-10 et 21-22 ; Walberg 1983, 17 : 5 (phase 3).
54. Heavy Spiral Style (?), suggérant une datation assez avancée, MM IIIA (MacGillivray 1998, p. 64, 71) ; v. aussi Betancourt 1985, fig. 85F (MM III-MR IA).
55. Betancourt 1985, fig. 70 : AG (MM IIB) ou Walberg 1983, 18(i) 4-5 (phase 4, MM IIIA-B).
BCH 127 (2003)
APERÇU DES CÉRAMIQUES MÉSOHELLADIQUES À DÉCOR PEINT DE L'ASPIS D'ARGOS II 15
Datation. D'après leur forme et leur décor, les tasses tronconiques de l'Aspis dériveraient de types du MM IIB-III, période qui correspond, dans la chronologie traditionnelle56, à ΓΗΜ IIB-IIIA. Or les exemplaires de l'Aspis appartiennent tous à la phase IV (HM IIIB/HR I) et les tasses du même type trouvées à Lerne sont elles aussi datées de 1ΉΜ III ou de l'HR I57. Cela suggère, ou bien que les imitations de produits minoens se répandent en Grèce continentale avec un certain retard — phénomène qui n'aurait rien d'étonnant et que l'on observe d'ailleurs en Crète avec la « céramique provinciale » — ou bien que le MM III recouvre une plus grande partie, voire la totalité de ΓΗΜ III. L'étude de l'ensemble des données de la fouille permettra peut-être de trancher entre ces deux hypothèses.
Bol (fig. 6)
La partie supérieure d'un petit bol à parois rectilignes évasées et bord légèrement rentrant (diam. 13 cm) est décorée de motifs rectilignes blancs (lignes obliques alternées) sur fond noir (PLM2) ; des pastilles plastiques à l'extérieur du bord complètent le décor peint. Malgré sa forme58 et son décor « archaïsants », qui renvoient plutôt au début de la période59, le bol de l'Aspis a été trouvé au bas de la couche 3 (v. n. 15).
15
Fig. 6. — Bol (éch. 1/3).
56. R Treuil, P. Darcque, J.-Cl. Poursat, G. Touchais etaL,Les civilisations égéennes du Néolithique et de l'Age du Bronze, Nouvelle Clio. L'histoire et ses problèmes 1 ter (1989), p. 113.
57. Zerner 1988, fig. 26 : 29-32. 58. Il rappelle les bols « à bord rentrant » typiques de ΓΗΑ. 59. À Lerne, un bol du même type mais un peu plus profond, orné d'un décor analogue (ZERNER 1988, fig. 30 :
21),estdatédel'HMI.
BCH 127 (2003)
16 Anna PHILIPPA-TOUCHAIS
Formes fermées
Cruche (fig. 7 à 9 et 23) Les fouilles du secteur Sud-Est de l'Aspis ont produit un nombre limité de cruches60,
qui appartiennent presque toutes au type à bec dressé61.
Cruche à bec dressé (16-18)
Technique et forme. Peu de cruches sont de technique fine, la plupart étant fabriquées en pâte semi-fine62. Malheureusement leur état très fragmentaire ne permet la reconstitution d'aucun profil. Le seul exemplaire dont la panse est partiellement conservée (18) présente un profil piriforme bien prononcé63. Pour le reste, on peut seulement avoir une idée de la forme de certains cols, tantôt assez larges et courts (16) tantôt plus élancés (17).
Décor. Certains exemplaires de fabrique assez fine sont décorés de larges bandes horizontales noires alternant avec de larges bandes non décorées qui donnent l'impression de zones « réservées »64. Deux de ces cruches, de technique très fine et de format réduit, présentent en outre sur l'épaule, dans la zone « réservée », deux ou trois cannelures très peu profondes, formées par de fines lignes horizontales d'argile en relief (fig. 8). On suppose que ce décor s'inspire du décor à la barbotine (waves) pratiqué par les potiers minoens65. De nombreuses cruches décorées dans ce style sont connues à Lerne — l'une d'elles a conservé son profil complet66 — ainsi qu'à Kastri (Cythère)67. Sur l'Aspis, deux anses verticales cylindriques, dont l'une présente une « corne » au sommet de la courbure68, doivent appartenir à cette famille de cruches (fig. 8). D'autre part, la cruche (18), qui porte de larges bandes brun noir bordées de lignes blanches, est décorée dans un style très voisin.
Le décor peint appartient presque exclusivement au style clair-sur-sombre monochrome, PLM2 (17, traces de peinture blanche) ou bichrome, PLB2 (16). Mais les rehauts en peinture blanche et pourpre sont souvent très effacés, au point que parfois on ne distingue plus
60. Il n'est pas facile de faire le compte exact des fragments de cruches car un certain nombre de fragments de parois pourraient appartenir aussi bien à des jarres. Un total de 90 fragments environ peut être attribué avec une relative certitude à des cruches : 20 fragments de bords/becs, une dizaine d'anses, 2 de fonds plats et une soixantaine de parois.
61. Le type à col cylindrique et embouchure horizontale, assez commun à Lerne (ZERNER 1988, fig. 31 : 24, 30 et 32 : 31, 34), n'est représenté sur l'Aspis que par des exemples très rares et incertains, v. n. 70.
62. Les parois sont assez épaisses (0,7-0,9 cm) et irrégulières, la surface lissée sans grand soin (traces de poussoir). 63. En Crète, un tel profil est plus commun au début du MM (Betancourt 1985, fig. 63). 64. Technique White Reserved, v. D. H. FRENCH, op. cit. {supra, n. 5), p. 37. 65. BETANCOURT 1985, p. 83. Zerner (1978, p. 164) note l'absence de parallèle exact en Crète. 66. Zerner 1978, p. 163-165 ; 1988, fig. 31 : 25, 26. 67. CoLDSTREAM-HuxLEY 1972, pi. 21 : 8-9, 11 et pi. 82 : 2. 68. Ces anses ont des parallèles à Lerne (Zerner 1978, p. 163 : « snake's head », et 1988, fig. 31 : 25) et à Cythère
(Coldstream-Huxley 1972, pi. 21 : 35-37).
BCH 127 (2003)
APERÇU DES CÉRAMIQUES MÉSOHELLADIQUES À DÉCOR PEINT DE L'ASPIS D'ARGOS II 17
16 17
Fig. 7. — Cruches à bec dressé (éch. 1/3).
leurs traces qu'en négatif. Sur les vases de style PLM2, les motifs sont rectilignes (bandes horizontales, obliques) ou curvilignes (spirales69, rameaux de feuilles pointues70, fig. 9), tandis que, sur ceux de style PLB2, on retrouve des motifs curvilignes ou floraux empruntés au répertoire du style de Camarès, notamment des rosettes en forme de marguerite71 (fig. 23b).
69. Kilian-Dirlmeier 1997, fig. 88 et pi. 25 : 248-249. 70. On avait d'abord pensé que les fragments portant ce motif provenaient de jarres mais, d'après des parallèles
plus complets d'Égine, ils semblent provenir plutôt de cruches à embouchure horizontale {ibid., fig. 87 et pi. 24 : 240-245).
71. BETANCOURT 1985, fig. 70 : O, Y (MM IIB) ; WALBERG 1976, 10(iv)12 (phase 3) ; ce motif décore aussi, outre de nombreuses tasses, plusieurs cruches minoïsantes d'Égine (KlLlAN-DlRLMEIER 1997, fig. 85-86, pi. 22-23).
BCH 127(2003)
18 Anna PHILIPPA-TOUCHAIS
1
Fig. 8. — Fragments de cruches à cannelures et décor « réservé ».
Fig. 9. — Fragments de cruches à décor clair-sur-sombre monochrome (PLM2).
Datation. Parmi le matériel de l'Aspis, tous les exemplaires de cruches décorées dans le style « réservé » datent de la phase la plus ancienne (couche 4b). Les mêmes vases, à Lerne comme à Kastri (Cythère), sont caractéristiques des tout premiers niveaux de l'habitat (HM I, MM IA72). Il y aurait peut-être là encore, comme pour les tasses carénées (v. supra, p. 11-12), un certain décalage chronologique entre les prototypes crétois, datés du MM IA — ou du début du MM IB car leur décor s'apparente à la barbotine, très populaire pendant cette phase — , et leurs imitations en Grèce continentale, trouvées, du moins sur l'Aspis, dans un niveau qui ne doit pas être antérieur au début du MM IB.
72. COLDSTREAM-HUXLEY 1972, p. 91 {deposity) et communication personnelle de V. Kyriatzi (Rtch Laboratory).
BCH 127 (2003)
APERÇU DES CÉRAMIQUES MÉSOHELLADIQUES À DÉCOR PEINT DE L'ASPIS D'ARGOS II 19
Les quelque soixante fragments de cruches à décor monochrome de style PLM2 proviennent pour moitié de la couche 473 et pour moitié de la couche 3. La répartition strati- graphique est différente pour les cruches à décor bichrome (PLB2) : un tiers seulement des trente-trois fragments trouvés provient de la couche 474, tout le reste de la couche 3. Il faut donc souligner la persistance de ce style à ΓΗΜ IIIB, alors qu'à la même époque sa vogue a nettement décliné en Crète, du moins en Crète centrale.
Jarre (fig. 10 à 1$ et 24 à 28)
C'est à des jarres qu'appartient l'écrasante majorité des fragments de céramique à peinture lustrée recueillis sur l'Aspis75. Deux types principaux ont été reconnus, la jarre à embouchure resserrée et la jarre h krge embouchure, le premier étant plus de deux fois mieux représenté que le second.
A. Jarre à embouchure resserrée
Trois sous-types ont été distingués en fonction de la forme du col, qui peut être tronco- nique, coupé ou cylindrique.
1. Jarre à col tronconique (19-25)
Forme. Vingt-cinq fragments de bord proviennent d'autant de jarres de ce type, dont un exemplaire a pu être restauré presque entièrement76 (19). Il s'agit d'un vase fabriqué en pâte semi-fine mais d'une technique particulièrement soignée (v. supra, p. 6). Par sa taille moyenne (hauteur ca 50 cm) et sa forme, il rappelle de près les jarres du même type à peinture mate77. De profil ovoïde ou piriforme, il est muni d'un col tronconique formant un angle prononcé avec son large bord évasé78 (diam. 11-16 cm, le plus souvent ca 14 cm). Deux anses horizontales, de section cylindrique ou légèrement triangulaire, sont placées à la hauteur du plus grand diamètre. Le fond plat est particulièrement étroit, d'un diamètre sensiblement égal à celui du bord. De nombreux exemplaires de ce type de jarre, en bon état de conservation, ont été trouvés à Lerne79.
73. 32 fragments, dont 21 proviennent de la couche 4b/c 74. Tous de la couche 4a, sauf deux (couche 4b). 75. On a dénombré en tout 300 fragments de jarres, dont 56 bords, 46 anses et une dizaine de fonds, les autres
étant des fragments de parois. 76. Sa hauteur n'est pas tout à fait certaine car il manque le fond. 77. Philippa-Touchais 2002, p. 30-31. 78. Qui tend à se raccourcir et à s'épaissir dans les phases plus tardives (classes PLB1 et PLB2). 79. ZERNER 1978, p. 160-161 ; 1988, p. 9 et fig. 35-38. À Haghios Stéphanos ce type de jarre est aussi assez bien
représenté mais les exemplaires sont très fragmentaires (Rutter 1976, tableau III. 7 : 19-24, 37 ; tableau III. 8 : 93-95, 106-127 ; tableau III. 11 : 314-316 ; tableau III. 12 : 370-398).
BCH 127 (2003)
20 Anna PHILIPPA-TOUCHAIS
Décor. La syntaxe du décor, qui s'organise en plusieurs zones horizontales sur la moitié supérieure du vase, ne semble pas changer au cours du temps ; ce qui change, c'est d'une part le style, d'autre part le répertoire des motifs.
a. — Le style sombre-sur-dair monochrome (PLM1) est de loin le plus commun80 et le plus caractéristique de cette jarre (19-21). Le répertoire des motifs, exclusivement rectili- gnes, est bien défini et standardisé81 : sous le bord entièrement recouvert de peinture sombre, se succèdent de haut en bas des zones constituées respectivement de groupes de lignes obliques, de triangles hachurés82 et de lignes obliques parallèles83. Parfois des lignes de peinture blanche sont appliquées sur l'engobe noir qui recouvre le bord (21). Ce type de jarre, décoré dans ce style précis, est le plus représentatif de la « variante continentale » de la céramique à peinture lustrée (v. supra, p. 3).
b. — Les styles dair-sur-sombre monochrome (PLM2) ou bichrome (PLB2), qui imitent sans doute des styles minoens (« variante minoïsante »), sont attestés par un nombre d'exemplaires beaucoup plus limité (presque deux fois moins)84 (22-24). Le répertoire décoratif du premier (PLM2) (22) comporte surtout des motifs rectilignes, semblables à ceux du PLM1 (fig. 11), tandis que le répertoire du second (PLB2) (23-24) est constitué de motifs aussi bien rectilignes que curvilignes85 (fig. 25a).
c. — Le style sombre-sur-dair bichrome (PLB1) est moins bien représenté que le style PLM1 mais pas de beaucoup (environ un tiers de moins)86 (25). Le motif le plus caractéristique est la frise d'arcades à champ hachuré ou quadrillé87 (fig. 12) ; des lignes ondulées et des files de points sont souvent ajoutées en peinture blanche, noire et pourpre (fig. 25b). Comme on l'a dit plus haut, ce style semble être une variante tardive du style PLM1 puisqu'il n'apparaît pas avant la phase III, au moment où ce dernier décline sérieusement (v. supra, p. 9).
80. Il est représenté par 81 fragments, dont 15 bords. Pour des jarres de Lerne décorées dans ce style, v. ZERNER 1988, fig. 35 : 43-45 et 36 : 48.
81. Il rappelle de façon frappante celui des jarres similaires en PM2 (v. n. 77). 82. Au lieu de chevrons croisés sur les jarres en PM2. 83. À la place de la ligne en zigzag des jarres en PM2. 84. En tout 5 fragments de bords en PLM2 et 3 fragments de bords en PLB2. Pour des exemples, à Lerne, de jar
res décorées dans le style PLM2, v. Zerner 1988, fig. 35 : 46-47, et dans le style PLB2, ibid., fig. 36 : 49-50 et fig. 37.
85. Le décor de ces vases, comme celui des cruches, ressemble beaucoup à celui de certains « vases fermés » (jarres de ce type ?) d'Égine (Kilian-Dirlmeier 1997, fig. 81-82 et pi. 18-19 ; fig. 88 et pi. 25 : 250).
86. En tout 44 fragments, dont un seul bord mais une dizaine de fragments de col/épaule, fournissent une indication sur le nombre minimum de vases.
87. Pour des jarres décorées dans ce style à Lerne, v. ZERNER 1988, fig. 38.
BCH 127 (2003)
APERÇU DES CÉRAMIQUES MÉSOHELLADIQUES À DÉCOR PEINT DE L'ASPIS D'ARGOS II 21
20
23
21 22
25
Fig. 10. — Jarres à col tronconique (éch. 1/5).
BCH 127 (2003)
22 Anna PHILIPPA-TOUCHAIS
Fig. 11. — Jarres à col tronconique à décor dair-sur-sombre monochrome (PLM2).
Fig. 12. — Jarres à col tronconique à décor sombre-sur-dair bichrome (PLB1).
Marques de potier. Les quatre exemples de marques de potier relevés sur la céramique à peinture lustrée du secteur Sud-Est sont tous gravés sur des anses de vases fermés88 (fig. 13). Trois de ces marques se trouvent sur des anses horizontales de section triangulaire, décorées d'une bande de couleur sombre sur la face supérieure, qui proviennent sans doute de jarres
88. Les fouilles du secteur Nord ont produit douze autres exemples de marques, gravées aussi sur des anses de vases fermés. À Lerne, on mentionne une seule marque gravée sur une anse de tasse (ZERNER 1988, fig. 24 : 12), toutes les autres provenant de cruches {ibid., fig. 31 : 25, 27, 29, 30, 32) ou de jarres (ibid., fig. 34 : 41, fig. 36 : 51-53).
BCH 127 (2003)
APERÇU DES CÉRAMIQUES MÉSOHELLADIQUES À DÉCOR PEINT DE L'ASPIS D'ARGOS II 23
Fig. 13. — Marques de potier sur des anses de vases fermés.
à col tronconique ou coupé ; la quatrième est apposée sur une anse de section cylindrique décorée d'une bande sur le dos, qui est plutôt une anse de cruche. Les marques consistent en des combinaisons de traits incisés : traits parallèles ou dessinant des signes plus complexes tels que Ν ou X. Des quatre exemplaires mentionnés, les deux seuls trouvés dans des niveaux en place proviennent de la couche 4b (phase II). À Lerne, des marques analogues datent aussi du début de ΓΗΜ89.
Fonction. D'après sa forme, la jarre à col tronconique paraît destinée à la conservation de denrées exclusivement liquides90, peut-être aussi, pour les plus petits d'entre eux, au service de ces denrées. Il est même possible, vu la forme et le décor standardisés du vase, que son contenu ait été un liquide bien précis. Il est aussi permis de penser que sa technique n'était pas indépendante de son contenu : la composition de la pâte, sa dureté, peut-être aussi la finesse des parois et le traitement particulier de la surface intérieure devaient lui assurer les conditions de conservation souhaitées. Enfin, outre sa valeur utilitaire, ce vase, dont la fabrication et le décor requéraient un certain investissement, devait avoir une valeur symbolique particulière et contribuer au prestige de ses propriétaires (v. infra, p. 36-37).
Datation. La majorité des exemplaires décorés en sombre-sur-clair monochrome (PLM1, « variante continentale ») a été recueillie, comme on l'a vu, dans le premier niveau
89. La plupart des exemples illustrés (v. note précédente) datent de ΓΗΜ I et quelques-uns seulement de ΓΗΜ II ; v. aussi Zerner 1986, p. 67 ; 1993, p. 46 et infra n. 94.
90. Sa forme, qui ne la rend guère maniable par une personne (surtout lorsque le vase était plein), et la minceur de ses parois n'en font pas un récipient adapté au transport. L'étroitesse du fond et l'emplacement du décor suggèrent d'autre pan que le vase devait être partiellement enfoncé dans le sol.
BCH 127 (2003)
24 AnnaPHILIPPA-TOUCHAIS
d'occupation HM (phase II, couche 4b), tandis que les niveaux suivants (phases III-IV, couches 4a et 3) en ont livré beaucoup moins91. Pour les exemplaires décorés dans le style clair- sur-sombre monochrome (PLM2) ou bichrome (PLB2), l'évolution est inverse : minoritaires pendant la phase II, ils deviennent ensuite beaucoup plus fréquents. Quant aux jarres à décor sombre-sur-clair bichrome (PLB1), elles n'apparaissent pas avant la couche 4a et leur présence est nettement plus marquée dans la couche 392.
À Lerne, où l'on connaît de nombreux exemplaires bien stratifiés de ce type, l'image est pratiquement la même93. Pour le site d'Asinè, on dispose d'indications quantitatives concernant l'ensemble de la céramique à peinture lustrée (v. supra, n. 13) mais peu de précisions sur la séquence94. À Haghios Stéphanos, la variante Dull Painted, qui est constituée pour l'essentiel par ce type de jarre, a un taux de fréquence nettement plus élevé à la période I qu'aux périodes II et III (v. supra, n. 13, pour tableaux). À Kastri (Cythère) ce type est rare95. À Égine enfin, il ne semble pas très fréquent96. Dans les publications plus anciennes, où ces vases étaient classés parmi la céramique à peinture mate, on trouve peu d'indications chronologiques : à Argos, l'établissement et la tombe HM de la Deiras, qui ont livré un certain nombre de fragments de jarres de ce type, datent de ΓΗΜ I-II97 ; à Aséa, il semble que des jarres du même type, aussi bien en PLM1 qu'en PLM2, soient présentes dès les niveaux les plus anciens et perdurent pendant toute la période98.
91. Sur un total de 80 fragments, au moins 40 proviennent de la couche 4b, 7 de la couche 4a et une quinzaine de la couche 3 (le reste a été trouvé hors contexte).
92. Sur un total de 44 fragments, une quinzaine proviennent de la couche 4a et le reste de la couche 3. 93. Zerner 1988, p. 9 et fig. 35-38. 94. Le style Dark-on-Light à motifs rectilignes, qui rassemble surtout des jarres de ce type, est daté de ΓΗΜ II ;
le style Light-on-Dark à décor géométrique est aussi daté de la même phase, tandis que les motifs plus élaborés (spirales) et les imitations ou importations du style de Camarès sont assignés à la fin de ΓΗΜ II ; le style Light-on-Dark à décor naturaliste est, quant à lui, daté de ΓΗΜ III (O. FRODIN, A. PERSSON, op. cit. [supra, n. 1], p. 274-278, 294). Les marques de potier fournissent aussi quelques indications : on sait que le site en a fourni en tout 14 sur céramique à PL, appliquées pour la plupart sur des cruches ou des jarres à col tron- conique datant de ΓΗΜ I-II (M. LlNDBLOM, op. cit. [supra, n. 22], p. 119) ; on pourrait en conclure qu'à 1ΉΜ I-II le nombre des vases à PL d'Asinè est à peu près égal à celui de l'Aspis, où l'on a dénombré 16 marques de potier.
95. Zerner (1978, p. 166) reconnaît que l'absence de la « variante continentale » dans le niveau MM IA de ce site ne milite pas en faveur d'une origine locale de la céramique à PL. En effet, la seule jarre de ce type provenant de ce niveau (COLDSTREAM-HUXLEY 1972, fig. 37 : 33) n'est pas décorée ; mais un tesson non illustré (ibid., p. 94 n° 39), considéré comme importé et décoré à la « peinture mate », pourrait en revanche lui appartenir (triangle hachuré).
96. St. HlLLER, loc. cit. (supra, n. 13), p. 197, en compte une vingtaine de fragments. 97. DESHAYES 1966, p. 122-123, 137, et G. TOUCHAIS, « Argos à l'époque mésohelladique : un habitat ou des
habitats ? », in A. PARIENTE, G. TOUCHAIS (éds), Argos et l'Argolide : Topographie et urbanisme. Actes de h Table ronde organisée par l'École française d Athènes et L· 4e Éphorie des antiquités préhistoriques et classiques, Athènes- Argos, 28 avril-l^ mai 1990, RechFH 3 (1998), p. 75.
98. E. J. Holmberg, op. cit. (supra, n. 1), p. 100-102.
BCH 127 (2003)
APERÇU DES CÉRAMIQUES MÉSOHELLADIQUES À DÉCOR PEINT DE L'ASPIS D'ARGOS Π 25
2. Jane à col coupé (26-30)
Forme. Seize fragments de bord proviennent de ce type de jarre, dont nous avons distingué trois variantes. Les fragments (26-27) appartiennent à la première variante qui, d'après des exemplaires à profil complet de Lerne, présente de fortes analogies avec la jarre à col tronconique, aussi bien du point de vue de la technique que du profil et du décor" ; la différence majeure réside dans la forme de l'embouchure : celle de la jarre à col coupé est un peu plus large (entre 15 et 18 cm) et se termine par un petit col cylindrique (26) ou une lèvre épaissie (27). Un exemplaire tout à fait particulier100 (28) est muni d'un petit col cylindrique très resserré (diam. 7 cm), la panse ayant sans doute un profil ovoïde. Les exemplaires de la troisième variante, dépourvue de col (29-30), renvoient à un type minoen par excellence, la jarre à bec ponté et épaule convexe101 ; le bord, à lèvre épaissie et aplatie (30), est cependant moins caractéristique de ce type de jarre102.
Décor. On retrouve les quatre styles de décor déjà cités sur la jarre à col resserré. Les jarres de la première variante sont pour la plupart décorées en sombre-sur-dair monochrome (PLM1) (26-27) ; il existe aussi trois exemplaires en dair-sur-sombre (PLM2). Le récipient à petit col cylindrique resserré (28), déjà unique par sa forme, porte aussi un décor particulier, fait de bandes horizontales brun-noir et rouges (PLB1). Les deux jarres à bec ponté (29-30) sont décorées en dair-sur-sombre bichrome (PLB2).
Datation. La plupart des exemplaires de jarre à col coupé de l'Aspis datent de la phase II (couche 4b) : c'est le cas de tous les vases de la première variante103 sauf un (26), qui a été trouvé dans la couche 3 et témoigne ainsi de la survivance du type, mais aussi de la préférence pour la peinture rouge dans la phase tardive (HM IIIB/HR I). À Lerne, les parallèles de cette variante datent également de la première phase HM. La jarre ovoïde (28) provient, elle aussi, du niveau HM le plus ancien de l'Aspis, comme d'ailleurs la première des deux jarres à bec ponté (29) ; en Crète, le type de cette dernière est daté au plus tôt du MM IIA et au plus tard du MM ΠΙΑ104, ce qui donne l'étendue du spectre chronologique du matériel minoen de la phase II de l'Aspis. En revanche, la deuxième jarre « à bec ponté » (30),
99. Zerner 1988, fig. 34 : 41-42. 100. Le seul parallèle possible est une jarre avec des traces de peinture rouge, provenant d'un niveau MA II-
MM IA (depositfS) de Kastri (Coldstream-Huxley 1972, fig. 37 : 74). 101. MacGillivray 1998, p. 78-79 et fig. 2.16 : types 3-5 (MM IIA-IIIA). On connaît un seul exemplaire de ce
type provenant de Lerne et daté de ΓΗΜ II (ZERNER 1988, fig. 33 : 38). En revanche, il en existe plusieurs à Égine (Kilian-Dirlmeier 1997, fig. 79 : 162-163, 80 : 168-171, 85 : 226), pour la plupart à lèvre légèrement surélevée (v. note suivante).
102. Un fragment de bord identique, à lèvre épaissie, provient de Lerne (ZERNER 1988, fig. 33 : 39) et date aussi de ΓΗΜ II. En Crète, le type le plus évolué de cette jarre (MM IIB-III) est par ailleurs muni d'une lèvre légèrement surélevée (MacGillivray 1998, fig. 2.16 : type 6 et p. 80).
103. Ce qui n'est pas surprenant, vu la prédominance du style PLMl parmi eux. 104. Cf. supra, n. 101.
BCH 127 (2003)
26 Anna PHIUPPA-TOUCHAIS
29
Fig. 14. —Jarres à col coupé (éch. 1/5).
Fig. 15. — Jarres à col coupé.
BCH 127 (2003)
APERÇU DES CÉRAMIQUES MÉSOHELLADIQUES À DÉCOR PEINT DE L'ASPIS D'ARGOS II 27
dérivée d'un type qui, dans la séquence minoenne, n'apparaît qu'au MM IIB105, a été trouvée dans un contexte de la phase III (HM ΠΙΑ), ce qui confirmerait la survivance, au cours de cette dernière, de matériel assignable à la phase Camarès classique (v. supra, p. 13, 15).
3. Jarre à col cylindrique ou amphore (31-34)
Forme. Une quinzaine de cols cylindriques plus ou moins fragmentaires appartiennent très probablement à des jarres, que l'on peut désigner aussi comme des amphores car, si l'on en juge par des parallèles mieux conservés ailleurs106, elles possédaient toujours deux anses. Leur bord (diam. entre 11 et 14 cm) est généralement retourné, avec une lèvre aplatie (31) ou pourvue d'un léger bourrelet médian (32). Parmi les exemplaires plus rares dont le bord ne se distingue pas du col concave (33-34), un seul a conservé l'attache supérieure d'une anse verticale de section ellipsoïdale (33). D'après les parallèles évoqués ci-dessus, l'épaule était convexe, la partie inférieure de la panse sans doute tronconique, ce qui lui donnait un profil ovoïde.
Décor. Les deux cols à bord retourné (31-32) sont recouverts d'un engobe brun-rouge sur lequel est appliqué le décor, très effacé, en peinture blanche et rouge (lignes horizontales rectilignes et ondulées). Sur le troisième exemplaire (33) des bandes rouges bordées de lignes blanches sont peintes sur le fond clair bien lissé du vase (PLB1) ; quant au quatrième (34), il porte un décor simple dans le style PLM2 (deux lignes blanches sur l'engobe noir).
Datation. Tous les récipients de ce type trouvés sur l'Aspis proviennent de la couche 3, sauf un, qui est issu de la couche 4a (33). À Lerne, des amphores/jarres bichromes à col concave sont présentes dans les niveaux de ΓΗΜ II, mais c'est de ΓΗΜ III que date l'unique amphore à bord retourné publiée jusqu'à présent107. Les tombes du Cercle Β de Mycènes fournissent aussi plusieurs parallèles, qui ne sont pas antérieurs à ΓΗΜ ΙΙΙΒ108. Tout indique donc que ce type est relativement tardif.
105. Cf. supra, n. 102. 106. Zerner 1988, fig. 40 : 67 ; DlETZ 1991, fig. 75, types MB-1, MB-2 (avec parallèles), datés de l'HM HIB. 107. Zerner 1988, fig. 39 et 40. 108. DlETZ 1991, supra, n. 106.
BCH 127 (2003)
28 Anna PHILIPPA-TOUCHAIS
32
34
Fig. 16. — Jarres à col cylindrique ou amphores (éch. 1/3).
B. Jarre à large embouchure ou pithos (35-37)
Technique et forme. Ce type de vase de stockage {pithos ridged), fabriqué en pâte grossière, est représenté par trois fragments de bord (35-37). Il s'agit d'un récipient à panse sans doute ovoïde109, dont l'embouchure a un diamètre qui oscille entre 23 et 36 cm environ. Le bord, non distinct de l'épaule, est souligné par un cordon en saillie, qui, outre sa fonction esthétique (décor plastique) avait sans doute une fonction pratique (moyen de préhension ou sorte de collet pour maintenir un couvercle).
Décor. Ce type de jarre, au moins dans sa version la plus grossière (35, 36), est généralement décoré, dans sa partie supérieure, d'une série de larges cannelures horizontales peu profondes. Outre ce décor plastique, le vase porte un décor peint « réservé » : un engobe foncé, noir ou brun-rouge, recouvre la surface extérieure110 sauf certaines cannelures, ce qui don-
109. D'après un vase de Lerne dont la partie supérieure est conservée, avec des anses horizontales de section cylindrique sur l'épaule (Zerner 1988, fig. 41 : 1).
110. Comme il n'existe pas de parallèle complet, on ignore si l'engobe recouvrait toute la surface extérieure du vase ou seulement sa partie supérieure. Sur un vase de Lerne de forme analogue mais de plus petite taille, dont le profil est conservé, l'engobe s'étend jusqu'à la base (ZERNER 1988, fig. 33 : 37).
BCH 127 (2003)
APERÇU DES CÉRAMIQUES MÉSOHELLADIQUES À DÉCOR PEINT DE UASPIS D'ARGOS II 29
35
Fig. 17. — Jarres à large embouchure ou pithoi (éch. 1/3).
naît l'impression de bandes blanches111 (fig. 18). L'exemplaire de taille plus réduite porte en outre un décor peint dans le style clair-sur-sombre monochrome (37).
Trois fragments de parois et un fragment de fond plat doivent provenir d'un ou deux grands pithoi décorés de coulures de peinture sombre (fig. 19), un décor particulièrement populaire dans la Crète minoenne. Il est intéressant de noter que, d'après les résultats de l'analyse pétrographique de l'un de ces fragments, il s'agirait du seul vase importé de Crète, probablement de la région de la Messara112.
Datation. À Lerne cette jarre apparaît dès le début de ΓΗΜ, plus précisément vers la fin de la phase VI113, tandis qu'à Kastri des fragments de pithoi à cannelures datent du MM IA114. C'est aussi des niveaux HM les plus anciens (couche 4b/c) que proviennent, sur
111. Même décor que sur les cruches de fabrique fine {supra, p. 16 et n. 64). Parfois les bandes sont effectivement recouvertes de couleur blanche diluée, v. aussi Zerner 1978, p. 164.
112. Communication personnelle de V. Kyriatzi (Fitch Laboratory). 1 13. Zerner 1978, p. 165, qui fait observer que cette forme rappelle un type minoen du MM IA (avec parallèle à Cnossos).
114. Coldstream-Huxlev 1972, fig. 21 : 19-21.
BCH 127 (2003)
30 Anna PHILIPPA-TOUCHAIS
l'Aspis, l'exemplaire (35) ainsi que tous les fragments de parois décorés de cannelures. Les deux autres fragments (36-37) ont été trouvés dans la couche 3. Les données de l'Aspis confirment donc l'apparition relativement précoce de ce type dans le répertoire HM et sa persistance jusqu'à la fin de la période, mais dans une variante moins grossière et portant un décor peint plus élaboré.
Kg. 18. — Fragments de pithoi à cannelures et décor « réservé
Fig. 19. — Fragments de pithoi à coulures.
BCH 127(2003)
APERÇU DES CÉRAMIQUES MÉSOHELLADIQUES À DÉCOR PEINT DE L'ASPIS D'ARGOS Π 31
Couvercle (fig. 20 à 21 et 29)
Technique et forme. Dix récipients cylindriques peu profonds, fabriqués en pâte semi- fine et décorés sur la face extérieure, ont été identifiés comme des couvercles (38-41). Leur profil est complet, ce qui permet de constater que, malgré une hauteur constante (entre 3 et 4 cm), ils ont un diamètre qui varie considérablement (entre 14 et 38 cm). Il faut aussi noter que leur forme est très proche des exemplaires à peinture mate en pâte micacée115. Comme ces derniers, on les verrait volontiers servir à boucher des vases de stockage, auxquels ils s'adapteraient particulièrement bien, les jarres à col tronconique (celles dont l'embouchure mesure ca 14 cm), mais surtout les jarres à col coupé (diam. ca 20 cm) ou les pithoi (diam. entre 26 et 38 cm). Outre leurs dimensions, deux autres éléments confortent cette hypothèse : leur pâte et leur décor, analogues à ceux de ces jarres.
Décor. Sur les huit exemplaires dont le décor est lisible, quatre sont décorés en sombre- sur-clair monochrome (PLM1) (38-40) et quatre en dair-sur-sombre monochrome (PLM2) (41). Les motifs des deux premiers styles sont rectilignes : triangles hachurés ou quadrillés (38), lignes obliques parallèles (40) ou alternées (39). Le décor du récipient (41) est particulièrement élaboré : triple arcade et groupes de (4 ?) gros points116.
Datation. Si l'on excepte un fragment trouvé hors stratigraphie (38) et deux dans la couche 3 (PLM2 et sans décor), tous les autres exemplaires de l'Aspis proviennent de la couche 4b (39-41), ce qui s'accorde bien avec leur style de décor primitif. Des exemplaires tout à fait semblables à Lerne117 sont datés de ΓΗΜ I. Le type, qui a des antécédents en Egée au Bronze Ancien118, est aussi connu par quelques exemplaires à Kastri de Cythère datant du MM LA.119 et à Haghios Stéphanos120, mais aussi en Crète, du MA à l'époque protopalatia- le et au delà121.
115. Les « couvercles » en PM2 trouvés sur l'Aspis sont en général de taille plus standardisée (diam. 13 cm) (Phiuppa-Touchais 2002, p. 35-36)
116. Pour les groupes de points, v. Walberg 1983, motif l(iv)l (phase 1, Pre-Kamares) ; les arcades sont aussi un motif qui apparaît dès le MA III, v. ibid., motif 9(vii) et (viii), et continue jusqu'à la phase 2 sous des variantes plus simples {ibid., p. 44).
117. Zerner 1978, p. 165 ; 1988, fig. 29 : 13-15, décorés en PLM1 et PLM2 et interprétés comme des plats. 118. Philippa-Touchais 2002, p. 36 et n. 174. 119. COLDSTREAM-HUXLEY 1972, fig. 37 : 88, 90 {depositfi) et 32 (deposity), considérés comme des plats. 120. TAYLOUR 1972, fig. 38 : 1-2, exemplaires décorés en PLM2 et interprétés comme des bols. 121. Y. Sakellarams, E. SakELLARAKI, Αρχάνες. Μια νέα ματιά στη μινωική Κρήτη (1997), ρ. 392-393 et fig. 345 ;
MacGillivray 1998, pi. 117 ; D. Levï, F. Carinci, Festàs e la Civikà Minoica II (1988), p. 231-232 et pi. 98 : g, h.
BCH 127(2003)
APERÇU DES CÉRAMIQUES MÉSOHELLADIQUES À DÉCOR PEINT DE L'ASPIS D'ARGOS Π 33
i il·
ï r
Fig. 21. — Couvercles.
3. Conclusions
Données quantitatives et chronologiques
Les trouvailles de l'Aspis confirment le caractère marginal de la céramique à peinture lustrée au sein de la production mésohelladique. Une céramique cependant présente dans tous les niveaux de l'habitat, mais avec un taux de fréquence variable puisqu'il passe de plus de 7 % dans le niveau de ΓΗΜ IB-II (phase II) à moins de 3 % dans ceux de ΓΗΜ III (phases III et IV).
La phase II (couche 4b/c) est marquée par la prédominance du style PLMl (« variante continentale »), le style PLM2 étant lui aussi bien attesté mais sa variante bichrome (PLB2) encore très marginale. À partir de la phase III le tassement des céramiques à peinture lustrée affecte surtout le style monochrome PLMl : dans la couche 4a le taux de fréquence des deux styles monochromes (PLMl et PLM2) paraît sensiblement égal, mais l'exiguïté des zones dans lesquelles cette couche a été fouillée interdit de l'affirmer ; dans la couche 3, en revanche, on constate un recul sensible du style PLMl au profit des trois autres (PLM2, PLB1, PLB2) ; dans cette dernière couche, qui correspond à la phase IV, ce sont les types minoï- sants qui prédominent.
50/127(2003)
34 Anna PHIUPPA-TOUCHAIS
Le recours à la céramique minoïsante pour dater les contextes helladiques requiert cependant une certaine prudence. Nous avons en effet constaté à plusieurs reprises qu'il existe un décalage chronologique patent entre l'apparition de certains types céramiques en Crète122 et leur diffusion à Argos, ce qui n'a somme toute rien d'étonnant.
La phase II de l'Aspis (HM IB-IIB) possède un matériel minoïsant comportant, d'une part, des types inspirés du MM IA/IB initial — ce qui suggère que le milieu de ΓΗΜ I est contemporain du début du MM IB — , d'autre part, les premières imitations de vases du MM IIB/IIIA — ce qui ferait pratiquement coïncider la fin de ΓΗΜ II avec celle de la phase Camarès classique.
La phase III (HM ΠΙΑ) est caractérisée par la présence de types dérivés de la production du MM IIB/IIIA, c'est-à-dire du Camarès classique (motifs naturalistes), mais aussi par celle de vases assignables au MM IIIB, ce qui invite à considérer cette dernière phase comme le terminus ante quem de ΓΗΜ ΠΙΑ. Si tel est le cas, la présence d'imitations de Camarès classique dans un contexte continental ne signifie pas que celui-ci est forcément contemporain du MM II ; il peut en effet dater d'une phase légèrement postérieure, pendant laquelle la céramique de Camarès continuait d'inspirer les ateliers locaux123.
Quant au matériel minoïsant de la phase IV (HM IIIB/HR IA), il est assignable au MM IIIB et au tout début du MR I. Les données stratigraphiques de l'Aspis semblent concorder, dans les grandes lignes, avec celles d'Haghios Stéphanos124.
Caractères physiques de la céramique à peinture lustrée
Technologie. L'un des traits fondamentaux de cette céramique, mis en évidence par les analyses physico-chimiques, est la grande homogénéité qui, par delà les différences macroscopiques, caractérise aussi bien sa composition que sa technologie. Mais les analyses ont aussi montré que, si cette technologie se rattache clairement à la tradition minoenne, il n'y a pratiquement pas d'importations Cretoises, même parmi la classe à pâte fine qui imite si
122. Notamment en Crète centrale et orientale, où l'on dispose de matériel publié. 123. C'est cependant la présence, entre autres vases, d'un bol à bec ponté de style Camarès classique qui amène
I. Kilian-Dirlmeier (1997, p. 66) à dater de l'HM II la tombe à fosse aménagée devant le rempart de Kolona. À la lumière des données stratigraphiques de l'Aspis, ce bol — qui pourrait être une imitation plutôt qu'une importation et qui, par sa forme (MacGillivray 1998, fig. 2.16 : 5) et son décor (WALBERG 1976, motif 105[iii] 6), daterait plutôt du MM IIB-IIIA — aurait parfaitement sa place dans un contexte de ΓΗΜ ΠΙΑ ; ν. aussi DlETZ 1991, p. 314 et tableau p. 321.
124. Où l'HM II (phases I et II) correspond au MM ΠΙΑ, l'HM ΠΙΑ (phase III) au MM IIIB-MR IA initial et l'HM IIIB-HR IA (phase IV) au MR IB initial à Haghios Stéphanos, v. RUTTER 1976, p. 26, 32, 45-46, 58-60.
BCH 127 (2003)
APERÇU DES CÉRAMIQUES MÉSOHELLADIQUES À DÉCOR PEINT DE L'ASPIS D'ARGOS II 35
bien la céramique protopalatiale. Cette homogénéité très forte suggère que l'ensemble des vases à peinture lustrée représente une production contrôlée, issue d'une tradition technologique commune et sans doute aussi d'un centre de fabrication commun, ou du moins d'un nombre restreint d'ateliers opérant dans une région bien déterminée.
Formes. Du point de vue du répertoire, il convient de souligner quatre points : la prépondérance des vases fermés ; l'introduction de petits vases à boire individuels125 ; la gamme limitée des types (tasse, cruche, jarre) ; la coexistence de formes helladiques (jarre à col tron- conique) et de formes minoennes (tasse, cruche).
Les deux premiers traits sont sans doute liés au fait que cette céramique était conçue pour la conservation et la consommation de denrées exclusivement liquides, donc à sa fonction et à son rôle social (v. infra, p. 36-37). Quant aux deux derniers, ils témoignent respectivement du caractère de production spécialisée de la céramique à peinture lustrée, et de la multiplicité des influences et des traditions qui ont présidé à sa genèse — car si la technologie est d'inspiration minoenne, le répertoire des formes trahit une « connexion » continentale. Ces deux derniers traits sont ceux qui permettent le mieux de caractériser l'atelier de production (v. infra, p. 38-39).
Décor. Contrairement au décor de la céramique à peinture mate, qui est en général assez simple et répétitif, celui de la céramique à peinture lustrée est riche et foisonnant, parfois même un peu extravagant, ce qui le rattache alors clairement à une esthétique étrangère au domaine helladique. L'organisation du décor reflète elle aussi une conception différente, qui envisage la surface du récipient de façon plus globale, la couvrant d'un dessin plus complexe, préétabli et réfléchi. Il faut cependant souligner que, des quatre styles décoratifs distingués, les deux qui imitent des styles minoens (PLM2, PLB2) sont appliqués sur des formes typiquement minoennes, tandis que la jarre helladique est initialement décorée dans un style d'origine plutôt helladique (PLM1, rappelant le « style dense » de ΓΗΑ III) et progressivement dans tous les autres styles (PLM2, PLB1, PLB2)126.
Il est évident que la polychromie, les motifs souvent très élaborés et la conception « globalisante » du décor devaient requérir une technique très au point, dépassant les possibilités d'une production domestique occasionnelle et relevant sans doute d'un artisanat spécialisé.
125. Ce genre de récipient était pratiquement absent du répertoire traditionnel des vases à boire helladiques, où prédominent les vases ouverts de taille moyenne, donc de plus grande capacité (canthares) ; ceux-ci ne sont guère adaptés à un usage individuel et ce n'est sans doute pas un hasard si les rares petits vases à boire individuels en céramique à PM sont tous des types tardifs (Philippa-Touchais 2002, p. 17, 22-24). Un phénomène parallèle a été observé au Bronze Récent en Macédoine, où les petits vases à boire, absents du répertoire des potiers locaux, sont empruntés à la céramique mycénienne, v. K. A. WÀRDLE, D. WARDLE, N. M. H. Wardle, « The Symposium in Macedonia : A Prehistoric Perspective », ΑΕΜΘ 15 (2001), p. 631- 643, surtout p. 641.
126. C'est ce que Zerner (1978, p. 163) appelle une « fusion » des deux variantes, continentale et minoïsante.
2X3/127(2003)
36 Anna PHIUPPA-TOUCHAIS
L'opulence du décor signe en outre le caractère luxueux de cette céramique et l'exclut d'un usage domestique quotidien.
Les choix technologiques qui transparaissent à travers l'ensemble des caractères physiques de cette céramique ne peuvent être fortuits. Ils sont sans doute liés, dans une certaine mesure, à sa fonction et à sa valeur sociale127.
Fonction et valeur sociale de la céramique à peinture lustrée
Contenant et contenu. L'apparition de nouveaux types de récipients est souvent liée à l'introduction de nouvelles denrées ou, d'une manière plus générale, à des changements dans les pratiques alimentaires. Il est fort probable que la présence des vases à peinture lustrée reflète un tel phénomène. Mais étant donné que ces vases ne se substituent pas aux types helladiques traditionnels et que, d'autre part, leur nombre est limité, les changements qu'ils introduisent ne doivent pas modifier fondamentalement les comportements alimentaires locaux ni affecter l'ensemble de la société.
D'autre part, le fait que toutes les formes du répertoire de cette céramique ont un rapport avec les denrées liquides — et même avec les trois fonctions (conservation, service, consommation) liées à celles-ci — suggère qu'au moins un certain nombre de ces vases128 constituaient des « services » {drinking sets)129. Dans cette hypothèse, il se pourrait que le produit qui était importé (?) et conservé dans les jarres appartenant à un tel « service » soit le même que celui qui était servi et consommé dans les cruches et les tasses correspondantes ; c'est bien sûr à du vin — ou à une boisson de ce type — que l'on pense, plutôt qu'à de l'huile.
On peut toutefois se demander si la plus grande variabilité, à la fois morphologique et ornementale, qui caractérise les jarres n'est pas en rapport avec celle de leur contenu, autrement dit si elles n'étaient pas destinées à contenir des produits différents, ou diverses variétés d'un même produit130. Nous ne disposons pour l'instant d'aucune indication sur la
127. G. HOURMOUZIADIS, « Εισαγωγή στο νεολιθικό τρόπο παραγωγής », Ανθρωπολογικά 2 (1981), ρ. 41. 128. Notamment les cruches, les tasses et certaines amphores décorées dans le même style (PLM2, PLB2). 129. Notion proposée, dans leur étude de la céramique mycénienne de Macédoine, par K. A. WARDLE,
D. WARDLE, N. M. H. Wardle, loc. cit. {supra, n. 125), p. 632 ; v. aussi G. NoRDQUIST, « Pairing of Pots in the Middle Helladic Period », in Ph. P. BETANCOURT, V. KARAGEORGHIS, R. LAFFINEUR, W.-D. NlEMEIER (éds), Meletemata. Studies in Aegean Archaeofogy Presented to Makom H. Wiener as he Enters his 65th Year, Aegaeum 20 (1999), p. 569-573.
130. Ce serait peut-être pousser un peu trop loin l'hypothèse que de suggérer que la jarre de tradition helladique (à col tronconique) était destinée, à l'origine, à la conservation d'un produit local. Rappelons cependant qu'une hypothèse non moins audacieuse a été proposée par J. Rutter à propos du contenu des jarres à étrier
BCH 127 (2003)
APERÇU DES CÉRAMIQUES MÉSOHELLADIQUES À DÉCOR PEINT DE L'ASPIS D'ARGOS II 37
nature de ce (ou ces) produit(s)131. Il y a cependant tout lieu de penser que, comme le contenant n'était apparemment pas destiné à un usage quotidien, le contenu ne devait pas non plus être d'une consommation courante. Il s'agirait donc d'une boisson qui était consommée en des occasions particulières (banquets ?), sans doute par un nombre limité de personnes.
Rôle social et valeur symbolique. Comme nous l'avons déjà dit ailleurs132, s'il est vrai qu'en Crète — à Cnossos notamment — les vases du style de Camarès étaient peut-être liés à une consommation rituelle de boisson à travers laquelle les élites auraient manifesté et renforcé leur statut dominant133, on peut penser que la présence, en Grèce continentale, d'imitations de cette céramique est l'écho d'une pratique analogue. Si tel est le cas, les vases minoïsants acquièrent un intérêt particulier par la lumière qu'ils jettent sur la société mésohelladique mais aussi sur la nature et le degré de l'influence Cretoise en Grèce continentale134. Car la fabrication de ces vases et leur diffusion sur le continent n'est probablement pas indépendante de l'affirmation, directe ou indirecte, du pouvoir politique et économique de la Crète protopalatiale, au delà même de ses frontières naturelles. L'usage de cette céramique au sein des populations mésohelladiques suggère en tout cas l'existence de groupes sociaux se référant à la symbolique et à l'idéologie minoennes et essayant de s'imposer par l'imitation de pratiques « palatiales ».
Mais qu'ils aient été liés ou non à de telles pratiques, les vases minoïsants, en tant que vecteurs d'une esthétique originale et objets à forte « valeur de distance »135, devaient de toute façon être considérés comme des biens de prestige dont la possession était un indicateur de statut social élevé.
HR III C du « style au poulpe », v. J. RuTTER, « Cultural Novelties in the Post-Palatial Aegean World : Indices of Vitality or Décline ? », in W. A. Ward, M. S. JOUKOWSKY (éds), The Crisis Years : The I2th Century B.C. from Beyond the Danube to the Tigris (1992), p. 63-64.
131. C'est dans l'espoir d'obtenir de telles indications que des analyses chimiques par chromatographie sont actuellement menées par O. Decavallas sur un certain nombre de tessons (v. BCH 126 [2002], p. 498).
132. A. Philippa-Touchais, « Μινωική και Μινωίζουσα κεραμική στον Ελλαδικό χώρο κατά τη Μέση Χαλκοκρατία. Νέα δεδομένα από το ΜΕ οικισμό της Ασπίδας του 'Αργούς », in Actes du 9e Congrès Crétologique, Ébunda, 1-7 octobre 2001 (sous presse).
133. P. M. Day, D. E. Wilson, « Consuming Power : Kamares Warc in Protopalatial Knossos », Antiquity 72 (1998), p. 350-358, surtout p. 356-357.
134. Sur le rôle des objets de prestige crétois dans le processus d'émergence de la société mycénienne, v. J. C. WRIGHT, " From Chief to King in Mycenaean Society ", in P. Rehak (éd.), The Rôle ofthe Ruler in the Prehistoric Aegean. Proceedings ofa Panel Discussion Presented at the Annual Meeting ofthe Archaeological Institute of America, New Orléans, Louisiana, 28 December 1992. With Additions, Aegaeum 1 1 (1995), p. 63- 80 (avec bibliographie).
135- Objets utilitaires dont la valeur et la demande augmentent à raison de l'éloignement de leur lieu de fabrication, v. E. H. CliNE, « Coals to Newcastle, Wallbrackets to Tiryns », in Ph. P. BETANCOURT, V. Karageorghis, R. Laffineur, W.-D. Niemeier (éds), op. cit. {supra, n. 129), p. 1 19-123, avec la bibliographie récente sur le sujet.
BCH 127 (2003)
38 AnnaPHILIPPA-TOUCHAIS
Le centre de production de la céramique à peinture lustrée
Comme nous l'avons rappelé plus haut, on a aujourd'hui tendance à situer le centre de production de cette céramique quelque part dans le Sud-Est du Péloponnèse, mais les données archéologiques ne permettent pas encore de le localiser avec plus de précision. Il n'est cependant pas inutile de formuler certaines hypothèses sur les caractères de ce centre de production, car on pourra ainsi mieux en cerner l'originalité et entrevoir la place qu'il occupait au sein de l'ensemble du dispositif productif de la Grèce mésohelladique.
Un atelier spécialisé. La frontière entre artisanat domestique et atelier spécialisé est bien difficile à tracer puisque, comme l'a souligné une étude récente, même des produits céramiques relevant d'une technologie complexe peuvent être élaborés dans le cadre d'un artisanat domestique n'impliquant ni l'intervention de spécialistes (au sens de « professionnels ») ni même l'existence d'installations particulières136. Cela dit, on peut considérer qu'une production céramique spécialisée137, caractérisée avant tout par sa fonction spécifique138, son homogénéité139 et sa diffusion hors du cadre local, ne peut être issue d'un artisanat domestique.
La céramique à peinture lustrée se définit justement, comme on l'a vu, par sa grande homogénéité technologique, doublée d'une standardisation morphologique. Plusieurs autres éléments renforcent l'idée qu'il s'agit d'une production spécialisée140 : sa haute qualité, résultant du soin et de la précision mis en œuvre dans son exécution, son contexte d'utilisation sans doute particulier et sa relative rareté au sein de l'habitat. On peut donc raisonnablement penser qu'elle est le produit d'un atelier expérimenté. Il faut souligner aussi l'esprit créatif et innovant de cet atelier. Car il ne se contente pas de copier : il crée des types originaux qui combinent des éléments issus des traditions helladique et minoenne, sans doute pour satisfaire les exigences d'une clientèle aux goûts et aux conceptions variées.
136. G. NORDQUIST, « Who Made the Pots ? Production in the Middle Helladic Society », in R. Laffineur, W D. NlEMEIER (éds), Politeia. Society and State in theAegean Bronze Age. Proceedings ofthe 5th International Aegean Conférence. Universiiy ofHeidelberg, Archdologisches Institut, 10-13 April 1994, Aegaeum 12 (1995), I, p. 201-207, notamment p. 205.
137. K. Kotsakis, Κεραμεική τεχνολογία και κεραμεική διαφοροποίηση (1983), ρ. 218-219, 268-271. 138. P. M. RlCE, « Evolution of Specialized Pottery Production : ATrial Model », Current Anthropology 22 (1981),
p. 222-223. 139. Liée au petit nombre de potiers impliqués, par opposition à la production domestique dont le fort degré d'hété
rogénéité reflète « les capacités, les intérêts et les besoins » de chaque individu, qui varient « pour des raisons biologiques et psychologiques, mais aussi sociales et culturelles », W. H. Davis, « Comment on Rice », ibid., p. 228.
140. G. NORDQUIST, loc. cit. (supra, n. 136), p. 205-207, pense à une production spécialisée mais qui constituait « an important supplément to the economy in areas of poor agriculture and perhaps as a type of village industry ».
SCH 127 (2003)
APERÇU DES CÉRAMIQUES MÉSOHELLADIQUES À DÉCOR PEINT DE L'ASPIS D'ARGOS Π 39
Au carrefour de plusieurs traditions. La mise en œuvre d'une technologie de tradition minoenne et l'imitation très réussie de vases minoens trahissent bien évidemment une connaissance approfondie de la production des ateliers crétois. Il ne serait d'ailleurs pas étonnant que les fondateurs du premier atelier de céramique à peinture lustrée soient des potiers venus de Crète141. Pour autant, cet atelier n'ignorait pas la tradition helladique, à laquelle appartient incontestablement la jarre à col tronconique, forme connue sur le continent depuis l'époque néolithique142.
Mais il existe aussi, à notre avis, une troisième connexion qui a été méconnue jusqu'à présent. Plusieurs éléments, d'ordre technologique pour la plupart, suggèrent en effet une certaine affinité avec la production d'Égine : 1) les stries à l'intérieur des vases fermés, très caractéristiques des jarres à peinture lustrée, se retrouvent souvent aussi sur les vases de stockage à peinture mate en pâte micacée, notamment les jarres piriformes ou barreljars14^ ; 2) la fixation des anses par mortaisage de la paroi est également un trait commun aux vases fermés de ces deux catégories144 ; 3) la forme de la jarre à col tronconique, tout comme le vocabulaire et la syntaxe de son décor sont pratiquement identiques dans les séries PLM1 et PM2145 ; 4) enfin, toutes deux sont aussi les seules à connaître le type du couvercle cylindrique.
Tous ces éléments suggèrent que les deux centres de production entretenaient des relations, apparemment plus étroites au début de la période. Le fait que les marques de potier ne se rencontrent que sur les produits de ces deux ateliers — même si les deux systèmes sont par ailleurs différents146 — tend à renforcer cette hypothèse. Mais étaient-ce des relations de dépendance, de concurrence, de collaboration ? Rien ne permet de répondre à cette question. Il est clair, en tout cas, qu'ils partageaient un certain nombre de savoir-faire techniques, ce qui confirme l'idée d'une interaction entre les deux ateliers, comme entre les différentes unités de production opérant dans un même système147. Le centre de production de céramique à peinture lustrée était donc situé au point de convergence d'au moins trois traditions, dont deux issues du monde insulaire. Cela peut faire penser qu'il se trouvait sans doute sur un site — ou plusieurs sites voisins — du continent tourné vers la mer148, à un endroit où se croisaient des voies maritimes et des courants d'influences culturelles.
141. Rutter 1976, p. 3, 64-65 ; J. Rutter, C. Zerner, loc. cit. (supra, n. 11), p. 75-83 ; J. N. Coldstream, G. L. Huxley, « The Minoans of Kythera », in R. Hdgg, N. Marinâtes (ids), op. cit. {supra, n. 11), p. 107- 112 ; Nordquist 1997, p. 49-50.
142. Cf. supra, n. 9. 143. Phiuppa-Touchais 2002, p. 25-26. 144. Contra Zerner 1993, p. 54, n. 36. 145. En dépit de l'avis contraire de Zerner, ibid. 146. M. LlNDBLOM, op. cit. (supra, n. 22), p. 117-119, 135. 147. C'est ce que l'on suppose à Égine, ibid., p. 135. 148. Contra G. Nordquist, loc. cit. (supra, n. 136), p. 207, qui suppose des « inland conditions ».
JCW 127 (2003)
40 Anna PHILIPPA-TOUCHAIS
Conclusions générales
Notre choix de présenter les poteries à décor peint était surtout dicté, nous l'avons dit au départ, par l'idée qu'elles se prêtent mieux que d'autres à l'étude de la variabilité céramique, à travers laquelle on peut appréhender certains traits de l'organisation socio- économique des communautés qui les ont produites et/ou consommées149.
Dans cette perspective, l'étude des poteries à décor peint de l'Aspis a montré que la céramique à peinture mate présumée locale était caractérisée par une grande hétérogénéité, une absence de standardisation et une technologie relativement médiocre, traits qui suggèrent à la fois un faible niveau de spécialisation et un contrôle assez lâche de la production. Cela renverrait à une division du travail peu marquée, dans le cadre d'une société faiblement hiérarchisée. Les céramiques importées, au contraire, qu'il s'agisse de la classe à peinture mate d'Égine ou de la catégorie à peinture lustrée, présentent, malgré leurs différences quantitatives, tous les caractères de productions issues d'ateliers organisés150, donc dépendant de communautés dotées d'une organisation socio-économique, d'une hiérarchisation et d'une autorité centrale plus développées151. Les indices de l'existence d'une communauté de ce type à Égine (Kolona) ont déjà été mis en évidence152. Il reste à localiser celle dont devait dépendre le second atelier.
Quoi qu'il en soit, le groupe humain installé sur l'Aspis, même s'il était organisé sur une base familiale plutôt que véritablement communautaire, n'était pas coupé du réseau de relations intercommunautaires qui s'était développé dans la région. D'autre part, bien que la société n'y fut pas clairement hiérarchisée, on décèle très tôt les indices d'une certaine différenciation, comme le fait que quelques-uns utilisent des poteries minoïsantes de fonction spéciale ou des vases éginétiques « d'apparat »153. Cette différenciation sociale semble du reste s'accentuer au cours de la dernière phase, si l'on en juge par l'indéniable dynamisme de la production céramique locale, qui semble s'accompagner d'une certaine spécialisation154. Ce dynamisme pourrait manifester un désir d'affirmation de l'identité helladique à
149. K. KOTSAKIS, op. cit. {supra, n. 137), surtout p. 147-220. 150. Sur la spécialisation de l'atelier d'Égine, v. M. Lindblom, op. cit. {supra, n. 22), p. 129-131. 151. Sur la structure des sociétés hiérarchisées (inégalité, division du travail, contrôle de la distribution des sur
plus), v. K. Kotsakis, op. cit. {supra, n. 137), p. 208-216. 152. J. B. Rutter, « The Prepalatial Bronze Age of the Southern and Central Greek Mainland », in T. CuiXEN
(éd.), Aegean Prehistory. A Review, AJA Suppl. 1 (2001), p. 126-131 ; W-D. NlEMEYER, « Aegina — First Aegean 'State' outside of Crète ? », in R. Laffineur, W.-D. Niemeier (éds), op. cit. {supra, n. 136), I, p. 73- 80.
153. Comme la jatte profonde sur pied cylindrique haut, qui n'était sûrement pas un vase d'usage quotidien, v. Philippa-Touchais 2002, fig. 1 et 3.
154. Ibid., p. 18-21 et p. 39, n. 181, à propos de la production et de la fonction de la coupe à PM ; v. aussi BCH 125 (2001), p. 563, et G. NORDQUIST, loc. cit. {supra, n. 129), p. 573.
BCH 127 (2003)
APERÇU DES CÉRAMIQUES MÉSOHELLADIQUES À DÉCOR PEINT DE L'ASPIS D'ARGOS II 41
une période où les influences minoennes sont plus fortes155, ou, à un niveau régional, une revendication de l'identité argienne face à la montée en puissance des élites de Mycènes.
La question de l'abandon de l'Aspis à la fin de cette phase est cruciale mais on ne peut espérer y apporter des éléments de solution avant d'avoir étudié l'ensemble des données de la fouille. Cependant, comme nous avons formulé, dans la première partie de cet article, des hypothèses sur les débuts de l'établissement, il n'est pas déplacé d'avancer ici quelques réflexions préliminaires sur sa fin.
D'après la séquence des céramiques à décor peint, il semble que l'habitat de l'Aspis fut abandonné pendant l'HR I ; et comme aucune trace de destruction violente n'a été observée, les causes de cet abandon ne doivent pas être liées à une cause extérieure. On s'est récemment interrogé sur les raisons pour lesquelles un certain nombre d'établissements mésohelladiques étaient abandonnés pendant la période de transition HM III-HR I156. Selon l'une des hypothèses formulées — à juste titre pensons-nous — , ce phénomène serait dû au fait que les « vieux schémas structurels » ne répondaient plus aux « nouvelles exigences en matière d'implantation des habitats », la période des tombes à fosse étant marquée, d'une manière générale, par une « restructuration et une réorganisation des habitats »157. Dans le cas de l'Aspis, le remodelage de l'établissement au début de ΓΗΜ IIIB158 suggère des changements dans le domaine de l'organisation sociale159. Il semble cependant que les pressions résultant des nouvelles conditions socio-économiques étaient telles qu'elles contraignirent bientôt les habitants à abandonner définitivement la colline pour aller rejoindre, au pied de celle-ci, le noyau d'habitat qui existait déjà et qui ne cessera ensuite de se développer160. Il s'agirait donc, en quelque sorte, d'un nouveau déplacement de l'habitat depuis les hauteurs vers la ville basse161.
155. S. VOUTSAKI, « Social and Political Processes in the Mycenaean Argolid : the Evidence from the Mortuary Practices » », in R. Laffineur, W.-D. Niemeier (éds), op. cit. {supra, n. 136), I, p. 60-61.
156. Au début (ex. Peflcakia Magoula), au cours (ex. Asinè) ou à la fin (ex. Aspis) de cette période. 157. J. NÎARAN, « Structural Changes in the Pattern of Settlement during the Shaft Grave Period on the Greek
Mainland », in R. Laffineur, W.-D. Niemeier (éds), op. cit. {supra, n. 136), I, p. 72. 158. Notamment la construction du complexe de bâtiments rectangulaires allongés, v. A. Philippa-Touchais,
G. TOUCHAIS, « Les fouilles de l'Aspis d'Argos. La Grèce avant les palais mycéniens », DossArch 222 (1997), p. 77-79.
159. Sur un essai d'explication du phénomène à Argos, v. N. Papadimitriou, Built Chamber Tombs ofMiddk andLate Bronze Age Date in Mainhnd Greece andlsknds (2001), p. 23 ; v. aussi DlETZ 1991, p. 293, 325- 326.
160. Sur les vestiges d'habitat HM II-IH dans ce secteur en général, v. G. TOUCHAIS, loc. cit. {supra, n. 97), p. 76 ; sur un intéressant ensemble de constructions de ΓΗΜ III, v. N. VÀLAKOU, « Ευρήματα από το μεσοελλα- δικό οικισμό του Αργούς. Ανασκαφή οικοπέδου Β. Τζάφα », in A. PARIENTE, G. TOUCHAIS (éds), op. cit. (supra, n. 97), p. 85-101 ; pour une recension des vestiges de l'habitat HM et HR, v. aussi N. Papadimitriou, op. cit. (supra, n. 159), p. 22-23.
161. Sur l'abandon de l'Aspis et le déplacement de l'habitat, v. N. PAPADIMITRIOU, op. cit. (supra, n. 159), p. 24. Un premier déplacement dans ce sens a été observé entre le Néolithique Final et ΓΗΑ II, un autre en sens inverse dans le courant de 1ΉΜ I, v. G. TOUCHAIS, N. VÀLAKOU, « Argos du Néolithique à l'époque géométrique : synthèse des données archéologiques », in A. Pariente, G. Touchais (éds), op. cit. (supra, n. 97), p. 10-11.
BCH 127 (2003)
42 Anna PHIUPPA-TOUCHAIS
On ne peut s'empêcher de penser qu'à Argos ces conditions nouvelles doivent être liées à l'émergence de Mycènes comme centre régional. Une de ces conditions pourrait être, par exemple, l'ouverture d'une importante voie de communication reliant Mycènes à la mer et passant au pied de l'Aspis162 : un tel axe, facilitant la circulation des hommes et des biens, ne pouvait qu'être un pôle d'attraction et favoriser l'essor économique et social, suscitant peut-être l'apparition de nouvelles classes d'artisans et de marchands163. Dans un tel contexte, l'établissement du sommet de la colline ne représentait plus qu'un vestige du « vieux schéma ». En tout état de cause, l'abandon de « l'acropole » de l'Aspis au début de l'HR — quand on sait l'importance des acropoles164 dans tous les grands centres mycéniens — peut faire penser que le site d'Argos, sans décliner vraiment165, perdit cependant alors un peu de son prestige, qu'il ne retrouva d'ailleurs pas avant l'abaissement définitif de sa puissante voisine.
Corrigmdum à BCH 126 (2002), p. 1-40 p. 39 : l'appel de note 183 doit être remonté quatre lignes plus haut, apte» « ... dans son secteur Sud-Est ».
162. Ce n'est peut-être pas un hasard si la seule rue mycénienne de quelque importance (larg. 2,70 à 2,90 m, en cailloutis) découverte jusqu'à présent à Argos est précisément une voie Nord-Sud qui longeait le pied du flanc oriental de l'Aspis, à peu près sous l'actuelle rue Irakléous, v. E. MOROU, AD 36 (1981) B', p. 109 (terrain Mitsakos-Kriémadis, n° 401 de l'index des terrains publié dans A. PARIENTE, G. TOUCHAIS [éds], op. cit. [supra, n. 97], p. 492). Ce tronçon de rue figure sur le plan de l'occupation d'Argos à l'HR, ibid., pi. VIII.
163. On ne peut exclure la dimension sémiologique, qui fait souvent d'une rue centrale un lieu valorisant. 164. Aux yeux de nombreux chercheurs, les vestiges mycéniens trouvés sur l'autre acropole d'Argos, la Larissa, ne
permettent pas de conclure à l'existence d'une citadelle (G. Touchais, N. Valakou, loc. cit. [supra, n. 161], p. 11 ; R. Hope Simpson, O. Dickinson, A Gazeteer ofAegean Civilisation in the Bronze Age, I. The Mainland and Isknds [1979], p. 44).
165. N. Papadimitriou, op. cit. {supra, n. 159), p. 23.
BCH 127 (2003)
- \ / f . c ,U
APERÇU DES CÉRAMIQUES MÉSOHELLADIQUES À DÉCOR PEINT DE L'ASPIS D'ARGOS II 43
10 i
12 13 14,
Fig. 22. — Tasses carénées (a), hémisphériques (b), tronconiques (c).
BCH 127 (2003)
l'S
APERÇU DES CÉRAMIQUES MÉSOHELLADIQUES À DÉCOR PEINT DE L'ASPIS D'ARGOS II 45
19
Fig. 24. — Jarre à col tronconique restaurée.
BCH 127 (2003)
46
*CC2>. I?). c
Anna PHILIPPA-TOUCHAIS
Fig. 25. — Fragments de jarres à col tronconique à décor PLB2 (a) et PLBl (b).
30
28
Fig. 26. — Jarres à col coupé.
BCH 127 (2003)