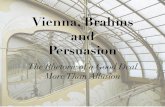Les procédés de la persuasion historique dans le Catilina de Salluste (2007)
-
Upload
u-bordeaux3 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Les procédés de la persuasion historique dans le Catilina de Salluste (2007)
Olivier Devillers
Les procédés de la persuasion historique dans le Catilina deSallusteIn: Vita Latina, N°176, 2007. pp. 134-148.
Citer ce document / Cite this document :
Devillers Olivier. Les procédés de la persuasion historique dans le Catilina de Salluste. In: Vita Latina, N°176, 2007. pp. 134-148.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/vita_0042-7306_2007_num_176_1_1238
Les procédés de la persuasion
historique dans le Catilina
de Salluste
La signification idéologique du Catilina est depuis longtemps discutée, et les diverses interprétations qui en ont été données - du pamphlet pro-césarien à la méditation sur la uirtus - n'ont pas toujours pleinement convaincu. C'est pourquoi, aujourd'hui, les chercheurs tendent de plus en plus souvent à dépasser l'idée d'une univocité de l'ouvrage et à insister sur sa complexité idéologique, complexité qui constituerait, en définitive, son principal message. Ainsi, à côté de la sceleris atque periculi nouitas, thème narratif signalé dans la préface (4, 4), Salluste aurait mis en évidence des notions comme la perte des repères, la crise des valeurs ou la division politique. Ci-dessous, nous voudrions, dans le sens d'une telle lecture, revenir sur divers procédés caractéristiques de l'écriture historique dans
et montrer à partir d'exemples comment chacun d'eux à la fois est à dans la monographie et participe à cette thématique ; en ce sens, aussi, nous
espérons contribuer à la compréhension de la dimension persuasive de la pratique historiographique de Salluste1.
Chronologie et déplacement de l'information
Salluste est vague en matière de chronologie2 et il ne respecte pas toujours la succession temporelle. Le principal déplacement qui lui est reproché est de situer la réunion entre Catilina et les conjurés dès juin 643 et d'antidater de la sorte
de la conjuration. Selon sa conception, en effet, le complot est le produit de toute époque et c'est pourquoi, au lieu de le faire simplement résulter de l'échec électoral de 63, il lui prête une plus longue évolution4. D'autres
ont été notés.
- La tentative d'assassinat contre Cicéron (28, 1-3, dans la nuit du 5 au 6 ou du 6 au 7 novembre) est citée avant l'octroi du SCV (29, 2-3, le 21 qui pourtant l'a précédé. L'inversion suggère que ce sont des craintes pour sa
vie qui ont conduit Cicéron à demander le SCV: la crise des valeurs que traverse
134
Rome est telle qu'il faut un motif personnel pour qu'un homme se soucie de l'État.
- Le plan de l'insurrection décrit en 43, 1-3 aurait, d'après Cicéron, été fixé dès la réunion dans la maison de Porcius Laeca qui est relatée en 27, 2 ; Salluste en aurait postposé la description pour donner davantage de consistance à l'activité de Lentulus.
- En 49, 4, l'incident des chevaliers menaçant César se serait produit après le débat sur le sort des conjurés et Salluste l'aurait placé avant5, de façon à le faire apparaître comme la conséquence d'accusations infondées contre César.
Par ailleurs, sans qu'il y ait à proprement parler déplacement, Salluste peut situer un événement par nature indatable à l'endroit qui lui convient le mieux. On songe en particulier à la naissance d'un projet de renversement de l'État par Catilina : il la met en relation avec la dictature de Sylla (5, 6), ce qui rejoint l'idée selon laquelle cette dernière marqua une étape dans le processus de dégénérescence de Rome (11, 4-7).
Digression
Dans le Catilina, bon nombre de digressions élargissent le champ et montrent que la conjuration s'insère dans un processus plus vaste, celui
de l'évolution de l'histoire de Rome dans son ensemble. D'autres fonctions sont ponctuellement discernables.
- Dans les chapitres sur l'histoire de Rome (6-13), la seconde partie, qui dépeint une décadence (10-13), abonde en parallèles avec le portrait de Catilina (chap. 5) : 10, 5 sur la dissimulation rappelle 5, 4 ; 11, 4-7 sur la dictature de Sylla rappelle que c'est après celle-ci que Catilina conçut le projet de s'emparer du pouvoir ; 12, 2 nihil pensi ... habere rappelle 5, 6 neque ... quicquam pensi habebat; les énu- mérations en 13, 3 rappellent l'usage du procédé dans le chap. 5 ; l'intérêt pour la jeunesse (12, 2 et 13, 4 iuuentutem; déjà 7, 4 iuuentus) rappelle ce qui a été dit sur la jeunesse de Catilina dans son portrait (5, 2; aussi 15, 1 iam primum adu- lescens), mais aussi ce qui sera dit sur son influence sur la jeunesse romaine dans les premiers chapitres relatifs à la conjuration (14, 5 ; 16, 1 ; aussi 17, 6). Il y a donc écho entre le peuple romain dans son déclin et la personnalité de Catilina (dans une moindre mesure de ses partisans6). Mais l'association est ambiguë : dans la mesure où le peuple romain a connu une période de uirtus (6-9), elle renvoie aussi aux potentialités de Catilina pour le bien.
- En 18-19, l'évocation d'une première conjuration de Catilina se présente comme une digression. L'acceptation de la réalité de cette première
conjuration - qui tient pour beaucoup de la rumeur non vérifiée7 - confère plus de consistance à la personnalité de Catilina ainsi qu'au danger qu'a couru l'État (spéc. 18, 8 eo die post conditam urbem Romam pessumum facinus patratum foret).
135
- L'espace consacré aux accusations contre Crassus et César (48-49) fait que l'on y a parfois vu une digression. Le passage est bâti autour d'un contraste. En 48, 3-49, 4, les accusations portées contre Crassus ne sont pas clairement réfutées8, alors que celles qui le sont contre César sont présentées comme fausses (49, 1 et 4). De même, Crassus est protégé par ses pairs d'attaques peut-être forgées par Cicéron, tandis que le même Cicéron refuse d'accuser César sur la foi
avancées par des ennemis personnels de celui-ci. La richesse de Crassus (48, 5 maximis diuitiis) contraste également avec l'endettement de César (49, 3),
que la puissance du premier vient de prêts personnels (48, 5 ex negotiis priua- tis obnoxii), alors que le second fait preuve de générosité dans le privé (49, 3 priuatim egregia liber alitaté). Enfin, Crassus jouit d'une totale impunité (48, 6), tandis que César est la cible de menaces (49, 4). Ainsi, le passage jette un
sur les paradoxes de l'époque, puisque c'est celui dont l'innocence est qui essuie le plus de désagréments, désagréments qui sont en outre de nature
à équilibrer la synkrisis, dans laquelle le même César est envisagé sous l'angle de la gloire. Enfin, Crassus et César sont deux personnages à qui a été confiée la garde de conjurés ; suggérer qu'eux aussi ont été soupçonnés ou soupçonnables ajoute à la confusion.
- Les avis les plus divers ont été portés sur la signification idéologique de la synkrisis entre César et Caton. Il se peut que cette incapacité à tirer un jugement constitue la morale même du passage. Peut-être celui-ci illustre-t-il un moment du processus historique où la uirtus ne se retrouve plus une et unique, mais apparaît comme fragmentée entre deux types de comportement (53, 6 diuorsis moribus)9! Autre signe de confusion : la réflexion positive qui est alors menée sur deux nobi- les en quête de gloire est suivie, en un contraste frappant, par la description de l'ignoble exécution d'un autre nobilis, Lentulus10.
Discours
Une des principales fonctions des discours est d'illustrer le caractère des (infra, à propos de Catilina). Par ailleurs, conformément à une idée mise dans
la bouche de Caton (52, 1 1 Iam pridem equidem nos uera uocabula rerum amisi- mus)n, Salluste s'attache à y montrer comment le vocabulaire politique est
Les discours des conjurés l'illustrent particulièrement, comme on le voit à de la libertas dans le premier discours de Catilina (20), mais aussi dans le
message de Manlius, dans la lettre à Catulus ou dans l'ultime harangue aux troupes.
Pour ce qui est des interactions entre discours, nous citerons l'analyse que K.F. Williams du message de Manlius à Marcius Rex (33)13. Pour elle, ce serait pour l'essentiel une création destinée à former une paire avec la
de Catilina à Q. Catulus (35). Salluste aurait voulu montrer ainsi le contraste dans l'attitude envers les miser i qu'ont Manlius (solidaire de leurs revendications) et Catilina (opportuniste dans l'attention qu'il leur porte).
136
Mais la principale paire de discours est constituée par les interventions de César et de Caton lors de la séance du 5 décembre. Nous nous attacherons à deux aspects seulement. D'abord, l'allusion de César aux Rhodiens (51, 5), dans la mesure où elle fait écho à un discours de Caton l'Ancien prônant la modération envers ceux- ci, constituerait un moyen de confronter Caton au modèle de son illustre ancêtre. Or César, qui, en tant que préteur désigné, prenait la parole avant Caton, savait-il que ce dernier allait s'exprimer de façon significative sur le sujet? Ne faudrait-il pas considérer l'argument rhodien comme un ajout de l'historien14? Ensuite, on relève divers échos entre ces deux discours et le reste du Catilina, à commencer par les deux premiers mots de l'intervention de César {omnis ordines) qui sont aussi ceux qui ouvrent la monographie ; les deux hommes apparaissent ainsi dans une certaine mesure comme des interprètes de la pensée historique de Salluste (par ex. César sur le rôle de Sylla, Caton sur la perte de sens du vocabulaire
Mais, précisément, comme on l'a dit à propos de la uirtus dans la syn- krisis, n'est-il pas problématique que la pensée de Salluste ait deux interprètes, dont les discours, en outre, soutiennent des positions opposées ?
Exagération, imprécision, généralisation
Une exagération par le recours à l'indéfini peut être observée par ex. à propos des nobles qui appuient en secret la conjuration (17, 5 complures), à propos des assassinat prévus lors de la première conjuration (18, 7 plerisque senatoribus per- niciem)16, à propos des rencontres entre Catilina et les conjurés (20, 1 cum singu- lis multa saepe egerat)... S'il n'est pas lié à une exagération, l'indéfini empêche à tout le moins de se représenter les faits avec exactitude : le nombre d'hommes restés fidèles à Catilina après l'annonce de l'exécution des conjurés à Rome est désigné par relicuos (57, 1), ce qui ne permet pas d'évaluer le nombre des
Ailleurs, l'exagération prend la forme d'une généralisation. Salluste présente l'ensemble de la plèbe comme séduite par les thèses de Catilina (37, 1 omnino cuncta plèbes), alors que Cicéron évoque surtout un support de la plèbe rurale (Cat., II, 8 ; IV, 6; Mur., 78-79) et qu'il semble effectivement que ce soit après 58 que la plèbe urbaine commença à s'agiter18. Plus ponctuellement, l'affirmation selon laquelle, par le passé, les Espagnols avaient toujours subi sans les
les gouverneurs cruels (19, 5) n'est pas exacte: L. Piso Frugi fut tué alors qu'il était pro-préteur en 112 av. J.-C19..
L'exagération peut être placée dans la bouche d'autrui. Caton dit avoir déjà parlé devant le Sénat (52, 7 saepe numéro ; saepe), alors que, âgé de 32 ans,
il n'est que sénateur depuis peu de temps ; Salluste lui donne ainsi une qui justifie la synkrisis20. Dans le message de Manlius à Marcius Rex, les
mots saepe ipsa plebs . . . armata a patribus secessit sont excessifs par rapport aux trois sécessions connues de la plèbe (en 484, en 449, en 287)21.
137
Modèles littéraires
L'accent a souvent été mis sur les modèles grecs de Salluste, au premier chef Thucydide ; il n'en faut pas pour autant mésestimer l'influence des auteurs latins, Sisenna, Ennius et, surtout, Caton l'Ancien. Mais, au-delà de la mise en évidence de l'emprunt, ce sont les implications de celui-ci qu'il convient d'expliquer. Or, à cet égard, Salluste apparaît comme un maître de l'intertextualité22, que l'on se situe au niveau de passages précis ou à celui de l'œuvre dans son ensemble. Pour ce qui est du premier point, on mentionnera l'allusion à Cicéron, Quae quousque tandem patiemini, dans le premier discours direct de Catilina (20, 9) ; l'écho, incontestable, contribue à souligner la perversion du vocabulaire politique par les conjurés23. Pour ce qui est du second point, il y a une indiscutable cohérence entre les archaïsmes du style et la vénération affichée pour les vieilles valeurs
Il ne faut toutefois pas simplifier ainsi que l'a signalé D.S. Levene à propos de l'utilisation de Caton l'Ancien24. Les références à ce dernier ont en effet leur part de paradoxe et elles traduisent en ce sens toute la complexité de la morale
de Salluste : par ex., au-delà de son aspect catonien, le prologue comporte un rejet de l'agriculture qui constitue une note anti-catonienne ; de même, il ne faut pas oublier combien Caton a milité pour la destruction de Carthage, événement que Salluste tient pourtant comme le début d'un déclin moral25...
Personnages
Salluste établit un lien entre le caractère des individus et l'enchaînement des faits et il reconnaît l'influence qu'exercent un petit nombre d'hommes sur toute la société : Ac mihi multa agitanti constabat paucorum ciuium egregiam uirtutem cuncta patrauisse eoque factum uti diuitias paupertas, multitudinem paucitas superaret (53, 4). Cette prééminence de l'individu ne signifie toutefois ni un
pour la collectivité (cf. les premiers mots de l'ouvrage omnis homines)26, ni une méconnaissance des facteurs sociaux, économiques...27.
Catilina est incontestablement la figure majeure de l'ouvrage28. Salluste lui reconnaît quelque éloquence (5, 4) et les discours qu'il lui prête participent à sa caractérisation Ainsi, entre les deux orationes rectae des chap. 20 et 58, on relève des points communs. D'abord, elles illustrent une même perversion du vocabulaire politique, spéc. de la libertas (rapprocher 20, 14 En Ma, Ma quant saepe optastis, libertas; praeterae diuitiae, decus, gloria in oculis sita sint et 58, 8 memineritis uos diuitias, decus, gloriam, praeterea libertatem atque patriam in dextris uostris portaré). Ensuite, les deux passages mêlent « vérités » et tromperie : dans ses
aux conjurés, le tableau que Catilina fait des excès des riches (20, 11-12) rejoint celui qu'avait dressé Salluste dans son histoire de Rome (12-13) - indice qu'il y a à retenir dans la rhétorique catilinienne -, mais les arguments par lesquels il appuie par la suite son projet (21, 3, soutien de Piso en Espagne, de Sittius en Maurétanie, élection d'Antonius comme consul) ne convainquent guère29; de
138
même, Catilina commence sa harangue par un mensonge, en se référant à une expérience des harangues militaires (58, 1 compertum ego habeo) qu'il n'a pas. Enfin, les deux discours sont des exhortations à l'action (rapprocher 20, 10 Viget aetas, animus ualet et 58, 19 animus, aetas, uirtus uostra me hortantur) et il
que ce soit aussi dans le rôle d'un homme capable de fédérer les énergies que Salluste a représenté Catilina. D'ailleurs, le fait que soit prêté à celui-ci un discours sur le champ de bataille (les propos de son adversaire sont à peine résumés ; 59, 5 et 6) révèle le désir d'en faire le «héros» de la fin de la monographie (56-61). Mais les qualités d'homme d'action qui lui sont alors reconnues avaient déjà été suggérées auparavant. Notamment, la formule strenui militis et boni imperatoris officia simul exsequebatur (60, 4) renvoie à la fin du discours aux conjurés : uel imperatore uel milite me utimini (20, 16). Bien plus, l'exhortation de Catilina à ses soldats, leur enjoignant de mourir en hommes et non comme du bétail (58, 21 neu capti potius sicuti pecora trucidemini quam uirorum more pugnantes) rappelle le propre prologue de Salluste, dans lequel il est souligné que l'homme doit s'élever au-dessus des animaux (1,1 ne uitam silentio transeant ueluti pecora)30 . Tout ceci contribue à mettre en avant les potentialités du personnage, ce qui constitue une critique pour l'époque et le contexte politique qui ont gâché ces potentialités. Dans cette mesure, l'ouvrage n'est pas un pamphlet contre Catilina31, ce qui n'aurait guère de sens une vingtaine d'années après les faits. Certes, celui-ci est pour
peint sous un jour défavorable, mais cette présentation négative n'est pas un but en soi pour Salluste; il s'agit du vecteur - ou du «prétexte»32 - qu'il a choisi pour illustrer un chaos sociétal33.
L'ambiguïté domine dans la présentation de Cicéron34. Par ex., il est dit que la plèbe le porte aux nues, mais cette même plèbe est présentée comme changeante (48, 1) ; son refus d'accuser injustement César est contrebalancé préalablement par le soupçon qu'il aurait suscité les accusations contre Crassus (48, 3-49, 4)... En somme, c'est plutôt la difficulté à juger Cicéron qui ressort35, corollaire de la difficulté que lui-même éprouvait à juger la situation à laquelle il était confronté : en 31, 6, au moment de son intervention au Sénat, il hésite entre la peur et la colère, siue praesentiam eius timens, siue ira commotus ; en 46, 2, après
des Allobroges, c'est à nouveau deux sentiments contrastés qui s'emparent de lui : at illum ingens cura atque laetitia simul occupauere36 . Il y a peut-être là une façon de suggérer la complexité de la situation, laquelle ne permet pas
de porter un jugement équilibré tant de la part des personnages que de celle de l'historien.
Caton et César ne jouent pas un rôle déterminant dans l'action. Pourtant, si l'on considère la paire de discours qui leur est prêtée ainsi que la synkrisis, ils
près de 19% du texte37. Le rôle joué par ces passages a été considéré supra.
Le portrait de Sempronia, à la fin de la liste des conspirateurs (25), surprend, puisque cette femme ne sera plus citée significativement par la suite (unique
ultérieure en 40, 5). Une idée souvent mise en avant est que ce portrait le pendant féminin de celui de Catilina. On ajoutera que Sempronia, dont il
139
est dit multa saepe uirilis audaciae facinora commiserat (25, 1), marque dans une certaine mesure l'abolition de la frontière entre hommes et femmes. Or, en 11, 3, Salluste avait écrit que la cupidité efféminait (ea ... corpus animumque uirilem effeminat) et, en 13, 3, il avait retenu l'homosexualité parmi les signes de la
(uiri muliebria patï) ; on y ajoutera la rumeur selon laquelle Catilina dans une relation homosexuelle les jeunes gens qu'il s'associait (14, 7). Sem-
pronia constituerait l'autre face de cette inversion38.
Psychologie
L'intérêt pour les personnages va de pair avec un goût pour les explications psychologisantes. Celles-ci sont souvent stéréotypées, fondées autour de quelques grandes émotions, en particulier la crainte, notion associée à celle de danger, et la spes, spécialement soulignée comme motivation des conjurés39. On notera aussi la présence d'explications doubles, l'une basée sur le contexte, l'autre sur la nature humaine (par ex. 49, 4 seu periculi magnitudine seu animi mobilitaté).
Le lien qu'entretiennent de telles attributions de pensée avec la persuasion est évident, les émotions que l'historien décrit étant aussi celles qu'il veut
à son lecteur40. Elles accompagnent souvent des effets dramatiques. Par ex., l'hypothèse d'un Catilina hanté par le meurtre du fils d'Orestilla est saisissante et la relation établie entre son âme tourmentée et son projet de conjuration (15, 3-5) illustre l'intrusion des facteurs personnels dans la causalité historique. Lorsque Catilina s'adresse aux conjurés (20), c'est un mélange d'espoir et d'incertitude qui domine son discours, ce qui n'est pas sans ironie : Catilina fonde ses espérances sur le désespoir de ses complices41. Les motifs que Salluste suppose à Catilina au moment où il s'assure le soutien de femmes (24, 4 per eas se Catilina credebat posse seruitia urbana sollicitare, urbem incendere, uiros earum uel adiungere sibi uel interficere) suggèrent qu'il y eut une permanence dans ses projets
(meurtres et incendies reviendront à un stade ultérieur de la conjuration). C'est enfin par la mention des sentiments contrastés de l'armée victorieuse à Pis- toia que s'achève la monographie (61, 9 ita uarie per omnem exercitum laetitia, maeror, luctus atque gaudia agitabantur) ; à la fois par son sens et par le temps auquel il est conjugué, agitabantur, ultime mot de l'ouvrage, nie pratiquement toute idée de conclusion42 ; il laisse confronté à une crise durable et suggère des développements funestes. On ne peut s'empêcher de penser qu'une telle fin reflète la réflexion sur la confusion des valeurs et l'impossibilité d'arrêter une conduite qui traverse la monographie.
Rappel et anticipation
II y a une pratique du rappel sous la forme explicite du renvoi interne qui assure la cohérence d'une présentation qui apparaît comme fragmentée dans le récit; on
140
en citera comme exemple le portrait de Curius, décrit en 23, 1-4 et sur lequel Salluste revient en 26, 3, en accompagnant sa mention de de quo ante memoraui ; ces simples mots « font revivre tous les détails du chapitre 23 et colorent ce qui est dit de surcroît »43. Pour le reste, parmi les événements antérieurs à la
c'est incontestablement à l'époque de Sylla que Salluste se réfère le plus, explicitement (11, 4-7; 16, 4; 21, 4; 28, 4; 37, 6; 51, 32-34) et implicitement: en 21, 2, les promesses faites aux conjurés {tabulas nouas, proscriptionem locu- pletium, magistratus, sacerdotia, rapinas, alla omnia quae bellum atque lubido uictorum fert) semblent inspirées par les évocations traditionnelles du régime syllanien. Plus ponctuellement, un rappel, placé dans la bouche d'autrui, retient l'attention dans la mesure où il est inexact: en 52, 30, dans le discours de Caton, Yexemplum de la mise à mort par Manlius de son fils est situé durant la guerre contre les Gaulois alors qu'il appartient à la guerre contre les Latins ; sans doute y a-t-il confusion44, mais il reste que le rappel d'une guerre gauloise peut être à rapprocher de la tentative de Catilina de gagner à sa cause les Allobroges (52, 24 Gallorum gentem).
Par ailleurs, il n'y a pas à proprement parler d'anticipations à la première Néanmoins, dans sa réfutation de la rumeur selon laquelle les conjurés
burent du sang humain, Salluste se réfère à l'hostilité dont Cicéron fera l'objet (22, 3 Ciceronis inuidiam, quae postea orta est) ; en apprenant que les ennemis de Catilina seront à leur tour mis sur la sellette, il révèle toute l'instabilité de la situation. En 24, 2, il est question du rôle tenu plus tard par Manlius {qui postea pr inceps fuit belli faciundi), ce qui permet, en annonçant que les menées de
se transformeront en bellum, d'insister sur le periculum. En 50, 4, à propos du châtiment des conjurés, il annonce que D. Silanus, qui avait d'abord demandé la mort, changera d'avis après avoir entendu César: en signalant à l'avance l'effet du discours de ce dernier sur Silanus, il suscite un sentiment de curiosité chez le lecteur.
Une forme plus implicite d'anticipation vient de ce que Salluste joue sur la connaissance par le lecteur de l'histoire postérieure aux événements qu'il raconte46. Ainsi l'espoir que Catilina fonde d'être le collègue d'Antonius (21, 3) apparaît vain à qui sait que Cicéron sera élu. Salluste peut aussi amplifier une action en
à des conséquences durables qu'elle eut sur ses acteurs et sur l'État, mais qui sur le moment n'étaient pas perceptibles. Par ex., après l'interception des
au pont Mulvius. il explique l'anxiété de Cicéron par la crainte que le des conjurés pèse lourdement sur lui (46, 2)47 ; de même, la scène qui voit
César quitter le Sénat sous la menace de l'épée (49, 4) prend un relief particulier quand on songe aux circonstances de sa mort48. Enfin, la partie du discours de César sur les dangers du précédent que serait l'exécution des conjurés peut être considérée comme faisant allusion à plusieurs événements qui se sont produits entre 63 et 42, y compris à des événements dans lesquels César lui-même fut
{SCV de 48 et de 47) ; serait alors soulignée la difficulté à suivre une ligne politique cohérente durant la crise de la République49.
141
Répétitions de mots
Salluste porte un grand soin au choix des mots et des formulations : en 5, 5, il évoque le uastus animas de Catilina, préférant l'adjectif uastus à magnus, peut- être parce que ce dernier serait trop louangeur, sans doute aussi parce que uastus garde une connotation inhérente au sens de uastare50; en 48, 5, Crassus est
comme hominem nobilem (aussi tanta uis hominis), alors que uirum aurait été plus laudatif ; en 54, 3, la générosité de César est évoquée par le gérondif dando, et non largiundo qui aurait donné le sentiment de largesses inconsidérées ; inversement, pour Caton, on lit nihil largiundo, tant il est vrai que nihil dando aurait suggéré une avarice extrême51...
Dans ce contexte, la répétition de mots dans des contextes voisins52 s'avère d'intentions.
- En 23, 3, Curius, enflammé par sa participation à la conjuration, promet à Fulvia «des mers et des montagnes», maria montisque; la formulation a surpris dans la mesure où elle ne correspond pas à l'expression proverbiale, auri montes. L'association entre mare et mons s'expliquerait toutefois par une allusion au
de Catilina, où celui-ci, décrivant les excès des riches, évoque l'argent qu'ils dépensent in exstruendo mari et montibus coaequandis (20, 1 1) ; ces mots ont eux- mêmes un écho dans la digression de Salluste sur Rome, a priuatis conpluribus subuorsos montis, maria constrata esse (13, 1).
- En 29, 2, le SCV est souligné comme habituel en de telles circonstances, quod plerumque in atroci negotio solet (aussi 29, 3 more Romano) ; l'expression revient en 30, 2, id quod in tali re solet, pour signaler cette fois des réactions populaires, comme l'annonce de prodiges ou des bruits alarmants. Cette répétition fait
l'existence des deux niveaux aux réactions divergentes, celui des décideurs et celui du peuple53.
- En 36, 4, Salluste commence sa présentation de la situation de Rome par les mots Ea tempestate mihi imperium populi Romani multo maxume miserabile uisum est. L'adjectif miserabile fait écho à l'insistance sur les miser i perceptible dans le message de Manlius à Marcius Rex ainsi que dans la lettre de Catilina à Q. Catulus.
- En 39, 6, à Rome, Lentulus essaie de trouver des partisans comme le lui avait ordonné Catilina, sicuti Catilina praeceperat ; c'est alors que s'insère l'épisode des Allobroges qui se conclut par des instructions que Cicéron donne aux légats gaulois, praecipit ut studium coniurationis uehementer simulent (41, 5). Le retour du verbe, indiquant au départ une volonté de Catilina et à l'arrivée une volonté de Cicéron (aussi 44, 1 ex praecepto Ciceronis), souligne comment l'initiative échappe au chef des conjurés pour échoir au consul54.
- Les adjectifs pristinus et memor reviennent trois fois dans les derniers : en 58, 12, dans le discours de Catilina {memores pristinae uirtutes), en 60, 3 à
propos des vétérans qui constituent sa troupe (ueterani pristinae uirtutis memores)
142
et en 60, 7 à propos de lui-même (memor generis atque pristinae suae dignitatis). Cette répétition n'apparaît pas innocente à la fin d'un ouvrage dont le prologue a mis en avant les notions de memoria (3, 2 memor es ; 4, 2 quaeque memoria digna ; 4, 4 memorabile) et de uirtus.
- À travers l'œuvre, la répétition de nobilislnobilitas en référence à Catilina ou aux conjurés (par ex. 5, 1 ; 17, 6; 18, 4; 23, 3 ; 43, 2 ; 52, 24) traduit l'idée que les troubles liés à la conjuration étaient aussi dus à la corruption de cette classe.
Utilisation des sources
L'allusion à une documentation de première main renforce le discours On citera :
- des témoignages oraux : la référence à des propos entendus de la bouche de Crassus (48, 9 ipsum Crassum ego postea ... audiuï) indique que le narrateur fut proche des plus hautes sphères politiques. On y ajoutera la mention d'une
personnelle de l'époque, memoria mea (53, 6), au moment d'évoquer la de César et de Caton ;
- des lettres : en 30, 1, une lettre de Saenius sur les activités de Manlius en Étrurie dont on n'a pas d'autre mention ; en 34, 3, une lettre de Catilina à Q. Catu- lus (earum exemplum infra scriptum est) ;
- des rumeurs : en 14, 7, il ne reprend pas à son compte les rumeurs de pratiques homosexuelles entre Catilina et les jeunes qui s'associaient à lui ; par contre,
de telles rumeurs, qu'il présente comme avérée (scio), apparaît comme un témoignage des mœurs dissolues de Catilina et de son entourage ; il n'y a donc pas tant insinuation qu'utilisation de la rumeur comme preuve (ce qui est conforme à l'usage rhétorique). Une autre rumeur qu'il rejette est celle selon laquelle les
auraient bu du sang humain, ce qui lui permet de souligner à la fois sa d'historien (22, 4 nobis ea res pro magnitudine parum comperta est) et la
complexité de la tradition sur la conjuration.
Cette activité heuristique se double d'un effort herméneutique, comme l'indique au chap. 53 la reprise de mihi multa legenti, multa audienti (53, 2) par mihi multa agitanti (53, 4). Il s'ensuit une inclination à réinterpréter et à réélaborer ses
que justifiait pleinement le caractère partisan de la plupart d'entre elles, à par Cicéron et ses proches (cf. 22, 4)55. Ainsi, si l'on estime généralement
que ses principes historiographiques lui interdisaient d'inventer des épisodes, divers passages portent la trace de réélaborations. Par ex., la façon dont il évoque la séance du 5 décembre ne concorde pas avec ce que l'on trouve dans les autres témoignages. De même, en 46, 6, il fait comparaître devant le Sénat Volturcius avec les députés Allobroges ([Cicero] Volturcium cum legatis introducit) ; il est en contradiction avec Cicéron (Cat., III, 8 introduxi Volturcium sine Gallis) ; sans doute a-t-il réuni deux interrogatoires distincts de façon à créer une seule scène dans laquelle aux aveux de Volturcius (47, 1) répondent ceux des Gaulois (47, 2).
143
Ou encore, dans le message de Lentulus à Catilina (introduit en 43, 4 par litteras . . . quarum exemplum infra scriptum est), il aurait changé l'ordre de l'énoncé : fac cogites in quanta calamitate sis et memineris te uirum esse (44, 5) au lieu de cura ut uir sis et cogita quem in locum sis progressus (Cic, Cat., III, 12)56.
Un indice de cette réélaboration constante du passé est apporté par la présence de contradictions, qu'expliquent les impératifs, parfois mouvants, de la stratégie narrative. Par ex., en 24, 2, Manlius apparaît à Fiesole, mais en 27, 1 et 3,
l'y envoie ; certes, on peut imaginer que Manlius était, pour les élections, revenu à Rome d'où il fut renvoyé par Catilina ; mais surtout en 27, 1, Salluste veut souligner une réaction immédiate de Catilina après son échec aux élections ;
de Manlius donne une consistance à cette activité. . . et peu importe sans doute que celui-ci se soit trouvé déjà à Fiesole, puisque le résultat est le même : la
dans cette ville d'un agent actif de la conjuration. De même, en 24, 4, il écrit que Catilina escomptait, grâce aux femmes qu'il ralliait, soulever les esclaves de la Ville ; mais, en 56, 5, on lit qu'il refusa d'enrôler des esclaves ; d'une part, au chap. 24, l'historien, qui a antidaté la conjuration, a besoin d'entretenir un climat de danger (d'où le projet qu'il prête à Catilina) ; d'autre part, la fin de l'ouvrage est marqué par une forme (relative) d'«héroïsation» de Catilina (d'où la mention de ce que son armée ne comportait pas d'esclaves). Ou encore, en 44, 6 et 48, 4, les conjurés à Rome semblent vouloir synchroniser leurs actions avec l'arrivée de Catilina près de Wrbs, alors qu'en 56, 4, il apparaît que Catilina temporise en Étrurie en attendant des nouvelles de la conjuration à Rome ; on peut se
si, dans le premier cas, Salluste n'a pas voulu souligner le danger couru par la cité57. Enfin, en 31, 1, afin de souligner le désarroi qui s'empare des Romains, il affirme que les menées de Catilina succèdent à une longue période de calme, diu- turna quies; seule la recherche d'un effet dramatique explique cette assertion que contredit toute l'analyse politique de l'historien, lequel voit la conjuration comme l'aboutissement d'une crise profonde et durable.
Au total, on a le sentiment que Salluste, pour être attaché à la recherche de la vérité (4, 3 quam uerissume potero ; 18, 1 de qua quam uerissume potero dicam), n'en assume pas moins sa part de subjectivité, ses choix critiques et ses
Le symbole en est l'enquête sur la première conjuration de Catilina, s 'achevant par un non liquet (19, 5 Nos eam rem in medio relinquemus)5S. Du reste, à y réfléchir, le prologue justifie davantage la légitimité de son entreprise qu'elle n'apporte de garantie sur sa réussite. Sans aller jusqu'à affirmer
d'écrire l'histoire, il laisse le sentiment d'une difficulté à rédiger celle-ci, ce que le lecteur rapprochera du caractère chaotique de l'époque décrite.
Volume de l'énoncé
La breuitas sallustéenne est bien connue et le prologue associe le souci de faire court à celui de dire vrai (4, 3 Igitur de Catilinae coniuratione quam uerissume potero paucis absoluam). La centralité sur l'action principale, sur les personnages
144
majeurs et sur les thèmes privilégiés provoque l'omission d'aspects secondaires, une pratique qu'illustrent entre autres les chap. 6-9, dans lesquels, concentrant le discours autour de l'idée de concordia, il ne dit rien des troubles à l'intérieur de la cité, des conflits entre plébéiens et patriciens...59.
Mais, en fait, Salluste pratique une technique du coup de projecteur et, s'il résume certains faits, c'est pour s'attarder sur d'autres. Aussi, lorsque cela l'arrange pour des motifs thématiques ou dramatiques, allonge-t-il l'énoncé.
- En 14, 6, l'explicitation de « services » que pouvait rendre Catilina afin de s'associer divers jeunes gens, est l'occasion de rappeler leur luxuria.
- En 21, 1, l'état d'esprit des conjurés est dépeint par une formule quelque peu redondante (homines, quibus mala abunde omnia erant, sed neque res neque spes bona ulla), leurs questions à Catilina sont développées à travers une triple
indirecte (21, 2), la réponse ce dernier est amplifiée par une énumération (21, 3).
- En 29, 2-3, il développe l'octroi du SCV, notamment en précisant dans circonstances il est donné et en détaillant les pouvoirs dont disposent les
consuls, autant de généralités qui confèrent plus d'impact à une décision qui aurait pu être signalée en peu de mots60.
- En 41, 1-2, l'hésitation des Allobroges est tirée en longueur par une des avantages que présentait chacune des deux options ; dans le même esprit,
en 46, 2, il est expliqué pourquoi Cicéron est partagé entre joie et anxiété.
- En 43, 2-3, il précise ea diuisa hoc modo dicebantur en spécifiant le rôle que devait tenir chaque conjuré lors de l'insurrection organisée à Rome par Lentulus ; à ce passage correspond peut-être, après la découverte du complot, l'énumération des notables à la garde desquels sont confiés les conjurés (46, 4).
- En 53, 1, le succès de Caton après son intervention est évoqué par des quelque peu pléonastiques : sententiam eius laudant, uirtutem animi ad
caelum ferunt, clarus atque magnus habetur.
Olivier DEVILLERS
ADNOTATIONES
1 Ci-dessous les figures de style (chiasme, asyndète, antithèse, ellipse, zeugma. . .) ne feront pas l'objet d'un examen particulier. Nous relèverons néanmoins de façon générale que Yincon- cinnitas sallustéenne se marie particulièrement avec le climat de bouleversement et de chaos qui ressort l'ouvrage; cf. 3, Ifacta dictis exaequanda sunt.
2 Le récit de la première conjuration de Catilina fait exception dans la mesure où il comporte plusieurs précisions temporelles : 18, 5 cir citer nonas Decembris ; kalendis Ianuariis ; nonas Februarias (deux autres mentions similaires seulement dans l'ouvrage : 17, 1 ; 30, 1). Ceci répond au souci de faire la clarté sur l'épisode (18, 1), mais n'empêche pas l'historien de conclure sur un non liquet (19, 5). Par contre, il maintient des précisions temporelles qui créent une atmosphère (intempesta nocte, «la nuit noire», en 27, 3 et 32, 1).
145
3 Sur la base de Cic, Mur., 50, cette réunion dans la maison de Catilina est située avant les élections de 63.
4 Spéc. P. McGushin, C. Sallustius Crispus. Bellum Catilinae. A Commentary, Leyde, 1977, p. 116; aussi W. Steidle, Sallusts historische Monographien, Wiesbaden, 1958, p. 91-92.
5 P. McGushin 1977 (n. 4), p. 234. 6 La description de ceux-ci est liée à la digression sur Rome par la transition In tanta tamque
corrupta ciuitate (14, 1). De plus, 13, 3 lubido stupri, ganeae est repris en 14, 2, dans la des associés de Catilina, impudicus, adulter, ganeo (texte dont l'établissement est
discuté; G.M. Paul, «Sallust, Catiline 14.2», Phoenix, 39, 1985, p. 158-161). 7 P. McGushin 1977 (n. 4), p. 298-301 (aussi p. 129-130). 8 Déjà 17, 7 ; aussi 19, 1, sur le support apporté par Crassus à Cn. Piso, personnage-clé de la
première conjuration de Catilina. 9 Dans ce sens W.W. Batstone, « The Antithesis of Virtue : Sallust's Synkrisis and the Crisis
of the Late Republic», ClassAnt, 7, 1988, p. 1-29; T. Spath, «Salluste, Bellum Catilinae: un texte tragique de l'historiographie ? », Pallas, 49, 1998 (= Rome et le tragique), p. 189 (sur «l'ambiguïté de toute tentative de conjuguer la uirtus au temps présent d la narration»).
10 T.F. Scanlon, Spes frustrata. A Reading of Sallust, Heidelberg, 1987, p. 33 «The reader is transported from the pinacle of virtus to the depths of the Tullianum».
11 Aussi 38, 3 honestis nominibus. Également H., I, 12 M sub honesto ... nomine. 12 Par ex. D.C. Earl, The Political Thought of Sallust, Cambridge 1961, p. 93-96. 13 K.F. Williams, «Manlius' Mandata : Sallust Bellum Catilinae 33 », CPh, 95, 2000, p. 160-
171. 14 Cette observation vaut aussi pour l'argument carthaginois pour autant qu'on y voie aussi une
allusion à l'attitude de Caton l'Ancien envers cette ennemie de Rome. 15 Liste par T.F. Scanlon 1987 (n. 10), p. 30-33. 16 La même imprécision prévaut lorsqu'il est question des attaques contre les citoyens prévues
par les conjurés à Rome (43, 2 alius autem alium) ; l'exagération, il est vrai, est plus flagrante chez Cic, Cat., III, 8 caedem infinitam ciuium.
17 Selon DC, XXXVII, 40, 1, ils furent environ 3000 à rester auprès de Catilina. 18 P. McGushin 1977 (n. 4), p. 204. 19 Cic, Verr., II, 4, 56. 20 P. McGushin 1977 (n. 4), p. 260. 21 P. McGushin 1977 (n. 4), p. 193. 22 Cf. R. Renehan, « A Traditional Pattern of Imitation in Sallust and His Sources », CPh, 71,
1976, p. 97-105. 23 D.C. Innés, «Quo usque tandem patieminil », CQ, 27, 1977, p. 468. De façon similaire, la
même association d'ignauia et de socordia se trouve dans les discours de Caton (52, 29 socordiae ... atque ignauiae) et de Catilina (58, 4 socordia atque ignauia). Toujours dans le discours de Caton, on trouve quelque écho entre l'énumération domos, uillas, signa, tabulas uostras (52, 5) et celle qu'on trouve dans le premier discours de Catilina tabulas, signa, toreumata (20, 12), à rapprocher toutes deux de celle qui figure dans la digression de Salluste sur Rome signa, tabulas pictas, uasa caelata (11, 5).
24 D.S. Levene, «Sallust's Catiline and Cato the Censor», CQ, 50, 2000, p. 170-191. 25 Une allusion est d'ailleurs possible : tout comme la destruction de Carthage voulue par Caton
l'Ancien avait été le début d'un déclin, celle des conjurés, voulue par Caton d'Utique, sera lourde conséquences.
26 De même, dans son survol de l'histoire de Rome, Salluste - se situant sans doute alors dans la tradition de Caton - ne mentionne pas un seul nom entre Énée (6, 1) et Sylla (11, 4).
27 C/.16, 4; 20, 5-8; 33; 37... Par ex. C. Venturini, «"Luxus" e "avaritia" nell 'opéra di Sallustio (Osservazioni e problemi)», Athenaeum, 57, 1979, p. 277-292.
28 Par ex. T. Spath 1998 (n. 9), p. 183-189. 29 En particulier, le lecteur a été prévenu de la mort de Pison (19).
146
30 T.F. Scanlon 1987 (n. 10), p. 35. 31 L'ambiguïté du portrait de Catilina est du reste montrée par le titre de la monographie de A.T.
Wilkins, Villain or Hero: Sallust's Portrayal ofCatiline, New York, 1994. 32 G. Zecchini, «Cicérone in Sallustio», in C. Stella & A. Valvo (éds), Studi in onore di
A. Garzetti, Brescia, 1996, p. 534. 33 Ce lien avec la collectivité est perceptible dès le portrait du chap. 5 : Salluste affirme s'y
aux mores de Catilina, ce qui permet d'intégrer le passage dans la suite du prologue ; de même, l'idée que les mauvaises pulsions de Catilina sont encouragées par les vices de l'époque introduit la digression sur Rome.
34 État de la question par G. Zecchini 1996 (n. 32), p. 527-531. 35 Aussi en 26, 2, dolus aut astutiae pour l'attitude adoptée par Cicéron afin de se protéger des
manœuvres de Catilina ; même si les deux mots ne sont pas nécessairement désapprobateurs, on voit mal Cicéron écrire (ou dire) de lui-même nec mihi deerant dolus aut astutiae ; P. McGushin 1977 (n. 4), p. 166.
36 Cf. T. Spath 1998 (n. 9), p. 187, sur un Cicéron qui est «la proie de ses sentiments». 37 Estimation de T.F. Scanlon 1987 (n. 10), p. 36. 38 B. Weiden Boyd, « Virtus effeminata and Sallust's Sempronia», TAPhA 1 17, 1987, p. 183-201. 39 Sur spes chez Salluste, T.F. Scanlon 1987 (n. 10). La crainte et l'espérance sont des notions
avec lesquelles Salluste prend ses distances dans le prologue ; 4, 2 a spe, metu, partibus rei publicae animus liber erat.
40 J. Marincola, «Beyond Pity and Fear: the Emotions of History», AncSoc, 33, 2003, p. 294, met en avant ce concept d'« audience-based émotion », à savoir que l'historien
à susciter une émotion donnée en la décrivant. 41 T.F. Scanlon 1987 (n. 10), p. 23. 42 J. Marincola 2003 (n. 40), p. 314. 43 É. Evrard, « L'émergence du narrateur principal dans l'œuvre de Salluste », in R. Poignault
(éd.), Présence de Salluste, Tours, 1997 p. 23. 44 Uexemplum présente une autre erreur concernant le prénom du personnage (A. au lieu de T.). 45 En 4, 5 initium narrandi faciam n'annonce pas un événement en particulier. 46 II y a là une forme d'analyse ex euentu, comme lorsqu'il prête au César de 63 le désir d'une
nouvelle guerre qui le couvrirait de gloire (54, 4). 47 À ce moment le consul, qui en réfère au Sénat sans avoir ouvert les lettres prises aux Allo-
broges, craignait surtout d'être accusé de répandre de fausses alarmes (Cic, Cat., III, 7) ; P. McGushin 1977 (n. 4), p. 224.
48 Pour d'autres allusions possibles à l'actualité, T.F. Scanlon 1987 (n. 10), p. 69 : le débat sur le sort à réserver aux conjurés ferait écho à celui sur le sort à réserver aux césaricides ; la bravoure de Catilina à Pistoia rappellerait celle de Brutus et de Cassius à Philippes.
49 D.S. Levene 2000 (n. 24), p. 189-190. 50 P. McGushin 1977 (n. 4), p. 62 ; le même commentateur, p. 1 12, revient sur l'expression uas-
tus animus à propos de 15, 4 ita conscientia mentem excitam uastabat. 51 P. McGushin 1977 (n. 4), p. 273. 52 Dans un même passage, la répétition de suggère un thème : insistance sur la gloire dans
l'éloge de l'ancienne Rome (7, 3 et 6 gloriae ; 6 gloriam) ; sur le scandale dans la des associés de Catilina (14, 1 flagitiorum; 2 et 3 flagitium) ; sur l'espérance parmi les
motivations des conjurés (21, 1 spes; speï); sur la débauche dans le portrait de Sempronia (25, 2 luxuriae ; 4 luxuria) ; sur la pauvreté dans le message de Manlius à Marcius Rex (33, 1 miseri, egentes ; 4 miseris ciuibus) ; sur la dette dans l'épisode relatif aux Allobroges (40, 1 et 4 aère alieno ; 1 aes alienum) ; sur le danger dans le discours de Caton (52, 2 pericula ; 28 periculis ; 36 pericula) . . .
147
53 On observe une même différence après la découverte de la conjuration, entre Cicéron, entre joie et souci (46, 2 ingens cura atque laetitia), et la plèbe, tout à la joie (48, 2 gau-
dium atque laetitiam agitabat). 54 Encore au moment de l'embuscade du pont Mulvius, 45, 3 sicuti praeceptum eraî; après
l'interception de Volturcius et des Allobroges, trois iubet successifs (46, 3, 5 et 6) ont pour sujet Cicéron; pour l'exécution des conjurés, 55, 1 iubet; 55, 5 quibus praeceptum erat.
55 G. Zecchini 1996 (n. 32) songe particulièrement au De Consiliis suis de Cicéron. 56 P. McGushin 1977 (n. 4), p. 220-222. De même, la phrase prêtée à Catilina après la
lère Catilinaire de Cicéron (31,9 incendium meum ruina restinguam ; selon Cic, Cat., II, 13, le conjuré resta silencieux) aurait été prononcée avant les élections consulaires de 63 (Cic, Mur., 51).
57 Dans le même sens, la critique qu'adresse Catilina à la socordia et à Yignauia de Lentulus (58, 4) n'est pas cohérente avec l'activité prêtée à celui-ci dans les chap. 43-44, dans lesquels l'historien met en avant la menace sur l'État.
58 De même, dans la digression sur l'histoire de Rome, il reconnaît que la réputation historique est question de hasard et ne se mesure pas toujours à l'aune de la vérité (8, 1 Sed profecto fortuna in omni re dominatur ; ea res cunctas ex lubidine magis quant ex uero célébrât
atque). 59 Sur les sélections de la matière dans les chap. 6-9, P. McGushin 1977 (n. 4), p. 69-86. 60 M.-L. Freyburger-Galland, «Catilina chez Salluste et Dion Cassius», in R. Poignault
(éd.)1997 (n. 43), p. 68 parle d'un «luxe de détails».
148