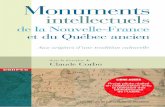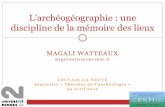Monuments intellectuels de la Nouvelle-France et du Québec ...
intellectuels et mémoire historique
-
Upload
univ-paris1 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of intellectuels et mémoire historique
1
Christophe CHARLE (Université de Paris-I)
Les intellectuels depuis l'affaire Dreyfus, usages et cécité d’une mémoire
historique
L’une des principales caractéristiques de la catégorie des intellectuels en France est d’être les témoins et souvent les garants d'une certaine mémoire, c'est-à-dire, pour l'essentiel, d'épisodes historiques dans lesquels ils ont été acteurs. Cette fonction est constitutive de la notion française même d'"intellectuels" (il faudrait utiliser les guillemets pour marquer la différence avec le sens banalisé et ahistorique de la littérature sociologique internationale), notion historique par essence, née de l'histoire et qui ne perdure dans son invariance relative que par la mémoire et la réhistoricisation. Les intellectuels en France sont donc au point crucial qui sépare la mémoire et l'histoire si l'on reprend l'analyse classique d'Halbwachs1. Halbwachs y oppose l'histoire, tableau des changements, et la mémoire collective, entreprise de perpétuation des invariances par un groupe, gommant donc l'histoire susceptible de modifier le groupe. Au contraire pour les intellectuels français, l'identité collective et l'invariance relative de la représentation de leur rôle passent par la mémoire réactivée d'épisodes qui se veulent des ruptures mais où les intellectuels ont cherché à affirmer des continuités transhistoriques qui justifient leurs interventions au nom de valeurs supposées non historiques.
Ma démarche sera génétique, mais elle sera de sens opposé à l’histoire commémorative habituelle des intellectuels car j'y introduirai une dimension structurelle explicative, par opposition à la démarche normative qui prévaut dans les essais sur l'être ou le devoir-être des intellectuels. Il ne s'agit pas pour autant, autre piège de toute interrogation historique sur les intellectuels, d'en faire une sociologie destructrice visant à les dénoncer pour les réduire au silence et dévaluer leur mémoire. L'étude génétique et l'analyse structurale tâchent de montrer pourquoi, ce qui, dans un groupe ordinaire, est impossible à tenir ensemble sans contradiction, la mémoire et l'histoire, sert au contraire, du moins en France, à empêcher que l'anti-intellectualisme réducteur ne l'emporte définitivement dans les périodes de basses eaux, tout comme, inversement, la mémoire des précédents évite tout triomphalisme prématuré des
1Cf. Maurice Halbwachs, La mémoire collective (1950), 2ème éd., Paris, PUF, 1968, notamment pp. 76-77.
2
2
combats toujours à refaire et sert d'invitation à refaire l'histoire, toujours fragile, du groupe symbolique. Cette tension contradictoire et le débat historique qui traverse les intellectuels comme enjeux de mémoire politique étaient en fait présents dès le point de départ. C'est pourquoi il est nécessaire de procéder à quelques rappels sur l'épisode fondateur, l'affaire Dreyfus.
L'acte de naissance, l'affaire Dreyfus. Comme toujours quand on parle de mémoire et d'histoire, il faut partir des mots,
de leur sens et de leur changement de sens, comme signes d'autres changements plus profonds.
“Intellectuel” est un substantif qui n'existait pas en français avant les années 1890, et, quand il a commencé à être employé dans ces années, il était toujours employé soit avec des italiques, pour montrer qu'il était justement un mot un peu à part, soit avec une majuscule, pour souligner que l'on désignait un ou plusieurs individus sortant de l'ordinaire2. Dès le départ, se trouve l'idée qu'il s'agit d'une catégorie hors normes, qui doit se faire une place et trouver son identité, alors que d'autres mots concurrents ou antérieurs pourraient la désigner tout aussi bien. Ce mot est pourtant devenu courant malgré son sens initial très particulier. Il est devenu usuel au lendemain d'un événement précis, la fameuse lettre publiée par Émile Zola dans L'Aurore et passée à la postérité sous le titre de "J'accuse", alors que son titre exact est "Lettre ouverte au Président de la République". Au lendemain de cette lettre, a été publiée une protestation signée par un certain nombre d'universitaires, d'hommes de lettres, d'artistes, de journalistes, d'étudiants ou d'individus sans titres particuliers qui approuvaient cette lettre de Zola, et demandaient la révision ou un nouveau procès pour le capitaine Dreyfus. Or cette protestation s'appelle simplement "protestation" dans les journaux. Par la suite, l'un des principaux adversaires des dreyfusards, Maurice Barrès, a publié un article la désignant comme “ La protestation des Intellectuels ”. C'est alors que le terme devient une notion générale et employée de façon courante. Les “ intellectuels ”, comme beaucoup de mouvements artistiques ou politiques ont donc été baptisés par leurs adversaires. Ceci explique déjà pourquoi cette notion d'"intellectuels" est problématique, puisqu'à l'origine c'est une insulte. Dire en 1898, “ ce sont des intellectuels ”, équivaut à “ ce sont des dreyfusards ”, des gens qui prétendent des choses que l’immense majorité des Français refusent. On trouve aussi l'idée d'une dissidence, et d'une prise à parti du pouvoir. Cet implicite colore le mot de manière très
2Sur ce point on trouvera une analyse détaillée dans mon livre, Naissance des "intellectuels" (1880-1900), Paris, Ed. de Minuit, 1990.
3
3
particulière. On aurait pu en rester là. Périodiquement, dans le vocabulaire politique, de nouveaux mots apparaissent pour désigner des tendances politiques précises, liées à une conjoncture, mais, par la suite, il ne viendrait à personne l'idée de traiter quelqu'un avec ces mots datés, sauf par métaphore ou comme insulte rétrospective. Histoire et sémantique
Or la notion d'"intellectuels" en France bien qu’historique et datée est pourtant encore aujourd'hui employée dans son sens quasi premier, j'en veux pour preuve le manifeste publié en novembre 1993, à l'occasion du Carrefour européen des littératures de Strasbourg, dont la thématique est quasi dreyfusarde, ou les récentes campagnes de pétitions à propos de la loi Debré sur les sans-papiers, ou de la réforme de la Sécurité sociale proposée par le gouvernement Juppé3.
Ce paradoxe d'une histoire devenue mémoire s'explique par l'histoire de l'affaire Dreyfus. Les dreyfusards ont été obligés de recourir au procédé du scandale délibéré, c'est-à-dire un moyen de lutte hors normes. Ce que Zola affirmait dans sa lettre "J'accuse" reposait sur une simple reconstruction intellectuelle à partir de quelques indices. Ces allégations tombaient sous le coup de la diffamation, d'autant plus que Zola attaquait les plus hautes autorités de l'État et certains chefs de l'armée.
Le deuxième procédé d'affirmation des "intellectuels" est cette protestation déjà citée, qui a servi d'acte de baptême aux intellectuels. Elle a pour fonction de montrer que l’acte de Zola n'est pas celui d’un fou, puisqu'on peut toujours dire de quelqu'un qui dénonce les gens sans preuves qu'il est fou. Il n'est pas fou, puisqu'il a derrière lui non seulement des licenciés ès lettres, des licenciés ès sciences, mais aussi Anatole France, de l'Académie française, des membres de l'Institut, des professeurs à la Sorbonne, des gens raisonnables et assis dans la société. L'acte de naissance des intellectuels se fonde surtout sur cette affirmation collective. Les "intellectuels" ne valent pas un par un, ils valent collectivement. Ils ne détiennent un pouvoir social que s'ils sont groupés, s'ils s'associent entre eux pour une action collective. C'est la grande rupture fondatrice de l'affaire Dreyfus qui en fait un lieu de mémoire essentiel. Naguère, l'histoire politique française avait déjà connu l'intervention des intellectuels, si l'on peut employer rétrospectivement le mot. Chateaubriand, Victor Hugo, Lamartine, George Sand, Michelet, Taine, Renan, ont pris des positions politiques décisives dans certains grands débats. Mais chacun d'eux le faisait en tant qu'individu connu, en tant qu'écrivain célèbre, savant ou poète illustre. Ils n'avaient pas besoin d'aller demander à des obscurs
3 Cf. Le Monde du 5 novembre 1993, p. 28.
4
4
et des sans-grades, même titrés, de les appuyer. Ils se suffisaient à eux-mêmes, ils étaient des témoins par eux-mêmes.
La dimension collective des intellectuels apparaît à ce moment et demeure centrale tout au long de leur histoire en fonction du nouveau paysage politique. Dans une république parlementaire où tout le pouvoir réside dans le Parlement et où les seuls représentants habilités de l'opinion publique sont les parlementaires, si l'on ne passe pas par les voies officielles il faut que les intellectuels s'érigent en une collectivité qui dit son mot dans un débat politique. Ils doivent former, comme tous ceux qui jouent un rôle en démocratie, un parti ou un groupe politique, en signant des pétitions qui, elles-mêmes, préparent des ligues formalisées et des actions de longue durée. En même temps, ils prouvent que les hommes politiques ne jouent pas leur rôle. Ils remettent en cause la légitimité du pouvoir politique, ce qui va bien au delà d'attaques personnelles comme celles de Zola dans J’accuse. A la limite, c'est une remise en cause du système parlementaire et de sa division du travail entre citoyens et délégués. Ceci repose sur l'idée que la démocratie en place est pleine de manques, de déficiences, de défauts et qu'il incombe à des citoyens plus éclairés que les autres, les "intellectuels", d'y remédier. Par cette action, on change d'univers politique et cela apparaissait insupportable, non seulement aux hommes politiques, contestés dans leur légitimité de représentants de l'opinion publique, mais aussi et surtout à un autre type d'intellectuels, qui refusent la notion mais sont quand même des intellectuels au sens sociologique banal. Ces derniers contestent le point de départ du raisonnement justificateur de l'entreprise, la nécessité de réviser le procès de Dreyfus et les moyens utilisés par les intellectuels dreyfusards4.
A partir du moment où ils sont sur la défensive, soit à l’automne 1898, les
intellectuels antidreyfusards vont reprendre les procédés des dreyfusards, validant ainsi indirectement l'existence d'une lacune dans la démocratie établie et prouvant eux-mêmes la légitimité indirecte d'une action collective des intellectuels comme contre-pouvoir hors normes. A gros traits, les intellectuels anti-intellectuels vont, eux aussi, publier des pétitions, mener des campagnes d'opinion, mettre en cause certains dreyfusards, fonder une ligue. Face à la "Ligue des droits de l'homme" des dreyfusards,
4 L’intellectuel qui a le mieux défini chez les antidreyfusards le refus de l’action des “ intellectuels ” est Brunetière dans “ Après le procès ” (Revue des deux mondes 15 mars 1898) Cf. aussi, A. Compagnon, Connaissez-vous Brunetière? Enquête sur un antidreyfusard et ses amis, Paris, Le Seuil, 1997, p. 128 et sq.
5
5
ils créent "la Ligue de la Patrie française"5. Les intellectuels forment ainsi deux partis qui s'opposent sur tout, sauf sur le fait qu'il est légitime de former un parti intellectuel.
Dès lors, "intellectuels" n'est plus seulement synonyme d'intellectuels
dreyfusards, le terme englobe aussi les intellectuels antidreyfusards. Il existe donc une action collective des intellectuels de gauche et de droite, selon des modalités analogues pour former deux partis opposés, puisqu'il y a toujours, comme dans le champ politique, la résistance et le mouvement, la gauche et la droite. Ainsi se crée une nouvelle communauté politique qui se recrute essentiellement dans les milieux intellectuels. On voit maintenant comment la dynamique de l'affaire Dreyfus, la nécessité de mobiliser l'opinion publique et les nouveaux procédés employés pour la mobiliser aboutissent à diffuser cette notion d'"intellectuels". Elle ne va plus seulement être une injure politique ou seulement désigner une partie de l'opinion. Elle définit à présent une catégorie de citoyens qui peuvent avoir des opinions opposées, mais considèrent tous qu'ils ont une responsabilité dans le débat public au nom de principes généraux divergents.
Le conflit des valeurs : l'individu ou la nation?
Ce qui est essentiel dans l'affaire Dreyfus, c'est non seulement qu'elle innove au plan du vocabulaire, des représentations et des moyens d'action employés par les acteurs, mais aussi par l'enjeu du débat lui-même. Ici encore, nous sommes confrontés à un paradoxe : comment une affaire individuelle est-elle devenue un enjeu collectif déterminant un nouveau clivage fondamental de la politique ? Pourquoi des partis se coalisent-ils pour ou contre? En fait, l'affaire Dreyfus met en cause des valeurs, qui relèvent de la mémoire politique française et en même temps leur donne un nouveau sens historique en fonction du contexte précis. D'un certain côté, l’affaire Dreyfus réactive le débat centenaire de la Révolution française entre ceux qui croient aux droits de l'homme, et pour qui les droits d'un individu sont supérieurs à la raison d'État, et ceux, au contraire, restés fidèles à l'idée monarchique de l'État supérieur à tout parce qu'il forme le ciment de la nation et prêts à souffrir une injustice plutôt qu’un désordre, selon la phrase célèbre de Goethe. L’État doit être défendu par une armée et, dans la mesure où le pays est menacé par des ennemis extérieurs, les Français n'ont pas le droit de se battre entre eux et d'affaiblir l'armée. Pour les intellectuels dreyfusards, la France n'est plus la France si elle n'est pas fidèle à son œuvre révolutionnaire et aux droits de l'homme; pour les intellectuels antidreyfusards au contraire, la France n'est plus la
5On peut renvoyer ici pour plus de détails à Jean-Denis Bredin, L'Affaire, n. éd. revue et augmentée, Paris, Fayard, 1993 et Jean-Pierre Rioux, Nationalisme et conservatisme, La Ligue de la Patrie française, Paris, Beauchesne, 1977.
6
6
France si elle est faible, divisée, si l'État peut être affaibli face à l'ennemi extérieur. C'est donc un débat fondamental : qui doit primer de l'individu ou de la nation, de l'individu ou de l'État? C'est aussi l'opposition entre la France liée à un régime politique parce que liée à un idéal, et la France comme entité éternelle. Les intellectuels des deux côtés défendent et ont conscience de défendre des valeurs fondamentales, et, par là même, d'être les porte-parole de deux traditions historiques totalement inconciliables.
Ceci explique pourquoi ce débat va se trouver périodiquement réactivé dans d'autres circonstances historiques, complètement différentes. On ne sera pas, à chaque fois, obligé de savoir si quelqu'un est innocent ou coupable, mais, à chaque fois, on va retrouver les mêmes systèmes de valeurs qui s'affrontent, et ce seront des coalitions d'intellectuels qui vont défendre ces valeurs avec des arguments identiques. Pourtant, au lendemain de l'affaire Dreyfus, le thème de la fin des intellectuels et de leur trahison commence à apparaître dans le débat politique. Cela peut paraître paradoxal. Ce changement idéologique a deux explications : les dreyfusards l'ont emporté et sont arrivés au pouvoir. Or, une partie de leurs anciens amis ont constaté qu'une fois au pouvoir, ces dreyfusards, si attachés aux principes, si attachés à la Révolution française, n'ont eu de cesse de trahir ces principes. Clemenceau, directeur de l'Aurore en 1898, ministre de l'intérieur en 1906 puis président du Conseil, fait tirer sur les ouvriers, réprime le mouvement des vignerons du Languedoc et jette en prison les leaders du principal syndicat, la C.G.T. Péguy dans Notre Jeunesse (1910), en tire la conclusion que le dreyfusisme qui, au début, était une mystique et défendait des valeurs éternelles s'est transformé en vulgaire politique. L'Affaire est devenue en fait un marchepied pour les arrivistes, pour les ambitieux qui, grâce à ce combat politique, ont accédé à de nouveaux ministères, à de nouvelles prébendes et, une fois au pouvoir, ont totalement oublié les principes sur lesquels ils avaient été élus.L'autre type d'attaque contre les intellectuels est celle, plus classique des antidreyfusards. Ils ont le sentiment que les dreyfusards étaient, dès le départ, pleins de duplicité : la défense de valeurs intemporelles et éternelles n'était qu'un faux-semblant et cachait des intérêts beaucoup plus médiocres. Le fait même d'être un intellectuel, aux yeux des antidreyfusards, est une perversion parce que ce rôle repose sur un raisonnement faux. C'est toute la thématique de l'Action française, qui prend son essor dans les années 1900. Les "intellectuels" non seulement sont intrinsèquement pervers, mais la République elle-même l'est : régime faible et instable, elle laisse faire cette catégorie. Seule une contre-révolution permettra d’écarter durablement les intellectuels du pouvoir. Non seulement il faut annoncer leur mort, mais il faut les tuer si besoin est socialement et même
7
7
physiquement : la première victime de cette campagne fut Jaurès dont l'assassin a été influencé par l'Action française et sa campagne contre le leader pacifiste6.
Ainsi apparaissent très vite les trois thématiques de la trahison, de la perversité et de la mort des intellectuels. Ces thématiques se retrouvent tout au long du XXème siècle. La dénonciation récurrente du précédent de l'affaire Dreyfus contribue ainsi indirectement à entretenir son rôle de mémoire fondatrice pour les intellectuels du XXème siècle.
Les avatars d'une dialectique Il reste à montrer comment se sont maintenues et se sont renouvelées ces
alternances d'apogée et de déclin des intellectuels au cours du XXème siècle, de mémoire passive et d'histoire active.
Des raisons de fond rendent compte du maintien de ces thématiques. Jusqu'aux années 1960, le nombre d'intellectuels potentiels reste relativement restreint. La croissance du nombre des intellectuels continue, mais demeure à une échelle modeste comparée à aujourd'hui. On n'est pas arrivé à ce que l'on appelle l'intelligentsia de masse. De 30 000 étudiants vers 1900, on passe, en 1935, à 80 000 surtout à cause de la féminisation. En 1960, on arrive à 194 000. Ce n’est qu’au-delà, que l'on change d'échelle : en 1975 on atteint 800 000, aujourd’hui au delà de deux millions. Être un étudiant au moment du Front populaire, c'est encore appartenir à une toute petite élite. Les mêmes phénomènes se produisent pour les autres professions intellectuelles, notamment les universitaires. La spécificité et le caractère élitiste de la notion d'intellectuels ne disparaissent pas avant les années 1960.
Le deuxième fait important, est la coupure de la guerre de 1914. La première guerre mondiale a représenté un coup très dur pour les intellectuels puisque les dreyfusards étaient, au départ, pacifistes. Ils étaient contre le pouvoir de l'armée et donc hostiles à l'idée qu'une guerre devait se déclarer. Cet idéal pacifiste a subi une certaine désaffection avec la guerre où les intellectuels des deux bords se mobilisent presqu'unanimement au sein de l'Union sacrée7. Pourtant, paradoxalement à la fin de la
6 On peut rappeler aussi que l’avocat de Dreyfus, Labori, a été également victime d’une tentative
d’attentat lors de procès de Rennes (1899) et qu’on a prétendu à un certain moment que la mort accidentelle de Zola (1902) était en fait un coup monté de l’extrême droite. Un autre dreyfusard, Léon Blum, sera violemment aggressé par des militants d’extrême droite le 13 mars 1936. 7Christophe Prochasson et Anne Rasmussen, Au nom de la patrie, Paris, La Découverte, 1996 et C. Prochasson, Les intellectuels, le socialisme et la guerre (1900-1938), Paris, Le Seuil, 1993.
8
8
guerre, on assiste à une nouvelle mobilisation pacifiste des "intellectuels". De nouveau, les idées pacifistes retrouvent une audience, avec notamment l'idéal de la concorde entre les nations (les principes de la SDN). La réaction est à la mesure du sacrifice de toute une génération des jeunes intellectuels. Par exemple, la moitié des effectifs des promotions de l'École normale supérieure de ces années est morte dans les tranchées. La jeune génération en veut particulièrement aux intellectuels établis, les héritiers des antidreyfusards qui ont pratiqué "le bourrage de crâne", l’encouragement à l'ardeur belliciste de la population. Ce pacifisme instinctif des jeunes générations renoue donc avec la première tradition dreyfusarde8.
Le deuxième facteur paradoxal de renaissance de ce dreyfusisme est la Révolution russe. Pour nombre d'intellectuels de gauche, la Révolution russe, notamment celle de février 1917, est une répétition de la Révolution française, une conséquence lointaine de la Révolution française, l'achèvement de la Révolution française. Il faut se replacer dans l'esprit de l'époque où l'information était très différente de celle que l'on peut avoir aujourd'hui sur ce qui s'est passé. Lénine lui-même revendiquait l'héritage de la Commune, se réclamait de Robespierre. La Révolution russe apparaissait comme la fin du tsarisme donc la fin du despotisme et de loin ressemblait beaucoup à la fin de la monarchie en France. Pour ceux qui sympathisent avec cette nouvelle révolution, la révolution redevient un idéal d'actualité à cause la Révolution russe.
L'autre phénomène est le maintien d'un courant d'extrême droite important entre les deux guerres, incarné par l'Action française, à l'apogée de son influence à l'époque. Son idéologie repose à la fois sur une dénonciation du dreyfusisme éternel et sur un effort pour mobiliser le courant intellectuel antidreyfusard à travers un certain nombre de manifestes, comme celui qui, au lendemain de la guerre, s'intitule "Pour un parti de l'intelligence" et dénonce le "bolchevisme intellectuel" dont témoignerait le texte publié peu auparavant par Romain Rolland et signé par des intellectuels français et étrangers en faveur d'une internationale de l'esprit9. On voit bien le prolongement des appels de l'affaire Dreyfus. Cela mobilise par réaction ceux qui, au contraire, continuent d'être les partisans de la République et des valeurs dreyfusiennes. Cette forte tradition d'extrême droite contribue au maintien d'une tradition de type dreyfusard de l'autre côté.
Le dernier facteur de permanence est l'aggravation, dans l'entre-deux-guerres, comme dans les années 1890, de la crise latente de la classe politique.
8Sur le pacifisme des normaliens, cf. Jean-François Sirinelli, Génération intellectuelle, khâgneux et normaliens dans l'entre-deux-guerres, Paris, Fayard, 1988. 9Le Figaro du 15 juillet 1919; le texte de Romain Rolland est publié dans L'Humanité du 26 juin 1919; tous ces textes sont cités dans J.-F. Sirinelli, Intellectuels et passions françaises, Paris, Fayard, 1990, p. 41 et sq.
9
9
L'antiparlementarisme est extrêmement répandu aussi bien à droite qu'à gauche d'ailleurs : la République est dénoncée comme décadente parce qu'elle n'arrive pas à résoudre les problèmes. Comme dans les années 1890, les intellectuels se sentent appelés de nouveau à jouer un rôle puisque les hommes politiques ne jouent pas le leur.
Tels sont les éléments de continuité qui expliquent qu'à la faveur de certaines crises, le dreyfusisme et l'antidreyfusisme puissent renaître à peu près dans les mêmes termes.
Apparition de critères nouveaux.
Mais il se produit également un certain nombre de phénomènes nouveaux qu'il ne faut pas sous-estimer et qui expliquent que la mémoire du rôle passé des intellectuels ne puisse être réactivée exactement dans les mêmes termes pendant cette période.
Le premier changement concerne la notion d'élitisme. On avait beaucoup reproché leur élitisme aux intellectuels dreyfusards : en signant des pétitions, en se posant en représentants de l'opinion en dehors des représentants patentés de l'opinion, ils prétendaient être une élite dirigeante nouvelle. Cette prétention était justifiée par le fait qu'ils avaient, de par leurs fonctions sociales, plus de lumières et une responsabilité particulière vis-à-vis de l'opinion. Cela revenait à affirmer qu'il y avait des privilégiés dans la démocratie, ce qui entre en contradiction avec la notion de démocratie puisque cela contredit le principe d’égalité.
En fait, les intellectuels de gauche dans l'entre-deux-guerres abandonnent leur élitisme initial et celui-ci est définitivement accaparé par la droite intellectuelle. En tant que défenseurs de la démocratie, les intellectuels de gauche se rallient à l'idée que leur fonction est de rendre la démocratie réelle, plus profonde et non de se poser en élite à part. Il faut donc diffuser les lumières. On peut retrouver ici aussi un phénomène de mémoire; un certain nombre de dreyfusards militants avaient déjà essayé de jouer ce rôle. Ils avaient notamment fondé des universités populaires pour faire partager aux classes populaires qui n'avaient pas pu faire d'études, des connaissances nouvelles et leur éviter d'être influencées par ce que les dreyfusards appelaient la “ mauvaise presse ”, qui défendait les idées antidreyfusardes et attisait l'antisémitisme et la xénophobie. C'était déjà un premier pas vers le peuple, comme on disait à l'époque. Ce mouvement renaît dans l'entre-deux-guerres. Certains proposent de supprimer la barrière, très forte en France à l'époque, entre, d'un côté, l'enseignement primaire, destiné aux futurs paysans et aux futurs ouvriers, et, de l'autre, l'enseignement du lycée réservé à une petite élite essentiellement bourgeoise. Ce sera un combat central jusqu'aux années 1970 pour les intellectuels de gauche et un facteur de leurs sympathies
10
10
pour les régimes de l'est aux réformes de l'enseignement radicales. Ainsi certains intellectuels de gauche, notamment Paul Langevin, Henri Wallon par exemple, vont être des fervents militants de cette idée, qu'il faut élargir le recrutement des élites aux classes populaires, pour, une fois encore, achever la révolution des droits de l'homme.
A l’inverse, l'élitisme tend à être accaparé par l'autre camp intellectuel, héritier des antidreyfusards. Pour ces derniers, il faut absolument maintenir la barrière, sinon nous allons vers le régime de la médiocrité.
On assiste également à la progressive organisation des intellectuels comme groupe social. Auparavant, l'engagement des intellectuels se produisait de façon épisodique, au coup par coup; il existe maintenant des intellectuels de parti, qui prennent une carte, défendent des positions précises et perdent leur autonomie en tant qu'intellectuels pour gagner en efficacité collective. Un clivage se crée entre ceux qui restent fidèles à l'ancienne conception selon laquelle les intellectuels doivent se garder de s'engager de façon durable dans un parti, et ceux, au contraire, qui pensent qu'un intellectuel, est un citoyen comme un autre et que sa seule activité efficace sera justement d'entrer dans un parti politique. Ce débat va être central des années 1920 jusqu'aux années 1960-70, tant qu'il y aura cette alternative de l'engagement ou au contraire de la réserve. On peut y voir de nouveau une dialectique de la mémoire et de l'histoire. Doit-on être fidèle à la mémoire fondatrice du groupe ou, au contraire, s'adapter à la nouvelle conjoncture historique qui marginalise les individus isolés, au risque de trahir la conception initiale et intemporelle du combat pour les valeurs? En même temps, c'est par ce débat sur l'engagement, au sens nouveau, que la mémoire du noyau initial peut se maintenir car il existe un groupe irréductible qui dénonce ce que Julien Benda appelle la “ trahison des clercs ” par le biais de la mise en carte des intellectuels.
La troisième innovation de cette période est le changement du paysage "médiatique". Lors de l'affaire Dreyfus, seule existait la presse comme moyen de mobiliser l'opinion publique. Dans l'entre-deux-guerres, apparaissent d'autres moyens; notamment la radio mais également le cinéma, puisqu'au cinéma on passe les actualités qui traitent, à leur manière, de politique10. Or les intellectuels ont un accès beaucoup plus limité à ces nouveaux médias. Il faut être particulièrement connu ou reconnu pour que l'on vous demande votre avis sur de grands problèmes. Ce phénomène des médias de masse, propriété des grands intérêts privés ou qui demandent de gros investissements accroît l'inégalité interne des intellectuels pour mobiliser l'opinion. Ce clivage va être de
10Sur ces transformations, voir Marc Martin, Médias et journalistes de la République, Paris, O. Jacob, 1997, chapitre V.
11
11
plus en plus important : il se produit comme une séparation entre les vrais intellectuels qui gardent l'accès à ces nouveaux médias, et les autres qui se contenteront d'avoir un rôle suiveur ou passif ou d'agir dans des cercles étroits, faute de moyens de diffusion de leurs idées.
La dernière spécificité de cette époque, réside dans les débats internes aux intellectuels : quelles sont les nouvelles causes sur lesquelles doivent se mobiliser les intellectuels? Doivent-ils rester dans la tradition de leur mémoire fondatrice ou innover, s'adapter aux nouveaux combats? L'épisode central pour la mobilisation des intellectuels dans ces années de l'entre-deux-guerres est la période du Front populaire. Si l'on analyse le Front populaire dans la perspective d'une comparaison avec l'affaire Dreyfus, on est frappé par un certain nombre d'analogies et de phénomènes de mémoire collective.
Tout d'abord, la mobilisation des intellectuels en faveur du Front populaire, c'est-à-dire d'une union des partis de gauche, est antérieure à celle des partis politiques. Ce sont les intellectuels qui, comme lors de l'affaire Dreyfus, ont servi de ferments pour mobiliser l'opinion publique et ont forcé les partis politiques à prendre le train en marche de cette union. Il s'agit bien sûr d'une vision un peu idéaliste et simplifiée du Front populaire, mais, dans l'image commune du Front populaire, pour l'opinion de l'époque, c'est ce qui s'est passé. On sait bien que, dans la réalité, les faits sont plus complexes avec notamment le changement de stratégie de Staline en France qui a permis le rapprochement communistes/socialistes. Les contemporains, même les intellectuels, ne savaient pas ce qui s'était réellement passé. Pour eux, l'important avait été, au lendemain du 6 février 1934, l'appel du Comité de vigilance des intellectuels antifascistes11, soit de nouveau une pétition, analogue à la protestation des intellectuels de 1898; ou encore la création de comités en faveur de l'unité, comme les comités de la Ligue des droits de l'homme; ou enfin les mouvements de masse au moment des grandes manifestations avec, à leur tête, des intellectuels prestigieux. On semblait un peu rejouer la même pièce que celle qui avait été inventée cinquante ans avant.
Le second facteur de continuité entre l'affaire Dreyfus et le Front populaire est qu'on retrouve des combattants de l'affaire Dreyfus à la tête du Front populaire, comme Paul Langevin, professeur au Collège de France, (dont le nom, au moment de l'affaire Dreyfus, figurait dans les 10 ou 15 premières signatures du manifeste des intellectuels), Alain, professeur de philosophie au lycée Henri-IV, lui aussi dreyfusard de la première heure, Paul Rivet, professeur au Muséum et également ancien dreyfusard ou encore
11"Appel aux travailleurs" rendu public le 5 mars mais élaboré le 17 février 1934, cf. J. F. Sirinelli, op. cit., p. 88.
12
12
Victor Basch, président de la Ligue des droits de l'homme et président du Rassemblement populaire qui avait été aussi, au moment du procès de Rennes en 1899, un très actif dreyfusard.
Dans le programme du Front populaire, le slogan c'est "le pain, la paix et la liberté". La paix et la liberté sont deux valeurs dreyfusardes. Dans le camp opposé au Front populaire, à l'extrême droite, on retrouve des vieux chevaux de retour qui étaient des antidreyfusards farouches, Maurras, Léon Daudet, Henri Massis. On assiste aussi à une exacerbation de la haine xénophobe et antisémite (notamment contre Léon Blum, le président du conseil) qui renoue avec les discours de l'affaire Dreyfus12. Les mêmes programmes s'opposent : d'un côté, la démocratie, de l'autre, un régime autoritaire ; d'un côté le pacifisme, de l'autre le culte de l'armée dernier rempart contre l'ennemi intérieur et extérieur.
Des schémas en échos.
Il s'agit d'une période de tension extrême : les gens sont extrêmement violents dans les polémiques politiques, une violence qui va laisser des traces très profondes, puisqu'ensuite, on ne va plus jouer avec des plumes ou des stylos mais avec des vraies armes pendant la guerre où les règlements de comptes vont aller jusqu'au bout avec la chasse aux partisans du Front populaire sous Vichy : on peut penser à Paul Langevin, envoyé en résidence surveillée, à Victor Basch, assassiné par la Milice, plus généralement aux universitaires juifs ou de gauche persécutés. Avec l'épuration des collaborateurs en 1944-45, y répondent l'exécution de Brasillach et le procès contre Maurras et la liste de proscription des écrivains publiée par le Comité national des écrivains. La guerre civile des intellectuels n'est plus seulement une guerre civile verbale mais une exclusion réciproque de l'autre camp de l'espace intellectuel et politique.
A côté du jeu de la mémoire, existent des discontinuités historiques liées aux modifications de structure évoquées plus haut.. Les partis politiques jouent maintenant un rôle fondamental. Les "intellectuels" ne peuvent plus rester complètement en dehors des partis politiques. Ils sont pris entre le marteau et l'enclume et perdent ce qui faisait leur force, c'est-à-dire leur autonomie. Ils doivent aussi se prononcer non plus seulement en fonction des débats internes à la France mais à propos aussi des questions internationales complexes dont ils maîtrisent moins bien les tenants et les aboutissants, où la France n'est plus seule en cause. Ainsi on assiste à une guerre de manifestes à
12Cf. notamment Pierre Birnbaum, La "République juive" de Léon Blum à Mendès France, Paris, Fayard, 1987.
13
13
propos de l’Éthiopie en 1935 (donc de l'Italie fasciste), de la situation en Allemagne (donc du nazisme), des rapports avec l'URSS (donc du communisme), de la guerre d'Espagne (donc de la paix et de la guerre). Il devient de plus en plus difficile de faire entrer cette histoire dans les schémas de mémoire antérieurs. La tentation est donc grande du "prêt-à-penser" en fonction d'une ligne, du moindre mal, de la palinodie et du reclassement permanent : antifascisme, anticommunisme, etc. Les intellectuels qui devraient, selon leur idéal premier, servir de points de repères à des systèmes de valeurs sont eux-mêmes parfois désorientés et divisés même à l'intérieur des deux grandes tendances classiques d'où des reclassements parfois surprenants entre les deux camps comme lors de la crise de Munich. De nouveau, comme après l'affaire Dreyfus, la thématique du déclin, de la mort de l'intellectuel classique reparaît. Et pourtant la période qui suit va voir une nouvelle renaissance autour de la figure emblématique de Sartre.
Les années 45-60 : Sartre et le Parti communiste.
La période qui suit la guerre a été appelée, à mon avis à tort13, “ l'âge d'or des intellectuels ”. Cet “ âge d'or ” des intellectuels, se confond aussi avec les "années Sartre"14. Pourquoi cette personnification rétrospective?
La première explication renvoie à la conjoncture politique elle-même. Comme dans les années 1890, comme dans les années 1930, la classe politique est à nouveau très critiquée après les espoirs déçus de la Résistance et de la Libération. De ce fait, il y a un rôle à jouer pour les intellectuels puisque, comme dans les deux époques antérieures, les intellectuels ont détenu leur maximum d'influence au moment d'une crise politique et idéologique. Les nouvelles générations cherchent des maîtres à penser et, dans ce genre de conjoncture, une personnalité comme Sartre était tout à fait indiquée. Comme l'on dit notamment Anna Boschetti et Pierre Bourdieu, Sartre c'est "l'intellectuel total"; il rassemble les fonctions de Zola et de Bergson, il est l'écrivain le plus connu de son époque mais aussi un philosophe professionnel dotés des titres universitaires les plus élevés. Il est l'intellectuel total puisqu'il est non seulement homme de lettres et philosophe, mais aussi journaliste et homme de radio, auteur de
13 A tort, puisque si l’intellectuel se définit par son autonomie et son esprit critique, c’est au contraire à cette époque qu’il renonce le plus à son autonomie en fonction d’intérêts partisans et qu’il trahit son esprit critique au nom d’une raison d’Etat, de parti ou d’une entité supérieure : l’histoire, le prolétariat etc. L’expression critiquée est de Michel Winock in L’Histoire n°83, 1985, pp. 20-34. 14Sur tout ceci, cf., notamment, Anna Boschetti, Sartre et les Temps modernes, Paris, Ed. de Minuit, 1985; Jeanine Verdès-Leroux, Au service du Parti, le Parti communiste les intellectuels et la culture, Paris, Fayard/Minuit, 1983; Tony Judt, Un passé imparfait. Les intellectuels en France 1944-1956, trad. fse, Paris, Fayard, 1992.
14
14
théâtre et de cinéma et directeur d'une revue, Les Temps modernes. Il peut mobiliser toute la gamme des moyens d'action d'un intellectuel. Il occupe toute la scène. Il est quatre personnes en une seule et peut s'adresser à des millions de gens.
Ces deux facteurs, une conjoncture et un homme, ne suffiraient pas à expliquer pourquoi il a pu servir de porte drapeau à la majorité des intellectuels (notamment dans les jeunes générations). Il faut tenir compte des séquelles de la guerre. Cette guerre a été aussi, on l'a vu, une guerre civile interne aux intellectuels si bien que toute la partie droite de l'échiquier intellectuel a disparu, soit parce qu'elle a été liquidée physiquement, ou déconsidérée par l'indignité nationale, par des peines de prison, par des exils, soit parce que les idées qu'elle a défendues sont devenues inacceptables dans la nouvelle conjoncture politique de l'époque. Il se produit donc une domination presque sans partage de la partie gauche des intellectuels, des héritiers des dreyfusards. Comme ils sont en position dominante, ils peuvent aller encore plus loin que les dreyfusards et se diviser selon des clivages plus complexes. Sans adversaires réels à droite jusqu’à la guerre d’Algérie, ils peuvent aller jusqu'à l'absolu, jusqu'au radicalisme révolutionnaire. Sartre, en appelant sa revue Les Temps modernes, affirme qu'une nouvelle période s'ouvre, qu'on entre dans une nouvelle ère. C'est une nouvelle découverte de l'Amérique, on change de monde avec la guerre. Le titre indique aussi qu'il faut reprendre tout à la base, repenser complètement le monde. Dans une période comme celle-là, on a besoin des philosophes, ceux qui pensent tout depuis la racine des choses, alors que, dans la période précédente, les intellectuels dominants étaient plutôt des écrivains comme Gide, Valéry, ou Malraux.
Le second changement est la très forte influence intellectuelle du Parti communiste qui va également dans le sens du radicalisme puisque le Parti communiste se pose en parti révolutionnaire. Les intellectuels attirés par le Parti communiste, c'est du moins ainsi qu'ils ont rationalisé après coup leur engagement, sont animés par un nouveau romantisme révolutionnaire et par le souci d’être dans le camp de l’antifascisme, quitte à oublier ou masquer les crimes et les aberrations du système soviétique. Ainsi Jean-Pierre Vernant, communiste dès 1932 et communiste critique à partir de 1958, mais qui ne démissionne qu’en 1970, lors de l’élection de Georges Marchais comme secrétaire général (pour lui un non-résistant ne peut incarner ce parti) écrit à ce propos :
“ Pour quelqu’un de ma génération, être communiste, c’était penser qu’on entrait dans une période d’affrontements décisifs contre les forces du mal. Ce n’était pas seulement notre sort individuel qui se jouait mais celui de l’humanité. Les adversaires les plus intransigeants du
15
15
fascisme, ceux qui pouvaient lui opposer quasiment une discipline militaire et une organisation aussi forte que la sienne, c’étaient les communistes. ”15. Le dernier phénomène important est la crise des valeurs républicaines et le déclin
des partis de gauche traditionnels qui les incarnaient, le parti radical et le parti socialiste. Cette crise ne se manifeste que progressivement. Elle se relie à la décolonisation, épisode tout à fait nouveau non seulement pour les Français, mais pour les intellectuels eux-mêmes. A la fin du XIXe siècle, la plupart des dreyfusards défendaient la colonisation en prétendant que la France apportait la civilisation en Afrique et en Asie. Or la plupart des héritiers des dreyfusards, dans les années 50, dénoncent au contraire la colonisation parce qu'elle va à l'encontre des droits de l'homme. Toujours au nom de la mémoire du groupe, ils peuvent s'assigner une nouvelle mission, non plus libérer le peuple mais aider à émanciper les peuples, ce transfert apparaît tout particulièrement pendant la guerre d'Algérie.
Algérie, la fracture.
L'Algérie va faire éclater la contradiction latente entre la mémoire et l'histoire des intellectuels. Certains ont assimilé l'affaire algérienne à une nouvelle affaire Dreyfus. Cela ne va pourtant pas de soi.
La première analogie tient aux événements eux-mêmes : les étudiants sont mobilisés en première ligne à cause de la résiliation des sursis. Ils sont touchés dans leurs intérêts propres en tant que groupe par les événements et ce sont les intellectuels les plus faciles à mobiliser puisqu'ils ont quelque chose à perdre dans cette affaire. Mais se greffe aussi toute une conjoncture idéologique, ce qu'on a appelé le tiers-mondisme. Certains intellectuels français pensent que la France, par la colonisation, a trahi l'idéal de la Révolution française notamment en niant les droits de l’homme des colonisés et en utilisant la torture pour réprimer la révolte. Des universitaires comme Pierre Vidal-Naquet, André Mandouze ou Henri-Irénée Marrou, en dénonçant la torture et les excès
15 J.-P. Vernant, “ Le trou noir du communisme ” repris dans Entre mythe et politique, Paris, Le Seuil, 1996, p. 579. Vernant pourtant est parfaitement informé de ce qui se passe en Union soviétique puisque sa femme est russe et qu’il s’est rendu dans la Russie stalinienne dès 1934 et connaît des dissidents : “ Je ne me posais pas, alors, le problème de l’existence ou non de la démocratie en URSS, je croyais simplement ce qu’il y avait dans les Textes; les textes de Marx c’était la réalité. ” (ibid.) Le témoignage de l’historien Maurice Agulhon, de dix ans plus jeune (il est né en 1926 alors que Vernant est né en 1915), confirme cette interprétation. Fils d’instituteurs socialistes, il adhère au communisme pendant ses années d’Ecole normale supérieure et se situe dans une fidélité à la tradition révolutionnaire française du Midi rouge pour la réaliser vraiment après les trahisons des anciens partis de gauche traditionnels (M. Agulhon, “ Vu des coulisses ” dans P. Nora (dir.), Essais d’egohistoire, Paris, Gallimard, 1987, pp. 9-59).
16
16
du gouvernement ou de l'armée, affirment renouer avec la tradition de Zola et des dreyfusards défendant les droits d'un innocent16.
Mais l'histoire continue, malgré les filiations, et introduit des clivages entre les héritiers du dreyfusisme. Il existe une deuxième tendance encore plus radicale, soutenue par Sartre, ceux qui signent le “ manifeste des 121 ” et ceux que l'on a appelé "les porteurs de valises". Pour les premiers, la guerre d’Algérie est une guerre qui n’ose pas s’avouer et est donc illégitime. Les citoyens n’ont donc pas à y participer car ce serait trahir les idéaux même de la citoyenneté française. Pour les seconds, la révolution algérienne est un fragment de la révolution mondiale en cours et cette révolution ne se produira plus grâce au prolétariat, comme l'ont cru les communistes ou un certain nombre d'intellectuels de gauche. Elle se produira par la révolte des peuples prolétaires du tiers monde. Le devoir des intellectuels révolutionnaires est donc d’aider ces peuples prolétaires, de même que les dreyfusards aidaient la classe ouvrière à s'éduquer et que les résistants se battaient contre le pouvoir illégitime de Vichy. Il y a enfin une troisième tendance, qui regroupe en fait la majorité des intellectuels et s'engage un peu plus tard au nom d'un nouveau pacifisme, de la lutte contre les risques de coup d’État militaire (comme en 1899) et de l’antifascisme du Front populaire.
Le fait que le combat algérien ait coïncidé chronologiquement avec la période où les intellectuels se sont éloignés en grand nombre du communisme a eu un double effet. Pour ceux qui souhaitaient avant tout un engagement de type militant, la lutte anticoloniale a pu servir de substitut au militantisme antérieur pour le socialisme ou le communisme. Comme précédemment, on était dans une logique manichéenne des deux camps chère à l’antifascisme, logique qui supprime la distance critique (d’où les enthousiasmes successifs et toujours aveugles pour les diverses libérations du Tiers monde). Ce substitut à l’ancienne foi communiste ou philocommuniste a servi d’écran au retour critique sur les aveuglements précédents et n’a donc pas suscité le débat intellectuel d’envergure que les événements de 1956 en Pologne et en Hongrie auraient dû faire naître. Sartre, compagnon de route de 1952 à 1956 se contente de rompre avec le P.C.F. et l’URSS mais proclame en même temps dans sa Critique de la raison dialectique le caractère indépassable du marxisme. Il reste donc pris dans une logique du tout ou rien, politiquement transférée au profit d’autres causes (l’Algérie, Cuba, le Vietnam, le maoisme). Il redonne même des gages aux régimes de type soviétique en se
16Sur les intellectuels et guerre d'Algérie : cf. Jean-Pierre Rioux et Jean-François Sirinelli (dir.), Les intellectuels français et la guerre d'Algérie, Bruxelles, Complexe, 1991. Sur les clivages entre universitaires, cf. C. Charle, “ Academics or intellectuals?, the Parisian Professors of the University of Paris and political debate in France from the Dreyfus Affair to the Algerian war ”, dans Jeremy Jennings (ed.), Intellectuals in Twentieth Century France, Mandarins and Samurais, Londres, New York, St Martin's Press, 1993, pp. 94-116.
17
17
lançant dans la campagne anti-impérialiste de protestation contre la guerre du Vietnam, ce qui implique un soutien direct ou indirect du régime communiste du Nord Vietnam par haine de la guerre américaine. Le retour à une vision de type droits de l’homme dreyfusarde devra donc attendre le milieu des années 70 pour redevenir légitime chez les figures dominantes de l’intelligentsia17.
Ces trois épisodes et ces renaissances périodiques des intellectuels montrent pourquoi ce mot "intellectuel", apparu dans une conjoncture si particulière, qui aurait pu disparaître, a quand même duré comme une mémoire structurant régulièrement, avec des inflexions, les diverses périodes historiques. Cette mémoire, malgré les contradictions, a permis aux intellectuels, qui s'y reconnaissent ou qui la dénoncent, de continuer à jouer un rôle historique particulier.
Le nouveau procès des intellectuels Depuis la fin des années 1970 pourtant, l'idée reçue dominante est que les
intellectuels sont voués au silence, au déclin, au don-quichottisme ou au repli professionnel. Trois grands facteurs expliquent ce pessimisme dominant. La première raison résiderait dans les nouvelles conditions du débat intellectuel : la domination des nouveaux mass média impliquerait le déclin de l'écrit et de la presse traditionnelle et supprimerait donc les conditions d’un débat public complexe. Les intellectuels, même s'ils avaient un message nouveau à transmettre, n'auraient plus les moyens de le diffuser largement puisque, dans leur écrasante majorité, ils n'ont plus accès aux moyens par lesquels on peut toucher “ l'opinion publique ”. Ceux qui y ont encore accès ne peuvent faire passer que des idées extrêmement sommaires. En conséquence, tout pousse à ne défendre que des causes unanimistes et à évacuer les débats politiques. Ainsi se réduirait progressivement la part des conflits de valeurs au fondement du rôle des “ intellectuels ” depuis cent ans.
Le deuxième changement serait l'usure de la notion même d'“ intellectuels ”. Garde-t-elle encore un sens à l’âge des universités de masse? Il n'y a jamais eu autant d'intellectuels au sens social, puisqu'il n'y a jamais eu autant de diplômés, mais jamais non plus aussi peu d’individus n'ont eu accès au statut d'“ intellectuels ” au sens de l'affaire Dreyfus, puisque très peu disposent des moyens de mobiliser l'ensemble de l'opinion18. Se surajoute à cette élitisation paradoxale, un problème de légitimité. A qui
17 Voir le soutien à certains dissidents soviétiques de l’ère Brejnev et la campagne de soutien à Solidarité lors du coup d’Etat militaire en Pologne de décembre 1981 animée notamment par P. Bourdieu et M. Foucault. 18 Je développe ce point dans mon analyse critique du livre de Rémy Rieffel, La tribu des clercs, les intellectuels sous la Cinquième République, Paris, Calmann-Lévy, 1992, dans “ Trop près, trop loin ”, Le Débat, n°79, mars-avril 1994, pp. 31-37.
18
18
et pour qui parlera-t-on? L'élitisme des intellectuels du siècle dernier, capté par l'intelligentsia de droite et récusé par les intellectuels de gauche dans l'entre-deux-guerres, n’est-il pas au fond contradictoire avec la défense de valeurs démocratiques?
La troisième impasse résiderait dans la crise même des débats. Existe-t-il encore un débat réel? Après avoir renié toutes les causes qui les avaient mobilisé, nombre d'intellectuels d'extrême-gauche pratiquent un masochisme apolitique de l'a quoi bon. L'engagement lui-même conduirait toujours à la perversion des idéaux, tout comme Péguy dénonçait la dérive de la mystique en politique. Mais se limiter à des causes anodines et unanimistes n'est-ce pas renoncer en même temps à la notion de dissidence constitutive des premiers intellectuels? Les vedettes du spectacle sont alors mieux qualifiés que les intellectuels patentés. Peut-on encore, au-delà de la préservation du consensus républicain minimal, définir des systèmes de valeurs qui s'opposent?
C'est sans doute sur ce dernier point que la dernière décennie a contredit le plus nettement les prophètes du silence des années 80, dont on vient de rappeler de manière sommaire les arguments. Loin de finir en 1989, le conflit des valeurs inauguré deux siècles auparavant a repris toute son actualité face aux phénomènes d'intolérance et de régression intellectuelle décrits précédemment. L'objection à ce raisonnement par analogie est cependant qu'on ne peut plus revenir en arrière avec le seuil qualitatif franchi par le système médiatique. A l’évidence, on ne pourra jamais plus disposer, pour toucher le public, comme dans les années 1890, de cinquante journaux d’opinion à Paris et d’un journal par sous-préfecture; il est devenu impensable, en unissant quelques bonnes volontés, de fonder un périodique culturel de large audience.
Renaissance des “ intellectuels ” ? Cependant, là encore, l’analogie des fins de siècle peut relativiser ce pessimisme
a priori. Tout comme l’emprise croissante du pouvoir économique sur la presse du siècle dernier a suscité le contre-pouvoir des petites revues ou de lieux de débats alternatifs, de même l’emprise analogue du marché sur les grands médias a engendré, à partir des années 1980, une multitude de réseaux intellectuels alternatifs (radios locales, journaux associatifs, revues para-universitaires ou militantes, messageries électroniques, etc.) dont on sous-estime probablement le rôle dans la formation d’une “ autre ” opinion publique en raison de la censure intéressée des médias dominants. La conjoncture idéologique et politique récente, la vigueur du mouvement associatif et les
19
19
nouvelles technologies émergentes qui créent un autre espace public peuvent à terme, battre en brèche cette censure invisible19.
En second lieu, et ceci répond à la troisième mise en cause du rôle des “ intellectuels ”, le débat central en France est redevenu, comme il y a cent ans, le problème de l'identité nationale en liaison avec le développement politique de l'extrême droite, la montée de la xénophobie, les nouveaux problèmes de pluralisme religieux face à la laïcité et l’affaiblissement de l’Etat-nation traditionnel20. Dreyfusards et antidreyfusards pourraient ainsi facilement retrouver leurs héritiers spirituels dans les deux camps les plus affirmés aujourd’hui. D'un côté, tout un courant politique utilise l’angoisse face à l'avenir, comme le faisaient le nationalisme et l’antisémitisme fin de siècle et, à l'opposé, un courant "antiraciste" rappelle, pour remobiliser une opinion sceptique face aux manques des partis politiques dominants, les précédents de l'entre-deux-guerres qui ont abouti à la xénophobie raciste institutionnalisée par Vichy.
Ainsi se retrouvent posées des questions cruciales auxquelles les intellectuels, avant et après l'affaire Dreyfus, avaient déjà tenté d’apporter des réponses : la France, en tant que nation, doit-elle se fermer ou rester ouverte? Que reste-t-il de ses valeurs fondatrices? La tradition immémoriale du Moyen Âge et de l’Ancien régime va-t-elle redevenir le seul socle national commun résistant à la “ mondialisation ”, c’est-à-dire à l’américanisation culturelle, comme le prétend une nouvelle droite de moins en moins masquée et discrète dans son entreprise de “ révolution conservatrice ”? Peut-on, au contraire, réévaluer l'acte fondateur de la Révolution française et son universalisme potentiel, malgré le débat confus et incertain relancé par la commémoration du Bicentenaire de la Révolution française sur fond de chute des régimes soviétiques21? La similitude avec le débat central de l’affaire Dreyfus est renforcée en outre par le développement (à partir des années 1980) d’une discussions similaire en Allemagne sur l’évaluation du passé nazi et sur le fondement de l’identité nationale allemande avant et après la réunification22. Si ce débat continue de s'étendre, comme il semble le faire depuis près de dix ans, ceux qui ont conquis un rôle grâce à lui dans les années 1890, c'est-à-dire précisément les “ intellectuels ”, peuvent retrouver cette fonction générale,
19La rapidité et l’ampleur de certaines mobilisations intellectuelles et sociales récentes (qu’il s’agisse des grèves de novembre-décembre 1995 ou des pétitions contre la loi Debré) qui ont surpris les commentateurs officiels souligne l’efficacité souterraine préalable de ces réseaux sous-jacents. 20 La littérature à citer ici serait infinie. L’approche la plus synthétique et compréhensive est fournie par Maurice Agulhon dans sa Leçon inaugurale à la chaire d’histoire de la France contemporaine du Collège de France (11 avril 1986), notamment pp. 8-20 repris dans "Conflits et contradictions dans la France contemporaine", Annales ESC, mai-juin 1987, pp. 595-610, et dans Histoire vagabonde, Paris, Gallimard, 1988, vol. II, pp. 283-306. 21 Sur ce point, voir Steven L. Kaplan, Adieu 89, Paris, Fayard, 1993. 22 Cf. Devant l'histoire, les documents sur la "querelle des historiens" (1987), trad. française, Paris, Cerf, 1988.
20
20
naguère perdue, avec la domination des experts, des intellectuels-de-parti ou des spécialistes de l'unanimité, et avec l’anti-intellectualisme dévastateur de la doxa néolibérale économiste.
Le second facteur favorable tient paradoxalement aux incertitudes même de la situation internationale, notamment en Europe. L'inquiétude nationale et la renaissance des pulsions nationalistes, en France ou ailleurs, se nourrissent sans doute, en premier lieu, des effets de la crise sociale et des dégâts produits par le néo-libéralisme et la concurrence internationale. Mais elles proviennent aussi de la monopolisation du discours sur l'Europe par ceux qui la réduisent aux seules vertus du marché unique dont les bienfaits supposés automatiques sont longs à se faire sentir pour la plupart des Européens de base. En tant que "fonctionnaires de l'universel" (P. Bourdieu) et responsables de la transmission et du développement des cultures européennes, les intellectuels qui estiment avoir une responsabilité politique face au néo-nationalisme comme au néo-libéralisme sans attaches ont à inventer et à proposer un projet culturel commun pour remplir ce nouvel espace public, paradoxalement vide, malgré son trop-plein de discours creux. Si l'on pousse l'idée d'Europe jusqu'à son sens profond, rêvé par certains intellectuels du XIXème siècle, construire une Europe dont le sens universel soit comparable à la conception universaliste de la France républicaine, implique la mise en commun d’une culture partagée entre les diverses composantes de l’Europe, pour faire reculer les antagonismes et les stéréotypes séculaires entre les différentes nations et dont maintes crises politiques récentes montrent la prégnance, y compris sur la mentalité des supposées élites en charge de la construction économique européenne. On aura une Europe sans citoyens tant qu’on aura une Europe sans culture multinationale partagée, c’est-à-dire sans système éducatif présentant un minimum de dénominateurs et de contenus communs. On retrouverait ainsi ce qui était l'idéal cosmopolite des Lumières mais lié à un projet politique nouveau puisque tous les États fédéraux ou confédéraux existants, sont soit de taille modeste, soit fondés sur la domination d’une culture particulière sur les cultures minoritaires, domination de plus en plus contestée comme le montrent les débats américains.
Les deux idéologies qui ont troublé la tradition intellectuelle française, le communisme et le tiers-mondisme, ont quasiment disparu comme pôles attractifs. Si l'on se place dans la conjoncture longue que j'ai évoquée, ces deux idéologies étaient en fait des idéologies étrangères aux intellectuels, surimposées sur le débat français et divisant plus qu'unissant les traditions intellectuelles antérieures. Elles donnaient apparemment aux intellectuels une nouvelle fonction, un nouveau rôle, un nouvel idéal. Leur déclin ramène à un type de débat plus facile à gérer par les intellectuels.
21
21
Il reste que ce programme suppose un travail collectif et international des intellectuels, difficile à mettre en oeuvre et qui fournit l’agenda des années à venir : réévaluation critique des combats antérieurs des intellectuels et de leurs manques ; relecture de l’histoire de l’Europe des deux derniers siècles et de ses composantes; réflexion sur la manière de réintégrer la deuxième Europe, naguère séparée mais qui souhaite légitimement retrouver la place qui était la sienne dans l’entre-deux-guerres dans l’espace des échanges culturels internationaux; programme d’action pour influencer les pouvoirs politiques dont les ambitions sont à la fois très limitées sur le plan culturel, gouvernées par l’utilitarisme (les industries culturelles) et contradictoire puisque partagées entre plusieurs visions possibles de l’Europe: gaullienne, germanique, anglo-saxonne, etc. Si l’on sort du cadre français pour examiner les intellectuels en Europe il est clair qu’eux-mêmes sont traversés par ces lignes de clivage héritées de la politique et de la culture spécifique à leur espace national initial, d’où la difficulté des dialogues comme ceux tentés dans la rencontre qui nous réunit23.
23 Sur la genèse de ces espaces nationaux qui divisent les intellectuels européens, voir ma synthèse provisoire : C. Charle, Les intellectuels en Europe au XIXème siècle, essai d’histoire comparée, Paris, Le Seuil, 1996; version anglaise partielle à paraître dans H. Kaelble (ed.), The European Way, Oxford, Berg, 2004 ; version allemande abrégée : Vordenker der Moderne, Die Intellektuellen im 19. Jahrhundert, Francfort/M, Fischer Taschenbuch Verlag, “ Europäische Geschichte ”, 1997.