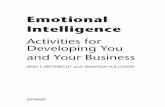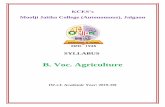Intro droit voc historique-1 2 (1)
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Intro droit voc historique-1 2 (1)
Introduction Historique au Vocabulaire Juridique
Le cours du 1er novembre est rattrapé le vendredi 26 octobre amphi B de 15h10 à 16h40
Introduction générale
Définitions :
• Vocabulaire :ensemble de mots employéspar une personne ou par un groupe.
• Droit : terme qui provient du latin, directum qui veut dire droit dans le sens d'unedirection droite, ce droit est généralement défini comme l'ensemble des règles régissant lavie d'une collectivité humaine. Ces règles doivent être reconnues comme telles et elles doivent être observées par la collectivité humaine en question.
Le vocabulaire juridique est donc le vocabulaire propre à la science du droit cad un ensemble de mots qui vont désigner spécifiquement le monde du droit et les acteurs du droit.
Dans la vie de tous les jours les termes du droit sont mal employés. En effet le mot "justice" par exemple utilisé dans le langage commun est attribuéaux tribunaux qui doivent rendre des décisions justes. Avec cette façon de penser on a alors des aprioris, il y a une assimilation dans le langage commun entre droit et justice, puisque les décisions prises par le tribunal doivent être justes. Or pour le juriste la notion de justice a un sens bien plus précis.
Pour le juriste:
• Justice subjective: c'est l'aspect moral de la justice et la justice est en général considérée comme un fondement du droit,et par exemple dans l'Antiquité les juristes romains définissaient la justice comme étant l'Art du bon et du Juste, de l'Equitable. C’estdonc d'abord un aspect moral puis un aspect institutionnel.
• Justice au sens institutionnel: l'ensemble des institutions judiciaires dont lafonction est de rendre la justice par le respect du droit.
L'Histoire : le Droit change constamment, son contenu notamment. Le droit aujourd'hui est issu del'héritage romain. Ainsi se découle deux catégoriesde droit : droit public et droit privé. Cette grande distinction droit publique / droit privé existait déjà à Rome dans l'Antiquité. Par exemple un historien Romain Tite Live, (59 avt JC et 17 après JC) disait que "la loi des XII tables" (grand texte de Droit romain) était la source de tout le droit, public et privé. Un autre grand Juriste romain, Ulpien, expliquait que le droit public est ce qui regarde l'Etat de la chose romaine et le droit privé ce qui concerne l'utilité des parties privées. Cette distinction est bien antérieure aux romains puisqu'on la pratique depuis la plus Haute Antiquité, comme par exemple la population babylonienne 1700 avant JC. [La chose publique est ce qui deviendra l'Etat]
Les Grecs dans l'Antiquité sont les inventeurs de la Science Politique, ce sont eux qui ont inventé le vocabulaire du pouvoir. Le mot même de "politique" dérive étymologiquement de "polis" en grec, qui signifie la cité. De là vient alors les termes : "politicos" tout ce qui attrait à la cité et "politéia", qui est la forme de gouvernement, cequ'on pourrait traduire par "constitution". Les grecs ont inventé le vocabulaire du pouvoir et ce faisant, ont conçu la notion de "cité", de "citoyenneté" et la notion de "constitution" dans le sens de régime politique, cad un mode de gouvernement du pouvoir.
L'héritage Romain est essentiel en matière juridique, ils ne sont pas les inventeurs de la notion de Droit, cependant ils sont les inventeurs de la Science Juridique. Ce sont les premiers à avoir réellement réfléchi sur le Droit, ils font duDroit une matière savante, spécifique. Il y a donc une réflexion sur le Droit, sur la science juridique. Le droit romain invente ainsi la langue du droit, et donc la terminologie juridique. Petit à petit les romains vont greffer sur le sens courant d'un mot un sens purement juridique. Par exemple ; l'origine du terme "contrat", pour les romains le terme "contractum" signifie à la base "la rencontre, la réunion". On part d'un trait général et à ce terme les romains vont donner une signification proprement juridique puisqu'ils vont l'appliquer audomaine du droit. "Contractum" = rencontre de deux volontés afin de faire naître un contrat de droit civil. Le droit romain est à l'origine de toutes les grandes catégories juridiques sur lesquelles se
sont construit les régimes/systèmes juridiques de l’Europe occidentale. Ainsi, tout ce qui est contrat mais également la notion de délit, le droitde propriété, les successions, la notion de source de droit, ou encore celles de juridiction ou de justice etc., sont issus du vocabulaire juridique conçu et pensé par les romains.
Première Partie du cours : Vocabulaire du droit public.
Deuxième partie du cours : Vocabulaire du pouvoir.
L'histoire du monde grec Antique s'étend sur 2 millénaires et traditionnellement on distingue 3 grandes périodes, tout d'abord la période archaïque(début du 2ème millénaire avant notre ère jusqu'au 7ème siècle avant notre ère). Cette période archaïque est chantée par le poète Homer, qui aurait été au 8ème siècle avant notre ère une épopée, c'est à dire qu'il mêlait des récits concernant les hommes et les dieux. Les deux sources principales sont "l'Iliade et l'Odyssée" et ce sont deux récits qui ont pour cadre le 12ème siècle avant JC. L'Iliade relate l'épisode de la cité de Troyes et de la chute de la cité de Troyes.
[Histoire: Hélène, la femme du roi de sparte se fait enlevée par le roi du Troyes, Priam. raison privée au déclenchement de la guerre mais il y a laraison politique qui est la volonté de puissance duroi de Misène, Agamemnon, frère du roi de sparte. veut écraser Troyes. guerre qui oppose grecs et troyens. et Odyssée ; Ulysse qui rentre de la guerre]
L'archéologie a confirmé des faits décrits dans cesépopées. Ces récits légendaires sont en réalité très empreints de toute la réalité sociale et politique de la Grèce archaïque comme leur façon devivre en communauté etc. c'est une époque où on a vu apparaitre de multiples principautés qui se sonttransformées en monarchie dominante, notamment en Crète puis presque partout dans toute la Grèce. Cependant au fil du temps les rois sont évincés parles nobles de la cité, qui vont prétendre à l'exercice du pouvoir. On a alors une idée du partage du pouvoir qui se met en place. C’est commecela que l'on aboutit à l’Age classique(6ème au 4èmesiècle : Age d'or de la Grèce, période de la cité état). C’est l'époque de la réflexion politique sur les différentes formes de gouvernement politiques qui peuvent exister, on recherche la meilleure forme degouvernement qui soit et cette réflexion est nourrie par la réalité puisque dans le monde grec il y a une multitude de cité-état. C’est à cette période que nait la démocratie à Athènes. L’époque hellénistique(fin du 4ème au 1er siècle avant notre ère). C’est une époque de déclin de cette cité état qui va être remplacé par une monarchie, mais une monarchie fédérative, à grande échelle, c’est la monarchie Macédonienne avec Philippe de Macédoine mais surtout celle de son fils, connu sous le nom d’Alexandre le grand. Ce dernier fonde un immense empire qui met définitivement fin à la cité état indépendante et il créée ainsi l’idée de monarchie universelle. A la chute d’Alexandre, cet empire immenseva être démantelé et on va voir apparaître de nouveau un certain nombre de royaumes que l’on va appeler les monarchies hellénistiques, qui sont des
monarchies absolues, personnelles, comme l’Egypte, la Macédoine. Ce monde grec va être militairement vaincu par une autre puissance qui est la puissanceromaine. C’est Rome qui réduira le nombre de ces monarchies qui les transformera en provinces romaines. Le dernier fait marquant est l’annexion de l’Egypte à Rome en 30 avant JC.
Athènes, à la mort d’Alexandre le Grand, a connu unsursaut d’indépendance mais globalement c’est aussila fin de la splendeur d’Athènes et dès le début du2ème siècle avant notre ère Athènes passe sous influence et domination romaine et Athènes devient un grand centre culturel et universitaire où tout bon romain va se cultiver, étudié à Athènes.
L’époque romaine est très longue, elle s’étend sur presque mille ans.
La cité de Rome a été fondée légendairement en 753 avant JC par Romulus Erémus. Plusieurs régimes se sont succédé.De 753 à 509 avant notre ère on a une royauté pendant laquelle le pouvoir n’appartient qu’à un seul : le roi. Puis, de 509 avant JC à 27 avant JC ; c’est le début de ce qu’on appelle la République Romaine ; le pouvoir était partagé entrele Sénat, les Assemblées du Peuple et les Magistrats. Le magistrat à Rome n’est pas un juge, mais le détenteur du pouvoir exécutif. A partir de 27 avant JC c’est l’Empire ; et l’empire se divise en deux parties à partir du 4ème siècle après JC. D’un côté l’empire romain d’occident avec pour capitale Rome et de l’autre côté l’empire romain d’orient dont la capitale est Byzance. L’empire romain d’occident va durer jusqu’en 476 après JC et donc
s’écroule à cette date ; mais l’empire romain d’orient dure jusqu’en 1453 après JC.
Indication bibliographique : « histoire des institutions de l’Antiquité »
Michel Humbert, « institutions politiques et sociales de l’Antiquité » édition Dalloz.
Jean Gaudemet « les institutions de l’Antiquité » édition Daumat, collection « les précis » ; « la naissance du droit » même édition même collection
Jean marie Carbasse ; « manuel d’introduction historique au droit » édition Puff.
Claire Lovisi, « manuel d’introduction historique au droit », édition Dalloz.
Première Partie : Approche Historique du Vocabulaire du Droit Public
C’est la Grèce, particulièrement pendant la périodedite « classique » qui a posé les principes politiques qui régissent encore aujourd’hui nos sociétés et qui fondent le droit public. « Politique » vient de « polis » en grec, la cité. On en déduit que la réflexion politique grecque
commence dans le cadre de la cité. Aristote(384 et 322 avant notre ère)donne une définition de la cité au 4ème siècle : « ce qui caractérise la cité, c’est une sorte de communauté ainsi que la participation commune des citoyens à un système de gouvernement ». Aristote était un philosophe mais également un grand penseur politique et il a développé sa pensée politique dans trois ouvrages ; « La Constitution d’Athènes », « L’éthique à Nicomaque », « La Politique ». On dit d’Aristote qu’il est le père du Droit Constitutionnel, parce qu’il est le premier à avoir véritablement entamé une réflexion sur les différentes constitutions politiques des cités, qu’elles soient grecques ou étrangères. Ces différents régimes politiques ont été comparés entre eux. Il y a ainsi deux notions clés qui découlent de la cité : le citoyen et la forme d’organisation politique de la cité (on peut aussi parler de Constitution). Cet aspect de Constitution est fondamental. La réflexion politique grecque va permettre de poser les différents types de pouvoir politiques qui existent, et c’est ainsi qu’on va pouvoir dégager ce qu’est une royauté, comprendre ce qu’est une tyrannie, comprendre ce que signifie l’aristocratie et surtout apprendre ce qu’est la démocratie. Les penseurs ont donc distingué l’aristocratie, la démocratie, la tyrannie, etc. etles ont ainsi comparé pour comprendre quelle était la meilleure forme de gouvernement possible. Ainsi on peut dire que ce sont bien les Grecs qui sont à l’origine de la démocratie.
La cité détermine les régimes politiques qui vont être appliqués, et derrière la cité le personnage clé est le citoyen, qui vit dans la cité. Les
romains reprendront la pensée politique grecque et lui donneront une base juridique et dégagent une notion fondamentale aujourd’hui qui est la notion de Res Publica, la chose publique, c’est l’Etat. Les grecs sont parvenus a penser le pvr d’une manière abstraite, indépendamment des titulaire de ce pouvoir.
Chapitre 1 : La cité antique, une communauté de personnes.
La cité est née dans le monde grec, la cité est le cadre dans lequel doit s’inscrire obligatoirement tout individu. Pour les grecs, l’individu est inséré à la fois dans la famille et dans la cité.
Présentation des caractéristiques de la cité antique : préliminaires
Deux aspects se dégagent, tout d’abord la cité s’inscrit dans un cadre géographique, puis elle se révèle être une structure nécessaire aux hommes.
• La cité, un ensemble géographiquement circonscrit.
Si la Grèce est le berceau de la cité antique, c’est à cause de facteurs géographique : le monde grec se compose de la péninsule puis il y a une multiplicité d’îles éparpillés en mer Egée et en mer Ionienne. Et à l’Ouest il y a la grande Grèce qui est maintenant le Sud de l’Italie et la Sicile et se prolonge jusqu’à l’actuelle Turquie etdans les Balkans. C’est donc un monde vaste ce qui entraine des difficultés de communication. La mer est omniprésente ; la plupart des cités grecques
vivent de la mer ; sauf Spartes (qui est à l’intérieur des terres) mais d’une manière généraleon peut dire qu’en Grèce la mer est fondamentale etgrâce aux ressources maritimes beaucoup de cités grecques réussissent à vive en autarcie, c’est à dire qu’elles se suffisent à elles-mêmes. La mer permet ainsi le développement des échanges maritimes entre les cités grecques. Forcément, ces cités grecques ont une maîtrise certaine de la mer et c’est ainsi que naît un sentiment d’appartenancecommune, se considèrent comme un peuple de la mer et c’est ce qui réunit toutes ces cités grecques. La cité antique constitue un cadre géographique précis, dont la superficie est limitée. La cité estavant tout la ville et ses faubourgs, c’est donc uncadre restreint. A ce cadre, va correspondre une organisation politique, une cité-état.Chaque cité va avoir son propre peuple, chaque cité va avoir sapropre organisation, ses propres institutions et chaque cité est finalement indépendante et souveraine par rapport aux autres cités grecques. Al’époque classique, on avait 750 cités dans la péninsule et 100 dans en Crète. Cette cité est le centre de la vie politique. [Ce modèle de la cité-état, va être repris par les romains, et Rome est également constituée de la ville et de ses faubourgs. Petit àpetit, Rome cherchera à conquérir le monde méditerranéen. Unempire se constituera alors. Rome apportera une autre manière de penser la cité-état, elle aura une conception originale de la cité.]
La cité en Grèce « polis », et en romain « cuivites » = la cité. L’organisation politique aujourd’hui est l’Etat.
• La cité, une structure nécessaire.
Les cités rassemblées, distinguent le grec civilisédu barbare ; c’est-à-dire de l’étranger, celui qui n’est pas grec. Généralement, on avait tendance à considérer que les barbares vivaient en peuplade dispersée ou encore sous l’autorité d’un prince. Dans l’esprit des Grecs antiques, la cité est ce qui caractérise le mode de vie des grecs. Pour eux,l’homme peut ne bien vivre que dans le cadre de la cité, et il est alors complétement inimaginable quel’on puisse vivre de manière isolée, en simple particulier. Ceux qui vivent seuls, en dehors de lacité se font appeler des « idiotes ».Ce qui caractérise la cité grecque c’est la vie en communauté avant tout. Il faut se reporter à l’analyse d’Aristote sur la cité, celle qui est unenécessité. Aristote pense que la vie au sein de la cité est une nécessité naturelle, dans le sens qu’elle existe dans la nature, on dit qu’elle est inhérente, et d’ailleurs avant de forger sa célèbredéfinition de la cité, de la polis, Aristote commence par aborder cette nécessité naturelle. Aristote explique dans son ouvrage « la politique », que les hommes et les animaux partagent une tendance à la socialisation, mais à la différence de l’animal, l’homme en faisant cela et donc en se rapprochant des autres ne cherche passeulement à survivre, il cherche à vivre mieux. C’est l’instinct naturel de l’homme qui le pousse àvivre en société, au sein de la cité. Pour Aristote, l’avènement de la vie au sein de la cité est un phénomène naturel, quasiment physique. Aristote, pour illustrer sa démonstration précise qu’il
n’y a pas de famille d’animaux, de cité d’animaux, donc c’est un phénomène naturel humain qui les distingue des animaux. Aristote définit l’homme comme un animal politique. Aristote forgera sa célèbre définition de la cité : « la cité est à la fois une sorte de communauté et une sorte de participation commune decitoyens à un gouvernement ». Plus que le territoire et la population, c’est la volonté des individus de se placer sous une loi commune afin devivre en communauté qui définit la cité. Pour les grecs, il ne peut y avoir de vie sociale en dehors de ce cadre, qui est restreint. Le nombre de citoyenspour Platon est de 5040, pour lui c’est le chiffre parfait. Le nombre est aussi de 10 000 citoyens pour un autre auteur, mais en réalité on comptait 60 000 citoyens hommes adultes. Ce cadre de la citépose des problèmes concrets. Comment fait-on pour gérer l’augmentation de la population ? S’il y a trop de monde dans la cité, on créée des colonies.La colonie, dans la conception grecque està l’origine une fraction de citoyens expatriés pourcause de surpeuplement, ils peuvent aussi être expatriés pour des raisons de jalousie politique. Ces colonies ne gardent aucun lien avec leur mère patrie. Ces colonies deviennent pleinement autonomes. Pendant toute la période classique il n’y aura jamais d’Etat Grec Unitaire. Il y aura descités indépendantes qui éventuellement pourront s’associer autour par exemple d’un sanctuaire commun. On parle d’ « amphyctionies ». Parfois, au sein de ces associations une cité peut l’emporter sur les autres si elle est plus forte, mais jamais une cité n’absorbera d’autres cités en Grèce. Il y aura des associations de défense au sein de ligue,
comme la ligue de Délos, qui a été constituée par Athènes en 478 avant JC, et cette ligue rassemblaitenviron 150 cités. C’est une ligue avant tout défensive, et toutes les cités qui y participaient payaient une sorte de contribution, il y avait ainsi un trésor constitué qui se trouvait ainsi à Délos, sur la plus petite île des Cyclades.
• Cité constitué par un cadre territorial et une communauté humaine.
Cette communauté humaine est spécifique ; et ne se confondra jamais avec toute la population du territoire de la cité. Les étrangers ou les esclaves n’appartiennent pas à la cité même s’ils habitent le territoire de la cité. Il y une collectivité de citoyens et ce n’est pas tous les habitants de la cité qui sont citoyens.
Section 1 : la citoyenneté selon les Grecs.
La spécificité grecque est leur avarice, surtout concernant la concession de la qualité de citoyens.Il y a un cloisonnement de la citoyenneté grecque. On est avant tout citoyen d’une cité avant d’être grec.
Paragraphe 1 : la qualité de citoyen.
Aristote, le citoyen : on définit dans l’usage celui qui est né de deux parents citoyens et non d’un seul. D’autres remontent même plus haut, par exemple jusqu’aux aïeux. Mais, comment l’aïeul était citoyen ? Il l’était s’il participait au pouvoir politique. Pour bénéficier de la qualité de citoyenil faut être né de parents citoyens qui eux-mêmes
doivent être nés de parents citoyens etc. Il souligne les insuffisances d’une telle définition ; la citoyennetépar sa naissance ne s’applique pas aux fondateurs de la cité. Ainsi il propose d’ajouter un autre critère : celui de la participation au gouvernement d’une cité.
Lecitoyen pour Aristote est donc celui qui est né de deux parents citoyens et si on participe au gouvernement d’une cité.
Tous les citoyens, au sens juridique du terme, ne participent pas à la vie politique, par exemple lesfemmes, qui ont pourtant la citoyenneté lorsqu’elles sont nées de père et de mère citoyens,mais elles sont toujours exclues de la fonction publique et politique de la cité. Par ailleurs elles ont une capacité juridique restreinte. Les femmes peuvent procéder à certains actes mais seulement sous contrôle ou avec autorisation du père ou du mari. Elles sont tout de même importantespuisqu’elles donnent les citoyens. Les enfants mâles, sont citoyens puisqu’ils sont nés deparents citoyens mais n’auront une pleine capacité juridique et politique qu’à leur majorité.
A Athènes : Vème – IVème siècle avant JC. A traverscette législation on comprend bien le caractère fermé de la citoyenneté grecque. A Athènes, il ne suffit pas de naître sur le territoire de la cité pour être citoyen. Le critère d’attribution de la « nationalité » ; n’est pas le droit du sol. Le système qui s’applique est le système du droit du sang. En 451 avant JC, l’assemblée du peuple athénien a décidé de ne pas laisser jouir de droitspolitiques ceux qui ne seraient pas nés de deux
citoyens. La situation du droit du sang est pousséeà l’extrême : il faut que les enfants soient nés d’un mariage légitime entre deux citoyens athéniens.
L’acquisition de la citoyenneté athénienne dépend avant tout de la légalité de la naissance qui elle-même dépend de la légalité du mariage des parents. Ce qui fait un mariage légitime, est une affaire defamille : la femme doit avoir été donnée en mariagepar son père ou par son frère à un homme. Ce n’est pas un mariage qui exige le consentement des époux.Il n’y a pas de cérémonie publique. Un enfant qui nait de deux citoyens athéniens qui ne sont pas mariés, ne deviendra jamais citoyen. On peut être déchu de sa qualité de citoyen. On perd alors le droit de cité, donc tous ses droits politiques (voter, participer aux assemblées) et ses droits desuccession.
(Droit su sol : ius soli ; droit du sang : ius sanguinis.)
Les naissances entre un athénien et un étranger ne sont pas considérées par le droit, il n’y a pas de mariage ou de filiation envisageable avec les étrangers.On ne devient pas athénien par mariage. Cette collectivité de citoyens évolue, se renouvelle mais ne meurt pas. Et le mariage, la procréationpermettent la permanence de l’espèce. Dans l’esprit des grecs anciens les familles de citoyens étaient censés assurer la permanence de lacité.
Paragraphe 2 : la situation de l’étranger.
Il y avait deux types d’étrangers : -le barbare, qui ne parle pas grec et –le metheque, qui est un grec mais né dans une autre cité.
• Le barbare.
Pour le Grec, le barbare est celui dont on ne comprend pas la langue. Le nom même de barbare, « barbaros » est une onomatopée qui signifie que pour le grec, lorsque le barbare parle, le grec ne comprend pas. Le mot de barbare signifie « celui qui maltraite la langue ».Au fil du temps, à partirdu Vème siècle avant JC, le terme « barbare » prendun sens supplémentaire qui devient « ennemi » à l’issu des guerres médiques. (Athènes contre les Perses) A partir de ces guerres médiques les barbares sont des ennemis. Les Grecs se sentiront toujours culturellement supérieurs, face aux barbares qui maltraitent la langue. Quant Aristoteparle du barbare, il parle aussi de « désordre, d’ignorance, cruauté, immoralité… »Ces barbares ne connaissent pas la civilisation, vivent en peupladesous un prince. Pour les grecs le monde est divisé en deux : grecs & barbares. Pour les grecs, les romains sont des barbares, et les romains ne supportentpas cette idée et lutteront contre cette vision des choses, en effet les élites romains forceront leurs enfants à apprendre & parler grec, et très vite pour les romains on aura l’idée que la langue grecque c’est la culture, la quintessence de la civilisation. Le monde est divisé en 3 pour les romains : les grecs, les romains, les barbares.
Les relations entre grecs et barbares peuvent se normaliser à certaines périodes et les cités
grecques peuvent même parfois tisser des liens d’hospitalité avec certains barbares. La figure du barbare n’est conçue que par les relations extérieures des cités, pcq les cités n’ont jamais cherché à donner un statut juridique au barbare. Le barbare est un ennemi avant tout ; c’est un étranger, une figure symbolisant la non-civilisation ; les autres étrangers qui vivent dansdes cités grecques sont des metheque et sont des figures concrètes des cités.
• le metheque.
Le metheque est un grec qui franchit les limites desa cité, pour aller dans une autre cité grecque. Dès qu’il quitte les frontières de sa cité et pénètre sur le territoire d’une autre cité, il devient un étranger ; « xenos », et doit impérativement recevoir l’hospitalité chez qqn, se faire héberger chez un citoyen de la cité dans laquelle il a choisi de se rendre. A la base de cesrelations entre grecs il y a une idée de réciprocité entre l’hôte et l’invité, se noue ainsiune relation de même rang. Ainsi si l’hôte part dans la ville du metheque, pourra le savoir. Celuiqui héberge doit répondre de son invité, cette personne que l’on héberge est le metheque, qui est à l’origine celui qui habite avec « metoikos ». En pleine époque classique, une cité comme Athènes va devoir spécifier le statut de cet étranger par nécessité car il y a beaucoup d’étrangers sur le territoire d’Athènes. Athènes a besoin de ces étrangers pour exercer les activités que les citoyens n’ont pas le temps de mener, notamment à
tous les métiers du commerce, ou encore les banquiers, même les métiers de la mer : marins, rameurs... les citoyens athéniens sont censés de s’occuper de la vie politique de la cité. Beaucoup d’étrangers et principalement les metheque ont contribué à la gloire d’Athènes : exemple d’Aristote, qui n’était pas Athénien, né en Thrace,mais a quitté sa cité très jeune, à 17 ans pour aller à Athènes pour se former à la philosophie, a suivi l’enseignement de Platon puis reste 20 ans environ à Athènes.
Metheque, définition du 3ème siècle avant JC : « est metheque quiconque venu d’une ville étrangère, habite dans la cité, et acquitte une taxe en vue de certains besoins déterminés de la cité. » Définition d’Aristophane de Byzance.
Pendant un certain nombre de jours ; si le séjour est de courte durée, on est un étranger de passage,qui n’est pas soumis à une certaine taxe, on la paie que si on reste plus longtemps selon une loi et ainsi on devient metheque. Ainsi si l’étranger passe plus d’un mois il est metheque et paie une taxe.
Pour être metheque, il faut avoir un domicile fixé dans une cité qui n’est pas sa cité d’origine et ilfaut payer une taxe. Ces taxes sont considérées comme un impôt personnel parce que ce type de taxe n’est pas acquitté par les citoyens qui, au sein deleur cité, ne paient que l’impôt foncier, c’est-à-dire l’impôt sur la terre. Avec la taxe payée, assumée par le metheque on est dans un type d’impôtpersonnel qui est caractérisé par le metheque. Si
ce dernier ne paie pas la taxe risque la perte de sa liberté. Ce metheque, au sein de la cité, n’a pas de droit politique, c ‘est à dire qu’il ne peutpas participer à la vie publique donc ne peut pas prendre part aux assemblées du peuple. En revanche il peut combattre dans l’armée, mais jamais dans lacavalerie parce que celle-ci est réservée aux citoyens. Il y a tout de même la reconnaissance de certains droits privés. A Athènes la loi protège enpartie la famille et la propriété du metheque. Maisil y a une restriction en ce qui concerne le droit de propriété : il ne peut pas être propriétaire de biens immobiliers, cad qu’il ne peut pas s’acheter de maison ni de terre, il peut juste avoir des biens meubles : un cheval, table… les biens immobiliers dans l’antiquité caractérisaient la principale source de richesse. Il y a donc un bien de propriété mais très réduit. Concernant la famille, il y a également des restrictions. A Athènes, les mariages mixtes sont interdits, c’est-à-dire les mariages entre un(e) athénien(ne) et un(e) metheque. Mais si le metheque est venu àAthènes avec sa famille, la loi athénienne protègetout de même sa famille.
Il y a un magistrat spécialisé chargé de rendre la justice concernant les metheque : le polémarque. Il y a donc pour les metheque un accès aux tribunaux, jouissent de certains droits donc peuvent les défendre devant le polémarque. C’est unarchonte ; les archontes sont des magistrats qui s’occupent de manière générale de trancher les litiges, et pour les metheque c’est l’archonte
polémarque. Le statut de metheque est reconnu par le droit à Athènes contrairement aux étrangers.
Un metheque peut-il acquérir la citoyenneté athénienne ? Ce changement de statut connait plusieurs degrés : lacité peut délivrer des distinctions honorifiques à certains metheques. Exceptionnellement la cité peut conférer à un metheque certains droits, comme un droit de propriété complet c’est-à-dire qu’enfin le methequepourrait devenir propriétaire d’un bien immobilier.La cité peut décider de dispenser le metheque de l’impôt, soit de manière partielle soit de manière totale, néanmoins dans ces deux cas, il s’agit pour la citéd’élever le metheque au-dessus de sa classe puisqu’il y aura eu une distinction. La cité peut décider de délivrer le droit de cité, soit la citoyenneté, mais c’est vraiment exceptionnel et dans un tel cas il faut une décision de l’assembléedes citoyens. Il faut avoir accompli une tache significative pour la cité, avoir de hauts faits par exemple au niveau militaire.
Cas particulier : l’esclave.
Il y avait énormément d’esclavage dans les cités antiques. Un esclave affranchi par son maître devient une personne libre, il peut avoir été affranchi par testament, par la cité ; du coup la liberté est donnée à l’esclave. Quel va être le statut personnel de cet affranchi ? Acquiert-il lacitoyenneté ? =>Non. Il obtient cependant un statutanalogue à celui du métèque, ne participe pas à la vie politique et dans les actes de la vie juridiqueou judiciaire, doit être assisté d’un citoyen. Cet
affranchi a une capacité politique et juridique restreinte. Êtreaffranchi c’est être libre mais c’est avoir des droits politiques et judiciaires même s’ils sont réduits.
Le terme métèque n’a pas le sens péjoratif connu. Techniquement il désigne simplement celui qui séjourne plus d’un mois dans une cité qui n’est pasla sienne et qui paie à ce titre un impôt personnelmarquant son statut d’étranger. Jouit de la libertémais de certains droits privés assez restreint. Il n’y a pas d’acquisition automatique de la citoyenneté puisque la concession de la citoyennetéest très rare et dépend du bon vouloir de l’assemblée. D’une manière générale, la cité grecque refuse catégoriquement de faire du droit dusol un critère d’acquisition de la citoyenneté. Le territoire de la cité est restreint et il y aurait un risque de surpeuplement. De plus le sentiment d’appartenance à la cité-mère est très fort chez ungrec et il n’est finalement transmissible que par les liens du sang.
Athènes, en pleine époque classique est une cité démocratique convaincue de sa supériorité. Athènes va ainsi vouloir exporter et imposer son modèle parle militaire, mais va chercher à préserver son modèle en restreignant ses citoyens.
Rome cherchera aussi à diffuser la supériorité de son modèle mais pas seulement par la force, en effet il utilisera aussi le droit, et Rome le fera par la donation de la citoyenneté romaine. Rome va tenter d’avoir un Empire Uni et pour cela donnera la citoyenneté plus facilement que les grecs.
Section 2 : la citoyenneté romaine
La citoyenneté chez les Romains a elle aussi vu le jour dans le cadre de la cité. Citoyenneté : civitas ; la cité de Rome, à l’origine couvre la ville de Rome et ses faubourgs. Du point de vue du contenu, la citoyenneté romaine est proche de la citoyenneté grecque. Le statut de citoyen implique la liberté dont jouit tout citoyen romain. Le citoyen est une personne libre à la différence des esclaves et le citoyen jouit de deux types de droit : d’une part des droits politiques, comme le droit de vote, le droit de se faire élire, le droitd’être rattaché à une tribu, etc. mais il jouit également du droit civil romain, ou droit des Quirites, (ancien citoyens) qui est le droit dont les citoyens se servent pour régler leurs différends privés : c’est la possibilité d’aller devant les tribunaux.
Les Romains ont développé une conception originale de la cité puisqu’ils lui ont conféré une valeur juridique abstraite : à la différence de la cité grecque, la citoyenneté romaine exprime une communauté de droits & de devoirs mais n’implique pas de vivre avec les autres dans le cadre géographique restreint de la cité. Dissociation entre le cadre civique et le cadre territorial et c’est cette dissociation qui entraine une conception dynamique de la citoyenneté. On peut être citoyen romain et habiter ailleurs, loin du pouvoir de la cité romaine. La citoyenneté est doncoctroyée plus facilement aux populations qui habitent loin de Rome, on dit que la citoyenneté
est ouverte. Elle se caractérise par une habile répartition entre droit du sol et droit du sang et par une dissociation entre droit politique et concession du droit civil romain. Cette citoyennetéromaine est l’élément qui permet de s’intégrer dansl’empire romain.
Paragraphe 1 : la qualité de citoyen
A la grosse différence du droit grec on ne trouve dans le droit romain aucune définition formelle de la citoyenneté et du citoyen. Les romains sont pragmatiques, tout comme leurs approches du droit, ils veulent répondre à des situations concrètes mais n’ont pas donné de définition de la citoyenneté pour ne pas réduire son champ d’application. Il existe donc une grande variété dumode d’acquisition de la citoyenneté.
• Les modes d’acquisition de la citoyenneté
On devient citoyen romain de plusieurs façons :
• Par la naissance : critère classique du droit du sang, il suffit de naitre d’un pèreromain dans le cadre d’un mariage légitime, c’est-à-dire reconnu comme tel par le droit romain.
Le droit romain peut ainsi parfois admettre les mariages mixtes, entre étranger et athénien ; si l’étranger a son peuple qui est lié, qui a conclu un traité avec Rome.
Les enfants qui naissent de l’union d’un mariage légitime, mixte ou non, sont légitimes et deviennent des citoyens romains.
S’il y a union naturelle : un homme et une femme conçoivent un enfant sans être mariés, s’il n’y a pas de mariage délégitime, l’enfant suit la condition de la mère : si celle-ci est romaine, l’enfant devient un citoyen romain.
Au 1er siècle, la loi Miniciadécide que l’enfant d’une romaine et d’un étranger qui n’est pas lié à Rome par un traité, c’est-à-dire d’un pérégrin, va suivre la condition la plus inférieure aux yeux du droit romain, donc la condition du père. Hommes à la guerre donc les femmes vont avoir d’autres hommes qui ne sont pas romains, et cette loi permetde moraliser les mœurs tout en conservant la puretédu droit romain.
• L’affranchissement de l’esclave : s’effectue au moyen d’un acte juridique précis.
Si les formalités de l’affranchissement ne sont pasrespectéesl’esclave accède à la liberté mais ne devient pas citoyen. Il devient alors apatride. Si l’affranchissement a été effectué correctement, l’esclave devient libre et suit la situation de sonancien maitre, si celui-ci était citoyen romain, alors l’affranchi sera citoyen ; mais il devra garder des liens avec son ancien maître, qui devient désormais ce qu’on appelle « un patron ». le patron est un citoyen, un homme d’influence qui noue des accords avec un certain nombre de citoyensmoins riches, moins bien placés que lui et les aide
en échange de services. Ce sont des liens dits « declientèle » l’esclave affranchi devient libre et citoyen mais entre ainsi dans une relation de clientèle, doit le respect à son patron, doit voterpour lui lors d’élection, lui doit des journées de travail et surtout s’il meurt sans héritiers, c’estl’ancien maître, le patron qui est successeur.
L’affranchi devient un libertinus. L’affranchi est celui qui se distingue de celui qui est né libre, l’ingenus. A l’origine, la distinction est marquée entre le libertinus et l’ingenus ; le libertinus vaavoir des droits civils et politiques plus restreints que l’ingenus, par exemple sous la république romaine (entre 509 et 27 avant JC) les affranchis, les libertinus n’avaient pas le droit de se marier avec des ingenus. Puis la législation s’est assouplie et à partir de 18 avant JC, des lois assouplissent le droit et le mariage des affranchisavec les hommes nés libres sera permis sauf s’il s’agit de personnes de rang sénatorial. (Noblesse romaine = sénateurs). A la seconde génération, c’est-à-dire les enfants des affranchis, tout est effacé : les enfants des affranchis naissent librespuisqu’ils sont nés de personnes libres, et deviennent alors des citoyens comme les autres et il n’y a plus de distinction politique ou juridique. Toute référence à l’état antérieur d’esclave disparait.
A Rome au 4ème siècle avant JC : On peut devenir citoyen par concession, Rome conquiert d’autres territoires.
• La perte ou la diminution de la citoyenneté
La perte de citoyenneté peut être volontaire, ce sont toutes les hypothèses où il y a un abandon volontaire par exemple lorsqu’un romain part vivre dans une colonie et il choisit de ne plus avoir la citoyenneté romaine et de prendre la nouvelle citoyenneté de la colonie qui a été fondée. Cependant il peut y avoir une perte involontaire dela citoyenneté. Un citoyen peut perdre sa citoyenneté involontairement soit lorsqu’il est prisonnier des ennemis soit lorsqu’il est sous le coup d’une sanction émanant de la cité notamment en matière pénale. La citoyenneté est un des trois attributs de la personnalité juridique, les deux autres caractères sont : la liberté & les droits familiaux.
Un citoyen doté d’une pleine capacité juridique estun citoyen qui a une citoyenneté entière c’est-à-dire undroit politique, civique, jouit d’une liberté totale et a des droits familiaux en matièrede mariage, etc.
La personnalité juridique vient du latin « caput ».Quand un des trois attributs manque, on emploi une expression : « capetis deminutio » (deminutio : destruction)= C’est donc la perte de la personnalité juridique.
En ce qui concerne la perte de la citoyenneté elle correspond a deux types d’amputation de la personnalité juridique ; soit il y a une perte totale de la personnalité juridique, on dit « capetis demunitio maxima » ; c’est à dire qu’il aperdu qualité de citoyen, liberté et droits
familiaux. C’est le cas par exemple du citoyen qui se retrouve réduit en esclavage par des étrangers. C’est aussi ce qu’on appelle une « mort civile » juridiquement, puisque cette personne n’a plus d’existence civile et légale aux yeux de la citoyenneté romaine. Si cette personneest libérée ou qu’elle s’enfuit, dès le moment où elle arrive sur le territoire romain, elle redevient citoyen etretrouve tous ses droits civils et juridiques.
Il peut y avoir une perte partielle de la personnalité juridique, on appelle cela la « capetis deminutio media » c’est le cas dans lequel une personne perd sa citoyenneté, ses droitsfamiliaux mais pas sa liberté. Si on perd la citoyenneté ; on perd ses droits familiaux car quand on perd la citoyenneté on perd le bénéfice dudroit civil romain. Cependant la personne reste libre. Cas du colon qui quitte la cité-mère pour créer une colonie, soit il renonce à la citoyennetéromaine et s’il fait ce choix, renoncera à tous lesdroits familiaux à Rome mais gardera sa liberté. Cette personne pourra reconstituer une personnalitéjuridique complète dans sa cité.
Quand la perte de la citoyenneté résulte d’une condamnation pénale : capetis deminutio media ; il y a des peines capitales qui confisquent ou entrainent la perte de la citoyenneté : par exemplela peine de l’exil. Il en va de même pour la peine de l’interdiction de l’eau et du feu, qui est considérée comme une peine capitale à Rome au même titre que la peine de mort.
Peine de l’eau et du feu : personne reste libre mais elle n’est plus censée pouvoir se nourrir et se loger sur le territoire romain puisque l’eau et le feu sont deux éléments nécessaires à la vie, ainsi si on a cette peine, on est plus désirable sur le sol romain, on perd la citoyenneté, ses droits familiaux mais on est libre mais il faut vite quitter le territoire romain parce que sinon n’importe qui a le droit de tuer la personne qui est condamné de cette peine. L’idée, c’est qu’i faut punir le citoyen qui a commis une peine grave et qui a commis la paix publique, et donc on lui retire sa citoyenneté on l’exclut de la communauté civique car il constitue un danger pour la société,c’est un élément impur dont la société n’a pas besoin.
Rome va faire de la naturalisation un instrument d’intégration des étrangers au sein de l’empire.
Paragraphe 2 : la situation des étrangers
L’intégration des étrangers à la citoyenneté romaine va évoluer selon les frontières de l’empire. Très tôt, dès l’époque archaïque, les romains se sont souciés de leurs relations avec lesétrangers. C’est comme cela que très tôt on trouve dans la législation romaine des dispositions de droit international public visant très clairement àgérer les relations avec les étrangers. A partir dumoment où Rome va commencer sa phase de conquête territoriale, la condition de citoyenneté se pose différemment : à l’époque archaïque, à l’origine les relations à l’étranger sont fondés sur des traités instaurant une réciprocité. Rome qui étend
ses conquêtes pense alors à déterminer quel sera lestatut juridique de ces étrangers militairement conquis par Rome. Il n’est ainsi plus question de cette égalité du départ. C’est alors que la citoyenneté devient un moyen efficace d’intégrer les étrangers dans l’empire romain.
• L’organisation des relations avec les étrangers par traités internationaux.
A l’époque archaïque, deux termes désignent l’étranger : « peregrinus » et « hostis ». Ces deux termes désignent l’étranger appartenant à un état lié à Rome par un traité international et doncprotégé par ce traité d’amitié et d’hospitalité.
A cette époque archaïque, l’étranger qui appartientà un état qui n’est pas lié juridiquement à Rome par un traité n’existe pas. Le terme « hostis » est le plus utilisé parce qu’il désigne l’étranger mais aussi « l’hôte ». Dès queRome conquit des territoires outre-mer, c’est le terme « peregrinus » qui s’imposera pour désigner l’étranger. Le terme « hostis » sera ainsi donné à l’ennemi. Les traités qui nous sont parvenus datentdu 5ème siècle avant JC, l’époque où Rome n’est qu’une petite cité du Latium.
Ces premiers traités visent à établir des relationspacifiques avec qq peuples étrangers. Ces traités, sont marqués dans « la loi des XII tables » qui date d’environ 1250 avant JC, qui est la première codification du droit romain. La loi des XII tablescontient surtout des dispositions de droit privé, mais dans cette loi on trouve tout de même des mentions de l’étranger. Le terme « hostis » est
employé, ce qui veut dire que ces premiers traités impliquent bien une réciprocité. Les deux peuples sont considérés être sur le même plan juridique, une même égalité. Cette égalité va se matérialiser par la concession de 4 éléments différents :
• Le « ius migrandi » : c’est le droit d’immigrer dans la cité et d’y acquérir la citoyenneté.
• Le « connubium » : c’est le droit de contracter un mariage légitime. Droit de se marier entres romains ou entre romain et étranger ayant cité lié à Rome par un traité. Possibilité de fonder une famille légitime aux yeux du droit romain. Enfants nés d’une telle union seront reconnu comme citoyens romains.
• Le « commercium » : c’est le droit de faire du commerce, d’acheter et de vendre, c’est un droit de marché, le droit de conclure des transactions commerciales entres romains etétrangers liés à Rome par un traité, ces transactions commerciales sont protégées par unstatut juridique.
• Il va y avoir une juridiction particulière qui va être créée, qui s’occupera des litiges entre les ressortissants des deux états liés par un traité. Cette juridiction est« le tribunal des récupérateurs » ; c’est un tribunal spécifique, différent de la procédure civile romaine, qui se réunit à des moments particuliers : il y a des jours fixes, consacrés aux règlements des litiges entre
romains et étrangers. Ce tribunal et son fonctionnement sont évoqués dans la loi des XIItables. Ce qui signifie que la loi interne, desXII tables, organise ce tribunal spécifique parallèlement aux litiges internes de la cité. Ce tribunal récupérateur est réciproque, c’est-à-dire qu’il va exister à Rome mais aussi dans les cités qui ont conclu un traité avec Rome ettous les litiges seront ainsi traités de la même manière.
Il y a deux exemples de ces traités :
• le « foedus cassianum » qui date de 493 avant JC. Traité qui engage Rome et une coalition de cités du Latium (région autour de Rome). Rome conclut ce traité avec 29 cités latines, qui prévoit : le commercium, le connubium, le ius migrandi et le tribunal des récupérateurs.
• Le « traité romano-carthaginois » : Carthage, grand ennemi de Rome à partir du 3èmesiècle avant JC pcq Carthage domine la méditerranée du 3ème au 7ème siècle avant JC ; Il y a donc trois grands traités conclus avec Carthage en 509 puis en 348 et en 306 avant JC,cependant il y aura des guerres puniques de 265 à 146avant JC. Le premier traité est un traité d’amitié, égal, qui prévoit qu’en cas d’une seule inexécution du traité, l’amitié doit cesser. Droits des romains sont énumérés puis les droits des carthaginois. Pas le droit de
connubium, de se marier entre romains et carthaginois pcq Carthage est trop éloigné, culturellement et géographiquement de Rome. Il y a seulement une notion de comercium. Il y a en matière de commerce une égalité réciproque des droits et il est dit qu’un romain à Carthage peut faire tout ce qu’un carthaginois peut faire et vice-versa. A l’époque archaïqueRome n’a pas définit un statut de l’étranger définit, elle n’a conçu le statut del’étranger que sur des traités basés sur la réciprocité et l’égalité. Cependant ceci va changer quand Rome va vouloir conquérir la méditerranée.
Rome détermine ainsi seule le statut à accorder auxétrangers conquis.
Les différents degrés de concession de la citoyenneté.
• La romanisation des italiens.
A l’origine, Rome normalisait ces relations avec les traités. A partir du 4ème siècle avant JC, Rome veut conquérir ces voisins italiens et les soumettre. Rome commence alors par les cités du Latium. Depuis ses origines, depuis 753 avant JC, Rome appartenait à la ligue latine, qui est une confédération de cités du Latium, qui partagent toutes une même communauté linguistique, religieuse et juridique. A partir du 5ème siècle, cette ligue latine devient une ligue de défense contre les ennemis communs. Rome va être prise par les Gaulois en 390 avant JC et c’est grâce à l’armée de cette ligue, l’armée fédérale,
que Rome sera libérée. C’est au sein de cette liguelatine qu’on a le traité « foedus cassanium ». Cependant Rome va prendre le dessus et va ainsi rompre l’égalité qui depuis le début dominait la ligue latine. Rome prétexte un soulèvement des cités du Latium contre elle et donc Rome va riposter en 340 et va dissoudre la ligue en 338 avant JC. Rome annexe le territoire de ces cités qui deviennent des terres romaines.
Quel est le statut des habitants de ces anciennes cités indépendantes ? Ces anciennes cités du Latiumvont devenir ce qu’on appelle des « municipes. » unmunicipe est, une ville municipale. Le municipe finalement c’est une sorte de reproduction au niveau local de Rome. En effet on trouve deux magistrats, une assemblée des habitants et un sénatlocal. Rome va décider que les habitants de ces municipes deviennent des citoyens romains. Cependant il va y avoir quelque subtilités en fonction des municipes. Soit Rome accorde la citoyenneté complète, soit elle va accorder la citoyenneté sans suffrage. S’ils ont citoyenneté complète, ont les mêmes droits et devoirs que les citoyens romains notamment le droit privé, le droitcivil romain, le droit de suffrage (de voter dans les assemblées du peuple), etc. ; la principale obligation est le service militaire au bénéfice de Rome. Cette citoyenneté complète est attribuée aux municipes qui étaient très proches de Rome d’un point de vue ethnique, culturel ou religieux. On accorde cette citoyenneté complète aux latins. Cependant Rome peut délivrer la citoyenneté sans suffrage cad que ces citoyens sont biens citoyens
romains mais n’ont pas de droits politiques. Ils nepeuvent pas venir voter à Rome, ni se faire élire àRome, ne peuvent pas faire partie du Sénat Romain. Ils ont un rôle politique à jouer mais qui est purement local, dans le cadre de leur municipe seulement. Par ailleurs jouissent du droit civil romain : ont des obligations militaires, peuvent venir habiter à Rome mais n’ont tout de même pas dedroit politiques, seulement locaux.
L’octroi de cette citoyenneté sans suffrage a été utilisée de deux façons à Rome : soit la populationqui a ce droit est « à l’essai », c’est-à-dire que la citoyenneté complète viendra si on est sur de lafidélité de cette municipe, soit il s’agit d’une punition parce que pour Rome, certaines cités du Latium sont responsables du soulèvement des cités du Latium contre elle. Quoi qu’il en soit il est possible plus tard d’accorder une citoyenneté complète à ces municipes. Cette citoyenneté sans suffrage est aussi utilisée lorsqu’il s’agira de donner un statut aux peuples d’Italie centrale.
Rome se lance dans la romanisation de l’Italie toutentière et aura recours à d’autres structures que les municipes. Rome utilise deux autres solutions :la fédération et la colonie.
Dans le cadre de la fédération il y a une alliance,un traité qui est conclu mais il est inégal en la faveur de Rome. Les cités concernées sont appelées les cités alliées. Elles ne sont pas du tout intégrées à la citoyenneté romaine. Ce sont des cités qui en apparence conservent leur souveraineté, leur personnalité juridique et
internationale. Mais dans les faits, on peut dire que les cités alliées à Rome dans le cadre d’une fédération font l’objet de beaucoup d’inégalités. C’est un traité qui comprend des obligations perpétuelles et unilatérales. Ces obligations consistent : à obéir à Rome ; il y a une contribution militaire très lourde et financière. La cité allée reconnait la supériorité de Rome et son hégémonie. Dans un tel système, les cités alliées doivent renoncer à toutes relations internationales en dehors de Rome puisqu’en gros ces cités alliées deviennent une sorte de client deRome et on doit obéissance et soutient à Rome exclusivement.
Il y a deux types de colonies, la colonie romaine et la colonie latine.
• La colonie romaine.
Rome envoie200 à 300 familles romaines sur des lieux stratégiques pour fonder une cité, notamment le long des côtes. Au 3ème siècle avant JC, les romainsvont confisquer des terres qui appartenaient aux gaulois situés entre Bologne et les alpes. On envoie des familles de citoyens dans ces terres chargés de fonder des cités à l’image de Rome. Dansces colonies toutes les décisions émanent des autorité romaines. Tout est construit sur le modèlede la ville de Rome et même la fondation de la ville se fait selon les mêmes places qu’àRome. Ces colonies romaines sont des morceaux de Rome éparpillés mais juridiquement on considère qu’ellesforment un tout avec Rome. Les habitants de ces colonies restent des citoyens romains.
• La colonie latine.
Rome va regrouper sur un territoire une population mixte, il ne s’agit pas d’envoyer sur place des familles de citoyens romains, il faut envoyer des citoyens romains mais qui renonceront de manière volontaire à leur citoyenneté romaine pour fonder des cités et qui auront alors une nouvelle citoyenneté. On trouvera aussi des alliés italiens , ceux qui font partie des fédérations, mais aussi des indigènes qui restent sur place. Chaque citoyen acquiert la citoyenneté de la nouvelle ville ; il n’y aura pas de citoyenneté romaine, jouiront de connubium, de comercium mais n’auront pas de droit politique,de droit de suffrage. Les habitants s’occuperont de la politique locale. Peuvent migrer vers Rome et ainsidevenir citoyens romains.Dès le 2ème siècle avant JC on supprime le « ius migrandi » dans les colonies latines, et on pourra toujours devenir citoyen romain dans ces colonies mais ce sera plus difficile : il faudra avoir exercé une magistraturelocale pour devenir citoyen romain. Ceci va permettre à Rome de romaniser l’Italie. Ce qui veutdire qu’en 272 avant JC, il n’y a plus sur le sol italien de cité ou de peuple réellement indépendantde Rome. Soit sont devenus des éléments de l’ordre juridique romain soit liés à Rome par un traité inégal. Utilisation très habile du droit du sang etdu droit du sol.
Rome a réussi à combiner à la fois le droit du sanget le droit du sol. Le droit romain joue en nuance
et en finesse entre concession complète et incomplète de la citoyenneté.
La qualité de citoyen est tellement recherchée qu’elle va se trouver au cœur d’une guerre, qui estla guerre sociale, qui oppose la cité de Rome aux alliés italiens de 91 à 89 avant notre ère. On dit que c’est une guerre sociale parce que vient de « socii » = les alliés en latin. Une telle guerre éclate parce que d’une part la citoyenneté sans suffrage est de plus en plus ressentie comme une condition dégradante, et d’autre part tous ces alliés qui n’ont pas obtenu la citoyenneté romaine ou qui ont obtenu une citoyenneté sans suffrage supportent de plus en plus mal le point de l’impôt qui pèse sur eux ainsi que les obligations militaires. Surtout que dans le même temps, les charges des citoyens romains s’allègent puisque la cité de Rome s’est enrichie grâce à ses conquêtes que les romains ne payent plus d’impôt contrairement aux non-citoyens et ces derniers se révoltent alors, d’où une guerre sociale. C’est unerevendication d’acquisition de la citoyenneté, et àl’issu de cette guerre, en 89 va être prise une loiPapira qui va ouvrir à tous les alliés l’accès à lacitoyenneté romaine. On peut dire que le territoireromain coïncide ainsi avec l’Italie ; il y a en quelque sorte une naturalisation générale de tous les italiens, qui vont tous jouir d’une citoyennetécomplète. Il y avait une communauté : de race, religieuse. Il y avait un sentiment communautaire qui animait l’Italie et c’est pour cela que le processus de romanisation a été possible. Dès le 3ème siècle avant notre ère, Rome commence une autre phase
de conquête, celle du bassin méditerranéen. En faitRome tend à la domination universelle d’après les termes utilisés par Polybe, historien grec qui a pourtant essentiellement écrit sur Rome. En effet il explique que Rome aspire à la domination universelle. C’est donc à partir du 3ème siècle quetoute la relation avec le pérégrin, avec l’étrangerprend tout son sens.
Paragraphe 3 : la situation des pérégrins provinciaux.
3ème siècle avant JC ; à partir de là Rome commencela conquête de territoire situés outre-mer : le bassin méditerranéen. La question dont Rome va traiter la question des étrangers est ambiguë : Rome ne prend pas en considération le statut accordé à ses étrangers, à ses pérégrins qui viventdans les territoires conquis. Pourtant, au même moment, la constitution romaine va s’enrichir d’un magistrat nouveau : une nouvelle fonction est créée, celle d’un magistrat créée spécialement pourrégler les litiges avec les étrangers, c’est le préteur pérégrin.
La conquête des territoires d’outre-mer va s’étendre sur les trois derniers siècles de la République à tel point que, lorsque l’on va voir apparaître l’Empire au sens politique du terme (27 avant JC) on peut dire que l’Empire géographique est situé. La première grande conquête méditerranéenne est laSicile, 241 puis la Corse et la Sardaigne vers 230, puis la Macédoine et l’Afrique en 146 et au 1er siècle avant JC Rome est devenue maîtresse de tout le bassin méditerranéen. Il y aura en plus les conquêtes de César : la Gaule
et plus tard sous l’empereur Claude, il y aura la conquête de la Bretagne (l’Angleterre aujourd’hui).Vers le milieu du 1er siècle avant JC, les Romains ont vraiment l’impression d’avoir atteint leur limite géographique. Le sénat de Rome confit au général victorieux, celui qui a conquis l’état, la province en question, le soin de rédiger le statut,la constitution de la nouvelle province romaine. Onparle alors de « lois de la province ». Ceci va être une loi octroyée par le général romain de manière unilatérale sans consultation des autoritéslocales. Cette loi accorde, rédige un nouveau statut à ce nouvel état annexé par Rome. Cet état n’existe plus en tant qu’état souverain vu qu’il devient province romaine, mais les habitants de cetétat demeurent aux yeux des romains des étrangers, des pérégrins. Ce sont des étrangers qui vivent en territoire Romain mais comme ils vivent en temps qu’étrangers certains peuvent même être vendus comme esclaves. Rome leur permet même de conserver leurs tribunaux locaux, mais Rome envoie un gouverneur pour contrôler ce qu’il se passe sur place. Sinon Rome leur laisse exercer leurs anciensdroits locaux. Rome fait le choix de ne pas intégrer ces populations, qui est ainsi un signe desoumission, de leur infériorité par rapport à Rome.C’est l’absence de proximité ; linguistique, religieuse ou raciale qui fait qu’il n’y a pas le lien qu’il y avait avec les italiens. Les populations des nouvelles provinces romaines restent des étrangers, des indigènes indignes de jouir des valeurs romaines et ainsi de jouir de la citoyenneté, on en reste au stade de l’annexion territoriale pure & simple. La concession de
citoyenneté est toujours possible mais elle est vraiment exceptionnelle pour ce qui concerne les provinces romaines. Mais, la position des romains est ambigüe car, à cette époque de conquête Rome créée le préteur pérégrin qui est le magistrat chargé des litiges avec les étrangers. Ce magistrata été créée parce que l’on est dans un contexte de conquête méditerranéen, ce contexte favorise le développement d’affaires commerciales entre Rome etles étrangers. Soit en outre-mer soit à Rome même parce que beaucoup d’étrangers viennent à Rome. Leséchanges commerciaux vont se développer et l’état romain contribue à ce commerce grâce aux moyens de communication : terrestres mais également maritimes(Rome se lance dans la lutte contre les pirates).
On a des nouvelles relations d’affaires qui sont prises en charge par les institutions romaines, parle droit romain et c’est pour cela que le préteur pérégrin est créé en 242 avant notre ère, à la fin de la première guerre punique (guerre opposant Romeet Carthage). Ce préteur pérégrin est compétent pour régler les litiges entre les romains et les étrangers ainsi qu’entre étrangers même. Ce sont ces nouveaux magistrats qui vont se charger des relations entre romains et étrangers ou entre étrangers. Il faut concevoir ce préteur pérégrin comme détenant une juridiction, on trouve le préteur pérégrin quand on a un problème à régler avec un étranger.
Une question se pose tout de même : quel est le droit applicable aux questions avec les étrangers ?Est-ce le droit civil ? => Non. Le droit civil aux
yeux du droit romain est le droit de la cité, c’est-à-dire que c’est le droit uniquement applicable aux citoyens romains. Le droit romain connait un système de personnalité des lois très fort. Dans ce droit civil, il n’y a pas de mentionsfaites de droit de commerce, pas de comercium prévu, & à côté de ce droit civil se développe un autre droit : celui de droit commun des échanges avec les étrangers, qui est le droit des gens : iusgentium.
Le ius gentium est le droit qui est au départ crée pour les relations commerciales entre romains et étrangers. A partir des conquêtes romaines, et à partir du développement des relations commerciales avec les étrangers on se rend compte qu’on a besoind’un droit commun et plus particulièrement de droitcommercial. On a besoin de ce droit pour tous les citoyens de l’empire romain quel que soit leur citéd’origine.
Droit civil : que les citoyens romains & ne s’occupe pas des affaires commerciales.
Droit des gens : droit commun à tout le monde & s’occupe des affaires commerciales.
L’influence de la pensée grecque se situe derrière ce droit des gens.
Ce droit des gens est un droit qui va pouvoir être utilisé par les romains et les étrangers mais il sera également possible d’être utilisé par les romains entre eux. Tous les actes de la vie commerciale font partie du droit des gens. Le droitdes gens sert à l’origine aux relations
commerciales mais est applicable à tous les étrangers.
Sous l’Empire, on assiste à un effort de romanisation de ces provinces provinciales. L’aboutissement de ces efforts est un Edit qui est l’Edit de Caracalla.
C) la citoyenneté universelle.
A partir de 27 avant JC, la prise en compte des pérégrins dans les provinces va être progressive : on commence à romaniser ces provinces et des passerelles vont être créées pour permettre aux pérégrins de devenir citoyens. Par exemple, si on exerce une magistrature locale au sein d’une province, on va automatiquement acquérir la citoyenneté romaine. Progressivement on se rend compte qu’il y aura une intégration des pérégrins. Peuvent ainsi venir à Rome pour faire une carrière politique. On se rend ainsi compte que dans les dynasties régnantes, dansles familles d’empereur, on commence à trouver des étrangers d’origine. A partir de 96 après JC la dynastie régnante est celle des Antonins qui est originaire de la province d’Espagne. La dynastie des Sévères à partir de 193, sera originaire d’Afrique. Progressivement va se déployer l’idée decitoyenneté universelle, qui est une idée philosophique puisque grâce à cette conquête du monde méditerranéen les échanges s’intensifient ; les échanges commerciaux mais aussi les idées en matière philosophique. Cette conception de citoyenneté universelle est une conception très ancienne puisqu’elle date du IVème siècle avant JC.
C’est un concept que l’on doit à des philosophes grecs, aux Stoïciens.
Les Stoïciens développent l’idée que l’on n’est pascitoyen d’un Etat mais que l’on est tout d’abord citoyen du monde. Petit à petit le système de la cité état en Grèce disparait ; qui est englobée dans un Empire (Macédonien) construit par Philippe de Macédoine mais surtout repris par son fils Alexandre le Grand. Cette idée est reprise par Sénèque, un écrivain et philosophe romain, conseillé de l’empereur Néron, aux alentours de 57 après JC. Cette idée est également reprise plutôt par l’empereur Marc Orel, en 61 après JC, qui faisait partie de la dynastie des Antonins.
Les romains s’imprègnent de cette idée de citoyenneté universelle, et on la retrouvera dans l’Edit de Caracalla, qui accorde la citoyenneté à tous les habitants de l’Empire, on est alors en 212après JC.
Caracalla est Empereur en 212 et prend un édit qui permet que la concession de la citoyenneté touche tous les habitants de la cité. C’est une mesure quidonne la citoyenneté à tous les habitants de l’empire, en gros ce sont tous ceux dont on a romanisé le territoire mais à qui on a pas encore accordé la citoyenneté.
Restrictions :
• Cette mesure ne vaut que pour le présent, pas pour l’avenir ; elle s’applique aux personnes qui vivent sur les terres de l’empire romain en 212 ; ceux qui viennent s’y
installer plus tard n’auront pas la citoyenneté.
• On exclut certaines personnes de cetteconcession de citoyenneté : les déditices, qui sont des étrangers prisonniers de guerre, des hommes qui généralement ont pris les armes contre Rome ; qui ont été fait prisonniers et qui sont généralement parqués aux frontières del’empire qui servent de main d’œuvre. Ces déditices sont sans droit, en théorie ils sont libres mais cette liberté est dépourvue de droit est similaire à celle des affranchis : sont en quelque sorte apatride,on ne sait pas quels sont leur statut exactement. On a ici un vide juridique qui explique que l’Edit de Caracalla met ces personnes de côté. On ne saitpas exactement quel est leur statut : apatride,libre à liberté conditionnelle, donc c’est plusfacile de les laisser comme ça, sans statut.
• On donne le droit de cité tout en permettant de conserver la citoyenneté d’origine. Cela veut dire que ces nouveaux citoyens peuvent prétendre à une carrière administrative ou politique à Rome, ils peuventutiliser le droit civil romain et peuvent aussiconserver leurs usages locaux, leur organisation politique locale et leur organisation judiciaire. Ils ont ainsi le choixparce qu’ils bénéficient des avantages de leur double-nationalité. On essaie de procéder à uneintégration en douceur ; et à une intégration
volontaire. C’est une liberté qui leur est donnée.
Quels sont les motifs qui ont inspiré Caracalla ? Pourquoi cet empereur a-t-il décidé de donner la citoyenneté à tous les habitants de l’empire ?
Il y a plusieurs raisons à un tel édit :
• Considération religieuse : c’est le désir de l’empereur de plaire aux Dieux, de leur être agréable. Il fournit ainsi de nouveaux fidèles aux Dieux. Ces nouvelles populations qui deviennent des citoyens romainsont le choix, mais l’idée, c’est qu’au fil du temps il y ait adhésion volontaire et pleine dela citoyenneté romaine : avec la religion.
• Considération financière : Ce sont despréoccupations fiscales : l’empire en 212 aprèsJC est quelque chose d’énorme et pour faire fonctionner un tel empire on a besoin d’argent.Augmenter le nombre de citoyens romains, c’est augmenter le contribuable et donc recevoir plusd’impôts.
• Cet édit est l’aboutissement d’un longprocessus de romanisation des provinces. Ce processus a commencé dès le Premier Empereur deRome, dès le royaume d’Auguste (27 avant JC). =évolution naturelle.
Influence du Stoïcisme ; influence de l’idée de citoyenneté universelle, il est très probable que dans l’entourage de l’empereur Caracalla il y avait
des juristes qui étaient très familiers de ce courant stoïciens.
Le cas romain est exemplaire en matière d’intégration des étrangers et en matière de conception de la citoyenneté.
La question de la citoyenneté est une question fondamentale dans la société aujourd’hui mais également à l’époque.
Chapitre 2 : De la communauté politique à l’Etat.
La cité est une communauté politique.
Le citoyen est celui qui est né d’un père et d’une mère citoyens en Grèce, et à côté du critère de la naissance, le citoyen est celui qui participe à un système de gouvernement. La pensée politique grecque manifeste un intérêt particulier pour la réflexion sur les systèmes politiques, sur la notion de constitution et sur quels régimes politiques peuvent exister et si on peut les classer. On va voir que parmi tous ces régimes politiques possibles que les penseurs grecs analysent ; il y en a un qui se détache car il est aujourd’hui considéré comme le meilleur : le régimedémocratique.
Le régime de la démocratie est inventé par les Grecs, c’est le « gouvernement du peuple par le peuple ». La Grèce a été le berceau de la cité, dela politique dans le sens de « vivre ensemble au sein de la cité ». A l’origine la politique est le fait de vivre dans la cité et donc d’organiser la vie au sein de la cité. L’héritage romain n’est pas
non plus négligeable ; ils ne sont pas connus pour être des philosophes ou des penseurs politiques puisqu’ils empruntaient leurs idées aux grecs, maisles romains sont un peuple de juriste. Les romains,avant tout juriste, ont réussi à greffer une analyse juridique sur la pensée politique grecque. C’est donc grâce à cette réflexion pratique des romains sur la pensée politique grecque qu’on a la notion d’Etat qui nous sert toujours aujourd’hui.
Section 1 : La genèse de la notion de Constitution.
Les Grecs ont posé la notion de Constitution par une double démarche : ont commencé par élaborer la notion de Politéia puis ont dégagé une typologie des régimes politiques, c’est-à-dire qu’ils ont classé les différents régimes politiques.
Paragraphe 1 : La Politéia.
Politéia = Constitution ; système de gouvernement. Aristote est fondamental puisqu’on le considère comme le père du droit constitutionnel. Aristote, dans son ouvrage « la politique » donne une définition et il indique que la Politéia c’est une certaine organisation des habitants de la cité. La Politéia est le système de gouvernement que les citoyens se sont donnés.
Définition moderne de la Constitution : « c’est la norme juridique suprême de l’Etat adopté par le pouvoir constituant et destiné à organiser les pouvoirs publiques et à garantir les droits des citoyens et les libertés fondamentales ».
En Grèce la Politéia doit garantir la liberté & la jouissance du droit civil.
Aristote dans son ouvrage « Constitutions » ; regroupe une collection de traités exposant les institutions politiques de 158 cités grecques ou barbares. Cet ouvrage n’est pas parvenu dans son intégralité. Cette étude des institutions athéniennes est fondamentale pour nous. Il aurait rédigé la constitution d’Athènes entre 329 et 322 avant JC. Cet ouvrage se divise en deux parties : la première suit une démarche historique, Aristote retrace l’évolution du régime athénien, de ces origines jusqu’en 403. La deuxième partie est une description détaillée des institutions politiques ;ici Aristote décrit exactement ce que sont la Boulé, le fonctionnement du Tribunal etc. Une fois que la Constitution est définie, les auteurs de l’époque se sont interrogés pour savoir pourquoi iln’y avait pas une constitution c’est-à-dire un seulmode de gouvernement politique valable pour une cité, mais des constitutions, c’est-à-dire plusieurs modes de gouvernement politique.
Cette existence d’une pluralité de constitutions ouvre la voie sur la typologie des différents régimes politiques existants.
Paragraphe 2 : la typologie des régimes politiques
Le premier à avoir réfléchi sur la typologie des régimes politiques est Hérodote ; qui est un historien grec qui écrit aux alentours des 6ème – 5ème siècle avant notre ère. Il a rédigé un ouvrage« les histoires » qui parle donc de la typologie des
différents régimes politiques ; c’est-à-dire qu’il va classer ces différents régimes. Il les classe selon un certain critère, celui qu’Hérodote dégage est celui du nombre de gouvernants. Il distingue les régimes dans lesquels il n’y a qu’un gouvernant, plusieurs ou même un grand nombre de gouvernants. Les grecs tirent différents types de constitution qu’ils vont juger bonnes ou mauvaises pour la cité. Très vite à ce critère quantitatif ; on y ajoute un critère qualitatif fondé sur l’intention des gouvernants. On va regarder si ces gouvernants gouvernent dans leur intérêt personnel ou bien dans l’intérêt de la cité. L’idée derrière tout cela, c’est de tenter d’analyser les raisons objectives des changements de gouvernement qui s’opèrent dans l’histoire grecque.
Ces changements de gouvernement sont également appelés des « révolutions » (qui est en fait un changement de constitution, donc il n’y a pas nécessairement utilisation d’arme).
Aristote analyse les différents types de régimes existants grâce aux critères qualitatifs et quantitatifs. Le fait dans ses deux ouvrages « la politique » et « la constitution d’Athènes ». L’idée d’Aristote dans « les constitutions » était bien d’analyser toutes les constitutions qu’il connaissait (au nombre de 158).
Platon a également réfléchi sur l’évolution des régimes.
• Le gouvernement d’un seul.
Il existe une forme pure de gouvernement et une forme dégénérée.
• La monarchie.
D’un point de vue étymologique ; monarchie vient de« monos » qui signifie « un seul » et le verbe « arkhein » qui signifie « commander ».
Au départ, la monarchie c’est simplement le gouvernement d’une seule personne, indépendamment de toute référence comme l’hérédité. En effet l’hérédité n’est qu’une façon parmi d’autre d’accéder au pouvoir. Un monarque peut ainsi être élu ou tiré au sort.
Le terme « royauté » est un terme plus récent, dontl’étymologie est romaine, vient de « rex », qui estcelui qui dirige les affaires ; c’est le roi, celuiqui commande ou qui préside. De manière générale, pour les anciens, on voit dans le gouvernement d’unseul celui qui trace la voie à suivre et qui incarne en même temps ce qui est droit.
Aristote dit que le bon monarque, c’est celui qui indique la voie à suivre et qui gouverne seul mais dans l’intérêt général. Certains auteurs, par exemple Xénophon ira jusqu’à comparer le monarque àun capitaine de navire. Cette royauté, est le régime qui va prévaloir en Grèce entre le Xème et le VIIème siècle avant notre ère. L’assemblée écoute, les anciens proposent et le roi dispose.
On assiste progressivement à un effacement progressif de la monarchie avec l’introduction du vote populaire. Avec le temps la monarchie tend à
être intégrée à une constitution plus riche, on garde un monarque mais on créée autour de lui d’autres institutions.
Avec le temps la monarchie dans sa forme pure va dégénérer et à Athènes, le roi sera considéré assezrapidement comme un magistratqui aura pour fonctionspécifique une fonction religieuse. Cependant à Athènes le roi ne sera plus qu’un magistrat parmi les autres, ce sera celui qui sera chargé des fonctions religieuses.
A Sparte, il y a deux rois, qui ont des pouvoirs militaires et religieux. Il y a alors une évolutiondes systèmes monarchiques, cependant, à l’époque classique en Grèce, la monarchie est considérée un peu partout comme incompatible avec la liberté et l’égalité qui doivent gouverner toute organisation politique.
(L’évolution est différente à Rome, puisqu’elle restera une monarchie de - 753 jusqu’en - 509. A partir de là la monarchie en tant que régime politique est bannie à Rome mais il y aura deux magistrats prépondérants, deux consuls, qui représenteront tout de même l’élément monarchique de la cité.)
Dans le cycle de transformation des constitutions, il arrive assez souvent que la forme pure de la monarchie s’altère et entraine l’avènement de la tyrannie, qui est la forme déviée du gouvernement d’un seul.
• La tyrannie.
Le terme tyran apparait au VIIème siècle avant notre ère et devient péjoratif à partir du Vème siècle puisqu’elle désigne ainsi une forme de monarchie qui se caractérise par son caractère illégal. Le tyran exerce un pouvoir sans contrôle.
Aristote dit que la tyrannie est une forme pervertie de la monarchie dans le sens où le tyran,à la différence du monarque, gouverne en faisant primer son intérêt personnel sur celui de la cité.
Platon réfléchit sur le cycle évolutif des constitutions, ainsi pour lui la tyrannie serait enréalité issue de la dégénérescence du régime démocratique. Il soutient que la démocratie, va être détruite justement par l’excès de liberté, ce qui conduit au mépris des lois dans tous les domaines ; c’est ce qui selon Platon engendre la servitude. Le peuple essaie de se protéger des riches, et il commence alors par se choisir un chef, qui ne tardera pas à se changer en tyran. Pour Platon, la source de la tyrannie n’est pas la même. Pour lui, cela provient d’une déviance du régime démocratique puisque ce sont les individus qui choisissent une personne pour les protéger maiscette personne se transforme en tyran. Le tyran privilégie son intérêt personnel.
D’un point de vue historique, ce phénomène de la tyrannie existe notamment entre le VIème et le VIIème siècle ; le tyran Denis de Syracuse à Syracuse mais il y a aussi des tyrans en Ionie, mais aussi à Athènes avec Pisistrate qui prend le pouvoir en – 557 et son fils lui succédera. C’est la littérature grecque qui a formé, qui a construit
la figure du tyran comme étant un personnage violent et arbitraire. Historiquement, ce que l’on sait, c’est que le tyran s’approprie le pouvoir dans les contextes de troubles : politiques, économiques… cependant, dans l’antiquité grecque, tous les tyrans n’ont pas été mal perçus par leurs contemporains. Par exemple Pisistrate était apprécié (mais pas son fils). L’image négative du tyran a été forgée a posteriori par la littérature parce qu’il peut apporter des points positifs commeà Corinthe. La personne du tyran à la grecque sera utilisée pour diaboliser à posteriori l’ancienne monarchie, celle des rois étrusques à Rome.
• Le gouvernement de quelques-uns.
Oligarchie, vient du grec « Oligoï » qui signifie « quelques-uns », et le verbe « arkhein » qui signifie « commander ». Cela signifie que quelques personnes exercent le pouvoir, et ces personnes sont égales entre elles.
Ces personnes sont choisies sur certains critères, il peut par exemple s’agir des meilleurs, et dans ce cas-là on appelle cela « l’aristocratie » qui vient d’ « aristoi » qui signifie « les meilleurs »et « kratos » qui signifie la « puissance », le pouvoir.
Pour Aristote comme pour Platon, l’aristocratie estla forme pure de gouvernement de quelques-uns. Platon comme Aristote accordent dans ce type de gouvernement une place primordiale à l’éducation parce que c’est grâce à elle que l’on peut former
les citoyens et ainsi prendre les meilleurs d’entreeux. Ils gouverneront en fonction du bien commun, pour l’intérêt général. Si cette élite qui est au pouvoir oublie l’intérêt de la cité, l’intérêt commun, et tend à protéger son propre intérêt, l’aristocratie va s’altérer. Il y a alors deux formes perverties possibles de l’aristocratie :
D’une part la ploutocratie ; vient de « ploutos » qui signifie « la richesse » et de « kratos » (puissance). Cela signifie que c’est le gouvernement de quelques-uns mais par les plus riches.
d’autre part la timocratie ; vient de « timos » quisignifie « l’honneur » et de « kratos ». C’est la recherche de l’honneur, de la gloire qui est la motivation des gouvernants.
Aristote : forme pure de gouvernement : aristocratie et la forme impure de gouvernement estla ploutocratie.
Platon : forme pure de gouvernement : aristocratie et la forme impure de gouvernement est la timocratie.
En effet ; le gouvernement timocratique est un mélange de bien et de mal, qui est caractérisée parle gout de la victoire, le gout des honneurs. Il pense qu’à l’origine il y a une aristocratie, que le gouvernement est aux mains des meilleurs et il pense que l’évolution normale, c’est que ces hommesau pouvoir veulent remporter des victoires, se couvrir d’honneur et c’est pour cela que l’aristocratie dévie vers la timocratie. A partir
du moment où on a acquis la victoire, l’honneur, ona envie de s’enrichir. Donc pour Platon dans ce type de régime, les riches sont plus honorés puisque les pauvres sont méprisésmais on accorde plus d’importance à la richesse qu’à l’éducation, et au final les dirigeants seront dirigés à partir d’une estimation de la fortune.
En Grèce, la royauté, laissait place à partir du VIIIème siècle, à des systèmes aristocratiques. Très souvent aux mains des Eupatrides qui signifie les « biens-nés », c’est-à-dire la noblesse.
L’exemple le plus frappant est ce qui s’est passé àSparte : du VIIème au IIIème siècle avant notre ère, le régime est de type oligarchique, il s’agit d’une organisation du pouvoir fondée en principe sur l’exercice du pouvoir par quelques-uns qu’on appelle les « égaux » puisqu’ils le sont par la fortune, par l’éducation et par les droits politiques. La particularité à Sparte, c’est que ces égaux sont choisis pour constituer le corps civique au détriment d’autres habitants de Sparte qui vont subir une sorte de déclassement. A côté deces égaux qui gouvernement, on a maintenu deux roisqui n’ont pas le pouvoir strictement décisionnel cependant Sparte est un régime mixte. A partir du IIIème siècle, Sparte qui était pourtant un modèle de cité disciplinée, va se transformer à son tour en ploutocratie.
La république romaine est un régime aristocratique,aux mains de la noblesse sénatoriale qui accaparaitla presque totalité des pouvoirs politiques, régimes oligarchiques.
• Le gouvernement du plus grand nombre.
Hérodote évoque l’isonomie, dans le sens d’égalité dans l’accès au droit, plus généralement dans l’accès aux charges publiques mais le terme apparu au Vème siècle est celui de démocratie. « demos » qui signifie « le peuple » et « kratein »qui signifie « exercer souverainement le pouvoir ».La démocratie est le gouvernement du peuple par le peuple, il occupe à la fois la place de gouverné etde gouvernant. Ce terme de démocratie a été formé pour transcrire l’exercice souverain du pouvoir parle peuple, ce qu’on pourrait aujourd’hui appeler la« souveraineté populaire ».
Les philosophes grecs ont émis sur la démocratie unjugement sévère.
Platon par exemple a sévèrement jugé la démocratie et dans son exposé sur les changements de constitution, il place ainsi la démocratie entre l’oligarchie et la tyrannie.
Les gouvernants vivent dans la richesse et ont laissé se multiplier les oisifs, les miséreux. Les pauvres, découvrant leur puissance du fait de leur nombre vont mettre à mort ou expulser un certain nombre de dirigeants. Puis,ils vont instaurer un régime politique à égalité enintroduisant le recours au tirage au sort. Le régime démocratique sera un régime multicolore pourPlaton, distribuant une certaine forme d’égalité defaçon identique à ceux qui sont égaux et à ceux quine le sont pas. Ainsi le régime démocratique débouche sur la tyrannie. Platon ne pardonne pas et
ne pardonnera pas à la cité d’avoir tué son maître Socrate.
Aristote aussi ne place pas la démocratie dans les formes pures de gouvernement. Quand il parle de démocratie, il emploie le terme de « politéia », ilpréfère évoquer la politéia, ou la république, pourdésigner le gouvernement du grand nombre dans l’intérêt général. S’il utilise le terme démocratie, cela a une tendance à être péjoratif puisqu’il évoque la forme déviée du gouvernement. Aristote assimile la démocratie et la démagogie, c’est-à-dire la démocratie à un système dans lequelle règne des lois est aboli et où l’intérêt personnel du grand nombre se substitue à l’intérêt général.
Cependant ceci se comprend puisqu’on est dans une période du déclin de la démocratie.
Section 2 : la démocratie athénienne.
La démocratie n’est pas une invention de la cité athénienne. D’autres cités grecques ont aussi cettenotion de régime démocratique comme en Ionie par exemple où ce régime a existé avant d’exister à Athènes. La démocratie athénienne est la référence de base en la matière. Athènes à l’époque classiquedomine le monde grec, et est la cité la plus importante. En - 338, Athènes est vaincue par Philippe II de Macédoine. Athènes tente d’exporter son modèle démocratique à partir du Vème siècle. Cette démocratie s’échelonne sur trois siècles : elle se construit au cours du VIème siècle, connait un âge d’or au Vème siècle mais décline au IVème siècle.
Une constitution, quel que soit le régime nait, croit, puis décline & meurt. Il y a une évolution cyclique des constitutions. La souveraineté populaire reste le substrat de tout régime démocratique. Cette souveraineté populaire va impliquer l’égalité dans l’accès aux charges publiques, c’est ce que les grecs appellent l’Isonomia. L’isonomia, c’est l’égalité devant les lois mais va prendre le sens d’égalité pour l’accèsaux charges publiques.
Paragraphe 1 : la reconnaissance de la souverainetédu peuple.
L’isonomie est la condition d’existence de cette souveraineté populaire. Cette isonomie ne va pas desoi, au VIème siècle avant JC, la société athénienne est toujours une société censitaire, c’est-à-dire que la participation au pouvoir est fondé sur le critère de la richesse. Au VIème siècle, ce sont les Eupatrides qui détiennent le pouvoir : ils ont l’éducation mais aussi la fortune. Instaurer une égalité de tous dans l’accèsaux charges publiques n’est pas inné. Au VIIème siècle il y a eu des tentatives faites pour réduireles disparités entre les Eupatrides et les autres, notamment les petits paysans. Ces tentatives viennent de Solon, il a en effet pris un certain nombre de mesures sociales et politiques, et par exemple il a interdit l’esclavage pour dettes. Avant Solon, si on avait des dettes et que l’on n’arrivait pas à exonérer on pouvait être réduit enesclavage pour les payer. Prend des mesures en faveur des paysans. Solon a répartit la population
athénienne en 4 classes, censitaires, en fonction de leur fortune, afin de permettre à tous de participer, de rentrer à l’assemblée populaire. L’assemblée ne sera donc plus réservée aux plus riches, cela permet aux pauvres, aux « thètes », qui n’ont que leur force de travail, de participer à l’assemblée. On ne peut pas encore parler d’isonomie, car globalement la constitution reste censitaire. La véritable isonomie arrive à la fin du VIème siècle avec Clisthène, il pose les bases du régime démocratique entre 507 et 501 avant JC. Prend toute une série de réformes, donne une base aux institutions démocratiques. C’est au Vème siècle que la démocratie atteint son point culminant avec Périclès.
Isonomie = égalité d’accès entre les charges publiques ; concept qui est le concepteur à la fin du VIème siècle. L’œuvre de Clisthène est consolidée par celle de Périclès au Vème siècle.
• La mise en œuvre de l’isonomie
Entre 507 et 501 avant notre ère, Clisthène a proposé à l’assemblée du peuple athénien des projets de réformes visant à inscrire officiellement l’isonomie dans la vie politique. L’idée était d’associer le peuple d’une manière effective à la vie publique. Clisthène propose de réorganiser le corps civique pour permettre à tous les citoyens de prendre part au gouvernement de la cité. Cette possibilité pour chacun sera ensuite poussée jusqu’à son terme par Périclès avec la création du misthos.
Clisthène veut retirer aux grandes familles athéniennes le monopole des charges publiques. Pourcela, il va réorganiser le corps civique et il va réorganiser les cadres politiques. Il va ainsi trouver une nouvelle façon d’organiser, de répartirla population athénienne. Cette organisation sera àla fois géographique et géométrique, ce ne sera plus une organisation fondée sur les liens du sang.Clisthène créée des circonscriptions, et en fonction de la circonscription à laquelle on appartient, on votera à tel ou tel moment au sein de l’assemblée par exemple.
Il y a un premier niveau appelé le Dème qui est la cellule de base, c’est une circonscription purementgéographique : on a pris la ville de la cité (ville+ faubourgs) et on l’a divisé en parcelles ; et chaque citoyen en fonction de son lieu d’habitationest réparti dans un dème.
Au-dessus, on a une circonscription territoriale plus vaste, appelé la trittye. La trittye est un regroupement de 2 dèmes contigus et on sait qu’il ya environ 30 trittyes. La trittye est englobée dansla tribu, et Clisthène crée 10 tribus qui chacune sont aussi des circonscriptions territoriales, et une tribu c’est le regroupement de 3 trittyes. Derrière ceci, il y a la volonté de briser définitivement la domination des anciennes grandes familles d’Eupatrides ; il faut rompre avec le passé, avec ce qu’Athènes a toujours connu. Selon Clisthène cette nouvelle répartition est une étape essentielle pour l’établissement d’un gouvernement isonomique, fondé sur un droit égal pour chaque
citoyen. Dans ces conditions, la politique n’est plus l’affaire de quelques familles seulement, maisest l’affaire de chaque citoyen du dème. Aristote :l’homme est un animal politique. Cela fonctionne dans le système de Clisthène. Chaque citoyen peut prendre part à la vie politique de la cité. C’est par la répartition avant tout géographique que naitla souveraineté populaire. A partir de là, la politique devient une activité permanente au sein de la cité. D’ailleurs, Clisthène pour la première fois va mettre en place un calendrier qui va organiser le temps politique, il organise et prévoit les réunions, la répartition des charges publiques et même leur rotation. Concrètement, ce n’est pas évident à mettre en place : les citoyens ont besoin d’argent cependant ils n peuvent pas participer à la vie politique de la cité puisqu’ilsn’ont pas de temps pour ça, ils doivent travailler pour survivre. Ainsi, on va trouver un désintérêt de la vie de la cité, puisque les citoyens les plus modestes ne vont pas siéger à l’assemblée, malgré les réformes de Clisthène, la politique est encore entre les mains des milieux les plus aisés, les plus fortunés. L’isonomie va être complétée, parachever au Vème siècle par l’institution d’une rémunération des citoyens appelé le misthos.
Le misthos est la rémunération accordée aux citoyens qui exercent certaines charges publiques. Son introduction s’est faite grâce à Périclès, grand homme d’Etat qui va dominer la cité athénienne pendant presque 30 ans. Il est tellementimportant que lorsque l’on parle du Vème siècle quece soit en Grèce ou à Rome, on parlera du siècle de
Périclès. Il était un magistrat et a été élu plusieurs fois stratège. L’idée, c’est que chaque citoyen devait pouvoir participer au dessein de la cité, même le plus modeste paysan ou artisan. Périclès affirme que la politique n’est pas l’affaire d’un clan ou d’une minorité, mais du peuple tout entier. Ce sont les propos de Périclès rapportés par un historien, Thucydide. Périclès instaure ainsi une rémunération, un salaire versé àceux qui participent à la vie politique de la cité.Ce sont les juges qui sont les premiers à recevoir un misthos, pour chaque jour qu’ils passeront au tribunal de l’Héliée. Puis ce seront les membres duconseil de la Boulé qui seront rémunérés (les Bouleutes) puis une grande partie des magistrats. Le seul organe qui échappe au misthos est l’assemblée, l’Ecclésia. Il n’y a pas de rémunération à l’assemblée populaire, à l’Ecclésia,puisque c’est un devoir fondamental pour tout citoyen. Ce n’est pas seulement un droit mais c’estun devoir. Le misthos dans son ensemble est sans doute l’aspect remarquable de l’œuvre constitutionnelle de Périclès. Ce misthos vient contribuer à la mise en œuvre réelle de l’isonomie.Il est, en quelque sorte, décisif puisque c’est grâce à ce misthos qu’on parvient à l’isonomie : ilpermet en effet même aux plus pauvres de participerà la vie politique de la cité et ainsi d’accéder à certaines magistratures. C’est donc une avancée considérable.
Le misthos va changer de destination au IVème siècle : dès la fin du Vème siècle à Athènes, la cité connait une crise ; la démocratie est en crise
et cette dernière est profonde et liée à la guerre du Péloponnèse mais aussi au régime des 30 tyrans en -404. A partir de -403, quand la démocratie revient, on constate que les citoyens se détournent de la vie politique. Pour relancer cet intérêt, on prend une mesureen -393 qui aura un résultat absolument désastreux : on accorde le misthos pour la participation à l’Ecclésia. Seuls les citoyens les plus démunis vont venir siéger à l’assemblée pour percevoir cette rémunération. Ce misthos accordé aux membres de l’Ecclésia devient ainsi un moyen desubsistance. Ce n’était pas une somme très élevée mais pour les citoyens qui n’ont pas de problèmes d’argent, ça ne les intéresse pas contrairement à ceux qui sont dans une pauvreté extrême. On ne voitarriver à l’assemblée que des citoyens extrêmement démunis mais qui ne sont pas plus intéressés que çaà la vie de la cité. On peut alors dire que l’isonomie est pervertie, et que l’assemblée ne représente plus l’assemblée souveraine de la cité, l’ecclésia ne représente plus qu’une foule de personne cherchant à se faire entretenir par la cité. Ces tentatives de mises en place concrètes del’isonomie sont remarquables & sans précédents.
Comment se traduit cette égalité de charge publique ?
• La traduction institutionnelle de l’isonomie.
L’idée, c’est que chaque citoyen puisse accéder à n’importe quelle charge publique quelle que soit safortune. Cette isonomie est bien la condition de gouvernement du peuple par le peuple. Cette
constitution démocratique prend quasiment sa forme avec Clisthène.
Il y a une assemblée populaire, un conseil, des magistrats et un tribunal qui forment la constitution démocratique.
• L’ecclésia.
Ecclésia : terme grec qui signifie assemblée. Sera repris pour le mot « église » qui est l’assemblée des fidèles. Donc l’ecclésia, c’est le peuple assemblé. En principe tous les citoyens athéniens de sexe masculin ont le droit d’y siéger à partir de 18 ans, cependant c’est également un devoir. Ce qu’il faut savoir c’est qu’au Vème siècle avant notre ère, à Athènes, il y a à peu près 45 000 citoyens et chaque citoyen est inscrit dans un dème. Seulement quelques centaines siègent ainsi régulièrement à l’assemblée. On a instauré pour quelques décisions importantes un Corum, par exemple quand la liberté de quelqu’un est en jeu, le Corum c’est à dire 6000 citoyens doivent être présents pour pouvoir prendre des décisions importantes. Il est évident que la plupart des citoyens notamment ceux qui habitent le plus loin ne siègent pas à l’assemblée. D’ailleurs les citoyens se sentent peu concernés par des décisionsqui ne vont pas dans leur intérêt.
Se réunissent sur la colline du Pnix, en face de l’Acropole. Cependant quand ce sont des décisions importantes, se réunissent sur l’Agora, place publique, juridique et économique de la cité. Cette ecclésia se réunit tous les 9 jours au Vème siècle et un ordre du jour est fixé. Les
citoyens ne siègent pas par parti politique comme aujourd’hui mais siègent individuellement.
Le principe fondamental qui règne lors de ces assemblées est la liberté et l’égalité dans la parole, qu’on appelle l’iségorie ou isegoria. Cela veut dire que chaque citoyen a le droit de proposerun projet de loi devant l’assemblée ; mais il a également le droit de s’exprimer avant le vote d’une loi et de proposer des amendements à la loi. Chaque citoyen peut aussi dénoncer tout projet de loi illégal. Ce principe de l’iségorie est fondamental et il est le complément naturel de l’isonomie. Chaque citoyen a autant le droit de participer à l’assemblée et d’y prendre part. C’estune condition véritable de la souveraineté populaire. Le vote se fait généralement à main levée pour des raisons de commodités et de rapiditédans la prise des décisions. Néanmoins il peut arriver qu’ils votent à bulletin secret pour des raisons graves comme la liberté des citoyens. L’ecclésia est un organe de gouvernement direct, cen’est pas une assemblée représentative. L’ecclésiadésigne et contrôle les magistrats mais asurtout le monopole du pouvoir législatif c’est-à-dire du pouvoir de faire la loi, et il y aura une hiérarchie entre ce qu’on appelle le « nomos », quiest la loi organisant la vie de la cité, la loi fondamentale de la cité ; et les décretsétant les décisions concernant les sujets moins importants. S’instaurent avec une prépondérance de la loi, l’assemblée veille au respect de cette hiérarchie des normes, et veille à la légalité de tous les décrets, de tous les projets de loi par rapport à
ces lois fondamentales de la cité. Va s’instaurer une sorte de contrôle de constitutionnalité des lois. L’assemblée a surtout le pouvoir législatif, de faire la loi. L’assemblée a également le monopole de la politique extérieure, c’est l’assemblée qui désigne souverainement de la paix et de la guerre, c’est elle qui intervient pour certaines procédures urgentes quand l’intérêt de lacité est menacé notamment en cas de trahison. C’estl’organe clé de ces institutions démocratiques. L’assemblée fonctionne en permanence grâce à un conseil qui est une émanation directe du corps civique.
• La Boulé.
La boulé est un conseil qui est une représentation restreinte du peuple qui est le démos. Apparemment la boulé est l’œuvre de Clisthène. Il y a en tout 500 Bouleutes à raison de 50 par tribu. C’est là qu’on voit la quintessence de la démocratie puisqu’ils sont tirés au sort, quelle que soit leurfortune. On peut être membre du conseil que 2 fois dans sa vie pour permettre à tout le monde de l’être au moins une fois et pour éviter que cette fonction devienne permanente. Les bouleutes ne sontmembres du conseil que pendant un an. La boulé est censée gérer les affaires de la cité jour & nuit. Les conseillers ne peuvent pas être disponibles jour & nuit pendant un an donc le travail est réparti. L’année est ainsi divisée en 10 périodes de 36 jours ; ces périodes sont appelées des pritannyes. Il y a donc une rotation, 50 bouleutes choisis d’une tribu vont assurer leur fonction
pendant une pritannye. Quand c’est leur tour d’êtreeffectivement conseiller, prennent le nom de « prytane » (« le premier de la cité ») ; chaque jour, pendant ces 36 jours, ils tirent au sort un chef parmi eux, qui va avoir un nom particulier quiest l’épistate des prytanes. Sont mobilisés pendantun an même s’ils travaillent 36 jours ; pour les aider on leur a donné le misthos. Ces hommes prêtent serment de respecter la constitution démocratique.
Le rôle de la Boulé est de préparer les décrets, les projets de loi qui seront soumis à l’approbation populaire lors des séances de l’assemblée. A ce stade là on parle de « probouleuma » qui sont donc rédigés par le conseil, par la boulé. Ce conseil est également l’organe de liaison par excellence entre l’ecclésiaet les magistrats. La boulé va exercer un étroit contrôle de l’action des magistrats donc la boulé va vérifier en amont qu’un candidat à une magistrature n’a pas fait l’objet de poursuites pénales par exemple, et plus généralement la boulé vérifie que certaines conditions de moralité soientremplies (des candidats mais aussi de sa famille, sur 3 générations). Une fois que les magistrats sont désignés, doivent rendre des comptes à la boulé, qui vérifiera aussi la gestion des deniers de la cité.
• Les magistrats.
Il s’agit là d’un sorte de « reste » des vestiges d’un ancien pouvoir, néanmoins on est dans un régime démocratiques et même si les magistrats ont
un pouvoir du passé, les magistrats sont en régime démocratique les délégués du peuple, c’est pour cela qu’on dit qu’ils participent à la souverainetépopulaire. Concernant leur mode de recrutement ; une fois que le contrôle de moralité a été fait ; il y a un tirage au sort effectué pour l’élection d’un même magistrat. Le premier tirage au sort se fait d’abord au niveau du dème puis au niveau de latribu, il n’y a aucune condition de cens, de la fortune, aucune condition de naissance qui ne soit requise. N’importe qui peut devenir magistrat il faut juste une grande moralité. Perçoivent aussi lemisthos pendant qu’ils sont en fonction. Les pouvoirs des magistrats vont être limités ; la magistrature ne dure qu’un an ; il y a trois principes :
• Principe de l’annualité : il est interdit d’exercer deux fois de suite la même magistrature. Exception flagrante qui est cellede Périclès puisqu’il a été élu plusieurs fois stratège.
• Principe de la collégialité, c’est-à-dire que le magistrat n’est pas isolé, il y a àAthènes un collège de 10 stratèges, donc le magistrat à des collègues qui occupent la même fonction que lui, cela implique l’égalité entreles magistrats d’un même collège, ce qui limitele pouvoir de chaque magistrat.
• Principe de la spécialisation, c’est-à-dire que chaque magistrat au sein de chaque collège à un pouvoir précis.
Exemple : pour le collège des archontes, il y a l’archonte roi, qui s’occupe des questions religieuses. Il y a aussi un archonte polémarque, qui s’occupe des litiges avec les étrangers, etc.
Chacun a donc une fonction bien particulière. En plus de cela, les magistrats vont faire appliquer les lois et ont le pouvoir de traduire devant un tribunal ceux qui ne respectent pas les lois. Concrètement, ces magistrats sont les éléments les plus contrôlés de la démocratie. Ne peuvent pas s’adresser directement au peuple, à l’assemblée, doivent toujours passer par l’intermédiaire du conseil ; et tous les mois ils doivent être confirmés dans leurs fonctions par l’ecclésia. On peut affirmer que l’élément dominant dans la constitution athénienne est le démos, le peuple, assemblé au sein de l’ecclésia.
• Le tribunal populaire de l’Héliée.
L’Héliée est donc un tribunal créée par Solon et cetribunal est une émanation de l’ecclésia ; au sein de l’ecclésia on tire au sort les membres au nombre de 6000 chaque année pour en faire des juges du tribunal de l’Héliée. Cependant pour être jugé tiré au sort il faut avoir plus de 30 ans. Les 6 000 Juges se répartissent en 10 tribunaux.Perçoivent le misthos, et à leur entrée en fonction, ces juges appelés les Héliastes prêtent un serment dans lequel ils s’engagent :
• à respecter la constitution et les lois ;
• à ne pas prononcer l’abolition des dettes privées ;
• à ne pas rappeler les bannis, ni d’ailleurs à prononcer injustement la peine du bannissement ;
• ne pas recevoir de cadeaux pour ne pasêtre corrompus.
L’Héliée va être compétente pour les actions privées et pour les actions publiques. La procédureest accusatoire, chaque citoyen peut dénoncer un manquement au nomos, à une des lois fondamentales de la cité. Si le citoyen qui dénonce échoue, il paie une amende et s’il réussit, perçoit une partie de la condamnation. L’instruction est faite par un magistrat et une fois l’instruction terminée c’est au tribunal de trancher, de décider et à partir de ce moment-là ladécision est rendue par le tribunal et souveraine, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de recours possible.
Paragraphe 2 : la préservation de la souveraineté du peuple.
C’est là toute l’originalité de la Constitution démocratique. La Constitution athénienne a prévu des gardes fous contre toute atteinte à la souveraineté populaire pour la préserver. Il s’agitd’écarter de la cité de manière provisoire ou définitive tout citoyen qui pourrait représenter undanger pour la démocratie. Le peuple se protège contre lui-même et ces mécanismes constituent un contrepoids à l’isonomie et à l’iségorie. Il existetrois procédures faites pour préserver la démocratie.
• L’ostracisme.
C’est une procédure propre à la démocratie athénienne qui permet d’exiler pendant 10 ans un citoyen sans confiscation de biens. Au terme de ce délai, le citoyen exilé peut revenir à Athènes sansêtre inquiété. Le terme vient du grec « ostrakon »,qui est un petit tesson de terre cuite sur lequel les membres de l’Ecclésia écrivent le nom d’un suspect.Clisthène aurait inventé cette procédure pour protéger le régime démocratique de toute tyrannie. C’est une procédure atypique puisque techniquement ce n’est pas un procès, même si la personne est bannie. Celui qui est frappé d’ostracisme ne peut pas se défendre et d’ailleurs,on ne connait son nom qu’à l’issu du vote. Tous lesans lors de la sixième prytanie, l’Ecclésia se prononce sur l’opportunité ou non de mettre en œuvre une procédure d’ostracisme : on voit s’il y aun danger quelconque qui menace la cité. Si la majorité est pour la procédure d’ostracisme, celle-ci a lieu lors de la huitième prytanie. C’est là que chaque citoyen présent à l’Ecclésia écrit le nom de quelqu’un s’il estime que cette personne estdangereuse pour la démocratie. Il faut 6000 présents ce jour-là pour que le vote soit pris en compte. Les noms des personnes inscrites étaient généralement des noms d’hommes politiques de premier plan. Exemple : en -482 ; est ressorti le nom d’Aristide, il avait eu le malheur de critiquerun projet militaire.
La procédure d’ostracisme devient une arme politique efficace et réelle qui est entre les mains des grandes familles, qui ont des influences.Mise en place d’un sorte de système de clientèle :
les personnes les plus influentes vont demander à leurs « clients » de voter comme eux, c’est-à-dire d’éliminer ainsi un quelconque ennemi de la grande famille. C’est donc l’arme des grands contre les autres grands. C’est une lutte pour la prééminence politique. Initialement, la procédure est censée protéger le régime mais cela a un effet pervers : en effet l’homme politique peut ainsi faire éliminer un rival grâce à ce système de procédure.
• La graphé paranomon
La graphé paranomon est une sorte de contrôle de constitutionnalité des lois. Graphé = idée d’actionintentée dans un procès publique. C’est une action qui a été créée par Périclès au Vème siècle qui répond à un soucis de garantir la stabilité des lois et d’empêcher le vote de décret ou de projet de lois qui seraient contraires aux lois fondamentales de la cité, au nomos. Dans les faits c’est la traduction de la supériorité du nomos sur les décrets et les projets de loi. C’est une actionpopulaire qui permet à n’importe qui d’attaquer l’auteur d’un projet de loi ou d’un décret avant même que ce projet n’ait été voté par le peuple. Onaccuse l’auteur de ce texte d’avoir transgresser les lois fondamentales de la cité. Action qui peut avoir lieu après le vote du texte dans un délai d’un an. C’est le tribunal de l’Héliée qui est compétent. Si l’accusateur obtient gain de cause, le projet de loi n’a pas lieu. L’accusé reçoit soitune amende plus ou moins forte selon le cas. Après trois condamnations par cette action illégale, le citoyen en question est frappé de l’atimie, qui est
une peine lourde qui correspond à la fois à une dégradation civique, à une confiscation des biens et un exil définitif obligatoire.
• L’Eisangélie
L’eisangélie signifie littéralement la dénonciation. C’est une procédure qui vise à réglerdans l’urgence une situation jugée grave ou dangereuse pour la démocratie. Il faut, pour qu’il y ait eisangélie, qu’il y ait eu une atteinte graveà la sureté de l’état et il faut qu’il n’y ait pas de loi prévoyant la punition de ce type de fait. C’est une action populaire et peut frapper aussi bien un magistrat qu’un particulier. C’est une accusation portée devant l’ecclésia justement pcq la situation ne semble pas prévue par une loi existante. L’assemblée va voter et on voit si on poursuit la personne qui a commis l’action dangereuse pour la cité. Si l’assemblée décide qu’il faut poursuivre l’affaire est confiée à la Boulé, chargé de qualifier juridiquement les faits et de proposer une peine. On est qu’au stade de la proposition et soit c’est l’assemblée qui tranche si coupable ou non soit l’affaire est renvoyée à l’Héliée, mais le plus souvent c’est l’assemblée qui juge. Ici, c’est un procès ; les peines encourues sont graves : soit ce sont de fortes amendes mais la plupart du temps la peine encourue est la peine capitale. Procédure la plus terrible et elle introduit la rétroactivité de la loi pénalepour la sanction. Cette procédure est donc une armeredoutable. Ex : ex -406 ; contexte : guerre du
Péloponnèse, une partie de la flotte athénienne estbloquée dans un port par les Spartiates. Pour dégager cette flotte, les stratèges athéniens montent une opération militaire qui réussit. Mais juste après, grosse tempête et les bateaux font naufrage, et beaucoup de marins meurent noyés. Les stratèges rentrent à Athènes, font l’objet d’une procédure d’eisangélie. On leur a reproché d’avoir détourné les fonds de la cité pour cette opération militaire. Accusation portée sur les stratèges collectivement. Parmi les membres du conseil, Socrate est contre cette procédure, mais il est seul et son action reste vaine et tous les stratèges athéniens sont finalement condamnés à mort. Ces procédures sont initialement faites pour protéger la cité, la citoyenneté populaire mais peuvent être détournées. Dès le IVème siècle les procédures contribuent au déclin du régime démocratique.
Paragraphe 3 : le déclin de la démocratie.
Vème siècle : âge d’or de la démocratie athénienne.La démocratie est le régime idéal qu’il faut exporter dans le monde grec. Puis aussi, on se rendcompte que le fonctionnement de la démocratie est extrêmement couteux : il faut financer le misthos, et il faut aussi trouver de l’argent. Se développe ainsi l’impérialisme athénien (on exporte le modèleathénien et on a besoin d’argent). Athènes veut partir à la conquête de d’autres territoires. L’impérialisme athénien prend racine dans la ligue de Délos. Au milieu du Vème siècle, Athènes essaie d’importer sa domination aux cités de la ligue.
Ainsi en -454, on transfère le trésor de Délos à Athènes. A partir de là, la Boulé fixera la tribu àpayer par les cités de la ligue. Athènes s’empare du trésor pour détourner les ressources de la ligue, c’est un pillage économique des autres citésde la ligue de Délos. L’impérialisme athénien est un impérialisme économique qui va servir à financerla démocratie athénienne. Il faut être honnête, la démocratie a un prix. Cette attitude est devenue insupportable pour les autres cités grecques. Donc il va y avoir une guerre entre Sparte et Athènes qui est la guerre du Péloponnèse, en -431. Cette guerre dure presque 30 ans. Il y a un impérialisme athénien qui s’explique par des besoins économiques. Ceci entraine le déclin de la démocratie. Pour illustrer un des aspects de l’impérialisme athénien : discours de Périclès poursaluer les morts à la guerre. Périclès, dans ce discours se fait l’avocat de la démocratie athénienne. Il souligne que le véritable éloge des victimes de la guerre est l’éloge des institutions pour lesquelles les victimes ont donné leur sang. Périclès commence par souligner l’originalité et l’exemplarité du régime. Il y a deux principes fondamentaux qui gouvernent la démocratie athénienne : l’iségorie et l’isonomie. Puis une fois ceci fait, il vante les mérites de la fraternité et de la philanthropie qui est présent dans le régime athénien, il dit qu’il y a un équilibre entre les citoyens. Périclès met en avantles qualités qui expliquent que pour lui, Athènes est un modèle pour les autres cités grecques. Il fait un éloge de la démocratie athénienne. Cependant, ceci ne doit pas nous tromper : dans les
faits ce n’est pas la réalité. Quoiqu’il en soit, la guerre du Péloponnèse emporte la démocratie athénienne qui va être remplacée par un gouvernement oligarchique dès -404 par le régime des 30 tyrans ; cependant ce gouvernement oligarchique ne dure qu’un an puisqu’en -403 la démocratie revient et est considérée comme la seuleforme viable de gouvernement. La démocratie athénienne ne sort pas indemne de la guerre du Péloponnèse. La défaite d’Athènes symbolise le rejet et l’échec du modelédémocratique dans le monde grec. A partir de cette défaite, le peuple athénien se désintéresse de la politique, l’ecclésia est quasi déserte.
-393 : misthos instauré pour les membres de l’assemblée. Cette mesure est un échec parce que seuls les plus pauvres viennent siéger. En cet IVème siècle on peut dire que l’assemblée est l’ombre d’elle-même, manipulée, peuplée de parasites. L’intérêt de la cité passe au second plan. En plus de tout cela, le misthos est impossible à financer. Il faut des revenus supplémentaires : Athènes connait un nouvel impérialisme. C’est donc le déclin du régime démocratique après l’apogée du Vème siècle. A partir de là, la cité démocratique athénienne a tendance à se caractériser par les dérèglements de la souveraineté populaire et laisse deux souvenirs funestes : - l’injuste procès issu de la procédure d’eisangelie infligée aux stratèges de la guerre du Péloponnèse et – la condamnation à mort de Socrate en -399. Il a été accusé d’impiété et de corrompre la jeunesse. Le tribunal se prononce en faveur de sa mort, il refuse de
s’enfuir et accepte la condamnation. Il boit ainsi le poison, l’assigue. C’est un geste fort qui prouve qu’il accepte sa mort puisqu’il témoigne ainsi de son attachement à la cité, et de son attachement au nomos. A partir du IVème siècle, la démocratie athénienne ne sera plus jamais la même, ce sera une forme atténuée. Système perverti, déréglé, et le système démocratique est ainsi critiqué par les auteurs comme Aristote, Xénophon…
Philippe II de Macédoine : bataille de Chéronée en -338.
Section 3 : la Res Publica Romaine ; les balbutiements de l’Etat.
La grande particularité des romains, est qu’ils sont à l’origine de la notion d’Etat ; Etat en tantque politique abstraite. L’Etat, qui représente juridiquement une société donnée. Cet état a pour nom la respublica chez les romains que l’on peut traduire par la chose publique. C’est un concept qui traduit la permanence de l’état romain. La respublica connait une grande période au Moyen Age,puisqu’il servira à construire juridiquement le pouvoir royal, des rois francs. C’est un concept abstrait, mais le régime politique concret qui durede -509 à -27.
Paragraphe 1 : Elaboration progressive de la Constitution.
A l’origine, lors de sa construction hypothétique en -753, Rome est une monarchie, 7 rois se succèdent et le premier est Romulus, qui aurait tracé un sillon représentant l’enceinte de la cité
de Rome. A partir de -753, on a une monarchie jusqu’en -620 ; l’effectivité du pouvoir appartientà quelques grandes familles romaines appelées les « Gentes » qui signifient « gens » = « famille ». On peut aussi parler des « patres » ; « pater » signifiant « le père ». Le pouvoir est aux mains dequelques grandes familles qui se réunissent au seind’une assemblée qui est le Sénat. A partir de -620,le pouvoir passe aux mains des rois étrusques ; reprennent le pouvoir au détriment des grandes familles, des patres. Ce sont les rois étrusques qui posent les bases de la constitution romaine. Leroi à partir de -620 est détenteur d’un pouvoir de type nouveau : l’imperium, qui est un pouvoir suprême de commandement. Ce pouvoir a une dimensioncivile et une dimension militaire. L’origine de ce pouvoir ne vient pas du peuple, ni des grandes familles romaines, mais résulterait par la prise d’hospices, qui est la consultation de signes divins, par exemple en regardant les oiseaux dans le ciel. La volonté divine est une nouvelle justification de pouvoir, qui procède d’un acte sacré. C’est une innovation forte, le pouvoir royalest rattaché à la sphère divine. Ensuite, autre création fondamentale : le populus, le peuple, qui apparait en tant qu’entité politique. Le peuple estdivisé, réparti en différentes classes. Cependant, cette répartition intervient selon la fortune des gens : répartition militaire avant tout selon le degré de fortune nécessaire pour se payer l’équipement militaire.
Classement militaire selon la fortune, on se sert de ce classement pour créer une assemblée qui aura
vocation pour voter la loi. Autre division de la population et chaque citoyen sera attaché à une tribu selon son lieu de résidence.
Rois forts au pouvoir mais cela ne plait pas aux grandes familles, ni aux sénateurs car cette monarchie personnelle les prive du pouvoir. Les sénateurs renversent la monarchie en -509 en prétextant rendre la liberté au peuple. Avènement de la république en -509 : nouvelle constitution, caractérisée par le fait qu’on retrouve l’imperium qui est dédoublé, confié à deux magistrats (hommes politiques) qu’on appelle les consuls. Ces deux consuls ont tous les deux un pouvoir suprême complet, sont tous les deux égaux, c’est le principe de la collégialité. Soit se relaient pour commander, soit un s’occupe des affaires de la ville et l’autre des affaires de l’armée. Ont tous les pouvoirs du roi étrusque sauf le pouvoir religieux, mais ont tout de même le droit de consulter les hospices (vient de Auspicium). Petit à petit, la constitution républicaine s’enrichit de nouvelles magistratures.
Les nouvelles magistratures romaines :
• Le dictateur.
Le dictateur est un magistrat extraordinaire. Il est nommé par les consuls en cas de péril de l’état, en cas de grave danger pour une durée de 6 mois maximum. Situation très particulière parce quenormalement une magistrature dure un an. Le dictateur, quand il est nommé, exerce seull’imperium, et les autres magistratures sont
suspendues. C’est une des premières magistratures crée après les consuls. Tombée en désuétude au 2ème siècle avant JC car Rome est à l’abri de toute mesure anti discrétionnaires. Au premier siècle avant JC, la dictature est déclarée comme anticonstitutionnelle.
• Les deux censeurs.
Renouvelés tous les 5 ans. Sont chargés du recensement, c’est-à-dire que ce sont eux qui vont répartir les citoyens dans les différentes centuries. Au départ on est classés selon le régimemilitaire par centuries. Les censeurs sont chargés de répartir, de voir cmt sont répartis les citoyensen fonction du cens, de la fortune de chacun ; et àl’occasion ces censeurs peuvent intégrer dans tel ou telle catégorie un étranger éventuellement. Vérifient la population et y mettent de l’ordre. Ils occupent la fonction 18 mois et à ce terme il ya un grand sacrifice de purification organisé, on appelle ça le Lustrum. Un lustre est une période de5 ans. La fête rétablie la cité dans son intégrité religieuse. Les censeurs doivent également dresser la liste des membres du Sénat, à partir de 318 avant notre ère. Si juge indigne peuvent lui infliger un blâme.
• Les préteurs.
Ceux qui sont chargés de rendre la justice en 367 avant JC. Le préteur est un magistrat supérieur tout comme le consul. Il a à peu près les mêmes pouvoirs que le consul, sauf qu’il ne présidera pas
les assemblées. Litige avec les étrangers : préteurpérégrin ; sinon c’est le préteur urbain.
• Les édiles.
Ceux qui gèrent la ville de Rome, sont chargés de l’approvisionnement de la ville, sont chargés de lapolice, des marchés.Tout ce qui touche à la ville et à son organisation. Il y a un édile par quartier. A l’origine les édiles sont ce qu’on appelle des Plébéiens, c’est-à-dire qu’ils ne font pas partie de la noblesse romaine, et ce n’est qu’à partir de 367 avant JC qu’on pourra trouver des édiles qui sont nobles. Mais l’édilité fonctionne à l’inverse des autres magistratures : la plupart des autres sont des magistratures qui initialement étaient réservésaux nobles, aux praticiens puis qui se sont ouvertsaux Plébéiens. Ici c’est l’inverse ça s’est ouvert au Patriciens.
• Les questeurs.
Ceux qui administrent les finances, recueillent desimpôts, tiennent la comptabilité. En pratique ce sont les agents d’exécution des charges financièresde l’Etat. Il y a 4 questeurs à partir de 267 avantJC.
• Le sénat.
Le sénat demeure l’élément conservateur de la constitution et va très vite devenir prééminent. Lesénat romain est composé de 300 membres. Mais ils ne sont pas toujours tous présents. A l’origine le sénat était une assemblée des membres des grandes familles. Puis les sénateurs vont être désignés par
les consuls ; et puis surtout à partir de 313 avantJC sont censés dresser la liste des sénateurs et sefera alors un classement des sénateurs avec un risque de voir disparaitre sa charge. La charge de sénateur n’est alors plus une dignité à vie. Tous les 5 ans, à chaque lustre, la liste sénatoriale est soumise à révision, en théorie. Dans les faits il n’y avait pas de révolution extraordinaire ni derenouvèlement donc des listes sénatoriales. D’une manière générale, on se rend compte avec le temps que les sénateurs sont alors des anciens magistrats. Le sénat est un organe extrêmement hiérarchisé. Il y a le « princeps senatus » ; ce qui signifie, le premier du sénat ; le président.
Le princeps senatus est le premier inscrit sur l’album sénatorial. En dessous les sénateurs sont classés selon les fonctions qu’ils occupaient. Sontd’abord inscrits les anciens dictateurs, les anciens consuls et les anciens préteurs. On trouveles anciens édiles puis les anciens questeurs à la fin de la liste. Ces sénateurs sont censés être d’une dignité irréprochable, sont censés servir de modèle. Durant les séances du Sénat, les sénateurs devaient adopter un code de conduite particulier. Les jeunes romains de la haute société assistaient aux séances du Sénat pour apprendre à se conduire. Le sénat romain est censé représenter à la fois la grandeur et la dignité de Rome. Tous les hauts magistrats peuvent consulter lesénat, les consuls, les préteurs mais également les tribuns de la plèbe. Les tribuns de la plèbe sont les magistrats réservés aux plébéiens. Le sénat ne peut pas se réunir de son propre chef. C’est un magistrat qui préside la séance et qui va demander aux sénateurs
leurs avis un par un. On laisse parler les sénateurs autant qu’ils le désirent. Le magistrat prend la décision de cesser d’interroger les sénateurs lorsqu’ils estiment avoir suffisamment d’avis. A partir de ce moment-là, on procède à un vote et ceux qui n’ont pas été entendus, doivent seranger derrière le sénateur qui a la même idée qu’eux. On les appelle « pédarii » ; puisqu’ils votent avec leurs pieds puisqu’ils se déplacent pour voter. Ainsi, le magistrat prend l’avis du sénat, un acte est ensuite rédigé, cet acte s’appelle un « senatus consulte ». Il y a des dérives dans ce type d’assemblée. Certains en profitent pour parler longtemps afin de reporter laséance au lendemain ou juste de retarder le vote. On pratique beaucoup l’absentéisme aussi. Les décisions prises au sénat sont très importantes, les sénatus consultes sont des avis mais traduisentune « auctoritas », qui serait une sorte d’autoritémorale. C’est justement parce qu’il est doté de cette autorité que l’avis qu’il rend a une certainevaleur, même s’il n’est pas obligatoire de prendre l’avis du sénat, on se rend compte que son influence est telle que les projets de lois passentdevant le sénat. S’il désapprouve un texte, ce texte ne deviendra pas une loi. Le sénat, par son autorité morale, augmente la portée des actes juridiques qu’on lui propose, ce qui fait de lui letitulaire d’un pouvoir normatif qu’a priori il ne porte pas.Le sénat est un organe de conseil mais doté d’une autorité morale tellement importante qu’en pratique son avis est fondamental. Pouvoir normatif terriblement important. Il a également haute main sur les finances de la république, il
maitrise les recettes et les dépenses. C’est le Sénat qui, tous les ans, autorise la levée des impôts. Ce sont donc les magistrats qui prendront le relai par la suite mais au-dessus le sénat décide tout de même de la levée des impôts. Le Sénat incarne Rome avec le peuple mais aussi avant le peuple. Initiales SPQR de Rome ; « Senatus Populus Quo Romanus » : le Sénat est le peuple de Rome. Dans la constitution Romaine, on a ses deux entités, le sénat et le peuple qui devraient être àégalité. Mais dans les faits le sénat est prédominant.
Le populus, va êtrereprésenté par des assemblées appelées à Rome des comices. Les comices sont les assemblées du peuple romain dans son ensemble. Il ya différentes comices.
• Comices curiates : ce sont les plus anciens. A partir du IVème siècle avant JC, n’ont plus que des attributions résiduelles. Onne s’en occupera plus dans la constitution romaine.
• Comices centuriates : ici c’est la fortune, la richesse qui va être prise en compte pour la composition de cette assemblée. Au sein de cette assemblée, les représentants sont partis en différentes classes ; selon la fortune de chacun. On reprend la distinction initiale de la population romaine en centuries,et toutes ces centuries sont regroupées en 5 grandes classes :
La première est celle des plus riches ; votent en premier. Puis celle des prolétaires.
Les comices centuriates vont élire certains magistrats, consuls et préteurs, ces comices sont chargés de déclarer la guerre mais en fait celle-ciémane d’une décision politique du sénat. Ils ont une compétence législative, ont surtout un rôle judiciaire pour les crimes les plus graves. Il y a une sorte d’appel au peuple qui va apparaître dès la fin de la IVème république. Tout citoyen romain condamné à mort peut en appeler au peuple réuni lors des comices centuriates. Ce sont les comices les plus importants.
• Les comices tributes ; apparaissent dès le Vème siècle, soit avec l’apparition des institutions de la Plèbe, soit avec une loi quidate de 449 qui s’appelle la loi Valeria Horatia. Cette assemblée la est censé être une assemblée égalitaire. Cette assemblée élit les magistrats inférieurs, notamment les édiles, les questeurs, mais ils élisent également le tribun de la plèbe, en gros c’est le magistrat de la plèbe. Leur principale attribution est levote des lois et viennent concurrencer sur ce point les comices centuriates. Va se confondre avec l’assemblée qui initialement était dédiée à la plèbe et qu’on appelle le consil de la plèbe.
Dès -494 la plèbe va se mettre à revendiquer un pouvoir politique. La plèbe va s’insurger contre latoute-puissance des patriciens. Va finir par se poser comme une force politique réelle qui
représente tous les exclus du pouvoir. A force de s’insurger, la plèbe va obtenir ses propres institutions. Il va y avoir des tribuns de la plèbequi sont l’équivalent des magistrats, il va y avoirune assemblée propre à la plèbe qui est le consil de la plèbe. Ce consil de la plèbe va avoir la propriété de prendre des lois applicables à la plèbe appelés des plébiscites. Ce n’est qu’en -286 que les plébiscites deviennent assimilables à des lois ; grâce à la loi Hortensia ; assimilation des plébiscites aux lois. Dès le Vème siècle la plèbe commence à revendiquer un rôle politique à part entière. La constitution romaine est scindée entre les institutions patriciennes et les institutions plébéiennes. Ce n’est que peu à peu que les plébéiens pourront avoir accès aux institutions patriciennes. Pour finalement trouver une égalité dans cette société. Société de type oligarchique qui a tendance àprivilégier les patriciens.
La république romaine regroupe en un seul régime une réalité très complexe ; c’est un régime qui au départ conserve les bases constitutionnelles de la cité telles qu’elles avaient été imposées par les anciens rois. Au départ on supprime le roi et petità petit on intègre les institutions de la plèbe, mais cette intégration dure de -494 à-376 voire-286. Puis en 27 avant JC, c’est le passage à l’empire, et là Auguste se présente comme le libérateur et comme le restaurateur de la république romaine.
La réflexion politique àRome est tardive et va se développer à partir de la pensée politique grecque.
A partir du moment où il découvre les écrits des philosophes grecs les romains les récupèrent et font des analyses juridiques. Comme celle de Cicéron,qui le premier donne une définition de la chose publique ; la res publica.
Polybe est un grec qui s’est installé à Rome.
Paragraphe 2 : l’idéal de la constitution mixte.
Polybe est né aux alentours de 200 avant JC ; né dans la région du Péloponnèse. Appartient à une famille aristocratique ; on sait de lui qu’il a joué un rôle politique important, lors du conflit qui opposa Rome à la Macédoine entre 171 et 168 avant JC. En plein conflit, Rome remporte un certain nombre de victoire en 168 de Pydna. A ce moment-làPolybe va être déporté àRome avec 1000 autres notables ; va y rester 17 ans et va ainsi fréquenter les membres de l’aristocratie romaine. N’est pas censé quitté Rome mais y reste dans de bonnes conditions. Puis aura le droit de rentrer chez lui et quand il en aura le droit, reviendra quand même àRome, et mourra vers 120 avant JC d’unechute de cheval. Un peu sur le modèle d’Hérodote, va écrire des histoires qui vont raconter les événements survenus à Rome du début de la seconde guerre punique, qui a duré de 218 à 201 avant JC ; jusqu’à la fin de la troisième guerre punique en 146. Polybe devient ainsi l’historien de Rome.
Dans ces histoires, va nous expliquer clairement pourquoi le régime romain est supérieur aux autres.C’est notamment dans le livre 6 qu’il nous raconte cela, et c’est là qu’il distingue trois formes de
gouvernement purs : la monarchie, l’aristocratie etla démocratie. Après avoir opéré cette distinction,va nous montrer comment une évolution fatale conduit chacun de ces régimes à une forme corrompue. Evolution cyclique des régimes, un cyclede transformation des constitutions qui existe. Pour Polybe le premier régime est la monarchie, mais le monarque à tendance a abusé de ses pouvoirs ; mais va se transformer en tyran. Puis certains citoyens valeureux vont chasser le tyran ;et c’est bientôt une aristocratie qui apparait. Cependant se transforme en oligarchie ; ensuite renversée par le peuple, qui va fonder la démocratie. La démocratie, régime pur, à son tour va dégénérer en démagogie ou plus exactement selon Polybe en ochlocratie ; vient de « okhlos » qui signifie la « foule ». Il y a ici une vision péjorative de Polybe. A la longue l’ochlocratie sera remplacé par le gouvernement d’un seul et doncune monarchie et le cycle des constitutions revientà son point de départ. De ce cycle des constitutions, Polybe déduit une instabilité des constitutions.
Création de régime mixte. Polybe explique que le meilleur gouvernement n’est pas celui qui s’en tient à une forme pure, c’est celui qui concilie demanière harmonieuse les différentes formes pures. En brefc’est un régime mixte. Toujours selon lui, c’est la constitution romaine qui serait le mieux parvenue à cet équilibre, puisqu’elle n’est ni monarchie ni aristocratie ni démocratie mais tout cela à la fois. Il explique qu’il s’agit d’un régime de véritable conciliation des institutions.
Exemple : parle de la guerre, qui est décidée par le peuple, conduite par les consuls sous le contrôle du sénat. Cela montre bien que chaque pouvoir a besoin des autres pour fonctionner. C’estgrâce à cet équilibre entre les pouvoirs que les régimes mixtes peuvent échapper au cycle des constitutions ; tout principe dans ce type de régime est contrebalancé par un principe contraire qui l’empêche de dégénérer.
En résumé, Polybe dresse un éloge de la constitution romaine. Polybe ne dit rien des institutions de la plèbe, qui pourtant à la date à laquelle il écrit font partie intégrante de la constitution romaine. L’harmonie décrite par Polybeest quelque peu abusive puisque la république romaine est un régime aristocratique. A l’époque dePolybe, la cité républicaine, est devenue une véritable oligarchie. La réalité du pouvoir appartient à unenoblesse qui monopolise les magistratures et domine le sénat. À l’époque à laquelle Polybeécrit, dit que la fracture n’est plus seulement politique, mais se situe entre les optimates, et les humiliores. Ce n’est plus une rupture entre patricien et plébéiens, c’est une rupture entre ceux qui se considèrent comme les meilleurs de la société et les autres, les plus humbles. Cette noblesse n’est plus la noblesse d’origine de Rome puisqu’il y a maintenant des plébéiens qui se considèrent alors comme les meilleurs, les plus instruits, les plus fortunés. Apparait une autre réalité : c’est une période pendant laquelle il y a quelques individus qui se considèrent comme des personnages de premierplan et qui vont se considérer comme chef d’une faction. A l’époque oùPolybe écrit on est dans les
prémisses de la crise romaine. On a un certain nombre qui ont tendance à vouloir prendre le pouvoir pour servirleurs propres ambitions. C’est une société avant tout oligarchique, mais dans l’analyse de Polybe il faut peut-être voir une miseen garde contre les dangers qui menacent une république dominée par l’aristocratie pcq Polybe sait qu’un régime aristocratique va dévier de manière obligatoire à cause de l’année cyclique desconstitutions sur une ochlocratie. Polybe sent que le régime romain est menacé. Il encense le régime en mettant un avertissement pour espérer faire remettre les romains dans le droit chemin pour qu’ils aient un régime parfait pour éviter que Romedevienne dans un régime dégénéré.
Paragraphe 3 : la respublica de Cicéron
Cicéron est un provincial puisqu’il est né à une centaine de kilomètres de Rome. Il est né aux alentours de 106 avant notre ère. Ce qui le caractérise, c’est qu’il n’est ni Plébéiens, ni Patricien. Il est issu d’une famille bourgeoise, ilest un homme nouveau. Cicéron est un brillant avocat mais c’est aussi un homme politique. Il a gravit les différents degrés de la magistrature romaine : questeur puis édile puis préteur et est devenu consul en 63 avant notre ère, et on peut ainsi dire qu’il est au sommet de sa carrière politique. Très rapidement il prend une retraite politique anticipée. C’est à partir de ce moment-làqu’il rédige deux importants traités de science politique mais dans un contexte pour lui de déceptions et d’angoisse puisqu’il craint pour sa
vie. Cicéron vit, écrit, fait de la politique dans une période difficile pour Rome : depuis la secondemoitié du 2ème siècle avant JC, Rome, la Républiqueest en crise et on a un écart toujours plus grand qui oppose le plus grand nombre de la population etquelques-uns qui se distinguent. Il y a donc des clivages sociaux de plus en plus nets entre le Populares (masse de citoyens) et ceux qui sont au dessus socialement appelés les Optimates. Ce clivage social persiste et c’est une époque à laquelle on commence à prendre l’habitude que certains individus, de grands généraux la plupart du temps, se mettent à exercer le pouvoir dans leurplus grand intérêt, donc quasiment dictatorial : Marius, grand vainqueur de cette guerre civile, puis Sylla, qui instaure une dictature soit disant pour restaurer la République. En vain, on aboutit alors au premier triumvirat en -60.
Le triumvirat est une association de trois personnes, qui sont un militaire, un général Prestigieux du nom de Pompée et Crassius, et César.Ces trois hommes se partagent alors le pouvoir. Crassius meurt en -53 et laisse alors Pompée et César face à face, et leurs ambitions respectives déclenchent une nouvelle guerre civile. Cette guerre est gagnée par César et meurt assassiné en -44. Dans ses fonctions de consul, Cicéron parvient à s’assurer l’hostilité du triumvirat, et s’auto-exile en -58. Il quitte Rome pour sa vie, part dansson village natal et reviendra un an plus tard à Rome, il n’est plus consul, il va écrire ces deux principaux traités politiques : le premier s’appelle « de legibus » qui est un traité sur les
lois, et le deuxième s’appelle « des republica » qui est le traité sur la République. Ces deux traités sont influencés par Platon ou Aristote, déjà dans les titres choisis et dans le style employé, puisque dans ces deux traités il s’agit d’un dialogue. L’inspiration grecque est donc belle et bien présente. Le but de l’ouvrage « des republica » est une réflexion sur la cité et sur le citoyen et au cours de sa réflexion, Cicéron va défendre également comme Polybe, le régime de la constitution mixte. Il écrit que c’est la meilleureforme de gouvernement et que c’était le gouvernement de Rome avant la crise de la République. Mais Cicéron va se singulariser, parce que lors de son étude, il définit les termes « populus » et « respublica » de manière concrète.
Cicéron appelle « peuple », populus, l’agrégation d’un grand nombre d’hommes liés par la reconnaissance du même droit et par une communauté d’intérêts. Il va justifier la fondation de cette communauté civique par l’idée que l’homme ne peut pas vivre isolé. En d’autres termes il reprend l’idée d’Aristote qui est que l’homme est un animalpolitique. Pour Cicéron le peuple s’associe librement et vie de manière volontaire en communauté. La respublica est assimilée à la res populi, c’est à dire à la chose du peuple, ce qui signifie que l’Etat romain c’est la chose, l’affaire de tout le peuple romain. La chose du peuple, implique qu’elle appartient à tous les citoyens romains quel qu’il soit. Cicéron incite ses concitoyens à s’occuper des affaires publiques de la cité, à défendre leur liberté parce qu’on ne
peut concevoir de constitution politique sans liberté. La participation volontaire et libre à la chose publique qui a caractérisé le développement de la constitution romaine. Selon Cicéron, le sauvetage de la République est l’affaire de tous, il concerne tout le monde car la République représente tous les romains depuis l’origine de Rome. Cicéron explique bien que la constitution romaine est le résultat d’expérience faite par les romains à travers l’adversité. Cicéron soutient quela construction du régime mixte serait contemporaine à la fondation de Rome. Romulus aurait alors construit la constitution mixte et le sénat et que la constitution s’est au fil du temps améliorée. Le terme respublica n’est pas réservé à transcrire le régime de la république romaine instauré en -509. C’est un thème qui a une vocationplus large : c’est l’association du peuple romain, de tous les citoyens romains à la chose publique etce depuis la fondation de la cité de Rome. Le termerespublica recouvre une abstraction. La respublica est une entité politique et juridique qui symbolisele peuple romain depuis toujours. C’est un terme qui traduit la permanence dans le temps du régime romain, de l’Etat. Le terme romain n’a pas d’équivalence en grec. Le populus romain ne correspond pas au démos grec.
Démos : en Grèce. qqch de concret, de propre à chaque cité.la population athénienne est particulière, se distingue des autres cités grecques. Le mot démos est également l’expression du régime démocratique, c’est à partir de la qu’on
a construit le mot de démocratie et désigne ainsi le pouvoir du peuple.
Populus : à Rome. N’a jamais désigné le pouvoir du peuple. Les romains ne connaissaient pas la démocratie. Pour Cicéron le meilleur régime est l’aristocratie soit un régime dans lequel il y aurait une personne qui gouvernerait, le premier des citoyens parmi ses pairs. Régime à tendance aristocratique ou monarchique est le meilleur pour Cicéron. Le populus est le groupement politique et juridique de tous les citoyens romains ayant vocation à participer à la chose publique, qui est une entité abstraite représentant la permanence de l’état romain depuis ses origines. Le terme respublica retranscrit l’état en général et non pasun régime politique. Les romains ont franchi une étape par rapport aux grecs en précisant à dégager ce concept d’état en tant qu’entité abstraite, ils ont compris que l’état regroupait les régimes purs tous ensemble. C’est l’entité abstraite qui s’applique au peuple tout entier.
Conclusion :
Les grecs ont inventé la notion de constitution sous le terme Politéia. Ils ont insisté sur le faitque la constitution pouvait regrouper plusieurs types de régimes et les ont classés. Les athéniens ont inventé et expérimenté le régime de la démocratie directe.
Les romains sont à l’origine de la notion d’Etat : la respublica traduit la permanence d’une société
donnée indépendamment de ses évolutions politiques et constitutionnelles.
C’est sur ce double héritage gréco-romain qu’une grande partie de notre droit constitutionnel est construit.
CHAPITRE 3 : LES RAPPORTS ENTRE POUVOIR ET RELIGION.
Le terme « religion » vient de « religio » ; à l’origine c’est un mot qui a un sens matériel, c’est le lien. A ce sens matériel se rajoute un sens plus subjectif qui va être celui de scrupules,respect, croyance. Et plus tard l’idée de culte religieux. La religion résulterait de la reconnaissance par les hommes d’une puissance extérieure qui exerce sur eux une force contraignante. Très vite, dès la plus haute antiquité pour apaiser ces puissances mystérieuses,les hommes leur font des offrandes ou les honorent pas des rites appropriés : c’est ainsi que serait née la religion comme ensemble de croyances et de pratiques cultuelles visant à organiser les relations entre les hommes et les Dieux. Très vite on passe d’un culte privé à un culte public. Assez rapidement le pouvoir politique va prendre en charge les cérémonies visant à contenter les dieux.A partir de là, va se poser la question de la nature des rapports avec les Dieux et plus précisément la question entre pouvoir et religion. Concernant la relation avec les Dieux, elle peut être monothéiste qui est la croyance en un dieu
unique ou polythéiste qui est la croyance en plusieurs dieux. Concernant la nature du pouvoir, on constate que soit il y a une stricte indépendance du pouvoir temporel et de la puissancespirituel. Il y a donc une séparation stricte de l’Etat et de l’Eglise. Mais parfois il peut y avoirune confusion entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel ; c’est la théocratie qui est le pouvoir d’un souverain confondu avec les dieux. Les romainscomme les grecs entretenaient de relations intéressantes avec leurs dieux, on allait même jusqu’à parler de contractualisme religieux. Par exemple ils sacrifiaient aux dieux pour avoir l’assurance d’une bonne récolte ou pour gagner une guerre. A partir du début de l’empire romain on assiste à un bouleversement dû à l’apparition d’unereligion monothéiste promu à un grand avenir, cettereligion est le christianisme. Il apparait au sein d’un empire polythéiste, et va avoir une vocation universelle, ne sera plus lié à un peuple élu. Cette vocation universelle va se heurter de plein fouet avec l’universalisme politique de l’empereur romain. A Rome, l’idée est de construire un empire géographique. Cet homme qui a en tête son empire (censé être universel) voit apparaitre sur son territoire une religion qui a une vocation universelle. Des intérêts se heurtent puisqu’il y aalors deux guides pour les populations : l’empereuret le christianisme. L’Eglise va devenir une véritable puissance dans l’histoire donc on a deux grandes puissances : l’empereur d’un coté et l’Eglise de l’autre.
Section 1 : l’importance de la théocratie : Exemplede l’Egypte pharaonique :
Pendant plus de 3 millénaires, l’Egypte a été dominée par une personnalité prestigieuse qui est le pharaon. Ceci dure du 4ème millénaire avant JC jusqu’au 1er millénaire avant JC, l’Egypte connait pendant cette période 31 dynasties pharaoniques. Lepharaon est l’intermédiaire entre le monde des dieux et la société terrestre, humaine. Selon la tradition les premiers rois d’Egypte auraient été eux-mêmes des Dieux et on dit souvent que dans l’Antiquité les Egyptiens étaient les hommes les plus religieux. Ce pharaon est considéré comme un dieu sur terre mais ceci pose une question importante qui est celle de la légitimité du pharaon ; c’est un homme mortel alors que sa fonction le désigne comme un dieu sur terre.
Paragraphe 1 : la notion de théogamie
La théogamie est un terme qui vient des grecs, qui est forgé sur teosgamos qui signifie le mariage avec un dieu. Ce sont les pharaons de la 5ème dynastie (-2465 et -2323) qui sont à l’origine de la théogamie, du mythe de la conception et de la naissance divine du pharaon. C’est à cette époque qu’on invente la théogamie, qui est l’acte par lequel un dieu se substitue au pharaon en prenant son apparence physique afin de pouvoir s’unir avec la reine et concevoir ainsi le futur héritier. Mariage avec un dieu dans le sens d’union physique.Le pharaon est donc considéré comme fils de Dieu, qui est Ré chez les Egyptiens.il y a une véritable rencontre entre le monde des dieux et celui des
hommes et c’est pourquoi le pharaon va avoir une double dimension : d’être un mortel en étant dieu sur terre. La théogamie permet d’assurer la continuité de la lignée royale. Cette théogamie légitime la dynastie régnante. Le futur pharaon estchoisi du régime dès sa conception et est garant dela continuité monarchique. C’est très important auxyeux des égyptiens parce que garder cette continuité monarchique, c’est s’assurer qu’il n’y aura pas de chaos après la mort du pharaon et ne viendra ainsi pas troubler l’ordre du cosmos. A chaque nouvelle naissance on a le fils d’un dieu qui nait et ça maintient ainsi l’ordre et l’ordre cosmique. Légitimité parfaite pour l’accession au trône. Il y a des cas où la légitimité du souverainn’était pas évidente. -479 avant JC ; c’est une femme qui accède au trône : Hatchepsout ; il lui faut recourir à une justification religieuse dans sa quête de légitimé. Cette femme est la fille ainée du pharaon Thoutmosis qui vient de décéder, et Hatchepsout est mariée à son demi-frère, Thoutmosis 2 qui mourra jeune, et Hatchepsout est la tutrice de son neveu Thoutmosis 3. Devient l’incarnation féminine d’un rôle masculin et règne pendant 20 ans. Pour légitimer son pouvoir, fait bâtir un temple magnifique pour légitimer son règneet ainsi utiliser la théocratie. Fait graver 15 scènes qui racontent le mythe de sa naissance divine. Ce serait le dieu Amon associé au Dieu Ré qui aurait engendré et fait façonner à son image l’héritière du trône. Il y a une scène où elle est présentée à tous les autres dieux. Devant les dieuxet devant les hommes Hatchepsout est représentée avec tous les attributs d’un roi. Le dieu Amon a
pris la peine de la présenter à tous les dieux d’Egypte. Cette reine a élaboré après coup un récitmythique, elle a créé une réalité aussi vraie que l’histoire aux yeux des égyptiens. A créé cette réalité par la magie des signes divins gravés dans la pierre.
Aménophis III fera la même chose à Louxor, aurait régné entre 1391 et 1383. Fait cela pour faire oublier que sa mère n’était pas porteuse de la légitimité pharaonique puisqu’elle était étrangère.Ramsès aussi fait cela, 1320-1310 avant JC : n’est pas de descendance royale, c’est un vizir, une sorte de ministre de l’ancien pharaon mais n’a pas eu d’enfant donc nomme Ramsès comme son héritier. Il accède alors au trône et utilise la théogamie pour se légitimer. Fais réécrire l’histoire, et fait édifier pour sa mère un monument sur lesquelles sont gravées sur les parois l’histoire de sa naissance et donc le mariage divin entre sa mère et un dieu, Amon Ré. Cette théogamie est bien utile et a servi à donner au pharaon une certaine légitimité. Ces histoires, ces mythes inventés, mettent en valeur la double nature du pharaon. Cecijustifie la nature théocratique du pouvoir.
Paragraphe 2 : de la théogamie à la théocratie
Théocratie : étymologiquement, c’est le pouvoir de Dieu. Le pouvoir est d’origine divine. Il y a une confusion entre les mains du pharaon, du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel car il y a une confusion entre le sacré et le profane. Donc le pharaon est chargé sur terre de maintenir l’ordre afin d’empêcher que le chaos règne. Cet ordre est
celui que veulent les dieux égyptiens, c’est un ordre harmonieux créé par les dieux quand ils ont créé la terre. C’est un concept de l’ordre, Maat, mais c’est également une déesse qui est une fille du dieu ré et qui symbolise justement la justice etla vérité. Ordonne la société des hommes. Le rôle de pharaon, c’est finalement d’assurer le triomphe de Maat. Pour ce faire, le pharaon entretient le dialogue avec les dieux, leur apporte des prières et les offrandes de l’Égypte. Tout le pouvoir temporel de pharaon va être conditionné par le respect de Maat. Le pharaon va instituer des lois, va faire régner la justice et ses armées vont assurer la paix et la prospérité de l’Egypte. Le pharaon gouverne bien au nom des dieux, derrière toutes ses actions il y a la volonté des dieux, et faire plaisir aux dieux, et maintenir l’ordre tel que le conçoivent les dieux.
Section 2 : Rome et les Dieux
Il faut bien comprendre que la spécificité gréco romaine en matière de religion, c’est qu’il ne s’agit pas de religion qui s’occupe de foie, ou desproblèmes de ce qu’il se passe après la mort. La religion grecque et surtout la religion romaine ontpour mission d’organiser les relations entre la cité et les dieux.
L’organisation de la religion témoigne d’une conception contractuelle de la religion, il y a unesorte de contrat passé entre la cité des hommes et des dieux. Ces contrats passés engendrent une certaine réciprocité dans les relations qui se
traduit par l’accomplissement de rites consacrés aux dieux.
Paragraphe 1 : le contrat passé avec les dieux.
On parle de lien contractuel, c’est ainsi que l’on définit le lien qui unit l’homme aux divinités dansles religions polythéiste grecques et romaines. Dans ces deux religions, ce n’est pas un sentiment individuel mais la peur des dieux qui motive les hommes à solliciter la bienveillance des dieux.
• La religion grecque
La religion grecque est ce que l’on appelle « anthropomorphique », c’est-à-dire que selon les grecs les divinités étaient conçues sous la forme d’être humain, dénués de toute fragilité physique mais avec des sentiments humains. Il y a un panthéon de 12 dieux de l’Olympe mais il y en a d’autres à côté. Chaque dieu a une attribution, parexemple Athéna est la déesse de la guerre, Poséidonest le dieu de la mer, etc. c’est une religion mythologique, qui repose sur un certains nombres demythes et de légendes concernant l’histoire personnelle de chaque dieu. Les dieux intervenaientdans la vie des mortels et agissaient en bien ou enmal, mais pouvaient aussi protéger les mortels. Ce qu’on voit dans les récits mythologiques comme chezHomer, c’est que les Dieux combattaient entre eux. Du point de vue de la pratique religieuse, n’importe qui peut célébrer un culte et n’a pas forcément besoin de recourir à un prêtre. Au sein de chaque famille, on voue un culte domestique à des divinités protectrices. C’est la même chose au
niveau de la cité : la vie politique s’accomplit toujours sous la vocation et sous la garantie d’un dieu. Il y a des dieux attachés à des cités particulières, on les appelle des « divinités poliades » ; par exemple Athéna est la déesse protectrice d’Athènes, Poséidon est le dieu protecteur de Corinthe, il y a alors l’idée d’attachement d’un dieu voir de plusieurs dieux à la cité qui est très forte.
Ce polythéisme ignore l’universalisme puisqu’un dieu est attaché à une cité. Finalement, les dieux font partie intégrante de la collectivité civique, font presque partie de la cité. Techniquement, dansle calendrier public des cités grecques, il y a desjours fixes destinés à honorer publiquement les dieux par des cérémonies. C’est un laïc, au sein des cités grecques, qui s’occupent des questions religieuses. Sous la monarchie, c’est le roi qui s’en occupe, et quand on n’est plus en monarchie c’est un magistrat qui s’occupe des questions religieuses.
• La religion romaine
La religion romaine est également fondée sur l’existence d’un panthéon de dieux, mais à la grande différence de la religion grecque, elle n’a pas de mythologie. La religion romaine n’est pas anthropomorphique. Les romains ont emprunté la plupart des dieux grecs. Le dieu grec principal Zeus est devenu Jupiter chez les romains, Aphrodite, la déesse de l’amour chez les grecs, devient Venus chez les romains etc. Ils ont juste changé les noms, se sont approprié les dieux grecs.
Il y a quelques dieux spécifiques qui protègent la cité de Rome, comme Jupiter, le dieu des dieux, mais on a également Junon, Minerve (déesse de l’intelligence), et Quirins (équivalent du dieu mars, mais pas sur). Pour les romains le nombre desdieux n’est pas limitatif. Les romains sont toujours pragmatiques et ont tendance à s’approprier les dieux de leurs ennemis ou des peuples qu’ils vainquent. Quand ils sont en guerre avec un autre peuple, vont exhorter, implorer les dieux étrangers pour que ces derniers désertent leur propre cité pour venir à Rome, où ils seront mieux traités. C’est un moyen très efficace de désarmer l’armée ennemie. La relation à Rome entre les dieux et les hommes est très pragmatique, logique. La religion romaine ne domaine pas un actede foie. Il faut la considérer avant tout comme la collaboration des dieux avec la collectivité romaine. Les dieux doivent contribuer à la grandeurde Rome. Les rites sont très révélateurs des rôles attribués aux dieux.
Paragraphe 2 : les rites de la cité.
L’historien grec Polybe, a parlé de la religion desromains et des relations qu’ils entretenaient avec leurs dieux, ils disaient que les romains étaient plus religieux que les dieux eux-mêmes : pas un évènement de la vie privée ou de la vie publique nese faisait à Rome sans demander l’approbation des dieux, que ce soit un événement de la vie privée oude la vie publique. Par exemple avant de partir faire la guerre on demande aux dieux leur avis. Donc ils organisent minutieusement les cultes et
les romains connaissent de nombreux différents cultes :
• il y a des cérémonies de prières ou devœux, c’est lorsque l’on demande quelque chose aux dieux ;
• il y a aussi des cérémonies de sacrifices d’animaux, il faut alors prendre cette cérémonie comme un hommage rendu aux dieux par les hommes. C’est une sorte de moyen de communiquer avec les dieux, et pour savoir si le sacrifice a été adopté par les dieux, lesprêtres sont chargés de regarder les entraillesde l’animal.
• Il y a également des jeux publics quisont organisés à Rome, comme des combats de gladiateurs, des courses de chars, etc. Ces cérémonies de jeux sont organisées pour faire plaisir aux dieux, c’est un moyen de s’attirer le bon vouloir de la population mais surtout desatisfaire les dieux.
En plus de cela, il y a quelques cérémonies exceptionnelles quand la relation des dieux et des citoyens sont en péril, comme :
• des cérémonies de purification, la cérémonie « devotio », qui est une promesse particulière faite à un dieu pour obtenir quelque chose de précis, par exemple on promet aux dieux la construction d’un temple, une partdu butin, etc.
• il y a aussi une cérémonie la « sacratio » : c’est quand un individu a commisun crime tellement grave qu’il risque d’entrainer la colère des dieux. Cet individu, qui est désigné publique, on lui organise une cérémonie pour le vouer aux dieux des enfers. Après cela, c’est un devoir pour tout citoyen de tuer cet individu. On parle d’homo sacer dans ce cas. L’idée est d’éliminer l’impur de la collectivité, c’est pour cela que n’importe qui peut le tuer sans être inquiété.
Cette religion romaine est une affaire d’état, et les mêmes personnes s’occupent de la religion et des affaires publiques.
A la tête de la religion romaine, on trouve un personnage, appelé le « grand pontife » qui est élu par le peuple. Le pontife est l’équivalent d’unprêtre pour nous. Ce grand pontife réside à un collège des pontifes, qui devront contrôler le déroulement des cultes, qu’il s’agisse d’un culte public ou privé. C’est le grand pontif qui fixe dans le calendrier romain les jours fastes et néfastes.
Les jours fastes, c’est ce que l’on peut faire conformément à la volonté des dieux. Les jours fastes sont les jours ouvrables, ceux où les assemblées pourront se réunir, les jours durant lesquels les procès peuvent avoir lieu.
Les jours néfastes, où les actions publiques ne sont pas agréées par les dieux. Il est ainsi très
dangereux de réunir une assemblée, de tenter un procès, de partir en guerre, etc.
C’est au grand pontif de fixer ce calendrier, et à côté de cela, les magistrats supérieurs, les consuls par exemple participent activement à la religion. Le fait de pouvoir prendre les hospices est le signe de savoir si les dieux approuvent ou désapprouvent une action. Tout acte concernant la vie politique romaine nécessite la prise préalable d’hospices. Par exemple, quand un magistrat prend ses fonctions, c’est qu’on a au préalable pris des hospices, et que les dieux sont d’accords. Il faut cependant respecter, en plus de regarder les oiseaux, des actes à la lettre. Les romains sont donc superstitieux, très respectueux de toutes les formalités à accomplir. C’est ainsi qu’on peut direque quelqu’un qui perd la guerre est quelqu’un qui,lors de la prise d’hospice, n’a pas eu l’accord desdieux. Il faut, à Rome, une participation collective au culte des dieux puisque l’accomplissement du destin de Rome dépend du cultedes dieux, qui sont en quelque sorte contraints de collaborer. Il y a une sorte de communication directe avec les dieux. Plus Rome va s’étendre, plus Rome va conquérir du territoire, plus le nombre des dieux augmentent. A partir de 27, il y aà la tête de Rome un empereur et on voit que les empereurs ont tendance à diviniser les empereurs défunts. C’est donc bien une religion polythéiste.
Mais un événement capital vient tourmenter leur religion : c’est l’apparition, l’avènement du christianisme, qui est une religion monothéiste,
fondée sur une foie personnelle, il y a une mutation en matière de foie qui s’accompagne d’une mutation politique car le christianisme apparait ausein de l’empire romain à partir où l’empereur de Rome détient tous les pouvoirs et quand il est quasiment désigné comme un dieu lui-même.
Comment le pouvoir impérial peut il s accommoder d’une religion qui a une dimension universelle ?
Section 3 : l’influence du christianisme sur le pouvoir.
Tout a commencé en Judée avec Jésus, qui est né vers 4 avant notre ère et il serait mort aux alentours de 30 de notre ère, sous l’empereur Tibert. A l’issu de son procès et de sa condamnation, les romains ont considéré le christianisme non par comme une religion, mais comme une secte turbulente. Cette religion monothéiste va se développer de plus en plus et se diffuser. Son Eglise rassemble de plus en plus de fidèles, parce que la vocation de cette religion est universelle, elle entend guider le peuple de Dieu qui souvent se confond avec le peuple de l’empire romain. Très vite aux yeux des chrétiens, on a un même peuple mais deux guides : l’empereur de Rome et Dieu et à partir du moment où les autorités se rendent compte de ce problème, le christianisme est perçu comme un danger pour le pouvoir. On distingue ainsi deux phases concernant le rapport impérial et l’Eglise, on a tout une phase pendant laquelle l’empire ignore et de temps en temps persécute les chrétiens et à partir du IVème siècle après notre ère le christianisme va
être reconnu comme religion et va être élevée au rang de religion d’état.
Paragraphe 1 : les fluctuations de la position de l’état envers l’église.
Au début de l’empire, aux alentours de 30 avant notre ère, le christianisme est ignoré par l’empire, il n’est pas distingué de la religion juive, il est qualifié de secte juive un peu turbulente. Il y a alors eu des persécutions pendant les deux premiers siècles ; c’est une période où le christianisme n’a aucune existence légale en tant que religion particulière. Les choses changent à partir du milieu du 3ème siècle, c’est-à-dire à partir du moment où le christianismese diffuse de plus en plus, c’est une époque où le pouvoir impérial commence à avoir du mal, à avoir des difficultés car le territoire de l’empire est devenu beaucoup trop vaste pour un seul homme. On est au milieu du 3ème siècle et comme le pouvoir impérial est en difficulté, on rend le culte de l’empereur obligatoire, qui a tendance à se confondre avec la religion romaine. Cependant les chrétiens refusent de considérer l’empereur de Romecomme un dieu, et à partir de là le christianisme devient un délit public, puisque ces derniers refusent de se consacrer au culte de l’empereur (d’où les persécutions contre les chrétiens à partir du 3ème siècle). Il y a une véritable
fluctuation de la position de l’état envers l’Eglise.
• L’enseignement du christ
« Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » : précepte religieux. Cette phraseest en fait à l’origine d’une question qui a été posée a Jésus par un groupe d’hommes constitués de pharisiens ; qui sont les membres d’un des principaux courants du Judaïsme ancien et étaient très attachés à la loi et hostiles au pouvoir romain ; et des hérodiens ; autre courant du Judaïsme, qui collaboraient avec l’occupant romain.Ce petit groupe de pharisiens et d’hérodiens va interroger Jésus pour savoir s’il faut payer ou nonla tribu, l’impôt à César, l’empereur. Ce groupe d’homme voulait enfermer Jésus. Ce dernier leur demande de leur présenter une pièce de monnaie, et leur demande de qui l’effigie et l’inscription proviennent elles. Les hommes répondent que cela vient de César, et c’est à ce moment là que Jésus déclare : « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », c’est donc une affirmation du partage du pouvoir et de l’Eglise : le pouvoir politique d’une part qui doit être respecté dans les limites qui sont les siennes et le pouvoir religieux qui a toutes compétences sur les affaires spirituelles.
Il y a un partage entre deux pouvoirs, mais ne doivent pas pour autant être mis sur le même plan. Le pouvoir religieux l’emporte sur le pouvoir politique dans le sens où le pouvoir politique a une origine divine. Si l’empereur de Rome est
empereur, c’est parce que Dieu l’a voulu. Pons Pilate voulait faire condamner Jésus, et Jésus lui dit qu’il n’avait aucun pouvoir sur lui s’il ne luiavait pas été donné d’en haut. Le message évangélique introduit une idée quelque peu révolutionnaire et pour le moment inconnue de la cité grecque comme de la cité romaine que l’individu n’appartient pas totalement à l’Etat. Sur le plan religieux, l’individu dépend d’une autre société qui a sa propre constitution et qui revendique une organisation propre.
Il y a donc un partage entre les deux pouvoirs : politiques et religieux, entre l’empereur et Dieux.Dans l’immédiat, va appartenir au premier messager de l’évangile de développer l’enseignement du Christ.
• Les commentaires de St Paul
St Paul, a rédigé « l’épitre aux romains ». Dans ce livre, il développe la phrase du Christ « rendez à César… » Et commente ainsi cette parole. Ce commentaire de St Paul sera repris dans de nombreuxcommentaires. Ce texte de St Paul a été dicté aux alentours de 57, 58 de notre ère. Il était destiné à la jeune communauté chrétienne de Rome. Selon st Paul, l’autorité de l’empereur romain s’impose parce que l’empereur est le ministre de dieu, c’estl’instrument de dieu chargé de récompenser le bien et de dénoncer le mal. L’empereur est celui qui a été choisi par dieu. Dans cette première expression
politique du christianisme il n’y a aucune espèce de remise en cause de l’état ni du point de vue de son organisation politique ni du point de vue de son organisation sociale. St Paul, rappelle que leschrétiens mais que l’ensemble du peuple romain doitobéir aux autorités. Il y a un devoir d’obéissance exigé des fidèles. C’est en se fondant sur les textes, les évangiles et les épitres de Paul, que la religion chrétienne jette les bases de la penséepolitique chrétienne, qui se précise d’avantages à partir de moment où l’Eglise va être reconnue officiellement par le pouvoir romain. Pendant une longue période, l’Eglise n’est pas reconnue par l’empire romain, le mot d’ordre chez les chrétiens est l’obéissance à l’égard de l’empereur de Rome, et qu’il est là parce que c’est dieu qui l’a voulu.Il va y avoir une évolution considérable de la place de la religion.
Paragraphe 2 : l’évolution du christianisme comme religion d’état.
Deux textes de lois importent ici : le premier est l’Edit de Milan, qui est la reconnaissance de la religion chrétienne en tant que religion et le deuxième est l’Edit de Thessalonique qui rédige le fait que la religion chrétienne devient religion d’état en -380. Les rapports Eglise-Etat connaissent de nouvelles relations : l’empereur estdésormais chrétien et n’hésite pas à s’immiscer dans la vie de l’Eglise, désigne les évêques, se prononce parfois sur les questions de dogme, etc. Cette tendance de l’empereur à s’immiscer dans la vie religieuse dans la partie orientale de l’empire
est appelé le « césaropapisme » : l’empereur confond le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. L’Eglise cherche elle à guider voir mêmeà juger la politique de l’empereur. Il y a donc desmenaces de tensions, qui font que la doctrine chrétienne, les penseurs chrétiens vont s’interroger sur la nature exacte des liens unissant ces deux pouvoirs : civil et religieux.
• Les deux cités de St Augustin.
Augustin est né en 354 dans l’actuel Algérie, d’un père citoyen romain et d’une mère berbère, chrétienne. Augustin est mort en 430 à Hippone, c’est un philosophe et un théologien. Augustin s’est converti au christianisme. C’est en 396 qu’ilest devenu évêque : l’évêque d’Hippone. Augustin est un des principaux pères de l’Eglise latine et après St Paul, est considéré comme le personnage leplus important dans le développement du christianisme occidental. A été le penseur le plus lu en occident.
IVème siècle : invasions barbares dans l’empire romain, et Augustin mourra pendant le siège de sa ville lors de l’invasion de l’Afrique romaine par les vandales. C’est donc une période de troubles, et de doutes, durant laquelle les païens, (ceux quiont une religion polythéiste) reprochent aux chrétiens la situation. Pour les païens, très nombreux au sein de l’empire, la situation politique et les menaces extérieures s’expliqueraient par la négligence à l’égard des dieux traditionnels de rome. St Augustin, dans ce
contexte particulier, entreprend une réflexion sansprécédent sur le christianisme.
St Augustin « la cité de dieu » est une œuvre politique majeure. Sa théorie, développée dans ce livre, est qu’il existe deux cités qui semblent s’opposer: la cité de dieu d’une part et la cité terrestre d’autre part. Dans l’esprit de st augustin il ne s’agit pas d’opposer l’église et l’état, et il ne s’agit pas non plus d’assimiler lacité de dieu à l’église et la cité terrestre à Rome. Ce qu’il dit, c’est que ces deux cités sont deux principes de vie, à l’autorité différente. La cité terrestre exerce une autorité physique et la cité de dieu exerce une autorité morale. Ces deux cités n’ont pas le même objet : la cité terrestre régit la vie extérieure des hommes, des peuples, etla cité de dieu régit la vie spirituelle des hommes. Ces deux cités n’ont pas les mêmes moyens, à la cité de dieu est dévolue la charité et à la cité terrestre, c’est le glaive qui est utilisé. Lacité de dieu est éternelle, ce qui n’est pas le casde la cité terrestre.
Il y a donc deux cités bien distinctes, indépendantes chacune dans leur sphère propre, maisces cités, même si elles sont distinctes et indépendantes avec leur même fonctionnement, elles doivent collaborer, parce qu’elles sont composées d’hommes. Ces deux cités ont pour préoccupation majeure la paix, c’est l’objectif : un chrétien appartient aux deux cités, et tous les hommes, chrétiens ou païens, doivent collaborer au bien de la cité terrestre. Il existe donc bien deux
principes de vie distincts mais nécessaires pour staugustin. Toute autorité ne peut venir de dieu, c’est-à-dire que le pouvoir ne peut être une chose personnelle, et l’empereur a été désigné de dieu pour faire régner la justice.
B) Gélase et la supériorité du pouvoir spirituel.
Les empereurs romains avaient tendance à se considérer souvent comme les chefs de l’Eglise et voulaient se méfier des affaires religieuses. Cela va durer jusqu’à ce que certains papes réussissent à réaffirmer l’indépendance du pouvoir spirituel par rapport à l’empereur (jusqu’au Vème siècle). Lepape le plus représentatif est Gélase, d’origine berbère. Il est pape pendant 4 ans entre 492 et 496(date de sa mort). Sa contribution aux rapports entre l’Eglise et l’Etat va être décisive. On lui doit un texte capital à Gélase, ce n’est pas un traité mais une lettre adressée à l’empereur romaind’orient, Anastase, cette lettre concerne son élection en tant que pape, « il y a deux pouvoirs principaux pour régir le monde : l’autorité sacré des pontifs et le pouvoir royal ». Gélase réaffirmeici l’indispensable séparation des deux pouvoirs. Il affirme aussi la supériorité du spirituel sur letemporel. Il dit bien que chacun de ses pouvoirs doit être indépendant dans sa sphère.
Chaque pouvoir est indépendant donc l’empereur a toute autorité en ce qui concerne l’ordre public, et les membres de l’Eglise, les clercs en général, doivent obéir à l’empereur, à l’ordre. L’Eglise en matière religieuse à son indépendance et l’empereurlui est alors soumis.
L’empereur n’est qu’un fils de l’Eglise comme tout chrétien, et le pape parle de l’empereur comme de son fils. L’empereur en matière de foie doit être soumis à ce que disent les évêques. Gélase dépasse de loin st augustin et en infléchit même sa doctrine, puisqu’il pose clairement l’idée d’une supériorité du pouvoir spirituel. Il va presque jusqu’à une absorption de l’ordre naturel dans l’ordre surnaturel, divin.
Collaboration des pouvoirs néanmoins, elle impliquel’idée d’une supériorité du spirituel sur le temporel. Cette idée se poursuit jusqu’au moyen âge, et donnera ainsi naissance à une doctrine de confusion des pouvoirs au profit de l’Eglise. Jusqu’au Vème siècle l’empereur s’accaparait tout le profit jusqu’à St Augustin et Gélase qui affirmela séparation de l’Eglise et de l’état stricte. Puis au moyen âge confusion des pouvoirs au profit de l’Eglise, on pourra même parler de théocratie pontificale.
Seconde Partie : Approche Historique du Vocabulaire du Droit Privé.
Dans le langage courant, nous associons souvent lesdeux mots de justice et de droit.
Cette façon de parler vient de l’antiquité romaine.Il faut évoquer, pour commencer, une œuvre qui datede 533 après JC qui est celle d’un empereur romain,Justinien ; cette œuvre reprend les écrits des grands penseurs du droit romain (jurisconsultes). Cette œuvre s’appelle « Le Digeste », publiée en 533 de notre ère, il y a un titre qui nous
intéresse « de la justice et du droit ». Le tout début de cette œuvre commence par un fragment d’un juriste romain, Ulpien, et qui dit « celui qui s’applique à connaître l’étude du droit doit d’abord savoir d’où vient le mot droit. [..] Le droit est l’art du bon et de l’équitable ». Ce sontles romains qui, à l’origine, ont réfléchi sur ses concepts de droit et de justice et des liens qui pouvaient y avoir de l’un à l’autre.
Il y aussi une assimilation entre les deux termes en Grèce, la Justice chez les grecs est traduite par deux mots : Thémis, et dike ; Thémis est la loidivine, puisque themis est la déesse de la justice,de la loi et de l’équité. Elle assiste Zeus, le dieu des dieux. Elle est représentée dans l’art ancien tenant les plateaux d’une balance. D’un point de vue technique, le terme « themis » désignela prescription, qui fixe les droits et devoirs de chacun, c’est donc la loi. « Dike » est la justice dans un sens plus matériel, dans le sens de dire ledroit. Derrière le concept de dike, il y a l’actionderrière un procès, le tribunal. C’est vraiment le fait de rendre le droit, de dire le droit. C’est lajustice dans un sens plus matériel. Chez les Grecs la justice et le droit sont plus ou moins rendus à une même notion, il y a une assimilation entre justice et droit. Cette assimilation est encore faite aujourd’hui, mais n’a plus la même valeur quedans l’antiquité.
Dans nos esprits, la justice est devenue une sorte de rêve de l’égalité absolue, mais si les organes qui rendent la justice ne rendent pas l’idéal, on a tendance à considérer
qu’ils sont injustes. La conception est donc différente. Cette conception, on la doit à la révolution et à l’émergence des concepts des droits de l’homme : onconsidère qu’il y a des droits inhérents à la personne humaine, imprescriptibles, inaliénables etsacrés. A notre époque, il y a eu des réactions de penseurs, de philosophes du droit pour dénoncer cette assimilation abuse de justice et de droit ; et doivent dénoncer que le droit n’est pas forcement juste. Il y a eu des courants de pensée comme le positivisme juridique par exemple, qui consiste à décrire le droit tel qu’il est. Ce positivisme consiste en le rejet d’un droit idéal ou naturel, et va conduire à penser que seul finalement le droit positif a une valeur juridique.Il n’y a pas de droit idéal qui serait un droit naturel des hommes, et seul le droit positif est lanorme à respecter.
CHAPITRE 1 : LES SOURCES DU DROIT.
On appelle source du droit, tout ce qui contribue àcréer les règles de droit propres à une cité. « Source de droit » est une métaphore qui viendraitde Cicéron, avocat romain. Il est le premier à avoir parlé de fontaine de droit, de source du droit, et l’idée c’est qu’à l’image de l’eau qui nait d’une source, le droit nait aussi de plusieurs
faits, de procédés. Notre système juridique a hérité des grecs, et des romains. De la Grèce, et surtout d’Athènes, nous avons hérité du culte de laloi, la loi en tant qu’expression du peuple, la loiest la principale source du droit. L’héritage romain, c’est que les romains nous ont laissé une magistrale classification des sources du droit, et nous vivons encore sur cette classification. Le droit romain a distingué la loi de la doctrine, dela coutume, etc.
Section 1 : La Grèce et la loi.
La loi, est le fait de l’Ecclésia, de l’assemblée du peuple. En raison de l’isonomie et de l’autre principe qui est l’iségorie, la loi est vraiment l’affaire de chaque citoyen. La loi est l’expression de la volonté populaire, à ce titre laloi est intouchable. La constitution prévoyait pour protégerla loi un mécanisme qui est celui de la graphéparomon, qui est une sorte de contrôle de constitutionnalité de la loi. Ce culte de la loi s’est accompagné d’un profond mouvement de réflexion sur le thème de la loi. Les philosophes ont ainsi eu deux thèmes de prédilection, ont distingué la loi naturelle et la loi positive, et se sont attachés à décrire et à donner la valeur dela loi positive.
Paragraphe 1 : les deux types de lois.
La loi positive, est la loi de la cité. C’est la loi que chaque communauté, chaque cité se donne. Laloi n’émane pas forcement du peuple, tout dépend durégime politique. La loi peut être le fait d’une loi, des gouvernants comme à Sparte. La loi
positive contient toujours un ensemble de règle visant à organiser ou à réguler les relations des membres de la communauté politique. La loi s’imposeà tous par sa portée générale en ce sens qu’elle est obligatoire. En Grèce, avant l’apparition de ladémocratie à Athènes, la loi était encore rudimentaire. La plupart du temps, le roi se contentait de déclarer des préceptes de la justice supérieure, de la dike. A l’époque archaïque, le roi disait la loi et la plupart du temps la loi était orale. Il disait la loi au cas par cas, qui était contrôlé par les anciens, qui étaient capables de rappeler les précédents. C’est grâce audéveloppement de la cité état que la loi va réussirà s’affranchir de ses cadres ancestraux et va devenir le nomos. « Nomos » vient d’un verbe « nemein » qui signifie « partager, répartir » doncle nomos à l’origine a vocation à répartir les droits et les devoirs de chacun. Le nomos est un terme et un concept qui serait apparu avec Solon, grand législateur athénien, il est intervenu dans une période politiquement troublée ; l’idée de Solon était de rétablir l’ordre au moyen de la loi,donc la loi va alors devenir un instrument de régulation sociale perfectionnée, on va pouvoir parler de loi positive dans le sens où la loi est laïque, propre à chaque cité, écrite, et consentie par les membres de la cité. Particularité : les grecs construisent leurs lois en s’appuyant sur la tradition, cela signifie qu’ils reconnaissent l’existence d’un ordre supérieur auquel toutes les lois positives doivent se conformer, du moins ellesne doivent pas heurter cet ordre supérieur, c’est cet ordre supérieur auxquelles toutes les lois
positives doivent se conformer que les grecs appellent la loi naturelle. Il va ya voir une assimilation entre loi naturelle et loi divine.
On peut faire la distinction de ces deux lois en cas de conflit entre lois naturelles et loi positives.
Antigone rapporté par Sophocle.
Œdipe, héritier du trône de Thèbes tuerait son pèreet épouser sa mère. Le roi de Thèbes, a alors décidé d’abandonner son fils mais l’enfant a été recueilli et a survécu, mais il ignorait ses origines. Puis, lorsqu’il est devenu adulte, ce jeune homme s’est alors rendu à Thèbes pour découvrir qui était ses vrais parents. En chemin ilrencontra un homme qui eut une conduite un peu bizarre à son égard. Il tua alors cet homme. Il ignorait que cet homme était le roi de thèbes, doncson père. Il faut alors trouver un nouveau roi pourthèbes, la reine doit se remarier, etc. le jeune homme arrive à thèbes et va participer au concours au trône, et réussit l’épreuve qui consiste à résoudre l’énigme du Sphinx. Il va donc épouser la reine de thèbes, Jocaste, mais il ignorait que c’était sa mère. Il aura 4 enfants avec elle, 2 filles dont la fameuse Antigone et deux garçons : Étéocle et Polinis. Œdipe va finir par réaliser qu’il a tué son père et épouser sa mère. Pour se punir lui-même, se crève les yeux, et lègue le trône a ses deux fils, qui sont censés gouverner à tour de rôle (chacun une année) part avec sa fille Antigone et se met à errer dans les rues. Va finir par mourir et à sa mort Antigone revient à thèbes
et regagne le palais royal. Mais la situation est délicate puisque ça ne se passe pas très bien entreles deux frères : Étéocle refuse de céder la place à son frère, polinis, qui va alors arriver à la tête d’une armée pour récupérer le trone. Les deux frères s’entretuent lors d’un combat singulier et le nouveau roi de thèbes, Créon, va ordonner des funérailles solennelles pour Étéocle et refuse de donner une sépulture à l’autre frère parce qu’il leconsidère comme un traitre à la cité. Mais Antigones’oppose à cette décision de Créon, et va alors donner une sépulture à Polinis. Pour avoir bafoué les lois de la cité, Antigone va être condamnée à être enterrer vivante par Créon.
Antigone, pour obéir à des lois ancestrales, à des lois non écrites, veut donner une sépulture à son frère mort. Pour obéir à ces lois ancestrales, va agir au mépris de la loi du roi, elle obéit à des lois divines, puisqu’il fallait ensevelir les morts, sinon l’âme des morts n’auraient pas de repos. Elle obéit à des lois qui seront éternelles.Il y a donc un conflit entre loi naturelle et loi positive. On retrouvera chez Platon, l’idée que le droit de la cité est fait en partie d’un droit non écrit, le droit naturel, et en partie d’un droit écrit, le droit positif de la cité. On retrouve même chez Platon et Aristote cette distinction entre droit écrit, droit positif et droit naturel, droit non écrit.
Toute la pensée politique grecque classique va êtredominée par cette dualité d’ordre juridique. On a d’un coté une loi supérieure, appelée tantôt loi
divine, tantôt loi naturelle, cette loi supérieure est finalement inscrite dans chaque conscience, et ce n’est pas utile de la fixer par écrit ; c’est une loi universelle et intemporelle. A coté de cette loi supérieure on a toutes les lois humaines, positives propres à chaque cité et donc changeantes selon lescirconstances, selon les régimes politiques, etc. c’est toute cette distinction entre la loi positive, le nomos et la loi naturelle, la physis, qui entraine la réflexion philosophique sur la loi.
Paragraphe 2 : l’importance de la loi positive.
La réflexion sur la loi positive et sur sa valeur par rapport à la loi naturelle est née des sophistes. Les sophistes, sont un ensemble de penseurs, d’orateurs, d’enseignants du Vème siècle avant notre ère. Ce sont la plupart du temps des professeurs de rhétorique, (l’art du langage) et laplupart d’entre eux sont installés à Athènes. Leur principale activité est d’enseigner aux jeunes citoyens fortunés ce qu’on appelle la sagesse (Sophia en grec). Sophia, c’est la sagesse dans le sens de savoir et non de modération ; c’est un savoir technique. Ils vont former des gens aptes à réfléchir, à prendre des décisions, vont former desgens aptes à gouverner. Les sophistes enseignent des techniques de persuasion, ils enseignent la capacité de pouvoir faire triompher leur point de vue dans les assemblées politiques ou dans les tribunaux, veulent former des gens qui réussissent socialement et politiquement. On ne possède quasiment rien de l’œuvre des sophistes parce que leur enseignement était payant et il n’avait donc
pas intérêt à l’offrir librement au public, donc iln’y a pas eu de prises de notes de l’étendue de l’enseignement de ces sophistes. Mais on sait qu’ily a eu un certains nombre de réaction : de l’engouement, ou des critiques. Parmi les sophistes, il y a eu différentes générations.
La première génération de sophistes composée entre autre de Protagoras ou Gorgias ; ce qui les caractérise, c’est qu’ils essaient de libérer l’homme des carcans de la religion ou des règles immuables de la nature. Ces sophistes contestent laperfection et l’immuabilité de la loi naturelle, qui serait finalement que le fruit de conventions réglées, créées par l’homme. Ces sophistes disent ce qui est juste ou injuste. C’est l’origine du relativisme ; et l’idée c’est que tous les comportements humains, toutes les croyances humaines, n’ont pas de références absolues qui seraient supérieures. C’est l’homme qui importe, qui sort vainqueur de la remise en cause des schémas traditionnels. Conteste la loi naturelle, conteste l’existence de dieu et de la loi divine, d’où la phrase de Protagoras : « l’homme est la mesure de toute chose » ; l’homme est ainsi placé au cœur du processus législatif, c’est lui qui va faire les lois, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. Ceci va faire avancer la pensée démocratique : la loi est faite par le peuple, pourle peuple.
• On se débarrasse des traditions.
La seconde génération va se distinguer par sa virulence par rapport au monde de la cité, le
pouvoir n’est qu’une question de rapport de force, parce que si rien n’est vrai en soit, alors rien n’est bien en soit. Celui qui gouverne est alors celui qui domine, pour ses sophistes de Seconde génération, comme Thrasimaque, pour lui, le gouvernement ne représente pas un idéal de justice puisque le gouvernement n’est que la domination de ceux qui, à un moment, détiennent le pouvoir. Donc,pour ses sophistes de seconde génération, la loi est le reflet des intérêts des plus forts. La loi, finalement, ce n’est que le reflet, l’expression decompromis passés entre les hommes. Si on suit cettepensée jusqu’au bout, si on a une telle vision de la loi, et bien le fait de violer la loi ne sera pas répréhensible : si on la viole, si on parvient à échapper à la sanction, alors l’acte n’est pas répréhensible, le tout est de ne pas se faire prendre. Cette vision va loin mais n’est pas nécessairement justifiée. C’est un point de vue négatif qui est celui de Platon.
Les premiers sophistes avaient donc dégagé toute existence de loi naturelle, divine, et insister surle fait que la loi positive y était supérieure, et les sophistes de seconde génération ont une vision plus pessimiste de la loi positive : réintroduisentl’existence d’une loi naturelle.
Platon n’aimait pas les sophistes parce qu’ils faisaient payer leur leçon, pour Platon la Sophia ne peut pas être ravalée au simple rang de technique que l’on fait payer : puisque pour lui, payer pour la sagesse c’est la corrompre. Derrière cela il ya comme une lutte des classes. Platon était issu de l’aristocratie et les sophistes
étaient issus de la plèbe ou metheques, et pour Platon on ne fait pas payer la Sophia mais peut être qu’il y avait aussi des considérations sociales derrière, et pour lui les sophistes sont amoraux, leur enseignement peut servir tout aussi bien à donner des armes à l’injustice. Il leur reproche aussi de manipuler le langage et de préférer l’efficacité à la vérité. Il y a de la part des sophistes un certains nombres d’attaques contre la loi, mais en dépit de ces attaques, ce qu’on peut dire avec certitude c’est que la loi demeure reine, garde toute son importance malgré les attaques des sophistes des différents générations.
La loi demeure reine se retrouve dans l’exemple de la mort de Socrate.
Socrate déplore que l’on confie la politique à une foule ignorante, comme dans le système démocratique. Paradoxalement Socrate ne condamne pas le nomos en tant que loi civique même si le nomos vient du peuple, de la voie démocratique. Il estime que ces lois civiques sont établies pour le bien des citoyens dans la recherche de la plus grande justice. De ce fait Socrate s’oppose aux sophistes puisque pour Socrate, désobéir à la loi c’est un crime majeur. Socrate lui-même se soumet àla loi et la preuve manifeste est sa mort en -399 de notre ère.
Plusieurs membres de la classe dirigeante athénienne pensait que Socrate, par son enseignement, constituait un danger pour l’ordre social, en un sens qu’il pervertissait les valeurs
morales de la société traditionnelle. En -399 Socrate a été accusé par Mélétos de deux crimes découpés en 3 chefs d’accusations : 1) il ne reconnait pas les dieux de la cité, selon ses accusateurs, Socrate nie les dieux. 2) on lui reproche d’introduire des divinités nouvelles pcq Socrate croyait en une sorte de démon personnel et croyait qu’il avait une voix, un signe qui lui parler mais rien ne prouve que ce soit une divinitépour lui 3) de corrompre la jeunesse d’autant que certains de ses disciples ont été prisonnier.
On intente alors un procès.
En -404, fin de la guerre du Péloponnèse, gagnée par Sparte et perdu par Athènes. Sparte a ainsi imposé à Athènes le régime des 30 tyrans. A Athènesbeaucoup de personnes ont attribué cette défaite à une prétendue perte des valeurs traditionnelles, ettrès vite on a trouvé les boucs émissaires de la société, dont les Sophistes, comme Protagoras ; et Socrate a été assimilé aux Sophistes. Socrate avaitbeaucoup de disciples dont une grosse influence, mais il fallait trouver des responsables à la défaite. Son procès s’est déroulé en deux temps : dans un premier temps, 501 jurés ont été réunis pour son jugement, et à ce moment la Socrate a refusé purement et simplement de lire un discours de défense qui avait été pour son intention par Lysias, un logographe (rédacteurs de discours). Socrate aurait dit à Lysias que ce serait comme unepaire de chaussure qui ne lui irait pas. Il raconteainsi sa vie aux jurés mais cela ne plait pas du tout et sera jugé coupable. Dans un premier temps
il faudra choisir la peine encourue par Socrate ou lui faire payer une amende. Les juges devaient écouter les deux parties, faire une proposition. Socrate et son accusateur devait proposer une accusation qui lui semblait raisonnable. Socrate sedit d’accord pour payer une amende complétement dérisoire et va même ajouter qu’avec ce qu’il avaitfait pour la cité, il méritait d’être hébergé et nourrit jusqu’à la fin de ses jours. Socrate se moque donc de la cité. Cette attitude exaspère des juges et va être condamné à mort avec 60 voies de plus qui requiert sa mort : il est condamné à boireun poison mortel qui est l’assigue. Pendant qu’il est en prison on lui propose de s’enfuir, mais refuse de le faire, parce qu’il dit que le respect des lois de la cité est plus important que sa propre personne.
La loi positive est donc très importante dans la vie des grecs anciens.
Section 2 : Rome et les sources du droit.
A la différence de ce qu’ont pu faire les grecs, Rome n’a pas donné la primauté à la loi comme source du droit. Rome va reconnaitre une grande variété de sources du droit et la place et la valeur de ses sources évoluent tout au long de la période romaine.
Gaius, a laissé dans un de ses ouvrages « les institutes » une classification des sources du droit. Gaius était un professeur, on ne dispose pasde sa biographie mais on sait qu’il a vécu au moinsjusqu’en 178 de notre ère parce qu’à cette date, il
a commenté une décision de l’empereur Marc Orel. Onsait qu’il a enseigné et écrit sous le règne de l’empereur Hadrien. Cependant on ne connaît Gaius que par un seul nom alors que tous les autres juristes romains ont trois noms comme les gens de bonne famille à l’époque. Gaius est une déformationde Caius, qui est le nom le plus répandu, le plus commun à Rome. Il y a plusieurs indices qui laissent à penser qu’il n’était sans doute pas citoyen romain. On peut imaginer qu’il n’était pas romain ou qu’il l’était depuis peu. L’empereur Hadrien s’était entouré de nombreux affranchis et on peut croire qu’il est ainsi devenu romain. On peut aussi imaginer qu’on l’appelait par un seul nom parce qu’il était très connu ? Certains historiens sont mêmes allés jusqu’à se demander si Gaius n’était pas une femme parce que dans son œuvre il a des propos un peu féministe pour l’époque. De plus, les autres juristes et ceux qui lui succèdent ne le cite pas, alors qu’il occupe une place de choix dans les siècles qui lui succèdent en droit. Notamment dans Le Digeste, qui est une compilation d’écrit de droit romain. On trouve un manuel appelé « les institutes » ; qui a été publié en 161 après JC mais il a été utilisé jusqu’au Vème siècle. Ce manuel correspond à une année d’étude dans la formation des futurs juristes, va connaître un gros succès à cause de saprésentation très rationnelle. Gaius fait d’abord une introduction sur les sources du droit puis il organise son propos selon un plan en trois parties : 1) personnes ; 2) biens ; 3) actions. Cette présentation-là est encore celle du code civil. On trouve aussi cette organisation dans la
philosophie grecque. Gaius enseigne le droit en se servant de la philosophie et c’est pour cela qu’il oppose le droit commun à tous les peuples, le droitdes gens ius gentium, au droit propre à chaque cité, le droit civil, ius cuivile. Ensuite, il procède à une énumération didactique des différentes sources du droit.
Il dégage ainsi :
1) les sources anciennes obsolètes : c’est-à-dire :au 2ème siècle, on peut encore appliquer les dates qui datent de 400 avant JC par exemple. Elles sont obsolètes parce que même si à l’époque de Gaius on peut les invoquer, elles ne produisent plus de droit, comme la loi, les plébiscites ou les senatusconsultes.
2) les sources anciennes actives : il s’agit d’une part de ce que l’on appelle la jurisprudence au sens romain du terme, iurisprudencia, qui signifie la sagesse du droit. En gros, c’est ce qu’on appelle aujourd’hui la doctrine. Ce sont les écritsdes juristes, des spécialistes du droit. Au fil du temps, ces écrits ont été mis dans des recueils et on aura des recueils de jurisprudence. Il y aura aussi les responsa, qui sont des consultations ou des traités fait par des juristes.
3) les sources nouvelles : les constitutions impériales. En gros, tous les textes juridiques quiémanent de l’empereur.
On a les édits, qui sont des dispositions généralesaffectant l’empire comme l’édit de Caracalla, mais il y aussi les décrets qui sont les décisions,
jugements de l’empereur dans un cas précis. Il y aussi les mandats, qui sont des ordres donnés par l’empereur à un personnage de l’empire. Il y également les rescrits, qui sont des consultations données par l’empereur sur un point de droit.
Gaius dit qu’il y a donc trois types de sources. Ilexplique ces sources de manière organique, avec lesorganes qui sont à l’origine de leur création.
Paragraphe 1 : le droit civil et le droit des gens
• Le droit civil
Le droit civil est le droit réservé à chaque citoyen de chaque cité. On appelle cela le ius cuivile. Par exemple, un grec ne pourra pas utiliser le droit civil romain dans ses rapports avec un romain. Donc, il y a en droit romain un principe de personnalité des lois. Le droit civil ne s’applique qu’aux citoyens romains, d’où la nécessité de créer un droit commun entre les peuples, un droit qui puisse s’appliquer dès qu’il ne s’agit pas d’un rapport entre seuls citoyens romains.
• Le droit des gens
Il va y avoir une nécessité de développer un « droit des gens » ; ius gentium. Ce droit des gensse développe quand Rome va commencer à conquérir des territoires. Ce droit des gens s’est développé principalement au départ en raison du commerce avecles étrangers. Très vite les romains ont compris que leur droit civil était dépassé et qu’ils avaient besoin d’un droit commercial romain pour
développer les affaires, le commerce avec les puissances étrangères. Très vite, ils ont compris qu’il était intéressant dans tous les autres domaines pour lesquels on ne pouvait pas appliquer le droit civil. D’un point de vue technique, le droit des gens est le droit qui s’applique partout dans l’empire romain, à la fois aux citoyens et auxétrangers, c’est un droit ouvert à tous les pérégrins dans leurs rapports entre eux mais aussi dans leurs rapports avec les citoyens romains. Avecla création de ce droit des gens, on sent une influence grecque d’un courant philosophique qui est le stoïcisme. L’acceptation, la propagation de l’idée de ce droit des gens, communs entre tous lesgens fait penser à la doctrine stoïcienne. Les stoïciens incitent à la pratique d’exercice de méditation pour vivre en accord avec la nature, c’est la raison pour atteindre la sagesse et le bonheur, buts ultimes. On peut ainsi souligner le contraste entre droit civil et droit des gens grâceaux Stoïciens parce qu’ils sont parvenu à distinguer le droit positif issu de l’ordre juridique de la cité et le droit sans loi, le droitqui existe partout, dans la nature. Ont distingué droit positif/droit naturel. Le droit romain fait bien une différence entre le droit des gens et le droit naturel, il n’y a pas d’assimilation parce que le droit naturel c’est ce que la nature donne àtous les animaux, mais aussi bien en fait aux hommes qu’aux animaux à proprement parler.
Le droit naturel est fondamental, de lui vient l’union de l’homme et de la femme (mariage) puis la procréation, et l’éducation des enfants. On retrouve les mêmes processus chez les animaux ; par contre le droit des gens est le droit
que les peuples humains observent : c’est le droit des nations.
On a un droit commun à tout le règne animal qui estle droit naturel et un droit propre à l’espèce humaine qui est le droit positif.
Paragraphe 2 : les différentes sources du droit
D’un point de vue purement organique, il y a trois principales sources du droit, l’édit des magistrats, la science des prudents (jurisprudence) et la loi. La loi, est la source qui a le plus évolué à partir del’époque impériale.
• L’édit des magistrats
Tout magistrat romain a le droit de publier un édit. Cet édit est en fait un catalogue d’action enjustice, dès son entrée en charge, le magistrat publie un édit, qui est affiché sur le Forum à la connaissance de tous. Cet édit va durer un an. Tousles magistrats sont censés publié un édit, c’est-à-dire un catalogue d’action en justice.
L’édit le plus important est celui du préteur puisque ce dernier est le magistrat chargé de la justice à Rome. Le préteur ne juge pas, il ne rend pas le verdict final. Il intervient au début du procès, il qualifie les faits. Il intervient seulement dans les affaires privées, autrement dit dans le civil.
A Rome, même lorsqu’on prouve qu’un dommage a été commis à notre encontre, l’affaire ne vas pas
forcément être jugée. Aller devant un juge, c’est un privilège que l’on n’accorde pas à tout le monde : c’est le préteur qui délivre un ordre de juger, sans lui il n’y a pas de jugement. Evidemment, pour délivrer cet ordre de juger le préteur va examiner l’affaire, les faits, et les qualifier, en fonction de ce qu’il y a dans son édit. Le préteur créée des actions en justice, du droit en délivrant des actions en justice, on appelle cela le droit prétorien. Le préteur peut créer des actions en justice à deux moments : lors de son entrée en charge, quand il publie son édit, et pendant son entrée en charge (où il publie un édit). Très souvent le préteur garde une grande partie de l’édit de son prédécesseur, parce que c’est plus pratique tout simplement : il a une liste d’actions en justice déjà qualifiées. Il peutaussi en supprimer. Il formule une demande d’actionpour tel ou tel motif de manière à ce que l’action demandée concorde avec une action dans l’édit. Il peut aussi créer une action en justice pendant son année en fonction : c’est l’hypothèse dans laquelledeux justiciables ont un différend, viennent trouver le préteur et se rendent compte qu’il n’y apas dans l’édit d’action correspondant à leur affaire. Si le préteur estime que la situation doitêtre protégée, il créée une nouvelle action, qui est fondée sur le fait, sur le cas d’espèce. Le préteur transforme un fait en droit, créée une nouvelle action qui va ainsi être intégrée dans l’édit.
Il y a donc deux parties dans l’édit du préteur : l’ancienne reprise année après année et la nouvelle
qui contient les actions que le préteur ajoute durant sa fonction.
L’édit du préteur est la principale de source de droit privé de la période du droit classique (entrele 2ème siècle avant JC et le 2ème siècle après JC). C’est un mode de création du droit très souple, il est en constante adéquation avec les besoins de la pratique puisque si une affaire n’estpas encore réglée par l’édit du préteur on trouve un préteur qui va créer l’action. C’est un mode de création du droit originale et sans précédent. Les choses vont changer et l’édit du préteur va subir une très grande modification, qui intervient en 125après JC : l’empereur Hadrien demande à un juriste de l’époque, appelé Julien, de rédiger l’édit du préteur de manière définitive. A partir de là, on parle d’édit perpétuel car il ne changera plus tousles ans. En gros, on a fixé définitivement l’édit du préteur parce que l’édit était affiché chaque année sur la grande place de Rome sur le Forum, et que tout le monde pouvait le voir, mais objectivement, c’est faux, parce que cet édit du préteur n’était compréhensible que par les juristes. Très vite, ce qu’il s’est passé c’est qu’on ne consultait plus l’édit du préteur ; il ne servait plus à rien. Donc l’empereur Hadrien demande à Julien de tout remettre en ordre et l’édit devient permanent. Il ne faut pas oublier que Gaius est contemporain de l’édit du préteur. Lepréteur n’est pas le seul à pouvoir éditer des édits. Les édits des gouverneurs de province sont aussi un catalogued’actions que les gouverneurs produisent dans les campagnes dont ils ont la charge. Il y aussi les
édits des édits curuls : ce sont les magistrats chargés de la police économique des marchés à Rome.
• La coutume
La coutume, c’est un usage qui tire sa force de sa répétition dans le temps et de son acceptation comme règle contraignante par la communauté où elles’est développée. La coutume est par essence non écrite. Dans l’ancien droit romain, quand on parle de la coutume, c’est celle des ancêtres. C’est alors la principale source de droit privé. Elle concerne la famille, les personnes, la propriété, la vente etc.
En 450 avant JC, avec la publication de la loi des XII tables il y a un changement puisque c’est la première mise par écrit du droit. A cette époque-là, cette loi n’est pas la source de tout le droit privé : on admet qu’il y a des matières qui continuent de relever de la coutume. Puisà partir du droit classique la coutume tombe en désuétude : elle est concurrencée par l’apparition de nouvelles sources du droit notamment l’édit du préteur. Il ne reste ainsi plus de place pour la coutume, jusque-là finalement la coutume comblait en général le vide laissé par la loi. Or, l’édit du préteur ne laisse aucune situation sans protection. Si un préteur décide qu’une situation mérite d’être sanctionnée, elle va l’être. A partir du moment où on voit apparaitre l’édit du préteur il n’y a plus de place par la coutume et c’est pour ça qu’elle n’est pas considérée comme une source du droit par Gaius. On ne connait plus la coutume à l’époque où il écrit.
Mais à l’époque tardive, après le 2ème siècle aprèsJC, on retrouve la coutume en droit romain sous deux formes : les coutumes provinciales d’abord, tous les usages locaux qui existent dans les différentes provinces romaines et que Rome n’a pas éradiqué. Ces coutumes localesvont être introduites dans le droit officiel romain. A partir de l’édit de Caracalla, en 212, les usages locaux vont devenir des coutumes provinciales romaines et vont rentrer dans le droit romain. On voit aussi réapparaitre les coutumes sous la forme du droit vulgaire c’est-à-dire qu’on constate que le droit romain classique est droit difficile, trop savant pour répondre aux attentes de la pratique : ce droit classique est ainsi simplifié, et on va parfois le remplacer en apportant directement des solutions à des questionslocales, concrètes.
On créée donc l’autre type de droit qui est le droit vulgaire qui remplace le droit classique, ce droit vulgaire est fondé sur toutes les coutumes locales.
Si Gaius n’en parle pas parce qu’à l’époque où il écrit, la coutume n’existe plus comme source du droit et réapparait un siècle plus tard puisque lescoutumes locales sont intégrées dans le droit romain.
C) La science du droit – la iuris prudencia
Quand on parle de jurisprudence à Rome, on évoque ce que l’on appelle la doctrine. Ce n’est pas le travail des tribunaux, c’est la doctrine c’est à dire ce qu’écrivent les juristes qui donnent des consultations, c’est le résultat de leur travail.
Jurisconsultes : ce sont des spécialistes du droit civil romain. Ils réfléchissent sur le droit civil et ils créent la science juridique romaine. Ces jurisconsultes apparaissent à partir du 2ème siècle avant notre ère et on peut dire qu’à partir de là le droit devient une science c’est-à-dire une discipline spécifique avec ses propres règles, son propre raisonnement et ce au même titre que l’arithmétiqueou que la philosophie par exemple. Les romains sontles premiers à avoir considéré que le droit était une science. Aucun droit de l’antiquité n’avait étéjusque-là mis au rang de science intellectuelle.
Les jurisconsultes ont une double activité : ils écrivent de nombreux traités, des manuels, ils créent la littérature juridique. De plus, ce sont des consultants, c’est-à-dire que très souvent un justiciable, ou même un juge vient trouver un jurisconsulte pour trouver une question de droit.
Si le jurisconsulte est quelqu’un d’une grande renommée, sa réponse va influer en quelque sorte sur la création du droit. Il y a par ce biais une activité créatrice de droit qui au fur et à mesure va prendre de plus en plus d’ampleur notamment quand Rome va devenir un empire. Dans la pratique, l’activité des jurisconsultes va devenir tellement importante que l’empereur de Rome va vouloir le contrôler. Ce contrôle va s’effectuer au moyen d’une sorte de brevet officielqui va être délivré à quelques jurisconsultes désignés par l’empereur. Dès Auguste, le premier empereur de Rome, on va donner à certains juristes choisis, le droit officiel de délivrer des consultations, qui seront munies de l’autorité
impériale. Cependant Gaius qui n’avait pas une trèsgrande renommée pouvait quand même donner des consultations. Le juge suivra l’avis d’un jurisconsulte mais il n’est pas obligé. La jurisprudence commence petit à petit à devenir une source du droit. Les choses s’amplifient au fil du temps.
A partir du règne de l’empereur Hadrien, il v a y avoir la loi de l’unanimité à laquelle Gaius fait référence dans son texte. La loi de l’unanimité va servir à enlever les incertitudes qui peuvent demeurer dans l’avis demandé aux jurisconsultes. A partir de la règle de l’unanimité on considère que si l’avis desdifférents jurisconsultes consultés concordent, le juge va être lié. Si les différents juristes consultés ne sont pas du même avis, le juge retrouve alors sa liberté de jugement et peut alorsdécider librement de la décision à appliquer.
Il faut désigner des jurisconsultes officiels puis la loi de l’unanimité. Il y a une importance accordée à la jurisprudence mais celle-ci s’atténueà partir du IVème siècle.
En effet les juristes consultes disparaissent à partir du IVème siècle après JC. La jurisprudence, qui était considérée auparavant comme une source vivante du droit, va se tarir. Ce fait devient évident quand on voit qu’un empereur au Vème siècle : Valentinien 3 va prendre une nouvelle loi qui est la loi des citations en 426. Cette loi des citations reconnait l’autorité de 5 jurisconsultes des siècles antérieurs : Gaius, Paul, Ulpien, Papinien, Modestien. Les autres juristes peuvent
être invoqués devant le juge mais sans forcément avoir de force ou d’autorité.
Généralement, devant un juge lors d’un jugement, s’il y a un point de droit à résoudre on se réfère à ces 5 juges. Si l’avis ne concorde pas, on se fieà l’opinion de la majorité. S’il y a une égalité, c’est l’opinion de Papinien qui sera préférée. Si un cas reste sans solution, là seulement le juge retrouve son pouvoir d’appréciation et de décision.
D) la loi à Rome.
Gaius commence son énumération des sources du droitavec la loi. Pour apprendre à lire aux petits on leur lisait la loi des XII tables. Pour les romains, savoir lire c’est lire la loi. Le terme « lex », loi, est fondamental pour un romain. Le terme lex ne correspond pas totalement à notre loi d’aujourd’hui. Une lex romaine peut être la loi votée par les assemblées mais ça peut être un contrat type. Dans le texte de Gaius la loi est la loi votée par le peuple, votée en assemblée. Gaius va fonder la légitimité de toutes les autres sources sur cette loi initialement votée par le peuple. La loi est lasource du droit qui va le plus évoluer en droit romain. La loi va subir le changement institutionnel du passage à l’empire et on va passer de la loi en tant que délibération du peupleà la loi qui va devenir une source normative aux mains de l’empereur. La loi va changer de nature avec le changement institutionnel puis la loi, une fois aux mains de l’empereur va être complétée d’une autre notion fondamentale que le droit romain
va apporter à notre tradition juridique qui est celle de codification.
Paragraphe 3 : La loi, délibération populaire.
On revient à la période républicaine et sous la république on définissait la loi comme ce que le peuple établit. La loi est votée par les comices, qui sont les assemblées politiques du peuple romain, c’est à dire les assemblées de l’ensemble du corps civique. Il ne faut pas confondre la loi romaine et la loi athénienne. La loi romaine n’est pas l’expression de la volonté générale comme pouvait l’être le nomos à Athènes. Rome n’a jamais été une démocratie, c’est un régime aristocratique (donc oligarchique). Le processus législatif à Romemontre bien cette différence entre les deux : à Rome les comices, les assemblées sont convoqués pardes magistrats supérieurs (consuls ou préteur) jamais l’assemblée du peuple ne se réunit elle-même. Les comices à Rome ne sont pas non plus maitre de l’ordre du jour, ils n’ont pas non plus l’initiative des lois, qui appartient aux magistrats. Surtout, les citoyens qui siègent dans les comices ne peuvent pas s’exprimer, ne peuvent pas présenter des amendements, il n’y a pas d’équivalent de l’iségorie athénienne.
En gros le magistrat pose une question, présente leprojet de loi et demande au peuple réunit en comices’il est pour ou contre le projet de loi. Le peuplese contente de répondre par oui ou par non.
A Rome, les citoyens votent par groupe, par centuries. Les centuries votent dans un ordre
déterminé, on commence par la première dans laquelle on trouve les nobles et les plus riches. Dès que la majorité est atteinte on arrête le vote donc ce n’est pas toute l’assemblée qui vote. Très souvent la dernière centurie, les plus pauvres, n’ont pas le droit de voter.
La grande loi à Rome est la loi des XII tables de -450. C’est la première mise par écrit des règles dedroit privé. Les lois qui interviendront par la suite d’une manière générale plutôt dans le domainedu droit public. A côté de cette loi, on reconnait une seconde source législative que Gaius place dansson texte à côté de la loi, il s’agit des plébiscites : ce que la plèbe ordonne et établit. La plèbe n’avait cessé de réclamer ses propres institutions et parmi celles-ci il y avait l’assemblée appelée le consil de la plèbe, c’est elle qui vote les plébiscites. Petit à petit les institutions de la plèbe vont être intégrées dans la constitution romaine et cette apogée intervient en 286 avant JC par la lex Hortensia : donne aux plébiscites ce qu’on appelle une valeur normative :les plébiscites sont assimilés à des lois. Sous l’empire la loi tombe en désuétude à telle point que la dernière loi votée est agraire et intervientaux alentours de 96 - 98 avant JC sous l’empereur Nerva. A partir du moment où Rome devient un empire, l’empereur ne cesse de capter tous les pouvoirs à son profit. Les pouvoirs des assemblées vont être diminués et quasiment réduits à néant. Lepeuple perd ainsi sa compétence législative. Cela ira jusqu’à la suppression pure et simple des comices centuriates. Il y a un déclin suppressif de
la loi : la loi cesse d’être une délibération du corps civique. En parallèle, on a un empereur qui intervient de plus en plus dans le processus de création du droit.
• Le développement du pouvoir normatif de l’empereur
Le pouvoir normatif, de légiférer de l’empereur, defaire la loi, va s’étendre. L’empereur va commencerpar se servir du sénat. Le sénat est une assemblée consultative, rendait des avis appelés les sénatus consultes. En soit, ce sénatus consulte n’avait pasde valeur normative contraignante, mais généralement on suit l’avis du sénat en raison de son autorité morale, auctorictas. Donc généralement, on demandait l’avis au sénat son avispour un projet de loi. C’était un conseil prestigieux. C’est ce dont l’empereur romain s’est rendu compte et dès le 1er siècle et même dès le règne du premier empereur auguste, utilise le prestige du sénat pour faire passer des mesures, des projets de loi.
Lorsqu’il est arrivé au pouvoir, Auguste demande à ce que lui soient confiés les pleins pouvoirs pour une courte durée afin de « restaurer » la démocratie. Met en place le régime du principat et se fait élire président du sénat à vie. Il a ainsi le pouvoir de faire la loi. Quand il veut prendre une loi, Auguste fait le choix de se rendre régulièrement au sénat pour faire des propositions.L’empereur va devant le sénat et dans son discours
il donne l’avis du sénat. Se sert du prestige de l’autorité sénatoriale en faisant croire que c’est le sénat qui est à l’origine du sénat alors qu’en fait c’est de lui qu’émane les textes.
Les sénateurs constituent une sorte de caution morale. Le premier empereur de Rome et ses successeurs ne veulent pas laisser penser que c’esteux qui dirigent tout. Forcément très vite ces sénatus consultes deviennent source de droit. Gaiusdit que le sénatus consulte, c’est ce que le sénat ordonne, prescrit et établit. Le senatus consulte tient la place d’une loi. Le temps passant, le pouvoir personnel de l’empereur va se dévoiler : l’empereur va se mettre à légiférer en son nom propre et va apparaitre des constitutions impériales. Ce sont l’ensemble des textes législatifs qui vont émaner de l’empereur ou de sesservices. Les constitutions impériales peuvent revêtir 4formes :
• Les édits : portée générale, sont censés s’appliquer à l’empire dans sa totalité.
• Les décrets : jugements ou conseils rendus par l’empereur. Sont limités à un cas d’espèce.
• Les rescrits : c’est une réponse écrite donnée par l’empereur à une requête émanant soit d’un particulier soit d’un fonctionnaire ou même d’un juge. On appelle cela rescrit parce que l’empereur va écrire la réponse qu’il va donner au même support.
• Les mandats : sont des ordres ou des instructions administratives adressées par l’empereur aux magistrats ou aux fonctionnairesde son empire.
L’empereur devient la principale source du droit, ce qui fait qu’au IIIème siècle se formule une maxime qui sera reprise par l’ancien droit françaispour justifier la toute-puissance du pouvoir normatif du droit : « ce qui plait au prince à force de loi ». L’empereur est une loi vivante. A partir de là, au IVème siècle, toutes les assemblées du peuple sont supprimées et le terme lex désigne désormais exclusivement une loi impériale.
Gaius termine sa classification en disant que si lepouvoir de l’empereur est de faire de constitution,c’est parce qu’elles sont comme la loi. Le peuple est dépossédé de son pouvoir législatif au vu de l’empereur. On a oublié la loi comme délibération du corps civique. Ce développement croissant va entrainer une nécessité toute pratique, qui est la nécessité de classer toutes ces lois du prince.
• La codification du droit.
Un code est un recueil juridique. Il est apparu au début comme un support écrit, prêt à recevoir des textes de toute sorte, c’est un support matériel. Jusqu’au début de l’ère chrétienne, cela s’écrivaitsur du papyrus. On appelait cela un volume.
Lorsque les grecs et les romains voulaient prendre des notes rapides, utilisaient une tablette couverte de cire. On écrivait sur ces tablettes avec un stylet. Les romains, lorsqu’ils voulaient prendre des notes plus importantes, ont pris l’habitude de relier entre elles quelques tablettes de cires. Et c’est ce qu’on a appelé un codex.
Courant du IIème siècle, Gaius écrit. Une révolution se produit dans l’histoire du livre, à partir de ce moment-là, on a trouvé comment écrire recto verso sur des feuilles de papyrus : on utilise la technique de mise au point pour relier les tablettes de cires pour relier aussi les papyrus.
Le codex devient ainsi un livre relié. Ce mot est capté par le domaine juridique parce qu’on se rend compte qu’on a le support idéal pour supporter des textes de lois.
Le code n’est pas forcément un recueil de texte législatif. De plus il faut distinguer le code de la compilation.
La compilation va être un simple regroupement de textes pour en faciliter la consultation. Une compilation peut être une œuvre publique ou privée tandis que le code est toujours une œuvre publique.
Le code réunit des textes législatifs, réglementaires, et en cela est toujours une loi. Le code est un texte à valeur législative alors quela compilation non. Le code crée le droit alors quela compilation est seulement un regroupement de texte. Cette distinction est moderne, doit beaucoupau code civil de 1804.
Chez les romains, cette distinction est floue. A Rome, le mouvement de codification, c’est-à-dire lanécessité de mettre par écrit pour classer organiser les textes juridiques est un impératif pratique. A partir du IIIème siècle la législation impériale se développe considérablement. Il devientdifficile de consulter ces textes normatifs. Il y abeaucoup d’incertitudes sur le droit applicable. Ilpeut en effet y avoir des contradictions sur ces différentes lois. On a besoin de recueils clairs deces normes impériales. Le but de la codification : rassembler dans un ouvrage unique le droit officielen vigueur afin qu’il soit accessible à tous les praticiens et que les règles soient établies clairement.
A Rome, les premières codifications vont correspondre à des initiatives purement privées et vont dater du IIIème siècle après JC.
Il y a deux premières tentatives de codifications, qui sont deux œuvres privées qui sont plus des compilations que des codifications. Ces œuvres datent de la fin du IIIème siècle ; il y a le Code Hergémonien (294) et le Code Grégorien (291). Ellesavaient une fin pratique et ont été créé par des professeurs. Mais c’était privé.
La première codification officielle intervient au Vème siècle. L’idée de l’empereur de l’époque, Théodose II, est d’affirmer grâce à ce code l’unitéde l’empire romain. C’est une époque où l’empire est scindé en deux ; néanmoins l’empereur d’Orient
Théodose II veut faire une œuvre qui marque l’empire et cette œuvre doit être un code. L’idée, c’est de reprendre dans un seul et même ouvrage l’essentiel de la législation impériale. Il faut classer cette législation. A cette occasion, on va éliminer toutes les mesures désuètes (qui ne servent plus) et on vamême supprimer les contradictions qu’il y a entre les textes. Ce code Théodosien est promulgué en 438, et il va être pendant très longtemps le seul code impérial connu en Occident.
Le droit romain va connaitre une seconde vague de codification qui va intervenir au VIème siècle à l’initiative de l’empereur d’Orient, Justinien. L’empereur de Rome demande alors en 528 après JC à une commission de juristes une immense codificationde textes juridiques. Il veut restaurer la grandeurdu droit romain, donc il veut créer des œuvres qui restent dans le temps. Cette commission travaille vite, sélectionne les textes juridiques, les classe, et va aussi moderniser les règles de droit qu’elle trouve. Cela va aboutit à une œuvre qui va regrouper 4 sources de droit différentes ; cette œuvre est le corpus de droit civil. Les 4 grandes sources de droit sont :
• Les Institutes, publié en 533, est manuel de droit très synthétique destiné à l’usage des étudiants et des praticiens du droit. Cette œuvre-là, de Justinien, recourt aumanuel de Gaius. Il faut savoir que cette démarche est à rapprocher de celle de Napoléon : Napoléon a prescrit lors du code
civil que les étudiants devaient étudier les institutes.
• Le Digeste, publié en 533, est un ouvrage qui rassemble le meilleur de la doctrine, c’est la réunion de tout ce qu’ont écrit les juristes romains. On peut également parler des « pendectes » en grec, qui indique la totalité de ce qui peut être enseigné. C’estune œuvre sans précédent, très ambitieuse, on parle alors de l’œuvre de Justinien. La technique codificatrice a bien été utilisée pour de la doctrine. Quand cette œuvre a été publiée, le Digeste est devenu de la législation étatique, une source de droit.
• Le code de Justinien, promulgué en 534qui est un recueil de constitutions impériales.Il s’agit de réunir tous les textes de loi émanant de l’empereur. On classe et on divise les matières. On élimine tout ce qui ne sert plus.
• Les Novelles, rassemblent les constitutions à partir de 535 jusqu’à la fin durègne de Justinien. C’est ce qui poursuit le code. Correspond plus à une compilation qu’à une codification parce qu’il n’y a pas le même effort de classification. On trouve des textes de valeur inégale.
Les romains ont été les premiers à établir et à classer les différentes manières de créer du droit.C’est ce qui est à l’origine de nos classificationsactuelles des sources du droit. L’œuvre codificatrice des empereurs Théodose et Justinien nous sert de base pour nos codifications notamment pour le code civil de 1804.
Chapitre 2 : la Justice.
La justice ; c’est avant tout l’application du Droit. Elle est conçue à la fois comme une valeur absolue à laquelle tout le monde aspire et va être conçue aussi dans un sens institutionnel. La justice c’est l’organisation judiciaire, tout ce qui attrait aux tribunaux.
Le but de la justice est de mesurer le comportementdes individus par des textes édictés par la cité.
Qu’est-ce que la notion de Justice ?
La justice institutionnelle.
Section 1 : l’approche théorique de la justice
Aristote a beaucoup contribué en matière de justiceen raison de sa sagesse et de sa justesse. Il influence les juristes romains quand ils cherchent à élaborer leur propre définition de la justice et du droit.
Paragraphe 1 : la conception Aristotélicienne de lajustice
Aristote, « Ethique à Nicomaque » ; n’est pas un ouvrage de morale. C’est une description des habitudes, des mœurs, des façons habituelles d’agir. C’est dans cette œuvre la qu’Aristote fait une distinction fondamentale entre la justice générale et la justice particulière.
• La justice générale, exprime la moralité, la conformité de la conduite d’un individu par rapport à la loi morale. La loi morale désigne la somme de toutes les vertus qu’on appelle encore « vertu universelle ». Ainsi un homme juste est un homme pieu, courageux, modeste, prudent, etc. mais attention, la justice générale ne se confond pas totalement avec la moralité. Etrejuste c’est d’avantage être en harmonie, ou en bonne relation avec les autres, avec la cité etmême avec le cosmos selon les grecs. La justicegénérale est extrêmement vaste et dépasse le seul respect du droit ainsi que les lois écrites et non écrites.
• La justice particulière est complémentaire de la justice générale, elle va notamment avoir pour objet de corriger les déséquilibres qui apparaissent lorsque certaines personnes se sont conduites injustement par exemple. Il y a deux types de justice particulière : la justice commutative et la justice distributive.
• La justice commutative :
Pour Aristote, la justice particulière a pour but de donner à chacun ce qui lui est dû, ni plus ni moins. Aristote dit que l’homme juste est celui quia l’habitude de ne pas prendre plus que sa part. Aristote laisse aux juges le soin de déterminer le partage des biens et les charges car une telle tâche ne saurait être l’affaire de particuliers. Lajustice particulière est avant tout l’affaire des juges et des juristes. La justice devient ainsi un art, une activité. L’art du juriste, c’est la capacité de rendre à chacun ce qui lui revient. Le droit va être la mesure du partage des biens. Le juge se trouve la plupart du temps face à deux adversaires qui se disputent par exemple l’attribution d’un bien, ou qui contestent l’existence d’une dette, ou encore la victime demande réparation d’un délit ou la punition du coupable. Donc le juge doit mettre fin au litige, en décidant quelle est la part qui revient à chacun. Par exemple, si deux personnes se disputentl’attribution d’un bien, c’est le juge qui tranche en faveur de l’un ou de l’autre partie. On peut aussi parler de justice réparatrice ou commutative.L’idée c’est de désigner ce travail du juge qui doit trancher dans les procès privés comme dans lesprocès publics et qui donne à chacun ce qui lui revient.
Pour Aristote, cette justice commutative, c’est celle qui ignore les différences entre les individus et qui donne à chacun la même part. Par exemple, si une blessure est infligée, la victime est en droit de demander réparation. Par
opposition, Aristote distingue un autre type de justice : la justice distributive.
• La justice distributive :
La justice distributive se préoccupe de la valeur respective des personnes et de leurs mérites inégaux. Cette forme de justice est fondamentale, et va permettre que la justice particulière rétablisse l’équilibre de la cité entre les membresde la cité pour ainsi garantir le respect du nomos.C’est l’exigence de justice même si elle est sourcede conflit au sein de la cité qui domine la vie et permet seule de réaliser l’être humain. Quand Aristote dit que l’homme est un animal politique, cela signifie que l’homme a besoin du cadre de la cité pour s’épanouir. Mais pour l’homme, vivre ne suffit pas, il faut vivre bien, de s’épanouir et donc selon Aristote de vivre dans une communauté dejustice qui reconnaitra à l’homme sa valeur en lui donnant ce qui lui revient. C’est pour cela que d’après Aristote la cité est nécessaire à l’homme. La justice permet l’équilibre de la cité, qui permet lui de préserver la cité.
Aristote distingue justice particulière et égalité.Il poursuit son analyse, il sait bien que la justice générale c’est le respect de la loi et la poursuite de l’égalité mais dès qu’il aborde la justice particulière, il se rend compte qu’il faut les distinguer de la notion d’égalité.
Aristote a très vite considéré que la justice générale pouvait être la poursuite de l’égalité
mais ce n’est pas forcément la même chose pour la justice particulière.
Sur la justice distributive, il dit qu’elle ne consiste pas seulement à récompenser les bons et à punir les méchants, c’est une notion qui fait intervenir l’idée d’une inégalité ou plus exactement d’une proportionnalité dans la proportion des biens, des récompenses ou des honneurs. Notion qui tient compte des valeurs de chacun. La justice distributive repose sur une sorte d’égalité proportionnelle car le but de la justice n’est pas d’instaurer une égalité absolue mais de rétablir dans la mesure du possible les choses telles qu’elles existaient avant le procès. On essaie d’établir l’état antérieur au procès. Or,au sein d’une même cité, tout le monde n’a pas les mêmes biens ou ne jouit pas des mêmes honneurs, il y a le prestige, la compétence de chacun qui rentreen ligne de compte. Se traduit dans le concept de justice distributive : égalité proportionnelle, n’instaura pas une égalité absolue, rétablie les choses telles qu’elles existaient avant le procès. On peut ainsi parler d’égalité géométrique, égalitéproportionnelle, relative.
On oppose la légalité géométrique à l’égalité arithmétique ; qui est la justice commutative : égalité absolue.
Le juge lors d’un procès tient compte de la situation antérieure au procès, prend ce caractère géométrique de l’égalité lorsqu’il applique la justice distributive. Aristote dit alors que les
citoyens sont inégaux. Au sein de la cité, il y a des différences dans le statut des citoyens.
Justice commutative : introduit une égalité absolue, arithmétique.
Justice distributive : introduit une égalité proportionnelle, géométrique.
Aristote affine d’avantage sa pensée, son raisonnement et ajoute que tout citoyen quel qu’il soit, dispose de la même faculté de soumettre au juge son litige. Il y a également une égalité dans l’application de la loi. Celui qui a commis un crime doit être puni quel que soit son statut social.la sanction est la même pour tous. Il y a bien une combinaison entre l’égalité géométrique etl’égalité arithmétique.
Aristote dit que les citoyens sont égaux et inégaux. Egaux devant la justice mais inégaux sur un point de vue social. Il y a une assimilation entre la justice et le droit. La justice doit aussitenir compte du fait que l’égalité entre les citoyens est dans certains cas géométriques et dansd’autres arithmétiques. Conception de la justice extrêmement riche qui va séduire les juristes romains qui vont la reprendre purement et simplement.
Paragraphe 2 : la justice selon les romains
Pour les romains, la science juridique a un objet extrêmement concret qui est le droit. Les romains raisonnent toujours selon la méthode casuistique : au cas par cas. Ils ont une approche concrète et
pragmatique du droit. Ils définissent tout de même la justice et le droit, et s’inspirent ainsi largement d’Aristote.
Au début du Digeste, Ulpien donne une définition du droit en disant que le droit est l’art du bon et del’équitable. Puis il précise sa pensée en disant que la justice est la volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun son droit. Il ajouteque les préceptes du droit sont les suivants : vivre honnêtement, ne pas léser autrui, avoir à chacun son dû.
Chez les romains comme chez les grecs il y a une assimilation entre le droit et la justice. Chez lesromains, cette assimilation est en premier lieu sémantique : Ulpien dit que le terme « droit » ; « ius », vient de la justice, « iustitia » ; à l’origine le terme « ius » signifie chez les romains une formule religieuse qui a force de loi. Il y a une référence à l’origine au serment religieux. A Rome à l’époque archaïque pour prendreun engagement on utilisait le serment. A l’origine il y a un lieu entre le droit et le serment. Puis le droit s’est laïcisé et à partir de la loi des XII tables, « ius » signifie seulement le droit.
Ce qui est important dans la définition d’Ulpien, c’est le fait que la justice est le fait de rendre à chacun son droit et que le droit est l’art du juste, de l’équitable et du bon. Cette notion d’équité est fondamentale pour l’appréhension de lajustice par les romains. L’équité est le reflet de la primauté du cas particulier sur la règle générale : on prend en compte les situations
particulières. L’équité représente une justice fondée sur l’équité en général, sur des critères telles que la raison, l’équité en général. Le justepour les romains, c’est l’équité.
Le droit dont il est question dans les deux définitions d’Ulpien ; est le droit civil romain : droit applicable aux romains dans leurs relations juridiques, possibilité de faire respecter son droit devant les tribunaux. Il faut comprendre qu’àRome le droit est indissociable de la sanction en justice. C’est parce qu’il existe une action en justice pour la faire valoir qu’une situation est reconnue par le droit. En droit romain il n’y a pasde droit sans action. Il faut que l’action soit inscrite dans l’édit du préteur pour aller devant le tribunal.
Le droit se calque sur la finalité de la justice qui consiste à rendre à chacun ce qui lui est du. Le magistrat organise le procès, le juge rend la sentence, et leur mission est de rendre à chacun cequi lui est du. Pour les romains ce qui est juste c’est ce qui est conforme au droit. Il faut compléter cette idée : si le droit civil est insuffisant pour résoudre une affaire soit sa stricte application serait finalement injuste, alors intervient la nécessité de rendre à chacun cequi lui est du. Il y a le recours à l’équité derrière cette phrase car l’équité permet de corriger cette absence de droit civil ou de contourner une loi injuste. L’équité intervient pour préserver l’équilibre.
Valer Maxime : historien né à la fin du 1er siècle après JC. Raconte l’histoire d’un homme qui se croyait sur le point de mourir. Cet homme veut faire don d’une somme d’argent à sa maîtresse au détriment de ses héritiers. Aux yeux du droit civilromain, ce type de donation est interdit. Pour masque la donation, cet homme reconnait vis-à-vis de sa maîtresse l’existence d’une dette (fictive). L’homme guérit de sa maladie, et comme la perte du gain est importante, la maîtresse est déçue du rétablissement de l’homme. La maitresse va voir un magistrat en se fondant sur la dette fictive.
Sur le plan juridique, le contrat de prêt est valable, il a été fait dans les formes. Le magistrat écoute les deux parties et se rend comptede la véracité de l’affaire. Le magistrat déboute la femme de sa demande au nom de l’équité.
Cette maxime, « rendre à chacun selon son dû » peuts’appliquer à double titre : à celui qui gagne le procès puisqu’on lui restitue son dû, et celui qui perd le procès aussi à ce qu’il mérite puisqu’il a la sanction.
Il faut simplement savoir que derrière les préceptes de vivre honnêtement, ne pas léser autruietc., il y a l’influence des stoïciens, du « bon père de famille » : c’est une morale qui sert de mesures aux différents comportements en société quipassent devant le juge. Le juge va juger en fonction de cette étique qui va lui servir de pointde repère, de mesure.
Section 2 : l’organisation de la justice
Au fil de l’histoire on trouve trois manières de régler un litige.
• Tout d’abord, il y a la vengeance, quiest le premier mode connu par les hommes des règlements des litiges : la victime ou sa famille inflige aux délinquants ou à sa familleun traitement destiné à réparer ou à compenser le dommage initialement subi. C’est le principede la vengeance. Ce traitement peut être équivalent à celui qui a été subi : vengeance du Talion : « œil pour œil dent pour dent ». letalion est un système répressif qui consiste à punir l’offense d’une peine identique à cette offense. Le terme « talion » vient de « talis »qui signifie pareil.
On exprime très souvent cette loi du talon par une formule biblique « œil pour œil dent pour dent ». Avec le système du talion on a un système de vengeance qui intervient. Ce n’est plus de la vengeance privé puisqu’une autorité supérieure intervient pour vérifier la mise en œuvre du talionvoir pour prononcer la peine. Le talion ne justifiepas la vengeance, au contraire la loi du Talion vise à codifier rationnellement, à encadrer les limites des représailles autorisées. Il y a une symétrie qui va garantir le principe équitable de la juste proportionnalité du crime et du châtiment.L’idée est de ne pas demander plus qu’un œil pour un œil, qu’une dent pour une dent, etc. l’important, c’est la symétrie, la proportionnalitéentre le crime commis et le crime infligé.
Loi du talion trouvée en Mésopotamie, dans le code d’Hammourabi (souverain de Babylone). Le roi de Babylone avait créé cette loi pour limiter la vengeance privée et cela introduit un début d’ordredans la société. On trouve des applications concrètes de cette loi.
Par exemple le constructeur d’une maison voit cettedernière s’effondrer et en s’effondrant elle entraine la mort du propriétaire, du fils du propriétaire ou même de l’esclave. Il est inscrit dans le code d’Hammourabi que c’est le constructeurqui doit être condamné à mort, c’est le fils du constructeur qui est condamné à mort si le fils du propriétaire est mort et si c’est l’esclave du propriétaire qui est mort l’esclave du constructeursera vendu.
Dans le Pentateuque, (les 5 premiers livres de la Bible). La loi du Talion revient dans l’Exode, dansle Lévitique, chacun est mis à mort pour son proprecrime, son propre péché. Dans le nouveau testament recommande de s’y opposer.
La loi du Talion, pour Kent, est un principe d’équivalence rigoureuse entre le délit et la sanction. C’est le degré de châtiment que la justice publique doit se donner pour principe et pour référence.
A partir de l’apparition de ces cités, de ces royautés, progressivement on va remplacer la vengeance ou le talion à la compensation pécuniaire. Initialement, poéna signifie le rachat
de la vengeance, c’est la somme d’argent qu’on doitverser afin qu’il n’y ait pas de vengeance.
• On voit apparaitre un deuxième moyen de régler un litige qui est le recours au tribunal.
Il s’agit d’une justice populaire à Rome.
La justice à Rome est le fait de spécialistes du droit et de particuliers comme tout à chacun, elle ne dépend pas du peuple. Tout notre vocabulaire vient de Rome.
• l’arbitrage est un mode alternatif de résolutions des conflits : un arbitre intervient pour prendre les décisions ; les deux parties choisissent de confier le règlement de leur litige à un arbitre qui devrarendre une sentence : mode extra-judiciaire de règlement des litiges, on n’est pas devant un tribunal.
Paragraphe 1 : le procès civil.
La justice civile est celle rendue entre les particuliers pour régler des questions civiles c’est-à-dire les questions concernant la propriété privée, la famille, les contrats et les délits privés. Les délits privés sont ceux qui ne font pasl’objet d’une procédure criminelle comme le vol, les injures et les dommages causés aux personnes ouaux choses.
Pour parler le procès on parle de judicium, ce terme la vient de jurisdicio, juridiction.
Rome va connaitre trois types de procédures.
• La procédure des actions de la loi : procédure de l’ancien droit romain.
Période : de 753 avant JC jusqu’au milieu du 2ème siècle avant JC. Elle est destinée à sanctionner les droits reconnus par la loi elle-même. Le terme d’ « action de la loi » désigne les procédures judiciaires et plus précisément les formalités requises pour le déroulement d’un procès. C’est uneprocédure légale, elle n’a pas été créée à partir de rien, ex nihilo. C’est une procédure reconnue par la loi et donc une procédure qui est envisagée dès la loi des XII tables. Cette procédure est la seule voie que les particuliers peuvent utiliser pour faire valoir leurs droits.
Si un particulier veut agir en justice, la prétention qu’il veut faire valoir doit rentrer dans le cadre d’une des actions de la loi qui existe.Ce plaideur devra effectuer tout un tas de formalités afin que sa demande corresponde à une des actions de la loi. Il s’agit de procédures orales et extrêmement formalistes. Seul finalement le rituel de formalité est apte à entamer la procédure. Ces formalités consistent principalementdans le prononcé de paroles solennelles et dans l’accomplissement de certains gestes. Ce formalismeest contraignant pcq s’il y a une petite erreur de commise, la procédure est interrompue. On ne pourrapas agir deux fois pour la même cause.
Il y a trois actions de la loi qui peuvent faire valoir la loi à Rome :
• Le sacramentum : procédure générale qui est censée permettre de sanctionner n’importe quel droit réel ou personnel. C’est un serment. Ces deux personnes vont se présenter devant le juge et vont prêter serment. C’est au juge de dire lequel des deux serments est juste. C’est une sorte de pari, qui est une somme d’argent.
• La demande de juge ou d’arbitre : domaine d’action plus restreint puisqu’elle ne sanctionne que les créances nées d’un contrat solennel verbal.
• La condictio : terme qui signifie « réclamation » : c’est la plus récente des actions de la loi, c’est une procédure abstraite qui prend en charge la sanction de toutes les créances certaines : qui est souventune dette d’argent : portant plus généralement sur une quantité certaine de choses fongibles.
A partir du 2ème siècle avant JC, on subit la conséquence d’une nouvelle procédure civile. Cette nouvelle procédure, qui vient simplifier le procès civil est la procédure formulaire qui est animée par le préteur.
• la procédure formulaire.
Le juge dans la seconde phase du procès a reçu une instruction écrite appelée formule, délivrée par lepréteur lors de son travail d’enquête.
La formule peut être deux choses : ça peut être l’action telle qu’elle figure dans l’édit du préteur ; et l’acte délivré par le préteur qui va nommer le juge et lui donner en quelque sorte l’ordre de juger, de prononcer la sentence. La rédaction de la formule va avoir lieu pendant la phase qui se déroule devant le magistrat. Cette procédure formulaire dure jusqu’au IVème siècle après JC.
Ces deux premières procédures sont des procédures formulaires, à l’opposition de la procédure extraordinaire.
La procédure extraordinaire apparait sous l’empire et surtout se développe à partir du IVème siècle après JC. Elle est le résultat du développement progressif du pouvoir de l’empereur en matière judiciaire. C’est la grosse révolution puisqu’il n’y a plus qu’un juge unique qui prend en charge tout le procès.
• La procédure ordinaire
Il va y avoir deux grands principes directeurs valables qui sont d’une part la division du procès en deux phases, et d’autre part l’intervention active des parties dans le déroulement du procès.
• La division du procès en deux phases :
On distingue dans le procès romain ordinaire deux phases chronologiques : une première qui se dérouledevant le magistrat et une seconde qui se déroule devant le juge. La tâche d’organiser le procès
appartient aux magistrats (supérieurs : préteur). Cela peut être le préteur urbain chargé d’organiserle procès entre citoyens romains et le préteur pérégrin chargé de procès entre romain et étranger.
• La première phase s’appelle « in iure » ; « devant le magistrat ».
Les deux parties au procès, commencent par dire leurs arguments et le magistrat va organiser la procédure en fonction de la situation.
A partir du moment où toutes les formalités sont accomplies, on ne peut plus rien ajouter ni rien retrancher. A partir de là, une fois les formalitéstoutes accomplies, le magistrat va prendre pour témoin les assistants pour la régularité des formalités accomplies et de l’opposition des deux adversaires.
Le magistrat désignera le juge qui sera responsabledu jugement dans la seconde phase du procès.
Pour la procédure formulaire, les parties viennent trouver le préteur pour exposer leur cas : soit l’affaire correspond à une des actions figurant dans l’édit, le préteur va délivrer la formule qui va permettre la phase du jugement soit on a une affaire pour laquelle il n’y a pas d’actions correspondant à l’édit du préteur, qui peut choisirde créer une action ou de ne pas le faire. S’il choisit de créer une nouvelle action, il rédigera une formule ce qui fait que le procès pourra continuer dans sa deuxième phase.
La rédaction de la formule, ça veut dire que la première phase du procès est terminée, clôturée et que pendant la deuxième partie ils se rendent devant le juge.
• On dit que cette phase est « apud iudiceum » qui signifie « devant le juge ».
Ce juge n’est pas un professionnel : c’est un simple particulier choisi par le magistrat. Ceux qui étaient désignés comme juge étaient alors des sénateurs ou des membres de la noblesse romaine. Lejuge tranche définitivement le conflit. Cette seconde phase du procès est dénuée de tout formalisme. Le juge écoute les parties, éventuellement les parties peuvent être représentées par un avocat mais ce n’est pas obligatoire. Les parties apportent leur preuve afinque le juge puisse se prononcer. A l’issue de l’audience, le juge doit condamner ou absoudre. Il est obligé sinon il risque le déni de justice. Le juge doit obligatoirement délivrer une sentence. Qu’il s’agisse du magistrat ou du juge, ils participent tous deux activement au procès. A la différence d’aujourd’hui, les autorités publiques ne prennent pas en charge toutes les phases du procès et il y a une partie active du procès.
• L’intervention active des parties au procès.
Le but du procès est de régler les différends, maisla cité ne s’occupe absolument pas de la comparution des parties devant le magistrat ou le juge. L’autorité publique ne s’occupe pas de faire
comparaitre les parties devant le magistrat ou le juge, ne s’occupe pas de la sentence.
• La comparution :
L’assignation en justice se fait sans l’intervention du magistrat, sans l’intervention même d’un quelconque auxiliaire de justice. Les préliminaires du procès sont purement privés : c’est au demandeur d’assurer la comparution de son adversaire devant le magistrat : cette comparution est obligatoire. Il ne peut pas y avoir de comparution par défaut et en principe il n’y a pas de représentations possibles ; les deux plaideurs doivent apparaitre devant le magistrat. Si l’adversaire oppose : le demandeur doit guetter sonadversaire dans un lieu public et devant tout le monde, il l’appelle en justice. Si le défendeur ne répond pas à cet appel, le demandeur peut alors le trainer de force devant le magistrat. Pour échapperà cette contrainte brutale le défendeur peut fournir un garant qui s’engage à obtenir sa comparution à une date ultérieure. Une fois qu’ils arrivent devant le juge, on sait quelles sont les prétentions des parties et le juge n’a plus qu’à trancher même si une partie n’est pas présente devant le juge. Si une des parties ne se présente pas devant le juge sans excuse valable, il perd le procès.
• L’exécution de la sentence :
C’est à la partie qui a gagné d’assurer l’exécutionde la sentence. Il y a la contrainte par corps qui
est l’exécution sur la personne. Cette contrainte est décrite dans la loi des XII tables, elle intervient quand celui qui est condamné par un jugement refuse la sentence. On laisse un délai de 30 jours pour exécuter la sentence et au bout de 30 jours le gagnant doit retourner de nouveau devant le magistrat pourréengager une procédure judiciaire. Une fois rendu devant le magistrat, il prononce un certain nombre de paroles et il va pouvoir en toute légitimité mettrela main sur le perdant au procès. Mettre la main sur lui signifie qu’il va pouvoir amener le débiteur, le perdant au procès chez lui enchainé etle garder dans une prison privée pendant 60 jours. La loi des XII tables précise le poids des chaines et la quantité de pain à lui donner chaque jour. Pendant ces 60 jours le créancier doit présenter ledébiteur durant 3 marchés successifs. Publiquement le créancier proclame que la personne enchainée lui doit tant d’argent. Si les 60 jours s’écoulent sans que personne ne se soit manifesté, le créancier peut enfaire ce qu’il veut : le vendre comme esclave, le faire travailler pour rembourser sa dette ou le mettre à mort. Mesure de la loi qui propose le cadavre du débiteur au prorata des créances. Mais cela n’a jamais été mis en pratique.
Dans ce système le débiteur répond de sa dette uniquement sur sa personne et cette exécution peut être d’avantage perçue comme une peine que comme une voie d’exécution. Dans l’ensemble il faut bien reconnaitre que pour éviter cette contrainte le perdant au procès, le débiteur exécutait son obligation la plupart du temps ou alors il trouvaitun garant qui allait payer sa dette. Les
conséquences très rigoureuses de cette loi d’exécution vont s’adoucir avec le temps et particulièrement avec l’arrivée de la fameuse procédure formulaire donc à partir des IIème et IIIème siècle après JC. Cette possibilité de se saisir de la personne du débiteur va être remplacé par une véritable action en exécution et à partir de ce moment-là, le perdant au procès qui n’exécutepas sa sentence risque toujours la prison privée ducréancier : il va être frappé d’infamie mais il n’est plus question ni d’esclavage ni de mise à mort. A partir de là, cette procédure d’exécution sur la personne constitue d’avantage un moyen de pression. Petit à petit, on admet que le perdant au procès peut s’opposer à une éventuelle voie d’exécution sans avoir besoin d’un garant. Il pourra même éviter d’être incarcéré par le gagnant au procès en procédant à une vente de ses biens. Quoiqu’il en soit, même si cette exécution sur la personne s’adoucit au fil dutemps, elle va se maintenir tout au long du droit romain. Cependant elle va être concurrencée par l’apparition d’une autre voie d’exécution qui est sur les biens du débiteur (du perdant au procès) à partir du IIème siècle avant JC. Il y a bien eu avant unepremière forme d’exécution sur les biens, dès la loi des XII tables mais cela s’appelait « la prise de gage » ce qui signifiait qu’il y allait avoir une saisie de biens mobiliers appartenant au débiteur qui, s’accompagnait d’un rituel où il fautprononcer des paroles solennelles. L’idée, c’est bien de forcer le perdant au procès à exécuter la sentence et donc à acquitter sa dette. S’il paie ce qu’il doit, il retrouvera l’objet qu’on lui a pris. Le problème, c’est qu’au moment où cette voie d’exécution sur les
biens est apparue, cela concernait surtout les créances de l’Etat comme c’était le cas pour quelqu’un qui n’avait pas payé ses impôts. Au débutil y a bien une voie d’exécution sur les biens qui existe mais elle est assez restreinte puisqu’elle ne concerne que les créances de l’Etat. Puis avec le début de la procédure formulaire, on voit apparaitre une véritable voie d’exécution sur les biens grâce à l’intervention du préteur. Cela s’agira de vendre en bloc le patrimoine du débiteur. Il y a des étapes dans cette vente ; toujours lors d’un procès :
1) Le préteur commence par envoyer le créancier, legagnant au procès en possession des biens du perdant. (On autorise le créancier à prendre les biens du perdant) la personne est solvable puisqu’elle n’a paspu acquitter son endettement. Le créancier s’empare ainside tous les biens du perdant, il s’agit d’une sortede saisie conservatoire en bloc. L’idée, c’est d’assurer une sorte de publicité de la procédure pour tous les autres créanciers éventuels. On cherche ainsi à contraindre le perdant à s’exécuter.
2) Ensuite, si le débiteur, le perdant, persiste à ne pas exécuter la sentence, à ne pas payer, on meten vente tous ses biens aux enchères. Le patrimoineest adjugé au plus offrant.
3) Ensuite, c’est la liquidation : celui qui a acheté les biens du débiteur va exercer tous les droits et actions possibles. Il va payer les créanciers éventuels, dans la limite de l’actif
disponible. Il peut faire tout ce qu’il veut de ce patrimoine, la seule condition est de payer ce qui est dû. Celui qui perd le procès est frappé d’infamie et s’il devait de l’argent à plusieurs personnes et que toutes ces personnes n’ont pas étépayées, il n’est pas libéré.
L’évolution de cette procédure fait qu’on est en face d’une vraie voie d’exécution. Le but de la procédure est bien l’exécution de la sentence, il faut que l’argent qui était dû soit versé. Le problème majeur c’est qu’il y a une vente en bloc du patrimoine du débiteur même si l’argent dû était une toute petite somme. Cette procédure s’affine avec le temps, dansle droit romain tardif, et il y aura notamment une possibilité de ne saisir que certains biens du débiteur justement au lieu de s’emparer de la totalité de son patrimoine. Quoi qu’il en soit, à partir du moment où on est dans une exécution forcée, c’est une solution qui n’est pas très satisfaisante, le mieux est l’exécution volontaire de la sentence. Il faut avec l’exécution involontaire corriger celui qui n’a pas exercé la sentence.
• La procédure extraordinaire
On appelle cette procédure extraordinaire simplement parce qu’elle s’est développée en marge du procès civil ordinaire. C’est une procédure qui correspond au développement progressif du pouvoir judiciaire de l’empereur. Elle a été introduite pour sanctionner de nouveaux cas que la pratique judiciaire antérieure avait jusqu’alors ignorée. Avec le développement de cette nouvelle procédure,
on voit que l’organisation judiciaire donne naissance à de nouvelles formes juridiques en margede la loi. Cette procédure est intéressante car lesgrandes lignes du procès civil sont différentes du procès ordinaire. La principale différence avec le procès ordinaire c’est qu’ici le procès est confié à un juge unique qui ne sera plus lié par la formule puisque cette dernière n’existe plus et qu’il ne sera plus lié non plus par le principe de la condamnation pécuniaire. Ce juge sera en quelquesorte un juge fonctionnaire, employé de la nouvelleadministration de l’empire et ce juge pourra parfois être remplacé par l’empereur lui-même.
Avec le développement de l’empire, la justice devient, en ce qui concerne le procès civil, un service public. Elle va placer des moyens de contrainte à la disposition des particuliers.
Le procès n’a qu’une seule phase. En théorie, le justiciable au lieu d’aller devant le préteur et derecourir à la justice ordinaire, va aller trouver l’empereur pour lui exposer son affaire. L’empereurva directement juger le litige. En pratique cela ne se passe pas comme cela : l’empereur ne peut pas recueillir toutes les plaintes du domaine civil quiémane de partout dans l’empire. L’empereur désigne ainsi un juge et lui confie alors l’affaire. C’est à ce moment-là que nait la délégation du pouvoir dejuger. A partir de là, toute une organisation hiérarchique se met en place : on nomme des juges et au sommet de ces juges il y a l’empereur. Le procès n’est plus scindé en deux : c’est le juge désigné
par l’empereur qui s’occupe de tout. La procédure est plus simple mais aussi plus autoritaire.
Le rôle du juge devient fondamental, il représente l’autorité publique puisqu’il a reçu une délégationdu pouvoir de juger de la part de l’empereur. Il a donc le pouvoir, la faculté d’assurer lui-même la comparution des parties et l’exécution de la sentence. Il y a une accentuation du caractère autoritaire et étatique. Finalement, il y a eu toute une évolution de la procédure civile qui est passée d’une justice laissée initialement aux parties à une justice d’état. Tout est aux mains dujuge qui représente l’empereur, l’autorité publique.
Concrètement, l’introduction du procès se fait à lademande d’un particulier soit par une citation privée (le demandeur va parler en son nom propre) soit parune citation officielle (le juge intervient pour démarrer,introduire le procès mais c’est toujours à la suite d’une requête d’une des parties). Les actions restent les mêmes, c’est-à-dire qu’on a toujours grâce à l’ancien édit du préteur un stock d’actions dans lequel on peut puiser, mais ce n’est plus un programme préétablit.Néanmoins on se tourne toujours vers l’ancien édit du préteur et le demandeur au procès doit choisir l’action grâce à laquelle le juge prononcera le jugement. Néanmoins, tout le reste évolue : l’efficacité du jugement lui-même s’est transformé.En effet désormais il y a une exécution possible par voie d’autorité : l’état peut contraindre les parties à s’exécuter. C’est une différence sensible avec laprocédure antérieure. Enfin, avec cette procédure
extraordinaire, l’idée d’appel apparait. En gros, le justiciable mécontent d’une décision va pouvoir faire appel auprès d’un autre juge. Dans ce cas la première sentence est réformée et un nouveau procèscommence devant un juge de rang supérieur. L’idée, c’est à nouveau de trancher l’affaire au fond. C’est vraiment une innovation puisque c’est l’unification du procès devant un juge unique et c’est la hiérarchie des juridictions qui permettentl’introduction de la procédure d’appel. A partir delà il faut bien comprendre que l’appel devient la voie de recours normale. C’est grâce à l’introduction de l’appel que l’unité du droit va être sauvegardée. On voit apparaitre tout un tas dejuge partout dans l’empire donc grâce à l’introduction de l’appel, redonne une certaine cohésion au système. C’est surtout en matière pénale que l’appel va être important.
Paragraphe 2 : le procès pénal.
A la différence de la justice civile, la justice criminelle à Rome n’a jamais été l’affaire des particuliers. Dèsl’époque royale, l’organisation de la justice criminelle, pénale, est entièrement prise en chargepar l’état. En matière criminelle, l’enjeu dépasse largement le règlement d’un différend entre particulier. La gravité des faits commis menace la communauté toute entière et c’est pour cela que cette justice relève exclusivement de l’état. On vadistinguer une procédure ordinaire et une procédureextraordinaire qui correspond aussi à la justice impériale.
• La procédure pénale ordinaire à l’époque républicaine
Dès l’époque royale, la répression des crimes étaitaux mains de l’état. Tout le déroulement du procès pénal est assuré par le roi sous la royauté, et puis dès les débuts de l’époque républicaine tout le déroulement du procès pénal est assuré par le magistrat, il n’y aura pas de divisions du procès en deux phases. C’est le magistrat qui va organiserle procès mais ce ne sera pas lui qui va prononcer la peine au final. La loi des XII tables confie à l’assemblée du peuple le monopole du prononcé de lapeine capitale. Ce sont les comices centuriates quise voient donc réserver le jugement des crimes lorsque c’est la peine de mort qui doit être prononcée. Lorsque la peine se résume à une lourde amende, ce sont les comices tributes qui agissent. Les comices centuriates vont intervenir quelle que soit la nature du crime (politique ou de droit commun). Ce système fonctionne tel quel jusqu’à la fin du IIème siècle avant JC. Dans ce système, on a un magistrat qui est compétent pour instruire le procès. On dit d’ailleurs que la procédure est inquisitoire c’est-à-dire que le magistrat peut se saisir d’office de toute affaire. (Quand il faut une action d’une des parties on parle de procédure accusatoire). Le magistrat instruit l’affaire et il est ensuite relayé par les comices, par les assemblées du peuple. A partir de 300 avant JC, tout accusé va pouvoir faire appel au peuple des décisions prononcées par le magistrat. Jusque-là, pour certains crimes, pour tous ceux n’entrainant pas la peine de mort ou une très lourde amende, le magistrat pouvait mener le
procès jusqu’à son terme et prononcer la sentence. Possibilité de faire appel devant les assemblées dupeuple de toutes les décisions prises par les magistrats. L’activité judiciaire des comices devient importante à partir de là, et même peut être trop importante. Au fur et à mesure que le temps passe on a tendance à Rome à étendre la citoyenneté. Il y a de plus une tendance certaine àqualifier comme crime public des infractions de plus en plus nombreuses. Les comices, les assemblées populaires, qui ont un rôle en matière judiciaire, vont se trouver débordés. Donc, on va trouver un système pour soulager les comices : on va créer de ce fait des jurys criminels permanents à compétence spécifique. Ces jurys vont apparaitre vers 150 avant JC.
Quaestiones : vient de « quaestio » qui signifie « enquête ». On a un type de crime dont la poursuite est affectée à un jury particulier. A partir de 150 avant JC le juge ne juge plus, il est remplacé par les Quaestiones, par ces jurys, qui sont constitués d’environ 50 membres, on les choisit parmi l’ordre sénatorial et on les place sous un préteur. Il y a un jury par crime. Il y a une multiplication des jurys et des chefs d’accusation. C’est un grand progrès du droit criminel romain. Le gros changement introduit par la procédure devant ces jurys, c’est que l’on est maintenant dans une procédure strictement accusatoire. Ça va être à un particulier de lancer une accusation. L’idée, c’est qu’un malfaiteur, s’il n’est pas accusé, ne peut pas être condamné. Pour qu’une infraction soit réprimée il faut qu’un
particulier en soutienne l’accusation devant un jury. Il faut jouir de la pleine capacité juridiqueet à partir du moment où on est citoyens on peut intenter une action, c’est ce que l’on appelle l’action pénale populaire. Là, on touche à quelque chose de typique des institutions républicaines telles que les romains les concevaient. L’idée, c’est que chaque citoyen doit se sentir responsablede l’ensemble de l’ordre public. Toute violation dela loi est censée le concerner directement. A Rome le citoyen qui exerce une action est un ministère public. Le ministère public incombe à l’ensemble ducorps civique.
Un citoyen peut porter une accusation, et à partir du moment où il accuse, il représente la cité touteentière, donc il va être astreint à des devoirs précis. L’accusateur ne pourra pas abandonner l’accusation avant le terme du procès, il ne pourrapas non plus se servir de l’accusation pour favoriser un coupable. Surtout, cet accusateur doitêtre sincère. Il faut ainsi établir cette sincérité. Le citoyen qui porte une accusation doitprouver de sa sincérité, et pour cela il doit prêter un serment appelé « le serment de calomnie ». Il juge que son accusation n’est pas calomnieuse et du coup il se soumet à la peine prévue pour les calomniateurs. Une vieille loi républicaine prévoyait que dans ce cas, l’accusateur devait subir la peine qu’aurait encourue l’accusé s’il avait été coupable. Pendant l’audience, les débats sont contradictoires et la preuve est libre. C’est pour cela qu’on voit multiplier à cette époque le recours aux avocats,
aux spécialistes du droit qui maitrisent l’art du discours, de convaincre et de persuader, l’art de la rhétorique. Jusqu’alors il n’y a avait pas d’obligation d’avoir un avocat, mais cela est très utile. Cicéron, était avocat. Procédure moins complexe qu’auparavant, puisqu’on évite le maniement très lourd de l’assemblée des comices mais le système des jurys présente de gros inconvénients.
1) Les jurés, ne jouissent d’aucune liberté dans lafixation de la peine. Le tribunal, le jury est prisonnier d’une alternative étroite : soit il acquitte purement et simplement, soit il administrela peine légale sous forme de mort la plupart du temps ou éventuellement sous la forme de la peine de l’eau et du feu. Le jury ne peut pas tenir compte des circonstances objectives du crime.
2) il faut être très sûr de soi pour lancer une accusation, le système intimide les accusateurs puisqu’il y a le risque de se voir menacer de la peine de la calomnie si on considère que c’en est une. Si l’affaire est connue et sure, il y a beaucoup d’accusateurs. Système pas si fiable que cela, on a toujours le rôle du préteur qui mène l’instruction, qui prépare l’accusation mais qui neva pas participer lui-même au jugement puisque c’est le jury qui s’en charge.
3) devant ces jurys, le droit de recours n’existe pas : ces jurys sont censés rendre une décision souveraine du peuple.
Ce système des jurys va être repris avec l’avènement de l’empire avant même que l’on voit surgir une procédure extraordinaire.
L’efficacité de ces jurys parait avoir été assez faible.
Lors de l’avènement de l’empire, le 1er empereur deRome, auguste, commence par consacrer ce système des jurys, il reprend ce système sans faire de retouches fondamentales. Reprend l’organisation de la justice criminelle de la république mais en ajoute deux nouveaux : un qui est le tribunal de l’adultère, qui est un délit public (adultère féminin) ; et un tribunal « de l’annone » qui est censé réprimer toutes les malversations destinées à faire varier le coût du blé. En apparence il y a un maintien de la justice républicaine, mais il ne faut pas tellements’y fier parce qu’avec le passage à l’empire il existe aussi une procédure extraordinaire.
• la procédure pénale extraordinaire
Il se passe en matière pénale un peu ce qu’il s’estpassé en matière civile : le pouvoir judiciaire de l’empereur se développe. L’empereur va avoir un droit « d’évocation » des affaires, ce qui veut dire qu’il attire à lui une partie des crimes qui auraient dû être jugés par les fameux jurys permanents notamment les crimes d’aise majesté : une personne de la famille de l’empereur est concernée. L’empereur prend aussi pour lui tous lesnouveaux cas qui ne sont pas prévus par la loi. Agissant ainsi, l’empereur se place au sommet de larépression pénale.
Il va même créer un tribunal suprême impérial qui finalement vient se placer au-dessus de tous les juges de l’empire, ce qui permet d’abandonner l’ancien système républicain. L’appel va ainsi se développer devant ce tribunal impérial donc on voitapparaître en matière pénale une justice à deux degrés. Il y a bien une unité du droit qui se créée au seindes mains de l’empereur parce qu’il vient à contrôler toute l’organisation judiciaire qu’il s’agisse du droit privé ou du droit criminel. Cependant l’empereur ne peut pas tout faire tout seul et il délègue alors une partie de son pouvoir à des juges permanents. Ces juges jouissent d’une grande latitude dans la détermination de la peine. Ils sont un peu libres de faire ce qu’ils veulent en matière de peine, et on se rend compte qu’à partir du 2ème siècle après JC que les peines vont varier selon les juges mais aussi selon la condition sociale des accusés. On va voir que les juges infligent des peines plus légères aux plus riches alors que les plus humbles sont victimes de discrimination. Dès cette époque on a tendance à assimiler les classes les plus humbles de la population à des classes dites dangereuses.
L’empereur délègue son pouvoir à des juges permanents qu’il choisit et qui ont beaucoup de pouvoir en matière d’administration de la peine. Grâce à la hiérarchisation des tribunaux et du tribunal suprême, (impérial) il y a l’appel. L’empereur, qui a un pouvoir impérial de juridiction, peut toujours réformer les décisions des juges qui ne sont finalement que ses délégués. En matière pénale les conditions de l’appel étaient
très strictes (celui qui a avoué ne peut interjeterappel etc.).
On voit apparaître le Sénat en matière de procédurecriminelle à l’époque impériale. C’est une rupture avec la procédure traditionnelle. Dès que l’on a affaire à un crime important, surtout politique, les Qaestiones vont perdre leurs compétences, ils vont être dessaisis de l’affaire et c’est le sénat qui va agir, pour répondre aux vœux de l’empereur.
Il va prendre deux grands types de crimes en charge :
• les accusations de l’aise majesté (quand l’empereur décide de ne pas traiter l’affaire).
Les accusations de l’aise majesté sont des conceptsd’atteinte aux intérêts de l’état comme la désobéissance ; crime qui devient de plus en plus important puisqu’au fil du temps il y a une confusion de plus importante entre l’empereur et l’état. L’atteinte à la dignité de l’empereur vaut comme crime contre l’état. Les écrits, les propos diffamatoires contre l’empereur aussi, ou encore les injures à la mémoire de l’empereur etc.
• Il y a des crimes de concussions : c’est un abus de pouvoir par un homme haut placé, qui occupe un emploi public comme un magistrat par exemple. C’est un abus de pouvoirpour extorquer de l’argent. C’est un crime de telle importance que c’est le sénat qui le prend en charge, mais ce n’est pas une menace
pour l’empereur puisqu’il a tout fait pour engager cette compétence criminelle du sénat.
L’empereur, Auguste mais surtout Tibert, comprend qu’il faut que l’aristocratie sénatoriale soit associée aux châtiments des crimes les plus graves.L’intérêt, c’est que cela permettra d’estomper des contours un peu trop monarchiques du régime. Auguste, pour conquérir le pouvoir, s’y est pris endouceur et pendant une longue partie de son règne concerne les institutions républicaines pour ne pasmontrer qu’il s’agit d’une monarchie donc met le sénat pour les matières criminelles.
Cette procédure donne une nouvelle forme au procès pénal. A nouveau, la procédure redevient inquisitoire. (Accusatoire devant les jurys permanents). L’idée, c’est que pour réprimer efficacement les délits publics les juges impériauxreçoivent le pouvoir de recherche d’offices les auteurs de crime. Le juge peut ainsi se saisir lui-même d’une affaire. On peut encore porter une accusation pour les jurys permanents.
Le procès pénal extraordinaire va faire apparaitre un nouveau mode d’investigation qui est la torture.A priori, à l’époque républicaine, la torture étaitinterdite pour les citoyens (dans le cadre d’un procès) par contre elle était infligée aux esclavesparce qu’on considérait qu’ils étaient incapables de dire la vérité s’ils n’étaient pas torturés, même pour un simple témoignage. La torture était alors infligée aux esclaves pour avoir des témoignages et non infligée aux accusés. Mais les citoyens vont grâce à la procédure extraordinaire
être soumis aux Qaestio, à une question qui est la torture. Toutes les accusations de faux, de magie, d’empoisonnements, de fausse monnaie, on peut recourir à la torture contre les citoyens. Le procédé se développe et très vite on décide que l’on peut recourir à la torture pour de simples délits d’opinion par exemple à quelqu’un qui refused’honorer une statue de l’empereur (chrétien). On étend la possibilité de recourir à la torture à descrimes plus « communs » comme l’homicide ou l’adultère. A l’époque tardive, les citoyens les plus éminents sont exemptés de la torture, sauf dans les affaires de l’aise majesté. La torture devient un procédé général et habituel d’investigation pénale. Cela va jusqu’au point qu’en 314, l’empereur Constantin fera de l’aveu extorqué, c’est-à-dire l’aveu obtenu par la torturela preuve par excellence du crime.
• l’administration de la peine
En ce qui concerne la peine, la loi du talion a étéévoquée. A Rome à partir de la loi des XII tables, le talion pouvait s’accompagner d’une peine en argent, la compensation pécuniaire, la poena (qui signifie somme d’argent) que l’on inflige à l’issued’un procès. A l’époque archaïque en droit romain, lorsqu’un délit est commis par une personne qui n’est pas juridiquement capable comme un fils de famille ou un esclave, quelqu’un qui se trouve dansla puissance d’autrui ; alors à ce moment-là c’est le père de famille ou le maître de l’esclave qui est responsable pécuniairement du paiement de la poena, de la compensation pécuniaire. S’il refuse de payer, il peut à ce moment-là abandonner à la
victime, son fils ou son esclave responsable du délit, c’est ce que l’on appelle l’abandon noxal. La victime peut ainsi faire ce qu’elle veut de la personne qui lui a commis préjudice. C’est une mesure très dure, et l’abandon noxal est une des caractéristiques les plus fondamentales du droit archaïque romain. Si le fils ou l’esclave vient à mourir avant le règlement de l’affaire, le père peut encore se libérer de sa responsabilité en abandonnant le cadavre ou une partie du cadavre. Ledroit romain se dégage de ces attitudes primitives et il va dégager le principe de la personnalité despeines au fil du temps. Le père ne sera plus tenu responsable du crime commis par son fils ou par sonesclave.
A l’époque classique, ce qui est intéressant, c’est qu’il y a dorénavant une personnalité des crimes etdes délits : on est responsables de ce que l’on a fait. Le problème se pose dès que l’intérêt public est touché. Dès les origines de Rome, on considère que dès qu’un crime ou un délit touche les intérêtspublics, il faut éliminer le coupable pour ramener la paix à Rome et apaiser les Dieux. Cette idée se maintient très fortement avec le temps, ce qui faitqu’à l’époque classique, on va voir se renforcer cesoucis de défendre l’ordre public par une répression exemplaire et dissuasive. A partir de l’époque classique la peine doit servir d’exemple et devenir dissuasive.
Au 1er siècle avant JC, Cicéron recommande aux magistratsde contraindre les citoyens désobéissants par des amendes, des chaînes ou des coups de fouet. A
partir de là, le vocabulaire du droit pénal se diversifie et on voit apparaître des termes qui impliquent que le châtiment doit frapper les coupables mais aussi avertir, prévenir les malfaiteurs potentiels. Cicéron dira que la république ne pourrait être gouvernée sans crainte ni vérité donc on va créer des prisons, infliger des supplices, etc.
Un peu plus tard, en pleine époque classique, Sénèque dira que la peine à trois fonctions : - elle doit corriger celui qu’elle frappe ; -rendre les autres meilleurs par l’exemple du châtiment ; - assurer l’ordre public par la suppression des méchants.
A partir de l’époque classique, on se rend compte et notamment à partir de l’empire que la peine de mort devient de plus en plus fréquente. Pendant toute la période républicaine il y a eu peu de peine de mort à l’encontre des citoyens. A côté de ces peines capitales (peine de mort et peine de l’interdiction de l’eau et du feu) on voit apparaitre des châtiments corporels dont l’éventailva être assez varié. L’idée, est de frapper les esprits. Il est écrit dans le Digeste, que les assassins de grands chemins subiraient le préjudicede la Croix sur le lieu du délit, par exemple. Plusle temps passe plus on pense que la peine doit êtreréparatrice, en plus d’être dissuasive. C’est toutel’idée de politique pénale qui se développe au fur et à mesure. La peine doit être adaptée aux circonstances, au temps et au lieu. Plus on avance dans le temps plus les peines sont importantes
puisque l’intimidation est recherchée. Des peines marquées par l’atrocité sont révélées.
Sous l’empire tardif, il faut détourner du crime enterrorisant. Ce principe est repris au moyen âge etil deviendra un lieu commun. Ce n’est pas pcq l’empire devient chrétien que cette politique pénale va changer. L’empire chrétien a un droit pénal extrêmement répressif parce qu’on considère que le délinquant est un rebel à l’ordre social qu’il faut mette hors d’état de nuire. L’arsenal des peines se développe et on voit apparaitre beaucoup de châtiments nouveaux, et en matière de peine de mort on voit se développer différentes manières de mettre à mort. Initialement, on se contentait d’une mort simple par le glaive, et puison va voir apparaitre des formes d’exécution plus spectaculaires appelés les « supplices recherchés »(code théodosien).
Sous le Haut Empire, on a beaucoup pratiqué la condamnation aux bêtes féroces. C’est un moyen de mettre à mort mais ce système va tomber en désuétude après l’empereur Constantin, tout comme le supplice de la Croix qui disparait au IVème siècle pour des raisons religieuses également. Bienavant les chrétiens, c’étaient les esclaves condamnés à mort qui subissaient le supplice de la Croix. Mais les chrétiens n’ont rien contre les condamnations par le feu donc ces dernières vont semultiplier. Toute une série de crimes est établie comme la désertion ou le faux monnayage, ou encore l’homosexualité, mais aussi l’enlèvement d’une jeune fille, ou l’auto mutilation militaire. Etc.
Le cas de la pauvre nourrice : elle a un enfant sous sa garde et celui-ci est enlevé par les malfaiteurs. La nourrice qui n’empêche pas l’enlèvement de l’enfant va subir la peine du plombfondu dans la bouche.
Il y aussi une peine archaïque qui est réactivée en318 par l’empereur Constantin ; contre les parricides (ceux qui tuent volontairement un procheparent) c’est la peine du sac. Cette peine consistedans un premier temps à fouetter le condamné jusqu’au sang, une fois ceci fait, on va l’enfermer dans un sac solide (en cuir, cousu) avec 4 animaux considérés par les romains comme particulièrement méchants ou hideux : unchien, un singe, un coq, et une vipère. Le sac et son chargement sont jetés dans la mer ou dans la rivière la plus proche. C’est une peine symbolique puisque dans la pensée romaine de l’époque archaïque, le but de cette peine est de punir le coupable mais surtout de l’expulser du monde des vivants. Pour eux celui qui commettait un parricideétait un monstre. Les spectres ne peuvent pas traverser l’eau pour les romains archaïques donc onnoyait le criminel pour éviter qu’il ne revienne dans le monde des vivants.
En pratique cette peine du sac a survécu, on dit qu’elle a été supprimée par Pompée à la toute fin de la république romaine mais ce point est discuté : cette peine a subsisté pour les meurtres du père ou de la mère et l’empereur Hadrien y voyait la peine tout à fait normale. En 318 dans une constitution Constantin applique cette peine dusac à tous les parricides.
Ces peines varient selon le niveau social du condamné.
Les gens les plus humbles, les « humiliores » y compris les esclaves, sont souvent voir de préférence condamnés à des travaux forcés. Cela signifie que par exemple, ils sont condamnés à participer aux travaux publics. Ou alors, ils peuvent être condamnés à une forme de travail pénible qui est celui des mines. Jusqu’à l’époque de Constantin (315 après JC) ; lorsque l’on était condamné aux mines, on était en plus marqués au ferrouge sur le visage mais ceci va disparaître sous Constantin.
Quand on est un honestiores, pour des cas équivalents, on était seulement voué à l’exil. Il peut y avoir deux types d’exil : la déportation ou la relégation.
La déportation est la forme d’exil la plus pratiquée, elle est en principe perpétuelle sauf sil’empereur fait grâce, c’est une peine infamante. La déportation peut entrainer la dissolution du mariage et la confiscation des biens.
La relégation, qui est généralement temporaire, elle n’entraine pas de confiscation des biens ou deperte de citoyenneté.
Concernant la prison : la prison ne constitue pas une peine, il n’y a pas de peine d’emprisonnement. Pour les romains, la prison ne sert qu’à mettre les gens en attente d’un jugement ou d’une exécution. C’est un moyen de contenir les hommes et non de les punir.
Il y a aussi des peines pécuniaires, qui viennent compléter en quelque sorte les différentes peines infligées. Même sous l’empire, on a en matière de peine pécuniaire des réminiscences de l’époque archaïque par exemple en cas de vol flagrant, le voleur va devoir verser le quadruple de la somme volée par exemple. Il y aussi le développement de l’amende due au fisc dans certains cas particuliers, mais ces peines pécuniaires sont accessoires.
L’infamie : quand on dit qu’une peine infligée entraine l’infamie, cela signifie que la personne perd sa bonne réputation, et elle perd ses droits ordinaires de citoyen. L’infamie peut aussi entrainer la perte d’une dignité particulière par exemple si un sénateur tombe sous le coup d’une condamnation pénale, il va perdre son rôle de sénateur. Un avocat malhonnête va être exclu de l’ordre des avocats etc. l’infamie initialement accompagne les peines administrées puis deviendra une peine principale. Il est fondamental pour les citoyens romains d’être enpossession de leurs pleines capacités juridiques etc. les peines les plus lourdes sont accompagnés de l’infamie.
Il y a toujours des systèmes pour contrebalancer les peines, il existe des cas de grâce. Dès l’époque républicaine, il y avait des possibilités de dispenser un condamné de l’exécution d’une peine etcette possibilité était au sein des comices, et ce pouvoir de gracier comme tous les pouvoirs, est entre les mains de l’empereur. Le pouvoir de gracier est lié au pouvoir de prononcer la peine puisque l’empereur romain prononce la peine. Il est source de droit, il est
maitre de la norme donc c’est normal qu’il soit maitre de la dispense. Quand l’empire est devenu chrétien, l’empereur a réuni dans sa personne deux attributs de dieu : la justice et la miséricorde qui sont deux vertus du prince chrétien. La clémence de l’empereur est une forme de modération de la peine et c’est aussi un acte de toute puissance. Cette grâce se rattache à une notion typiquement romaine qui est celle de l’équité. La grâce permet d’écarter l’application d’un droit strict au nom d’un principe supérieur qui permet finalement d’atteindre le plus juste. Au fil du temps le droitde grâce va se développer au fur et à mesure que l’empereur devient absolu. L’empereur devient chrétien et il ne pourra utiliser son pouvoir de gracier qu’en vue du bien commun. Le pouvoir de gracier a pris une grande ampleur quand les condamnations à mort se sont multipliées.
Paragraphe 3 : la preuve
La preuve : probatio, terme qui revêt 2 sens différents, un sens intellectuel, adhésion de l'esprit à la vraisemblance, et un sens matériel : essai, exactement épreuve, la preuve gomme les incertitudes de la cité.
• Les caractères généraux de la preuve
Historiquement, il a existé 2 systèmes de preuve correspondant à deux modes d’établissement de la vérité (des preuves rationnelles et irrationnelles).
Les preuves rationnelles : vérité vient d'un raisonnement logique, ce système a été mis en place
par le droit romain. La charge de la preuve incombe au demandeur.
Les preuves irrationnelles : la vérité n'est pas plus raisonnée ; elle est révélée. On recourt aux puissances divines.
L’ordalie, c’est soumettre les plaidants à une épreuve dont l’issue va déterminer la personne bienfondée, celle qui a raison dans l’action. L’issue de cette preuve est déterminée par les dieux. On fait passer à l’accusé une épreuve physique. Le dieu est censé protéger l’accusé si celui-ci est innocent. Il y a une évolution du procès et de la pénalité.
Ordalie du chaudron : consiste à faire plonger la main de la personne dans de l’huile bouillante pourdire si elle était coupable ou non. L’ordalie est présente dans le code d’Hamourabi. Le résultat des épreuves peut décider du sort de l’accusé et c’est le juge qui décide. C’est d’ailleurs lui qui détermine s’il y a ordalie ou non.
Ordalie du fleuve : on précipite l’accusé vers le fleuve pour qu’il dise la vérité. Dans le droit mésopotamien, on pouvait payer quelqu’un pour qu’ilaille sauter à notre place. L’ordalie pouvait être orientée.
On trouve des ordalies proches de nous : en Afrique, il existe l’ordalie du poulet, qui consiste à donner du poison au poulet et en fonction de sa réaction, on dit si la personne est coupable ou non. Néanmoins, il faut se replacer à la place de ces populations qui étaient très croyantes.
L’ordalie offre un avantage psychologique : celui qui sait qu’il est dans son bon droit sait qu’il réussira l’épreuve. Il y a une prise en compte de facteurs psychologiques. C’est un procédé très vieux attesté par les hommes au moyen Age, mais en grec ou à Rome l’ordalie est en fait peu pratiquée.Les romains sont en effet des juristes et ont développés des preuves rationnelles contrairement aux francs.
• La classification des preuves rationnelles.
Dès l’époque archaïque, le droit romain va connaître des preuves rationnelles. Après le 3ème siècle, les juristes classent ces modes de preuves en 5.
• L’aveu : aveu du défendeur qui reconnait volontairement les faits. L’aveu est assimilé à un jugement de condamnation. C’est la preuve par excellence aussi bien lors du procès civil que lors du procès pénal.
• Le serment : on dit que l’on jure lorsque l’on dit la vérité. Le parjure est considéré comme une faute religieuse grave aux yeux de la religion. Il renforce la portée du serment.
• L’écrit : mode de preuve très fiable. Le problème, c’est qu’on en a eu recours tardivement.
• Le témoignage : grande importance en droit archaïque et classique et moins dans le droit romain tardif. Plus le temps passe, plus on se montre méfiant à l’égard des témoins doncon fait appel à plusieurs témoins et le crédit de sa parole dépend alors de sa fortune, de sonsexe, de son âge et de son statut social. En droit romain tardif, la preuve par témoin n’estpas autorisée si l’acte écrit est authentique.
• La présomption : c’est une conséquenceque le juge tire d’un fait connu ou inconnu. Les indices sont pris en compte selon leur force. Le droit romain distinguait les présomptions simples qui sont celles susceptibles d’être mises en échec par une preuve contraire et les présomptions légales etirréfragables qui ne peuvent être contestées.
Chapitre 3 : le droit des personnes
Section 1 : l’Etat Civil
L’intérêt de l’état est de connaître ses ressortissants puis il y a aussi un intérêt des particuliers qui est que grâce à l’état civil, ils peuvent disposer de preuves pour tous les éléments qui concernent leur vie. Historiquement, la tenue d’un état civil et la délivrance relative à l’acte d’état civil ont été longues à instaurer. Dès la haute antiquité, il y a eu des recensements de la
population. Le premier exemple se situe dans la Bible, dans le 1er testament. Plus tard, dans l’Antiquité romaine, lors de la république romaine,on recense tous les 5 ans. Les égyptiens, passés sous domination romaine, sont recensés aussi mais tous les 14 ans. Entre temps, on déclare les naissances des hommes. Ces enquêtes, sont très espacées et ne donnent pas de document. Les romainsà partir de l’empire ont utilisé l’état civil, qui va disparaître à partir du 5ème siècle lors des invasions barbares.
Paragraphe 1 : les actes d’Etat Civil
Le régime de l’Etat Civil ne s’applique qu’aux citoyens. Il n’a donné lieu à aucune organisation systématique et est constitué de pièces différentes. Il y a trois types d’actes.
• Les actes publics : ils sont relatifs à l’adoption, à l’émancipation et à l’affranchissement. A partir de l’empire, ces actes se réalisent en justice. La déclaration est faite devant un juge qui représente l’acte constitutif du nouveau statut. Tout ce qui se passe en justice est enregistré dans des sortesde procès-verbaux du juge. Les intéressés peuvent ainsi obtenir de ces actes des extraits(en copie).
• Les actes semi-publics :
• les déclarations de naissances sont obligatoires depuis le règne d’Auguste et ne visent que les seuls enfants légitimes. Elles doivent être faites par les parents dans les 30jours suivant le jour où l’enfant reçoit son nom. La déclaration est faite devant les autorités mais il n’y a aucun examen. Ils doivent publier ces actes sur un tableau. A ce moment-là, les intéressés peuvent prendre une copie de cet extrait et pour qu’elle soit valable, il faut qu’elle soit garantie par des témoins au nombre de 7.
• La naturalisation accordée aux soldatsen fin de service par l’empereur ou par un général en particulier. On peut devenir citoyenromain par ce biais. Cette naturalisation est une mesure générale gravée sur une table de bronze. La copie est aussi possible et la présence de témoins est obligatoire.
• La prise de toge virile : on grave surun tableau exposé publiquement la prise de togevirile, c’est lorsque l’on fête la majorité de l’homme. La copie est aussi possible mais il faut obligatoirement les témoins.
• Les actes privés : cela sert pour garder un souvenir ou cela peut être un acte auquel on a recours pour prouver un autre événement. On peut déclarer une naissance illégitime ou un mariage par des actes privés ou même les décès. Pour qu’il y ait valeur, il
faut que la déclaration soit faite devant 7 témoins. Chaque témoin appose son sceau, sa marque. L’acte a alors une valeur de preuve.
Tous les actes de l’Etat des personnes sont mis à l’écrit mais sous des formes différentes. Les actesnon nécessaires, qui ne sont pas décisifs, on peut prouver le contraire. Par exemple pour une déclaration de mariage, comme c’est un acte privé on peut prouver le non consentement et dire qu’il est nul. L’acte écrit en droit romain n’est pas décisif. Le droit romain dit qu’on préfère la vérité à l’écrit. Peuvent faciliter la preuve de certains actes mais n’ont pas une grande valeur.
Paragraphe 2 : le nom
Le nom est le moyen d’identification de l’individu.Il permet à l’autorité publique de retrouver un citoyen, un soldat, un délinquant. Le nom permet deconnaitre le propriétaire d’une chose, etc. il est très important dans les rapports juridiques. Le nomest un signe de rattachement, une indication d’origine, il n’est pas attribué de manière arbitraire. Le choix du nom n’est pas libre, on porte le nom de ses ancêtres ou du moins le même que les parents ont reçu. Le nom a aussi un caractère religieux, c’est souvent lors de cérémonies religieuses que l’enfant reçoit son nom.Le nom a aussi une importance sociale, il y a certaines familles qui peuvent porter avec fierté le nom de leurs ancêtres. Deux grands problèmes : -celui du système onomastique : c’est la compositiondu nom et son attribution. C’est la façon dont le
nom est composé. – celui du régime juridique du nomqui comporte des protections.
Le premier problème a toujours intéressé les hommes, exemple : en chine, chaque personne à troisnoms, le premier est celui de la grande famille, ledeuxième celui d’un ancêtre qui a fixé sa propre descendance et le troisième est plus personnel. Puis il y a un prénom.
Dans l’antiquité, notamment chez les grecs, chaque personne ne porte qu’un seul nom. Les enfants légitimes apportent à leur nom le prénom du père. Tous les peuples de l’antiquité fonctionnent comme cela sauf les romains. Les romains eux portent trois noms, par exemple Cicéron : Marcus Tulius Cicéron. Le nom gentilis est Tulius, Cicius est sonsurnom. Gens = grande famille. Généralement, pour les femmes, on les désigne que par le nomen, Tulia si Cicéron avait une sœur. Le prénom a un caractèrepersonnel. Pour Cicéron, son prénom est Marcus.
Le nom n’est pas donné le jour de la naissance maislors d’une cérémonie religieuse, 9 jours après la naissance pour les garçons et 8 jours après pour les filles. Officiellement, un nom et un prénom suffisent. Très vite le surnom est devenu nécessaire pour réduire l’homonymie. On peut parfois avoir un 2ème surnom sans valeur juridique mais cela permet de distinguer.
Quelques fois la dénomination ne se fait pas à a naissance comme pour les esclaves : portent un nom sans valeur juridique, donné par le maître. Le maître peut changer le nom comme il le veut. Si
l’esclave est affranchi, il devra porter les 3 nomsromains, la triumnomina. Il reçoit alors le prénom et le nom gentilis de son ancien maître et comme surnom, il conservera le dernier nom porté. Pour Cicéron, comme il a affranchi son esclave Tiro, il s’appelait : Marcus Tulius Tiro.
Lors de naturalisation collective, comme lors de l’Edit de Caracalla, on a donné le nom et le prénomde l’empereur qui a fait cette mesure.
En cas d’adoption, les adoptés prennent le nom entier de l’adoptant, le surnom compris et conservent en plus de cela leur ancien nom gentilis.
Octave adopté par César s’appellera Caïus Julius César Octavianus.
On ne dispose que de deux renseignements sur le changement et sur l’usurpation du nom.
• Dans le code de Justinien, dans le titre relatif au changement de nom. A l’époque tardive, on pouvait changer de nom comme on voulait.
• Si on prend un faux nom, on va être puni de la peine du faux : l’usurpation de nom est fortement pénalisée.
Section 2 : la famille
A certaines époques quand l’état n’a pas encore acquis toute sa force, l’état laisse aux communautés familiales une sorte d’autonomie. Quand on commence à
étudier la famille au regard de l’histoire, c’est relativement important.
La famille, c’est dans un certain sens un groupe restreint de personnes unies les unes aux autres par le mariage ou par des liens de filiation. Le mot famille désigne souvent dans notre langage un groupe plus large, plus nombreux. Il peut aussi désigner le groupe des personnes unis par un lien proche ou lointain de parenté collatérale.
Si on observe la tradition familiale de l’Occident on peut croire de prime abord que certains grands traits la caractérise, tout au moins jusqu’à l’époque actuelle.
Le premier de ces traits caractéristiques est que la famille a longtemps été fondée essentiellement sur le mariage, en Occident du moins. Les unions illégitimes ainsi que les enfants qui en sont issussont tantôt ignorés par le droit et tantôt battu par le droit. Il peut y avoir parfois quelques mesures de bienveillance notamment en faveur des enfants illégitimes mais ces mesures font plus figure d’exception, ou ces mesures de bienveillance sont des mesures de régularisation d’une situation anormale. A l’époque actuellele droit français connait à ce sujet une accélération assez sensible : on ne perçoit plus lemariage comme un des fondements quasi exclusif de la famille.
La deuxième caractéristique est la monogamie. C’estun trait particulier à l’Occident. La monogamie existait déjà en Grèce et les romains l’ont toujours maintenu, et de manière générale les pays
européens. Cependant ce n’est pas le cas pour tous les pays, où la monogamie n’est pas une obligation absolue. Monogamie : union d’un homme et d’une femme qui font des enfants.
La troisième caractéristique est la prépondérance de l’homme dans la famille : principe qui entraîne à la fois la puissance paternelle (du père sur ses enfants) et matrimoniale (du mari sur sa femme). L’étendue de sa puissance peut être très diverse selon les époques. A l’époque actuelle il n’y a plus de suprématie de l’homme au sein de la famille. Pendant très longtemps cependant il y a eucette prépondérance masculine.
De nos jours, seule la monogamie semble se maintenir. Il y a alors un problème de définition puisqu’en réalité il n’y a aucune définition de la famille qui puisse convenir à tous les pays, à toutes les époques et à toutes circonstances. Il n’y a pas de définition universelle de la famille.
Paragraphe 1 : la famille grecque
Aristote a beaucoup écrit sur la famille lorsqu’il a réfléchi au processus de construction de la cité. Lorsqu’Aristote évoque la définition de la cité et de la citoyenneté il évoque la famille. D’après Aristote : « par nature les couples existent parce que le mâle et la femelle ne peuvent se passer l’un de l’autre en vuede la reproduction. Puis, à partir de cette familleva se construire le village, qui est un agrégat de famille, une colonie de famille. Puis sur le village sera faite la cité. La cité est la réunion de différents villages. » Pourtant, Aristote dit,
toujours dans « la politique » que la cité est antérieure à la famille et à chacun de nous, parce que pour lui chaque individu ne peut pas se suffire à lui-même.Pour Aristote la cité est une nécessité absolue. Lafamille et la cité sont très intimement liées. La famille, c’est finalement une sorte de passage obligé pour la perpétuation des citoyens. Le but dela procréation est de créer des futurs citoyens, etde les élever dans le culte de la cité.
La famille est une famille patriarcale. Vient de « patriarces » qui signifie « chef de famille », le patriarche. Tous les membres de la famille sont situés sous l’autorité d’un chef. Le modèle grec vadifférer du modèle romain. La famille grecque est une famille patriarcale dominée par les liens du sang. Rome pousse jusqu’à l’extrême la dimension patriarcale. La famille romaine n’est pas seulementle père, la mère et les enfants, c’est un chef de famille sous la puissance duquel sont placés un certain nombre d’individus qui vivent avec lui. Lesliens du sang passent au second plan. Les esclaves peuvent alors faire partie de la famille romaine. Cette conception d’une famille patriarcale plus ou moins poussée, va nominer la conception de la famille occidentale jusqu’à une période relativement récente.
Aristote donne une définition de la famille : « la communauté constituée selon la nature pour la vie de chaque jour est la famille. »
Cette communauté va être appelée en grec l’ « oikos », famille au sens strict, le foyer. Aristote décrit la structure de cette communauté
conçue comme un noyau de base. Le lien personnel qui existe entre les membres d’une même famille, donc la parenté. Le lien de puissance qui existe entre les membres de cette même famille : le pouvoir domestique.
• La parenté
La parenté va avoir à la fois un statut naturel et social. Si on commence par évoquer le statut socialde la parenté, il faut rappeler que pour Aristote, la famille ne se forme pas au hasard de la vie privée. La cité, la polis, est un agrégat d’oikos, de foyers. Aristote dit que toute cité se compose de familles. La famille est une réalité naturelle donc vitale comme l’est d’ailleurs la cité. La familleest un élément essentiel à la vie des hommes comme l’est la cité. Aristote, s’inscrit ainsi contre l’approche plutôt utopique que pouvait avoir Platon.
Platon, « la république », va être aux antipodes de lapensée d’Aristote. Pour Platon, une cité sans famille est possible mais même préférable. Selon Platon, la sphère du privé se révèle constamment une entrave au bon déroulement de la politique, carla sphère du privé véhicule tout un tas de sentiment comme la jalousie ou la convoitise, etc. à partir du moment où se crée des sentiments il y ades sources de dissension. Il considère qu’il faut détruire la cellule de base qui est la famille parce que c’est un obstacle à l’unité et donc à l’harmonie de la cité. Platon propose une sorte de système communautaire pour remplacer la famille traditionnelle. Il n’y aura plus de foyers où des couples vivent avec leurs enfants. D’après Platon,
« Les femmes des guerriers seront communes à tous, aucune n’habitera en particulier avec l’un d’eux. Les enfants aussi seront communs. Le fils ne connait pas son père et réciproquement ». Les unions seront décidées par les dirigeants. Les enfants nés de ces unions sont séparés de leur mèreet élevés collectivement. Dans ce système les enfants présentant un handicap seront « dissimulés ». Dans cette vision la cité devient en quelque sorte une seule et unique famille, ce qui fait que Platon renie en bloc tout l’héritage aussi bien philosophique que juridique de la famille, du mariage et de la filiation légitime.
Pour Platon, ce ne sont pas les familles qui constituent la cité mais au contraire c’est la citéqui est une seule et même famille.
Evidemment, Aristote dans « la politique » va lui s’attacher à dénoncer le caractère faux et artificiel de la famille Platonicienne. Il va donner à la parenté un statut essentiel, parce que pour lui, la famille est le seul cadre apte à créerdes citoyens. La citoyenneté se transmet par le sang mais seulement aux enfants nés d’un mariage légitime. Donc c’est normal qu’Aristote dise que la famille est le seul cadre créé pour fabriquer des citoyens. La famille est donc le cadre naturel de la parenté.
Pour les Grecs, on a une famille au sens restreint (père, mère, enfants : oikos) et une famille au sens plus large. En réalité, on va pouvoir distinguer trois niveaux de parentés :
• Oikos, le foyer, qui rassemble la famille nucléaire : père, mère qui habitent ensemble dans la même maison avec leurs enfants.
• Genos, famille au sens plus large : c’est la lignée dont le fondateur serait un ancêtre quasi légendaire ou un héros. Le génos est la lignée de laquelle on est issu. Il y aura souvent la célébration d’un sorte de cultefamilial parce qu’on est fier de ses origines, de ses ancêtres. Parenté en ligne directe.
• La phratrie, c’est la parenté en lignedirecte mais également en ligne collatérale : tous les descendants d’un même ancêtre. Oncles,tantes, cousins... c’est la famille au sens très large.
Tout enfant qui est reconnu par son père à la naissance doit être présenté à la phratrie et doit donc être inscrit au sein de cette phratrie. Un des membres de la phratrie peut faire objection sur cette intégration dans le groupe familial s’il y a un doute sur la légitimité de l’enfant. La phratrie a donc un rôle important, elle interviendra égalementdans tous les cas d’adoption. Il faut aussi une présentation de l’adopté à la famille pour qu’il soit intégré à la famille. (L’adoption en Grèce estpossible uniquement si on n’a pas d’enfant légitimede sexe masculin. On adopte de préférence des enfants du même sang, comme un neveu, un cousin ;
l’idée c’est que l’enfant adoptif doit permettre à une lignée de ne pas s’éteindre.)
Si on résume, l’oikos est à la fois une partie de la cité puisqu’il s’insère dans le cadre plus largedu genos et dans le cadre encore plus large de la phratrie. C’est une petite partie mais le modèle dela cité. C’est pour cela qu’il va y avoir au sein de l’oikos une organisation très stricte fondée surl’autorité. L’oikos est un lieu d’éducation où les enfants apprennent à être des citoyens.
• Le pouvoir domestique
Seul l’oikos représente un lieu d’exercice du pouvoir, ce n ‘est ni le cas du genos ni de la phratrie. Il n’y a qu’un seul titulaire de ce pouvoir impérial, en l’occurrence c’est le chef de famille. Aristote dit qu’il y a des esclaves et des personnes libres (père, mère, enfants). La famille, si l’on suit la pensée d’Aristote est le cadre d’une triple relation de pouvoir dont Aristote va définirla nature. Relations : maitre/esclave, relation mari/épouse et la relation père/enfant. C’est l’ensemble de ces relations qui sert de fondement àce que l’on appelle le pouvoir domestique, qui est le sein du pouvoir au sein de la famille. Domos, est la maison. Pouvoir domestique : pouvoir de l’homme au sein de la maison.
Tout d’abord le rapport maitre/esclave :
• L’esclavage existe dans la nature pourAristote, c’est une institution commune à tous les peuples. Juridiquement, l’esclave est une chose mobilière, et comme toute marchandise il
peut être acheté, vendu, transmis par testamentou par donation. On parle d’esclave-marchandise. Ce statut-là se transmet héréditairement. L’esclave est dépourvu de toute capacité juridique, il est totalement soumis à la puissance de son propriétaire. Le maitre peut le faire travailler, il peut louer sa force de travail à quelqu’un d’autre, il peut le vendre mais aussi le corriger si nécessaire voir le tuer. Si l’esclave se marie, les enfants qui naitront de cette union deviendrontaussi la propriété du maître.
Ce qu’il y a d’intéressant, c’est que cette façon d’appréhender l’esclave comme une marchandise n’empêche pas qu’en droit grec on considère aussi l’esclave comme une personne. Aux yeux du droit l’esclave est une marchandise, un droit mobilier mais il est classé par les membres de l’oikos et vaparfois être perçu comme une personne. Pour Aristote l’esclave n’est pas répertorié parmi les choses. C’est pour cela qu’il dit qu’au sein de l’oikos il y a personnes libres et esclaves.
Dans la réalité, l’esclave vit dans la famille et il y a ainsi un attachement réciproque entre lui etles membres de l’oikos. Il est vu comme une personne pour les grecs. Les maîtres peuvent ainsi affranchir leur esclave. Le maître qui vient à mourir peut affranchir son esclave par testament. L’affranchi aura ainsi un statut assez proche de celui du méthèque.
En ce qui concerne le rapport mari/épouse :
• On parle ici de la puissance maritale.D’une manière générale dans l’Antiquité grecqueles filles étaient mariées entre 12 et 14 ans parce que cela correspond à l’âge de la puberté. Sont mariées à un homme que leur père (ou leur frère si le père est mort) choisit pour elle, puisqu’elle est considérée comme juridiquement incapable. Un contrat est établi dans lequel sont énumérés devant témoins les devoirs, les obligations des époux. L’homme doit protéger et entretenir sa femme, et la femme doit se soumettre au mari. La femme passesous la puissance de son mari à qui elle doit obéissance. Le mari peut rompre unilatéralementle mariage, il peut répudier sa femme ou demander le divorce. Aristote dit que c’est « pour la femme l’autorité d’un homme d’état, et que l’homme est par nature plus apte à commander que la femme, sauf exception contrenature. » Il y a bien une supériorité de l’homme qui existe par nature d’après Aristote.Mais il soulève l’exception en faisant référence aux barbares, aux étrangers parce qu’il sait que chez les non grecs la femme peut parfois exercer un certain pouvoir à l’égal de l’homme. Il en profite ici pour distinguer une nouvelle fois les grecs et les barbares. Les femmes ont pour Aristote un rôle purement domestique il s’agit de procréer des enfants légitimes dont l’éducation sera en réalité confié aux hommes du moins pour les garçons. Certes, on a vu que la femme était citoyenne, mais il faut avant tout la voir comme un maillon nécessaire dans la transmission de la citoyenneté. Donc, il y a une obligation
évidente de fidélité de la part de la femme : elle doit transmettre la citoyenneté. L’adultère (féminin) est un crime, l’action est publique et c’est à tel point que le mari aura le droit de tuer impunément sa femme et son amant s’il les surprend en flagrant délit. D’une manière générale la femme grecque est exclue de la vie sociale. Les seuls événements auxquels elle a le droit d’assister sont des funérailles ou aux actions publiques. D’un point de vue patrimonial l’infériorité de la femme est manifeste. Elle apporte une dot ; unesomme d’argent le jour de son mariage, qui seragérée par son mari puisque la femme n’a aucun patrimoine propre. Sa capacité juridique en estplus réduite. Inégalité évidente dans les rapports mari/femme.
Pour finir, le rapport père/enfant : la puissance paternelle.
• La puissance paternelle se dégage dès la naissance de l’enfant. L’enfant nait dans lefoyer et le père peut soit accepter et reconnaitre l’enfant soit il peut rejeter l’enfant s’il a un doute sur sa légitimité ou s’il a une malformation quelconque. S’il décide de le reconnaitre, au bout de 10 jours il organise une cérémonie où devant témoins il donne un nomà l’enfant. Cette cérémonie à un but double en quelque sorte, elle tend à montrer publiquementqu’il s’agit d’un enfant légitime et cette cérémonie montre également le passage sous la puissance du père : c’est l’intégration de
l’enfant à la famille donc dans le corps social, mais cette intégration se fait par une démarche seulement paternelle. C’est à partir de là que sa filiation devient légitime. L’accouchement par la mère ne suffit pas à créer la filiation légitime. L’enfant quin’est pas reconnu par son père n’est pris en considération ni par la famille ni pour le droit. Dès la naissance le père a sur ses enfants un droit de vie et de mort, et cela a des conséquences très graves. Un enfant qui n’est pas reconnu par le père, qui est exposé, ne deviendra jamais citoyen et cet enfant ne pourra pas être adopté par d’autres citoyens. On recueilleces enfants, mais si on le fait on peut très bien le traiter comme un esclave ou comme un homme libre. Jusqu’à l’époque de Solon le père peut vendre les enfants. Les enfants ont un devoir d’obéissance envers leur père et en cas de transgression de ce devoir le père peut même agir devant un tribunal. Il existe une action pour mauvais-traitement. L’enfant est incapable juridiquement, dépourvu de droits politiques. Le fils pourra échapper à la puissance paternelle quandil aura atteint sa majorité. Le fils est majeurà 18 ans en Grèce, mais une émancipation est possible avant l’âge de 18 ans. Pour la fille, mariée très tôt, va directement passer de la puissance de son père à celle de son mari. Ellen’acquiert jamais de capacité juridique. Différence entre les filles et les garçons dansla famille. Cette différence se fait dès l’âge de 7 ans. Jusqu’à cet âge les enfants filles et garçons sont élevées par la mère et à partir de 7 ans la mère continue d’éduquer sa fille pour qu’elle sache tenir une maison mais
pour les garçon, on fait soit appel à un précepteur si on a les moyens ou alors on demande à un homme de la famille d’éduquer le garçon.
En matière successorale, sur le plan patrimonial :
• A priori aux yeux du droit grec il y aune égalité pour les enfants en puissance : ilsjouissent tous d’une part égale à la succession. Egalité patrimoniale au sein de la famille grecque puisqu’une fois que les enfants quittent l’oikos il n’y en a plus. Cette égalité patrimoniale est en réalité inexistante. On instaure une égalité patrimoniale parce que la fille apporte une dot lors de son mariage donc on ne peut l’écarter mais dans les faits l’argent de la fille est réservée pour constituer la dot pour qu’elle participe aux charges du futur ménage, et géré par son mari.
Cette différence on la voit particulièrement dans une hypothèse : le père meurt, et il n’a qu’un enfant, c’est une fille. A Athènes cette fille est appelée la fille épiclère. Elle n’héritera pas, elle devient au contraire un élément de la succession. Cette succession a vocation à passer à un homme de la famille. Pour résoudre ce problème la solution trouvée est de marier la fille en question avec le parent le plus proche de son père. La succession nesort ainsi pas de la famille.
Paragraphe 2 : la famille romaine
A l’origine la famille romaine est essentiellement patriarcale, c’est un type d’organisation familialequ’on trouve presque partout. Patriarcal : père, qui sera le pater familial et arkhe : le pouvoir. Celui qui détient le pouvoir dans ses familles est
le père. La parenté n’existe alors que par les hommes. A l’origine cette idée dit que le sang du père est transmis aux enfants seulement et pas celui de la mère. Le père serait celui des deux parents qui serait physiquement le plus apte à êtrele chef. Il y l’autorité de force particulière du chef de famille.
La famille romaine va être la cellule de base de lacité. Selon Cicéron, les êtres humains ont le besoin naturelde procréer ce qui fait que la communauté, la cité résulte dans le couple puis dans les enfants. On reprend l’idée qu’on a unesorte de colonies de familles qui s’installent les unes avec les autres et qui vont finir par constituer une cité. On retrouve l’idée à la fois que la constitution de la famille est ordonnée à la procréation pour sauvegarder l’espèce humaine mais aussi pour donner des citoyens, pour sauvegarder l’Etat romain. Côté grec la famille est repliée sur une famille légitime, indissociable de la parenté par le sang. Les romains eux développent une conception particulière de la famille légitime : elle repose en réalité sur un lien juridique bien plus que sur le lien du sang. Appartiennent à la famille légitime romaine ceux qui sont placés sous la puissance d’un chef de famille. La famille romaine est une famille ouverte sur l’extérieure, l’adoption est très fréquente.
• Composition et caractéristiques de la famille romaine.
Ulpien laisse dans le Digeste une célèbre définition de la famille. Pour lui le terme « familia » a plusieurs sens. Soit il est employé pour désigner les choses et les personnes (il désigne ici le patrimoine
familial) soit il est employé pour désigner toute parenté. Il dit que la famille est constituée de plusieurs personnes soumises par la nature ou par le droit à la puissance d’une seule.
« Domos » désigne à la fois la maison, le foyer et la famille qui y réside. Tout est fondé sur la puissance du chef de famille. On ne fait partie de la domos que si on est soumis à la puissance du chef. C’est autourde l’autorité absolue du chef de famille que se construit l’unité de la maison, du foyer. Dans cette domos on a un père de famille, pater familias, et ce père de famille est la seule personne à être pleinement capable au sens juridique du terme : On dit qu’il est « sui iuris ». Ce père de famille a la faculté de procéder à tous les actes juridiques qui existent. Il peut contracter, former un contrat, rédiger un testament, etc. les autres membres de la domos vontêtre en quelque sorte ces sujets. Ils vont être soumis au pouvoir du père. Ils vont être sous la puissance du père de famille, on dit qu’ils sont « alieni iuris ». Ils sont soumis à la puissance d’autrui, ils sont ainsi incapables juridiquement. Les alieni iuris sont toutes les personnes qui vivent autour du père : sa femme, ses fils et ses filles non mariées mais aussi les enfants de ses fils, ses belles-filles. Tout acte juridique émanant d’une de ses personnes doit être autorisé par le père de famille. Parenté de sang mais aussi d’alliance. Ces deux types de parenté sont unis en uneseule parenté qui découle du fait d’être sous la puissance d’un chef de famille commun. Ce qu’il y ad’intéressant c’est que ce foyer, la domos, va
durer aussi longtemps que vit le pater, et ce quel que soit l’âge des enfants. cela signifie qu’un homme même parvenu à la pleine maturité, tant qu’ila son père, il reste alieni iuris et il n’a pas de capacité juridique. Pendant très longtemps le père romain a eu un véritable pouvoir de vie et de mort.Il y a une unité de la domos autour du père de famille. Ceci s’explique par une première raison purement religieuse, le groupe familial a une vocation religieuse à rome, la famille doit célébrer un culte domestique, mais aussi le culte des ancêtres ou des pénates (les petites divinités du foyer). La seconde raison c’est qu’on considère en droit romain que la domos a un seul patrimoine, qui est aux mains du chef de famille. Tous les autres membres de la domos ont sur ce patrimoine unsorte de droit de propriété latent, virtuel puisqu’ils hériteront à la mort du père mais n’auront pas de patrimoine propre. Pour certains membres on va changer de chef. Les filles qui se marient deviennent soumises à leur mari et plus à leur père. Les fils et les veuves à la mort du pèredeviennent sui iuris tout comme les filles non mariées.
A partir de l’époque classique et surtout sous l’empire tardif, onva voir s’atténuer ce principe primitif de rattachement par les hommes. On va commencer à définir que la parenté peut aussi se définir par lafemme et la puissance du père de famille va alors s’atténuer. On multiplie certaines mesures protectrices des enfants mais il faut avoir conscience que jusqu’au bout cette puissance paternelle va rester un des traits caractéristiques du droit romain. La
puissance du père sur ses enfants évolue il n’a plus le pouvoir de vie et de mort par exemple. On aessayé d’aménager la puissance paternelle. En ce qui concerne les rapports mari/femme on va supprimer la puissance du mari sur sa femme, mais en essayant de toujours respecter l’ancien principedu lien familial. Dès l’époque classique il y a un sortede mouvement de libération pour les femmes, et dès l’empire, (IIème siècle après JC) la femme est mariéesans faire vraiment partie de la domos. Cette liberté entraine une séparation des patrimoines. Aufur et à mesure ce cadre très strict des origines et ce schéma d’un père omnipotent au sein de sa famille a tendance à s’atténuer voir à être supprimé.
• Le couple
Les unions extra-conjugales ont toujours existé. Très tôt, il s’est posé à leur propos la question de savoir en quoi ces unions se distinguaient de l’institution du mariage et quels pouvaient être les situations de faits. A Rome, le concubinage estfortement attesté. les romains étaient capables de voir que certaines unions se distinguaient par leurstabilité, leur durée et par leur communauté d’habitation. D’une manière générale les concubins se font passer pour des mariés, ils ne cachent pas leur union. Il existe bien le mot « conconbinatus ».
Il existe des unions entre pérégrins, ou entre des citoyens de cité différente ou encore l’union des esclaves. Il y a beaucoup de situations d’union
entre un homme et une femme mais ne sont pas considérés comme des mariages purs et simples.
Dès l’époque d’Auguste, des lois ont réprimées l’adultère, les relations contre nature et ce que l’on appelle le « stuprum » qui est toute relation hors mariage. Il existe quelques exceptions pour les femmes considérées comme peu honorables, comme les prostituées ou assimilées, les affranchis ou enfin les femmes de condition socialetrès basse. Si on a un « stuprum » avec ces femmes là on ne tombe pas sous le coup de la loi.
Certains auteurs ont estimé que les femmes avec quion se mettait en concubinage étaient seulement des personnes avec qui l’union n’était pas considérée comme du strup.
Selon d’autres auteurs, le concubinat serait une union légale, inférieure, licite à condition de n’être ni adultère ni incestueux. Le concubinat serait une forme inférieure au mariage ouverte dansles cas où le mariage était impossible comme pour les militaires.
Enfin, beaucoup d’auteurs pensent que le concubinatexistait bien mais qu’il était ignoré par le droit pénal qui n’y voyait pas un cas de strup parce que c’était une union stable et était ignoré par le droit civil parce qu’ils ne lui reconnaissaient aucun effet.
A partir du moment où l’empire devient chrétien il y a une hostilité naturelle à l’égard des relationshors mariage mais il y aura des faveurs accordées aux enfants nés d’un concubinat régulier. On inciteles couples à régulariser leur union pour avoir les
avantages et que les faveurs ne soient pas accordées qu’aux enfants.
• Le mariage
Ce régime purement patriarcal n’a existé à Rome dans sa perfection qu’à l’époque républicaine. Sousl’empire il s’adoucit et se mélange à des principes nouveaux. Les mœurs vont se relacher petit à petit et au fur et à mesure l’état va se donner le droit d’intervenir dans les familes. Les jurisconsultes romains se faisaient une opinion très haute du mariage. On sait que deux types de mariage coexistaient à rome :
• Le mariage com manu : mariage qui soumet la femme à la puissance du mari ou à la puissance du père de son mari.
Le mariage com manu correspond pleinement au modèlepatriarcal de la famille. La femme rentre dans la domos et sous la puissance du pater. Elle est complétement dépendante de lui.
Base du droit familial romain. Pour contracter ce type de mariage, il fallait qu’il y ait un acte ou un évènement spécifique. Il y avait trois façons decontracter un mariage com manu.
La première façon était de faire une cérémonie, de suivre un acte religieux et l’élément essentiel de cette cérémonie était une offrande de pain ou de gâteau confectionné à l’aide d’épotre (farine spéciale) à Jupiter. Il y avait la présence du grand pontife et à cette cérémonie devait assister 10 témoins.
La deuxième façon, est une cérémonie d’achat. C’estla forme romaine d’un système de mariage répandu dans beaucoup de systèmes primitifs comme le système par vente : le mari achète la femme. Cérémonie durant laquelle on se sert d’une balance pour peser l’argent amené du mari.
La troisième façon se fait par une sorte de prescription : après un an de cohabitation ininterrompu l’homme acquiert la manus sur la femmemais s’il n’y a pas eu de mariage religieux ou de mariage par vente.
Le mariage com manu va au fil du temps s’effacer. Dès 450 avant JC on pouvait nuancer cette dernière façon : si la femme découchait pendant trois nuits de suite, alors la manus du mari sur sa femme étaitimpossible.
La quatrième façon, qui n’est pas répertoriée par le droit : il faut parler du mariage par rapt, par enlèvement. Il y a ainsi une sorte d’obligation au mariage. (Légende de l’enlèvement des Sabines).
La femme mariée par un mariage com manu est appeléela mater familias, la mère de famille. La femme change de famille mais cela signifie qu’elle va rompre tout lien avec sa famille d’origine, elle rentre véritablement dans la domos de son mari. Pèse alors toute la puissance du manus du mari. Elle devient totalement incapable et cela aura des conséquences quant à son patrimoine, tout va dépendre de la situation de la femme avant le mariage, si elle avait son propre père ou non. Si au moment du mariage elle a encore son père elle
est donc fille de famille et n’a aucun patrimoine propre. Passe simplement de la puissance de son père à la puissance de son mari. Si elle n’a plus son père, cela signifie qu’elle est capable juridiquement. Cela signifie aussi qu’elle a des biens, qu’elle a hérité. Tous ces biens sont récupérés par son mari. Seul lui est censé avoir unpatrimoine au sein de la domos. Cependant l’homme doit subsistance à la femme. Comme la femme coute cher, il faut qu’elle participe aussi au foyer. On instaure ainsi une dot constituée par le père de lafemme pour compenser l’absence de droit de successions et pour donner ainsi de l’argent au foyer.
Si l’un des deux époux meure, le mariage est dissout. Si la femme meure d’abord elle ne laisse aucun héritier puisqu’elle n’a pas de patrimoine. Si le mari meure en premier la femme hérite d’une part comme les enfants. Ce type de mariage à partir de l’époque classique va devenir très génant et il y aura un déclin de ce type de mariage (IIème siècle après JC) au profit du mariage siné manu.
• Mariage siné manu : mariage qui excluttoute soumission de la femme à son mari.
Le mariage siné manu, la femme reste juridiquement dans sa propre famille, elle n’entre pas dans la famille du mari.
• Les grandes étapes du mariage
Il y a le consentement, des formes et des festivités qui entrainent une certaine publicité. Le mariage entraine la vie commune des époux et
consommation du mariage. Ce sont des éléments qu’onretrouve presque à toutes les époques. Dans tous ses éléments l’acte qui détermine la formation du mariage n’est pas forcément le même selon les époques. Aujourd’hui il faut les consentements devant le maire et la signature de l’acte. C’est unrecours à la forme qui relève d’une conception assez récente de l’histoire et à l’époque ce n’était pas ça qui comptait. Dans beaucoup de sociétés antiques le mariage se réalise par étapes successives. Par exemple on voit dans la Bible que pour qu’un mariage soit valablement formé il faut qu’il y ait deux actes séparés de 12 mois. Dès le premier acte, la première étape du mariage, si la femme a des relations avec un autre que son fiancé, elle est réputée adultère. Sicette première étape a été trouvé et que dans l’intervalle de 12 mois le futur mari meurt la femme va être contraire au « lévirat », qui est un type particulier de mariage dans lequel une veuve épouse le frère de son mari mort afin de poursuivrela lignée. Cette première étape ressemble alors à des fiançailles. Cette première étape, qui est un accord entre les familles, si on veut dissoudre le lien il fautun divorce véritable. Il faut attendre 12 mois pour que l’épouse entre dans la maison de son mari, et qu’une bénédiction publique soit donnée par témoins.
En droit romain, on ne va pas avoir deux étapes mais trois dans la formation du mariage. On a, dès l’ancien droit, l’attestation de fiançailles, qui deviendront avec l’époque classique facultatives. Le consentement va compter, il doit demeurer libre. S’il y a des fiançailles il n’y a aucune action en
obligation de la promesse ou de dommages et intérêts pour rupture des fiançailles.
Il y a quand même une conséquence qui reste de l’époque antérieure : s’il y a des fiançailles conclues à l’époque classique et que la fiancé a des relations avec un autre homme ces relations sont considérées comme adultère.
Droit archaïque : fiançailles ; droit classique : plus de fiançailles obligatoires. A partir du 3ème siècle (fin) on a un retour des fiançailles. L’usage se répand de remettre de l’argent ou un anneau. En cas de rupture injustifiée des fiançailles, on peut garder ou rendre la bague ou garder ou rendre l’argent selon la personne qui rompt les fiançailles. A Rome aussi on peut avoir un mariage par étape, néanmoins ces fiançailles obligatoires en droit archaïque, facultative en droit classique puis réapparaissent à l’époque tardive.
A Rome il n’y a aucune forme particulière de mariage. A Rome le mariage s’accompagnait de cérémonie religieuse. Il n’y a que des usages comme :
La poignée de mains : on organise une cérémonie et une femme qui n’a été marié qu’une seule fois rapproche les époux pour leur donner leur mains.
La femme soit conduite dans la maison de son mari :à la fin de la fête l’épouse est accompagnée au domicile conjugal et à l’entrée de la maison viens le passage singulier du seuil de la maison. A l’intérieur de la maison il y aura un nouveau rituel on lui présente l’eau et le feu qui sont leséléments essentiels.
Il y aura un autre usage : celui de la bénédiction à l’Eglise. Ces usages sont païens, à l’époque chrétienne ils vont s’accompagner d’un nouveau rite, celui de la bénédiction à l’Eglise et la poignée de mains sera donc à l’Eglise. Ces rites nesont pas nécessaires ni suffisant a la formation dulien matrimonial. Ce ne sont que des usages, ces formalités ne sont pas nécessaires et pas suffisantes. Le juriste romain refuse d’en tenir compte pour eux la formation du mariage est autre chose.
L’élément essentiel à la formation du mariage est le consentement. La vie commune, la cohabitation etla consommation du mariage sont importants mais pour les romains, sont nécessaires dans une certaine mesure (qui est limitée) parce que par exemple une femme absente ne peut pas se marier même par procuration parce qu’il n’y a mariage que si la femme va habiter la maison du mari. Ce n’est pas la cohabitation qui forme le mariage, c’est le consentement. On appelle cela un consentement qualifié à se prendre pour mari et femme et à vivreselon les lois du mariage. On va traiter son conjoint honorablement, à le faire participer à sonrang social et surtout on va s’engager à développerà son encontre des sentiments. C’est la volonté de ne pas déshonorer son conjoint.
Les romains avaient l’habitude de rédiger des tablettes de mariage en vue d’avoir des enfants. C’était une preuve du mariage mais ce n’est pas unepreuve absolue. C’est pour ça qu’une loi de 428 après JC a présumé qu’il y avait mariage lorsque le
conjoint est de même rang social et qu’il n’y a aucun empêchement à leur union. Justinien autorisait le mariage entre personne de rang socialdifférent.
Dès lors que la femme est libre, dès qu’elle est genue et que ce n’est pas un inceste, le mariage est présumé.
Il y a peu d’actes publics à Rome il y a plus d’actes privés ou semi publics mais qui peuvent être plus contestés.
L’écrit en cas de mariage n’a pas une force très forte. Très vite les juristes ont élaboré un système de preuve par présomption. C’est ainsi qu’une loi de 428 après JC prise sous l’empereur Théodose présume le mariage lorsque les conjoints sont de même rang social et qu’il n’y a aucun empêchement légal à leur union. Cette règle sera allégée par Justinien. Il admettra que le mariage puisse être valide même entre personnes de rang social inégal. Dès que l’union ne constitue pas un inceste le mariage est présumé. On a tendance à considérer que deux personnes sont mariées quand ils sont libres de naissance et qu’il n’y a pas d’empêchement à leur union. Le droit romain sur la question du mariage n’évoluera plus, ces règles sont fixées par le corpus de Justinien et c’est le terme de l’union en droit romain.
C) la filiation
La filiation est le lien juridique de descendance entre deux personnes dont l’une est le père ou la mère de l’autre. On dit que cette filiation est
soit légitime si elle se crée dans le cadre du mariage soit naturelle si elle se crée hors mariageet la filiation peut enfin résulter d’un jugement qui entérine une adoption.
• L’établissement de la filiation
Les parents possèdent des droits sur l’enfant né ouà naitre.
Ils peuvent refuser l’enfant et peuvent alors faireavorter la mère ou abandonner l’enfant à sa naissance. Pour l’abandon on parle d’exposition à Rome. Les romains envisageaient les rapports familiaux sous l’angle de la puissance et en particulier de la puissance paternelle. Cela est possible dès la naissance de l’enfant. L’enfant à sa naissance est alors placé devant le père et cet homme a le choix, soit le père choisit de soulever l’enfant de terre, et c’est alors un geste qui symbolise l’acceptation de l’enfant ou ilpeut alors choisir de le laisser au sol et cela signifie qu’il le refuse et la mère n’a pas son motà dire. Ils sont alors jetés au dépotoir, mais peuvent aussi être déposés dans un lieu public comme dans un temple. Quand on abandonne l’enfant on remet son sort aux dieux qui eux décident de le laisser vivre ou mourir. Le premier venu peut récupérer l’enfant ou en faire son esclave.
Romulus aurait imposé l’obligation d’élever, de reconnaitre tout enfant mâle et par contre on pouvait rejeter les autres enfants : filles ou ceux ayant une malformation avec l’accord de 5 voisins. Dans la loi des XII tables on a le droit de tuer a la naissance les enfants qui semblent monstrueux, ou avec un
handicap. Ces coutumes n’étaient pas propres aux romains. Cet usage de l’exposition est très répanduchez tous les peuples antiques, comme chez les grecs par exemple. Les anciens ne s’embarrassaient pas d’un enfant anormal ou d’un enfant de trop ou la légitimité était incertaine. Beaucoup de gens abandonnaient les enfants et surtout les filles. On peut aussi vendre les nouveaux nés quand on vraiment très pauvre pour obtenir de l’argent. Constantin va permettre de vendre les nouveaux nés en cas de misère extrême.
Pendant longtemps l’avortement a été réprimé dans deux cas : celui causé à une femme non consentante par un tiers ou l’avortement volontaire de la femmecontre la volonté de son mari. On protège soit la femme soit le mari mais jamais l’enfant.
A partir du moment où l’empire devient chrétien, onne s’occupe plus du mari : l’avortement provoqué est assimilé à un homicide. On voit dès St Augustinqu’une femme commet un péché dès lors qu’elle ne met pas au monde autant d’enfant qu’elle le pourrait.
Les tests de paternité n’existent pas donc :
Présomption juridique : l’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari de sa mère. Il faut uneprésomption de cohabitation des deux parents et il faut fidélité de lamère.
Hippocrate (mort en 375 avant JC) et il avait reconnu que la durée de gestation d’un enfant oscillait entre 182 jours et 300 jours. La loi des XII tables fixait la gestation à 10 mois maximum. Présomption due au
juriste Paul : on connait toujours la mère avec certitude. Le père est le mari de la mère. Les romains n’étaient pas fous et pour eux ni l’une ni l’autre n’a de valeur irréfragable. Doutes quant à la présomption médicale.
• Les particularités de la filiation adoptive
Institution très répandue. En France l’adoption n’acommencé à être adoptée sur une grande échelle qu’àpartir de 1939.
Il y a l’adoption à proprement parler qui est le cas de l’adoption de quelqu’un qui est alieni iuris, qui n’est pas capable juridiquement. Cet enfant ne fera que changer de père de famille.
Il a aussi l’adogration : qqn qui a une pleine capacité qui passe sous la capacité de qqn d’autre et il perd alors ses propres capacités juridiques.
Dans les anciens temps de Rome, chaque famille avait son culte et se préoccupait de la continuation de ce culte familial et quand un homme n’avait pas de descendant il était conduit à adopter un enfant pour continuer le cultefamilial.
Très souvent à Rome, l’adoption a eu des fins politiques et ce, à toutes époques, alliances soit par mariage soit par adoption. On adoptait par exemple ou on se faisait adopter pour poursuivre une carrière politique. Claudius par exemple, grandadversaire de César et de Cicéron était patricien, s’est fait adopté par un plébéien pour être tribun de la plèbe.
César qui n’avait pas de garçon a adopté Auguste qui devint 1er empereur de Rome. Celui-ci adoptera par la suite les fils de sa fille. Pour transmettreson trône il décide d’adopter ses petits-fils mais ils vont mourir donc Thibert lui succèdera. Le droit civil romain connait de parenté que par les hommes. Le processus de légitimation a été très tardif à Rome. Cela s’explique par l’adrogation (fait d’adopter qqn qui est juridiquement indépendant) qui va éteindre un foyer, une domos. Etant donné qu’il y a des mécanismes beaucoup plus grave que l’autre, les formes de ces mécanismes ne sont pas tout à fait les même.
L’adoption est un acte purement privé néanmoins cesformalités sont assez compliquées. L’adoption se fait en deux temps : il faut éteindre l’ancienne puissance paternelle et on en créer une nouvelle. L’idée, ça va être de libérer la personne qui doit être adoptée de son ancienne puissance paternelle et pour cela les romains vont faire une loi dans laloi des XII tables : si un père vend trois fois son fils alors il est libéré de la puissance paternelle. On utilise cette technique pour permettre l’adoption. Pour créer la nouvelle puissance paternelle il faut passer devantun magistrat.
Grace a Justinien les formes de cette adoption vontêtre réformées on ne retient que le consentement dupère d’origine et du père adoptif et l’autorisationde l’autorité judiciaire.
Il existait aussi l’adrogation par testament. L’adrogeant doit avoir au moins 60 ans et au moins 18 ans de plus que l’abrogé.
L’adrogé pouvait avoir une femme et des enfants, çapouvait être un homme romain père de famille ayant sous sa puissance ses enfants et il passe quand même sous la puissance de l’adrogeant. Toute la famille de l’adrogé passe sous la puissance de l’adrogeant.
L’adrogeant va devoir promettre de restituer en casde problème à l’adrogé tous les biens qu’il en reçoit.
Adoption pleine et entière : adoptio plena. Conserve tous les effets traditionnels de l’adoption comme la rupture avec la famille d’origine mais elle sera exceptionnelle et ne pourra intervenir que si elle ne représente aucun danger. Par exemple une adoption au sein de la mêmefamille qui fait que si par la suite il y a une émancipation quelconque, l’adopté qui est émancipé ne perd pas vraiment ses droits successoraux. On maintient une adoption pleine et entière.
Adoption minus plena : l’adopté est à la fois dans sa famille d’origine et dans sa famille adoptive. Va être placé sous la puissance du père adoptif mais jouit des droits successoraux de sa famille d’origine. Les conséquences de ces mécanismes sont avant tout patrimoniales. Idée est de transmettre un trône, un nom et un patrimoine.
FIN