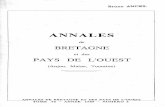Le chemin de fer de Mauritanie : composant d’un modèle minier ou moyen de développement d’une...
-
Upload
univ-antilles -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of Le chemin de fer de Mauritanie : composant d’un modèle minier ou moyen de développement d’une...
1
Le chemin de fer de Mauritanie : composant d’un modèle minier ou moyen de
développement d’une région ? Lucie DEJOUHANET Géographe doctorante – Université Paris X Nanterre 38 rue Péreire, 78100 Saint-Germain-en-Laye [email protected] La ligne de chemin de fer du nord de la Mauritanie relie sur 700 km la mine de fer de la Kédiya d’Idjil et le port minéralier de Nouadhibou, formant avec eux un système minier intégré, aménagement gigantesque typique des fronts pionniers décrits par Pierre Monbeig (1966). Le complexe fut mis en exploitation en 1963 par la MIFERMA, Société Anonyme des Mines de Fer de Mauritanie, aux capitaux en majorité français, dans un contexte de recherche par les puissances européennes et américaine, puis japonaises, de nouvelles sources d’approvisionnement en minerai, consécutif aux progrès techniques de l’industrie et des transports et à la délocalisation des sidérurgies sur les côtes. Sur ce « front pionnier » (Monbeig, 1966) des territoires nomades, en marge des flux mondiaux, l’arrivée d’une industrie moderne gérée de l’extérieur et produisant pour le marché international aboutit à une nouvelle organisation de l’espace. La ligne ferroviaire est-elle depuis restée un couloir d’exportation ou a-t-elle permis un développement régional ? À une époque où la notion de « développement durable » est au centre de tous les débats, la question de la pérennité de l’organisation régionale autour d’un aménagement minier, par nature non durable, est essentielle. Nous présenterons d’abord la composition d’un espace régional dépendant de la ligne ferroviaire puis les enjeux de cet aménagement pour la Mauritanie et l’avenir de la nouvelle organisation spatiale. 1. Un aménagement ferroviaire structurant l’espace 1.1. Le chemin de fer comme couloir d’exportation 1.1.1. Un moyen de transport adapté dans un milieu difficile « Les chemins de fer de pénétration sont les plus directement liés au mouvement pionnier (…). Partant du littoral atlantique sud-américain ou africain, ils s’enfoncent comme des vrilles dans la masse continentale mais peu d’entre eux en atteignent le cœur. Leur rôle est moins d’acheminer hommes et produits vers l’intérieur des terres que d’assurer le drainage des matières premières vers l’extérieur. » (Monbeig, 1966, pp. 981-982). La construction de la ligne ferroviaire reliant la Kédiya d’Idjil à Nouadhibou fut motivée par la présence dans la Kédiya d’un gisement d’au moins 200 millions de tonnes, avec une forte teneur en fer (65% Fe), extraordinaire pour l’époque. Cette montagne isolée dans les plaines
2
du Tiris Zemmour, dont le nom en langue berbère est Adrar In Ouzzal, la « montagne de fer », s’élève jusqu’à plus de 900 mètres.
Carte 1. Localisation du complexe minier de Mauritanie
D'après un fond de la CIA diffusé par l'Université de Pennsylvania (États-Unis).
Ouverte en 1963, la ligne permit d’extraire 5 millions de tonnes de minerai de fer la première année, pour atteindre 7 millions de tonnes en 1966. Depuis 1995, le train transporte de 10 à 11 millions de tonnes de minerai par an. Il emprunte une voie de près de 700 km de long, avec neuf voies de croisement ; elle fut prolongée au fur et à mesure du déplacement de l’exploitation. Le train, longtemps l’un des plus longs du monde, peut mesurer 2,5 kilomètres et pèse en moyenne 22 000 tonnes. Il se compose d’au moins 210 wagons de minerai et d’une douzaine de wagons variés dont une voiture de passagers, tirés par trois ou quatre locomotives. Trois trains par jour circulent dans chaque sens ; une fois par semaine, un train spécial ravitaille les bases le long de la ligne et quotidiennement, un train d’eau rejoint la ville de Zouérate au départ de Boulanouar. La ville de Nouadhibou, point d’arrivée des trains de minerai et de départ des cargos (au port de Point Central), est située sur le Cap Blanc qui abrite la baie du Lévrier (Dakhlet Nouadhibou). Après avoir traversé les regs de l’Inchiri puis les massifs dunaires du Tijirit, la ligne contourne les falaises de l’Adrar pour desservir au nord les centres urbains de F’Dérik et Zouérate.
3
Carte 2. Le système minier dans son environnement régional
D'après un fond de carte MIFERMA (Rapport de 1963).
Le milieu désertique du Nord de la Mauritanie est peu adapté à une occupation humaine sédentaire. Sur la période 1950-1991, les précipitations annuelles des espaces traversés par la ligne de chemin de fer ont été inférieures à 100 mm, réparties sur moins de 10 jours de pluie par an. La région de Nouadhibou est particulièrement aride, la pluviosité moyenne depuis 1922 est inférieure à 20 mm par an avec des effets de vent quasi permanents entraînant des phénomènes de chasse-sable. La visibilité y est réduite plus de 200 jours par an (CAMPUS, LERG, LEDRA, env. 1995). Le besoin en eau à Zouérate est d’autant plus important que l’utilisation en eau pour la première transformation du minerai de fer est estimée entre 5 et 25 tonnes pour une tonne de minerai traité (Scott et Bragg, 1975, in Ripley, Redman, Crowder, 1996). Si la société minière a réglé le problème d’eau pour l’exploitation du minerai en utilisant une réserve souterraine d’eau salée éloignée du site de Zouérate, l’alimentation en eau de la cité minière se fait grâce à la ligne de chemin de fer à partir de l’importante nappe souterraine de Boulanouar qui alimente également Nouadhibou. Transport nécessitant une surveillance constante mais résistant dans des conditions extrêmes, le chemin de fer constitue le moyen de transport privilégié des fronts pionniers, il est utilisé aussi bien dans la zone intertropicale que dans les climats rudes de la Sibérie ou dans les plaines de l’Amérique des pionniers (Salesse, 1989, in De Sa, 1990). Il répond aux exigences du transport de la main d’œuvre, des vivres et du matériel nécessaire à la mise en exploitation des gisements. 1.1.2. Le chemin de fer, composant d’un système minier intégré Dans cette région désertique, une exploitation moderne est complètement dépendante de l’extérieur : la mise en valeur du gisement nécessite l’importation de matériel, de véhicules, de pièces détachées, de rails, mais aussi de combustibles comme le pétrole, la Mauritanie ne produisant pas ces biens industriels. Le train amène aussi à la ville minière les produits nécessaires à la vie humaine (eau, produits de la pêche, produits manufacturés…).
4
Associée au port minéralier de Nouadhibou, la ligne ferroviaire forme un complexe minier performant. À Nouadhibou, les wagons de minerai sont déchargés du train à un rythme de 70 wagons par heure, le minerai est stocké puis embarqué sur les minéraliers, ou traité par l’unité de criblage. La capacité de chargement des cargos (poids utile : 150 000 t) est de 7 500 tonnes par heure (brochure de la SNIM, 2003). Le complexe minier du nord de la Mauritanie est un système intégré : la mine, la ligne ferroviaire et le port minéralier appartiennent à la société extractrice. La société contrôle toute la filière d’extraction, de transport et d’exportation du minerai. Mais ce complexe appartient aussi à un système économique à l’échelle mondiale, dépendant des industries sidérurgiques. Le gisement minier est resté une périphérie, certes intégrée et exploitée, de centres dominants ou hypercentres, aux rôles de coordination, d’impulsion et de commandement (Reynaud, 1981, p. 67). « Les pays industrialisés projettent des fractions d’eux-mêmes sur des territoires extérieurs chaque fois qu’ils doivent se fournir de matières premières rares. » (Claval, in Reynaud, 1981, p. 74). L’exploitation de Mauritanie, du temps de la MIFERMA, est une forme d’« associat » par rapport à la France, elle en possède les caractéristiques : la petite taille : « l’associat type est un port, une mine » (Reynaud, 1981, p. 75), l’intensité des liens avec son centre lointain et une situation d’enclave dans sa région : les capitaux, la technologie, la main d’oeuvre qualifiée, proviennent du centre, tandis que les produits et les bénéfices repartent vers le centre. Intégrée par nature aux échanges mondiaux, liée aux flux économiques internationaux, dans un espace sous-peuplé aux conditions difficiles, la ligne de chemin de fer ne devait être qu’un couloir d’exportation, drainant le minerai de fer hors du continent. La société minière a le droit d’utilisation des sols et sous-sols, et par l’ampleur des aménagements, elle imposa un modèle minier d’occupation de l’espace. 1.2. D’un modèle minier à un développement local ? 1.2.1. La construction d’un espace régional Peuplées de nomades, les terres du Nord avaient été intégrées à un système économique prospère durant la période glorieuse du commerce caravanier, mais « des changements politiques, des transformations sociales, des déplacements de courants de circulation les avaient comme écartées de l’œkoumène. Des circonstances politiques nouvelles, des révolutions sociales, des renouveaux économiques et le progrès technique les réintègrent. » (Monbeig, 1966, p. 990). Si le port de Nouadhibou existait depuis la colonisation, « porte d’entrée en Mauritanie » (Bonte, 2001, p. 83), l’intérieur des terres était peu colonisé. Le Tiris abritait des tribus nomades organisées vivant de l’élevage et du commerce du sel de la sebkha d’Idjil, à une vingtaine de kilomètres de la Kédiya. Pour évaluer l’impact de l’aménagement dans la région, nous comparons la carte de 1961 au 1/100 000 du nord de la Mauritanie, avant la mise en exploitation de la mine, et des cartes de l’IGN, Institut Géographique National, datant de 1969 à 1975 au 1/200 000, que nous complétons avec les cartes de l’Atlas de Mauritanie (CAMPUS, LERG, LEDRA, env. 1995).
5
Port-Étienne (Nouadhibou) et Fort-Gouraud (F’Dérik) étaient en 1960 de petits villages constitués pour le premier de pêcheurs et pour le deuxième d’exploitants de la sebkha d’Idjil, et de nomades sédentarisés. Entre les deux, seul Choum existait, village à la limite des falaises de l’Adrar. Une route reliait Fort-Gouraud et Fort-Trinquet (extrême nord du pays) à la ville caravanière d’Atar par Choum, pour se prolonger vers Chinguetti ou vers le sud du pays. L’introduction d’un moyen de transport moderne, reliant la côte à des villes associées à un réseau nord-sud, conduisit à de nouvelles dynamiques spatiales. L’impact le plus important fut la construction des cités planifiées de Cansado sur le Cap du Lévrier, et de Zouérate, ville minière au nord-est de la Kédiya. Le village de F’Dérik fut équipé de services urbains mais ne devint pas un centre de peuplement. L’entretien de la voie nécessitait la construction de bases de maintenance le long du trajet : la surveillance constante des rails était nécessaire du fait du climat et du poids des trains, de l’érosion éolienne et de l’ensablement dû au déplacement des barkhanes de l’Inchiri. Le long de la ligne, six bases de maintenance et une gare furent construites : Boulanouar (km 95, le km 0 étant le port minéralier) où se trouvait le seul forage d’eau potable de la région, Dibilâl (km 179) située sur une voie de croisement, Aghoueyyit (km 255), Amchigdel - Tmeymichat (km 317) où était implantée la base de changement et de repos à mi-parcours de l’équipe de cheminots du train, Ben Amira (km 393), Choum (km 459) où une gare permettait la montée de passagers dans le train, Touâjil (km 568).
L’accessibilité de la région par la voie de chemin de fer fut complétée par une multimodalité des transports le long de la ligne. Le chemin de fer fut doublé d’un réseau de pistes et de routes nécessaires à sa maintenance. En 1970, les deux villes de la Kédiya, F’Dérik et Zouérate, étaient équipées chacune d’un aéroport et la route nord-sud (RN1) fut améliorée. Autour d’Amchigdel, deux aéroports étaient distants d’une trentaine de kilomètres. Boulanouar était le carrefour du réseau de pistes ouest – est et de celui descendant vers le sud.
Avec le début de l’exploitation minière, la région subit une transformation radicale, le chemin de fer reliant l’intérieur des terres à la côte en quinze ou dix-sept heures, modifiant les modes de communication des populations nomades et les dynamiques territoriales. 1.2.2. Le modèle linéaire à la base d’un nouveau réseau d’échanges L’installation d’une activité moderne, demandeuse en main d’œuvre, a attiré des populations de l’ensemble du pays, voire des pays voisins pour Nouadhibou, provoquant une réorganisation du peuplement à l’échelle nationale. L’exploitation minière constitue la seule implantation humaine dans le nord, avec la petite ville isolée de Bir-Moghrein. Son impact dans l’organisation spatiale mauritanienne est proportionnel à une situation originelle extrêmement déséquilibrée. Les services de soins, l’accès à l’eau, les magasins de produits alimentaires ou de première nécessité encouragèrent les populations nomades à se fixer autour des villes minières ou des bases de maintenance de la ligne, créant une occupation linéaire discontinue le long de la voie ferrée. En 1969, Zouérate comptait près de 10 000 habitants, actuellement elle en abrite près de 40 000. Les sécheresses des années 1970 et l’attrait des salaires motivèrent également l’abandon à court ou long terme du mode de vie nomade. Le système de solidarité des nomades mauritaniens permit une large diffusion de l’impact économique de l’activité minière dans la région, les employés de la compagnie minière assurant l’hospitalité des membres de leur famille ou leur tribu.
6
La ligne de chemin de fer est utilisée par les populations locales pour le transport des marchandises. La voiture de passagers étant réservée aux cheminots et aux touristes, les nomades s’installent sur les wagons de minerais avec leurs animaux et pratiquent aux arrêts des échanges avec les commerçants. Ce commerce, toléré par la société minière, entraîne une organisation de flux économiques linéaires parallèles à l’activité d’exportation minière. Les produits sont ensuite commercialisés dans les régions traversées. Le chemin de fer sert aussi à transporter le sel de la sebkha d’Idjil, transformant radicalement les modes de commercialisation traditionnels. Les bases restent dépendantes du passage du train et ne développent aucune activité. La présence de puits ou de citernes, la création de jardins et le ravitaillement par le train permettent aux populations installées de vivre, mais ces bases ont un rayonnement local limité à l’attrait des populations et au petit commerce lié à la ligne ferroviaire. Le développement de Boulanouar est associé aux forages hydrologiques mais son essor pourrait se poursuivre grâce à sa situation sur le trajet de la route prévue pour relier le Maroc au Sénégal. Tmeymichat bénéficie de la présence de la base de changement des équipes où la rotation des employés donne un dynamisme quotidien au village, mieux relié au reste de la région de la ligne par la transmission aisée des nouvelles. Si Ben Amira a acquis une réputation internationale par le concours de sculpture organisé sur le monolithe du même nom fin 1999, le village en a peu bénéficié. La ligne a favorisé une implantation humaine ponctuelle et limitée. La ville de Choum s’est agrandie grâce à la gare. Originellement lieu de transition entre les villes caravanières du centre du pays et celles du Nord, lieu de passage obligé des routes de la plaine contournant la frontière, la ville a tiré profit de cette situation de carrefour. La gare y facilita les transactions commerciales et devint le centre d’un réseau d’échanges entre Nouadhibou, Zouérate – F’Dérik et les villes de l’Adrar. 1.2.3. L’évolution du modèle minier de développement Les nouveaux centres urbains se constituèrent comme enclaves de modernité. Les villes de Zouérate et Cansado reproduisaient le modèle de ville minière européen (modèle minier européen) ou américain (company-town). Dans le Sahara mauritanien où le mode de vie des nomades repose sur les activités traditionnelles d’élevage et d’agriculture et s’organise autour des tribus, le caractère exogène du modèle minier implanté par les sociétés est flagrant.
Ce modèle urbain repose sur une hiérarchie socio-spatiale. En 1968, la ville de Zouérate est divisée en trois quartiers correspondant chacun à une classe différente de personnel. La conception de la cité, les types de véhicules de service attribués, l’organisation des services et des loisirs étaient fonction des normes hiérarchiques du travail industriel. La rotation rapide des agents expatriés et le recrutement par l’intermédiaire de réseaux de relations personnelles contribuaient à la fragmentation de la vie sociale (Bonte, 2001, p. 78). Deux sociétés différentes cohabitaient, l’une se protégeant, l’autre voulant pénétrer la première. Les problèmes entre les communautés étaient liés en partie à l’organisation de l’entreprise minière : l’absence d’éducation industrielle de la population mauritanienne avait cantonné celle-ci à des postes de manœuvres, donc la laissait sous les ordres d’un personnel expatrié, recruté parmi les anciens travailleurs des colonies, ce qui dans un contexte de décolonisation était évidemment mal vécu. En outre, la population non expatriée n’avait pas le droit d’obtenir un logement de la MIFERMA, et des bidonvilles se formèrent autour de la
7
ville minière. Une cité européenne, bien conçue, aérée, dotée d’équipements modernes (voirie, éclairage, adduction d’eau et d’électricité...) et proche des équipements collectifs voisinait une ville mauritanienne avec un petit quartier moderne, au sud, et de vastes bidonvilles au nord et au sud (Bonte, 2001, p. 80). Zouérate était alors un parfait « isolat » selon la définition d’Alain Reynaud : « L’isolat (...) est un ensemble spatial caractérisé par une densité assez élevée de population, une organisation interne poussée, une coupure plus ou moins accentuée avec l’extérieur, une avance ou un retard marqué par rapport au reste de la classe socio-spatiale dont il fait partie. (...) L’isolat est fondé sur la notion de système quasi-fermé, entretenant avec l’extérieur le minimum de relations. (...) En termes de théorie générale des systèmes, l’entropie d’un tel système, c’est-à-dire la mesure de son degré de désordre, augmentera jusqu’à créer des tensions. » (Reynaud, 1981, pp. 84-87). Les grèves de 1966-1968 puis la nationalisation de la MIFERMA en 1974 correspondirent à un processus d’appropriation de son espace par la Mauritanie. Nous l’envisageons comme le passage du front pionnier, accompagné de son corollaire de conflits, sur la ville de Zouérate : jusque là, la société minière avait vécu enclavée mais sous les pressions extérieures, elle dut se laisser intégrer dans l’espace contrôlé par l’autorité centrale. Cette ouverture progressive de l’enclave minière aux populations qui l’entouraient se fit d’abord par la « mauritanisation » de l’entreprise. 2. Enjeux et avenir d’un aménagement essentiel pour le pays 2.1. Enjeux historiques, enjeux politiques : un espace frontière stratégique La Kédiya d’Idjil se trouve à proximité de la frontière avec le Sahara Occidental, la ligne de chemin de fer longe cette frontière et dans une certaine mesure la matérialise dans l’espace. Dès 1900 la France et l’Espagne s’accordèrent sur le tracé actuel de la frontière. Aucun compromis ne pouvant être trouvé en 1954, la MIFERMA dût prolonger sa voie ferrée de plus de 200 km pour contourner le Sahara Occidental. La région a été depuis la colonisation le théâtre de rivalités territoriales. Au moment de l’Indépendance en 1960, l’implantation de la société apparut comme un facteur d’identité nationale et d’appropriation des vastes territoires du nord contestés par le Maroc (Bonte, 2001, p. 183).
Entre 1968 et 1973, dans le contexte de la guerre froide et des revendications tiers-mondistes, la Mauritanie traversa une crise culturelle, sociale et politique aboutissant à une volonté de rupture nette avec le passé colonial et l’impérialisme mondial. La mauritanisation du personnel de la société minière, demandée avec insistance par les nombreuses grèves, prépara la nationalisation de la MIFERMA. Le gouvernement mauritanien exigea que les bénéfices de la société se traduisent par des investissements locaux et peu après le remplacement du Franc CFA par l’Ouguiya (juin 1973), la nationalisation de la société minière assura à la Mauritanie la maîtrise de son unique source de revenus.
La place dans l’économie de la société minière et son importance sociale la plaça comme support politique et économique de la Mauritanie, mise à mal dans le conflit du Sahara Occidental. Le Front Polisario avait bien compris la faiblesse de la Mauritanie lorsqu’il attaqua, dès 1975, la ville de Zouérate et le train minéralier. La guerre et les coups d’État successifs empêchèrent tout projet de développement et fragilisèrent la nouvelle autorité. Dans la conjoncture difficile traversée par la Mauritanie, l’enjeu politique de la
8
mauritanisation concurrença l’enjeu industriel et en 1983, la quasi totalité du personnel était mauritanienne (Bonte, 2001, pp. 160-192). En reposant son économie sur une activité en marge de son territoire, le pays a été fragilisé par les conflits armés qui ont touché cet espace difficilement contrôlable. Victimes des conflits, surveillées encore par les services d’espionnage des pays frontaliers, entourées de mines antipersonnel, les mines et la voie ferrée furent des cibles faciles pour les acteurs de la guerre. 2.2. Enjeux économiques : le complexe minier, pilier de l’économie mauritanienne Les exportations du minerai de fer de la Kédiya d’Idjil représentaient environ 60% des exportations du pays en 2002. Le secteur minier contribuait pour 13% au PIB, pour environ 50% issus des services, près de 18% de l’agriculture, 15% de la pêche et des activités de transformation qui y sont liées, un des secteurs majeurs de l’économie mauritanienne (env. 40% des exportations), et 4% du secteur manufacturier relativement peu développé (Organisation Mondial du Commerce, 2002). Ces chiffres montrent le déséquilibre de l’économie mauritanienne où les activités de service pèsent lourd en comparaison des activités productrices. La Mauritanie se compte au nombre des « pays miniers » décrits par O. Bomsel avec une économie reposant essentiellement sur l’exportation de minerais depuis plus de quarante ans, une politique d’importations de denrées alimentaires non produites par un secteur agricole marginal, un exode rural et une croissance de l’urbanisation appuyés par l’établissement d’un système de large redistribution du revenu national par la multiplication des emplois du service public (Bomsel, 1989, p. 286). Le régime fiscal appliqué à la MIFERMA devait permettre à l’État mauritanien de tirer une bonne partie de ses ressources de l’exploitation minière mais l’application de ce régime fut difficile du fait du déclin du marché du fer. La nationalisation de la société minière entraîna une confusion entre la stratégie de la nouvelle SNIM, Société Nationale Industrielle et Minière, et la politique du gouvernement, entre le budget de la société et les revenus nationaux (Bonte, 2001, pp. 89-192). À la fin des années 1970, les revenus miniers ne furent plus suffisants pour supporter le système de redistribution et cette redistribution vers des emplois improductifs devint alarmante lorsqu’elle concerna la SNIM elle-même. Sa restructuration, exigée par les banques de prêt, fut un échec quant au licenciement du personnel excédentaire : à la fin de 2001, la SNIM comptait encore 3 552 employés (rapport annuel de la SNIM, 2001, 12). L’afflux de migrants et le poids économique des deux villes de Zouérate et de Nouadhibou conduisirent à une restructuration administrative par la création de deux régions autonomes. Les activités économiques des deux villes principales se développèrent en parallèle des besoins de l’activité minière et de ses employés. Nouadhibou, contrairement à Zouérate, pût diversifier son économie par le développement du secteur de la pêche, devenu lui aussi essentiel à l’économie mauritanienne. La ville de Zouérate devint alors un marché pour la production de Nouadhibou qui transitait vers l’intérieur des terres par le train. Avec l’achèvement récent de la route reliant Nouadhibou à la capitale Nouakchott, le port est entré dans des dynamiques d’échanges à une échelle nationale qui transformeront sans doute la nature de ses activités.
9
2.3. L’avenir de la région 2.3.1 Une marginalisation des mines de Mauritanie sur le marché mondial du fer L’ensemble minier de Mauritanie exporta sur le marché 10,5 millions de tonnes de minerai de fer en 2002. En 2001, les réserves en minerai de fer de la Kédiya étaient évaluées à 245 millions de tonnes. Reposant sur des gisements limités, avec des charges d’exploitation importantes et un accès réduit au marché, il a désormais peu de poids face, par exemple, au complexe de Carajás, mis en exploitation en 1985 et composé lui aussi d’un ensemble minier et d’un port minéralier reliés par une longue ligne de chemin de fer, qui exporte aujourd’hui près de 50 millions de tonnes par an. Face à la diminution de ses réserves, la MIFERMA investit progressivement dans des usines de valorisation des minerais à faible teneur en fer, à Rouessa (1973) ou aux Guelbs (1974). La mise en exploitation en 1991 des grands gisements à forte teneur en fer de M’Haoudat et l’exploitation prévue d’autres gisements à faible teneur (réserves possibles : 2,1 milliards de tonnes), dans les Guelbs de l’Ouest et du Nord, donne l’espoir d’une pérennité de la production, la société minière ayant atteint un équilibre financier. Cependant, la Mauritanie ne peut plus faire reposer toute son économie sur une activité aussi dépendante de lourds projets d’extension des zones exploitées, demandant des investissements étrangers. Des recherches sont actuellement menées pour trouver du pétrole sur le territoire national, ce qui allègerait les coûts d’exploitation de la SNIM, mais l’exploitation de cette ressource serait encore tournée vers l’exportation, les activités intérieures étant limitées. La Mauritanie semble bloquée dans sa nature de « pays minier ». 2.3.2. Un aménagement ferroviaire qui n’a pas lancé l’économie régionale Le chemin de fer mauritanien exporte le minerai sans que cette commercialisation ne soit valorisée dans la région. Les conditions climatiques, l’absence de combustibles et d’eau ne permettent pas l’installation d’unités productrices de gueuse, le faible marché de consommation et les difficultés économiques du pays ne rendent pas plausible la création d’une usine sidérurgique. L’aciérie électrique de Nouakchott fonctionne avec des ferrailles (déchets). L’ouvrage Mining and metallurgy investment in the third world : the end of large projects ? (1990) d’Olivier Bomsel pose la question de l’avenir des exploitations exportatrices de minerai des pays du Sud. Les sociétés doivent diversifier leurs activités et fournir le marché local, afin de contrer les difficultés du marché mondial. Il insiste : « il y a, selon nous, peu d’avenir pour les grands projets exportateurs du Tiers-Monde » du fait de la difficulté croissante de développer des opérations compétitives dans des pays « rentiers ». La SNIM cherche à diversifier ses produits, elle a acquis des permis de recherche d’or et de diamants dans la région de la Kédiya d’Idjil, s’intéresse aux possibilités d’exploitation du gypse et transporte sel et pierres marbrières vers Nouadhibou. La ligne ferroviaire reste encore le moyen de drainer les matières premières de l’intérieur des terres vers la côte. Cherchant à utiliser la ligne ferroviaire comme atout régional, la SOMASERT, filiale de la SNIM spécialisée dans les activités touristiques, a accroché au train minéralier une voiture de
10
voyageurs surnommée « le train du désert ». Elle propose aux touristes des excursions dans les villes minières et dans les villes caravanières. Ayant la seule gare de passagers entre F’Dérik et Nouadhibou, Choum est au centre des stratégies régionales de développement touristique et, dans les circuits, une étape essentielle puisqu’elle fait le lien spatial entre la tradition de l’Adrar et la modernité du complexe minier. Cependant, le tourisme reste à l’état embryonnaire, la Mauritanie n’étant pas une destination prisée et les conditions d’accueil restant très limitées. Si le train a contribué au développement et à la commercialisation des produits de la pêche de Nouadhibou vers l’intérieur des terres, le transport de passagers et de marchandises reste clandestin. Le transport des populations et de leur bétail sur les wagons de minerai, s’il entraîne de graves accidents, contribue dans une faible mesure à une plus grande mobilité des populations, mais cette activité commerciale reste précaire. Malgré la nationalisation de la société minière, il n’a pas été envisagé d’utiliser le train comme moyen de développer les échanges, en utilisant la tradition commerçante des populations. Si la voie ferrée joua son rôle dans le désenclavement de la région où les flux économiques se sont diversifiés et multipliés, ils restent limités et dépendants de la pérennité de l’activité minière. La route prévue entre Nouakchott et Atar permettra une meilleure liaison de la région avec le centre du pays, minimisant ce rôle de désenclavement, même si la voie ferrée demeure un axe de pénétration par rapport à un réseau Nord-Sud renforcé. Dans le cas d’une baisse de rentabilité excessive de l’activité minière qui conduirait à un arrêt de la production, les populations sédentarisées le long de la ligne reprendraient probablement leur mode de vie nomade ou iraient grandir les bidonvilles de Nouakchott ou du sud du pays. Aucune activité viable ne s’étant développée, il faudrait une forte volonté politique et une aide extérieure pour maintenir un trafic même faible sur la ligne, la maintenance du chemin de fer coûtant cher en matériel et en hommes. À moins qu’une autre activité extractrice prenne le relais en quantité ou en valeur similaire à celle générée par la production de minerai de fer. La nouvelle organisation de l’espace autour de la ligne Zouérate – Nouadhibou est fragile. Si de nouveaux centres économiques ont émergés, les échanges demeurent faibles et ne sont pas institutionnalisés, la population reste instable, conservant ses traditions nomades. Au niveau national, le peuplement le long de la voie ferrée a permis une meilleure occupation du territoire national mais le centre, où se trouve le pouvoir central, absorbe les revenus issus des marges sans rien produire : denrées agricoles au sud, minerai de fer au nord, créant un déséquilibre peu viable. Finalement, la voie ferrée du nord, couloir d’exportation du minerai, a à la fois réorganisé l’espace national et entraîné un développement localisé, mais ces transformations peuvent difficilement être considérées comme durables. L’aménagement ferroviaire n’a créé dans l’espace qu’une organisation dépendante du transport et le modèle minier, bien qu’il ait intégré les populations locales et créé de nouveaux flux, reste de référence. Orientation bibliographique : BONTE, P. (2001), La Montagne de Fer, La SNIM (Mauritanie) : une entreprise minière saharienne à l’heure de la mondialisation, Paris, Ed. Karthala, 368 p. BOMSEL, O. (1989), Competitiveness and prospects for the African Mining Industry : A case study of the Guelbs complex in Mauritania, Butterworth & Co (Publishers) Ltd, env. 20 p.
11
BOMSEL, O. (1990), Mining and Metallurgy Investment in the Third World : The End of Large Projects ?, OECD Development Centre Studies, Paris, 221 p. COOPÉRATION FRANÇAISE CAMPUS ; Université de Nouakchott LERG ; Université de Rouen LEDRA (env. 1995), Atlas Migrations et gestions du territoire, République Islamique de Mauritanie, 12 planches, notice explicative. DE SA, P. (1991), Le minerai de fer, Paris, Ed. Economica, 151 p. (coll. Cyclope). MONBEIG, P. (1966), Les franges pionnières. In : Géographie Générale, Bruges, Encyclopédie de la Pléiade, pp. 974-1006. REYNAUD, A. (1981), Société, espace et justice, Paris, PUF, 263 p. TEX Report (2003), Iron Ore Manual 2002-2003, Tokyo, Japan, theTEX Report Ltd (publishers), 346 p. www.snim.fr : site de la SNIM www.wto.org : site de l’Organisation Mondiale du Commerce