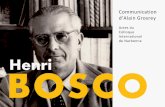\"à mi chemin entre ciel et terre\" - les stylites
Transcript of \"à mi chemin entre ciel et terre\" - les stylites
« à mi chemin entre le ciel et la terre »
Les stylites et leur espace vital
Rozalia HORVATH
Université de Strasbourg
INTRODUCTION
Le phénomène stylite inauguré par Saint Syméon le Grand dans la Syrie du Ve siècle
est, peut-être, la manifestation la plus spectaculaire de ce grand mouvement religieux de
masses appelé « monachisme oriental ». « Les stylites étaient des ascètes vivant sur des
colonnes pour se tourne plus profondément vers Dieu. Ils y passaient toute leur vie, dans une
immobilité presque absolue1. » Le mouvement stylite pris donc naissance vraisemblablement
de l’inspiration du moine Syméon le Grand.
Le stylitisme, en tant que mouvement religieux, se situe dans une époque précis de
l’histoire de l’Eglise, aux Ve, VIe et VIIe siècles - bien que selon certains sources, des
phénomènes stylites éparses existaient jusqu’à XIXe siècle – et dans une région bien localisée
du monde méditerranéen, la Syrie, ce qui n’exclus pas l’existence des stylites en dehors de
cette époque et de ce milieu géographique.
Dans notre travail nous nous proposerons d’examiner le phénomène stylite d’après sa
relation à l’espace. Contrairement en effet à d’autres vies monastiques, ascétiques existantes
dès le début du christianisme et accentuant ou bien la « fuga mundi », une séparation stricte
du monde ou bien la vie communautaire, menée dans l’enceinte d’une ville, souvent au
service des hommes par un ministère liturgique ou par le pratique des œuvres de charité, le
stylitisme semble situer aux confins de ces deux formes de vie bien identifiable, qui est d’une
part la vie anachorète d’autre part la vie cénobitique. Le stylite vit en même temps la
séparation du monde, s’installant sur cette petite portion bien délimitée de l’espace qui est sa
colonne, mais il ne se retire pas dans l’isolement du désert ou un forêt. Un stylite n’est jamais
loin des régions habitées, il est l’homme séparé par excellence qui peut être toujours trouvé,
1 I. PENA et alii., Les stylites syriens, Milan, Franciscan Priting Press, 1987, Collection minor n° 16, p.23
1
toujours consulté. C’est en quelque sorte un anachorète au milieu des hommes. Pour
comprendre le choix et la signification de cette forme de vie ascétique menée à un lieu pour le
moins inhabituel pour le commun des chrétiens et aux plupart des ascètes, nous allons d’abord
examiner comment cette vie entre « terre et ciel » est interprétée dans la vocation personnelle
de ces ascètes, puis en un second temps, en recourant à quelques résultats des fouilles
archéologiques, nous examinerons comment se traduisit cette implantation ascétique de point
de vue architecturale et géographique, enfin, en un troisième étape nous nous proposons de
jeter un regard sur l’insertion de « l’homme de la colonne » dans son entourage humain
proche et lointain.
Pour l’analyse proposée nous nous recourrons le plus souvent à différentes « Vita » de
Syméon le Grand, qui peut être considéré comme archétype des stylites. Nous compléterons
toutefois nos informations par des données retenues de la vie des autres stylites, comme Saint
Daniel, Syméon le Jeune, ou encore des stylites installés autour de Qal’at Sim’an, sanctuaire
érigé à la fin du Ve siècle en l'honneur de celui qui fut un des plus prestigieux ascètes de
Syrie, le stylite Syméon.
1. DES HOMMES DES HAUTEURS
En regardant de près les deux hagiographies principales de Syméon, le récit de
Théodoret de Cyr dans son Histoire des moines de Syrie et la Vie syriaque, nous trouvons
deux approches pour expliquer le « pourquoi » de l’ascension Syméon sur sa colonne, plus
exactement sur « ses » colonnes, car les récits de sa vie relatent qu’il occupera jusqu’à sa mort
quatre colonnes différentes, qui deviennent d’ailleurs de plus en plus hautes. Théodoret de
Cyr au début du chapitre 26 de son Histoire des moines contient deux expressions qui
caractérisent la vocation de Syméon2 : philoponia et philosophia, littéralement l’amour de
labeur et l’amour de la sagesse. Philoponia véhicule l’idée de la difficulté, évoque un effort
pénible, et peut avoir le sens d’un combat spirituel, ascétique. Théodoret nous raconte3 que
Syméon s’est converti au christianisme en entendant les Béatitudes « Heureux les affligés » et
« Heureux ceux qui pleurent ». Et c’est ainsi que la vie menée par Syméon sera dure et d’une
extrême sévérité. Théodoret nous dira aussi que Syméon est monté sur le pilier car il trouva la
foule des admirateurs trop nombreux. Il sentait le poids du monde insupportable, et c’est de
2 cf. S. ASHBROOK HARVEY « The sense of a stylite : perspectives on Simeon the Elder », in. Vigiliae Christianae, Vol. 42,
No. 4. (Dec., 1988), p. 379-380 3 THEODORET 26,2
2
cela qu’il se sentait libéré en montant sur sa colonne. En considérant sa vie du point de vue de
la philosophia, Théodoret nous montre comment Syméon atteint cela par le moyen de la
discipline physique, en avançant vers une vertu de plus en plus haut de l’âme. Philosophia est
utilisé en ce chapitre4 pour décrire et ce que Syméon doit chercher, et la vie monastique en
son sens institutionnel. La manière « sauvage » de son ascétisme était le moyen par lequel son
âme est devenue capable d’ascendre toujours plus haut dans sa quête de Dieu. Quand Syméon
a choisi à monter sur sa colonne, il le fait parce qu’il désirait « voler vers le ciel et quitter la
vie sur cette terre »5. Quand il va exhorter les foules venues en pèlerins au pied de sa colonne,
il les presse à se détacher du monde et « voler vers le ciel ». Syméon pratique si parfaitement
cette discipline que Théodoret nous dit, qu’il a surpassé la nature humaine6, il mena une vie
angélique.
Malgré des nombreuses divergences, la Vie de Syméon décrit par Théodoret de Cyr
représente une tradition en harmonie avec la Vie de saint Antoine de l’Egypte, daté du 4e
siècle. Comme Antoine, Syméon devait acquérait la maîtrise de soi-même pour avoir la force
nécessaire pour accomplir l’œuvre de Dieu, que ce soit par les miracles, les jugements, ou
l’enseignement. La capacité d’accomplir cet œuvre s’accroissait en lui progressivement dans
la mesure où sa carrière et sa discipline se sont progressées. Théodoret nous laisse entendre
que Syméon est arrivée à son accomplissement avec l’aide de la grâce, mais si cette grâce est
un don, c’est un don « bien-mérité », et pour Syméon cela passa par son philoponia. Mais ce
que Théodoret admire avant tout c’est la manière de prier de Syméon, par exemple avec des
prosternations en haut de sa colonne. Dans cette prière manifeste le control de Syméon au
dessus de sa nature humaine. Par conséquence il retrouve sa véritable nature humaine, créée à
l’image de Dieu. A son tour, c’est le spectacle du saint sur sa colonne qui va pousser ses
observants de se considérer eux-mêmes et d’être secoués de leur indifférence, comme note
Théodoret7.
Nourrie sans doute de la même tradition que le récit de l’évêque de Cyr sur Syméon, la
Vie syriaque du saint représente l’histoire officielle ou « autorisée ». Mais à la différence du
récit de Théodoret où la/les colonne(s) sont présentées comme instrument de mortification
dans un chemin de l’unification intérieure de l’ascète et comme instrument où son humanité
travaillée et transfigurée par la grâce est exposé comme « exemple » à suivre devant la foule
4 THEODORET 26,2 et 23
5 cf. THEODORET 26,22
6 cf. THEODORET 26,1
7 cf. THEODORET 26, 12.22
3
des pèlerins, la Vie syriaque nous offre une interprétation différente. Dans le développement
graduel de la vocation stylite nous recevons une vue plus subtile, comment la colonne était
choisi et compris8.C’est une série de vision qui amène Syméon à découvrir ce que Dieu veut
de lui. Les models qui lui sont proposés sont Moïse – Dieu lui dit « Comme j’ai fut avec
Moïse, je serais avec Toi9 »-, et Elie, qui donne le directive final pour que l’ascète monte sur
la colonne. Syméon est appelé pour re-ordonner le monde de Dieu : pour qu’il soit un
nouveau Moïse, qui dispense de cette nouvelle montage – sa colonne – la Nouvelle Loi pour
le peuple. Comme un nouvel Elie, il est amené à se tenir fermement devant des rois et des
juges, réprimandant ouvertement les puissants en prenant la défense des pauvres et ceux qui
sont oppressés. Plus tard Daniel le Stylite réprimandera également l’empereur impie,
Basiliskos, et son biographe met sur ses lèvres une phrase prononcé par le prophète Elie
contre Achab10
. En effet, Syméon s’efforce accomplir sa vocation de « saint homme », en
agissant dans des affaires relevant de la juridiction civile et religieuse ; la redistribution de
l’eau, de la terre, etc. Tout cela fait partie de la vocation de prophète, et c’est dans la ligné des
prophètes, comme Moïse et Elie qu’est compris dans la Vie syriaque le pratique stylite de
Syméon. Mais cette interprétation est encore plus vaste. Dans l’Ancien Testament le prophète
n’a pas seulement proclama la parole de Dieu : il l’a mis aussi en pratique, il l’a accompli tant
littéralement par des actes de service, de guérison et de patronage que par des actes
symboliques de leur comportement qui dérangea et secoua la société. Le « stylite-prophète » a
reçu la parole même de Dieu de se mettre à part pour vivre en communion avec Dieu. Et leur
retrait était chaque fois liées aux lieux élevés : loin du peuple qui resta en bas.
La réponse de Syméon à l’appel divin est typiquement syrienne : il se demande, quel
était le comportement des modèles bibliques ? Pour cela il pensa à deux personnages
principaux… Moïse et Elie. En regardant comment et par quoi ils ont atteint leur grandeur :
par la foi ? la Charité ? l’humilité ?... et il s’établira, comme eux, debout, jour et nuit, dans
une prière quasi continuelle…11
Ainsi, Syméon monta sur la hauteur de sa colonne et commença une vie de stylite non
pas par pénitence, pour dénier son corps, non plus par mesure disciplinaires, mais pour
accomplir la volonté, le plan de Dieu. Par ses actions exposées publiquement – comme
prophétie par comportement – il pouvait ainsi proclamer la Parole de Dieu. A la manière des
8 cf. S. ASHBROOK HARVEY « The sense of a stylite » p. 382-385
9 Paul BEDJAN, Acta Martyrum et sanctorum, Tome IV, Leipzig et Paris, 1894, 572
10 André-Jean FESTUGIERE, Les moines d’Orient, vol. II. Paris, Cerf, 1962, p. 148
11 BEDJAN, idem., 547
4
prophètes de l’Ancien Testament, Syméon est la porte-parole de Dieu, et comme telle, il
exécute ce devoir du haut de sa colonne par la puissance de sa parole – qui est un motif
fréquent dans la Vie syriaque de Syméon. La colonne est donc pour Syméon, et ses disciples
plus lointains, l’image des hauts lieux, des montagnes sur lesquels les prophètes ont reçu la
parole et la loi de Dieu. Le Christ lui-même a accompli son œuvre sur des hauts lieux. C’est
sur la montagne qu’il a donnée la nouvelle loi, le sermon sur la montagne. Ces de la montagne
qu’il a comblé puisse affamer et c’est sur la montagne que Satan le tenta…
Une autre interprétation de la vie menée sur ces blocs de pierres élevées se trouve
encore dans la Vie syriaque. Ici les débuts et la fin de la vie de Syméon sont accompagnés par
la mention de l’encens. Comme jeune berger il rassembla de la résine de styrax pour la brûler
comme encens, sans comprendre pourquoi il est poussé à faire cela. Après sa conversion, en
retournant à son troupeau, il a voulu refaire ce geste pour que cette bonne odeur monte vers
Dieu qui est dans les cieux. Une apparition angélique lui demande alors d’élever un autel en
pierre, justement comme plus tard elle lui demandera d’élever une colonne en pierre. La
colonne de Syméon – et à sa suite celles des autres stylites – sera donc un haut lieu où une vie
consumée dans la prière et la pénitence sera un encens d’adoration pour le Dieu vivant.
Ces quelques réflexions, interprétations spirituelles nous amènent au lieu où Syméon a
établi sa première colonne. Et c’est lieu, comme différents autres sites archéologiques, nous
livres des données précieux pour situer ces hommes vivant « à mi chemin entre le ciel et la
terre12
» dans l’espace architecturale et géographique.
2. LA COLONNE ET SON EMPLACEMENT
Cette vie d’ascèse, symbole prophétique vivant était donc menée sur un monticule,
quelques pierres superposées, terminés en un plateforme : la colonne. Cette colonne était la
demeure du stylite, la conditio sine qua non de son ascèse.
A l'époque d'or du stylitisme l'Orient ne manquait point de colonnes. Le monde
classique gréco-romain en avait élevé un peu partout dans les campagnes et dans les villes,
isolées ou alignées. Elles provenaient de palais, de monuments funéraires et surtout de
temples païens, qui lorsque le christianisme devint religion d'Etat furent détruits et
abandonnés ou bien remplacés par des églises. Quelques années avant l'ascension de Syméon
le Grand sur la colonne, l’ermite Maron convertira un temple païen, « demeure, de démons »,
12
EVAGRE LE PONTIQUE, Historia Ecclesiastica, liv. I,13
5
en église13
. A son instar des stylites ont employé ces piliers pour s'y installer, ou en certain cas
ils ont fait construire un nouveau. La colonne de St. Alypius, par exemple, faisait partie d'un
monument funéraire abandonné qui portait un bas-relief figurant un animal, moitié taureau,
moitié lion, que le saint remplaça par une croix14
. Les stylites les plus célèbres se faisaient
ériger une colonne sur commande. Ainsi Syméon le Grand eut quatre colonnes successives de
6, 12, 22 et 36 coudées de hauteur respectivement15
. Syméon le Jeune et le stylite Lazare en
eurent trois chacun; mais d'autres stylites moins renommés se contentèrent d'une seule
colonne pendant toute leur vie. Autour du Djebel Sim'an, région des stylites, lieu où Syméon
le Grand construisit dans sa jeunesse l’autel puis plus tard sa colonne fut érigée, des visiteurs
et archéologues peuvent constater l'existence de nombreuses colonnes de l'époque gréco-
romaine, qui autrefois étaient comme une continuelle provocation pour les nombreux stylites
qui pullulèrent à des dates différentes dans cette région. L'idée devait venir à quelqu'un
d'utiliser ces colonnes pour y asseoir son ermitage.
La base de la colonne16
. – Il n'existe pas de description de la colonne d'un stylite. La
documentation à cet égard est pauvre et lacuneuse. Cependant, en réunissant les détails
dispersés dans les différentes récits de leurs vies, en examinant les restes de colonnes
conservés jusqu'à nos jours et en se fondant sur une iconographie qui se créa dès les temps de
Syméon le Grand, il est possible pour les chercheurs de donner une description approximative
de la colonne d'un stylite et de la façon dont il y vivait.
Toute colonne comportait logiquement trois parties: base, fût et plate-forme. La colonne
de Syméon le Grand possède une base à degrés, taillée à même le roc. Parmi les débris de la
colonne de Kafr Deryan un bloc de pierre fût trouvé, rond, brisé, d'environ 60cm de haut, qui
lui servait très probablement de base. Il reposait directement sur le roc. Celui-ci, taillé en
forme carrée, est surélevé de 40 cm. La base de la colonne du stylite d'Erhab, par exemple, est
formée d'un bloc de pierre de 95cm de diamètre sur 75cm de haut. Sa partie supérieure est
munie de bords, destinés à mieux fixer le fût à la base, en évitant le balancement. Si les restes
de la colonne du stylite de Toqad ne furent pas trouvées, les archéologues ont retrouvé son
emplacement et, plus exactement, l'emplacement de la « mandra ». « Mandra » (gr.) signifiait
primitivement "parc de moutons". Il prit bientôt un sens figuratif. Dans les biographies des
stylites, il désigne une cour entourée d'une barrière de pierres ou une simple enceinte, au
13
, cf. THEODORET 16 14
Vita S. Alypii, c. 9, in. H. DELEHAYE, Les Saints Stylites, Bruxelles, Société des Bollandistes, 1923, p. CXLIX. 15
cf. THEODORET 26 16
Pour cet approche archéologique de la tradition stylite nous nous inspirerons de l’ouvrage de I. PENA et alii., Les stylites
syriens, p. 33-53
6
milieu de laquelle se dressait la colonne. La "mandra" servait à isoler la colonne, en la
protégeant contre la vénération excessive des fidèles17
. Chez les écrivains ecclésiastiques,
« mandra » désigne aussi le monastère lui-même18
. La « mandra » de Toqad comporte un mur
d'enceinte carré de 65cm de hauteur et de 4 m 15 de côté, autour de la colonne ; mais existent
des autres, entourant des colonnes à Teleda, à Telanissos, etc.
Le fût de la colonne. – Au milieu de la mandra, sur la base de pierre s'élevait le fût de la
colonne. D'ordinaire, celui-ci était attaché à la base par une barre de fer, dont les marques sont
encore visibles sur les vestiges des colonnes, spécialement sur celle de Syméon le Grand. La
barre assurait la stabilité de la colonne, en parant au danger des ouragans ou des tremblements
de terre, assez fréquents dans l'ancien Orient. Le biographe de Saint Daniel le Stylite rapporte
qu'une violente tempête secoua, comme un arbre, la colonne du saint. « Quand le vent
soufflait du Sud, elle s'inclinait du côté gauche et quand c'était le vent du Nord, elle penchait
vers la droite ». Et l'auteur anonyme donne la raison de cet état de choses: « Comme la
colonne n'avait pas été fixée convenablement, elle ne tenait plus que par la barre qui avait été
enfoncée en son milieu ». L'empereur Léon, qui avait ordonné l'érection de la colonne, « fut
très irrité contre l'architecte qui avait si mal établi les fondations de la base »19
. Mais il est
arrivait que lors d’un tremblement de terre un stylite, établi sur une colonne au bord de la mer,
près de Byzance, soit projeté dans la mer, lors de la catastrophe.
Le fût de la colonne était composé d'un ou de plusieurs tambours, reliés par des barres
ou des anneaux de fer. La colonne que l'empereur Léon érigea à St. Daniel, en reconnaissance
des prières qui lui avaient fait obtenir de Dieu un héritier, était composée de deux tambours,
unis par des lingots de fer. Cette colonne était encore debout au Xe siècle et, d'après l'auteur
de la Vie de St. Luc le Stylite, elle avait l'aspect d'une « tour ».
Etant donné que la colonne était, le plus souvent, le cadeau d'un bienfaiteur, sa hauteur
dépendait de la générosité de celui-ci et de la renommé:- du stylite. La quatrième et dernière
colonne de Syméon le Grand comportait trois tambours, en l'honneur de la Sainte-Trinité, ce
qui lui donnait une hauteur totale de quarante coudées d'après la Vie Syriaque, trente-six
d'après Théodoret de Cyr, c'est-à-dire de 16 à 18 mètres. Cette hauteur était la limite maxima
« normale » qu'une colonne de stylite pouvait atteindre. Au-delà de cette mesure la vie sur la
colonne présentait de graves inconvénients pour le pénitent, surtout au point de vue
apostolique: il fallait des poumons à toute épreuve pour se faire entendre et il était difficile de
17
A. J. FESTUGIERE, Antioche païenne et chrétienne, Paris 1959', p. 351. 18
D’où vient le nom « archimandrite ». 19
FESTUGIERE, Les moines d’Orient, p. 123
7
trouver une échelle assez longue pour atteindre la plate-forme. La première colonne de St.
Daniel avait « la taille de deux hommes »20
.
Les colonnes des stylites· étaient parfois ornées de signes chrétiens. La Vie de Saint
Alypius fait mention d'une croix sculptée sur sa colonne21
. La colonne de St. Luc était ornée
de cinq croix d'airain, dont quatre se dressaient aux coins du chapiteau et la cinquième en face
du stylite. Sur la colonne de Saint Daniel un dévot fit graver l'inscription suivante, afin de
transmettre le nom du stylite à la postérité: « A mi-chemin entre la terre et le ciel se tient un
homme qui ne craint pas les vents qui·soufflent de toutes parts. Son nom est Daniel.22
».
La plate-forme ou le chapiteau. - Mais le stylite ne vivait pas sur le fût même: celui-ci
supportait un autre élément plus important où l'ascète passait sa vie: une plate-forme, ou
parfois un chapiteau, assez large pour qu'il puisse s'y tenir debout et s'y coucher. Aucune
plate-forme et aucun chapiteau de stylite n'ont été retrouvés jusqu'à présent par archéologues
et ce sont eux pourtant qui nous permettaient de mieux connaître le genre de vie des stylites.
Le fait de ce manque de vestige a conduit certains chercheurs à nier catégoriquement
l'existence des chapiteaux dans les colonnes de stylites. Il y aurait eu, selon eux, au-dessus de
la colonne une dalle carrée dont le côté pouvait être nettement supérieur au diamètre de la
colonne et qui portait sur ses quatre faces un parapet élevé, au-dessus duquel apparaissait seul
le buste de l'ascète. Ce dispositif peut avoir été creusé dans un bloc de pierre, ou construit en
bois. Cette dernière hypothèse rendrait compte de la complète disparition des chapiteaux dans
les quatre cas où les colonnes ont pu être retrouvées. Les chapiteaux corinthiens sont dus à
l'imagination des peintres23
.
Autres chercheurs, comme le franciscain I. Pena remarque, qu’il n'a jamais existé de
colonne-type, identique pour tous. Le système stylite resta toujours l'expression d'un mode
individuel de vie ascétique. La plus grande fantaisie régna dans la conception de chacun. Il
sera donc imprudent de trop généraliser. Dans la Vie de St. Luc le Stylite, par exemple, le
chapiteau est cité expressément24
, et la colonne de Daniel avait un chapiteau creusé en forme
de cuve25
.
I. Pena pense, cependant, que les colonnes des stylites du Nord de la Syrie, étaient
généralement privées de chapiteau. Un cas typique est la colonne du stylite anonyme de
20
FESTUGIERE, Les moines d’Orient, p. 109 21
Vita S. Alypii, c. 9, dans DELEHAYE, Les Saints Stylites, p.; CXLIX. 22
FESTUGIERE, Les moines d’Orient, p. 115 23
J. LASSUS, Sanctuaires chrétiens de Syrie, Paris 1947, p. 277-280. 24
Vita S. Lucae, dans DELAHAYE, op. c., p. CLV 25
cf. FESTUGIERE, Les moines d’Orient, p. 109
8
Telanissos, découverte en 1972. Elle peut nous éclairer sur la constitution de la demeure du
stylite, puisque la partie supérieure du fût est conservée presque intacte: un bloc de 1 m 32 de
haut et de 0 m 78 de diamètre. Deux entailles traversent diamétralement la surface supérieure;
elles forment au centre un orifice de 0 m08 de profondeur et de 0 m07 de diamètre. Cet orifice
a été évidemment pratiqué pour recevoir une coulée de plomb, où étaient fixées des barres de
fer saillantes. Celles-ci soutenaient, à leur tour, la plate-forme sur laquelle se tenait le stylite,
et qui dépassait le diamètre de la colonne. En outre, dans toute la partie supérieure, à
intervalles irréguliers, étaient percées des trous. Ils étaient destinés à recevoir des supports en
bois ou en fer qui soutenaient la plate-forme saillante. Ainsi conçue, la colonne du stylite
laissait à désirer au point de vue esthétique. On peut bien supposer que l'architecte, ou le
maçon constructeur, a voulu, cacher à la vue de la foule cet amas de barres saillantes, de
supports, de clous, etc., qui fixaient la plate-forme du stylite. Nous sommes dans une période
de l’histoire où les préoccupations esthétiques jouent un grand rôle dans l’architecture. Rien
de plus simple donc que d'imaginer une rangée de planches qui dissimulaient obliquement la
partie supérieure du fût et donnaient l'illusion, à celui qui les regardait d'en bas, d'avoir affaire
à un chapiteau. C'est la même méthode, d'ailleurs, qui persiste encore aujourd'hui dans la
construction de certains minarets ruraux en Syrie du Nord.
D'après les calculs des proportions, établis sur ce qui reste de la colonne de Syméon le
Grand, M. de Vogüé a pu conclure que « le chapiteau offrait une aire de six pieds de côté, soit
environ quatre mètres carrés de surface26
». Selon I. Pena et ses collaborateurs quatre mètres
carrés supposaient, un chapiteau trop grand pour la colonne de Syméon. Evagre le Pontique,
par contre, donna une autre mesure, sans préciser s'il s'agit de la première ou de la dernière
colonne du saint: « Celui-ci (Syméon) fut le premier à monter sur une colonne dont l'espace
était à peine de deux coudées » (Hist. Eccl. Liv. I,13). Les stylites ont réalisé peu à peu des
« améliorations » sur la plateforme pour la rendre plus habitable. Saint Alypius, stylite de
Paphlagonie, avait fixé au-dessus de la colonne quelques planches en bois pour pouvoir se
coucher. La plate-forme de la troisième colonne de Saint Syméon le Jeune était plus
confortable, puisqu'il y avait assez de place pour recevoir des visiteurs. Ainsi Denys, évêque
de Séleucie de Piérie, put y entrer pour l'ordonner prêtre, malgré l'humble résistance du
saint27
. Toute plate-forme était couronnée d'un garde-fou qui arrivait à la ceinture du stylite et
le protégeait contre le vertige. Cette mesure de sûreté devait être générale, puisque nous ne
connaissons aucun cas de stylite tombé à cause d'un faux pas.
26
M. DE VOGÜE, Syrie centrale. Architecture civile et religieuse, Paris 1865-1877, p. 149. 27
Vita S. Alypii, c. 25, dans DELEHAYE, op. o., p. LXXXIV et NICEPHORUS, Vita S. Symeonis Junioris, c. XIX
9
Quant à la vie sur la colonne, il faut d'abord préciser qu'il n'existe, du moins pour les
stylites syriens, ni uniformité ni règlement pour l'organisation de la vie sur la colonne. Le
stylite jouissait de la plus grande liberté pour disposer de sa vie, car le système reste une
manifestation individuelle d'ascèse. Les circonstances extérieures, climat, époque, milieu
social, etc., modifièrent le genre de vie des stylites et influèrent sur leurs occupations.
La rudesse du climat devait rendre, évidemment, les conditions de vie particulièrement
pénibles sur la colonne, des hivers rigoureux alternant avec des étés très chauds. Il était
normal que l'une des préoccupations des stylites ait été d'ordre météorologique. Syméon le
Grand, par exemple, était exposé sur la colonne aux rigueurs de la saison, n'ayant d'autre
couverture que le ciel. Tout au plus il se protégeait la tête avec un capuchon pointu qui faisait,
à cette époque, partie du costume monastique. Mais la vie ouverte à tous les vents devait être
familière à un homme qui avait gardé les troupeaux dans sa jeunesse sur les montagnes du
Taurus. Mais ni la violence des vents qui viennent du Taurus en hiver, ni les brûlures du soleil
d'août ne pouvait séparer de sa colonne ce « martyr » ou « athlète » de la Foi.
A mesure que le mouvement se répandait, de nouveaux éléments s'introduisirent dans la
forme de vie des stylites. Ainsi, pour se protéger contre les rigueurs des saisons, on imagina
une espèce d'abri-cellule au-dessus de la plate-forme, ou bien une guérite en planches
couverte d'un toit. La seconde colonne de Syméon le Jeune était surmontée d'une sorte de
tente faite de peaux. Elle avait même une petite fenêtre. Mais le saint, après la mort de son
maître, le stylite Jean, supprima la fenêtre pour plus de mortification, se privant ainsi de la
lumière28
. Quant à Daniel, il commença sa carrière de stylite sans abri, afin d'imiter plus
parfaitement Syméon le Grand. Un incident désagréable allait changer son genre de vie. Un
jour d'hiver, le vent lui arracha la tunique et la jeta au sol. Le stylite, n'ayant pas le moyen de
descendre pour la reprendre, « resta toute la nuit nu et exposé à la neige. De bon matin son
disciple vint le tirer de sa détresse. Il approcha l'échelle et trouva le saint demi-gelé. Il parvint
à le réanimer avec de l'eau chaude et des éponges. Mais à la suite de cet incident, l'empereur
Léon 1er, son admirateur et dévot, l'obligea d'avoir dorénavant un abri29
. »
Le "tuyau de dégagement » - Le stylite restait donc, jour et nuit, exposé aux regards de
la foule qui observa ses plus petits mouvements. Même s'il était, dans le meilleur des cas,
protégé par un abri-cellule, il devait se trouver dans l'embarras pour répondre à certains
besoins physiologiques. Des archéologues, en examinant les restes de la colonne de Kafr
28
NICEPHORUS, Vita S. Symeonis Junioris, c. VI 29
FESTUGIERE, Les moines d’Orient, p. 126
10
Deryan, ont remarqué des traces de canalisation, notamment une entaille creusée dans la base
en direction de l'Est, ayant une longueur de 33cm x 16cm et 17 cm de profondeur. Cette
canalisation ne paraît pas avoir d'autre but logique que de servir d'écoulement des eaux.
Probablement il existait un conduit en plomb ou en terre cuite qui montait de la base jusqu'au
sommet de la colonne. Leur opinion était confirmée par l'existence, à 1 m15 de la base, d'une
cavité naturelle dans le roc, d'environ 1 m 50 x 0 m 60 x 1 m 10. Ils ont pensé d’avoir trouvé
en cela une fosse destinée à recevoir les eaux sales. Des autres colonnes ont peut également
déduire que les stylites qui y étaient installé, ont eu des notions assez précises d'hygiène. La
Vie du stylite Saint Lazare mentionne un détail prosaïque: une espèce de "tuyau de
dégagement" qui courait le long de la colonne. Des fourmis qui avaient fait leur nid dans un
arbre proche de la colonne montaient par le « tuyau de dégagement » jusqu'au stylite et
détournaient son esprit de la prière, tout en ajoutant à ses pénitences une mortification
supplémentaire30
.
Une hypothèse intéressant fût émise par certains spécialistes, qui pensent que l’abri-
cellule des stylites s'est perpétué jusqu'à nos jours dans l'architecture rurale syrienne. En effet,
à quelques centaines de mètres de l'emplacement de la colonne du stylite du nom Yohannan à
Athareb se trouve le minaret d'une mosquée. De forme ronde à l'image d'une colonne, il est
surmonté d'une plate-forme que protège une grille en bois. De cette plate-forme, le muezzin
appelle les fidèles à là prière. Le minaret est couvert d'une calotte en bois. Il existe un vrai
parallélisme entre la colonne du stylite et le minaret musulman. La figure du muezzin, sur la
plate-forme, appelant les fidèles à la prière, ne devait pas différer de celle de Yohannan le
Stylite appelant le peuple à la pénitence.
L'usage du minaret s'est-il inspiré du mouvement stylite? Cette hypothèse n'est pas
gratuite. Elle pourrait avoir une confirmation dans la Vie de Saint Siméon le Grand, qui parle
d'une affluence continuelle d'Arabes et de Sarrasins au pied de la colonne. « Les Ismaélites,
dit Théodoret de Cyr, témoin oculaire des faits, arrivent par groupes de deux cents, trois cents
à la fois, parfois même plusieurs milliers. Ils renient à grands cris les erreurs de leurs pères,
fracassent devant ce grand luminaire les statues qu'ils adoraient et, abjurant les orgies de
Vénus, ils s'initient aux divins mystères »31
. L'influence que le monachisme, et plus
particulièrement le stylitisme, a pu avoir sur l'Islam des premiers siècles est une question qui
demande des recherches approfondies qui dépassent le cadre de cette étude. Une chose est
sûre. La sympathie que Mahomet éprouvait pour le christianisme provenait, en bonne partie, 30
Vita S. Lazari, c. 222. dans DELEHAYE, op. cité., p. CLX 31
cf. THEODORET 26
11
de la vie austère que pratiquaient les moines chrétiens. Les références à la vie monastique sont
fréquentes dans le Coran. La légende du moine Buhaira, à qui l'on attribue l'éducation
spirituelle de Mahomet, est l'un des souvenirs les plus remarquables de l'influence des moines
chrétiens de la frontière de la Syrie sur les Arabes nomades. Rien d'étrange donc si le
fondateur de l'Islam a eu des entretiens avec des stylites syriens, car, ils étaient nombreux
dans la Syrie du VIIe siècle. En outre, ils s'installaient au bord des voies de communication,
par motifs d'apostolat. « Tous les Arabes de la Mésopotamie et de la Syrie, affirme F. Nau,
avaient vu des solitaires et des ascètes, avaient mangé aux portes des monastères et avaient
assisté à des controverses entre monophysites et diphysites »32
. Le soin avec lequel les moines
entretenaient les vastes citernes, faisait des couvents des points naturels de rassemblement
pour les Arabes du désert.
Ces dernières réflexions sur la situation des colonnes par rapport des lieux habités, des
réseaux de route et le fait de leur apostolat concret nous amène à considérer comment se situa
l’ascète de la colonne, cet homme à mi chemin entre ciel et terre par rapport les hommes qui
l’entouraient et la vie civile et ecclésiale de leur époque.
3. LES STYLITES - A LA CROISEE DES MONDES ?
A la fin du second partie de notre travail, nous avons vue que contrairement des ascètes
d’Egypte, comme Antoine et ses disciples, les stylites de Syrie ne sont pas des anachorètes
proprement dit, bien qu’il ne s’agit pas davantage des cénobites en leur cas. Peut-être plus que
n’importe quelle autre forme de vie ascétique de l’époque le stylitisme se situe à la jonction
d’une vie « séparée », mais qui inclut dès le début le maintient de la relation avec le monde.
Nous avons vue également en examinant les sources et les interprétations bibliques du
stylitisme que la séparation, la « montée dans le hauteur » est cette condition du rôle de
médiation de ces « saints hommes ». En relatant le contact avec les tribus Arabes, il était
mentionné que les colonnes des stylites ont été dressées non loin des routes, éventuellement
des villes, villages. Nous pouvons donner plusieurs explications à cette proximité. Le plus
prosaïque vient de la densité de population de la Syrie, relativement élevée à l’époque, qui n’a
pas rendu possible une telle retraite comme dans le cas des ascètes d’Egypte, qui ont pu se
retirer à leur guise au désert. Le choix de la pratique stylite s’expliquera ainsi : la colonne
permettait une réelle séparation dans l’espace par rapport des gens de l’alentour. La plupart
32
F. NAU, Les Arabes chrétiens de Mésopotamie et de Syrie du VIIe au VIIIe siècle, Paris, 1933, p.5
12
des stylites, n’oublions pas, avant leur « ascension » sont passé par différentes étapes de la vie
ascétique, menant la vie cénobitique, puis le reclusage, ou vivant sous le ciel, sans abri, ou toit
quelconque. Il y a comme une avancée, une véritable montée lors du choix d’une vie sur la
colonne, comme nous l’avons vu dans la vie de Syméon, qui tente à s’échapper de la foule
croissant de ses admirateurs, en prenant un peu de hauteur. Toutefois, le lien entre stylites et
leur environnement n’est jamais coupé. Syméon le Grand - et à sa suite les autres stylites -
« ne néglige pas les affaires de l'Eglise. Il combat en même temps l'impiété des gentils et
l'obstination des juifs et des hérétiques ... Il conseille même aux évêques des Eglises d'avoir
soin de leurs ouailles ». Le biographe, Théodoret ajoute: « Il prêche deux fois par jour »33
.
Certaines colonnes étaient entourées·jour et nuit, d'une multitude de personnes qui, comme
note Théodoret au sujet de Syméon, ressemblait à « une rivière humaine, qui reçoit par divers
chemins ce nombre infini de peuples venus de tous côtés. Le stylite installé près de Beyrouth
au VIe siècle avait encore un auditoire plus choisi: les étudiants de l'Université de droit de
Béryte. Les jours de congé, ils allaient en excursion jusqu'à la colonne, attirés par la
nouveauté du spectacle. De sa hauteur « le solitaire » conseillait et sermonnait les futurs
juristes34
.
Si nous avons parlé d’un influence possible du stylitisme sur la tradition de la
« muezzin » de l’Islam, nous devrions, de l’autre côté, poser la question, à la suite de certains
chercheurs, si la tradition stylite n’était pas elle-même influencée par un autre culte, rite lié à
des « colonnes ». Parce que, si du point de vue de l’ascétisme chrétien, la montée de Syméon
le Grand sur sa colonne, au début du Ve siècle était une jamais vue, nous ne pouvons pas être
sûr, si sa pratique n’était pas inspirée éventuellement d’autres cultes non chrétiens. David T.
M. Frankfurter dans son article publié en 1990 sur les « religions aux colonnes » de la Syrie
de l’Antiquité tardive35
, suggère un rapprochement entre le stylisme chrétien et la pratique des
« phallobates » mentionnés par l’écrivain grec Lucian, qui écriva au début du IIe siècle. Dans
son œuvre De dea Syria il parle du culte de la déesse Atargatis à Hierapolis, une des centres
religieux de la Syrie de Nord. Il relate l’existence à la porte du temple de Hierapolis des
« phalli » installés par Dionysios, chacun mesurant 1800 pieds. Un homme monta deux fois
par année sur une de ces colonnes et vécu sur elle pendant une période de sept jours. Lucian
donna la raison de cette montée ainsi : le peuple croyait que cet homme installé dans les
33
cf. THEODORET 27 34
J. LAMMENS, La, vie· unive'sitaire à Beyrouth sous les Romains et le Bas-Empire, dans Revue du Monde Egyptien,
sept. 1921, t. I, p. 657. 35 David T. M. FRANKFURTER, « Stylites and Phalobates : Pillar Religions in late Antique Syria », Vigiliae Christianae, Vol.,
44, n° 2. (Jun., 1990), pp. 168-169
13
hauteur communique avec les dieux, il demande la bénédiction sur la Syrie et les dieux
écoutent cette prière qui est prononcé plus près d’eux. Autres ont pensé que cette montée
symbolique sur la colonne trouve son origine dans la mémoire du Déluge où les hauts lieux
furent saufs des eaux.
Evidemment, nous ne pouvons pas approfondir ici la question de l’interdépendance
entre stylitisme et pratique religieuse antérieur liée aux colonnes. Il semble toutefois, que le
problème de la relation, à 100 km et à 3 siècles de distance, entre le stylite chrétien et le
phallobate païen dont nous parle Lucian ait été mal posé : il ne s'agira pas de la reviviscence
d'un culte païen mais de la continuité d'une expression symbolique. Le phénomène stylite
devra alors être étudié dans une perspective diachronique, comme tradition, et dans une
perspective synchronique, comme rupture.
Ce que nous devons retenir par contre de ce rapprochement entre la pratique païenne
antérieure et le stylitisme, c’est la figure de l’homme de la colonne, plus proche de Dieu, qui
implore la bénédiction, qui est, en fin de copte « intermédiaire » entre les hommes d’en bas et
Dieu « vers qui il avance ». Ce rôle de médiation se retrouve d’une manière accentuée chez le
stylite. Nous l’avons vu dès le début de notre travail le rôle prophétique de ces saints hommes,
qui n’est pas seulement la médiation de la Nouvelle Loi, une parole divine pour le peuple « en
bas », mais aussi le rôle, le diakonia de la prière et la demande de la bénédiction de Dieu sur
eux.
Peter Brown dans son livre sur la société et le sacré36
explique amplement un
phénomène culturel typique de la Syrie à l’époque de l’émergence du stylitisme chrétien : le
rôle charnière du patron du village. Brown affirme, qu’à partir du Discours sur les patronages
de Libanius et de l'Histoire religieuse de Théodoret, il est possible, de voir dans le patron un
personnage nécessaire de la vie de village. Le patronage était une réalité de l'existence. Ce
que le « patron » pouvait offrir, c'était le pouvoir sur place, la , élément central de
son rôle propre. En usant de ce pouvoir, il aidait les villageois à maîtriser leurs relations avec
le monde extérieur: il faisait avancer leurs procès; à l'occasion, sa protection s'étendait à leurs
querelles avec d'autres villages ou bien il s’arrangeait pour qu'ils satisfissent aux exigences
fiscales et ne fussent pas obligés de s'y soustraire. Le patron est un facteur de déséquilibre
seulement si ses activités menacent les liens traditionnels entre le village et le monde extérieur
- lorsqu'il a acquis une position assez élevée pour intercepter les rentes et les impôts. Le lien
entre le village et le patron était encore renforcé par les services offerts à l'intérieur même du
36
cf. Peter BROWN, La société et le sacré dans l’Antiquité tardive, Paris, Seuil, 2002, coll. Points Histoire, p. 66-68
14
village. Le « bon patron » était un homme qui a employé son « ,» pour aplanir les
questions épineuses de la vie du village. Il s’occupa d'approvisionner le village en eau et de la
faire répartir, régla l'extinction des dettes. Il pouvait régler sur place les conflits entre
villageois et épargner à ceux-ci le long déplacement jusqu'à la ville pour y porter leurs litiges.
Offrir ces services prenait du temps. Beaucoup de propriétaires résidant en ville n'étaient de
bons patrons qu'en paroles. Ils ne voulaient pas de ces devoirs qui les conduisaient loin dans
la campagne et les privaient de la vie politique urbaine. Ainsi, ils se voyaient éliminés par les
militaires dont le « , pouvoir» prenait souvent la forme d'une garnison proche du
Village… Pour des hommes que leur carrière plaçait en marge de l’aristocratie terrienne, le
lourd travail du patronage, était l'unique moyen d'accéder à la seule source permanente de
richesse et de prestige dans le monde ancien, c'est-à-dire la terre. Il arriva qu’un ermite
(Abraham) a accédé à cette fonction. Il s’installa d’abord dans un village païen comme
courtier pour la récolte des noix. Il chantait les Psaumes. Ses voisins aussitôt bloquèrent
l'entrée de sa maison avec des détritus. Mais, quand le percepteur arriva, ce fut Abraham qui
fut capable, grâce à des amis de négocier un prêt pour tous. A partir de ce moment-là, il fut
déclaré patron du village. Ce déroulement des faits ne montre pas les paysans cherchant
refuge auprès d'un puissant protecteur; il indique plutôt une relation, dans ses étapes
primitives, strictement bilatérale. Très souvent, c'était le village qui donnait le ton. Pour les
fermiers astucieux et sûrs d'eux-mêmes de la Syrie et de romaines tardives, le patronage fut le
levier qui fit bouger la structure la propriété foncière à leur avantage, à la faveur des rivalités
patrons éventuels. Et à la fin du IVe siècle il y avait comme une « chasse au patron» parmi les
villageois de Syrie. Cela était dû au fait que le nouveau patron comblait un vide dans la
société rurale : les villageois avaient besoin d'un homme charnière, qui appartînt au monde
extérieur et qui néanmoins pût mettre son pouvoir, son savoir-faire et sa culture et ses valeurs
à leur disposition. La crise de l'Empire romain tardif est précisément celle qui vit l'homme-
charnière traditionnel disparaître de la scène du village. Ce sont avant tout les liens spirituels
entre ville et campagne qui se rompirent alors. Les villageois durent chercher autour d'eux
pour recréer, avec le matériau humain qu'ils avaient sous la main, la figure vitale de l'homme-
charnière, l’homme médiateur. Au demeurant, un patron efficace était essentiel au
fonctionnement interne des villages, en ce temps de prospérité croissante. Des communautés
de petits fermiers avides de gain, les villageois du Massif calcaire entre autres, avaient besoin
d'un arbitre pour régler leurs querelles. La prospérité des maisons individuelles contraste là de
façon significative avec l'absence totale, avant la fin du Ve siècle, du moindre signe de
bâtiment collectif. Le sens communautaire était faible. Des citernes privées dispensaient les
15
villages des collines de la dure discipline de coopération imposée à la paysannerie d'Égypte
par le Nil. Les villages qui n'étaient gouvernés que par un conseil d'anciens, c'est-à-dire par
les égaux des habitants, menaçaient d'exploser sans l'intervention d'une personnalité
extérieure influente, dit Peter Brown. Quand le patron était faible, le village était rendu
invivable par les querelles: l'idéal était un patron tel que « de son temps, nul ne pût ouvrir la
bouche». Le patronage rural en Syrie était comme le conducteur d'une locomotive, en ce qu'il
permettait aux villages de l'intérieur de traverser une période de prospérité croissante sans
surchauffe.
C'est là que le stylite (ou autre « saint homme ») arriva sur le devant de la scène pour
jouer son rôle dans la société villageoise et dans les relations entre le village et le monde
extérieur. Car ce que les hommes attendaient du saint homme coïncide avec ce qu'ils
recherchaient dans le patron rural. L'Histoire religieuse de Théodoret mérite d'être examinée
attentivement de ce point de vue. Écrite pour confirmer et faire connaître les traditions locales
qui entouraient le saint homme de Syrie, elle reflète ce que Théodoret et ses informateurs
demandaient à ce personnage. Ils savaient exactement ce qu'ils voulaient - une nouvelle
version du « bon patron », un homme assez puissant pour « étendre sa main sur les hommes
en détresse ». Par-dessus tout, le saint homme est un homme de pouvoir. Dans le récit de
Théodoret, la campagne syrienne est comme ponctuée de personnages au pouvoir surnaturel,
aussi palpables, aussi bien localisés et· authentifiés par l'acclamation populaire que l'étaient
les postes de garnison et les grandes fermes. Rendre visite à un saint homme, c'était se rendre
sur le lieu du pouvoir. L’Histoire religieuse est l'étude d'un pouvoir (la grâce, le pouvoir de
Dieu) en acte. C'est pourquoi on insiste même sur le détail des gestes stylisés par lesquels ce
pouvoir se montre. Dans Théodoret, le portrait des saints hommes en action est tracé avec
autant de précision que se trouve fixée la représentation formalisée des gestes du Christ dans
l'accomplissement de·ses miracles. Cette société avait cultivé une image d'elle-même
délibérément urbaine et civile. La violence s'y formulait depuis longtemps en termes de
démonique et le saint homme y était très nécessaire! Il pouvait maîtriser, en les
diagnostiquant, en entrant en relation avec eux, en les dominant solennellement, ces fonds
d'agression non explicités, d'envie et de récrimination mutuelle, qui s'accumulent dans les
groupes restreints qu'étudie l'historien de l'exorcisme. Le langage traditionnel de la possession
permettait de repérer les forces et désignait un homme capable de les briser. Par exemple, les
nombreux villages qui firent à appel à Théodore de Sykéôn traversèrent des crises
dramatiques de perturbation dues à la « possession », suivies d'un rétablissement après que le
16
saint homme eut fait une démonstration d'autorité sur les démons. Fait révélateur: dans ces
villages-là, la crise était en général provoquée par un individu entreprenant qui, prétendait-on,
avait tenté de modifier à son avantage les bornages immémoriaux du village. En ces occasions
la crise était résolue sous la forme d'un opéra spectaculaire, au cours duquel le stylite (ou
autre saint homme) défiait et maîtrisait ce qu'il y avait de démonique dans le village. Ces
incidents ont un contexte social : tout comme la croyance à la « malédiction » prononcée par
le saint homme, ils condensent un souci répandu dans des communautés petites et fragiles,
celui de trouver un personnage qui résolve les tensions et les explosions de violence internes à
la communauté. Toute la documentation fait ressortir l'importance vitale du saint homme
comme médiateur dans la vie du village. Antoine se trouva immédiatement assailli par la
foule: il devint le « médecin de l'Égypte entière ». «…il en consola beaucoup qui étaient
affligés, en réconcilia d'autres qui se querellaient et en fit des amis. » En Asie Mineure au VIe
siècle quand les gens étaient ennemis les uns des autres ou avaient des griefs les uns contre les
autres, il les réconciliait et, ceux qui avaient engagé des poursuites judiciaires, il cherchait à
les ramener à de meilleurs sentiments en leur conseillant de ne pas se nuire les uns aux autres.
C'est à l'intervention de tels hommes que les villageois demandaient un sentiment d'identité
commune. Ils exerçaient un certain contrôle sur les tendances fortement centrifuges du monde
paysan de l'Antiquité tardive. Par exemple, le saint homme affirmait qu'on devait faire face au
malheur par des cérémonies qui missent en valeur l'activité collective du village. Des villages
attaqués par des spectres de femmes, dans le Liban, reçurent le conseil de se faire tous
baptiser et de prendre des mesures rituelles collectives. Au VIe siècle – continue Brown -,
nous sommes déjà dans un monde de processions villageoises soigneusement organisées, par
lesquelles le saint homme réincarne, à travers des ripailles solennelles, l'idéal ancien du grand
bienfaiteur, présidant aux réjouissances d'une communauté unie. Par-dessus tout, le stylite
disait fortement que seule la pénitence pouvait détourner le malheur et que la pénitence
signifiait, très concrètement, une «nouvelle donne », parmi les villageois. C'est là que nous
rencontrons Syméon le Stylite à l'œuvre. Ce que nous savons de l'activité de Syméon dans les
villages en tant que médiateur est d'autant plus impressionnant que notre source principale
considère que cette activité va de soi. Le Syrien, auteur du panégyrique qui nous est le plus
accessible, avait intérêt à ajouter des fioritures exotiques à une réputation locale si fermement
établie qu'il n'eût servi de rien de la redire encore: les princesses persanes, les marchands
d'Asie centrale, les cheikhs du Yémen37
voilà qui intéressait le narrateur et son auditoire, plus
37
cf. Hartmut Gustav BLERSCH, La colonne au carrefour du monde, Abbaye de Bellefontaine, coll., Spiritualité Orientale n°
77, 2001, p. 62-63
17
que l'incessant ruissellement de délégations venant des villages avoisinants avec leurs
problèmes quotidiens.
Donc, en se vouant à sa colonne, le stylite ne disait pas adieu à la foule, et la vie qu'il
avait embrassée n'était pas incompatible avec l'apostolat parmi les multitudes et n’était même
pas conçue sans l’idée de cet apostolat. Le stylite avait donc des disciples, dirigeait les
consciences, distribuait des avis et des conseils et haranguait les pèlerins. Peter Brown
mentionne également que ces mouvements de foule autour de la colonne peuvent être
expliqués par la « fluidité de la population villageoise de Syrie. Alors […] un sous-emploi
massif était la norme de la vie paysanne. Après la moisson et le battage, des foules de
désœuvrés se constituaient durant le plein été et l'automne. Le développement de plantations
d'oliviers avait créé un réservoir de main-d'œuvre mobile: une population fluide y était
mobilisée de novembre à avril pour les travaux de la récolte d'olives. Dans l'intervalle, elle
produisait des équipes d'habiles artisans qui parcouraient les villages des montagnes […] c'est
eux aussi qui édifiaient la réputation du saint homme, dans la vie duquel, en Syrie, la foule est
un élément essentiel. » 38
Comme les autres moines de l’époque, les stylites avaient un rôle de médiation, de
charnière dans les conflits et la survie de l’Empire Romain Oriental au cours du Ve siècle.
Comme le note W. H. C. Frend dans son étude39
, Syméon, par exemple avait des contacts
réguliers avec les officiels, leur envoya plusieurs pétitions, et avait un accès direct à
l’empereur de l’époque, Théodosius II. Syméon le Grand persuada Théodosius à annuler les
instructions de Praefectus praetorio per Orientem qui obligea les chrétiens de rendre aux Juifs
les Synagogue qu’ils leur ont pris en Antioche. Quant à Daniel le Stylite, il est devenu
finalement l’arbitre entre des empereurs rivaux40
. Après avoir miraculeusement guérit des
courtisans, et après avoir intercédé pour que l’impératrice puisse avoir un fils, Daniel aura une
position incomparable devant l’empereur Léon Ier. En dehors de l’arbitrage entre l’empereur
et le roi Lazica en 466, il fut consulté pour autres conseils, spécialement en 468 lors de la
menace de Genséric sur Alexandrie. L’empereur pris d’angoisse à cette nouvelle envoie un
messager pour informer le stylite au sujet de Genséric et « lui dire qu’il voulait envoyer là-bas
une armée. » Mais Daniel, comme ses prédécesseurs, les prophètes de l’Ancien Alliance, fait
dire à Léon de ne pas se faire de souci à ce sujet, car ni Genséric ni autres ennemis n’auront
38
BROWN, idem., p. 65 39
W.H.C. FREND, « The monks and the Survival of the East Roman Empire in the Fifth Century », in. Past and Present, N°
54. (Feb., 1972), pp. 3-24 40
FESTUGIERE, Les moines d’Orient, p. 126
18
pas Alexandrie. L’année suivant Daniel montrera encore sa finesse politique, en soutenant –
sans quitter sa colonne, bien entendu – le faction du consul Zénon contre le dominant
germanique clan d’Alan, Aspar et son fils Ardaburius. Zénon, son orthodoxie et son zèle était
remarquable, tandis que le goth Alan était suspect d’Arianisme dans les yeux de Daniel. Il
n’est pas étonnant, dès lors qu’une fois Zénon devenu empereur, Daniel garda un grand
influence dans le cours.
Or ce dernier remarque de la vie de Daniel nous montre non seulement la prise de
position de/des stylites dans des questions civile, mais encore au niveau religieux. Si nous
essayons relier cette question à la question de l’espace vitale du stylite, nous découvrirons un
trait très intéressant. Nous savons en effet, que le stylitisme fût un mode stable de la vie. Le
stylite, en principe, ne quittait jamais sa colonne. Il avait fait comme un voeu de stabilité
forcée en se consacrant à ce genre de vie. Nous avons vu, que Saint Daniel ne descendit pas
de la sienne même lorsqu'une violente tempête secoua la colonne comme un arbre. Syméon le
Jeune ne consentit à recevoir la prêtrise que sur la colonne.41
Les stylites demeuraient sur la
colonne jusqu'à leur mort, à moins d’en être chassés par la violence. Il y avait, néanmoins, des
exceptions: le bien commun, l'incursion de barbares ou l'ascension sur une colonne plus
élevée.
Ce bien commun était en certain cas le bien de l’Eglise. Comme d’autres moines, les
stylites sont intervenus dans les débats théologiques de leur époque. Nous avons vu le choix
de Daniel en faveur de Zénon contre Aspar, ce dernier soupçonné d’Arianisme. Et à l’instar
des moines connus des récits de l’histoire des premiers conciles œcuméniques, nos stylites
n’en étaient pas toujours absents. Un manuscrit du British Museum fait mention d’un stylite,
Mar Yonan de Kafr Deryan42
. De sa vie nous ne savons que ce que nous dit ce manuscrit, à
savoir que ce stylite, en qualité d’archimandrite participa à la réunion que les grands
défenseurs du Monophysisme syrien tinrent au monastère de Batabu le 17 mai 567. En cet
époque de lutte entre des Monophysites qui admettaient les dogmes du Concile de Nicée et,
d’autre part, les Monophysites dits « trithéistes » qui niaient l’unité de l’essence de la Trinité
les désaccords sur les dogmes de foi et divers intérêts politiques personnels déchirèrent
pendant plusieurs années l’Eglise monophysite. C’est alors que les chefs de Constantinople
suggérèrent aux moines monophysites de l’Antiochène de convoquer un synode qui
41
Parmi d’autres pistes il serait intéressant de travailler la question du stylitisme et le sacrement de l’ordre. Néanmoins, le
cadre de notre travail ne permet pas l’approfondissement de la question. Nous devons toutefois remarquer qu’administrer le
sacrement de l’ordre à un stylite revenait davantage de considérer ce geste comme honorifique à l’égard d’un confesseur
éminent de la foi, envers « un relique vivant » 42
cf. I. PENA idem., pp. 96-103
19
renforcerait la foi des fidèles et montrerait aux Trithéistes la force du Monophysisme. Ce
concile fut convoqué dans le monastère de Batabu, avec 45 participants. Notre stylite, Mar
Yonan, informé de la convocation du synode, abandonna sa colonne et se rejoignit Batabu, à 2
heures de marche de son lieu d’ascèse. Sur le Syndocticon nous trouvons en 22e position la
signature de notre stylite : « Jonas, archimandrita, qui stat supra columnam in pago Kafr
Deryan ». Ayant accompli son devoir envers son Patriarche, Mar Yonan a reprit le chemin du
retour et remonta sur la colonne du haut de laquelle il continua à louer Dieu et à prêcher aux
hommes assoiffés de vérité.
CONCLUSION
Au cours de notre travail nous avons jeté un premier regard sur le phénomène stylite qui
est né de l’inspiration géniale et spontané d’un home de tout premier plan dans l’histoire du
monachisme oriental : Syméon le Grand. La vie de Syméon et de ses plus grand disciples peut
donner une première clé pour comprendre le pourquoi, le comment de ce pratique ascétique
(aujourd’hui si étrange aux lecteurs occidentaux), en particulier en ce qui concerne
l’emplacement du stylite dans son espace vitale, son « hauteur, largeur, longueur et
profondeur… ». Nous avons entrevue les raisons profondément bibliques et spirituelles de
cette « montée ». Monter comme Moïse, les Prophètes et le Christ sur ce haut lieu, pour
donner la Loi Nouvelle, pour prier, pour interpeller. Monter comme offrande vivant sur un
autel.
Nous avons découvert cette relation paradoxe entretenu avec l’entourage : être séparé -
tout en demeurant proche ; coupé des affaires du monde – tout en assurant un rôle charnière
entre les hommes des villages et des villes laissés « en bas », puis entre eux et Dieu, qui est
aux cieux ; vivre dans un dépouillement total et être à la disposition des cours impériaux, etc.
Stylites coupés, éloignés des communautés monastiques, et d’autres, dont nous savons que de
leur hauteur ils ont dirigé des communautés installées à la proximité de leur colonne.
Notre travail ne faisait que jeter un premier regard sur ce mouvement spirituel original
né de la ferveur religieuse et de l’esprit d’indépendance de l’homme de Syrie de l’Antiquité
Tardive. Nous n’avons pas eu la possibilité d’analyser au cours de notre travail le phénomène
stylite en lien avec les sacrements, du point de vue iconographique, ou le culte qui les entoura
non seulement après leur mort, mais déjà au cours de leur vie. On ne garde pas seulement
précieusement leurs reliques, en construisant pour eux des sanctuaires. Déjà dans leur vivant,
20
les stylites étaient considérés comme des reliques vivantes, procurant et médiatisant les
bienfaits de Dieu à ceux qui se confient à eux.
Le genre de vie des stylites, si opposé aux exigences de la nature humaine, fascina –
comme intrigue encore aujourd’hui – l’imagination des chrétiens de l’époque, aux yeux
desquels ils apparaissent comme des êtres surhumains, totalement spiritualisés. Ils étaient
considérés comme des anges en chair mortelle. Et ce qu’Evagre le Pontique dit de Syméon le
Grand peut être appliquer à ses nombreux successeurs connus ou ignorés : « Il vécut comme
un ange dans un corps mortel et, à l’encontre des lois de la nature qui tendent vers la terre par
leur propre poids, il s’éleva entre la terre et le ciel ». Ou comme nous avons lu au sujet de
Daniel : « A mi-chemin entre la terre et le ciel se tient un homme qui ne craint pas les vents
qui·soufflent de toutes parts. » Ces hommes entre ciel et terre n’ont assurément pas eu peur de
se laisser emporté par ce « Vent de tous les vents », qui « souffle où il veut », et qui les a
conduit en cet espace « entre ciel et terre ».
21
BIBLIOGRAPHIE
- S. ASHBROOK HARVEY « The sense of a stylite : perspectives on Simeon the Elder »,
in. Vigiliae Christianae, Vol. 42, No. 4. (Dec., 1988)
- Paul BEDJAN, Acta Martyrum et sanctorum, Tome IV, Leipzig et Paris, 1894
- Hartmut Gustav BLERSCH, La colonne au carrefour du monde, Abbaye de
Bellefontaine, coll., Spiritualité Orientale n° 77, 2001
- Peter BROWN, La société et le sacré dans l’Antiquité tardive, Paris, Seuil, 2002, coll.
Points Histoire
- Hippolyte DELEHAYE, Les Saints Stylites, Bruxelles, Société des Bollandistes, 1923
- André-Jean FESTUGIERE, Les moines d’Orient, vol. II. Paris, Cerf, 1962
- Antioche païenne et chrétienne, Paris 1959
- David T. M. FRANKFURTER, « Stylites and Phalobates : Pillar Religions in late Antique
Syria », Vigiliae Christianae, Vol., 44, n° 2. (Jun., 1990)
- W.H.C. FREND, « The monks and the Survival of the East Roman Empire in the Fifth
Century », in. Past and Present, N° 54. (Feb., 1972), pp. 3-24
- I. PENA et alii., Les stylites syriens, Milan, Franciscan Priting Press, 1987, Collection
minor n° 16
- Théodoret de Cyr, Histoire des moines de Syrie, I. « Histoire Philothée » I-XIII.
Introduction, texte critique, traduction, notes par Pierre Canivet et Alice Leroy-
Molinghen. Paris, Cerf, 1977, Collection « Sources chrétiennes » N° 234.
- Théodoret de Cyr, Histoire des moines de Syrie, II. « Histoire Philothée » XIV-XXX.
Introduction, texte critique, traduction, notes par Pierre Canivet et Alice Leroy-
Molinghen. Paris, Cerf, 1979, Collection « Sources chrétiennes » N° 257.