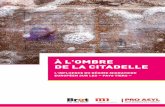A chacun son chemin. Une analyse de la redéfinition des stratégies paysannes et des dynamiques...
Transcript of A chacun son chemin. Une analyse de la redéfinition des stratégies paysannes et des dynamiques...
�������������
����������� ���
Une analyse de la redéfinition des stratégies paysannes
et des dynamiques territoriales dans le contexte migratoire des Andes équatoriennes
Thèse de Géographie soutenue publiquement le 7 décembre 2012
en vue de l’obtention du titre de Docteur de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Jury :
Evelyne Mesclier, Directrice de recherche, IRD – Codirectrice de thèse.
Jean-Louis Chaléard, Professeur de Géographie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Codirecteur de thèse.
Hubert Cochet, Professeur d’Agroéconomie, Institut AgroParisTech.
Geneviève Cortes, Professeur de Géographie, Université Montpellier 3 Paul Valéry – Rapporteur.
Jean-Paul Deler, Directeur de recherche honoraire, CNRS.
Laurent Faret, Professeur de Géographie, Université Paris 7 Denis Diderot – Rapporteur.
�������������
����������� ���
Une analyse de la redéfinition des stratégies paysannes
et des dynamiques territoriales dans le contexte migratoire des Andes équatoriennes
Thèse de doctorat de géographie
UMR 8586 PRODIG – Ecole Doctorale de Géographie de Paris – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
3
– C’est pas mauvais cette petite potée…
– Ouais… pas de quoi écrire une thèse !
Patrick Dewaere, Gérard Depardieu, Les valseuses.
4
« Alors l’Indien rassembla ses haillons, les poules et le maïs, chargea sur ses épaules le père paralytique et, suivi de la femme à qui il confia son maigre bagage, des guaguas et du chien, il prit le chemin de la forêt. Il avait pensé aller demander abri à son compère Tucuso. Mais, sur le chemin, il rencontra d’autres familles, elles-mêmes dépouillées de leur cabane et notamment, celle de son compère. »
Jorge Icaza, Huasipungo.
�
5
�� ���� �����
Cette recherche n’aurait pas abouti sans le concours de nombreuses personnes en France
comme en Equateur. En premier lieu, je tiens à remercier M. Chaléard et Mme Mesclier, pour
avoir accepté de diriger ce travail de thèse et pour leur rigueur scientifique. Merci à Luciano
Martínez et Santiago Ortiz (FLACSO), à Freddy López (PUCE), ainsi qu’à Manuel Carrasco
et Ana Luz Borrero (Université de Cuenca), pour la confiance qu’ils m’ont témoignée. Un
grand merci aux dos hermanos, Marco Bustamante et Patricio Peñafiel, pour leur aide
précieuse sur le terrain et pour les moments plus chaleureux passés à Cuenca.
Je souhaite également remercier Charles Le Cœur et Jean-Louis Tissier, qui m’ont toujours
témoigné de l’intérêt lors de nos rencontres à l’Institut de Géographie, ainsi que Yann
Richard, Jean-François Valette et Georgette Zrinscak, avec lesquels il fut particulièrement
stimulant de travailler à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Evidemment, je ne pourrais oublier tous les paysans qui, de Juncal à la paroisse Octavio
Cordero Palacios, m’ont accueilli avec gentillesse et n’ont cessé de me faire la démonstration
de leur humilité. Il n’a pas toujours été facile d’expliquer l’intérêt de mon travail à des
paysans pour qui la priorité quotidienne est de survivre. Ma vision décalée du monde a sans
doute contribué au maintien de barrières invisibles entre eux et moi, mais qu’importe. Après
avoir sillonné les chemins les plus ardus, après avoir partagé des repas silencieux, il n’y a pas
plus belle récompense que d’avoir été appelé « vecinito ». Pour cela, je leur adresse le plus
amical des muchas gracias.
Un grand merci à tous ceux qui m’ont accompagné de près ou de loin tout au long de cette
thèse. Merci aux miens, parents et amis, pour leurs encouragements répétés. Et pour finir, une
spéciale casse-dédi à A-AC.
8
���� ��
����������� ���
Une analyse de la redéfinition des stratégies paysannes
et des dynamiques territoriales dans le contexte migratoire des Andes équatoriennes
L’émigration paysanne est à l’heure actuelle l’une des dynamiques les plus importantes à l’origine des recompositions territoriales dans les Andes rurales d’Equateur. Dans la paroisse Octavio Cordero Palacios, située dans la province de l’Azuay, la diminution de près de 30% de la population depuis le début des années 1980 a entraîné de profondes transformations de l’espace agraire, en témoignent la réduction des superficies cultivées et la très nette augmentation des aires pâturées, symbole du développement de l’élevage laitier à l’échelle locale. Au-delà de ces mutations majeures, les agriculteurs familiaux de la zone se sont orientés ces dernières années vers le maraîchage, en profitant de la proximité de Cuenca, la troisième ville équatorienne, en vue de commercialiser une partie de leurs productions. Pour cela, ils ont bénéficié de l’appui de plusieurs institutions ayant facilité leur intégration marchande par la mise sur pied d’associations régionales de producteurs agroécologiques.
Dans ce nouveau contexte, les économies domestiques ont beaucoup évolué. Les apports monétaires de l’émigration internationale, de la vente de lait et de produits maraîchers permettent à certaines exploitations de capitaliser et parfois même de se moderniser. Toutefois, de nombreuses familles paysannes demeurent en marge de ces mutations et parviennent difficilement à leur subsistance grâce aux revenus de l’artisanat et des emplois locaux.
Cette thèse, qui s’appuie sur un travail de terrain de dix mois au cours desquels près d’une quarantaine d’exploitations auront servi d’échantillon pour une analyse qualitative, propose ainsi d’étudier la variété des stratégies paysannes qui caractérise l’une des localités de la sierra équatorienne où l’émigration internationale est la plus ancienne. Pour cela, elle s’intéresse principalement aux facteurs de différenciation des économies domestiques et soulève en outre la question du pouvoir en milieu rural, en décrivant le rôle des migrants les plus anciens dans la dynamique territoriale locale.
Mots-clés : Equateur – Andes – migration – paysannerie – agriculture vivrière – agriculture commerciale – maraîchage – élevage laitier – approvisionnement urbain – réseaux de producteurs – relations ville-campagne – dynamiques territoriales.
9
���� ���
�������������� ����
Un análisis de la redefinición de las estrategias campesinas
y de las dinámicas territoriales en el contexto migratorio de los Andes ecuatorianos
La migración campesina es actualmente una de las dinámicas más importantes al principio de las recomposiciones territoriales en los Andes rurales del Ecuador. En la parroquia Octavio Cordero Palacios, ubicada en la provincia del Azuay, la disminución de cerca del 30% de la población desde el inicio de los años 1980 ha provocado transformaciones profundes del espacio agrario, como lo indican la reducción de las superficies cultivadas y el aumento de las áeras pastoreadas, símbolo del desarrollo de la ganadería lechera a escala local. Más alla de estas mutations mayores, los agricultores familiares de la zona se han orientado en los últimos años hacia la producción de hortalizas, aprovechando de la cercanía de Cuenca, la tercera ciudad ecuatoriana, en la meta de comercializar una parte de sus producciones. Para eso, han beneficiado del apoyo de varias instituciones que han facilitado su integración mercantil gracias a la formación de asociaciones regionales de productores agroecológicos.
En este nuevo contexto, las economías domesticas han cambiado mucho. Las remesas, la venta de leche y de hortalizas permiten a algunas explotaciones capitalizar y a veces modernizarse. Sin embargo, muchas familias campesinas se quedan en margen de estas mutaciones y alacánzan con dificultad a su subsistencia gracias a los ingresos de la artesanía y de los empleos locales.
Esta tesis, la cual se apoya sobre un trabajo de campo de diez meses durante los que unas cuarenta explotaciones han constituido la muestra de un análisis cualitativo, propone entonces estudiar la variedad de las estrategias campesinas que caracterizan una de las localidades de la sierra ecuatoriana en donde la migración internacional es la más antigua. Así, se interesa principalmente a los factores de diferenciación de las economías domesticas y plantea la cuestión del poder en el medio rural, describiendo el rol de los migrantes más antiguos en la dinámica territorial local.
Mots-clés : Ecuador – Andes – migración – campesinado – agricultura de subsistancia – agricultura comercial – horticultura – ganadería lechera – aprovisionamiento urbano – redes de productores – relaciones campo-ciudad – dinámicas territoriales.
10
�� ����
�������������������
An analysis of the redefinition of farmers' strategies
and territorial dynamics in the migratory context of the Ecuadorian Andes
Farmers’ emigration is today one of the most significant dynamics leading to territorial rearrangements in the rural Ecuadorian Andes. In the parish of Octavio Cordero Palacios, located in the Azuay Province, the nearly 30% population decline since the beginning of the 1980s has led to major transformations in the agrarian land, as evidenced by the decrease in the size of the cultivated lands and the obvious increase in the size of the pasture lands, these symbolizing the development of dairy farming on a local scale. More than these major changes, the family farmers in the area have turned to vegetable farming over the past few years, taking advantage of their proximity to Cuenca, the third largest city in Ecuador in order to sell a part of their productions. To achieve this, they have been provided support from many institutions that facilitated their commercial integration by putting up regional associations of agroecological farmers.
In this new context, household economics have evolved considerably. Remittances, money from the sale of milk and of market garden produce allow some farms to capitalise and even sometimes to modernise. Yet, many farming families are left outside these changes and hardly manage to subsist on incomes from the craft industry and from local jobs.
This study, based upon a ten-month fieldwork in which about forty farms have been used as a sample for a qualitative analysis, will examine the various sorts of farming strategies that are typical of one of the villages of the Ecuadorian Sierra, from which the oldest wave of migrants originated. To achieve this, this study will mainly concentrate on the differentiating factors of household economics, and will also question the power issue in local areas, by describing the role played by the oldest migrants in the local territorial dynamics.
Keywords: Ecuador – Andes – migration – farming – subsistence farming – vegetable farming – dairy farming – urban supply – producers’ networks - city/country relationship – territorial dynamics.
11
������������������
1. Avant 2000, la monnaie officielle de l’Equateur était le sucre. Pour plus de clarté, toutes
les sommes en sucres présentes dans la restitution des témoignages ont été converties en
dollars en prenant compte des taux de change passés. Pour cela, nous avons utilisé les
données disponibles dans l’ouvrage d’A. Acosta, Breve historia economica del Ecuador
(Acosta, 2006), et plus précisément dans le tableau n°2 disponible en annexe pages 355 et
356 : « Cotizaciones del dólar de Estados Unidos de Norteamérica, 1910-2000 (en sucres
por dólar) ».
2. Les institutions, les lois et les programmes gouvernementaux auxquels nous faisons
référence dans le texte ont vu leurs noms traduits en français. Certains ont été simplifiés,
par souci de clarté. Pour les versions en langues originales, se référer à la Table des sigles.
3. Concernant la transcription des noms vernaculaires, nous avons repris l’orthographe
utilisée dans l’administration et sur la plupart des cartes disponibles. Certains lieux précis
ont toutefois des orthographes différentes selon les sources et les époques. Nous avons
alors retranscrit les noms à la manière de G. Torres, auteur du Dictionario Kichua –
Castellano, Yurakshimi – Runashimi (1982).
4. Les noms de notre localité d’étude et de certaines communautés qui la composent ont
changé au cours des deux derniers siècles. Pour chaque époque que nous aborderons, nous
utiliserons les toponymes correspondants.
5. L’âge des personnes citées dans la restitution des entretiens correspond à celui de 2010.
6. L’usage de couleurs pour les tableaux présentés dans cette thèse n’a pour seule fonction
que d’en faciliter leur lecture.
12
���������������
ANH/SA – Archives Nationales d’Histoire, Section Azuay.
Archivos Nacionales de Historia, Sección Azuay..
Banque Centrale d’Equateur. Banco Central del Ecuador.
Banque de Développement. Banco de Fomento.
Bon de Solidarité (Bon de l’Etat). Bono de Solidaridad (Bono del Estado).
CEDIR – Centre de Développement et de Recherche Rurale.
Centro de Desarrollo e Investigación Rural.
CEPAL – Commission Economique pour l’Amérique Latine.
Comisión Económica para América Latina.
CG-Paute – Conseil de Gestion des Eaux du Bassin Versant du Paute.
Consejo de Gestión de Aguas de la Cuenca del Río Paute.
Conseil National de Développement. Consejo Nacional de Desarrollo.
Conseil de Programmation d’Actions d’Urgence.
Consejo de Programación de Acciones Urgentes.
CREA – Centre de Reconversion Economique des régions Australes d’Equateur.
Centro de Reconverción Económica del Austro.
Direction Nationale de la Migration. Dirección Nacional de Migración.
ESPAC – Enquête Continue des Superficies et de Production Agricole.
Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua.
ETAPA-Cuenca – Entreprise Municipale de Télécommunications, de gestion de l’Eau Potable, des Egouts et d’assainissement.
Empresa municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento.
13
FAO – Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture.
Food and Agriculture Organization.
Fonds d’Initiatives Locales. Fondos de Initiativas Locales.
FLACSO – Faculté Latino-Américaine de Sciences Sociales.
Facultad Latinoamericana de Ciensas Sociales.
IERSE – Institut d’Etudes et de Recherches de l’Equateur.
Instituto de Estudios de Regimen Seccional del Ecuador.
Institut Géographique Militaire. Instituto Geográfico Militar.
INAMHI – Institut National de Météorologie et d’Hydrologie.
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología.
INDA – Institut de Développement Agraire.
Instituto de Desarrollo Agrario.
INEC – Institut National de Statistiques et de Recensements.
Instituto Nacional de Estadisticas y Censos.
LDA – Loi de Développement Agraire. Ley de Desarrollo Agrario.
Loi d’Organisation et de Régime des Comunas.
Ley de Organización y Regimen de las Comunas.
Loi de Réforme Agraire et de Colonisation. Ley de reforma Agraria y Colonización.
PAU – Programme d’Agriculture Urbaine. Programa de Agricultura Urbana.
Registre de l’Information Cartographique du Bassin Versant du Paute.
Registro de la Información Cartográfica de la Cuenca del Paute.
Recensement de la population
USCB – Bureau du Recensement des Etats-Unis.
Censo de población.
United States Census Bureau.
14
���������
Pour définir les mots de ce glossaire, nous nous sommes référés aux ouvrages de P. Morlon
(1992), G. Cortes (2000), C. Huttel et al. (1999) et J. Poloni-Simard (2000). Certaines
définitions ont toutefois été simplifiées, le but n’étant pas de fournir une explication détaillée
de chaque terme. Pour certains d’entre eux qui correspondent davantage à des expressions
populaires, nous n’avons eu d’autre choix que de les définir nous-mêmes. La majorité des
termes traduits viennent de l’espagnol, sauf indication.
Adobe : torchis. Matériel de construction constitué d’un mélange de terre argileuse, d’eau et
de paille, utilisé autrefois pour l’édification des maisons paysannes.
A medias : forme la plus courante de métayage dans les Andes équatoriennes. Le propriétaire
et le métayer se partagent en principe à parts égales les produits de la parcelle cultivée.
Austro : désigne la région australe de l’Equateur composée des provinces du Cañar, de
l’Azuay et du Morona Santiago.
Ayllu : terme quechua qui désigne un groupe de parenté, un lignage. Communauté se
réclamant d’un ancêtre commun.
Ayni : terme quechua qui fait référence à un échange réciproque de travail, entre parents ou
voisins.
Babaco [Carica pentagona Heilborn] : fruit originaire d’Equateur, cultivé à ciel ouvert dans
les fonds de vallée ou à l’intérieur de serres au-delà de 1500 mètres d’altitude. L’arbre sur
lequel il pousse se distingue par un tronc fin et mesure en général entre 2 et 2,5 mètres.
Cacique : à l’époque coloniale, désignait un chef indien.
Calcha : tige de maïs. Sert en général à l’alimentation des animaux (bovins, porcs) après les
récoltes.
Cambio mano : ou prestamano. Terme contemporain qui fait référence à l’ayni*.
Centavo : centime.
15
Chamburo [Carica chrysopetala Heilborn] : fruit originaire des Andes, cultivé à ciel ouvert
jusqu’à 3000 mètres d’altitude environ. Parfois désigné comme la « papaye de terre froide »
(« papaya de tierra fría »), il pousse sur des arbres pouvant atteindre quatre à cinq mètres de
hauteurs.
Chicha : boisson légèrement alcoolisée produite à partir de la fermentation du maïs.
Chulquero : expression populaire qui désigne les prêteurs, ou plutôt les usuriers, vers qui la
majorité des équatoriens se dirigent pour financer leur émigration.
Compañero : camarade. Terme fréquemment employé dans les campagnes pour désigner un
ami, ou pour s’adresser à quelqu’un au moment d’engager la conversation.
Communauté : désigne un groupe de familles regroupées sur un même territoire et pouvant
réaliser des mingas*, des travaux d’intérêt collectif (construction d’une route, d’un réservoir,
etc.). Certaines d’entre elles descendent d’anciens ayllus*, tandis que d’autres se sont formées
beaucoup plus récemment.
Comuna : institution paysanne reconnue officiellement par le ministère équatorien de
l’Agriculture depuis 1937. Elle peut réunir plusieurs dizaines de familles travaillant
collectivement sur des parcelles appartenant à l’Etat, mais dont elle a l’usufruit. De fait, la
comuna peut désigner une organisation sociale et le territoire qui lui correspond.
Comunero, comunera : membre d’une comuna*.
Corregimiento : unité administrative du temps de la période coloniale.
Costa : côte. L’une des trois macrorégions de l’Equateur. Elle s’étend du nord au sud, de la
province d’Esmeraldas à la province d’El Oro, et d’est en ouest, du littoral pacifique aux
contreforts des Andes (cf. Carte n°1).
Coyote : expression très populaire en Equateur, comme dans le reste de l’Amérique latine,
qui désigne un passeur illégal.
Hacienda : ou latifundio. Nom donné aux grandes propriétés agricoles en Amérique latine.
Avant les réformes agraires du XXe siècle, certaines d’entre elles pouvaient atteindre
plusieurs milliers d’hectares. Du fait de leur permanence dans certaines régions, ou bien à
cause de processus locaux de reconcentration de la terre, le terme est toujours très utilisé.
16
Huasipungo : serf. Jusqu’à la réforme agraire en 1964, ce terme désignait les travailleurs
attachés à l’hacienda et soumis à toutes sortes de corvées, en contrepartie desquelles ils
pouvaient cultiver un petit lopin de terre pour leur subsistance.
Huerto : potager.
Livre : unité de poids équivalente à 454 grammes.
Manteca de cerdo : saindoux.
Melloco [Ullucus tuberosus H. B. K.]: tubercule d’altitude cultivé jusqu’à 3500 mètres
d’altitude.
Minga : du quechua minka. Travail d’intérêt collectif exécuté par les membres d’une même
communauté.
Mita : à l’époque coloniale, travail obligatoire dû par la population indigène à l’autorité
espagnole.
Mote : du quechua muti. Maïs bouilli, qui constitue la base de la plupart des repas des paysans
des Andes équatoriennes.
Motepillo : plat typiquement cuencanais. Maïs bouilli et mélangé ensuite à des œufs brouillés.
Mote sucio : autre plat cuencanais. Maïs préparé dans de la manteca de cerdo*.
Oca [Oxalis tuberosus Mol.] : tubercule d’altitude cultivé jusqu’à 3500 mètres d’altitude.
Oriente : orient. La deuxième macrorégion d’Equateur. Désigne la plaine amazonienne
couvrant toute la moitié est du pays (cf. Carte n°1).
Paja : paille. Désignait il y a encore quelques années les tiges de roseaux utilisées pour
couvrir les maisons paysannes.
Paja toquilla : fibre naturelle obtenue après le séchage de feuilles de palmier (Carludovica),
et utilisée pour la confection des chapeaux Panamá.
Pampamesa : expression populaire qui signifie « table de campagne » ou « table en plein
champ ». Forme la plus courante pour partager un repas, surtout pendant les mingas*, au cours
de laquelle les paysans alignent sur l’herbe de grandes pièces de tissu sur lesquelles ils
mélangent les victuailles que tous ont apportées.
17
Páramos : étage des Andes tropicales humides situé au-delà de 3000 mètres d’altitude, qui
s’étend du nord du Venezuela au sud de l’Equateur, et dont la végétation se compose
essentiellement de touffes d’herbe et d’arbustes.
Parcialidad : subdivision d’un caciquat. Unité administrative sur laquelle s’exerçait à
l’époque coloniale l’autorité d’un cacique.
Paroisse rurale : L’Equateur est divisé en 24 provinces, 226 cantons, 359 paroisses urbaines
et 790 paroisses rurales. En ce qui concerne ces dernières, pour beaucoup, leur création
remonte à la période coloniale durant laquelle l’Eglise devait assurer le contrôle de la
population indienne en dehors des villes, par l’intermédiaire de curés. Aujourd’hui, ces
paroisses rurales ne sont plus seulement des circonscriptions ecclésiastiques : chacune d’entre
elles correspond à un territoire administratif dirigé par une assemblée d’élus appelée « junta
parroquial » (assemblée paroissiale) mandatée pour quatre ans.
Peón : ouvrier agricole. Terme hérité de la période coloniale qui garde parfois une
connotation péjorative.
Picota : petit enclos proche de la maison où jadis les animaux étaient réunis pendant la nuit
après avoir passé tout le jour dans les pâturages d’altitude.
Quebrada : ravine d’incision linéaire.
Quintal : unité de poids équivalente à 45,4 kilogrammes.
Real : unité monétaire équivalent à un dixième de sucre*.
Remesas : remises, mandats. L’emploi du terme espagnol dans cette thèse a pour but de
montrer combien ce mot est aujourd’hui sacralisé dans les Andes rurales puisque les transferts
d’argent depuis l’étranger constituent bien souvent la plus grande part des revenus monétaires
des familles paysannes.
Reducción : réduction. Village fondé par les Espagnols où était concentrée la population
indigène pour y être évangélisée.
Segunda : travail de buttage, pour renforcer les tiges de maïs et de fèves quelques mois après
les semis.
Sierra : chaîne de montagne. La troisième macrorégion de l’Equateur. Désigne la cordillère
des Andes qui traverse le pays du nord au sud, de la province de Carchi à celle de Loja (cf.
Carte n° 1).
18
Solar : unité de surface. Dans les campagnes azuayennes, le solar correspond à 2500m². Dans
d’autres régions de la sierra, la superficie d’un solar peut varier. Parfois, l’expression solar
peut même être utilisée comme un synonyme de « parcelle », ce qui peut rendre l’emploi de
ce terme encore plus confus.
Sucre : monnaie officielle de l’Equateur de 1884 à 2000.
Tamal : petit chausson de farine de maïs cuit à la vapeur dans des feuilles d’épi de maïs,
fourré de viande, de poulet ou de porc, et de petits légumes.
Uvilla [Physalis peruviana L.] : fruit d’altitude originaire de la région andine cultivé jusqu’à
3200 mètres d’altitude. Appelé « coqueret du Pérou » en France.
Yoni : expression populaire qui désigne les Etats-Unis. Vient de la contraction de United,
comme dans United States.
Zhumir : eau de vie de canne à sucre produite dans la vallée du Paute, très consommée par les
paysans au moment des fêtes, mais aussi lors de réunions familiales.
19
����������������� �
�
�
« Où allons-nous ; on ne peut plus gagner sa vie. On ne peut plus gagner sa vie en cultivant la terre. Je vous le demande, qu’est-ce qui va sortir de tout ça ? »
John Steinbeck, Les raisins de la colère.
20
Dans sa Grammaire des civilisations, parue pour la première fois en 1987, F. Braudel faisait
cette description du monde rural latino-américain : « jetée dans le travail forcené et
mercenaire de la monoculture prise dans de vastes domaines hâtivement constitués par le
capital des importateurs étrangers, puis brusquement abandonnée en même temps que les
domaines eux-mêmes, lors de tel ou tel changement de la demande, une grande partie de la
population paysanne est faite d’ouvriers agricoles errants, que l’absence de travail, un jour,
mène à la ville proche pour une embauche problématique, ou pour l’émigration vers une autre
province. » (Braudel, 1993 : 487). Si comme toute représentation, celle de l’historien français
a le défaut de réduire à quelques traits une situation en réalité fort complexe, elle montre
cependant que la mobilité constitue l’une des caractéristiques du paysan latino-américain.
Mais alors, dans quelle mesure celle-ci participe-t-elle aux transformations de la campagne ?
Parmi les très nombreuses études sur les migrations internationales, il est de coutume de ne
s’intéresser qu’aux points de vue des pays d’arrivée, et cette « unilatéralité » comme le
rappelle G. Simon, constitue l’une des « limites de l’approche habituelle des faits
migratoires » (Simon, 2008 : 12). En France, les travaux sur les diasporas et les
regroupements communautaires ont occupé ces dernières années une place importante dans la
littérature géographique (Ma Mung, 2000 ; Audebert, 2006), tandis que de nombreuses études
se sont davantage intéressées aux dynamiques des réseaux transnationaux (Simon, 1979 ;
Faret, 2003 ; De Tapia, 2005). Pourtant, les migrations, qu’elles soient locales ou
internationales, figurent parmi les éléments centraux des stratégies de reproduction des
groupes paysans dans les pays en développement, comme en attestent nombre d’analyses en
Amérique latine (Léonard, 1995 ; Quesnel et Del Rey, 2005 ; Caguana, 2008), en Afrique
(Franqueville, 1987 ; Guetat-Bernard, 1998 ; Ba, 2007), et en Asie (Racine, 1994 ; Landy,
1994 ; Bruslé, 2006), mais qui n’ont cependant pas traité, ou seulement de manière limitée,
des effets des migrations sur les espaces agricoles des régions qu’elles concernent.
Ne faudrait-il pas alors, dans le cadre de nouvelles analyses, privilégier une autre approche
centrée sur les espaces de départ, en particulier dans les pays du Sud, où les migrations
apparaissent comme un phénomène majeur1 ? En effet, ne serait-il pas pertinent de considérer
les migrations comme un moteur de nouvelles territorialités, en nous inspirant par exemple de
1 « Les pays du Sud – des Suds, doit-on dire, tant leur diversité va croissant – constituent les principaux espaces d’alimentation des migrations internationales, avec près de 75% des émigrés de la planète en 2007. » (Simon, 2008 : 52).
21
l’étude de G. Cortes qui, dans les Andes boliviennes, a montré que la stratégie migratoire de
nombreux migrants avait pour objectif l’achat de terres (Cortes, 2000) ? C’est bien là
l’ambition de cette thèse, à travers laquelle nous porterons notre attention sur une petite
localité rurale de la sierra équatorienne, où depuis plus de quarante ans, l’émigration
d’hommes et de femmes est un fait presque quotidien.
�� �������������������������������� �!������"���
En 2008, ils étaient entre 1,4 et 1,6 millions officiellement recensés à l’étranger (Faculté
Latino-Américaine en Sciences Sociales – FLACSO, 2008 : 15), aux Etats-Unis, en Espagne
et en Italie notamment. Un million et demi d’Equatoriens qui pour leur grande majorité ont
émigré ces dix dernières années pour fuir la pauvreté dans leur pays d’origine. L’instabilité
économique dont a été victime l’Equateur entre 1998 et 2000 a conduit à une crise sociale
sans précédent pour le pays, même si cette dernière trouve ses origines au moment de
l’ouverture libérale du début des années 1980, qui conduisit au dégagement progressif de
l’Etat de tous les secteurs de l’économie nationale. Il n’empêche que les effets de la crise
asiatique de 1997 associés aux dégâts d’El Niño de 1998 ont provoqué, dans un climat
politique des plus tendus, « la régression économique la plus sévère d’Amérique latine2 »
(Acosta, 2006 : 196). En 1999, le PIB chuta de 27% par rapport à 1998, alors que le nombre
de personnes vivant dans l’extrême pauvreté passait de 2,1 à 4,5 millions de personnes entre
1995 et 2000 (ibid.), représentant alors le tiers de la population nationale. C’est dans ces
conditions que l’émigration devint une stratégie de survie, un chemin que près de 180 000
Equatoriens décidèrent d’emprunter pour la seule année 2000 (FLACSO, 2008 : 16).
Dans ce contexte, les études migratoires en Equateur se sont multipliées, mais la plupart,
marquées par des approches sociologique ou anthropologique, ont porté sur la dynamique des
réseaux communautaires et l’intégration collective des migrants dans les espaces
métropolitains d’Europe et d’Amérique du Nord (Miles, 2004 ; Herrera et al., 2006 et 2008 ;
Pribilsky, 2007). De même, les travaux sur l’importance croissante de l’émigration féminine
(Wagner, 2004 ; Herrera, 2006 ; Meñaca, 2006) et les publications traitant de l’importance des
transferts financiers, les remesas, pour l’économie équatorienne, ont été très nombreux
2 « El Ecuador sufrió en 1999 el retroceso económico más severo en América latina ».
22
(Sanchez, 2004 ; Acosta et al., 2006 ; Muñoz, 2008), sans pour autant traiter spécifiquement
de leurs effets dans les campagnes.
Quelques études ont cependant traité des conséquences de l’émigration paysanne, en
témoigne celle de L. Martínez qui a porté sur les mutations du marché du travail en milieu
rural, et qui a montré que la diminution de la main-d’œuvre favorisait l’arrivée de travailleurs
étrangers, des Péruviens en particulier, laquelle avait tendance à provoquer la baisse des
salaires journaliers et la multiplication des conflits avec la population équatorienne
(Martínez, 2006a). De même, nous pourrions citer le travail de M. Vaillant qui, dans la
province du Cañar (cf. Carte n°1), a montré combien l’émigration favorisait une nouvelle
forme de différenciation sociale, les remesas permettant d’augmenter de manière considérable
le revenu global de certaines familles, quand d’autres ne cumulaient que de faibles rentrées
monétaires avec pour seules activités l’agriculture et les rares opportunités locales de travail
(Vaillant, 2008). Mais, de nouveau, ces analyses apparaissent limitées en ne traitant encore
une fois que de thèmes socioéconomiques. L’importance de l’émigration, en particulier dans
la sierra équatorienne, ne pourrait-elle pas être la raison d’un renouvellement du
questionnement scientifique et donner l’occasion d’une analyse géographique qui porterait
davantage sur les changements des usages du sol et des structures foncières ?
#� ����$ ������%��&'��������
En 2007, nous avions déjà réalisé un premier travail de recherche à Juncal, dans la province
du Cañar, et sur la base d’une quarantaine d’entretiens, nous avions cherché à comprendre les
effets de l’émigration paysanne dans cette localité. Rapidement, nous avions constaté que la
dynamique migratoire, qui n’avait alors pas plus d’une quinzaine d’années, était devenue au
fil du temps un véritable facteur de segmentation sociale, les familles « avec migrants » ayant
plus de facilité pour acquérir de nouvelles terres, tandis que les familles « sans migrant »
étaient laissées en marge du marché foncier (Rebaï, 2007).
Par la suite, notre réflexion prit une autre voie. Comme l’écrivit J. Lombard, « le [jeune]
chercheur, évolue au cours de son parcours scientifique : son regard change et les
problématiques et les approches elles aussi, se transforment » (Lombard, 1999 : 131). Il nous
23
sembla effectivement que l’étude des dynamiques territoriales dans le contexte migratoire des
Andes rurales ne pouvait se résumer à la seule question de l’appropriation, concrète ou
symbolique, de l’espace par les paysans. De nouvelles interrogations devinrent alors plus
importantes à nos yeux : qu’en était-il par exemple des espaces agricoles, des choix culturaux
et de l’alimentation des groupes domestiques ? Quelle influence les remesas avaient-elle sur
l’agriculture familiale ? Favorisaient-elles l’émergence d’un nouveau profil d’exploitant ? Ces
questions nous parurent d’autant plus évidentes que le débat sur l’alimentation dans le monde
prit une dimension majeure ces dernières années, en témoignent par exemple les nombreuses
publications relatives à ce sujet (Hubert et Clément, 2006 ; Charvet, 2008 ; Janin, 2008). Les
paysans équatoriens étaient-ils condamnés à émigrer sans avoir un jour l’opportunité de vivre
de leur agriculture en nourrissant leur pays ?
C’est ainsi que nous avons décidé de mener une nouvelle recherche articulée autour d’une
problématique simple : dans quelle mesure l’émigration paysanne entraîne-t-elle la
recomposition du milieu rural dans les Andes équatoriennes ? Bien entendu, nous allions
pouvoir mettre à profit nos observations faites à Juncal, mais avant même d’investir notre
nouveau terrain d’étude, il nous fallait déterminer à travers quel prisme nous allions observer
les mutations en cours.
(� � ) �$���������*������'�+�������%���!��%������'� �������� ��
!��%����
Bien que cela paraisse utopique de vouloir saisir toutes les variables qui participent de la
transformation d’une société rurale, il convient néanmoins d’employer un outil théorique qui
nous permette d’étudier de manière globale les effets de l’émigration paysanne dans la sierra
équatorienne. Pour M. Mazoyer et L. Roudart, « le concept de système agraire est l’outil
intellectuel qui permet d’appréhender la complexité de toute forme d’agriculture réelle par
l’analyse méthodique de son organisation et de son fonctionnement » (Mazoyer et Roudart,
2002 : 70). Ceci étant dit, la notion de système agraire définie par ces mêmes auteurs désigne
précisément « un type d’agriculture historiquement constitué et géographiquement localisé,
composé d’un écosystème cultivé caractéristique et d’un système social productif défini,
24
celui-ci permettant d’exploiter durablement la fertilité de l’écosystème cultivé
correspondant » (ibid.).
D’un point de vue méthodologique, l’étude d’un système agraire suppose tout d’abord un
travail d’analyse historique, pour montrer comment ce dernier « [a] été amené à évoluer sous
la double dépendance des conditions écologiques et des transformations socio-économiques »
(Dufumier, 1996 : 303). En cela, elle est un outil fondamental de l’Agriculture Comparée,
discipline développée ces dernières décennies à l’Institut National Agronomique Paris-
Grignon, puisqu’elle permet de mieux saisir les spécificités de toute forme de développement
agricole, avant d’en étudier les recompositions actuelles. Cette démarche a d’ailleurs été
adoptée par H. Cochet (1993) et P. Gasselin (2000) qui, dans leurs travaux respectifs, ont
commencé par décrire la lente et progressive construction des territoires qu’ils étudiaient,
avant d’analyser les mutations des structures socioéconomiques qui les composaient.
Cependant, il y a de quoi s’interroger sur les limites géographiques du système agraire, car il a
« par son intitulé l’inconvénient de laisser théoriquement de côté tout ce qui ne concerne ni
l’agriculture, ni les structures agraires » (Landy, 1994 : 43). En effet, il existe dans les
campagnes des flux de personnes et des réseaux commerciaux qui témoignent de liens
tangibles avec le monde urbain (Chaléard et Dubresson, 1999) et qui laissent entrevoir la ville
et la campagne comme un « continuum » (Gastellu et Marchal, 1997). Par ailleurs, les
migrations, qui provoquent l’absence d’une partie de la main-d’œuvre et peuvent, dans
certains cas, fournir une part importante des revenus familiaux, agissent elles aussi sur les
recompositions du milieu rural, en témoigne par exemple l’expérience décrite par S. Fanchette
dans les campagnes du delta du Nil où, à la fin des années 1980, les envois d’argent en
provenance des pays du Golfe favorisèrent le développement de petites entreprises artisanales
dans le secteur de la construction (Fanchette, 1992).
La notion de système agraire ne saurait alors être rigide : elle implique en réalité la prise en
compte de tous les facteurs qui agissent sur la dynamique territoriale d’une petite région, de
l’existence ou non de voies de circulation aux aléas du marché, en passant par les
interventions des acteurs institutionnels. En outre, elle suppose de s’intéresser aux techniques
employées par les agriculteurs, ce qui implique de fait un changement d’échelle dans
l’analyse et de porter un regard plus précis sur les différentes unités de production qui
cœxistent à l’échelle locale.
25
,���'��-%'������������'��'�.'��-%'��������/.���% %�����'0�
Depuis A. Tchayanov et ses travaux sur L’organisation de l’économie paysanne parus en
1925, les spécialistes du monde rural ont pris l’habitude de considérer l’exploitation familiale
comme « une unité de production et une unité de consommation » (Haubert, 1999 : 10), dont
l’objectif est de parvenir à sa propre reproduction par la mise en œuvre de systèmes agricoles
diversifiés, sans ignorer pour autant que l’une des caractéristique de la famille paysanne est
aussi de diversifier ses activités économiques, comme ce fut le cas pendant longtemps dans
les régions françaises (Duby et Wallon, 1976 ; Simon, 2002).
Dans les pays du Sud, où la faible productivité des exploitations familiales pousse les
agriculteurs à la recherche de revenus complémentaires (Dufumier, 2006), certaines régions
se sont même spécialisées dans des activités artisanales ou industrielles, comme c’est le cas
par exemple en Equateur (Martinez, 2000 ; 2009). S’il est alors admis que l’émigration
internationale est une stratégie qui s’inscrit dans un cadre spatial élargi, impliquant par
conséquent l’absence prolongée de certains membres, dans quelle mesure peut-on encore
parler d’exploitation familiale ?
En réalité, mieux vaut parler d’exploitation « à temps partiel » (Diry, 2004 : 34), lorsque
plusieurs membres d’une même famille sont temporairement ou définitivement employés à
l’extérieur et que les salaires qu’ils apportent contribuent à la survie du groupe domestique.
Dans ce cas, « la notion de système de production est insuffisante » (Gastellu, 1997 : 701) car
elle se réduit au seul cadre de l’exploitation agricole et ne décrit que « la combinaison dans le
temps et dans l’espace des ressources disponibles et des productions végétales et animales »
(Dufumier, 1996 : 79), en étudiant principalement le système de culture, qui se caractérise par
une série de « techniques successivement mises en œuvre [qui] contribuent dans leur
ensemble à favoriser la croissance et le développement des plantes cultivées (Dufumier,
1996 : 82), et le système d’élevage, définit comme la « combinaison et [la] succession de
techniques destinées à produire des animaux ou des productions animales avec la force de
travail et les moyens de production disponibles dans l’exploitation (ibid.).
Il est donc plus logique de parler de système d’activités, car l’analyse de l’unité économique
domestique doit être faite globalement puisque « les activités non agricoles, qu’elles soient
26
réalisées sur la ferme (comme souvent les activités artisanales) ou hors ferme (comme les
activités salariales), ne prennent leur signification que dans leur complémentarité aux
activités agricoles » (Haubert, 1999 : 11). Il s’agit par conséquent d’un cadre d’analyse
beaucoup plus large permettant d’intégrer les divers facteurs qui contribuent aux mutations de
l’agriculture paysanne et des campagnes dans leur ensemble.
1� �%���� ��!��2���������3�'�!�� *�� '�&���������� ���� ���������
����'�������'�����
Au-delà du choix des outils théoriques qui devaient nous permettre de prendre la mesure des
mutations en cours dans la sierra équatorienne, il nous fallait bien évidemment retenir une
zone d’étude qui présente des intérêts particuliers.
Après notre expérience dans le Cañar, région qui faisait partie de l’un des « sous-espaces de la
périphérie passive [de l’Equateur]3 » (Deler, 1981 : 228), il était important de sélectionner une
autre localité pour ne pas limiter l’analyse des effets de l’émigration paysanne dans la région
andine à une seule étude de cas. Dans l’optique d’un travail de comparaison avec la paroisse
de Juncal, nous devions alors nous orienter en priorité vers une zone caractérisée par une
émigration plus ancienne, pour analyser ses effets concrets sur une période plus longue. Il
était alors logique de mener cette nouvelle recherche dans la province de l’Azuay (cf. Carte
n°1), considérée comme le cœur historique de l’émigration équatorienne depuis les premiers
départs de populations rurales à destination des Etats-Unis au milieu des années 1950 (Carpio,
1992).
3 « Qualifiés facilement de « traditionnels », d’ « arriérés » ou de « marginaux » , ces sous-espaces sont les plus éloignés de l’espace urbain central, du triple point de vue de la distance physique ou de l’accessibilité, de la distance socioéconomique (types de production et de consommation) et de la distance culturelle » (ibid.).
28
Toutefois, en choisissant ce nouveau cadre d’analyse, nous devions obligatoirement intégrer
la question de l’influence urbaine, car au-delà même du contexte migratoire, il était nécessaire
de prendre en compte la croissance démographique de la ville de Cuenca, la troisième ville du
pays et capitale provinciale de l’Azuay, qui depuis sa fondation au XVIe siècle, entretient
d’intenses relations avec les campagnes qui l’entourent (Poloni-Simard, 2000), et qui au cours
des dernières décennies a connu une très nette augmentation de sa population, en passant de
87 415 à 329 928 habitants entre 1974 et 2010 (Institut National d’Etudes Statistiques et de
Recensements – INEC, 1974 et 2010).
Le choix de travailler dans une localité proche d’une ville moyenne était par ailleurs très
intéressant pour observer les évolutions de l’agriculture familiale dans un contexte a priori
favorable. Si à Juncal, nous avions constaté qu’il était difficile d’envisager une reconversion
agricole des exploitations, même avec l’apport de remesas, dans cette nouvelle situation, nous
allions évaluer si la proximité d’un marché urbain pouvait être bénéfique à des familles
paysannes dont la main-d’œuvre avait diminué au cours des dernières années mais qui
bénéficiaient tout de même d’un capital important pour s’orienter vers des cultures
commerciales. Pour cela, nous allions pouvoir nous inspirer de plusieurs études latino-
américaines et africaines ayant montré l’influence des villes sur le développement de
productions marchandes dans des régions où prédominent les unités de production familiales
(Mesclier, 1991 ; Douzant-Rosenfeld et Grandjean, 1995 ; Chaléard, 1996 ; Calas, 1999).
C’est ainsi que nous nous sommes orienté vers la paroisse Octavio Cordero Palacios située à
une vingtaine de kilomètres au nord de Cuenca (cf. Carte n°2). En Equateur, la création des
paroisses rurales remonte à la période coloniale, durant laquelle l’Eglise devait assurer le
contrôle de la population indienne en dehors des villes, par l’intermédiaire de curés. De nos
jours, les paroisses rurales ne sont plus seulement des circonscriptions ecclésiastiques mais
correspondent chacune d’entre elles à un territoire administratif dirigé par une assemblée
d’élus appelée « junta parroquial » (assemblée paroissiale) mandatée pour quatre ans.
Concernant la paroisse Octavio Cordero Palacios, celle-ci comptait 2 271 habitants en 2010
(INEC, 2010). A la limite de la province du Cañar, elle s’étend sur une superficie de 22 km² à
une altitude comprise entre 2600 et 3400 mètres. Traversée du nord au sud par la rivière
Sidcay, elle est bordée à l’ouest par la rivière Paluncay qui sert de limite naturelle avec la
localité de Checa. Au nord, la paroisse Octavio Cordero Palacios est limitrophe de celle de
Deleg, tandis qu’au sud, elle est voisine de celle de Sidcay (cf. Carte n°3).
31
9� � %������ %� �����2��'���������*������& ��2��������%����!�%����
����!����� ��!���'�'�!�'���
Bien qu’il s’agisse d’une petite localité, le fait de ne pas avoir été véhiculé nous a contraint à
organiser notre travail de terrain avec méthode. Tout d’abord, nous nous sommes
régulièrement rendu dans la paroisse Octavio Cordero Palacios pour nous faire connaître des
paysans et des autorités politiques, afin de créer des liens de confiance indispensables au bon
déroulement de notre recherche. Pour cela, nous avons pu compter sur le Centre de
Développement et de Recherche Rurale (CEDIR), une petite ONG avec laquelle nous avions
travaillé à Juncal4 et présente dans la zone depuis plusieurs années.
Bien évidemment, la présence du CEDIR a constitué un facteur décisif dans le choix de mener
notre recherche dans la paroisse Octavio Cordero Palacios. Si notre ambition était, comme
nous l’avons souligné plus haut, de nous rapprocher d’un centre urbain après notre première
expérience dans le Cañar, il était toutefois indispensable de pouvoir bénéficier d’un appui
institutionnel, au moins lors du démarrage de notre investigation. Les premières sorties avec
les techniciens de l’ONG nous ont permis d’assister aux réunions qu’ils organisaient avec la
population paysanne, au cours desquelles, en nous positionnant en retrait des discussions,
nous prenions des notes sur des éléments qui nous semblaient sur le moment intéressants.
Rapidement, notre présence devint habituelle : les paysans commencèrent alors à nous appeler
« señor ingeniero » (« monsieur l’ingénieur ») tandis que nous parvenions progressivement à
mettre des noms sur les visages.
Au bout d’un mois, nous nous sommes pourtant détaché de la tutelle du CEDIR, pour garder
notre indépendance et pour élargir notre champ d’observation : en ne côtoyant que les paysans
inscrits dans les projets de l’institution, nous n’aurions eu accès qu’à une minorité peu
représentative de la population locale. Comme le dit P. Pelissier, il importe au géographe de
devenir « un indigène du territoire qu’il étudie », précisant que cela nécessite « discrétion et
surtout sympathie » (Théodat, 2007 : 3). C’est dans cette optique que nous avons poursuivi
notre travail de terrain, n’hésitant pas à nous rendre tous les dimanches dans la paroisse
Octavio Cordero Palacios, pour profiter après la messe de l’affluence dans le centre de la
4 Une partie des informations que nous avions recueillies au cours de nos entretiens avait été mise à disposition de l’équipe technique en vue d’améliorer son action auprès de la population paysanne.
32
localité et ainsi, faire connaissance avec la population avant de programmer des entretiens les
jours suivants.
Bien souvent, nous nous sommes également déplacé pour prendre le temps d’observer la
campagne, muni de notre appareil à photographier. Parfois, les rencontres au hasard ont
abouti à de véritables entretiens, quand d’autres donnèrent lieu à des discussions plus
cordiales, très utiles d’ailleurs, car elles facilitèrent par la suite notre entrée dans les
exploitations. Progressivement, on s’est mis à nous saluer, même de loin : les efforts
commençaient à payer, notre présence quotidienne dans la localité avait fait de nous un
véritable « indigène ». Du vouvoiement, avec lequel les paysans s’adressaient à nous aux
premiers jours, le tutoiement devint la norme, avec les hommes tout du moins. Si certains
d’entre eux avaient au début des réticences à répondre à nos questions, au fil du temps, ils
n’hésitèrent plus à nous parler de leurs champs et de leurs enfants partis à l’étranger.
Concrètement, nous sommes allé à la rencontre des paysans des 16 communautés situées de
part et d’autre de la rivière Sidcay. Chacune d’entre elle correspond à un regroupement de
familles sur un territoire dont les limites (un cours d’eau, une colline, un bosquet, etc.) sont
parfois assez floues. Si comme nous le verrons par la suite, les plus anciennes de ces
communautés formaient chacune un ayllu, un groupe de familles descendant d’un même
ancêtre, la plupart ne correspondent aujourd’hui qu’à une sorte d’unité administrative, souvent
appelée « sector » (secteur) ou « barrio » (quartier), où l’on retrouve systématiquement une
petite capilla (chapelle) qui sert de lieu de réunion aux paysans.
Durant les premiers temps de notre travail de terrain, nous nous sommes donc rendus dans
chacune de ces communautés, sans distinction, dans l’unique but de connaître la population.
Par la suite, nous avons accordé plus d’importance à certaines d’entres elles qui présentaient
des intérêts particuliers (une histoire migratoire plus ancienne, des pratiques agricoles
originales, etc.). Notre démarche fut donc progressive, mais elle nous a permis de mieux
cibler les spécificités de notre localité d’étude.
33
:����������� ���!� �������������
Dans l’objectif de comprendre l’évolution des pratiques paysannes dans la paroisse Octavio
Cordero Palacios, nous nous sommes entretenus avec 44 personnes, un grand nombre d’entre
elles ayant accepté de nous recevoir à plusieurs reprises pour différents types d’entretiens et
d’enquêtes réalisés au cours de deux périodes, de juillet à décembre 2008, et de juin à août
2009 (cf. Annexe n°1). Concernant leurs critères de sélection, ils seront davantage explicités
au fil des chapitres, pour ne pas alourdir cette introduction générale. Pour le moment, nous
nous contenterons de faire l’inventaire des techniques de travail et des différentes sources que
nous avons mises a profit pour mener notre recherche.
:����� ��������� ��'�+� ������������'�!�'���'� ��&�� ��'�����������
Pour commencer, nous avons mené 16 entretiens pour reconstituer l’histoire agraire de notre
localité. Pour cela, nous sommes allés à la rencontre de dirigeants politiques et de paysans.
Ces premiers échanges, réalisés parfois au cours de marches à travers la localité, se sont
articulés autour de questions simples portant sur les évolutions des pratiques paysannes et du
paysage agraire au cours des dernières décennies. La plupart des personnes consultées nous
ont alors décrit la vie paysanne durant leur jeunesse, en insistant plus particulièrement sur
l’organisation des tâches agricoles et l’importance des autres activités ayant lieu sur ou en
dehors des exploitations.
Sans même que nous leur demandions de le faire, plusieurs d’entre elles nous ont expliqué les
changements qu’avait impliqué l’émigration au fur et à mesure des années, en témoigne cette
phrase que nous avons entendue plus d’une fois : « comme tout le monde est parti à la Yoni
[aux Etats-Unis], il n’y a plus d’agriculture. » Loin d’être anodine, elle nous a même permis
de prolonger certains entretiens, en demandant d’abord aux paysans s’il n’était pas possible de
nuancer leur propos, avant de les interroger plus largement sur la manière dont ils
envisageaient l’avenir de la paroisse Octavio Cordero Palacios.
Parmi les autres sujets abordés lors de nos premiers entretiens, il y eut celui des comunas
Illapamba et San Luis qui, d’après la majorité des personnes rencontrées, avaient connu de
grandes transformations ces dernières décennies, « à cause de la migration ». En Equateur, la
34
comuna est une organisation sociale reconnue par le ministère de l’Agriculture et qui d’après
la Loi d’Organisation et de Régime des Comunas promulguée en 1937 (cf. Annexe n°2),
requiert un minimum de 50 personnes majeures pour se constituer. Parmi ses droits, figure
celui de posséder des biens d’usage collectif, des terres agricoles par exemple, qui seraient la
propriété de l’Etat équatorien mais dont elle aurait l’usufruit, comme cela a pu être le cas des
deux organisations de la paroisse Octavio Cordero Palacios au cours de leur histoire.
Dans quelle mesure les comunas Illapamba et San Luis avaient-elles alors évolué dans le
contexte migratoire ? Quelles en étaient les spécificités actuelles ? Qu’en était-il des usages
du sol à l’échelle de ces deux territoires ? Afin de répondre à ces questions, les seuls
entretiens que nous avions eu avec les anciens de la localité ne pouvaient pas suffire,
beaucoup d’entre eux ne faisant plus partie de l’une ou de l’autre organisation depuis
longtemps. D’ailleurs, cela constituait pour nous une autre interrogation : pourquoi des
familles qui avaient été membres des comunas n’en étaient plus ? Il était donc essentiel que
nous entrions en contact avec des comuneros, anciens et actuels, pour comprendre les
particularités des territoires d’Illapamba et de San Luis, chose que nous réalisâmes au moment
de mener des entretiens individuels avec des chefs d’exploitation de la paroisse Octavio
Cordero Palacios.
:�#��� ��!+�2� ��� ������ ����������2� ���� ���') � !����������
En attendant, il nous fallait compléter notre analyse historique des transformations des
pratiques paysannes à l’échelle locale. Pour cela, il était nécessaire de croiser les témoignages
forcément subjectifs des personnes interrogées avec des sources administratives et
statistiques, bien que celles-ci présentent certaines limites, surtout pour les plus anciennes.
Pour commencer nous avons pris la peine de réunir le plus grand nombre d’informations
disponibles sur l’évolution de l’usage du sol dans la paroisse Octavio Cordero Palacios ou, à
défaut, dans la province de l’Azuay. Pour cela, nous avons recueilli les données des enquêtes
et des recensements agraires réalisés par l’INEC, ainsi que celles du Registre de l’information
cartographique du bassin versant du Paute, réalisé par l’Institut d’Etudes et de Recherches de
l’Equateur (IERSE) en 2003. Pour pouvoir utiliser ces informations statistiques avec la plus
grande rigueur, nous avons réalisé des entretiens avec deux techniciens, un de l’INEC et un
autre de l’IERSE, pour connaître les méthodes employées pour la création de données et leurs
35
principales limites (cf. Annexe n°3). Puis, nous avons consulté les archives du ministère de
l’Agriculture, où nous avons trouvé des documents aussi rares que précieux sur les comunas
Illapamba et San Luis, notamment des registres anciens faisant état du nombre d’individus
inscrits dans chacune des deux organisations au cours des cinq dernières décennies, ainsi que
des rapports de techniciens, assez courts il vrai, indiquant les superficies et les types de
cultures présentes sur ces deux territoires à différents moments de leur histoire.
Au-delà même des informations que nous avons recueillies, au cours de nos entretiens et
auprès des différentes institutions que nous avons visitées, nous avons réalisé un travail de
recherche bibliographique portant sur l’histoire agraire de l’Equateur. Ainsi, nous avons pris
la peine de consulter un très grand nombre d’ouvrages et d’articles de revues scientifiques5
portant sur les politiques agricole et foncière, cela nous permettant, comme nous le ferons par
la suite, de resituer notre étude dans son contexte national. Enfin, nous avons également
parcouru les nombreuses monographies de l’Azuay disponibles à l’Université de Cuenca
(Mora, 1926a ; Borrero, 1989 ; Vázquez, 1995), ainsi que plusieurs diagnostics agraires
réalisés dans différentes localités du bassin versant du Paute (CG-Paute et al., 2006), pour
prendre connaissance des principales dynamiques à l’œuvre dans les campagnes des Andes
australes d’Equateur. Après quoi, nous nous sommes davantage consacré à l’étude des
systèmes d’activités familiaux.
:�(��� ��������� ��'� ��&�� ��'�����������������������'�
En parallèle de ce travail préliminaire sur l’histoire agraire locale, nous nous sommes aussi
entretenus avec 12 anciens migrants. Les plus vieux d’entre eux nous ont décrit les contraintes
qui les ont poussé à partir travailler en Amérique du nord dès le début des années 1960, tandis
que les plus jeunes nous ont surtout expliqué comment ils avaient bénéficié de solidarités
familiales pour pouvoir partir à leur tour dans les années 1980. C’est ainsi que nous avons pu
retracer l’histoire migratoire de la paroisse Octavio Cordero Palacios, en prenant compte de
son caractère spécifique, sans omettre toutefois de la situer dans le contexte azuayen. Après
quoi, nous nous sommes davantage consacré à l’étude des systèmes d’activités familiaux.
5 A titre d’exemple, nous avons répertorié de nombreux articles de la section « Debate agrario-rural » (Débat agraire-rural) de la revue trimestrielle Ecuador Debate qui paraît depuis 1985.
36
:�,��� ��������� �2�!'� �-%'������ ����!�'�
Si nôtre première tâche fut de dresser le cadre géohistorique de notre étude, nous avons
poursuivi notre recherche en nous intéressant plus précisément aux stratégies économiques
des familles paysannes, et pour cela, nous avons réalisé des entretiens avec 38 chefs
d’exploitation, parmi lesquels 11 anciens migrants que nous avions consultés pour traiter des
origines de l’émigration internationale dans la paroisse Octavio Cordero Palacios (cf. Annexe
n°1). Pour ce qui est d’ailleurs des caractéristiques générales de notre échantillon d’analyse,
nous nous sommes aussi bien dirigé vers des familles « avec migrants » (28), que vers des
familles « sans migrant » (10), pour explorer au mieux la diversité sociale à l’échelle locale.
La « famille », au sens où nous l’entendons, correspond au « ménage », c’est-à-dire à l’unité
de production et de consommation réduite aux parents et à leurs enfants. Dans certains cas
particuliers, nous préciserons cependant si d’autres membres (grands-parents, petits-enfants,
gendres et belles-filles, etc.) sont présents dans les exploitations, ou si d’autres types de
relations familiales existent, les unités de production et de consommation ne correspondant
pas systématiquement, comme l’a d’ailleurs démontré J-M. Gastellu en étudiant pour cela les
paysanneries ouest-africaines (Gastellu, 1980).
En ce qui concerne le panel que nous avons retenu, celui-ci résulte d’un choix raisonné et ne
prétend pas servir de base à l’élaboration de statistiques précises, mais il semble refléter la
tendance migratoire locale. Au cours de notre travail de terrain, nous avons eu beaucoup de
difficulté à rencontrer des familles « sans migrant », ce qui explique que parmi toutes celles
que nous avons étudiées, 74% d’entre elles avaient au moins un membre à l’étranger en 2009.
Au sein même des exploitations, en aidant parfois à certaines tâches agricoles, nous avons
organisé nos entretiens de la façon suivante :
� chez les familles « avec migrants », nous nous sommes d’abord intéressé à l’histoire
migratoire familiale (« qui a émigré ? » ; « par quels moyens ? » ; « combien de
temps ? »), avant de porter notre attention sur l’organisation du travail agricole et les
transformations de l’exploitation en fonction de l’émigration familiale (« main-
d’œuvre disponible ? » ; « usage des remesas pour l’achat de terre ou de
matériel ? » ; « orientation(s) culturale(s) ? »). Puis, nous avons fait le bilan
37
économique des exploitations en y intégrant les ventes, les achats d’intrants et les
salaires locaux (artisanat, emplois journaliers, emplois urbains) ;
� chez les familles « sans migrant », nous avons cherché à reconstituer l’organisation du
travail au sein des exploitations, en nous intéressant aux caractéristiques de la main-
d’œuvre et en faisant l’inventaire des cultures présentes. Nous nous sommes
également intéressé aux activités extra-agricoles pour évaluer leur importance
économique en comparaison de celle des éventuelles ventes de produits agricoles et
d’élevage.
Techniquement, nous avons alterné les questions ouvertes (« quelle est la différence entre
l’agriculture d’aujourd’hui et celle d’avant l’émigration ? » ; « que représente l’agriculture
pour vous ? ») et les questions fermées (« recevez-vous de l’argent de l’étranger ? » ; « avez-
vous acheté de la terre grâce à la migration »), pour que nos discussions ne prennent pas la
forme d’enquêtes mécaniques et répétitives. Ces entretiens semi-dirigés ont d’ailleurs été
réalisés en plusieurs fois, de manière à ce qu’entre chaque session, nous ayons le temps de
reprendre les informations pour mieux préparer les questions à venir, ce qui explique par
ailleurs que nous n’ayons pas mené nos entretiens en suivant un modèle préétabli.
Le fait d’avoir mené des entretiens approfondis se justifie par notre volonté d’aller au-delà de
conclusions superficielles sur l’état de l’agriculture familiale dans le contexte migratoire des
Andes équatoriennes, et de nous distinguer ainsi de travaux s’appuyant essentiellement sur
des méthodes quantitatives, comme ceux des géographes étasuniens B. Jokish (2002) et C.
Gray (2009). Si pour ces deux études, de très nombreuses enquêtes ont pu être réalisées, les
résultats obtenus ne se résument pourtant qu’à des données chiffrées accompagnées de
constats sommaires sur les mutations de l’agriculture familiale. En outre, le classement des
exploitations en grandes catégories, en fonction de leurs revenus ou de leurs choix productifs,
apparaît très limité pour distinguer les spécificités et les stratégies de reproduction des
groupes domestiques. De fait, la méthode quantitative, employée seule, est insuffisante pour
mettre en lumière la complexité des transformations actuelles dans les Andes rurales, et ne
permet en outre, que d’analyser de manière superficielle leur réalité sociale.
A l’inverse, les choix qualitatifs de J. Peltre-Wurtz, dans son travail sur les stratégies de
12 familles de Quito aux revenus modestes en quête de denrées alimentaires (Peltre-Wurtz,
38
2004), et de C. Aubron, qui s’est intéressée à 8 familles de producteurs laitiers dans le
département de Huancavelica, dans les Andes péruviennes (Aubron, 2006), nous ont semblé
beaucoup plus pertinents compte tenu de la précision des résultats obtenus. En limitant leurs
échantillons d’analyse pour mieux suivre quotidiennement, et sur des périodes relativement
longues, les acteurs qu’elles étudiaient, les deux études ont démontré que des familles qui
présentaient a priori les mêmes caractéristiques pouvaient avoir des stratégies de reproduction
très différentes. Autrement dit, elles ont mis en évidence le fait que même sur la base de
quelques cas particuliers, il pouvait être démontré qu’il existe une grande variété sociale à
l’échelle locale.
C’est la raison pour laquelle nous avons nous-mêmes fait le choix de n’étudier qu’un groupe
réduit de familles, dans une seule localité, mais en ayant à l’esprit notre première expérience à
Juncal pour comparer certains phénomènes, afin de disposer du temps nécessaire pour
l’obtention d’informations abondantes qui, par la suite, devait nous permettre de décrire au
mieux les pratique paysannes dans le contexte migratoire.
Pour en revenir à nos entretiens, il était par ailleurs essentiel d’avoir une idée précise des dates
auxquelles avaient eu lieu certains évènements clés de l’histoire familiale (mariage, départ(s)
à l’étranger, retour(s) dans la localité, achat de terre, construction de maison,
investissement(s) agricole(s), etc.), pour comprendre ensuite les évolutions différenciées des
unités de production au cours des dernières années et la mutation plus globale du système
agraire de la paroisse Octavio Cordero Palacios. Parfois, il fut tout de même difficile d’obtenir
des informations précises, en ce qui concerne par exemple certains investissements fonciers.
En effet, il arriva que certaines personnes ne se souviennent pas du prix d’achat d’une parcelle
de terre, du fait de son ancienneté, quand d’autres évitèrent poliment de nous répondre, pour
éviter de parler d’argent. Cette précision ne vaut cependant que pour une poignée d’entretiens.
Ainsi, nous présenterons par la suite un certain nombre de données relatives à la dynamique
foncière dans la paroisse Octavio Cordero Palacios au cours des dernières décennies.
:�1� ����') ��!��������*���+���������;� �'�����
Qu’il s’agisse des familles « avec » ou « sans migrant », nous avons tenu compte des revenus
réguliers (ventes agricoles, salaires extérieures et remesas) de l’ensemble du groupe, comme
l’exige la notion de système d’activités, même s’il est de toute évidence très difficile de faire
39
le diagnostic exact d’une exploitation familiale, la part d’autoconsommation échappant la
plupart du temps à tout type de comptabilité et l’obtention de données économiques étant
parfois délicate. Ainsi, nous avons pu nous rendre compte des effets concrets de la migration
sur l’agriculture locale, en observant par exemple les investissements effectués par certaines
familles, ou en constatant les écarts socioéconomiques entre les différentes unités de
production.
Pour compléter les données économiques recueillies lors de nos entretiens, nous avons pu
faire le suivi hebdomadaire des ventes agricoles de 5 familles travaillant en groupe. Grâce à la
collaboration des chefs d’exploitation qui ont accepté de nous confier leur livre de comptes,
nous avons pu évaluer leurs ventes de produits agricoles et d’élevage sur une période de neuf
mois, de septembre 2008 à mai 2009 (cf. Annexe n°4). Bien entendu, et afin que notre analyse
soit complète, il aurait fallu mener ce travail sur une période plus longue, de douze ou de
vingt-quatre mois par exemple, mais ces informations, mêmes partielles, nous ont tout de
même permis d’évaluer la rentabilité économique de certains choix productifs. De plus, il
aurait été difficile de réunir de plus amples informations, car les livres de comptes des
producteurs locaux sont bien souvent illisibles ou inutilisables : notre tentative de réaliser le
même type de suivi avec un autre groupe s’est avéré impossible pour cette raison. Le
traitement de ces données a d’ailleurs été particulièrement long et fastidieux, car les erreurs de
calcul ou la mise en forme des comptes, parfois curieuse, nous ont obligé à refaire l’ensemble
de la comptabilité.
:�9��� ��������� !��%'��������� �2�!�� �!���� �� ����������' �
En parallèle de notre travail dans la paroisse Octavio Cordero Palacios, nous avons mené 18
entretiens auprès de techniciens et de fonctionnaires (cf. Annexe n°2), sur les thèmes de
l’agriculture paysanne et du ravitaillement urbain dans la province de l’Azuay.
Comme il a été dit précédemment, nous avons d’abord sollicité plusieurs membres du CEDIR,
ainsi que certains ingénieurs du ministère de l’Agriculture et de l’entreprise publique de
protection environnementale et de gestions des eaux ETAPA-Cuenca, présents eux aussi dans
la paroisse Octavio Cordero Palacios au moment où nous réalisions notre travail de terrain,
pour connaître les points de vue de techniciens de grandes institutions publiques, et donc
différent de celui des paysans, sur les enjeux de l’émigration en milieu rural. De même, nous
40
nous sommes rendu dans les locaux de l’Institut National de Développement Agraire (INDA)
à Cuenca, dont la mission principale est l’attribution de titres de propriété, pour y rencontrer
un fonctionnaire avec lequel nous avons échangé sur la question des terres communales, après
avoir mené nos propres recherches dans les archives du ministère de l’Agriculture, comme
nous l’avons décrit plus haut.
Plus tard, nous nous sommes aussi entretenus avec les ingénieurs du Programme
d’Agriculture Urbaine (PAU) de la Municipalité de Cuenca et du Centre de Reconversion
Economique de l’Austro6 (CREA), deux institutions dont l’objectif commun est la promotion
de l’agriculture commerciale dans les campagnes de l’Azuay et qui interviennent toutes deux
dans la paroisse Octavio Cordero Palacios depuis plusieurs années. Par la suite, nous nous
sommes également orienté vers le Conseil de Gestion des Eaux du Paute (CG-Paute), une
institution publique qui œuvre pour la protection de l’environnement et le développement
d’une agriculture durable à l’échelle du bassin versant du Paute, et qui est aussi intervenue ces
dernières années dans notre localité d’étude. Enfin, nous nous sommes rendus dans cinq
marchés de Cuenca pour discuter avec les administrateurs de l’organisation du ravitaillement
urbain en produits agricoles et de la place accordée aux agriculteurs azuayens sur les espaces
de vente.
<������� �������'����'�-����
Pour mettre en forme notre analyse des recompositions territoriales dans la paroisse Octavio
Cordero Palacios à l’heure de l’émigration internationale des paysans, nous avons décidé de
structurer cette thèse en trois parties.
Tout d’abord, nous ferons l’analyse historique des pratiques paysannes dans la paroisse
Octavio Cordero Palacios, et ce depuis le milieu du XIXe siècle. Ainsi, nous verrons quels
facteurs ont conditionné l’organisation de l’espace agraire local (Chapitre 1), et l’évolution
progressive des systèmes d’activités familiaux jusqu’au début de l’émigration internationale
des paysans (Chapitre 2).
6 L’Austro regroupe les trois provinces australes de l’Equateur que sont le Cañar, l’Azuay et le Morona Santiago.
41
Dans un second temps, nous nous intéresserons aux pratiques agricoles actuelles. Nous
chercherons alors à comprendre comment les familles paysannes parviennent à s’adapter au
manque de main-d’œuvre, en décrivant pour cela les choix productifs qui sont opérés au sein
des exploitations (Chapitre 3). Puis, au-delà du seul contexte migratoire, nous prendrons la
mesure de l’influence de la ville de Cuenca sur les mutations des systèmes de productions
dans notre localité d’étude (Chapitre 4).
Enfin, dans une troisième partie, nous tâcherons de décrire la réalité sociale de la paroisse
Octavio Cordero Palacios. Nous réaliserons ainsi le diagnostic économique de plusieurs
exploitations ayant un lien ou non avec l’émigration, afin d’évaluer et de comparer
l’importance des remesas, des emplois locaux, de l’agriculture et de l’élevage dans les
différents systèmes d’activités familiaux (Chapitre 5), après quoi, nous porterons une attention
plus particulière sur le rôle des anciens migrants dans la dynamique territoriale locale
(Chapitre 6).
42
����������������
��� �� ��������������� �������������
��������������������������������������������������
43
���� !"#�� ��
Depuis très longtemps, les populations paysannes de la région andine se distinguent par leur
grande mobilité. L’anthropologue J. Murra a montré que bien avant les Incas, différentes
ethnies de l’actuel Pérou parvenaient à tirer parti du contrôle vertical de plusieurs étages
écologiques, en établissant pour cela des colonies permanentes entre le littoral et le versant
oriental de la cordillère. Si ce « modèle en archipel » devait assurer la subsistance des
populations, grâce aux échanges de denrées produites sur la côte, en altitude et dans ce qui est
aujourd’hui la région amazonienne, il impliquait de fait une intense mobilité des individus qui
devaient assurer le transport des aliments vers les différents noyaux de peuplement (Murra,
1975).
A partir du XVIe siècle, la conquête espagnole, qui provoqua une baisse drastique de la
population indigène, engendra une restructuration de la société andine, par la création des
reducciones, et « la formation de finages continus disposés autour des villages qui [rompit] la
logique andine de l’archipel » (Dollfus, 1992 : 15). Dans ce contexte, la mobilité des
individus prit une autre forme, du fait de l’encadrement de la population indigène par
l’autorité coloniale, laquelle, en s’appuyant sur le système de travail obligatoire de la mita, put
décider du déplacement de la main-d’œuvre pour les travaux dans les mines et les haciendas.
Plus tard, au cours du XXe, les processus de réformes agraires, outre le fait qu’ils conduisirent
à la redistribution des terres agricoles, permirent de libérer une masse considérable de
paysans. En Bolivie par exemple, le démantèlement des haciendas à partir de 1953 favorisa
« l’émergence rapide de véritables processus migratoires » (Cortes, 2000 : 101).
En Equateur, les effets croisés de la réforme agraire de 1964, du développement de
l’agriculture d’exportation sur la costa, des activités pétrolières dans l’oriente, et enfin de la
croissance urbaine, entraînèrent de la même façon une plus grande circulation des populations
andines, et plus particulièrement vers les régions les plus dynamiques du pays. C’est ainsi,
que dans les campagnes du Cotopaxi (Chiriboga, 1984), de l’Imbabura et du Chimborazo
44
(Martinez, 1985), tout comme celles du Cañar (Rebaï, 2007), les paysans prirent l’habitude de
migrer régulièrement pour obtenir des revenus complémentaires à leur activité agricole.
Comme dans le reste de la sierra, la mobilité des paysans de la paroisse Octavio Cordero
Palacios prit tout au long du XXe siècle une plus grande ampleur. Quels furent donc les
facteurs qui amenèrent à l’élargissement progressif du cadre spatial de leurs stratégies et à
prendre, dès le début les années 1960, les chemins de l’émigration internationale ? Pour le
savoir, nous mènerons dans cette première partie une analyse en deux temps. Tout d’abord,
nous nous intéresserons à l’évolution de l’espace agraire dans la paroisse Octavio Cordero
Palacios depuis le milieu du XIXe siècle (Chapitre 1), ce qui nous permettra de comprendre
ensuite les raisons pour lesquelles les familles paysannes diversifièrent en permanence leurs
activités, en intégrant pour cela toutes sortes de filières économiques (Chapitre 2).
45
��������
�� ��������������������������������������������
������������ �����������������������������
« Voyez ce potager et ces vignobles, dit-il, ici la terre est aride et les pluies sont traîtresses, mais ils poussent parce qu’ils sont soutenus par un système très ingénieux et compliqué de citernes, de canaux et de vannes qui règlent l’irrigation, un système tellement ancien que nul ne sait qui l’a conçu et qui l’a réalisé ni quand, et pourtant tout ce qui concerne la propriété est archivé depuis plus de six cents ans. Tout le visible et tout l’invisible : les terrasses, la maison, la citronnade que vous venez de boire et moi-même, nous sommes les enfants de cet effort terrible, ininterrompu et anonyme. »
Eduardo Mendoza, L’année du déluge.
46
Quelles ont été les dynamiques ayant participé de la construction du territoire de la paroisse
Octavio Cordero Palacios ? C’est à cette question que nous tâcherons de répondre dans ce
premier chapitre, de manière à poser les bases de notre analyse des dynamiques territoriales
dans cette localité.
Pour ce faire, nous avons mobilisé plusieurs sources d’informations. Tout d’abord, nous avons
consulté de nombreux travaux d’historiens traitant des dynamiques rurales dans la province de
l’Azuay depuis le début de la période coloniale (Mora, 1926a ; Espinoza, 1989 ; Poloni-
Simard, 2000), cela nous permettant de situer notre zone de recherche dans son contexte
régional. Cependant, la plupart des ouvrages consultés nous ont fourni des informations assez
superficielles sur notre terrain d’étude. C’est la raison pour laquelle nous avons pris la peine
de réaliser 16 entretiens auprès de dirigeants politiques et de paysans, dont les âges variaient
de 32 à 90 ans, que nous avons sollicités dès le début de notre travail de terrain.
En arrivant dans la paroisse Octavio Cordero Palacios, nous sommes immédiatement entrés en
contact avec les élus de l’assemblée paroissiale, lesquels nous ont aimablement reçu et ont
accepté de répondre à nos questions en préambule de leurs séances de travail, et cela à trois
reprises au mois de juin 2008. Puis, nous avons réalisé des entretiens individuels avec certains
d’entre eux, avant qu’ils nous désignent d’autres personnes à consulter dans la paroisse. Nous
sommes alors rendus chez des anciens dont la mémoire était « incroyable », et nous avons pu,
progressivement, reconstituer l’histoire de notre localité.
Malgré les descriptions détaillées qui ont émaillé l’ensemble des entretiens que nous avons
recueillis, nous ne pouvions néanmoins nous limiter aux seules paroles des personnes
consultées. Les souvenirs étant forcément subjectifs, il était nécessaire de réunir des
documents officiels nous fournissant des informations relativement fiables sur l’évolution de
l’espace agraire dans notre zone d’étude, pour confirmer, nuancer ou infirmer les propos tenus
par les individus avec lesquels nous échangions. Dans cette optique, les archives du ministère
de l’Agriculture à Cuenca ont été à plusieurs reprises d’une grande utilité. Elles nous ont
permis par exemple de disposer de rapports d’ingénieurs très précis sur la résolution de
conflits fonciers dans la paroisse Octavio Cordero Palacios au cours des dernières décennies.
Toutefois, ces archives furent trop souvent insuffisantes pour comprendre avec plus
d’exactitude les mutations de l’espace agraire local au-delà des années 1950. Par conséquent,
nous avons dû nous en remettre à nos seuls entretiens, en conservant toutefois notre sens
47
critique et en cherchant systématiquement à faire correspondre les différents témoignages
recueillis, en demandant par exemple aux personnes interrogées de valider ou de préciser les
propos de celles que nous avions consultées antérieurement.
En dépit de certains manques, ce travail de compilation d’informations provenant de sources
diverses, mais non moins complémentaires, nous permet à présent de décrire l’évolution de
l’espace agraire dans ce qui est aujourd’hui la paroisse Octavio Cordero Palacios, depuis le
milieu du XIXe siècle. Dans ce chapitre, que nous organiserons en deux parties, nous
commencerons par décrire les différents processus d’appropriation qui ont conduit à l’avancée
progressive de la frontière agricole sous l’effet d’une croissance démographique constante, en
insistant par ailleurs sur les différents types d’exploitation qui se développèrent localement.
Puis, nous nous intéresserons aux différents facteurs qui aboutirent à la transformation de la
structure foncière locale par la création officielle des comunas Illapamba et San Luis.
� � !���� ���� " �� �������� #���$�� ������� ��������� ���� ��� ��
���������� ������%&'()*'(+
Dans sa description historique de la province de l’Azuay, L. Mora n’accorda précisément que
trois lignes à la paroisse de Santa Rosa (Mora, 1926b : 123). Si cette localité était à l’époque
sans grande importance pour la culture ou l’économie régionale, elle connut cependant des
transformations majeures qui témoignent de la vigueur des dynamiques territoriales dans les
campagnes cuencanaise depuis plus d’un siècle et demi.
����,��� ����������������
L’histoire de la paroisse Octavio Cordero Palacios commence bien avant 1933, date à laquelle
elle prit le nom de l’homme de lettres qu’elle avait vu naître en 1870. Si l’on s’en tient à la
seule période coloniale, J. Poloni-Simard a signalé dans son travail sur la société indienne du
corregimiento de Cuenca entre le XVIe et le XVIIIe siècle, que dans le hameau de Santa Rosa,
en lieu et place de notre zone d’étude, l’installation d’Indiens originaires d’Alausí était « fort
ancienne, parfois contemporaine à la fondation de la ville [de Cuenca en 1557] » (2000 : 341).
Depuis cette date, Santa Rosa n’était qu’un hameau de la paroisse San Blas, où vivait en
48
grande majorité une population indienne, réunie dans plusieurs parcialidades comme
Muyupamba, Azhapud, Adobepamba et Parcoloma7, à la tête desquelles les caciques
organisaient la répartition des droits sur les terres collectives et prélevaient le tribut reversé
aux autorités espagnoles.
A l’époque, ni Santa Rosa ni presque aucune autre localité située dans les vallées des fleuves
Tomebamba, Machángara et Tarqui ne se trouvaient sous la domination d’haciendas. Bien
que celles-ci commencèrent à se multiplier dans le corregimiento de Cuenca au cours du XVIe
siècle, « il est loin d’être prouvé que les propriétaires fonciers contrôlèrent la totalité de
l’espace agricole, même celui considéré comme le plus fertile, réussissant à en exclure
communautés, caciques et familles indiennes. Surtout, on ne peut parler, à propos de cette
région de l’audience [de Quito], de la constitution de grands domaines intégrés (combinant
agriculture et activité textile), composites (associant pâturages, terres de cultures céréalières et
plantations commerciales), comme ce fut le cas dans les bassins centraux et septentrionaux
[de Riobamba et Quito] » (Poloni-Simard, 2000 : 315).
�����-./���!��0��0��1#-���������!��# 0���#-!�2���#��!
�-!����2�#- ��0�-���034����!�����
7 D’après O. Cordero Palacios (1926), il s’agit d’anciens centres de peuplement cañaris (confédération pré-incaïque), situés dans l’actuelle province de l’Azuay.
49
A l’instar des autres bourgs situés dans la périphérie de Cuenca, Santa Rosa connut un essor
démographique important dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, « alimenté par
l’accroissement naturel et les migrations [en provenance d’autres secteurs du corregimiento] »
(Poloni-Simard, 2000 : 383). Cela rendit difficile l’encadrement religieux de la population
indienne, en conséquence de quoi, Santa Rosa fut officiellement promue au rang de paroisse
civile et ecclésiastique en 1854, par décret du gouverneur de l’Azuay. La première église fut
construite cette même année, dans l’actuel secteur de Pueblo Viejo (« Village Ancien »), alors
que dans le reste de la localité avaient lieu depuis plusieurs années de profondes
transformations de l’espace agraire.
�5�#�$����������6������������"!����������
Entre 1850 et 1860, des familles métisses, de double ascendance espagnole et indienne,
vinrent coloniser des espaces entièrement boisés situés au dessus de 2900 mètres d’altitude.
Ce phénomène était loin d’être exceptionnel dans la région de Cuenca où, dès le XVIIe siècle,
on assistait à « la croissance du nombre de métis dans les villages, y compris les hameaux les
plus reculés » (Poloni-Simard, 2000 : 346). La famille Aguilar fut l’une des toutes premières à
pénétrer dans la zone, comme nous le raconta Teófilo, un nonagénaire du secteur d’El Rocío :
« mon arrière grand-père, Manuel Bautista, vint à Suranpallti pour défricher de grands
espaces. » Même s’il fut incapable de nous donner le nom de la localité d’origine de son aïeul,
il insista cependant pour nous dire qu’« à cette époque, les plus vaillants pouvaient avoir
beaucoup de terres. »
La seule vaillance des colons ne peut cependant pas expliquer ce processus d’accaparement
foncier. Du côté de Deleg, la paroisse située au nord de Santa Rosa, il est probable que dès
1850, la famille Cordero, qui possédait déjà de vastes propriétés dans la région australe8, vint
déboiser de grands espaces pour se constituer de nouvelles exploitations, en profitant
certainement de la situation pour exproprier certaines familles indiennes de leurs terres. Dans
son élan, il est possible qu’elle ait franchi la limite entre les deux localités, prolongeant de fait
le secteur de Suranpallti sur le territoire même de Santa Rosa, et qu’elle se soit appropriée des
terres qui, jusqu’alors, n’avaient pas de propriétaire. Cela confirmerait ainsi les dires de
Bolívar, un ancien militaire âgé de soixante ans qui a passé toute sa jeunesse dans la localité,
8 A Juncal par exemple, comme nous l’avions constaté lors de notre précédente recherche.
50
qui nous dit lors d’un entretien, qu’au milieu du XIXe siècle, des huasipungos (serfs) s’étaient
échappés des haciendas de Deleg pour venir s’installer sur les bords de la rivière Sidcay.
Après diverses recherches, aucun ouvrage sur l’histoire régionale ne put nous confirmer cet
épisode, mais il est probable que lors de la colonisation de Suranpallti par la famille Cordero,
des familles de paysans indigènes se soient réfugiées à proximité des lieux de peuplement
comme Azhapud et Adobepamba, entraînant ainsi une augmentation de la population dans le
sud de la paroisse de Santa Rosa.
D’autres familles, comme les Montesdeoca ou bien encore les Robles, dont l’origine
géographique demeure elle aussi inconnue, vinrent à leur tour coloniser le secteur de
Suranpallti. Comme les Aguilar, elles engagèrent les paysans des communautés
d’Adobepamba, d’Azhapud et de Muyupamba en leur offrant un repas par jour de travail. Le
déboisement fut rapide et fit apparaître en quelques années de grands espaces dédiés à la
culture du maïs, de l’orge, du blé et de tubercules comme l’oca [Oxalis tuberosus Mol.] et le
melloco [Ullucus tuberosus H. B. K.].
Il existait alors un contraste fort entre les familles métisses du nord de la localité qui, d’après
Teófilo, possédaient toutes « plusieurs hectares », et les familles indiennes qui ne devaient
vivre en revanche que sur de petits lopins de terre, en profitant toutefois d’espaces plus vastes
pour l’élevage, afin de parvenir à leur subsistance.
�7��������������������� �8������$����6�������� ������
Les paysans du sud de la paroisse, regroupés dans les ayllus (communautés) de Muyupamba,
Adobepamba, Azhapud et Parcoloma, « vivaient dans de petites maisons en adobe
[cf. Photographie n°1] dont les toits étaient couverts de paille et à côté desquelles on trouvait
de petits champs cultivés, comme nous le décrivit Bolívar, en se remémorant ses plus anciens
souvenirs de jeunesse lors d’une longue marche dans le secteur d’Adobepamba. L’association
maïs, haricot, fève, orge et blé était entièrement destinée à l’autoconsommation. A côté des
lopins, on retrouvait généralement un enclos, appelé picota, qui accueillait durant la nuit les
bovins et les ovins ayant pâturé tout le jour durant sur les terres d’Illapamba situées entre
2900 et 3200 mètres d’altitude. Là-bas, des espaces mis en valeur de façon collective étaient
dédiés à la production de tubercules, comme la pomme de terre, le melloco ou l’oca.
51
��#�#2������-.�0-��-���--�9��!#-��:!�--� �-!��!����0� �� #;���9;�
Avec ses murs en adobe et ses colonnes en bois, cette petite maison, dont le toit de paja a été remplacé par des tuiles, est le symbole d’une époque (presque) révolue. Source : N. Rebaï (2009).
Ainsi, les petits exploitants du sud de la localité avaient développé des systèmes de production
écologiquement diversifiés, fondés sur la dispersion des espèces végétales et animales en
fonction du gradient altitudinal9, selon le principe même de « micro-verticalité » décrit par
U. Oberem dans son étude des paysanneries des Andes septentrionales d’Equateur du XVIe
siècle : « les membres d’un même groupe avaient des parcelles situées à différents étages
écologiques accessibles en un seul et même jour avec la possibilité de revenir à leur lieu de
vie pour la nuit10 » (Oberem, 1981 : 51). Les paysans de Santa Rosa parvenaient donc à tirer
parti des changements de température pour diversifier leurs productions (cf. Carte n°5).
9 Dans les montagnes tropicales, la température diminue en moyenne de 0,65°C tous les 100 mètres (Demangeot, 1999).
10 « Los miembros de un grupo tenían campos situados en diferentes pisos ecológicos alcanzables en un mismo día con la posibilidad de regresar al lugar de residencia por la noche. »
53
L’usage des terres d’Illapamba, ancien de « plus de deux cent ans », comme il est possible de
le lire dans un courrier daté de 1987 adressé au ministère de l’Agriculture par les paysans de
la paroisse Octavio Cordero Palacios (cf. Annexe n°5), permettait aux paysans de pratiquer
l’élevage et de disposer d’une réserve de bois pour l’usage domestique. Le retour quotidien
des animaux à proximité des parcelles cultivées assurait de fait un transfert de fertilité
nécessaire pour les cultures vivrières. Pour ce qui était de la répartition des tâches au sein des
exploitations, la conduite des troupeaux vers les hautes terres concernait les hommes, tandis
que les femmes se consacraient au désherbage régulier des parcelles, à la répartition des
matières animales sur les terres cultivées, ainsi qu’à l’élevage des porcs, des cobayes et de la
volaille. Plus haut, entre 3200 et 3400 mètres, se trouvaient les páramos, desquels descendait
la rivière Sidcay, dont l’eau était utilisée par l’ensemble des familles paysannes, aussi bien
pour l’agriculture que pour leurs usages domestiques.
!���9�-.�4���������� �!!:!��9�! ���# 0���#-�!�-���#!��03�3�!�����
En 1880, la paroisse de Santa Rosa comptait 2 016 habitants (Palomeque, 1990 : 225), c’est-à-
dire presque autant qu’en 2010, date à laquelle furent recensées 2 271 personnes dans la
paroisse Octavio Cordero Palacios (INEC, 2010), mais à la fin du XIXe siècle, la population
était regroupée sur environ un quart du territoire paroissial. Dans ce contexte de forte densité,
54
les superficies cultivées étaient réduites et les terres laissées en jachère à l’intérieur des
exploitations sans doute de très petites superficies11.
Comme nous l’expliquèrent les personnes que nous avons interrogées, les sols étaient
labourés à l’aide d’une araire tirée par deux bœufs et dirigée par un homme, tandis que les
femmes étaient chargées de placer les semences dans les sillons fraîchement creusés
(cf. Photographies n° 2/3). Durant les pics de travail, qui correspondaient aux périodes de
semis et de récoltes, les familles paysannes pratiquaient le cambio mano, un système de
travail correspondant à l’ayni, hérité de la période pré-incaïque (Alberti et Mayer, 1974), et
très courant dans l’ensemble de la région andine (Morlon, 1992, Ferraro, 2004). Il s’agissait
d’un échange entre plusieurs familles, ou plutôt d’une mise en commun de la main-d’œuvre
pour travailler la terre, mais aussi pour construire les maisons.
Le cambio mano pouvait aussi concerner les familles sans araire qui fournissaient un jour de
travail sur les parcelles voisines contre un jour de labour dans leurs propres exploitations.
Enfin, les mingas, ou minka en quechua, héritées elles aussi de la période pré-incaïque12
(Alberti et Mayer, 1974 ; Ferraro, 2004), réunissaient un grand nombre d’individus sous
l’autorité des chefs de communautés, pour le travail sur les terres collectives d’Illapamba,
pour l’ouverture de chemins ou pour la construction de petits canaux d’irrigation permettant
l’usage de l’eau de la rivière Sidcay.
A la fin du XIXe siècle, il existait donc deux grands types d’agricultures à Santa Rosa : celle
des familles de Suranpallti, qui possédaient des exploitations de taille moyenne, et celle des
familles regroupées dans le sud de la paroisse, qui ne possédaient que peu de terre. Si d’un
point de vue de la structure agraire, le territoire était alors divisé en deux, en vérité, les
disparités locales étaient bien plus importantes.
11 Les picotas, dont nous avons expliqué la fonction plus haut, devaient probablement changer de place d’une année à l’autre, ce qui correspondait en définitive à une rotation des parcelles cultivées au sein des plus petites exploitations.
12 Toutefois, comme l’ont écrit B. Orlove, R. Godoy et P. Morlon, « cette coutume andine a sans cesse été utilisée [au profit de], ou récupérée par les groupe dominants : empire, curacas [caciques] et encomenderos, grands propriétaires, Etat moderne… » (Orlove et al., 1992 : 103).
55
��#�#2������!-.5=7�����:!�-����������
Dans les Andes, l’araire est encore le moyen le plus répandu pour labourer les sols.
Lorsque que la terre est retournée, il faut ensuite placer la semence et la couvrir d’engrais. Pour cela, il faut donc mobiliser plusieurs personnes, comme dans le passé. Source : N. Rebaï (2008).
56
�/� ����� ����������������������
A Suranpallti, le processus de colonisation s’est poursuivi des années durant, jusqu’à ce que
les espaces conquis par les familles métisses soient limitrophes du secteur d’Illapamba, « sans
que jamais il n’y ait de conflit13 », précisa Teófilo, avant d’ajouter que dans le premier quart
du XXe siècle, les fils et petit-fils de Manuel Bautista « possédaient chacun plusieurs
hectares. » Tous produisaient céréales et tubercules, tandis qu’une partie importante de
l’espace était dédiée aux élevages bovin et ovin. Pour travailleur leurs terres, les familles de
Suranpallti engageaient chaque année des peones, qui n’étaient autres que les paysans du sud
de la paroisse.
Comme nous le décrivit Téofilo, « les journées de travail allaient de l’aube au coucher du
soleil, et les ouvriers agricoles ne percevaient pour tout salaire qu’un real [un dixième de
sucre] et un repas le midi. Les peones venaient surtout pour manger car beaucoup mouraient
de faim à cette époque. Quand nous allions en chercher vingt, nous revenions avec quarante
ou cinquante d’entre eux, parce que les frères voulaient aussi venir. Et puis nous donnions
aux ouvriers un peu de chicha, et ça, cela les attirait beaucoup. »
Bien que le discours tenu par Téofilo soit modéré, il faut comprendre en réalité que les
familles de Suranpallti exploitèrent les paysans du sud de la paroisse et instaurèrent de fait
une forme de domination sociale à l’échelle locale, comme il en existait une dans d’autres
localités de la sierra où la présence d’haciendas contraignait les huasipungos à toutes sortes
de tâches, même si, précisons-le, dans la paroisse de Santa Rosa, le contexte social était
différent, car les familles de Suranpallti n’ont à aucun moment exercé de contrôle sur les
terres agricoles situées plus en aval de la rivière Sidcay. C’est d’ailleurs en ces termes que
Rosa, une paysanne du secteur de la Dolorosa, âgée de 62 ans, nous raconta l’époque où,
petite, elle allait travailler dans les exploitations du nord de la paroisse : « à huit ans, je
n’avais rien, je marchais pieds nus. J’allais travailler dans les haciendas de Suranpallti [sic]
pour récolter le maïs ou parfois pour aider dans les cuisines. »
13 Nous n’avons d’ailleurs jamais entendu d’autre version. Il est probable que les familles de Suranpallti n’aient pas voulu créer de tension avec le reste de la population paysanne en empiétant sur les terres d’Illapamba. Il est donc possible que dès cette époque, une limite conventionnelle ait été définie entre les deux territoires.
57
Concernant les récoltes, une faible partie seulement était destinée à la vente, comme nous le
dit Manuel Cruz, 69 ans, qui naquit et vécut à Suranpallti jusqu’à l’âge adulte : « à l’époque
[vers 1950], mes parents produisaient de tout, et ils travaillaient sous forme de cambio mano.
Il fallait aussi engager des peones pour semer, désherber et récolter. L’essentiel était
consommé par les familles, et le maïs permettait d’élever des porcs pour notre propre
consommation. Il y avait aussi de l’avoine pour nourrir des mules et quelques chevaux. Nous
avions du lait, nous faisions des fromages et nous avions un peu de pomme de terre. Parfois,
nous faisions du troc avec des familles de Deleg. »
Jusqu’en 1950, l’organisation territoriale dans la paroisse nouvellement baptisée Octavio
Cordero Palacios était donc assez simple. Dans le nord, et plus précisément dans les secteurs
de Suranpallti et d’Hacienduco14, les familles Cordero, Aguilar, Montesdeoca et Robles
possédaient des exploitations de taille moyenne, tandis qu’au sud, vivaient les familles
paysannes dont les propriétés étaient réduites à de petits lopins de terre. En parallèle,
l’augmentation de la population avait conduit à la transformation progressive de l’espace
agraire : entre 1880 et 1962, la localité connut une augmentation de 57% de sa population, en
passant de 2 016 à 3 175 habitants (Palomeque, 1990 : 225 ; INEC, 1962), ce qui contraignit
les familles d’Azhapud et d’Adobepamba à coloniser progressivement les terres d’Illapamba.
C’est dans ce contexte que naquit la communauté de Chaquillcay, probablement entre 1920 et
1930, dans un secteur situé aux alentours de 3000 mètres d’altitude (cf. Carte n°6). Toutefois,
l’avancée de la frontière agricole sous l’effet de cette poussée démographique ne fut pas le
seul trait des recompositions territoriales locales. D’autres transformations, plus radicales,
allaient avoir lieu quelques années plus tard.
14 Ce toponyme, qui fait référence à l’existence d’haciendas ou de grandes propriétés, est révélateur du type d’exploitation que l’on pouvait trouver dans ce qui est certainement la zone la plus plane de la paroisse.
59
��#�#2������!-./=*���!������2�! 0��!!����:!�2��2������� �!���!�#- �����;����
�-!��! �11���-�!!����0�! ������#�!!�#���4�#�#� ��#������#!
Dans le barrio d’El Rocío (Suranpallti), à gauche, ou bien dans le secteur d’Hacienduco, les parcelles sont de tailles moyennes et l’habitat dispersé.
A Cristo del Consuelo (Chaquillcay), les parcelles sont plus réduites et l’habitat plus dense.
A Santa Rosa (Muyupamba), les propriétés sont minuscules et l’habitat concentré. Ces clichés montrent que l’histoire agraire locale a produit des espaces contrastés où la distribution de la terre et la répartition du peuplement sont très inégales. Source : N. Rebaï (2008, 2009).
60
5�0���>����8��� ��������������%*'()*&(+
Depuis le milieu du XIXe siècle, la colonisation des espaces boisés avait engendré l’une des
principales mutations spatiales de la paroisse Octavio Cordero Palacios. Elle avait tout aussi
bien concerné les familles métisses venues développer l’agriculture et l’élevage que les petits
exploitants du sud de la localité à la recherche de moyens de subsistance. Au cours des années
1950, l’espace agraire continua d’évoluer, toujours sous l’effet d’une colonisation progressive
des espaces situés en altitude, mais aussi par l’avènement d’un conflit foncier de grande
ampleur.
5�� ����,������������������������������?�����@
A partir des années 1950, de nombreux changements eurent lieu dans la paroisse Octavio
Cordero Palacios, bien que pour les comprendre, il faille revenir plusieurs décennies en
arrière. Entre 1900 et 1920, une partie de la population de Chaquillcay se mit à fabriquer des
tuiles et des briques en exploitant la terre argileuse située dans le secteur qui, bientôt, allait
s’appeler La Tejería15. Comme nous le conta Bolívar, « à l’époque [1950-1970], on pouvait
voir une multitude de fours qui permettaient de cuire les tuiles [cf. Photographies n°10/11].
Chaque famille en avait un, et c’étaient les hommes qui les fabriquaient. » Au cours de nos
entretiens, nous pûmes en apprendre davantage sur cette activité, en rencontrant un ancien
fabricant de La Tejería :
« Le travail était dur et risqué car nous travaillions à l’aveugle, sans savoir si nous allions vendre nos tuiles. Nous ne pouvions faire qu’une à deux productions annuelles et cela nous prenait du temps. D’abord, il fallait creuser et récupérer beaucoup de terre. Cela prenait environ trois jours. Ensuite, il fallait mélanger la terre avec de l’eau et former les tuiles avant de les laisser sécher une semaine. Puis il fallait beaucoup de bois pour que le four puisse marcher huit jours sans jamais s’arrêter. Mes frères et moi montions plusieurs fois par jour à Illapamba tandis que mon père se chargeait de cuire les tuiles. Il en fallait environ quatre mille pour une maison. Nous vendions chaque tuile à 3 sucres [0,15 dollar en 1975]. Cela pouvait rapporter beaucoup d’argent, à condition d’être sûrs de pouvoir les vendre. Ici, les familles achetaient les tuiles petit à petit et remplaçaient leurs toits de paille au bout de quelques années. »
Manuel, 52 ans, Cristo del Consuelo.
15 La Tuilerie. Vient de teja qui signifie « tuile » en espagnol.
61
��#�#2������!-.(=���!4�!��2�! �����A����
Les dernières traces d’une activité artisanale : un ancien four (en haut) et un séchoir pour les briques. Source : N. Rebaï (2009).
62
D’après les dires des anciens, certains tuiliers parvinrent à agrandir leurs exploitations ou à
augmenter leurs troupeaux de bovins pendant les années fastes de La Tejería. Cependant, la
vente de tuiles ne concerna qu’un petit groupe de familles, « une vingtaine », comme le
précisa Manuel, ce qui explique que cette activité n’ait pas plus largement profité à la localité.
En revanche, elle eut des effets très importants sur le paysage agraire puisque les zones
d’altitude furent progressivement déboisées. Le couvert végétal connut une réduction d’autant
plus rapide que la population paysanne, qui continuait de croître, poursuivit le processus de
colonisation pour étendre les superficies cultivées au-delà des 3000 mètres d’altitude, gagnant
de fait toujours plus d’espace sur les terres d’Illapamba. Ainsi, comme nous l’expliqua
Bolívar, « des habitants de Chaquillcay formèrent de nouvelles communautés, comme La
Dolorosa ou El Cisne », avant que n’ait lieu la plus importante recomposition foncière de la
localité au cours du XXe siècle.
5�5�@"����������������������
Entre 1930 et 1950, lorsque furent construites les deux voies carrossables reliant Cuenca à
Santa Rosa, le centre de la nouvelle paroisse Octavio Cordero Palacios, les tuiliers de
Chaquillcay eurent un accès plus facile aux paroisses de Sidcay et de Ricaurte, ce qui leur
permit d’accroître leur commerce. Pour cela, ils se mirent à exploiter davantage les espaces
boisés d’Illapamba, entraînant rapidement de vives oppositions, en particulier celles des
habitants de Parcoloma, la communauté la plus peuplée de la zone. C’est ainsi que Félix, un
paysan de 63 ans, nous décrit le contexte de l’époque : « les tuiliers allaient déboiser les
terres situées en altitude et cela dérangeait ceux de Parcoloma, parce qu’ils pensaient qu’il
n’aillait plus leur rester de bois. Alors il y eut beaucoup de conflits très violents entre eux. »
Dans ce contexte, et pour limiter par ailleurs le développement des petites propriétés
individuelles dans les zones d’altitude, le ministère de l’Agriculture intervint et décida en
1962 de réglementer l’accès aux espaces collectifs par la création de deux comunas. Dès lors,
les paysans de Parcoloma se mirent à utiliser les terres de San Luis, tandis que ceux des autres
communautés continuèrent à exploiter celles d’Illapamba (cf. Carte n°7). Un fossé fut même
creusé pour limiter les deux nouveaux territoires, en suivant le tracé arbitraire décidé par les
ingénieurs du ministère de l’Agriculture, mais comme nous le raconta Félix, « pendant
plusieurs années, tout le monde passait la frontière, ce qui provoquait de nombreux conflits. »
63
Dans l’une comme dans l’autre organisation, les paysans continuèrent cependant à travailler
collectivement sous l’autorité de présidents démocratiquement élus, comme l’exige le
règlement officiel des comunas (cf. Annexe n°2), en cultivant tubercules et céréales, mais de
façon plus modeste, car la réduction des terres d’Illapamba, sous l’effet de la croissance
démographique et de l’avancée de la frontière agricole à l’échelle locale, avait logiquement
entraîné la baisse des superficies dédiées à cet effet.
Si en l’espace d’un siècle, le territoire d’Illapamba rétrécit telle une peau de chagrin et vit ses
limites fixées officiellement par les pouvoirs publics au début des années 1960 (cf. Cartes n°6
et 7), les mutations de la paroisse Octavio Cordero Palacios ne s’arrêtèrent pas là. Alors que
depuis plusieurs décennies la croissance démographique à l’échelle locale avait été constante,
et qu’elle avait déjà donné lieu à la formation de la communauté de Chaquillcay, plusieurs
autres communautés virent le jour entre 1960 et 1980, période durant laquelle la population
locale continua d’ailleurs d’augmenter, passant de 3 175 à 3 274 habitants entre 1962 et 1974
(INEC, 1962 et 1974). Ainsi, naquirent San Vicente, San Bartolomé, Virgen de La Nube,
Patrón Santiago, San Jacinto et Santa Marianita, sortes de « petites sœurs de Chaquillcay et de
Parcoloma », pour reprendre l’expression de Bolivar.
Partout dans la paroisse, de nombreuses petites chapelles en bois et en adobe furent
construites, ce qui signifiait l’établissement de nouveaux groupes de familles sur tel ou tel
territoire, faisant ainsi avancer la frontière agricole, vers l’est et vers l’ouest (cf. Carte n°7).
L’influence de l’Eglise allait être telle que désormais, les communautés, qui n’avaient plus
grand-chose à voir avec les ayllus originels puisque leurs habitants n’avaient pas
nécessairement les mêmes ancêtres communs, ne porteraient plus de noms indiens ou faisant
référence à des éléments physiques. Seules Adobepamba et Azhapud gardèrent ainsi leurs
noms d’origine, tandis que d’autres, comme Suranpallti et Chaquillcay devinrent El Rocío et
Cristo del Consuelo (cf. Carte n°7).
En un peu plus d’un siècle, la paroisse Octavio Cordero Palacios, anciennement appelée Santa
Rosa, connut donc de profondes transformations. Toutefois, celles-ci ne se limitèrent pas à la
seule dimension agraire : au-delà des champs, les stratégies des familles évoluèrent beaucoup
elles aussi, comme nous le verrons dans le chapitre qui suit.
65
��������
�� ���������� ��� � ����������������������� ��
������������������������������ ����!��� ��"#
« C’est un voyage qui ne finit jamais, toujours recommencé par des hommes qui ressemblent à ceux qui les ont précédés comme l’eau d’un verre ressemble à l’eau d’un autre verre. Ce sont les mêmes visages de couleur indéfinissable, les mêmes pieds gigantesques, aux orteils écartés, sortant des sandales trouées, les mêmes cheveux clairsemés, les mêmes corps décharnés et résistants, les mêmes femmes aux visages fatigués desquelles toute beauté a disparu. »
Jorge Amado, Les chemins de la faim. �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
66
Au cours du XXe siècle, la croissance de la population dans la paroisse Octavio Cordero
Palacios entraîna la colonisation progressive des terres d’altitude et la multiplication des
petites propriétés individuelles. Toutefois, si le recul de la frontière agricole eut pour but de
satisfaire des besoins alimentaires croissants, il n’empêcha en aucune forme les familles
paysannes de diversifier leurs activités, à l’image de celles de la province de Tungurahua qui,
depuis l’époque coloniale, profitèrent de la situation stratégique de la ville d’Ambato, à la
croisée des routes commerciales entre la sierra et la costa, pour développer une importante
activité artisanale (Martínez et North, 2009).
D’après B. Kervyn, l’idée que pour les paysans, la primauté serait accordée aux activités
agricoles de subsistance, et non à la maximisation du revenu, est à discuter. Il explique en
effet que « l’ordre de priorité dans l’assignation des ressources et dans les objectifs
économiques dépend des facteurs disponibles, et d’autres conditions comme le marché ou le
niveau d’information, et non d’une rationalité inhérente au paysannat en général » (1992 :
442). Autrement dit, la recherche de revenus serait de même importance que l’agriculture de
subsistance, et c’est pourquoi, les groupes paysans profiteraient des temps faibles de l’activité
agricole pour travailler à l’extérieur de leurs exploitations, tant pour la satisfaction de leurs
besoins élémentaires que pour épargner. Dans ces conditions, comment les familles paysannes
de la paroisse Octavio Cordero Palacios ont-elles organisées leurs systèmes d’activités avant
que l’émigration internationale ne se généralise ?
Pour tâcher de répondre à cette question, nous organiserons ce chapitre en deux parties. Pour
commencer, nous verrons comment, depuis la période coloniale, les agriculteurs de Santa
Rosa, puis de la paroisse Octavio Cordero Palacios, ont constamment profité d’opportunités
économiques extérieures, au niveau provincial comme à l’échelle nationale, pour cumuler des
revenus qui leur permirent de compenser les insuffisances de leurs productions agricoles.
Puis, nous reviendrons sur les circonstances qui ont conduit au début de l’émigration
internationale dans cette localité de la région cuencanaise.
67
$%&��� "������ ����������� ���"���������� ������������ ������" �"��
Du nord au sud de la province de l’Azuay, les paysans ont depuis longtemps diversifié leurs
activités hors domaine agricole, en se consacrant par exemple à l’artisanat (Martínez Borrero
et Einzmann, 1993). Depuis l’époque coloniale, la population de Santa Rosa en a fait de
même, contrainte par la faiblesse des productions agricoles de trouver la plupart du temps ses
moyens de subsistance en dehors des exploitations.
Pour le montrer, nous resituerons d’abord notre localité d’étude dans son contexte régionale et
national. Nous nous servirons à cet effet des études de J-P. Deler (1981), J. Poloni-Simard
(2000) et S. Palomeque (1990), pour décrire les différents réseaux économiques auxquels
furent intégrés les paysans de Santa Rosa, puis de la paroisse Octavio Cordero Palacios, au
cours des deux derniers siècles. Au-delà de ce cadre général, nous nous appuierons bien
entendu sur les entretiens que nous avons réalisés et qui nous ont permis de comprendre
précisément l’organisation des systèmes d’activités familiaux durant les dernières décennies.
$%$%'�������� � �������������������� ������� ���"����
Dès la fondation de Cuenca au XVIe siècle, le développement de l’artisanat fut très important.
C’est à cette période que J. Poloni-Simard (2000) situe l’établissement d’une population
indienne spécialisée dans divers corps de métiers (charpentiers, tuiliers, forgerons, etc.)
géographiquement situés au cœur de la cité coloniale. Dans le but de répondre à une demande
urbaine croissante16, il est probable qu’à cette époque, des habitants de Santa Rosa se soient
rendus en ville pour y vendre de la laine aux nombreux ateliers de tisserands alors en activité.
De même, il est possible qu’une partie de leur production ait été exportée, en passant par le
Pérou et le port de Lima, la laine ayant été la principale filière économique de la région
cuencanaise durant toute la période coloniale (Palomeque, 1990). Dans ce contexte, il est tout
aussi envisageable que se soit donc multiplié le nombre de muletiers, comme partout dans le
corregimiento (Poloni-Simard, 2000), illustrant déjà les liens commerciaux étroits entre
Cuenca et les campagnes alentours (cf. Gravure n°1).
16 Entre 1778 et 1854, la population de Cuenca est passée de 16 001 à 38 056 habitants (Palomeque, 1990 : 228).
68
(��)&��*+$%�*������&�*��
Depuis sa fondation au XVIe siècle, Cuenca attire les paysans des campagnes azuayennes, en témoigne cette description de C. Wiener parue dans la revue française Le tour du Monde : « les Indiens des environs [de Cuenca] apportent à la foire, qui se tient une fois par semaine sur la grande place et dans les rues adjacentes, les comestibles et le combustible, des poteries et des chapeaux de paille assez grossiers, qu’ils échangent contre des scapulaires, des images de saints ou des cotonnades » (Wiener, 1884 : 414). Pour l’illustrer, une gravure de Taylor, réalisée à partir d’une photographie, montre au premier plan deux paysans chargés de ballots, à l’entrée de la cité (Wiener, 1884 : 409).
Outre le fait que la laine servait à la confection de vêtements, elle assurait ainsi un revenu aux
groupes paysans. Cette rentrée d’argent leur permettait de payer les différents tributs à
l’autorité coloniale et, dans une moindre mesure, de couvrir une partie de leurs dépenses
domestiques. Plus tard, dans la seconde moitié du XIXe siècle, l’achat de provisions devait
avoir lieu chez les familles de Suranpallti qui, d’après Teófilo, exerçaient une intense activité
commerciale, et cela bien avant de venir s’installer dans la paroisse de Santa Rosa : « à
Suranpallti, il y avaient des hommes qui allaient jusqu’à Riobamba acheter de la pomme de
terre, du riz, du sucre et surtout du sel pour les revendre à Cuenca sur le marché de San
Francisco [aujourd’hui 10 de Agosto]. A cette époque, le transport se faisait par mules et
chacune d’entre elles pouvait rapporter 20 sucres [10 dollars] de bénéfice par voyage. Les
familles de Suranpallti vendaient aussi une partie de leurs marchandises aux paysans de
Santa Rosa et de Chaquillcay. »
69
L’élevage ovin avait donc une grande importance dans le passé, tant du point de vue
agronomique, avec le transfert de fertilité, que du point de vue économique, car il permettait
aux familles paysannes de couvrir une partie de leurs dépenses, quand la plus grande part des
productions végétales, la totalité certainement, était réservée à l’autoconsommation.
Toutefois, si la vente de laine fut l’une des premières formes de rémunération dans la paroisse
de Santa Rosa, elle ne fut certainement pas la plus importante.
$%%'�������������������
C’est durant la seconde moitié du XIXe siècle que prit son essor la filière artisanale des
chapeaux de paja toquilla, plus connus sous le nom de Panamás, au moment où la
redéfinition des circuits commerciaux après l’indépendance de l’Equateur en 1830, conduisit
à une nouvelle forme de spécialisation économique dans la province de l’Azuay. Alors que la
laine avait perdu de son importance, les exportations de chapeaux vers l’Amérique du nord et
l’Europe devinrent le nouveau moteur économique du pôle cuencanais, grâce à la mise en
œuvre d’une politique qui favorisa la création de petites unités de production en villes et qui
intégra dans le même temps les populations paysannes aux réseaux commerciaux
internationaux (Palomeque, 1990).
Durant les premières décennies, les habitants de Santa Rosa devaient profiter de leurs
passages en ville pour acheter la paja toquilla qui allait servir à la confection des chapeaux.
Plus tard, lorsque furent percées les deux voies carrossables qui relièrent la paroisse à Cuenca,
trois petites foires se développèrent, la première, au point nommé La Raya, dans l’actuel
secteur d’Azhapud, et les deux autres, à Santa Rosa et Parcoloma (cf. Carte n° 8). Dans ces
conditions, les tisseurs de chapeaux purent vendre leurs ouvrages directement dans la localité
et tirer quelques revenus de la vente de petits animaux, comme nous l’expliquèrent Bolívar,
Téofilo et Segovia, une paysanne de 80 ans du secteur d’El Rocio.
71
Le négoce devait alors correspondre à la description faite par le voyageur étasunien
H. Franck, lorsqu’il fit halte à Azogues, au cours de son périple andin au début du XXe
siècle : « alors que la lumière du jour déclinait, de tous les points cardinaux, de toutes les
huttes entourées par des champs de maïs, affluaient des hommes, des femmes et des enfants,
chacun portant avec lui un chapeau récemment tressé, touffu avec ses bouts de « paille » non
coupées. Une douzaine de négociants de Cuenca les achetaient aussitôt qu’ils arrivaient,
jamais au prix réclamé par le vendeur mais après un ardent marchandage, à la fin duquel les
tisseurs finissaient par se résigner humblement17 » (Franck, 1917 : 187-188).
��/�/(������*+$%'��/*.����/*��-������&-��*3�3���-�4�'/�����/*-�(���/'�-�
Une fois les tâches agricoles terminées, les paysans se consacraient chez eux, comme c’est le cas sur cette photographie, à la confection de chapeaux de paja toquilla. Source : J.M. Borrero et H. Einzmann (1993 : 191).
Si en 1875 la paroisse de Santa Rosa comptait alors 80 tisseurs de chapeaux (Archives
Nationales d’Histoire, Section Azuay – ANH/SA, 1875), il semble que plus tard, la grande
majorité des familles aient été concernées par cette fabrication artisanale, même à Suranpallti.
Dans chaque foyer, tous les membres pouvaient se consacrer à l’ouvrage dès que les tâches
17 « As the afternoon declined, there streamed in from every point of compass, from every hut among the surrounding cornfields, men, women, and children, each carrying a newly woven hat, bushy with its uncut « straw » ends. A dozen agents from Cuenca bought these as they arrived, never at the price demanded, but after a heated bargaining to which, in the end, the weavers always meekly yielded. »
72
agricoles avaient été accomplies. Quand arrivait la fin de semaine, la production familiale
hebdomadaire était alors vendue à l’un des négociants cuencanais, lesquels expédiaient
ensuite une grande partie de la production régionale vers Guayaquil, pour l’exportation.
�����*+0%'�/�(�*�-���/*-�����'���'�.�'��������5&-6&��*$072
�
Comme la laine, mais sans doute de façon plus notable, la vente de Panamás permit aux
familles paysannes de Santa Rosa, puis de la paroisse Octavio Cordero Palacios, de couvrir
leurs dépenses domestiques et, dans certains cas, d’acheter du petit bétail. Notre travail de
terrain nous a permis de réunir plusieurs témoignages sur le déroulement de cette activité
73
artisanale entre la fin des années 1930 et le début des années 1960, parmi lesquels les deux
exemples qui suivent :
« A partir de dix ans, j’ai commencé à faire des chapeaux, comme mes quatre soeurs. Nous les vendions aux négociants, le dimanche, à la foire de Santa Rosa. Nous devions les tresser le soir, après les travaux agricoles. Nous les vendions 1 sucre [0,2 dollar]. »
Segovia, 80 ans, El Rocío.
« J’ai commencé à faire des chapeaux à l’âge de sept ans. Je pouvais en tisser jusqu’à deux par jour. Je gagnais grâce à cela entre 60 et 70 sucres[entre 3,5 et 4 dollars] par mois, et cela me permettait d’acheter du sucre et du sel. A cette époque [1950-1960], nous pouvions payer les commerçants à chaque fin de mois. »
Rosa, 62 ans, La Dolorosa.
Il est peu probable cependant que la vente de Panamás ait pu à un moment ou à un autre
servir à l’achat de terre, la faiblesse des revenus limitant tout processus de capitalisation et la
priorité des groupes paysans, comme nous le soulignions plus haut, étant de couvrir certaines
dépenses alimentaires. Cependant, d’autres opportunités économiques se présentèrent et
favorisèrent la mobilité des hommes, faisant une nouvelle fois évoluer les systèmes d’activités
familiaux dans la paroisse Octavio Cordero Palacios.
$%8%'��������������������"� ��9��
�
Après les cycles du cacao, du riz et du café, qui conduisirent à l’émergence du port de
Guayaquil et d’un grand nombre de petits centres urbains sur la costa durant la première
moitié du XXe siècle (Deler, 1981), l’Equateur connut à partir de 1940 un nouveau boom
économique avec l’essor des exportations de bananes. Alors qu’en Amérique centrale, le
développement de maladies dans les bananeraies engendra une chute de la production, les
firmes nord-américaines décidèrent de délocaliser leurs capitaux vers l’Equateur, où
rapidement, « les régions andines, dans le cadre de la mise en place d’un système économique
national, ne manquèrent pas d’être touchées par les effets du développement des structures
productives exportatrices dans la région littorale » (Deler, 1981 : 146).
74
Dans ce nouveau contexte économique, les paysans de la sierra virent en effet la possibilité
d’augmenter leurs revenus, en migrant ponctuellement vers les grandes plantations côtières,
où ils purent trouver du travail pendant des années. A partir de la décennie 1940, s’établirent
ainsi des réseaux migratoires entre les localités rurales les plus reculées des Andes et les zones
les plus dynamiques de l’économie nationale situées dans les provinces d’El Oro et du Guayas
en particulier. Ces migrations, entre la sierra et la costa, donnèrent une nouvelle dimension à
« la tradition ancienne du déplacement des populations entre les hautes terres andines et les
zones littorales » (Deler, 1981 : 139), en place depuis le début de la période coloniale et les
itinéraires muletiers entre Quito et Guayaquil, mais aussi entre Cuenca et Guayaquil, comme
l’indiqua J. Poloni-Simard (2000). Si ce furent en premier lieu les bananeraies qui attirèrent le
plus d’ouvriers agricoles, au fil du temps, la fréquentation régulière de la région côtière permit
aux paysans andins de trouver du travail dans des exploitations cacaoyères, dans les rizières et
plus tard, à partir des années 1980, dans les bassins de production de crevettes.
Dans la paroisse Octavio Cordero Palacios, cette pratique fut rapidement généralisée chez les
hommes en âge de travailler. Pour les chefs de famille, il fallait prioritairement trouver des
revenus qui permettaient de couvrir les dépenses domestiques. Pour les célibataires ou les
jeunes mariés, il s’agissait de gagner en autonomie et de se constituer un petit capital pour
acheter plus tard un peu de terre. Les migrations avaient lieu en dehors des pics de travail
agricole, qui correspondaient aux périodes de semis et de récolte, car les emplois extérieurs ne
devaient pas mettre en péril la production locale. Les travailleurs partaient alors trois ou
quatre mois, dans le Guayas ou parfois dans le Cañar18, et revenaient ensuite avec leurs
économies, ce qui fit évoluer les pratiques alimentaires locales, comme nous l’expliqua
Octavio, un paysan de 55 ans qui fréquenta Guayaquil pendant plusieurs années : « à cette
époque, les gens ont commencé à manger autre chose que du maïs. Avec l’argent qu’ils
gagnaient en travaillant sur la côte, ils achetaient beaucoup de riz. » Ce dernier nous décrivit
aussi les années 1960-1970 comme une période de transformation des codes vestimentaires,
du fait de la plus grande fréquentation du milieu urbain par les hommes de la localité, comme
nous le dirent avant lui plusieurs paysans de Juncal qui migrèrent eux aussi sur la côte durant
leur jeunesse.
18 La partie occidentale de cette province se trouve sur le piémont de la cordillère des Andes, là où depuis plusieurs décennies on cultive de la banane et du cacao.
75
Comme pour la filière Panamá, nous avons pu réunir un grand nombre de témoignages sur les
migrations côtières entre 1950 et la fin des années 1990, certains nous indiquant même que la
mobilité concernait aussi les jeunes garçons :
« Je suis allé sur la côte pour la première fois à l’âge de huit ans. Mon père était invalide donc ma mère, mes sœurs et moi devions travailler. Nous faisions tous des chapeaux. Mais moi, j’allais aussi à Naranjal dans les plantations de cacao et de café. Nous étions payés au rendement [au nombre de caisses remplies à la fin de la journée]. Le meilleur ouvrier pouvait gagner 75 sucres [3,4 dollars] par jour [à la fin des années 1960]. »
Juan Manuel, 61 ans, El Cisne.
« Dans les années 1960, j’aillais à Naranjal [province du Cañar – cf. Carte n°10] pour travailler dans les bananeraies et j’étais payé à la tâche. Je migrais pour que ma famille survive. Entre 1969 et 1981, je travaillais dans une exploitation de canne à sucre à La Troncal [province du Cañar]. Sur la fin je gagnais 800 sucres [40 dollars] par mois. »
Angel, 61 ans, Santa Marianita.
« A l’âge de dix ans, je suis parti travailler à La Troncal, pour travailler dans une bananeraie. J’’y suis retourné pendant huit ans, environ un tiers de l’année. Puis pendant trois ans, j’ai travaillé pour l’entreprise AZTRA, qui produisait de la canne à sucre. Tout l’argent servait à nourrir ma famille. Moi, je n’ai pas acheté de terre avec. »
Julio, 56 ans, El Cisne.
« A partir de douze ans, je migrais régulièrement un ou deux mois pour aller travailler dans de grandes exploitations de la côte. Là-bas, il y avait de la banane et du cacao. J’allais travailler dans le Guayas avec mon père. Au début je gagnais 500 sucres par mois [20 dollars], mais au fil des années, en grandissant, je gagnais plus. Il y a dix-sept ans, juste avant de me marier, je suis allé travailler à Machala [province d’El Oro] et j’ai gagné 400 000 sucres en un mois [360 dollars]. Ce fut un bon salaire. »
Delfín, 42 ans, Azhapud.
Les migrations sur la côte étaient bien entendu organisées en fonction des informations
diffusées : certains pouvaient indiquer à leurs frères et à leurs amis que dans leurs zones de
travail, on engageait des ouvriers agricoles ou des transporteurs. C’est pourquoi la plupart des
paysans de la paroisse Octavio Cordero Palacios se sont rendus dans les mêmes localités des
76
années durant (cf. Annexe n° 7), entretenant de fait un réseau circulatoire interrégional. Déjà,
nous avions pu faire la même observation à Juncal, où les paysans, au moment de trouver des
emplois temporaires sur la côte, pouvaient compter sur ceux déjà présents depuis plusieurs
jours pour leur indiquer chez quels patrons trouver un emploi. Selon ce même principe, ceux
qui parvenaient d’une saison à l’autre à garder leur place dans la même exploitation pouvaient
introduire leurs proches.
Beaucoup d’hommes choisirent néanmoins de rester plus durablement sur la côte, ou parfois
en Amazonie, pour profiter de l’offre d’emplois plus stables. Plusieurs d’entre eux purent
ainsi acheter un peu de terre, ou du bétail, immédiatement après leur retour. Ce fut par
exemple le cas de Salvador, un paysan de 63 ans du secteur d’El Cisne : « je suis allé sur la
côte pour la première fois à l’âge de dix ans, dans les provinces d’ El Oro et du Guayas.
J’occupais des emplois temporaires. Je passais neuf mois là-bas et je revenais passer trois ou
quatre mois ici. Au début [vers 1955], nous étions payés 3 sucres [0,2 dollar] par jour et puis
plus tard 6 sucres par jour. J’ai fait cela jusqu’à mon mariage en 1970. Puis, je suis parti
travailler pendant deux ans dans l’oriente, dans les nouvelles exploitations pétrolières [mises
en service à la toute fin des années 1960]. Quand je suis revenu en 1972, j’ai pu acheter un
terrain d’un hectare pour 75 000 sucres [2 800 dollars]. »
En tout, nous avons reconstitué 18 parcours migratoires interrégionaux à partir desquels nous
avons pu cartographier les déplacements allers-retours des paysans de la paroisse Octavio
Cordero Palacios entre 1950 et 2008 (cf. Carte n° 10). Si pour une minorité d’entre eux,
comme ce fut le cas pour Salvador, les migrations saisonnières furent un moyen de capitaliser
avant d’acquérir un bien foncier, d’autres décidèrent de renoncer définitivement à la vie de
paysan, en acceptant le premier emploi venu, comme nous le dit Octavio à propos de ses deux
frères : « ils vivent depuis « toujours » dans les bidonvilles de Guayaquil. Ils sont ouvriers
agricoles à Naranjito. Nous nous voyons tous les cinq ou six ans. » C’est ainsi, comme le
soulignèrent J-P. Deler (1981) et D. Delaunay (1991), que les migrations des populations
andines au cours de la période 1950-1990 participèrent à l’accélération des transferts
démographiques interrégionaux au profit des villes de la costa, et en particulier celles du
Guayas et d’El Oro19.
19 Au cours de cette période, la seule ville de Guayaquil vit sa population officiellement recensée passer de 258 966 à 1 508 444 habitants (INEC, 1950 et 1990).
77
�����*+$2%'�-3�(����/*-�*�����(�/*�'�-��$,��:-�*-
��'����/�--�/���)�/�/����/��'���/-�*���$072��22,
�
78
Ainsi, pour beaucoup de paysans minifundistes de la paroisse Octavio Cordero Palacios, les
migrations sur la côte furent déterminantes pour l’obtention de revenus. En revanche, pour les
familles de Suranpallti, une toute autre activité leur permit de s’enrichir durant de longues
années.
$%;%'���������������<�������
En 1928, l’arrivée du chemin de fer20 à El Tambo, dans la province du Cañar, sonna le glas
des activités commerciales des familles de Suranpallti. Le perçage d’une voie carrossable de
Cuenca jusqu’à la petite station située désormais à seulement quelques heures de route eut
pour effet de court-circuiter le réseau commercial que les Aguilar et bien d’autres avaient
entretenu depuis plusieurs décennies, en se rendant régulièrement à Riobamba à dos de mules.
Il fallut trouver alors une alternative pour s’assurer de revenus importants, notamment pour
payer les peones dont les salaires avaient augmenté au fil des années21. C’est à ce moment que
commença la contrebande d’alcool, comme nous le compta Teófilo : « en allant très souvent à
Riobamba, mes oncles apprirent à connaître toutes les routes commerciales de la sierra. A
San Antonio, dans le Cañar, il y avait là-bas des hommes qui revendaient de l’alcool acheté
dans les plantations de la côte22. Mes oncles, et plus tard moi-même, allions acheter l’alcool
dans le Cañar, puis nous le transportions jusqu’ici. »
Le témoignage de Teófilo fut à ce point précis, qu’il nous raconta les détails de la contrebande
dans les années 1940 et 1950 : « Au début, il fallait faire attention aux contrôles, donc nous y
allions avec seulement quelques mules, chacun la sienne. Mais quand je me suis marié, j’ai
commencé à y aller avec deux, trois, puis dix mules, et là, je gagnais vraiment beaucoup
d’argent ! Chaque mule me rapportait entre 100 et 120 sucres [entre 5,5 et 6,5 dollars en
1950] ! Nous vendions cela surtout aux paysans ! Quelle folie ! Ils achetaient cela en grandes
quantités, pour les mingas et pour les travaux agricoles. Quand les tonneaux étaient vides, je
repartais : 4 jours pour y aller et 4 jours pour revenir. Au fil des années, le retour devint plus
20 En 1873, le président G. García Moreno (1869-1875) lança la construction du chemin de fer en Equateur, un projet qui dura plusieurs décennies et qui participa grandement à la structuration du territoire national (Deler, 1981).
21 D’un real au début du XXe siècle, ils passèrent à deux sucres par jour à la fin des années 1950, d’après Teófilo et Segovia.
22 Cela correspond à plusieurs témoignages que nous avons recueillis à Juncal, où nous avions rencontré des paysans qui faisaient de la contrebande d’alcool dans les années 1950.
79
long car arrivés dans le Cañar, nous devions attendre parfois plusieurs jours parce que des
acheteurs de Checa, Chinquitad et Deleg venaient eux aussi s’approvisionner. »
Plusieurs paysans de Chaquillcay firent également de la contrebande d’alcool, à l’image de
Manuel C., 59 ans, qui nous confirma que plus jeune, il allait lui aussi jusque dans le Cañar,
mais avec une ou deux mules seulement, « tandis qu’à Suranpallti, chaque jour, il y en avait
50 ou 60 qui appartenaient aux Aguilar et qui revenaient approvisionner la zone ». Ils ne
furent cependant pas très nombreux, et il est logique que cette activité n’ait concerné que
modérément les petits exploitants de la paroisse Octavio Cordero Palacios, ces derniers ne
disposant que de peu de terre et de faibles ressources fourragères pour se consacrer à la fois à
l’élevage bovin, pour la production de lait, et à l’élevage de mules. Ainsi, la contrebande
d’alcool permit aux familles de Suranpallti de renforcer leur prestige social, avant que certains
de leurs membres ne décident de partir travailler à l’étranger.
%'����<"���� ����������������������� �
Aux Etats-Unis, le Bureau du Recensement National (USCB) indiquait la présence de
244 Equatoriens dans le pays pour la période 1930-1939. Même s’il est exagéré de parler de
pionniers23, ce chiffre, aussi marginal soit-il, montre que l’émigration équatorienne est loin
d’être récente, comme l’ont d’ailleurs montré un certain nombre d’études (Borrero, 1995 ;
Carpio, 1992). Nous proposons donc de revenir sur ses origines, avant de nous intéresser plus
précisément à la mise en place du réseau migratoire dans la paroisse Octavio Cordero
Palacios, en restituant pour cela plusieurs fragments de nos entretiens, comme nous l’avons
fait depuis le début de notre travail.
Dès notre arrivée sur le terrain, nous avons appris que nous trouverions les plus anciens
migrants dans le secteur d’El Rocío. Peu de temps après, nous nous y sommes donc rendu, et
nous avons commencé par interroger des personnes au hasard, puis, à force de visites
répétées, nous sommes parvenus à rencontrer plusieurs anciens migrants. Ces derniers
acceptèrent le plus souvent, et non sans fierté, de nous conter leur histoire en nous recevant
directement chez eux. Ainsi, nous pûmes remonter aux racines de l’émigration internationale
23 Il ne devait pas s’agir d’ouvriers, comme c’est majoritairement le cas aujourd’hui, mais plus certainement de diplomates, de commerçants et peut-être d’étudiants.
80
des paysans de la paroisse Octavio Cordero Palacios et comprendre la transformation
ancienne des systèmes d’activités familiaux.
%$%'�������� �!� �������������� ���� ��
S’il faut situer le véritable début de l’émigration équatorienne, il semble juste de choisir la
décennie 1950, au moment de la crise du chapeau Panamá, comme le font d’ailleurs la plupart
des auteurs ayant abordé cette question (Gratton, 2006 ; Jokish et Kyle, 2006). La chute des
exportations de cette production artisanale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale24
plongea de nombreux paysans originaires des provinces andines du Cañar et de l’Azuay dans
une situation économique particulièrement délicate. Alors qu’en 1946, les exportations de
chapeaux représentaient 22,8% des revenus de l’Equateur, celles-ci n’en représentaient plus
qu’1,6% en 1954 (Espinoza et Achig, 1981 : 148). Dans ce contexte, les tisserands de la
région australe perdirent une part très importante de leur principale rentrée d’argent, ce qui
contraignit la plupart d’entre eux à quitter leur campagne, soit pour les pôles urbains
nationaux, Guayaquil en particulier, soit pour l’étranger.
Il existe néanmoins très peu d’informations sur la mise en réseau de cette première vague
d’émigration. Comme dans l’Atlas marocain, où se furent tout d’abord les éleveurs bovins les
plus importants qui migrèrent vers la France au début des années 1960 (Noin, 1971), il est fort
probable que les négociants cuencanais furent ceux qui partirent en premier, en bénéficiant
par ailleurs de contacts grâce à leurs anciens réseaux d’exportation, avant que les paysans ne
viennent alimenter progressivement les flux à destination des Etats-Unis pour donner à cette
dynamique pionnière une origine majoritairement rurale. Ainsi, le nombre de résidants
équatoriens aux Etats-Unis passa de 8 574 pour la période 1950-1959, à 34 107 pour la
période 1960-1969 (USCB). Certains choisirent cependant le Canada, où l’obtention d’un visa
de travail était plus facile, tandis que d’autres partirent travailler au Venezuela alors en pleine
période de prospérité économique grâce à sa rente pétrolière, comme nous en verrons des
exemples par la suite.
Il faut toutefois préciser que la crise du chapeau Panamá ne fut pas le seul élément
déterminant de ces nombreux départs. A la fin des années 1950, la région cuencanaise entra
24 Après avoir eu beaucoup de succès pendant plusieurs décennies, le Panamá se démoda dans les grandes villes européennes et nord-américaines.
81
dans un processus global de restructuration de son économie, avec la multiplication
d’établissements industriels qui vinrent concurrencer les unités artisanales (Pozo, 2010). Un
certain nombre de professions disparurent ainsi, comme celle de tuilier par exemple, ce qui
entraîna la baisse des revenus extra agricoles de nombreuses familles paysannes, lesquelles ne
virent comme autre solution que de quitter la région, comme le firent bon nombre d’anciens
tisseurs de chapeaux. En ce qui concerne plus particulièrement la paroisse Octavio Cordero
Palacios, le schéma fut identique, à la différence près que la crise de la filière Panamá ne fut
pas le principal facteur de l’exode des paysans.
%%'�������������������� ���������/��� ����������� �����
�
C’est à la même époque, ou pour être précis quelques années plus tard, que les hommes de
Suranpallti décidèrent de partir, lorsque la contrebande d’alcool prit fin et qu’ils perdirent
ainsi leur principale rentrée d’argent, comme nous le raconta Manuel Cruz : « ce qui nous
faisait surtout vivre, c’était la contrebande d’alcool. Moi-même, depuis mes douze ans je
partais avec huit mules qui appartenaient à mon père, et cela rapportait beaucoup d’argent.
Peu à peu, la contrebande est devenue difficile et risquée. Il y avait chaque fois plus de
gardes pour nous arrêter et nous prendre nos mules qui étaient ensuite vendues aux enchères
à Cuenca. Nos frères ou nos cousins qui n’étaient pas connus de la police allaient les
racheter pour que nous puissions continuer le commerce. Nous vendions la boisson à Biblián,
Deleg, Solano, Sidcay… et il en manquait toujours ! Mais avec Velasco Ibarra [Président de
la République d’Equateur25] et l’influence qu’avait sur lui l’Eglise, il y eut de plus en plus de
répression. Les gardes ont commencé à abuser de leur pouvoir. Ils faisaient des descentes et
confisquaient les mules ainsi que l’alcool que nous transportions. »
Comme trente ans auparavant, lorsque le réseau commercial depuis Riobamba disparut, les
paysans de Suranpallti cherchèrent une alternative à la fin de leur négoce. Les migrations sur
la côte n’étant pas aussi rentables, certains parmi eux décidèrent donc de partir à l’étranger,
comme le firent les anciens contrebandiers du Val de Nure en Italie, qui s’en allèrent travailler
en banlieue parisienne dès la fin du XIXe siècle après que leur activité prit fin (Martini, 1995).
Dans les années 1960, les formalités administratives ne constituaient pas un frein, et le voyage
25 J.M. Velasco Ibarra fut président de la République d’Equateur à cinq reprises entre 1934 et 1972.
82
pouvait être payé par les économies faites grâce à la vente d’alcool. Ils furent donc plusieurs à
prendre des initiatives personnelles, comme l’indiquent les deux témoignages qui suivent :
« Quand la contrebande s’est arrêtée, nous avons cherché à émigrer. Mais comment ? Je m’étais mis à travailler sur la côte depuis quelques temps. J’achetais du charbon chez des grossistes et je le vendais ensuite au détail dans la rue. A Guayaquil, j’ai rencontré un négociant américain qui m’a renseigné sur les Etats-Unis et sur ce qu’il fallait faire pour émigrer. J’en ai parlé à deux de mes amis de Suranpallti et en 1965, nous sommes tous partis, avec un visa de tourisme de trois mois. L’argent de la contrebande m’a permis d’acheter le billet d’avion pour Miami à 12 000 sucres [650 dollars]. Et de là-bas, nous sommes allés à New York. »
Isaías, 64 ans, El Rocío.
« Avec la disparition de la contrebande d’alcool, il fallut que nous trouvions autre chose. En 1966, je me souviens être allé avec Ricardo [un ami] faire une demande de visa pour les Etats-Unis à Guayaquil. C’est moi qui en avait eu l’idée et c’est lui qui en a eu un ! Je suis parti un an plus tard au Canada, car à cette époque il n’y avait pas besoin de visa pour aller là-bas. Cela m’a coûté 11 000 sucres [560 dollars]. Je suis arrivé à Toronto, sans connaître personne. Je ne comprenais rien ! J’avais de quoi vivre trois mois, il fallait vite trouver un travail. »
Manuel Cruz, 69 ans, El Rocío.
Si le réseau migratoire de la paroisse Octavio Cordero Palacios trouve son origine à
Suranpallti, c’est bien parce que les paysans de ce secteur eurent la capacité économique de
partir en premier, mais sans doute aussi parce qu’ils furent influencés par la dynamique
migratoire en marche à Checa et Deleg, où la crise du Panamá avait affecté la population
depuis plusieurs années déjà (Carpio, 1992). Il n’est pas impossible d’ailleurs que certains
hommes de Suranpallti aient bénéficié des réseaux migratoires de ces localités voisines, même
si nous n’avons jamais pu en rencontrer au cours de notre travail de terrain.
Ce n’est que quelques années plus tard que les paysans du reste de la paroisse Octavio
Cordero Palacios commencèrent à émigrer. Les liens de solidarité, d’abord familiaux,
s’étendirent ensuite à une plus grande partie de la population. Ainsi, les premiers migrants de
Suranpallti financèrent d’abord les départs de leurs frères, puis de leurs cousins, avant que
leurs familles ne commencent à prêter des sommes d’argent importantes à d’autres personnes
dignes de confiance. C’est donc sur plusieurs années que s’établit le réseau migratoire local,
83
fonctionnant sur la complémentarité entre les migrants les plus anciens, qui jouaient parfois le
rôle de prêteurs, ou de chulqueros pour employer l’expression équatorienne, et les néo-
migrants, qui s’engageaient à rembourser leur dette dès l’obtention d’un travail à l’étranger.
Progressivement, la généralisation de l’émigration internationale des paysans allait provoquer
de profonds changements dans la paroisse Octavio Cordero Palacios, comme nous pourrons le
constater par la suite.
84
�����������
Depuis plus d’un siècle, les paysans de la paroisse Octavio Cordero Palacios n’ont eu de cesse
de s’ouvrir vers l’extérieur. Leur adaptation permanente aux changements structurels de
l’économie nationale fut l’une de leur force, ce qui leur permit dans une certaine mesure de
pallier les limites de leurs activités agricoles. Ainsi, la pluriactivité, elle-même conditionnée
par une intense mobilité, constitue depuis longtemps l’une de leurs caractéristiques majeures,
comme c’est le cas des groupes paysans de la région de Kroumirie, dans l’Atlas tunisien, où
les jeunes hommes, au cours des dernières décennies, ont continuellement migré en ville pour
participer à la survie de leurs familles (Sandron, 1997).
Pour autant, cette recherche permanente de revenus extérieurs n’a pas empêché l’avancée de
la frontière agricole dans la paroisse Octavio Cordero Palacios, l’augmentation de la densité
ayant conduit, durant toute la première partie du XXe siècle, à la colonisation des terres
d’altitude. Au fil du temps, cette dynamique favorisa le développement du minifundio qui
entraîna par conséquent la réduction progressive des terres communales. En parallèle, la
formation de propriétés plus importantes dans le secteur de Suranpallti produisit un contraste
territorial très net à l’échelle de la localité. Si les disparités socioéconomiques devinrent de
plus en plus évidentes, elles s’illustrèrent par le fait que les individus les plus riches s’en
allèrent en premiers, avant que les exploitants minifundistes n’empruntent à leur tour les
chemins de l’émigration internationale.
Sous quelle forme la construction du territoire de la paroisse Octavio Cordero Palacios, qui
s’était faite jusque-là au rythme d’appropriations foncières parfois violentes, allait-elle se
poursuivre dans le contexte migratoire ? Comment le système agraire et les systèmes
d’activités allaient-il évoluer au fil des décennies ?
86
� �!�����! �
Si l’on s’interroge sur les effets de l’émigration en milieu rural, plusieurs hypothèses peuvent
être faites. En premier lieu, elle pourrait entraîner un abandon progressif de l’agriculture : ce
phénomène a déjà été observé en Equateur, dans la province d’Imbabura, où F. López a
montré que les migrations paysannes vers la ville d’Ibarra entraînaient à moyen terme une
réduction des superficies cultivées (López, 2003). De même, il pourrait être supposé que des
liens se créent entre les groupes d’émigrés et leurs localités d’origine, comme dans la région
de Sétif, en Algérie, où M. Côte a observé que la mise en commun de fonds destinés à la
construction d’un réseau d’irrigation avait une influence considérable sur le développement de
l’agriculture locale (Côte, 1996).
La troisième hypothèse serait que la migration conduit à une diversification des activités
agricoles. Nous en avons nous-mêmes vécu l’expérience dans la province du Cañar, où le
développement de la production de fraise était le symbole d’une agriculture en voie de
mutation. Néanmoins, nous avions mis en évidence les difficultés d’une telle reconversion,
trop ambitieuse pour des familles paysannes amputées d’une grande partie de leur main-
d’œuvre et surtout, très éloignées des grands centres urbains nationaux.
Comme le précisait J. Lombard dans son analyse des relations villes-campagnes au Sénégal et
au Mali, « le regard doit [ainsi] tenir compte de la place des villes et des métropoles dans les
organisations spatiales, qu’elles soient régionales, nationales ou internationales »
(Lombard : 1999 : 132). Dans cet esprit, notre étude ne pourrait traiter des seuls effets de
l’émigration paysanne dans la paroisse Octavio Cordero Palacios, et négliger par ailleurs les
influences de Cuenca qui, nous l’avons vu, exerce depuis sa fondation une influence
considérable sur les campagnes azuayennes. En d’autres termes, il ne s’agit pas uniquement
de nous interroger sur les mutations de l’agriculture familiale dans le contexte migratoire,
mais plutôt de déterminer dans quelle mesure évoluent les logiques productives sous les
influences croisées de l’émigration et de la proximité urbaine.
87
Dès lors, plusieurs questions serviront à jalonner notre réflexion à venir : comment les
familles paysannes parviennent-elles à compenser le manque de main-d’œuvre ? Quelles
orientations culturales suivent-elles ? Privilégient-elles les cultures vivrières dites
traditionnelles, comme le maïs et les tubercules, ou font-elles le choix de moderniser leurs
systèmes de production, en investissant par exemple l’argent de la migration, pour développer
des cultures commerciales destinées au marché urbain régional ?
Pour le voir, nous analyserons tout d’abord les effets de la diminution de la main-d’œuvre sur
les usages du sol dans la paroisse Octavio Cordero Palacios (Chapitre 3), avant de porter notre
attention sur la récente intégration marchande de petits producteurs maraîchers aux réseaux
d’approvisionnement de la citée cuencanaise (Chapitre 4).
88
��������
�� ����� ����� ����������� �
���� ����������� !� �������������� �������������������
« La nuit s’étendait sur les vallées. La lune était une chose trouble dans le firmament. Seul, le perpétuel coassement des grenouilles troublait la grande paix de la campagne qui semblait sommeiller, épuisée par une longue journée de travail. »
Jorge Icaza, Cholos.
89
Au cours des dernières décennies, l’émigration internationale des paysans de la paroisse
Octavio Cordero Palacios a progressivement pris de l’importance. Dans quelle mesure les
logiques de travail ont-elles alors évolué dans le contexte migratoire ? Qu’en est-il
actuellement des systèmes de productions familiaux ? L’usage du sol est-il resté le même ?
Pour l’évaluer, nous proposons tout d’abord de décrire la mise en place des réseaux
migratoires à l’échelle locale, en décrivant pour cela les parcours de plusieurs anciens
migrants, avant de faire le point sur l’évolution démographique de la paroisse au cours des
quarante dernières années, en utilisant pour cela les données statistiques de l’INEC. Dans un
second temps, nous nous intéresserons plus spécifiquement aux pratiques agricoles du
moment. Nous tâcherons alors d’expliquer l’adaptation des systèmes de production familiaux
au manque de main-d’œuvre global, tout en resituant notre étude dans un contexte plus large,
celui des dynamiques agraires ayant cours dans la sierra équatorienne.
"#$������������������ ����%������&��
L’émigration internationale des paysans de la paroisse Octavio Cordero Palacios dure depuis
plus de quarante ans maintenant. Afin de montrer quelles furent les évolutions de la localité
au cours des dernières décennies, nous proposons tout d’abord de retracer le parcours de
plusieurs anciens migrants, en rapportant les témoignages recueillis pendant nos entretiens,
avant de proposer une analyse de la baisse de la main-d’œuvre disponible à l’échelle des
38 exploitations que nous avons étudiées.
"#"# �� � �� � �� � ��� �� �% ���� ����� ' � �%�%�� � ����� ��
!%�����������( ����
Avec 143 habitants/km² en 1982, la paroisse Octavio Cordero Palacios se situait parmi les
régions d’Equateur où les densités de population étaient les plus fortes (Portais, 1990). Malgré
les migrations saisonnières sur la côte et les activités artisanales, les conditions de vie
paysannes restaient difficiles, d’autant que la taille moyenne des plus petites exploitations
avait dû baisser au cours des dernières décennies, comme dans l’ensemble de la sierra
(Fauroux, 1980). Ainsi, pour la seule province de l’Azuay, la taille moyenne des exploitations
90
de moins de 5 hectares était passée de 1,57 à 1,24 hectare, entre 1954 et 1974 (INEC,
Recensement Agraires I et II).
Pour de nombreux paysans, le choix de l’émigration internationale s’imposa de fait, mais pour
partir, il fallait pouvoir compter sur l’aide de parents déjà installés à l’étranger. Au cours de
notre travail de terrain, plusieurs d’entre eux nous ont décris les conditions de leur départ,
entre l’urgence de quitter une situation précaire et les réseaux dont ils ont bénéficié. Quand ils
nous racontèrent leurs expériences, la plupart insistèrent sur la dureté de la vie quotidienne
dans les villes d’Amérique du nord, organisée autour des différents emplois cumulés et des
sacrifices consentis pour épargner et toujours envoyer de l’argent à leurs familles, comme
nous le montrent ces trois exemples :
« Dans les années 1950 et 1960, je vendais du charbon. J’allais en acheter en gros à Guayaquil, puis je le vendais au détail ici. Mais avec le temps le commerce n’était plus aussi rentable et l’agriculture payait encore moins. Mes cousins qui travaillaient aux Etats-Unis me disaient de venir. Ils me racontaient qu’il y avait du travail pour moi et même pour tous les hommes d’ici. Alors en 1973, j’ai vendu un petit terrain dont j’avais hérité de mes parents et j’ai aussi mis une partie des mes économies dans le voyage. J’ai obtenu un visa de tourisme pour le Mexique, puis je suis passé par Tijuana avec un groupe de 20 autres clandestins parmi lesquels il y avait des Equatoriens et des Péruviens. Je suis arrivé à Los Angeles, puis j’ai rejoint New York en partant d’un petit aérodrome. Mes cousins m’attendaient. Nous vivions tous ensemble. Ce sont eux qui m’ont aidé à trouver un emploi dans une petite fabrique de meubles. Je gagnais 170 dollars par semaine. »
Miguel, 70 ans, Santa Rosa.
« Je suis parti la première fois pour améliorer la vie de ma famille et pour payer une dette. En 1975, après avoir travaillé quelques années sur la côte, j’avais acheté un hectare à 200 000 sucres [7 900 dollars]. Je payais par échéances, tous les trois à six mois. En 1984, il me manquait la moitié à payer. Alors j’ai décidé d’émigrer car je ne pouvais plus passer mon temps à travailler pour rembourser la dette. Ma famille devait aussi manger. J’ai demandé à mes frères, qui avaient émigré dans les années 1970, de me prêter 400 000 sucres [4 000 dollars] et je me suis retrouvé à New York. J’ai travaillé dans un restaurant, d’abord comme commis, puis comme chef, pour 10 dollars de l’heure. Pendant trois ans, j’ai pu envoyer 200 dollars par mois. »
Juan, 58 ans, La Nube.
91
« Après m’être marié en 1981, je n’avais presque rien. J’avais hérité d’un lopin de terre qui ne permettait pas de vivre dignement. Je travaillais aussi dans la construction, mais même avec 12 sucres [0,25 dollar] par jour, nous avions du mal à nous en sortir. Alors je suis parti en 1983, à vingt ans. Cela m’a coûté 300 000 sucres [3 600 dollars], entre le billet pour aller jusqu’au Mexique et le coyote [passeur] pour franchir la frontière. Des parents qui vivaient déjà à New York m’ont prêté l’argent et je les ai remboursés petit à petit. J’ai trouvé du travail dans une usine textile, au début comme simple ouvrier, puis comme contremaître. Je travaillais soixante-dix heures par semaine pour un salaire de 300 dollars hebdomadaires. J’envoyais presque la moitié à ma femme. Moi je travaillais du lundi au samedi. Je n’avais pas le temps de dépenser. Le dimanche, je me reposais et je lavais mes vêtements. Et après, une autre semaine commençait. »
Luis, 47 ans, La Dolorosa.
��)�)*������+"#�!������!��,,�-�.�,��)$$-/�-���0-��)���//���/�12)�3�/45""
Roosevelt Avenue, dans le quartier du Queens à New York. De nombreux petits restaurants témoignent de la présence déjà ancienne de la communauté équatorienne dans la « Grande Pomme ». Source : M. Chenet (cliché personnel).
Pour ce qui est des 12 anciens migrants avec lesquels nous nous sommes entretenus, il y eut
plusieurs périodes de migration entrecoupées de phases plus ou moins longues de retour dans
la localité (cf. Tableau n°1). Bien qu’il ne s’agisse que de quelques cas particuliers, nous
92
avons pris la peine de dresser le bilan des itinéraires migratoires personnels, pour mettre en
lumière un fait particulièrement intéressant :
��6,��-/+"#����)-�.$�*���)���.�/���/���)/�-7��"4��2.�/.
��,����)�..�)���8�)�)����)��,���).�/���"9:;��455;
Nom Age
en 2010
Age au premier
départLieux d’émigration
Périodes de
migration Total
Angel 61 ans 34 ans Chicago
1983 5 mois
12,5 ans 1985-1991 6 ans
Chicago-Minneapolis 1992-1998 6 ans
Daniel L. 56 ans 22 ans New York-Chicago 1976-1979 3 ans
16 ans Chicago 1985-1998 13 ans
Isaías 64 ans 19 ans
New York 1965-1967 2 ans
3 ans Chicago 1986-1987 5 mois
Chicago 1987-1988 10 mois
Juan 58 ans 32 ans New York 1984-1987 3 ans
9 ans Minneapolis 1994-2000 6 ans
Julio 56 ans 31 ans Chicago 1985-1988 3 ans
15 ans 1989-2001 12 ans
Luis 47 ans 20 ans New York 1983-1993 10 ans
Luz 51 ans 32 ans New York 1991-2000 9 ans
Manuel Cruz 69 ans 26 ans Toronto
1967-1971 4 ans
10,5 ans 1972-1977 5 ans
1988-1989 16 mois
Manuel Le. 44 ans 22 ans New York 1988-2005 17 ans
Miguel 70 ans 33 ans New York 1973-1976 3 ans
Salvador 63 ans 29 ans
New York 1976-1977 1 an
12 ans
Venezuela 1982-1986 4 ans
Chicago 1986-1989 3 ans
Minneapolis 1991-1994 3 ans
Madrid-Tolède-Murcie 1998-1999 8 mois
Milan 1999 1 mois
Paris 1999 1 mois
Vicente 60 ans 31 ans New York 1981-1985 4 ans Source : entretiens réalisés entre juillet 2008 et août 2009.
93
Pour l’ensemble des cas étudiés, nous retrouvons régulièrement les mêmes espaces d’arrivée :
New York et Chicago sont en effet les zones d’installation les plus fréquentes chez les
migrants de la paroisse Octavio Cordero Palacios. Cette caractéristique est la preuve de
l’existence à l’échelle de cette localité, comme dans certaines régions rurales du Mexique, de
réseaux migratoires structurés et entretenus depuis de nombreuses années par des « canaux
d’entraide directs et indirects » (Faret, 2003 : 190), facilitant les prêts d’argent et la circulation
d’informations dans le cadre familial ou extrafamilial. Pour le voir avec plus de clarté, il
aurait été plus intéressant encore de réaliser cette analyse avec les émigrés actuels, pour
élaborer la carte de leur dispersion internationale. Mais bien souvent, et cela constitue
malheureusement l’une des limites de nos entretiens, les personnes vivant seules depuis
plusieurs années furent incapables de nous dire où se trouvaient leurs enfants et parfois même
leurs conjoints. C’est pourquoi nous nous sommes souvent contentés de réponses assez
vagues sur leurs localisations. Malgré cela, l’étude préalable des réseaux migratoires a été
importante pour comprendre les transformations plus profondes de notre zone d’étude, les
premières d’entres elles étant d’ordre démographique.
"#4#,����� �� !�< ����� !%=� ������� � ���������� ����� �����
Si les habitants de Suranpallti furent les premiers à quitter leurs exploitations dès le milieu des
années 1960, ils furent donc bientôt imités par de nombreux paysans des autres secteurs de la
paroisse Octavio Cordero Palacios. Toutefois, il faut préciser que les effets démographiques
de l’émigration à l’échelle locale ne devinrent importants qu’à partir de la fin des années
1980, comme en témoignent les chiffres du Tableau n° 2 :
��6,��-/+4#�8),-��)/��,��)�-,���)/
��,����)�..�)���8�)�)����)��,���).�/���"9:4��45"5
Année 1962 1974 1982 1990 2001 2010
Nombre d'habitants 3 175 3 274 3 134 2 767 2 178 2 271
Source: INEC, Recensements de la population (1962/2010).
En effet, si la population demeure relativement stable entre 1962 et 1982, il faut y voir les
effets d’une croissance naturelle encore importante, comme en témoigne d’ailleurs
94
l’augmentation sensible de la population en 1974, que nous avions déjà soulignée dans le
Chapitre 1. Ce n’est que par la suite, avec l’absence prolongée des hommes depuis dix ou
vingt ans, et la baisse logique de la natalité, que la population se mit à décliner et qu’elle
connut une baisse globale de 28,5% entre 1982 et 2010.
Il faut cependant remarquer, qu’entre 2001 et 2010, le nombre d’habitants de la paroisse
Octavio Cordero Palacios a augmenté de 4%, une première depuis trente ans. Cette légère
croissance de la population est sans doute la preuve que l’hémorragique démographique
locale s’est atténuée au cours de la dernière décennie, comme à l’échelle nationale, où le
nombre de migrants est passé de 125 106 à 42 399 entre 2003 et 200726, du fait du
raffermissement des politiques migratoires des pays d’accueil, des Etats-Unis et de l’Espagne
en particulier (Gómez, 2004 ; Chacón, 2005; Herrera, 2008). Dans ce contexte, les effets de la
croissance naturelle se sont davantage fait sentir, mais il faut également prendre en
considération les retours qui ont eu lieu ces dernières années, qu’il s’agisse de reconduites à la
frontière, comme il y en eut 29 996 entre 2001 et 2007 à l’échelle nationale
(FLACSO, 2008 : 20), ou simplement de personnes venues se réinstaller dans leur localité
d’origine. Ainsi, lors du dernier recensement national de la population (INEC, 2010),
32 personnes de la paroisse Octavio Cordero Palacios ont déclaré qu’elles habitaient à
l’étranger il y a encore cinq ans. De même, il faut tenir compte des individus qui, après avoir
vécu de longues années sur la côte, sont revenus vivre dans la paroisse Octavio Cordero
Palacios, à l’image de Braulio, un paysan de 37 ans du secteur d’Azhapud, lequel nous
expliquait au cours d’un entretien être revenu en 2008 prendre la tête de l’exploitation
familiale, après avoir passé plus de vingt ans à Guayaquil. Comme lui, ils furent 19, depuis
2005, à quitter le Guayas pour se réinstaller dans l’Azuay, toujours d’après le dernier
recensement (INEC, 2010).
En dehors des variations démographiques intercensitaires, il faut insister sur l’absence
prolongée des migrants, certains d’entre eux ayant passé plus de dix ans à l’étranger entre la
fin des années 1960 et le début des années 1990, comme nous l’avons vu plus haut, et d’autres
étant absents des exploitations depuis plus de quinze ans, comme nous l’avons constaté
lorsque nous arpentions la campagne azuayenne (cf. Annexe n°9). Si l’on s’interroge alors sur
le fonctionnement des exploitations familiales, cet élément n’est pas à négliger. Comme a pu
26 Il s’agit là des données les plus récentes. Pour le détail du solde migratoire en Equateur depuis 1976 : cf. Annexe n° 8.
95
l’écrire A. Quesnel, à propos des migrations rurales au Mexique, « le désengagement de
certains individus de l’organisation de production agricole de l’unité domestique exige un
réajustement immédiat des tâches et, à plus long terme, une redéfinition des rôles à l’intérieur
de celle-ci » (Quesnel, 1997 : 166). C’est dans ce contexte que les femmes, devenues de fait
les véritables chefs d’exploitation, ont joué un grand rôle pour le maintien de l’activité
agricole dans la paroisse Octavio Cordero Palacios entre 1974 et 2010 : au cours de cette
période, elles représentèrent en moyenne 61% de la main-d’œuvre disponible âgée de 10 à 59
ans.
��6,��-/+#�8),-��)/��.�>>����>.>�$�/�/.��$�.�-,�/.����,�..�.�!�*�
��/.,����)�..�)���8�)�)����)��,���).�/���"9?@��45"5
Recensement Sexe 10/19
ans
20/39
ans
40/59
ans Total
Part de la
main-d’œuvre
disponible
(en %)
1974
F 358 517 303 1 178 62
H 275 233 203 711 38
1982
F 313 428 313 1 054 62
H 322 233 214 769 38
1990
F 335 349 317 1 001 60
H 328 158 179 665 40
2001
F 253 246 275 774 64
H 233 147 147 527 36
2010
F 247 305 220 772 56
H 245 236 133 614 44
Source : INEC (Recensements nationaux de la population, 1974/2010).
S’il est alors possible de parler d’une féminisation de la main-d’œuvre agricole dans la
paroisse Octavio Cordero Palacios, il faut toutefois souligner que ce phénomène ne s’est pas
accentué, ou très peu, au fil des dernières décennies. Une observation plus précise des chiffres
96
présentés dans le Tableau n°3 nous renseigne d’ailleurs sur l’érosion de 34,5% des effectifs
féminins depuis 1974. Cela signifie en d’autres termes que les femmes ont de plus en plus
émigré elles aussi, à l’image de ce qui a pu être observé à l’échelle nationale. En effet, depuis
trente ans, le nombre d’Equatoriennes parties travailler aux Etats-Unis ou en Europe a
progressivement augmenté, passant de 12 014 en 1976 à 83 899 en 2000, avant de décliner de
manière presque constante au cours des années 2000 (FLACSO, 2008 ; cf. Annexe n°8).
Il convient cependant de relativiser un tant soit peu la valeur de ces chiffres, car l’émigration
internationale ne doit pas être considérée a priori comme le seul facteur de la baisse
démographique dans la paroisse Octavio Cordero Palacios. Il ne faudrait pas omettre par
exemple, que certains individus ont choisi de quitter la campagne pour s’installer en ville, à
Guayaquil par exemple, comme nous l’avons vu antérieurement, ce qui a bien entendu
participé à la chute de la population locale, bien que certains d’entre eux aient pu revenir ces
dernières années. Au final, l’ensemble de ces mouvements, aux échelles nationale et
internationale, doit nous conduire à préciser les conditions même de reproduction des
populations rurales de la région andine.
"## �� ��( �� ' ��� %����� � !���������� ���� ���� �� ����=��%
�����A������ �
Au-delà même de ses effets sociodémographiques, la pratique migratoire chez les paysans de
la paroisse Octavio Cordero Palacios apparaît en définitive comme leur caractéristique
principale, car si l’on s’attache à faire le cumul des années passées sur la côte et à l’étranger,
nous constatons que plusieurs d’entre eux avaient passé, en 2010, plus de la moitié de leur vie
à l’extérieur de leur localité d’origine (cf. Tableau n°4). La recherche systématique de revenus
complémentaires à l’activité agricole correspond à ce que L. Martínez décrit comme la
« prolétarisation » des populations paysannes de la sierra (Martínez, 1984), laquelle devint
plus importante au moment où l’Equateur prit une orientation néolibérale il y a trente ans de
cela.
97
��6,��-/+@#����)-�.$�*���)���./���)/�-7���/���/���)/�-7
��?��2.�/.��,����)�..�)���8�)�)����)��,���).�/���"9;?��455;
Nom Age en 2010
Période
migratoire
nationale
Période
migratoire
internationale
Total de la
période passée
en dehors de
l’exploitation
Angel 61 ans 21 ans 12,5 ans 33,5 ans
Daniel L. 56 ans 13 ans 16 ans 29 ans
Juan 58 ans 16 ans 9 ans 25 ans
Julio 56 ans 11 ans 15 ans 26 ans
Luis 47 ans 6 ans 10 ans 16 ans
Manuel Le. 44 ans 10 ans 17 ans 27 ans
Salvador 63 ans 19 ans 12 ans 31 ans
Source : entretiens réalisés entre juillet 2008 et août 2009.
Après l’« euphorie pétrolière » (Acosta, 2001 : 137) des années 1970, qui permit notamment
la modernisation des infrastructures urbaines, comme à Quito (Couret, 1994), les années 1980
furent celles de l’austérité économique et de la remise en question du modèle de
développement national initié vingt ans auparavant. La dette accumulée par l’Etat équatorien
aboutit en 1982 au Plan National de Stabilisation, sous la présidence d’O. Hurtado (1981-
1984), puis à la dérégulation de l’économie nationale durant les mandats successifs de
L. Febres Cordero (1984-1988) et de R. Borja (1988-1992). Désormais placé sous le contrôle
des grandes instances économiques internationales dans le cadre du « consensus de
Washington » (Williamson, 1990), l’Equateur subit un appauvrissement fulgurant, une
récession économique qui fut pour lui, comme pour tous les pays d’Amérique latine, le drame
d’une décennie perdue.
C’est dans ce contexte que le pays entra dans un processus d’appauvrissement général,
caractérisé par une baisse constante de son PIB entre 1981 et 1989 (cf. Annexe n°10) et que
les paysanneries furent mises à mal, tant par la disparition progressive des services
d’encadrement de l’Etat, que par l’arrivée sur le marché national des productions céréalières
des pays du Nord (Peltre-Wurtz, 1988, 2004). C’est pourquoi elles se dirigèrent de plus en
98
plus vers les secteurs d’emplois les moins qualifiés des villes équatoriennes et, dans notre cas,
des métropoles étasuniennes, entraînant en retour une mutation profonde du milieu rural.
"#@#���������� ������� ������� ' ���=�� ����������� ����=��% ��� � �
��<� �������� �%
Après plusieurs années passées à l’étranger, certains migrants de la première heure revinrent
et investirent dans différents types d’activités. Commerces, transports, achats de terre et de
propriétés en ville, plusieurs d’entre eux nous contèrent leurs ambitions au moment de leur
retour :
« Je suis resté trois ans à New York. Chaque mois, j’envoyais 100 dollars en Equateur. Quand je suis revenu, je suis parti vivre à Guayaquil avec ma femme, en pensant qu’il y aurait plus d’opportunités, qu’il était possible de faire du commerce. Mais ma femme ne s’est pas acclimatée au mode de vie de la côte, alors nous sommes revenus à Cuenca. Nous avons acheté un petit immeuble et nous louions les appartements. Mais le quartier était trop dangereux. Nous avons tout revendu et sommes revenus à Santa Rosa vers 1980. Nous avons acheté un petit terrain [un demi hectare] à 50 000 sucres[1 800 dollars] dans le centre de la paroisse et nous y avons construit une maison. J’ai acheté une camionnette et à partir de là, je me suis mis à faire du commerce, comme avant, lorsque je vendais du charbon. J’allais à Cuenca acheter des bouteilles de gaz et je les revendais dans la paroisse. »
Miguel, 70 ans, Santa Rosa.
« En 1985, je suis parti pour la première fois. Mon frère avait déjà émigré depuis plusieurs années et me prêta les 300 000 sucres [2 600 dollars] pour payer le coyote. Je suis passé par Tijuana et Los Angeles avant d’arriver à Chicago. Là-bas, je vivais avec mon frère et des amis qui m’ont trouvé un emploi dans une boulangerie. Je gagnais 300 dollars par semaine, mais au bout de six mois, j’en ai eu assez du pain ! J’ai trouvé un emploi dans une fabrique de confiseries où je suis resté travailler deux ans et demi. Pendant tout ce temps, j’envoyais presque 250 dollars par mois à ma femme qui a pu acheter en 1986 un terrain d’un hectare à 800 000 sucres [5 400 dollars], à Parcoloma. C’est à ce moment que je suis revenu, pour me consacrer uniquement à l’agriculture, mais pendant des années ce fut très difficile. Les choses n’avaient pas changé, même avec plus de terre. Alors en 1999 je suis reparti à Chicago. Pendant deux ans, j’ai travaillé dans une fabrique de meubles. J’ai mis un an à payer ma dette avant d’envoyer de l’argent à ma famille. Je suis rentré en Equateur en 2001, mais aujourd’hui j’aimerais retourner travailler aux Etats-Unis… »
Julio, 56 ans, Parcoloma.
99
« A New York, je travaillais comme plongeur et je gagnais 120 dollars par semaine. Puis je suis passé commis de salle et je gagnais 150 dollars, et même un peu plus avec les pourboires. Au bout de deux ans, je suis rentré. J’ai acheté un minibus et je faisais la liaison entre la paroisse Octavio Cordero Palacios et Cuenca. A l’époque [1970-1980] il fallait quatre heures pour remonter de la ville ! Je pouvais prendre jusqu’à trente personnes qui payaient chacune un sucre. Cela s’appelait « Transporte Miraflores », puis c’est devenu « Transporte Santa Rosa ». C’était illégal, car je n’avais pas le permis d’opération attribué par le gouvernement provincial, mais au moins je gagnais ma vie. En 1986, je suis reparti à Chicago. J’ai payé mon billet pour Mexico 25 000 sucres [500 dollars] et j’ai donné 500 dollars au coyote. Je suis resté 5 mois à travailler comme commis de salle. Je gagnais 180 dollars par semaine et je ne dépensais presque rien parce que je vivais chez de la famille. En 1987, je suis revenu en Equateur, j’ai ouvert une petite épicerie et j’ai continué à transporter les gens de la localité avec un nouveau minibus acheté 450 000 sucres [2 400 dollars]… mais je ne suis pas resté longtemps. Dans les années 1980 tout le monde partait ! Le responsable d’une agence de voyages à Cuenca me donnait un pourcentage à chaque fois que je lui ramenais un client [un candidat à l’émigration]. En un an j’ai gagné 4 000 dollars et je me suis même fait payer un billet alors que je ne voulais plus partir ! J’ai utilisé l’argent pour acheter un terrain à Cuenca et je suis retourné à Chicago. Je travaillais toujours comme commis et j’envoyais 100 dollars par mois à ma femme pour qu’elle commence à construire notre maison en ville. Je suis resté dix mois et quand je suis revenu, je me suis mis à travailler comme chauffeur dans la compagnie de transports collectifs 12 de Abril. J’ai continué ce métier jusqu’en 1996 ».
Isaías, 64 ans, El Rocío.
« Les premières semaines à Toronto ont été très difficiles. Je ne savais pas quoi faire, ni où aller. Un jour, un Chilien s’est approché de moi dans un restaurant. Il m’a parlé en espagnol et m’a proposé du travail dans une usine. Au début, je gagnais 0,85 dollars [canadiens] de l’heure. Puis, j’ai été augmenté à 1,75 dollar. En 1971, j’ai réussi à obtenir une carte de séjour, ce qui me permit d’aller chercher ma femme en Equateur. Quand nous sommes revenus nous avions chacun notre emploi. Elle était femme de ménage et moi je travaillais dans une autre fabrique. A nous deux, nous gagnions un peu plus de 250 dollars par semaine. C’était peu, mais nous pouvions économiser. En 1977, nous sommes revenus à El Rocío où nous nous sommes mis à faire de l’élevage sur les terres [6 hectares] que j’avais achetées dix ans plus tôt [à 300 000 sucres, soit 15 000 dollars], alors que je faisais de la contrebande d’alcool. Puis, nous avons acheté plusieurs terrains à Cuenca que nous avons vite revendus. Avec les bénéfices et quelques économies, nous avons acheté un plus grand terrain situé dans le centre ville et nous y avons construit un immeuble pour y louer des appartements. Au bout de quelques temps, nous sommes partis nous y installer parce qu’il était plus commode de vivre en ville. Les années ont passé et en 1988 je suis retourné à Toronto pour payer les études de ma fille. Depuis la dernière fois, les salaires avaient beaucoup augmenté. Je suis resté un peu moins de deux ans et je gagnais 1 700 dollars en deux semaines. De retour en Equateur, j’ai commencé à
100
prêter de l’argent à ceux qui voulaient partir. Je prêtais à des gens de confiance, à ceux qui étaient proches de ma famille. J’ai du le faire une quinzaine de fois. Cela me rapportait un peu, grâce aux intérêts [2 ou 3%].En 2004, grâce à l’argent des loyers [de l’immeuble à Cuenca], j’ai pu acheter 1,5 hectare, toujours dans le secteur d’El Rocío ».
Manuel Cruz, 69 ans, El Rocío.
Ces témoignages nous indiquent que les stratégies migratoires peuvent avoir des finalités très
différentes. Pour Julio par exemple, elle eut pour objectif de capitaliser au maximum pour
acheter de la terre, comme ce fut le cas pour d’autres anciens migrants que nous avons
rencontrés dans la paroisse Octavio Cordero Palacios (Angel, Juan, Luis, Salvador, Vicente et
Daniel L.) Toutefois, l’acquisition d’une nouvelle parcelle agricole ne fut pas systématique.
Pour Miguel, Isaías et Manuel Cruz, l’intention fut d’investir en ville afin de s’y installer,
même si pour le premier, l’expérience tourna court.
Durant les dernières décennies, les investissements hors domaine agricole ont démontré chez
certains migrants la volonté de diversifier leurs activités, comme Isaías, qui choisit de devenir
chauffeur, ou d’investir dans la formation de leurs enfants, à l’instar de Manuel Cruz. Ce
dernier, précisons-le, s’est d’ailleurs orienté vers l’élevage bovin dans son exploitation
d’El Rocío, en parallèle de ses investissements immobiliers à Cuenca. La diversité des projets
mis en œuvre par les migrants au moment de revenir dans leur localité marque la
complexification des systèmes d’activités, comme nous l’avions déjà noté à Juncal, où
certaines familles paysannes, ayant un ou plusieurs membres à l’étranger, vivaient aussi bien
de l’élevage bovin que d’activités extra-agricoles, après avoir investi une partie des remesas
pour développer de petits commerces. En réalité, nous constatons donc que la dynamique
migratoire ne va pas dans le sens d’un changement uniforme du milieu rural, mais au
contraire, qu’elle engendre de multiples transformations qui concernent à la fois les systèmes
d’activités familiaux et les choix productifs des exploitations.
"#;#,������� �=��������������������� ������
Pour ce qui est des cas où la priorité fut accordée à l’achat de terre, il convient de remarquer
que ce ne fut pas toujours le choix le plus judicieux, car même après l’exploitation des
parcelles nouvellement acquises, certains paysans, à l’image de Julio, furent contraints de
101
repartir travailler à l’étranger à cause de productions encore trop insuffisantes pour leur
permettre de rester vivre de l’agriculture. En Bolivie, G. Cortes fit d’ailleurs le même constat,
après avoir mené des enquêtes dans deux communautés paysannes de la région de
Cochabamba, ajoutant même que « lorsque la terre est immédiatement exploitée, non
seulement les gains sont dérisoires (en argent ou en produits), mais elle est l’est parfois à pure
perte » (Cortes, 1999 : 263).
En nous appuyant sur les informations recueillies au cours de nos entretiens, il nous est
possible de retracer l’évolution globale du prix de la terre dans la paroisse Octavio Cordero
Palacios au cours des quatre dernières décennies. Si, en 1970, Vicente acquit une parcelle
d’un hectare et demi au prix de 3 470 dollars dans le secteur de la Dolorosa, Rosa, dont le
mari a émigré en 2001, acheta pour sa part un terrain de 2000 m² en 2005, dans le même
secteur de La Dolorosa, au prix de 3 000 dollars. Entre ces deux transactions foncières, il s’est
écoulé un peu plus de trente ans, au cours desquels le prix de la terre a plus que sextuplé.
��6,��-/+;#,�.�����.���������?�7�,)���/�.
��,����)�..�)���8�)�)����)��,���).�/���"9?4��455;
Nom
Année de
l’investissement
foncier
Taille de la
parcelle
Prix
d’achat en dollars
Prix à
l’hectare en dollars
Secteur
Vicente 1970 1,5 hectare 3 470 2 313 La Dolorosa
Salvador 1972 1 hectare 2 800 2 800 El Cisne
Juan 1975 1 hectare 7 900 7 900 La Nube
Miguel 1980 0,5 hectare 1 800 3 600 Santa Rosa
Julio 1986 1 hectare 5 400 5 400 Parcoloma
Salvador 1987 0,5 hectare 1 200 2 400 El Cisne
Luis 1993 2 hectares
10 400 5 200 La Dolorosa 2 hectares
Juan 1997 2 hectares 18 500 9 250 La Nube
Rosa 2005 2000 m² 3000 15 000 La Dolorosa
Source : entretiens réalisés entre juillet 2008 et août 2009.
102
Cependant, il nous faut préciser que les prix de certains achats fonciers réalisés par plusieurs
exploitants que nous avons interrogés ne correspondent pas exactement à la tendance
économique générale. En 1975, Juan a par exemple acquis un hectare pour la somme de
7 900 dollars, tandis que cinq ans plus tard, Miguel acheta une parcelle, certes deux fois
moins grande, à seulement 1 800 dollars. Ces écarts de prix peuvent s’expliquer par différents
facteurs, comme l’accessibilité du terrain, plus ou moins facile, la pente, qui peut rendre plus
délicate la mise en culture, et la présence parfois d’une petite maison en adobe. En ce qui
concerne Juan, la parcelle qu’il acheta en 1975 se trouvait sur un terrain plat, au milieu duquel
se trouvait une maison qu’il habita plusieurs années, avant d’en construire une nouvelle au
cours des années 1990, dès son retour des Etats-Unis. A propos de Salvador, l’acquisition
qu’il fit en 1987 d’un demi hectare, au prix de 1 200 dollars, alors qu’un an plus tôt, Julio
acheta un lot d’un hectare à 5 400 dollars, s’explique par le fait que le terrain n’avait pas été
encore défriché à cette époque, qu’il était très difficile d’accès, ce qui n’avait d’ailleurs pas
vraiment changé en 2008 au moment où nous nous y sommes rendus, et qu’il se situait en
outre sur une pente assez forte.
Au-delà des deux exceptions citées, il apparaît donc clairement que le prix de la terre dans la
paroisse Octavio Cordero Palacios a connu une augmentation régulière au cours des quarante
dernières années, jusqu’à rendre presque impossible l’investissement foncier, la valeur d’un
hectare pouvant atteindre désormais 20 000 dollars d’après les dires de plusieurs paysans que
nous avons interrogés. Cette situation n’est cependant pas exceptionnelle : à Juncal, nous
avions déjà mis en évidence ce phénomène, en soulignant par ailleurs que l’augmentation des
prix avait été particulièrement brutale compte tenu du caractère récent de la dynamique
migratoire. Dans d’autres localités voisines de la paroisse Octavio Cordero Palacios, elles
aussi caractérisées par une émigration paysanne importante, plusieurs diagnostics agraires ont
confirmé la très nette augmentation des prix du foncier au cours des dernières années (CG-
Paute et al., 2006). Cependant, l’émigration des paysans de la paroisse Octavio Cordero
Palacios ne perturba pas seulement le marché de la terre : elle entraîna aussi une mutation de
l’usage du sol et des systèmes de production.
"#:#�� ���� � ��( ���� ������ %�
Il existe beaucoup de mythes autour de l’émigration, que même les techniciens présents en
milieu rural n’hésitent pas à relayer. Au cours des cinq dernières années passées en Equateur,
103
nous avons souvent entendu que « les familles avec migrants ne travaillent plus et [qu’elles]
ne font qu’attendre les remesas. » Il importe néanmoins de revoir ce jugement caricatural et
d’analyser objectivement les mutations de l’agriculture dans le contexte migratoire.
��)�)*������/+"@#��.���$�.�6�/�)//�.B
Alors que son mari est à la Yoni depuis plusieurs années, Rosa travaille seule dans leur exploitation de La Dolorosa. Derrière elle, la campagne semble vidée de sa population. Source : N. Rebaï (2009).
Pour cela, nous pouvons commencer par évaluer la diminution de la main-d’œuvre à l’échelle
des 38 familles que nous avons étudiées. En 2009, celles-ci réunissaient 208 membres au
total, mais seulement 87 personnes entretenaient un lien régulier avec l’agriculture, parmi
lesquelles 62 s’y consacraient à plein temps et 25 à mi-temps. En revanche, 62 individus
travaillaient à l’étranger, et 9 de plus occupaient un emploi permanent en ville, à Cuenca
précisément, ce qui les empêchait de participer aux tâches agricoles (cf. Graphique n°1). De
plus, 50 personnes étaient présentes sur place mais ne participaient aucunement, ou de façon
très limitée, aux besognes régulières dans les exploitations : il s’agissait d’enfants, de
personnes âgées et de personnes handicapées. Enfin, nos entretiens ont révélé que parmi tous
les individus qui se trouvaient à l’étranger en 2008, 54% d’entre eux avaient émigré après
2001 (cf. Annexe n°9), ce qui signifie qu’à l’échelle de la paroisse Octavio Cordero Palacios,
104
les départs ont continué d’être importants au cours de la dernière décennie, même si comme
nous le disions plus haut, le cumul de la croissance naturelle et des retours dans la localité les
ont compensés.
*�����0-�/+"#���������)/��.$�$6��.��.C>�$�,,�.��-����.D
�/>)/���)/��,�-�)��-����)/����,�-�,)��,�.���)/
Bien que l’on ne puisse pas savoir à quel point cet échantillon de travail est représentatif de la
paroisse Octavio Cordero Palacios, il est néanmoins logique que la baisse globale de la
population paysanne ait conduit à de profondes transformations agraires au niveau local.
Reste à savoir dans quelle mesure.
105
4#-�������� �������� �� ���������� �����
Si l’émigration entraîne une diminution importante de la main-d’œuvre disponible au sein des
exploitations, il convient par conséquent d’observer l’évolution de l’usage du sol que cela
implique. Nous allons donc nous intéresser aux nouvelles logiques de travail des familles
paysannes de la paroisse Octavio Cordero Palacios qui, délaissant chaque jour un peu plus les
cultures de cycles longs, font la part belle à l’élevage laitier.
4#"#,������ �� ���� ���(� � ��� B
Si dans le passé, le maïs, les tubercules, la fève et le haricot occupaient l’essentiel de l’espace
agraire, dorénavant, ces cultures vivrières ne couvrent que des superficies réduites à quelques
centaines de mètres carrés, car au-delà, le besoin de main-d’œuvre devient très important.
C’est en tout cas ce que nous avons pu observer chez la plupart des agriculteurs, avec qui
nous avons reconstitué le déroulement type d’une saison agricole au cours de nos entretiens.
��)�)*������/+";#,�.������..-���>����.��.�-,�-��.���2�,�.,)/*.
A côté des maisons, le doré des parcelles de maïs ne couvre désormais que des surfaces réduites. Source : N. Rebaï (2008).
106
Pour cultiver un solar, une parcelle de 2500 m², il faut commencer par préparer le sol à l’aide
d’une araire, ce qui nécessite la présence de deux hommes (ou éventuellement d’un homme et
d’une femme) pendant 2 jours. Il faut en effet sillonner la parcelle une première fois (arar),
puis accomplir la même tâche mais de façon perpendiculaire (cruzar) pour affiner au
maximum la structure du sol. Ce travail est en général complété par un bêchage manuel
accompli par 2 ou 3 femmes.
Lorsque l’exploitation ne dispose ni d’une araire ni de la paire de taureaux nécessaire pour la
tractée, elle doit alors les louer : 30 dollars par jour pour l’attelage et 10 dollars en plus pour
l’ouvrier qui le dirige. Le maïs et le haricot sont ensuite semés ensemble, tous les 80
centimètres environ, intervalle au milieu duquel la fève est plantée. Dans certaines
exploitations, de l’avoine peut être cultivée entre les semis de maïs et récoltée au bout de
quatre mois pour nourrir les bovins. Quelques pépins de courge sont aussi éparpillés entre les
différentes cultures et donneront au moment des récoltes des légumes qui pourront être
consommés par les agriculteurs ou permettre de nourrir les bovins et les porcs. Le tout est
ensuite fertilisé avec de l’engrais organique, quand les revenus familiaux le permettent.
Ce travail ayant lieu au mois d’octobre, au cours d’une période de plus fortes précipitations27
(cf. Graphique n°2), il s’accompagne par la suite d’une importante opération de désherbage
qui se répète une fois par mois, jusqu’à la récolte qui a lieu entre les mois de mai, pour la fève
et le haricot, et juillet, pour le maïs. Deux mois après les semis, les paysans réalisent la
segunda, qui consiste en un travail de buttage qui vise à renforcer les tiges de maïs et de fèves
à leur base, en formant de petits monticules de terre, pour éviter que le vent ne les casse.
27 Le régime pluviométrique de la région cuencanaise est fait de deux maxima et de deux minima.
107
*�����0-�/+4#$)2�//���.�����������)/.$�/.-�,,�.
�,�.����)/E����-���A�-�/��F�/���455?��4559
5
45
@5
:5
C5
"55
"45
"@5
":5
"C5
455
���� ���� �� ��� ��� ���� ��� � ���� ����� ���� ���� ����
�������������
����
Source : Institut National de Météorologie et d’Hydrologie (INAMHI).
Pour toutes ces tâches régulières, de nombreuses exploitations ont recours à des journaliers
qu’elles paient 10 dollars par jour lorsqu’il s’agit d’un homme, alors que le salaire d’une
femme n’est que de 6 dollars. Au cours des dernières années, la raréfaction de la main-
d’œuvre locale a conduit à l’augmentation des salaires, qui étaient deux fois moins élevés au
début des années 2000, mais en revanche, elle n’a pas permis de résorber les inégalités
sexuelles, alors que pour beaucoup, « les femmes sont de meilleures ouvrières. »
Pour les récoltes, celle de maïs en particulier, le besoin de main-d’œuvre est moins important
mais il arrive parfois qu’un ouvrier soit engagé deux jours durant pour abréger le labeur. Pour
une production annuelle de maïs-fève-haricot, toujours sur une superficie de 2500m², les coûts
de production peuvent alors atteindre 220 dollars (cf. Tableau n°6), un prix particulièrement
élevé, surtout pour les familles ne disposant pas de revenus extérieurs importants, et qui l’est
d’autant plus si l’on tient compte des faibles rendements généralement obtenus.
108
��6,��-/+:#�)-�����)�-���)/�!-/.),����$�G.A>�8�A�����)�
��/.,����)�..�)���8�)�)����)��,���).�/455C
Tâche Main-d’œuvre /
matériel nécessaire
Période /
Fréquence Dépense en dollars
Préparation
du sol
Location de l’araire et des taureaux
2 jours 60
1 ouvrier Conduite de l’attelage
2 jours 20
2 ouvrières Bêchage
2 jours 24
Désherbage
et buttage 2 ouvrières
1 jour par mois pendant 8 mois
96
Récolte 1 ouvrier 2 jours 20
Total 220
Source : entretiens réalisés entre mai 2008 et août 2009.
En effet, d’après les résultats des enquêtes agraires (ESPAC) réalisées en continu par l’INEC
entre 2003 et 2008, le rendement moyen pour un hectare de maïs cultivé en association avec
de la fève et du haricot était de 0,5 tonne dans la province de l’Azuay. Cependant, il faut
considérer ce chiffre avec prudence puisque les données produites par l’INEC sont obtenues à
partir d’un travail réalisé dans une zone de référence réduite à quelques kilomètres carrés (cf.
Annexe n°11), comme nous l’expliquerons davantage par la suite. D’après P. Peñafiel,
l’ingénieur agronome du CEDIR, qui depuis plus de 25 ans parcourt les campagnes de
l’Azuay, « le rendement maximum que les agriculteurs de la région peuvent atteindre est de
0,6 tonne par hectare pour le maïs [associé à de la fève et du haricot]. » En ce qui concerne
les informations que nous avons nous-mêmes recueillies auprès des exploitants de la paroisse
Octavio Cordero Palacios, le rendement moyen ne dépasse pas 0,2 tonne par hectare dans la
paroisse notre zone d’étude et figure probablement parmi « les plus faibles » de l’Austro,
toujours d’après P. Peñafiel.
Autrement dit, si dans le contexte migratoire la plupart des familles paysannes ne cultivent
plus qu’un quart d’hectare à proximité de leurs maisons, elles finissent par ne récolter que
50 kg de maïs par an, c'est-à-dire à peine plus d’un quintal, l’unité de poids équivalant à 45 kg
et largement utilisée par les paysans de la sierra, et dans ces conditions, elles ne parviennent à
être autosuffisantes que quelques mois dans l’année. En voulant suivre les recommandations
109
alimentaires établies par l’ancien Conseil National de Développement28 (cf. Wurtz, 2004 :
146), un ménage composé de deux adultes de plus de vingt ans, dont la consommation
quotidienne de céréales devrait être de 300g chacun, et de deux enfants de un à six ans, qui
consommeraient individuellement 100g de céréales par jour, verrait son stock de maïs épuisé
en deux mois s’il ne variait pas sa consommation de céréales avec du riz ou de l’orge par
exemple. Peu importe alors le régime alimentaire adopté, qu’elles consomment exclusivement
du maïs ou non, les personnes vivant dans la paroisse Octavio Cordero Palacios ont donc
recours à des achats importants de céréales, ce qui implique nécessairement l’existence de
revenus réguliers.
Pour beaucoup de familles paysannes, consommer du maïs dans ces conditions est devenu
hors de prix, le niveau élevé des salaires journaliers, conséquence directe du contexte
migratoire, ayant favorisé la diminution très nette des superficies cultivées dans la paroisse
Octavio Cordero Palacios au cours des dernières années. Luis, dont nous avons déjà parlé au
début de ce chapitre, nous donna d’ailleurs son avis sur cette situation : « il y a encore vingt
ans cela ne coûtait pas aussi cher d’engager un ouvrier. Les gens travaillaient pour un repas.
Il y avait aussi beaucoup plus d’entraide entres les familles. Pour travailler la terre ou pour
construire les maisons, les gens faisaient du cambio mano. Un jour chez l’un, un jour chez
l’autre, et tout allait très vite. Maintenant, vous perdez plus de temps en cherchant un peón
qu’en travaillant seul, et quand vous le trouvez, vous dépensez de l’argent pour rien. »
Désormais, même pour les familles les plus pauvres de la localité, les échanges de travail
tendent à disparaître. Beaucoup d’entre elles préfèrent en effet monnayer leur aide sur les
parcelles voisines pour disposer de sommes d’argent qui leur permettront d’acheter leurs
vivres sur les marchés urbains, plutôt que de produire leur propre alimentation en travaillant
sous forme de cambio mano.
Cependant, il n’est pas envisageable d’assister à court terme à la disparition complète des
cultures vivrières de cycles longs. D’abord, parce que les exploitants ne souhaitent pas
dépendre uniquement d’achats extérieurs, et ensuite, parce que ces cultures continuent d’être
présentes dans l’alimentation quotidienne. Leur importance est d’autant plus grande qu’elles
sont au cœur des traditions culinaires régionales, l’exemple le plus évocateur étant celui du
maïs, appelé mote quand il est bouilli et qu’il constitue la base de nombreux repas, et grâce
28 Il fut remplacé en 1998 par le Bureau de Planification qui devint à son tour le Secrétariat National de Planification et de Développement en 2004.
110
auquel sont produits les tamales (papillotes de farine de maïs fourrées d’un peu de viande et
de petits légumes), ainsi que le fameux mote pillo (maïs bouilli et mélangé à des œufs
brouillés), très consommés par les cuencanais lors des jours de fête. A l’avenir, la question de
la conservation du patrimoine gastronomique pourrait cependant se poser dans la province de
l’Azuay, compte tenu de la baisse importante des superficies cultivées enregistrée ces
dernières années. En attendant, la plupart des exploitations continueront certainement à
produire du lait, comme elles l’ont fait ces dernières années.
��)�)*������/+":#��.�,��.��*�)/�-7�/8)������.������)/B
La préparation du mote pillo, un plat typique de la région de Cuenca. Source : N. Rebaï (2008).
4#4#-���������������� ������ !% �=���
L’autre fait marquant dans la paroisse Octavio Cordero Palacios est le développement de
l’élevage bovin. Si la majorité des familles ont en effet réduit les superficies qu’elles
consacraient aux cultures de cycles longs, dorénavant, elles laissent la plus grande partie de
leurs terres en herbe pour nourrir leurs vaches laitières. Dans un grand nombre de cas, elles
n’hésitent pas non plus à faire déboiser leurs parcelles par des bûcherons professionnels, à qui
elles vendent leurs arbres pour quelques dizaines de dollars, de manière à étendre leurs
111
pâturages et à augmenter leurs revenus dans le même temps. Comme nous l’avions déjà
observé à Juncal, la vente quotidienne de lait aux différents intermédiaires qui sillonnent la
localité pour collecter la production locale, et la revendre ensuite aux grandes laiteries
régionales, garantit à ces familles des rentrées monétaires régulières, contrairement au maïs
qui, même en cas de bonnes récoltes, n’assure des revenus qu’une fois par an. Toutefois, ni la
paroisse Octavio Cordero Palacios, ni celle de Juncal ne sont des cas isolés de la région
andine.
Depuis 2002, la limitation des importations de lait et de ses dérivés a conduit à l’augmentation
de la production nationale, qui est passé de 3,5 millions de litres produits quotidiennement en
2000 (INEC, 2000) à « 5,7 millions de litres » en 2011, d’après J.P. Grijalva, président de
l’association des éleveurs bovins de la sierra et de l’oriente (cf. Annexe n°12). En outre, ce
nouveau contexte économique a conduit à l’augmentation du prix d’achat aux producteurs,
passé de 0,18 à 0,39 dollar entre 2002 et 2011 (cf. Annexe n°12).
Ainsi, comme au Pérou, où la protection du marché national du lait à partir des années 1990 a
favorisé le développement d’une filière fromagère artisanale capable de répondre à une
demande urbaine en pleine croissance (Aubron, 2006 ; Cochet et al., 2009), l’élevage laitier
en Equateur a permis de satisfaire une consommation nationale en nette augmentation, la
population des villes ayant crû de 70% entre 1990 et 2010, passant de 5,3 à 9 millions
habitants. Dans ces conditions, la production laitière est devenue très importante pour les
groupes paysans de la sierra car elle apporte, comme le soulignait M. Vaillant dans son
analyse des effets socioéconomiques de l’émigration dans la province du Cañar, « des revenus
réguliers et stables tout au long de l’année, sans donner lieu à des pics de travail
saisonniers29 » (2008 : 40), ce qui permettrait aux exploitations familiales d’entrer à moyen
terme dans un processus de capitalisation et de modernisation (Chauveau, 2007).
L’élevage laitier joue par conséquent un rôle essentiel pour de nombreux foyers de la paroisse
Octavio Cordero Palacios. Si l’on se fie aux statistiques officielles du troisième recensement
agraire de l’INEC, en 2000, la production quotidienne de lait était en moyenne de 3,5 litres
par vache dans la province de l’Azuay. Cette quantité a pu être confirmée par M. Willot dans
son diagnostic agraire de la localité, à travers lequel sont décrites avec précision les
29 « […] ingresos regulares y estables a lo largo del año, y no exige picos estacionales de trabajo […] ».
112
caractéristiques d’un « système d’élevage laitier intensif en travail » (Willot, 2004 : 39), celui
de la majorité des petites exploitations familiales. En effet, dans les plus petites exploitations,
les charges animales peuvent atteindre 6 têtes par hectare. Cela joue bien évidemment sur la
production quotidienne de lait qui, par ailleurs, varie beaucoup pendant l’année. La période de
lactation ne dure que neuf mois au cours desquels le volume laitier diminue progressivement.
Si la production moyenne d’une vache peut atteindre 7 litres par jour pendant les douze
premières semaines, elle diminue ensuite de « 30% tous les trois mois » (Willot : 2004, 39).
��)�)*������/+"?#��.6)8�/.��/.,����)�..�)���8�)�)����)��,���).
Dans des exploitations de petites tailles, les vaches laitières sont parfois nombreuses, ce qui témoigne de leur importance économique. Source : N. Rebaï (2008).
De plus, les éleveurs doivent faire face à des périodes plus critiques où la quantité de fourrage
diminue fortement. C’est précisément le cas entre le mois de mai et le mois d’août, période
durant laquelle les précipitations sont faibles. Les paysans donnent alors à leurs animaux la
calcha, les tiges de maïs fraîchement coupées et conservées après la récolte (cf. Photographie
n°18), « sans que cela ne soit un complément alimentaire efficace [tant l’apport énergétique
est faible] », comme nous l’expliqua P. Peñafiel. Les chefs d’exploitation ont alors l’habitude
113
de conduire leurs animaux sur des « pâturages informels30 » (Huttel et al., 1999 : 97), qui ne
sont autres que les mauvaises herbes ayant poussé sur les parcelles en repos après les récoltes.
��)�)*������/+"C#,!�,�$�/����)/��,!�,�8�*�6)8�/
En été, lorsque l’herbe se fait rare, les paysans donnent à leurs animaux de la calcha. Source : N. Rebaï (2008).
Parfois, des éleveurs disposant de revenus extérieurs choisissent d’acheter du fourrage, de
l’avoine en particulier, ou bien encore de louer de petites parcelles de pâturages, cela
permettant de maintenir l’alimentation des animaux même pendant les phases les plus
critiques de l’année. Il arrive aussi que certains d’entre eux produisent de la luzerne, sur des
superficies n’excédant pas 500 m², comme nous l’avons observé chez Daniel, un exploitant de
la communauté de Cristo del Consuelo, ou bien chez Miguel, du secteur de Santa Rosa. Cela
permet également d’alimenter le bétail tout au long de l’année, même durant les périodes de
faibles pluies. Les familles de la zone consomment ensuite une partie de la production
quotidienne de lait, souvent sous forme de fromages frais qui viennent compléter les plats de
riz et de maïs (cf. Photographies 19/20).
30 « Pastoreado[s] informal[es] »
114
��)�)*������./+"9H45#,�,���.)-.�)-��..�.>)�$�.
La traite quotidienne : de ce geste simple dépend une part importante de l’alimentation familiale.
La production laitière est aussi partiellement vendue, parfois sous forme de fromages frais. Source : N. Rebaï (2008).
115
Pour elles, il s’agit en effet de couvrir les besoins alimentaires et de compenser leur faible
consommation de protéines animales, la viande de bœuf n’étant que très rarement inclue dans
les plats. Enfin, la vente de lait et de fromages peut avoir beaucoup d’importance et
représenter la plus grande part des revenus d’une exploitation, ce qui correspond à une
véritable économie paysanne orientée vers l’élevage laitier, comme l’a constaté P. Le Ray
dans son diagnostic agraire de la paroisse de Pindilig située dans la province du Cañar (Le
Ray, 2004), et comme l’a décrit C. Chauveau, en généralisant son analyse à l’ensemble de la
sierra équatorienne (Chauveau, 2007). Toutefois, nous verrons dans le Chapitre 5 que
l’importance économique du lait peut varier d’une exploitation à l’autre compte, en fonction
des ressources foncières, de la taille des élevages et surtout de la composition des ménages,
les familles les plus nombreuses se réservant une plus grande part de leur production laitière
pour l’autoconsommation.
L’importance des autres types d’élevages au sein des exploitations est par ailleurs loin d’être
négligeable. Les cobayes, dont la consommation est très ancienne et demeure très prisée dans
la région andine (Celestino, 1998), se comptent bien souvent par dizaines, réunis dans de
petits clapiers où chaque jour, les paysans viennent les alimenter avec de grosses bottes
d’herbe. Si dans le passé, les animaux étaient libres de circuler dans la maison paysanne, ce
nouveau mode d’élevage, qui vise à réunir les cobayes en un même endroit et qui témoigne de
l’intervention très probable d’une institution auprès des éleveurs31, n’est pas sans contrainte. Il
n’est pas rare en effet que la mortalité des animaux soit très élevée, leur densité dans leurs
petits compartiments (cf. Photographie n°21) et l’humidité de l’herbe fraîche qui les nourrit
favorisant la propagation rapide des bactéries, comme nous l’expliquèrent P. Peñafiel, du
CEDIR, et J. Ezquebel, ingénieur agronome au ministère de l’Agriculture. Malgré cela, les
cobayes gardent les faveurs des paysans, car ils constituent avec le lait l’un des principaux
apports en protéines, et restent par conséquent très consommés tout au long de l’année, et plus
particulièrement lors des fêtes et des mingas (cf. Photographie n°22).
31 Il s’agit là d’une hypothèse que nous n’avons pas eu l’occasion de vérifier sur le terrain.
116
��)�)*������./+4"H44#,��)6�2��-/�/�$�,�!�,�8�*��$�)���/�
Dans la plupart des exploitations de la paroisse Octavio Cordero Palacios, les animaux sont réunis par dizaines.
Parfois vendus, ils sont aussi très consommés par la population locale. Source : N. Rebaï (2009).
117
C’est aussi le cas des volailles, élevées en plein air et nourries avec un maïs plus dur (amarillo
duro), produit sur la côte, que les paysans de la paroisse Octavio Cordero Palacios achètent en
ville. Dans tous les cas, les ventes de cobayes et de gallinacés complètent les revenus
familiaux lorsque ces derniers se font moins importants (absence de remesas, irrégularité des
emplois locaux, etc.) et permettent même dans certains cas de pallier une dépense imprévue.
Les porcs, nourris avec les restes alimentaires, les épluchures, le petit lait récupéré de la
fabrication des fromages et parfois de la farine de maïs, ne sont en général réduits qu’à deux
ou trois animaux par exploitation, parmi lesquels on trouve bien souvent une truie
reproductrice. Ils sont d’ordinaire destinés à l’autoconsommation, même si
occasionnellement, l’un d’entre eux peut être vendu.
Quant aux moutons, ils ont dorénavant presque disparu de la paroisse Octavio Cordero
Palacios car depuis plusieurs années maintenant, les pâturages sont prioritairement réservés
aux vaches laitières puisqu’elles représentent un intérêt économique majeur. Dans ce
contexte, les moutons ont perdu leur fonction dans la gestion de la fertilité des parcelles
agricoles, d’autant que les exploitants ont de plus en plus recours à l’achat de sacs d’engrais
de 15 kg, à 1 dollar pièce, composés d’un mélange de fumier de volailles et de son de riz.
Enfin, il ne faut pas ignorer que les moutons demeurent faiblement appréciés aux repas, que
leur laine n’est plus utilisée par les paysans, qui achètent dorénavant leurs vêtements, et que
celle-ci ne se vend même plus du fait de l’usage beaucoup plus important que dans le passé de
matières synthétiques par l’industrie textile.
4##6� ������ ����������������=� %
Compte tenu de l’adaptation des familles paysannes au contexte migratoire, l’usage du sol dans
la paroisse Octavio Cordero Palacios a nettement évolué au cours des deux dernières
décennies. D’après les données de l’IERSE (2003), les superficies cultivées y ont été réduites
de 9% entre 1991 et 2001, et les espaces boisés de 19%. A l’inverse, les aires pâturées ont
augmenté de près de 85%, parvenant même à gagner du terrain sur les páramos, dont la surface
a diminué de 12% au cours de la même période (cf. Tableau n°6 ; Cartes n°11 et 12).
118
��6,��-/+?#�8),-��)/��..-���>����.I�/�������.J��.���/����,�.>)�$�.�!-.�*��-.),
��/.,����)�..�)���8�)�)����)��,���).�/���"99"��455"
Occupation du sol 1991 2001
Espaces cultivésMaïs, haricot, fève, petit pois, orge, blé, pomme de terre
1 194,2 1 088
Espaces boisés 596,1 479,6
Páramos 173,2 152,9
Pâturages 300,9 554,4
Source : IERSE (2003).
�����/+""H"4#�8),-��)/��.���/����,�.>)�$�.�!-.�*��-.),
��/.,����)�..�)���8�)�)����)��,���).�/���"99"��455"
119
Cependant, il est nécessaire de nous arrêter sur les données produites par l’IERSE et d’en
présenter les limites. Tout d’abord, il convient de tenir compte de leur relative ancienneté et
qu’elles ne peuvent par conséquent nous renseigner sur les évolutions de l’espace agraire dans
la paroisse Octavio Cordero Palacios au cours de la dernière décennie. Par ailleurs, il importe
de revenir sur la méthode qui a été employée pour constituer ces informations. D’après
O. Delgado, coordinateur pour l’IERSE des travaux de géomatique réalisés à l’échelle de la
province de l’Azuay, les photographies aériennes qui ont permis la réalisation des cartes
d’usage du sol de 1991 et 2001 ont été complétées par des observations directes sur le terrain
et des relevés géo-référencés, mais qui n’ont pas eu lieu dans notre zone d’étude. En effet, sur
la première comme sur la deuxième carte, les parcelles agricoles semblent occuper les deux
tiers du territoire de la paroisse Octavio Cordero Palacios, et de façon presque homogène.
Pourtant, compte tenu de la dynamique migratoire et de la diminution globale de la main-
d’œuvre à partir du début des années 1980, il est probable que dès 1991 les pâturages aient
occupé de plus grandes superficies dans tous les secteurs de la localité, avant que ce
phénomène ne s’accentue au cours des années 2000 sous la double influence de la migration
et de la politique nationale de protection du marché du lait.
En dépit de ces quelques imprécisions, il faut tout de même souligner un fait particulièrement
intéressant qui fait de la paroisse Octavio Cordero Palacios un cas d’étude paradoxal. Les
informations présentées ci-dessus indiquent en effet que la chute des superficies boisées est
corrélative de la baisse de la population, ce qui va dans le sens inverse de la forest transition
theory32 (Mather, 1992 ; Rudel, 1998), laquelle voudrait que les migrations des populations
rurales auraient pour conséquence de favoriser le retour de la « nature ». En Equateur, ce
constat a d’ailleurs été fait, dans les provinces du Morona Santiago (Rudel et al., 2002) et de
Loja (Gray, 2008), où les baisses de densités rurales ont engendré la diminution des
superficies cultivées et la formation de forêts secondaires. Cela prouve en définitive qu’il est
difficile de théoriser sur les effets de l’émigration en milieu rural, compte tenu des contrastes
qu’il est possible d’observer d’une région à l’autre en ce qui concerne les usages du sol,
lesquels n’évoluent pas seulement en fonction des densités de population, mais également par
rapport au contexte économique et aux conditions d’accès aux différents marchés, national ou
international, comme cela se voit à l’échelle de notre localité d’étude avec le développement
32 Théorie de transition de la forêt.
120
de l’élevage laitier dans un contexte de déprise démographique presque continue depuis trente
ans.
Si nous poursuivons notre analyse en changeant d’échelle, il apparaît que l’évolution des
usages du sol dans la province de l’Azuay a suivi la même tendance que dans la paroisse
Octavio Cordero Palacios. Les enquêtes agraires réalisées par l’INEC entre 2003 et 2008
indiquent en effet une réduction de 53% des superficies cultivées contre une augmentation de
7,5% des aires pâturées, alors qu’entre 1996 et 2001, 5,6% de la population régionale a
émigré à l’étranger (INEC, 2001)33, et que depuis, il est fort probable que le nombre de
migrants d’origine azuayenne ait continué d’être important, comme en témoigne le maintien à
un niveau très élevé du nombre de départs à l’échelle nationale au cours des dernières années.
Entre 2001 et 2007, ils furent ainsi, en moyenne, 91 506 Equatoriens à quitter leur pays
chaque année (cf. Annexe n° 8).
��6,��-/+C#�8),-��)/��..-���>����.I�/$�,,���.�!�������.J
��.���/����,�.>)�$�.�!-.�*��-.),��/.,���)8�/����,!�K-�2�/���455��455C
Occupation du sol 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Espaces cultivésMaïs, blé, orge, fève, haricot, pomme de terre
80,7 80,2 77,6 57,8 47,9 38,6
Espaces boisés 184,8 179,2 174,8 185,9 174,5 169,5
Páramos 76,3 76,8 76,4 78 67,7 90,2
Pâturages 244,8 246,7 249,9 235,6 275,6 263,1
Source : INEC (Enquêtes agraires – ESPAC : 2003/2008).
Toutefois, une nouvelle critique des données statistiques paraît indispensable, car même si la
réduction des aires cultivées semble indiscutable, nous constatons en revanche des variations
interannuelles considérables pour les superficies pâturées et pour celles des páramos. Comme
nous l’avons indiqué précédemment, la méthodologie employée par l’INEC pour la réalisation
de ses enquêtes continues est assez limitée puisqu’elle s’appuie essentiellement sur
l’observation des dynamiques agraires dans des zones de travail de référence. Mais cette
observation est aussi très subjective, comme nous l’a expliqué J. Maldonado, l’ingénieur
rencontré au siège de l’INEC à Quito. En effet, si le technicien en charge du travail de terrain 33 Il s’agit là des données démographiques les plus récentes pour l’échelle provinciale.
121
constate une première année que des animaux se trouvent dans les páramos, il estimera qu’il
s’agit de pâturages ; si l’année suivante, il ne s’y trouve pas d’animaux, il considérera qu’il
s’agit alors des páramos.
L’ambiguïté réside donc dans cette observation ayant lieu dans une zone d’altitude où la
frontière entre les différentes formes d’occupation du sol est particulièrement floue. Cette
méthode a cependant l’intérêt de montrer combien les páramos peuvent être mis à mal sous
l’effet d’un développement accéléré de l’élevage bovin, alors qu’il s’agit d’espaces
écologiquement fragiles dont l’accès devrait être limité, au risque d’accentuer les phénomènes
d’érosion et d’augmenter la pression sur les ressources en eau, comme l’ont souligné deux
études, la première dans la province de Cotopaxi (Alomía, 2005) et la seconde dans celle de
Tungurahua (Girard, 2005). Il s’agit là d’un thème précis que nous aurons d’ailleurs
l’occasion d’aborder dans le Chapitre 6, puisque nous l’avons vu un peu plus haut, les
páramos de la paroisse Octavio Cordero Palacios ont également subi des changements
importants au cours des dernières décennies.
Enfin, si l’on observe les mutations agraires à l’échelle de la sierra équatorienne au cours des
dernières années, elles semblent également avoir suivi la même tendance que celles de la
paroisse Octavio Cordero Palacios, mais à des niveaux plus mesurés. En effet, les enquêtes
agraires de l’INEC montrent que les superficies cultivées ont globalement été réduites de
19,5% entre 2003 et 2008, tandis que les aires pâturées ont connu au cours de la même
période une augmentation de 13%.
��6,��-/+9#�8),-��)/��..-���>����.I�/$�,,���.�!�������.J
��.���/����,�.>)�$�.�!-.�*��-.),��/.,�.�/��.�0-��)���//�.�/���455��455C
Occupation du sol 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Cultures vivrièresMaïs, blé, orge, fève, haricot, pomme de terre
411 448 426 390 375 331
Espaces boisés 1 164 1 155 1 150 1 124 1 138 1 163
Páramos 538 524 592 575 572 516
Pâturages 18 553 20 855 19 839 20 817 20 662 20 913
Source : INEC (Enquêtes agraires – ESPAC : 2003/2008).
122
Néanmoins, il ne faudrait pas voir dans ces transformations rapides les seuls effets de
l’émigration paysanne, importante il est vrai, mais inégale dans les différentes provinces, tant
du point de vue de son ancienneté que celui des effectifs concernés34. Comme nous
l’évoquions plus haut, l’ouverture croissante aux importations céréalières depuis le début des
années 1980 a grandement fragilisé l’agriculture familiale de la région andine et conduit à la
très forte diminution des productions de maïs (-50%), d’orge (-60%) et de blé (-68%), au
cours des deux dernières décennies.
��6,��-/+"5�8),-��)/��.��)�-���)/.��$�G.D�!)�*�����6,�I�/$�,,���.���)//�.J
��/.,�.�/��.�0-��)���//�.�/���"99��455C
Production 1993 2003 2008
Maïs 150,2 91,8 75,5
Orge 44,3 22,7 17,9
Blé 25,5 11 8,1
Source : INEC (Enquêtes agraires – ESPAC : 1993/2008).
C’est dans ce contexte que la majorité des exploitations familiales se sont progressivement
orientées vers l’élevage laitier, pour s’assurer de revenus réguliers, en profitant par ailleurs
d’une consommation urbaine en constante progression, comme nous l’avons souligné plus
haut. En d’autres termes, l’émigration ne fut pas le seul facteur des mutations agraires dans la
sierra équatorienne au cours vingt dernières années, mais à l’échelle de petites localités
comme la paroisse Octavio Cordero Palacios, elle est un élément de plus à prendre en
considération dans l’étude du système agraire et pour expliquer certaines transformations
radicales du territoire local, lesquelles, nous le verrons dans le chapitre suivant, ne se limitent
pas seulement à la diminution des superficies dédiées au maïs et à l’extension des aires
pâturées.
34 Alors que 34 053 azuayens émigrèrent à l’étranger entre 1996 et 2001, il n’y eut par exemple que 1 323 individus originaires de la province andine du Carchi, située dans le nord du pays, qui s’en allèrent à l’étranger au cours de la même période..
123
��������
�� ����� �������� ����������������� � ��� ���������������������
« En haut, sur la charge des légumes, allongés à plat ventre, couverts de leur limousine à petites raies noires et grises, les charretiers sommeillaient, les guides aux poignets. Un bec de gaz, au sortir d’une nappe d’ombre, éclairait les clous d’un soulier, la manche bleue d’une blouse, le bout d’une casquette, entrevus dans cette floraison énorme des bouquets rouges des carottes, des bouquets blancs de navets, des verdures débordantes des poix et des choux. Et, sur la route, sur les routes voisines, en avant et en arrière, des ronflements lointains de charrois annonçaient des convois pareils, tout un arrivage traversant les ténèbres et le gros sommeil de deux heures du matin, berçant la ville noire du bruit de cette nourriture qui passait. »
Emile Zola, Le ventre de Paris.
124
Dans le contexte migratoire des trois dernières décennies, les mutations agraires dans la
paroisse Octavio Cordero Palacios se sont accélérées. Toutefois, nous avons précisé que la
diminution de la main-d’œuvre ne peut être le seul facteur déterminant de nouvelles pratiques
agricoles à l’échelle locale. Bien souvent, les espaces ruraux évoluent sous d’importantes
influences urbaines, comme en Chine, où T. Sanjuan définit la ville comme un « acteur rural »
(Sanjuan, 2011 : 223), en insistant par exemple sur l’industrialisation des campagnes situées
en périphéries de grandes métropoles. La ville de Cuenca aurait-elle donc participé de
l’évolution récente de l’agriculture familiale dans la paroisse Octavio Cordero Palacios, au
même titre que la migration ?
Pour le savoir, nous analyserons d’abord comment la proximité urbaine est devenue au cours
des vingt dernières années, un facteur de mobilisation collective des agriculteurs pour le
développement de cultures marchandes destinées au marché cuencanais. Nous verrons alors
quelles sont désormais les caractéristiques des systèmes de production et les effets des
nouvelles logiques productives sur le paysage agraire de la paroisse Octavio Cordero Palacios.
Puis, dans un second temps, nous irons en ville, pour étudier l’importance des acteurs
institutionnels ayant facilité l’installation de petits producteurs locaux sur les marchés. Ainsi,
nous nous intéresserons à la réorganisation des espaces de vente urbains, avant de discuter des
avantages et des limites des circuits courts d’approvisionnement dans la province de l’Azuay.
� ! ��� ��"" � �� ��� �� � ������������ �������� ���� �� "������
#���������� ����������
Dans la paroisse Octavio Cordero Palacios, le développement de l’élevage laitier
s’accompagne d’un travail plus intensif sur de petites parcelles maraîchères appelées huertos,
où salades, choux et carottes sont produits pour l’autoconsommation, mais aussi pour la vente.
Depuis plusieurs années, les familles paysannes de la zone profitent en effet de la proximité
de Cuenca pour vendre régulièrement leurs produits, en se rendant une à deux fois par
semaine sur les différents marchés de la ville. Compte tenu de l’histoire agraire locale, cette
dynamique commerciale est tout à fait originale, même si dans certains cas, et à des périodes
précises, la vente de produits agricoles et d’élevage, comme ce fut le cas de la laine, a pu
avoir lieu dans le passé.
125
Pour comprendre le développement récent du maraîchage dans la paroisse Octavio Cordero
Palacios, nous avons demandé aux chefs d’exploitation de nous expliquer les raisons qui les
avait conduits à s’orienter vers cette activité. Puis, nous avons voulu connaître l’organisation
du travail quotidien sur les potagers et les contraintes qu’elle pouvait impliquer. En parallèle,
nous nous sommes entretenus avec certains membres du CEDIR, pour comprendre d’un point
de vue institutionnel, les origines du maraîchage dans la paroisse Octavio Cordero Palacios et
resituer cette dynamique productive dans son contexte régional.
Notre tâche passe préalablement par une mise au point terminologique comparable à celle
faite par F. Landy dans l’introduction de son ouvrage qui porte sur les dynamiques agraires
dans deux localités rurales de l’état indien de Karnataka (Landy, 1994). Jusqu’ici, nous
utilisons le mot « paysan » pour désigner une population dont le mode de vie s’organisait
principalement autour de l’agriculture et de quelques activités complémentaires (artisanat,
emplois saisonniers). Le terme « producteur » renvoie quant à lui à un métier, pour lequel les
relations avec le milieu urbain sont fréquentes et le temps dédié aux activités commerciales
comparable à celui qui est accordé aux diverses tâches au sein de l’exploitation. Ce n’est donc
pas anodin si à travers les pages qui suivront, nous parlerons davantage de « producteurs »,
car nous focaliserons une partie de notre attention sur les dynamiques de l’agriculture
commerciale dans la paroisse Octavio Cordero Palacios.
� � $ ���� �� ���������� ������ ���� %� ���������
C’est à la fin des années 1990 que le curé de la paroisse Octavio Cordero Palacios,
le Père J.35, encouragea les paysans de la localité à se consacrer à l’agriculture commerciale.
Pour cela, il eut un message simple, comme nous le raconta Natividad, une petite exploitante
de 55 ans du secteur de Cristo del Consuelo : « avant 2000, il n’y avait pas de vente de
produits agricoles. Nous vendions seulement des petits animaux à la foire de Parcoloma.
Ceux qui allaient à Cuenca étaient peu nombreux et ils vendaient leurs poulets et leurs
cobayes de façon informelle. L’arrivée du Père J. a tout changé. Ils nous disait : « j’ai de la
peine en vous voyant aller à Cuenca avec vos paniers vides et revenir avec vos paniers pleins.
35 Malgré diverses tentatives, il ne fut pas possible de rencontrer cet acteur clé à cause de son affectation dans une autre province équatorienne, ni même d’entrer en contact avec lui.
126
Vous avez de la terre, alors vendez ! » A partir de ce moment, nous avons commencé à
travailler différemment ».
L’idée du Père J. était de former de petits groupes de travail pour compenser le manque de
main-d’œuvre et pour vendre ensuite des produits maraîchers sur les marchés urbains. En
outre, cela devait permettre aux familles de la zone de ne plus seulement dépendre des
remesas pour acheter les fruits et légumes qu’eux mêmes pouvaient produire. Dans sa
démarche, il fut sans doute influencé par le contexte régional de l’époque, comme nous le dit
M. Solíz., la directrice du CEDIR : « L’essor du maraîchage dans la paroisse Octavio
Cordero Palacios est le fruit de diverses influences. Au niveau provincial, il existe une
synergie entre l’Eglise et les ONG locales depuis le début des années 1980. Cela correspond
à l’origine à la volonté commune de viabiliser la condition paysanne après la réforme agraire
[laquelle n’a cependant pas eu d’effet dans la paroisse Octavio Cordero Palacios, le discours
de la directrice du CEDIR portant sur un contexte plus général]. Au milieu des années 1990
d’autres institutions sont apparues, comme l’Université de Cuenca ou le Centre d’Agriculture
Biologique, pour participer au débat sur le développement rural régional. De leur côté, la
Municipalité de Cuenca et le CREA ont donné une plus grande importance au maraîchage en
créant deux associations de producteurs agroécologiques composées chacune de dizaines de
familles. L’agroécologie est une approche très concrète du développement : avec
l’émigration, il fallait trouver une alternative pour sauvegarder le travail paysan, même si
tout changement demande du temps. Et aujourd’hui, cela fait près de quinze ans que cela
existe. »
En définitive, le Père J. ne fut que le relais d’un processus plus important ayant cours au
niveau régional. Dans la paroisse Octavio Cordero Palacios, les paysans s’orientèrent donc
assez vite vers la production de fruits et de légumes, comme nous le décrit encore Natividad :
« j’ai commencé le maraîchage en 2004. J’ai vendu l’une de mes vaches qui était vieille et qui
ne produisait plus beaucoup de lait, et avec l’argent, j’ai construit une serre, pour y produire
des salades, des choux et des fruits. Mes voisins avaient déjà formé un groupe de travail. Ce
sont eux qui m’ont aidé pour la construction de la serre. María [sa voisine] m’a convaincu
d’en faire partie et de faire du maraîchage. C’est elle qui m’a donné mes premières
semences. » Toutefois, l’action menée par le curé ne fut pas le seul facteur de changement. En
parallèle, il y eut plusieurs initiatives personnelles qui participèrent au renouvellement de
l’agriculture locale.
127
Pour certaines paysannes, le temps était venu de se convertir en véritables actrices du
ravitaillement urbain régional. C’est ce que nous expliqua, avec beaucoup de conviction,
Alejandrina, une agricultrice de 35 ans du secteur de Corazón de Jesús : « depuis l’âge de dix-
huit ans, je vais à Cuenca vendre mes produits. Pendant des années, ce fut très difficile, à
cause des intermédiaires qui achètent leurs stocks à la Feria Libre [le plus grand marché
cuencanais, où l’on retrouve d’importants grossistes qui font venir des productions agricoles
de tout le pays] et qui viennent ensuite les vendre aux consommateurs. Ils ne laissaient pas
beaucoup de place, ils avaient des stands très grands et parfois il fallait presque se battre
avec eux. Pourtant, nous devions nous aussi vendre nos produits pour vivre. Tous mes frères
et sœurs ont émigré aux Etats-Unis il y a bien longtemps. Moi et beaucoup d’autres n’avons
que l’agriculture. C’est pour cela que nous nous sommes unis, pour être plus respectés. Nous
nous sommes adressés à la Municipalité de Cuenca pour avoir son appui, et en 2000, nous
sommes devenus un groupe de producteurs juridiquement reconnu. Aujourd’hui nous avons
gagné en visibilité sur presque tous les marchés de la ville. »
Pour plusieurs anciens migrants de retour dans la localité, il importait d’investir dans
l’agriculture, comme nous le dit Salvador : « j’ai beaucoup migré parce qu’ici
l’agriculture traditionnelle [sous-entendu, la production de maïs et de tubercules] n’est pas
rentable. Avec peu de terre, il faut produire des choses qui se vendent bien si l’on veut vivre
dignement. En 1972, j’ai assisté à un atelier du ministère de l’Agriculture sur la fruiticulture.
Je me suis alors mis à produire des pommes, et bientôt il y en eut un peu partout dans la
localité. Plus tard, au Venezuela et aux Etats-Unis, j’ai visité de grandes exploitations et je
me suis dit que je pouvais faire pareil chez moi. Dans les années 1980, nous étions un groupe
de producteurs de pommes et nous recevions l’appui du CREA. Il y a même une chaîne de
télévision de Guayaquil qui est venu nous voir pour faire un reportage. Mais nous ne
vendions pas la production. Nous consommions tout et parfois nous en donnions même aux
vaches ! Après avoir migré de nouveau je suis revenu et j’ai construit deux serres pour
produire des fruits. Mais il a fallu se battre pour avoir le droit de les vendre de manière
officielle à Cuenca. Ce n’est que depuis 2000 que je dispose d’un poste sur les marchés
urbains. »
Le témoignage de Salvador est très intéressant car il nous indique qu’au-delà des apports
financiers, la migration est, dans certains cas, source d’expériences qui sont ensuite mises à
profit par les individus pour développer de nouveaux systèmes de production au moment de
128
retourner dans leurs exploitations. En revanche, il confirme aussi que la stratégie migratoire
n’est pas synonyme de changement immédiat, comme nous l’avions souligné dans le
Chapitre 3, et qu’elle ne garantit pas obligatoirement l’essor de l’activité marchande, même si
le capital investi est important. A l’inverse, les propos de Natividad et d’Alejandrina nous
révèlent que dans le contexte migratoire, les prises d’initiatives individuelles ou collectives
des paysans sont déterminantes pour lutter contre le manque de main-d’œuvre, et surtout, pour
entraîner la reconnaissance des agriculteurs familiaux par les institutions publiques.
Cependant, notre analyse serait incomplète si nous ne précisions pas que la mobilisation
paysanne dans la paroisse Octavio Cordero Palacios, outre le fait qu’elle fut en partie
encouragée par l’Eglise, n’aurait pas été possible sans la présence d’une ville comme Cuenca,
dont la population a triplé au cours des quarante dernières années. De toute évidence, la
croissance urbaine régionale a favorisé le développement de cultures marchandes dans les
campagnes de l’Azuay, comme cela s’est déjà vu par exemple au Burkina Faso, et plus
précisément dans la région de Bobo-Dioulasso, où l’essor de productions fruitières et
maraîchères a démontré « la capacité de réaction du secteur agricole quand la demande
solvable existe » (Tallet, 1999 : 58).
��&!���'(�� �)#!���#'$�!��#��!���#'
$�!�)�!!�$����'���'����*+��,-�-
Année 1974 1982 1990 2001 2010
Nombre d'habitants 104 470 152 406 194 981 277 374 329 928
Source: INEC, Recensements de la population (1962/2010).
Enfin, il ne faudrait pas ignorer les effets de l’amélioration des transports collectifs dans la
région cuencanaise depuis le milieu des années 1990. Si la mobilité des populations
paysannes pouvait être plus contraignante il y a encore trente ans, de nos jours, les
innombrables bus qui sillonnent quotidiennement, et à toute allure, les routes qui conduisent à
Checa, Chiquintad, Sidcay, San Joaquín ou Baños, témoignent de relations intenses entre la
troisième ville équatorienne et les campagnes qui l’entourent. De fait, les transports collectifs
ont joué un grand rôle pour favoriser l’intégration des producteurs de la paroisse Octavio
Cordero Palacios à l’économie cuencanaise, ce qui est comparable à l’observation faite par
129
M. Jobbé-Duval, laquelle a montré que dans la région de Cochabamba, dans les Andes
boliviennes, l’amélioration des conditions de transports à partir des années 1960 a permis le
développement d’une filière pomme de terre qui assure depuis des revenus stables aux
exploitations familiales (Jobbé-Duval, 2005).
Ainsi, les relations que les agriculteurs de la paroisse Octavio Cordero Palacios entretiennent
avec la cité azuayenne, à laquelle ils sont liés par une ligne de bus régulière, sont désormais
plus étroites, en témoigne le fait que pour désigner Cuenca, ils n’hésitent plus à employer
l’expression « el centro » (« le centre »), comme s’ils ne se trouvaient plus tout à fait dans une
localité rurale, mais plutôt dans une sorte de quartier éloigné du cœur de la ville.
��#�#.������'(,/ 0�'���#0�1���'��10�'���#0�
Chaque matin, les paysans de la paroisse Octavio Cordero Palacios se rendent à Cuenca pour aller vendre leurs produits. En début d’après-midi, ils reprennent le bus, cette fois direction « Santa Rosa ». Source : N. Rebaï (2008).
Au cours des deux dernières décennies, la mutation du système agraire de la paroisse Octavio
Cordero Palacios s’est donc exercée sous une double influence : celle de la migration d’abord,
qui a contraint la plupart des familles paysannes à réduire les superficies qu’elles consacraient
aux cultures de cycles longs, et celle de la proximité urbaine, qui a favorisé le développement
130
de cultures maraîchères destinées grande en partie à la vente. Dans ces conditions,
l’organisation du travail quotidien au sein des exploitations a logiquement évolué.
� , �� � ��� �� ��� ���� ��� ��� ��
La production maraîchère est pour les paysans de la paroisse Octavio Cordero Palacios une
manière de procéder à une meilleure mise en valeur de leur terre, en travaillant plus
intensément sur de petites surfaces. Cette orientation productive est néanmoins rythmée par
certaines priorités quotidiennes qu’il nous faut expliquer.
� , � ������������ ���2����� �"���� ��
Dans la plupart des exploitations maraîchères, les légumes sont cultivés en plein champ, sur
des parcelles allant de 100 à 400 m², ou parfois dans de petits jardins potagers de moins de 50
m² collés aux maisons et protégés des animaux par des clôtures en bois. On y trouve alors des
salades, des choux, des choux-fleurs, des brocolis, des carottes, des betteraves, des radis, des
oignons, de l’ail, des navets, mais aussi de la blette, du céleri, de l’épinard, du persil, de la
coriandre et plusieurs variétés de plantes médicinales comme la camomille. S’agissant de
cultures de cycles allant de un à trois mois, les cultivateurs peuvent disposer chaque semaine
de la plus grande variété de légumes possible, pour s’assurer de bonnes ventes au marché.
��&!���'(�, �3�!�0$���#$����#'4#3�'0
$�0���'����!�0��!����04���������0���0�'��0$�'0!����#�00�#���)�#�#�$��#��!���#0
Produits Durée
de cycle moyen Produits
Durée
de cycle moyen
Ail 3 mois Chou-fleur 2 mois
Betterave 2 mois Coriandre 2 mois
Brocoli 1 mois Epinard 2 mois
Blette 3 mois Oignon 45 jours
Camomille 2 mois Persil 3 mois
Carotte 3 mois Navet 1 mois
Céleri 1 mois Salade 2 mois
Chou 3 mois Radis 1 mois Source : entretiens réalisés entre juillet 2008 et août 2009.
131
Pour cela, la gestion de l’espace cultivé est fondamentale. Chaque type de produit est
régulièrement planté sur différentes portions du potager. Celui-ci ressemble alors à une grande
mosaïque composée de toutes sortes de légumes qui en sont à différents stades de croissance.
Bien entendu, la superficie des huertos peut varier en fonction de la taille de l’exploitation, de
l’importance de l’élevage bovin et des superficies pâturées qu’il faut donc lui consacrer, et
bien entendu de la main-d’œuvre disponible.
��#�#.������'(, �'�#��.��$�'0!����#�00�#���)�#�#�$��#��!���#0
Sur de longues bandes de plusieurs mètres, les exploitants cultivent toutes sortes de légumes. Certains sont sur le point d’être récoltés (comme au premier plan), tandis que d’autres n’ont été semés que récemment (au second plan). Parfois, les parcelles maraîchères sont délimitées par des clôtures en bois (à gauche). Source : N. Rebaï (2008).
Une autre caractéristique importante de l’activité maraîchère est qu’elle nécessite un apport
important de matière organique. Ainsi, les déjections de cobayes, de volailles et de vaches
sont récupérées par les paysans, puis réutilisées dans les potagers. Néanmoins, les quantités
apportées sont loin d’être suffisantes. Dans ces conditions, les cultivateurs ont recours à
l’achat de sacs d’engrais qu’ils mélangent avec les matières récupérées dans leurs propres
exploitations. Le tout est ensuite mis en terre, après que le sol eut été bêché à la houe. Cela
peut impliquer des coûts élevés, en particulier dans les exploitations où les parcelles
132
maraîchères sont les plus grandes et où les achats de sacs d’engrais peuvent être beaucoup
plus fréquents, comme nous le verrons à travers plusieurs exemples dans le Chapitre 5.
Pour une partie des légumes (carottes, betteraves, radis, oignons, ail et navets), les paysans ont
recours à l’achat de semences (environ 0,02 dollar par graine), tandis que les salades, les
choux ou bien encore les brocolis sont repiqués à partir de plants conservés dans de petites
pépinières situées à proximité des potagers. Les cultivateurs procèdent ensuite à un
désherbage régulier de leurs parcelles, une tâche particulièrement laborieuse pendant les
périodes de fortes précipitations. C’est toutefois au cours de cette période qu’ils obtiennent les
meilleurs rendements, alors que pendant les périodes plus sèches, ils assistent en général à la
baisse des productions.
Quant aux récoltes, elles ont lieu une à deux fois par semaine, en fonction du nombre de
sorties au marché. Logiquement, le temps de travail dédié au maraîchage est élevé : il faut en
moyenne quatre heures par jour à une personne seule pour se consacrer entièrement à une
parcelle d’environ 200 m², mais bien entendu, cela peut varier en fonction des capacités
physiques des individus, mais surtout, en fonction des périodes de l’année. Au cours des
périodes de plus fortes précipitations, le travail de désherbage étant plus important, le temps
de travail passé au sein des huertos augmente inéluctablement. Dans certaines exploitations
qui comptent plusieurs potagers, le travail quotidien peut alors durer sept ou huit heures, sans
compter le temps qu’il faut dédier aux ventes. C’est pourquoi, au cours des dernières années,
les paysans de la paroisse Octavio Cordero Palacios ont développé des productions fruitières
moins exigeantes en travail, leur permettant de diversifier leurs revenus et de compenser
l’investissement quotidien sur les parcelles maraîchères.
� , , ! ��� ��"" � ��� ������� �2�����5� �
Parmi toutes les productions fruitières que l’on trouve aujourd’hui dans la paroisse Octavio
Cordero Palacios, il y a d’abord les productions annuelles (pomme, poire, abricot, figue,
prune) destinées à l’autoconsommation et en moindre partie à la vente. Il s’agit en général de
quelques arbres formant un petit verger à côté de la maison familiale, même s’il arrive que
plusieurs dizaines de pommiers, de poiriers ou de pruniers soient plantés sur une même
parcelle.
133
En dehors de cela, des productions pérennes sont également très présentes. Il s’agit de mûres,
de tomates d’arbre (Cyphomandra betacea Sendt.), de babacos (Carica pentagona Heilborn)
et plus parcimonieusement d’uvillas (Physalis peruviana L.) et de chamburos (Carica
chrysopetala Heilborn). Comme le lait, elles peuvent assurer aux cultivateurs des revenus
réguliers tout en leur permettant de couvrir plus facilement les besoins alimentaires de leurs
familles.
��#�#.������0'(,67,8 $�0��!����09��������0$�'0!����#�00�#���)�#�#�$��#��!���#0
Des tomates d’arbres, des mûres, que l’on trouve dans de nombreuses exploitations…
… et des babacos produits à l’intérieur de serres. Souvent, les produits maraîchers poussent à l’ombre des arbres fruitiers (en bas à droite), un modèle d’agriculture étagée qui permet un gain d’espace important dans beaucoup de petites exploitations. Source : N. Rebaï (2008, 2009).
Si comme nous l’avons constaté en interrogeant les exploitants de la paroisse Octavio Cordero
Palacios, ces cultures se sont beaucoup développées au cours des dernières années, elles sont
néanmoins connues dans la zone depuis longtemps. La tomate d’arbre, par exemple est native
134
de la région andine et très consommée en Equateur comme en Colombie. Les arbres peuvent
être cultivés jusqu’à 2800 mètres d’altitude et produire chaque année près de 250 fruits, sur
une période allant de trois à quatre ans. La mûre est quant à elle adaptée au climat frais et
pousse sans mal jusqu’à une altitude de 3000 mètres (Huttel et al., 1999 ; cf. Tableau n°12).
En revanche, le babaco, originaire des fonds de vallées où le climat est plus chaud, doit être
cultivé sous serre. Il faut alors compter 1 500 dollars environ, entre le matériel et les frais de
construction pour une structure de 300 m². Le babaco nécessite par ailleurs un apport régulier
en eau, ce qui implique l’installation d’un système d’irrigation par goutte à goutte lui aussi
onéreux. Entre le réservoir pour récupérer l’eau de pluie et les dizaines de mètres de
tuyauterie, il faut un apport initial de près de 500 dollars, ce qui suppose des revenus
importants et donc, une activité rémunérée en dehors de l’exploitation. Cependant, lorsque
toutes ces conditions parviennent à être réunies, le rendement peut alors atteindre près de 60
fruits pour chaque arbre planté (cf. Tableau n°12).
��#�#.������0'(,*7/- !���#$����#'$��������$�'0!����#�00�#���)�#�#�$��#��!���#0
Légèrement surélevé, le réservoir peut contenir jusqu’à 300 litres d’eau. L’eau s’écoule ensuite par gravité dans les tuyaux qui sillonnent les rangées de babacos. Source : N. Rebaï (2008).
135
��&!���'(�/ �3�!�0$���#$����#'����'$�4�'�04#3�'0$�0���'����!�0��!����09��������0�''��!!�0
���0�'��0$�'0!����#�00�#���)�#�#�$��#��!���#0
Cultures fruitières Altitude
maximale en mètres
Prix
d’un plant en dollars
Début de la
production
Période de
production
Rendement
annuel par plant
Babaco [Carica pentagona Heilborn]
Sous serre 1,25 9 mois 3 ans 50 à 60 fruits
Tomate d’arbre [Cyphomandra betacea Sendt.]
2800 0,25 13 mois 3 à 4 ans 250 fruits
Mûre [Rubus sp]
3200 1 8 mois 10 à 12 ans variable
Chamburo [Carica chrysopetala Heilborn]
2800 0,5 9 mois 4 à 5 ans 50 fruits
Uvilla [Physalis peruviana L.]
3000 0,25 8 mois 3 ans 24 livres
Sources : Huttel et al. (1999) ; entretiens réalisés avec P. Peñafiel (CEDIR); entretiens réalisés entre mai 2008 et août 2009.
L’avantage de telles productions est bien évidemment leur rentabilité (cf. Tableau n°13).
Même si elles nécessitent un apport régulier en matière organique (environ 5 kg par an pour
un plant de tomate d’arbre ou de babaco) et restent sujettes à des pertes importantes en cas de
froid ou de mauvaises conditions de transport (Huttel et al., 1999), elles permettent aux
cultivateurs d’obtenir rapidement des revenus bien supérieurs aux dépenses qu’elles ont
engendrées.
Sur une superficie de 25 m², où les arbres sont plantés à un mètre d’intervalle, la culture de
tomate d’arbre par exemple, peut générer, d’après nos propres calculs, un bénéfice net de
609 dollars dès la deuxième année (cf. Tableau n°14), alors qu’elle ne contraint qu’à un temps
de travail moyen de quatre heures par semaine pour une personne seule. Cela dit, même dans
les exploitations où la main-d’œuvre est encore importante, il est assez rare que les superficies
dédiées à la culture de la tomate d’arbre dépassent les 30 ou 40 m², les familles paysannes
choisissant le plus souvent de diversifier leurs productions, d’abord pour s’assurer de
meilleures ventes, ensuite pour varier leur propre alimentation. C’est d’ailleurs pourquoi, dans
la plupart des exploitations, les autres productions fruitières comme la mûre, le chamburro et
l’uvilla, sont réduites à quelques arbres ou arbustes, même si comme nous le verrons dans le
Chapitre 5, certaines exploitations spécialisées font le choix d’en cultiver des quantités
autrement plus importantes.
136
��&!���'(� ��'��&�!����#��'���!!�$�0���'����!�0��#$����#'09��������0�''��!!�0
��:0�'��0$�'0!����#�00�#���)�#�#�$��#��!���#0
Type de
culture
Superficie
ou
quantité
cultivée
Production
annuelle
Coût de
production
1ère
année en dollars
Coût de
production
2ème
année en dollars
Prix de
vente en dollars
Bénéfice /
déficit
1ère
année en dollars
Bénéfice /
déficit
2ème
année en dollars
Babaco 300 m² 18 000 fruits
3750 1 750 0,9 fruit 300 16 600
Tomate d’arbre
25 m² 9 000 fruits 225 216 0,1/fruit -225 609
Mûre 5 plants variable 26,5 21,5 1,2/livre variable variable
Chamburo 5 plants 250 24 21,5 0,15/fruit -15 16
Uvilla 5 plants 120 livres 22,75 21,5 1/livre 17,25 98,5
Sources : Huttel et al. (1999) ; entretiens réalisés avec P. Peñafiel ; entretiens réalisés avec entre mai 2008 et août 2009.
Toutefois, c’est en cherchant à mettre en évidence la rentabilité de ces différentes cultures
fruitières que le CEDIR est intervenu auprès des exploitants de la paroisse Octavio Cordero
Palacios (cf. Photographie n°31), comme nous l’expliqua P. Peñafiel : « il a y a un grand
intérêt à promouvoir les cultures fruitières dans ces zones rurales où de nombreuses
exploitations n’ont presque plus de main-d’œuvre. C’est un moyen pour elles d’obtenir un
revenu régulier sans beaucoup travailler. Toutes ces familles paysannes doivent tirer parti du
marché cuencanais. Il y a là-bas une grande demande en fruits, pas seulement en produits
laitiers. La tomate d’arbre est très consommée au petit déjeuner tandis que la mûre et le
babaco sont très appréciés sous forme de jus. Il faut aussi encourager les productions
locales : pourquoi ne consommer que du raisin importé du Chili quand on a ici des produits
de qualité qui peuvent favoriser l’économie rurale? »
137
��#�#.������0'(/� !���#4#��#'$�0��!����09��������0
$�'0!����#�00�#���)�#�#�$��#��!���#0
Ces dernières années, le CEDIR a encouragé la production fruitière auprès de nombreuses exploitations. On voit ici l’un des membres de l’équipe technique de l’institution procéder à la distribution de nouveaux plants. Source : N. Rebaï (2008).
Les exploitants de la paroisse Octavio Cordero Palacios ont donc fait au cours de la dernière
décennie le choix de la diversification agricole et de la rentabilité. Si d’une part, la diminution
de la main-d’œuvre disponible les a conduit à limiter les superficie dédiées aux cultures de
cycles longs pour mieux se consacrer à l’élevage laitier, comme nous l’avons vu dans le
Chapitre 3, de l’autre, la proximité de la ville de Cuenca a favorisé le développement du
maraîchage et de certaines cultures fruitières. Dans ces conditions, le paysage agraire a
profondément changé et il se caractérise dorénavant par de nombreux éléments originaux.
� / ������ ��2����
Il y a moins de vingt-cinq ans, A.L. Borrero insistait sur le fait que les campagnes de l’Azuay
étaient très largement dominées par la culture du maïs (Borrero, 1989). Depuis, plusieurs
facteurs, parmi lesquels la migration des populations paysannes et la croissance urbaine
régionale, ont donné lieu à la recompostion des systèmes de productions familiaux et, plus
138
largement, à la transformation des finages, comme c’est le cas dans la paroisse Octavio
Cordero Palacios.
Sur la Photographie n°32 (à suivre), prise en hauteur pour une meilleure vision d’ensemble de
l’espace agraire, six longues parcelles de moins d’un hectare, sorte de « champs en lanières »
(Gourou, 1973 : 9), sont alignées au bord de la route qui conduit à Cuenca. Les clôtures qui
les séparent sont faites de fils barbelés et de tronçons de bois d’eucalyptus, un arbre que l’on
trouve abondamment dans la sierra depuis qu’il y fut massivement introduit à la fin du
XIXe siècle (López, 2001). Sur ces parcelles, le maïs est réduit à des petits bouts de terres
éparpillés au milieu des pâturages qui occupent majoritairement l’espace. Au centre de
l’image, on distingue un lopin de quelques mètres carrés de terre brune, sur lequel des salades
et des choux sont cultivés, ainsi que deux serres de dimensions réduites, dans lesquelles des
babacos sont produits tout au long de l’année. Plus bas, une tache d’un vert plus sombre
indique la présence d’un verger de quelques dizaines de mètres carrés composé de pommiers,
de poiriers, de pruniers et de mûriers.
Sur la photographie n°33 (à suivre également), prise de plein pied pour une vision réduite à
une seule parcelle, le maïs a cette fois complètement disparu. Là encore, l’espace est
majoritairement dédié aux pâturages, au milieu desquels on retrouve un grand potager. Au
second plan, on distingue une belle et grande maison, comme il en apparaît d’ailleurs sur le
cliché précédent. Dans la paroisse Octavio Cordero Palacios, les anciennes constructions en
adobe sont désormais à peine visibles à côté des nouvelles constructions « en dur ». Comme
l’écrivit M. Cote dans son analyse des dynamiques rurales en Algérie, la migration en milieu
rural est une dynamique propice au « renouvellement du parc de l’habitat » (2005 : 75). Ces
nouvelles constructions, sortes de « géosymboles » (Bonnemaison, 1981 : 257) car elles
témoignent de l’importance de la dynamique migratoire à l’échelle locale, permettent à
certains migrants de montrer leur réussite économique. Elles ont aussi pour fonction de
maintenir un lien avec l’Equateur, comme l’achat de terre, et de mettre à l’abri le reste de la
famille resté sur place. Toutefois, l’apparente modernité de ces nouvelles demeures contraste
avec un intérieur plus vétuste, où le mobilier et les équipements restent le plus souvent limités
à quelques éléments anciens.
140
Les mutations de la paroisse Octavio Cordero Palacios ont donc été particulièrement
importantes ces dernières années, en témoignent les nouveaux systèmes de cultures
développés dans les unités de production et les changements dans les modes d’habiter.
Toutefois, si nous avons indiqué plus haut que désormais, les exploitations familiales se
consacrent davantage au maraîchage et à la production de fruits pour la vente, il convient à
présent de décrire plus spécifiquement l’activité marchande, et pour cela, d’étudier les réseaux
auxquels appartiennent les petits producteurs pour approvisionner le marché cuencanais.
, !�� ��2�������� �� ����������� ;���"��� ������"������ � ���<��=
L’orientation vers le maraîchage est aujourd’hui une solution rationnelle d’utilisation de la
main-d’œuvre disponible dans le contexte migratoire : l’intensification du travail sur de
petites surfaces, complétée par le développement de l’élevage, permet à un grand nombre de
familles paysannes de la paroisse Octavio Cordero Palacios de pallier l’absence de certains de
leurs membres, de produire une partie de leur alimentation, et surtout, de tirer des revenus
réguliers de la vente de produits frais. Cependant, il a fallu pour cela que différents acteurs
agissent pour sécuriser leur accès aux marchés urbains. Pour comprendre comment s’est
opérée l’intégration des agriculteurs familiaux, il a donc fallu que nous passions côté ville
pour nous intéresser à l’action de plusieurs institutions publiques ayant œuvré ces dernières
années pour la création d’associations régionales de producteurs. Ainsi, nous avons mené des
entretiens à Cuenca, pour que les représentants de ces institutions nous expliquent leur
mission à l’échelle régionale. Avec eux, nous avons discuté sur les marchés cuencanais, où il
fut le plus simple de les rencontrer, ce qui nous a donné l’occasion de mieux comprendre
l’organisation des espaces de vente et le rôle que jouent à présent les petits producteurs des
campagnes azuayennes dans l’approvisionnement de la ville de Cuenca en produits agricoles.
, � $ ��""��������������� �� �2�� ��� ������������ "�=���� >
C’est à partir du milieu des années 1990 que la Municipalité de Cuenca lança son Programme
d’Agriculture Urbaine (PAU), en faisant appel à une équipe d’agronomes cubains pour
promouvoir l’agroécologie dans les périphéries rurales de la cité azuayenne. Ce fut pour
M. Carbajal, technicien au PAU, un acte fondateur qui permit de faire « le pont entre la ville
141
et la campagne. Dans ce projet, il y avait un objectif très simple : trouver un moyen pour que
les paysans fournissent des produits sains aux consommateurs urbains. » Toutefois, ce n’est
que quelques années plus tard que le lien se fit, après que les revendications de plusieurs
groupes de vendeurs informels originaires des périphéries rurales furent entendues, comme
nous l’avons d’ailleurs évoqué à travers le témoignage d’Alejandrina en début de chapitre.
Pour mieux les intégrer aux espaces de ventes, la Municipalité décida justement de les
orienter vers le maraîchage agroécologique.
Dans un premier temps, le PAU se chargea de sensibiliser les paysans à certaines règles
fondamentales de production (utilisation interdite d’intrants chimiques, fabrication de
compost au sein de l’exploitation, diversification des plantes cultivées, etc.) en multipliant les
ateliers de formation dans diverses localités rurales. Puis, la Municipalité accorda à ces
mêmes paysans le statut officiel de « Producteurs Agroécologiques de l’Azuay », ce qui allait
considérablement changer leurs rapports avec les consommateurs.
��#�#.������'(/ �'��00�4&!��$�0��#$������0�.�#��#!#.�?��0$�!��@��3�',--*
Dans une salle mise à disposition par la Municipalité de Cuenca, les producteurs se sont réunis pour débattre des objectifs de l’association. Dans l’assistance, les femmes sont grandement majoritaires. Source : N. Rebaï.
142
Comme nous l’expliqua R. Cabrera, le coordinateur du PAU, « avec la création de cette
association régionale, il y avait plusieurs points positifs. Nous pouvions favoriser
l’agriculture locale et donc permettre à de nombreux paysans de s’en sortir, alors que la
majorité d’entre eux sont pauvres. Dans de nombreuses paroisses, l’émigration est très
importante et pour beaucoup de femmes seules, cela convient parfaitement : elles peuvent
venir au marché vendre leurs produits et avoir de bons revenus. Et puis pour les
consommateurs, c’est aussi une garantie de qualité. Il y a donc des intérêts communs autour
de l’agroécologie. Sur les marchés, on constate que les clients préfèrent les produits locaux.
C’est une vraie fidélisation. » Au fil du temps, l’association grossit et la vague
agroécologique aboutit à la formation d’un deuxième grand groupe de producteurs sous
l’influence du Centre de Reconversion Economique de l’Austro (CREA), une autre institution
majeure dans la région.
Créé en 1957, sous l’impulsion commune des autorités politiques de l’Azuay, du Cañar et du
Morona Santiago, pour endiguer la crise économique régionale entamée par l’effondrement de
la filière Panamá, le CREA eut pour mission tout au long des dernières décennies
d’encourager les initiatives économiques locales et d’appuyer en particulier l’agriculture
paysanne des provinces australes de l’Equateur. Pour cela, il a par exemple fourni une
assistance technique aux petites exploitations, participé à la distribution d’intrants et mis sur
pied de nombreux projets d’irrigation à l’échelle de petits bassins versants. Au début des
années 2000, il prit lui aussi la voie de l’agroécologie et mis sur pied l’association des
« Producteurs Agroécologiques de l’Austro », sur les mêmes bases théoriques que
l’organisation municipale, comme nous le confirma A. Palaguachi, ingénieur agronome au
sein de l’institution : « l’intérêt d’une telle structure, c’est qu’elle offre aux paysans un accès
régulier au marché et des produits sains pour les consommateurs. Sur notre foire, il y a des
cultivateurs qui viennent de trois provinces [Cañar, Azuay, Morona Santiago], avec des
produits variés, ce qui en fait un espace de vente très intéressant qui se distingue des autres
marchés de Cuenca. »
La création des deux associations, celle des Producteurs Agroécologiques de l’Azuay
(Municipalité de Cuenca) et celle des Producteurs Agroécologiques de l’Austro (CREA),
conjuguée aux efforts de structures plus modestes qui œuvrent pour le développement de
l’agriculture paysanne, comme le CEDIR dans la paroisse Octavio Cordero Palacios,
correspond en définitive à la mise en place de « techniques d’encadrement » (Gourou, 1976)
143
de la production agricole et du ravitaillement urbain dans la province de l’Azuay. Ces
dernières années, elles ont agi sur « le modelé et la transformation des paysages » (ibid : 17),
produit une nouvelle organisation du travail agricole et renforcé le sentiment des petits
exploitants d’être reconnus comme des acteurs importants de l’approvisionnement du marché
cuencanais en produits frais. L’institutionnalisation du ravitaillement urbain ne s’est toutefois
pas arrêtée là : elle a même conduit à la reconfiguration des différents espaces de vente de la
ville.
, , >A��������������2��� �� � ���������������
Pour la Municipalité de Cuenca comme pour le CREA, l’agroécologie est un moyen efficace
pour lutter contre la pauvreté paysanne : elle sécurise l’accès au marché et garantit des
revenus aux producteurs locaux désormais labellisés. Cependant, au-delà de ces principaux
arguments, il faut voir dans l’émergence de ces deux associations la volonté commune de
lutter contre l’informalité et donc, de maintenir l’ordre sur les marchés. C’est d’ailleurs ce que
nous a confirmé J. Astudillo, l’administrateur du marché 3 de Noviembre situé dans le centre
de Cuenca : « il ne faut pas se tromper, ni être trop naïf : les associations de producteurs
permettent avant tout d’ordonner l’espace public. Le centre historique de Cuenca est classé
au patrimoine de l’humanité [depuis 1999] et il revient donc à la Municipalité de maintenir
les rues propres et dégagées. »
Cela correspond au final à ce qui a pu se dérouler dans les centres de nombreuses villes latino-
américaines. Après avoir été ignorés des pouvoirs publics pendant plusieurs décennies, ils
sont devenus au cours des années 2000, l’objet de grands programmes de réaménagement,
dont le double objectif fut de glorifier le patrimoine et d’exclure les populations non solvables
(Rivière d’Arc, 2006). C’est dans ce contexte, que depuis 2008, s’est amorcé le
réaménagement du quartier 9 de Octubre, le plus populaire du centre-ville cuencanais, au
milieu duquel on retrouve un marché très animé (cf. Photographies n°35/38). Avec la
présence de gardes à l’entrée du nouvel édifice commercial, il est devenu impossible pour les
paysans de venir y vendre leurs produits, et même lorsqu’ils décident de s’installer dans les
rues adjacentes, la police est souvent là pour les déloger. Pour les paysans de la région, et plus
spécialement pour ceux de la paroisse Octavio Cordero Palacios, qui avaient pour habitude de
venir au marché 9 de Octubre depuis longtemps, cette situation contraint à chercher d’autres
144
espaces de ventes informels plus éloignés ou à frapper à la porte de l’une des deux
associations de producteurs.
��#�#.������0'(/67/8 !����4�'�.�4�'�����'�$�4��������������
Prises à deux ans d’intervalle, ces photographies montrent la transformation de l’un des quartiers centraux de Cuenca. En 2007, la place 9 de Octubre grouillait de monde, tandis qu’aujourd’hui, l’espace de vente est sécurisé et les vendeurs informels relégués dans des rues plus éloignées. Source : N. Rebaï (2007, 2009).
Néanmoins, l’entrée dans l’un des deux groupes ne se fait pas sans difficulté. La démarche est
même particulièrement longue, compte tenu du nombre de postulants à un poste de vente
officiel inscrits sur liste d’attente. Cela commence par une visite de l’exploitation par des
techniciens chargés de vérifier si le paysan dispose d’assez de ressources pour vendre
régulièrement ses produits, car il n’est pas question d’être absent du marché plus de trois jours
par an, sous peine de renvoi. En outre, il importe aux ingénieurs de ne pas trouver de produits
chimiques et de vérifier si l’agriculteur est capable de produire son propre compost. Si tout se
passe bien, il n’y a pas besoin de seconde inspection ; dans le cas contraire, le paysan doit
145
attendre de nouveaux plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour un second diagnostic de
son exploitation, car les équipes du PAU et du CREA sont particulièrement réduites. Ensuite,
le futur membre doit s’acquitter d’un droit d’entrée de 50 dollars36, auxquels viendra s’ajouter
ensuite 1 dollar en moyenne par jour de marché, pour la location du stand (cf. Photographies
n°39/40).
L’entrée n’est pas cependant pas immédiate et les néo-producteurs agroécologiques doivent le
plus souvent attendre qu’un espace leur soit libéré sur le marché auquel ils ont été affectés.
Compte tenu du succès de ces deux associations (cf. Annexe n°13), on assiste depuis plusieurs
mois à une saturation des espaces de vente, en particulier ceux de la Municipalité, comme
nous l’expliqua M. Vintimilla, administrateur de la foire de Miraflores : « le problème qui se
pose aujourd’hui est le manque d’espace. L’idée d’intégrer plus de producteurs
agroécologiques est très bonne, mais où voulez-vous les mettre ? Il ne faut pas oublier que les
intermédiaires jouent eux aussi un rôle important. Ils vendent tout ce que les paysans ne
produisent pas : des fruits [bananes, mangues, citrons, oranges], des épices, du cacao, du
poisson, de la viande, etc [cf. Photographies n°41/42]. Nous ne pouvons pas les sacrifier. Il
faut donc envisager d’ouvrir d’autres points de ventes. » C’est dans ces conditions que
dorénavant les deux institutions imposent des normes de production plus strictes, pour limiter
le nombre de nouveaux producteurs et ainsi mieux réguler l’accès aux marchés.
Le mode d’intégration des paysans au sein des associations de producteurs est donc
particulièrement complexe. Il l’est d’autant plus qu’en réalité, la Municipalité de Cuenca et le
CREA procèdent suivant une logique d’exclusion car les deux associations n’intègrent que
très rarement les populations les plus pauvres de l’espace rural régional, celles qui disposent
de très peu de terre et qui ne sont pas en mesure de payer un droit d’entrée élevé37. Autrement
dit, elles laissent en marge des dynamiques commerciales les familles paysannes qui sont a
priori les plus vulnérables et qui auraient un besoin prioritaire d’appui institutionnel (cf.
Photographies n°43/44).
36 Le tarif est le même pour les deux associations.
37 Même si l’association municipale autorise à régler ce droit d’entrée en plusieurs fois.
146
��#�#.������0'(/*7 !�)�0�&�!���$�0��#$������0�.�#��#!#.�?��0
0��!�04�����0���'��'��0�',--*
Les stands et les uniformes verts donnent aux Producteurs Agroécologiques de l’Azuay une grande visibilité sur la Foire de Miraflores…
… même si les intermédiaires occupent la plus grande partie de l’espace de vente.
De leur côté, les vendeuses informelles dans le quartier 9 de Octubre doivent lutter au milieu de la circulation… quand ce n’est pas la police qui vient les déloger brutalement. Source : N. Rebaï.
147
, / ! �������������� "������ ���B�� ��������"����������� ����� �C
Malgré certaines faiblesses dans le mode d’intégration, l’Association des Producteurs de
l’Azuay réunissait 218 membres en 2009. Pour chacun d’entre eux, deux ventes
hebdomadaires avaient lieu. La première, en semaine (du lundi au vendredi), sur le marché 12
de Abril ou à la foire de Totoracocha ; la seconde, le samedi ou le dimanche, sur le marché 12
de Abril, à la foire de Miraflores ou bien encore à la foire de Ricaurte. Suivant ce système,
chaque producteur peut bénéficier de la plus grande fréquentation des espaces de vente en fin
de semaine, même si entre eux, les affluences peuvent beaucoup varier en fonction de leur
localisation. Le marché 12 de Abril et la foire de Miraflores sont par exemple deux espaces de
vente très fréquentés, le premier parce qu’il se situe tout près du centre ville, le second parce
qu’il se trouve au milieu d’un quartier ouvrier densément peuplé. A l’inverse, la foire de
Totoracocha est particulièrement éloignée du centre et celle de Ricaurte n’attire en réalité que
les habitants de cette localité située dans la périphérie de Cuenca (cf. Carte n°13).
��#�#.������'(6 $�0��#$������0�.�#��#!#.�?��0$�!��@��3�',--*
Alejandrina (au centre) est présente chaque samedi à la foire de Miraflores. Son uniforme vert lui permet de se distinguer auprès des ménagères cuencanaises. Source : N. Rebaï.
148
Pour sa part, l’Association des Producteurs de l’Austro regroupait 77 membres en 2009. Dans
leur cas, les ventes n’ont lieu qu’une fois par semaine, le samedi, à la foire agroécologique du
CREA située à l’ouest du centre ville de Cuenca (cf. Carte n°13). Aux dires des producteurs,
cette unique sortie hebdomadaire n’est pas un désavantage. La foire du CREA ne réunit en
effet que des producteurs agroécologiques, ce qui la distingue des autres espaces de ventes
urbains, souvent encombrés et très mouvementés. Ainsi, les ventes s’y déroulent dans une
atmosphère conviviale, au milieu de quelques rangées de vendeurs. Ce contexte singulier
attire une clientèle nombreuse et régulière qui vient profiter de prix inférieurs à ceux pratiqués
sur les marchés du centre ville.
��#�#.������'(D !�9#����.�#��#!#.�?��$������',--*
Chaque samedi, les producteurs agroécologiques de l’Austro vendent leurs produits dans d’excellentes conditions. Source : N. Rebaï.
Car l’intérêt des associations régionales de producteurs agroécologiques réside bien là : elles
fournissent aux populations urbaines des denrées de qualité à des coûts très avantageux. Sur
des produits de consommation courante comme les fruits, les œufs et les produits maraîchers,
les prix peuvent être de 30 à 70% inférieurs à ceux pratiqués par les vendeurs intermédiaires
du centre ville (cf. Tableau n° 14). Ce constat a d’ailleurs de l’importance à Cuenca, où le
149
coût de la vie est depuis plusieurs années le plus élevé d’Equateur, du fait de l’isolement
historique de la région australe par rapport à l’axe Quito-Guayaquil (Deler, 1981), et surtout,
de l’importance de l’émigration internationale et du tourisme qui ont favorisé la circulation
d’argent dans la cité azuayenne, et provoqué ainsi une inflation des prix. En juillet 2012, le
coût du panier de la ménagère cuencanaise était ainsi de 607,44 dollars, contre seulement
585,81 dollars en moyenne pour celui de huit des plus grandes villes du pays38 (INEC, 2012).
Une ombre au tableau cependant, le prix du poulet, presque quatre fois supérieur à celui
proposé par les intermédiaires, alors qu’il s’agit sans le moindre doute de la viande la plus
populaire d’Equateur. Mais même sur ce point, les producteurs disent avoir un avantage, leurs
poulets étant « plus savoureux et meilleurs pour la santé » que ceux élevés en batterie dans les
grandes exploitations avicoles du pays, ce qui leur permet à coup sûr, de les écouler.
��&!���'(�6 �#4�����0#'$�0���E4#3�'0$�������#$���0$��#'0#44���#'�#���'��
�����?��00����#�04�����0$���'���)�!!�$����'�����!�9#���$�����
�'���0����4&��,--8��F�')���,--*
Prix en dollars
Produits Centre ville 9 de Octubre, 10 de Agosto,
12 de Abril (1)CREA (2) Différence
Salade (unité)
0,8 0,18 -75%
Chou-fleur (unité)
0,85 0,26 -71%
Chou (unité)
0,27 0,24 -11%
Tomate d’arbre (unité)
0,13 0,1 - 30%
Mûre (livre)
1,03 1 -3%
Fromage (livre)
1,45 1,25 -14%
Œufs (par 5)
2,76 1,05 -56%
Poulet (entier)
2,38 8,27 +350%
Sources :1) : Indice des prix au consommateur (2008-2009), INEC (2009) ; 2) : enquêtes commerciales réalisées auprès de 5 producteurs agroécologiques originaires de la paroisses Octavio Cordero Palacios. Calculs et mise en forme: N. Rebaï.
38 A savoir Guayaquil (2,3 millions d’habitants), Quito (1,6 millions d’habitants), Cuenca (329 928 habitants), Machala (241 606 habitants), Manta (217 553 habitants), Loja (180 617 habitants), Ambato (178 538 habitants) et Esmeraldas (154 035 habitants). Source : INEC, Recensement de la population (2010).
150
L’essor des associations de producteurs agroécologiques dans la région cuencanaise est
révélateur de profonds changements, à la campagne comme à la ville. Il indique tout d’abord
une mutation de l’agriculture familiale, mieux intégrée à l’économie urbaine que dans le
passé. Il démontre aussi une certaine volonté chez les pouvoirs publics d’améliorer les
conditions de vie paysannes, en s’appuyant pour cela sur l’idée très à la mode de
« développement durable », tout en maintenant l’ordre dans les quartiers commerçants de la
cité cuencanaise. En allant au marché, l’observateur pourrait croire que la présence de
producteurs agroécologiques introduit une nouvelle forme de concurrence avec les marchands
intermédiaires. Il aurait partiellement raison puisque l’on observe effectivement des signes de
fidélisation, de la foire du CREA à celle de Miraflores. Mais il aurait tort, en partie, car la
dynamique commerciale n’en est pour le moment qu’à ces débuts. En 2009, sur les 6 000
postes de ventes disponibles à Cuenca, à peine plus de 300, soit 5% d’entre eux, étaient
occupés par des producteurs locaux.
Le développement de l’agriculture commerciale dans la périphérie rurale de Cuenca demeure
donc encore limité, mais il confirme toutefois que les circuits courts d’approvisionnement
peuvent être très efficaces, d’une part, pour assurer un revenu régulier aux agriculteurs,
d’autre part, pour garantir des prix bas aux consommateurs. Dans le contexte azuayen, il est
nécessaire de rappeler le rôle déterminant des femmes, qui représentaient 87% des
producteurs agroécologiques en 2009, d’après les registres officiels du PAU et du CREA, et
qui à l’image des paysannes de la vallée du fleuve Sénégal, montrent toute leur capacité à
diriger les exploitations et à intégrer dans le même temps l’économie urbaine en l’absence des
hommes (Dia et Adamou, 2009).
En dépit des contraintes dues à l’émigration, les femmes apparaissent ainsi comme les
garantes de l’activité économique en milieu rural, comme en attestent d’ailleurs de
nombreuses études de cas ayant mis en valeur « l’inventivité » féminine dans les campagnes
des pays en développement (Granié et Guetat-Bernard, 2006). Toutefois, si certaines
exploitations ont aujourd’hui gagné en dynamisme, parce qu’elles se trouvent intégrées à des
réseaux de producteurs, il est probable que beaucoup d’autres se maintiennent dans une
situation de grande précarité. C’est en tout cas ce que nous chercherons à savoir en
poursuivant notre analyse.
152
�����������
Dans de nombreuses régions des Suds, l’agriculture familiale offre de grandes possibilités
pour répondre à la demande urbaine en produits agricoles. A Tananarive par exemple, qui a
connu ces dernières décennies une croissance démographique accélérée, les filières
maraîchères et fruitières connaissent un regain d’importance (Rabenanambola et al., 2009).
Dans ces conditions, on observe un rapprochement entre la ville et la campagne, les petites
unités de productions étant plus facilement intégrées à l’économie urbaine, et les citadins
ayant une consommation alimentaire beaucoup plus locale. S’il se dessine alors de véritables
îlots maraîchers en périphérie des villes, les réseaux d’approvisionnement apparaissent mieux
structurés, comme c’est le cas dans la région d’Hanoï, où les agriculteurs se consacrent
pleinement à la commercialisation de leurs produits et fournissent une part majeure des
denrées maraîchères aux détaillants (Moustier et al., 2004). Dans ces conditions, les revenus
des exploitations n’en sont que plus réguliers, ce qui incite les cultivateurs à privilégier la
demande locale, comme en Afrique de l’Est où certaines cultures de rente comme le café
n’ont « plus la faveur des agriculteurs » (Charlery de la Masselière et al., 2009 : 318), du fait
de l’instabilité des prix internationaux.
En ce qui concerne l’expérience cuencanaise, celle-ci démontre tout d’abord que les pouvoirs
publics peuvent avoir une influence considérable pour faciliter l’intégration des agriculteurs
familiaux à l’économie urbaine, mais elle indique aussi que la dimension écologique est
devenue incontournable dans le discours officiel, comme dans la très grande majorité des
régions du monde où le concept de « développement durable » s’est imposé dans les débats
politiques et scientifiques (Veyret, 2007), bien que parfois cela corresponde davantage à une
« mise en scène » (Latouche, 2004 : 51).
En Equateur, les nombreuses publications en sciences sociales, sur les thèmes de la durabilité
(Martínez, 1997 ; Larrea 2006 ; Albán et al., 2009) et de l’agroécologie (Yurgevic 1997 ;
Alvarez et Bustamante, 2006 ; Bustos et Bustos, 2010), ont certainement eu beaucoup
d’influence sur les innombrables institutions qui travaillent en milieu rural, et qui pour
153
certaines, ont eu l’ambition de faire émerger des associations régionales de producteurs. A
Cuenca, cela n’est d’ailleurs pas sans conséquence sociale puisque ces dernières ne
regroupent à l’heure actuelle qu’un nombre limité d’exploitants, tandis que les nombreux
vendeurs informels sont la cible des pouvoirs locaux, pour qui l’aménagement de l’espace
public reste la priorité. Dans ce cas précis, la création des associations de producteurs
correspond tout autant à une stratégie de contrôle des espaces de vente par les autorités, et
l’intégration marchande apparaît comme un facteur de différenciation sociale des agriculteurs
azuayens.
Le contexte migratoire et la croissance urbaine sont donc à l’origine d’une mutation profonde
de la province de l’Azuay, tant du point de vue du discours politique que des relations entre
Cuenca et sa périphérie rurale. Côté campagne, les évolutions semblent néanmoins plus
radicales, avec la disparition progressive des cultures de cycles longs qui assuraient l’essentiel
de l’alimentation paysanne il y encore quelques années. Sans toutefois parler de « révolution
agricole », comme a pu le faire H. Cochet en décrivant les mutations opérées dans les
campagnes burundaises au milieu du XXe siècle (Cochet, 2001), il importe de savoir si les
nouvelles orientations culturales, et le maraîchage en particulier, permettront à moyen terme
de maintenir les unités de productions familiales dans la périphérie de Cuenca. Autrement dit,
nous chercherons à répondre à deux questions au cours des chapitres suivants : les seules
ventes régulières sur les marchés urbains permettent-elles aux petites exploitations de
supplanter l’émigration comme principale source de revenus ? Quels types de contrastes
sociaux peut-on voir apparaître de nos jours, alors que seule une minorité d’agriculteurs
dispose d’un accès officiel au marché urbain ?
155
�������������
L’essor de l’agriculture marchande dans la paroisse Octavio Cordero Palacios est signe d’une
adaptation rapide des groupes paysans à la croissance urbaine dans la province de l’Azuay.
Dans bien d’autres régions des Andes, l’intégration d’agriculteurs familiaux aux circuits
d’approvisionnements régionaux ou nationaux a conduit au renforcement des économies
domestiques, ce qui renforce l’idée que l’accès direct au marché est une condition essentielle
pour le maintien des plus petites exploitations. De nouveau, nous pouvons citer l’étude de
M. Jobbé Duval, dans laquelle il apparaît que le développement de la filière pomme de terre à
Altamachi, outre le fait qu’elle répond à la demande croissante de produits alimentaires sur le
marché de Cochabamba, l’une des principales villes boliviennes, a permis aux exploitants
d’entrer dans un processus de capitalisation, puis de s’équiper de camions, pour faciliter la
commercialisation de leurs productions, et de se constituer des troupeaux de bovins destinés à
fournir une force de traction pour les semis et les labours, facilitant ainsi le déroulement des
tâches agricoles (Jobbé-Duval, 2005).
La formation de réseaux de producteurs agroécologiques dans la région cuencanaise pourrait-
elle être par conséquent une voie de développement pour l’agriculture familiale ainsi qu’une
alternative durable à l’émigration et à la prolétarisation déjà ancienne des foyers ruraux ? Pour
le savoir, il nous faudra porter un regard attentif sur les nouvelles caractéristiques de
l’économie domestique, en comparant précisément les revenus agricoles avec ceux de la
pluriactivité locale et de l’émigration internationale dans plusieurs exploitations de la paroisse
Octavio Cordero Palacios, avant de mettre en lumière les nouvelles formes de disparités
socioéconomiques qui se sont développées ces derniers temps à l’échelle de la localité.
C’est donc logiquement que nous aborderons par la suite la question de la redéfinition du
pouvoir local. Dans de nombreuses régions des Suds, les dynamiques migratoires font
apparaître de nouvelles figures influentes, comme celle des migrants mexicains qui, après
avoir passé plusieurs années dans les métropoles étasuniennes, se muent en véritables
entrepreneurs en créant dans leur pays d’origine de petites unités industrielles en s’inspirant
156
du modèle des maquiladoras (Faret, 2000). Dans la paroisse Octavio Cordero Palacios, le
contexte migratoire pourrait-il conduire à ce genre de changements et faire émerger des
acteurs économiques influents à l’échelle locale ?
A Juncal, nous avions déjà constaté que la migration pouvait entraîner une mutation de
l’économie avec la multiplication des commerces (échoppes alimentaires, quincailleries,
taxiphones), des bus et des camionnettes de transport, mais compte tenu de l’exiguïté du
marché local, nous nous étions aperçus dans le même temps que la plupart de ces
reconversions étaient peu rentables. Nous avions alors émis certaines réserves sur la capacité
des migrants à diversifier leurs activités économiques dans les localités les plus reculées des
Andes rurales.
A l’inverse, la proximité de Cuenca ne pourrait-elle pas être un avantage pour la population
de la paroisse Octavio Cordero Palacios, comme nous l’avons vu précédemment avec le
développement de l’agriculture commerciale ? N’y aurait-il pas la possibilité pour les
exploitations bénéficiant de remesas de moderniser leurs systèmes de productions, par
l’acquisition de matériel sophistiqué, afin de répondre à une demande urbaine et pour
s’assurer de revenus autrement plus importants que ceux des petits producteurs maraîchers ?
Dans ce cas, les contrastes sociaux pourraient être beaucoup plus marqués entre les familles
agricultrices et c’est alors que l’on pourrait observer d’autres phénomènes : le pouvoir des
remesas ne pourrait-il pas aller au-delà même de la seule dimension économique, en
provocant par exemple de nouveaux conflits ?
Pour tâcher de répondre à l’ensemble de ces questions, nous nous intéresserons dans un
premier temps aux facteurs de différenciation économique à l’échelle de la paroisse Octavio
Cordero Palacios, en décrivant pour cela les activités de 10 exploitations (Chapitre 5). Puis,
dans un deuxième temps, nous porterons notre attention sur 4 anciens migrants et nous
verrons dans quelle mesure ces derniers participent aux reconfigurations territoriales de la
localité (Chapitre 6).
157
��������
��� �������������� �������������� ������� �� ����������� ����� � ����
« Ce lieu me plaît ; il a remplacé pour moi les champs paternels ; je l’ai payé du produit de mes rêves et de mes veilles ; c’est au grand désert d’Atala que je dois le petit désert d’Aulnay ; et pour me créer ce refuge, je n’ai pas, comme le colon américain, dépouillé l’Indien des Florides. Je suis attaché à mes arbres ; je leur ai adressé des élégies, des sonnets, des odes. Il n’y a pas un seul d’entre eux que je n’aie soigné de mes propres mains, que je n’ai délivré du ver attaché à sa racine, de la chenille collée à sa feuille ; je les connais tous par leurs noms comme mes enfants : c’est ma famille, je n’en ai pas d’autre, j’espère mourir au milieu d’elle. »
François-René de Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe.
158
Avec l’émergence de grandes associations régionales de producteurs, l’agriculture marchande
dans la paroisse Octavio Cordero Palacios s’est considérablement développée au cours de la
dernière décennie. Dans ces conditions, quels sont les effets directs sur les économies
domestiques ? Les revenus agricoles sont-ils devenus plus importants que ceux de la
pluriactivité locale et de la migration ? Dans quelle mesure les ventes peuvent-elles varier
d’une exploitation à l’autre ?
Pour le savoir, nous proposons d’organiser ce chapitre en trois parties. Tout d’abord, nous
nous intéresserons à cinq petites exploitations appartenant à l’association des Producteurs de
l’Austro. Pour chacune d’entre elles, nous ferons un bilan global de leurs activités
économiques afin d’évaluer l’importance de leurs revenus commerciaux et de la mettre en
balance avec celles des salaires locaux et des remesas. Puis, nous étudierons le cas de deux
anciens migrants ayant réalisé des investissements importants pour moderniser leurs
exploitations, et de la même façon, nous ferons l’inventaire de leurs revenus monétaires, pour
juger de la rentabilité de leurs systèmes de production. Enfin, nous focaliserons notre attention
sur la comuna Illapamba. Nous expliquerons ses mutations au cours des dernières décennies
et nous présenterons les profils de ses différents membres en faisant, comme pour les autres
exemples traités au fil de ces pages, le bilan de leurs activités économiques.
Après avoir expliqué les grandes transformations survenues dans la paroisse Octavio Cordero
Palacios au cours des dernières décennies, ce nouveau chapitre devrait nous permettre
d’explorer la diversité sociale au sein de cette localité, en comparant les systèmes d’activités
de plusieurs exploitations. Ainsi, nous devrions observer avec plus de précision les effets
contrastés de la migration dans cette zone d’étude.
�� �� ������ �� ����������� ���� ������ ��� ����� ��!�� �� ��� ��� ��
� ���� ��������� "���
Le groupe de producteurs agroécologiques Bajo Invernadero réunit Félix, María, Daniel,
Manuel et Natividad, de la communauté de Cristo del Consuelo. Depuis longtemps, ces cinq
exploitants entretiennent de bonnes relations de voisinage, ce qui les a conduit à se réunir
pour travailler ensemble, comme le Père J. les y encouragea il y plus de dix ans maintenant.
159
Depuis 2004, le groupe Bajo Invernadero bénéficie en outre de l’appui technique du CREA,
grâce auquel il est devenu particulièrement dynamique pour la production et la vente de
produits maraîchers sur le marché cuencanais39. Pour le voir, nous proposons de décrire son
organisation avant de nous intéresser plus particulièrement aux caractéristiques de chaque
exploitant.
���� #�� �$�!�� ��� ����� % �� ������� �� ��� �� ��� ����� �� ��� �������
�&�������� ��� ��������� '�
En 2009, parmi la trentaine d’individus que réunissaient les cinq exploitations du groupe Bajo
Invernadero, 18 se consacraient à l’agriculture, dont 10 à plein temps, tandis que 3 occupaient
un emploi permanent à Cuenca, ce qui les empêchait de participer aux tâches agricoles
quotidiennes. Par ailleurs, 9 autres personnes étaient présentes, mais ne se consacraient à
aucune activité économique : il s’agissait soit de personnes âgées, soit de jeunes enfants.
Concernant la population émigrée, on pouvait recenser, toujours à l’échelle du groupe,
8 personnes qui vivaient aux Etats-Unis (cf. Graphique n°3).
Cependant, toutes les exploitations n’étaient pas concernées par la migration de la même
façon. Certaines d’entre elles avaient plusieurs de leurs membres à l’étranger, tandis que
d’autres n’en avaient pas du tout. Toutes ne disposaient pas non plus du même nombre de
personnes ayant un emploi en ville, ni de ressources foncières équivalentes. De là, nous
pouvions supposer que dans chacune des exploitations qui composaient le groupe Bajo
Invernadero, les revenus, les choix culturaux et l’importance des productions commerciales
pouvaient varier. C’est donc bien pour les différents systèmes d’activités qui le composaient a
priori que nous nous avons choisi d’étudier en priorité ce groupe. En nous y intéressant, nous
allions pouvoir effectuer un premier travail de comparaison sur les spécificités de l’agriculture
familiale dans la paroisse Octavio Cordero Palacios, avant d’élargir notre analyse à d’autres
exploitations de la localité.
39 Le nom Bajo Invernadero, qui signifie « Sous la serre », témoigne d’ailleurs de l’ambition initiale des différents membres de ce groupe de s’orienter vers l’agriculture commerciale.
160
(�����)*�+,-����������.+#�/0�01��/#�/2�0����/#*(�.*�����������������
�+2.+���.+#���*�.��*����.+��#���*��.����/���.+
Il faut avouer que la facilité avec laquelle nous sommes entré en contact avec les différents
chefs d’exploitation, par l’entremise du CEDIR, a bien entendu influencé notre choix.
Néanmoins, il nous faut dire qu’après avoir cherché à étudier deux autres petits groupes de
producteurs agroécologiques, il nous a semblé moins pertinent de le faire car aucun ne
présentait la même variété sociale que celui de Bajo Invernadero : le premier, dans le secteur
d’Azhapud, ne réunissait que trois exploitations à la tête desquelles se trouvaient de jeunes
couples n’ayant pas de lien avec la migration, et le deuxième, à Santa Rosa, ne réunissait au
contraire que des exploitations dirigées par des femmes de migrants. Nous avons alors décidé
de consacrer notre temps à étudier le groupe Bajo Invernadero, d’autant qu’il était le seul à
tenir une comptabilité relativement précise de son activité marchande. En ce qui concerne par
161
exemple les producteurs d’Azhapud, le livre de comptes que nous avons consulté était tout
simplement inutilisable, certaines pages étant déchirées et d’autres complètement illisibles.
Ainsi, nous avons commencé par étudier le fonctionnement du groupe Bajo Invernadero.
Compte tenu du manque de main-d’œuvre dans certaines exploitations, les membres qui sont
encore sur place procèdent depuis plusieurs années à des échanges de travail pour les tâches
agricoles, et se rendent chacun leur tour à Cuenca pour vendre les produits de l’ensemble du
groupe. C’est ainsi que María nous l’expliqua : « chaque lundi, nous nous réunissons pour
travailler sur les parcelles de deux membres du groupe. Nous faisons une minga40 le matin, et
une autre l’après-midi. Puis, chaque samedi, nous réunissons nos productions et deux d’entre
nous vont à la foire du CREA s’occuper de la vente. Pour cela, nous devons louer une
camionnette. Cela revient à 1,5 dollars chacun [soit 7,5 dollars hebdomadaires pour le
groupe]. Le dimanche, nous faisons les comptes et nous partageons. »
��.�.(������+,34���/��.#*���*�/#*(�.*�������������������2.���#*�����+5667
Chaque samedi, les petits producteurs maraîchers de Cristo del Consuelo se rendent en ville pour vendre leurs produits. Source : N. Rebaï.
40 Il s’agirait plus précisément de cambio mano mais le fait que les producteurs emploient le terme minga indique qu’ils se situent davantage dans une dynamique collective, où les échanges de travail ont un intérêt social, celui de faire croître la production agricole, pour augmenter leurs ventes et satisfaire plus facilement leurs besoins alimentaires.
162
De plus, chaque mercredi, Mercedes, l’épouse de Daniel, se rend au marché 12 de Abril en
tant que membre de l’association des Producteurs Agroécologiques de l’Azuay. Pour les
autres exploitants du groupe, qui envoient une petite partie de leurs productions,
principalement des légumes, cela constitue un revenu monétaire non négligeable : entre
septembre 2008 et mai de 2009, les ventes moyennes d’un producteur du groupe Bajo
Invernadero était de 120 dollars par mois et provenaient pour 25% de celles du mercredi.
��1���*+,�8����������.+#�/9�+��/(�.1���/:�+#.����/;#*(�.*��#���.#*���*�/
���������������+2.+���.+#�/<.*�/#�0������+���/����01��566=��0��5667
Ventes cumulées du
mercredi Marché 12 de Abril
Ventes cumulées du
samedi Foire du CREA
Total des ventes
1 412,90 4 196,55 5 609,45
Source: livre de comptes du groupe de producteurs Bajo Invernadero. Calculs et mise en forme : N. Rebaï.
D’après le Tableau n°16, on observe que les ventes de l’ensemble du groupe Bajo
Invernadero se maintiennent à un niveau assez élevé (de 450 à 780 dollars) entre les mois de
septembre 2008 et mai 2009. Cela signifie à première vue que les petits producteurs
maraîchers sont en mesure de fournir des produits en grandes quantités (presque) tout au long
de l’année, en obtenant par ailleurs des rentrées d’argent régulières.
��1���*+,�4�9�+��/0�+/*����/:�+#.����/;#�/��+)��.#*���*�/#*(�.*��
���������������+���/����01��566=��0��5667
Producteur Sep.08 Oct.08 Nov.08 Déc.08 Jan.09 Fev.09 Mar.09 Avr.09 Mai 09 Total X
Félix 45,35 77,40 92,55 97,10 105,65 73,65 31,40 28,60 92,10 643,80 71,50
María 293,75 299,05 335,45 249,90 174,25 207,55 163 140,40 169,05 2 032,40 225,80
Daniel 151,40 156 150,75 125,25 187,20 150,95 239,85 213,40 166,10 1 591,40 176,80
Manuel 43,20 57,05 90,25 86,60 65,65 53,55 110,55 77,70 97,65 682,15 75,80
Natividad 80,90 68,70 112,10 65,35 71,90 105,60 58,65 30,35 66,15 659,70 73,30
Groupe 614,6 658,2 781,1 624,2 604,65 591,3 586,3 448,65 519,5 5 609,45 623,3
X = revenu brut mensuel moyen. Source: livre de comptes du groupe de producteurs Bajo Invernadero. Calculs et mise en forme: N. Rebaï.
163
Cependant, si nous examinons de plus près les ventes de chaque producteur à partir du
Graphique n°4, nous nous apercevons qu’elles suivent en réalité des trajectoires en dents de
scie mais que les pics de chaque producteur ne correspondent pas systématiquement. Il y
aurait donc, comme nous l’envisagions plus haut, cinq types d’exploitation dans le groupe
Bajo Invernadero, les écarts de revenus permettant par ailleurs d’aller dans le sens de cette
hypothèse. En outre, cela signifie que les volumes de ventes des producteurs ne sont pas
obligatoirement liés à l’évolution des précipitations, même si comme nous l’avons expliqué
dans le Chapitre 4, celle-ci peut avoir une influence sur le rendement des productions
maraîchères.
(�����)*�+,3��9.�*��.+0�+/*����#�/9�+��/#�/��.#*���*�/#*(�.*����������������
/*���0������������������2.���#*�����+���/����01��566=��0��5667
6
6
�66
�6
566
56
-66
-6
366
������ ������ ������ � ���� �����! "����! #����! �����! #�$��!
���������
����� ���� ����� ��� �� ���������
Source: livre de comptes du groupe de producteurs Bajo Invernadero.
Il nous faut insister à nouveau sur le fait que les chiffres que nous utilisons pour notre étude
ne portent que sur une période de neuf mois et qu’il aurait été beaucoup plus intéressant de
disposer de données s’étalant sur une période plus longue, allant jusqu’à vingt-quatre mois par
exemple, pour comparer les revenus des producteurs d’une année à l’autre, et juger ainsi de
164
l’influence des précipitations et des conséquences des périodes de vacances, en juillet, août et
décembre, qui d’après les producteurs, engendreraient une baisse de la fréquentation des
marchés cuencanais et donc une diminution des volumes de ventes. Malheureusement, notre
travail de terrain fut trop court, mais il nous laissa tout de même assez de temps pour étudier
les originalités du groupe de producteurs Bajo Invernadero.
Il est donc temps de faire une analyse détaillée des ventes au niveau de chaque exploitation,
avant d’inclure dans les bilans économiques les sources monétaires extérieures (ventes
informelles, pluriactivité locale, remesas, etc.) et les principales dépenses agricoles (achats de
semences, d’engrais, de fourrages, etc.). Nous pourrons alors déterminer si les ventes sur les
marchés urbains suffisent à couvrir les dépenses globales des exploitations, ou si au contraire,
ces dernières demeurent fortement dépendantes de revenus extérieurs. Ainsi, nous
parviendrons à comparer l’importance des différentes sources de revenu au sein de chaque
système d’activité familial. L’ordre dans lequel nous avons choisi de présenter les cinq
familles n’est pas anodin. Nous souhaitons commencer par les deux cas les plus concernés par
la migration (Félix et María), avant de poursuivre par un cas mixte de migration et de
pluriactivité locale (Daniel), et de conclure par les deux dernières exploitations qui ne
comptent aucun membre émigré (Manuel et Natividad).
��5�2�� > ���& ������������&���'���������������
Félix et sa femme vivent seuls depuis que leur dernier fils a rejoint ses quatre frères et sœur
aux Etats-Unis en 2005. Ils possèdent environ 1,5 hectare de terre, divisés en plusieurs lots
provenant de différents héritages. Sur le principal terrain de l’exploitation (1 hectare), Félix et
son épouse possèdent leur maison, un carré de maïs de quelques mètres, un petit potager
(50 m²), une cinquantaine de pommiers, un peu d’herbe pour une centaine de cobayes
(cf. Photographie n°48) et une quinzaine de volailles. Les deux autres lopins (0,5 hectare au
total), situés à quelques minutes de marche, sont laissés en pâturages pour nourrir deux vaches
laitières.
165
��.�.(������+,3=��&�?��.�����.+#�2���?:�;
Félix est fier de nous montrer son élevage de cobayes, lequel lui permet de s’alimenter et d’obtenir des revenus réguliers. Source : N. Rebaï (2008).
En parallèle de cela, Félix travaille a medias sur la terre de son voisin : sur près d’un demi
hectare, il cultive du maïs, associé à de la fève et du haricot, puis, il enchaîne avec une
production de petits pois. Les récoltes sont ensuite partagées avec le propriétaire de la parcelle
qui est désormais trop âgé pour travailler seul. Cela permet donc à Félix de produire une
partie de son alimentation et de réduire par conséquent ses dépenses domestiques, car ainsi, il
n’aura pas à acheter le maïs, ni les petits pois que lui et sa femme ont l’habitude de
consommer une bonne partie de l’année. Enfin, toujours sur ce même terrain, Félix cultive un
deuxième potager de 200 m² environ, sur lequel il produit surtout des salades, des choux-
fleurs et des brocolis (cf. Photographie n°49). Malgré l’absence de ses enfants, Félix ne fait
pas appel à de la main-d’œuvre supplémentaire, hormis l’aide ponctuelle des autres
producteurs du groupe Bajo Invernadero. Le travail sur ses deux potagers l’occupe
quotidiennement, puisqu’il faut chaque jour en désherber une partie. Il faut aussi repiquer
régulièrement et récolter les produits deux fois par semaine, pour les ventes du mercredi et du
samedi.
166
��.�.(������37��&�?��.�����.+#�2���?:5;
�Non loin de la maison familiale, le potager de Félix se compose de choux, de salades et de brocolis qui forment des rangées bien ordonnées. Source : N. Rebaï (2008).
Quand il s’emploie à couper l’herbe pour les cobayes, sa femme s’occupe d’aller traire les
vaches deux fois par jour, matins et soirs. Félix et sa femme ne vendent pas de lait ou très peu.
Ils consomment une partie de la production moyenne, 10 litres par jour au plus haut de la
production, et se servent du reste pour fabriquer des fromages qu’ils consomment ou qu’ils
vendent au marché. Il faut environ trois litres de lait pour fabriquer un fromage d’une livre
vendu au prix moyen de 1,25 dollar, d’après le livre de comptes du groupe de producteur Bajo
Invernadero. Cela revient à vendre le lait au prix moyen de 0,40 dollar/litre, soit dix centimes
de moins que lorsqu’il est vendu en bouteille. Mais pour l’ensemble des petits producteurs
présents sur les marchés urbains, il importe aussi de diversifier leurs produits (cf. Tableau
n°18), pour s’assurer de ventes plus importantes et pour satisfaire la clientèle cuencanaise
désireuse de consommer des produits frais. Pour cela ils n’hésitent donc pas à transformer le
lait.
167
��1���*+,�=�#�����#�/9�+��/0�+/*����/:�+#.����/;#�2���?
/*���0������������������2.���#*�����+���/����01��566=��0��5667
Produits Sep.08 Oct.08 Nov.08 Déc.08 Jan.09 Fév.09 Mar.09 Avr.09 Mai 09 Total X
P.M 38,80 18,70 30,15 12,05 11,95 10,55 21,65 24,85 39,35 208,05 23,10
F 0,50 18,50 13 4,50 7 2 45,50 5,05
P.L 18,20 20,25 9,25 18 21,85 2,75 3,75 94,05 10,45
V.O 6,50 18,50 16,65 12,50 28,70 11,25 5 5,75 104,85 11,65
C 8 12,50 59,30 40 30 47 196,80 21,90
Total 45,80 81,90 92,55 97,60 105,65 73,65 31,40 28,60 92,10 649,25 72,15
X : revenu brut mensuel moyen ; P.M : produits maraîchers; F : fruits ; P.L : produits laitiers ; V.O : volaille et œufs ; C : cobayes. Source : livre de comptes du groupe de producteurs Bajo Invernadero. Calculs et mise en forme : N. Rebaï.
Si l’on observe avec attention le détail des ventes de Félix et de sa femme, on remarque que
les produits agricoles représentent 38% de ses revenus bruts sur les marchés au cours des neuf
mois étudiés. Toutefois, si l’on cumule l’ensemble des ventes provenant de l’élevage, on
s’aperçoit alors qu’il s’agit de l’activité la plus rémunératrice chez ce producteur sur
l’ensemble de la période. Les ventes régulières d’œufs, de poulets, de cobayes et de fromages
frais représentent au total 395,7 dollars, c’est-à-dire deux tiers de ses revenus bruts, soit en
moyenne 44 dollars par mois, contre seulement 28,15 dollars pour les ventes de fruits et de
légumes.
Pour Félix, l’élevage tient une place d’autant plus importante qu’il permet de compenser les
baisses ponctuelles de ventes de produits maraîchers. Par exemple, entre décembre 2008 et
février 2009, alors que celles-ci ne représentaient en moyenne que 11,5 dollars par mois, les
revenus bruts liés à l’élevage atteignaient en moyenne 72,4 dollars, soit près de 83% de son
revenu brut global sur cette période. En revanche, lorsque les ventes liées à l’élevage ne
dépassent pas les 8 dollars mensuels (septembre 2008, mars et avril 2009), les ventes
agricoles ne parviennent pas à combler le manque à gagner (cf. Graphique n°5).
168
(�����)*�+,��9.�*��.+0�+/*����#�/9�+��/#�2���?
/*���0������������������2.���#*�����+���/����01��566=��0��5667
6
56
36
86
=6
�66
�56
������� ������ ������ � ���� �����! " ���! #����! �����! #�$��!
#������
���������������� ���������������� �������� ����������������
Source : livre de comptes du groupe de producteurs Bajo Invernadero.
Néanmoins, il faut bien prendre en compte les ventes informelles qui ont lieu directement sur
l’exploitation. Ainsi, il arrive fréquemment à Félix de vendre des cobayes à ses voisins,
comme il nous le dit lui-même : « en général, je peux en vendre deux ou trois par semaine,
environ 5 dollars chacun. C’est moins cher qu’au CREA [où leur prix peut atteindre 7 dollars]
mais cela rapporte un peu d’argent, de quoi acheter du riz, de l’huile, du café ou du sucre. »
Si ces ventes occasionnelles couvrent certaines dépenses domestiques, il ne faut pas oublier
les dépenses agricoles. Chaque mois, Félix doit acheter des semences et des sacs d’engrais,
car comme il nous l’expliqua, « [ses] animaux n’en produisent pas assez. » Cela revient en
moyenne à 35 dollars mois, soit la dépense la plus importante pour son exploitation. Il faut
aussi ajouter, comme pour les autres membres du groupe, les coûts de transport pour se rendre
au marché (camionnette à l’aller, bus au retour) et la location hebdomadaire du stand, soit près
de 3 dollars chaque semaine.
Si le bilan économique de son exploitation devait s’arrêter là, Félix s’en tirerait avec une
marge brute de 66 dollars en moyenne, mais chaque mois, il reçoit environ 100 dollars de ses
169
enfants, ce qui représente 47% de ses revenus. Cela leur permet, à lui et son épouse, de
couvrir ainsi leurs dépenses domestiques et d’accéder ainsi à une meilleure qualité de vie.
��1���*+,�7�1���+��.+.0�)*�0�+/*��0.@�+:�+#.����/;#��&�?��.�����.+�(���.��#�2���?
�+���/����01��566=��0��5667
Revenus Dépenses
Sur le marché Ventes agricoles 28,15 Transport 8,50
Ventes liées à l'élevage 44 Location de stand 2
Sur l'exploitation Ventes agricoles 0 Compost 30
Ventes de cobayes 40 Semences 5
Extérieur Remesas 100
Total 212,15 45,50
Calcul des dépenses de transport et de location de stand réalisé sur la base de 4 sorties mensuelles à la foire du CREA ; calcul des revenus directs sur l’exploitation réalisé sur la base de 2 ventes hebdomadaires de cobayes à 5 dollars. Sources : entretiens réalisés entre juillet 2008 et août 2009 ; livre de comptes du groupe de producteurs Bajo Invernadero.
��-�0��A� �����'������� ���������� ������>�������
María vit avec sa fille et sa mère. Séparée de son mari depuis plusieurs années, elle exploite
aujourd’hui ses propres terres, ainsi que celles de son frère et de sa sœur, tous deux partis
travailler aux Etats-Unis au milieu des années 1990. Cela représente un peu plus de
2,5 hectares divisés en quatre terrains, qui dans leur intégralité forment l’héritage familial. De
plus, María a récupéré il y a quelques années un lot d’un hectare dans un contexte tout à fait
particulier : « pendant deux ans, j’ai élevé un petit garçon dont les parents vivaient aux Etats-
Unis. Quand ils ont voulu le récupérer, ils m’ont proposé de l’argent mais moi, je préférais
de la terre. Alors ils m’ont donné un terrain situé là-haut, dans le secteur de la Dolorosa. »
Du coup, pour la paysanne, il s’agit de s’occuper quotidiennement de 3,5 hectares, alors que
Norma, sa fille, étudie la moitié du temps, et que sa mère est âgée et ne peut donc pas
beaucoup travailler, en dehors des quelques heures quotidiennes qu’elle passe à s’occuper du
petit bétail.
Sur le premier terrain (1 hectare), María habite une grande et belle maison qui appartient en
fait à son frère et qui a été construite grâce à l’argent de la migration. Sur ce même terrain, les
170
deux tiers de l’espace sont laissés en pâturage. Un quart de maïs est tout de même conservé,
ainsi qu’un tout petit espace (25 m²) pour faire pousser des pommes de terre. Au milieu des
pâturages, un potager d’environ 250 m² permet de cultiver des salades, du céleri, des carottes
et des oignons. Sur le côté, une trentaine de pieds de tomates d’arbre donne des fruits tout au
long de l’année.
��.�.(������+,6��&�?��.�����.+#�0����:�;
���Le triptyque désormais classique de l’espace agraire dans la paroisse Octavio Cordero Palacios : un potager, des vaches qui pâturent et une belle et grande maison, symbole de la réussite migratoire. Source : N Rebaï (2008).�
Un peu plus haut, María possède un deuxième terrain (1000 m²). Là, elle compte un autre
potager, plus petit (50 m²), où ne poussent presque uniquement que des choux, ainsi qu’une
cinquantaine de pommiers et une vingtaine de pieds de tomates d’arbre. Elle conserve là aussi
un grand carré d’herbe pour nourrir la centaine de cobayes réunis à quelques pas dans un petit
clapier en bois (cf. Photographie n°51). Les troisième et quatrième terrains (1,5 hectare au
total) sont laissés en pâturage, tout comme le cinquième (1hectare), sur lequel María possède
néanmoins une quinzaine de pommiers.
171
��.�.(������+,���&�?��.�����.+#�0����:5;
�Comme son voisin Félix, María possède un élevage de plusieurs dizaines de cobayes. Source : N. Rebaï. (2009).
Grâce aux espaces pâturés qu’elle possède, María peut nourrir plusieurs vaches laitières.
Malgré diverses tentatives, nous n’avons jamais pu savoir leur nombre exact, ni connaître la
production de lait, mais compte tenu des ventes importantes de produits laitiers (cf. Tableau
n°15), il pourrait s’agir d’un volume moyen de 25 litres par jour. María possède par ailleurs
un taureau, qu’elle utilise pour labourer son terrain et qu’elle loue occasionnellement aux
voisins, ainsi que 9 moutons destinés à la vente et à l’autoconsommation. Enfin, elle compte
dans son exploitation une dizaine de volailles destinées elles aussi à la vente comme à
l’alimentation domestique.
Pour commencer, María vend une bonne partie de sa production de lait à la foire du CREA.
Vendu à 0,6 dollar le litre, ou sous forme de fromages, cela lui assure 35% de ses revenus
officiels, mais contrairement à Félix, elle ne se consacre que de façon marginale à la vente de
petits animaux. Cela ne représente en effet que 4% de ses rentrées d’argent à la foire du
CREA (cf. Tableau n°20).
172
��1���*+,56�#�����#�/9�+��/0�+/*����/:�+#.����/;#�0����
/*���0������������������2.���#*�����+���/����01��566=��0��5667
Produits Sep.08 Oct.08 Nov.08 Déc.08 Jan.09 Fév.09 Mar.09 Avr.09 Mai 09 Total X
P.M 96,80 122,05 174,10 116,15 123,65 126,80 136,85 113,70 148,15 1 158,25 128,70
F 2,50 3,95 4 1,20 1 3 4 1,50 21,15 2,35
P.L 143,15 157,45 150,35 117,25 49,40 47,75 23,15 19,70 8,40 716,60 79,60
V.O 36,30 15,60 3 54,90 6,10
C 15 7 16,50 32 11 81,50 9,05
Total 293,75 299,05 335,45 249,90 174,25 207,55 163 140,40 169,05 2032,40 225,80
X : revenu brut mensuel moyen ; P.M : produits maraîchers; F : fruits ; P.L : produits laitiers ; V.O : volaille et œufs ; C : cobayes. Source : livre de comptes du groupe de producteurs Bajo Invernadero. Calculs et mise en forme : N. Rebaï.
Le profil de María est particulièrement intéressant, car même si ses ventes de produits laitiers
ont une grande importance, elles demeurent assez irrégulières. Alors qu’elles participaient à
48% de ses revenus bruts entre septembre et décembre 2008, elles n’y participaient plus qu’à
17% entre janvier et mai 2009. A contrario, les ventes de produits maraîchers lui assuraient
des rentrées monétaires constantes au cours des neuf mois étudiés. Même si la baisse des
ventes de produits laitiers ne fut pas entièrement compensée, les ventes de légumes lui
assurèrent un revenu brut mensuel de près de 130 dollars en moyenne entre septembre 2008 et
mai 2009, et constituèrent la plus grande part de ses revenus sur les marchés urbains, offrant
ainsi une certaine stabilité économique à son exploitation (cf. Graphique n°6).
173
(�����)*�+,8��9.�*��.+#�/9�+��/0�+/*����/#�0����
/*���0������������������2.���#*�����+���/����01��566=��0��5667
6
6
�66
�6
566
56
-66
-6
366
������ ������ ������ � ���� �����! " ���! #����! �����! #�$��!
#������
���������������� ���������������� �������� ����������������
Source : livre de comptes du groupe de producteurs Bajo Invernadero.
Cela dit, il ne faudrait pas oublier les autres revenus de María. Chaque jour, elle vend une
grande partie de son lait (environ 20 litres, le reste est destiné à l’autoconsommation) à un
négociant du Cañar qui vient dans la zone collecter une partie de la production locale41. En
2009, cela lui rapportait environ 7 dollars par jour (0,35 dollar/litre), sauf le mardi et le
vendredi, jours durant lesquels elle fabrique ses fromages. De plus, il lui arrive régulièrement
de vendre des animaux en dehors des jours de marché. Elle vend ainsi trois à quatre cobayes
par semaine, à 5 dollars pièce, et parfois, un mouton au prix de 40 dollars.
L’argent gagné est le plus souvent réinvesti. Tous les trois mois, María achète environ 150
sacs d’engrais, « pour le potager, pour les fruits et un peu aussi pour le maïs et la pomme de
terre. » Cela représente une dépense moyenne de 50 dollars par mois, en plus d’autres frais
ponctuels : « en période sèche, je dois acheter du fourrage pour les vaches. Cela me coûte 22
dollars par mois. Ensuite, quand vient le temps de semer un peu de maïs derrière la maison
[sur environ 2500 m²], je dois engager 3 ouvriers par jour pendant 3 jours. Cela revient à
41 Ils doivent être cinq ou six à se partager le lait de la paroisse Octavio Cordero Palacios. Parmi eux, deux en sont originaires, mais n’ont jamais accepté de répondre à nos questions.
174
plus de 90 dollars. Et puis il faut aussi louer une araire à 30 dollars. Je ne sais pas si je vais
continuer à produire du maïs dans le futur. Mieux vaut l’acheter ! »
En revanche, María est beaucoup plus évasive lorsqu’il s’agit d’évoquer les sommes d’argent
reçues des Etats-Unis : « tout ce que mon frère et ma sœur envoient est pour ma mère. Un
jour c’est 100 dollars, un autre c’est 50. Ils payent aussi les études de ma fille, mais moi je ne
reçois rien. » Néanmoins, en tant que chef d’exploitation, il lui revient de gérer l’argent de la
famille. Après plusieurs entretiens, et au détour de questions en apparence anodines, nous
estimons que María reçoit au minimum 100 dollars par mois, une somme bien moins
importante par exemple que celle obtenue par la vente de produits laitiers, mais qui représente
néanmoins 17% de ses revenus bruts.
Le bilan économique de l’exploitation de María est en définitive largement positif puisque ses
dépenses agricoles mensuelles ne représentent en moyenne que 89,5 dollars. Chaque mois,
María parvient à dégager un revenu net de plus de 460 dollars en moyenne, notamment par
ses ventes de produits laitiers et maraîchers, alors que les remesas qu’elle reçoit chaque mois
ne représentent qu’une modeste part de son revenu global.
��1���*+,5��1���+��.+.0�)*�0�+/*��0.@�+:�+#.����/;
#��&�?��.�����.+�(���.��#�0�����+���/����01��566=��0��5667
Revenus Dépenses
Sur le marché Ventes de fruits et légumes 131,05 Transport 13
Ventes liées à l'élevage 94,75 Location de stand 6
Sur l'exploitation
Ventes agricoles 0 Compost 50
Vente de lait 140 Semences 10
Ventes de cobayes 80 Fourrage 5,50
Ventes de petit bétail 6,50 Main-d’œuvre 10
Extérieur Remesas 100
Total 552,30 89,50
Calcul des dépenses de transport et de location de stand réalisé sur la base de 4 sorties mensuelles à la foire du CREA ; calcul des revenus directs sur l’exploitation réalisé sur la base de 4 ventes hebdomadaires de cobayes à 5 dollars. Sources : entretiens réalisés entre juillet 2008 et août 2009 ; livre de comptes du groupe de producteurs Bajo Invernadero.
175
��3�#�� �� ������ �������'��������&������ ������B�����
Daniel est l’un des rares hommes de la paroisse Octavio Cordero Palacios à ne jamais avoir
migré, pas même sur la côte. Aujourd’hui, il est le chef d’une famille nombreuse, dont
seulement deux membres ont émigré (un fils et une fille). Sa femme, Mercedes, cinq de ses
enfants et cinq petits-enfants vivent avec lui sur une exploitation d’un peu plus de 3 hectares
regroupant six terrains qui proviennent d’héritages divers ou d’achats effectués il y plus de
quarante ans.
Sur le premier terrain (1,5 hectare) se trouve une modeste maison construite par son fils
émigré. Autour, l’espace est divisé en plusieurs petits lopins : deux potagers (200 m²), une
soixantaine de pommiers, une vingtaine de pieds de tomates d’arbre, quelques pruniers (reine-
claude), de la luzerne (200 m²), du maïs (600 m²), du maïs associé à de la fève et du haricot
(200m²) et un peu de petit pois (150 m²). C’est ici que l’on trouve par ailleurs une trentaine de
poulets destinés à la vente, environ cinquante cobayes et cinq moutons.
��.�.(������+,5��&�?��.�����.+#�#�+���:�;
�Dans l’exploitation de Daniel, on trouve encore des cultures de cycle long, comme sur cette parcelle où l’on distingue à la fois du maïs (à gauche) et de la fève (à droite). Source : N. Rebaï (2009).
176
Plus haut, dans le secteur de la Dolorosa, un autre terrain (1hectare) est dédié pour moitié au
maïs, tandis que le reste de l’espace est occupé par des pâturages, au milieu desquels se trouve
un potager de 100 m². Encore plus haut, une parcelle de 2500 m² permet de cultiver un peu de
pomme de terre, tandis que trois autres terrains (1 hectare au total) sont entièrement laissés en
pâturage. En tout, près d’un hectare et demi pâturé et un peu de luzerne permettent à Daniel
d’élever deux vaches, dont la production moyenne de lait est de 10 litres par jour.
��.�.(������+,-��&�?��.�����.+#�#�+���:5;
�
Sur une autre parcelle, les pâturages occupent une grande partie de l’espace. Toutefois, on remarque au second plan un petit potager (protégé par des barrières en bois), et encore un peu de maïs (à gauche) Source : N. Rebaï (2009).
L’avantage d’une famille encore nombreuse est que Daniel ne fait jamais appel à de la main-
d’œuvre supplémentaire. Lui, son épouse et ses trois filles se consacrent quotidiennement à
l’agriculture, pendant que l’un de ses fils travaille comme maçon à Cuenca. L’autre fils
encore présent sur l’exploitation est électricien, mais seulement à temps partiel, ce qui lui
permet ponctuellement de participer aux tâches agricoles. Ainsi, la famille peut encore
cultiver de la pomme de terre, ainsi que du maïs dont une partie de la récolte sert à nourrir 4
porcs.
177
De son côté, Mercedes se rend chaque mercredi au marché 12 de Abril à Cuenca. Comme sa
sœur Natividad, elle s’est orientée vers le maraîchage lorsque le Père J. officiait dans la
paroisse. Au début, elle allait vendre ses produits de manière informelle au marché 9 de
Octubre, jusqu’à ce qu’elle devienne membre de l’Association des Producteurs
Agroécologiques de l’Azuay. Comme le mercredi elle se charge de vendre au nom du groupe
Bajo Invernadero, le samedi, elle est son mari envoient à leur tour leurs produits à la foire du
CREA.
Le détail des ventes de Daniel et Mercedes indique chez ce couple de producteurs la
prédominance des revenus liés à l’élevage. Si les produits laitiers, en réalité presque
uniquement des fromages, représentaient à eux seuls 42,4% de la recette globale entre
septembre 2008 et mai 2009, il est à noter que les ventes d’œufs et de petits animaux n’étaient
pas en reste : elles correspondaient à près du quart, 24% pour être exact, des revenus bruts au
cours de la période.
��1���*+,55�#�����#�/9�+��/0�+/*����/:�+#.����/;#�#�+���
/*���0������������������2.���#*�����+���/����01��566=��0��5667
Produits Sep.08 Oct.08 Nov.08 Déc.08 Jan.09 Fév.09 Mar.09 Avr.09 Mai 09 Total X
P.M 28,25 55,70 76,25 45,35 68,20 47,35 47,35 49,60 46,30 464,35 51,60
F 1 4 35 9 7,90 2,40 12,30 71,60 7,95
P.L 56,15 53,30 49,50 34,90 69 69,80 142 130,20 70,50 675,35 75,05
V.O 67 32 33 50 30,60 30,50 37 280,10 31,10
C 15 25 12 36 12 100 11,10
Total 152,40 156 150,75 129,25 222,20 162,15 239,85 212,70 166,10 1 591,40 176,80
X : revenu brut mensuel moyen ; P.M : produits maraîchers; F : fruits ; P.L : produits laitiers ; V.O : volaille et œufs ; C : cobayes. Source : livre de comptes du groupe de producteurs Bajo Invernadero. Calculs et mise en forme : N. Rebaï.
En revanche, si les ventes de produits maraîchers ne représentaient en moyenne que
51,6 dollars par mois, soit moins de 7 dollars par jour de marché, il faut y voir les effets d’une
consommation familiale bien plus importante que dans d’autres exploitations, où seulement
trois à quatre personnes sont à nourrir. C’est par exemple le cas chez María, où la superficie
dédiée à la production de légumes est sensiblement la même, mais rapporte presque trois fois
plus d’argent chaque mois. C’est donc logiquement que durant les neuf mois étudiés, les
178
ventes liées aux différents élevages dépassaient presque systématiquement les ventes de
produits agricoles en ce qui concerne l’exploitation de Daniel.
(�����)*�+,4��9.�*��.+#�/9�+��/0�+/*����/
#�#�+���/*���0������������������2.���#*�����+���/����01��566=��0��5667
6
6
�66
�6
566
56
-66
-6
������ ������ ������ � ���� �����! " ���! #����! �����! #�$��!
#������
���������������� ���������������� �������� ����������������
Source : livre de comptes du groupe de producteurs Bajo Invernadero.
En dehors des marchés urbains, Daniel ne vend quasiment rien. Le lait est intégralement
consommé (seules les productions du mardi et du vendredi sont utilisées pour la fabrication de
fromages) tandis que les ventes de cobayes sont « très rares. » La vente d’un mouton ou d’un
porc peut néanmoins avoir lieu, une à deux fois par an, et rapporter entre 40 et 60 dollars. Les
autres revenus dont la famille dispose viennent donc des activités extérieures des enfants. Le
premier fils de Daniel gagne environ 300 dollars bruts par mois sur les chantiers de Cuenca,
tandis que le second, dont l’activité est plus réduite, perçoit en moyenne 120 dollars bruts.
Cela permet alors de couvrir l’ensemble des dépenses de l’exploitation.
Chaque mois, Daniel doit en effet acheter 20 sacs d’engrais, pour les potagers et les arbres
fruitiers, et des semences pour environ 5 dollars. Pour maintenir sa production laitière même
durant la saison sèche, et assurer ainsi une partie de l’alimentation de sa famille, Daniel loue
un petit terrain où il amène paître ses deux vaches, ce qui lui coûte au total 80 dollars par an.
179
Enfin, il ne faut pas oublier les 3 dollars hebdomadaires pour le transport et les frais divers sur
les marchés.
Contrairement à Félix et à María, Daniel ne reçoit pas beaucoup d’argent des Etats-Unis. Son
fils est parti il y a une quinzaine d’années, mais sa fille, elle, ne s’y trouve que depuis trois
ans : « l’argent qu’elle envoie sert à payer ses dettes [contractées auprès de voisins]. Mon fils
nous envoie 200 dollars tous les quatre mois », comme nous l’avoua Mercedes. Cela
reviendrait à augmenter de 7 % les revenus bruts de l’exploitation, alors que son bilan
économique est déjà positif, grâce aux emplois urbains qui représentent a eux seuls 65% des
ressources familiales. Dans ce cas précis, les retombées monétaires de la pluriactivité locale
s’avèrent bien plus importantes que la migration et dépassent de loin les revenus de
l’agriculture et de l’élevage.
��1���*+,5-�1���+��.+.0�)*�0�+/*��0.@�+:�+#.����/;
#��&�?��.�����.+�(���.��#�#�+����+���/����01��566=��0��5667
Revenus Dépenses
Sur le marché Ventes agricoles 59,50 Transport 8,50
Ventes liées à l'élevage 117,25 Location de stand 4
Sur l'exploitation
Ventes agricoles 0 Compost 20
Vente de petit bétail 8,50 Semences 5
Fourrage 6,50
Extérieurs Emplois urbains 420
Remesas 50
Total 655,25 44
Calcul des dépenses de transport et de location de stand réalisé sur la base de 4 sorties mensuelles à la foire du CREA ; calcul des revenus occasionnels réalisé sur la base de la vente annuelle d’un mouton à 40 dollars et d’un porc à 60 dollars. Sources : entretiens réalisés entre juillet 2008 et août 2009 ; livre de comptes du groupe de producteurs Bajo Invernadero.
���0��������& ����������������� ��� ' ��������
Manuel est lui aussi chef d’une famille nombreuse. Dans son exploitation de 3,5 hectares, où
tous les terrains proviennent d’héritages divers, seule son épouse se dédie entièrement à
l’agriculture. Lui et trois de ses fils sont ouvriers dans le secteur de la construction la moitié
180
de l’année pendant que l’une de ses filles est employée à plein temps dans un magasin à
Cuenca, ce qui l’empêche de participer aux tâches agricoles. Enfin, cinq jeunes enfants sont
toujours scolarisés. Ainsi, comme nous le dit Manuel, en souriant, « pour l’instant, personne
n’a migré mais cela ne devrait pas tarder !42»
L’exploitation ne compte qu’un terrain principal (1 hectare), celui sur lequel se trouvent la
maison, 3 potagers (300 m²), environ 250 m² de maïs et un peu d’herbe pour les animaux. Les
13 autres parcelles, qui représentent 2,5 hectares au total, sont laissées en pâturage pour élever
une vache laitière, dont la production maximum est de 9 litres de lait par jour, deux génisses,
ainsi qu’une trentaine de cobayes. L’exploitation compte aussi un porc et quelques poulets.
��.�.(������+,3��&�?��.�����.+#�0�+*��
Un grand potager se trouve derrière la maison de Manuel et de sa famille, sur la plus grande parcelle de l’exploitation. Source : N. Rebaï (2009).
Le bilan commercial de Manuel attire l’attention car il indique des ventes beaucoup moins
diversifiées que dans les exploitations précédentes. En effet, les produits agricoles lui assurent
75% de sa recette globale sur les marchés urbains entre septembre 2008 et mai 2009, tandis
42 L’un des fils de Manuel est marié avec une femme vivant aux Etats-Unis, ce qui laisse supposer un départ prochain.
181
que les ventes d’œufs ou d’animaux sont presque inexistantes (un seul cobaye vendu en 9
mois). La vente de produits laitiers ne représente elle que 23% de ses revenus bruts, c’est-à-
dire moins de 3 dollars en moyenne par jour de marché.
��1���*+,53�#�����#�/9�+��/0�+/*����/:�+#.����/;#�0�+*��
/*���0������������������2.���#*�����+���/����01��566=��0��5667
Produits Sep.08 Oct.08 Nov.08 Déc.08 Jan.09 Fév.09 Mar.09 Avr.09 Mai 09 Total X
P.M 24,95 57,05 67,45 56,40 42,65 33,05 70,85 68,95 91,55 512,90 57
F
P.L 18,20 22,80 30,20 23 20,50 29,70 8,75 6,10 159,25 17,70
V.O
C 10 10 1,10
Total 43,15 57,05 90,25 86,60 65,65 53,55 110,55 77,70 97,65 682,15 75,80
X : revenu brut mensuel moyen ; P.M : produits maraîchers; F : fruits ; P.L : produits laitiers ; V.O : volaille et œufs ; C : cobayes. Source : livre de comptes du groupe de producteurs Bajo Invernadero. Calculs et mise en forme : N. Rebaï.
Comme chez Daniel, il faut voir dans ces résultats les effets directs de la consommation
familiale quotidienne. Si les ventes de produits agricoles n’atteignent en moyenne que 57
dollars par mois alors que la superficie dédiée au maraîchage est d’environ 300 m², c'est-à-
dire un peu plus que chez María, c’est bien parce que 11 personnes se nourrissent des produits
de l’exploitation. Cette remarque vaut aussi pour la production laitière qui assure une partie de
l’alimentation familiale et n’offre que des revenus limités tout au long de l’année (cf.
Graphique n°8). Dans l’exploitation de Manuel, les ventes mensuelles de produits liés aux
différents élevages n’atteignent que 18,8 dollars en moyenne, c'est-à-dire moins que deux
jours de salaire pour un ouvrier agricole. En d’autres termes, les élevages ont une importance
économique très marginale pour la famille de Manuel et servent essentiellement à couvrir les
besoins alimentaires domestiques.
182
(�����)*�+,=��9.�*��.+#�/9�+��/0�+/*����/#�0�+*��
/*���0������������������2.���#*�����+���/����01��566=��0��5667
6
56
36
86
=6
�66
�56
������ ������ ������ � ���� �����! " ���! #����! �����! #�$��!
#������
���������������� ���������������� �������� ����������������
Source : livre de comptes du groupe de producteurs Bajo Invernadero.
En dehors des ventes hebdomadaires, seuls les salaires d’ouvriers complètent les revenus
familiaux. Cela fait sept ans que Manuel exerce la profession de maçon, « à Cuenca surtout,
mais ces deux dernières années, à cause de la crise, les gens ne construisent plus beaucoup ».
Il ne travaille alors que quatre à cinq mois par an, ce qui lui rapporte sur l’année environ
1 200 dollars bruts. Ses fils se trouvent dans la même situation et ne gagnent en moyenne que
60 dollars bruts par mois en tant que manœuvres. Quant au salaire brut de sa fille, il est
d’environ 200 dollars par mois.
Bien entendu, tout cet argent sert à couvrir les dépenses d’alimentation, les frais de transport
pour le marché et la scolarité des cinq plus jeunes du foyer. Mais il ne faut pas oublier les
dépenses agricoles : chaque mois, Manuel doit en effet acheter une vingtaine de sacs
d’engrais, et deux fois par an, il loue un petit terrain pour laisser paître ses bovins, ce qui lui
coûte au total 160 dollars chaque année.
En définitive, pour Manuel, les rentrées monétaires liées à l’agriculture et l’élevage, bien que
régulières, ne représentent que 16% du revenu global de son exploitation. Le poids de
183
l’autoconsommation y est pour beaucoup mais en retour, les salaires extérieurs permettent de
couvrir l’ensemble des dépenses domestiques et agricoles et de dégager une marge moyenne
de 510 dollars par mois.
��1���*+,5�1���+��.+.0�)*�0�+/*��:�+#.����/;
#��&�?��.�����.+�(���.��#�0�+*���+���/����01��566=��0��5667
Revenus Dépenses
Sur le marché Ventes agricoles 57 Transport 8,50
Ventes liées à l'élevage 18,80 Location de stand 2
Sur l’exploitation
Ventes agricoles 0 Compost 20
Ventes liées à l'élevage 0 Semences 5
Fourrage 13,50
Extérieurs Emplois urbains 480
Total 555,80 46,50
Calcul des dépenses de transport et de location de stand réalisé sur la base de 4 sorties mensuelles à la foire du CREA. Sources : entretiens réalisés entre juillet 2008 et août 2009 ; livre de comptes du groupe de producteurs Bajo Invernadero.
��8�+�� ' ��� ����>��� ��� ����>��'�������������� ������ ���
Natividad vit seule, sans mari ni enfant. Elle possède 4 petits terrains desquels elle parvient à
obtenir ce dont elle a besoin pour se nourrir. Sur le premier lot (2500 m²), hérité de ses
parents, se trouve une petite maison en adobe. Tout autour, l’espace est là encore divisé en
plusieurs petits lopins : de l’herbe (200 m²) pour la trentaine de cobayes, du maïs associé à de
la fève et du haricot (300 m²), deux potagers (200 m²), une dizaine de pieds de tomates
d’arbre et un petit poulailler pour garder ses huit volailles (cf. Photographie n°55). Sur le
deuxième terrain (1000 m²), l’espace est divisé en deux : moitié cultures associées (maïs et
fève), moitié tubercules (pomme de terre, oca et melloco). Le troisième terrain (1000 m²) est
lui aussi divisé en deux : moitié cultures associées (maïs, fève, haricot), moitié pâturages.
Enfin, le quatrième terrain (1500 m²) situé dans les hauteurs de la Dolorosa est entièrement
laissé en pâturage.
184
��.�.(������+,��&�?��.�����.+#�+���9�#�#
�Sur la plus petite exploitation du groupe, Natividad parvient à cultiver toutes sortes de produits: des tomates d’arbre, des légumes et même un peu de maïs (au deuxième plan). Source : N. Rebaï (2008).
Pour cultiver tout cela, Natividad peut compter sur l’aide ponctuelle de ses 3 nièces, les filles
de Mercedes et de Daniel. En revanche, elle doit elle-même couper l’herbe pour les cobayes
et aller traire matins et soirs ses deux vaches qui produisent au maximum 8 litres de lait par
jour, ce qui l’occupe quotidiennement 5 heures, sans compter le travail sur ses potagers.
��1���*+,58�#�����#�/9�+��/0�+/*����/:�+#.����/;#�+���9�#�#
/*���0������������������2.���#*�����+���/����01��566=��0��5667
Produits Sep.08 Oct.08 Nov.08 Déc.08 Jan.09 Fév.09 Mar.09 Avr.09 Mai 09 Total X
P.M 8,70 19 62,65 27,70 27,90 28,15 38,15 23,35 39,65 275,40 30,60
F 2,50 1 1 0,50 5 0,55
P.L 59,70 43,70 48,45 37,65 27 25,20 7 248,70 27,65
V.O 6 16 22,75 3,50 16,50 64,75 7,20
C 10 29 17 10 66 7,30
Total 80,90 68,70 112,10 65,35 71,90 105,60 58,65 30,35 66,15 659,70 73,30
X : revenu mensuel brut moyen ; P.M : produits maraîchers; F : fruits ; P.L : produits laitiers ; V.O : volaille et œufs ; C : cobayes. Source : livre de comptes du groupe de producteurs Bajo Invernadero. Calculs et mise en forme : N. Rebaï.
185
Si l’on examine le bilan commercial de Natividad, on s’aperçoit de nouveau que les revenus
bruts liés à l’élevage sont les plus importants. Si les ventes d’œufs, de poulets et de cobayes,
en dépit de leur inconstance, lui assurent en moyenne 14,5 dollars par mois, soit 18% de ses
revenus bruts sur les marchés urbains, il faut noter l’importance des ventes de produits laitiers
qui représentent 38% de sa recette globale entre septembre 2008 et mai 2009.
Entre septembre 2008 et février 2009, le revenu moyen de Natividad était de 84 dollars par
mois, contre seulement 51,7 dollars entre mars et mai 2009. Si lors de la première période, les
ventes de produits laitiers représentaient 48% du revenu brut global de la productrice, et
jusqu’à 74% au mois de septembre 2008, leur absence presque totale au cours des mois
suivants ne fut pas compensée par une augmentation des ventes de fruits et de légumes, ni
même par des ventes plus nombreuses de cobayes ou de volailles. Malgré cela, le maraîchage
joue un rôle économique essentiel car il permet à Natividad de maintenir une régularité dans
l’obtention de revenus, même si les ventes peuvent par moment être limitées, comme aux
mois de septembre et d’octobre 2008. Ainsi, les ventes de légumes frais assuraient en
moyenne 31 dollars par mois au cours de la période étudiée.
(�����)*�+,7��9.�*��.+#�/9�+��/0�+/*����/
#�+���9�#�#/*���0������������������2.���#*�����+���/����01��566=��0��5667
6
56
36
86
=6
�66
�56
������ ������ ������ � ���� �����! " ���! #����! �����! #�$��!
#������
���������������� ���������������� �������� ����� �����������
Source : livre de comptes du groupe de producteurs Bajo Invernadero.
186
En dehors des ventes sur les marchés, Natividad ne dispose que de revenus modestes. Chaque
jour, elle vend trois à quatre litres de lait à l’un des collecteurs de la zone, sauf le mardi et le
vendredi, jours de fabrication des fromages, ce qui lui rapporte environ 6 dollars par semaine.
Cela lui permet entre autres de nourrir ses vaches car elle aussi est contrainte de louer une
petite parcelle pâturée, ce qui lui revient à 25 dollars par mois, un coût qui atteint même 35
dollars durant la saison sèche. Une partie de ses gains hebdomadaires sert également à l’achat
de grain pour ses poulets, mais comme elle nous le dit, « cela coûte 16 dollars chaque mois
[pour environ 50 kg de maïs dur]. Ce n’est pas assez rentable car je ne vends presque que des
œufs. Je crois que je vais arrêter [l’élevage de volaille], cela me coûte trop cher. » Pour ses
deux potagers, Natividad doit aussi acheter 80 sacs d’engrais par an, ainsi que des semences,
pour environ 5 dollars par mois. Pour sa petite exploitation, il s’agit de dépenses importantes
qui ne lui permettraient de dégager qu’une marge mensuelle d’à peine plus de 30 dollars.
Mais au-delà de ses propres revenus, Natividad bénéficie de l’aide de sa sœur, domestique à
Cuenca, laquelle lui donne chaque mois environ 10 dollars.
��1���*+,54�1���+��.+.0�)*�0�+/*��:�+#.����/;
#��&�?��.�����.+�(���.��#�+���9�#�#�+���/����01��566=��0��5667
Revenus Dépenses
Sur le marché Ventes agricoles 31 Transport 8,50
Ventes liées à l'élevage 42,10 Location de stand 2
Sur l'exploitation
Ventes agricoles 0 Compost 6,50
Vente de lait 24 Semences 5
Fourrage 43,50
Extérieur Aide familiale (sœur) 10
Total 107,10 65,50
Calcul des dépenses de transport et de location de stand réalisé sur la base de 4 sorties mensuelles à la foire du CREA. Sources : entretiens réalisés entre juillet 2008 et août 2009 ; Livre de comptes du groupe de producteurs Bajo Invernadero.
��4� 1 ��� �� � � ��� ��� ��"�C��� ������ "��� �'�� ��� ����������� ��
���������������� ���
�
De cette description détaillée du fonctionnement des cinq exploitations du groupe de
producteurs Bajo Invernadero, nous pouvons tirer quelques enseignements intéressants. On
187
peut d’abord observer que les différents types d’élevages jouent un rôle économique essentiel
puisqu’ils représentent quatre fois sur cinq (Félix, María, Daniel et Natividad) plus de 60%
des ventes ayant lieu sur les marchés urbains ou directement sur les exploitations.
L’importance du maraîchage est en revanche assez variable, allant jusqu’à représenter 75%
des ventes moyennes chez Manuel, contre seulement 31% chez Félix. Enfin, les ventes de
fruits demeurent globalement marginales et ne représentent en moyenne que 2,7% du chiffre
d’affaire des producteurs sur les marchés urbains, même si ponctuellement, elles assurent des
rentrées d’argent conséquentes, comme ce fut le cas chez Daniel, qui obtint 35 dollars par la
vente de 28 livres de reines-claudes et de 7 livres de mûres en janvier 2009 (cf. Annexe n°14).
Nous pouvons donc avoir une réserve sur le discours des différentes institutions présentes
dans l’espace rural azuayen. Beaucoup d’entre elles, comme le CEDIR dans la paroisse
Octavio Cordero Palacios, estiment en effet qu’il serait judicieux de développer les
productions fruitières, moins exigeantes en travail que le maraîchage par exemple, pour
garantir une rémunération stable aux exploitations familiales. Pourtant, nos propres enquêtes
démontrent que les ventes de fruits sont généralement très faibles (Félix, María, Daniel,
Natividad), voire totalement nulles (Manuel). En réalité, les seules productions de pommes,
de mûres ou de tomates d’arbre ne pourraient pas assurer la reproduction des groupes
domestiques, à moins de s’y consacrer sur des superficies autrement plus importantes.
En ce qui concerne la rémunération de l’activité maraîchère, celle-ci est assez faible. Au sein
du groupe de producteurs Bajo Invernadero, quatre exploitations sur cinq (Félix, Daniel,
Manuel et Natividad) obtenaient entre septembre 2008 et mai 2009 un revenu brut quotidien
de moins de 2 dollars en moyenne (pour un mois à 30 jours), tandis que la cinquième (María),
obtenait en moyenne 4,30 dollars bruts. A travers ces chiffres, il faut bien entendu voir les
effets d’une consommation familiale souvent très importante (Daniel et Manuel), et les limites
de l’agriculture manuelle. C’est d’ailleurs pour cela que dans certains cas (Félix, Daniel et
Manuel), les salaires extérieurs ont un rôle central dans les systèmes d’activités car ils
garantissent, plus que l’agriculture, la reproduction du groupe domestique.
Malgré tout, il est nécessaire de souligner que dorénavant, les familles du groupe Bajo
Invernadero parviennent à couvrir plus facilement leurs besoins alimentaires. Au cours de nos
entretiens, les producteurs ont régulièrement fait référence à la plus grande abondance de
188
nourriture, à la plus large variété des aliments et aux intérêts nutritionnels du maraîchage, sans
doute aussi parce qu’ils se l’entendaient répéter par les promoteurs régionaux de
l’agroécologie, en déclarant comme Félix ou María qu’il s’agissait du « meilleur moyen pour
manger sainement. » Ce constat global a d’ailleurs fait l’objet d’un rapport d’expertise publié
à Cuenca, qui soulignait le « changement positif de l’alimentation des producteurs [de la
paroisse Octavio Cordero Palacios] avec l’agroécologie43 » (Mac Aleese, 2007 : 18).
Pour le confirmer dans notre propre étude, il aurait été intéressant de faire des enquêtes de
consommation, en demandant par exemple aux cultivateurs maraîchers d’évaluer la part de
leurs productions destinées aux foyers. De même, des enquêtes spécifiques de dépenses
alimentaires, comme en fit G. Cortes en Bolivie (2000), auraient permis de connaître les
budgets hebdomadaires consacrés aux achats de vivres. Ainsi, nous aurions pu évaluer le
niveau d’autosuffisance de chaque famille ou, à l’inverse, leur dépendance aux achats de
nourriture, ce qui aurait pu aboutir à l’élaboration de modèles de régimes alimentaires, en
fonction des catégories d’exploitation. Malheureusement, il nous fut impossible de faire ce
travail avec les producteurs du groupe Bajo Invernadero, notre priorité ayant été de
comprendre au mieux l’organisation des systèmes d’activités familiaux et le déroulement des
tâches agricoles et commerciales.
Enfin, si le fait de ne pas avoir traité la question de l’alimentation des ménages peut constituer
une limite à notre travail avec le groupe Bajo Invernadero, il est en une autre qui concerne la
précision des données que nous avons exploitées, et plus particulièrement celles des salaires
extérieurs. Même si nous pouvons affirmer que nos entretiens se sont toujours déroulés dans
d’excellentes conditions, nous ne pouvons pas être sûr que les montants indiqués par les
personnes interrogées aient toujours été exacts, surtout lorsqu’il s’agit des remesas. Il est
probable que dans certains cas ils aient été sous-estimées, et par conséquent, que les
diagnostics économiques que nous avons réalisées avec certaines exploitations du groupe
Bajo Invernadero soient légèrement faussés.
A l’inverse, il est probable que pour exploitations de Daniel et de Manuel, les salaires des
emplois locaux soient en réalité légèrement inférieurs, car au moment de nous entretenir avec
eux, les deux chefs d’exploitation furent incapables de nous donner les périodes de travail
43 « […] un cambio positivo de la alimentación de los productores […] ».
189
exactes de leurs enfants, de leurs fils en particulier, et nous dirent ainsi de façon presque
hasardeuse que ces derniers avaient un emploi à temps plein « la moitié de l’année ».
Néanmoins, compte tenu de la précarité du marché de l’emploi dans le secteur de la
construction, comme nous l’expliqua d’ailleurs Manuel, les périodes d’activité salariée
pourraient être en réalité beaucoup plus courtes, et les revenus monétaires moins importants.
��.�.(������+,8�#�/.*9����/#�+/�&����+��#&*+���9���
Dans le centre-ville de Cuenca, sur la Plaza de San Francisco, des hommes originaires des périphéries rurales attendent que l’on vienne leur proposer du travail, même pour une journée. Comme chaque jour, très peu d’entre eux en obtiendront. Source : N. Rebaï (2008).
En dépit de ces quelques éléments, la majorité des informations que nous avons détaillées
provenant du livre de comptes, ainsi que d’entretiens répétés pour confirmer les informations
distillées par les différents exploitants, nous autorisent à penser que notre analyse
socioéconomique du groupe de producteurs Bajo Invernadero demeure pertinente. Pour
autant, celle-ci doit à présent se prolonger, et pour ce faire, nous allons porter notre attention
sur deux exploitations où les effets de l’émigration au cours des dernières décennies ont été
bien plus importants.
190
5���'��� ������������D� ����� ����������� ��� ������>��� ��� ���
Il était indispensable que dans notre étude, nous nous intéressions aux migrants de retour,
comme nous l’avions déjà fait à Juncal. Seulement, dans la province du Cañar, nous nous
étions aperçu que les investissements post-migratoires pouvaient être infructueux. Il nous
fallait alors vérifier si dans un autre contexte, celui de la paroisse Octavio Cordero Palacios,
d’anciens migrants pouvaient mettre sur pied des projets économiques rentables.
Pour trouver ce type d’acteur, nous nous sommes d’abord adressé aux premières personnes
avec lesquelles nous nous sommes entretenues, lesquelles nous ont toutes désigné Salvador et
Juan. Par la suite, notre prise de contact avec ces deux exploitants se fit sans mal puisqu’ils
participaient régulièrement aux ateliers du CEDIR. Plusieurs fois, ils acceptèrent de nous
recevoir pour nous compter fièrement leur réussite, leurs parcours migratoires, ainsi que leur
choix de s’orienter, non sans grands moyens, vers la production de fruits. A présent, nous
allons donc expliquer comment Salvador et Juan ont réussi ces dernières années à développer
une activité commerciale particulièrement dynamique, en modernisant progressivement leurs
exploitations grâce à d’importants investissements dans du matériel sophistiqué.
5���/��'���� ����� ��� ����������'��� ������������� ����� � E��
Salvador est né en 1947. Au cours des dernières décennies, il a régulièrement migré à
l’étranger, ce qui lui a permis d’agrandir et de doter son exploitation d’un matériel qu’il fut le
« premier » à utiliser dans la paroisse Octavio Cordero Palacios. Pour lui, tout a débuté après
son mariage en 1970 :
« avec ma femme, nous avions peu de terre. Nous vivions sur une petite parcelle [située dans l’actuel secteur d’El Cisne] héritée de mes beaux-parents. Je suis alors parti travailler dans l’oriente, dans les nouvelles exploitations pétrolières. Je suis revenu au bout de deux ans et j’ai acheté un hectare à 75 000 sucres [environ 2 800 dollars]. Entre 1972 et 1976, j’ai reçu 15 hectares sur la côte, grâce à la réforme agraire. C’était à Churute, je produisais du riz et du maïs. Mais en 1976, à cause de la sécheresse, j’ai tout perdu. J’avais une dette de 300 000 sucres [11 000 dollars] auprès de la Banque de Développement. J’ai revendu ces terres et je suis parti aux Etats-Unis, en empruntant 120 000 sucres [4 400 dollars] à des voisins. A New York, je travaillais comme commis de cuisine dans un restaurant. Mais au bout d’un an, j’ai été renvoyé en Equateur [par les services étasuniens
191
d’immigration]. Je suis revenu vivre dans la paroisse mais c’était plus dur que d’être ouvrier aux Etats-Unis. L’agriculture ne pouvait pas nous servir à nous les petits exploitants. Nous n’avions pas de quoi investir et même pas de quoi manger. Alors il fallait partir travailler. Aujourd’hui c’est toujours pareil… »
C’est dans ces conditions, après quelques années passées dans son exploitation, que Salvador
décida de repartir :
« en 1982, je suis parti travailler avec ma femme au Venezuela. Ce fut très facile. Nous y sommes allés en bus, sans visa. Mon cousin et mon beau-frère étaient déjà là-bas, dans l’Etat de Miranda. J’ai travaillé dans une entreprise forestière, où je replantais des arbres, puis j’ai été ouvrier dans le secteur de la construction. Ma femme était cuisinière dans un hôtel et pendant ce temps, en Equateur, mon autre beau-frère et le reste de ma famille s’occupaient de nos terres. Grâce à notre travail au Venezuela et aux quelques économies des Etats-Unis, nous avons pu rembourser notre dette. »
De là, Salvador va connaître sa deuxième expérience étasunienne :
« en 1986, je suis de nouveau allé aux Etats-Unis, directement de Caracas. Je connaissais le chemin ! Avec mon cousin et mon beau-frère, nous avons rejoins le Mexique et nous sommes passés par Monterrey. Ma femme, elle, est rentrée en Equateur. Je suis arrivé à Chicago et j’ai travaillé dans les cuisines d’un bateau pour touristes sur le lac Michigan. De plongeur à commis de cuisine, je suis passé de 3,5 à 6 dollars par jour. C’était dur et je préfère oublier… Je suis retourné en Equateur au bout de trois ans et j’ai acheté un demi-hectare à 650 000 sucres [1 200 dollars]. Avec quatre autres associés, nous avons monté une petite entreprise de menuiserie. J’ai personnellement investi 1 500 000 sucres [2 700 dollars], mais cela n’a pas marché. »
Après cet échec, Salvador émigra de nouveau vers les Etats-Unis :
« en 1991, je suis allé à Minneapolis. Je cumulais deux emplois : de 7 à 15h, j’étais commis de cuisine dans un restaurant et de 16 à 23h, je faisais le ménage dans un grand magasin. Je gagnais 500 dollars par semaine et j’envoyais environ 600 dollars par mois à ma femme, pour qu’elle puisse manger, pour couvrir les dépenses agricoles et pour qu’elle puisse prêter un peu d’argent à ceux qui voulaient migrer. Au bout de trois ans je suis revenu. En 1995, j’ai construit ma première serre pour produire des babacos. »
192
Croyant en avoir fini avec ses migrations, Salvador fut contraint de partir une nouvelle fois,
suite à un événement tout à fait particulier :
« en 1998, je me suis fait voler 7 800 dollars au sortir de la banque. Ils allaient me servir pour l’achat d’une voiture. Alors j’ai décidé de migrer encore une fois. J’ai obtenu un visa de tourisme pour l’Espagne et je suis parti. C’était plus dur en Europe. Presque tout l’argent que je gagnais servait à me loger et à me nourrir. Certains de mes compagnons dormaient sous les ponts et à l’époque il n’y avait pas beaucoup de travail. Je suis passé de Madrid à Tolède, puis à Valence et enfin à Murcie. Nous étions victimes de racisme. Les ingénieurs des huertas de Valence nous disaient que nous ne savions pas travailler. Je suis resté huit mois et je suis parti. Je suis allé tenter ma chance à Milan. J’avais travaillé dans une pizzeria à Chicago, je parlais anglais pour me débrouiller. J’y suis resté un mois. Enfin, je suis parti à Paris. J’étais à l’aéroport [de Roissy] « Charles de Gaulle » et je voulais rentrer chez moi. Mais en discutant [en anglais] avec le patron d’un hôtel, j’ai trouvé du travail pour un mois supplémentaire. Après cela, je suis rentré définitivement et depuis, je ne me consacre qu’à l’agriculture. »
En tout, Salvador a passé 12 ans à l’étranger (cf. Schéma n°2). Son exploitation couvre
désormais une superficie d’un peu plus de deux hectares, ce qui semble presque dérisoire si
l’on ne s’intéresse pas à ses choix culturaux. En réalité, plutôt que d’acheter des terres,
Salvador a préféré investir une grande partie de son capital dans des équipements lui
permettant de développer des cultures très rentables et destinées au marché urbain cuencanais.
194
Sur son premier terrain de 5000 m² situé dans le secteur d’El Cisne, Salvador a construit sa
maison derrière laquelle il cultive un peu de maïs (400 m²). Plus bas, il possède un grand
verger où l’on trouve quarante pieds de tomate d’arbre, une cinquantaine de pommiers, deux
cent mûriers et une trentaine de pruniers. C’est là qu’il cultive aussi des produits maraîchers,
sur environ 250 m².
��.�.(������+,4��&�?��.�����.+#�/��9�#.�:�;
Derrière sa maison, Salvador possède un grand verger où il produit notamment des tomates d’arbre et des mûres. A l’intérieur, les cultures maraîchères poussent à l’ombre des arbres fruitiers. Source : N. Rebaï (2009).
Plus haut, il possède une autre parcelle de 2500 m², dont il a hérité il y a quelques années,
divisée en deux : un tiers de l’espace est occupé par plusieurs petits potagers (150 m² au total)
au milieu desquels se trouve une serre de 750 m² comptant 400 pieds de babacos
(cf. Photographie n°58) ; sur les deux autres tiers de ce terrain, Salvador cultive encore un peu
de maïs. A quelques minutes de marche, un troisième terrain d’un demi hectare est laissé en
pâturage, au milieu desquels se trouve une autre serre de 300 m². Là encore, il cultive 210
pieds de babacos. Enfin, sur une quatrième parcelle d’un hectare environ, Salvador produit un
peu d’oca (sur 1000 m² environ), tandis que le reste de l’espace est occupé par des pâturages
pour nourrir cent cinquante cobayes, un taureau et une vache dont la production moyenne de
195
lait est d’environ 6 litres par jour. Au moment de visiter l’exploitation de Salvador, sur les
610 pieds de babacos, les trois quarts étaient en production tandis que le reste venait d’être
replanté.
��.�.(������+,=��&�?��.�����.+#�/��9�#.�:5;
Sur une autre parcelle, Salvador a construit l’une de ses deux serres où il produit des babacos en grande quantité. Source : N. Rebaï (2009).
Salvador est un homme très occupé. Chaque jour, il doit travailler sur ses différentes
parcelles, s’occuper de plusieurs potagers, entretenir les pieds de babacos et récolter les
tomates d’arbre pour les vendre le samedi à la foire du CREA (cf. Photographie n°59). Depuis
2000, il se rend en effet chaque semaine à Cuenca. Il a d’abord été membre de l’association
municipale avant d’adhérer à l’association des Producteurs de l’Austro, « pour avoir moins de
concurrence, car nous sommes moins nombreux à la foire du CREA » et pour bénéficier,
selon lui, d’un « meilleur » appui technique. Dès 2004, sa femme a donc pris le relais dans
l’association des Producteurs de l’Azuay. Chaque jeudi, elle se rend au marché 12 de Abril,
avant d’y retourner le dimanche, ce qui permet au couple d’avoir deux matinées de vente sur
les marchés urbains en fin de semaine.
196
Comme il nous le confia lui-même, les ventes de fruits et de produits maraîchers atteignent en
moyenne 200 dollars par semaine : « C’est en général ma femme qui gagne le plus, autour de
120 dollars hebdomadaires. » Avec seulement trois matinées de vente par semaine, le jeudi et
le dimanche au marché 12 de Abril et le samedi au CREA, Salvador ne pourrait cependant pas
écouler toute sa production fruitière, comme il nous le précisa : « le jeudi, mon épouse vend
une trentaine de babacos et les fins de semaine nous en vendons environ 80 [au prix moyen de
0,90 dollar]. » Ce qui rend l’activité commerciale de Salvador encore plus dynamique, c’est le
contrat qu’il a passé avec un restaurant de Cuenca, auquel il livre chaque semaine environ 200
babacos. Vendus en moyenne à 0,7 dollar pièce, les fruits lui rapportent aux alentours de
550 dollars par mois. Il y a trois ans, il a même passé un contrat avec l’un des nombreux
Supermaxi44 de la ville, auquel il a livré 600 babacos. Il y a donc un grand intérêt à cultiver
plusieurs centaines d’arbre, car de cette manière, Salvador est en mesure de fournir
occasionnellement des quantités de fruits importantes, ce qui lui procure des revenus
conséquents.
��.�.(������+,7�/��9�#.����2.���#*����
Chaque samedi, Salvador se rend à Cuenca pour vendre ses fruits et légumes. Mais à neuf heures, « il n’y a plus rien ! » Source : N. Rebaï (2008).
44 L’une des grandes chaînes de supermarchés en Equateur.
197
Malgré ces différents réseaux commerciaux, toute la production fruitière de l’exploitation
n’est pas vendue. Près d’un tiers des babacos ne parvient pas sur le marché urbain, tout
comme les mûres ou bien encore les reines-claudes, dont la fragilité accentue les pertes. De
fait, ces cultures fruitières rapportent assez peu, entre 15 ou 20 dollars par mois. En revanche,
les tomates d’arbre, dont la production moyenne est de 150 fruits par semaine, se vendent
« facilement ». En prenant compte des pertes éventuelles et de la consommation directe sur
l’exploitation, elles offrent un revenu mensuel brut oscillant entre 40 et 50 dollars. Cela
représente approximativement un quart des ventes de produits agricoles, tandis que les ventes
de cobayes, au nombre de 3 par semaine, procurent un peu plus de 60 dollars par mois.
De tous ses revenus, Salvador en réinvestit une bonne partie. La plus grande part des dépenses
concerne la rénovation des deux serres, qui intervient tous les quatre ans. Pour la plus petite, il
faut compter environ 900 dollars pour remplacer le plastique usé, plus 3 ouvriers pendant
deux jours, ce qui revient à une dépense globale de plus de 1 000 dollars. Pour la plus grande,
l’investissement est deux fois plus important. Il y a trois ans, il a aussi fallu changer le
système d’irrigation des deux serres, ce qui a occasionné une dépense globale de 680 dollars.
Ce nouveau matériel pourra dans le meilleur des cas être utilisé pendant huit ans. Pour
l’ensemble de son exploitation, mais plus particulièrement pour ses fruits et ses potagers,
Salvador a recourt à l’achat de 150 sacs d’engrais par mois, en plus d’autres compléments
organiques qui lui coûtent 600 dollars par an.
Il ne faut pas non plus ignorer les coûts de main-d’œuvre, car si Salvador se consacre
essentiellement à ses cultures fruitières, et si sa femme s’occupe plus largement des animaux,
il leur faut régulièrement engager des ouvriers agricoles pour s’occuper des potagers et pour
entretenir les parcelles de maïs et de tubercules. Cela représente environ 10 jours de travail
par mois, payés 10 dollars, soit une dépense globale de 100 dollars toutes les quatre semaines
environ. Enfin, les coûts de transports atteignent 18 dollars pour se rendre directement aux
différents marchés (environ 6 dollars par sortie) et 10 dollars pour chaque livraison de fruits
au restaurant, soit une dépense hebdomadaire globale de 28 dollars (cf. Tableau n°28).
198
��1���*+,5=�1���+��.+.0�)*�0�+/*��0.@�+:�+#.����/;
#��&�?��.�����.+�(���.��#�/��9�#.��+5667
Revenus Dépenses
Sur le marché
Ventes de produits maraîchers 184 Transport 88
Ventes de fruits 616
Ventes liées à l'élevage 63 Location de stand 12
Restaurant Ventes de fruits 140 Transport 40
Sur l’exploitation
Ventes agricoles 0 Entretien matériel 70
Compost et compléments organiques
200
Ventes liées à l'élevage 0 Semences 10
Main-d’œuvre 100
Total 1 003 520
Calcul des dépenses de transport et de location de stand réalisé sur la base de 4 sorties mensuelles à la foire du CREA et 8 sorties mensuelles au marché 12 de Abril. Source : entretiens réalisés entre juillet 2008 et août 2009.
Le cas de Salvador est donc particulièrement intéressant car il indique que même une petite
exploitation est en mesure d’obtenir des revenus aussi élevés que réguliers, en produisant et
en commercialisant des quantités importantes de fruits destinées à la ville. Il montre en
définitive que l’apport de capital, ici grâce à la migration, est un facteur fondamental pour
viabiliser l’économie paysanne et permettre à celle-ci de se lier au marché urbain. Dans des
situations comparables, on observe une plus grande variété de productions, certaines
exploitations dirigées par d’autres anciens migrants parvenant à produire des fruits et des
légumes, et à élever toutes sortes d’animaux. C’est ce que nous allons voir à présent.
5�5�<��� ����� ��� �����"� � '��� � ����������� ���
Quand il était petit, Juan menait « une vie misérable ». Sa famille possédait une seule petite
parcelle de 2500 m². Pour survivre, sa mère faisait des chapeaux et son père était journalier.
Lui a passé toute son adolescence sur la côte, avant de revenir dans la paroisse Octavio
Cordero Palacios pour se marier à l’âge de 22 ans. Puis, il est parti une première fois à New
York pour finir de payer une lourde dette contractée après l’achat d’un hectare dans les années
1970 (cf. Chapitre 3). Après cela, il revint en Equateur, bien décidé à vivre de l’agriculture :
199
« Quand je suis rentré, j’ai acheté un tracteur et un autre terrain [2500 m²] à côté de celui que j’avais acheté avant de partir aux Etats-Unis. Tout cela m’a coûté plus de trois millions de sucres [15 500 dollars]. Je louais parfois mon tracteur à cinquante sucres [25 centimes] de l’heure. »
Après seulement quelques années passées dans son exploitation à produire du maïs et
de la pomme de terre, Juan s’en alla de nouveau :
« En 1994, je suis reparti aux Etats-Unis. Cela m’a coûté 6 000 dollars. Je suis allé en avion jusqu’au Guatemala, puis en bus jusque dans le nord du Mexique et enfin, j’ai passé la frontière clandestinement. J’ai rejoins mon frère à Minneapolis et comme la première fois, j’ai travaillé dans un restaurant. De commis à chef, je suis passé de six à quinze dollars par jour. Au bout d’un certain temps, je cumulais même deux emplois : je travaillais dans un premier restaurant de 8 à 13h et dans un second de 15h à minuit. Je gagnais jusqu’à 3 500 dollars par mois ! J’envoyais suffisamment d’argent à ma femme pour qu’elle puisse acheter deux nouveaux terrains [environ deux hectares] en 1997, toujours à côté de chez moi. Cela me coûta 75 000 000 de sucres [environ 18 500 dollars] en tout. En 2000, des membres de ma famille, qui vivaient dans l’oriente, me poussèrent même à acheter cent hectares à quatre-vingt millions de sucres [3 200 dollars]. Ce terrain, je l’ai revendu en 2008 à 42 000 dollars. Aujourd’hui, je ne me consacre plus qu’à l’agriculture. Je vends une grande partie de ce que je produis et cela fait des années que je n’achète plus rien ! Mes économies m’ont permis d’acheter de la terre et d’envoyer mes enfants à l’université. »
Juan a donc passé neuf ans aux Etats-Unis (cf. Schéma n°3). A présent, il vit dans le secteur
de La Nube et possède à présent une exploitation d’un peu moins de 3 hectares où l’on trouve
aussi bien des cultures commerciales, des cultures vivrières et de l’élevage laitier. De fait, ses
productions et ses ventes sont beaucoup plus diversifiées que celles de Salvador, mais comme
son voisin, Juan vend ses produits à la foire du CREA depuis 2005, tandis que sa femme se
rend au marché 12 de Abril le dimanche et le jeudi. Avec trois sorties hebdomadaires en ville,
c’est presque autant de travail de commercialisation qu’il faut pouvoir gérer en parallèle des
priorités agricoles.
201
Sur son premier terrain (2500 m²) situé dans le secteur de La Nube, Juan a construit une belle
et grande maison à côté de laquelle un pick-up rouge est à l’abri dans une sorte de garage en
bois. Derrière, une serre de petite dimension (100 m²) protège quelques pieds de tomates
d’arbre et de babacos. Tout autour, dans un grand potager (300 m²), poussent silencieusement
des choux, des brocolis, des oignons et des carottes, à côté d’un bruyant poulailler comprenant
une cinquantaine de gallinacés. Au fond de la parcelle, un petit enclos regroupe 3 porcs, et
dans un clapier en bois, se trouvent 150 cobayes.
��.�.(������+,86��&�?��.�����.+#�<*�+:�;
Comme tous les vendredis, Juan et son épouse récoltent les produits qui seront vendus le lendemain à la foire du CREA. Derrière eux, on distingue les babacos. Source : N. Rebaï (2009).
Le deuxième terrain d’environ 3 hectares est le cœur de l’exploitation. Là, Juan a construit
deux serres. Dans la première (300 m²), poussent une centaine de pieds de babacos et toutes
sortes de produits maraîchers : salades, choux, navets mais aussi des carottes et des épinards ;
dans la seconde (500 m²), construite il y a peu, de longues bandes de salades, de choux et
d’oignons sont cultivées (cf. Photographie n°61).
202
��.�.(������/+,8���&�?��.�����.+#�<*�+:5;
Dans la toute nouvelle serre, il cultive là aussi des salades, des choux et bien d’autres légumes. Source : N. Rebaï (2009).
Entre les deux grandes structures en plastique, il faut marcher environ cent mètres, longer le
petit hangar en bois où l’on aperçoit le tracteur, et traverser une parcelle de maïs d’environ
2500 m². Un peu plus loin, les vestiges d’une troisième serre laissent apparaître une centaine
de pieds de tomates d’arbre, « mais qui ne produisent plus beaucoup » d’après Juan, tandis
que le reste du terrain (environ 2 hectares) est laissé en pâturage pour élever 2 vaches, dont la
production moyenne est de 12 litres de lait par jour, 2 génisses et 2 jeunes taureaux. Une
troisième parcelle (2500 m²), située dans le secteur de Cristo del Consuelo, et dont il a hérité
de ses parents, permet à Juan de cultiver là aussi un peu de maïs.
Chaque jour, Juan doit faire le tour des serres pour prendre soin des arbres fruitiers et
surveiller les produits maraîchers. Il s’occupe aussi des bovins qu’il faut régulièrement
déplacer. De son côté, sa femme se consacre à la fabrication de fromages et s’occupe des
porcs et des cobayes. Avec eux vivent deux enfants, une fille de 25 ans qui est aide-soignante
et un fils de 20 ans qui poursuit ses études à l’université. Trois autres enfants vivent aux Etats-
Unis depuis plusieurs années déjà. Juan et son épouse sont donc seuls, dans leur exploitation,
203
à se consacrer pleinement à l’agriculture et à la commercialisation des produits. Ainsi, chaque
vendredi matin, ils passent quelques heures à récolter tous les deux les produits qui seront
vendus en fin de semaine à Cuenca, où ils se rendent confortablement assis dans le véhicule
familial.
Comme pour Salvador, la vente de fruits assure à Juan des revenus importants. Sur une
journée, il lui arrive fréquemment de vendre plus de babacos et de tomates d’arbre que sa
femme, mais comme il nous l’expliqua, « au marché 12 de Abril, elle peut vendre plus de
fromages et plus de poulets. » Ainsi, en fonction des espaces de vente sur lesquels ils se
rendent, Juan et son épouse se sont spécialisés. Au CREA, les ventes de fruits atteignent en
général 50 dollars par semaine tandis que les ventes de cobayes ou de fromages sont
moyennes et ne rapportent globalement pas plus de 30 dollars. A l’inverse, la fréquentation
des ménagères cuencanaises est plus grande sur le marché du centre ville ce qui permet à sa
femme d’écouler plus facilement les produits de l’élevage familial. Dans ces conditions, elle
parvient à vendre jusqu’à 10 cobayes (à 6 dollars pièce), 4 poulets et une quarantaine d’œufs
(à 0,25 dollar l’unité) chaque semaine. Elle vend par ailleurs jusqu’à 30 fromages
hebdomadaires alors que lui n’en vend « pas plus de 10. » Ce n’est que sur la vente de
produits maraîchers que les deux semblent être sur un pied d’égalité, chacun parvenant à
gagner environ 30 dollars par semaine.
Si l’on considère par ailleurs la vente de lait ayant lieu directement sur l’exploitation cinq
jours par semaine (10 litres par jour au prix unitaire de 0,35 dollar, soit 17,5 dollars par
semaine), les revenus de Juan dépassent les 1 300 dollars mensuels, ce qui semble être
considérable si l’on rapporte ce chiffre aux revenus bruts moyens des producteurs du groupe
Bajo Invernadero. Néanmoins, il faut prendre en considération l’ensemble des dépenses
auxquelles le producteur doit faire face pour le bon fonctionnement de son exploitation.
Comme chez Salvador, une bonne partie des revenus sert à la rénovation des deux serres qui,
dans le cas de Juan, intervient tout les deux ans. Comme il nous le dit, une grande partie de
son exploitation est balayée par des vents forts, « ce qui empêche le plastique de tenir
longtemps. » Par conséquent, il doit régulièrement embaucher plusieurs ouvriers et acheter du
matériel neuf, ne serait-ce que pour continuer à produire des fruits. Pour la plus petite de ses
deux serres, il faut compter environ 1 100 dollars afin de remplacer le plastique usé, plus 3
ouvriers pendant deux jours, ce qui revient à une dépense globale de 1 240 dollars, un coût qui
atteint 2 000 dollars lorsqu’il s’agit de rénover la plus grande. En outre, il faut régulièrement
changer le système d’irrigation en investissant pour cela près de 600 dollars tous les huit ans.
204
Pour l’ensemble de son exploitation, Juan utilise évidemment beaucoup d’engrais organique.
Pour les fruits et légumes, il a recourt à l’achat d’une centaine de sacs chaque mois, tandis que
pour le maïs et les autres cultures vivrières, il en consomme 200 lors des semis. Pour finir, il
ne faut pas oublier les coûts de main-d’œuvre réguliers, notamment pour l’entretien des
différentes petites parcelles maraîchères de l’exploitation. Ainsi, chaque semaine, Juan engage
deux ouvriers qui travaillent chez lui pendant deux jours, ce qui contraint à une dépense
hebdomadaire de 40 dollars. Pour le maïs, il engage également deux jours durant deux
ouvriers, pour désherber les parcelles, et deux autres encore pour la segunda, ce qui lui revient
au final à 80 dollars par an. Enfin, concernant les dépenses de transport, elles sont pour Juan
moins importantes que celles de la plupart des cultivateurs de la zone, puisqu’il dispose de
son propre véhicule pour aller vendre ses produits en ville.
��1���*+,57��/��0���.+#*1���+��.+.0�)*�0�+/*��0.@�+:�+#.����/;
#��&�?��.�����.+�(���.��#�<*�+�+5667
Revenus Dépenses
Sur le marché
Ventes de produits maraîchers 240 Transport 16
Ventes de fruits 280 Location de stand 12
Ventes liées à l'élevage 870
Sur
l’exploitation
Ventes agricoles 0 Entretien matériel 140
Engrais organique 116
Vente de lait 84 Semences 10
Main-d’œuvre 165
Total 1 390 469
Calcul des dépenses de location de stand réalisé sur la base de 4 sorties mensuelles à la foire du CREA et 8 sorties mensuelles au marché 12 de Abril ; calcul des dépenses de transport établi sur la base de trois déplacements hebdomadaires vers les marchés de Cuenca. En 2009, la consommation de carburant pour un pick-up comme celui de Juan était d’environ 15 dollars par semaine pour un cuencanais habitué à de nombreux déplacements quotidiens. Pour un agriculteur, dont la mobilité est plus réduite, les dépenses de carburant sont donc moins importantes, et ne doivent atteindre en moyenne que 8 dollars hebdomadaires. Les seuls déplacements commerciaux ne peuvent donc excéder 4 dollars par semaine, soit 16 dollars par mois. Source : entretiens réalisés entre juillet 2008 et août 2009.
Le fonctionnement des deux dernières exploitations décrites nous révèle plusieurs éléments
intéressants. Qu’il s’agisse d’une spécialisation économique où les ventes de fruits forment à
elles seules la majorité des revenus réguliers (Salvador), ou bien d’une diversification des
activités agricoles et d’élevage (Juan), les petites unités de production offrent de grandes
possibilités pour assurer le ravitaillement urbain lorsqu’elle dispose de capitaux importants.
205
A l’inverse, nous avons indiqué plus haut l’importance des revenus extra-agricoles dans
certaines exploitations du groupe de producteurs Bajo Invernadero, en soulignant le fait qu’ils
permettaient de pallier les dépenses quotidiennes des familles. Autrement dit, il n’existerait
pas une, mais des agricultures commerciales dans la paroisse Octavio Cordero Palacios. Nous
proposons donc de classer les exploitations vues tout au long de ce chapitre en fonction de
leurs revenus, pour comparer les différents systèmes d’activités que nous avons décrit
précédemment et comparer l’importance économique des activités agricoles et d’élevage à
celles de la migration et des emplois locaux dans les différentes économies domestiques.
-�*����� �������������� ���%���>' ������
Dans les exploitations où les systèmes de production sont plus intensifs en travail, comme
dans celles des producteurs du groupe Bajo Invernadero, les salaires extérieurs sont
indispensables car ils compensent les revenus modestes du maraîchage et de l’élevage,
lesquels peinent à décoller du fait d’une consommation domestique souvent très importante.
Dans d’autres situations, l’agriculture et l’élevage conservent une importance économique
majeure. Si les remesas viennent compléter les revenus familiaux, les ventes de produits frais
procurent en générale plus de la moitié des rentrées d’argent régulières, voire la totalité. Cela
se vérifie justement dans les exploitations où la main-d’œuvre est aujourd’hui très limitée.
-��� #�� �>��� ��� ��� �F ��� ����� � �>��� ���� ���� ������ ����� ���� ��
��������� ���������������� "��
Chez Daniel, entre septembre 2008 et mai 2009, cinq personnes se consacraient
quotidiennement à l’agriculture et à l’élevage pour un revenu moyen de 36 dollars bruts
mensuels. Le maraîchage ne leur rapportait d’ailleurs à chacune que 10,3 dollars bruts par
mois, soit l’équivalent d’une journée de salaire d’un ouvrier non qualifié. Pour le reste, deux
autres personnes occupaient un emploi extérieur, parfois à mi-temps, et gagnaient en moyenne
210 dollars par mois, tandis que les revenus de la migration, bien qu’irréguliers, assuraient
tout de même 7% des revenus bruts de l’exploitation, c’est-à-dire autant que le maraîchage.
Au final, les activités extérieures représentaient 72% des revenus bruts familiaux et
206
participaient donc majoritairement à la reproduction du groupe domestique (cf. Graphique
n°10).
Le constat est encore plus net chez Manuel. Pour lui et sa famille, les salaires des emplois
locaux représentaient 86% des revenus bruts entre septembre 2008 et mai 2009, alors que les
ventes de produits maraîchers ne constituaient par exemple que 9 % des rentrées d’argent
régulières. L’unique personne qui se consacrait alors quotidiennement à l’agriculture et à
l’élevage obtenait un revenu brut moyen de 75,8 dollars par mois, tandis que les quatre autres
qui occupaient des emplois précaires en ville percevaient un salaire moyen de 120 dollars
bruts mensuels (cf. Graphique n°11).
Dans ces deux situations, la faiblesse des revenus agricoles s’explique en partie par la
présence de nombreuses personnes au sein des exploitations. Dans ces conditions, la part de
l’autoconsommation est évidemment très élevée, ce qui limite donc les ventes hebdomadaires.
L’argent extérieur de la migration ou des emplois locaux est donc essentiel pour les familles
composées d’un nombre plus important d’individus n’ayant que peu de terre pour produire
l’ensemble de leur alimentation et dégager par ailleurs un surplus de production qui leur
permettrait d’avoir une activité marchande soutenue. Dans ces deux cas précis, ne doit-on
donc pas inverser les rôles et considérer l’agriculture comme une activité complémentaire aux
emplois urbains, permettant par ailleurs au groupe domestique de parvenir plus facilement à
couvrir ses propres besoins alimentaires ?
Ailleurs, les systèmes de production restent très intensifs en travail, mais les familles sont
beaucoup plus réduites. On pourrait alors imaginer une augmentation significative des
revenus par tête, mais il n’en est rien. Entre septembre 2008 et mai 2009, les ventes de
produits agricoles, de petits animaux et de fromages frais rapportaient en moyenne
112,15 dollars bruts par mois à Félix et son épouse, soit 3,75 dollars par jour (pour un mois à
30 jours) pour ce couple de producteurs. Le maraîchage ne leur assurait d’ailleurs que 11,25
dollars par mois, une somme presque dérisoire à côté de l’argent de la migration qui assurait
au couple 45% de ses revenus bruts (cf. Graphique n°12)
207
-�5� #�� �>��� ��� ��� �F �&��� ������� �� �&���'��� G����� �� �H��
������ "�������� ���
�
Si María conduisait l’exploitation la plus rentable du groupe de producteurs Bajo Invernadero
entre septembre 2008 et mai 2009, c’est bien parce que ses ventes régulières lui rapportaient
452,3 dollars bruts mensuels, soit le double du salaire minimum équatorien en 2009, qui était
à l’époque de 218 dollars par mois (CEPAL, 2009). L’élevage laitier lui assurait alors en
moyenne 220 dollars bruts mensuels, soit le double de ce qu’elle recevait des Etats-Unis. Les
ventes régulières de produits agricoles dépassaient elles aussi de 30% les revenus de
l’émigration, tandis que les cobayes lui procuraient 16% de son revenu brut global, soit
presque autant que les remesas. En résumé, le salaire journalier de María était de 15 dollars
bruts par jour (pour un mois à 30 jours), un niveau de rémunération supérieur à celui d’un
ouvrier non qualifié, ce qui devrait lui permettre à moyen terme de moderniser son
exploitation, pour s’orienter comme d’autres, vers des cultures beaucoup plus rentables (cf.
Graphique n°13). Bien entendu, il faut préciser que le contexte migratoire lui a été favorable
ces dernières années. En dehors du fait qu’elle aie reçu un terrain pour avoir élevé le fils d’un
couple d’émigrés, l’absence de son frère et de sa sœur lui permet de bénéficier de ressources
foncières plus importantes qui lui permettent de développer l’élevage laitier et d’augmenter
ainsi ses revenus. �
Enfin, le cas de Natividad est tout à fait exceptionnel, voire paradoxal. Si elle ne perçoit en
moyenne que 107,1 dollars par mois, elle prouve néanmoins que même sans grandes
ressources, le développement de l’agriculture marchande est possible et que l’accès au marché
urbain est un facteur déterminant pour le maintien des petites unités de production agricoles.
Ce qu’il faut retenir par ailleurs, c’est l’influence de la dynamique collective qui a permis à
Natividad de s’orienter vers des productions plus rentables que les cultures de cycle long,
même si dans son cas, l’élevage laitier joue de nouveau un rôle fondamental en lui fournissant
53% de ses revenus bruts (cf. Graphique n°14). En définitive, l’agriculture et l’élevage, tout
en assurant sa propre sécurité alimentaire, lui garantissent un salaire brut de 3,25 dollars par
jour (pour un mois à 30 jours), ce qui est faible, mais néanmoins suffisant pour lui permettre
de vivre dignement.
208
(�����)*�/+,�6I�3����������.+0.@�++�#�/��9�+*/1�*�/#�/�?��.�����.+/
#*(�.*��#���.#*���*�/���������������+���/����01��566=��0��5667
209
-�-�#������������������ �����J
Dans les exploitations où les systèmes de production sont plus intensifs en capital, comme
chez Salvador et Juan, nous l’avons vu, les revenus agricoles sont bien plus importants. Les
investissements que les deux anciens migrants ont effectués pour produire des fruits en
abondance sont aujourd’hui particulièrement rentables. Malgré des coûts de production
mensuels de 405 dollars en moyenne, ils parviennent tous deux à dégager une marge nette de
plusieurs centaines de dollars chaque mois. Ne travaillant qu’avec leurs épouses et parfois
quelques ouvriers agricoles, leurs salaires dépassent de loin ceux des autres producteurs de la
zone ou même ceux des emplois locaux non qualifiés. Dans leur situation, nous pouvons
même affirmer qu’un apport financier supplémentaire provenant de la migration serait
marginal s’il ne s’agissait, comme dans la plupart des cas, que d’une centaine de dollars par
mois.
Si Salvador se définit lui-même comme un « fruiticulteur », c’est bien parce que 56% de ses
revenus proviennent principalement de la vente de babacos et de tomates d’arbre. Il ne
faudrait pas ignorer non plus les ventes régulières de produits maraîchers qui lui assurent près
de 400 dollars par mois. En revanche, les ventes de cobayes sont pour lui marginales, et celles
de produits laitiers totalement inexistantes. Comme nous le disions plus haut, il s’agit bien là
d’une forme de spécialisation économique, non sans risque, car une chute soudaine de ses
rendements, à cause d’une maladie éventuelle de ses arbres fruitiers, ou une détérioration des
conditions de ventes, pourrait le priver d’une partie de ses revenus, sans possibilité de
compensation immédiate (cf. Graphique n°15).
A l’inverse, pour Juan, l’expression « finca integral »45, très en vogue chez les techniciens à
l’œuvre dans les campagnes de l’Azuay, paraît justifiée. Les ventes, diversifiées et
relativement homogènes, correspondent à une stratégie de réduction du risque économique,
laquelle s’avère payante puisqu’il s’agit certainement de l’exploitation la plus rentable de la
paroisse Octavio Cordero Palacios, de l’avis même des paysans qui voient en Juan l’une des
plus belles réussites migratoires de la localité. On pourrait néanmoins remarquer l’importance
économique des différents types d’élevages, desquels Juan parvient à tirer 63% de ses revenus
(cf. Graphique n° 16).
45 « Exploitation intégrale ».
210
(�����)*�/+,�I�8����������.+0.@�++�#�/9�+��/���K/��9�#.���<*�+�+5667
D’après ce que nous avons vu jusqu’ici dans ce chapitre, les petites exploitations de la
paroisse Octavio Cordero Palacios démontrent leur capacité à s’adapter au contexte
migratoire, même si dans certains cas, les revenus des emplois extérieurs demeurent plus
importants que ceux des ventes agricoles. Cette première observation nous indique par
conséquent que même au niveau d’un échantillon réduit de familles, il existe des contrastes
socioéconomiques importants et des stratégies de reproduction variées. Un certain nombre
d’interrogations demeurent cependant : toutes les exploitations de la localité parviennent-elles
à tirer parti du contexte migratoire et de la proximité urbaine ? Les agriculteurs ont-ils tous les
moyens de s’orienter vers des cultures commerciales ? Qu’en est-il de ceux qui
n’appartiennent pas aux réseaux de producteurs agroécologiques ?
3�# '��� ����� ������������%���������B�
En 2008, la comuna Illapamba ne réunissait que quelques familles qui travaillaient
collectivement sur des terres agricoles situées à 3200 mètres d’altitude. C’est en tout cas ce
que nous apprîmes au cours d’un entretien avec les représentants de l’assemblé paroissiale, au
211
début de notre travail de terrain, en juin 2008. Comment cette organisation, qui au milieu des
années 1960 comptait plus d’une centaine de membres, avait-elle alors décliné ? Comment les
logiques de travail avaient-elles évolué au cours des dernières décennies ? Et surtout, quels
étaient les paysans qui appartenaient encore à la comuna au moment de notre venue sur le
terrain ?
Pour le savoir, il a d’abord fallu que nous reconstituions l’histoire d’Illapamba et que nous
réalisions des entretiens comparables à ceux que nous avons menés avec les membres du
groupe Bajo Invernadero. Pour commencer nous nous sommes adressé aux dirigeants
politiques de la paroisse Octavio Cordero Palacios, lesquels nous ont ensuite renvoyé à
Vicente, le président de la comuna en 2008. Avec lui, notre premier entretien fut très cordial
et il nous apprit même que l’entreprise publique ETAPA-Cuenca intervenait sur le territoire
d’Illapamba depuis plusieurs mois. Nous avons alors décidé de contacter M. Bustamante, de
l’institution susnommée, lequel nous proposa ensuite de l’accompagner sur le terrain tous les
mercredis.
Pendant plusieurs semaines, nous avons donc assisté aux travaux collectifs et aux réunions de
l’organisation. Dans ce contexte, nous avons pu réaliser des entretiens avec 11 des 12 paysans
de la comuna, l’un d’eux refusant catégoriquement de dialoguer avec nous, et c’est ainsi que
nous avons appréhendé la réalité sociale de ce groupe. Pour compléter ce travail, nous nous
sommes plusieurs fois rendu aux archives du ministère de l’Agriculture à Cuenca où nous
avons consulté plusieurs documents anciens, des registres46 et des rapports d’ingénieurs en
particulier. Cela nous a permis de compléter les témoignages des paysans et de resituer le
territoire d’Illapamba dans sa perspective historique. Par ailleurs, nous nous sommes aussi
entretenu avec des anciens membres de la comuna, lesquels nous ont fait des descriptions de
l’organisation et de ses avatars au cours des dernières décennies, comme nous allons le voir à
présent.
46 Ces derniers sont très précieux pour connaître l’évolution démographique d’une comuna. Malheureusement, ils sont irrégulièrement mis à jours par les organisations, alors qu’il s’agit de « l’une de leurs obligations », comme nous le précisa R. Burbano, juriste au ministère de l’Agriculture à Cuenca.
212
3���*���C���'���� �����&����������"���������������������� ��
En 1962, lorsque les nouvelles limites de la comuna Illapamba furent établies par le ministère
de l’Agriculture, l’organisation devait compter plus d’une centaine de comuneros. Comme
nous le décrit alors Félix, sans que nous puissions confirmer ses dires d’une preuve formelle,
« dans le temps, il y avait des dizaines de personnes qui se rendaient à Illapamba pour
travailler ensemble. Petit, j’y allais avec mon père, car à l’époque, il fallait du monde pour
cultiver la pomme de terre et pour s’occuper des animaux. » Quelques années plus tard, la
situation avait semble-t-il assez peu évolué. Comme l’indique une note de 1973 archivée au
ministère de l’Agriculture à Cuenca, l’organisation comptait cette année là 130 familles
(cf. Annexe n°15). D’après Luis, « les gens allaient travailler à Illapamba pour avoir de quoi
se nourrir », c’est pourquoi « presque tout était mis en culture.47 »
Toutefois, dès la fin des années 1970, le nombre de paysans membres de la comuna Illapamba
commença à décliner. Comme l’indique une enquête réalisée par le ministère de l’Agriculture
(cf. Annexe n°16), en 1984, l’organisation ne comptait plus que 60 inscrits. Félix, qui en était
à l’époque le président, nous expliqua cette baisse importante du nombre de comuneros : « à
cause des emplois sur la côte et de l’émigration [internationale] qui était de plus en plus
importante, les gens ont commencé à moins venir parce qu’ils ne pouvaient plus travailler
chez eux et participer aux tâches collectives en même temps. » Dans ces conditions l’usage du
sol à Illapamba évolua lui aussi progressivement. Toujours d’après Félix, « il y avait de moins
en moins d’agriculture et de plus en plus d’élevage. »
Au cours des années qui suivirent, le nombre de comuneros à Illapamba continua de décliner
tandis que l’émigration internationale des paysans augmentait. En 1994, d’après le registre
des membres de l’organisation, celle-ci ne comptait plus que 19 inscrits (cf. Annexe n°17), et
en 2008, ils n’étaient plus que 12, comme nous l’avons indiqué plus haut. Dans ces
conditions, l’usage du sol du territoire communal continua d’évoluer rapidement.
47 On peut cependant en douter. Il devait plus probablement s’agir de quelques hectares, de tubercules principalement, mais aussi de céréales.
213
A l’instar de ce que nous avons pu observer dans un grand nombre d’exploitations familiales,
les paysans d’Illapamba ont progressivement réduit la taille des parcelles dédiées à
l’agriculture, faute de main-d’œuvre disponible, pour se consacrer davantage à l’élevage
laitier. Comme nous l’expliqua Vicente, « il est devenu trop difficile de travailler avec si peu
de monde. Même avec les enfants qui accompagnent leurs parents, cela ne suffit pas. Mieux
vaut alors se consacrer à l’élevage pour consommer et vendre du lait. »
En nous appuyant de nouveau sur les données de l’IERSE, dont nous avons présenté les
limites dans le Chapitre 4, il est possible de prendre la mesure des mutations de l’usage du sol
à Illapamba au cours des vingt dernières années. Entre 1991 et 2001, les comuneros
déboisèrent ainsi de grands espaces, entraînant une augmentation de 165% des superficies
pâturées sur le territoire communal, tandis que les parcelles cultivées, qui étaient déjà
réduites, voyaient dans le même temps leur surface totale diminuer de 44%. Cette extension
des pâturages fut par ailleurs d’une telle importance qu’elle entraîna une baisse de 8% de la
superficie des páramos.
��1���*+,-6��9.�*��.+#�//*���2����/:�+�������/;#�/���+������/2.�0�/#&*/�(�#*/.�
#�+/��&�#'��������01��+����77���566�
Occupation du sol 1991 2001
Cultures vivrières Maïs, blé, orge, fève, haricot, pomme de terre
2,5 1,4
Espaces boisés 109 75
Pâturages 25,3 67
Páramos 51,2 47,1
Source: IERSE (2003).
3�5���'������B� �������'�� ��B���������� '������� "���
Toutefois, le développement de l’élevage ne fut pas la seule raison du déboisement rapide du
territoire communal. D’après le bilan économique de la comuna Illapamba entre janvier 2008
et mars 2009, la vente de lait ne représentait en effet que 97,1 dollars, soit 3% des revenus
bruts de l’organisation (cf. Tableau n°31).
214
��1���*+,-��1���+��.+.0�)*�#���&�#'��������01��+���<�+9���566=��0��/5667
Revenus en dollars
Dépenses en dollars
Ventes agricoles 256,05 Dépenses agricoles (compost et semences)
172,55
Ventes d’herbe 215 Location de tracteur 208
Ventes de lait 97,10 Alimentation 718,44
Vente de bois 2 348,40 Frais divers
(transport, électricité, gaz, entretien de la maison communale)
299,76
Caisse communale 250 Frais administratifs 342
Divers 1,60 Divers 80
Total 3 168,15 Total 1 820,75
Source : « Egresos e Ingresos realizados en la organización comunal de Illapamba en el el periodo enero 2008 hasta marzo del 2009 », archive du ministère de l’Agriculture (date et auteur inconnus, cf. Annexe n°18). Calculs et mise en forme : N. Rebaï. NB : les chiffres présentés ici ne correspondent pas exactement à ceux du document original, lequel contient certaines erreurs de calculs.
Certes, il est fort vraisemblable qu’une très grande part de la production laitière ait été
destinée à l’autoconsommation, mais un niveau de rémunération aussi faible depuis plusieurs
années a sans doute été déterminant pour que la comuna cherche à diversifier ses revenus.
Ainsi, la vente de bois, principalement d’eucalyptus et de conifères, comme elle est pratiquée
par de nombreuses familles paysannes de la zone, a eu ces dernières années un intérêt
économique majeur à Illapamba. Entre janvier 2008 et mars 2009, elle représenta même 74%
des rentrées d’argent de l’organisation et permit à elle seule de couvrir l’ensemble de ses
dépenses totales. Cela signifie qu’au-delà même de vouloir développer l’élevage laitier, tant
pour des raisons monétaires qu’alimentaires, la coupe de bois est, dans le contexte actuel, une
ressource économique essentielle pour le maintien de l’organisation communale (cf.
Photographies n°62/63).
215
��.�.(������/+,85I8-�#�/1.�/�*?���*��(�/ ���+(�0�+�#�+/�&*/�(�#*/.��������01�
Dans plusieurs secteurs de la comuna, on observait encore en 2008 la présence de bûcherons (en haut).
Ailleurs, une grande partie de la végétation avait déjà disparu, laissant apparaître de grandes aires de pâturages. Source : N. Rebaï (2008).
216
3�-�#����� "��������'� ����� �������������'�����
Dans le contexte actuel, la comuna Illapamba n’a donc plus rien à voir avec ce qu’elle était il
y a cinquante ans. En dehors de l’augmentation très nette des superficies pâturées, doublement
conditionnée par la vente de bois et le développement de l’élevage laitier, s’est mise en place
une forme d’appropriation de l’espace tout à fait originale, même si dans une moindre mesure,
les tâches agricoles collectives se maintiennent et permettent même à l’organisation d’avoir
une petite activité commerciale.
3�-���*������������ ����$������L
Pour protéger les páramos et limiter les phénomènes d’érosion induits par une réduction
accélérée du couvert végétal, l’entreprise ETAPA-Cuenca est intervenue auprès des paysans
d’Illapamba, en les incitant à concentrer l’élevage sur une partie seulement du territoire
communal. Depuis plusieurs années, l’institution publique, dont l’une des missions est la
protection des ressources hydriques à l’échelle de la province de l’Azuay, intervient auprès
des communautés paysannes de la région en les appuyant techniquement pour maintenir les
espaces boisés des páramos. C’est ainsi que nous l’expliqua M. Bustamante, l’ingénieur en
charge du projet de conservation environnemental mené par ETAPA-Cuenca dans la paroisse
Octavio Cordero Palacios depuis 2008 : « de nos jours, les paysans ne cherchent qu’à
développer l’élevage sans se préoccuper véritablement des conséquences que cela implique
sur le milieu. S’ils colonisent les páramos ou s’ils ne laissent plus un seul arbre, alors ils
mettront en péril la stabilité des sols et les ressources en eau. C’est pourquoi, nous voulons
favoriser le reboisement du territoire d’Illapamba, tout en permettant un partage d’une partie
des aires pâturées, pour que chaque paysan ait la responsabilité d’une portion du territoire
communal et qu’il puisse y élever ses propres animaux. »
Dans ces conditions, ETAPA-Cuenca participe symboliquement à la désolidarisation de
l’organisation paysanne, alors que celle-ci semble déjà manquer de cohésion, comme nous le
déclara Ermelinda, une comunera de longue date : « avant, les gens venaient travailler
collectivement, mais dorénavant, c’est devenu chacun pour soi. » En effet, pour un certain
nombre de comuneros, ce qui importe aujourd’hui est de conserver leurs droits d’accès aux
terres communales, pour y laisser paître leurs vaches laitières, quand dans leurs propres
217
exploitations il leur est difficile de maintenir les troupeaux. A l’inverse, le manque
d’implication est évident lorsqu’il s’agit de se joindre aux tâches ingrates de désherbage des
parcelles ou de fabrication de compost. Ainsi, comme nous le dit Rosa, membre de la comuna
depuis plus de trois décennies, « les mingas n’ont plus rien à voir avec celles du passé, tout va
très lentement, des tâches qui prenaient seulement quelques heures auparavant nécessitent
désormais plusieurs jours. Les gens ne viennent plus à l’heure car ils préfèrent travailler chez
eux. Personne ne paye plus d’amende en cas de retard. Aujourd’hui, il n’y a plus d’ordre. »
3�-�5�L���������� ����'������������ '������ ��������� � ������ '���
Toutefois, il serait inexact d’affirmer que les pratiques collectives ont complètement disparu à
Illapamba et que toutes les institutions présentes aux côtés de l’organisation ont bouleversé
son fonctionnement. Ces dernières années par exemple, le ministère de l’Agriculture a
régulièrement fourni des semences et de l’engrais à la comuna, en veillant à leur utilisation
collective. De son côté, le CEDIR a encouragé au cours des années 2000 la production de
pommes de terre, dans le cadre d’un programme financé par l’Organisation des Nations Unies
pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). L’encadrement institutionnel des paysans
d’Illapamba a donc favorisé, dans une certaine mesure, le maintien d’une dynamique
collective, malgré la diminution de la main-d’œuvre, et en dépit de certaines aspirations
individuelles.
On pourrait croire alors à une sorte de mise sous tutelle de la comuna par les différentes
institutions présentes à ses côtés, mais le fait que certaines productions se soient maintenues et
qu’elles aient permis à plusieurs membres de l’organisation de satisfaire une partie de leurs
besoins alimentaires, comme nous le verrons par la suite, nous pousse à relativiser ce
jugement. En 2008, les comuneros cultivaient toujours un demi hectare de pomme de terre, et
une petite parcelle de maïs de 1500 m² environ. D’après Manuel S., l’un des plus anciens de
l’organisation, une part assez « faible » de la production était vendue, tandis que le reste était
directement consommé par les paysans (cf. Photographie n°64), tout comme le lait produit par
les quatre vaches de la comuna, dont seulement une part infime était commercialisée, comme
l’indique le bilan économique présenté antérieurement.
218
��.�.(������+,83�*+����/�������01�
Les pommes de terres récoltées par les paysans d’Illapamba sont partagées et parfois même consommées les jours de travail, après avoir été préparées dans des conditions rustiques. Source : N. Rebaï (2009).
Enfin, la comuna s’est orientée, comme bon nombre d’exploitations familiales de la paroisse
Octavio Cordero Palacios, vers le maraîchage, pour produire une partie de son alimentation et
pour tirer des revenus de la vente régulière de légumes frais. Depuis 2005, l’organisation
dispose en effet d’un stand à la foire du CREA, ce qui lui permet d’exister en tant
qu’association de producteurs agroécologiques. Ainsi, elle reçoit de temps à autres un appui
technique, pour cultiver un potager de 400 m² environ, grâce auquel elle parvient à obtenir
quelques dizaines de dollars chaque mois. Bien que la rémunération brute de l’activité
maraîchère soit faible, comme nous l’avons vu précédemment avec les producteurs du groupe
Bajo Invernadero, et d’autant plus lorsque le produit des ventes doit être divisé entre les 12
familles membres de la comuna, le groupe de paysans consacre une grande partie de son
temps à l’entretien du potager, et chaque samedi, Manuel S. se charge de la vente des
produits.
219
��.�.(������+,8���/#��+���/�/����/�*���9�/�������01�
Les comuneros à l’oeuvre : ils préparent le sol avant de semer de la pomme de terre. Source : N. Rebaï (2008).
En dépit de quelques revenus commerciaux, la comuna Illapamba paraît être en plein déclin,
en témoigne d’ailleurs la baisse constante de sa population depuis plus de trente ans. Une
question mérite par conséquent d’être posée : pour quelles raisons les derniers comuneros
continuent-ils d’être membres de cette organisation ?
3�3�������� ������%����� "�������� ��J
Après avoir décrit les grandes mutations de la comuna Illapamba au cours des dernières
décennies, il est temps de nous intéresser plus précisément aux profils des paysans qui la
composaient encore en 2008. Compte tenu de la part importante de la production agricole
destinée à la consommation directe, nous pourrions considérer qu’il s’agit d’individus aux
ressources modestes et à la recherche de moyens de subsistance en dehors de leurs
exploitations. La réalité n’est cependant pas si évidente. Pour le montrer, nous proposons
d’analyser les cas particuliers de trois comuneros, Ermelinda, Julia et Vicente, avec qui les
entretiens furent particulièrement réussis. Pour chacun, nous avons réalisé le bilan des
220
activités économiques, comme nous l’avons fait pour les producteurs du groupe Bajo
Invernadero, mais en intégrant cette fois-ci les dépenses alimentaires et les principales
dépenses domestiques dans chaque bilan comptable.
Si d’ores et déjà, nous pouvons préciser que nos calculs économiques correspondent
davantage à des estimations des revenus et des dépenses de chacune des familles de la
comuna Illapamba, alors que pour les producteurs du groupe Bajo Invernadero nous
disposions de chiffres précis, en ce qui concerne tout du moins les ventes sur les marchés
urbains, la méthode que nous allons employer à présent a cependant l’intérêt de nous fournir
des éléments supplémentaires pour appréhender au mieux les caractéristiques sociales de la
paroisse Octavio Cordero Palacios. En effet, grâce aux entretiens réalisés avec les paysans
d’Illapamba, nous avons pu déterminer dans quelle mesure les familles parvenaient à couvrir
leurs dépenses agricoles et à satisfaire dans le même temps leurs besoins les plus
élémentaires, comme l’achat de vivres par exemple. Plus qu’un bilan économique des
exploitations, nous avons donc réalisé un bilan économique des ménages qui composaient la
petite organisation paysanne en 2008.
Concrètement, nous avons pu faire ce travail car nous disposions de plus de temps : avec les
producteurs du groupe Bajo Invernadero, il nous fallut nous rendre à la fois sur les
exploitations et sur les espaces de vente, ce qui nous contraignit à faire l’analyse de l’activité
commerciale en priorité. Avec les différents exploitants d’Illapamba, nous avons fait deux ou
trois entretiens, d’abord sur les activités agricoles (dépenses, revenus, choix culturaux, etc.),
puis sur les salaires extérieurs (artisanat, emplois locaux, remesas) et les dépenses
domestiques (alimentation, éducation, frais divers, etc.). C’est ainsi, que nous nous avons pu
constater une grande variété de profils socio-économiques à l’échelle de la comuna, comme
nous allons le voir à présent.
3�3�������� ��� ���'� ����%�������B������'� ���"�� ������
Ermelinda est née dans la paroisse Octavio Cordero Palacios en 1926. Veuve depuis l’âge de
36 ans, elle a élevé seule ses quatre enfants dans sa petite exploitation d’un hectare située dans
le secteur de San Bartolomé. Membre de la comuna Illapamba depuis près de quarante ans,
elle vit aujourd’hui avec Elisa, la plus jeune de ses filles. Julio et Daniel, ses deux fils aînés
221
ont émigré aux Etats-Unis à la toute fin des années 1970, tandis que Rosario, son autre fille,
possède avec son mari sa propre exploitation.
Pour cultiver leurs trois petites parcelles, Ermelinda et Elisa peuvent compter sur l’aide de
Rosario et surtout de son araire. En 2008, elles purent ainsi récolter un peu plus de deux
quintales de maïs, environ 25 kg de fève et une cinquantaine de courges, le tout pour leur
propre alimentation. Elles possèdent en outre une trentaine de cobayes destinés à être
consommés sur place, même si de temps à autres, « il arrive d’en vendre deux ou trois aux
voisins », pour obtenir quelques revenus. En dehors de cela, Ermelinda ne possède ni vache,
ni mouton, seulement quelques volailles éparpillées autour de la maison.
L’accès aux terres d’Illapamba est donc fondamental pour elle et sa fille. L’herbe de le
comuna lui permet de nourrir ses cobayes, tandis qu’une partie du lait et des tubercules
récoltés par l’organisation leur permet de satisfaire une partie de leurs besoins alimentaires.
Pour le reste, les deux femmes ont recours à des achats réguliers d’huile, de farine, de riz, de
sel et de sucre. Pour couvrir ces dépenses, « environ 60 dollars par mois », Elisa tisse des
chapeaux, comme dans le passé. Au cours d’une bonne semaine, elle peut en réaliser six, ce
qui lui permet de dégager une marge nette de 14 dollars, après l’achat de la paja toquilla48. En
dehors de ces maigres revenus, Ermelinda et sa fille reçoivent tout de même un peu d’argent
de l’étranger : « entre 60 et 80 dollars par mois de la part de Julio et Daniel », plus 40 dollars
par mois de la part du mari d’Elisa qui a émigré il y a quelques années. Passées les dépenses
alimentaires et les autres frais réguliers, comme le gaz, l’électricité et les transports en ville,
cet argent extérieur permet à Ermelinda et sa fille de dégager une marge nette d’un peu plus
de 80 dollars par mois en moyenne, de couvrir d’autres types de dépense (achats de
vêtements, d’outils, etc.), ou de faire face à certaines urgences sanitaires (cf. Tableau n°32).
48 Il faut compter 0,72 dollar de fibres pour la confection d’un seul chapeau, tandis que le prix de vente est en moyenne de 3 dollars.
222
��1���*+,-5�0.@�++�#�/��9�+*/1�*�/��#�/#���+/�/0�+/*��/:�+#.����/;
#&��0���+#���#�/�2�����+566=
Revenus Dépenses
Ventes de cobayes 10 Alimentation 60
Vente de chapeaux 36,50
Remesas 110 Frais divers 15,40
Total 156,50 Total 75,40
Calcul des ventes de cobayes réalisé sur la base de deux ventes mensuelles à 5 dollars ; calcul des ventes de chapeaux réalisé sur la base de 4 ventes hebdomadaires et d’un bénéfice unitaire de 2,28 dollars ; calcul des remesas réalisé sur la base de deux envois mensuels moyens, le premier de 70 dollars (de la part du fils d’Ermelinda) et le second 40 dollars (de la part de son gendre) ; calcul des frais divers réalisé sur la base de 2 déplacements hebdomadaires à Cuenca, pour un coût total de 1,60 dollar, de l’achat mensuel de 2 bouteilles de gaz, pour un coût total de 4 dollars, et d’une facture d’électricité moyenne de 5 dollars par mois. Source : entretiens réalisés entre juillet 2008 et décembre 2008.
Avec si peu de terre, et n’appartenant à aucun groupe de producteurs, Ermelinda et sa fille
dépendent donc cruellement de ressources extérieures pour se nourrir. Pour elles, l’argent de
l’artisanat et de la migration reste déterminant pour pallier leurs dépenses domestiques,
comme le fait d’être membre de la comuna leur permet de couvrir plus facilement leurs
besoins alimentaires. Et qu’importe si, de chez elle, Ermelinda doit marcher « près de deux
heures » chaque fois qu’elle se rend sur les terres d’Illapamba, l’essentiel est de revenir avec
de quoi manger.
3�3�5�<�� � ������ ������B��������������������'� �������
���%������������ ��� ' ��
Julia a 36 ans. Membre de la comuna Illapamba depuis plus de dix ans, elle est mère d’une
famille de sept enfants et possède avec son mari une exploitation d’un hectare environ, divisée
en quatre lots situés dans les secteurs de Cristo del Consuelo et de Parcoloma. Pour cultiver
leur peu de terre, Julia fait appel à six de ses frères et sœurs. Comme elle nous le déclara elle-
même, « avec autant de monde, on ne met qu’une journée pour tout semer, et une autre pour
tout désherber ». En 2008, Julia et son mari récoltèrent ainsi près de cinq quintales de maïs,
un quintal de fève, et même un peu de blé, le tout destiné à la consommation familiale. En
dehors de cela, Julia cultive un potager de 200 m², à côté duquel se trouve une dizaine de
pieds de tomates d’arbre. L’exploitation compte par ailleurs une quarantaine de volailles,
223
environ trente cobayes, ainsi qu’une génisse, que Julia parvient à nourrir avec l’herbe de la
comuna.
Pour le reste des productions agricoles destinées à l’alimentation familiale, Julia compte bien
évidemment sur les pommes de terre et les légumes produits à Illapamba, bien qu’il ne
s’agisse que de quantités assez peu importantes pour une famille aussi nombreuse. En ce qui
concerne plus particulièrement le lait, elle ne pouvait en récupérer que quelques litres par
semaine, ce qui était loin de pouvoir satisfaire la consommation de deux adultes, de deux
adolescents et de cinq jeunes enfants. Afin de couvrir l’ensemble des besoins alimentaires du
groupe, les achats sont donc importants, comme nous l’expliqua Julia : « chaque mois, nous
devons acheter du riz [70 dollars], et nous en mangeons presque tous les jours. Nous achetons
aussi du beurre [11 dollars], de l’huile [8 dollars] et du lait [24 dollars] pour les enfants. » De
plus, il faut aussi compter l’achat de sel, de sucre, de café et parfois de sodas, ce qui revient à
augmenter chaque mois les dépenses alimentaires familiales de quelques dizaines de dollars.
Pour y faire face, le groupe dispose de plusieurs sources de revenus.
Depuis quatre ans, Julia est membre de l’association des Producteurs Agroécologiques de
l’Azuay, ce qui lui permet d’aller vendre ses produits sur les marchés cuencanais. Ainsi, elle
parvient à gagner en moyenne 90 dollars par semaine, les seuls poulets lui garantissant un peu
plus de 75% de ses gains hebdomadaires. Les ventes de salades, de carottes et autres brocolis
lui fournissent un petit complément monétaire, mais elles ne dépassent que rarement les 20
dollars par semaine, ceci étant dû à l’importante consommation familiale qui empêche Julia
de se rendre sur les marchés avec de grandes quantités de légumes frais.
En outre, il faut aussi compter sur les salaires des emplois locaux : le mari de Julia exerce la
profession de maçon, la moitié de l’année tout du moins, et perçoit pour cela un revenu
mensuel de 200 dollars bruts en moyenne, soit le double de ce que gagne leur fils aîné âgé de
quinze ans, lui aussi ouvrier une petite partie de l’année. Enfin, Julia bénéficie du Bon de
Solidarité octroyé par l’Etat équatorien aux familles les plus modestes avec des enfants en bas
âge, et reçoit donc 30 dollars par mois.
En dehors des frais alimentaires, les rentrées d’argent permettent de couvrir l’ensemble des
dépenses agricoles que Julia nous détailla avec précision : « je dois acheter du maïs dur [50
dollars par mois] pour nourrir les poulets, de l’orge [25 dollars par mois] pour les cobayes et
224
parfois de l’avoine pour la génisse [60 dollars par an]. Chaque mois, je dois aussi acheter du
compost [15 dollars] pour le potager et pour les arbres fruitiers. » Bien entendu, il faut aussi
payer le gaz, l’électricité, les nombreux déplacements en ville et la location des stands sur les
marchés urbains, ce qui entraîne une augmentation globale des dépenses familiales d’une
soixantaine de dollars chaque mois. Enfin, le budget annuel consacré à l’éducation de cinq de
ses enfants est lui aussi important : pour chacun d’entre eux, il faut compter 30 dollars par an
pour l’uniforme et 3 dollars par mois pour leurs déjeuners.
��1���*+,--�0.@�++�#�/��9�+*/1�*�/��#�/#���+/�/0�+/*��/:�+#.����/;
#�<*�����/�2�0�����+566=
Revenus Dépenses
Ventes agricoles 80 Fourrage 80
Ventes de poulets 280 Engrais organique 15
Emplois locaux 300 Frais divers 60,40
Bon de solidarité 30 Alimentation 150
Education 26
Total 690 Total 331,40
Calcul des ventes de poulets réalisé sur la base de sept ventes hebdomadaires à 10 dollars en moyenne ; calcul des frais divers réalisé sur la base de 12 déplacements hebdomadaires à Cuenca, pour un coût total de 9,60 dollars, de deux locations hebdomadaires de stand sur le marché, pour un coût total de 8 dollars par mois, de l’achat mensuel de 3 bouteilles de gaz, pour un coût total de 6 dollars, et d’une facture d’électricité moyenne de 8 dollars par mois. Source : entretiens réalisés entre juillet 2008 et décembre 2008.
Dans la situation de Julia, l’accès aux terres d’Illapamba est donc stratégique pour combler les
besoins alimentaires de sa famille. Certes, les retombées directes ne sont pas très importantes,
mais cela lui permet tout de même d’élever des cobayes et de ne pas augmenter ses dépenses
en fourrage qui représentent déjà 25 % de son budget global mensuel. A l’avenir, elle aimerait
avoir « une ou deux vaches, pour ne plus acheter de lait aux voisins. » Sa famille en
consommerait davantage et pourrait même gagner un peu d’argent en produisant quelques
fromages pour la vente. Grâce aux salaires extra-agricoles, cela devrait pouvoir se réaliser
bientôt, mais en attendant, Julia et son mari devront maintenir la fréquence de leurs achats
alimentaires, compte tenu de la petite taille de l’exploitation et du grand nombre de personnes
à nourrir quotidiennement. La pluriactivité devrait donc continuer de jouer un rôle essentiel
pour cette famille paysanne, pour plusieurs années encore.
225
3�3�-�9 ����� ����� ��� ��������������%��
En 1981, Vicente émigra aux Etats-Unis. Il y resta quatre ans pendant lesquels il travailla
comme plongeur puis comme commis de cuisine. Régulièrement, il envoya de l’argent à
Elisa, son épouse, qui put acheter deux parcelles, l’une d’un hectare et l’autre de 2500 m²,
pour un total de 170 000 sucres (3 500 dollars) en 1982. Ces deux acquisitions vinrent
s’ajouter aux 2,75 hectares que le couple possédait depuis plusieurs années déjà, après avoir
hérité de plusieurs terrains. Ainsi, lorsque Vicente revint chez lui en 1984, il se retrouva à la
tête d’une exploitation de quatre hectares.
Depuis plus de vingt ans maintenant, Vicente et Elisa se consacrent donc essentiellement à
l’agriculture et à l’élevage laitier. La moitié de leur exploitation leur permet de récolter du
maïs (6 quintales), de la pomme de terre (13 quintales), ainsi que de la fève et du haricot. A
proximité de leur maison, un grand potager de 300 m² et une petite serre de 120 m² leur
assurent des fruits et des légumes tout au long de l’année.
��.�.(������+,88��&�?��.�����.+#�9���+��
Tout près de la maison de Vicente, les salades et les choux poussent silencieusement. Source : N. Rebaï (2009)
226
Le reste de l’exploitation est laissé en pâturage, pour élever 6 vaches produisant chacune un
peu plus de dix litres de lait par jour. L’exploitation compte aussi plus de 150 cobayes, une
quarantaine de volailles et même 4 moutons. Ainsi, Vicente, Elisa et leur fils âgé d’une
vingtaine d’années, parviennent à couvrir sans difficulté leurs besoins alimentaires, tout en
ayant une activité commerciale florissante.
Depuis 2001, Elisa est membre de l’association des Producteurs agroécologiques de l’Azuay.
Chaque semaine, elle se rend au marché 12 de Abril, le mercredi, et à la foire de Miraflores, le
samedi. Comme elle nous le dit avec beaucoup d’enthousiasme, « il n’y a jamais de mauvaise
semaine », avant de nous décrire avec précision ses ventes hebdomadaires : « tout d’abord, les
légumes rapportent environ 30 dollars. Ensuite, je vends 4 ou 5 cobayes, 3 poulets, 5 ou 6
babacos et une soixantaine de tomates d’arbre. Je vends aussi quinze ou vingt fromages et
une quarantaine d’œufs. » Ainsi, les ventes sur les marchés urbains rapportent globalement à
Vicente et Elisa un peu plus de 130 dollars par semaine.
��.�.(������+,84����/����2.���#�0���2�.��/
Chaque Samedi, la compagne de Vicente se rend à Cuenca pour y vendre les produits de l’exploitation. Source : N. Rebaï (2009)
227
Concernant les ventes directes sur l’exploitation, elles sont aussi très importantes. Chaque
matin, un négociant du Cañar achète au couple la plus grande partie de sa production de lait,
ce qui lui assure un revenu quotidien de 19 dollars, sauf le vendredi, jour de fabrication des
fromages destinés à la vente. Sans même compter les ventes éventuelles de maïs, de pomme
de terre ou bien encore de moutons, les revenus de Vicente et Elisa sont donc déjà très
importants. Cela leur permet bien entendu de couvrir l’intégralité de leurs dépenses agricoles.
Chaque mois, il leur faut acheter pour 50 dollars de maïs dur pour les volailles, ainsi qu’une
cinquantaine de sacs d’engrais organique pour le potager et les arbres fruitiers. Tous les quatre
ans, ils doivent en plus rénover leur petite serre, ce qui leur coûte près de 450 dollars. Pour
leurs vaches laitières, Vicente et Elisa ont aussi recours à l’achat de compléments
alimentaires, à base de farine de maïs, de mélasse de canne à sucre et de sels minéraux, ce qui
les contraint à une dépense d’un peu plus de 50 dollars par mois.
Les frais alimentaires sont en revanche assez modérés, compte tenu des volumes produits sur
l’exploitation et des besoins familiaux limités, mais certainement plus diversifiées que chez
Hermelinda et Julia. Outre le riz, le café, le sucre, le sel et la farine, Vicente, Elisa et leur fils
consomment plus de viande (porc, bœuf), plus de fruits (bananes, raisin) et d’autres produits
industriels comme les sodas. Chaque mois, ils dépensent ainsi 80 dollars environ, auxquels
viennent s’ajouter les frais de gaz et d’électricité, les coûts de transports et les cotisations
diverses sur les marchés urbains.
��1���*+,-3�0.@�++�#�/��9�+*/1�*�/��#�/#���+/�/0�+/*��/:�+#.����/;
#�9���+����/�2�0�����+566=
Revenus en dollars
Dépenses en dollars
Ventes de fruits et légumes 162 Maïs dur 50
Fourrage bovin 50
Ventes de produits laitiers 480 Engrais organique 50
Ventes de cobayes, de poulets et d’oeufs
304 Entretien de la serre 12,50
Frais divers 31,60
Alimentation 80
Total 946 Total 274,10
Calcul des frais divers réalisé sur la base de 12 déplacements hebdomadaires à Cuenca, pour un coût total de 9,60 dollars, de deux locations hebdomadaires de stand sur le marché, pour un coût total de 8 dollars par mois, de l’achat mensuel de 3 bouteilles de gaz, pour un coût total de 6 dollars, et d’une facture d’électricité moyenne de 8 dollars par mois. Source : entretiens réalisés entre juillet 2008 et décembre 2008.
228
Pour Vicente, la volonté de se maintenir dans la comuna Illapamba ne correspond en rien à
une stratégie alimentaire, comme cela peut être le cas pour Ermelinda ou Julia. Chez cet
ancien migrant, qui est parvenu ces dernières décennies à augmenter son patrimoine foncier
tout en ayant une activité commerciale dynamique, l’objectif est de profiter de plus d’espace
pâturé pour maintenir sa production laitière qui représente à elle seule 51% de ses revenus
bruts. Sa présence dans l’organisation répond donc à une logique purement économique.
3��*������� ��� ����� �������!������E��
Les trois exemples décrits précédemment rendent compte de situations alimentaires variables
et d’écarts de revenus considérables au sein même de la comuna Illapamba. Si le contexte
migratoire a conduit à la diminution progressive du nombre de paysans membres de cette
organisation au cours des trois dernières décennies, il n’a cependant pas agi comme un facteur
d’uniformisation sociale. On aurait pu penser en effet que seuls des exploitants aux ressources
économiques et foncières limitées continueraient d’être membres de la comuna, mais il
apparaît au contraire qu’en 2008, des profils de paysans variables coexistaient à Illapamba,
lesquels pouvaient être classés en trois groupes distincts (cf. Tableau n°35).
Il y a d’abord les paysans les plus pauvres (type 1), comme Hermelinda, sans grandes
ressources foncières, dépendant presque exclusivement de maigres revenus extérieurs et de
leur travail à Illapamba pour se nourrir. Ici, le revenu familial moyen est de 108 dollars bruts
par mois, tandis que les seules dépenses alimentaires, qui se limitent bien souvent à l’achat de
riz, de farine, de sel, de sucre et d’un peu de matière grasse, atteignent en moyenne 58 dollars
toutes les quatre semaines environ. Dans ces conditions, la production agricole et les produits
d’élevage sont prioritairement destinés à l’autoconsommation, tandis que le reste de l’argent
disponible sert en majeure partie à couvrir les frais domestiques (gaz, électricité), ainsi que les
dépenses de transports, de santé et d’éducation.
Vient ensuite un groupe de paysans modestes (type 2), comme Julia, n’ayant que très peu de
terre pour nourrir des familles souvent nombreuses (à l’exception de Rosa), et travaillant à
Illapamba pour compléter leurs ressources alimentaires. L’enjeu est aussi de disposer de
superficies pâturées pour élever cobayes et vaches laitières, de manière à s’assurer d’un peu
de viande et de lait pour l’autoconsommation. Les familles qui composent ce groupe
disposent néanmoins de revenus extérieurs importants, près de 280 dollars par mois en
229
moyenne, complétés par des sommes parfois élevées provenant de la vente de produits
maraîchers (Olga) ou de volailles (Julia et Rosa). Cela leur permet ainsi de couvrir leurs
dépenses alimentaires mensuelles, qui s’élèvent en moyenne à 94 dollars, et de faire face aux
dépenses de santé et d’éducation.
On trouve enfin des paysans plus riches (type 3), comme Vicente, ayant suffisamment de terre
pour être autosuffisants et se consacrer dans le même temps au commerce de produits vivriers.
Leur présence à Illapamba n’a pour seul but que de maintenir leur élevage laitier, tandis que
leurs ventes mensuelles de fromages, de cobayes, de fruits et de légumes leur rapportent
plusieurs centaines de dollars. Ainsi, leurs dépenses alimentaires, plus réduites que celles des
autres paysans de la comuna, ne dépassent généralement pas les 70 dollars par mois, bien que
celles-ci soient plus variées et comportent parfois de la viande et davantage de produits
industriels.
��1���*+,-��@�.�.(��#�/2�0����/0�01��/#���&�#'��������01��+566=
Type Nom Age
Composition
familiale Patrimoine
foncier en hectares
Revenus en dollars
Dépenses
alimentaires en dollars A B C D E I II III IV
1
Ermelinda 84 2 2 1 10 60 110 / 60
Manuel C. 59 1 1 3 1 / 45 20 60
María C. 37 2 2 0,4 / 100 / 30 70
María V. 40 1 1 1 1 8 60 / / 40
2
Julia 36 1 2 6 1 360 300 / 30 150
Jorge 34 1 1 6 1 76 200 / 30 90
Olga 32 1 1 4 0,2 94 200 / 30 90
Rosa 64 1 1 3 3 270 40 100 / 40
Miguel C. 58 3 1 4 2 2 50 250 200 / 100
3 Vicente 60 2 1 4 946 / / / 70
Manuel. S 67 2 1 2 2,5 344 300 100 / 70 A : personnes se consacrant à l’agriculture à plein temps ; B : personnes se consacrant à l’agriculture à mi-temps avec un emploi plus ou moins régulier à l’extérieur de l’exploitation familiale (hors emplois journaliers) ; C : personnes ayant un emploi à temps plein à l’extérieur de l’exploitation familiale ; D : personnes vivant elles aussi sur l’exploitation mais qui ne se consacrent pas à l’agriculture (enfants, anciens, handicapés) ; E : personnes à l’étranger. I : Revenus agricoles et revenus liés aux différents élevages ; II : Revenus locaux (emplois urbains, artisanat, salaires journaliers) ; III : Remesas ; IV : Autres revenus (ex : ‘Bon de solidarité’). Source : entretiens réalisés entre juillet 2008 et décembre 2008.
230
Une précision sur les données économiques qui ont été présentées au cours des dernières
pages mérite cependant d’être faite. En ce qui concerne plus particulièrement Ermelinda, Julia
et Vicente, qui ont tous trois été pris en exemple pour décrire la diversité sociale à l’échelle de
la comuna Illapamba, il apparaît dans les bilans économiques des trois ménages que ces
derniers avaient en 2008 une grande capacité d’épargne. Pour Vicente, cette caractéristique
s’explique par le fait que l’exploitation qu’il possède est suffisamment grande pour y
développer un élevage laitier qui lui rapporte 480 dollars par mois, c’est-à-dire un peu plus de
la moitié de ses revenus bruts mensuels. En ce qui concerne l’exploitation de Julia, 43,5% des
rentrées monétaires moyennes correspondaient en 2008 aux salaires des emplois locaux,
tandis que pour Ermelinda, 93,6% de ses revenus bruts mensuels provenaient de l’artisanat ou
de la migration.
Si pour l’ancien migrant de la comuna, l’agriculture et l’élevage assurent 100% de ses revenus
bruts réguliers, lesquels atteignaient en moyenne 946 par mois en 2008, en revanche, ils ont
un poids beaucoup moins important dans les bilans économiques des familles des deux
paysannes prises en exemple. Pour Julia, les seules ventes de produits maraîchers et de
volailles, qui représentaient en moyenne 300 dollars par mois en 2008, ne pourraient couvrir
les dépenses régulières du groupe domestique, lesquelles étaient d’un peu plus de 330 dollars
mensuels la même année, à moins de réduire les achats de denrées alimentaires. En ce qui
concerne Ermelinda, le constat est plus net : en l’absence des remesas et des revenus de
l’artisanat, son ménage entrerait dans un processus de décapitalisation.
Ainsi, les cas de Julia et d’Ermelinda nous indiquent que les activités extra-agricoles, outre le
fait qu’elles permettent pour beaucoup de familles paysannes de couvrir à la fois les dépenses
de l’exploitation et les frais domestiques, ont une grande importance économique. En effet,
elles favorisent l’accumulation d’un capital qui, à moyen terme, pourrait entraîner la
transformation de l’exploitation, par l’achat plus régulier de fourrage pour le développement
d’un petit élevage par exemple.
Toutefois, cette hypothèse est à considérer avec prudence car, comme nous l’avions précisé
quand nous traitions plus haut des exploitations du groupe Bajo Invernadero, il est possible
que les données économiques que nous avons recueillies avec les paysans d’Illapamba ne
soient pas tout à fait exactes, en particulier celles concernant les revenus extérieurs. Il est fort
probable en effet que les paysannes que nous avons interrogées aient « allonger » de façon
231
involontaire les périodes de travail de leurs époux et de leurs fils, nous expliquant que ces
derniers, maçons ou manœuvres pour la plupart, travaillaient en général « la moitié de
l’année » à plein temps. Cependant, et comme nous l’expliquions plus haut, la précarité du
marché de l’emploi cuencanais nous autorise à penser que les périodes d’activité salariée
pourraient être en fait beaucoup plus courtes, et la moyenne des salaires bruts mensuels moins
élevée. De fait, l’épargne des familles paysannes de la comuna Illapamba pourrait être
nettement plus modeste.
Au-delà de cette mise au point, nous pouvons dire que les évolutions récentes au sein de la
comuna sont à l’image de celles ayant eu cours à l’échelle de la paroisse Octavio Cordero
Palacios : des transformations agraires importantes, une mutation globale de l’économie
familiale et des contrastes sociaux d’un nouveau type, entre des exploitations aux ressources
économiques aussi diverses qu’importantes, et d’autres, avec de faibles revenus. Ainsi,
l’analyse qualitative que nous avons réalisée à l’échelle de petits groupes d’exploitations
démontre que le contexte migratoire est propice à la mutation profonde du milieu rural.
D’autres phénomènes en lien avec la migration ont cependant eu lieu dans des secteurs que
nous avons jusque là ignorés, comme nous allons le voir dans le chapitre qui suit.
232
��������
�� ����� ���������������
����������������������������������������������������������
Créon – « Qui a osé ? Qui a été assez fou pour braver ma loi ? »
Jean Anouilh, Antigone.
233
Des luttes paysannes qui ont jalonné tout le XXe siècle, et qui pour beaucoup ont abouti à des
processus de réforme agraire, aux mobilisations des groupes indigènes pour la reconnaissance
de leurs territoires ancestraux, la question des conflits dans les campagnes latino-américaines
est depuis longtemps très importante. En Equateur, elle a d’ailleurs fait l’objet de nombreuses
analyses, en témoignent par exemple les travaux de G. Fontaine sur l’organisation des
mouvements écologistes opposés à l’exploitation du pétrole dans la région amazonienne
(2008), mais à notre connaissance, pas une seule ne traite de conflits locaux qui auraient un
lien avec une importante émigration paysanne.
Dans la paroisse Octavio Cordero Palacios, le contexte migratoire laisse apparaître de
nouvelles figures, parmi lesquelles les plus anciens migrants, dotés d’un pouvoir économique
important. Au-delà même des investissements réalisés au sein de leurs exploitations, et de leur
activité commerciale prospère, n’ont-ils pas en réalité plus d’influence sur les recompositions
territoriales locales ? Ne seraient-ils pas les tenant d’une nouvelle forme de pouvoir qui leur
permettrait d’imposer leurs choix au reste de la population ?
Pour le voir, nous organiserons ce dernier chapitre en deux parties. Nous nous intéresserons
tout d’abord aux recompositions foncières ayant eut lieu dans la comuna San Luis, en
décrivant le rôle majeur tenu par un ancien migrant. Puis, nous analyserons comment
plusieurs exploitants sont parvenus, après une expérience migratoire réussie, à mobiliser
autour d’eux une partie de la population paysanne pour faire éclore des projets de
développement agricoles.
!"��# ������������������������ ���������������$��
L’une de nos interrogations en arrivant dans la paroisse Octavio Cordero Palacios portait sur
le lien entre la dynamique migratoire et les recompositions foncières locales. Nous pensions a
priori que l’émigration pouvait favoriser la concentration de la terre aux mains de quelques
individus, mais nous nous sommes rapidement aperçu que cela n’était pas le cas, les prix du
marché foncier limitant les acquisitions massives de parcelles. Toutefois, après seulement
quelques sorties de terrain, nous avons appris que les terres communales de San Luis avaient
été divisées en 2003, et que plusieurs anciens migrants avaient été à l’origine de ce processus
234
singulier. Nous avons alors cherché à comprendre leur démarche, en nous entretenant
régulièrement avec l’un d’eux, avant de nous intéresser aux autres discours, ceux du reste de
la population paysanne et des institutions concernées par cet événement.
! !� ����������% ��&����������� ������������ �����
D’après les représentants politiques de la paroisse Octavio Cordero Palacios, rencontrés à
maintes reprises dans le cadre de leurs réunions bimensuelles, « la division des terres de San
Luis [eut] lieu parce que les personnes qui n’avaient pas émigré voulaient s’approprier la
terre de la comuna, alors que les autres reçoivent de l’argent des Etats-Unis. » C’est en tout
cas ce qu’ils nous dirent en chœur, pour éviter semble-t-il, un sujet très sensible. Pour
compléter ce discours de façade, nous interrogeâmes en privé César, le président de
l’assemblée paroissiale, qui nous tint un discours beaucoup plus nuancé : « en réalité, Angel,
le président de l’ ancienne comuna San Luis, a passé plusieurs années aux Etats-Unis. Grâce
à son argent, il a acheté beaucoup de terre et il a joué un rôle politique important ces
dernières années. »
Nous décidâmes alors de rencontrer directement Angel, avec qui le contact s’établit
facilement. Il est vrai que dans un premier temps, l’ancien dirigeant pensait tirer parti de notre
présence dans la paroisse Octavio Cordero Palacios, croyant que nous représentions le CEDIR
et que nous pouvions lui obtenir des financements pour ses projets personnels. Mais après
avoir clarifié la situation, il accepta de nous recevoir à de nombreuses reprises, parfois chez
lui, et nous pûmes avoir plusieurs discussions très franches.
Il nous raconta d’abord son parcours migratoire fait de multiples allers-retours entre
l’Equateur et les Etats-Unis. Après son premier départ en 1983, il avait en effet migré deux
autres fois, en 1985 et 1992, et était resté au total près de treize ans entre Chicago et
Minneapolis. L’argent qu’il avait gagné lui avait permis d’acheter un peu plus de trois
hectares de terre, qui lui permettent aujourd’hui de se consacrer à l’élevage bovin, alors
qu’entre temps, il avait financé la migration de sa femme et de cinq de ses enfants, toujours
installés aux Etats-Unis. Nous avions alors la confirmation qu’Angel s’était bâti un patrimoine
foncier relativement important grâce à la migration.
235
Par la suite, nous nous intéressâmes plus précisément à la dynamique foncière à San Luis.
Angel nous expliqua alors que, selon lui, la privatisation des terres devait bénéficier « aux
plus pauvres, à ceux qui n’avaient pas de terre, ni d’argent », en espérant peut-être que nous
ne verrions pas la contradiction entre sa véritable situation et son discours. Il alla même plus
loin en affirmant que la redistribution des parcelles aux paysans de Parcoloma était « comme
un processus de réforme agraire, car la terre [doit] appartenir à ceux qui la travaillent, pas à
ceux qui sont à la Yoni et qui n’en ont rien à faire ! » Enfin, il nous expliqua que la division
des terres était de toute manière « inéluctable », car depuis la création de la comuna San Luis
en 1962, les familles paysannes ne parvinrent jamais à créer de véritable dynamique
collective. En 1972, les comuneros avaient même reçu l’aval du ministère de l’Agriculture
pour cultiver individuellement des parcelles de plus de 6250 m², ce qui mettait alors fin à de
multiples conflits (cf. Annexes n°19). De fait, il existait depuis longtemps une division du
territoire de San Luis, et comme à Illapamba, les paysans n’eurent de cesse au cours des
dernières années d’y développer l’élevage laitier.
D’après les données de l’IERSE, et malgré leurs limites, il apparaît que le territoire de San
Luis a connu de grandes transformations au cours des vingt dernières années. Entre 1991 et
2001, le déboisement de grands espaces à l’intérieur même des limites communales conduisit
à l’augmentation de 240% des superficies pâturées, une évolution bien plus importante
d’ailleurs que dans tout le reste de la localité. En ce qui concerne, les parcelles agricoles,
celles-ci, qui étaient déjà fort petites, voyaient dans le même temps leur surface totale
diminuer de 57%. Enfin, les páramos connurent une réduction de 12% de leur superficie, ceci
étant dû à l’augmentation brutale des aires de pâturage.
��'#��()*+!�,-#(��-).�""(���/����"0�)�������"1.�"���)����#�"/-�2�".%("�3�.("-#
.�)"#��������"�)#(�"�)��� 44 ��566
Occupation du sol 1991 2001
Espaces cultivésMaïs, haricot, fève, petit pois, orge, blé, pomme de terre
2,8 1,6
Espaces boisés 153,8 116,5
Páramos 50,75 45,1
Pâturages 16,81 57,5
Source: IERSE (2003).
236
!5!(�������� ��7�� ����������������8�����$����%���������������
Dans son esprit, Angel ne fit donc que concrétiser une volonté ancienne de partage des terres,
en ne cessant par ailleurs de nous rappeler que la comuna était née d’une division du territoire
d’Illapamba au début des années 1960, même si entre temps, les changements dans la
législation foncière en Equateur furent très importants.
En 1964 fut promulguée la première Loi de Réforme Agraire et de Colonisation, qui fut suivie
d’un second volet en 1973, dont l’objectif principal était de mettre fin à l’oligarchie terrienne,
en particulier dans la région andine, afin d’« incorporer la paysannerie marginalisée à la
société nationale et [d’] articuler de grandes zones « inoccupées » au territoire national49 »
(Gondard et Mazurek, 2001 : 15). Même si dans certaines provinces, comme celles du
Chimborazo et de Loja, plusieurs dizaines de milliers d’hectares furent octroyés aux petits
exploitants, à l’échelle de la sierra, le processus de redistribution des terres fut assez limité et
ne mit pas un terme au monopole des haciendas (Gondard et Mazurek, 2001 ; Zapatta et al.,
2008).
En réalité, et comme le montra E. López (1994), les différents gouvernements qui se
succédèrent jusqu’au milieu des années 1990 n’eurent de cesse, par leur inaction ou par la
publication de décrets en faveur de l’oligarchie terrienne, de limiter les effets du processus de
réforme agraire. Avec l’adoption de mesures néolibérales au cours des années 1980,
synonymes d’ouverture aux importations agricoles, vint également le moment de remettre en
cause la législation foncière nationale. C’est dans ce contexte, qu’en 1994, fut promulguée la
Loi de Développement Agraire (LDA), sous la présidence de S. Durán Ballén (1992-1996). Il
fut alors décidé de procéder à la privatisation des terres communales et des ressources
naturelles, ainsi qu’à la dérégulation complète de la distribution des intrants agricoles.
Symbole de la « contre-réforme agraire du XXe siècle50 » (Martínez, 2004 : 24), cette LDA ne
fit que consolider « une structure agraire caractérisée par une très forte concentration de la
terre qui laisse peu d’espace pour l’économie paysanne51 » (ibid.). C’est notamment dans ce
49 « […] incorporar al campesinado marginado a la sociedad a la sociedad nacional y articular extensas zonas « vacías » al territorio nacional. »
50 « […] contrarreforma agraria del siglo XX. »
51 « […] una estructura agraria caracterizada por una alta concentración de la tierra que deja poco espacio para la economía campesina. »
237
contexte que les agro-industries purent développer la floriculture dans les provinces de
Pichincha et de Cotopaxi, en s’accaparant les ressources hydriques et en mobilisant une main-
d’œuvre d’origine paysanne bon marché, laissant planer le risque de voir disparaître
progressivement les unités familiales de production dans ces régions (Gasselin, 2000 ;
Korovkin, 2003).
Dans la paroisse Octavio Cordero Palacios, il n’y eut pas d’agro-industrie qui vint prendre
possession des terres communales, mais il est certain que la LDA agit comme un élément
déclencheur du processus de division à San Luis, comme nous pûmes le vérifier lors de notre
tout premier entretien avec Angel, lequel nous expliqua que cette loi avait fait naître le débat
au sein de la population paysanne, en précisant que « ceux qui voulaient diviser les terres
[avaient] commencé à se réunir à ce moment là. »
Un autre élément fut tout aussi important pour aboutir au partage des terres communales de
San Luis. Avec l’augmentation de l’émigration dans le courant des années 1990, ne restèrent
en majorité que les paysans favorables à la division du territoire communale, ces derniers
considérant que le fait de ne pas migrer leur donnait le droit de s’approprier des terres qui, au
contraire, importaient peu à ceux qui s’en allaient. Comme nous le dit plus précisément
Angel, « nous étions de plus en plus nombreux à vouloir la parcellisation des terres.
Ensemble, nous sommes donc allés à l’Institut National de Développement Agraire [INDA –
organisme créé au moment même de la promulgation de la LDA pour faciliter le mode
d’accès à la propriété foncière] pour obtenir des titres de propriétés officiels, et en quelques
mois, l’affaire fut réglée. » D’après Angel, la privatisation des terres ne fut donc qu’une
formalité à laquelle personne ou presque ne s’opposa.
Pour en vérifier la validité juridique, nous nous rendîmes au ministère de l’Agriculture à
Cuenca. C’est ainsi que R. Burbano, qui vécu l’affaire de près, nous résuma la situation : « en
réalité, le processus de privatisation est totalement illégal parce qu’à l’époque, le président
de la comuna [Angel] ne consulta jamais les familles membres de l’organisation. Ce qui est
sûr, c’est qu’il s’est appuyé sur une poignée d’amis fidèles, tous des anciens migrants comme
lui, avec lesquels il s’est rendu à l’INDA pour obtenir des titres de propriété qui n’ont aucune
238
valeur juridique puisque la constitution [de 1998] définissait les terres communales comme
« indivisibles52 » [et remettait donc en cause la LDA de 1994]. »
De son côté, H. Déleg, le fonctionnaire en charge de l’affaire pour l’INDA, nous expliqua la
situation avec un tout autre argument lorsque nous lui rendîmes visite à son bureau : « la
division des terres de San Luis se fit parce qu’il n’existait aucun titre de propriété collectif.
Ce ne fut rien d’autre qu’une attribution de terres en friches. » C’est d’ailleurs celui que
J. Arias, le directeur de l’INDA pour la région australe à l’époque des faits, présenta au
ministère de l’Agriculture dans un courrier daté de 2002, pour justifier la future partition du
territoire communal, en insistant sur le fait que l’INDA est la seule institution publique en
Equateur autorisée à délivrer des titres de propriété en milieu rural (cf. Annexe n°21). C’est
pourquoi, R. Burbano, quand nous l’interrogeâmes, nous expliqua avec fatalisme que « le
pouvoir de contestation du ministère de l’Agriculture fut limité dans cette affaire. »
Confrontés à cet imbroglio juridique, il nous est difficile de tirer des conclusions définitives
sur l’histoire de la comuna San Luis, d’autant que plusieurs points d’ombre demeurent. S’il
n’existait pas de titre de propriété de la terre, « comme pour la plupart des comunas en
Equateur » nous précisa R. Burbano, il existait cependant un acte officiel de création de
l’organisation paysanne octroyé par le ministère de l’Agriculture en 1962, qui attestait par
conséquent de la reconnaissance institutionnelle de la comuna. En outre, depuis plusieurs
décennies, le ministère de l’Agriculture intervenait régulièrement à San Luis, soit dans le
cadre de projets agricoles, soit pour le règlement de conflits fonciers entre les comuneros, ce
qui démontrait de fait l’existence d’un territoire collectif.
Comment l’INDA a-t-il pu alors considérer ces terres « en friches » ? Pour répondre à cette
question, il est peut-être nécessaire d’évoquer le thème sensible de la corruption des autorités
publiques. En théorie, les titres de propriétés délivrés par l’INDA sont gratuits, mais comme
nous le confia Angel, les paysans qui en obtinrent en 2004 durent s’acquitter de plusieurs
dizaines de dollars, « pour les frais de dossier ». Cela dit, au cours de nos multiples entretiens
avec le président de l’ancienne comuna, les montants oscillèrent beaucoup, passant de « 72
dollars » lors de notre première entrevue, à « 220 dollars » plusieurs semaines plus tard.
52 « […] la propriété imprescriptible des terres des communautaires, qui seront inaliénables, insaisissables et indivisibles […] » (Constitution de la République d’Equateur de 1998, Titre I, Chapitre V, Première section, Article 84, Alinéa 2 - cf. Annexe n°20).
239
Plusieurs semaines après notre visite à l’INDA, où notre entretien avec H. Deleg fut des plus
tendus, nous apprîmes que l’ingénieur avait été remercié par l’institution, pour des faits avérés
de corruption dans d’autres cas d’attributions foncières frauduleuses. Angel et ceux qui
l’accompagnèrent dans cette affaire auraient-ils alors profité de leur pouvoir économique pour
soudoyer un fonctionnaire et faire main basse sur les terres de San Luis? Auraient-ils entraîné
une partie de la population paysanne pour cumuler une somme d’argent visant à faciliter leur
« démarche » auprès de l’INDA ? Possible, mais rien ne permet de l’affirmer, même si à
Parcoloma et dans le reste de la paroisse Octavio Cordero Palacios, on imagine que oui.
!+!#����������������������� ����� ��� ��� �9������������������
�������9����
Au-delà même du partage des terres de San Luis, la population paysanne à Parcoloma paraît
on ne peut plus divisée. Pour beaucoup, les anciens migrants qui formèrent un groupe
d’intérêt puissant, se rendirent coupable de la confiscation d’un bien collectif pour leur profit
personnel. C’est en substance ce que nous dit Manuel L., un ancien comunero âgé de 78 ans :
« ce qui s’est passé est injuste ! Cela devrait revenir aux plus pauvres, alors que ceux qui ont
obtenu des parcelles sont les plus riches ! Ils ont de la terre et des remesas ! »
César, le président de l’assemblée paroissiale, eut un discours encore plus dur quelques mois
après notre premier entretien : « ce qui s’est passé à San Luis n’est pas bien. La comuna avait
une utilité publique car elle permettait par exemple aux paysans de récupérer du bois pour
leurs usages domestiques. Aujourd’hui, ce n’est plus possible car beaucoup n’ont plus accès
aux espaces boisés situés en altitude. Ce qui est plus grave encore, c’est que la privatisation a
été faite secrètement, sans qu’il n’y ait de débat entre les personnes concernées. Angel n’a
pas été démocratique, il a usé de moyens de pression pour atteindre son objectif, et beaucoup
de femmes seules, dont les maris étaient à la Yoni, ont été menacées. »
Aujourd’hui, l’ancienne comuna San Luis, dont la superficie totale est de 221 ha, est donc
partiellement divisée. Concrètement, 49,5 ha ont été parcellisés en 92 lots, tandis que deux
autres portions du territoire furent officiellement classées « zone de protection
environnementale » (93 ha) ou « zone de reforestation » (22 ha). Néanmoins, comme nous
l’expliqua M. Bustamante, un brin désabusé, « tout cela ne sont que des bêtises. Aucune
240
institution n’est aujourd’hui responsable de la reforestation, ni même d’un quelconque
programme de protection environnementale. » L’INDA n’a donc fait que de limiter de façon
arbitraire des aires soi-disant protégées, dans le simple but de donner un semblant de
transparence à son action sur le territoire de San Luis.
�����)* :!#�������-���.�"�)#(�".��(�"566:
Pour le reste, il y aurait donc 92 nouveaux propriétaires, qui disposeraient de parcelles de
7500 m² en moyenne. Néanmoins, ils ne sont en réalité qu’une soixantaine, voire peut-être
moins, car au moment de l’attribution des titres de propriétés, certains paysans en obtinrent
deux, voire davantage. Parmi eux, il y eut Angel, qui nous confirma avoir obtenu une parcelle
241
à son nom, et une autre au nom de son épouse, vivant depuis plusieurs années à Chicago, ce
qui constitue d’ailleurs une autre contradiction, puisque le président de l’ancienne comuna
nous expliqua à de nombreuses reprises que la terre devait revenir à ceux qui vivent toujours
en Equateur. Quant à Juan Manuel, qui fut de ceux qui encouragèrent la division des terres, il
obtint lui aussi au moins deux parcelles, comme nous le constatâmes en trouvant les copies de
ses titres de propriété, le premier à son nom et le second au nom de sa femme, dans les
archives du ministère de l’Agriculture à Cuenca (cf. Annexe n°22).
Dans certains cas, plusieurs individus rachetèrent immédiatement les parcelles des paysans les
plus pauvres, et parmi eux, il y eut de nouveau Angel : « quand nous avons obtenu les titres
de propriété, beaucoup voulurent les revendre. Moi, j’ai récupéré celui d’une vielle paysanne
pour mille dollars. » Ainsi, nous comprenons pourquoi le président de l’ancienne comuna prit
soin de ne pas exclure systématiquement les paysans les plus faibles. Son objectif fut sans
doute de passer un accord avec certains d’entre eux, pour qu’ils le suivent dans ses démarches
auprès de l’INDA, avant qu’ils ne lui cèdent, à lui ou à d’autres chefs de file du mouvement,
leurs titres de propriété. De cette façon, Angel pouvait se défendre de ne privilégier que les
familles les plus riches de Parcoloma, même si au final, il y eut un véritable jeu de
marchandisation foncière à San Luis. Tout cela ne fut pourtant que la première manifestation
d’une volonté brutale d’accaparation de ressources de la part d’une poignée d’anciens
migrants.
!:!�$������������������������������������ �� ����%��
Dans les pays en développement, les conflits hydriques ont été abordés sous différents angles
et à des échelles variables. En Afrique subsaharienne par exemple, plusieurs auteurs ont porté
leur attention sur les eaux des grands fleuves et les enjeux géopolitiques de leur partage
(Raison et Magrin, 2009). Sur la côte péruvienne, où l’essor des cultures d’exportation a été
très important au cours des vingt dernières années, A. Marshall s’est en partie intéressée aux
rapports de force déséquilibrés qui régissent les usages de l’eau, opposant les moyens
considérables des firmes agroindustrielles à ceux, plus modestes, des petites unités de
production familiales (Marshall, 2009).
En Equateur, et plus précisément dans la petite localité d’Urcuquí située dans la province
andine d’Imbabura, T. Ruf a montré que les conflits concernant les usages de l’eau
242
constituaient l’une des caractéristiques de la société paysanne locale, du fait de leur existence
depuis l’époque coloniale et de leur renouvellement permanent sous l’effet de revendications
populaires ayant rythmé les cinq derniers siècles (Ruf, 1996). En Equateur toujours, mais à
l’échelle nationale cette fois, C. Récalt a conduit une analyse du conflit qui oppose depuis
plusieurs années l’Etat et les organisations paysannes indigènes, en suggérant l’idée que pour
rompre avec les politiques libérales qui furent imposées au pays ces dernières décennies, dont
la plus symbolique reste la LDA de 1994, et clore enfin la question de la gestion de l’eau, le
gouvernement équatorien « pourrait davantage tenir compte des droits et des aspirations des
populations indigènes et s’appuyer ainsi sur leurs capacités de mobilisation pour mener à bien
des politiques progressistes [de gestion des ressources naturelles] » (Récalt, 2011 : 6-7).
Cependant, et malgré la diversité des études de cas, la question des conflits hydriques, comme
celle des antagonismes pour l’accès à la terre, ne semble pas avoir été abordée à l’échelle
locale, dans un contexte de forte émigration. Or, il apparaît que dans la paroisse Octavio
Cordero Palacios, la conflictualité entre les anciens migrants et le reste de la population
paysanne ne se limite pas à la seule dimension foncière, comme en témoigne cet autre épisode
ayant eu lieu à San Luis, et dont le principal protagoniste fut une nouvelle fois Angel.
Depuis longtemps, les paysans de Parcoloma et de Sidcay utilisaient les ressources hydriques
provenant des páramos de San Luis, pour leurs usages domestiques et agricoles. Les habitants
de Parcoloma bénéficiaient ainsi de l’eau captée aux points « Gulalag » (1,2 et 3), tandis qu’à
Sidcay, la population recueillait celle de « Pie de letrero » (cf. Carte n°15).
��'#��()*+;!�����3�.�""-(���".%��(��-,�)�)�.�"�����.�"�)#(�"�)566;
Point de captation Débit moyen
en litres/sec. Système
d’irrigation
Estimation du
nombre d’usagers
Gulallag 1 2,13
Parcoloma 150 Gulallag 2 1,02
Gulallag 3 0,41
Pie de letrero 1,31 Sidcay 1000
Source : ETAPA-Cuenca. N.B. : le nombre d’usagers correspond aux robinets installés dans les zones de peuplement. Ainsi, il n’est pas rare qu’une même famille dispose de plusieurs accès à l’eau.
243
En 2007, tout fut pourtant bouleversé. Angel et plusieurs autres paysans, les mêmes qui le
suivirent au moment de la division des terres communales, décidèrent de prendre possession
de toutes les sources présentes à San Luis, sans en aviser quiconque, et de dévier les canaux
d’irrigation vers un réservoir qu’ils avaient creusé à quelques mètres des différents points de
captation.
�����)* <!#-��#�"���-).�"���)����#�""-(���".%��("(�#�������-���.�"�)#(�"
C’est ainsi que le président de l’ancienne comuna présenta son point de vue lors d’une
réunion d’urgence organisée par ETAPA-Cuenca au mois d’août 2008, durant laquelle nous
fûmes présent, et à laquelle assistèrent les paysans de Parcoloma et de Sidcay dans une
244
atmosphère des plus tendues : « les terres de San Luis nous appartiennent, ainsi que toutes les
sources d’eau qui s’y trouvent ! » Ce à quoi les dirigeants de Sidcay répondirent en chœur
qu’il n’était qu’un « voleur ! »
Comme nous l’avions déjà fait à propos de la division des terres communales, nous
interrogeâmes R. Burbano pour savoir quels étaient les enjeux de ce nouveau conflit. Dans
son bureau du ministère de l’Agriculture, il nous résuma clairement la situation : « les
paysans de Sidcay utilisent l’eau [de Pie de letrero] depuis plus de cent ans. Cependant, il
s’agit d’un usage de fait et non de droit, car il n’existe pas d’acte officiel qui leur donne la
priorité sur cette source. Leur tort fut de ne pas réclamer de concession au ministère de
l’Agriculture en 1994 [au moment où fut promulguée la LDA]. Du coup, les paysans de San
Luis se la sont appropriés. »
En dehors du conflit sur les droits d’usage, cette appropriation des ressources en eau eut des
effets néfastes sur l’environnement. Pour construire leur réservoir, Angel et ceux qui le
suivirent arrachèrent plusieurs centaines de mètres carrés d’arbustes situés à 3600 mètres
d’altitude, au beau milieu des páramos, « là où il est le plus important de maintenir une
couverture végétale pour la protection des sols », comme nous le précisa M. Bustamante,
avant d’ajouter que « le risque d’érosion est désormais très élevé à cet endroit
[cf. Photographie n°68]. »
En réalité, pour Angel et bien d’autres paysans de Parcoloma, l’obtention de titres de
propriété en 2004 leur donnait le droit, selon eux, de profiter de toutes les ressources
disponibles sur le territoire de l’ancienne comuna. Ils pensèrent ainsi avoir la légitimité de
contrôler les points de captation d’eau situés dans les páramos de San Luis, sans même se
soucier du sort de centaines de familles vivant en contrebas. En outre, ils se soucièrent assez
peu des conséquences environnementales lorsqu’ils décidèrent de creuser leur réservoir, ce
qui fit vivement réagir les institutions publiques qui travaillèrent sur ce dossier, en particulier
ETAPA-Cuenca. Cette dernière dut intervenir à de multiples reprises, en organisant des
ateliers de formation sur les usages de l’eau et sur la nécessité de maintenir une couverture
végétale dans les zones d’altitude, pour développer à moyen terme un véritable modèle
d’agriculture durable dans la zone.
245
��-�-3������)*=!.�"��">(�".%��-"�-)"(�#�������-���.�"�)#(�"
Le réservoir creusé dans les páramos, et la disparition du couvert végétal qu’il a engendré, pourrait être la cause de processus d’érosion accélérés lors des prochaines années. Source : N. Rebaï (2009).
Début 2009, un compromis put être trouvé entre les paysans de Parcoloma et ceux de Sidcay.
ETAPA-Cuenca, qui avait réuni de nombreuses autres fois les dirigeants des deux parties,
parvint à leur faire entendre qu’un partage des eaux du point de captation « Pie de letrero »
pouvait convenir aux besoins de chacun (cf. Photographie n°69). Pourtant, lors de notre
dernier passage dans la paroisse Octavio Cordero Palacios en 2011, rien n’était encore réglé.
Malgré la remise en état du système d’irrigation de Sidcay par les paysans de Parcoloma, le
ministère de l’Agriculture, à qui il revient d’attribuer les droits d’usage de l’eau, n’avait pas
encore décidé de la répartition de la ressource. Pour M. Bustamante, le problème venait du
« manque d’efficacité de la part du ministère » et de son « incapacité à prendre un décision
claire. » En attendant, même si les relations semblent s’être apaisées, rien ne garantit que le
conflit ne puisse renaître dans les prochains mois si une décision officielle n’émane pas
rapidement des autorités publiques.
246
��-�-3������)*4!�����()"-)��(
Plusieurs réunions furent nécessaires pour que les paysans de Parcoloma et de Sidcay trouvent un accord sur le partage de l’eau provenant des páramos de San Luis. Source : N. Rebaï (2008).
L’histoire de ce qui est aujourd’hui l’ancienne comuna San Luis montre à quel point le
contexte migratoire peut entraîner des recompositions foncières radicales. Mais au-delà même
de ces changements, le plus frappant est de voir émerger des acteurs majeurs dont les prises
de décisions peuvent avoir une influence considérable sur le reste de la population paysanne.
C’est ainsi que localement, apparaît une nouvelle forme d’autorité incarnée par plusieurs
anciens migrants.
5!(�����$��������� �� �����������%$����������?�� ��� �����@ ��A
Ils sont plusieurs, dans la paroisse Octavio Cordero Palacios, à être respectés, jalousés ou
accusés de semer la discorde au sein de la population paysanne. Anciens migrants devenus
fruiticulteurs ou bien éleveurs bovins, nous nous sommes intéressés à eux, à leurs discours et
aux relations étroites que certains entretiennent avec le reste de la population paysanne pour
maintenir leur position sociale.
247
C’est au cours d’un entretien portant sur son activité commerciale que nous avons appris que
Salvador avait bénéficié, avec Juan, de l’appui financier d’institutions publiques pour acquérir
du matériel de haute technologie il y a de cela quelques années. Cette information suscita chez
nous une grande curiosité : comment deux petits producteurs de fruits étaient-ils parvenus,
seuls, à mobiliser autant de ressources ? En parallèle, nous avons porté notre attention sur le
cas de Luis. Après plusieurs rencontres imprévues, dans le bus qui venait de Cuenca, ou à la
sortie de la messe à Santa Rosa, il nous sembla pertinent de suivre celui qui avait œuvré pour
la formation d’un groupe de producteurs agroécologiques dans le secteur de la Dolorosa,
comme il nous l’expliqua lui-même au détour d’une discussion amicale. Comment était-il
parvenu à créer un dynamique collective ? Quel était son but ? Afin de répondre aux questions
posées dans ce paragraphe, nous allons poursuivre notre réflexion en nous intéressant aux cas
de Salvador, Juan et Luis, comme nous l’avons fait précédemment avec Angel, et tâcher de
mesurer l’influence de ces trois anciens migrants dans la dynamique territoriale locale.
5! ! #%���� ���� ��� ������� �������� ���� �� ���� �� B ��� �� ���C���
����������
Depuis longtemps, Salvador a compris qu’il valait mieux exister au sein d’un collectif plutôt
que de rester isolé. C’est pourquoi, au cours des vingt dernières années, il a encouragé ses
voisins à s’unir autour d’un projet qui lui tenait à cœur, celui de la fruiticulture. Il nous
décrivit ainsi la dynamique qu’il impulsa près de chez lui, dans le secteur d’El Cisne :
« lorsque nous avons formé notre association de producteurs à la fin des années 1980, c’était
pour recevoir l’appui du CREA. Seuls, nous ne pouvions pas faire grand-chose, mais dès que
nous avons formé un groupe juridiquement reconnu [l’association des « Fruiticulteurs d’El
Cisne »], nous avons gagné en visibilité et beaucoup d’autres institutions [le ministère de
l’Agriculture et le CEDIR entre autres] sont venues nous aider. »
Salvador est aujourd’hui un producteur de fruits et de légumes prospère. Néanmoins, il sait
que son activité agricole pourrait être encore plus rentable s’il parvenait à vendre toute sa
production. C’est pourquoi, il était important qu’il obtienne le financement d’une chambre
froide pour la conservation de ses produits, après quoi il pourrait élargir ses réseaux de
commercialisation au-delà même du marché cuencanais. Seul, il n’aurait pu obtenir le soutien
d’une banque, malgré ses hauts revenus. Quant aux petites structures de micros crédits, elles
248
n’auraient pu lui avancer que des sommes très modestes. Salvador mobilisa alors ses voisins
fruiticulteurs d’El Cisne pour qu’ils obtiennent ensemble un appui financier.
Fondé en 2005, pour remplacer le Conseil de Programmation d’Actions d’Urgence qui avait
été créé après la catastrophe de la Josefina53, le CG-Paute s’est engagé ces dernières années à
mener un vaste programme de conservation environnementale dans le bassin versant du Paute,
après avoir reçu un financement de 14 millions de dollars de l’Union Européenne pour la
période 2005-2010. Pour cela, il a par exemple fourni une assistance technique aux petites
exploitations des provinces du Cañar, de l’Azuay et du Morona Santiago, en les encourageant,
comme le PAU et le CREA, à s’orienter vers l’agroécologie.
Comme nous l’expliqua plus précisément I. Belezaca, l’ingénieur en charge de la coordination
des projets agricoles au sein du CG-Paute, « la réforme agraire [qui, nous l’avons déjà
signalé, n’a pas concerné la paroisse Octavio Cordero Palacios, mais il s’agit là encore d’un
discours institutionnel ayant une portée générale] a conduit la majorité des paysans à
surexploiter les terrains les plus fragiles comme les pentes et les páramos [aggravant ainsi
l’érosion des sols (De Noni et al., 2001)], et depuis, il n’y a jamais eu de véritable politique
de protection environnementale. Notre objectif est d’améliorer les systèmes de production,
pour protéger les sols que les petits exploitants utilisent intensément, et pour que les
agriculteurs parviennent à l’autosuffisance et dégagent en même temps des excédents qu’ils
viendront vendre sur le marché cuencanais. Tout cela va dans le sens de la nouvelle
constitution [de 2008] qui met l’accent sur le « bien vivre » [« buen vivir »] et la souveraineté
alimentaire nationale. C’est donc pour cela que nous utilisons des Fonds d’Initiatives locales,
pour que des groupes de producteurs agroécologiques puissent émerger et que se développe
une véritable agriculture durable dans la région. »
Ainsi, les fruiticulteurs del Cisne reçurent une subvention de plus de 50 000 dollars pour
construire un entrepôt et aménager leur chambre froide (cf. Photographies n°70/73), car leur
projet répondait aux critères fixés par le CG-Paute. D’après l’expression employée par
53 Le 29 mars 1993, un glissement de terrain se produisit à une vingtaine kilomètres au nord-est de Cuenca, sur le versant de la colline Parquiloma au lieu dit « La Josefina ». Sur le plan humain, on dénombra soixante et onze victimes et la mise en sécurité de la zone nécessita l’évacuation de quatorze mille personnes. D’un point de vue matériel, les dégâts furent considérables puisque le bilan économique des seules pertes directes s’éleva à 147 millions de dollars avec la destruction de 1 500 maisons, de 20 kilomètres de route, et de 3 ponts, sans compter les 2 500 hectares de terres agricoles sinistrées (Léone et Velásquez, 1996).
249
Salvador, « une petite entreprise agricole » allait bientôt voir le jour, aussitôt que tout serait
en état de fonctionnement. Mais en réalité, tous ces investissements ne devraient pas profiter
de la même façon à l’ensemble du groupe.
��-�-3������")*;6D;+!()��""-�����-).���-.(���(�"�),-��.�2-.��)�"���-)
En arrivant dans le secteur d’El Cisne, l’association de fruiticulteurs souhaite la bienvenue aux visiteurs (à gauche). Plus loin, se trouve le futur entrepôt où sera conservée la production locale.
A l’entrée du bâtiment, un panneau indique le financement dont a bénéficié le groupe de producteurs. A l’intérieur, la chambre froide n’attend plus que de fonctionner. Source : N. Rebaï (2008).
Parmi les douze fruiticulteurs de l’association d’El Cisne, tous ne sont pas à mettre au même
niveau. Exceptés Salvador et Juan, dont nous avons détaillé les activités dans le Chapitre 5,
aucun ne produit en réalité de volumes importants. Dans l’exploitation de Manuel L. par
exemple, il n’y avait en 2008 qu’une cinquantaine de pommiers, ce qui paraît bien faible pour
envisager une activité commerciale soutenue, et concernant les autres membres de
l’association, le CEDIR vint même les encourager à diversifier leurs productions.
250
Parmi les douze fruiticulteurs de l’association d’El Cisne, tous ne sont pas à mettre au même
niveau. Exceptés Salvador et Juan, dont nous avons détaillé les activités dans le Chapitre 5,
aucun ne produit en réalité de volumes importants. Dans l’exploitation de Manuel L. par
exemple, il n’y avait en 2008 qu’une cinquantaine de pommiers, ce qui paraît bien faible pour
envisager une activité commerciale soutenue, et concernant les autres membres de
l’association, le CEDIR vint même les encourager à diversifier leurs productions.
C’est ainsi que Zoíla, Teresa ou Rosario, avec qui nous n’avons pas eu d’entretiens formels
mais plutôt des discussions amicales au cours des ateliers organisés par le CEDIR, reçurent
quelques dizaines de plants de tomate d’arbre, à titre expérimental. Mais comme nous l’avons
vu précédemment chez les producteurs du groupe Bajo Invernadero, cela ne devrait leur
procurer que des revenus limités et loin d’augmenter leur influence au sein de l’association de
fruiticulteurs. En définitive, l’usage de l’entrepôt et de la chambre froide ne devrait profiter
qu’à Salvador et Juan, les deux anciens migrants aux capacités économiques supérieures.
Ces dernières années, la stratégie de Salvador, qui fut de rallier à sa cause des agriculteurs
plus modestes pour recevoir des appuis institutionnels afin de moderniser son activité
marchande, fut très efficace. En véritable leader, il est désormais le relais incontournable de la
population paysanne auprès des techniciens, lesquels n’hésitent pas à l’ériger comme un
exemple de réussite à suivre pendant leurs visites dans la paroisse Octavio Cordero Palacios.
De fait, Salvador entretient des relations étroites avec plusieurs institutions, ce qui lui assure
certains privilèges, comme le fait d’avoir pour lui seul l’un des stands les mieux situés à la
foire du CREA. En d’autres termes, il est le symbole d’un nouveau type de paysans dont le
prestige social vient d’une expérience migratoire ayant conduit à une réussite économique
incontestable.
5!5! (� ���$��� ������������ ��� ������� �������� E �%���� � ��� ������
�%�������7�
En dehors des projets agricoles, l’influence des anciens migrants se vérifie dans la dynamique
foncière locale, comme ce fut le cas à San Luis. Un certain nombre d’entre eux souhaiterait
désormais faire main basse sur les terres d’Illapamba, les uns pour leurs propres intérêts, les
autres pour lancer de nouvelles dynamiques de travaux collectifs. Dans les derniers temps de
251
notre travail de terrain, nous avons donc cherché à comprendre leurs revendications qui, à
l’avenir, pourraient engendrer de nouveaux conflits fonciers.
5!5! !"���������� ���?�� ���������� ����� �������� ���A
Salvador et Juan aimeraient tous deux avoir plus de terre pour produire davantage de fruits.
Toutefois, ils ne se voient pas acquérir de nouveaux terrains, compte tenu des prix élevés qu’il
faudrait payer pour cela. Ils voudraient donc accéder aux terres d’Illapamba, non pas en leurs
noms propres, mais en tant que membres de l’Association des Fruiticulteurs del Cisne. C’est
en tout cas ce que nous expliqua Juan, au cours d’un entretien : « aujourd’hui, il n’y a plus
personne dans la comuna. Combien sont-ils ? Un petit groupe ? Et voyez toute la terre qu’ils
ont pour eux. Nous autres de l’association voudrions pouvoir travailler là-bas. Ils n’auraient
qu’à nous céder deux hectares. »
Pour Salvador et Juan, il n’est donc pas question d’appartenir à l’organisation communale et
de récolter de la pomme de terre avec les autres comuneros. Leur ambition n’est autre que de
disposer d’une parcelle dont l’accès serait réservé à l’association des Fruiticulteurs d’El
Cisne. Comme nous le dit Salvador, avec beaucoup d’aplomb, « nous pourrions y produire
des fraises et des mûres en grandes quantités. Mais nous ne travaillerions pas avec ceux
d’Illapamba et nous ne partagerions pas nos productions. »
En d’autres termes, Juan et Salvador voudraient obtenir une sorte de concession sur les terres
d’Illapamba, de manière à ce que l’activité commerciale de leur association de producteurs,
dont ils sont les seuls véritables moteurs, prenne une autre dimension. Depuis plusieurs
années, ils ne cessent donc de solliciter les membres de la comuna pour avoir le droit de
cultiver une parcelle sur le territoire communal, n’obtenant pour toute réponse qu’un refus
catégorique. Mais dans ce cas, ils ne sont pas les seuls.
5!5!5!# ���?�� �@ ��������������� �������������� �� ������
���7��A
Luis a 47 ans. Au début des années 1980, il s’en alla travailler à New York où il resta une
dizaine d’années. De façon régulière, il envoya de l’argent à son épouse, Elvira, ce qui leur
252
permit d’acheter un peu plus de quatre hectares de terre. Aujourd’hui, ils mènent tous deux
une vie paisible dans leur exploitation, au sein de laquelle ils ne se consacrent qu’à l’élevage
bovin. Leur troupeau se compose d’une dizaine de vaches, produisant chacune un peu moins
de dix litres de lait par jour en moyenne. Cela procure au couple un revenu brut de près de
950 dollars par mois puisqu’ils vendent chaque jour la quasi-totalité de leur production à l’un
des collecteurs parcourant la zone. En dehors de cela, Luis se rend ponctuellement à la foire
aux bestiaux de Cuenca où il achète trois ou quatre veaux pour environ 1000 dollars, qu’il
élève pendant seize mois environ, avant de retourner les vendre pour en tirer un bénéfice de
« 400 dollars environ » par tête.
��-�-3������)*;:!#%�F�#-�����-).�#(�"
A côté de la grande maison construite il y a déjà quelques années, les terres ne sont dédiées qu’aux pâturages, à perte de vue. Source : N. Rebaï (2009).
Bien entendu, cet élevage bovin implique des dépenses importantes : de l’achat de compost
tout d’abord, pour l’entretien des pâturages, soit près de 2 000 dollars chaque année, plus des
frais vétérinaires qui atteignent 250 dollars par an. Cela correspond en définitive à système
d’élevage beaucoup plus intensif en capital que la très grande majorité des petites
exploitations de la paroisse Octavio Cordero Palacios. Néanmoins, et malgré toutes ces
253
dépenses importantes, Luis et son épouse parviennent à dégager une marge nette de
1 159 dollars par mois en moyenne, ce qui leur est suffisant pour couvrir l’ensemble de leurs
dépenses alimentaires, car précisons-le, le couple doit presque tout acheter: riz, maïs, pommes
de terre, fruits et légumes, et tous les autres produits de consommation courante, excepté le
lait.
��'#��()*+=!'�#�)��-)-2�>(�2�)"(�#2-G�)0�).-##��"1
.�#%�F�#-�����-).�#(�"�)5664
Revenus Dépenses
Sur le marché Vente d’un bœuf 650 Achat d’un veau 250
Sur l'exploitation Vente de lait 945 Compost 165
Frais vétérinaire 21
Total 1 595 436
Calcul de la vente de lait réalisé sur la base d’une vente moyenne de 90 litres quotidiens au prix unitaire de 0,35 dollar ; Sources : entretiens réalisés entre juillet 2008 et août 2009.
Malgré cela, et c’est bien là le paradoxe, Luis est resté très attaché au travail de la terre. Lors
de notre première conversation, il déplorait le fait que « depuis plusieurs années, il n’y a plus
d’agriculture à cause de l’émigration. » Pour remédier à cela, il prit l’initiative de réunir ses
voisins, pour qu’ensemble, ils produisent à nouveau du maïs, de la fève et de la pomme de
terre. C’est ainsi qu’il nous l’expliqua, avec beaucoup de conviction : « autour de nous, il y a
de nombreuses exploitations qui n’ont plus qu’une ou deux personnes pour travailler alors
que dans le passé, il y en avait dix ou douze dans chaque famille. Alors, plutôt que
d’abandonner les terres, nous pouvons les cultiver en travaillant tous ensemble et produire
ainsi notre propre alimentation. »
En s’inspirant d’autres groupes qu’ils pouvaient voir travailler près de chez eux, Luis et douze
autres exploitants (des anciens migrants, des femmes seules et des paysans plus âgés),
décidèrent alors de former l’association des « Producteurs Agroécologiques de La Dolorosa »
et de se mettre à cultiver huit parcelles mises à disposition par différents membres. Chez
Celina, ils semèrent par exemple 2000 m² de maïs au mois de septembre 2008 ; chez Yolanda,
ce fut un peut moins de 1500 m² de fèves, tandis que chez Miguel C., ils semèrent également
près de 3000 m² de pommes de terre.
254
��-�-3������)*;<!()������##��(#��,�����#�"��-.(���(�".�#�.-#-�-"��
Pour produire de la fève (à gauche) ou bien de la pomme de terre, les producteurs de la Dolorosa disposent de plusieurs parcelles mises à disposition du groupe par différents membres. Source : N. Rebaï (2008/2009).
Pour cultiver 4 hectares au total, le groupe de La Dolorosa se réunit une à deux fois par
semaine. Leur travail leur permet ainsi de couvrir une partie de leurs besoins alimentaires et
de tirer quelques revenus. C’est en ces termes que Luis nous l’expliqua : « sur chacune des
parcelles, nous travaillons à medias. La moitié de la production revient au propriétaire du
terrain, et l’autre moitié est distribuée au reste du groupe. » En 2009, une petite partie de la
production de pomme de terre fut même vendue, permettant l’achat de bois pour construire un
petit grenier. A l’avenir, il se pourrait que le groupe développe une activité commerciale plus
régulière, et qu’il envisage même d’obtenir le statut de vendeur officiel sur l’un des marchés
cuencanais, comme la comuna Illapamba.
255
��-�-3������)*;!#%��(��.�#����������
Après une matinée de travail, les paysans de La Dolorosa partagent un repas en plein champ et décident des prochaines tâches à venir. Source : N. Rebaï (2008).
Sous l’impulsion de Luis, dont la réussite sociale en fait aujourd’hui un leader naturel, la
formation du groupe de producteurs de la Dolorosa est un exemple intéressant de réactivation
des liens de solidarité au sein de la population paysanne, comme nous l’avons vu aussi avec le
groupe Bajo Invernadero. Si dans beaucoup d’autres exploitations, les relations s’établissent
aujourd’hui sur la base d’échanges monétarisés, l’entraide est ici un facteur clé pour le bon
fonctionnement de la dynamique collective.
Néanmoins, Luis voudrait désormais aller plus loin. Dans son esprit, il serait important de
pourvoir cultiver plus de terre, afin de « conserver [notre] agriculture et [nos] traditions. »
Pour cela, il faudrait alors entrer dans la comuna Illapamba, mais comme Salvador et Juan,
ses demandes répétées au nom de son association se sont heurtées au refus des membres de
l’organisation communale. Pourtant, Vicente, qui est à la fois membre de la comuna et du
groupe de producteurs de La Dolorosa, ne serait pas forcément opposé à l’élargissement du
nombre de comuneros. Mais comme il nous le dit lui-même, « à Illapamba, il y a beaucoup
256
de familles pauvres qui ont besoin des pâturages pour survivre et qui ne voudront pas
partager avec plus de monde les terres qui leur ont été attribuées par ETAPA-Cuenca. »
5!5!+!.��������������@ ��� �������������������H������ ����I
Ainsi, Salvador, Juan, Luis et les paysans de La Dolorosa vivent comme une injustice le fait
de ne pouvoir accéder eux aussi aux terres d’Illapamba, ce qui semble paradoxal lorsque l’on
sait que durant les dernières décennies, le nombre de comuneros n’a cessé de baisser. Cela
révèle cependant que même dans le contexte migratoire, la terre suscite un intérêt
considérable, comme nous l’avions déjà observé à Juncal, où l’achat d’une ou plusieurs
parcelles paraissait être systématique chez les familles de migrants, malgré l’augmentation
des prix du foncier.
Tout cela nous amène en définitive à nous interroger sur le devenir de la comuna Illapamba, à
l’heure où la migration apparaît être la dynamique la plus importante dans le processus de
transformation globale de la paroisse Octavio Cordero Palacios. D’ailleurs, même les
techniciens du ministère de l’Agriculture semblent préoccupés par cette situation, comme en
témoigne cette réflexion de R. Burbano : « la loi des comunas [de 1937] est aujourd’hui
caduque car elle ne prévoit rien en cas de baisse du nombre de comuneros. Comment devra-t-
on gérer à l’avenir les organisations [qui n’auront plus qu’une poignée de membres] ?
Faudra-t-il [en] recruter de force ? Faudra-t-il rendre les terres à l’Etat ? »
Pour le moment, il est inenvisageable d’aborder le sujet avec les paysans d’Illapamba. Après
leur accord passé avec ETAPA-Cuenca, il n’est pas question pour eux de perdre leur
monopole sur les espaces pâturés de la comuna, ni même de partager les terres avec une
quelconque association de producteurs. A l’avenir, la situation pourrait donc être de plus en
plus conflictuelle au sein de la population paysanne, à l’image de ce qui se produisit à San
Luis il y a quelques années. Le contexte migratoire pourrait entraîner de nouvelles
recompositions foncières dans la paroisse Octavio Cordero Palacios, et peut-être même dans
d’autres localités de la sierra, car avec la généralisation de l’émigration paysanne, il n’est pas
impossible d’assister à la multiplication des rapports de force entre une « nouvelle élite
paysanne », riche et ambitieuse, et une masse d’exploitants aux ressources limitées.
257
�����������
Après avoir comparé en détail les situations de 9 exploitations de la paroisse Octavio Cordero
Palacios, il apparaît clairement que le contexte migratoire favorise l’apparition de nouvelles
inégalités à l’échelle locale. En effet, l’émergence d’une minorité d’exploitants au pouvoir
économique supérieur, ayant su se diversifier pour intégrer l’économie urbaine et obtenir
régulièrement des rentrées d’argent très élevées, contraste avec la permanence d’une majorité
de familles aux revenus agricoles modestes, très loin de pouvoir entrer dans un processus de
capitalisation qui leur permettrait de moderniser leurs exploitations, et grandement
dépendantes des salaires des emplois locaux pour couvrir leurs besoins quotidiens, comme
c’était déjà dans le cas dans la passé.
L’analyse des transformations sociales en cours dans la paroisse Octavio Cordero Palacios
mérite cependant d’être plus précise, car il existe en effet un nombre important d’exploitations
se trouvant dans des situations intermédiaires. Certaines d’entre elles disposent par exemple
de revenus agricoles bien supérieurs à ceux de la pluriactivité ou de la migration, alors
qu’elles ne font que vendre des fruits, des légumes et des produits laitiers, tandis que d’autres,
malgré leur appartenance à des réseaux de producteurs, n’obtiennent que des revenus limités
sur les marchés urbains et continuent de dépendre des remesas.
Tout cela démontre en définitive que le contexte migratoire n’entraîne pas une évolution
homogène des pratiques paysannes, comme nous l’évoquions déjà dans le Chapitre 3 lorsque
nous traitions de la diversité des projets économiques des migrants les plus anciens, sans
provoquer pour autant une séparation évidente entre une classe d’exploitants riches et une
autre d’exploitants pauvres. En réalité, il existe à l’échelle locale une paysannerie plurielle,
bien plus semble-t-il qu’elle ne l’était dans le passé, en témoigne d’ailleurs la
complexification des systèmes d’activités qui s’est opérée au cours des dernières décennies.
L’élargissement du cadre spatial des stratégies paysannes par l’émigration internationale, le
maintien de la pluriactivité locale et dans certains cas de l’artisanat, la formation récente de
groupes de producteurs et le développement de cultures commerciales, ainsi que l’importance
258
croissante de l’élevage bovin ont rendu les profils des exploitations familiales beaucoup plus
divers qu’ils ne l’étaient cinquante ans auparavant.
Ainsi, quand certaines familles cumulent remesas et revenus agricoles, d’autres se spécialisent
dans la vente de produits laitiers ; si plusieurs d’entre elles mènent une activité commerciale
dynamique, beaucoup doivent en revanche additionner plusieurs salaires pour compenser les
déficits de leurs productions vivrières. En définitive, nous serions tenté de dire qu’à l’échelle
de notre zone d’étude, il n’existe pas vraiment de modèle d’exploitation, mais au contraire,
que chacune d’entre elles est un cas spécifique, même si à certains moments nous les avons
classé par types, pour clarifier notre démonstration.
S’il est alors possible de parler d’une évolution accélérée du milieu rural, celle-ci se
caractérise en outre par l’apparition d’un nouveau pouvoir, celui des anciens migrants. Bien
que leur réussite économique a pu être soulignée, elle ne doit pas être déconnectée de leur
influence croissante sur le reste de la population paysanne, ou même des relations qu’ils
entretiennent avec les institutions publiques qui travaillent en milieu rural. Ces nouveaux
« caciques », comme nous les avons définis, sont le reflet d’une paysannerie plus dynamique,
mais dont les ambitions peuvent aller à l’encontre des intérêts de l’ensemble de la population
paysanne, en témoignent les conflits qui ont rythmé la vie dans la paroisse Octavio Cordero
Palacios ces dernières années. En outre, ce nouveau pouvoir, essentiellement masculin,
semble paradoxal compte tenu du fait que lors des dernières décennies, les femmes furent les
garantes du maintien de l’activité agricole et du développement de réseaux marchands dans la
région cuencanaise.
A l’image des phénomènes locaux que nous avons pu décrire, l’émigration paysanne dans le
reste des Andes équatoriennes pourrait donc entraîner une série de changements profonds au
cours des prochaines années. Nous l’avions déjà observé à Juncal en constatant par exemple
que les écarts de richesses allaient croissant entre les familles avec migrants et les familles
sans migrant. Pourtant, nous n’avions pas vu de transformation majeure de l’usage des terres
communales, ce qui pourrait avoir lieu si l’émigration continuait, comme elle s’est poursuivie
des années durant dans la paroisse Octavio Cordero Palacios. Ainsi, les évolutions
démographiques et les nouveaux rapports de force dans le contexte migratoire devraient
probablement donner lieu à de nouvelles recompositions territoriales dans la région andine.
259
����������������
�
�
« Nous et les nôtres, nous vivrons encore quand tous ceux-là seront morts depuis longtemps. Nous sommes ceux qui vivront éternellement. On ne peut pas nous détruire. Nous sommes le peuple et le peuple vivra toujours. »
John Steinbeck, Les raisins de la colère.
260
« Ainsi va la vie. Emigrer, toujours émigrer, pour trouver ailleurs ce qu’il n’y a plus chez
soi ». C’est sur ces mots que Luz finit de nous conter son histoire, lorsque nous l’avions
visitée dans sa petite exploitation de Parcoloma. Son mari est parti il y a près de vingt ans, et
comme beaucoup de femmes seules, elle tente de survivre en cultivant sa terre. En pensant
toujours un peu à la Yoni.
Après avoir rangé notre cahier, nous l’avions saluée aimablement, et tout au long du chemin
qui nous conduisait au bus, nous nous étions demandés si, effectivement, la migration ne
pouvait être que l’unique alternative pour l’agriculture paysanne en Equateur. A cette époque,
nous n’en étions qu’à l’un de nos premiers entretiens, et nous n’avions pas encore idée de la
variété de phénomènes que nous allions observer dans la paroisse Octavio Cordero Palacios.
�����������������
De nos jours, l’émigration paysanne est indéniablement l’une des dynamiques les plus
importantes à l’origine des recompositions territoriales dans les Andes équatoriennes. Les
phénomènes que nous avons observés dans notre zone d’étude nous prouvent que les
campagnes andines sont loin de se caractériser par un seul type d’agriculture ou un seul type
de paysannerie, mais qu’il existe au contraire une ruralité diverse, faite d’une multitude
d’acteurs aux logiques distinctes. Ces observations faites à l’échelle d’une seule petite
paroisse nous laissent donc imaginer la très grande variété des phénomènes à étudier et à
comparer dans l’ensemble de la région andine.
C’est ici que nous touchons d’ailleurs à la limite de notre travail, car il aurait été judicieux de
mener notre recherche dans plusieurs localités, comme le firent E. Mesclier au Pérou
(Mesclier, 1991) et G. Cortes en Bolivie (Cortes, 2000). A plusieurs reprises, nous nous
sommes tout de même appuyé sur notre expérience dans la province du Cañar, où nous avions
déjà constaté des phénomènes variés, et à d’autres moments, il fut tout aussi intéressant de
mettre en parallèle les dynamiques à l’œuvre dans les campagnes de l’Azuay avec celles ayant
cours dans d’autres régions des Suds. Nous en tirons aujourd’hui des conclusions qui seront
261
certainement la base de réflexions à venir, notre intérêt pour l’étude des stratégies paysannes
dans les pays en développement étant plus que jamais aiguisé.
D’un point de vue méthodologique, les entretiens et les enquêtes que nous avons réalisés dans
la paroisse Octavio Cordero Palacios nous ont permis de réunir un volume d’informations très
important, nous permettant de réaliser une cartographie inédite de la zone, de comprendre
l’évolution des pratiques paysannes depuis plusieurs décennies et d’avoir une idée précise des
conditions de vie actuelles de nombreuses familles. Cela n’aurait pas été possible sans une
présence presque quotidienne auprès des exploitants qui, bien souvent, nous demandèrent
avec autant de gentillesse que de curiosité l’origine d’une telle implication personnelle. Pour
que notre étude soit la plus sérieuse possible, il nous fallait connaître au mieux la paroisse
Octavio Cordero Palacios, même si, comme l’écrivit J. Bonnemaison, « comprendre une
société qui n’est pas la sienne est une gageure presque impossible » (Bonnemaison, 1981 :
260).
Cette attitude naquit d’une volonté de ne pas aboutir à des conclusions partielles, ce qui fut
notre principal regret lors de notre précédente expérience équatorienne. A Juncal, les
exigences d’un calendrier universitaire particulièrement serré nous avaient contraint à réaliser
notre travail de terrain en un temps très court, nous obligeant par conséquent à laisser
plusieurs questions en suspens. Dans notre localité d’étude azuayenne, nous avons pu mener
une réflexion plus approfondie sur les capacités réelles des agriculteurs familiaux à s’adapter
au contexte migratoire, en élargissant par ailleurs notre analyse à des thématiques nouvelles
comme celles de l’approvisionnement urbain et des luttes de pouvoir au coeur de la
population paysanne. Il en ressort plusieurs éléments importants sur lesquels nous devons
revenir à présent.
���������������������������������� �!�����
Dans la paroisse Octavio Cordero Palacios, le contexte migratoire a provoqué ces dernières
années une profonde transformation de l’usage du sol marquée par la diminution des
superficies consacrées aux cultures de cycles longs et l’extension des pâturages. Toutefois, un
262
autre facteur a participé à la transformation du système agraire local : la croissance urbaine
régionale a, en effet, favorisé le développement du maraîchage au sein des unités de
production familiale, ce qui témoigne de toute la capacité d’adaptation des plus petites
exploitations, souvent limitées en main-d’œuvre et en capitaux. Néanmoins, cela ne doit pas
occulter la fragilité économique dans laquelle se maintiennent beaucoup d’entre elles. En
effet, si l’on constate globalement que l’accès au marché cuencanais entraîne une
augmentation des revenus agricoles, cette seule condition n’est pas suffisante pour fournir aux
familles agricultrices un travail pleinement rémunérateur. La pluriactivité locale et la
migration demeurent dans bien des foyers les premières ressources monétaires, et constituent
par conséquent les principaux facteurs de reproduction sociale dans l’espace rural.
C’est bien ce que nous avons pu constater en suivant le travail des producteurs du groupe
Bajo Invernadero, très efficaces pour se consacrer collectivement à la vente de leurs
productions, mais qui dans le même temps, peuvent se trouver dans une situation de très
grande dépendance à l’égard des remesas et des salaires locaux. Entre septembre 2008 et mai
2009, alors que deux exploitations de ce groupe obtenaient plus de 75% de leurs rentrées
d’argent grâce à leurs ventes de produits agricoles et d’élevage, une troisième avait un revenu
brut global qui dépendait pour 47% de remesas, tandis que les deux dernières dépendaient à
plus de 70% de salaires extérieurs. Cela s’explique bien entendu par différents facteurs,
notamment la taille de la propriété, déterminante pour le développement de l’élevage laitier,
devenu ces dernières années l’une des premières sources de revenus pour de nombreuses
exploitations de la paroisse Octavio Cordero Palacios et du reste de la sierra. Mais il faut
aussi considérer la part de l’autoconsommation, très importante chez certaines familles
pouvant réunir près d’une dizaine de membres, et chez qui les volumes de produits réservés à
la vente sont logiquement plus modestes.
Dès lors, si nous avons observé des différences assez nettes entre les exploitations qui
composent le groupe Bajo Invernadero, à l’échelle de notre localité d’étude, nous nous
sommes aperçus que les contrastes socioéconomiques pouvaient être bien plus marqués,
comme c’était le cas notamment dans la comuna Illapamba en 2008. A cette époque, plusieurs
familles luttaient quotidiennement pour produire leur propre alimentation, en disposant par
ailleurs de maigres revenus extérieurs pour couvrir leurs autres besoins fondamentaux, tandis
que d’autres, moins nombreuses, qui avaient modernisé leurs exploitations après une
263
expérience migratoire réussie, se consacraient davantage à leurs productions commerciales
qui leur permettaient d’obtenir des revenus très élevés.
Dans le contexte migratoire, les pratiques agricoles sont donc bien loin d’être uniformes. Il
serait même maladroit de tenter une typologie des familles agricultrices de la paroisse Octavio
Cordero Palacios, tant leurs rapports avec la migration et le marché peuvent varier. De même,
le constat qui doit être fait à propos des liens entre migration, agriculture commerciale et
développement doit être nuancé car l’existence des remesas ou l’apparition de réseaux de
producteurs ne veut pas dire que la pauvreté rurale soit en baisse. En réalité, il semble plus
juste d’évoquer l’apparition de nouvelles formes d’inégalité entre les exploitations.
"�� #�� �$��������%�� &� �$���%��%�%����'� (������ !%��� �� �!��%))������ ���*���
)%��������+)�%�����%�������������� ���$�,��-�.�
Dans la province de l’Azuay, le développement du maraîchage et de l’élevage laitier permet à
certaines exploitations d’obtenir des revenus aussi importants que ceux de l’émigration ou de
la pluriactivité, voire de rentrer dans un processus de capitalisation qui leur permettra à moyen
terme de moderniser leurs systèmes de production. Mais comme nous avons pu le constater
dans la paroisse Octavio Cordero Palacios, leur nombre est encore trop réduit pour parler de
filières qui seront à l’avenir des voies de développement pour l’agriculture familiale à
l’échelle régionale. Cela nous donne par conséquent l’occasion de souligner les limites des
réseaux de producteurs agroécologiques, présentés comme des alternatives à l’émigration
paysanne par les institutions qui en font la promotion.
Tout d’abord, nous avons pu constater que la rémunération journalière moyenne de l’activité
maraîchère était très faible dans la plupart des exploitations, celle-ci n’excédant pas 5 dollars
par travailleur, ce qui explique que dans bien des cas, l’émigration, ou à défaut, les emplois
urbains, continuent d’être considérés comme de meilleures opportunités économiques. La
forte concurrence entre les producteurs maraîchers apparaît également comme un obstacle à
l’augmentation de leurs revenus. La diversification des productions locales devrait donc être
davantage encouragée par les institutions comme le PAU, le CREA, le CG-Paute et même les
petites ONG qui appuient les exploitations de la région. En outre, si ces dernières affirment en
264
chœur vouloir faire des agriculteurs familiaux des acteurs centraux de la sécurité alimentaire
régionale, il convient alors que l’approvisionnement de la ville de Cuenca en denrées
agricoles soit beaucoup plus varié.
Certaines exploitations disposant de capitaux importants, comme celles des migrants de
retour, ont dans ce contexte un rôle déterminant à jouer en s’orientant vers des cultures
commerciales nécessitant une modernisation importante des systèmes de production.
L’expérience que nous avons eue dans la paroisse Octavio Cordero Palacios, avec ceux que
nous avons désignés comme de « petits entrepreneurs agricoles », montre avec quelle facilité
certaines cultures fruitières peuvent être écoulées sur les marchés urbains, ou via d’autres
canaux de distribution, et procurer ainsi des revenus réguliers très importants. Dans ces
conditions, la migration apparaît effectivement comme un facteur de développement pour les
unités de production, mais le nombre d’exemples auxquels nous pourrions faire référence
demeure anecdotique.
La question qui se pose est donc celle de l’accès au capital pour les exploitations familiales,
avant même que ne soit évaluée l’influence réelle des appuis institutionnels qui, dans la
province de l’Azuay, montrent certaines limites. Au niveau des seules associations de
producteurs agroécologiques ni le PAU ni le CREA n’ont la capacité de contrôler
régulièrement tous les exploitants de la région, ce qui provoque ponctuellement certaines
irrégularités dans les productions, comme nous l’avons entendu dire de la part des ingénieurs
de ces institutions. De là, à ce qu’ils puissent mener des campagnes de financement ou de
microcrédit pour encourager la diversification agricole et participer de manière plus évidente
à la viabilisation de l’agriculture familiale, le chemin est donc encore long.
Par ailleurs, il ne faudrait pas ignorer une autre limite de taille de la « voie agroécologique ».
Si d’un point de vue environnemental, le développement du maraîchage provoque une érosion
des sols moins importante que la culture intensive du maïs, sur un plan économique, la plupart
des exploitants sont désormais dépendants de l’achat régulier d’engrais organique, même
lorsqu’ils possèdent des animaux produisant un peu de fumier. Ainsi, pour les seuls membres
du groupe Bajo Invernadero, l’achat d’engrais représentait en moyenne 44% des dépenses
agricoles dans chaque exploitation entre septembre 2008 et mai 2009.
265
Dans les conditions actuelles, la pratique du maraîchage est donc encore bien loin de
constituer une alternative durable à l’émigration paysanne, garantissant une rémunération
suffisante à une majorité de petits exploitants, d’autant que les associations régionales de
producteurs apparaissent bien plus comme un outil politique, dont l’objectif est la réduction
de l’informalité sur les espaces de ventes urbains. En outre, seules quelques centaines
d’exploitants bénéficient pour l’heure d’un label agroécologique et d’un accès régulier aux
marchés urbains, quand près de 70 000 autres agriculteurs azuayens disposant de moins de
trois hectares (INEC, 2000), n’ont aujourd’hui que des moyens limités pour intégrer
l’économie urbaine et développer une activité commerciale.
A l’avenir, nous pourrions donc observer un contraste de plus en plus net entre une
paysannerie dynamique, entretenant des liens tangibles avec la ville, et une autre plus pauvre,
contrainte d’emprunter des chemins différents de celui de l’agriculture marchande pour
survivre. Exactement ce que l’on peut déjà voir à l’échelle de la paroisse Octavio Cordero
Palacios où les disparités socioéconomiques ne cessent d’augmenter, avec leur lot de tensions.
/��#����� ����� ��0������������������%������1��
Le contexte migratoire est donc propice au renouvellement des pratiques agricoles, mais il est
également favorable à l’émergence de nouveaux pouvoirs. L’histoire de San Luis symbolise
l’apparition d’un nouveau type de rapport de force dans les campagnes équatoriennes, alors
que celles-ci ont déjà été le lieu de bien des conflits, opposant par exemple la petite
paysannerie à de puissantes firmes agroindustrielles (Harari et al., 2004 ; Rodríguez, 2008 ;
Ojeda 2008). Dans le cas de l’ancienne comuna, un certain nombre de migrants de retour ont
été les acteurs décisifs d’une reconfiguration foncière majeure, en agissant pour la
privatisation de terres collectives. Indéniablement, il s’agit là d’une évolution très nette de la
société paysanne, au sein de laquelle de plus en plus d’individualités disposant de ressources
économiques importantes sont prêtes à faire passer leurs propres ambitions au détriment du
reste de la population. C’est par exemple ce qui pourrait avoir lieu si, comme ils le voudraient,
d’autres anciens migrants parvenaient à privatiser les terres d’Illapamba, pour mener à bien
leurs projets commerciaux. Le pouvoir des remesas va donc bien au-delà de la seule
266
dimension économique puisqu’il engendre une nouvelle forme de fragmentation sociale du
milieu rural, au sein duquel la raison du plus fort est plus que jamais la meilleure.
Mais il serait tout de même réducteur de ne résumer que sous l’angle des conflits la question
de la redéfinition des relations sociales dans le contexte migratoire, la preuve en est que de
nouvelles formes de solidarités apparaissent entre les exploitations diminuées en main-
d’œuvre, comme c’est le cas par exemple avec les membres du groupe Bajo Invernadero, ou
bien ceux de La Dolorosa. Au même titre que les achats de terre, que la construction de
nouvelles maisons en dur, ou que les violentes appropriations foncières que nous avons
décrites, ces nouvelles solidarités pourrait être considérées elles aussi comme une forme de
« résistance territoriale » (Cortes, 1999 : 267), car elles indiquent clairement la volonté des
groupes paysans de se maintenir sur leur terre et de vivre de leur agriculture. Mais en
parallèle, d’autres éléments sont bien entendu à prendre en considération.
2��3�����!�����)%����$���������������������� �������%����� �����.�
L’analyse des effets de l’émigration paysanne dans les Andes équatoriennes exige de
s’interroger sur l’avenir de l’agriculture familiale dans cette région du monde. Les remesas,
au-delà même de servir à l’amélioration des conditions de vie matérielles des foyers ruraux
(Auroi, 2008 ; Baby-Collin et al., 2009), pourraient constituer l’amorce d’une nouvelle forme
de développement économique dans les campagnes, même si la réalité est en fait bien plus
complexe.
Il ne faudrait pas omettre que, bien souvent, la stratégie migratoire est synonyme de risque et
d’incertitude. Entre la dette contractée chez le chulquero, la clandestinité, et les perspectives
d’emploi souvent limitées dans les pays d’accueil, comme en ces temps de récession
économique, les chances de réussite apparaissent toujours plus réduites pour ceux qui partent.
De plus, notre expérience dans les provinces du Cañar et de l’Azuay démontre qu’une part
assez minime de la population paysanne est parvenue ces dernières années à tirer profit de la
migration. Dans la paroisse Octavio Cordero Palacios, 10% des familles que nous avons
étudiées ont réussi à mettre sur pied une activité commerciale prospère, quand 60% d’entre
elles utilisent les remesas pour satisfaire en priorité leurs besoins quotidiens, malgré leurs
267
activités marchandes. Pour ce qui est du reste de la population, les quelques ventes
hebdomadaires de produits agricoles, qui ont lieu parfois de manière informelle, sont bien
souvent insuffisantes et doivent nécessairement être compensées par des revenus extra-
agricoles, lesquels peuvent être par moments très difficiles à obtenir compte tenu de la
précarité du marché de l’emploi au niveau local.
Au-delà même de ces différents éléments, qui témoignent d’une situation sociale de plus en
plus contrastée, la réduction constante des superficies cultivées pourrait bien être envisagée
comme un symbole fort de la « fin des paysans » (Mendras, 1967) dans la sierra
équatorienne. Dès lors, c’est aussi la question de la sécurité alimentaire nationale qui pourrait
se poser à l’avenir : les émeutes de la faim qui ont touché nombre de pays du Sud en 2008 ont
montré qu’une trop grande dépendance aux importations agricoles, comme c’est le cas en
Equateur depuis près de trente ans, pouvaient mettre en péril la stabilité d’un État.
Pour contribuer au maintien des exploitations familiales, l’articulation plus évidente entre
villes et campagnes, qui symboliserait le retour d’une agriculture locale comme dans la
province de l’Azuay, pourrait être décisive pour viabiliser à moyen terme les économies
rurales. Cela impliquerait de favoriser l’émergence de réseaux courts d’approvisionnement
pour faciliter l’intégration marchande des agriculteurs, comme le suggèrent H. Cochet et al.
(2009), au lieu de privilégier des filières d’exportation qui tendent à fragiliser la société
paysanne (Gasselin, 2000 ; Martinez, 2003 ; Chaléard et Mesclier, 2004). Notre expérience
indique d’ailleurs que les plus petites unités de production font preuve d’une grande efficacité
pour fournir la ville de Cuenca en produits frais et obtenir ainsi des revenus réguliers, tout en
garantissant des prix bas aux consommateurs. Il y aurait donc, comme nous l’avons montré,
un intérêt majeur à faciliter l’accès des exploitations familiales au marché urbain national,
pour qu’elles disposent ainsi du capital nécessaire à leur reproduction et qu’elles ne dépendent
pas uniquement des revenus de l’émigration et de la pluriactivité locale.
268
����������
����� ����������������������� �������������� ����
���� ������������������� �������������� ���!���"���� #�
10h40. Comme toujours, je dois courir dans les rues de Cuenca pour arriver sur l’Avenida
España et attraper le bus qui se rend toutes les heures à Santa Rosa. Il passera comme
toujours à 11h05, et il m’est interdit de le rater ou je manquerai la sortie de la messe. Je
voudrais voir certains compañeros, et Bolívar m’attend pour discuter des événements récents
en Tunisie. « Tu es venu te réfugier en Equateur ? » m’avait-il demandé, lorsque je l’avais eu
au téléphone quelques jours auparavant.
Comme toujours, le bus est bondé. Les paysans de Ricaurte, de Sidcay et de la Paroisse
Octavio Cordero Palacios ont l’habitude de monter à l’arrêt précédant le mien et c’est à peine
si j’arrive à me faufiler derrière le chauffeur. Je scrute les visages mais cette fois-ci, je ne
reconnais personne.
Le bus avance. Il passe devant l’aéroport et descend rapidement vers Ricaurte. Des fenêtres, je
vois les bâtiments gris du parc industriel de Cuenca. Le volume de la radio est poussé au
maximum, mais cela n’empêche pas certaines paysannes de somnoler, avec leurs paniers sur
les genoux. A Ricaurte, le bus passe comme toujours devant les petits restaurants où rôtissent
par dizaines des cobayes que viennent déguster les cuencanais chaque fin de semaine.
Premier arrêt. Des paysans descendent, d’autres montent, le tout dans une grande agitation.
Puis, le bus reprend son chemin, plus lentement désormais. Il s’éloigne progressivement de la
269
ville, le paysage change, les premiers champs apparaissent, les premières maisons colorées
aussi.
Deuxième arrêt. Pendant la courte pause, je regarde vers le sud la ville de Cuenca qui s’étend
sur plusieurs kilomètres. Le rouge brique est la teinte dominante, tandis que vers le nord, je ne
vois que du vert, celui des pâturages de Sidcay, où comme dans la paroisse Octavio Cordero
Palacios, l’élevage laitier est devenu l’activité principale. Le bus repart, un peu plus léger.
J’observe à nouveau les visages, mais là encore, je ne reconnais personne. Ni Mercedes, ni
Victoria, ni aucune autre paysanne avec qui je discutais parfois en venant de Cuenca.
Aujourd’hui, je n’ai pas de chance.
Le bus arrive à Parcoloma. Je regarde par la fenêtre pour trouver sur le bord de la route un
visage familier. Personne. Quelques paysans descendent, et le bus repart. Il continue son
chemin et passe par El Cisne, sans même s’arrêter. Il ne fait pas très beau et le gris du ciel
rend l’ambiance mélancolique. Quelques centaines de mètres encore et j’arriverai à
Chaquillcay. Je fais signe au chauffeur de s’arrêter et lui donne les 40 centavos.
11h50. Je marche doucement. A quelques mètres, Bolívar est là. Trop occupé à crier sur le
pauvre ouvrier perché sur le toit de sa maison, il ne s’aperçoit même pas de ma présence. Je
lui demande alors ce qu’il fabrique, à décorer encore et toujours sa maison. Il se retourne alors
et me crie « Naaaacho ! ». Suivent cinq bonnes minutes d’embrassades. « Le déjeuner sera
bientôt prêt. Les filles sont à l’intérieur, mais avant, je dois terminer cela », finit-il par me
dire. Cela tombe bien : au même moment, les paysans sortent de la petite chapelle de Cristo
de Consuelo.
La première à me reconnaître est María : « alors vecinito, tu n’as toujours pas ramené la
vecina ? » me demande-t-elle dans un grand éclat de rire. Je lui demande comment va le
travail. « On lutte, on lutte » me dit-elle, avant d’ajouter que ces dernières semaines, « il a
beaucoup plu et [que] les rendements ont été mauvais ». Sa fille est à côté, elle me salue
timidement. Je l’interroge sur ses études. Elle me dit qu’elle obtiendra son diplôme
d’ingénieur d’ici deux ans. Je lui demande si elle n’est pas prête à partir, là-bas, aux Etats-
Unis, comme elle m’en avait vaguement parlé il y a plusieurs mois. « Je ne sais pas » me dit-
elle en souriant. « J’aimerais bien aller visiter » finit-elle par me dire.
270
Manuel arrive. « Alors vecinito ? Comment ça va ? » Nous discutons de tout et de rien, des
ventes sur le marché au temps qui passe, avant que n’apparaissent Luis, Vicente et sa femme
Elisa. Nous nous saluons chaleureusement et je demande ensuite à Vicente comment va le
travail à Illapamba. Il me répond qu’il n’est plus membre de l’organisation. Je n’en reviens
pas, mais après quelques minutes, je me dis que c’est finalement logique. Je me tourne alors
vers Luis, pour savoir s’il n’a pas remplacé son compère de La Dolorosa : « toujours pas » me
dit-il. « Les gens ne veulent plus travailler ensemble. »
María voudrait savoir si je compte revenir travailler ici, pour les aider, elle et les autres de
Bajo Invernadero, car plus personne ne les appuie : « depuis que Don Salvador s’est disputé
avec les ingénieurs du CEDIR, ceux-là ne viennent plus du tout. » Je ne sais que lui répondre.
Je lui dis alors que je les appellerai pour qu’ils viennent de temps en temps. La discussion
prend fin. Nous nous saluons et chacun rentre chez soi pour profiter du repos dominical.
Je m’en vais déjeuner avec Aleida et Maria José, les deux filles de Bolívar. Elles me tiennent
au courant de la vie trépidante de Teófilo, qui passe le plus clair de son temps chez ses
enfants, aux Etats-Unis. Elles me racontent aussi ce qui a changé en mon absence. « Untel est
revenu », « celui-ci s’est fait construire une maison », « celle-là a rejoint son fiancé à la
Yoni ». Comme d’habitude.
Il est 15h. Le dernier bus va bientôt passer, et je ne peux naturellement pas le rater.
Finalement, je n’ai même pas discuté avec Bolívar. Il me salue et me demande quand je
reviendrai. Je lui réponds « dans quatre ou cinq semaines normalement. » Il me dit alors de
prendre soin de moi et que les portes de sa maison me seront toujours ouvertes. Le bus arrive,
je cours comme ce matin, direction Cuenca.
���� ����$��%������� ���&'����������(&)�
Il est 11h lorsque j’arrive à Chaquillcay. Aujourd’hui, c’est jour de fête : Bolívar inaugure son
café-restaurant. La veille, les anciennes gloires du club de football du Deportivo Cuenca sont
même venues jouer dans la paroisse, pour le plaisir de tous. Cet après-midi, il y aura d’autres
festivités mais je ne sais pas encore lesquelles. Bolívar me voit arriver de loin et me salue
271
chaleureusement, comme à son habitude. Il me dit d’entrer, de faire comme chez moi. A
l’intérieur, je fais connaissance avec son frère et sa nièce qui habitent tous deux à Los
Angeles, ainsi que d’autres membres de la famille. Nous parlons un peu avant qu’Aleida ne
me dise de m’asseoir pour déjeuner. Au menu : une salade de mellocos, du riz et du poisson.
Je dis alors à mes voisins de table que le melloco se fait de plus en plus rare ici, car plus
personne ne le cultive. Plusieurs d’entre eux s’étonnent qu’un étranger puisse savoir cela. Je
leur raconte alors ce que m’a dit un jour Bolívar, alors que nous bavardions assis au bord d’un
chemin : « dans le passé, il y avait beaucoup plus de maïs car les gens n’avaient que cela
pour se nourrir. Cela permettait même d’élever quelques porcs, et du coup, les familles
mangeaient plus souvent de cette viande. La manteca de cerdo [saindoux] était ensuite
récupérée et elle permettait de cuire les autres aliments et de leur donner du goût. C’est avec
elle que l’on préparait le mote sucio… C’était une époque où il existait encore l’odeur de la
campagne, celle des animaux que l’on faisait rôtir et que l’on partageait entre voisins. Il y
avait aussi le bruit de la campagne, celui des paysans qui travaillaient ensemble pendant les
mingas, qui criaient et qui commandaient les bêtes de somme. Aujourd’hui, tout cela a
disparu. C’est comme si la campagne était morte. »
A la fin du repas, je m’en vais attendre la sortie de la messe. Tout le monde est là, comme
d’habitude. Je salue de nombreuses personnes, des femmes surtout, et je finis comme toujours
par discuter avec Manuel : « Comment ça va vecinito? » me dit-il. Nous parlons du travail et
du marché. Il me dit que la période est un peu difficile en ce moment à cause des vacances :
« les gens sont à la plage, alors nous vendons un peu moins. » Puis il ajoute : « enfin, vous le
savez mieux que moi, du moment que nous vendons régulièrement, même un peu, et grâce à
Dieu, tout va bien. »
Daniel arrive tranquillement, les mains dans le dos : « je vais voir mes vaches » me dit-il en
me saluant. Toujours sympathique, il plaisante, me dit que je me suis perdu à Quito et que
c’est pour cela que je ne viens plus ici. Je lui réponds alors que j’attends toujours qu’il me
donne un peu de terre pour m’installer. Il rit de bon cœur avant de s’en aller, toujours
doucement.
Je reprends ma discussion avec Manuel et lui demande comment va Félix que je n’ai pas eu
l’occasion de voir, ni aujourd’hui, ni la fois dernière. Il me dit alors qu’il est aux Etats-Unis
272
depuis plusieurs mois. Je n’en reviens pas. Puis il ajoute qu’il s’y trouve certainement car l’un
de ses fils est malade. Quand reviendra-t-il ? « On ne sait pas. »
Il est 15h. Le jeu du « cerdito » va commencer. Bolívar a convoqué tous les enfants de la
communauté pour qu’ils attrapent le petit goret enduit de je ne sais quelle matière grasse.
Comme il s’agit d’un cadeau de Don Kafé, le vainqueur aura le droit de le garder. Ils sont une
vingtaine, surexcités, à courir dans tous les sens. Je prends quelques photos, après quoi je bois
un dernier verre de zhumir. Il est l’heure de rentrer. Je salue tout le monde et promets de
revenir très vite.
����������������
Annexe n°1 – Liste des entretiens réalisés dans la paroisse Octavio Cordero Palacios entre
juillet 2008 et août 2009 ......................................................................................................... 275
Annexe n°2 – Texte officiel de la Loi d’Organisation et de Régime des Comunas .............. 277
Annexe n°3 – Liste des entretiens institutionnels réalisés entre juillet 2008 et août 2009 .... 280
Annexe n°4 – Extraits du livre de comptes du groupe de producteurs Bajo Invernadero ..... 281
Annexe n°5 – Courrier daté de 1987 et adressé au ministère de l’Agriculture par les
comuneros d’Illapamba .......................................................................................................... 283
Annexe n°6 – Certificat de création de la comuna San Luis délivré par le ministère de
l’Agriculture en 1962 ............................................................................................................. 284
Annexe n°7 – Les migrations interrégionales de 18 paysans de la paroisse Octavio Cordero
Palacios entre 1950 et 2008 .................................................................................................... 285
Annexe n°8 – Evolution du solde migratoire en Equateur entre 1976 et 2007 ...................... 286
Annexe n°9 – Répartition des membres des 38 familles étudiées, en fonction de leur
occupation et de leur localisation ........................................................................................... 287
Annexe n°10 – Evolution du PIB équatorien entre 1980 et 2000 .......................................... 290
Annexe n°11 – Extrait de la méthdologie employée par l’INEC pour ses enquêtes agraires
continues (ESPAC) ................................................................................................................ 291
Annexe n°12 – Entretien de J.P. Grijalva, président de l’association des éleveurs bovins de la
sierra et de l’oriente, publié dans le quotidien Hoy le 25 juillet 2011 ................................... 293
Annexe n°13 – La vague agroécologique dans l’Azuay commentée par la presse régionale :
extrait du quotidien El Mercurio du 21 juillet 2008 ............................................................... 296
Annexe n°14 – Le détail des ventes de Daniel au marché 12 de Abril et à la foire du CREA en
Janvier 2009 ........................................................................................................................... 297
Annexe n°15 – Note du ministère de l’Agriculture de 1973 à propos de la comuna
Illapamba….. .......................................................................................................................... 299
Annexe n°16 – Extrait d’une enquête réalisée par le ministère de l’Agriculture auprès de la
comuna Illapamba en 1984 .................................................................................................... 300
Annexe n°17 – Extrait du registre de la comuna Illapamba de 1994 ..................................... 280
274
Annexe n°18 – Détail du bilan économique (en dollars) de la comuna Illapamba entre janvier
2008 et mars 2009 .................................................................................................................. 301
Annexe n°19 – Courrier du ministère de l’Agriculture adressé aux dirigeants politiques de la
paroisse Octavio Cordero Palacios à propos du partage des terres communales de San Luis en
1973 ........................................................................................................................................ 305
Annexe n°20 – Extrait de la Constitution de la République d’Equateur de 1998 .................. 306
Annexe n°21 – Courrier de J. Arias, directeur de l’INDA pour la région Australe, adressé au
ministère de l’Agriculture en 2002 ......................................................................................... 307
Annexe n°22 – Titres de propriété de Juan Manuel dans le secteur de San Luis ................... 308
275
�������������������� ����� �������������� ������������ �� ���������
��� �������������������������
N° Nom Age
en 2010Communauté
Entretien
sur
l’histoire
agraire locale
Entretien
sur les débuts
de l’émigration
locale
Entretien sur
l’exploitation
Suivi
hebdomadaire
de l’activité
commercial
1 Alejandrina 35 Corazón de
Jesus Oui / Oui /
2 Angel 61 Santa Marianita Oui Oui Oui /
3 Bolívar 60 Cristo del Consuelo
Oui / / /
4 Braulio 37 Azhapud / / Oui /
5 César 32 Santa Rosa Oui / / /
6 Daniel 65 Cristo del Consuelo
/ / Oui Oui
7 Daniel L. 56 La Dolorosa / Oui Oui /
8 Delfín 42 Azhapud / / Oui /
9 Elisa S. 55 Santa Rosa / / Oui /
10 Ermelinda 84 San Bartolomé / / Oui /
11 Félix 63 Cristo del Consuelo
Oui / Oui Oui
12 Isaías 64 El Rocío Oui Oui / /
13 Jorge 34 Cristo del Consuelo
/ / Oui /
14 Juan 58 Virgen de La nube / Oui Oui /
15 Juan Manuel 61 El Cisne Oui / / /
16 Juana 55 Pueblo Viejo / / Oui /
17 Julia 36 Cristo del Consuelo
/ / Oui /
18 Julio 56 Parcoloma / Oui Oui /
19 Luis 47 La Dolorosa Oui Oui Oui /
20 Luz 51 Parcoloma / Oui Oui /
21 Manuel 52 Cristo del Consuelo
Oui / Oui Oui
276
22 Manuel C. 59 Cristo del Consuelo
Oui / Oui /
23 Manuel Cruz 69 El Rocío Oui Oui Oui /
24 Manuel L. 73 El Cisne / / Oui /
25 Manuel Le. 44 Parcoloma / Oui Oui /
26 Manuel S. 67 La Dolorosa / / Oui /
27 María 45 Cristo del Consuelo
/ / Oui Oui
28 María C. 37 Santa Rosa Oui
29 María P. 64 La Dolorosa / / Oui /
30 María V. 40 San Bartolomé / / Oui /
31 Mariana 55 Parcoloma / / Oui /
32 Miguel 70 Santa Rosa Oui Oui Oui /
33 Miguel C. 52 La Dolorosa / / Oui /
34 Narcisa 37 Pueblo Viejo / / Oui /
35 Natividad 55 Cristo del Consuelo
Oui / Oui Oui
36 Octavio 55 Adobepamba Oui / Oui /
37 Olga 32 La Dolorosa / / Oui /
38 Rosa 45 La Dolorosa / / Oui /
39 Rosa L. 49 Santa Rosa / / Oui /
40 Salvador 63 El Cisne / Oui Oui /
41 Segovia 80 El Rocío Oui / / /
42 Teófilo 90 El Rocío Oui / / /
43 Vicente 60 La Dolorosa / Oui Oui /
44 Victoria 45 Cristo del Consuelo
/ / Oui /
Total 16 12 38 5
Source : entretiens réalisés en mai 2008 et août 2009.
280
�������������������� ���������������� �������� �������������������������
� Astudillo Jaime, administrateur du marché 3 de Noviembre.
� Iván Belazaca, technicien CG-Paute.
� Antonio Palaguachi, Ingénieur agronome, CREA.
� Ruben Burbano, juriste, Ministère de l’Agriculture (Cuenca).
� Marco Bustamante, ingénieur, ETAPA-Cuenca.
� Rufo Cabrera, Coordinateur du PAU, Municipalité de Cuenca.
� Manuel Carbajal, Technicien membre du PAU, Municipalité de Cuenca.
� Hernán Deleg, fonctionnaire, Institut National de Développement Agraire.
� Jaime Ezquebel, ingénieur agronome, Ministère de l’Agriculture (Cuenca).
� Hernán Gonzalez, administrateur du marché 9 de Octubre.
� Walter Lucero, administrateur du marché 12 de Abril.
� Patricio Peñafiel, ingénieur agronome, CEDIR.
� Ramiro Peñares, administrateur du marché 27 de Febrero.
� María Soliz, directrice du CEDIR.
� Eduardo Velez, Directeur technique du CG-Paute.
� Mauricio Vintimilla, administrateur des foires de Miraflores et Totoracocha.
281
��������������� �������� ���������������� ��������� ������� ��� ����������������� ���� ���
Première page.
283
��������� ����� � ������������!������ ���������� ��������� ����� ���
�� ��������� ������������"��
Source : archives du ministère de l’Agriculture à Cuenca (sans référence).
�
284
���������#���� ���������� ��������������������������
���� ���� �������� ��������� ����� �������#��
Source : archives du ministère de l’Agriculture à Cuenca (sans référence).
285
���������!������� �������� ����������������$����������� ������������ �� ����������
��� ���� ����������
Nom Age
en 2010 Lieux de travail Type de migrationPériodes de migrationTotal
Angel 61 Naranjal - Truncal Saisonnière 1960-1981 21 ans
Braulio 37 Guayaquil - Playas Prolongée 1985-2008 23 ans
Daniel L. 56 Churute Saisonnière 1963-1976 13 ans
Delfín 42 Guayas - Machala Saisonnière 1980-1993 13 ans
Félix 63 Churute - Truncal Saisonnière 1962-1972 10 ans
Juan 58 Truncal Saisonnière 1964-1980 16 ans
Juan U. 61 Naranjal Saisonnière 1957-1973 26 ans
Julio 56 Truncal Saisonnière 1966-1977 11 ans
Luis 47 Puerto Inca Saisonnière 1975-1981 6 ans
Manuel 52 Puerto Inca - Truncal -
Triunfo - Guayaquil Saisonnière 1974-2003 29 ans
Triunfo Saisonnière 1959 1 mois Manuel C. 59
Naranjal Prolongée 1959-1967 8 ans
Manuel L. 73 Triunfo - Puerto Inca -
Naranjito Saisonnière 1950-1975 25 ans
Manuel Le. 44 Truncal Saisonnière 1978-1988 10 ans
Manuel S. 67 Triunfo - Churrute Saisonnière 1958-1998 40 ans
Miguel C. 50 El Oro Saisonnière 1972-1974 2 ans
Octavio 55 Guayaquil - Salinas Saisonnière 1972-1978 6 ans
El Oro - Guayas Saisonnière 1957-1970 13 ans
Oriente Prolongée 1970-1972 2 ans Salvador 63
Churute Prolongée 1972-1976 4 ans
Vicente 60 Puerto Inca Saisonnière 1964-1972 8 ans Source : entretiens réalisés entre mai 2008 et août 2009.
286
������������������������������� ��� ������������ ���� ����!#�������!�
Année Solde
migratoire
1976 24 374
1977 21 702
1978 22 856
1979 21 002
1980 14 400
1981 9 855
1982 6 557
1983 11 548
1984 14 768
1985 22 158
1986 21 995
1987 16 940
1988 27 089
1989 26 210
1990 23 539
1991 25 880
1992 25 900
1993 30 683
1994 37 349
1995 33 146
1996 27 780
1997 32 000
1998 40 735
1999 91 108
2000 175 922
2001 138 330
2002 165 215
2003 125 106
2004 69 715
2005 62 077
2006 84 524
2007 42 399 Source : Direction Nationale de la Migration.
287
������������ ��� �����������" ���������������������%��
����������������� �������������������� �����������
Nom A B C D E F G
Alejandrina 1 1 Epoux 9 ans 3
Fille 16 ans
Fils 14 ans
Fils 13 ans
Fils 12 ans
Fille 4 ans
Epouse 4 ans
Angel 1 6
Fils 32 ans
Braulio 2
Fils 16 ansDaniel 5 1 1 2
Fille 3 ans 5
Fille 16 ans
Fille 9 ans
Fille 7 ans
Fils 5 ans
Epouse 3 ans
Daniel L. 1 6
Fille 3 ans
Delfín 2 2
Epoux 8 ans Elisa 1 2 1 2
Fils 18 ans
Fils 34 ansErmelinda 2 2
Fils 32 ans
Fils 14 ans
Fils 11 ans
Félix 2 4
Fille 8 ans
288
Fils 5 ans
Jorge 1 1 6
Fils 9 ans
Fils 8 ans Juan 2 2 3
Fille 8 ans
Epoux 15 ans
Fils 12 ansJuana 1 3
Fils 10 ans
1
Julia 1 2 6
Julio 1 2 2
Fils 8 ans Luis 2 2
Fils 5 ans
Epoux 23 ansLuz 2 1 2
Fils 2 ans
Manuel 1 4 1 5
Fille 16 ans
Fils 10 ansManuel C. 2 3
Fille 3 ans
3
Fille 18 ans
Fille 15 ans
Fils 12 ansManuel Cruz 1 2 4
Fils 4 ans
Manuel L. 2 3 4
Manuel Le. 2 3
Fils 17 ansManuel S. 2 1 2
Fils 14 ans
Frère 15 ansMaría 1 1 1 2
Sœur 13 ans
María C. 2 2
Fille 14 ans
Fils 6 ans María P. 1 1 1 3
Fils 4 ans
289
María V. 1 1
Fille 11 ansMariana 1 2
Fille 6 ans
Fils 19 ans
Fils 19 ansMiguel 2 1 3
Fille 8 ans
Fils 10 ansMiguel 1 1 1 2
Fils 6 ans 5
Narcisa 1 1 Epoux 7 ans
Natividad 1
Octavio 2
Olga 1 1 4
Rosa 2 1 1 Epoux 9 ans 2
Rosa L. 2 3
Salavador 2
Vicente 2 1
Frère 22 ansVictoria 3 2
Sœur 17 ans
Total 62 25 9 62 / / 50
A : personnes se consacrant à l’agriculture à plein temps ; B : personnes se consacrant à l’agriculture à mi-temps, avec un emploi plus ou moins régulier à l’extérieur de l’exploitation familiale (hors emplois journaliers); C : personnes ayant un emploi à temps plein à l’extérieur de l’exploitation familiale (hors emplois journaliers) ; D : personnes à l’étranger ; E : lien de parenté avec le chef d’exploitation ; F : période migratoire (en cours en 2010) ; G : nombre de personnes vivant elles aussi sur l’exploitation mais qui ne se consacrent pas à l’agriculture (enfants, anciens, handicapés). Source : entretiens réalisés entre juillet 2008 et août 2009.
290
��������������������������"������� ������ ���������������
Année PIB
en milliards de dollars
1980 1,17
1981 1,39
1982 1,35
1983 1,11
1984 1,15
1985 1,18
1986 1,05
1987 0,94
1988 0,91
1989 0,97
1990 1,05
1991 1,15
1992 1,24
1993 1,45
1994 1,68
1995 1,8
1996 1,91
1997 1,97
1998 1,97
1999 1,37
2000 1,64 Source : Banque Centrale d’Equateur.
293
���������������� �������������� �����%�� ���������������������������� �"������������ ����������
����� �� %���"�������������������������� �������������
« El precio oficial del litro de leche ayudó al sector a
mejorar sus condiciones »
Publicado el 25/Julio/2011 | 00:05
Entrevista
Juan Pablo Grijalva
Quién es: Gerente general de la asociación de ganaderos de la sierra y oriente
El sector productor de leche ha presentado mejoras debido al establecimiento del precio oficial del litro en finca, el cual es de ¢39,33. Sin embargo, se muestran preocupados por el bajo consumo que tiene la población.
¿Cuál es la situación actual del sector?
Podemos decir que hemos mejorado en los últimos años, ya que en los años 2002-2003, el litro de leche no tenía un precio oficial y los compradores pagaban hasta ¢18, lo que representaba pérdidas para los productores.
El precio del litro es actualmente de ¢39,33, lo que permite tener mayores ingresos a los productores. Se ha podido también mejorar la calidad del producto, realizando inversiones en mejoras de pasto, adquisición de fertilizantes de mejora calidad, etc.
¿Podemos decir que el sector atraviesa por su mejor momento?
Creo que estamos en un buen momento, pero falta realizar mejoras.
¿Cuáles?
Creemos que el Gobierno debe impulsar el consumo de leche a través de campañas de
294
concientización que den a conocer la importancia del producto en la alimentación. La población ecuatoriana tiene un consumo per cápita de 100 litros, mientras que en el Uruguay, principal consumidor del mundo, se toma 225 litros.
¿Qué otras mejoras necesitan los productores?
Lo que se requiere es implementar tecnología para seguir mejorando el producto. Es importante también la capacitación a los productores, con la finalidad de contar con mano de obra calificada. Otra ayuda que necesitamos se relaciona con el robo del ganado. Este problema ha azotado al sector durante mucho tiempo, por lo que pedimos a las autoridades que nos ayuden a controlar este inconveniente.
¿Cuántos productores existen en el país?
Según el censo agropecuario, son aproximadamente 298 mil productores, de los cuales, el 73% está en la Sierra; el 19%, en la Costa, y el 8%, en la Amazonía.
¿Cuántas personas trabajan en el sector?
Aproximadamente 1,5 millones de empleos directos e indirectos genera la cadena productiva de esta actividad.
¿Cuál es la producción que tiene el Ecuador?
Actualmente, se producen 5700000 litros diarios, es decir, 85% más que en 2010.
Si se ha incrementado la producción, ¿se puede decir que el Ecuador puede exportar
leche?
Sí. Ante el aumento de la producción, el sector tiene dos objetivos por cumplir. El primero se relaciona con el promover el consumo y el segundo tiene que ver con la exportación.
¿Se han realizado exportaciones?
Sí. En 2010, se exportaron alrededor de 60 mil litros a Venezuela, ya que este mercado es deficitario en producción de leche.
¿Cuáles son los mercados a los cuáles se apunta a ingresar?Creemos que el Perú, Colombia y Centroamérica son mercados potenciales para este sector
¿Qué hace falta para poder llegar a esos países?
Necesitamos estudiar esos mercados y tener un adecuado proceso de logística para que sea exitosa la exportación.
¿Cuáles son los competidores que tiene el Ecuador?
Los principales son la Argentina, el Uruguay, países de la Unión Europea y Nueva Zelanda.
295
¿La calidad de la leche nacional permite pensar en que se puede exportar?
Sí. La calidad de la leche ecuatoriana es alta, debido a las condiciones climáticas y geográficas que tiene el país. Además de estos factores, las mejoras de calidad permiten contar con una materia prima óptima para poder acceder a mercados internacionales.
¿Han tenido acercamientos con el Gobierno para solicitar ayuda en esta área?
Sí. Hemos tenido reuniones los Ministerios de Coordinación de la Producción, de Industrias, Desarrollo Social. Actualmente, hemos tenido acercamientos con la Cancillería con la finalidad de que apoyen al sector para concretar mercados a los cuales se exporte. (JMM)
Source internet : http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-precio-oficial-del-litro-de-leche-ayudo-al-sector-a-mejorar-sus-condiciones-489803.html
296
������������������������ ������������������)��$������������� ����� ��� ��������*��
��� �������������� ��� ��������������������������
297
��������������������������������������������� �&������ ���������������� ������ ����������� ������
299
���������� �������������� ��������� ����� �������!����� �����������������������"��
Source : archives du ministère de l’Agriculture à Cuenca (sans référence).
300
����������#����� ����������������� �������� �������� ��������� ����� ���
��� +��������������������"����������
Source : archives du ministère de l’Agriculture à Cuenca (sans référence).
301
����������!����� ������ ��� ���������������������"����������
Source : archives du ministère de l’Agriculture à Cuenca (sans référence).
N°1……………………………………………………………….N°19
302
����������������������"��������������'�������� (��������������������"���
��� ������� ����������� ������
�
������
305
���������������� � �������� ��������� ����� ���� �������� ���������������������� ���
��������� �� ������������ ��������� ���������� ��������������������������!��
307
���������������� � �������� �%�� ����� ������������� ���� �������� ���%��
�� ���������� ��������� ����� ����������
310
������������
�� ������������������������������������������ ��������������������������
� ACOSTA Alberto – 2006, Breve historia económica del Ecuador. Corporación Editora
Nacional, Quito.
� ACOSTA Alberto, LOPEZ Susana, VILLAMAR David – 2006, La migración en el
Ecuador: oportunidades y amenazas. Universidad Andina Simón Bolívar / Corporación
Editora Nacional, Quito.
� ACTIS Walter – 2006, « Ecuatorianos y ecuatorianas en España ; Inserción(es) en un
mercado de trabajo fuertemente precarizado ». In: G. Herrera, M.C. Carrillo, A. Torres
(eds.), La migración ecuatoriana: transnacionalismo, redes e identidades, pp. 169-201.
� AFOLAYAN Adejumoke – 2009, « International migration, territorial recomposition and
development within the south-western Nigeria and south-eastern Benin republic
Borderland ». In: A. Quesnel (coord.), Migrations internationales, recompositions
territoriales et développement, pp. 137-148.
� ALBAN Monserrat, MARTINEZ ALIER Joan, VALLEJO Cristina (eds.) – 2009, Aportes
para una estrategia ambiental alternativa: indicadores de sustentabilidad y políticas
ambientales. FLACSO / Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Quito.
� ALBERTI Giorgio, MAYER Enrique – 1974, Reciprocidad e intercambio en los Andes
peruanos. Instituto de Esudios Peruanos, Lima.
� ALOMIA Mercedes – 2005, « Efectos de la producción agropecuaria en los suelos de los
páramos: el caso Guangaje ». In: Ecuador Debate, n°65, pp. 175-194.
� ALVAREZ Susana, BUSTAMANTE Teodoro – 2006, « La investigación agroecológica:
¿puede contribuir a la disminución de los impactos ambientales? ». In: Ecuador Debate,
n°69, pp. 161-166.
311
� ANTHEAUME Benoît, GIRAUT Frédéric (eds.) – 2005, Le territoire est mort. Vive les
territoires ! Une (re)fabrication du développement. IRD, Paris.
� ARIAS ALBA – 1985, « Los flujos migratorios en Guayaquil: 1962-1974 ». In: Ecuador
Debate, n°8, pp. 59-109.
� ARREGHINI Louis, MAZUREK Hubert – 2004, « Territoire, risque et mondialisation.
Quelques réflexions à partir du cas des pays andins ». In : G. David (dir.), Espaces
tropicaux et risques. Du local au global, pp. 240-258.
� ARROBO Carlos – 1982, « Las políticas agrarias: versión estatal ». In: Ecuador Debate,
n°1, pp. 55-71.
� AUBRON Claire – 2006, Le lait des Andes vaut-il de l’or? Logiques paysannes et
insertion marchande de la production fromagère andine. Thèse de doctorat, INAP-G.
� AUDEBERT Cédric – 2006, L’insertion sociospatiale des Haïtiens à Miami.
L’Harmattan, Paris.
� AUROI Claude – 1998, « Les agricultures andines, une lente évolution ». In : Traditions
et modernisation des économies rurales, pp. 285-306.
� AUROI Claude – 2008, « La contribution des migrants au développement local en
Amérique latine ». In : Annuaire suisse de politique de développement, vol. 27, n°2,
pp. 133-153.
� AYALA MORA Enrique – 2009, Resumen de historia del Ecuador. Corporación Editora
Nacional, Quito.
� BA Abdoul – 2007, Acteurs et territoires du Sahel : rôle des mises en relation dans la
recomposition des territoires, ENS Editions, Paris.
� BABY-COLLIN Virginie, CORTES Geneviève, FARET Laurent, GUETAT-BERNARD
Hélène (dir.) – 2009, Migrants des Suds. IRD, Paris.
� BABY-COLLIN Virginie, CORTES Geneviève, FARET Laurent – 2009, « Transferts
migratoires, trajectoires de mobilité et développement. Regards croisés sur la Bolivie et le
Mexique ». In : V. Baby-Collin, G. Cortes, L. Faret, H. Guetat-Bernard (dir.), Migrants
des Suds, pp. 237-259.
� BALAREZO Susana – 1984, « Tejedoras de paja toquilla y reproducción campesina en
Cañar ». In: Mujer y Transformaciones Agrarias, pp. 147-223.
312
� BATAILLON Claude, DELER Jean-Paul, THERY Hervé – 1991, Amérique latine,
tome III – Géographie Universelle, Belin, Paris, 480 p.
� BELOTE Linda, BELOTE Jim – 2006, « ¿Qué hacen dos mil saraguros en EE.UU y
España? ». In: G. Herrera, M.C. Carrillo, A. Torres (eds.), La migración ecuatoriana:
transnacionalismo, redes e identidades, pp. 449-463.
� BEY Marguerite – 1994, Le meilleur héritage. Stratégies paysannes dans une vallée
andine du Pérou. ORSTOM, Paris.
� BEY Marguerite – 1997, « Que sont les communautés andines devenues ? Changements
dans la société rurale péruvienne ». In : J-M. Gastellu, J-Y. Marchal (eds.), La ruralité
dans les pays du Sud à la fin du XXe siècle, pp. 381-400.
� BLANCHARD Sophie – 2006, « La colonisation des basses terres boliviennes par les
paysans andins. De la marche vers l’Oriente à la contre réforme agraire ». In : Graphigéo,
n°31, pp. 27-38.
� BLANCHON David – 2010, L’eau : Un ressource menacée ?. La Documentation
Française, Paris.
� BLANC-PAMARD Chantal (coord.) – 1993, Politiques agricoles et initiatives locales.
Adversaires ou partenaires. ORSTOM, Paris.
� BLANC-PAMARD Chantal, BOUTRAIS Jean (coord.) – 1997, Thème et variations.
Nouvelles recherches rurales au Sud. ORSTOM, Paris.
� BLANC-PAMARD Chantal, CAMBREZY Luc (coord.) – 1995, Terre, Terroir,
Territoire. Les tensions foncières. ORSTOM, Paris.
� BONNAMOUR Jacqueline – 1996, Agricultures et campagnes dans le monde. SEDES,
Paris.
� BONNEMAISON Joël – 1981, « Voyage autour du territoire ». In : L’Espace
Géographique, n°4, pp. 249-262.
� BORRERO Ana Luz – 1989, El paisaje rural en el Azuay. Banco central del Ecuador,
Cuenca.
� BORRERO Ana Luz, VEGA Silvia – 1995, Mujer y migración: alcance de un fenómeno
nacional y regional. ILDIS / Abya Yala, Cuenca.
313
� BOURDIEU Pierre, SAYAD Abdelmalek – 1964, Le déracinement. La crise de
l’agriculture traditionnelle en Algérie. Les Editions de Minuit, Paris.
� BRASSEL Frank, HIDALGO Francisco (eds.) – 2007, Libre comercio y lácteos. La
producción de leche en el Ecuador entre el mercado nacional y la globalización. SIPAE /
IRD, Quito.
� BRASSEL Frank, HERRERA Stalin, LAFORGE Michel (eds.) – 2008, ¿Reforma agraria
en el Ecuador?: viejos temas, nuevos argumentos. SIPAE, Quito.
� BRAUDEL Fernand – 1993, Grammaire des civilisations, Flammarion, Paris.
� BRET Bernard – 1996, « Amérique latine : de la réforme agraire à l’agro-industrie ».
In : J. Bonnamour, Agricultures et campagnes dans le monde, pp. 139-162.
� BRETON Victor – 2005, Capital social y etnodesarrollo en los Andes. CAAP, Quito
� BRETON Victor – 2006, « Glocalidad y reforma agraria. ¿De nuevo el problema
irresuelto de la tierra ? ». In: �conos, n°24, pp. 59-69.
� BRUNET Roger, FERRAS Robert, THERY Hervé (dir.) – 1993, Les mots de la
géographie. Dictionnaire critique. La Documentation Française, Paris.
� BRUSLE Tristan – 2006, Aller et venir pour survivre ou s’enrichir. Circulations de
travail, logiques migratoires et constructions du monde des Népalais en Inde. Thèse de
doctorat, Université de Poitiers.
� BUSTOS Blanca, BUSTOS Hortencia – 2009, Hacia la soberania alimentaria.
Agroecología y comercio asociativo desde experiencias andino-amazonicas. Universidad
Andina Simon Bolívar / Cooperación Técnica Alemana / Ediciones La Tierra, Quito.
� CAGUANA Miguel, 2008 – « Diáspora de kichwa kañaris : islotes de prosperidad en el
mar de pobreza ». In: A. Torres, J. Carrasco (coord.), Al filo de la identidad. Migración
indígena en América Latina, pp. 127-146.
� CALAS Bernard – 1999, « Les paradoxes des rapports villes-campagnes à travers à
travers l’analyse du ravitaillement kampalais ». In : J-L. Chaléard, A. Dubresson (eds.),
Villes et campagnes dans les pays du sud : une géographie des relations, pp. 87-103.
� CARPIO Patricio – 1992, Entre pueblos y metrópolis. La migración internacional en
comunidades austroandinas en el Ecuador. ILDIS, Cuenca.
314
� CELESTINO Olinda – 1998, « Stratégies alimentaires dans les Andes ». In : Journal des
anthropologues, n°74, pp. 83-104.
� CERAMAC – 2003, Crises et mutations des agricultures de montagne. Actes du colloque
international en hommage au Professeur C. Mignon, PUVB, Clermont-Ferrand.
� CG-PAUTE, FONDACIÓN ECOLÓGICA MAZÁN, IRD – 2006, Dinámicas socio-
económicas rurales en la cuenca del Paute, Cuenca.
� CHACÓN Osacr – 2005, « La disfuncional ley de inmigración de los Estados Unidos de
hoy ». In : Programa Andino de Derechos Humanos (ed.), Migración, despalazamiento
forzado y refugio, pp.131-136.
� CHALEARD Jean-Louis – 1996, Temps des villes, temps des vivres. L’essor du vivrier
marchand en Côte d’Ivoire. Karthala, Paris.
� CHALEARD Jean-Louis, DUBRESSON Alain (eds.) – 1999, Villes et campagnes dans
les pays du sud : une géographie des relations. Karthala, Paris.
� CHALEARD Jean-Louis, MESCLIER Evelyne – 2004, « Dans le nord du Pérou,
l’agriculture commerciale augmente-t-elle les risques chez les petits producteurs ? ».
In : G. David (dir.), Espaces tropicaux et risques : du local au global, pp. 279-291.
� CHALEARD Jean-Louis, MOUSTIER Paule, LEPLAIDEUR Alain – 2002,
« L'approvisionnement vivrier des villes en Guinée : entre fragilité et dynamisme ».
In : Autrepart, n°23, pp. 5-23.
� CHARLERY de la MASSELIERE Bernard, NAKILEZA Bob, UGINET Estelle – 2009,
« Le développement du maraîchage dans les montagnes d’Afrique de l’Est : les enjeux ».
In : Les cahiers de l’Outre-Mer, n°247, pp. 311-330.
� CHARVET Jean-Paul – 1987, Le désordre alimentaire. Hatier, Paris.
� CHARVET Jean-Paul – 2007, L’agriculture mondialisée. La Documentation Française,
Paris.
� CHARVET Jean-Paul – 2008, Produire pour nourrir les hommes. SEDES, Paris
� CHAUVEAU Christophe – 2007, « La producción lechera en las economías campesinas
de la Sierra : seguridad, dinamismo económico y pluriactividad ». In: F. Brassel,
F. Hidalgo (eds.), Libre comercio y lácteos. La producción de leche en El ecuador entre el
mercado nacional y la globalización, pp. 43-51.
315
� CHIRIBOGA Manuel – 1982, « El papel del Estado en las transformaciones agrarias ».
In: Ecuador Debate, n°1, pp. 73-93.
� CHIRIBOGA Manuel – 1984, « Campesino andino y estrategias de empleo : el caso de
Salcedo ». In: Centro Andino de Acción Popular (ed.), Estrategias de supervivencia en la
comunidad andina, pp. 59-124.
� CHRIBOGA Manuel – 1985, « El sistema alimentario ecuatoriano: situación y
perspectivas ». In: Ecuador Debate, n°9, pp. 35-84.
� CHIRIBOGA Manuel – 1995, « Las ONGs y el desarrollo rural en los países andinos:
dilemas y desafíos ». In : Ecuador Debate, n°35, pp. 109-133.
� CHIRIBOGA Manuel – 1999, « El sector agropecuario ecuatoriano: cuellos de botella y
estrategias de salida ». In: Ecuador Debate, n°46, pp. 195-256.
� CHIRIBOGA Manuel – 2004, « Mercados, mercadeo y economías campesinas ».
In: Ecuador Debate, n° 61, pp. 217-234.
� CHONCHOL Jacques – 1995a, Systèmes agraires en Amérique latine : des agricultures
préhispaniques à la modernisation conservatrice. IHEAL, Paris.
� CHONCHOL Jacques – 1995b, « Le problème de la terre et les sociétés rurales en
Amérique latine ». In : C. Blanc-Pamard, L. Cambrézy (coord.), Terre, terroir, territoire :
les tensions foncières, pp. 257-288.
� COCHET Hubet – 1993, Des barbelés dans la sierra. Origines et mutations d’un système
agraire au Mexique. ORSTOM, Paris.
� COCHET Hubert – 2001, Crises et révolutions agricoles au Burundi, INAP-G / Karthala,
Paris.
� COCHET Hubert, AUBRON Claire, JOBBE DUVAL Margot – 2009, « Quelles sont les
conditions à réunir pour une intégration marchande porteuse de développement durable
pour les paysanneries andines ? ». In : Les cahiers de l’Outre-Mer, n°247, pp. 395-417.
� CORDERO PALACIOS Octavio – 1926, « El Azuay histórico ». In: L. Mora (dir.),
Monografía del Azuay, pp. 23-78.
� CORTES Geneviève – 1998, « Migrations, systèmes de mobilité, espaces de vie : à la
recherche de modèles ». In : L’Espace géographique, n°3, pp. 265-275.
316
� CORTES Geneviève – 1999, « Mobilités paysannes et identités territoriales dans les
Andes paysannes ». In : J. Bonnemaison, L. Cambrézy, L. Quinty-Bourgeois (eds.), Le
territoire, lien ou frontière ?, tome I, pp. 259-268.
� CORTES Geneviève – 2000, Partir pour rester : survie et mutation de sociétés paysannes
andines (Bolivie). IRD, Paris.
� CORTES Almudena, TORRES Alicia (coord.) – 2009, Codesarrollo en los Andes:
contextos y actores para una acción transnacional. FLACSO, Quito.
� COTE Marc – 1996, Pays, paysans, paysages d’Algérie. CNRS, Paris.
� COTE Marc – 2005, L’Algérie : espace et société. Media Plus, Paris.
� COURADE Georges, PELTRE-WURTZ Jacqueline (eds.) – 1991, « La sécurité
alimentaire à l’heure du néo-libéralisme ». Cahiers des Sciences Humaines, vol. 27, n°1-2.
� COURET Dominique – 1994, Système d'information géographique, inégalité dans le
logement et ségrégation spatiale à Quito, Équateur. ORSTOM, Paris.
� DAVID Gilbert (dir.) – 2004, Espaces tropicaux et risques: du local au global. IRD,
Paris.
� DELAUNAY Daniel, LEON Juan, PORTAIS Michel – 1990, Transición demográfica en
el Ecuador. IPGH / ORSTOM / IGM, Quito.
� DELAUNAY Daniel – 1990, « La démographie agraire de l’Equateur ». In : Cahiers des
Sciences Humaines, vol. 26, n°4, pp. 705-729.
� DELAUNAY Daniel – 1991, « Les migrations dans l’espace démographique équatorien ».
In : A. Quesnel, P. Vimard (eds.), Migrations, changements sociaux et développement,
pp. 145-159.
� DELER Jean-Paul – 1981, Genèse de l’espace équatorien. Essai sur le territoire et la
formation de l’Etat national. IFEA / ADPF, Paris.
� DELER Jean-Paul – 1991, « L’Equateur bipolaire ». In : C. Bataillon, J-P. Deler,
H. Théry, Amérique latine, tome III – Géographie Universelle, pp. 264-275.
� DELER Jean-Paul, GOMEZ Nelson, PORTAIS Michel – 1983, El manejo del espacio en
el Ecuador – Etapas claves. IRD, Quito.
317
� DE GRAMMONT Hubert, MARTINEZ Luciano (comp.) – 2009, La pluriactividad en el
campo latinoamericano. FLACSO, Quito.
� DEMANGEOT Jean – 1999, Tropicalité. Géographie physique intertropicale. Armand
Colin, Paris.
� DE NONI Georges, VIENNOT Marc – 1993, « Mutations récentes de l’agriculture
équatorienne et conséquences sur la durabilité des agro-systèmes andins ». In : Cahiers
ORSTOM, vol. XXVIII, n° 2, Paris.
� DE NONI Georges, VIENNOT Marc, ASSELINE Jean, TRUJILLO Germán – 2001,
Terres d’altitude, Terres de risques. La lutte contre l’érosion dans les Andes
équatoriennes. IRD, Paris.
� DE TAPIA Stéphane – 2005, Migrations et diasporas turques. Circulation migratoire et
continuité territoriale (1957-2004). IFEA / Maisonneuve et Larose, Paris.
� DIA Hamidou, ADAMOU Moumouni – 2009, « Les transferts d’argent des migrants de la
vallée du fleuve Sénégal. Processus d’affectation et impact sur la région d’origine ».
In : A. Quesnel (coord.), Migrations internationales, recompositions territoriales et
développement, pp. 20-32.
� DI MEO Guy – 1998, « De l’espace aux territoires : éléments pour une archéologie des
concepts fondamentaux de la géographie ». In : L’information géographique, n°3,
pp. 99-110.
� DIRY Jean-Paul – 2004, Les espaces ruraux. Armand Colin, Paris.
� DOLLFUS Olivier – 1992, « Les Andes comme mémoires ». In : Comprendre
l’agriculture paysanne dans les Andes centrales. Pérou – Bolivie, pp. 11-31.
� DOLLFUS Olivier – 1997, La mondialisation, Presses de Sciences Po, Paris.
� DOLLFUS Olivier, BOURLIAUD Jean, MESCLIER Evelyne – 1991, « Pérou : stratégies
paysannes en situation d’instabilité ». In : Problèmes d’Amérique latine, n°3, pp 27-38.
� DOLLFUS Olivier, BOURLIAUD Jean – 1997, « L’agriculture de la côte péruvienne au
vent du néolibéralisme ». In : Problèmes d’Amérique latine, n°25, pp. 87-104.
� DOUZANT-ROSENFELD Denise, GRANDJEAN Pernette (dir.) – 1995, Nourrir les
métropoles d'Amérique latine: approvisionnement et distribution, L’Harmattan, Paris.
318
� DUBY Georges, WALLON Armand – 1976, Histoire de la France rurale, tomes I à IV,
Seuil, Paris.
� DUFUMIER Marc – 1993, « Politiques agricoles et initiatives locales ». In : C. Blanc-
Pamard (ed.), Politiques agricoles et initiatives locale : adversaires ou partenaires,
pp. 15-47.
� DUFUMIER Marc – 1996, Les projets de développement agricoles. Manuel d’expertise.
Karthala / CTA, Paris.
� DUFUMIER Marc – 2004, Agricultures et paysanneries des Tiers-mondes. Karthala,
Paris.
� DUFUMIER Marc – 2006, « Diversité des exploitations agricoles et pluriactivité des
agriculteurs dans le tiers-monde ». In : Agricultures, vol. 15, n°6, pp. 584-588.
� ESPINOZA Leonardo (éd.) – 1989, La socieda azuayo-cañari : pasado y presente, IDIS /
El Conejo, Cuenca.
� ESPINOZA Leonardo, ACHIG Lucas – 1981, Proceso de desarrollo de las provincias de
Azuay, Cañar y Morona Santiago: breve historia económica y social de la región cañari.
CREA, Cuenca.
� FANCHETTE Sylvie – 1997, « Densité de population et urbanisation des campagnes : le
delta du Nil ». In : J-M. Gastellu, J-Y. Marchal (eds.), La ruralité dans les pays du sud à
la fin du XXe siècle, pp. 153-173.
� FARET Laurent – 2003, Les territoires de la mobilité. Migration et communautés
transnationales entre le Mexique et les Etats-Unis. CNRS, Paris.
� FAUROUX Emmanuel – 1980, « Equateur: les lendemains d’une réforme agraire ».
In : Problèmes d’Amérique latine, n°56, pp. 103-134.
� FAUROUX Emmanuel – 1989, « La plasticité des structures communautaires dans le
processus de transformation de l’Equateur rural ». In : Cahiers des sciences humaines,
vol. XXV, n°3, Paris.
� FERRARO Emilia – 2004, Reciprocidad, don y deuda. Formas y relaciones de
intercambios en los Andes de Ecuador : la comunidad de Pesillo. FLACSO / Abya Yala,
Quito.
319
� FRANCK Harry – 1917, Vagabonding down the Andes. Being the narrative of a journey,
chiefly afoot, from Panama to Buenos Aires. The Century Company, New York.
� FRANQUEVILLE André – 1987, Une Afrique entre le village et la ville : les migrations
dans le sud du Cameroun. ORSTOM, Paris.
� FREGOSI Renée – 2006, Altérité et mondialisation, la voie latino-américaine. Ellipses,
Paris.
� FONTAINE Guillaume – 2008, « Le mouvement écologiste contre l’exploitation
d’hydrocarbures en Équateur ». In : Problèmes d’Amérique latine, n°70, pp. 41-60.
� FORERO Alvarez Jaime – 2009, « Typologie des formes d’agriculture dans les hautes
terres andines de Colombie ». In : Les cahiers de l’Outre-Mer, n°247, pp. 419-437.
� GALLAIS Jean – 1976, « De quelques aspects de l’espace vécu dans les civilisations
tropicales ». In : L’Espace Géographique, n°1, pp. 5-10.
� GALLEGOS RAMIREZ Franklin – 2000, « Equateur: la crise de l’Etat et du modèle
néolibéral de développement ». In : Problèmes d’Amérique latine, n°36, pp. 77-88.
� GÁLVEZ Z. Patricia (ed.) – 1995, Economía campesina y sistemas de producción.
Estudio de base en la sierra andina. DHV Consultants BV / Ministerio de cooperación
técnica del reino de los Países Bajos, Amersfoort.
� GARCIA PASCUAL Francisco – 2003, « El ajuste estructural neoliberal en el sector
agrario latinoamericano en la era de la globalización ». In: European revew of latin
merican and caribbean studies, n°75, pp. 3-30.
� GARCIA PASCUAL Francisco – 2006, « El sector agrario del Ecuador: incertidumbres
(riesgos) ante la globalización ». In: �conos, n°24, pp. 71-88.
� GARCIA PASCUAL Francisco – 2007, « ¿Un nuevo modelo rural en Ecuador? Cambios
y permanencias en los espacio rurales en la era de la globalización ». In: �conos, n°29,
pp. 77-93.
� GASSELIN Pierre – 2000, Le temps des roses : la floriculture et les dynamiques agraires
de la région agropolitaine de Quito (Equateur). Thèse de doctorat, INAP-G.
� GASSELIN Pierre – 2001, « La explosión de la floricultura de exportación en la región de
Quito: una nueva dinámica agraria periurbana. In: P. Gondard, León J.B. (eds.),
Dinámicas territoriales: Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela, pp. 55-68.
320
� GASTAMBIDE Axel – 2000, « Equateur : de la crise bancaire de 1998 à la crise politique
de 2000 ». In : Problèmes d’Amérique latine, n°36, pp. 61-76.
� GASTELLU Jean-Marc – 1980, « … Mais, où sont donc ces unités économiques que nos
amis cherchent tant en Afrique ? ». In : Cahiers ORSTOM, vol. XVII, n°1-2, pp. 3-11.
� GASTELLU Jean-Marc – 1997, « Le désordre et le sens ». In : J-M. Gastellu, J-Y.
Marchal (eds.), La ruralité dans les pays du sud à la fin du XXe siècle, pp. 695-709,
ORSTOM, Paris.
� GASTELLU Jean-Marc, BACA TUPAYACHI Epifanio – 1994, « Le marché dans les
économies paysannes ». In : Cahiers des Sciences Humaines, vol. 30, n°1-2, pp. 157-178.
� GASTELLU Jean-Marc, MARCHAL Jean-Yves (eds.) – 1997, La ruralité dans les pays
du sud à la fin du XXe siècle. ORSTOM, Paris.
� GIRARD Sabine – 2005, « Les páramos : espace stratégique pour la gestion de l’eau dans
les Andes septentrionales : le bassin versant du río Ambato (Equateur) ». In :
Mappemonde, n°78, http://mappemonde.mgm.fr/num6/articles/art05202.html.
� GOLTE Jürgen – 1980, La racionalidad de la organización andina, IEP, Lima.
� GOMEZ Emilio José – 2004, « La política migratoria de España y la Union Europea ».
In : F. Hidalgo (ed.), Migraciones. Un juego con cartas marcadas, pp. 171-190.
� GOMEZ ESPINOZA Nelson – 2001, « El hombre andino y su espacio: el caso
ecuatoriano ». In: Dinámicas territoriales: Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela, pp. 7-14.
� GONDARD Pierre – 1984, « Agricultura de altura ». In : Ecuador Debate, n°6, pp. 25-47.
� GONDARD Pierre – 2005, « Ensayo en torno a las regiones de Ecuador: Herencias y
reestructuraciones territoriales ». In : Ecuador Debate, n°66, pp. 45-58.
� GONDARD Pierre, MAZUREK Hubert – 2001, « 30 años de Reforma Agraria y
colonización en el Ecuador (1964-1994): dinámicas espaciales ». In : P. Gondard, León
J.B. (eds.), Dinámicas territoriales: Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela, pp. 15-39.
� GONDARD Pierre, LEON Juan Bernardo (eds.) – 2001, Dinámicas territoriales:
Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela. IRD / PUCE, Quito.
� GOUROU Pierre – 1947, Les pays tropicaux. Principes d’une géographie humaine et
économique. PUF, Paris.
321
� GOUROU Pierre – 1976, Pour une géographie humaine. Flammarion, Paris.
� GRATTON Brian – 2006, « Ecuador en la historia de la migración internacional. ¿Modelo
o aberración? ». In: G. Herrera, M.C. Carillo, A. Torres (eds.), La migración ecuatoriana:
transnacionalismo, redes e identidades, pp. 31-55.
� GRAY Clark – 2008, Out-migration and rural livelihoods in the southern Ecuadorian
Andes. Doctoral dissertation, Uiversity of North California.
� GRANIE Anne-Marie, GUETAT-BERNARD Hélène (dir.) – 2006, Empreintes et
inventivité des femmes dans le développement rural. IRD / Presses Universitaires du
Mirail, Paris / Toulouse.
� GUETAT-BERNARD Hélène – 1998, « Nouvelles articulations villes-campagnes. Pluri-
appartenance et mobilité spatiale et professionnelle des ruraux du delta du Nil ». In :
L’Espace géographique, vol. 27, n° 3, p. 253-264.
� GUIBERT Martine, JEAN Yves (dir.) – 2011, Dynamiques des espaces ruraux dans le
monde. Armand Colin, Paris.
� HARARI Raúl, KOROVKIN Tanya, LARREA Carlos, MARTINEZ Luciano, ORTIZ
Pablo – 2004, Efectos sociales de la globalización. Petróleo, Banano y flores en Ecuador.
Abya Yala, Quito.
� HAUBERT Maxime – 1999, L’avenir des paysans. Les mutations des agricultures
familiales dans les pays du Sud. IEDES / PUF, Paris.
� HERRERA Gioconda – 2006, « Mujeres ecuatorianas en las cadenas globales del
cuidado». In: G. Herrera, M.C. Carillo, A. Torres (eds.), La migración ecuatoriana:
transnacionalismo, redes e identidades, pp. 281-303.
� HERRERA Gioconda – 2008, « Políticas migratorias y familias transnacionales :
migración ecuatoriana en Espana y Estados Unidos ». In: G. Herrera, J. Ramírez (eds.),
América Latina migrante: Estado, familia, identidades, pp. 71-86.
� HERRERA Gioconda, CARRILLO María Cristina, TORRES Alicia (eds.) – 2006, La
migración ecuatoriana: transnacionalismo, redes e identidades. FLACSO, Quito.
� HERRERA Gioconda, MARTINEZ Alexandra – 2002, Genero y migración en la region
sur. FLACSO, Quito.
322
� HERRERA Gioconda, RAMIREZ Jacques (eds.) – 2008, América Latina migrante:
Estado, familia, identidades. FLACSO, Quito.
� HERRERA Stalin – 2007, Percepciones sobre la Reforma Agraria. Análisis del discurso
de dirigentes de organizaciones campesinas e indígenas. SIPAE, Quito.
� HIDALGO Franciso, 2004 – Migraciones. Un juego con cartas marcadas. Abya Yala /
ILDIS, Quito.
� HOUTART François (comp.) – 2004, Globalización, agricultura y pobreza. Abya Yala,
Quito.
� HUBERT Bernard, CLEMENT Olivier – 2006, Le monde peut-il nourrir tout le monde?.
IRD, Paris.
� HUTTEL Charles, ZEBROWSKI Claude, GONDARD Pierre – 1999, Paisajes agrarios
del Ecuador. IRD / IFEA / PUCE, Quito.
� IBARRA Hernán – 2004, « La comunidad campesino/indígena como sujeto
socioterritorial ». In : Ecuador Debate, n°63, pp. 185-206.
� JANIN Pierre (coord.) – 2008, « Les enjeux de la crise alimentaire mondiale ». Hérodote,
n°131.
� JANIN Pierre – 2008, « Le soleil des indépendances (alimentaires) ou la mise en scène de
la lutte contre la faim au Mali et au Sénégal ». In : Hérodote, n°131, pp. 92-117.
� JOBBE-DUVAL Margot – 2005, Mille et une recettes de pomme de terre. Dynamiques
agraires et territoriales à Altamachi, cordillère orientales des Andes boliviennes. Thèse
de doctorat, INAP-G, Paris.
� JOKISCH Brad – 2002, « Migration and agricultural change: the case of smallholder
agriculture in highland Ecuador ». In: Human Ecology, n°4, vol. 30, pp. 523-550.
� JOKISH Brad, KYLE David – 2006, « Las transformaciones de la migración
transnacional del Ecuador, 1993-2003 ». In: G. Herrera, M.C. Carillo, A. Torres (eds.),
La migración ecuatoriana: transnacionalismo, redes e identidades, pp. 57-69.
� KAY Cristóbal – 2007, « Algunas reflexiones de estudios rurales ». In: Íconos, n°29,
pp. 31-50.
323
� KEITA Seydou – 2009, « Migrations internationales et mobilisation des ressources. Les
maliens de l’extérieur et la problématique du développement ». In : V. Baby-Collin, G.
Cortes, L. Faret, H. Guetat-Bernard (dir.), Migrants des Suds, pp. 217-235.
� KERVYN Bruno – 1992, « L’économie paysanne au Pérou : théories et politiques ». In :
P. Morlon (coord.), Comprendre l’agriculture paysanne dans les Andes centrales. Pérou –
Bolivie, pp. 436-470.
� KINGMAN Eduardo – 2006, «Viajeros y migrantes, cultura y alta cultura: el gremio de
albañiles de Quito se reúne en Madrid ». In : G. Herrera, M.C. Carillo, A. Torres (eds.),
La migración ecuatoriana: transnacionalismo, redes e identidades, pp. 467-480.
� KOLLER Sylvie – 2006, L’un part, l’autre reste. Jeunes Équatoriens sur la scène
migratoire. PUR, Rennes.
� KOLLER Sylvie – 2008, « Equateur : l’invitation au retour ». In : Caravelle, n°91,
pp. 87-99.
� KOROVKIN Tanya – 2003, « Desarticulación social y tensiones latentes en las áreas
florícolas de la sierra ecuatoriana ». In : Ecuador Debate, n° 58, pp. 143-158.
� LANDY Frédéric – 1994, Paysans de l’Inde du Sud. Le choix et la contrainte. Karthala /
IFP, Paris.
� LARREA Carlos – 2004, Pobreza, dolarización y crisis en el Ecuador. Abya Yala, Quito.
� LARREA Carlos – 2006, Hacia una historia ecológica del Ecuador. Universidad Andina
Simón Bolivar, Quito.
� LATOUCHE Serge – 2004, Survivre au développement. Mille et Une Nuits, Paris.
� LATOUCHE Serge – 2005, L’occidentalisation du monde. La Découverte, Paris.
� LEONARD Eric – 1995, De vaches et d’hirondelles. Grands éleveurs et paysans
saisonniers au Mexique. ORSTOM.
� LEONE Frédéric, VELASQUEZ Elkin – 1996, « Analyse en retour de la catastrophe de la
Josefina (Equateur, 1993) : contribution à la connaissance du concept de vulnérabilité
appliqué aux mouvements de terrain ». In : Bulletin de l’IFEA, n°25, pp. 461-478.
� LE RAY Pierre – 2004, Diagnostic agraire de la paroisse de Pindilig. Mémoire de stage
de fin d’études, CNEARC, Montpellier.
324
� LEVY Jacques, LUSSAULT Michel (dir.) – 2003, Dictionnaire de la géographie et de
l’espace des sociétés. Belin, Paris.
� LOMBARD Jérôme – 1999, « Quand les transports (dé)lient campagnes et villes ».
In : J-L. Chaléard, A. Dubresson (eds.), Villes et campagnes dans les pays du Sud.
Géographie des relations, pp. 131-149.
� LÓPEZ Ernesto – 1994, « La ley de desarrollo agrario y la modernización ». In: Ecuador
Debate, n°32, pp. 126-151.
� LÓPEZ Fredy – 2003, L’utilisation du sol dans le bassin du lac San Pablo – Imbacocha –
Equateur, Mémoire de DEA, Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
� LÓPEZ María Fernanda – 2001, « La exportación de Eucalipto y su influencia en la
organización espacial de la sierra ecuatoriana ». In: P. Gondard, León J.B. (eds.),
Dinámicas territoriales: Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela, pp. 41-54.
� LYNCK Thierry (éd.) – 1993, Agriculture et paysannerie en Amérique latine. Mutations
et recompositions. ORSTOM, Paris.
� MA MUNG Emmanuel – 2000, La diaspora chinoise, géographie d’une migration.
Ophrys, Paris.
� MARSHALL Anaïs – 2009, S’approprier le désert. Agriculture mondialisée et
dynamiques socio-environnementales sur le piémont côtier péruvien. Le cas des oasis de
Virú et d’Ica-Villacuri. Thèse de doctorat, Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
� MARTINEZ Luciano – 1984, De campesinos a proletarios. El Conejo, Quito.
� MARTINEZ Luciano – 1985, « Migración y cambios en las estrategias familiares de las
comunidades indígenas de la Sierra. In: Ecuador Debate, n°8, pp. 110-152.
� MARTINEZ Luciano – 1994, « Situación actual y perspectivas de la economía
campesina ». In: Ecuador Debate, n°31, pp. 137-152.
� MARTINEZ Luciano (comp.) – 1997, Desarrollo sostenible en el medio rural. FLACSO,
Quito.
� MARTINEZ Luciano, 2000, Economías rurales: actividades no agrícolas. CAAP, Quito.
� MARTINEZ Luciano – 1998, « Comunidades y tierra en el Ecuador ». In: Ecuador
Debate, n°45, pp. 173-198.
325
� MARTINEZ Luciano – 2003, Dinámicas rurales en el subtrópico. CAAP, Quito.
� MARTINEZ Luciano – 2004, « El campesino andino y la globalización a fines de siglo
(una mirada sobre el caso ecuatoriano) ». In: European revew of latin american and
caribbean studies, n°77, pp. 25-40.
� MARTINEZ Luciano – 2006a, « Migración internacional y mercado de trabajo rural en
Ecuador ». In: G. Herrera, M.C. Carillo, A. Torres (eds.), La migración ecuatoriana:
transnacionalismo, redes e identidades, pp. 147-168, FLACSO.
� MARTINEZ Luciano (coord.) – 2006b, « Lo global y lo local en el medio rural ». Iconos,
n°24.
� MARTINEZ Luciano – 2007, « ¿Puede la pobreza rural ser abordada a partir de lo
local? ». In : �conos, n°29, pp. 51-61.
� MARTINEZ Luciano (comp.) – 2008, Territorios en mutación: repensando el desarrollo
desde lo local. FLACSO, Quito.
� MARTINEZ Luciano, NORTH Liisa – 2009, « Vamos dando la vuelta ». Iniciativas
endógenas de desarrollo local en la Sierra ecuatoriana. FLACSO, Quito.
� MARTINEZ BORRERO Juan, EINZMANN Herald – 1993, (coord.), La cultura Popular
en el Ecuador, tomo I – Azuay. CIDAP, Cuenca.
� MARTINI Manuela – 1995, « Un axe migratoire privilégié : Apennin émilien-Val-de-
Marne ». In : A. Bechelloni, M. Dreyfus, P. Milza (dir), L'intégration italienne en France,
pp. 207-218.
� MATHER, Alexander – 1992, « The forest transition ». In: Area, vol. 24, n°4,
pp. 367-379.
� MAZOYER Marcel, ROUDART Laurence – 2002, Histoire des agricultures du monde.
Du néolithique à la crise contemporaine. Seuil, Paris.
� MEIER Peter – 1982, « Artesanía campesina e integración al mercado: algunos ejemplos
de Otavalo ». In : C. Sepulveda, R. Ferrín (eds.), Estructuras agrarias y reproducción
campesina, pp. 121-148.
� MEÑACA Arantza – 2006, « Ecuatorianas que « viajaron ». Las mujeres migrantes en la
familia transnacional ». In : G. Herrera, M.C. Carillo, A. Torres (eds.), La migración
ecuatoriana: transnacionalismo, redes e identidades, pp. 305-334.
326
� MESCLIER Evelyne – 1991, Les paysans face au marché dans des situations
d’instabilité. Etude comparative dans les Andes du Pérou. Atelier national de
reproduction des thèses, Lille.
� MESCLIER Evelyne – 2003, « Les Andes rurales dans la mondialisation, entre crises et
ouvertures ». In : Collectif, Crises et mutations des agricultures de montagne, pp. 105-
120.
� MILES Ann – 2004, From Cuenca to Queens. An Anthropological story of transnational
migration. University o Texas Press, Austin.
� MIRNA Benavides Blanca, ORTIZ Xenia, SILVA Claudia Marina – 2004, « Pueden las
remesas comprar el futuro? Estudio realizado en el cantón San José de la Labor,
Municipio de San Sebastián, El Salvador ». In : Ecuador Debate, n°63, pp.1 53-184.
� MONCADA Martha, CUELLAR Juan Carlos – 2004, El Peso de la deuda externa
ecuatoriana y el impacto de la alternativas de conversión para el desarrollo. Abya Yala,
Quito.
� MONTES DEL CALSTILLO ANGEL (éd.) – 2009, Ecuador contemporaneo: análisis y
alternativas actuales. EDITUM, Murcie.
� MORA Luis – 1926a (dir.), Monografía del Azuay. Burbano Hermanos, Cuenca.
� MORA Luis – 1926b « Diversos datos sobre el cantón Cuenca ». In : L. Mora (ed.),
Monografía del Azuay, pp. 105-125.
� MORLON Pierre (coord.) – 1992, Comprendre l’agriculture paysanne dans les Andes
centrales. Pérou – Bolivie. INRA, Paris.
� MOUSTIER Paule – 2007, « Urban Horticulture in Africa and Asia, an efficient corner
food supplier ». In : Acta Horticulturae, n° 762, pp. 145-148.
� MOUSTIER Paule, THAI Bui Thi, VAGNERON Isabelle – 2004, « Organisation et
efficience des marchés de légumes approvisionnant Hanoi (Vietnam) ». In : Cahiers
Agricultures ; vol. 13, n°1, pp. 142-147.
� MUÑOZ Viviana – 2008, « Rompiendo mitos: un estudio sobre remesas en el Ecuador ».
In : J. Ponce (ed.), Es posible pensar una nueva política social para América Latina », pp.
189-216.
� MURRA John – Formaciones económicas y políticas del mundo andino. IEP, Lima.
327
� NIETO Marisol – 2005, « Las remesas, su influencia en la economía ecuatoriana y el
dilema del desarrollo ». In : J. Ponce Leiva, Emigración y política exterior en Ecuador,
pp. 197-221.
� NOIN Daniel – 1971, La population rurale du Maroc, tomes I et II. PUF, Paris.
� NORTH Liisa, MARTINEZ Luciano (coord.) – 2007, « El mundo rural en los Andes ».
Iconos, n°29.
� NORTH Liisa L., CAMERON John D. (eds.) – 2008, Desarrollo rural y neoliberalismo.
Ecuador desde una perspectiva comparativa. Universidad Andina Simón Bolivar, Quito.
� OBEREM Udo – 1981, « El acceso a recursos naturales de diferentes ecologías en la
sierra ecuatoriana (siglo XVI) ». In : S. Moreno Yanez, U. Oberem (eds.), Contribución a
la etnohistoria ecuatoriana, pp. 45-71.
� OCCHIPINTI Laurie – 2003, « Mujeres como madres, mujeres como agricultoras:
imágenes, discursos y proyectos de desarrollo ». In: Ecuador Debate, n°59, pp. 123-136.
� OJEDA Andrea – 2008, « Concentración azuquera : el caso de la Troncal ». In : F.
Brassel, S. Herrera, M. Laforge (eds.), ¿Reforma agraria en el Ecuador?: viejos temas,
nuevos argumentos, pp. 119-132.
� PALOMEQUE Silvia – 1990, Cuenca en el siglo XIX. La articulación de una región,
Abya Yala / FLACSO, Quito.
� PECQUEUR Bernard – 2005, « Le développement territorial : une nouvelle approche des
processus de développement pour les économies du Sud ». In : B. Antheaume, F. Giraut,
Le territoire est mort. Vive les territoires ! Une (re)fabrication du développement, pp.
295-316.
� PELTRE-WURTZ Jacqueline – 1988, « Le blé en Equateur ou le prix de l’indépendance
alimentaire ». In : Cahiers des Sciences Humaines, vol. 24, n°2, pp. 213-223.
� PELTRE-WURTZ Jacqueline – 2004, Alimentation et pauvreté en Equateur. Manger est
un combat. IRD / Karthala, Paris.
� POINSOT Yves – 1999, « L’incidence géographique des risques agricoles. Une
formulation théorique à partir des cas andins et africains ». In : Revue de Géographie
alpine, n°3, pp. 31-51.
328
� POINSOT Yves, POUILLE Fabien, POUYLLAU Michel – 1997, « Deux modèles
culturels de la ruralité andine, province de Bolívar, Equateur ». In : J-M. Gastellu,
J-Y. Marchal (eds.), La ruralité dans les pays du Sud à la fin du XXe siècle, pp. 471-491.
� POLONI-SIMARD Jacques – 2000, La mosaïque indienne. EHESS, Paris.
� PONCE Javier – 2005, Emigración y política exterior en Ecuador. CEI / FLACSO / Abya
Yala, Quito.
� PONCE Juan (ed.) – 2008, Es posible pensar una nueva política social para América
Latina. FLACSO, Quito.
� PORTAIS Michel – 1990, « La distribución geográfica de la población y su evolución:
1950-1982 ». In: D. Delaunay, J. León, M. Portais, Transición demografica en el
Ecuador, pp. 57-74.
� POZO Santiago – 2010, « El desarrollo economico del Azuay en el período 1940-2010 ».
In : II Encuentro sobre historia de la provincia del Azuay, Université de Cuenca.
� PRIBILSKY Jason – 2007, La chulla vida. Gender, migration and the family in Andean
Ecuador and New York City. Syracuse University Press, Syracuse.
� QUESNEL André – 1997, « Nouvelles dynamiques démographiques en milieu rural. Faits
et approches à partir d’exemples mexicains et africains ». In : C. Blanc-Pamard, J.
Boutrais (coord.), Thèmes et variations. Nouvelles recherches rurales au Sud, pp. 163-
178.
� QUESNEL André, DEL REY Alberto, « Mobilités, absence de longue durée et relations
intergénérationnelles en milieu rural », Cahiers des Amériques latines, n°45, p. 75-90.
� QUEZADA Milton – 1998, « La migración internacional de la población urbana de la
provincia del Azuay ». In: Economía y Política, n°3, pp. 167-189.
� RACINE Jean-Luc, 1994 – Les Attaches de l'homme. Enracinement paysan et logiques
migratoires en Inde du Sud. Editions de la Maison des Sciences de l’Homme / Institut
Français de Pondichéry, Paris.
� RABEMANAMBOLA Maholy, RAKOTOARISOA Jacqueline, RIEUTORT Laurent –
2009, « Entre ville et campagne : les adaptations du maraîchage paysan sur les Hautes
Terres centrales malgaches ». In : Les cahiers de l’Outre-Mer, n°247, pp. 285-310.
329
� RAISON Jean-Pierre, MAGRIN Géraud (dir.) – 2009, Des fleuves entre conflits et
compromis. Essais d’hydropolitique africaine. Karthala, Paris.
� RAMIREZ Franklin, RAMIREZ GALLEGOS Jacques – 2005, La estampida migratoria
ecuatoriana. Crisis, redes transnacionales y repertorios de acción migratoria. Abya Yala,
Quito.
� RECALT Christine – 2009, « Entre partage et exclusion : les politiques de l’eau en
Equateur depuis trente ans – Píllaro (Tungurahua) ». Thèse de doctorat, Université Pierre
Mendès France de Grenoble.
� RECALT Christine – 2011, « La gestion de l’eau en Equateur : la révolution citoyenne ou
la solution indigène ? ». In : Chroniques des Amériques, n°1, Montréal.
� REGNAULT Henri (coord.) – 2008, Agriculturas andinas, TLC y globalización
agroalimentaria. ¿Oportunidades, reconversiones, vulnerabilidades?. CISEPA, Lima.
� REBAI Nasser – 2007, Crise, migration et renouveau dans les Andes équatoriennes,
Mémoire de Master II, Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
� RODAS Hernán – 1985, « La migración campesina en el Azuay ». In: Ecuador Debate,
n°8, pp. 155-193.
� RODAS Sonia, SCHULDT Jürgen – 1992, « Impacto del proceso de ajuste económico
sobre la reproducción social del Ecuador en los años ochenta ». In: Ecuador Debate, n°27,
pp. 49-62.
� RODRIGUEZ Eduardo – 2008, « Competencia desigual. Agroindustria bananera y
pequeños productores : el caso de Barbones ». In : ¿Reforma agraria en el Ecuador?:
viejos temas, nuevos argumentos, pp. 65-76.
� ROUQUIE Alain – 1998, Amérique latine. Introduction à l’Extrême-Occident. Seuil,
Paris.
� RUDEL Thomas – 1998, « Is there a forest transition? Deforestation, reforestation, and
development ». In: Rural Sociology, vol. 63, n°4, pp. 533-552
� RUDEL Thomas, BATES Diane, MACHINGUIASHI Rafael – 2002, « A tropical forest
transition? Agricultural change, Out-migration, and secondary forests in the ecuadorian
amazon ». In: Annals of the Association of American Geographers, n°92, vol. 1,
pp. 87-102.
330
� RUF Thierry – 1996, « Cinq siècles de conflits sur l’eau dans les Andes équatoriennes :
fondations de réseaux et partage de l’eau à Urcuquí ». In : Y. Chatelin, C. Bonneuil (dir.),
Les sciences hors d’Occident au XXe siècle, vol 3. « Nature et environnement », pp. 195-
221, ORSTOM, Paris.
� SAKHO Papa, BEAUCHEMIN Cris – « Circulation internationale et développement local
au Sénégal ». In : A. Quesnel (coord.), Migrations internationales, recompositions
territoriales et développement, pp. 45-57.
� SÁNCHEZ Jeannette – 2004, « Ensayo sobre la economía de la emigración en Ecuador ».
In: Ecuador Debate, n°63, pp. 47-62.
� SANCHEZ PARGA José – 1986, La trama del poder en la comunidad andina. CAAP,
Quito.
� SANDRON Frédéric – 1997, « Déterminants des migrations en zone montagneuse
forestière tunisienne ». In : J-M. Gastellu, J-Y Marchal (eds.), La ruralité dans les pays du
sud à la fin du XXe siècle, pp. 531-551.
� SANJUAN Thierry – 2011, « Les nouvelles relations ville-campagne en Chine
aujourd’hui ». In : Dynamiques des espaces ruraux dans le monde, pp. 217-228.
� SANTANA Roberto – 2005, « Los actores de la construcción territorial, desarrollo y
sustentabilidad ». In: Ecuador Debate, n°65, pp. 67-82.
� SIMON Anthony – 2002, La pluriactivité dans l’agriculture des montagnes françaises :
un territoire, des hommes, une pratiques. PUBP, Clermont-Ferrand.
� SIMON Gildas – 1979, L’espace des travailleurs tunisiens en France. Structures et
fonctionnement d’un champ migratoire international. Martineau, Poitiers.
� SIMON Gildas – 2008, La planète migratoire dans la mondialisation. Armand Colin,
Paris.
� TALLET Bernard – 1999, « Le maraîchage à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) : un
dynamisme agricole sous influence urbaine ». In : J-L. Chaléard, A ; Dubresson (eds.),
Villes et campagnes dans les pays du sud : une géographie des relations, pp. 47-59.
� TCHAYANOV Alexandre – 1990 [1925 pour l’édition russe], L’organisation de
l’économie paysanne. Librairie du Regard, Paris.
331
� THEODAT Jean-Marie – 2007, « Entretien avec Paul Pélissier ». In: Echogéo, n°1,
http://echogeo.revues.org/1660.
� TORRES Alicia – 2006, « De Punyaro a Sabadell… la emigración de los kichwa Otavalo
a Cataluña ». In: G. Herrera, M.C. Carillo, A. Torres (eds.), La migración ecuatoriana:
transnacionalismo, redes e identidades, pp. 433-448.
� TORRES Alicia, CARRASCO Jesús – 2008, Al filo de la identidad. Migración indígena
en América Latina. FLACSO, Quito.
� TULET Jean-Christian – 2003, « Les opportunités des montagnes tropicales latino-
américaines ». In : Collectif, Crises et mutations des agricultures de montagne, pp. 175-
192.
� TULET Jean-Christian, BARCET Hugues – 2006, L’Atlas élémentaire du monde rural
latino-américain. PUM, Toulouse.
� TULET Jean-Christian – 2009, « Montagnes tropicales et transformation des systèmes
agropastoraux ». In : Cahiers d’Outre Mer, n°247, vol. 62.
� UNDA Mario – 1986, « La migración temporal de obreros de la construcción a Quito ».
In: Ecuador Debate, n°11, pp. 143-154.
� VAILLANT Michel – 2008, « Más allá del campo: migración internacional y
metamorfosis campesinas en la era globalizada. Reflexiones desde el caso rural de Hatun
Cañar (Andes ecuatorianos)». In: L. Martínez (comp.), Territorios en mutación:
repensando el desarrollo desde lo local, pp. 229-252.
� VAILLANT Michel, CEPEDA Darío, GONDARD Pierre, ZAPATTA Alex, MEUNIER
Alexis (eds.) – 2007, Mosaico agrario. Diversidades y antagonismos socio-económicos en
el campo ecuatoriano. SIPAE, Quito.
� VÁZQUEZ Paciente – 1995, Campesinos del Azuay. Economía, sociedad y cultura. IDIS,
Cuenca.
� VELASCO Juan – 1985, « La migraciones internas en el Ecuador: una aproximación
geográfica ». In: Ecuador Debate, n°8, pp. 33-58.
� WAGNER Heike – 2004, « Migrantes ecuatorianas en Madrid : reconstruyendo
identidades de género ». In: Ecuador Debate, n°63, pp. 89-102.
332
� WIENER Charles – 1884, « Amazone et Cordillères ». In : Le Tour du monde, n°48, pp.
337-416.
� WILLIAMSON John – 1990, Latin American adjustment: how much has happened?.
Peterson Institute for International Economics, Washington.
� WILLOT Mélise – 2004, Diagnostic agraire de la paroisse d’Octavio Cordero Palacios,
Mémoire de stage de fin d’études, CNEARC, Montpellier.
� YURGEVIC Andres – 1997, « Agroécología y desarrollo rural sutentable ». In: L.
Martinez (ed.), El desarrollo sustentable en el medio rural, pp. 13-30.
� ZAPATTA Alex, RUIZ Patricio, BRASSEL Frank – 2008, « La estructura agraria en el
Ecuador: una aproximación a su problemática y tendencias ». In: F. Brassel, S. Herrera,
M. Laforge (eds.), ¿Reforma agraria en el Ecuador?: viejos temas, nuevos argumentos,
pp. 17-30.
�������������������������� ��!"���
� FAO – 2008, L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde, Rome.
� FLACSO – 2008, Ecuador : la migración en cifras, FLACSO / UNFPA, Quito.
� IRD – 2009, Migrations internationales, recompositions territoriales et développement,
document de synthèse des projets [Programme FSP 2003-74]. IRD / MAE, Paris.
� MAC ALEESE Juliette – 2007, Alimentación, nutrición y salud. Conclusiones del estudio
realizado con los productores agroecológicos, Progressio, Cuenca.
� OIM – 2008, Perfil migratorio del Ecuador, Genève.
� OIM – 2010, Etat de la migration dans le monde, Genève.
#�������$����
� ANH/SA – Archivo Nacional de Historia, Sección Azuay – 1875
� CEPAL – 1990/2010, Anuario estadístico de América latina y el Caribe.
333
� INEC – 1950, I Censo de Pobalción.
� INEC – 1954, I Censo Agrario.
� INEC – 1962, II Censo de Pobalción.
� INEC – 1974, III Censo de Pobalción.
� INEC – 1982, IV Censo de Pobalción.
� INEC – 1993/2008 – Encuensta de superficie y producción agropecuaria por muestreo de
areas.
� INEC – 1990, V Censo de Pobalción.
� INEC – 1994, Ecuador: migraciones interprovinciales absolutas acumuladas hasta los
años 1974, 1982 y 1990.
� INEC – 2000, III Censo Agrario.
� INEC – 2001, VI Censo de Pobalción.
� INEC – 2006, Encuesta de condiciones de vida (Noviembre de 2005 – Octubre de 2006).
� INEC – 2006, Pobreza y extrema pobreza en el Ecuador (Noviembre de 2005 – Octubre
de 2006).
� INEC – 2009, Indice de precios al consumidor en la ciudad de Cuenca (septiembre de
2004 – Enero de 2009). [Enquête non publiée. Information disponible sur demande au
bureau de l’INEC à Cuenca].
� INEC – 2010, VII Censo de Pobalción.
� INEC – 2012, Canasta familiar básica nacional y por ciudades[mes de Julio].
� INHAMI – Series Mensuales de datos meteorológicos – estación ‘Ricaurte-Cuenca’.
[Information disponible sur demande au bureau de l’INHAMI à Quito].
%�&�����!���
� IERSE – 2003, Registro de la información cartográfica de la cuenca del Paute,
http://www.uazuay.edu.ec/geomatica/source/web/links/metadatos.html
� USCB – http://www.census.gov/
334
������������ ��������������� ������
�������
Carte n°1 – Divisions provinciales de l’Equateur .................................................................... 27
Carte n°2 – Localisation de la paroisse Octavio Cordero Palacios à l’échelle provinciale ..... 29
Carte n°3 – Les divisions territoriales dans la paroisse Octavio Cordero Palacios.................. 30
Carte n°4 – La structure foncière et les productions agricoles dans la région de Cuenca au
XVIIIe siècle............................................................................................................................. 48
Carte n°5 – L’espace agraire dans la paroisse de Santa Rosa vers 1860 ................................. 52
Carte n°6 – L’espace agraire dans la paroisse Octavio Cordero Palacios vers 1950 ............... 58
Carte n°7 – L’espace agraire dans la paroisse Octavio Cordero Palacios vers 1980 ............... 64
Carte n°8 – Les foires dans la paroisse Octavio Cordero Palacios vers 1960.......................... 70
Carte n°9 – L’organisation de la filière Panamá jusqu’en 1950.............................................. 72
Carte n°10 – Les migrations interrégionales de 18 paysans de la paroisse Octavio Cordero
Palacios entre 1950 et 2008...................................................................................................... 77
Cartes n°11/12 – Evolution des principales formes d’usage du sol dans la paroisse Octavio
Cordero Palacios entre 1991 et 2001...................................................................................... 118
Carte n°13 – Localisation des marchés et des foires à Cuenca .............................................. 151
Carte n°14 – Le territoire de San Luis depuis 2004 ............................................................... 240
Carte n°15 – Localisation des principales sources d’eau sur le territoire de San Luis .......... 243
�����������
Graphique n°1 – Répartition des membres des 38 familles paysannes étudiées, en fonction de
leur occupation et de leur localisation.................................................................................... 104
Graphique n°2 – Moyenne des précipitations mensuelles à la station « Ricaurte – Cuenca »
entre 2007 et 2009 .................................................................................................................. 107
335
Graphique n°3 – Répartition des membres des 5 familles du groupe Bajo Invernadero, en
fonction de leur occupation et de leur localisation................................................................. 160
Graphique n°4 – Evolution mensuelle des ventes des 5 producteurs du groupe Bajo
Invernadero sur le marché 12 de Abril et à la foire du CREA entre septembre 2008 et mai
2009........................................................................................................................................ 163
Graphique n°5 – Evolution mensuelle des ventes de Félix sur le marché 12 de Abril et à la
foire du CREA entre septembre 2008 et mai 2009 ................................................................ 168
Graphique n°6 – Evolution mensuelle des ventes de María sur le marché 12 de Abril et à la
foire du CREA entre septembre 2008 et mai 2009 ................................................................ 173
Graphique n°7 – Evolution mensuelle des ventes de Daniel sur le marché 12 de Abril et à la
foire du CREA entre septembre 2008 et mai 2009 ................................................................ 178
Graphique n°8 – Evolution mensuelle des ventes de Manuel sur le marché 12 de Abril et à la
foire du CREA entre septembre 2008 et mai 2009 ................................................................ 182
Graphique n°9 – Evolution mensuelle des ventes de Natividad sur le marché 12 de Abril et à
la foire du CREA entre septembre 2008 et mai 2009............................................................. 185
Graphiques n°10/14 – Répartition moyenne des revenus bruts dans les exploitations du groupe
de producteurs Bajo Invernadero entre septembre 2008 et mai 2009.................................... 208
Graphique n°15/16 – Répartition moyenne des ventes chez Salvador et Juan en 2009......... 210
�
��������
Gravure n°1 – L’entrée à Cuenca ............................................................................................ 68
�
�
���������������
Pohotographie n°1 – Une ancienne maison paysanne dans le secteur d’Adobepamba ........... 51
Pohotographies n°2/3 – Le paysan et l’araire........................................................................... 55
Pohotographies n°4/9 – Les héritages du passé : paysage agraire et dispersion de l’habitat
dans les différents secteurs de la paroisse Octavio Cordero Palacios ...................................... 59
Pohotographies n°10/11 – Les vestiges de la Tejería............................................................... 61
Pohotographie n°12 – La confection des Panamás au sein même des exploitations
agricoles….. ............................................................................................................................. 71
336
Pohotographie n°13 – D’ici et d’ailleurs : la communauté équatorienne de New York en
2011…...................................................................................................................................... 91
Pohotographie n°14 – Des champs abandonnés ? .................................................................. 103
Pohotographie n°15 – Les petites superficies des cultures de cycles longs ........................... 105
Pohotographie n°16 – Des plats régionaux en voie de disparition ?...................................... 106
Pohotographie n°17 – Des bovins dans la paroisse Octavio Cordero Palacios...................... 112
Pohotographie n°18 – L’alimentation de l’élevage bovin...................................................... 113
Pohotographies n°19/20 – Le lait sous toutes ses formes ...................................................... 114
Pohotographies n°21/22 – Le cobaye : un animal d’élevage important................................. 116
Pohotographie n°23 – Santa Rosa – Cuenca – Santa Rosa .................................................... 129
Pohotographie n°24 – Un potager dans la paroisse Octavio Cordero Palacios...................... 131
Pohotographies n°25/28 – Des cultures fruitièes dans la paroisse Octavio Cordero
Palacios……........................................................................................................................... 133
Pohotographies n°29/30 – La production de babacos dans la paroisse Octavio Cordero
Palacios................................................................................................................................... 134
Pohotographie n°31 – La promotion des cultures fruitières dans la paroisse Octavio Cordero
Palacios................................................................................................................................... 137
Pohotographies n°32/33 – Le paysage agraire dans la paroisse Ocatvio Cordero Palacios en
2009........................................................................................................................................ 139
Pohotographie n°34 – Une assemblée des Producteurs Agroécologiques de l’Azuay en
2009….................................................................................................................................... 141
Pohotographies n°35/38 – Le réaménagement récent du marché 9 de Octubre .................... 144
Pohotographies n°39/44 – La visibilité des producteurs agroécologiques sur les marchés
cuencanais en 2009................................................................................................................. 146
Pohotographie n°45 – Des producteurs agroécologiques de l’Azuay en 2009 ...................... 147
Pohotographie n°46 – La foire agroécologique du CREA en 2009 ....................................... 148
Pohotographie n°47 – Les producteurs du groupe Bajo Invernadero à la foire du CREA en
2009........................................................................................................................................ 161
Pohotographie n°48 – L’exploitation de Félix (1) ................................................................. 165
Pohotographie n°49 – L’exploitation de Félix (2) ................................................................. 166
Pohotographie n°50 – L’exploitation de María (1) ................................................................ 170
Pohotographie n°51 – L’exploitation de María (2) ................................................................ 171
Pohotographie n°52 – L’exploitation de Daniel (1) ............................................................... 175
Pohotographie n°53 – L’exploitation de Daniel (2) ............................................................... 176
337
Pohotographie n°54 – L’exploitation de Manuel ................................................................... 180
Pohotographie n°55 – L’exploitation de Natividad................................................................ 184
Pohotographie n°56 – Des ouvriers dans l’attente d’un travail.............................................. 189
Pohotographie n°57 – L’exploitation de Salvador (1) ........................................................... 194
Pohotographie n°58 – L’exploitation de Salvador (2) ........................................................... 195
Pohotographie n°59 – Salvador sur la foire du CREA........................................................... 196
Pohotographie n°60 – L’exploitation de Juan (1) .................................................................. 201
Pohotographie n°61 – L ’exploitation de Juan (2) ................................................................. 202
Pohotographies n°62/63 – Des bois aux paturâges : changement dans l’usage du sol à
Illapamba................................................................................................................................ 215
Pohotographie n°64 – Un repas à Illapamba.......................................................................... 218
Pohotographie n°65 – Les derniers espaces cultivés à Illapamba.......................................... 219
Pohotographie n°66 – L’exploitation de Vicente................................................................... 225
Pohotographie n°67 – Elisa à la foire de Miraflores .............................................................. 226
Pohotographie n°68 – Des risques d’érosion sur le territoire de San Luis............................. 245
Pohotographie n°69 – A chacun son eau................................................................................ 246
Pohotographies n°70/73 – Une association de producteurs en voie de modernisation.......... 249
Pohotographie n°74 – L’exploitation de Luis ........................................................................ 252
Pohotographie n°75 – Une parcelle cultivée par les producteurs de La Dolorosa................. 254
Pohotographie n°76 – L’heure de la pampamesa................................................................... 255
�
�
��� !���
Schéma n°1 – Verticalité des systèmes de production a Santa Rosa au XIXe siècle ............... 53
Schéma n°2 – Parcours migratoire, investissements fonciers et agricoles de Salvador entre
1970 et 2009 ........................................................................................................................... 193
Schéma n°3 – Parcours migratoire, investissements fonciers et agricoles de Juan entre 1970 et
2009........................................................................................................................................ 200
338
��"#���$��
Tableau n°1 – Parcours migratoires internationaux de 18 paysans de la paroisse Octavio
Cordero Palacios entre 1965 et 2005 ....................................................................................... 92
Tableau n°2 – Evolution de la population de la paroisse Octavio Cordero Palacios entre 1962
et 2010 ...................................................................................................................................... 93
Tableau n°3 – Evolution des effectifs féminins et masculins par classes d’âge dans la paroisse
Octavio Cordero Palacios entre 1974 et 2010.......................................................................... 95
Tableau n°4 – Parcours migratoires nationaux et internationaux de 7 paysans de la paroisse
Octavio Cordero Palacios entre 1957 et 2005 ......................................................................... 97
Tableau n°5 – Les achats de terre de 7 exploitants de la paroisse Octavio Cordero Palacios
entre 1972 et 2005 ................................................................................................................. 101
Tableau n°6 – Coût de production d’un solar de maïs-fève-haricot dans la paroisse Octavio
Cordero Palacios en 2008....................................................................................................... 108
Tableau n°7 – Evolution des superficies (en hectares) des principales formes d’usage du sol
dans la paroisse Octavio Cordero Palacios entre 1991 et 2001 ............................................. 118
Tableau n°8 – Evolution des superficies (en milliers d’hectares) des principales formes
d’usage du sol dans la province de l’Azuay entre 2003 et 2008 ............................................ 120
Tableau n°9 – Evolution des superficies (en milliers d’hectares) des principales formes
d’usage du sol dans les Andes équatoriennes entre 2003 et 2008.......................................... 121
Tableau n°10 – Evolution des productions de maïs, d’orge et de blé (en milliers de tonnes)
dans les Andes équatoriennes entre 1993 et 2008.................................................................. 122
Tableau n°11– Evolution de la population de la ville de Cuenca entre 1974 et 2010 ........... 128
Tableau n°12– Cycles de production moyens des principales cultures maraîchères présentes
dans la paroisse Octavio Cordero Palacios ............................................................................ 130
Tableau n°13 – Cycles de production et rendements moyens des principales cultures fruitières
annuelles présentes dans la paroisse Octavio Cordero Palacios............................................. 135
Tableau n°14 – Rentabilité potentielle des principales cultures fruitières annuelles présentes
dans la paroisse Octavio Cordero Palacios ............................................................................ 136
Tableau n°15 – Comparaison des prix moyens de huit produits de consommation courante
pratiqués sur trois marchés du centre villle de Cuenca et à la foire du CREA entre septembre
2008 et janvier 2009............................................................................................................... 149
339
Tableau n°16 – Répartition des ventes globales (en dollars) du groupe de producteurs Bajo
Invernadero en fonction des jours de marché entre septembre 2008 et mai 2009................. 162
Tableau n°17 – Ventes mensuelles (en dollars) des cinq producteurs du groupe Bajo
Invernadero entre septembre 2008 et mai 2009..................................................................... 162
Tableau n°18 – Détail des ventes mensuelles (en dollars) de Félix sur le marché 12 de Abril et
à la foire du CREA entre septembre 2008 et mai 2009.......................................................... 167
Tableau n°19 – Bilan économique mensuel moyen (en dollars) de l’exploitation agricole de
Félix entre septembre 2008 et mai 2009 ................................................................................ 169
Tableau n°20 – Détail des ventes mensuelles (en dollars) de María sur le marché 12 de Abril
et à la foire du CREA entre septembre 2008 et mai 2009...................................................... 172
Tableau n°21 – Bilan économique mensuel moyen (en dollars) de l’exploitation agricole de
María entre septembre 2008 et mai 2009 ............................................................................... 174
Tableau n°22 – Détail des ventes mensuelles (en dollars) de Daniel sur le marché 12 de Abril
et à la foire du CREA entre septembre 2008 et mai 2009...................................................... 177
Tableau n°23 – Bilan économique mensuel moyen (en dollars) de l’exploitation agricole de
Daniel entre septembre 2008 et mai 2009.............................................................................. 179
Tableau n°24 – Détail des ventes mensuelles (en dollars) de Manuel sur le marché 12 de Abril
et à la foire du CREA entre septembre 2008 et mai 2009...................................................... 181
Tableau n°25 – Bilan économique mensuel moyen (en dollars) de l’exploitation agricole de
Manuel entre septembre 2008 et mai 2009 ............................................................................ 183
Tableau n°26 – Détail des ventes mensuelles (en dollars) de Natividad sur le marché 12 de
Abril et à la foire du CREA entre septembre 2008 et mai 2009............................................. 185
Tableau n°27 – Bilan économique mensuel moyen (en dollars) de l’exploitation agricole de
Natividad entre septembre 2008 et mai 2009......................................................................... 186
Tableau n°28 – Bilan économique mensuel moyen (en dollars) de l’exploitation agricole de
Salvador en 2009.................................................................................................................... 198
Tableau n°29 – Bilan économique mensuel moyen (en dollars) de l’exploitation agricole de
Juan en 2009........................................................................................................................... 204
Tableau n°30 – Evolution des superficies (en hectares) des principales formes d’usage du sol
dans la comuna Illapamba entre 1991 et 2001 ....................................................................... 213
Tableau n°31 – Bilan économique de la comuna Illapamba entre janvier 2008 et mars
2009….. .................................................................................................................................. 214
Tableau n°32 – Moyenne des revenus bruts et des dépenses mensuels (en dollars)
d’Ermelinda et de sa fille en 2008.......................................................................................... 222
340
Tableau n°33 – Moyenne des revenus bruts et des dépenses mensuels (en dollars) de Julia et
sa famille en 2008 .................................................................................................................. 224
Tableau n°34 – Moyenne des revenus bruts et des dépenses mensuels (en dollars) de Vicente
et sa famille en 2008............................................................................................................... 227
Tableau n°35 – Typologie des familles membres de la comuna Illapamba en 2008 ............. 229
Tableau n°36 – Evolution des superficies (en hectares) des principales formes d’usage du sol
dans la comuna San Luis entre 1991 et 2001 ......................................................................... 235
Tableau n°37 – Partage des sources d’eau provenant des páramos de San Luis ................... 242
Tableau n°38 – Bilan économique mensuel moyen (en dollars) de l’exploitation de Luis en
2009........................................................................................................................................ 253
342
�������������
� ���������������������������������������������� �!������������������� � ����� �� ���" ���� �
������������������
Une analyse de la redéfinition des stratégies paysannes et des dynamiques territoriales dans le contexte migratoire des Andes équatoriennes
L’émigration paysanne est à l’heure actuelle l’une des dynamiques les plus importantes à l’origine des recompositions territoriales dans les Andes rurales d’Equateur. Dans la paroisse Octavio Cordero Palacios, située à proximité de la ville de Cuenca, la diminution de la main-d’œuvre au cours des trois dernières décennies a entraîné une profonde transformation des usages du sols, en témoignent le développement de l’élevage laitier et du maraîchage, deux symboles de l’adaptation des unités de production familiales au contexte migratoire et à la croissance urbaine. Dans ces conditions, les économies domestiques changent, sous le double effet des transferts monétaires depuis l’étranger et de l’intégration marchande, mais pour une partie des familles paysannes seulement, car beaucoup d’entre elles demeurent encore dépendantes de salaires locaux pour leur subsistance. Ainsi, cette thèse propose d’étudier la variété des stratégies paysannes dans l’une des localités de la sierra équatorienne où l’émigration internationale est la plus ancienne. Pour cela, elle s’intéresse principalement aux facteurs de différenciation des économies domestiques et soulève en parallèle la question du pouvoir en milieu rural, en décrivant le rôle des anciens migrants dans la dynamique territoriale locale.
Mots-clés : Equateur – Andes – migration – paysannerie – agriculture vivrière – agriculture commerciale – maraîchage – élevage laitier – approvisionnement urbain – réseaux de producteurs – relations ville-campagne – dynamiques territoriales.
��������������������
Un análisis de la redefinición de las estrategias campesinas y de las dinámicas territoriales en el contexto migratorio de los Andes ecuatorianos
La migración campesina es actualmente una de las dinámicas más importantes al principio de las recomposiciones territoriales en los Andes rurales del Ecuador. En la parroquia Octavio Cordero Palacios, ubicada a proximidad de la ciudad de Cuenca, la disminución de la mano de obra durante las tres últimas décadas ha provocado transformaciones profundes del uso del suelo, como lo indican el desarrollo de la ganadería lechera y de horticultura, dos símbolos de la adaptación de las unidades de producción familiar al contexto migratorio. En estas condiciones, las economías domesticas cambian, bajo el doble efecto de las remesas y de la integración comercial, para una parte de las familias únicamente porque muchas de ellas se quedan dependientes todavía de los salarios locales para su subsistencia. Así, esta tesis se propone estudiar la variedad de las estrategias campesinas en una de las localidades de la sierra ecuatoriana en donde la migración internacional es la más antigua. Para eso, se interesa principalmente a los factores de diferenciación de las economías domesticas y plantea la cuestión del poder en el medio rural, describiendo el rol de los migrantes más antiguos en la dinámica territorial local.
Mots-clés : Ecuador – Andes – migración – campesinado – agricultura de subsistancia – agricultura comercial – horticultura – ganadería lechera – aprovisionamiento urbano – redes de productores – relaciones campo-ciudad – dinámicas territoriales.
������� ������������
An analysis of the redefinition of farmers' strategies and territorial dynamics in the migratory context of the Ecuadorian Andes
Today Farmers’ emigration is one of the most significant dynamics leading to territorial rearrangements in the rural Ecuadorian Andes. In the parish of Octavio Cordero Palacios, located close to Cuenca, the decrease in labour over the past thirty years has led to a profound transformation of land use, as evidenced by the development of dairy and vegetable farming, that both symbolize the way family production units adapted to the migratory context and to the urban growth. In these circumstances, household economics are changing, due to remittances and to their commercial integration. Yet, a narrow subset of these families is involved in these mutations, since most of them still depend on local incomes to subsist. This study will thus examine the various sorts of farming strategies in one of the villages of the Ecuadorian Sierra, from which the oldest wave of migrants originated. To achieve this, this study will mainly concentrate on the differentiating factors of household economics and will question the power issue in local areas, by describing the role played by the oldest migrants in the local territorial dynamic.
Keywords: Ecuador – Andes – migration – farming – subsistence farming – vegetable farming – dairy farming – urban supply – producers’ networks - city/country relationship – territorial dynamics.