Le chagrin des anciens Belges. Déviance de la référence héroïque dans les antiquités nationales
Militaires, ‘prévôts’ et policiers : les multiples tâches des gendarmes belges autour de la...
Transcript of Militaires, ‘prévôts’ et policiers : les multiples tâches des gendarmes belges autour de la...
Gestion des crises extérieuresles nouveaux théâtres d'opération comportent des contextescritiques : états faillis, transitions démocratiques difficiles ensortie de guerres civiles, etc. asymétriques, transfrontaliers, ilsmêlent des phases opérationnelles classiques à des opérationshumanitaires et civilo-militaires. les forces de police à statutmilitaire semblent, en partenariat étroit avec les forces arméesengagées et les autorités locales, être un moyen pertinent pourrestaurer l'ordre public et des conditions de vie acceptablespour les populations. l'exploration de leur mise en œuvre dansle cadre de mandats internationaux, de leur expressionlogistique et juridique éclaire une facette des conflitsmodernes.
LES GENDARMES DANS LA GRANDE GUERRE
RE
VU
E D
E L
A G
EN
DA
RM
ER
IE N
ATI
ON
ALE PORTRAIT > CNE Fontan,
héros malgré lui ?
N°
252
/ 1er
TRIM
ES
TRE
201
5
THÈME DU PROCHAIN DOSSIER
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
MUSÉE > La Grande Guerreau musée de la gendarmerie
INTERNATIONAL >Carabiniers 1915-1918
REVUEde la gendarmerie nationalerEvuE triMEstriEllE / Mars 2015 / n° 252 / prix 6 Euros
LE COMBAT DE LA ROUGEMARE
GENDARMES ET COMBATTANTS DU CIEL
GÉOPOLITIQUE DE LA GENDARMERIE AU LEVANT
Les gendarmes dans la grande guerre
avEc la collaboration du cEntrE dE rEcHErcHE dE l'écolE dEs oFFiciErs dE la GEndarMEriE nationalE
Edition spécialE réaliséE sous la dirEction dE louis n. panEl
COUV N°252.qxp_Mise en page 1 Copier 12 09/04/2015 11:08 Page1
retour sur images numéro 252
RETROUVEZ DESPORTRAITS
D’EXCEPTIONEN PAGE 140 DE
CE NUMERO
L’obligation de la conception d’une géostratégie, une judiciarisation dans le contexte d’uneguerre économique et de la protection des valeurs fondamentales attachées à la personnehumaine, donnent une nouvelle expression à l’univers cyber qui dépasse de simples contingencestechniques. Pour faire face à ses dérives, une cyberpolice européenne s’organise pour neutraliserune cyberdélinquance évolutive.
>>
© s
pec
tral
des
ign
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:00 Page1
AVANT-PROPOS
numéro 252
3
« Il faut être toujours prêt à faire la guerre, pour n'être jamais réduit aumalheur de la faire. » Fénelon, Les aventures de Télémaque.
Le conflit de 1914 devait être rapide et localisé selon la typologie desconflits précédents. Ce fut un engagement mondial où les nations ontmobilisé toutes leurs ressources humaines et matérielles. Le rôle de lagendarmerie fut à la mesure de l’ampleur du choc. Elle y participa, tant parses combattants volontaires que dans le cadre des prévôtés ou àl’intérieur, en maintenant le maillage territorial. Cette forme d’engagement,à contrario de celle des carabiniers italiens employés en unités constituéesen première ligne, provoquera un déficit de reconnaissance. Pourtant, qued’actes difficiles, parfois héroïques, furent accomplis par des gendarmes,tant au sein d’unités combattantes qu’à l’occasion de l’exécution demissions indispensables : la police de la circulation, le renseignement, larépression des crimes et délits, la traque des espions, le service des états-majors, etc.
Les auteurs des textes qui vous sont proposés permettent de rétablir lageste et l’engagement quotidien des gendarmes de carrière, auxiliaires etréservistes trop longtemps méconnus. Nous vous proposons égalementdeux beaux textes sur les carabiniers italiens et la gendarmerie belge. Ilsmontrent la généralisation des problématiques qu’ont rencontrées cesforces militaires exerçant des missions de police : hiérarchie nébuleuse,prolifération des missions, hostilité des troupes, gestion primordiale desflux logistiques, philosophie spécifique à la réappropriation des territoireset des populations.
1ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:00 Page3
SOMMAIRE
numéro 252
4
DOSSIER Grande guerre de 1914-1918 et gendarmerie nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
PORTRAITCapitaine Fortan, héros malgré lui ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145par Vincent ossadzow
Joseph Plique, premier directeur de la gendarmerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155par Xavier Borda
blOC NOTES
PRESENTATIONl’histoire de la gendarmerie, nouveau chapitre de l’histoire militaire . . . . .6par Jean-noël Luc
la Grande Guerre de la Gendarmerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14par Louis n. Panel
MUSÉEla Grande Guerre au musée de la gendarmerie nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34par élinor Boularand
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
INTERNATIONAlles carabiniers italiens dans la Grande Guerre :Arme combattante et force de l’ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43par Flavio Carbone
Militaires, « prévôts » et policiers : les multiples tâches desgendarmes belges autour de la Grande Guerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53par Jonas Campion
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:00 Page4
5
Prévôté et lutte contre l’alcoolismedans le Groupe d’armées du Nordpendant la Grande Guerre 105
par marie-Laure Fery
la gendarmerie coloniale durant lapremière guerre mondiale 111
par Benoït Haberbusch
Géopolitique de la gendarmerie aulevant (1918-1920) 119
par Hélène de Champchesnel
la reconstitution de la gendarmerie enAlsace et lorraine à la fin de lapremière guerre mondiale 127
par Georges Philippot
GrANDe GUerre De 1914-1918et gendarmerie nationale
DossIerDossIer
1er trimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
le combat de la Rougemare 63par Jean-Paul Lefebvre-Filleau
la garde pendant la guerre, le départdes volontaires 73
par Pierre Bourmeaux
l’organisation du renseignement dansla gendarmerie en 1914 79
par mélanie Peslerbe
la police de la circulation et lesrelations entre gendarmes et soldats
85par olivier Buchbinder
Des « soldats-citoyens » dans lagendarmerie de la Grande Guerre : lespremiers gendarmes auxiliaires 91
par Louis n. Panel
Gendarmes et combattants du ciel 99par Salomé Krakowski
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:00 Page5
Héritière de la maréchaussée, la gendarmerie conserve une empreintemilitaire façonnée depuis plus de deux siècles qui règle son organisation,sa gouvernance et sa mémoire.
Interface entre l’état, les armées et la population, elle décline une iden-tité spécifique ancrée dans la légalité républicaine, le service public et unecapacité de projection tant sur les théâtres d'opération intérieurs qu'exté-rieurs. Elle dégage un modèle de militarité dont ce numéro permet d'explo-rer une facette à l'occasion du premier conflit mondial.
PRESENTATION
6 Revue de la Gendarmerie Nationale 4e trimestre 2014
UNE DEClINAISON DE lA MIlITARITÉVOUÉE AU SERVICE DE lA NATION
mus
ée d
e la
gen
dar
mer
ie n
atio
nale
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:00 Page6
l’histoire de la gendarmerie, nouveau chapitre de l’histoire militaire
La position particulière du gendarme,ce soldat réglementairement noncombattant, a entretenu l’indifférencedes chercheurs à son égard. Tropmilitaire pour les historiens de lasociété, il ne l’était pas assez pourceux de l’armée. Parue en 1992, lacélèbre Histoire militaire de la Francelui consacre, au mieux, deux à troislignes, en négligeant même les
prévôtés(1) !D’autresrecherches,novatrices, sur les
entrées en guerre, les sorties de guerreou les occupations ne sont guère plus
curieuses. Etpourtant, comme lemontrent lesétudesrassemblées ici, lesgendarmes ontassumé desmissions militairesdiversifiées au
(1) André Corvisier (dir.),Histoire militaire de laFrance, tome III, De 1871 à1940, sous la dir. de GuyPedroncini, Paris, PuF,1992, 518 p.
Lcours de la GrandeGuerre. D’autreschantiers récents(2)
prouvent quel’histoire del’héritière de lamaréchausséeenrichit celle dumonde militaire, dela défense et des
relations entre les forces armées et lasociété.
Les premiers textes organiques de lagendarmerie sont sans ambiguïté sur sonstatut. La loi de 1791 rappelle qu’elle« continuera de faire partie de l’armée »(titre III-2). L’ordonnance de 1820 la définitcomme « l’une des parties intégrantes del’armée » (article 2). Le décret de 1854décrit en détail ses missions militaires,dont celle de police prévôtale, et luireconnaît la possibilité de créer des unitéscombattantes (article 536). Laréglementation est en retard sur les faits,
(2) Les travaux réalisés à laSorbonne et ailleurs sontrecensés dans édouardEbel, ronan L’Héréec, Jean-noël Luc, Bibliographie del’histoire de la gendarmerie,Vincennes, SHD, 2011 (enligne). La thèse deLouis n. Panel (La GrandeGuerre des gendarmes.« Forcer au besoin leurobéissance », Paris, DmPA-nmE, 2013) est le premierdoctorat consacré auxmissions militaires desgendarmes pendant unconflit.
par Jean-Noël luc
PRESENTATION
71ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
JeAN-Noël lUcProfesseur à l’universitéParis-Sorbonne
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page7
car, quelques mois après sonorganisation, en 1791, la gendarmerieenvoie des troupes sur les champs debataille.
Gendarmes au combat, deHondschoote à la Guerre d’AlgérieLes divisions combattantes degendarmerie formées à partir de 1791 sefont remarquer à la bataille deHondschoote, en 1793. Sous l’Empire, lagendarmerie d’Espagne s’illustre, en1812, à la victoire de Villodrigo. Enapplication du décret de 1854, deuxbataillons de gendarmerie à piedparticipent à la Guerre de Crimée, etd’autres régiments à celle de 1870-1871.Au XXe siècle, des gendarmes combattent
PRÉSENTATION
L’HISToIrE DE LA GEnDArmErIE, nouVEAu CHAPITrE DE L’HISToIrE mILITAIrE
8
Le combat de Villodrigo (1812) représenté par lechef d'escadron Bucquoy, en 1937.
© m
usée
de
la G
end
arm
erie
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
au sein d’unités préexistantes (garderépublicaine mobile en 1939-1940 etGarde pendant la campagne de Tunisieen 1942-1943) ou de troupes créées pourl’occasion (45e bataillon de chars légersen 1939-1940, groupements Daucourt etThiolet en 1944-1945, légions de garderépublicaine de marche en Indochine,commandos de chasse en Algérie). Auxmembres de ces unités, il faut ajouter lesgendarmes, territoriaux, mobiles,prévôtaux, conduits à combattre dansd’autres cadres au cours des campagnescoloniales, des trois guerres franco-allemandes et des conflits de ladécolonisation.
Les faits d’arme occupent une placeprivilégiée dans la mémoire officielle ducorps, dont les drapeaux affichent desnoms de victoires. mais la légitimité dusouvenir ne doit pas masquer le caractèreanecdotique de la plupart des textespubliés, à ce sujet, dans la pressecorporative. Plusieurs pistes méritentpourtant de retenir l’attention : lesfonctions spécifiques de certaines unités,les interrelations entre les gendarmes etles autres troupes, le poids del’expérience combattante dans lesparcours individuels, les comportementsprofessionnels et les réseauxgénérationnels, l’exaltation de sa filiationguerrière par la gendarmerie(3). Le chantieractuel le plus fécond porte sur l’histoiredes prévôtés.
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page8
le gendarme prévôtal, « soldat de laloi » auprès des autres troupes
Instruments de laloi(4) et auxiliaires dela justice auxarmées, lesprévôtaux assumentdes tâches multiples,parfois encollaboration avecd’autres militaires :maintien de l’ordre etde la discipline,police judiciairemilitaire, lutte contrela désertion,encadrement desunités privées deleurs chefs,régulation de lacirculation et duravitaillement,
répression des atteintes aux biens et auxpersonnes, lutte contre la propagandeennemie, collecte du renseignement,interrogatoire et transfert des prisonniers,contrôle des civils à la suite des armées,organisation de la justice et des prisonsprévôtales, « véritables oubliées del’histoire » jusqu’aux thèses de LouisPanel et d’Aziz Saït(5).
négligés par la mémoire collective, lesprévôtaux l’étaient également par leshistoriens jusqu’à l’ouverture du chantierde la Sorbonne. Dix-huit travaux ont déjàété réalisés sur leurs activités au cours
(3) Sur ces questions, voirJ.-n. Luc, « Les missionsmilitaires desgendarmes… », dans J.-n.Luc et Frédéric médard,Histoire et dictionnaire de lagendarmerie, Paris, Jacob-Duvernet-DmPA, 2013,p. 121-122 et129 sq.Vincennes, SHD,2011 (en ligne). La thèse deLouis n. Panel (La GrandeGuerre des gendarmes.« Forcer au besoin leurobéissance », Paris, DmPA-nmE, 2013) est le premierdoctorat consacré auxmissions militaires desgendarmes pendant unconflit.
(4) « Le soldat de la loi que jesuis ne reçoit, en matièrejudiciaire, d’ordre que de laloi » : réponse d’un prévôt àun officier qui le presse defaire fusiller des suspects,finalement innocentés, citéepar Louis Panel, op. cit.,p. 303.
(5) Aziz Saït, Les Prévôtés,de la « drôle de guerre » à« l’étrange défaite »,doctorat sous la dir. de J.-n. Luc, Paris-Sorbonne,2012, p. 393 sq.
des campagnes d’Espagne, d’Algérie etdu mexique, au XIXe siècle, de la GrandeGuerre, de 1939-1940, de 1943-1945 et
de la Guerred’Indochine(6). Cettepremière moissonpermet d’analysersous un anglenouveau la conduitedes troupes encampagne, lapratique etl’imaginaire de l’ordremilitaire, l’importancede la circulation dans
la zone des armées, la vie quotidiennedes soldats et leurs interactions avec lespopulations. Les archives des prévôtéséclairent, par exemple, la recherche durenseignement en macédoine à partir de1915, la débâcle de 1940, la délinquanceparmi les Forces Françaises Libres, lesviolences au sein du corpsexpéditionnaire français en Extrême-orient, les exactions commises contredes civils et leur répression. En Espagne,en Algérie ou au mexique, des prévôtsjustifient la protection des habitants, deleurs biens et de leurs coutumes avec desarguments repris, un siècle après, par lacélèbre doctrine « gagner les cœurs et lesesprits »(7). Cette attitude se retrouve dansd’autres contextes : Emmanuel Jaulinestime que la gendarmerie a servi ouessayé de servir, pendant la Guerred’Algérie, de « garde-fou face à une
(6) Par exemple, GildasLepetit, « La Manière la plusefficace de maintenir latranquillité » ? L’interventionde la gendarmerie impérialeen Espagne (1819-1814),doctorat, 2009, à paraître ;Hélène de Champchesnel, lagendarmerie au levantpendant la Seconde Guerremondiale, doctorat, 2008, àparaître ; Pierre-Yves LeQuellec, Les prévôtés sur lesthéâtres d'opérationsextérieures en Extrême-Orient (1946-1954), doctoraten cours.
(7) Jean-noël Luc, « Lesmissions militaires desgendarmes… », op. cit.,p. 125.
PRÉSENTATION
L’HISToIrE DE LA GEnDArmErIE, nouVEAu CHAPITrE DE L’HISToIrE mILITAIrE
91ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page9
pas avec l’arrêt des hostilités et la sortiede la guerre, l’un des chantiers de la
nouvellehistoriographie de ladéfense(9). Actrice de
la mobilisation, la gendarmerie contribueensuite aux transferts des hommes et dumatériel au cours de la démobilisation,comme le montrent deux contributions àce numéro, ainsi qu’à l’occupation decertains territoires. Des territoriauxcoopèrent à la gestion civile et militairedes quarante-cinq nouveauxdépartements français créés sous la
révolution etl’Empire(10). Encoremal connue, lagendarmerie de
l’armée française du rhin participe, àpartir de 1919, à l’administration de lazone occupée. Instituée à partir de 1945,la gendarmerie des forces françaises enAllemagne, dont l’étude a commencé à laSorbonne, assume plusieurs missionsmilitaires jusqu’en 1999.
L’enquête doit s’étendre à la colonisation,car les gendarmes, combattantsoccasionnels au sein des prévôtés,concourent ensuite au processus dit depacification, puis à l’administration desterritoires. or la nouvelle histoire del’exercice de la police en terres colonialesa montré l’intérêt d’étudier les actionsdiversifiées des appareils militaro-policiers. L’histoire de la gendarmeriecoloniale(11) permet ici à l’histoire militaire
(9) Jacques Frémeaux,michèle Battesti (dir.), Sortirde la guerre, Paris, PuPS,2014.
(10) Aurélien Lignereux,Servir napoléon. Policiers etgendarmes dans lesdépartements annexés,1796-1814, Seyssel, ChampVallon, 2012.
armée que les nécessités, réelles ousupposées, del’action risquaientd’entraîner trop
loin »(8).
Avant, pendant et après la guerre : legendarme, gestionnaire etcollaborateur des arméesEn période de paix, les personnels de ladépartementale et des formationsspécialisés assurent la police générale etjudiciaire des autres militaires. Ilsencadrent la conscription, arrêtent lesinsoumis et les déserteurs, contrôlent lespermissionnaires et collaborent àl’administration des réserves. Ilssurveillent les troupes en marche,escortent les convois de munitions etparticipent à la collecte durenseignement.
L’entrée en guerre accroît lescontributions des gendarmes à laconstitution, au transfert et àl’équipement des troupes. Sous leConsulat et l’Empire, ils sont au premierrang de la lutte contre l’insoumission et ladésertion. « Faites un ordre du jour à lagendarmerie ; apprenez lui que je merepose sur [son] activité pour maintenir latranquillité intérieurement et faire marcherla conscription », ordonne l’empereur àmoncey, le 1er octobre 1805, au début dela campagne contre la Troisième coalition.
Les responsabilités militaires desprévôtaux et des territoriaux ne cessent
(8) Emmanuel Jaulin, LaGendarmerie dans la Guerred’Algérie, Panazol,Lavauzelle, 2009, p. 401.
10
PRÉSENTATION
L’HISToIrE DE LA GEnDArmErIE, nouVEAu CHAPITrE DE L’HISToIrE mILITAIrE
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page10
des représentants de l’état et participer,grâce à son implantation nationale, à laprotection des points sensibles, aurenseignement, à la défense civile et à larésistance. Développée par les Livre blancsur la Défense de 1994 et de 2008, ladoctrine du continuum sécurité intérieure-défense nationale consacre cetengagement « en temps de paix et decrise de toute intensité, jusqu’auxsituations de conflit armé, sur le territoirenational (métropole et outre-mer), commedans les opérations extérieures » (2008).
Ces missions sont assurées notammentpar des formations spécialisées dédiées àune armée ou à un secteur d’activité enrelation avec la défense : gendarmerie
11
de participer àl’essor d’un chantierprometteur(12).
De la défenseopérationnelle duterritoire auxOPEX : lesfonctions militairesde la gendarmeriedepuis le milieu duXXe siècle
À partir des années 1980, la gendarmeriedevient la principale force de la défenseopérationnelle du territoire (DoT),élaborée à partir de 1959-1962. Dans cecadre, elle doit assurer la liberté d’action
(11) Vingt-trois travaux ontdéjà soutenus au sein duséminaire de la Sorbonnesur le rôle des gendarmesen Algérie, au maroc, enTunisie, en martinique, ennouvelle-Calédonie, auLevant et en Indochine ; troisdoctorats sont en cours depréparation, sur lesgendarmes au Sénégal(1840-1870), au Cameroun(1919-1960) et au Liban(1920-1939).
(12) Jean-Pierre Bat etnicolas Courtin (dir.),Maintenir l’ordrecolonial. Afrique etMadagascar, xixe-xxe
siècles, rennes, Pur, 2013.
PRÉSENTATION
L’HISToIrE DE LA GEnDArmErIE, nouVEAu CHAPITrE DE L’HISToIrE mILITAIrE
1ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
Adjudant de gendarmerie, en poste à Sakaraha en 1961 (Madagascar), recevant avec son collèguemalgache les doléances de la population dans un rôle de médiation.
© c
olle
ctio
n D
uran
d P
hilip
pe
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page11
12
sur les répercussions juridiques de leursinterventions. Elle contribue audéveloppement de la recherche – encorefreiné par l’inaccessibilité de la plupartdes archives – sur le vaste champ desactions dites civilo-militaires.
la militarité du gendarme, nouvelobjet d’étudeobjet de discussion depuis la fin du XIXe
siècle, l’identité militaire des gendarmesdoit retenir l’attention des historiens. Dumoins de ceux qui osent s’affranchir del’assimilation exclusive, et stérilisante pourla recherche, de la militarité au combat,« but final des armées », selon la célèbreformule du colonel du Picq en… 1880. Sile statut originel et les unités
maritime, gendarmerie de l’air,gendarmerie de la sécurité desarmements nucléaires, gendarmerie del’armement. En réponse aux nouvellesformes de judiciarisation de l’actionmilitaire, la gendarmerie prévôtale est, parailleurs, dotée, en 2013, d’uncommandement autonome et d’unebrigade de recherche projetables. Laréduction du format des armées conduitenfin à recruter dans la gendarmerie lamoitié des réservistes opérationnelseffectifs au début du XXIe siècle.
Depuis plus de trente-cinq ans, lesgendarmes apportent également leurconcours à des opérationsinternationales, au cours desquelles ilsassument des missions militaro-policièresvariées : respect du cessez-le-feu etmaintien de l’ordre, lutte contre leterrorisme ou la piraterie, évacuation desressortissants français ou étrangers,collecte du renseignement et enquêtessur des crimes de guerre, formation etencadrement des forces de sécuritélocales.
L’histoire des fonctions militaires de lagendarmerie depuis le milieu du XXe siècleélargit, une fois encore, le champ del’histoire de la défense. Elle complètel’étude de l’évolution de la doctrine et desstratégies imposée par les mutations ducontexte international, des conflits et desmenaces. Elle apporte un autre éclairagesur les mutations des forces armées et
PRÉSENTATION
L’HISToIrE DE LA GEnDArmErIE, nouVEAu CHAPITrE DE L’HISToIrE mILITAIrE
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
Militaire de la gendarmerie en poste au Tchaddans le cadre de la prévôté.
© c
omm
and
emen
t d
e la
gen
dar
mer
ie
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page12
ses équipements et ses tenues, sasymbolique et samémoire(14) ? Placé àl’interface entrel’état, les armées etla population, legendarme a-t-ilpanaché, à sonniveau, l’identitémilitaire, le légalismeet la culture deservice public(15) ? A-t-il contribué aux
mutations de la notion de militarité et dela place des militaires dans la société ?Comment la gendarmerie s’est-elle située,à chaque époque, entre ses deux pôles,militaire et policier ? Dans quelscontextes, depuis le XIXe siècle, et avecquels enjeux, la militarité de ce corps est-elle affichée ou estompée par sesresponsables, défendue ou rejetée parses personnels, critiquée ou niée pard’autres soldats et par des syndicats depoliciers ?
(14) J.-n. Luc, « Quand Cliorencontre les gendarmes :Dix ans de recherches surl’histoire d’une force militaireoriginale (2000-2010) »,dans Hubert Heyriès (dir),Histoire militaire, études dedéfense et politiques desécurité des années 1960 ànos jours : bilanhistoriographique etperspectivesépistémologiques, Paris,économica, 2012, p. 243-245.
(15) Arnaud Houte, Le métierde gendarme national auxixe siècle : la constructiond’une identitéprofessionnelle, rennes,Pur, 2010,
13
combattantes intermittentes de l’héritièrede la maréchaussée participent à soncaractère militaire, ils ne le résument pas.Depuis plus de deux siècles, lesgendarmes assument, au cours del’ensemble des conflits et pendant lespériodes de paix, des responsabilitésspécifiques dans la gestion des troupes,la défense et la projection des forces.L’étude de ces interventions a toute saplace dans une histoire militaire rénovée,qu’André martel proposait d’élargir, en1996, à « tout ce qui prépare le combat et
concourt aucombat »(13). Depuiscette époque, lesnouvelles formes du
combat, l’essor des autres missions, larevalorisation du soutien et lacivilianisation de l’armée ont confirmé lapertinence de ce programme, qui s’étend,on l’a vu, à l’après-combat.
La question de l’appartenance de lagendarmerie française à l’institutionmilitaire n’a donc guère de sens pourl’historien des pratiques sociales etculturelles. Dès lors que l’héritière de lamaréchaussée fait partie, depuis sacréation, des forces armées, il est pluspertinent de rechercher les composantes,les traits particuliers et les évolutions desa militarité. Comment, et avec quelsrésultats, l’empreinte militaire a-t-ellefaçonné, depuis plus de deux siècles, sonorganisation et sa gouvernance, sonrecrutement et son système de formation,
(13) André martel, « Del’histoire militaire à l’histoirede la Défense », Bulletin del’AHCESR, n° 14, 1996,p. 9.
l’AUTEUR
Le professeur Jean-Noël Luc dirige depuis2000, à l’Université Paris-Sorbonne, unchantier sur l’histoire de la gendarmerie etdes autres forces de sécurité, qui aproduit 165 travaux universitaires, fourni lamatière de 28 ouvrages et permisd’organiser 7 colloques.
PRÉSENTATION
L’HISToIrE DE LA GEnDArmErIE, nouVEAu CHAPITrE DE L’HISToIrE mILITAIrE
1ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page13
UNE GUERRE MENÉE AVECCOURAGE ET AbNÉGATION
Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, la gendarmerie appa-raît comme une « armée de l'intérieur ». Cette mission est pourtantéloignée de celle des prévôts partis au front et des volontaires qui intè-grent les unités des armées. Invisibles ou considérés par la troupecomme trop présents au regard de certaines missions de police, peunombreux, écartelés hiérarchiquement, dispersés dans de multiplestâches, ils mènent une guerre silencieuse, utile et efficace.
La guerre d'usure change le regard porté sur une gendarmerie quisubit une transformation décisive de son institution au gré de crisesinternes et de réformes. Lorsque la Grande Guerre prend fin, le gen-darme a gagné en autonomie mais on devine à la lecture des publica-tions son impopularité.
PRÉSENTATION
14 Revue de la Gendarmerie Nationale 4e trimestre 2014
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page14
la Grande Guerrede la Gendarmerie
Le centenaire de la Grande Guerre estl’occasion de sortir de l’ombre denombreux acteurs oubliés ouméconnus du premier conflit mondial.Embusqués et permissionnaires,fusillés et suicidés, enfants et veuves,religieux, animaux… rien ni personnene semble devoir échapper àl’offensive éditoriale qui a précédé ouaccompagné le lancement descommémorations(1). On devraitpourtant ranger au nombre des oubliésles gendarmes de 1914-1918, si lestravaux entrepris depuis une dizained’années sous la direction de Jean-
Noël Luc àl’université de ParisIV n’avaient permisde mieux cernerleur rôle à traversla guerre.Chercheursfrançais et
Létrangers ontégalement retracéleurs conditionsd’exercice et devie, entrant dans le
détail de leur rôle politique et militaire,de leurs missions, de leur image. Lesconclusions qu’ils rassemblent au seinde ce dossier complètent et précisent,notamment pour des théâtres, desmissions ou des figures particulières,la synthèse tentée pour le seul frontoccidental. Elles constituent un tourd’horizon d’une institutionprofondément éprouvée, mais aussirenouvelée par l’épisode destranchées.
Tout au long de la Belle époque, lagendarmerie, marquée commel’ensemble de la société militaire par lethème de la revanche, est tenue de sepréparer à une nouvelle guerre. Dans
(1) Voir par exemple lestravaux récents dusrespectivement à Charlesridel, Emmanuelle Cronier,André Bach, Denis rolland,manon Pignot, Peggy Bette,Xavier Boniface, EricBaratay.
PRESENTATION
151ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
loUIs N. PANel
Docteur en histoire Conservateur desmonuments historiques
par loUIs N. PANel
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page15
cette hypothèse, elle organise desexercices de réquisition et demobilisation. Pris pour une alerte réelle,celui mis en œuvre par erreur par labrigade d’Arracourt, en novembre 1912,manque de créer un incidentdiplomatique mais s’affirme comme unsuccès opérationnel. Les gendarmess’exercent également à leur service encampagne, codifié une dernière fois enjuillet 1911, à l’occasion des manœuvresorganisées annuellement dans chaquerégion militaire, et entretiennent une formede culture de guerre lors des inspectionsréglementaires au cours desquelles onvérifie leur connaissance des consignesen cas de déclaration de guerre ou desgestes élémentaires du combattant. Leurservice courant du temps de paixcomporte par ailleurs un versant militaireimportant, qui participe de la formationcontinue à la police prévôtale. Chaque
brigade doit en effetrechercher les réfractaires auservice militaire, réprimer,notamment au voisinage desvilles de garnison, ladésertion, tenir à jour lesfichiers – dits carnet A et B –des résidents suspectésd’espionnage oud’antimilitarisme qui seront àarrêter en cas demobilisation. Les unités de lafrontière de l’Est,particulièrement sensibiliséeset formées au contre-
espionnage, guettent quant à elles lemouvement des voyageurs et réprimentles incursions d’aéronefs.
Le Plan XVII, mis en place au printemps1914, prévoit en cas de guerre d’envoyeraux armées, pour y assurer le maintien del’ordre et la police militaire, près de4 000 gendarmes prévôtaux. Cependant,moins de 5 % des gendarmes ont déjàfait campagne, soit à l’occasion desdernières expéditions coloniales,notamment à madagascar, au Tonkin ouau maroc, soit au cours d’opérations
interalliées, en Chine,en Crête ou enTurquie(2). Lesréférencesprincipales desgendarmes lorsqu’ilsentrent en guerre nesont donc ni les
(2) Jean-marie Delaroche, Lagendarmerie crétoise et lesEuropéens pendantl'occupation internationalede l'île (1896-1907), sous ladir. d’olivier Wieviorka,université Paris-X, 2006,et La gendarmeriemacédonienne et lesEuropéens pendant le statutspécial des trois vilayet(1903-1908), sous la dir. deGilles Pécout, EPHE, 2009.
16
Deux ans avant la guerre, la brigade frontalière d’Arracourt(Meurthe-et-Moselle) est distinguée pour avoir mobilisé son cantonpar erreur.
mus
ée d
e la
gen
dar
mer
ie
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
PRÉSENTATION
LA GrAnDE GuErrE DE LA GEnDArmErIE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page16
simulacres auxquels ils se sont livréssaisonnièrement pour satisfaire aux rituelsdes inspections et de l’avancement, ni lescorps expéditionnaires auxquels bien peuont participé, mais plutôt les grandesgrèves face auxquelles presque tous ontété déployés, souvent à plusieursreprises, durant de longs mois. or lalogistique, l’équipement et souvent leservice des petits détachements degendarmerie expédiés sur le site desmouvements sociaux sont étroitementcalqués sur le service en campagne.C’est donc le maintien de l’ordre publicassuré « comme à la guerre » par desunités de circonstances « vivant enpopote » qui constitue pour l’essentiel del’arme l’expérience opérationnelle la plusprobante avant 1914.
la gendarmerie face à « l’énormemachine » de la mobilisationL’ordre de mobilisation générale surprendd’autant moins l’institution que depuisune semaine, elle est placée en étatd’alerte. Commandée le 26 juillet pourrenvoyer sur leur corps tous lespermissionnaires en raison de la tensionpolitique, elle se livre également à unesurveillance attentive des frontières etcommence de préparer les réquisitions etle rappel des réservistes en mettantprogressivement en œuvre « toutesmesures de nature à gagner du temps sil’ordre de mobilisation est donné ». Lesbrigades interviennent également pourséparer, dans de nombreuses villes deprovince, les manifestants pacifistes etnationalistes. Dans la soirée du 1er août,elles placardent dans chaque commune
171ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
Avant-guerre, « l’école des grèves » constitue la principale expérience opérationnelle des gendarmes.
mus
ée d
e la
gen
dar
mer
iePRÉSENTATION
LA GrAnDE GuErrE DE LA GEnDArmErIE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page17
18
revanche n’a pas lieu de servir, leministère de l’Intérieur ayant ordonné desurseoir aux arrestations, tout enmaintenant la surveillance des inscrits.Les réquisitions ne posent pas davantagede difficultés, la levée des bêtes et dumatériel étant assez largement payée parl’autorité militaire, dans un contexted’urgence. Sont confisqués en revanche,et stockés tant bien que mal dans lesbrigades, les postes TSF privés et lesplaques publicitaires de la société maggi,soupçonnés d’être autant de moyend’espionnage allemand.
Pour les gendarmes, le point le plusdélicat de l’entrée en guerre reste
les affiches annonçant la mobilisation detoutes les classes, renseignent les
réservistes égarés,puis recherchent lesrares insoumis, seuls1,22 % desmobilisés ayant faitdéfaut(3).
Si les manifestationscessent presque aussitôt, la gendarmeriedoit encore protéger les ressortissantsétrangers et les commerces àconsonance germanique, menacés par lafoule, avant de conduire les ressortissantsallemands et austro-hongrois dans descamps de regroupement. Le carnet B en
(3) L-n. Panel, « Pratiquesprofessionnelles de lamobilisation : laGendarmerie nationale et lalevée en masse (1900-1914) », in internationalreview of military history,n° 80, 2004, pp. 62-65.http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/ImG/1_quisommesnous/etude_des_conflits/2004-gthm.pdf
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
PRÉSENTATION
LA GrAnDE GuErrE DE LA GEnDArmErIE
Après la mort de leur officier, les dix gendarmes de la section de Longwy ont été capturés. Durantleur transfert en Allemagne, l’un deux s’est évadé.
colle
ctio
n p
rivée
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page18
compagnie des Ardennes, replié surDouai, il est fait prisonnier avec quinze deses hommes le 1er octobre. Entre-temps,les prévôtés ont atteint les armées et yont organisé la retraite, puis contribué à lareprise en main des troupes sur la marne.La gendarmerie reçoit alors l’ordre célèbredu général Eydoux de « maintenir les
hommes sur la lignede feu et forcer, aubesoin, leurobéissance »(4).
Le décret organique du 20 mai 1903 surle service de la gendarmerie prévoyait queles gendarmes puissent, en cas deguerre, former des unités combattantes,ainsi qu’ils l’avaient fait au XIXe siècle.Cependant, les effectifs très éprouvés desbrigades, à peine suffisants pourconstituer les prévôtés, n’ont donnéaucune prise à cette possibilité.Conscients du déficit d’image qui menaceleur institution et de l’accusationd’embusquage qui ne manquera pas defrapper un corps de militaires de carrièreparadoxalement tenus à l’écart de l’ordrede bataille, de nombreux gendarmes ontalors réclamé leur reversement dans lestroupes de ligne. La garde républicaine,formation-école de la gendarmeriecomptant beaucoup de jeunescélibataires, parce qu’elle est maintenue àParis pour y monter la garde et desservices d’honneur, est ainsi la plusexposée aux critiques. Après la désertionde plusieurs gardes partis s’engager dans
(4) ministère de la Guerre,Historique de lagendarmerie. Guerre 1914-1918, Paris, Charles-Lavauzelle, 1920.http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6235185h
19
finalement leur propre mobilisation. Eneffet, dès le 3 août, chaque brigade doitexpédier aux armées, pour y constituerles détachements prévôtaux, un à troishommes, lesquels ne sont remplacésqu’avec délai par des militaires rappelés,âgés et insuffisamment nombreux. Ainsis’explique que le 5 septembre, la brigadede Gournay-en-Braye ne puisse opposeraux vingt saboteurs allemands venusdynamiter les ponts d’oissel, près derouen, que trois retraités .
Avant même d’avoir pu se constituer enprévôtés, la gendarmerie est en effetconduite à engager le combat. Afin deprévenir tout incident diplomatique, legouvernement avait ordonné fin juillet auxtroupes de couverture de se replier à plusde dix kilomètres de la frontière. Lesgendarmes sont ainsi les premiersmilitaires à entrer au contact des avant-gardes ennemies. En une quinzained’endroits sur la ligne du front, des unitésde gendarmerie s’opposent à l’invasion.Le capitaine Brosse à Briey, le capitainePaoli à Hazebrouck, ou le maréchal deslogis Duquenoy, à Cassel, sont cités pourles combats retardateurs imposés auxtroupes allemandes, de même que lesbrigades d’Herbeuville et de Fresnes-en-Woëvre, aux effectifs dérisoires mais àl’action décisive. Tenues de fermer lamarche des évacués, quelques brigadessont capturées au fil de l’invasion,notamment celles de Longwy etmaubeuge. Quant au commandant de la
1ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
PRÉSENTATION
LA GrAnDE GuErrE DE LA GEnDArmErIE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page19
départementaux, voire prévôtaux,rejoignent à leur tour des unitéscombattantes. Cependant, lesversements postérieurs à 1914 ne sontpas tous le fait de volontaires, dont laproportion n’excède pas 60% desdétachés, mais souvent la conséquencede la loi mourier sur le renvoi en ligne desjeunes et des célibataires et quelquefoiscelle d’une mesure disciplinaire.
la guerre à l’horizon de la brigadeAu printemps 1915, le ministère de laGuerre s’avise que « la gendarmerie adéjà fourni [aux armées] plus du doublede l’effectif qui était prévu à l’origine ».Son premier souci est de répondre à la
la légion étrangère et l’échange « de gifleset de coups de poings », le gouvernementautorise le versement, à titre individuel etsous l’uniforme de la ligne, de près de560 officiers et gardes partis renforcer lesrégiments comme cadres temporaires, enseptembre et octobre 1914. Deux centsmourront au front sous d’autresemblèmes, dont le lieutenant Fontan,célèbre depuis qu’il avait arrêté, en 1912,le bandit Bonnot ; d’autres s’illustrerontcomme cadres dans l’aviation, commeGaston merlhe, ou dans les chars, lesbrigades russes et les troupes coloniales.Par la suite, un autre demi-millier degardes intègre les prévôtés, tandis qu’unpeu moins de trois cents gendarmes
20 Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
PRÉSENTATION
LA GrAnDE GuErrE DE LA GEnDArmErIE
Des officiers de la garde républicaine volontaires pour servir aux armées posent gare de l’Est, enseptembre 1914.
mus
ée d
e la
gen
dar
mer
ie
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page20
pénurie des cadres, en procédantd’abord à de massives promotions desous-officiers à l’épaulette. maréchauxdes logis-chefs et adjudants vont ainsiprendre la tête de près d’un quart desarrondissements, avec des bonheursdivers. Si le commandement se satisfaitglobalement de ces cadres de fortune, enrevanche les autorités administratives etjudiciaires pointent leur manqued’instruction. C’est pourquoi, en juillet1915, le ministère imagine de verser dansla gendarmerie les « magistrats mobiliséscomme homme de troupe ». Ceux-ciétant très rares, puisqu’ils étaient souventofficier de réserve, notamment dans lajustice militaire, la mesure est vite étendueaux avocats. C’est ainsi qu’Henri Denoixde Saint-marc, ténor du barreau bordelaiset futur bâtonnier, et Auguste Chavernac,avocat près de la cour d’appel d’Aix, tousdeux mobilisés comme gardes des voiesde communication, puis commeconducteurs, entrent dans la gendarmerieen octobre 1915. Le premier est affecté àla gendarmerie de Verdun et cité à deuxreprises, le second, placé à la tête de lasection d’Hyères, meurt en s’opposant àdes cambrioleurs en 1917.
Pour les brigadiers et gendarmes, que laloi sur les réserves ne permet pas demobiliser, la situation est critique. Legouvernement de Bordeaux doit ainsirappeler tous ceux qui ont quitté leservice depuis moins de cinq ans et lesmaintient finalement en service sans limite
d’âge. Il accepte également tous lesvolontaires, dont le capitaine Paoli, âgé de72 ans, demeure le plus célèbre. Ce trainde mesures ne suffisant pas à combler lesvacances créées par la formation desprévôtés, puis les morts et blessés de lapremière année de campagne, leministère imagine de faire appel à desgendarmes auxiliaires, recrutés pour ladurée de la guerre et choisis parmi lesréservistes de l’armée territoriale, qui ontété mobilisés à plus de quarante ans pourservir essentiellement dans les services etles administrations. En plus de bons étatsde services et d’un casier judiciaire vierge,il est demandé aux candidats de« posséder une instruction élémentairesuffisante, et notamment savoir rédigerune page sous la dictée ». Ces auxiliaires,affectés à raison d’un par unité aumaximum, sont prévus exclusivementpour remplacer à l’intérieur les gendarmespartis aux armées. Ils rendent d’assezbons services pour être progressivementportés à six mille personnes . En 1917, onen compte ainsi jusqu’à trois par brigade,tandis qu’une centaine est incorporéedans les prévôtés. En Aquitaine, un quartdes gendarmes de la XVIIIe légion sontdes auxiliaires. Admis à prêter serment etnommés gendarmes temporaires, les plusméritants – 20% environ – servent alors àl’égal des actifs. Finalement l’auxiliaire,que raillent sympathiquement les journauxde tranchée sous les traits du « vieuxPandore », devient une figure
211ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
PRÉSENTATION
LA GrAnDE GuErrE DE LA GEnDArmErIE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page21
22
de divorces. L’inquiétude apparaîtégalement à propos de l’éducation desadolescents. Les demandes d’admissionau Prytanée s’accroissent, de même quecelles de secours financiers, encore quela gratuité du logement, des soinsapportés par les médecins et vétérinaires,du bois de chauffage ou la concessiond’un carré de jardin où se pratiquentmaraîchage et petit élevage tiennent lesgendarmes et leurs familles à l’abri durenchérissement des prix qui frappe plusnettement, à compter de 1916, leursconcitoyens. Le lien avec les absents sefait par le courrier, subitement devenuabondant, et par la presse corporative,avant que reparaissent, courant 1916,des gendarmes vêtus de bleu horizonpermissionnaires ou relevés.
incontournable de l’arrière, à laquelle LéoLarguier consacrera en 1919 son romanFrançois Pain, gendarme.
Le contexte de la guerre dissuadant leurspropriétaires, généralement les conseilsgénéraux, d’y investir, et le personnelétant moins nombreux pour les entretenir,les brigades se dégradent. rappelés etauxiliaires ne pouvant y vivre, puisque lesfamilles des prévôtaux y résident encore,seul le chef de brigade de complémentcampe dans les locaux, aux hasards despossibilités. À la faveur du départ auxarmées d’une grande partie des hommes,les relations entre les familles se fontmoins distantes mais souvent plustendues. Les brigades de la GrandeGuerre connaissent un pic d’adultères et
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
PRÉSENTATION
LA GrAnDE GuErrE DE LA GEnDArmErIE
À partir de 1916, les gendarmes adoptent la tenue bleue horizon et le casque Adrian portés par lestroupes. Aquarelle du commandant Bucquoy, 1939.
mus
ée d
e la
gen
dar
mer
ie
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page22
de vives tensions entre brigades etadministrés, notamment à l’occasion desréquisitions de 1916 et 1917, ou ducontrôle de permissionnaires quisupportent mal d’être tracassés sur leurlieu de repos. Dans l’ensemble toutefois,la gendarmerie de l’intérieur, perçuecomme d’autant plus protectrice qu’ellese raréfie alors que les cadrestraditionnels des sociétés rurales sonttous au front, a bénéficié du regaind’intérêt de civils en quête de sécurité.
Des gendarmes en guerre par-delàl’horizonSi, pour nombre de gendarmes, la guerrecommence ainsi au village, elle semanifeste pour une poignée d’entre euxsous les lointains horizons de l’empirefrançais. Les opérations y sont àl’évidence d’un moindre impact, mais lesfaibles postes de la gendarmerie coloniale– parfois un seul homme, rarement ungradé – sont bientôt confrontés au défi dela mobilisation des troupes indigènes etau contrôle, voire à la réquisition deressources désormais indispensables auravitaillement de la métropole. En Algérie,où s’applique le décret du 2 août 1914sur l’état de siège, la gendarmerieprocède à la mobilisation immédiate desEuropéens et encadre les unités dezouaves et tirailleurs levées localement.La guerre, et notamment la levée detroupes musulmanes, favorise égalementune remise en cause de l’autoritécoloniale. Les brigades de Perrégaux, en
23
outre le contrôle des mobilisables et despermissionnaires, qui prend avec laguerre une importance considérable,l’état de siège conduit les brigades àapprofondir certaines de leurs attributionsdu temps de paix. Elles développent lapratique du renseignement sur le moraldes populations et l’opinion publique,mais aussi des enquêtes à caractèreéconomique afin de connaître au mieuxl’état des ressources de leurs administrés,de prévenir les pénuries et de lutter,notamment après la mise en place durationnement, contre le marché noir etl’accaparement. Elles font également faceà une recrudescence du braconnage, lachasse étant interdite jusqu’à la fin de1916, au scandale des propriétaires etdes cultivateurs.
D’autres missions, propres à la guerre,sont à organiser ex nihilo, comme lasurveillance extérieure des camps deprisonniers de guerre ou de retenusadministratifs établis à l’intérieur, la traquedes déserteurs – estimés à plus de80 000 au fil de la guerre – parfoisorganisés en maquis et le contrôle desfrontières. Alors que plusieurs gendarmessont agressés par des militaires tentantde passer les Pyrénées ou les Alpes,d’autres essuient le feu de déserteursregroupés et armés, notamment enCorse, en région parisienne et dans lemassif central. L’allongement du conflit etl’affaiblissement progressif de lagendarmerie départementale entraînent
1ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
PRÉSENTATION
LA GrAnDE GuErrE DE LA GEnDArmErIE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page23
rôle est de maintenir l’ordre et la sécuritéau sein d’un port brusquement devenu lecarrefour des nations. Les troupesfrançaises y côtoient les arméesbritanniques, venues les unes et lesautres de toutes les parties de leursempires. on compte également dessoldats italiens, russes, serbes etmonténégrins. Cependant, Salonique, quin’a été prise par les Grecs aux Turcs quetrois ans plus tôt, reste une place neutreoù résident de nombreuses populationsciviles, de toutes origines. Dans cesconditions, la gendarmerie voit sesmissions de renseignement et de contre-espionnage prendre une importanceessentielle, tandis que se mettent en
octobre 1914, et de mac mahon, ennovembre 1916, font face à desinsurrections qui motivent l’envoi detroupes métropolitaines. Au total, lesquelque 800 gendarmes d’Algérieprocèdent au cours du conflit à plus de
24 000 arrestations,dont 4 200déserteurs etinsoumis(5).
Levée en partie depuis l’Afrique du nord,la gendarmerie du corps expéditionnaired’orient débarque à Seddul-Bahr le27 avril 1915. Après son repli surSalonique, elle met en place uneorganisation prévôtale singulière, cardéployée en pays neutre. Son premier
(5) Cécile Blanchemanche,La Gendarmerie en Algériependant la Première Guerremondiale, maîtrise, Histoire,Paris IV, sous la dir. deJacques Frémeaux, 2005,151 p.
24 Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
PRÉSENTATION
LA GrAnDE GuErrE DE LA GEnDArmErIE
Considérés comme mobilisés au même titre que leurs camarades de métropole, les gendarmes dela Réunion, responsables de l’effort de guerre, recevront la médaille commémorative de 1914-1918.
Ser
vice
his
toriq
ue d
e la
Déf
ense
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page24
place une prison et un tribunal prévôtaux,dont le service sera très soutenu(6). Ce
théâtre d’opérationparticulier est pour lagendarmerie
française l’occasion de fréquentersimultanément ses homologues desarmées alliées, et notamment les Provostmarshals britanniques et carabiniersitaliens. Quant aux gendarmes belges queles brigades du nord et des Ardennesfréquentaient dès avant la guerre sur lafrontière, ils coopèrent désormais sur lesol français, dans la région fortifiée deDunkerque mais aussi à Sainte-Adresseet même à orléans .
Rôles et visages de la prévôté auxarméesSur les axes vitaux du front, etnotamment le long de la Voie sacrée, lesprévôtaux veillent à la fluidité de lacirculation, que le général Fayolle jugeêtre « la partie vitale de l’armée » . Lagendarmerie impose alors les premièreslimitations de vitesse, contrôle l’état desvéhicules et les autorisations desconducteurs, s’attirant de nombreusesinimitiés et s’exposant auxbombardements. Dans lescantonnements, les prévôtaux tentent defaire régner la discipline et l’hygiène,notamment en réprimant l’alcoolisme,s’opposant à l’intrusion des femmes dansla zone des armées et contrôlantrégulièrement la voierie. Pendant labataille, ils gardent les arrières immédiats
(6) Isabelle roy, Lagendarmerie en Macédoine(1915-1920), maisons-Alfort,SHGn, 2004, 243 p.
du front pour dissuader les replisintempestifs, mais aussi orienter lesblessés ou les renforts. Enfin, ilssupervisent, en tant qu’officiers d’état civill’ensevelissement des cadavres et luttent
contre les pillards(7).
Du point de vuematériel, les prévôtés s’établissent auplus près du QG qu’elles desservent,dans des locaux de réquisition plus oumoins adaptés au service. À compter de1916, les gendarmes descendentrégulièrement dans des caves pours’abriter des bombardements. Lesprévôtaux vivent et travaillent ensemble,souvent au contact de leurs prisonniers,tiennent leur propre popote, cultivantmalgré eux un entre soi qui leur évite desrelations de plus en plus rugueuses avecles combattants, mais use des individusqui cherchent, parfois contre lesrèglements, à s’isoler. À la fin de 1915, lagendarmerie revêt la tenue bleu horizon etle casque de l’infanterie, se rapprochantainsi de l’aspect des soldats. De retour àl’intérieur, en raison soit des permissionsoctroyées à partir de l’été 1915, soit de larelève instituée six mois plus tard, lesgendarmes y apparaissent, dans leurnouvel uniforme, comme revenant dufront, notamment à l’attention desmobilisés. Aux armées, 17 % desgendarmes reçoivent la croix de guerre,11 % sont blessés et 3 % meurent, uneproportion sept fois inférieure à celle del’infanterie mais équivalente à celles de
(7)http://rha.revues.org/4182
251ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
PRÉSENTATION
LA GrAnDE GuErrE DE LA GEnDArmErIE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page25
26
sanctions, qui sont en majorité imputablesau contexte de la guerre de position,n’entrave guère les carrières et le légertassement de l’avancement est largementrattrapé par l’appel produit par ladémobilisation.
En territoire étranger, des tribunauxprévôtaux peuvent être confiés auxofficiers de gendarmerie. Ces juridictions,qui fonctionnent parallèlement auxconseils de guerre, qu’elles délestent desaffaires mineures, n’existent cependantqu’à Salonique puis brièvement enAllemagne dans le 1er semestre 1919.Elles passionnent des prévôts érigés enmagistrats qui regrettent tous qu’unrecours plus étendu à cette justice
l’aviation ou du train des équipages. Pourla moitié d’entre eux, les prévôtaux mortspour la France sont victimes d’accidentou de maladie, pour un tiers, desbombardements. Plus sûre que celle destroupes, la position des prévôtaux sembleplus difficile moralement si l’on se fie à untaux de suicide s’élevant à 0,56 ‰ dansla gendarmerie contre 0,22 ‰ parmi lespoilus. Avant le printemps 1917, un tiersdes prévôtaux sont punis, le plus souventpour des fautes commises en exécutantleur service, notamment dans la prise encharge des prisonniers, parfois pourabsence injustifiée, mais rarement pourdes incidents survenus avec la troupe.Paradoxalement, le rythme soutenu des
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
PRÉSENTATION
LA GrAnDE GuErrE DE LA GEnDArmErIE
Une prévôté de division pose à Valmy avec son sous-officier, ses employés territoriaux et sesprisonniers allemands.
mus
ée d
e la
gen
dar
mer
ie
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page26
souvent par voie de terre, et que lesprévôtaux qualifient eux-mêmes demouvement perpétuel. L’escorte desprisonniers et préventionnaires, ignorantl’automobile, grève considérablementl’effectif des prévôtés et expose lesgendarmes aux lazzis, voire aux attaques,des soldats qu’ils rencontrent.Fréquemment désignés commeprésidents ou jurés des conseils deguerre, mais aussi à l’occasion commecommissaires-rapporteurs et mêmecomme défenseurs, les prévôtsentretiennent une connaissance intime dela justice militaire, dont ils encadrent lesséances. En revanche, la gendarmerie setient à l’écart de l’application des peines,notamment capitales, en opposantsystématiquement aux réquisitionsabusives les règlements qui ne luiassignent qu’un rôle de service d’ordrelors des parades d’exécution. Cependant,le fait de voir les gendarmes,responsables de la conduite descondamnés, du prétoire au poteau, assoitdans l’opinion publique leur réputation defusilleurs.
la crise de 1917, facteur durenouvellementL’année 1917 marque une criseparticulièrement aiguë pour lagendarmerie. Aux armées comme àl’intérieur, les gares, spécialement aupassage des trains de permissionnaires,sont le théâtre de scènes d’émeute etd’affrontement. Les gendarmes, isolés,
27
d’exception n’ait pas eu lieu. Chaquequartier général devant disposer, de ladivision à l’armée, d’une prison pouraccueillir les prévenus de conseil deguerre, la gendarmerie gère au cours dela guerre environ cent cinquante prisonsprévôtales, établies au hasard descantonnements dans des locaux defortune, tels que des étables, caves ouéglises. Toutes reçoivent pour des séjoursde quelques jours les justiciables desjuridictions aux armées, qu’ils soientmilitaires ou civils, hommes ou femmes,français ou étrangers, à la seule exceptiondes prisonniers de guerre, soit jusqu’àsoixante dix personnes par prévôté. Entredeux audiences ou interrogatoires, lesdétenus sont employés à de menustravaux, comme les corvées de voirie oude latrines, voire placés au service de laprévôté dont ils assurent la cuisine ou leménage. Cette proximité entre gendarmeset justiciables contribue à affiner lesregards réciproques, mais distilleégalement le soupçon, face à larecrudescence des évasions et dessuicides, de la connivence des gardiens.La surveillance de la prison mobilise lebrigadier et deux ou trois gendarmes àpied de chaque prévôté, et représente lepremier motif des punitions infligées dansla gendarmerie, aussi est-elle décritecomme « le cauchemar des officiers etdes gendarmes ».
Ce dernier, d’ailleurs, s’étend égalementaux transfèrements opérés aux armées,
1ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
PRÉSENTATION
LA GrAnDE GuErrE DE LA GEnDArmErIE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page27
28
leurs brigades, ces derniers doivent s’yappliquer tout particulièrement à lasurveillance de l’opinion et la lutte anti-pacifiste. Aux armées, Bouchez créeégalement des sections prévôtales,volantes et interchangeables, mises àdisposition de chaque armée pourrenforcer sur les points critiques lesprévôtés de division et constituer, aubesoin, de gros bataillons propres àrétablir l’ordre. Cette organisation, quipermet aux prévôtés de se concentrer surleur mission de police administrative etjudiciaire aux armées, tout en dotant lesarmées d’une force efficace derétablissement de l’ordre, donne, àcompter de juin 1918, une tellesatisfaction dans la résolution desmutineries qu’on envisage alors d’utiliseraussi les sections à l’arrière.
Début 1918, Clemenceau nomme lelieutenant-colonel Plique, qui futresponsable des gendarmes dans l’affairede la Courtine, sous-directeur de lagendarmerie, puis crée cinq secteurs degendarmerie à l’intérieur, tous confiés àdes généraux de l’arme, désormaisresponsables « des forces degendarmeries rassemblées pour lemaintien de l’ordre ». Les gendarmesquant à eux sont tous promus au rang desous-officier et pourvus de galons desergent. Leur solde mensuelle de basepasse de 125 à 150 francs, mais lerevenu réel d’une nouvelle recrue avoisinesouvent, en 1919, les 500 francs. Quant
sont l’objet d’invectives au départ desrames et de violences à quai. À force, lecommandement donne même l’ordre auxprévôtaux, pour ne pas envenimer lessituations, de ne pas se montrer tantqu’ils n’ont pas les moyens d’intervenir enforce. À l’intérieur, le renchérissement dela vie, très net en 1917, produitégalement des scènes de violence sur lesmarchés, tandis que des gendarmeriessont attaquées, à Saint-Claude et Aurillac,par des populations solidaires de soldatsréformés. Enfin, au cœur du pays, lagendarmerie de la Creuse, renforcée pardes troupes d’infanterie et des batteriesd’artillerie, doit mettre sur pied unevéritable opération pour résorber lamutinerie de la brigade russe cantonnéeau camp de la Courtine durant plus d’unmois.
Les premières manifestations de la crisede 1917 ont donc souligné les faiblessesstructurelles de la gendarmerie, tant auxarmées qu’à l’intérieur. Pour lui redonnerde l’autorité face aux troupes, nivelleprend le parti de nommer à la tête desformations prévôtales le général Bouchez,un officier de gendarmerie qui s’est illustréà la tête d’une division à Verdun, auquelPétain accordera dans les faitsl’autonomie pour mener la réforme desprévôtés. Ce nouvel inspecteur général dela gendarmerie aux armées choisit derendre des gendarmes à l’intérieur enréduisant l’effectif de chaque prévôté devingt-deux à quinze hommes. renvoyés à
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
PRÉSENTATION
LA GrAnDE GuErrE DE LA GEnDArmErIE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page28
rhénanie, en Silésie, à Constantinople, enCilicie, au Levant et jusqu’en Chine,renouant de façon spectaculaire avec latradition révolutionnaire de rayonnementinternational et d’exportation du modèlegendarmique.
La révolution silencieuse occasionnée parla sortie de guerre s’appuie surtout sur unprofond renouvellement du personnel.Sous le gouvernement Clemenceau,surtout à la faveur de la démobilisation,plus d’un tiers des gendarmesdépartementaux est renouvelé. Cesnouveaux gendarmes sont aussi des
29
aux chevaux, ils cessent d’être lapropriété des gendarmes montés. Dans lemême temps, la gendarmerie semodernise. Chaque arrondissementperçoit une motocyclette britanniqueattelée d’un side-car en osier, chaquecompagnie, une Ford T de l’arméeaméricaine.
L’installation du téléphone, sans êtrecomplète, est très largement achevée en1919, et des machines à écrire sontdistribuées à tous les officiers. La mêmeannée, l’arme est redéployée, au gré destraités de paix, dans la Sarre, en
1ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
PRÉSENTATION
LA GrAnDE GuErrE DE LA GEnDArmErIE
Georges Clemenceau, président du Conseil et ministre de la Guerre en 1918-1919, réformesilencieusement, mais profondément, la gendarmerie.
Bib
lioth
èque
nat
iona
le d
e Fr
ance
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page29
30
avait toujours entendu qualifier laGendarmerie mobile de gardeprétorienne, préjugé qui jusqu’alors avaitfait dissoudre ces unités mobilescependant créées dans les moments dedanger et avorter tout projet dereconstitution, si sage soit-il. Le présidententendait réussir cette fois et sansdélais ». Dans un premier temps, songouvernement emploie à l’intérieur, sur lethéâtre des conflits sociaux, une partiedes sections prévôtales qui ont démontréleur intérêt face aux mutineries l’annéed’avant. Au printemps 1918, environ unmillier de gendarmes prévôtaux sont ainsienvoyés dans la vallée du rhône, leDauphiné et la Languedoc. Lors de leurdémobilisation, ces unités, devenuesindispensables, conservent leur uniformede campagne et sont converties enpelotons de gendarmerie, identiquesquant à leur composition et leursmissions, mises à disposition de chaquechef de légion. La gendarmerie mobile estainsi née dans le secret, au prix d’unesoigneuse dissimulation. Cette genèseclandestine, initiée en 1917 par Pétain etBouchez sous la forme des sections, puispar Clemenceau et Plique sous celle despelotons, est régularisée en 1921 par lasanction d’une loi qui ne fait que
reconnaître etformaliser une
situation de fait(8).
(8)http://rha.revues.org/5412
gendarmes nouveaux, tous issus destranchées et formés à une doctrinecommune dans des centres créés en1918. Les officiers issus des armes,comme les sous-officiers promus àl’épaulette, se retrouvent à Versailles ausein de l’école des officiers degendarmerie créée le 31 décembre 1918,et qui forme, la première année, unesoixantaine de cadres. En mars 1918apparaissent des centres d’instruction,devenus un an plus tard les écolespréparatoires de la gendarmerie. Ilsassurent la formation de près de 7 000gendarmes en moins de deux ans. Cettegénération bleu horizon, très différente desa devancière et volontiers remuante,imprime un virage décisif à la gendarmeriede l’entre-deux-guerres. Le créateur del’école de Strasbourg dit de ses élèves« J’ai toujours pensé qu’ils apporteraientun sang nouveau dans un organismeauquel cela ne saurait nuire ». Admis à laretraite vingt à vingt-cinq ans plus tard,les recrues de Clemenceau jouent un rôledécisif dans l’engagement de certainesunités de gendarmerie en faveur de larésistance.
Enfin, le Tigre connaît bien laproblématique de la gendarmerie mobiledont le projet avait avorté sous sonpremier gouvernement. Aussi donne-t-il« l’ordre verbal d’organiserimmédiatement la Gendarmerie mobile,sans qu’elle en porte le nom et sansimiter les précédentes organisations. Il
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
PRÉSENTATION
LA GrAnDE GuErrE DE LA GEnDArmErIE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page30
lynché, ni quand, ni où. La genèse de larumeur apparaît facilement. La mémoired’un canular improvisé dans Verdun en1916 a fait écho l’année suivante à l’envieinassouvie des mutins d’en découdreavec la force publique. Confondue avec lemeurtre, près de Commercy, dugendarme Lempereur, vraisemblablementabattu par un déserteur en septembre1917, elle a ensuite infiltré la littérature
31
De l’historique au trou de mémoireDès la fin de 1916, la rumeur s’estrépandue sur le front qu’à Verdun, dessoldats auraient pendu des gendarmes àdes arbres ou des réverbères. À lachambre, le député Abel Ferry mentionnecet événement comme véridique,l’accréditant du même coup à l’intérieur.L’affaire des pendus sera sans cesseévoquée par les anciens combattants,sans que l’on sache jamais qui fut ainsi
1ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
PRÉSENTATION
LA GrAnDE GuErrE DE LA GEnDArmErIE
Le monument de la gendarmerie à Versailles, érigé de 1936 à 1940 et sur lequel figure, à la suitedes batailles alors inscrites sur les drapeaux de l’arme, la mention « Grande Guerre ».
mus
ée d
e la
gen
dar
mer
ie
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page31
32
Guerre mondiale, trois fois plus nombreuxque leurs aînés de 1914-1918. Le secondobjectif est la rédaction d’un monumentalGrand livre d’or historique de laGendarmerie, lequel tente de rassemblertous les grands faits individuels de l’arme,en insistant sur la Grande Guerre. Peudiffusé en dehors du cercle desintéressés, il ne parvient pas à renverserl’image de la gendarmerie dans la sphèredes anciens combattants. Ce n’est doncque dans les années 1950, après que lacampagne de 1940, mais surtout lesmaquis de la Libération, puis les légionsde marche d’Indochine ont offert à lagendarmerie l’occasion d’affirmer soncaractère combattant, que le débats’apaise entre l’arme et la troupe, lagénération des prévôts de Verdun ayantalors largement disparu.
combattante et certains travauxhistoriques.
Il est vrai que dans les années 1930, lerefus d’attribuer la carte du combattantaux prévôtaux de la Grande Guerrecristallise les tensions entre gendarmes et
ancienscombattants(9).Pendant 25 ans,
d’anciens prévôts, rassemblés autour deGeorges Lélu, colonel en retraite, vontclamer leur indignation auprès desautorités et demander réparation. Leuréchec les conduit alors à organiser unecontre-offensive en direction de l’opinionpublique, pour manifester le caractèrecombattant de la gendarmerie et son rôledurant la Grande Guerre. Au lendemainde la manifestation du 6 février 1934, laSnAoG, une association des anciensofficiers de gendarmerie, presque tousvétérans de 1914-1918, est créée pourporter deux projets essentiels. Le premierest un monument national de lagendarmerie, érigé par souscription àVersailles, destiné à retracer toutes lesgloires de la gendarmerie. Centré sur lecénotaphe du prévôt d’Azincourt, LeGallois de Fougières, il porte à la suite desprincipales batailles où s’est illustrée lagendarmerie l’inscription « GrandeGuerre ». Toutefois, lors de soninauguration, reportée du fait del’occupation allemande jusqu’en 1946, lesens du monument s’est déplacé vers lesgendarmes tués durant la Seconde
(9)https://www.yumpu.com/en/browse/user/forcepublique.org
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
PRÉSENTATION
LA GrAnDE GuErrE DE LA GEnDArmErIE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page32
33
En définitive, la figure du gendarme,en particulier prévôtal, ballottéeentre la légende noire des pendus
de Verdun et celle dorée un tempsentretenue au sein de l’institution, n’auraitpu n’être qu’une victime collatérale del’après Première Guerre mondiale,emportée par le trou de mémoirehistoriographique. L’histoire tend plutôt àdémontrer qu’il s’agit moins d’un hérostrès discret que d’un acteur très présent.on lui doit en effet des vocables telsqu’école de sous-officier, général degendarmerie, brigade de recherche,gendarme motocycliste ou pelotonsmobile. En mettant en exergue desthématiques telles que la coopérationinternationale, le commandement de lagendarmerie prévôtale ou la géopolitiquede la gendarmerie en Syrie et au Liban,les recherches ici rassemblées veulentmontrer que si la Grande Guerre de lagendarmerie mérite d’être connue, c’estparce qu’elle est actuelle.
l’AUTEUR
Ancien élève de l’Ecole du Louvre et del’Institut national du Patrimoine, Louis N.Panel est docteur en histoire etconservateur des monuments historiques.Il a publié Gendarmerie et contre-espionnage (SHGN, 2004) et La GrandeGuerre des gendarmes (Nouveau monde,2013). Il prépare actuellement l’expositioninaugurale du musée de la Gendarmerienationale, consacrée au rôle de l’armedans le premier conflit mondial.
1ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
PRÉSENTATION
LA GrAnDE GuErrE DE LA GEnDArmErIE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page33
UN lIEU DE CUlTURE ET DE RECHERCHE
Véritable musée d'histoire et de société, plus qu'un conservatoire de lamémoire militaire de l'Arme, le Musée de la gendarmerie nationale seraaccessible à tous les publics. Ouvert sur la ville, bénéficiant d'une architec-ture intérieure innovante, fondé sur un parcours muséographique reliant l'his-toire de France à celle de l'institution, il débouche sur la gendarmerie actuelleà travers ses spécialités et domaines d'excellence. Adossé au Centre deRecherche de l'EOGN, il contribuera à la recherche scientifique dans lesdomaines historiques et sociologiques. Sa première exposition sera consa-crée à la première guerre mondiale.
MUSÉE DE lA GENDARMERIE
34 Revue de la Gendarmerie Nationale 4e trimestre 2014
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page34
la Grande Guerreau musée de la gendarmerie nationale
La multiplicité des missions attribuées àla gendarmerie nationale laisseapparaître la complexité du rôle dugendarme qui, pendant les quatreannées du conflit, a pu endosserplusieurs uniformes : celui du gendarmeprévôtal, du gendarme de l'intérieur ouencore de l'unité dans laquelle il acombattu. Les collections conservéesau musée de la gendarmerie nationaletraduisent cette pluralité. Cette périodede l’histoire de la gendarmerie nationaleaura sa place dans la muséographie dunouveau musée, qui ouvrira ses portesdans l’année 2015, et plus
particulièrementdans le cadre d’uneexpositiontemporaire.
Une collectionréservée à un publicd'initiésAlors que lepatrimoine des
Larmées est conservé et présenté dans degrands musées nationaux ouverts aupublic depuis des décennies (musée del'Armée, musée national de la marine,musée de l'air et de l'espace), lagendarmerie nationale ne disposed'aucune structure équivalente accessibleau plus grand nombre. Pourtant, il existebien un musée de la gendarmerie
nationale. Crée en1946(1) au sein del'école d'applicationde la gendarmerie(actuelle école des
officiers de la gendarmerie nationale) àmelun, celui-ci a pour mission derassembler en un seul endroit les objets etdocuments liés à l'histoire de l'Arme afind'en retracer l'évolution. Situé dans l'unedes salles d'un bâtiment de la caserneAugereau, investie par la gendarmerie dès1945, il s'organise autour de différentesvitrines dans lesquelles sont présentéesdes pièces diverses et variées provenant
(1) Circulairen°40986/Gend. T. du16 août 1946 relative à lacréation d'un musée de lagendarmerie nationale (inMémorial de la gendarmerie,1946, p.162).
SOCIÉTÉ
35
par elINor BoUlArAND
1ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
elINor BoUlArAND Capitaine, officier degendarmerie, directrice duMusée de la Gendarmerienationale
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page35
belles pièces sont achetées en salle desventes et chez les antiquaires, enrichissantune collection qui atteint aujourd'hui plusde 30 000 items (objets, documents etphotographies rassemblés).
malgré l'intérêt croissant de l'institution etdu public pour ce patrimoine de mieux enmieux conservé, le musée resteconfidentiel. Ce paradoxe se ressent àplusieurs niveaux. Alors qu'aucunecommunication institutionnelle n'estréalisée, le musée apparaît, dès la fin desannées 1980 et jusque dans les années2000, dans plusieurs guides touristiquesce qui suscite un intérêt du grand publicqui est malgré tout refréné par lesconditions d'accueil. Seules les visites surrendez-vous sont autorisées et un passageau poste de sécurité de l'école estobligatoire. Cela a pour conséquence unniveau de visites qui ne dépasse pas 5 725personnes pour la meilleure année (1997)avec un public essentiellement constituéd'affinitaires (militaires, gendarmes,pompiers, policiers, familles degendarmes, retraités de l'Arme,associations d'anciens, etc.). Cette faiblefréquentation cantonne le musée à saconfidentialité jusqu'à ce qu'uneconjonction d'éléments commence peu àpeu à faire sortir le musée de l'ombre.
Un écrin et une appellation « Musée deFrance » à la mesure de la valeur descollections.À la fin des années 1990, le directeurgénéral de la gendarmerie nationale posele principe de la rénovation du musée de lagendarmerie. Son ambition est de l'ouvrir
de dons de gendarmes d'active, deretraités, de réservistes ou encore dedescendants de gendarmes.
Cette collection s'étoffe au fil des annéesmais aucune réelle politiqued'enrichissement n'est définie. Au départ,le commandant d'école accepte ce qui luisemble intéressant sans obligatoirementchercher à combler les lacunes existantes.Cependant la gendarmerie prend encompte un patrimoine qu'elle n'a que trèsrarement considéré, son organisation etses missions ne favorisant pas (saufexception notamment au sein de la garderépublicaine) la conservation des témoinsde son histoire. Les pièces de collection sefaisant toujours plus nombreuses, lemusée déménage en 1969 et s'installedans un bâtiment voisin qui lui offre uneplus grande superficie. Celui-ci n'esttoujours pas accessible au grand public.Les élèves de l'école, dont le cursuscomprend une visite obligatoire,constituent la majorité des visiteurs. Lemusée continue à se développer et unbudget d'acquisition est mis en place. De
36
PRÉSENTATION
LA GrAnDE GuErrE Au muSéE DE LA GEnDArmErIE nATIonALE
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
La construction lente d'une collection de valeurmais peu accessible
mus
ée d
e la
gen
dar
mer
ie
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page36
au grand public et de le hisser au rang desautres musées militaires existants. Desétudes sont mises en œuvre et l'idéed'ouvrir ce musée à Paris ou tout près(Vincennes par exemple) est avancée.Parallèlement, les élus de la ville de melundécouvrent les collections qui sommeillentau sein de l'école. Persuadés du potentield'un tel patrimoine, ils proposent àl'institution de participer à la rénovation dece musée à la condition qu'il s'ancre àmelun, berceau de la formation desofficiers de la gendarmerie. L'objectif estdouble : d'un côté fournir un équipementculturel de qualité accessible au plus grandnombre et de l'autre, dynamiser le territoireet le rendre attractif aux plans économiqueet touristique. C'est ainsi qu'en 2005, laCommunauté d'agglomération melun-Valde Seine (récemment constituée), la ville demelun et le ministère de la Défense seréunissent autour de la signature d'unprotocole. La Communautéd'agglomération prévoit alors de prendreen charge l'investissement, la gendarmeries'engage à subvenir au fonctionnement etla ville de melun propose l'aménagementdes abords directs du nouvel équipement.
En 2010, le projet de rénovation est confiéau cabinet d'architectes parisien de renommoatti & rivière (Historial Charles de Gaulleaux Invalides, Cité internationale de ladentelle à Calais, musée des écritures dumonde à Figeac). Conçu comme unevéritable vitrine pour l'institution et commeun vecteur de notoriété incontournable, ilsera une porte ouverte sur l'Arme danstoutes ses dimensions (historique, actuelle,
internationale). Fondé sur un parcoursmuséographique conçu par lesscénographes de Scénos-Associés liantl'histoire de France à l'histoire del'institution et débouchant sur lagendarmerie actuelle à travers sesspécialités et domaines d'excellence, lemusée constituera également un outiladossé au Centre de recherche de l'EoGnpour l'organisation de colloques et deconférences.
Grâce à la richesse des collectionspréservées et à la qualité de son projetscientifique et culturel, le musée de lagendarmerie reçoit, en 2011, l'appellationmusée de France. L'ouverture de cenouveau musée est désormais prévue aumois d'octobre 2015. Véritable muséed'histoire et de société, plus qu'unconservatoire de la mémoire militaire del'Arme, il sera accessible à tous les publics(scolaires, familles, handicapés,chercheurs, etc.).
le patrimoine des gendarmes pendantla Première Guerre mondialeLes collections consacrées à la PremièreGuerre mondiale conservées au musée dela gendarmerie représentent plus de trois
PRÉSENTATION
LA GrAnDE GuErrE Au muSéE DE LA GEnDArmErIE nATIonALE
371ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
Maquette du projet de rénovation (Cabinet Moatti& Rivière) : un espace ouvert sur la ville.
Cab
inet
moa
tti &
riv
ière
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page37
de relèves), trouve sa place dans lescollections sous différentes formes : le« prévôt », en 1914, part dans la zone desarmées dans sa tenue de service en tempsde paix. Aucun ajustement n'est réalisé sice n'est l'ajout d'un couvre casque cachoupour les cavaliers et d'un couvre képi bleupour les gendarmes à pied à des fins decamouflage. Quelques effets decampement (bouthéon, gamelle, etc.) sontfournis par les autres corps d'armée. Lerevolver 1892 constitue le principalarmement. En 1915, le gendarme prévôtal(puis le gendarme de la zone des arméeset enfin le gendarme de l'intérieur) est dotéde la tenue dite bleu horizon. Ses effetssont alors les mêmes que ceux de latroupe à l'exception du passepoil de laculotte qui revêt la couleur blanche, desgrenades présentes sur le col de latunique, du galon d'élite et de la grenadearborés sur le képi.
Pièce unique de la collection (le muséen'en possède qu'un exemplaire), la culottebleu horizon à passepoil blanc a étéachetée, en 1987, avec une capote et unképi également bleu horizon pour 2 400francs. En novembre 1915, le gendarmeprévôtal est doté d'un nouveau casquefabriqué en acier. Il s'agit du casque ditAdrian du nom du sous-intendant Adrian,qui le présente au général Joffre avant sonadoption. Des brisques d'anciennetépeuvent se retrouver sur la manchegauche des tuniques. Elles indiquent lenombre d'années passées dans la zonedes armées (la première brisque pour 1 anet les suivantes pour 6 mois). Plus les
cents items provenant en grande partie dedons mais aussi d'achats. Là encore, lesobjets concernés sont variés. Sont ainsiinventoriés des armes à feu, des armesblanches, des pièces d'uniformes, descoiffures, des objets du quotidien, desarchives, des photographies, des œuvresgraphiques, des médailles et desdécorations.
Certains de ces objets peuvent êtreassemblés afin de former des silhouettesde gendarmes dans diverses situations : àl'intérieur, en prévôté et au combat,traduisant la multiplicité des rôles qu'ontjoué les gendarmes pendant les quatreannées du conflit. Au début de la guerre, legendarme départemental, resté à l'intérieurporte la tunique et le képi modèle 1895. Ilpeut également revêtir le bonnet de policenotamment en position de repos. Pour lagrande tenue, les gendarmes sont dotésdu casque modèle 1912. L'uniforme estrapidement complété par une tenue d'étéissue de la tenue kaki portée en Corse eten Afrique du nord. En effet, en juillet1915, l'autorisation est accordée aux
officiers, adjudants-chefs(2) et adjudantsde toutes armes de
porter la tenue kaki, l'été, sur ordre ducommandement. Cet uniforme estégalement revêtu sur le front d'orient parles gendarmes constituant la prévôté. Latenue dite bleu horizon est égalementprévue pour les gendarmes de l'intérieur.
Le gendarme prévôtal (rappelons que laplupart des gendarmes départementaux aconnu la prévôté du fait de l'organisation
(2) Le grade d'adjudant-chef apparaît en 1912 dansl'armée et en 1916 dans lagendarmerie.
38
PRÉSENTATION
LA GrAnDE GuErrE Au muSéE DE LA GEnDArmErIE nATIonALE
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page38
du quotidien tels que du matériel decampagne, des sacoches decorrespondance, des mémentos, deséquipements de sûreté (menottes,cabriolets de conduite), etc. À travers cettepart de l'histoire de l'Arme, traduite par cessilhouettes reconstituées, se distinguentaussi des histoires particulières qui seracontent grâce aux témoins reçus aumusée et à la mémoire collectée.
les histoires racontent l'Histoire Le patrimoine lié à la Première Guerremondiale sera présenté, dans le futurmusée de la gendarmerie, dans une salleentièrement dédiée à cette période, situéeau deuxième étage du parcourspermanent. Deux mannequins (gendarmecombattant en tenue bleu horizon /gendarme prévôtal en tenue kaki frontd'orient) seront installés dans cette salle etdeux autres (officier de gendarmeriepartant en prévôté en 1914 / gendarmedépartemental en tenue bleu horizon)seront exposés dans la grande vitrinesuspendue, leur faisant écho. outre cesmannequins anonymes reconstitués dansle but de représenter une fonction et au-delà des missions et des conditionsd'exercice particulières, des hommes dontl'histoire a retenu le nom seront mis envaleur. Du lieutenant Fontan, le muséeconserve, grâce au don de son neveu, lesmenottes qu'il portait lors de l'arrestationde Jules Bonnot, son revolver 1892, sesdécorations et un fonds photographiquede plus d'une vingtaine de clichés.
Les deux filles du capitaine Pogu, un desofficiers de gendarmerie les plus cités de la
39
brisques sont nombreuses, plus longtempsle militaire est resté dans la zone desarmées, d'où l'expression « vieuxbriscard ».
Le combattant volontaire est égalementprésent. Sa tenue est celle de l'unité danslaquelle il est détaché pour le combat. uneculotte bleu horizon avec passepoiljonquille est conservée dans les collectionsdu musée. Assorti d'une tunique bleuhorizon, le combattant représenté peutainsi être un gendarme affecté dans unrégiment de chasseurs à pied. Dans lesannées 1990, différents casques Adrianont été acquis (au magasin « Le Poilu » àParis) pour évoquer le rôle des gendarmescombattants : casques de l'infanterie, del'armée d'Afrique (zouaves et tirailleurs), del'armée coloniale et des chasseurs à pied.
Ces différentes tenues de gendarmes sontcomplétées par des accessoires et objets
PRÉSENTATION
LA GrAnDE GuErrE Au muSéE DE LA GEnDArmErIE nATIonALE
1ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
La gendarmerie adopte la tenue bleuehorizon en 1915.
mus
ée d
e la
gen
dar
mer
ie
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page39
fait changer les jugulaires de leur casquemodèle 1912 pour des exemplaires plusouvragés. or le capitaine Jarlot les aconservées dans leur forme d'origine, ceque l'équipe du musée n'a jamais encoreconstaté pour un autre officier.
Pour clore cette liste, citons le chefd'escadron merlhe, un des dix-sept gardesrépublicains devenus pilotes observateursà partir de 1916. De sa carrière, le muséeconserve des photos, sa légion d'honneur,une paire d'étriers. Chaque pièce decollection véhicule une part de l'histoire. Sil'histoire même de la pièce peut êtredécelée, un travail de recontextualisationpeut se mettre en œuvre. Le cas particulierpermet au cadre général de prendre toutson sens.
Enfin, il ne faut pas oublier ladocumentation, au sens large, car elle estla source première de la recherchehistorique. Elle recèle des trésors aumusée de la gendarmerie notamment leshistoriques de légions pendant la GrandeGuerre. une affiche de mobilisation a ainsiété achetée en 1981. Trois carnets de
Première Guerre mondiale (sept fois dontdeux à l'ordre de l'armée), ont offert aumusée de la gendarmerie quelques effetsde leur père : sa canne, son curvimètre,son pistolet d'alarme, sa boussole, sesdécorations. Ce capitaine de gendarmeriedépartementale a été requis pour laprévôté avant de s'engager commecombattant au sein du 155e régimentd'infanterie. Ayant participé aux deuxactions qui ont valu à son régiment d'êtrecité à l'ordre de l'armée, il obtient le droitde porter la fourragère à titre personnel ycompris sur sa tenue de gendarme.
La famille de l'adjudant Cartery a donné aumusée son casque Adrian portant laplaque commémorative de la GrandeGuerre tandis que l'équipe du muséefaisait l'acquisition, pour 1 500 francs de lacantine du gendarme Camerlinkrenfermant une tenue de corvée, unetunique, un képi, des boutons, desmanchettes et autres accessoires (1985).
Le capitaine Jarlot, major de la premièrepromotion d'officiers de l'écoled'application de la gendarmerie (créée ausein de la caserne Schomberg, à Paris, en1901), a participé aux événements de1914 – 1918 en tant que gendarme del'intérieur puis comme gendarme prévôtal.En 2002, sa petite-nièce a offert au muséele casque Adrian de l'officier ainsi que sonrevolver 1892 dans un état quasi neuf, sonsabre modèle 1822 modifié 1885 et sontapis de selle. Son casque 1912 complètece fonds avec une particularité. Alorsqu'aucun règlement ne le prévoit, lesofficiers de gendarmerie ont très largement
40
PRÉSENTATION
LA GrAnDE GuErrE Au muSéE DE LA GEnDArmErIE nATIonALE
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
Arme du Capitaine Fontan et menottesqu’il passa à Jules Bonnot.
mus
ée d
e la
gen
dar
mer
ie
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page40
du métier de gendarme pendant la guerre.Le personnage du gendarme lui-mêmesera mis en valeur à travers son quotidien,ses relations avec son entourage, safamille, son institution et les autres armées.Pour garantir la rigueur scientifique del'événement, le commissariat del'exposition a été confié à Louis n. Panel,conservateur du patrimoine et docteur enhistoire, spécialiste de la gendarmerie entre1914 et 1918. Ce dernier a constitué lecomité scientifique de l'exposition autourdu général Bach, du général Philippot, desprofesseurs Becker, Boniface, Cochet, Lucet des spécialistes Farcy, Grandhomme etLe naour. L'ouverture du musée de lagendarmerie nationale en 2015 luipermettra d'inscrire sa première expositiontemporaire dans une dynamiqueinternationale liée aux commémorations ducentenaire de la Première Guerre mondiale.
Alors que 2014 est conçue comme l'unedes années phare de cescommémorations, 2015, bien queconstellée d’événements culturels, trouveraun écho supplémentaire dansl'inauguration de l'exposition « La grandeGuerre des gendarmes », d'ores et déjàlabellisée par la mission du centenaire.Exposition de dimension internationale parle biais de sa thématique et du lieud'accueil, « La Grande Guerre desgendarmes », accessible à tous lespublics, permettra au musée de lagendarmerie de faire tomber les idéesreçues, de mettre en valeur les réellesmissions et la complexité du rôle dugendarme tout en valorisant son nouvelécrin.
41
notes du gendarme Joseph Duprat ontégalement été acquis auprès d'unparticulier anglais en 2007. Des fondsprivés offerts au musée dont le fond ducolonel de gendarmerie Lélu contient desdocuments originaux tels qu'un« Indicateur du permissionnaire » daté du15 octobre 1917 permettant aux militairesen permission de savoir commentregagner leur domicile par voie ferrée àpartir du front et comment y revenir(horaires, correspondances des trains,cartographie du réseau, etc.). Cet officier,capitaine au moment de la guerre, étaitaffecté à la prévôté de la 43e divisiond'infanterie et a également laissé un cahierdans lequel il copiait ses lettres rendantcompte de l'activité de sa prévôté entre le5 avril et le 10 octobre 1915.
Une première exposition temporairedédiée à la Grande Guerre desgendarmesFinalement, un dixième de la collection liéeà la Première Guerre mondiale sera exposéau sein du parcours permanent du futurmusée. Les ensembles cohérentspermettant de remettre les objets dans leurcontexte ont été privilégiés, la superficiedisponible interdisant une présentationexhaustive. néanmoins, afin de permettreau grand public d'avoir une vision encoreplus précise du sujet, la premièreexposition temporaire du musée seraconsacrée à « la Grande Guerre desgendarmes ».
Labellisée par la mission centenaire, cetteexposition a pour ambition de faire lalumière sur nombre d'aspects méconnus
PRÉSENTATION
LA GrAnDE GuErrE Au muSéE DE LA GEnDArmErIE nATIonALE
1ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page41
UN ENGAGEMENT MAITRISESUR TOUT lE SPECTRE DESOPERATIONS
> Quels sont les facteursde la réussite de l’engagementdes carabiniers dans la GrandeGuerre ?
£ Une légitimité par un engagement sur lefront de l’intérieur et les fronts extérieursavec une expérience militaire affirmée. Descombats sur des phases essentielles duconflit : Podgora, Caporetto,…tant dans lecadre d’affrontements directs que decombats de flanc-garde ou de coups d’arrêt.
£ Une transposition du service spécial civilaux armées maîtrisée par une montée enpuissance au moyen d’une réorganisation enpelotons prévôtaux et l’incorporationd’auxiliaires issus des armées. Une capacitéà maintenir une pression à l’intérieur enterme de maintien de l’ordre.
£ Une bonne articulation entre l’activité detranchées auprès des unités opérationnelleset celles de l’arrière. Une aptitude manifesteà gérer les flux lors de basculements defronts ou l’encadrement de retraitesdélicates : police de la circulation, combatsd’arrière-garde, redirection des troupesdébandées, chasse aux déserteurs.
INTERNATIONAl
42 Revue de la Gendarmerie Nationale 4e trimestre 2014
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page42
INTERNATIONAl
43
les carabiniers italiens dans laGrande Guerre : arme combattanteet force de l’ordre
Au cours de la Grande Guerre, lescarabiniers royaux italiens ontparticipé activement sur plusieursfronts à toutes sortes d’activités àcaractère militaire. Ils le firent commecombattants du « régiment de
carabiniers demarche »(1), en tantque carabiniers
aviateurs et arditi, en exécutant lapolice militaire à la suite des troupescombattantes et aux arrières, et dansle cadre des missions des forces del’ordre sur le territoire national.
les évolutionsd’emploi de l’armedes carabiniersdans lesopérations deguerreLes carabiniers ontété présents duranttoutes lesopérations militaires
(1) Le « regimento deicarabinieri reali mobilitato »constitué dès la mobilisationde mai 1915 (ndt).
Ade l’histoire italienne, à commencer par labataille de Grenoble en 1815. À partir de1822, les carabiniers du royaume deSardaigne assumèrent également lesfonctions de police militaire, ainsi que deforce de l’ordre à statut militaire et à
compétencegénérale(2). Ainsipeut-on affirmer que,dès le début de leur
histoire bicentenaire, les carabiniers ontjoué plusieurs rôles : force de l’ordre,police militaire, arme combattante, et quetoutes ces missions furent régulièrementaccomplies au cours de la GrandeGuerre.
Les carabiniers avaient déjà eu l’occasiond’acquérir une expérience importantedans le domaine de la police militairecomme dans les combats aux côtés desunités régulières de l'armée italiennedurant la guerre italo-turque en 1911-1912. Au début des hostilités entre l’Italieet l’Autriche-Hongrie, en mai 1915, un
(2) Giuliano Ferrari, LaPolizia Militare profili storici,giuridici e d’impiego,Supplément du n° 2 de laRassegna dell’Arma deiCarabinieri, Avril-Juin 1993.
par FlAvIo cArBoNe (TrADUcTIoN De M. loUIs-N PANel)
1ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
FlAvIo cArBoNe
lieutenant-colonel, chefde la sectiondocumentationdu Service historique descarabiniers.
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page43
régiment de carabiniers royaux de marchefut créé à l’effectif de 65 officiers etenviron 2 500 sous-officiers etcarabiniers. S’y ajoutèrent ensuite ungroupe d’escadrons de carabiniers àcheval, 257 pelotons et 168 sectionsprévôtales, soit un total d’environ500 officiers et 20 000 sous-officiers etcarabiniers.
Le régiment et le groupe d’escadronsconstituèrent de véritables unités decombat tandis que les sections etpelotons furent affectés, essentiellementpour des services de police militaire, aucommandement en chef, aux servicesgénéraux, aux commandements et auxservices d’armées et enfin à chaquedivision d’infanterie et de cavalerie. Dansces dernières, les carabiniers agirent nonseulement sur les arrières, mais encore enpremières lignes, aux postes médicaux,
aux sorties des tranchées, aux passagesobligés, le long des routes et desitinéraires des troupes d’opération. Parmiles nombreuses missions qui leur furentassignées, on peut citer : la mobilisationdes soldats et des citoyens, latransmission des ordres, les services desécurité, la police judiciaire pour lescrimes militaires et de droit commun, lasurveillance sanitaire, l’assistance auxblessés, le maintien de l’ordre public dansles agglomérations, la sûreté descommunications, la prévention et larépression de l’espionnage.
Il faut signaler que les carabiniers sedistinguèrent durant les batailles del’Isonzo, du Carso, du Piave, sur lesmonts Sabotin et Saint-michel etparticulièrement dans les combats sur lespentes de Podgora. Au cours du conflit,environ 1 400 carabiniers moururent et5 000 furent blessés. À la fin desopérations une croix de l’ordre militaire deSavoie, quatre médailles d’or de la valeurmilitaire, 304 d’argent, 831 de bronze,801 croix de guerre de la valeur militaireet un millier de citations à l’ordre furentattribués à des unités constituées ou àtitre individuel.
Le 5 juin 1920, pour l’ensemble de sesopérations de guerre, le drapeau del’arme des carabiniers reçut sa premièremédaille d’or de la valeur militaire avec lacitation suivante : « a renouvelé ses plusfières traditions par d’innombrablespreuves d’attachement tenace au devoir
INTERNATIONAl
LES CArABInIErS ITALIEnS DAnS LA GrAnDE GuErrE : ArmE ComBATTAnTE ET ForCE DE L’orDrE
44
Position de carabiniers sur les pentes du montPodgora.
Aut
ore:
red
azio
ne c
atal
ogo
foto
graf
ico
cara
bin
ieri
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page44
et de brillant héroïsme, apportant uneprécieuse contribution à la victoire desarmes de l’Italie ». Dès lors, le 5 juindevint officiellement la date de célébrationde la fondation de l’arme.
les carabiniers combattantsEn ce qui concerne son rôle comme armecombattante, on pense principalement aurégiment de carabiniers royaux demarche. Cette unité, aux ordres ducolonel Antonio Vannugli, organisée entrois bataillons, fut mobilisée au début deshostilités et composée de militairesprovenant principalement de la légion-école, c’est-à-dire de jeunes carabiniersnouvellement promus.
La formation fut engagée à partir de juilletdevant le mont Podgora, près de Gorizia,en remplacement d’une formationd’infanterie. La mission du régimentconsistait à combler une couverture queles unités de la IIIe armée auraient dûassurer pour entrer aussitôt dans la villede Gorizia. Ainsi, le régiment fut cantonnéprès du front pour être déployé le 7 juillet.La reconnaissance du champ de bataillecommença et conduisit le régiment àsortir avec fougue de la tranchée le19 juillet pour conquérir la cote 240 dumont Podgora. L’inefficacité de l’action del’artillerie italienne, la résistance desdéfenses autrichiennes et la présence depositions de mitrailleuses, en plus d’unemeilleure exploitation du terrain, permirentaux Austro-Hongrois de maintenir leurposition. Au terme d’une intense journée
de combats, le bilan fut de 53 tués,143 blessés et 10 disparus parmi lesmilitaires de tous grades du régiment decarabiniers. Pour leurs faits d’arme, ilsreçurent neuf médailles d’argent de lavaleur militaire, 33 médailles de bronze et13 croix de la valeur militaire. Lecommandant de la brigade « Pistoia »,dans un document établi à ce moment-là,écrivit que les carabiniers « restèrentfermes et impassibles sous la tempête deplomb et de fer qui faisait rage de toutepart ».
Le 10 octobre 1917, Emmanuel-Philibertde Savoie, duc d’Aoste et commandantde la IIIe Armée, au cours d’unecérémonie de remise de la médaille de lavaleur militaire aux carabiniers de sonarmée rappela que « sur le Podgora,pendant les journées mémorables dejuillet 1915, organisés en régiment, vousavez donné des preuves de la plusgrande ténacité, restant fermes etimpavides sous la furieuse tempêteennemie de fer et de feu, décimés, maisnon affaiblis ». Ces déclarationstémoignent de l’importance de l’impôt dusang versé par les carabiniers dans lestout premiers mois de la guerre.
En septembre 1915, le régiment futrestructuré et les 3 bataillons, en partiereconstitués et réorganisés encompagnies autonomes, furent affectésaux unités dépendantes ducommandement en chef des IIe et IIIe
armées. En 1916, de ces unités furent
INTERNATIONAl
LES CArABInIErS ITALIEnS DAnS LA GrAnDE GuErrE : ArmE ComBATTAnTE ET ForCE DE L’orDrE
451ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page45
d’arme combattante, de nombreuxcarabiniers de tous grades sedistinguèrent dans la guerre de la3e dimension, comme pilotesenthousiastes de machines volantes. untotal de 173 officiers, sous-officiers etcarabiniers avait rejoint l’expérimentationde la toute jeune aéronautique italiennesur le champ de bataille. Il faut citer enparticulier l’un d’eux, Ernesto Cabruna.Entré au service comme simple carabinier,il intégra la nouvelle armée de l’air commecapitaine pilote dans les années 1920. Ilfut un véritable as de l’aviation naissanteet décoré de la médaille d’or de la valeurmilitaire.
outre Cabruna, bien d’autres sedistinguèrent et reçurent d’importantesdistinctions. Parmi eux, citons le brigadier
remaniées et 39 nouveaux pelotons decarabiniers royaux furent constitués pourles besoins de la police militaire.
En conséquence de la Strafexpedition del’année, il devint nécessaire de déplacerde l’Isonzo sur le front des alpes « plus de400 000 hommes, 75 000 bêtes et80 000 véhicules, avec une forcelogistique qui vit pour la première fois lescarabiniers impliqués dans l’organisationde la circulation routière militaire à grandeéchelle ». En outre, « pour renforcer latenue des unités, vu le niveau des pertesévidentes, qui attinrent le chiffre de190 000 hommes, des postes decarabiniers furent déconcentrés auprès
des états-majors desbrigadesendivisionnées »(3).
on peut doncaffirmer que, pour lescarabiniers, une fois
assumée la fonction d’arme combattante,il devint nécessaire de renforcer les unitésde police militaire prévues dès le tempsde paix. La transformation et lacroissance exponentielle de l’armée demobilisation avaient rendu indispensablede recourir à un nombre toujours plusgrand de carabiniers. Leurs petites unitésse distinguèrent au cours de la guerre,non seulement par leurs fonctions depolice militaire, mais aussi celles dedétachements combattants sur les flancsdes unités engagées en premières lignes.
De fait, en ce qui concerne les activités
(3) Ferrari souligne qu’« avecelle [la bataille de Podgora]se vérifie le principe, toujoursrespecté par les carabiniers,qu’une bonne police militairetire son prestige et sonautorité du fait de sedistinguer au combat ». G.Ferrari, La Polizia Militare,op. cit., pp. 107-108.
46 Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
INTERNATIONAl
LES CArABInIErS ITALIEnS DAnS LA GrAnDE GuErrE : ArmE ComBATTAnTE ET ForCE DE L’orDrE
Spad S.VII d’Ernesto Cabruna “Un contre dix”.
serv
ice
hist
oriq
ue c
arab
inie
ri
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page46
de l’escadron de garde royale – lesfameux cuirassiers – Albino mocellin,décoré de la médaille d’argent de lavaleur militaire, qui fut parmi les premierspilotes à tomber en combat aérien aucours du conflit.
la police militaireEn règle générale, la prévôté s’apparentaità une section de carabiniers attachée àun état-major de grande unité. Jusqu'à laPremière Guerre mondiale, le conceptprévaut encore d'emploi de massesd'hommes encadrés et contraints decombattre selon des doctrines désormaisobsolètes. Ce mode d’organisation futmaintenu jusqu’en mai 1916, lorsqu’il futprocédé à une remise en ordre des unitésprésentes sur le front. Elle donna lieu àune forte croissance des unitésorganiques avec l’institution de pelotonsprévôtaux à pied en renfort des sectionsdéjà existantes qui ne parvenaient plus àassumer leurs nombreuses missions quileur avaient été progressivementassignées.
Pour donner une idée du service, lesmissions des unités de carabiniers étaientles suivantes : « service de policegénérale, service de sauvegarde, serviced’escorte, de guide et de garde auprèsdes états-majors, service de courrierpostal, charges et missions de confiance.Tous ces services, sauf celui du courrier,étaient assurés par des carabiniersdégagés des sections attachées auxétats-majors des grandes unités ». L’armedes carabiniers royaux reproduisait ainsi
l’activité de contrôle qu’elle avait déjà misen œuvre dans la société italienne. Elleétendait sur un mode plus opérationneltoutes les activités qu’elle assumait déjàau titre du service spécial.
une manifestation de la transposition desactivités du service spécial de la sociétécivile à la société militaire apparutclairement lorsqu’il fut affirmé que « lescarabiniers des sections sont considéréscomme toujours en service, ils ont touteliberté de circulation, et dans l'exercice deleurs fonctions ne doivent pas êtredistraits ou retenus par qui que ce soit.Lorsque, pour accomplir les missions quileur sont confiées, ils réclament unrenfort, il doit être accordé dans la
mesure jugéeappropriée par lecommandant destroupes auquel lademande estadressée » (4).
une autre mission confiée aux carabiniersroyaux prévôtaux fut de patrouiller sur lechamp de bataille après l’action, pourprocéder à l’arrestation des « personnesqui s’y trouvaient dans le but de piller ».Entre-temps, la surveillance des routes futaméliorée avec la constitution de postesde reconnaissance pour réguler l’accèsdes hommes et du matériel dans la zonedes opérations.
Les carabiniers, en particulier le capitaineVittorio Bellipanni, furent cités par legrand poète Gabriele d’Annunzio lorsque
(4) Comando Generaledell’Arma dei Carabinierireali, Stralcio del Servizio inGuerra – Parte i. Serviziodelle truppe – riguardantel’Arma dei Carabinieri Reali,roma, Voghera Editore,1914, p. 4 (par analogieavec les dispositions del’article 1 du décretorganique adopté en 1912).
471ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
INTERNATIONAl
LES CArABInIErS ITALIEnS DAnS LA GrAnDE GuErrE : ArmE ComBATTAnTE ET ForCE DE L’orDrE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page47
48
réguler le flux de réfugiés; réprimer dansl’œuf toute velléité de révolte. À cesmissions, plus proprement militaires,s’ajoutait la participation directe auxcombats : les unités de l’armeconcoururent en effet activement, soit àdifférents combats d'arrière-garde, soitplus particulièrement à la défensetemporaire de lignes d'arrêt sur leTagliamento et le Livenza, et de lanouvelle position défensive elle-même,sur le Piave. [...] Les sections déjàplacées à la suite des grandes unités [...]en suivirent le sort en tous points : parmielles, se distinguèrent la 31e et la73e sections, ainsi que les 229e et288e pelotons, cités solennellement; legroupe d’escadrons et le bataillonautonome, à la disposition ducommandement en chef, furent déployéssur le Piave où ils participèrent au coupd’arrêt, au cours duquel, le 1er décembre,fut recréé en urgence le hautcommandement des carabiniers
royaux »(5) qui avaitété dissous quelque
temps auparavant.
Carabiniers force de l’ordreFerrari résumait ainsi l’effectif de l’armeauprès des armées en campagne audébut des hostilités : « Dans l'ensemble,donc, les prévôtés ont nécessité l'emploid'environ 80 officiers et 3 000 sous-officiers et carabiniers : une part déjàconsidérable, par rapport aux effectifs del’arme, à l'époque inférieur à
(5) G. Ferrari, La PoliziaMilitare, op cit., pp. 111-112.
celui-ci prononça, le 12 juin 1917,l’oraison funèbre de son ami,mortellement blessé au cours de la10e bataille de l’Isonzo tandis qu’ilramenait au combat un détachement quis’était débandé. En peu de lignes, cetexte parvient à rendre puissamment leservice des carabiniers au front : « c’estl’arme de la fidélité immobile et del’abnégation silencieuse, l’arme qui dansla profondeur des lignes et de-là dans labataille, dans la tranchée et sur les routes,dans la ville détruite et sur le cheminbouleversé, dans le danger soudain et lerisque permanent, donne tous les joursles preuves d’une valeur d’autant plusglorieuse que la gloire est plus rare ;l’arme des Carabiniers du Roi inscritaujourd'hui le nom du capitaine VittorioBellipanni sur les tables des grandsexemples ».
Au cours des événements de la retraitequi suivit la percée austro-allemande deCaporetto en octobre 1917, Ferrari asouligné que « la contribution descarabiniers fut certainementdéterminante : sans leur travail acharné etsouvent très ingrat, elle [la retraite]n’aurait pas été possible. Le principalennemi contre lequel le corps dut sebattre fut certainement la panique. Lesprincipales missions furent d’endiguer lesdébandades et les désertions, au besoinpar l’usage des armes, de convoyer lesunités en retraite, régulant les étapes pouréviter l’encombrement des itinéraires, de
INTERNATIONAl
LES CArABInIErS ITALIEnS DAnS LA GrAnDE GuErrE : ArmE ComBATTAnTE ET ForCE DE L’orDrE
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page48
l'organisation de l’arme intervint sur cesujet, tandis qu’avec un second décret du23 avril 1917, une nouvelle réorganisationde l’ordre de bataille fut prévue, bien quedictée par des besoins par naturetemporaires. Fut établie « l’institutiontemporaire du commandement supérieurde l'arme par les commandants desgroupes de légions, destinés à alléger lecommandement supérieur d'un ensemblecomplexe d’attributions relatives à ladiscipline, l'administration et le servicespécial des légions, désormaisaugmentées en nombre et renforcées, etconçus pour faire sentir plus étroitementet efficacement aux légions elles-mêmesl'action supérieure d’inspection et decontrôle ».
49
30 000 hommes, dispersés dans ungrand nombre d’unitésterritoriales »(6).
La bonne performance dans la bataille etle maintien dans la discipline de l’arméeau cours de la bataille du solstice (21 juin1918) ont eu pour effet de renvoyer unepartie des carabiniers du service au frontvers le service intérieur, surtout pour lemaintien de l'ordre public et la traque desdéserteurs dans les villes et lescampagnes.
Alors que les besoins de l'avant étaienttoujours plus pressants, il devintnécessaire de traiter également ceux del’intérieur donnant lieu à uneréorganisation territoriale des carabiniers.un premier décret de 1916 (n° 1314) sur
(6) ibid., p. 106.
INTERNATIONAl
LES CArABInIErS ITALIEnS DAnS LA GrAnDE GuErrE : ArmE ComBATTAnTE ET ForCE DE L’orDrE
1ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
Un corps d’élite qui sut couvrir des missions délicates et complexes
red
azio
ne c
atal
ogo
foto
graf
ico
cara
bin
ieri
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page49
50
En août 1918, le service de surveillance etde contrôle sur tout le territoire de la zonede guerre fut confié à l’arme descarabiniers, dans ses composantesmobiles et territoriales. Les buts duservice étaient : garantir la sécurité duterritoire contre les infiltrations ennemies,empêcher la circulation des espions oudes éléments dangereux, juguler ladébandade ou l’éloignement excessif desmilitaires isolés, assurer la circulationrégulière des troupes ou des convois surles voies de communication et veiller à lastricte observation des règles de policede la route. Le service était accompli avecl’aide de postes fixes de barrage et decontrôle, de patrouilles de liaison et desurveillance, et d’escadrons mobiles.
Une référenceA partir de la guerre italo-turque, « laparticipation des unités de carabiniersauprès des grandes unités de combat aucours des campagnes successivesenregistra une remarquable montée enpuissance. Pendant la Première Guerremondiale, les hommes de l'armeemployés dans les prévôtés des arméesen campagne (commandement en chef,armées, corps d'armée, divisions,intendances, inspections des arrières,etc.) attinrent le chiffre de 20 545personnes réparties en sections et
pelotons, dans untotal de424 unités » (8).
(8) Pietro Verri, La poliziamilitare attraverso i tempi,rome, Comando Generaledell’Arma dei Carabinieri,1975, pp. 247-248.
En outre, à partir de 1917, il fallut recourirà des auxiliaires, recrutés parmi lesmeilleurs éléments des troupes de ligne,pour faire face aux exigences d’ordrepublic à l’intérieur et de maintien de ladiscipline parmi les troupes au front.
Pendant toute la guerre, l’articulation et lacoordination entre l’activité de tranchéesauprès des unités opérationnelles etcelles de l’arrière rendit à l’armée desservices irremplaçables et il fut nécessaired’augmenter le nombre de carabiniersemployés. Au moment de la dernièrebataille, ils avoisinaient les 19 500 sous-officiers et carabiniers, sous les ordres de488 officiers. « Cela signifie notammentque l’effectif total de l’arme à ce momentétant de 31 300 hommes, le servicespécial, la police judiciaire et les autresservices particuliers sur tout le territoiredurent être assurés juste par les11 200 carabiniers restant : moitié moinsqu’en temps normal ». Pour donner uneidée de la lourdeur du service qui vint àpeser sur l’arme à l’intérieur, il suffit derappeler que 93 532 déserteurs etinsoumis furent arrêtés (outre 35 000hommes qui se présentèrentspontanément) et que 142 000 hommesen absence illégale furent renvoyés surleurs corps. Durant cette mission, lescarabiniers endurèrent 719 cas d’usage
des armes et eurent22 morts et 189blessés(7).
(7) rutilio Sermonti, iCarabinieri nella storiad’italia, rome, CentroEditoriale nazionale, 1984,p. 758.
INTERNATIONAl
LES CArABInIErS ITALIEnS DAnS LA GrAnDE GuErrE : ArmE ComBATTAnTE ET ForCE DE L’orDrE
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page50
51
Les récompenses attribuées auxdétachements ou aux militaires quicombattirent sur le front témoignent de lacontribution apportée par l’institutionentière dans l’une des deux périodes lesplus complexes et difficiles pour le jeuneétat italien, qui avait célébré depuis peules cinquante ans de son unité. nonseulement du fait d’un impôt trop lourd dusang, les carabiniers italiens sedistinguèrent, dans des circonstancesextraordinaires, en constituant uneréférence pour des citoyens en uniforme.
INTERNATIONAl
LES CArABInIErS ITALIEnS DAnS LA GrAnDE GuErrE : ArmE ComBATTAnTE ET ForCE DE L’orDrE
1ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
AllER PlUS lOIN
Le lieutenant-colonel Flavio Carbone, chefde la section documentation du servicehistorique des carabiniers est Docteur enhistoire. Il a soutenu à l’université deRome–La Sapienza une thèse sur lerecrutement et la formation des officiersde l’arme des carabiniers de 1883 à 1926.
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page51
lA MARCHE VERSl’AUTONOMIEINSTITUTIONNEllE
> Comment distinguer lesmodalités d’action de lagendarmerie Belge pendantle conflit ?
£ Pendant l’invasion, les unitésterritoriales incarnent un ordre nationaldans les zones sous contrôle belge. Ellesassurent des fonctions de prévôté tout enparticipant aux combats. Elles vivent unécartèlement hiérarchique entre lesautorités militaires, judiciaires et civiles.
£ Lors de la reconquête, un plancomprend une restructuration territoriale,une réimplantation dans le sillage destroupes et l’exercice de missions demaintien de l’ordre, de contrôle despopulations et de répression de lacriminalité pour pallier un vide sécuritaire.
£ En fin de conflit, la gendarmerie belgeest positionnée en tant que force depolice centrale, à statut militaire, avec unecertaine autonomie institutionnelletempérée par l’instauration d’uneinspection générale de la gendarmerie.
INTERNATIONAl
52 Revue de la Gendarmerie Nationale 4e trimestre 2014
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page52
INTERNATIONAl
53
Militaires, « prévôts » etpoliciers : les multiples tâches des gendarmesbelges autour de la Grande Guerre
Entre 1914 et 1919, quel a été l’impactdu conflit sur l’organisation et lesmissions du corps ? Loin des clichés,il convient de répondre à ces deuxquestions pour éclairer l’articulation,parfois difficile, entre les fonctionspolicières, militaires, administrativesou judiciaires des gendarmes,déracinés de leurs résidenceshabituelles, suite à l’offensiveallemande de l’été 1914.
Lorsqu’on évoque le rôle de lagendarmerie belge durant la Première
Guerre mondiale,deux imagesviennentimmédiatement àl’esprit. D’une part,la légende dorée del’héroïsme, incarnéeà la fois par lespremiers mortsbelges du conflit, lesgendarmes Bouko
Eet Thill, le 4 août 1914 dans la régionliégeoise, et par l’engagementd’Edemolen, près de Gand, le 7 octobre1914, où un détachement cycliste degendarmes, sous les ordres du capitaineFrémault, livre des combats retardateursface à des unités allemandes largementsupérieures en nombre. Leurcommémoration annuelle fait partie desfastes de la gendarmerie belge à partir de1933. D’autre part, la légende plus
sombre des« piottepakkers »1,qui fait référence à lacritique émanant des
militaires et à l’ingrate mission de contrôledes soldats à l’arrière du front.
Ces images, qui se réfèrent à deux voletsde la mission militaire de la gendarmerie,n’offrent évidemment qu’une visionréductrice du rôle des gendarmes durantle conflit et surtout de l’impact de cedernier sur le corps. Dans cettecontribution, nous éclairerons les
(1) Littéralement,« attrapeurs des piottes »,un des surnoms donné auxsoldats belges, derrièrel’Yser.
par JoNAs cAMPIoN
1ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
JoNAs cAMPIoN Docteur en HistoireChargé de Recherches duFRS-FNRS,Membre du Centred’histoire du droit et de la justice (Universitécatholique de louvain,belgique).
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page53
multiples volets de la fonction desgendarmes durant et après la guerre.nous poserons ainsi, entre continuités etde ruptures, la question de l’évolution de
l’identité et del’organisation de lagendarmerie autourdu conflit(2).
Face à l’invasion,des gendarmes aux arméesÀ l’aube de la guerre, la gendarmerie estforte d’environ 4 300 hommes, répartisentre ses services centraux, trèsrestreints, et son réseau de brigadesterritoriales, essentiellement présentesdans les régions rurales ou semi-urbaines. Bien que son rôle dans larépression des crimes ne fasse quecroître, c’est une institution de police àl’identité militaire prépondérante dontl’organisation, l’équipement et les
(2) outre la littératureexistante, nous fondonsessentiellement notre propossur les archives concernantla gendarmerie conservéesau musée royal de l’Armée(mrA) de Bruxelles, au seindu fonds dit moscou.
pratiques restentissus du cœur duXIXe siècle(3). Leconflit qui s’annoncemet rapidement sous
tension les fonctions policières etmilitaires des gendarmes belges. Ilsdevront faire face à une large variété detâches qui, si elles sont l’apanage de la« sûreté publique » en temps de guerre,répondent à des priorités hiérarchiques,politiques, militaires, judiciaires ouinstitutionnelles parfois contradictoires.
À partir de la seconde quinzaine du moisde juillet 1914, la gendarmerie territorialeparticipe activement à la mobilisation del’armée belge et aux réquisitions qui endécoulent. Les gendarmes procèdentégalement aux arrestations de suspectsd’espionnage, à la surveillance desfrontières, des lieux de transit et des voiesde communication. Près du tiers deseffectifs rejoint les prévôtés de l’armée encampagne, notamment auprès de l’état-major, augmentant la charge de travail debrigades en sous-effectifs. Aprèsl’ultimatum allemand du 2 août, lessoldats de la loi supervisent la mise enœuvre d’obstacles sur les axes possiblesd’invasion, mettant ainsi leur polyvalenceen évidence.
Le 4 août, avec le début de l’invasion, lecaractère militaire de l’arme s’affirme. Lesbrigades reçoivent l’ordre d’accompagnerle repli de l’armée en campagne,désorganisant de facto le maillage des
(3) marie-Claire rabier, « Lagendarmerie belge, 1830-1914 », in Actes du Colloquesur l’Histoire militaire belge(Bruxelles, 26-28/03/1980),Bruxelles, 1981, pp. 417-425.
54
Les gendarmes Bouko et Thill, premièresvictimes belges du conflit.
©m
arc
Poe
lman
s
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
INTERNATIONAl
mILITAIrES, « PréVôTS » ET PoLICIErS : LES muLTIPLES TâCHES DES GEnDArmES BELGES AuTour DE LA GrAnDE GuErrE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page54
forces de l’ordre sur le territoire belge. Denombreuses communes sont maintenantvides de toute présence policière. Deplus, les gendarmes territoriaux prennentrégulièrement part aux affrontements,qu’ils soient confrontés directement àl’avance allemande ou qu’ils prennent encharge des missions de reconnaissance,de couverture de l’armée ou deharcèlement de détachements ennemis.Jusqu’à la stabilisation du front derrièrel’Yser à l’automne 1914, le destin desgendarmes se mêle à celui des autresunités de l’armée : bataille de Liège, de laforteresse d’Anvers, combats dans lesFlandres et retraite vers l’Yser. Tant lesprévôtés que les unités territoriales yalternent missions de combats et gestionde l’arrière. Progressivement, ce sont cesdernières fonctions qui prennent ledessus, les gendarmes devant contrôlerles mouvements de militaires pourchasser les déserteurs, les fuyards ou leségarés. Dès ce moment, il se creuse entrele corps et les soldats de ligne un fossé.Ce dernier explique la mise en lumièreultérieure de la « mémoire dorée » ducorps, quant aux événements de 1914.
La guerre de mouvement, la stabilisationdu front et la réorganisation de l’effort deguerre belge, tant sur le territoire restélibre qu’en France ou en Angleterre,débouche sur la segmentation du corps.Si les pertes n’ont pas été excessives(une cinquantaine de tués jusqu’à la finoctobre 1914, selon le mémorial de la
gendarmerie(4)), leseffectifs disponiblesse dispersent
largement. Dans cette Belgique de l’exil,les gendarmes incarnent l’ordre nationalpartout où se sont repliés des militaires,des services, des administrations ou desréfugiés belges. Tout au long du conflit,c’est le corps qui assure la protection dela famille royale. Des détachements degendarmerie sont présents à Paris,Londres, dans les villes côtièresanglaises, à orléans où une partie de laprison sert pour des détenus belges,autour de Sainte-Adresse où s’est installéle gouvernement et à Calais. Aux Pays-Bas occupés, 120 hommes sont internésau milieu de plusieurs milliers de militaireset réfugiés civils qui ont passé la frontièrepour éviter la captivité en Allemagne. Desdétachements assurent la liaison auprèsdes armées alliées en contact avec desBelges. Enfin, la gendarmerie resteprésente en Belgique, où des unitésdépendant du quartier général constituentun cordon de sécurité à l’arrière du front,tandis qu’un détachement territorial estcantonné au sein de chaque communerestée libre, avec pour mission d’incarneret de faire fonctionner la vie publique.
Au plan institutionnel, la situation ducorps est complexe. Les hommes sontcritiqués pour leurs tâches de prévôté etde contrôle de l’arrière. Ils sont parconséquent considérés comme des“planqués” par certains soldats.
(4) Service historique de lapolice (SHP), Bruxelles,mémorial de la gendarmerie.
551ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
INTERNATIONAl
mILITAIrES, « PréVôTS » ET PoLICIErS : LES muLTIPLES TâCHES DES GEnDArmES BELGES AuTour DE LA GrAnDE GuErrE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page55
56
puis le détachement des hommes vers lesbrigades territoriales. Sous-jacent à sespropositions, il faut lire sa volonté deregrouper, autant que possible, deseffectifs épars, afin d’en assurer unemeilleure coordination. Ce programmemet en avant les missions policières del’arme et souligne la priorité que devrontconstituer le maintien de l’ordre, lecontrôle des populations et la répressionde la criminalité lors de libération de laBelgique. C’est d’ailleurs pour cetteraison que le plan précise que les officierset hommes réaffectés au sein desbrigades territoriales doivent déjà avoirservi dans ces mêmes régions avant1914 pour assurer l’efficacité de l’armepar la connaissance de l’espace et despopulations à contrôler. Le temps passépeut en laisser douter. Pour lecommandant du corps, l’objectif àpoursuivre est de disposer le plusrapidement possible de la majorité deseffectifs, au détriment des missionsmilitaires, prévôtales ou de service auxadministrations, pour planifier le plusefficacement possible la restaurationterritoriale du corps. Le ministre donneson accord quant aux projets qui lui sontprésentés et une période d’oppositionlarvée relative à l’affectation desgendarmes voit le jour entre le corps etles autorités civiles, judiciaires oumilitaires. Elle correspond à une montéeen puissance progressive desrevendications d’autonomieinstitutionnelle de la gendarmerie. Celle-ci
Largement disséminés au service demultiples autorités, ils vivent unécartèlement de leur rattachementhiérarchique interne au profit de l’état-major des armées, de ministères,d’autorités judiciaires comme les servicesdes auditorats en charge de l’exercice dela justice militaire. Face à cette situation,l’état-major du corps plaide, autant quepossible, pour qu’il puisse garder uncontrôle sur l’affectation et l’emploi desgendarmes. À partir de 1916, c’est autourde la préparation d’un éventuel retour ducorps sur l’ensemble du territoire belgeque cette revendication vaprogressivement s’exprimer.
Préparer le retour sur le territoirenational (1916-1918)En août 1916, le commandant du corpsprend l’initiative de faire valider par leministre de la Guerre ses plans pourorganiser le retour des gendarmes enBelgique. Il s’agit de « faire occuper par lagendarmerie territoriale les communes
évacuées parl’ennemi »(5) sur lemodèle des unitésprésentes en 1914,au fur et à mesure de
l’avancée espérée de l’armée belge. Leplan doit permettre une réimplantationrapide de l’arme, selon une division duterritoire en trois zones, couplée avec leregroupement des effectifs engroupements mobiles provisoires, leurprogression dans le sillage des troupes
(5) mrA, Fonds moscou,4527-185 14a 3910, copied’une note n°5023/Em du20/11/1915 – noteconcernant la répartitionactuelle et les services de lagendarmerie, 27/04/1918.
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
INTERNATIONAl
mILITAIrES, « PréVôTS » ET PoLICIErS : LES muLTIPLES TâCHES DES GEnDArmES BELGES AuTour DE LA GrAnDE GuErrE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page56
la fin de la Guerre : vers une nouvelledonne policière
Avec l’Armistice, la« ré-occupation »(7)
du territoire par lagendarmerie est rapide. L’historiqueofficiel de la gendarmerie durant laPremière Guerre mondiale, rédigé en1920, se plaît à souligner que l’état-majorétait de retour à Bruxelles dès le23 novembre 1918 et la majorité des
brigades en poste audébut décembre(8). Sil’on se réfère aux
archives, la situation est légèrement plusnuancée. Globalement, il est pourtantpossible d’affirmer que les gendarmesmaillent à nouveau l’ensemble du territoireentre la fin décembre 1918 et le début1919.
Passé l’optimisme initial de la victoire,plusieurs domaines se révèlentproblématiques. À moyen terme, lesréponses qui leur sont apportées, auxplans institutionnel, politique et judiciaireparticipent à une redéfinition profonde ducorps mais également de l’ensemble del’appareil policier belge. À partir de la fin1918, la gendarmerie devient la force depolice centrale en Belgique à la suite deschoix politiques consécutifs auxbouleversements du conflit : l’armée nesera plus mobilisée pour la gestion destroubles à l’ordre public, les gardesciviques, dissoutes en 1914, ne sont pasrestaurées après l’Armistice tandis que
(8) mrA, Fonds moscou,4002-185 14a 2118,Campagne 1914-1918,corps de gendarmerie
(7) mrA, Fonds moscou,4527-185 14a 3910, noten°4386 Gd, 27/10/1918.
57
est confortée par la situation de l’arme quiest certes déracinée depuis l’été 1914,mais qui dispose encore de l’essentiel deses moyens humains faisant d’elle uneinstitution de premier plan. un rapport
d’octobre 1918(6)
révèle que“seulement”
297 gendarmes ont été tués, internés oufaits prisonniers depuis le début de laguerre, pour 4 238 gendarmes etgendarmes supplétifs en service. Lespertes ont pu être compensées par lerecrutement et la formation de nouveauxgendarmes à l’arrière du front, tout aulong du conflit.
À partir du mois de septembre 1918, lerythme des opérations militairess’accélère, bouleversant les prévisions.Face à un risque d’effondrement militairede l’Allemagne et au vide sécuritaire quien découlerait, le commandant du corpsplaide pour une accélération de la remisesur pieds des unités territoriales,lesquelles doivent se rendre le plusrapidement possible dans leur résidencedu temps de paix. Il n’a de cessed’obtenir la diminution des effectifsdétachés de son autorité, pour pouvoirles affecter rapidement à leur tâchetraditionnelle de police administrative oujudiciaire, et réinstaurer un ordre policiersur des régions largement démunies ence domaine.
(6) mrA, Fonds moscou,5537-185 14a 7236, noten°207/m de l’état-major,14/10/1918.
1ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
INTERNATIONAl
mILITAIrES, « PréVôTS » ET PoLICIErS : LES muLTIPLES TâCHES DES GEnDArmES BELGES AuTour DE LA GrAnDE GuErrE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page57
chauffage deslocaux(9). Auxdifficultés logistiquesse rajouterapidement une
augmentation considérable desinterventions demandées aux gendarmes.Ils accompagnent la reconstruction, larépression de l’incivisme (collaborationavec les Allemands) et le retour progressifdes réfugiés. Dans la Belgique del’immédiat après-guerre, c’est un appareilpolicier affaibli et désorganisé qui doitfaire face à une hausse du banditisme, àsa transformation, à son développementautour des questions de ravitaillement etde trafics transfrontaliers. Les soldats dela loi occupent une place centrale dans ceprocessus en appuyant si nécessaired’autres services de l’état comme lesdouanes. Enfin, le corps est confronté auxévolutions politiques de la démocratiebelge. Le principe du suffrage universelmasculin est acquis dès novembre 1918,le droit de grève est renforcé et lemouvement ouvrier est passé d’une forced’opposition à un parti de gouvernement.
Face à cette nouvelle donne sécuritaire,l’organigramme du corps – correspondanttoujours, si ce n’est quelques adaptationsmineures, à celui en vigueur avantl’invasion de 1914 – se révèle insuffisant.Par conséquent, il s’adapteprogressivement à partir de 1919, demanière plus systématique en 1921. Dèsles premières mesures prises, les lignes
(9) Voir les notesconcernant la périodenovembre 1918 – mars1919 dans SHP, registre decorrespondance de laBrigade de Frameries, 1918-1921, 1403.
les polices communales continuent, saufà de rares exceptions près, à nereprésenter que des organes mineurs. Siune police judiciaire près des Parquets estinstaurée en 1919 dans le but de réprimerles crimes et délits, la gendarmerie, par sapolyvalence, son caractère militaire, soncommandement centralisé et sarépartition territoriale, incarne les atoutsdes autorités dans les domaines dumaintien de l’ordre, de la prévention descrimes et délits ou de la répression destroubles. Les réformes progressivementmenées au sein de la gendarmerieaffirment les aspects policier et militaired’une institution qui évolueprogressivement d’un corps ancré dansune logique répressive du XIXe siècle versune police incontournable et moderniséeau service d’un état élargissant seschamps d’intervention.
Dans un premier temps, les gendarmessont confrontés à de profondes difficultésmatérielles, dans les régions dévastéespar les combats. Les rapports alarmantsse multiplient : ils se rapportent auxdestructions des casernes et à la difficilevie quotidienne qui en découle ; ilssignalent que certaines casernes sontoccupées par des réfugiés et doncinutilisables ; ils demandent la livraison dematériel pour le couchage ou pour letravail de bureau ; ils constatent lemanque du combustible pour le
58 Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
INTERNATIONAl
mILITAIrES, « PréVôTS » ET PoLICIErS : LES muLTIPLES TâCHES DES GEnDArmES BELGES AuTour DE LA GrAnDE GuErrE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page58
fait son apparition. Automobiles, motos,camions ou encore voitures blindéeséquipent les groupes mobiles, les états-majors et même certaines brigades. Petità petit, les gendarmes se déplacent plusvite, plus loin, plus nombreux maiségalement de manière plus visible,lorsque c’est nécessaire.
Corollaire du rôle joué par les gendarmesdurant le conflit et du contexte enBelgique libérée, les réformes de l’après-guerre reconnaissent une autonomieinstitutionnelle accrue qui débouche surune réaffirmation de l’esprit de corps. Dès1920, un officier issu du sérail, le colonelBlondiau, est nommé à la tête de
l’arme(11). Si, pourcontrebalancer cetteévolution, le
gouvernement réinstaure la fonctiond’inspecteur général de la gendarmeriedont la mission est d’en préserver lecaractère militaire, c’est un signe fort dereconnaissance pour l’institution, quin’hésitera pas à faire valoir et défendreses points de vue face à l’armée, à lajustice ou à certains élus locaux.
Dans le même temps, les initiatives pourrenforcer l’identité de l’arme connaissentune nouvelle vigueur, émanant d’initiativesofficielles ou de la base. Elles insistenttant sur les missions policières que surl’identité militaire du corps et soulignentsurtout son sens du devoir et du sacrifice,que ce soit en temps de paix ou durant la
(11) « La gendarmerie auxgendarmes », in Legendarme, n°4, 04/1920.
59
directrices témoignant de son importancedans les missions de police au sein de lasociété belge de l’entre-deux-guerressont aisément discernables. Avant tout,cette période se caractérise par laconfirmation du caractère militaire de lagendarmerie. Les réformes se définissentensuite par des dynamiques derenforcement humain et matériel, despécialisation et de renforcement del’autonomie et de la cohésioninstitutionnelle.
Le cadre théorique passe de4 900 hommes en 1918 à 6 000 hommesen août 1919, puis à 6 800 deux ans plustard. Aux traditionnelles brigadesterritoriales, maillant l’ensemble duterritoire, s’ajoutent en 1921 des unitésmobiles pour maintenir et rétablir l’ordredans les principaux centres économiquesdu pays (Bruxelles, Charleroi, Liège,
Gand, puisAnvers)(10).L’équipement des
gendarmes se modernise, à commencerpar l’uniforme qui devient plus discret etplus utilitaire. Le téléphone se répanddans les brigades dès 1919. Le corps faitégalement usage de la radio. Laspécialisation progressive de l’institutionet l’essor de la mobilité au sein d’unesociété industrielle marquent ledéveloppement d’une nouvelle manièrede se déplacer pour les gendarmes. Lecheval perd de son importance au profitdu vélo, mais surtout le véhicule à moteur
(10) mrA, Fonds moscou,1358 1825 14 3307, noten°5991 de l’état-major,21/11/1930.
1ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
INTERNATIONAl
mILITAIrES, « PréVôTS » ET PoLICIErS : LES muLTIPLES TâCHES DES GEnDArmES BELGES AuTour DE LA GrAnDE GuErrE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page59
l’impact de la guerre
Au final, que conclure de ce rapidesurvol de l’expérience de lagendarmerie belge durant la
Première Guerre mondiale ? Sans aucundoute, le conflit a mis le corps soustension. repliés durablement de leuremprise territoriale traditionnelle, lesgendarmes sont tiraillés entre leurs tâchesmultiples de combattants, de policiers, deprévôts. malgré ces tensions et descritiques sur son action, le corps a sudéfendre un point de vue institutionnelpropre alors qu’il était largement disperséentre différentes implantations. Il pourrase développer plus encore aprèsl’Armistice puisqu’il devient, jusqu’à la findu XXe siècle, la clé de voûte de l’appareilpolicier en Belgique. Il bénéficie alorsd’une légitimité intacte et de la pleineconfiance des autorités. Si le conflitreprésente une crise, son impact estparticulièrement important et fécond pourla gendarmerie. Les circonstancesexceptionnelles du conflit représentent, entermes policiers, un accélérateur deréformes dont l’arme tirera des bénéfices,en termes de moyens, de missions ou decohésion institutionnelle.
guerre. Ces initiatives participent àl’affirmation et la légitimation du corpsdans l’espace public alors que son rôleaccru l’expose également à diversescritiques sur ses interventions. En 1920,le corps reçoit, comme de nombreusesautres unités de l’armée, un étendard desmains du roi. Les batailles auxquelles il aparticipé entre 1914 et 1918 y sontinscrites. Divers monuments en l’honneurdes gendarmes sont inaugurés : celui enmémoire de Bouko et Thill, à Visé, en
1920(12), ou l’annéesuivante, lemonument auxofficiers, sous-officiers, brigadiers etgendarmes mortspour la loi et lapatrie, à Bruxelles.
En janvier 1920 toujours, le premiernuméro du journal Le gendarme estpublié. Cette initiative, entendant défendreles intérêts des membres de l’arme,constitue une des premières publicationsspécifiquement dédiée à ce groupe socialet constitue un moyen de liaison utile àses membres.
(12) Détruit par lesAllemands en 1942, il estremplacé par une plaque« provisoire ». Actuellement,dans le cadre du centenairede 1914-1918, le monumentoriginel est récrée àl’identique. Il devrait êtreinauguré à l’été 2014. Sur ceprojet,http://www.1579.be/1914-bouko-thil.htm
60 Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
INTERNATIONAl
mILITAIrES, « PréVôTS » ET PoLICIErS : LES muLTIPLES TâCHES DES GEnDArmES BELGES AuTour DE LA GrAnDE GuErrE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page60
61
bibliographie sélective
Commandement de la gendarmerie,Histoire de la gendarmerie, 2 vol.,Bruxelles, 1979-1980.
Benoît Dupuis, Jocelyn Balcaen, GuidoDenis, La gendarmerie belge : souvenirsd’un corps d’élite, Tournai, 2001.
Benoît majerus, Xavier rousseaux, « Theimpact of the war on Belgian policesystem », in Cyrille Fijnaut (dir.), Theimpact of WWii on Policing in North WestEurope, Tilburg, 2004, pp. 43-89.
Benoît mihail, Anna Francis, « Centred’histoire et de traditions ou servicehistorique : l’héritage de la gendarmerieentre musée et dépôt d’archives », inJonas Campion (dir.), Les archives despolices en Belgique : des méconnues dela recherche, Bruxelles, 2009, pp. 51-63.
marie-Claire rabier, « La gendarmeriebelge, 1830-1914 », in Actes du Colloquesur l’Histoire militaire Belge (Bruxelles, 26-28/03/1980), Bruxelles, 1981, pp. 417-425.
Xavier rousseaux, Axel Tixhon, « Du‘sergent à verge’ à la ‘profileuse’: pistespour l’histoire des polices dans l’espacebelge, du moyen âge au XXe siècle », inJonas Campion (dir.), Les archives despolices en Belgique : des méconnues dela recherche, Bruxelles, 2009, pp. 11-34.
l’AUTEUR
Jonas Campion est Chargé de Recherchesdu FRS-FNRS, membre du Centred’histoire du droit et de la justice(Université catholique de Louvain,Belgique). Docteur en histoire en 2009(UCL et Paris IV), il travaille sur uneapproche transnationale des gendarmerieseuropéennes au XXe siècle. Membre duprojet PAI 7/22 « Justice et populations »(politique scientifique fédérale belge), il anotamment publié Les gendarmes belges,français et néerlandais à la sortie de laSeconde Guerre mondiale, chez AndréVersaille éditeur (2011).
1ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
INTERNATIONAl
mILITAIrES, « PréVôTS » ET PoLICIErS : LES muLTIPLES TâCHES DES GEnDArmES BELGES AuTour DE LA GrAnDE GuErrE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page61
DOSSIER
GRANDE GUERRE DE 1914-1918 ET GENDARMERIE NATIONAlE
Des « soldats-citoyens »dans la gendarmerie de laGrande Guerre : lespremiers gendarmesauxiliairesp.91
par Louis n. Panel
Le combat de la Rougemarep. 63
par Jean-Paul Lefebvre-Fillleau
La police de La circulation etles relations entreGendarmes et soldatsp. 85
par olivier Buchbinder
L’organisation du renseigne-ment dans la gendarmerieen 1914p. 79
par mélanie Peslerbe
Gendarmes etcombatttans du cielp. 99
par Salomé Krakowski
Prévôté et lutte contrel’alcoolisme dans leGroupe d’armées duNord pendant la GrandeGuerrep. 105
par marie-Laure Fery
La gendarmerie colonialedurant la Première Guerremondialep. 111
par Benoît Haberbusch
Géopolitique de lagendarmerie au Levant(1918-1920)p. 119
par Hélène de Champchesnel
La reconstitution de lagendarmerie en Alsace etLorraine à la fin de la pre-mière guerre mondiale.p. 12
par Georges Philippot
La Garde pendant la guerre,le départ des volontairesp. 73
par Pierre Bourmeaux
62 Revue de la Gendarmerie Nationale 4e trimestre 2014
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page62
le combat de la Rougemare
Cet article a été rédigé d'après le livre LeCombat de larougemare(1), avecl'aimable autorisationdes auteurs : Jacques
Heuillard, président de la Sociétéhistorique et géographique du bassin del'Epte, et le docteur Germain Galérant, dela Société française d’histoire de lamédecine, petit-fils de gendarme.
Des combats d’une dimension modestesont souvent passés sous silence du
fait de l’ampleurdes théâtresd’opération qui ontmarqué le caractèremondial du conflitde 1918. Ils n'enont pas moins pesésur le cours decelle-ci. Dans cecadre, nous vousproposons
(1) Le combat de laRougemare. 1989 (76-Luneray : Impr. Bertout).
Dd’évoquer le combat de laRougemare, entre Beauvais et Rouen,qui coûta la vie au maréchal des logis-chef Crosnier et aux gendarmesPraëts et Lebas, de la brigade deGournay-en-Bray, le 16 septembre1914. Il nous ancre dans la réalité del’intégration des gendarmesterritoriaux dans le cours de la guerre.
En août 1914, les belligérants sontconvaincus que la guerre sera courte. Leplan allemand, dit plan Schlieffen, prévoitd'écraser la France en deux ou troissemaines avant de se retourner contre larussie. Quant au plan français dugénéral Joffre, il entrevoit de couper endeux l'armée allemande par uneoffensive en Alsace.
Les Français sont arrêtés dès leur entréeen Alsace par la puissance de feuennemi. Le plan Schlieffen sembled'abord réussir, les Allemandsenvahissent la Belgique neutre, puis
DOSSIER
63
par JeAN-PAUl leFeBvre-FIlleAU
1ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
JeAN-PAUlleFeBvre-FIlleAU
Ancien officier d'état-major à la légion degendarmeriedépartementale de basse-Normandie, àCaen.
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page63
64
voitures de tourisme et deuxcamionnettes aux plaques minéralogiquesde la reichswehr. outre les personnels etleurs armes individuelles qu'ellestransportent, ces automobiles sontchargées de cinq cents kilogrammesd'explosifs et de systèmes de mise à feu.Dans la soirée du 14 septembre, lesquatre véhicules, phares allumés, quittentles lignes allemandes entre noyon etroye, près de Candor et d'Avricourt, pourse diriger vers l'ouest. À mareuil-la-motteet à Lassigny, ils essuient quelques ballesde fusils qui ne peuvent stopper leurallure. mais à margny-sur-matz, ils setrouvent empêtrés au milieu d'un fortdétachement de cavalerie française dontils parviennent à se dégager en tiraillant,en hurlant une bordée d'injures dans lalangue de Goethe et en annihilant d'uncoup de poing sur l'œil l'intrépidité d'unsergent. À quelques kilomètres del'algarade, l'une des deux voiturestamponne une camionnette du convoi enfuite. Cette dernière est fortementaccidentée. Il faut l'abandonner aprèsavoir transbordé son chargement. un peuplus loin, à montdidier, un soldat françaisveut absolument barrer la route au convoi.mal lui en prend ! Il est écrasé sans pitié !
Les deux voitures et la camionnetteennemies poursuivent ensuite vers l'ouestet, à l'aube du 15 septembre,s'immobilisent dans un bois, entre Saint-Just-en-Chaussée et Bresles, une dizainede kilomètres à l'est de Beauvais. Dès la
déferlent sur le nord de la France et sedirigent vers Paris. mais une contreoffensive, la Bataille de la marne (6-13septembre 1914), les rejette sur l'Aisne.
Les deux adversaires tentent alorsréciproquement de se déborder parl'ouest. Il en résulte un glissement dufront vers le nord nord-ouest, baptisé« course à la mer », bien que la mer nesoit pas l'objectif. Cette course se termineen novembre 1914 par de furieuxcombats que les historiens ne manquentpas de décrire.
Un corps franc allemand s’enfoncedans les lignes françaisesun corps franc allemand, parti de noyon,reçoit pour mission de détruire le pontferroviaire d'oissel en vue de couper lesvoies ferrées Paris-Le Havre et Le mans-rouen et d'obstruer la navigation sur laSeine, indispensable à la logistique desarmées françaises. La bataille de la marnevient de se terminer. À l'ouest de l'oise,en amont de Compiègne et vers le Pas-de-Calais, il n'y a pas encore de frontcontinu ; quelques patrouilles à chevalgardent le flanc droit de l'arméeallemande, prêtes à sonner l'alerte en casd'attaque française.
Le corps franc qui se heurte auxgendarmes français est sous lecommandement du capitaine Tiling. Secomposant d'une vingtaine d'hommesrevêtus d'un uniforme réglementaire, cetteunité commando est répartie entre deux
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
DOSSIER
LE ComBAT DE LA rouGEmArE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page64
nuit suivante, la caravane repart encontournant Beauvais par le nord :Fouquerolles, Tillé, Troissereux et Saint-Germain-de-Fly. Arrivée à mi-chemin deBeauvais et de Gournay-en-Bray, sur laroute de rouen, un nouvel incident seproduit : l'une des deux voitures detourisme tombe en panne. Le capitaineTiling, qui avait recasé son monde danstrois véhicules après l'accident de laveille, ne peut recommencer l'opération. Ildécide donc de laisser sur place dixhommes sous les ordres d'un sergent. Àeux de se débrouiller ! Abandonnés enpleine campagne du pays de Bray,presque sans vivres et sans ordresparticuliers, les soldats n'en mènent paslarge... Ils tentent de progresserdiscrètement dans un paysage vallonné,au milieu de prairies entourées de haiesvives. Vers midi, parvenus aux abords deSavignies, tenaillés par la faim, ilsinterpellent un civil, Constantin Bertin, etlui demandent de les conduire là où il al'intention d'aller, c'est-à-dire chez sasœur, mme Godin, qui l'attend à déjeunerdans sa ferme, “la ferme du moulin”, aumont-renard. Son mari étant mobilisé,cette femme vit seule avec son fils deneuf ans et emploie un journalier,m. Taverne. Les Allemands ont une tellefringale qu'ils se jettent sur les pommesde terre et sur le pain de leur hôtesse.Après quoi, ils déballent leur paquetage,font leur toilette et changent de linge sansmodifier leurs uniformes. Quelques-uns
baragouinant le français envoient l'enfantchercher du café, non sans préciser qu'ilne doit rien dire s'il ne veut pas causerd'ennuis à sa mère.
Pendant ce temps, les militaires mettentla ferme en état de défense ; ils aveuglentles ouvertures ; de l'intérieur de la maison,une sentinelle guette les alentours. Quantà mme Godin, elle prépare pour le soir uneplatée de haricots. mais la situation va sedénouer tragiquement. Dans la soirée,André Lenormand, âgé de quinze ans,survient inopinément. Il apporte une pairede galoches. mme Godin le reçoit sur lepas de la porte d'entrée. Cet accueilintrigue l'adolescent qui remarquel'aspect étrange du logis, le silence etl'obscurité des pièces. Soudain, dans unmurmure, la femme lâche : «... desAllemands... ici... ». André Lenormand sehâte de porter la nouvelle à son père. Cedernier attelle immédiatement sa carrioleet se rend à Beauvais. De Savignies àBeauvais, la route est mauvaise. Il faitpresque nuit lorsque Lenormand père seprésente au commandant de la Place. Ilest très mal reçu ! Cette histoire desoldats ennemis installés dans une fermebrayonne laisse incrédule ce colonel de laterritoriale qui déclare que, de toutefaçon, il n'a pas de troupes à sadisposition ! Toutefois, profitant del'arrivée inattendue d'un détachement dugénie, il décide d'envoyer sur placequelques hommes avec un lieutenant àleur tête. Guidé par m. Lenormand, le
651ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
DOSSIER
LE ComBAT DE LA rouGEmArE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page65
66
Un témoin gênant : Octavie DelacourQuant au capitaine Tiling, avec seshommes à bord des deux véhicules qui luirestent, il a continué sa route vers l’ouest.Encore quelques kilomètres et le voiciprès de Gournay-en-Bray où ilenvisage de passer la journée du 16.
A sept kilomètres au sud, en directionde Paris, à neuf-marché, un cheminvicinal se détache de la grand-route etgrimpe vers un plateau : c'est la côte desFlamants qui gagne le minuscule hameaudu même nom à la lisière de la forêt deLyons. Tiling et ses hommes s'yarrêtent. Les voitures sont camouflées pardes branches grossièrement coupées etles soldats s'allongent dans une sorte defosse de deux mètres de profondeur surcinq mètres de large, tout près de larougemare. Trois sentinelles veillent.mais l'artisan du destin est déjà en route,cette fois-ci en la personne d'unepaysanne de cinquante-six ans, mmeoctavie Deiacour. Le 16 au matin, ellemarche d’un bon pas vers Ferrières-en-Bray. Le soleil est déjà haut quand elles'approche du refuge des Allemands,plongée dans ses pensées. Tout d'uncoup, à deux pas, surgit un soldat ! « Iln'est pas de chez nous, se dit-elle. Lesnôtres, ils ont un pantalon rouge, unevareuse bleue et un képi. Celui-là est engris avec un drôle de petit béret demarine. Un Anglais, peut-être ? Ou unRusse ? Ou bien encore un Serbe ? C'estpas clair tout ça... ». Sans un mot, voilà
petit groupe de soldats quitte Beauvais à22 h 20 pour atteindre la ferme du moulinà 23 h 20. La nuit est noire et il pleut àverse. Les hommes reçoivent l'ordre dene tirer sous aucun prétexte ; on attendrale jour pour donner l'assaut, si nécessairecar tout le monde est persuadé qu'il s'agitd'une fausse alerte. malheureusement, unsoldat s'empêtre dans une barrière qu'iln'a pas vue. Ceux qui le suivent crient« Aux armes ! », croyant à une attaquedes Allemands et se lancent à l'assaut dela maison. Le premier qui la touche briseun carreau d'une fenêtre d'une pièce durez-de-chaussée et écarte le rideau quimasque l'ouverture. C'est la chambre deConstantin Bertin, le frère de la fermière.réveillé en sursaut, apeuré, il s'enfuit encriant et gagne l'extérieur par la cuisine.Les Français lui tirent dessus ! Touché pardeux balles, il fait quelques pas et agonisedans le potager... Dans la foulée, lessoldats se précipitent dans la maison parla porte qui a été ouverte par leur victime,se heurtent à m. Taverne qui, lui aussi,cherche à s'échapper. Le pauvrejournalier est aussitôt lardé de coups debaïonnettes, roule sous une table où il estlaissé pour mort !... Et les Allemands ?Que font-ils ? rassasiés par la bonnenourriture de mme Godin, ils dorment dansl'étable voisine sans être protégés par ungarde. Leur sommeil est si lourd qu'ilsn'ont pas entendu les coups de feu ! Il estune heure du matin lorsque les soldatsfrançais les réveillent pour leur signifierqu'ils sont prisonniers.
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
DOSSIER
LE ComBAT DE LA rouGEmArE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page66
67
que le soldat la saisit par le bras et, d'undoigt sur les lèvres, lui fait signe de setaire. Ensuite, un autre soldat sedémasque ; « un gradé, sûrement, vu qu'ila une casquette... » imagine mme
Deiacour. D'un seul coup, les souvenirsd’enfance remontent précipitamment :« Les Prussiens ! » une peur bleue étreintimmédiatement la vieille dame. Sesjambes semblent se dérober. Paslongtemps. Le gradé à la casquette n'estautre que le capitaine Tiling. Il toise lapauvre femme puis, d'un brusque geste, illui ordonne de partir et de se taire.Poursuivant sa route, trop heureuse d'êtreencore en vie, octavie Delacour, danstous ses états, n'a de cesse de conter samésaventure à toutes les personnes derencontre. A neuf-marché, elle frappe à laporte du maire, m. Couverchel. L'accueilest courtois, cependant il est excédé parles histoires de uhlans qu'on voit partoutet qui entretiennent une atmosphèred'inquiétude. mais octavie continue à luiassurer qu'elle a bien vu des Prussiens,qu'elle n'a pas eu la berlue. De mauvaisgré, m. Couverchel décide d'envoyer songarde-champêtre en reconnaissance.Certes, le bonhomme porte un képi, unsemblant d'uniforme et un revolver. Il estassez fûté pour estimer qu'en cas derencontre avec l'ennemi, cette apparenceguerrière ne lui vaudra pas un bonaccueil. Aussi, à son retour de “mission”,il proclame : « Y a pas pus ed prussiensdans l'boué que d'mouques sur unegôle ». Comment ne pas croire ce
représentant de l'ordre ? Furibarde,octavie rajuste son capet et s'engage surla route de Gournay-en-Bray : septkilomètres à pied.
Il est près de midi, ce 16 septembre1914, quand elle frappe à la porte de lagendarmerie de Gournay-en-Bray. Lemaréchal des logis-chef de réserveCrosnier Jules-Arsène la reçoit. C'est uncommandant de brigade expérimenté.Agé de 47 ans, il est retraité de lagendarmerie depuis le 11 février 1914seulement... après avoir commandé, de1899 à 1903, la brigade à chevald'étrépagny (Eure), puis la brigade àcheval de Darnétal (Seine-maritime)
1ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
DOSSIER
LE ComBAT DE LA rouGEmArE
Une femme de caractère qui saura donner uneinformation précieuse.
Ser
vice
his
toriq
ue d
e la
Déf
ense
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page67
68
mètres. C'est peut-être un garde-forestier ? Alors, Crosnier lance lessommations d'usage. La réponse estimmédiate : des coups de feu claquent,des balles sifflent et quelques-uness'écrasent sur les maisons voisines. Dansun élan de fureur, les gendarmes prennentle pas de charge tout en tirant à lacarabine de cavalerie et au revolver. maisle feu des Allemands est plus nourri etmieux ajusté car, de l'endroit où ils setiennent, la fameuse fosse, ils sont aussi àl'aise que dans un stand de tir. Praëtstombe, touché par trois balles, dont uneprès du cœur. A leur tour, Crosnier etLebas s'écroulent face en avant, lepremier atteint par trois balles au cœur, lesecond par deux balles également aucœur. Blacher, qui n'est pas armé, tentede s'échapper ; une balle allemandel'arrête net. Ayant un poumon et le foietraversés, il mourra dans la soirée. Ducôté de l'ennemi, Erik Krampitz, 21 ans,est tué de deux balles dans la tête. Ledrame n'a duré que trois minutes. Parcrainte d'être fusillés comme franc-tireur,noiret et Allée s'enfuient vers mainnevilleoù ils rencontrent, en chemin, l'escouadedes gendarmes qui poussent leurs vélosaux pneus crevés...
Dès la fin du combat de la rougemare,les hommes du capitaine Tiling quittentles lieux, non sans difficulté car la pluie dela nuit précédente a détrempé le sous-bois et la camionnette, surchargée, s'estembourbée. mais tout s'arrange et, plein
jusqu'en 1907, enfin la brigade à chevaldu Havre jusqu'à la date de sa retraite.Crosnier écoute son interlocutrice avecscepticisme. Toutefois, soucieux de nerien laisser dans l'ombre, il décide d'allerse rendre compte sur place.
les gendarmes entrent en scèneL'effectif de la brigade à cheval deGournay-en-Bray se limite à quatrehommes. Crosnier se fait accompagnerdes gendarmes Praëts Eugène, unvétéran de soixante et un ans qui a tenu àreprendre du service, et Lebas Eugène-Stanislas, un réserviste de quarante-troisans. une voiture est réquisitionnée augarage Allée. Le fils, rené, y prend place.Aux côtés des gendarmes, s'assoientdeux civils : Edmond noiret, vingt-troisans, instituteur, et Fernand Blacher, vingt-cinq ans, réformé pour raison de santé.Auparavant, Crosnier a téléphoné auxgendarmes de mainneville avec lesquels ila convenu que les deux brigades ferontleur jonction aux Flamants, à 14 heures.Le rendez-vous n'aura pas lieu ; à défautd'automobile, les gendarmes demainneville ont dû enfourcher leursbicyclettes. La route étant parsemée desilex, ils perdront leur temps à coller desrustines. A 14 heures, les gendarmes etles civils de Gournay-en-Bray parviennentà proximité du hameau des Flamants.Quelques habitants crient auxgendarmes : « II est là... à l'entrée... ilnous a parlé ! ». En effet, un homme enuniforme verdâtre court à une centaine de
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
DOSSIER
LE ComBAT DE LA rouGEmArE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page68
69
gaz, les deuxvoitures dévalent lacôte des Flamants,virent devant lagendarmerie demainneville ets'engagent sur larn 14. Le convoiroule rapidementvers étrépagny,puis écouis. Peuavant Le Thil, unpneu éclate. Descurieux s'amassentet offrent leur aidetandis que lessoldats en arme sedégourdissent lesjambes. « Vousavez une panne ? Oui... panne...panne... » Et le mécanicien montre lepneumatique : « Malate... malate... - Vousêtes des Anglais ? Yes... » La réparationeffectuée, les véhicules repartent. où lespseudo-Anglais vont-ils se cacher ? Enforêt de Lyons ? Elle est toute proche.
les territoriaux en alerteDepuis le combat de la rougemare, auxFlamants, l'alerte a cependant étédonnée. A 20 heures, le 16 septembre,l'unité de gardes-voies et decommunications affectée à la surveillancedes ponts de chemin de fer quifranchissent la Seine, entre oissel etTourville-la-rivière, est avisée « de laprésence du côté de Gournay et
d'Etrépagny de deux automobilesmontées par des officiers allemandsrevêtus d'uniformes français qui ont tuétrois gendarmes ».
Le sergent Leroy et le caporal morancémettent aussitôt leurs subordonnés sur lepied de guerre et préviennent les postesles plus proches placés sur la voie ferréeParis-rouen, jusqu'à Sotteville-sous-le-Val, de l'autre côté du tunnel qui coupe laboucle de la Seine avec son sommet àElbeuf. Ce secteur a une importancestratégique : venant de rouen, la voieferrée franchit le fleuve que l'Ile auxBœufs divise en deux bras ; les ouvragesd'art à cet endroit sont métalliques et trèsvulnérables aux explosifs. Juste à la sortie
1ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
Cartographie de l'engagement de la Rougemarre.
DOSSIER
LE ComBAT DE LA rouGEmArE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page69
sud, un embranchement se dirige vers lemans en traversant Elbeuf et sadisposition est telle qu'un convoi venantde là ne peut reprendre la direction deParis qu'en manœuvrant dans la gare deoissel, donc de l'autre côté du fleuve. En1914, la garde de ces postes est assuréepar des territoriaux âgés. Beaucoup ont lavue basse et le maniement d'armes peuassuré...
Il est 22 h 30 lorsque les hommes duposte de Tourville-la-rivière et les soldatsDuhamel, Gruel et moreau se tenant avecLeroy dans l'Ile aux Bœufs aperçoivent, àtrois kilomètres au nord-est etdescendant la côte des Authieux-sur-le-Port-Saint-ouen, les lumières de deuxautos. Quelques minutes après, ellespassent à vive allure devant le poste deTourville qui les mitraille à bout portant, etles rate ! Huit cents mètres plus loin, ellestombent sur Leroy et ses hommes. Làaussi, le feu mal ajusté manque sa cible.Lumières éteintes, les voitures ennemiesdisparaissent dans la nuit. Au bruit desmoteurs, les territoriaux devinent qu'ellesse dirigent vers Elbeuf. Passés sur la rivegauche de la Seine, à l'entrée de oissel,les Allemands font demi-tour et reviennentaux abords de Tourville, sur la rive droite.Ils longent la Seine en direction de Cléonet de Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Dans leurtraversée de Bédanne, ils rallument leursfeux de route à acéthylène. Si laperplexité des Français est grande,l'inquiétude des soldats du Kaiser est
70
vive. Ces derniers pensent que l'alarme aété répercutée partout et qu'il n'y a plusaucun espoir d'issue vers Elbeuf. mais ladétermination du capitaine Tiling n'a pasfléchi. Aussi, à défaut des ponts, il espèrefaire sauter le tunnel qui relie Tourville-la-rivière à Sotteville-sous-le Val, ce quiserait une belle réussite !
Leroy et le sergent Arvieux, quicommande le poste voisin, estimentjudicieusement que l'adversaire choisira lepassage du tunnel, au sud-est, au bas del'étranglement de la boucle de la Seine. Ilsaccourent à pied à Sotteville-sous-le-Valdemander du renfort. Là, le sergentSoûlais se refuse à croire à cette histoired'automobilistes allemands déguisés. Illaisse ses camarades prendre la directiond'Igoville et se poster au Val renoult,endroit où Leroy, qui connaît parfaitementla région, pense que l'ennemi a toutechance de montrer son nez. Etant revenude ses doutes, Soûlais vient quand mêmeles renforcer. D'autorité, Leroy assigne àchacun son rôle : Soûlais fera lessommations d'usage ; les deux autresgradés et les trois soldats couchés sur lacrête d'un talus tireront sur les véhicules,ainsi que deux soldats embusquéscinquante mètres plus loin. Il est uneheure du matin. Le sergent Leroy a vujuste. Les Allemands, renonçant à franchirElbeuf ou l'Ile aux Bœufs, choisissent latroisième alternative : prendre la directionde Pont-de-l'Arche par le Val renoult oùles Français les attendent. Cinq coups de
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
DOSSIER
LE ComBAT DE LA rouGEmArE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page70
feu claquent en même temps, puis deux,et d'autres encore. Les autos forcentl'allure sur la route en ligne droite. unponceau, et c'est l'accident ; la routecomporte deux virages à angle droit ; lacamionnette passe, de justesse, mais lalimousine accroche la maçonnerie ; uneembardée, elle quitte la chaussée et,trente mètres plus loin, s'immobilise dansun champs. Le conducteur parvient àrepartir en marche arrière mais bloqueson véhicule contre un mur, invisible dansl'obscurité.
une voix se fait entendre : « Officierallemand blessé... Se rend prisonnier ».Les soldats français approchentprudemment avec des lanternes ; ils netiennent pas à subir le sort desmalheureux gendarmes de Gournay-en-Bray. Sous les ordres de Leroy, baïonnetteau canon, la voiture ennemie est cernée. Ilen sort six hommes en uniforme allemanddu génie dont un officier blessé à lajambe, au bras et au visage. Les autressont indemnes. Ils n'opposent aucunerésistance et sont conduits au poste deSotteville-sous-le-Val.
Il reste la camionnette. Elle n'est pas alléeloin. Conduite par le maréchal des logisSchütze, celle-ci s'arrête. Le sous-officierjuge la situation désespérée : il n'a plusavec lui que trois soldats dont l'un estmortellement blessé à la gorge (unnommé Lange) et son officier estprisonnier. Il ordonne alors à ses
« coreligionnaires » de s'égayer dans lacampagne. Au cours de la matinéesuivante, Schütze a la malchance d'êtrerepéré dans une propriété de Tourville.Aussitôt alertés, les gendarmes de labrigade de oissel marchent vers lui.marqués par le drame qui a coûté la vie àleurs collègues de Gournay-en-Braye, ilsne sont pas enclins à la clémence : le sortde Schütze est instantanément réglé...Quant aux deux autres soldats en fuite, ilssont capturés le 22 septembre suivant. Lafouille des véhicules ennemis permet dedécouvrir une grosse quantité d'explosifs,des détonateurs, des armes individuelleset des cartes routières portant le tracé aucrayon rouge de l'itinéraire emprunté.
Ce parcours suscite une réflexion : mêmesi les cartes saisies ne mentionnent pasd'emplacements de réserves d'essence,ces dernières doivent exister car lesautomobiles de cette époque sont d'unegrande voracité en carburant. or, de royeà oissel, il y a 180 kilomètres par la routela plus directe. Ce n'est pas le trajet suivipar le capitaine Tiling. En effet, depuisquarante-huit heures, le détachement del'officier ennemi a parcouru une distancebien supérieure. De toute évidence,l'expédition a été minutieusementpréparée. Interrogé, Tiling ne fera aucunerévélation importante.
711ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
DOSSIER
LE ComBAT DE LA rouGEmArE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page71
l’AUTEUR
Jean-Paul Lefebvre-Filleau a mené unecarrière d’officier dans l’armée de Terre, puisdans la Gendarmerie nationale, qu’il a achevéen 2005 comme lieutenant-colonel,responsable des ressources humaines à l'état-major de la région Basse-Normandie. Admisdans le clergé orthodoxe en 2006, il estdésormais aumônier des hôpitaux de Caen etde Vernon (Eure), ainsi qu’aumônier militairenational pour la gendarmerie. Egalementauteur, sociétaire de la Société des gens delettres de France et membre de la Société desauteurs de Normandie, il a publié les ouvragessuivants : Moines francs-maçons du pays deCaux (1991), Gendarme FFI de l’Ile de France(1994), Mystères en Normandie (1995), LesFarces du normand Alphonse Allais (1996),L’affaire Bernadette Soubirous (1997), Saint-Vincent de Paul contre les piratesbarbaresques (2001), La Guerre de cent ans enNormandie (2004), On a assassiné Zola (2005).Il est chevalier de la Légion d’honneur
Pour revenir à l'action courageuse ducommandant de la brigade deGournay-en-Bray et de ses
gendarmes, il est incontestable que celle-ci a permis de déceler un corps francallemand qui devait se livrer àd'importants sabotages sur une artèrevitale, la ligne de chemin de fer Paris-rouen-Le Havre, puisqu'elle assurait leravitaillement des armées françaises etanglaises de tout ce que recevaient lesports de Dieppe et du Havre. Le combatde la rougemare, même s'il peut paraîtremodeste, démontre en outre que lemaréchal des logis-chef Jules-ArsèneCrosnier et les gendarmes Eugène Praëtset Eugène-Stanislas Lebas possédaientun sens élevé du devoir. Leur sacrificemérite le plusgrandrespect.
72 Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
DOSSIER
LE ComBAT DE LA rouGEmArE
Monument de commémoration.
Ser
vice
his
toriq
ue d
e la
Déf
ense
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page72
la garde pendant la guerre le départ des volontaires
Ce texte a été publié dans la Revue dela gendarmerie n° 5, peu aprèsl’annonce de la remise de la Légiond’honneur au drapeau et à l’étendardde la garde républicaine. Rédigé par unacteur des événements, dix ans aprèsl’armistice, il témoigne du travail demémoire auquel se prêta l’engagementde nombreux gardes dans des unitéscombattantes au cours de la GrandeGuerre, et le sacrifice d’un tiers d’entreeux.
l’ingrate charge de l’ordre public dansla capitale
Lorsque, dans cetaprès-midi ensoleillédu samedi 1er août1914, l'ordre demobilisation généraleappela aux armestous les Françaisvalides, les deuxrégiments de la garderépublicaine eurent le
Cprofond désir de prendre une large partau danger commun. Illusion, hélaséphémère ! Le gouvernement avaitdécidé le maintien à Paris de cettetroupe, au loyalisme éprouvé, quiconstituait pour lui la plus sûre dessauvegardes.
Pendant les premières semaines de laguerre, la garde républicaine dut donc serésigner à l'accomplissement, dans lacapitale, d'une tâche ingrate, pénible etsans éclat. mais le désir de participerdirectement à la lutte sur le front fut sigrand chez certains gardes que troisd'entre eux partirent sans autorisationpour s'engager dans des régiments demarche : le premier parvint jusqu'à Toul,les deux autres, qui étaient partis avecarmes et bagages, rejoignirent unrégiment d'infanterie coloniale en routevers le front. Ces derniers, qui étaientsous mes ordres à la Ve compagnie, ontbien mérité l'amnistie pour la punitionencourue à l'occasion de leur escapade :
DOSSIER
73
par PIerre BoUrMeAUX
1ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
PIerreBoUrMeAUX
Capitaine degendarmerie.
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page73
l'adjudant Le Goff et le sergent Lefèvresont tombés tous deux au champd'honneur.
Dans le courant du mois d'août, lapresse, à plusieurs reprises, se fit l'échodes doléances de certains militaires de lalégion toujours mécontents d'être
maintenus à Paris.Le colonel Klein(1)
crut devoir attirerl'attention de tout son personnel sur cettemanière d'agir « déplorable, disait-il, àtous les points de vue ». La décision ducorps du 30 août 1914 s'exprimait ainsi :« Un corps d'élite comme le nôtre n'a pasà faire, par la voie de la presse, étalage deses sentiments de patriotisme, son passérépond de son présent et nous sommestoujours dignes de nos anciens. Depareilles communications sont d'autantplus inutiles qu'à l'heure actuelle, le payssait qu'il peut compter sur le concours leplus absolu de tous ses enfants.Consacrons-nous donc entièrement à lamission que nous a confiée legouvernement et mettons tout notre
(1) Commandant la légion dela garde républicaine depuisavril 1913.
cœur, ainsi que notre ardeur, à bien laremplir ».
Cependant, l'avance des arméesallemandes sur le territoire national et versParis amena le commandement à faireparticiper, dans une certaine mesure, lagarde républicaine à la défense de lacapitale et à lui confier quelques missionsspéciales. C'est ainsi que, du 6 au9 septembre, des cavaliers et descyclistes de la légion participèrent à lagarde de plusieurs points importants,contre toute tentative de la cavalerieennemie signalée dans la direction nord-Est de Paris.
l’appel aux volontairesEnfin, dans les derniers jours deseptembre, à la suite de nombreuses etpressantes démarches, le général Gallienifit appel aux volontaires de la légion, pourservir dans l'infanterie comme chefs desection ou de demi-section. Plus de500 gradés et gardes demandèrentimmédiatement à partir. Le 26 septembre,le gouverneur militaire fit connaître que294 sous-officiers, brigadiers ou gardesétaient désignés pour servir sur le front,comme adjudants et sergents d'infanterie.Tous ces militaires rejoignirent leur postele 27 septembre dans les IIe et IVe armées.À ces premiers volontaires allait échoirl'honneur d'ouvrir le Livre d'or de la garderépublicaine. Quinze jours plus tard, lelundi 12 octobre, le colonel Klein passaiten revue, dans la cour des Célestins,2 chefs d'escadron, 5 capitaines,
74
Des gardes posent avant le départ pour le front,en septembre 1914.
Ser
vice
his
toriq
ue d
e la
Déf
ense
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
DOSSIER
LA GArDE PEnDAnT LA GuErrE, LE DéPArT DES VoLonTAIrES
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page74
6 lieutenants, 22 sous-lieutenants et172 sous-officiers, nouveaux volontaires,qui avaient revendiqué l'honneur de partirà la frontière et qui rejoignirent leur postedans la journée du 16 octobre. Par lasuite, 65 officiers furent désignés, sur leurdemande, pour les prévôtés et les états-majors en campagne.
En août 1916, le ministre prescrivit l'envoiau front, dans les prévôtés, de tous lesgardes à pied des classes 1908 et plusjeunes et de quelques gradés volontaires.Au mois d'octobre 1917, nouveau départde tous les gradés et gardes des classes1907 et plus jeunes pour la cavalerie,1904 et plus jeunes pour l'infanterie.Enfin, à des dates diverses, la garderépublicaine a encore fourni une vingtainede volontaires à l'aviation et à l'arméerusse, ce qui porte à plus de 1 100 lechiffre des officiers et hommes de troupepartis au front.
Telle est, comme effectif, la contributionde la garde républicaine à la GrandeGuerre que le public et l'armée elle-mêmeméconnaissent totalement. Cetteignorance a été entretenue parl'apparition, durant tout le cours deshostilités, de l'uniforme de la garde danstous les coins de Paris. Le public, malinformé, continuait à nous considérercomme arme de parade, oubliant que lalégion devait, quoi qu'il arrive, assurer samission de sécurité. De la tranquillité deParis, en effet, dépendait, en temps deguerre plus encore que pendant la paix,
celle de la France tout entière.
mais, de 1914 à 1918, nous avonstraversé de telles crises, la situationextérieure et notre existence matériellenous ont fait éprouver de si grands soucisque le problème de l'ordre social estpassé, pour les non-initiés, au secondplan de nos préoccupations nationales.nous entendons encore répétercouramment : « Les deux régiments de lagarde auraient dû partir au front et lagendarmerie elle-même aurait pu fournirplusieurs régiments parfaitementencadrés ». Question complexe etdélicate à trancher. Seuls, ceux quil'examinent avec cette indépendanced'esprit que confère une sereineignorance des disponibilités réelles et desbesoins de notre arme lui trouvent unesolution facile et simpliste.
Une geste héroïqueQuoi qu'il en soit, la garde républicaine arépondu présent à toutes les sollicitationsde l'autorité militaire et a offert plus qu'onne lui a jamais demandé. Si notre drapeauet notre étendard n'ont pu flotter au ventdes batailles, leur gloire cependant n'aurapas été diminuée. Elle a, au contraire, étégrandie par la beauté du courage et dusacrifice des 500 volontaires qui, auxarmées, ont su magnifiquementreprésenter leur corps. Il suffit, pour leprouver, de synthétiser ici les gestes duLivre d'or dressé à la gloire de nos héros.Quel magnifique palmarès ! :218 camarades tombés au champ
751ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
DOSSIER
LA GArDE PEnDAnT LA GuErrE, LE DéPArT DES VoLonTAIrES
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page75
d'honneur, 187 sous-officiers, brigadiersou gardes promus officiers sur le champde bataille, 111 croix de la Légiond'honneur, 234 médailles militaires et 917citations dont 260 à l'ordre de l'armée.
Faut-il préciser par des exemples, dignesdes héros de Plutarque, le dévouement etl'abnégation de quelques-uns. Prenonsau hasard, le choix est facile. C'est lesous-lieutenant Guillemet, un vieux sous-officier de vingt-cinq ans de service, quifait cette fière réponse à son capitaine quilui demandait pourquoi il voulait partir àson âge : « Pour montrer l'exemple auxjeunes ». une pareille réponse nesupporte aucun commentaire.
Ce sont les lieutenants Bordachar etLéchallier, mes bons camarades du courspréparatoire à l'Ecole de gendarmerie,qui, pour prêcher d'exemple, sollicitentl'autorisation de partir dès le 3 août au
soir ; leur vie,pourtant, n'était quepromesse. Tousdeux, sur le plateaude Lorette, dormentleur dernier sommeil,enveloppés dans leurtunique bleue dechasseur à pied.C'est encore unepléiade de vieuxgradés, devenusofficiers, les
capitaines Couillaud(2), rambour et rutiler,les lieutenants Blanc, Copen(3) et Jeanny(4)
(2) maréchal des logis àpied, Arthur Couillaud futdétaché comme sous-lieutenant au 97e régimentd’infanterie où il reçut lacroix de guerre avec troiscitations.
(3) Joseph Copen, maréchaldes logis dans le régimentd’infanterie de la garderépublicaine, fut détachécomme lieutenant au41e régiment d’infanterie, ettué à l’ennemi le5 septembre 1916.
(4) Charles Jeanny, fourrierdu régiment d’infanterie, futdétaché comme souslieutenant au 99e régimentd’infanterie et tué à l’ennemile 13 octobre 1918.
76
qui n'hésitent pas à quitter leur foyer oùpourtant les attachait l'affection d'unefemme et de nombreux enfants. Ce sont,enfin, tous les officiers de la garde quidemandent à partir et que le tirage au sortdoit départager. Comment de tels soldatsn'auraient-ils pas écrit de belles pages àla gloire de la garde républicaine ? Aussil'attribution de la croix de la Légiond'honneur à son drapeau et à sonétendard n'est que la juste rançon dusang généreusement versé par lesvolontaires de 1914 sur les champs debataille, au cours de la Grande Guerre. Lajoie fut grande, dans toutes les casernesde la légion, quand les journauxapportèrent la bonne nouvelle le 2 août aumatin. Le colonel moinier fit aussitôtparaître l'émouvant ordre du jour ci-dessous, dans lequel il sut traduire toutela satisfaction qu'éprouvait son cœur desoldat.
« Officiers et sous-officiers,
Par décret du 30 juillet 1928, le présidentde la République a décerné à notredrapeau et à notre étendard la croix dechevalier de la Légion d'honneur. C'est laplus belle récompense que pouvaientrecevoir ces emblèmes illustrés par ledévouement héroïque de tous les bravesqui ont volontairement offert leur sang à lapatrie.
Je suis certain que chacun de vousressent avec une reconnaissante émotiontout le prix de cet éclatant hommage que
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
DOSSIER
LA GArDE PEnDAnT LA GuErrE, LE DéPArT DES VoLonTAIrES
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page76
le gouvernement de la République tient àrendre à vos aînés, et je veux me portergarant que, toujours, en toutescirconstances, vous saurez montrer quevous êtes dignes de succéder à ceux quivous ont indiqué le chemin de l'honneuret du devoir. »
nous espérons que la remise de la croix ànotre drapeau et à notre étendard seral'occasion d'une de ces fêtes magnifiquescomme seule peut en organiser la garderépublicaine. Ce jour-là, autour de nosemblèmes sacrés se retrouverontnombreux les survivants des volontairesde 1914.
la mémoire des bravesQue sont-ils devenus ces 300 quirestent ? Beaucoup jouissent en paixd'une retraite bien méritée. Certains ontété maintenus dans l'infanterie avec lesgalons d'officier qu'ils ont si dignementconquis. Quelques-uns, enfin, sontrevenus dans la garde ou servent dans lagendarmerie.
Parmi les officiers de la légion partiscomme volontaires, trois occupentaujourd'hui, dans le commandement denotre arme, des postes très en vue. Cesont : le colonel Bucheton, l'actueldirecteur de la gendarmerie au ministèrede la Guerre ; le colonel moinier, le chefde la garde républicaine ; le colonelChanu, le glorieux blessé qui commande,à orléans, la Ve légion de gendarmerie.
A cette occasion aussi, le peuple deParis, qui aime ses deux régiments, devraêtre renseigné sur la portée et la beautédu geste accompli en 1914 par sessoldats de l'ordre. Ce qu'il faudra surtoutsouligner, c'est que les volontaires de lagarde sont partis à une heure où ilsavaient pu déjà contempler les ravages dela guerre et les horreurs des mutilations.Ils ont puisé leur désir du sacrifice danscette atmosphère du danger où s'exaltele vrai courage. Leur détermination adonc quelque chose de plus épique, deplus poignant. Il est peut-être bon de leredire aujourd'hui que la nation entière, ausortir de l'épreuve, tend toute son énergiedans l'effort de renaître et participe,quelquefois à son insu, à cette iniquenécessité qui s'appelle « l'oubli ».
771ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
DOSSIER
LA GArDE PEnDAnT LA GuErrE, LE DéPArT DES VoLonTAIrES
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page77
78
Aussi, remercions m. le général dedivision Crinon et le ministre de laGuerre, m. le président Painlevé,
de nous avoir permis d'évoquer ici, à dixans de distance, le souvenir de nosmorts, de nos blessés et de nos mutilés.réjouissons-nous, enfin, d'avoir vuaccorder pleine et entière satisfaction auxlégitimes aspirations de la garderépublicaine, ce corps d'élite de toujours,qui, comme toutes les collectivités, penseavec Victor Hugo que si « le mondematériel repose sur l'équilibre, le mondemoral doit reposer sur l'équité ».
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
DOSSIER
LA GArDE PEnDAnT LA GuErrE, LE DéPArT DES VoLonTAIrES
l’AUTEUR
Pierre Bourmeaux est né en 1881 dans lescôtes d’Armor. Maréchal des logis à lapremière compagnie du régiment d’infanteriede la garde républicaine en octobre 1914, il estdétaché sur sa demande au 118e RI commesous-lieutenant à titre temporaire. Unepremière citation à l’ordre de l’armée salueen mars 1915 ce « remarquable officier, pleind’allant et d’entrain [qui] a fait preuve depuis ledébut de la campagne des plus belles qualitésmilitaires. A chargé a la tête de sa compagnie,entraînant tout son monde par son magnifiqueexemple. Est tombé le bras cassé et en raisondu feu a dû rester plusieurs heures sur leterrain en attendant d’être secouru ». Il estdécoré de la légion d’honneur en novembresuivant. Promu lieutenant à titre définitif en1916, il est maintenu dans l’infanterie jusqu’àsa démobilisation et son retour à la garde. Il nela quitte que de 1923 à 1925 quand, promucapitaine, il fut nommé à Morlaix et anotamment à faire face au procès Seznec.Rentré sur sa demande à la garde, commeadjudant-major du régiment de cavalerie,c’est-à-dire officier chargé de la logistique, ildevient en 1933 commandant militaire del’hôtel des Invalides. Il achève sa carrièrecomme chef d’escadron à la légion de Paris en1938. Titulaire de la Croix de guerre 1914-1918et de la croix du combattant il était officier dela Légion d’honneur depuis 1931.
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page78
l’organisation du renseignement dans la gendarmerie en 1914
En temps de guerre, les servicesextraordinaires demandés par lesautorités militaires à la gendarmeries'ajoutent à un nombre considérable demissions. Maillon primordial de lasûreté du territoire, la gendarmerie futégalement en charge, notamment par lavolonté de Georges Boulanger, ministrede la Guerre, de missions derenseignement et de contre-espionnageaussi diverses que délicates à mettreen œuvre.
Qu'est-ce que le renseignement ?Communémentsynonymed'espionnage, lerenseignement ne faitpas uniquementréférence à cesecteur spécifique.on peut établir unlien entre les notionsde renseignement et
Ede contre-espionnage mais aussi avecl'ensemble des missions relatives aucontrôle de la population et de sonopinion, à la surveillance de son moral,de sa santé et de ses besoins. Tous lesaspects de la vie quotidienne des civils,mais aussi des militaires, sont ainsisoumis à une surveillance accrue dans lecadre des fonctions de renseignement.
Quoique dans l'ombre du DeuxièmeBureau(1), le rôle dela gendarmerie n'enest pas moins
déterminant au cours de la GrandeGuerre. La loi du 18 avril 1886 lui aattribué officiellement les missions desurveillance et de recherche despotentiels espions. À l'aube de la GrandeGuerre, les premières directives etcirculaires donnent à l'arme desinstructions en la matière. représentantune force de police présente surl'ensemble d’un territoire alors largementdominé par la ruralité, proche du terrain
(1) Le Deuxième Bureau del’état-major de l’armée esten effet en charge durenseignement.
DOSSIER
79
par MélANIe PeslerBe
1ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
MélANIe PeslerBe
Professeur d'histoire-géographie titulaire d'unmaster d'histoire « Forcepublique, régulationsociale, sécurité intérieureet Défense » à l'UniversitéParis-Sorbonne.
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page79
et polyvalente, la gendarmerie estdésignée comme l'institution la mieux àmême d’exécuter ces missions.
Des missions complexes et diversesLa protection du territoire passe par larecherche des espions, ainsi que desdéserteurs et des insoumis. S'introduisantà l'intérieur du territoire national,susceptible de transmettre desinformations et renseignements depremière importance, l'espion est uneangoisse permanente pour les états-majors, mais aussi pour les civils quivivent dans l'inquiétude d'en avoir unpour voisin. Leurs traques et leursrecherches sont confiées à l'arme dontles hommes entretiennent des relationsde proximité avec les populations.
Les gendarmes ont reçu des instructionstrès précises, dès l'année 1886, danslesquelles ont été définis le termed'espion et une typologie afin d'en faciliterla traque. L'instruction sur la surveillancede la gendarmerie, datée du 9 décembre1886, caractérise alors l'espion commeétant un individu « le plus souvent denationalité étrangère, qui soit directementou indirectement, et par des moyens lesplus divers, cherche à se renseigner surune ou des questions dont laconnaissance peut être réputéepréjudiciable à la défense du territoire etde la sûreté extérieure de l’État » qui « àl'aide d'un déguisement ou d'un fauxnom, ou dissimulant sa qualité, saprofession ou sa nationalité s'introduitdans une place forte, un poste, un navire
80
Trois gendarmes prévôtaux présentent un prisonnier de guerre devant des officiers d’état-major pourinterrogatoire (v. 1916). La qualité de la photographie et de sa mise en scène désigne, à l’évidence, undocument de propagande.
Ser
vice
his
toriq
ue d
e la
Déf
ense
.
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
DOSSIER
L’orGAnISATIon Du rEnSEIGnEmEnT DAnS LA GEnDArmErIE En 1914
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page80
de l’État ou dans unétablissementmilitaire oumaritime »(2). L’espionagit afin d'obtenirdes informations
pertinentes sur les forces adverses, quece soit d'un point de vue militaire(emplacement des contingents,mouvements et concentrations detroupes, etc.) ou encore industriel(comme les types d’armes utilisées ou enfabrication). Complétée par une typologie,cette instruction distingue l'espionambulant de l'espion sédentaire. Lamobilité ou l'intégration dans lapopulation de ces deux catégoriesd'espions les rend l'une et l'autre toutaussi difficiles à poursuivre. Divers outilssont à leur disposition pour mener à bienleurs quêtes. Pigeons voyageurs, signauxlumineux, dirigeables, appareilsphotographiques sont quelques-unes deleurs nombreuses méthodes qui fontaussi l'objet d'une surveillance accrue dela part des gendarmes. Le pigeon secaractérise par sa vitesse et sa discrétionqui lui permettent d'être apprécié toutautant par les forces militaires que par lesespions, puisqu'il est un moyen decommunication imprévisible et difficile àcontrer. En ce qui concerne lacolombophilie, un chapitre entier del'instruction provisoire sur la mobilisationet le fonctionnement en temps de guerredu service des pigeons voyageurs, datéedu 20 septembre 1906, est consacré à
(2) Service historique de laDéfense, 9 n 19. Instructiondu 9 décembre 1886 sur lasurveillance de lagendarmerie concernant lesespions. Cf. Louis n. Panel,Gendarmerie et contre-espionnage, maisons-Alfort,SHGn, 2004.
guider les gendarmes dans leursrecherches. Leur vigilance est ainsidirigée, en particulier, sur les importationsclandestines de pigeons sur le territoirefrançais et les consignes insistent sur ladestruction immédiate des oiseaux dansles cas où des perquisitions, notamment« chez des agents déjà tenus en suspicion
dès le temps depaix »3), auraientpermis d'endécouvrir.
Les espions, personnages énigmatiques,objets de représentations imaginaires oufantasmatiques, sont des individusdifficiles à appréhender. Ils peuventprofiter de la topographie qu'offrentcertains départements français, toutcomme les déserteurs et les insoumis,afin de déjouer les pièges tendus par lesgendarmes.
Des individus suspects : le déserteur,l'insoumis, l'étranger et le nomadeChaque soldat est un élément clé desdispositifs offensifs et défensifs français.La défection de ces hommes suscite uneinquiétude forte pour les autorités, quiperçoivent les déserteurs à la fois commedes éléments manquants à la défense duterritoire et comme de potentiellessources d'information pour les forcesennemies.
Le terme d'insoumis désigne les hommess’étant dérobé au service militaire, celuide déserteur, les militaires qui ont
(3) Service historique de laDéfense, 7 n 22. Instructionprovisoire du 20 septembre1906 sur la mobilisation et lefonctionnement en temps deguerre du service despigeons voyageurs.
811ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
DOSSIER
L’orGAnISATIon Du rEnSEIGnEmEnT DAnS LA GEnDArmErIE En 1914
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page81
abandonné leur poste. Il est du devoir desgendarmes de se charger de lasurveillance et de la recherche de cespersonnes afin de les amener ou de lesramener dans les cantonnements,garnisons et régiments et qu'ils trouventleurs places sur le front. Dès qu'unindividu est identifié et désigné commeinsoumis ou comme déserteur, sarecherche est directement attribuée auxgendarmes. Ces derniers ne disposentalors que de simples signalementsrelatant les noms, prénoms, le régiment etcorps du soldat et parfois son lieud'origine. Ils ne disposent pas dedescriptions physiques comme ilspeuvent parfois en avoir pour lesignalement d'espions suspects. Cessignalements brefs permettent unediffusion rapide de l'information etl'ouverture d'enquêtes sur lesantécédents du soldat, sur son lieu derésidence, sur sa famille, qui mènent àson arrestation. Dans un soucid'efficacité, chaque année sont élaboréesdes listes d'insoumis et de déserteurs.Ces listes, classées par ordrealphabétique, s'accompagnent desrésumés ou des résultats d'enquêtesfaites par la brigade de gendarmerieresponsable du canton où la personnepourrait être localisée. Ces listespermettent donc d'élaborer un suivi àl'échelle régionale et nationale.
L'étranger, quelle que soit sa nationalité,est très redouté en période de guerre.
82
Soupçonné de divulguer des informationsà sa nation d'origine, il suscite dèsl’entrée en guerre une vagued’« espionnite » et de xénophobie. Il estainsi l'objet de nombreuses mesuresrestrictives. L'instruction ministérielle du9 décembre 1886 ordonne la surveillancedes étrangers par les gendarmes sousl'autorité des préfets. ont alors étéinstaurés et confiés à l'ensemble descompagnies de gendarmerie deuxcarnets afin de répertorier, classer lesindividus suspects et de les arrêter. Lepremier d'entre eux, le carnet A, recense,pour chaque département, tous les nomsdes étrangers résidant en France en âgede servir aux armées. Le second, lecarnet B, énumère quant à luiessentiellement les individus suspectés
de mener desactivitésd'espionnage(4). Àcompter de 1909, il
change d'orientation pour s'étendre àtous les individus jugés antimilitaristes, quipourraient alors troubler une potentiellemobilisation. Ce carnet B sert donc àidentifier, à connaître et à surveiller entemps de paix les étrangers et lesFrançais susceptibles de commettre desactions d'espionnage ou de sabotage,afin de pouvoir les arrêter à lamobilisation. L'inscription d'un individudans le carnet B fait l'objet d'une longueprocédure. L'autorité de gendarmerie doittout d'abord avoir des soupçons sur unindividu et faire une enquête préliminaire
(4) Jean-Jacques Becker,Le carnet B, les pouvoirspublics et l’antimilitarisme,Paris, Klincksieck, 1973, p.110.
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
DOSSIER
L’orGAnISATIon Du rEnSEIGnEmEnT DAnS LA GEnDArmErIE En 1914
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page82
sur ses potentielles activités suspectes. Àla suite de l'enquête, est transmise aupréfet la demande d'inscription. Celui-cijuge de la gravité des faits et consulte lesautorités militaires et le ministre del'Intérieur afin de prendre sa décision. Êtreinscrit dans le carnet B signifie alors fairel'objet d'une surveillance constante. Cesdeux carnets permettent ainsi d'identifiertous les individus et étrangers suspects,facilitant, si nécessaire, leur arrestation.
Les nomades, par leur mode de vieitinérant, inquiètent également lesautorités. Est considéré comme nomadetout individu, quelle que soit sanationalité, circulant en France, sansdomicile ni résidence fixes. En cas deperturbation de l'ordre et de la sûretépublique, les nomades sont sujetsd'expulsions, décidées par les autoritéscommunales et exécutées par les forcesde police dont la gendarmerie. Lesséjours de communautés nomades nesont pas facilités par une législation quileur impose la possession de carnetsanthropométriques d'identité, instaurés et
rendus obligatoirespar la loi du 16 juillet1912 et faisant figurede titres decirculation(5).
Des enquêtes difficiles : effectifsréduits, population hostilenombreuses sont donc les missions derenseignement qui s'ajoutent aux autrestâches que l’arme a en charge en temps
(5) Loi du 16 juillet 1912relative à l'exercice desprofessions ambulantes et àla circulation des nomades.http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6105294r
ordinaire. Celle-ci opère dans un contextetrès particulier. La Grande Guerre imposed’assurer un service de prévôté auxarmées et d’y expédier de nombreuxbrigadiers et gendarmes qui sont affectésaux unités et places militaires. Cetteréduction des effectifs dans lescompagnies de gendarmerie a lieu alorsque le corps connaît une crise durecrutement. Débutée dès la fin duXIXe siècle, une crise profonde causée parl'insuffisance des rengagements au profitde la gendarmerie affecte l’arme à la veillede la Première Guerre mondiale. Cettecarence se comprend par un malaisematériel et moral qui affecte l'ensembledu corps. Faiblesse de la rémunérationqui ne prend pas en compte l'anciennetéde service, progression de carrière troplente ou bloquée, manque de repos,longueur des tournées, surcharge detravail, discipline et règlements troprigides sont autant d'éléments quiexpliquent la déperdition des effectifs.Ces difficultés de recrutement entraînentune diminution supplémentaire deseffectifs qui contraint le ministre de laGuerre à instaurer l'emploi de gendarmesauxiliaires, le 23 avril 1915, afin depermettre à l'institution de mener à bienet dans les meilleures conditionspossibles l'ensemble de ses tâches.
représentant de la loi, en charge de sonapplication, mais aussi de celle denombreuses restrictions et contraintesimposées par les besoins de la guerre, le
831ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
DOSSIER
L’orGAnISATIon Du rEnSEIGnEmEnT DAnS LA GEnDArmErIE En 1914
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page83
84
détente. Ils voient les gendarmes commedes privilégiés, qui ont des conditions devie plus confortables que les leurs, alorsqu’ils n'ont pas à subir les horreurs descombats. D’autre part, les déserteurs etinsoumis, malgré leurs manquements audevoir national, bénéficient parfois dusoutien de la population qui les aide à secacher et à déjouer les opérations misesen place dans le but de les arrêter.
Véritable force de protection, l'armea donc mis en place l'ensembledes dispositifs relatifs à la sûreté du
territoire et à la protection de lapopulation qui lui ont été demandés afinde parer aux entreprises malveillantesorganisées par les forces adverses.L'omniprésence du contrôle et de lasurveillance des gendarmes semble avoireu un impact contrasté sur les habitants.Tantôt enclins à aider les gendarmes, ilspeuvent aussi faire obstacle à l'applicationdes missions de la gendarmerie.Toutefois, malgré les sentimentsantagonistes dont elle a été le sujet, lesnombreuses difficultés rencontrées et lafaiblesse de ses effectifs, l'arme a remplila pluralité des missions derenseignement, aussi complexes les unesque les autres, qui lui étaient assignées.
gendarme est l'objet de réactionsambivalentes de la population au coursdu conflit. Dans le difficile contextepolitique, social et économique imposépar la guerre, la gendarmerie apparaîtcomme une force apaisante etsécurisante par sa présence et bénéficiedu soutien de la population, notammentdans ses recherches d'individussuspects. Effectivement, face à l'entrainet à la bonne volonté des civils, lesgendarmes se trouvent à gérer unequantité importante de témoignages oude dépositions plus ou moins fondésrelatant d'éventuels comportementssuspects. L'abondance de cesdépositions que doit traiter et vérifier lagendarmerie ne fait qu'accroître ladifficulté de la recherche. À l’inverse,parce que la gendarmerie est uneinstitution militaire qui ne se bat pas enunités constituées et de manière visible,elle doit faire face à des réactionshostiles. Souvent décriés et critiqués, lesgendarmes sont accusés d'être desplanqués et des embusqués. restés àl'arrière, symbole du commandement etde l'autorité, ils se trouvent confrontés àdes préjugés et des dénigrementsprovenant de la population, portantatteinte à leurs fonctions. La présence deces militaires à l'arrière du front inspire unsentiment virulent, particulièrement de lapart des soldats, qui voient en eux uneforce militaire oppressante, qui oblige lessoldats à respecter une discipline stricte,même dans les moments de repos et de
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
DOSSIER
L’orGAnISATIon Du rEnSEIGnEmEnT DAnS LA GEnDArmErIE En 1914
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page84
la police de la circulation et les relations entre Gendarmes et soldats
La police des cantonnements a pourobjet le respect des consignesgénérales et ponctuelles qui règlent lavie des soldats. Ils sont plongés sansrémission dans la vie militaire, cette viede garnison qui, transposée dans lecadre des camps de fortune du front,restreint les influences extérieures,favorise l’esprit de corps et lasolidarité. Cette mission de policecomplexe est dévolue dès l’origine à lagendarmerie aux armées.
La perte de la liberté de se déplacer, laplus manifeste des servitudes militaires,est aussi la plus lourde à supporter pourles soldats. Ils s’en affranchissent lors desgrandes manifestations de l’été 1917, enmême temps que des corvées, qui gâtentle repos, et des punitions pour les fautes le
détail par lesquellesle commandemententend lutter contrel’oisiveté de la guerre
Lde position qui engourdit les troupes etentraîne le relâchement de la discipline.Elle est indispensable pour la difficileréduction des délais de manœuvrelorsque les soldats sont dispersés sur unlarge périmètre. L’observation aérienne,domaine dans lequel les arméescentrales bénéficient d’une sérieuseavance, nécessite également dediminuer la visibilité des déplacementsdes soldats. En même temps, ellediminue les opportunités de pillages etde désertions.
Les mesures de couvre-feu concourentau même objet : « Aucun feu ne doit êtrevisible au bord des routes et dans lescantonnements » rappelle le prévôt du16e corps à ses gendarmes le
2 septembre1914(1). Le couvre-
feu est de rigueur, même à plusieursdizaines de kilomètres du front, la zonede combats étant parfaitementcartographiée par les Allemands et les
(1) Service historique de laDéfense, 22 n 11 94.
DOSSIER
85
par olIvIer BUchBINDer
1ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
olIvIerBUchBINDer
Secrétaire des affairesétrangères, Ambassade de France enGuinée et en Sierra-leone.
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page85
pièces de très fort calibre qu’ils utilisentétant capables de tirer à de grandesdistances.
Une surveillance continue etrépressiveLa gendarmerie aux armées est amenée àconstater des infractions pendant toute ladurée de la guerre. Les procès-verbauxd’infraction aux consignes de couvre-feupeuvent masquer la suspicion d’activitésd’espionnage et d’intelligence avecl’ennemi. Le développement systématiquedu repérage de l’adversaire par ladétection des foyers lumineux met enévidence la vulnérabilité des installationsmilitaires dans les deux camps. La
surveillance à cet égard est renforcéeavant les grandes opérations, l’aviationn’étant pas apte à interdire le ciel pendantla préparation d’une offensive avant 1918.
En ce qui concerne les déplacements, laprévôté colmate les brèches quisubsistent dans un dispositif. Elle contrôlel’application des mesures de surveillanceprescrites et déploie son propre réseauaux limites des secteurs tenus par lesformations et sur les lignes d’étapesperpendiculaires au front. un premierrideau de postes de contrôle est tendupar les unités combattantes. une gardeest toujours établie dans les villages, auxcarrefours de quelque importance, auxcantonnements et devant les lieux« consignés », c’est-à-dire interdit auxtroupes, qu’il s’agisse de grandes villesoù d’estaminets. La prévôté fournit despostes de contrôle fixes et mobiles selonles mêmes modalités que les troupesd’opérations. Ils sont notammentpositionnés sur les points defranchissement d’obstacles naturels(cours d’eau, ponts, lacs, gués, cols),ainsi que dans les gares de la zone desarmées. « Nul ne pouvait circuler sur lesroutes sillonnées par les gendarmes sans
une autorisationsignée du colonel »,écrit Barthas(2).
La vingtaine degendarmes affectés à une divisiond’infanterie ne peut assumer seule cettemission, d’autant plus que les difficultés
(2) Louis Barthas, Lescarnets de guerre de LouisBarthas, tonnelier (1914-1918), Paris, La découverte,2003, note de mai 1917.
86
Le capitaine Lélu, prévôt de la 43e divisiond'infanterie, et son greffier s'entretiennent avecdeux soldats dans le Pas-de-Calais, vers 1915.
Ser
vice
his
toriq
ue d
e la
Déf
ense
.
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
DOSSIER
LA PoLICE DE LA CIrCuLATIon ET LES rELATIonS EnTrE GEnDArmES ET SoLDATS
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page86
sont nombreuses. Le 13 août 1914, unepatrouille de la prévôté tente d’intercepterles « dragons et les hussards en infractiondans les cabarets » de Bayon et le prévôtrapporte que « de nombreux militaires de
tous grades ont fui ànotre approche »(3).
La prévôté demande « des patrouilles descorps de troupes stationnéesactuellement dans la place » qui sont« indispensables pour seconder l’actionde la prévôté afin que les ordres soientstrictement exécutés ».
Des relations tendues avec la troupeLes officiers, que l’on devine à traversl’expression « militaires de tous grades »,ne donnent apparemment pas l’exemplede la soumission. De même, les difficultésne proviennent pas toujours des troupesd’opérations. Le 2 septembre, unepatrouille du même corps doit renvoyerpar deux fois un militaire, commisd’intendance, dans son cantonnementavant qu’il ne s’exécute. Il fait de plus desdifficultés à donner son nom. Ce genred’attitude est fréquent, les mauvais sujetsayant trouvé dans l’anonymat del’uniforme une sécurité dont ils n’aimentnaturellement pas se départir. Lesmilitaires de carrière que sont lesgendarmes éprouvent parfois desdifficultés à respecter les grades que laguerre confère aux civils mobilisés. Enmars 1915, le gendarme Valet, de laprévôté de la troisième DI, « étant chargéde faire une ronde à vingt-et-une heures,
(3) SHD, 22 n 1194.
pour s’assurer que les cafés ducantonnement étaient fermés et qu’il nes’y trouvait pas de militaires », entend dubruit et se fait ouvrir la porte d’un café. Il ytrouve deux officiers du génie « qui yétaient logés régulièrement » et quitentent de lui en imposer. Le gendarmeValet réagit vigoureusement : « Desofficiers subalternes, je m’en fous,donnez-moi vos noms ou je vous arrête ».Puis il a « imposé le silence à un officier »en lui disant « taisez- vous » ce qui est,d’après le motif de sa punition, « uneattitude tout à fait irrespectueuse » qui luivaut 25 jours d’arrêt de rigueur par legénéral commandant la division, bien qu’il
ait nié les faits(4).
Les gendarmes sontnécessairement conduits à entraver lesmanifestations de sociabilité au sein desunités. Ainsi, le capitaine commandant laprévôté du 7e CA surprend en pleinebatterie, de nuit, à Coeuvres, uncanonnier d’une section de munitionsd’artillerie et un soldat du septièmeescadron du train qui, « étant pays (…),s’étaient réuni pour se voir les causes et
ensemble »(5). Etantdonné le recrutement
régional des unités, cette excuse ne peutatténuer la sanction. Elle doit néanmoinsêtre évidente pour les soldats qui lamettent en avant. Ils sont « pays », ilsviennent du même terroir, parlent le mêmedialecte, se réunissent naturellement pourse soutenir dans les horreurs de la guerre.
(5) SHD, 22 n 396, 23 avril1915.
(4) SHD, 22 n 88, 31 mars1915.
871ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
DOSSIER
LA PoLICE DE LA CIrCuLATIon ET LES rELATIonS EnTrE GEnDArmES ET SoLDATS
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page87
88
est arrêté sur la route d’Ecuiry par lecapitaine prévôt de la 55e DI car il n’a pasde permis de circuler. Il en reçoitfinalement un, rouge, valable 15 jours. Le« fourgonnier chargé du ravitaillement despostes » n’a pas de laissez-passer ; il fautlui en établir un rapidement. Le brigadierCordier, de la prévôté du quartier généraldu 7e corps, arrête à la poste aux armées,à Coeuvres, un cycliste revenu « sansordre de mission » toucher un mandatpour son capitaine. Il a un « ton des plusarrogants » signale le brigadier et il reçoithuit jours de prison. on peut facilementimaginer, à partir de ce compte-rendusuccinct, pourquoi les protagonisteshaussent le ton. La mission du cycliste estcertes anodine mais elle témoigne de larelation de confiance indissociable de lacohésion d’une troupe. Sa bonne foi estpatente et devrait pouvoir se passer dejustificatifs.
En novembre 1915, trois soldats du parcde mortefontaine sont interceptés par lesgendarmes à cheval « en absenceirrégulière » à Vaumoiset. Le chef d’état-major du corps prescrit une enquête poursavoir s’il n’y a pas lieu de les déférer auconseil de guerre pour « abandon deposte en territoire en état de guerre ». Ilsen sont quittes pour 15 jours de prison :les soldats des services n’ont aucuneraison de déserter…
Des troupes de lignes sont adjointes à lagendarmerie, en période de fortecirculation dans la zone des armées. Au
Un contrôle trop tatillon ?Les procès-verbaux montrent la minutiedes gendarmes qui signalent les défautsd’une machine administrative censéepermettre un contrôle total. Le14 septembre 1914, le prévôt du 16e CAprocède à l’inspection des convoisadministratifs, sur ordre du chef d’état-major, pour s’assurer « qu’aucun militairenon compris dans l’effectif de guerre ne
faisait partie descolonnes »(6). Après
la désorganisation des premiers combats,des soldats ont dû s’insérer dansmouvements routiers pour gagner l’arrièreou pour se reposer mais les places dansles parcs et les convois, déjà convoitées,sont réservées à d’heureux privilégiés.
Le soldat Carmé est signalé aucommandement pour infraction auxconsignes de cantonnement le 6 mars1915. Brancardier à la 16e section desinfirmiers militaires cantonnés au châteaude Valsery, il a été arrêté sur la route deCoeuvres, « à environ 500 mètres de soncantonnement ». Il a déclaré « avoir quittéce dernier sans autorisation écrite pouraller dire sa messe journalière àCoeuvres ». Quelques jours plus tard, unepermission écrite permanente est délivréeau soldat Carmé, conciliant son servicedans les ordres et dans l’armée du
général Dubois(7).
Le sous-lieutenant,commandant la section de projecteurs,
(6) SHD, 22 n 1194, 14septembre 1914.
(7) SHD, 22 n 396, 6 mars1915.
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
DOSSIER
LA PoLICE DE LA CIrCuLATIon ET LES rELATIonS EnTrE GEnDArmES ET SoLDATS
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page88
13e corps, un régiment de spahis fournit« trois cavaliers chaque jour par demirégiment, responsables d’un rayon de10 kilomètres ». Ces détachements, pourassurer les patrouilles accompagnées
d’un prévôtal(8),posent un certainnombre de
problèmes. Dans leur mission d’aiguillerles transports à destination de l’avant, lesprévôtaux rencontrent parfois desdifficultés, comme l’indique ce compte-rendu d’un gendarme de la prévôté du 7e
corps : « De service au carrefour place del’église à Bray-sur-Sommes, nous avonsdemandé à un sous-officier du 4e Génie,monté sur le siège d’un fourgon, la routequ’il devait prendre, pour l’aiguiller sur sadestination. A notre demande, ce sous-officier d’un air railleur s’est mis à bailleret a fait mine de ne pas entendre. Luiayant à plusieurs reprises posé la mêmequestion, il s’est penché vers nous et adit : ‘‘je vais à Chipilly. Et puis entre nous,vous n’êtes qu’un manche à balai’’. Invitéà donner son identité, il s’y est refusécatégoriquement. Il a crié sur nous et plusparticulièrement sur le cavalier Chugnaudu 2e escadron du 6e régiment dechasseurs à cheval. Les cris et gestesqu’il faisait n’avait qu’un but : exciter lesquelques soldats présents contre nous.Nous l’avons conduit devant l’adjudant ducommandant de la place à Bray. Il adéclaré se nommer Berthelot, maréchal
(8) Louis n. Panel,Gendarmerie et contre-espionnage, SHGn,maisons-Alfort, 2004, p. 57.
des logis du4e régiment du
Génie »(9).
Faisant, preuve d’une mauvaise volontéplus ou moins habituelle et tolérée, legradé invective un cavalier du6e chasseurs qui participe à la patrouille. Ilévite ainsi de tomber sous le coup desdispositions du code de justice militairesanctionnant la rébellion contre les agentsde la force publique. Il semble lancer enmême temps un appel, détourné, à larévolte en dénonçant la participation dechasseurs à cheval à la patrouilleprévôtale, comme si c’était une trahisonde la part d’un soldat des troupesd’opérations. De plus, pour éviter unesanction, il donne vraisemblablement unefausse identité, Berthelot étant celui d’ungénéral aussi populaire que Joffre.
(9) SHD, 22 n 396, 28 août1916.
891ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
DOSSIER
LA PoLICE DE LA CIrCuLATIon ET LES rELATIonS EnTrE GEnDArmES ET SoLDATS
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page89
90
Le système de contrôle desdéplacements, devenu fonctionneltrès tôt, s’est renforcé
progressivement. Dans la zone de l’avant,les sentinelles ne demandentgénéralement que le mot de passe qui estsouvent le nom d’un fait d’armes ou d’unsoldat illustre. C’est une vérificationsommaire mais rapide, qui n’interfère pasavec l’impératif de célérité dansl’exécution du service. Dès que lessoldats s’en éloignent, ils doivent êtremunis de justificatifs écrits. La zone desétapes joue le rôle d’un filtre, retient lessoldats qui quittent le secteur assigné àleur unité. Pour y circuler et à plus forteraison pour quitter la zone des armées lessoldats doivent être porteur d’un ordre demissions. Cela n’arrive qu’à titre trèsexceptionnel car seuls les officiersbénéficient d’une certaine liberté decirculation. même les blessés ne sont
autorisés à quitter lechamp de batailleque munis de billetsd’évacuation, viséspar le chef desection(10).
(10) Lucien Laby, Lescarnets de l’aspirant Laby,médecin dans les tranchées,Paris, Bayard, 2001. Labybénéficie d’une liberté dedéplacement inhabituelle :officier du service de santé, ilest originaire de la régiondes combats.
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
DOSSIER
LA PoLICE DE LA CIrCuLATIon ET LES rELATIonS EnTrE GEnDArmES ET SoLDATS
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page90
Des « soldats-citoyens » dans la gendarmerie de la Grande Guerre :les premiers gendarmes auxiliaires
Cet article a été publié dans le n° 222 de la Revue de
la Gendarmerie nationale en 2007.
La disparition des gendarmes auxiliaires àl’orée de l’an 2000, conformément au plande professionnalisation des armées, amarqué un tournant dans l’histoire del’Arme : la fin des relations, initiées en1970, de l’Institution avec la conscription.Toutefois, cette suspension du servicenational ne saurait exclure le recours auxforces vives de la nation, en cas de « crisede haute intensité ». Ce faisant, lagendarmerie renoue avec une traditionancienne. En effet, un précédenthistorique, le décret du 2 mai 1915,
rappelle que, mêmedans une troupe demétier, comme l’étaitla gendarmerie dudébut du XXe siècle,subsistent desrecours exceptionnelsau « soldat-citoyen ».
LLorsqu’elle entre en guerre, le 2 août1914, la Gendarmerie nationale accusedepuis plusieurs années un réel sous-effectif. Les causes en sontnombreuses : les unes sont lointaines etrelativement structurelles, le service de lagendarmerie, mis en avant dans lapresse des dernières années de la Belleépoque à l’occasion des grandes grèvesou de la querelle de l’inventaire des biensdes églises, étant perçu commeimpopulaire. En outre, à peine réévaluéedepuis trente ans, la solde du gendarmeest peu attractive pour qui ignore – orc’est le cas de tout observateur extérieur– les compensations en nature quipeuvent l’accompagner. un secondphénomène, conjoncturel, creuseégalement le déficit : la loi militaire du7 août 1913, en portant à trois ans ladurée du service militaire, a reculé d’uneannée la date de l’éventuel rengagementdans la gendarmerie. À la veille de 1914,l’Arme est donc privée d’une classe, et
DOSSIER
911ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
par loUIs N. PANel
loUIs N. PANel
Docteur en histoire Conservateur desmonuments historiques
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page91
l’effectif théorique de vingt-sept millehommes pour l’ensemble des formations
de la gendarmerien’est pas réalisé(1).
Crise nationale etcrise des effectifsLa mobilisationgénérale du 2 août1914 suspend de
facto le recrutement de la gendarmerie.En outre, le plan mis en œuvre, conçudans la perspective d’une guerre courte,ne prévoit l’envoi au front que de3 400 gendarmes prévôtaux, ce qui serévèle bientôt beaucoup trop juste pourl’encadrement des armées : c’est enréalité six mille gendarmes qu’il va falloirrapidement détacher à la suite destroupes. Pour faire face à ces handicapsconjugués en matière d’effectif, il fautdonc, dès 1914, improviser plusieurssolutions. La première est en faitcontenue dans le décret de mobilisationlui-même. Le plan rappelle en effet àl’activité les officiers et sous-officiers detoutes armes rayés des cadres depuismoins de cinq ans. Par ce biais, plusieurscentaines de militaires de réserve del’Arme viennent renforcer la gendarmeriedépartementale. Toutefois, cette mesurese révélant bientôt insuffisante, unecirculaire de la direction de la cavaleriedatée du 19 août autorise tout militaire dela gendarmerie dégagé de ses obligationsà se porter volontaire pour reprendre duservice à l’intérieur ; on lui permet alorsde choisir sa légion. C’est ainsi que le
(1) Le jour de la mobilisation,il manque un officier et trentehommes dans la Ire légion(Lille), trois officiers et28 hommes dans la IIIe(rouen), un officier et22 hommes dans la XVe
(marseille), etc. Si le tauxnational du déficit n’excèdepas 4%, c’est aussi que leseffectifs théoriques n’ontplus augmenté depuis 1906.
capitaine Paoli, en retraite depuis 1895,reprend du service à l’âge prodigieux de74 ans et commande avec brio, jusqu’en1916, l’arrondissement d’Hazebrouck
(nord), pourtant sousle feu de l’ennemi(2).Enfin, le 27 octobre
1914, un amendement à la loi du 21 mars1905 sur le recrutement de l’armée étendaux brigadiers et gendarmes lesdispositions portant sur tous les sous-officiers, dont les militaires de l’Armen’ont pourtant pas encore le statut.Désormais, « les brigadiers degendarmerie et les gendarmes jouissantd’une pension de retraite pour anciennetéde services restent, pendant cinq ans àpartir de leur radiation des contrôles del’activité, à la disposition du ministre de laGuerre, qui peut les employer, en cas demobilisation, pour le service du
territoire »(3).
Ces appoints de quelques centainesd’hommes ne peuvent suffire cependant àmener une guerre longue. En effet,lorsqu’il apparaît que le conflit peutexcéder le cadre des quelques moisinitialement envisagés, la nécessité derenforcer encore les prévôtés se dessine,tandis qu’il n’est plus envisageable dedégarnir plus longtemps les compagniesdépartementales, indispensables àl’encadrement d’un pays soumis à l’effortd’une « guerre de siège ». Ainsis’aperçoit-on, en avril 1915, que, selonles termes de l’un de ses responsables,
(2) François Paoli (1842-1923), SHD-DAT 5 Yf 90234.
(3) Mémorial de lagendarmerie, 1914, pp. 366-367.
92 Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
DOSSIER
DES « SoLDATS-CIToYEnS » DAnS LA GEnDArmErIE DE LA GrAnDE GuErrE : LES PrEmIErS GEnDArmES AuXILIAIrES
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page92
« la gendarmerie a déjà fourni plus dudouble de l’effectif qui était prévu àl’origine et elle est appelée à constituerencore des prévôtés pour les formationsnouvelles », notamment pour l’arméed’orient, en cours de création. À cettedate en effet, de très nombreuxgendarmes prévôtaux ont déjà dû êtreremplacés : plusieurs dizaines d’entre euxsont morts de blessure de guerre ou demaladie contractée en service. Plusieurscentaines ont été évacuées ou relevés paranticipation, pour raison de santé. or, à ladifférence des troupes, la gendarmeriefonctionne depuis la mobilisation sur deseffectifs clos : il n’est pas question delever une nouvelle classe ou d’appeler denouveaux réservistes et retraités, cesderniers ayant été mobilisés dans la pluslarge acception possible, dès le débutdes hostilités.
Une création de circonstanceC’est pourquoi, le 23 avril 1915, le
ministre de la Guerremillerand(4) adresseun rapport au
président de la république constatant lasituation de la gendarmeriedépartementale et préconisant leversement de militaires de toutes armesréservistes de l’armée territoriale (rAT) –c’est-à-dire âgés de plus de quarante ans– dans les brigades, pour la durée de la
guerre et souscertaines
conditions(5).
(4) ministre de la Guerre dugouvernement Viviani du26 août 1914 au 29 octobre1915.
(5) Mémorial de lagendarmerie, 1915, pp. 137-139.
Agréé par le président Poincaré, ce projetdébouche sur la publication d’un décret,le 2 mai 1915, instituant les premiers« gendarmes auxiliaires » (quoique leterme ait été parfois employé pourdésigner les militaires indigènes servantdans la gendarmerie d’Afrique et lagendarmerie coloniale). Ce texte est enfait un amendement au décret organiquedu 20 mai 1903, introduisant un article18bis ainsi conçu : « en temps de guerre,des gendarmes auxiliaires peuvent êtreadmis dans la gendarmerie à titretemporaire ». Ces derniers doivent êtrechoisis parmi les rAT non encore affectésdans la zone des armées (lesquels sontfinalement inclus, le 30 avril 1917, à
931ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
Alexandre Millerand, ministre de la Guerre en1915, puis commissaire général de laRépublique en Alsace et Lorraine en 1919 estici représenté après son élection à laprésidence de la République en 1920 par lepeintre Marcel Baschet.
mus
ée d
’ors
ay.
DOSSIER
DES « SoLDATS-CIToYEnS » DAnS LA GEnDArmErIE DE LA GrAnDE GuErrE : LES PrEmIErS GEnDArmES AuXILIAIrES
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page93
condition d’être chargés de famillenombreuse). Lescandidats sontsoumis à sixconditions(6) :
1° Être apte au service armé.Contrairement aux apparences, lesgendarmes auxiliaires n’appartiennentdonc pas au « service auxiliaire » del’armée, qui emploie les hommesréformés.
2° mesurer au moins 1,64 m. Cecritère de taille, jugé peu signifiant,sera toutefois abaissé à 1,62 m parune circulaire du bureau de lagendarmerie, le 2 mai 1917.
3° Posséder une instructionélémentaire suffisante, et notammentsavoir rédiger une page sous la dictée.Compte tenu des emplois auxquelssont destinés les auxiliaires, cettecondition est essentielle et lespremières recrues pèchent souventsous cet aspect. Aussi est-il rappelé àplusieurs reprises aux officiers chargésde la sélection qu’ils doivent s’assurerpersonnellement du sérieux aveclequel est effectuée cette dictée.
4° Avoir été bien noté par sessupérieurs.
5° n’avoir encouru aucunecondamnation.
6° Avoir une vie régulière et une bonneconduite.
(6) Stéphane Coillard, Lesauxiliaires de la gendarmeriependant la Grande Guerre(1915-1918), SHGn,maisons-Alfort, 1997, 60 p.
94
En outre, les règles alors en vigueur pourles élèves-gendarmes à pied leur sontappliquées : comme ces derniers,auxquels ils sont toutefois subordonnés,ils portent la tenue de gendarme et lesarmes, sans avoir prêté serment.Cependant, ils perçoivent une soldenettement inférieure, de 103,80 francs parmois, bientôt rendue dérisoire parl’inflation. Centralisés par les générauxcommandant de région militaire, lesdossiers de candidature sont adressés auministre au début de chaque trimestre. Cedernier émet alors un choix, sur l’avis dubureau gendarmerie de la direction de lacavalerie. Les chefs de légion sontensuite laissés libres de répartir dansleurs brigades les candidats reçus. Lesconditions d’emploi des premiersauxiliaires sont strictes : ceux-ci doiventoccuper exclusivement le poste d’ungendarme titulaire parti pour le front. Enoutre, il ne peut être affecté qu’unauxiliaire par brigade, lequel ne peut servirni dans le canton de son domicile, ni dansun canton limitrophe. n’étant pasassermenté, l’auxiliaire ne peut ni dresserprocès-verbal, ni concourir aux missionsde police, mais doit rester à la brigadepour effectuer des écritures, consignerdes déclarations ou accompagner untitulaire en tournée. Aussi, les premièresréactions sont-elles mitigées à l’égard deces recrues. À diverses reprises, lescadres de contact soulèvent la qualitétrop inégale des gendarmes issus de laterritoriale, et surtout leurs pouvoirs trop
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
DOSSIER
DES « SoLDATS-CIToYEnS » DAnS LA GEnDArmErIE DE LA GrAnDE GuErrE : LES PrEmIErS GEnDArmES AuXILIAIrES
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page94
limités. Pour le colonel Georges Lélu,« pleins de bonne volonté, ces hommesn’avaient aucune connaissance du métieret ne purent rendre que de minimes
services »(7). Lecapitaine Faivre luifait écho, relevantque « les territoriauxemployés àseconder lagendarmerie ontévidemment rendu
des services utiles, [mais] ils ne pouvaientnaturellement opérer seuls, l’autorité leurmanquait, il fallait un gendarme pour lesdiriger »(8).
Des brigades aux tranchéesPrenant acte de ces critiques, undeuxième texte admet, le 21 novembre1915, qu’après six mois de présencedans la gendarmerie, les auxiliaires ayantdonné satisfaction puissent être admis àprêter serment et servir à l’égal desgendarmes titulaires, en qualité de« gendarmes temporaires ». Pour cela, ilssuivent un stage de trois mois, sousl’autorité du chef de légion, puissouscrivent un engagement pour troisans. Ils touchent alors la solde desgendarmes rappelés, toujours inférieure àcelle des élèves-gendarmes. En outre, cetexte admet que, exceptionnellement,plusieurs auxiliaires soient affectés dans la
même brigade(9). uneseconde étape dansl’extension du rôle
(7) Colonel Georges Lélu, LaGendarmerie et la guerre1914-1918, Paris, Charles-Lavauzelle, 1934, 31 p.
(8) Capitaine Charles Faivre,Mémoire sur lesobservations personnellesfaites au cours de lacampagne 1914-1918,Aubusson, 1920. musée dela Gendarmerie, 4 mu 89.
(9) Mémorial de lagendarmerie, 1915, pp. 280-281.
des auxiliaires intervient en février 1916,lorsque certains d’entre eux sont envoyésau front pour relever des gendarmesprévôtaux. Ce type d’emploi, non prévu àl’origine, correspond en fait àl’accroissement des charges de lagendarmerie aux armées, à la veille de labataille de Verdun. Dans la pratique, lesauxiliaires versés dans les prévôtés ont aumoins un an d’expérience en gendarmerieà l’intérieur, et sont choisis parmi lescélibataires ou veufs sans enfant. Ilsdoivent également avoir été correctementnotés durant leur passage en brigade.
Que ce soit à l’intérieur ou aux armées,les gendarmes auxiliaires, d’aborddiscrets, voire anecdotiques, s’imposentbientôt comme des figuresincontournables. La seule XVIIIe légion(Bordeaux), qui comptait avant-guerremoins d’un millier de gendarmes, emploieainsi progressivement deux cent quarantegendarmes auxiliaires et quarante-septgendarmes temporaires : une partimportante du service repose alors sur lesépaules de ces « vieux novices ». De fait,tous ne sont pas des modèles de vigueurphysique, ni de conscienceprofessionnelle. mais si un certain nombred’erreurs de recrutement amène dans unpremier temps les chefs de légion àprononcer des révocations, d’autresauxiliaires, en revanche, ne tardent guèreà maîtriser les ficelles du métier, et mêmeà s’illustrer : toujours dans la XVIIIe légion,le gendarme auxiliaire Autesserre est par
951ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
DOSSIER
DES « SoLDATS-CIToYEnS » DAnS LA GEnDArmErIE DE LA GrAnDE GuErrE : LES PrEmIErS GEnDArmES AuXILIAIrES
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page95
96
connaissent de fait toute sorte desituations, y compris les plus tragiques :l’auxiliaire milles a disparu en mer après letorpillage du medjerda, le 11 avril 1917,son camarade Brachet, affecté à labrigade de reims, « maintes foisremarqué pour son courage », deux foiscité, est tué par éclat de torpille alors qu’ils’employait à dégager un pont de lamarne sous un intense bombardement,en août 1918. Le gendarme auxiliaire,renfort des prévôtés, devient même, àcette époque, une figure littéraire, sous laplume de Léo Larguier. Son héros,François Pain, est ainsi un fils decordonnier, étudiant en lettres etrépétiteur dans un collège. À lamobilisation, ce conscrit de la classe1897 est rappelé dans l’infanterie où il estblessé deux fois. Versé dans la territorialeaux environs de 1917, il se rengage alorscomme gendarme auxiliaire et sertjusqu’à l’armistice dans la gendarmerieaux armées. Quinze jours après la fin descombats, il meurt de la grippe
espagnole(12). or ilest trèssymptomatique quece gendarme, le seul
qui soit le personnage central d’un romande guerre, ait été un auxiliaire. De fait, cesvieux soldats, si semblables aux troupiersdont ils étaient issus, ont certainementmarqué les esprits.
Vers l’après-guerreÀ partir du 29 juillet 1917, soucieuse de
(12) Léo Larguier, FrançoisPain, gendarme, Paris,Editions françaises illustrées,1919, 272 p.
exemple félicité en 1918 pour avoir« intelligemment secondé son chef debrigade pour découvrir le refuge et réussià capturer dans des conditions difficilestrois déserteurs recherchés depuislongtemps ». Son camarade Delauzun, demarseille, est quant à lui cité à deuxreprises, notamment pour avoir réalisé
plus de six centsarrestations en sixmois(10) !
En cette période de durs combats, lesauxiliaires ont aussi leur lot de victimes.Sur les six mille gendarmes auxiliaires ettemporaires finalement institués, plusieurscentaines sont blessés, tandis qued’autres trouvent la mort dans descirconstances qui traduisent la diversitédes emplois qui leur sont confiés. Vivien,affecté à la brigade de Beaulieu-les-Fontaines, est très grièvement blessé le17 août 1918, pendant la seconde bataillede la marne, et doit être amputé d’unejambe. Qu’ils succombent des suites demaladies ou blessures rapportées desarmées, comme les auxiliaires mahenc ouGendry ou le gendarme temporaireGachassin, victime des bombardements,ou lors du service à l’intérieur commel’auxiliaire Colly, abattu par un malfaiteur,tous ont partagé le quotidien des plus
jeunes gendarmes(11).Participant, au seindes unités de
gendarmerie, à toutes les formes decombats, les gendarmes auxiliaires
(10) Historique de la xVe
Légion de Gendarmerie,Paris, Charles-Lavauzelle,1922, p. 77.
(11) Grand livre d’Orhistorique de la Gendarmerienationale, t. IV, Beaune,Girard, 1939, p. 412.
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
DOSSIER
DES « SoLDATS-CIToYEnS » DAnS LA GEnDArmErIE DE LA GrAnDE GuErrE : LES PrEmIErS GEnDArmES AuXILIAIrES
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page96
n’être pas totalement prise au dépourvuaprès la guerre, la gendarmerie reprendpartiellement son recrutement. Aprèsl’armistice, la libération des rAT supprimede fait l’auxiliariat initié en 1915. Cettemesure représente pour la gendarmeriedépartementale la disparition en quelquesjours de près d’un tiers de son effectif.C’est pourquoi un décret du 23 novembre1918 maintient le statut de gendarmeauxiliaire, tout en décalant sa cible.Peuvent désormais intégrer lagendarmerie comme gendarmesauxiliaires les hommes issus de toutes lesarmes, âgés d’au moins vingt-et-un anset ayant servi pendant un minimum d’unan dans une unité combattante. Par cebiais, la gendarmerie s’ouvre à l’immensevivier des soldats en cours dedémobilisation, et peut rapidement
compenser son sous-effectif. De plus, latitularisation fréquentedes auxiliaires les plusméritants, etl’obligation pour lesmilitaires du rangcandidats à unecarrière dans lagendarmerie d’avoird’abord souscrit unengagement commegendarmes auxiliaires,fait de l’auxiliariat, nonplus seulement uncorps de complément,mais une période
probatoire et un passage obligé avant uneintégration éventuelle dans lagendarmerie.
Certes, la création, le 28 mai 1919, desécoles préparatoires de gendarmerie,destinées à former tous les nouveauxélèves-gendarmes, puis le décret dedémobilisation générale du 23 octobresuivant, qui signe la fin de l’auxiliariat,marquent la clôture de l’expérience.Pourtant, la validité du décret du 2 mai1915 subsiste aussi longtemps que le Dodu 20 mai 1903, auquel il est adossé.C’est pourquoi en 1940, en raison d’unnouvel état de guerre, des réservistes desautres armes sont de nouveaux versésdans la gendarmerie sous le vocable de
971ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
DOSSIER
DES « SoLDATS-CIToYEnS » DAnS LA GEnDArmErIE DE LA GrAnDE GuErrE : LES PrEmIErS GEnDArmES AuXILIAIrES
Ecole préparatoire de gendarmerie de Mamers, 1919
Ser
vice
his
toriq
ue d
e la
Déf
ense
.
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page97
« gendarmesauxiliaires »(13). Enoutre, l’idée, engerme dès 1918, defaire des auxiliairesun corps nonseulement decomplément, maisaussi de transitionpour des militaires ducontingent désireux
de faire ensuite carrière dans lagendarmerie, est directement à l’originede la loi de 1970, qui recrée un corps de« GA », hors de tout contexte de crise – etpour cette fois un quart de siècle(14). C’estdonc de l’issue de la Grande Guerre quele corps des gendarmes auxiliaires, né en1915 de l’enlisement des tranchées, tirevéritablement son origine, et même lesprincipes de son rétablissement à titrepermanent… près de cinquante ans plustard.
(13) La directive n° 760 T/10G du 31 janvier 1940autorise le détachementdans les compagnies degarde républicaine mobile deréservistes des autresarmes, dans la limite d’untiers des effectifs totaux.
(14) La loi n° 70-596 du9 juillet 1970 permet pour lapremière fois à des appelésdu contingent d’intégrer laGendarmerie nationale poury effectuer leur servicenational. Les derniersgendarmes auxiliairesquittent l’Arme en 2002.
98 Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
DOSSIER
DES « SoLDATS-CIToYEnS » DAnS LA GEnDArmErIE DE LA GrAnDE GuErrE : LES PrEmIErS GEnDArmES AuXILIAIrES
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page98
Gendarme et combattants du ciel
Le 26 septembre 1914, le gouverneurmilitaire de Paris autorise une partie dupersonnel de la garde républicaine àservir aux côtés des combattants. Lespremiers volontaires intègrent surtoutdes régiments d’infanterie mais à partirde 1915, les gendarmes sont orientésplutôt vers les armes nouvelles, commel’aviation. Cet article retrace l’histoirede ces hommes qui ont eu l’audace derejoindre les rangs d’une aéronautiquemilitaire naissante.
le recrutement despilotesune circulaire du3 août 1915 prescritde « transmettre àl’administrationcentrale toutes lesdemandes depassage dans lestroupes del’aéronautique ». Siles archives de cette
Ltoute jeune spécialité restent lacunairespour la période 1914-1918, en revanche,les cahiers d’enregistrement de la garderépublicaine consignent ces demandesd’affectation accompagnées de l’avisdes chefs hiérarchiques. Le recrutements’accentue à partir du printemps 1916,lorsque l’aviation de chasse s’organise.Les deux dernières années du conflit ontainsi vu un nombre croissant de pilotessortir des centres d’instruction. Près de17 000 militaires, ayant en commun uncaractère sportif et intrépide ainsi qu’uneaptitude technique pour l’aéronautique,ont rejoint cette formation en 1914-1918.
Quand elles sont complètes, les fichesmatricules des gendarmes permettent desuivre leur parcours. C’est le cas dugarde marcel Lemoine du 2e escadron,désigné pour le 1er groupe d’aviation enseptembre 1916, détaché à l’écoled’Avord en octobre suivant et breveté le14 février 1917. Dirigé sur l’école deClermont-Ferrand en mars, il est nommé
DOSSIER
99
par sAloMé KrAKowsKI
1ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
sAloMéKrAKowsKI
Aspirante de gendarmerie,diplômée de l’École dulouvre et titulaire d’unmaster d’histoire militaire, chargée d’études auService historique de laDéfense.
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page99
adjudant des troupes aéronautiques le8 mai. Il passe ensuite dans lesescadrilles Br 117, puis Br 121 avantd’être muté à la Br 126 en février 1918.Les documents d’archives révèlent qu’ilest « renvoyé de l’aéronautique ». Affectéprovisoirement au 8e régiment decuirassiers en avril, il regagne la garde enoctobre suivant.
Des missions diversifiéesLorsque la guerre éclate, l’aviation estcantonnée à des missions dereconnaissance de jour sur les lignes
ennemies(1). Bientôtles observations desaviateurs permettentle réglage des tirs
d’artillerie tandis que la photographieaérienne se développe à la fin de l’année1914. Christophe Dû, qui a intégré la9e compagnie de la garde en 1911, est
(1) Les missions dereconnaissance de nuit, debombardement et deréglage de tirs d’artilleriesont d’abord confiées àl’aérostation.
breveté pilote en septembre 1916.Adjudant à l’escadrille F 130, spécialisédans les reconnaissances et opérationsde guerre en territoire ennemi, il effectuede longues missions en Tripolitaine. Quantà Gaston Guigon, initialement garde à la7e compagnie, il devient pilote le 23 août1917. Formé aux réglages de tird’artillerie, il sert notamment dansl’escadrille 211 avant de passer dans la509. Le 22 octobre 1918, attaqué partrois avions allemands, il est contraint delivrer un combat au cours duquel sonappareil est sérieusement touché.Détaché comme adjudant dans l’arméed’orient, il reçoit deux citations, dontl’une précise que son « escadrille ayanteu des pertes sévères, [il] a contribuégrandement à relever le moral de sesjeunes camarades en volant jusqu’à septheures par jour, dans des conditions trèspérilleuses ».
100
Gaston Merlhe, détaché dans l'aviation comme adjudant à titre temporaire, pose devant un Caudron G4en 1916 ou 1917.
mus
ée d
e la
gen
dar
mer
ie n
atio
nale
.
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
DOSSIER
GEnDArmES ET ComBATTAnTS Du CIEL
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page100
L’aviation de bombardement estorganisée la première en tant que
spécialité dèsnovembre 1914(2),toutefois sonefficacité est alorsdavantagepsychologique que
matérielle. C’est véritablement à partir defévrier 1915 que le bombardements’organise, les attaques étant désormaisdirigées sur des points névralgiques deslignes ennemies ou à l’arrière du front.Dès l’été, les Allemands mettent en placeune défense efficace provoquant unevéritable hécatombe côté français. Lesmissions de bombardement sontinterrompues des mois durant, avant dereprendre seulement de nuit, puis de jourà la fin de l’année 1917. Issu de la8e compagnie de la garde républicaine,Laurent Pams est détaché dans l’aviationen mai 1916, comme mitrailleur puisaffecté à un emploi de bombardier au seinde l’escadrille VB 101. une citation de1917 indique qu’il « a pris part à seizebombardements de nuit allant toujourssur l’objectif indiqué malgré le feu intensede l’artillerie ennemie ».
Alors que les premiers combats entreaviateurs s’engagent avec de simplesarmes de poing ou d’épaule, on chercherapidement dans les deux camps à mettreau point un appareil monoplace muni d’unarmement maniable et performant. « Lavéritable révolution qui est à l’origine de la
(2) marie-CatherineVillatoux, « L’aéronautiquemilitaire dans la GrandeGuerre : versl’institutionnalisation » inArchives de l’aéronautiquemilitaire de la PremièreGuerre mondiale, Vincennes,Service historique de laDéfense, 2008, p. 21.
chasse […] fut apportée par la mitrailleusefixe dans l’axe tirantà travers l’hélice »(3).Il faut toutefoisattendre le bilan de labataille de Verdunpour qu’une véritabledoctrine d’emploi dela chasse ne soitélaborée(4). Lespremiers groupes decombat voient le jouren octobre 1916rassemblantplusieurs escadrilles
sous un même commandement pourcréer un effet de masse. Garde à pied ausein de la 4e compagnie depuis 1912,Paul noguès rejoint l’aviation en mai 1916en qualité de canonnier. Après avoirobtenu son brevet le 22 août 1917, il estsuccessivement affecté à Avord, miramas,Istres et Le Crotoy.
À côté de ces portraits de pilotes, le casdu garde Léon Conan est intéressantpuisque celui-ci est détaché, en tant quemécanicien, au 2e groupe d’aviation àLyon en juillet 1917. En effet,antérieurement à son entrée à la garderépublicaine en 1913, Conan avaitaccompli son service militaire auxéquipages de la flotte à Lorient en tantqu’apprenti-mécanicien. Enfin, certainsoccupent un poste administratif, telEmmanuel Béroud, réserviste mobilisé enaoût 1914 à l’âge de quarante-trois ans,
(3) Charles Christienne(général), Pierre Lissarrague(général) [et al.], Histoire del’aviation militaire française,Paris, Charles-Lavauzelle,1980, p. 103. malgré lesinnovations de rolandGarros, les Allemandsprennent une longueurd’avance avec leur Fokker.
(4) Abattus un à un par deschasseurs allemands ennombre, les Farman françaisfont face à de grandesdifficultés. Le commandantCharles de rose, chef del’aéronautique, organisealors des patrouilleschargées de « détruiresystématiquement tous lesappareils ennemis, jusqu’à 5à 6 km au-delà de la ligne defront ». marie-CatherineVillatoux, op.cit., p. 26.
1011ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
DOSSIER
GEnDArmES ET ComBATTAnTS Du CIEL
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page101
nommé secrétaire à la directionaéronautique en septembre 1916.
l’icône Gaston MerlheGaston merlhe est sans aucun doute leplus célèbre des gendarmes aviateurs. néà Bannalec le 24 octobre 1884, il fait sespremières armes au 21e régiment dedragons avant de s’engager dans lagarde républicaine. nommé maréchal deslogis à cheval en décembre 1913, il estaffecté au 1er escadron au quartier desCélestins. Lorsque la guerre éclate,merlhe se porte volontaire pour servir surle front, mais doit attendre 1916 pour voirsa demande aboutir. Il choisit alors derejoindre le personnel navigant del’aéronautique militaire. Détaché commeélève pilote, dès mars 1916, au centred’aviation de Dijon puis à l’école de Tours,il vole pour la première fois le 4 avril.« Assidu et doué d'un grand sang-froid, ildevient rapidement un excellent gardepilote. En juillet 1916, après 30 heures et20 minutes de vol, […] Merlhe reçoit sonbrevet d'aviateur ». Il rejoint alorsl’escadrille C 105 puis la C 229 quelquesmois plus tard. Pilotant un Caudron, « ilengage son premier combat aérien [mi-novembre 1916]. L'appareil allemand qu'ilattaque, complètement désemparé faceau mépris du danger de Merlhe, esttouché de plusieurs impacts de
mitrailleuse et romptl'engagement pourrejoindre seslignes »(5). Enchaînant
(5) François rivet (chefd’escadron), « un destinexceptionnel : le chefd’escadron Gaston merlhe(1884-1951) », Le Trèfle,n°102, mars 2005, p. 53.
102
les sorties au cours de l’année 1917, iln’hésite pas à attaquer les appareilsennemis tentant de pénétrer les lignesfrançaises ; son avion est d’ailleurs cribléde balles à plusieurs reprises. Ainsi, le30 avril, il parvient seul à mettre en fuiteun chasseur qui tentait d’incendier undirigeable français. Il engage au total dixcombats décisifs au cours de la guerre.
Ses quatre citations,qui signalent sonaudace et son sang-froid, témoignent dela diversité desmissions menées(6).
la contribution dela gendarmeriedépartementaleSi la plupart de cesnouveaux pilotesproviennent de lagarde républicaine,
« en réalité, des gendarmes […] sontprélevés sur toutes les légions où existeune certaine disponibilité »(7) ; la légion degendarmerie départementale de Parisfournit ainsi quelques hommes àl’aéronautique. âgé de vingt-quatre ans,le maréchal des logis Etienne Laliat est leplus jeune d’entre eux et semble être lepremier gendarme à intégrer l’aviation,dès novembre 1915. Quant à JulesGodiveau, il est d’abord détaché au seinde la prévôté de la 83e division, puisintègre l’école de Dijon et obtient sonbrevet le 17 septembre 1916. Il rejoint
(6) Souffrant d’une blessureà la jambe droite, sa carrièrede pilote s’achève à la sortiede la guerre. Devenulieutenant en juillet 1917 etréintégré dans son armed’origine, il reçoit lecommandement dudétachement degendarmerie de l’Afriqueoccidentale française àDakar entre 1921 à 1941. Ilassure ensuite les fonctionsd’inspecteur principal etcommandant des gardes-cercles, puis de juge de paixà Kolda. Le chef d’escadronmerlhe meurt le12 septembre 1951 auSénégal.
(7) Louis n. Panel, LaGrande Guerre desgendarmes, Paris, nouveaumonde, 2013, p 63.
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
DOSSIER
GEnDArmES ET ComBATTAnTS Du CIEL
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page102
ensuite le GB 4, puis l’escadrille n 92. Leparcours le plus remarquable est sansconteste celui d’Eugène Simon,gendarme à cheval à Longjumeau,mobilisé dans la prévôté de la 10e arméeen mai 1916, avant d’être nommé élèvepilote au 1er groupe d’aviation de Dijoncinq mois plus tard. Passésuccessivement par les écoles d’Avord etde Pau au cours de l’année 1917, ilintègre l’escadrille SPA 81 en mai. « Piloted’une rare conscience, d’une ténacité etd’une ardeur remarquables dans lecombat […], le 30 septembre 1917, bienqu’ayant sa mitrailleuse enrayée, [iln’hésite pas] à se porter seul avec uncamarade de combat à la rencontre d’uneforte patrouille ennemie qui menaçait unavion de réglage qu’il a brillammentdégagé ». Le 16 octobre 1917, ilremporte une belle victoire en abattant unadversaire dans les lignes françaises,action qui lui vaut une citation à l’ordre del’armée. Porté disparu au cours d’uneoffensive française au nord de montdidier,il est déclaré « mort pour la France » le31 mars 1918, après la découverte del’épave de son Spad atteint par l’artillerieallemande.
Devoir de mémoire« Le risque domine la vie des aviateurs :hasard des combats qui souvents’achèvent par une mort atroce, maisaussi malchance des accidents si
nombreux à cetteépoque de machines
(8) Charles Christienne(général), Pierre Lissarrague(général), op.cit., p. 184.
fragiles et peu sûres »(8). on estime que,durant la Première Guerre mondiale, troisdécès sur cinq sont causés par desdéfaillances techniques. Ainsi, GabrielFradet, brigadier de la 6e compagnie de lagarde républicaine, incorporé au1er groupe d’aviation, est victime d’unechute lors d’un entrainement à Istres le19 novembre 1917. Comme l’ensemblede ses camarades disparus au cours duconflit, son nom est inscrit au monumentaux morts de l’arme.
La gendarmerie a tenu à rendre plusparticulièrement hommage à deux de sespersonnels décédés au cours du conflit. Àce titre, en 2001, le 68e stage d’élèvesgendarmes de l’école du mans a reçu le
nom de gardeAntoine Lingueglia(9),sergent mitrailleur àl’escadrille Br 126,déclaré mort pour laFrance le 27 mai1918 à la suite d’uncombat aérien au-
dessus de Coucy-le-Château. outre sonappartenance à la gendarmerie et sonservice dans l’aéronautique, l’insigne de lapromotion Lingueglia évoque le lieu de sadisparition ainsi que ses deux citations(10)
accompagnées de la croix de guerre,avec étoile de bronze puis avec palme, etde la médaille militaire.
En 2008, la 295e promotion de l’école demontluçon a choisi la figure du garde
(9) né le 8 juin 1889,Lingueglia intègre la 8e
compagnie de la garde en1911. Volontaire pour servirau front, il est détaché au1er groupe d’aviation de Dijonen septembre 1916.
(10) Citations à l’ordre durégiment le 1er novembre1917 et à l’ordre de l’arméele 13 juillet 1918.
1031ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
DOSSIER
GEnDArmES ET ComBATTAnTS Du CIEL
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page103
Emile Dhumerelle(11).Adjudant pilote issudu régiment decavalerie, il est
affecté à l’escadrille F 130 à partir demars 1917. Il participe à huit missions debombardement à longue distance avantqu’un grave accident ne mettesubitement fin à sa carrière : le 22 août,son Farman, touché au retour d’unemission offensive sur Verdun, s’écrase surle plateau de malzéville. L’insigne de cettepromotion associe un vol – meublehéraldique constitué d’une paire d’ailes –et le casque des cavaliers brochés surune épée en pal portant le nom de cegendarme. L’ensemble repose sur unegrenade reprenant les couleurs de lamédaille militaire et de la croix de guerre1914-1918, reçues à titre posthume.
le retour dans les subdivisionsd’armes d’origineCertains gardes quittent l’aéronautiqueavant même la fin du conflit tel EmileBarbillat qui, après avoir servi dans lesescadrilles SAL 215 et F 218, est rayé dupersonnel navigant pour inaptitudephysique en janvier 1918 et renvoyé à lalégion de la garde républicaine. Combledu destin, quelques mois plus tard, il estblessé par une bombe larguée sur lequartier des Célestins.
La possibilité pour ces gendarmes depoursuivre leur carrière dans l’aviation àl’issue de la guerre reste faible puisqu’uneinstruction du 21 décembre 1918 sur la
(11) né le 1er juin 1887,Dhumerelle est nommé élèvegarde à cheval au 2e
escadron en 1910. Brigadierau 4e escadron en 1915, ilest détaché au 1er groupe
104
réintégration des militaires détachésstipule que « la situation déficitaire deseffectifs de la gendarmerie commande leretour dans leur arme de tous leséléments disponibles ». rares sont ceuxqui ne réintègrent pas leurs unités.Exception notable, Isidore Fauré, garde à4e compagnie entré dans l’aviation en juin1916, est rengagé comme adjudant au29e bataillon de chasseurs à pied àcompter du mois de juillet 1919. Il en estde même de Claude Cardinal entré au1er escadron de la garde en 1909 et passéà l’aviation en octobre 1916, sa fichematricule indiquant son versement au29e régiment d’artillerie de campagne.
Quelle que soit leur destinée après-guerre, les parcours de ces militairesattestent la participation de lagendarmerie aux combats de 1914-1918,démontrant que l’Institution œuvre bienau-delà de ses missions traditionnelles,comme la prévôté. Le livre d’or de l’armecontient ainsi quatorze citationscommémorant les actions de cesgendarmes ayant eu l’honneur departiciper aux débuts de l’aéronautiquemilitaire, spécialité qui devient une armedistincte en 1922, puis une armée à partentière en 1933.
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
DOSSIER
GEnDArmES ET ComBATTAnTS Du CIEL
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page104
Prévôté et lutte contre l’alcoolisme dans le Groupe d’armées duNord pendant la Grande Guerre
Cet article a été publié en 2000 dans le hors-série n° 2
de la Revue de la gendarmerie nationale.
Loin de l’idée générale d’unealcoolisation des troupes tolérées parla hiérarchie pour aider à supporter lesrigueurs du front, l’examen des faits etdes textes montre que la hiérarchie amis en œuvre un certain nombre demesures pour réprimer l’alcoolisme etatténuer ses effets en matièred’indiscipline et d’ordre public. Lagendarmerie prévôtale s’est vue confiercette mission. Elle s’en acquittera nonsans susciter une hostilité descombattants tous grades confondus.
« La mobilisation des armées françaises deterre et de mer est ordonnée sur toutel’étendue du territoire français, en Algérie,dans les autres colonies et dans les paysde protectorat. Tout français soumis aux
obligations militairesdevra se conformeraux prescriptions
Lcontenues dans ces affiches sous peined’être punis avec toute la rigueur deslois ». Tels sont les termes du décret demobilisation générale signé, le 1er août1914, de la main du président Poincaré.Le même jour, à seize heures, lesbrigades de gendarmerie reçoivent untélégramme leur enjoignant, pour lelendemain, de proclamer partout l’appelaux armes. Si la zone des armées dunord-Est est fixée par l’arrêté le 2 août,le Groupe d’armées du nord (GAn)obtient son appellation le 13 juin 1915.La gendarmerie prévôtale opérant sur ceterrain est alors chargée de la police etde la justice militaire.
les prévôtés en 1914 : des missionstraditionnellesTout au long de la guerre, plus de17 000 gendarmes ont fait partie, parrelèves, des formations prévôtales, avecun nombre maximal de 6 000 présents.Ces unités sont constituéesconformément au décret du 20 mai
DOSSIER
105
par MArIe-lAUre Fery
1ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
MArIe-lAUre Fery Maîtrise d’histoireUniversité Paris IV
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page105
1903, portant règlement sur l’organisationet le service de la gendarmerie, et àl’instruction sur l’organisation et le rôle dela gendarmerie aux armées du 31 juillet1911. mais ce dernier texte a été conçupour une guerre de mouvement et delignes d’étapes, alors qu’après la bataille
la marne et celle del’Yser, la stabilisationdes arméesfrançaises donne,selon le généralLarrieu, « lespectacle dumauvais emploid’une grande partiede son personnel »(1).Avec la mêmeamertume, le colonelIgert(2) dénonce ledétournement desprévôtaux de leurs
fonctions originelles et leur transformation
(1) Général Larrieu, « LaGendarmerie depuis leConsulat », Gendarmerienationale. Revue d’études etd’informations, 3e trimestre,1953, p. 11.
(2) Les prévôtaux sontprésents sur les carrefours,notamment pour protégerles convois à pied, et àl’entrée des villages. Armésd’un fanion de jour ou d’unelanterne colorée la nuit, leprévôt se fige souvent en« épouvantail ». Cette ingratemission a contribué àmaintenir la fluidité des fluxlogistiques notamment lorsde la bataille de Verdun.Louis-n. Panel « Lagendarmerie dans la bataillede Verdun (février-octobre1916) – maintenir l’ordresous le feu », Revuehistorique des armées, 242,2006 p 69-69
en sentinelle à la manière« d’épouvantails ».
Le service prévôtal revêt des aspectstraditionnels : police des cantonnements,répression du pillage, de l’espionnage etdes menées défaitistes, service de lacirculation dans les agglomérations et surles routes, service du champ de bataille.mais les gendarmes prévôtaux sont aussichargés de missions particulières, parfoisliées à l’abus d’alcool, qui sert de dérivatifaux troupiers cantonnées en ville :surveillance des débits, répression àl’égard des contrevenants, garde desprisons prévôtales, instruction près lestribunaux militaires.
l’élaboration d’un arsenal juridiquede lutte contre l’alcool et ses méfaitsA partir de 1915, le commandement estpréoccupé par une véritable crisedisciplinaire liée à l’abus d’alcool dans latroupe. Le paroxysme est atteint en 1917,comme en témoigne la récurrence decertains chefs d’inculpation. Le 19 juillet,par exemple, un caporal et un deuxièmeclasse sont arrêtés par la prévôté de ladirection des étapes du GAn en gare de
Château-Thierry pour« ivresse, outrages etmenaces, violationde consigne ». Le10 août, dans lamême gare, undeuxième classe estarrêté pour les actes
(3) Service historique de laDéfense, 18 n 198. GAn,direction des étapes Est,état-major, compte rendu ausujet des arrestationsopérées par la prévôté de ladirection des étapes Estpour la provocation demilitaires à l’indiscipline, crisséditieux, rébellion, outragesà des officiers ou agents dela force publique, juillet-août1917.
106
Unité de réservistes en stationnement lorsd’un mouvement de troupes.
Col
lect
ion
A.C
arro
bi
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
DOSSIER
PréVôTé ET LuTTE ConTrE L’ALCooLISmE DAnS LE GrouPE D’ArméES Du norD PEnDAnT LA GrAnDE GuErrE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page106
« d’outrages, de voies de fait envers unsupérieur pendant le service, rébellion,violence sur les gendarmes, ivressepublique et manifeste »(3).
L’alcoolisme et l’indiscipline, qui lui estassociée, sont fermement combattus parles autorités militaires, comme le prouventles nombreuses réglementations qui sesuivent et se complètent tout au long dela guerre. outre la législation déjà prévuepar le Code pénal et le Code de justicemilitaire, le général commandant en chef,et surtout les généraux commandant desarmées du nord, prennent des arrêtésfermes à l’égard des hommes de troupetrouvés en état d’ébriété pour possessiond’alcool et des débitants contrevenants.Le 3 novembre 1915, le général Duboiscrée, dans la zone de la 6e armée, unservice de surveillance de la circulation etde la vente de l’alcool, confiée auxprévôtés et aux douaniers. Agents duministère des Finances, ces derniersjouent un rôle essentiel dans lasurveillance des débits de boisson. Lesreceveurs des contributions indirectesétablissent, de leur côté, un relevé desdébitants installés dans la localité, surlequel sont mentionnés leurs noms etadresses ainsi que les quantités totalesde spiritueux et de boissons alcooliséesreçues, avec le nom et l’adresse desmaisons expéditrices. Ces enquêtespermettent aux représentants despouvoirs publics de découvrir certainesirrégularités de transport ou de vente. Le
3 octobre 1916, le général Humbert,commandant la 3e armée, définit lesdomaines de compétence de tous lesagents de l’Etat concernés : « lesbrigades de douaniers chargés de lasurveillance des débits, les postes fixesou mobiles de gendarmerie, chacun en cequi le concerne, exerceront unesurveillance active sur les voituresmilitaires ou civiles […] Les prévôté desCA et de la DES, la force publique des DIrelèveront chez les receveurs-buralistesou agents des contributions indirectestous les acquits à caution délivrés pour le
transport de l’alcooldes boissonsalcoolisées »(4).
Finalement, l’autoritémilitaire, pour venir àbout de laconsommationd’alcool, décide desmesures énergiques
le 7 septembre 1917(5) : recours auxgendarmes prévôtaux pour limiter lesarrivages de vin, réquisition des livraisonsexcessives, restriction du nombre desdébits par la fermeture de certainsétablissements et l’interdiction descréations. Il est également prescrit unevérification stricte des heures d’ouverturedes cafés et restaurants pour lesmilitaires. Ces interventions successivesd’acteurs civils et militaires dans letraitement de la crise disciplinaire liée àl’alcoolisme s’expliquent essentiellement
(4) SHD, 18 n 190. Etat-major de la 3e armée,1er bureau. Instruction dugénéral Humbert pour lesCA, DI et la DES n° 1/203du 3 novembre 1916.
(5) SHD, 18 n 190. GQGdes armées et du nord-Est,état-major, 1er bureau, notesur les droits de l’autoritémilitaire pour éviter l’abus dela consommation du vindans la zone des armées,7 septembre 1917.
1071ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
DOSSIER
PréVôTé ET LuTTE ConTrE L’ALCooLISmE DAnS LE GrouPE D’ArméES Du norD PEnDAnT LA GrAnDE GuErrE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page107
par la non-application des anciensrèglements.
les applications limitées de lanouvelle réglementationCertains textes restent allusifs quant ausort du débitant pris en flagrant délit devente illicite d’alcool à des militaires. Legénéral Humbert, dans une lettre du12 juillet 1916, rappelle qu’en cas de« condamnation pour fraudes,d’infractions aux arrêtés de l’autoritémilitaire, de désordres, de cas d’ivresseconstatés ou répétés, l’établissementsera consigné à la troupe, et la fermeturepourra être prononcée par mesure depolice par l’autorité militaire. En cas derécidive, les contrevenants pourront être
évacués de la zonedes armées »(6).
Contrairement à ceque l’on pourrait
penser, les procès-verbaux dressés parles gendarmes prévôtaux pour abusd’alcool et actes d’indisciplinen’aboutissent pas systématiquement àdes plaintes devant le conseil de guerre.Lorsque c’est le cas, du fait de la gravitédu délit ou du crime, l’inculpé prétextetoujours avoir été pris de boisson. En1914, l’ivresse en soi est une simplecontravention et faire reconnaître, sur lesprocès-verbaux dressés par lesprévôtaux, que cet acte a été commissous l’empire de l’alcool permetd’invoquer des circonstances et desexcuses atténuantes devant la juridiction.
(6)SHD, 18 n 190. Etat-major, 3e armée, 2e bureau,correspondance avec legénéral commandant le13e CA, 12 juillet 1916.
108
Dès lors, les conseils de guerre du GAnfinissent pas rejeter les plaintes pour délitsmineurs avec situation d’ébriété. D’unepart, avec une séance tous les trois jourspour juger une douzaine d’affaires dont laplupart sont graves, les tribunauxmilitaires sont surchargés. D’autre part,en cas d’ivresse et de délit associé, leconseil de guerre condamne le prévenu àune détention de quinze jours à un mois,soit le temps approximatif déjà passé enprévention à la prison prévôtale.Autrement dit, le condamné, qui sort librede la séance de conseil de guerre, estreconduit par la prévôté à son unité. Enrevanche, s’il avait été remis à son chefde corps aussitôt après l’infraction, cedernier lui aurait infligé immédiatementune peine adaptée.
« Ils ont droit à la considération et àl’estime des autres militaires »Les missions prévôtales de surveillance etde répression de l’alcoolisme sontimpopulaires auprès des populationsciviles, mais surtout parmi les troupiers.Pour ces derniers, plus qu’un simpletrouble-fête, le gendarme est celui qui faitpunir puisque le procès-verbal déclencheune procédure disciplinaire, et quiapplique des sanctions en gardant laprison prévôtale ou ramenant les fautifs àleur corps. Les procès-verbaux dresséscontre des permissionnaires pour outrageà agents de la force publique mentionnenttrès souvent les injures de « lâches »,« planqués de l’arrière » ou « pourris de
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
DOSSIER
PréVôTé ET LuTTE ConTrE L’ALCooLISmE DAnS LE GrouPE D’ArméES Du norD PEnDAnT LA GrAnDE GuErrE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page108
civils » lancées aux prévôtaux. En outre,cette violence verbale est souventaccompagnée de coups et blessures surles gendarmes. Le 5 juillet 1917, à Saint-Dizier, les tentatives de ces derniers pourrétablir l’ordre se heurtent à la solidaritéde soldats ivres. Ce jour-là, lespermissionnaires attaquent les forces del’ordre qui ont arrêté deux d’entre eux,n’hésitant pas à « taper sur les
embusqués »(7).Cette situationconflictuelle montre
l’amertume de soldats qui méconnaissentle danger encouru par ceux qui sont aussichargés de la surveillance des routes etde la circulation sur le front dans deszones parfois soumise auxbombardements.
(7) Guy Pédroncini, Lesmutineries de 1917, Paris,PuF, 1996, pp. 177-178.
1091ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
DOSSIER
PréVôTé ET LuTTE ConTrE L’ALCooLISmE DAnS LE GrouPE D’ArméES Du norD PEnDAnT LA GrAnDE GuErrE
APPEl à COMMUNICATION :UNE AUTRE HISTOIRE DEl’EUROPE EN GUERRE.GENDARMERIES ET POlICESFACE A ̀lA PREMIER̀E GUERREMONDIAlE (1914-1918)
Colloque international organisé à l’EOGN àMelun les 4, 5 et 6 février 2016 par Le Centrede recherche de l’École des officiers de laGendarmerie nationale et Le musée de laGendarmerie, en partenariat avec L’universitéParis-Sorbonne, Le Centre d’histoire du XIXe siècle, Le Labex EHNE, L’université catholique de Louvain-la-Neuve, Le Pôle d’attraction interuniversitaire «Justice et populations : l’expérience belge enperspective internationale »)Accompagnées d’un CV d’une page, lespropositions de communication (jusqu’à 1500mots environ) seront envoyées avant le 1er juin2015, aux adresses suivantes :[email protected]@[email protected]
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page109
110
Les lacunes de la réglementationrelative à la répression de ladiscipline ont été peu à peu
comblées. Les instructions réitérées desquartiers généraux du GAn, et surtout dechaque armée, prouvent l’applicationlimitée de chacune de ces consignes. onpeut donc imaginer l’ampleur de lamission prévôtale de surveillancequotidienne et de répression, assuréeconjointement à celle des douaniers etdes gendarmes territoriaux. La prévôtéexerce une tâche ingrate, méprisée parles simples fantassins comme par lesofficiers de l’armée de Terre, à tel pointque le général Pétain est dansl’obligation, en juillet 1917, de rappeler àses hommes le respect dû à la policeprévôtale. un mois plus tard, le généralGuillaumat, commandant la 2e armée,explique que les gendarmes à l’œuvre surle front « ont droit à la considération et à
l’estime des autresmilitaires »(8). Les3 500 citations avecattribution de la croixde guerre délivrées
aux prévôtaux montrent que les autoritésmilitaires ont reconnu la qualité de leurtravail.
(8) SHD, 18 n 189. Etat-major, 2e armée, ordregénéral n° 8652 du généralGuillaumat sur les« difficultés entre lesgendarmes et les militairesdes autres armes », août1917.
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
DOSSIER
PréVôTé ET LuTTE ConTrE L’ALCooLISmE DAnS LE GrouPE D’ArméES Du norD PEnDAnT LA GrAnDE GuErrE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page110
la gendarmerie coloniale durant la Première Guerre mondiale
À la veille de la Première Guerremondiale, la gendarmerie coloniale estprésente dans une grande partie del’empire français. Ce vaste espaceultramarin n’est pas censé jouer de rôlemajeur dans le conflit à venir, prévupour être bref, avec une batailledécisive en Europe. Néanmoins,l’orientation vers une guerre totale,mobilisant toutes les énergies, entraînel’exploitation des ressources del’immense empire colonial pourapporter à la métropole certainesdenrées et surtout des combattants et
des travailleurs.Face à cesbouleversements,quel rôle lagendarmeriecoloniale a-t-ellejoué entre 1914 et1918 ?
AUne force réduite, dispersée maispolyvalenteSelon l’annuaire de la gendarmerie de1914, la gendarmerie coloniale est àl’image de l’empire français de l’époque :sa diversité est le fruit de son histoire.Absente de l’Afrique noire (hors Sénégal),elle est aussi exclue de l’Algérie et de la
Tunisie(1). Enrevanche, on latrouve au maroc etmême en Chine(force publique).Son ancienneté est
variable selon les colonies(2). Elle remonteau XVIIIe siècle pour la martinique et laréunion, alors que sa présence aumaroc ne date que de 1907.
Placée dans les attributions du ministredes Colonies, la gendarmerie coloniale
manque, parailleurs,
d’homogénéité(3). Elle se compose d’unejuxtaposition de détachements
(1) La XIXe légion d’Algérieet la compagnie de Tunisiesont classées dans la« gendarmerie desdépartements ».
(2) La dénomination de« gendarmerie coloniale »date de l’ordonnance du17 août 1835.
(3) Articles 64 et 65 dudécret du 20 mai 1903.
DOSSIER
111
par BeNoîT hABerBUsch
1ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
BeNoîThABerBUsch Chef d’escadron, docteuren histoire, est chercheurau Service historique de laDéfense.
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page111
administrés séparément les uns desautres, chacun sous l’autorité d’ungouverneur. on compte ainsi huit officierset 273 gendarmes coloniaux dans larégion caraïbe (Guadeloupe, Guyane,martinique), six officiers et240 gendarmes coloniaux en Indochine(détachements d’Annam-Tonkin et deCochinchine-Cambodge), enfin deuxofficiers et 99 hommes en océanie (Tahitiet nouvelle-Calédonie). À cela s’ajoutentles petits détachements de la réunion
(deux officiers, 85 hommes), du Sénégal(21 hommes), de Saint-Pierre-et-miquelon(10 hommes), des établissements del’Inde (2 officiers et 9 hommes) et de laforce publique de Chine (9 hommes). Autotal, en 1914, la gendarmerie colonialecomprend 26 officiers et 1 020 gradés ougendarmes. Cet effectif limité, face àl’immensité des territoires à contrôler, estrévélateur de la sous-administrationchronique des colonies françaises.
112
En Polynésie, le poste de gendarmerie peut se composer d’un seul homme.
Ser
vice
his
toriq
ue d
e la
Déf
ense
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
DOSSIER
LA GEnDArmErIE CoLonIALE DurAnT LA PrEmIèrE GuErrE monDIALE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page112
Son organisation, directement inspirée dela métropole, reprend la répartition enarrondissements, sections, brigades etpostes à pied ou à cheval. Son personnelest exclusivement de souche européenne.Toutefois, on note le recours à desauxiliaires ou des supplétifs, comme enIndochine et en Inde, où les gendarmesencadrent une gendarmerie indigène
composée de50 gradés et263 cipahis(4).
En matière de missions, le ratio desactivités militaires et civiles dépend dudegré de pacification. Ainsi au maroc, oùla conquête est loin d’être achevée, lesgendarmes effectuent avant tout unservice de prévôté. C’est le cas dumaréchal des logis Bouvier. En août 1914,détaché auprès d’une colonne militaire, ila déjà pris part à sept combats dont celuide Zidania. Dans les autres territoires, cesmilitaires remplissent des tâchesdébordant largement le cadre traditionneldes missions du gendarme. Ils peuventcumuler les fonctions de maire, d’officierd’état civil, de juge de paix, decommissaire de police, de gardien deprison, de douanier, de percepteur, depostier, de sergent recruteur... Cettepolyvalence constitue une autrecaractéristique majeure de la gendarmeriecoloniale du début du XXe siècle.
Une entrée en guerre à géométrievariableL’absence de plan de défense coordonné
(4) Décret du 22 mai 1908,Mémorial de la Gendarmerie1908, pp. 337-343.
de l’empire colonial n’empêche pas uneaugmentation de la charge de travail desgendarmes coloniaux dans les mois quiprécédent le conflit, en raison del’application dans une partie des coloniesde la loi du 7 août 1913 sur lerecrutement de l’armée. Ainsi, à laréunion, le sous-lieutenant Favreau noteque cette mesure donne lieu à « denombreux déplacements et a nécessité
un grand nombred’enquêtes »(5).
Le 1er août 1914,lorsque la mobilisation générale estdécrétée en France, la nouvelle sepropage rapidement dans l’empire malgrél’immensité des distances. Dès le 2 août,les gendarmes du Sénégal et des Antillesen sont informés. À la martinique, lecommandant du détachement reçoit letélégramme suivant : « Ordre demobilisation générale, le premier jour de lamobilisation est le dimanche 2 août 1914.Ouvrir immédiatement le pli cacheté quivous a été adressé et mettez à exécution
les instructions qui ysont contenues »(6). Àla réunion, le décret
de mobilisation est notifié le 3 août 1914à 0 heures 15. Informé avec un légerdécalage, le gouverneur général del’Indochine décide néanmoins de surseoirà l’exécution du décret pour le motifsuivant : « Cette mesure, qui ne seraitjustifiée par aucune nécessité de défense,désorganiserait tous les services,
(5) rapport n° 580 du23 juillet 1914 du sous-lieutenant Favreaucommandant la section deSaint-Pierre, SHD, 974 E 42.
(6) Télégramme n°468 remisle 2 août au commandant dudétachement de lamartinique, SHD, 972 E 4.
1131ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
DOSSIER
LA GEnDArmErIE CoLonIALE DurAnT LA PrEmIèrE GuErrE monDIALE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page113
suspendrait vie économique et sociale ettroublerait profondément population
indigène en cemoment dans leursrizières »(7).
En Polynésie, la confirmation officielle del’entrée en guerre ne parvient que le29 août 1914, mais les autorités de Tahitiont déjà su prendre les mesuresnécessaires grâce aux informationséchangées lors de la rencontre fortuite, le2 août 1914 à raiatea, du croiseur
(7) Copie d’un télégrammereçu le 8 août 1914 aucabinet du ministère de laGuerre, SHD, 5 n 88.
114
cuirassé montcalm et de la canonnière laZelée. Aussi, lorsque les navires, leScharnhorst et le Gneisenau, de l’amiralvon Spee s’apprêtent à investir Papeetele 22 septembre 1914, ils ne s’attendentpas à être reçus à coups de canons.Surpris par cette résistance organisée parle capitaine de vaisseau Destremau etignorant la capacité des forces adverses,l’amiral von Spee décide de lever l’ancre,non sans avoir bombardé Papeete. Aucours de l’incendie qui détruit une partiede la ville, l’adjudant de gendarmerie
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
En 1914, la gendarmerie du Sénégal est de 21 hommes.
Ser
vice
his
toriq
ue d
e la
Déf
ense
DOSSIER
LA GEnDArmErIE CoLonIALE DurAnT LA PrEmIèrE GuErrE monDIALE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page114
Bouillaud se distingue dans l’organisationdes secours et la lutte contre le feu. Lesgendarmes disséminés dans les îles duPacifique, notamment aux marquises,vivent sous la menace de l’escadre de
l’amiral von Speejusqu’en décembre1914, date de sadestruction(8).
l’Empire tiendra-t-il ?Comme en métropole, les gendarmescoloniaux participent à la mise en œuvredes forces. Aux Français, appelés sousles drapeaux dans les troupes coloniales,s’ajoutent les indigènes recrutés sur labase du volontariat, mais le plus souventcontraints de s’engager. L’état sanitairede ces derniers est généralementdéplorable comme le regrette, enseptembre 1914, le général Pineau,commandant les troupes de l’AoF. Selonmarc michel, la présentation de tant « demalingres, de goitreux, de malades, devieillards, surtout d'hommes dont la tailleétait inférieure à la limite réglementaired'1,66 mètre » n’est pas seulement lereflet de la misère physiologique de lapopulation mais constitue une forme
subtile derésistance(9). Quoiqu’il en soit, enAfrique, les
gendarmes sont en plus confrontés à desépidémies qui désorganisent lamobilisation. Au Sénégal, par exemple,
(8) Benoît Haberbusch ,« La gendarmerie dePolynésie entre 1900 et1914 », Revue de laGendarmerie nationale,n°245, mars 2013, pp. 116-121.
(9) marc michel, LesAfricains et la GrandeGuerre, l'Appel à l'Afrique(1914-1918), Paris, Karthala,2003, p. 37.
ceux des brigades de Dakar sontdistingués pour leur action dans la luttecontre la peste entre 1914 et 1915.
Les gendarmes poursuivent, en outre,leur activité de renseignement devenueplus sensible. À la martinique, legouverneur désire être renseigné dès le12 août sur l’état d’esprit de la populationet l’évolution des prix. « L’enquête,précise-t-il, devra être faite avec tout letact voulu, de façon à ce que lapopulation ignore que l’administration sepréoccupe de l’état de chose créé par la
guerreeuropéenne »(10). Lesautorités coloniales
se méfient plus particulièrement desmenaces venant de l’extérieur. Aumaghreb français, la fidélité de lapopulation musulmane envers la Francefait l’objet de rapports réguliers en raisondes actions menées à son égard parl’Allemagne et la Turquie. De gravestroubles éclatent en Algérie en novembre1916 et en Tunisie en août 1917. EnIndochine, on redoute l’influence néfastedes agents consulaires allemandsimplantés au Yunnan pour attiser la hainedes révolutionnaires annamites. Du reste,durant cette période, la gendarmerie estconfrontée à plusieurs révoltes locales,comme à la prison de Saïgon et à Bâti(Cambodge) les 15-16 février 1916 et aupénitencier de Thai-nguyen au Tonkin le30 août 1917.
(10) Demande transmise le12 août 1914 auxcommandants de section dela martinique, SHD 974 E 4.
1151ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
DOSSIER
LA GEnDArmErIE CoLonIALE DurAnT LA PrEmIèrE GuErrE monDIALE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page115
116
frustration est-ellepartagée par lesgendarmescoloniaux ? Difficilede le dire, faute de
sources. Toutefois, plusieurs d’entre euxdemandent à partir au front, à l’instar dulieutenant Touchard à la martinique. Enmars 1915, il sollicite un emploi de songrade, pour la durée de la guerre, dansson corps d’origine, la cavalerie. Laplupart de ces demandes sont refuséescar la présence de ces militaires est jugéeindispensable par les autorités coloniales.Le 23 novembre 1916, la circulaireministérielle (Guerre) n°7815 3/2 avise lesgendarmes coloniaux qu’ils doivent resterà leurs postes pendant la guerre. À défautde rejoindre les armées, ces dernierspeuvent participer financièrement à l’effortcollectif. Le 1er avril 1918, le personnel dudétachement de la réunion verse ainsi22 241 francs aux œuvres patriotiquesdiverses.
Les seuls gendarmes coloniaux àrejoindre le front sont les permissionnairesbloqués en métropole au moment de ladéclaration de la guerre. on compte, parexemple, cinq gradés et 13 gendarmesvenant de la réunion, 28 gradés etgendarmes servant à la Guadeloupe et18 « Guyanais » dont le commandant dudétachement (soit 41 % des effectifs de laGuyane !). Certains sont détachés dansles corps de troupe, tel le gendarmeGuillaumet de la réunion versé comme
(11) Lettre du 30 novembre1914 du général de divisionLyautey, commissairerésident général de Franceau maroc, commandant enchef, au ministre de laGuerre, SHD, 6 n 28.
En nouvelle-Calédonie, si les effets de laguerre ne sont pas immédiats, lestensions de la colonisation sont réactivéessous le double effet de la dégradation desconditions de vie et de la mobilisation. Laponction sur la population locale nereprésente pourtant que 8,48 % pour lesBlancs (1 025 hommes sur 11 403) et5,39 % pour les indigènes (1 078hommes sur 27 580). En avril 1917, àKoné, un différend entre des tribus deconfessions différentes dégénère enrévolte à cause de l’interventionmaladroite des autorités. S’ensuit alors,jusqu’en 1918, le cycle infernal« agression-répression » qui entraîne lamort d’une dizaine d’Européens et d’unesoixantaine de mélanésiens.
« …Qu’on ne les considère pascomme des inutiles et desembusqués »En novembre 1914, le général Lyautey seplaint de la dégradation de l’état d’espritdes officiers servant sous ses ordres aumaroc : « Mes officiers s’accusent de nepas rendre au pays les services qu’il esten droit d’attendre de leur valeur, de leurexpérience de soldat de métier. Ils sefigurent qu’il le leur reprochera, qu’il leleur reproche déjà […] ces sentiments […]tenaillent tous les esprits […], malgré lesparoles […] du ministre pour les assurerqu’on ne les considère pas comme desinutiles et des embusqués »(11). Cette
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
DOSSIER
LA GEnDArmErIE CoLonIALE DurAnT LA PrEmIèrE GuErrE monDIALE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page116
sergent au 59e régiment d’infanterie. Il esttué le 12 mai 1915 à Thélus (Pas-de-Calais). D’autres rejoignent des prévôtés,tel le gendarme Sibiril de Pointe-à-Pitre.Affecté à la prévôté du quartier général du31e CA, il est blessé au feu le 24 août1916. Décédé le 3 septembre, il estinhumé au cimetière militaire de Blercourt(meuse).
Loin de l’enfer des tranchées, lesgendarmes restés aux colonies sontaccaparés par les lourdes tâches duquotidien. Ils doivent assumer la chargede travail des fonctionnaires mobilisés. EnGuyane, le départ des agents de policeentraîne le détachement d’un gendarme àmacouria à partir de 1915. De même, lagendarmerie coloniale assure, comme enmétropole, le travail ingrat de recherchedes insoumis et des déserteurs. Celanécessite de fastidieuses démarchessouvent inutiles, comme s’en plaint en1916 l’adjudant-chef Blanchet,commandant la section de Saint-Denis àla réunion : « Parmi les insoumis figurantsur les contrôles, regrette-t-il, beaucoupsont décédés ». Bien qu’éloignés descombats, les gendarmes coloniauxbénéficient d’une certaine reconnaissanceavec la circulaire du 2 juin 1918,assimilant le séjour dans certainescolonies au séjour au front et l’attributionde la médaille commémorative de laGrande Guerre. épargnés par l’épreuvedu feu, les gendarmes coloniaux doiventaffronter à la fin de la guerre un réel
danger avec le retour au foyer des soldatscontaminés par la grippe espagnole. unepartie du personnel et de leur famille esttouchée par l’épidémie qui provoqueplusieurs millions de morts à travers lemonde. Du 19 avril au 2 mai 1919,17 décès en moyenne par jour sontrelevés parmi la population par lecommandant de section de Saint-Pierrequi ajoute : « L’enfouissement descadavres s’opère, au cimetière, dans de
bonnesconditions »(12)). Au-delà de cettepandémie, l’après-
guerre dans les colonies se caractériseaussi par le développement desaspirations nationalistes auprès d’unepopulation déçue de ne pas avoir récolté,sur le plan politique, le fruit des sacrificesconsentis pendant la guerre.
(12) Lettre n°168/2 du 2 mai1919 du lieutenant Serre dela section de Saint-Pierre aucapitaine commandant ledétachement, Saint-Pierre,SHD, 974 E 1.
1171ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
DOSSIER
LA GEnDArmErIE CoLonIALE DurAnT LA PrEmIèrE GuErrE monDIALE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page117
118
En définitive, entre 1914 et 1918, lesgendarmes coloniaux ont été lesgarants méconnus de la sécurité
dans l’empire, ce qui a permis à lamétropole de concentrer ses efforts surles fronts européens tout en captant lesressources humaines et matérielles deces possessions d’outre-mer. Ilconviendrait d’approfondir cette étude parune mise en perspective de lagendarmerie coloniale avec les autresforces civiles ou militaires déployées dansces contrées et par une comparaisonavec les colonies françaises dépourvuesde gendarmes. Quoi qu’il en soit, cetteformation particulière sort renforcée duconflit, puisque son système est étenduaux nouveaux territoires acquis par laFrance après l’Armistice du 11 novembre1918 en Afrique équatoriale et au Levant.
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
DOSSIER
LA GEnDArmErIE CoLonIALE DurAnT LA PrEmIèrE GuErrE monDIALE
l’AUTEUR
Il est l’auteur notamment de La gendarmerieen Algérie (1939-1945), SHGN, 2004, Lagendarmerie en Deux-Sevres sousl’occupation, Geste éditions, 2007 et Lesgendarmes face au crime, Geste éditions,2007.
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page118
Géopolitique de la gendarmerie au Levant (1918-1920)
Nombreux et variés sont les visages dela gendarmerie dans le Levant del’immédiat après-guerre. Cettediversité, corollaire de l’éclatement del’Empire ottoman, traduit l’expressiondes différentes ambitions politiques quis'expriment sur la région. L’exercice dela violence légitime est au cœur de cesrivalités, qu’elles soient turques,britanniques, françaises, arabes ouencore locales. Dès lors, les gendarmesdu Levant sont-ils, au nom de leurparticipation au maintien de l’ordrepublic, l’objet d’appropriationsparticulières ? L’investigation historique
menée autour duredéploiement de lagendarmerie auLevant offre unprisme original pourcerner ces multiplesenjeux politiquesqui présidentbientôt à
Nl’élaboration de la carte des États deSyrie et Liban dans leur formecontemporaine.
les prémices de la présencefrançaise au levantAprès neuf jours de traversée, lemaréchal des logis-chef Lacassin et sesdouze gendarmes débarquent, le 21mars 1918, à Port-Saïd. Ce cœurnévralgique des forces françaises aumoyen-orient n’abrite en réalité qu’unfaible nombre de Français. L’attributiond’une prévôté à ce détachement françaisde Palestine-Syrie (DFPS) corroboredonc l’affirmation des ambitionspolitiques françaises dans la région.L’enjeu est d’importance, car depuis ledébut de la guerre, les Britanniques ontclairement formulé leurs vuesimpérialistes sur le moyen-orient. Si lesFrançais ont réussi à s’imposer à la tabledu partage de l’Empire ottoman,officieusement dessiné par les accordsSykes-Picot en 1916, leur présence sur
DOSSIER
119
par hélèNe De chAMPchesNel
1ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
hélèNe DechAMPchesNelDocteur en histoireEnseignant-chercheurHistorien conseil.
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page119
le terrain peut seule donner crédit à leursambitions politiques. Les Françaisparticipent donc timidement et dans lamesure de leurs moyens à la grandeaventure du général Allenby, repoussantles Turcs vers le nord et libérantJérusalem en 1917. Ces premiers succèssont cependant interrompus pour portersecours aux fronts de Somme et deFlandre. Aussi n’est-ce qu’à l’automne1918 que le front turc est de nouveauouvert. Commence alors une marcherapide vers Damas, libérée le 1er octobre1918, ouvrant la voie vers Alep et la Ciliciejusqu’aux portes de l’Arménie. Au fur et àmesure de l’avancée des Alliés, le généralAllenby répartit l’administration desterritoires ennemis occupés entre lesprotagonistes. Dans l’esprit des accordsSykes-Picot, la France hérite d’une zonenord réunissant Saint-Jean d’Acre à
Alexandrette, agrandie en janvier 1919 dela Cilicie, l’ensemble étant confié à desofficiers français, sous l’autorité dulieutenant-colonel de Piépape. L’inférioriténumérique et la subordinationhiérarchique du détachement françaisauprès des Britanniques invitent àrelativiser l’autonomie cette administrationfrançaise. mais l’heure est surtout auxinterrogations concernant l’avenirpolitique du Levant. Suspendue à unrèglement international, cette périoded’incertitude laisse libre cours àl’expression des ambitions et des rivalitésles plus acharnées.
À la fin de la Première Guerre mondiale, larégion nord est au bord de la famine.L’une des premières entreprises de laFrance est d’organiser la distributiongratuite de farine et de blé en ayant ledouble avantage d’asseoir sagouvernance sur la région comme sapopularité. Toutefois, les ravages de laguerre et les caprices de la nature nepeuvent expliquer seuls l’ampleur del’insécurité qui règne alors. Les autoritésdoivent faire face à une recrudescence deviolences exercées par des bandes decavaliers. L’armée française, avec sestroupes régulières, est démunie devantces incursions évanescentes qui causentcependant de très graves dégâts. Enréalité, ce banditisme recouvre desréalités plurielles. Jean David mizrahidistingue avec justesse trois formesd’exactions : une délinquance de
120
Carte des accords Sykes-Picot.
© C
reat
iveC
omm
ons
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
DOSSIER
GéoPoLITIQuE DE LA GEnDArmErIE Au LEVAnT (1918-1920)
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page120
subsistance, un grand banditismeorganisé et une composante politiqueinstrumentalisée par des autonomismes
locaux(1). Les forcesfrançaises ne saventdégager, de prime
abord, toutes les subtilités de cesdifférentes manifestations violentes maiselles ont néanmoins saisi l'intérêt des’appuyer sur des forces localespartageant avec ces bandits d’idoinespratiques guerrières. À l’échelon local, lesenjeux sécuritaires recouvrent égalementdes ambitions politiques diverses. Ainsi,chaque niveau de pouvoir tente-t-ild’accaparer l’exercice de la violencelégitime. Il est intéressant de noter qu’àchacun de ces niveaux et avec différentsvisages, la gendarmerie s’offre, demanière récurrente, comme un élémentde réponse pour chacune des autoritésengagées, que ce soit à l’échelon local,étatique ou supra étatique, la Franceétant une future puissance mandataire.
Des gendarmeries aux couleursd’OrientBien avant la présence mandataire, lagendarmerie appartenait déjà au paysagedu Levant. Depuis le XIXe siècle, la Franceavait tissé de nombreux échanges enmatière de maintien de l’ordre avec laPorte, à commencer par ceux qui sontentretenus avec la milice libanaisecalquée sur le modèle de la gendarmeriefrançaise au sortir de son intervention aumont-Liban. Quelques années plus tard,
(1) Jean-David mizrahi,Genèse de l’Étatmandataire, Paris, PuPS,2003, p.116.
une mission internationale deréorganisation de la gendarmerieottomane, au sein de laquelle la Francedétient une place de choix, s’attache àétoffer ce réseau dans l’ensemble del’Empire. Pourtant, à la fin de la PremièreGuerre mondiale, les destins de ces ex-gendarmes ottomans diffèrent largementselon les régions dans lesquelles ilsévoluent.
La débâcle militaire turque réduit àl’errance nombre d’hommes en armes etdéfaits de toute autorité. Cela estprincipalement avéré à la frontière sud dela Turquie et certaines de ces formationssemblent savamment manipulées par lesTurcs désireux d’affaiblir leurs ennemisd’hier. L’extrême flexibilité de ces bandesarmées ne permet pas de distinguer,parmi les vétérans de l’armée ottomanequi les composent, la proportion d’ex-gendarmes. néanmoins, quelques-unesd’entre elles sont identifiées comme des"groupes de gendarmes". Si l’on nedispose que de très peu d’informationssur leurs conditions de subsistance, desphotographies montrent un état defatigue, voire d'hébétement, qui accréditel’idée de la déliquescence de lagendarmerie ottomane dans la régionnord ainsi que le dénoncent largement lesFrançais.
En revanche, dans les futurs états deSyrie, la mainmise de l’émir Fayçal surl’ex-gendarmerie ottomane sonne commeun symbole fort d’affirmation étatique. À
1211ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
DOSSIER
GéoPoLITIQuE DE LA GEnDArmErIE Au LEVAnT (1918-1920)
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page121
Damas et dans le vaste hinterland dont legénéral Allenby lui a confiél’administration, l’émir hachémite prendsoin, dans un premier temps, depréserver les élites locales. Lagendarmerie, non démunie de sonencadrement, survit ici mieux qu’ailleurs,continuant à être un agent essentiel dumaintien de l’ordre dans la région. Dansun second temps, Fayçal lui assigne unencadrement pro-arabe, s’assurant ainsila fidélité de ce corps. Puis il procède aurenforcement de cette gendarmerie parun régiment de méharistes, preuve dusoutien qu’elle assure auprès del’instance étatique. Les Français ontcependant une piètre opinion de cetteforce de gendarmerie qui, selon lelieutenant Déprez, regroupe « unpersonnel entièrement corrompu et, d’unefaçon générale, pris parmi la lie de la
population »(2). Lesdifficultés queconnaissent lesFrançais dans ledomaine de la
sécurité intérieure en zone nord, etnotamment en Cilicie, invitent à relativiserces propos. Cette dépréciation s’inscritégalement dans le contexte très tendud'une rivalité franco-arabe, à l’heure où leroyaume arabe de Fayçal fait ombre auxprétentions françaises sur cette région.Les Français se complaisent également àrabaisser Fayçal au rang de trublionmanipulé par les Britanniques pour mieuxentraver la mission civilisatrice de la
(2) SHD, 331 A 5. rapportdu capitaine Deprez, chef duservice de la gendarmerie,sur la réorganisation desgendarmeries syrienne etlibanaise, daté du 20 juin1920.
France. on retiendra cependant ici que,dès 1918, la gendarmerie en Syrie faitpartie de l’arsenal étatique de rigueur.
la prévôté française et le maintien del’ordre au levantPour pacifier le Levant, la Frances’appuie, en sus de son armée, sur sagendarmerie présente au titre de laprévôté. Dans un premier temps et au vude son faible effectif, cette prévôté duDétachement Français de Palestine-Syriene participe aucunement au maintien del’ordre général. Son service se concentreautour du quartier général. En 1920,L’arrivée de renforts change la donne. Aumois de décembre, la transformation deson appellation en Force Publique deBeyrouth traduit sa nouvelle implicationdans le maintien de l’ordre public et faitsuite à l’officialisation du statut de laFrance comme puissance mandataire.L’action des gendarmes de la prévôté sortainsi du champ exclusif de l’arméefrançaise. La géographie des trois, puisquatre Forces Publiques constituées en1921 correspond à celle des pointschauds du Levant, accréditant ainsi lathèse d’une implication réelle dugendarme, si timide soit-elle, dansl’exercice du maintien de l’ordre généraldu Levant.
L’emploi des forces supplétives pourpacifier la Cilicie doit beaucoup à lapratique coloniale de certains hautsgradés de l’armée française du Levant.L’expérience tonkinoise, au début du
122 Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
DOSSIER
GéoPoLITIQuE DE LA GEnDArmErIE Au LEVAnT (1918-1920)
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page122
XXe siècle, d'une contre-guérilla menéepar des populations armées par la Francepour réduire les incursions de bandesarmées chinoises a laissé de vifssouvenirs tant chez le général Billotte que
chez le colonelCatroux(3). La prévôtéprend une part active
à la mise en œuvre de cette stratégie. Elleest chargée de réorganiser en Cilicie uneformation déjà existante sous l’Empireottoman et baptisée Zaptiès. À l’origine,cette garde civile était chargée dansl’Empire ottoman de faire régner l’ordredans les campagnes. Placée sous lecommandement direct de la prévôté,cette formation souffre néanmoins d’unecarence d’encadrement, la grandemajorité des officiers d’origine turqueayant émigré. Cette première pseudo-gendarmerie locale, sous commandementfrançais, connaît donc de très nombreuxdéboires et le groupement est rapidementdissous devant le nombre d’exactionscommises par les soldats. Les gendarmesprévôtaux tentent alors, sans plus desuccès, d’instituer une Force Publique.Cette fois, ils ne recrutent que des« indigènes non militaires, sans cadre et
sans officier »(4).Cette formation nedoit pas apporter les
résultats espérés car elle est égalementrapidement supprimée. Bien que cetteexpérience soit peu concluante, on notenéanmoins l’investissement croissant dela prévôté française dans le maintien de
(3) Patrice morlat, Larépression coloniale au Viêt-Nam (1908-1940), Paris,L'Harmattan, 1990.
(4) SHD, 2 G 3883.Historique de la prévôté destroupes du Levant.
l’ordre public, que son action soit directeou indirecte. À ses côtés, le nouveauService des renseignements (Sr)procède également à des expériencessimilaires.
le Service des Renseignements (SR)français, instigateur de gendarmeriesProfitant de la dualité du pouvoirmandataire, le Service desrenseignements (Sr) obtient assezrapidement sur le terrain une puissanteautorité. Il a aussi l’avantage de pouvoirs’appuyer sur un personnel compétent etexpérimenté, le plus souvent arabophone.De même qu’avaient tenté de le faire lesgendarmes prévôtaux, les officiers de Srinstituent des formations supplétives dontils s’octroient le commandement direct,sous le prétexte d’en garantir l’efficacité.Ces formations prennent le nom de"gendarmeries mobiles". une premièreexpérience est menée au mois denovembre 1920. recrutées parmi deschasseurs libanais, trois formations de100 à 150 hommes, placées chacunesous le commandement d’un officier degendarmerie libanaise, sont réparties surl’ensemble du territoire. mais en réalité,ces compagnies de gendarmes mobilesdemeurent à la disposition des conseillersadministratifs français qui ne sont autresque les officiers du Sr. L’expérience estde courte durée et, au même titre que lesautres formations, ce groupe estfinalement dissous le 1er octobre 1921.
Le véritable succès des gendarmeries
1231ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
DOSSIER
GéoPoLITIQuE DE LA GEnDArmErIE Au LEVAnT (1918-1920)
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page123
124
mobiles en 1924 et deux pelotons pour lesandjak d’Alexandrette, soit un effectiftotal de 398 cavaliers.
Ces formations sont en théorie sous laresponsabilité des états du Levant qui enassurent le complet financement. Ladénomination choisie pour ces corpsfrancs souligne combien le gendarmeappartient au paysage du maintien del’ordre public du Levant. Toutefois, lecommandement direct que la France enassure, par le biais de l’officier du Sr,représente une réelle spoliation del’exercice de la violence légitime. Bienqu'il s'agisse de répondre à une situationd'insécurité majeure, la France usesciemment de ces formations pourétouffer les autonomismes locaux etasseoir son propre pouvoir. Cettestratégie française est d’autant pluspatente que la gendarmerie mobile s’érigeégalement en concurrence avec lesgendarmeries d’état, encore sous étroitcontrôle mandataire, bien qu’elles doiventthéoriquement revenir dans un avenir trèsproche à la disposition des autorités duLevant. or Jean-David mizrahi note uneréelle atrophie de la gendarmerie d’étatd’Alep entre 1922 et 1924, corollaire de
l’essor de cesgendarmeries
mobiles(5) et ouvrant droit à une potentielleadministration directe des campagnes parla France. mais, à l’image de sa relationmandataire, la France semble secomplaire dans une politique ambiguë
(5) Jean-David mizrahi, op.cit, p. 155.
mobiles tient essentiellement à unepremière heureuse expérience menéedans l’état d’Alep en 1922. un jeuneofficier du Sr, Philibert Collet, ayant déjàà son actif de brillants faits d’armes, estalors en charge du caza d’Idlib. Au débutdu mois de juillet, il rassemble un corpsfranc spécialisé dans la poursuite desbandes armées qui terrorisent la région.La légende raconte la merveilleusealchimie créée, dès le premier assaut,entre cet officier charismatique et lacinquantaine de cavaliers tcherkesses quil’accompagne. Philibert Collet sait, avecexception, tirer parti du particularisme deces exilés caucasiens en mal dereconnaissance et aux traditions martialesaffirmées. Celui que l’on appelleradésormais « Collet des Tcherkesses »donne leurs lettres d’or aux gendarmeriesmobiles du Levant. Dès la fin du mois etdevant l’ampleur de ses succès militaires,la petite formation, élue 1er groupementde gendarmeries mobiles, est étoffée. Lemodèle est bientôt étendu jusqu’à formerquatre escadrons de gendarmeries
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
DOSSIER
GéoPoLITIQuE DE LA GEnDArmErIE Au LEVAnT (1918-1920)
Troupe circassienne avec un officier français.
Ser
vice
his
toriq
ue d
e la
déf
ense
.
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page124
dont les gendarmeries, et surtout cellesd’état, sont le reflet.
les gendarmeries d’ÉtatDès 1919, avant même la reconnaissanceofficielle du mandat français, cinqgendarmes de la prévôté du Levant sontmissionnés pour réorganiser lesgendarmeries du Levant. Après avoirréactualisé le règlement de lagendarmerie ottomane inspiré du décretde 1903, ils ouvrent deux écoles au Libandont sortent diplômés, tous les trois mois,pas moins de 160 gendarmes. Assezrapidement, chaque état et territoire duLevant sont ainsi dotés d’unegendarmerie d’état. Les gendarmesfrançais assurent un contrôle strict de cesformations bientôt renforcé par un serviced’inspection des gendarmeries localesdont le réseau de conseillers techniquesassure en réalité le commandementdirect, voire opérationnel.
Sous l’égide de la prévôté, unegendarmerie naît, harmonieusementrépartie sur le territoire et soigneusementorganisée pour être compétente etefficace. Pourtant l’attitude de la France àson égard est ambivalente. La grandedifférence entre la gendarmerie libanaiseet celles des autres territoires du Levantrévèle ostensiblement les subjectivitésfrançaises. Habités d’une méfiance toutecoloniale à l’égard des autochtones, lesFrançais ne semblent pas croire en lavaleur de ces formations dont ilsredoutent une éventuelle manipulation par
les Britanniques. Ces gendarmeriesd’état, initiées avant l’établissement dumandat, semblent donc bien faire partieintégrante des outils d’un état modernemais leur création s’inscrit dans le cadred’un simple transfert de compétencestechniques alors que la puissancemandataire cherche, quant à elle, às’octroyer le monopole du pouvoir. Preuveen est que ces gendarmeries d’étatseront sans réelle autonomie et quasidésarmées. Cette ambivalence de lapolitique française perdure entre les deuxguerres et les gendarmeries syrienne etlibanaise épousent les soubresauts destensions franco-levantines autour del’exercice de la violence légitimematérialisés par la délicate question dutransfert des Troupes Spéciales, futuresarmées de Syrie et Liban.
1251ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
DOSSIER
GéoPoLITIQuE DE LA GEnDArmErIE Au LEVAnT (1918-1920)
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page125
126
Préexistantes à la présencefrançaise, les gendarmeries duLevant présentent ainsi une variété
de formations dont la coexistence perdurependant l’ensemble de l’entre-deux-guerres. Le gendarme semble donc offrirune collection de réponses adaptées auxdifférentes formes d’insécurité queconnaît le Levant et continue d’être l’undes référents du maintien de l’ordrepublic. Son omniprésence peut toutautant se lire à l’échelle du territoire duLevant qu’à celle, verticale, du pouvoir. Legendarme du Levant représente donc unmoyen privilégié, quoique non exclusif,d’exercer la violence légitime. L’apparentecontradiction des enjeux impérialistes etmandataires et les velléités de la Francede conforter à long terme sa placeprivilégiée au Levant se donnent aussi enlecture au travers de l’histoire desgendarmeries du Levant. Chacune d’entreelles, bridée et placée plus ou moinsofficiellement sous tutelle française,traduit l’effort de monopolisation dupouvoir conduit par la France. Pendanttoute la durée du mandat, la France ne sedépartit pas de ces ambitions et le rôleque jouera la gendarmerie syrienne dansl’accession à l’indépendance de la Syriefait montre de ces durables crispationsautour de l’exercice de la violencelégitime.
l’AUTEUR
Hélène deCHAMPCHESNEL estl’auteur d’une thèse sur lagendarmerie au Levantpendant la Seconde Guerremondiale. Maître de
conférences à Sciences-Po, elle exerce enqualité d’Historien-Conseil.retrouvez-la sur www.historien-conseil.fr
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
DOSSIER
GéoPoLITIQuE DE LA GEnDArmErIE Au LEVAnT (1918-1920)
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page126
la reconstitution de la gendarmerie en Alsace et Lorraine à la fin dela première guerre mondiale
Cet article a été publié dans la Revue historique des
armées, n° 213, 1998.
Comment refaire l’Alsace-Lorrainefrançaise ? Cette question est poséedès 1915, par la Conférence d’Alsace-Lorraine qui étudie au cours des44 séances qu’elle tient pendant laguerre, les réponses à apporter danstous les domaines et pour toutes lesadministrations, y compris laGendarmerie à laquelle elle consacre saséance du 7 octobre 1918. Déjà, dès1917, certaines des propositions de
constitution decette gendarmeried’Alsace-Lorrainefaites par le généralBouchez,inspecteur généralde la gendarmerieaux armées, ont étévalidées par lecommandant enchef. Les officiers
Cd’exception qui conduisirent ce projetse heurtèrent à de nombreusesdifficultés tant dans la mobilisationd’une ressource humaine adaptée quedu fait d’un écartèlement entrel’autorité civile et militaire sanscompter avec la sourde oppositiond’une sous-direction qui s’était vuimposer ce projet. Cet article vouspermettra de comprendre lacinématique de cette création auregard du contexte particulier de lareconquête des populations et desélites de cette région.
Du Reichland d’Alsace-lorraine auconcept d’une gendarmeriespécifiqueEn 1918, du gendarme français àbicorne d'avant 1871, il ne restait, dansla mémoire de vieux Alsaciens ouLorrains, que quelques images que letemps avait rendues de plus en plusfloues. Le seul gendarme queconnaissaient les populations du
DOSSIER
127
par GeorGes PhIlIPPoT
1ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
GeorGesPhIlIPPoT
Chef du service historique de la gendarmerienationale de 1997 à 2003.
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page127
reichland, c'était le gendarme allemandrencontré sur les routes, à cheval, ou à
pied, son fusil sousle bras(1). Logeantchez l'habitant, à unou deux parrésidence(2), ilsurveillait de quatre àsix communes. Cegendarme étaitcertes craint maiscependant bienadmis par lapopulation,
«... souvent marié dans le pays... etaccessible aux petits cadeaux... »(3).Beaucoup plus dépendant des autorités
(1) Intervention de DeWendel le 4 janvier 1921,« Procès-verbaux du ConseilConsultatif d’Alsace-Lorraine », Années 1920 et1921, ImprimeriesAlsaciennes, Strasbourg,1920-1921.
(2) Au chef-lieu de lacirconscription où résidait lemaréchal des logis-chef,l’effectif était de 3 ou 4.
(3) Archives nationales (An),AJ 30/241 : note dusénateur Hirschaueradressée à Barthou, ministrede la Justice le 21 mars1922.
civiles(4) que legendarme français,le gendarmeallemand était aussiun militaire d’origine
qui, pour postuler à cette fonction, avaitdû justifier de neuf années, au moins, deservices militaires.
La gendarmerie allemande n'avait pas cecaractère national de la gendarmeriefrançaise. Chaque état confédéré avait sa
propre gendarmerie(5)
dont les effectifsvariaient, vers 1913,de neuf pour le pluspetit (Schaumbourg
– Lippe) à 5 525 pour le plus important (laPrusse). Pour ce qui concerne lereichland d'Alsace-Lorraine, lagendarmerie, créée par la loi d'empire du20 juin 1872 était, à la veille de la guerre,à l'effectif de 446 militaires dont septofficiers, 23 maréchaux des logis-chefs et416 gendarmes répartis en 192 postesorganisés en 22 circonscriptionsterritoriales et cinq districts.
Telle était, dans ses grandes lignes,l'organisation de la gendarmerieterritoriale allemande que s'apprêtait àremplacer le chef d'escadron degendarmerie michel, arrivé à Strasbourgle 21 novembre 1918 et désigné pourprendre le commandement de lagendarmerie d’Alsace-Lorraine. L’idéed'une gendarmerie française spécifiquesusceptible de se substituer à la
(4) rapport du général mas,38e séance de la conférenced’Alsace-Lorraine, Procès-verbaux de la conférenced’Alsace-Lorraine,Imprimerie nationale, Paris,1917-1919.
(5) Manuel pratique pourl’Alsace-Lorraine, Centred’instruction deGendarmerie d’Alsace etLorraine, ministère de laGuerre, 1919.
128
Léon Achille Bouchez, alors commandant lagarde républicaine (1908).
mus
ée d
e la
gar
de
rép
ublic
aine
.
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
DOSSIER
LA rEConSTITuTIon DE LA GEnDArmErIE En ALSACE ET LorrAInE À LA FIn DE LA PrEmIèrE GuErrE monDIALE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page128
gendarmerie allemande après lareconquête de l'Alsace-Lorraine naquit del'expérience conduite par des officiers etgendarmes alsaciens dans les territoires,réoccupés dès 1914, des cantons deThann, masevaux et Dannemarie. Cettegendarmerie d'Alsace avait été créée, pardécision du général commandant en chef,le 26 décembre 1915, et ses effectifs,fixés à 87 gendarmes (36 parlantallemand, 20 le dialecte), répartis en
brigadesterritoriales(6).D'abord dépendantedes prévôtés, elle fut
ensuite placée sous l'autorité du généralcommandant la VIIe armée jusqu'en juin1917, puis rattachée aux missionsmilitaires administratives mises en place,dans les territoires d’Alsace, à compterdu 1er juillet 1917 ; ces missionsdépendaient directement, au ministère de
la Guerre, du serviced'Alsace-Lorrainecréé à cette date(7).
Parmi les officiers de gendarmerie trèsimpliqués dans cette gendarmeried'Alsace, on trouvait déjà le chefd'escadron michel, du 2e bureau de laVIIe armée, futur commandant de lalégion de gendarmerie d'Alsace etLorraine, le capitaine muller, prévôt de la57e division d'infanterie, futurcommandant de l'école de gendarmeriede Strasbourg, puis de la compagnie degendarmerie du Bas-rhin, le lieutenant
(6) « Procès-verbaux de laConférence d’Alsace-Lorraine 1917-1919 »,38e séance, volume II,Imprimerie nationale, p. 195.
(7) une instruction du18 juillet 1917 règle tout cequi concerne cettegendarmerie territorialed’Alsace.
Bucquoy(8), prévôt dela 105e divisiond'infanterie, futurcommandant de
l'arrondissement de gendarmerie deSélestat... mais c'est le général dedivision Bouchez, inspecteur général de lagendarmerie aux armées, qui allait donnerl'impulsion nécessaire au projet de
création d'unegendarmeried'Alsace etLorraine(9).
Le général Bouchezest l'un des officiersde gendarmerie lesplus illustres de laguerre 1914-1918(10).
De 1914 à 1917 il commande la 32edivision d'infanterie sur les fronts deLorraine (août-septembre 1914), deFlandres (octobre 1914 - février 1915), deChampagne (mai à août 1915), duTardenois (fin 1915), de Verdun (août -septembre 1916), d'Argonne (septembre1916 - février 1917). Le 7 mars 1917, ilest nommé inspecteur général de lagendarmerie aux armées, et le 19, ilpropose au général commandant en chef,alors que l’issue du conflit est plusqu’incertaine, un projet de gendarmeriepour l'Alsace-Lorraine : un corps de600 gendarmes alsaciens-lorrains. Leprojet est accepté mais « le généralcommandant en chef a toutefois estiméqu’il n’y avait pas lieu de constituer une
(8) Capitaine Louis Bucquoy,« La Gendarmerie auxarmées », Le Passepoil,3e année, 1923, n° 4,Strasbourg, ImprimerieAlsacienne, p. 57.
(9) Expression qui sesubstitue peu à peu dans lestextes officiels, après 1918,à « Alsace-Lorraine », maisqui désigne les mêmesterritoires, les actuelsdépartements du Bas-rhin,du Haut-rhin et de lamoselle.
(10) Pierre Hallynck, « Legénéral Bouchez », Revued’Etudes et d’informationsde la Gendarmerie,1er trimestre 1915, n° 15.
1291ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
DOSSIER
LA rEConSTITuTIon DE LA GEnDArmErIE En ALSACE ET LorrAInE À LA FIn DE LA PrEmIèrE GuErrE monDIALE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page129
gendarmerie entièrement en Alsaciens-Lorrains. Une gendarmerie autochtoneserait sans autorité : son organisationfavoriserait le régionalisme, et il a préciséson opinion en déclarant que sur600 gendarmes, 200 Alsaciens-Lorrains
suffiraient »(11). Leprojet Bouchez, ainsicorrigé, devientl'instruction du18 août 1917 quidécide « la créationd'un centre
d'instruction, pour 200 gendarmesalsaciens-lorrains, par lots de 100,réservant pour l'avenir le recrutement des400 gendarmes métropolitains pourcompléter le corps à 600 »(12). Telle est labase d'une organisation qui va connaîtrede nombreuses difficultés dans sa miseen place et de profondes modifications
(11) « Procès-verbaux de laConférence d’Alsace-Lorraine 1917-1919 »,38e séance, volume II,Imprimerie nationale, p.196.
(12) An, AJ 30/241 :ministère de la Guerre,rapport du Service desAlsaciens-Lorrains du 14 mai1917.
quant à ses effectifs et à leur répartitionentre gendarmes alsaciens-lorrains etgendarmes de « l’intérieur ».
Un centre d'instruction pourgendarmes alsaciens-lorrains à lureen 1918
reste en effet à trouver, pour ce centred'instruction, un lieu, un chef et... desgendarmes Alsaciens-Lorrains. L'endroitne pose pas de problème; on convientrapidement que l'emplacement le mieuxadapté est le site du PC de la VIIe armée,à Lure. Pour ce qui est du chef, on fait saconnaissance à partir de la lettremanuscrite qu'il adresse le 19 mai 1917 àun colonel non identifié. « Je vousremercie, écrit-il, pour tout l'intérêt quevous avez bien voulu prendre à moi en lacirconstance. Le général Bouchez, monchef bienveillant auquel je suis tout
130
Le chef d’escadron Albert Michel, alors officier d’état-major au service de renseignement de laVIIe armée (1917)
xxxx
xxxx
xxxx
x
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
DOSSIER
LA rEConSTITuTIon DE LA GEnDArmErIE En ALSACE ET LorrAInE À LA FIn DE LA PrEmIèrE GuErrE monDIALE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page130
dévoué, a pris en main la question de lacréation d'un corps de gendarmesalsaciens et de votre côté vous avez bienvoulu associer mon nom au projet à
l'élude »(13). Il s'agitdu chef d'escadron
de gendarmerie michel, alsacien d'origine,chef du service de renseignement à l'état-major de la VIIe armée.
Cette lettre, ainsi que la note qui y estjointe, donne d'intéressantes informationssur ce personnage hors du communqu'est Albert michel ainsi que sur saconception du rôle qu'il entend faire joueraux gendarmes en Alsace reconquise.« Je suis personnellement très persuadéque pour mieux asseoir notre influence là-bas, il faut faire de la pénétrationméthodique..., la liaison entre nous et nosnouveaux administrés doit être intime etconstante.... Je rêve de faire dugendarme alsacien un modèle et unexemple. Attitude militaire et tenueexemplaires pour montrer ce que noscompatriotes ont dans le sang ; esprit dediscipline parfait, moral à hauteur de latâche; instructeur technique de transitionne bousculant rien : service plus préventifet éducateur que répressif.... Voilà desagents de pénétration tout indiqués... devéritables agents de pénétration et deliaison dont le rôle doit s'inspirer desdirectives suivantes : être en contactconstant et étroit avec les populationsalsaciennes de la zone intéressée,s'efforcer par la conversation de connaître
(13) ibid.
leur état d'esprit, les rassurer, les tenir aucourant de ce qui peut les intéresser,propager les nouvelles qu'ils doiventconnaître... remonter leur moral s'il en estbesoin... ». Tels sont les sentiments quianiment dès 1917 celui qui sera de la fin1918 à juillet 1925 le commandant de lalégion de gendarmerie d'Alsace etLorraine.
En septembre 1917, tout est prêt à Lurepour accueillir les premiers élèves-gendarmes. « Les baraquements toutneufs sont spacieux et aussi confortablesque l'on puisse souhaiter.... Le reste del'organisation est prévu... et tout suit soncours. D'après la note du GQG,l'ouverture des cours pourrait être prévuepour les environs du 1er novembre,évidemment tout dépend entièrement du
recrutement desélèves... » (14). Etc'est bien la
question.
En effet, si le général commandant enchef a approuvé le projet de formationd'un corps de gendarmerie spécialementdestiné à l'Alsace-Lorraine et composénotamment de 200 gendarmes originairesd'Alsace-Lorraine, « il ne prévoit pas lerecrutement de ces Alsaciens-Lorrainsdans les corps combattants sur les fronts
nord, nord-Est etd'orient »(15).Autrement dit, lesdeux seulesressources possibles
(14) ibid. : lettre du17 septembre 1917 dulieutenant-colonel michel.
(15) ibid. : rapport du servicedes Alsaciens-Lorrains du14 mai 1917. Le service desAlsaciens-Lorrains de l’état-major de l’armée (3e bureau)devient le 1er juillet 1917 leservice d’Alsace-Lorraine.
1311ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
DOSSIER
LA rEConSTITuTIon DE LA GEnDArmErIE En ALSACE ET LorrAInE À LA FIn DE LA PrEmIèrE GuErrE monDIALE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page131
de candidats à la gendarmerie d'originealsacienne ou lorraine, ce sont l'arméed'Afrique d'une part, les dépôtsd'alsaciens-lorrains (prisonniers de guerreissus de l'armée allemande) de Saint-rambert, monestrol, Lourdes et Paris,d'autre part. Dans ces dépôts, l'officierinterprète Spinner, du Service desAlsaciens-Lorrains, chargé d'y faire de lapropagande, n'est guère optimiste. Le31 mars 1917, il écrit, de Saint-rambert àson supérieur hiérarchique à Paris : « Jene sais trop s'il y aura grande affluencepour cette carrière car le paysan aimerentrer pour cultiver sa terre ; l'ouvrierrejoindra sa fabrique où les salaires sonttrès élevés. Les commerçants eux aussitrouveront des emplois plusrémunérateurs. On n'est pas sans ignorer[sic] que les gendarmes allemands étaientbien mieux payés que les gendarmesfrançais ».
Du côté de l'armée d'Afrique, on traîneles pieds. Si « à la date du 11 novembre1917 on n'a reçu aucun documentconcernant le recrutement de lagendarmerie d'Alsace-lorraine », le13 décembre, le général commandant lestroupes françaises d'Afrique rend comptequ'il est bien en possession desinstructions lui prescrivant de « prélever200 gendarmes sur les corps etdétachements alsaciens-lorrains », maisque « ce prélèvement est de nature àaggraver encore la crise d'effectifs dontsouffrent ces unités », et il demande
132
qu'on lui remplace, nombre pour nombre,les effectifs qu'il doit restituer.
L'affaire commence donc relativementmal. Le chef d'escadron michels'impatiente : « Tous les jours, j'apprendsque nombre de corps africains ontcomplètement ignoré la question, qued'autres l'ont mal connue, que lapropagande faite là-bas a été trèsinsuffisante, les porte-paroles n'étant pas
au courant ouhostiles »(16). Et cen'est qu'avec
68 candidats que commencera au Centred'instruction des gendarmes alsaciens-lorrains de Lure, fin juin 1918, le premierstage de formation. Le 2e stage débuterale 1er novembre 1918 avec 87 nouveauxélèves. Le chef d'escadron michel n'atoutefois pas perdu son temps pendantcette année d'attente. Tout en continuantà assurer ses fonctions de chef du Sr dela VIIe armée, il a rédigé et fait imprimer laquasi-totalité des cours qu'il dispenseralui-même, assisté de quelques sous-officiers de gendarmerie.
la mise en place du dispositif de lagendarmerie en Alsace et lorraine ennovembre 1918Lorsque survient l'armistice, on est loin dedisposer des 600 gendarmes prévus dansle projet Bouchez. Aussi, dès le10 novembre 1918, le généralcommandant en chef prescrit au généralcommandant le Groupe d’Armées de l'Estde mettre en place « trois cents
(16) ibid. : lettre du chefd’escadron michel du 6 août1918.
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
DOSSIER
LA rEConSTITuTIon DE LA GEnDArmErIE En ALSACE ET LorrAInE À LA FIn DE LA PrEmIèrE GuErrE monDIALE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page132
gendarmes destinés à faire partie de lagendarmerie du territoire d’AIsace-Lorraine, soit 200 à Nancy et 100 àBelfort. Les gendarmes sont à préleversur les prévôtés des grandes unités du
GAE »(17). Le14 novembre 1918,le général Bouchez
dans son Instruction Technique surl'organisation de la gendarmerie duterritoire d'Alsace-Lorraine donne sesdirectives pour la mise en place dudispositif en Alsace-Lorraine. C'est unvéritable ordre d'opération clair et précisqui fixe :
- la base de l'organisation, celled'avant 1870, soit trois compagnies(moselle, Bas-rhin, Haut-rhin)regroupant, en 12 arrondissements,112 brigades ;
- les effectifs ; 492 provenant pour 87de la gendarmerie déjà existante enAlsace, pour 75 du CIGAL de Lure,pour 30 (gradés) de la réserve dupersonnel de la gendarmerie et pour300, des prévôtés ;
- la répartition des effectifs : 4 parbrigade et trois réserves constituées àmetz, Strasbourg et Colmar ;
- diverses consignes et conduites àtenir :
pour les officiers : « les officiers à tousles degrés devront avant tout, pourl'emploi de leur troupe, s'inspirer de
(17) Service historique de laDéfense (SHD), 16 n 191,note du 10 novembre 1918.
l’intérêt général et ne jamais seretrancher derrière des règlementsfaits pour des situations normales etnon applicables dans lescirconstances actuelles » ;
pour les gendarmes : « au moment dela réoccupation, le premier devoir desgendarmes de la brigade est d'aiderau triage des habitants... ».
Tout paraît donc prêt et, le 18 novembre,le dispositif rassemblé à Belfort est enmesure de faire mouvement. Il n'en vapas de même à nancy où, à la surprisedu général Bouchez, aucune des sectionsprévôtales prévues n'a rejoint sadestination. II s'ensuit un échange demessages instructifs sur les relations dumoment entre les états-majors d'armées,qui refusent ouvertement de remettre à ladisposition du général, commandant enchef, les sections de gendarmes
demandées et l'état-major du GQG(18)...Le 20 novembre legénéral Bouchez se
fâche, et adresse au général commandanten chef à l'état-major du GQG à Provinsle message suivant : « Je demandeinstamment que vos ordres soientexécutés... ». Enfin, le 26 novembre, legénéral inspecteur de la gendarmerie auxarmées qui, le 22 novembre, s'est rendului-même à nancy, peut rendre comptequ'à l'exception de 40 gendarmes, ledispositif prévu est en place en Alsace eten moselle(19).
(18) SHD, 16 n 191,messages des 16, 18 et19 novembre 1918.
(19) ibid., message du26 novembre.
1331ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
DOSSIER
LA rEConSTITuTIon DE LA GEnDArmErIE En ALSACE ET LorrAInE À LA FIn DE LA PrEmIèrE GuErrE monDIALE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page133
Le chef d'escadron michel, quant à lui,mis à la disposition du ministère de laGuerre pour commander la gendarmeried'Alsace-Lorraine, est à Strasbourg avecles premiers gendarmes français dès le21 novembre, la veille de l'entrée officielledes troupes françaises dans la ville, et le23 il accompagne chez le haut-commissaire maringer, Lévy, juge autribunal de Strasbourg qui, dès le7 novembre, « s'est saisi de la directiondes services de police de la ville » pour
l'appuyer dans sademande derévocation desresponsables de la
police allemande(20).
(20) Archivesdépartementales (AD) 67, AL121/847, rapport manuscritdu commissaire spécial enmission Pérenner du 25novembre 1918.
134
Le 26 novembre ceux-ci sont congédiés,ils seront payés jusqu'au 31 décembre,
puis expulsés(21).Quant auxgendarmesallemands, le
télégramme adressé par le haut-commissaire de la république àStrasbourg à toutes les administrations, le4 décembre 1918, ne leur laisse aucunealternative : « Ai décidé sauf examen descas individuels - inviter gendarmesallemands à quitter territoire français. Leschevaux seront retenus contre reçu fixantvaleur estimative – familles pourrontaccompagner leur chef – mobilier ne seraacheminé qu'ultérieurement »(22).
(21) ibid., lettre du haut-commissaire de larépublique du 26 novembre1918.
(22) AD 57, 5 r 687.
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
DOSSIER
LA rEConSTITuTIon DE LA GEnDArmErIE En ALSACE ET LorrAInE À LA FIn DE LA PrEmIèrE GuErrE monDIALE
Gendarme prévôtal escortant l’entrée des autorités militaires dans Strasbourg en 1918.
serv
ice
hist
oriq
ue D
e la
Déf
ense
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page134
La place est libre pour les gendarmesfrançais, mais la tâche est immense. Ilssont déjà répartis dans leurs nouvellesrésidences depuis plusieurs semaines,quand deux décrets et un arrêté, tous lestrois du 31 décembre 1918, instituent lecadre réglementaire de leur organisation,de leur recrutement et de leur formation.« Il est créé pour les territoires d'Alsace etLorraine une légion de gendarmerie;l'effectif de cette légion comprend : ...1 000 chefs de brigade et gendarmes.Pour la première organisation la totalitédes emplois de chefs de brigade et lamoitié des emplois de gendarmespourront être attribuées aux chefs debrigades des autres légions qui en ferontla demande.... Il est créé au chef-lieu de
la légion, un centred'instruction »(23).Quant aux conditions
d'admission des Alsaciens et Lorrainsdans la gendarmerie, elles sontassouplies puisque tous ceux qui, soit ontservi sous les drapeaux français, soitproviennent des dépôts d'Alsaciens etLorrains de Paris, Saint-rambert etLourdes, soit sont restés en Alsace-Lorraine ou y sont revenus aprèsl'armistice, peuvent se porter candidatss'ils font la preuve de leur originealsacienne ou lorraine.
Confusion, tensions et conflitsDe décembre 1918 à avril 1919, la légionde gendarmerie d'Alsace et Lorraine et lecentre d'instruction de gendarmerie de
(23) Mémorial de lagendarmerie, décret du 31décembre 1918.
Strasbourg(24), qui luiest rattaché, vontconnaître desdifficultés qui iront
jusqu'à remettre en cause leur existence,non du fait de l'exécution des missions,mais des conflits de compétences etd'attributions qui vont naître entre lesdifférentes parties prenantes à l'emploi età la gestion de ce nouveau corps degendarmerie.
Pour comprendre ces tensions, il fautd'abord ne pas perdre de vue que cettegendarmerie d'Alsace et Lorraine est lafille du général de division Bouchez,inspecteur général de la gendarmerie auxarmées, qui l’a fait reconnaître, à sanaissance, par le général commandant enchef. Elle n'est pas issue d'une idée de lasous-direction de la gendarmerie qui nel'a pas voulue, surtout avec un tel poidsde mille gradés et gendarmes, mais quien héritera cependant. Les commandantsd'armée qui ont dû fournir300 gendarmes prévôtaux pour saconstitution, puis à compter de février1919, les commandants supérieurs desterritoires d'Alsace et de Lorraine,responsables du maintien de l'ordre,estiment que cette gendarmerie doit êtreplacée sous leur autorité. Lescommissaires de la républiquecomprennent bien l'intérêt qu'ils ont àconserver cette gendarmerie le pluspossible dans leurs mains, mais ils sontbien obligés de tenir compte du rôle
(24) AD 67, AL 121/423 : ils’agit du centre d’instructionde Lure transféré àStrasbourg en décembre1918.
1351ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
DOSSIER
LA rEConSTITuTIon DE LA GEnDArmErIE En ALSACE ET LorrAInE À LA FIn DE LA PrEmIèrE GuErrE monDIALE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page135
136
d'Alsace et la plaçant dans lesattributions directes de l'administration del'Alsace qui devrait être intégralementenvisagée.... En tout état de cause, ilimporte qu'à l'avenir, aucun ordre nidemande ne devraient être adressésdirectement à la gendarmerie d'Alsace-Lorraine. Il y aura lieu de les faire passer
par le haut-commissariat »(26). Le
contenu de cette note ainsi que lamodification de l'en-tête habituelmarquent bien l'intention du chefd'escadron michel de se placer dans lesattributions du haut-commissaire, lesdeux instructions qu'il cite sonteffectivement contradictoires, mais il estcependant évident que le texte spécifiqueà la gendarmerie d'Alsace-Lorraine(18 juillet 1917) vise bien à créer unegendarmerie territoriale dépendante del'autorité civile.
Le 20 décembre, une lettre du haut-commissaire appelle l'attention dumaréchal commandant en chef sur « lesinconvénients que présente l'applicationpure et simple à la Légion de gendarmeried'Alsace-Lorraine, de l'instruction du28 février 1918 subordonnantcomplètement la gendarmerie territoriale àla gendarmerie de campagne » et luipropose de « décider qu'à l'avenirl'autorité militaire ou les officiers de laprévôté devront s'adresser à moi-mêmeou aux commissaires de la République àColmar et à Metz lorsqu'il leur paraîtra
(26) AD 67, AL 121/424.
important des autorités militaires pendantcette période transitoire entre l’armisticeet le traité de paix. Quant au Servicegénéral d'Alsace-Lorraine, placé à Parisauprès du président du Conseil qui,rappelons-le, est aussi ministre de laGuerre, il soutient le point de vue descommissaires de la république surlesquels il a autorité. C'est donc dans cecontexte de relations complexes etd'intérêts pas toujours convergents que lagendarmerie d'Alsace et Lorraine fait sespremiers pas au milieu d'obstacles qui semultiplient.
Les premiers tiennent aux conflits locauxentre les autorités d'emploi. Dès le2 décembre, le chef d'escadron michelrend compte au haut-commissaire ducontenu d'un télégramme, que lui a faitparvenir le prévôt du Groupe d’Armées del'Est, l'informant que « la gendarmerie duterritoire est subordonnée à la prévôté de
l'armée »(25). Le16 décembre, il
adresse une note au haut-commissaire(en-tête : république française – Haut-Commissariat de la république – Légionde gendarmerie d'Alsace-Lorraine), sur lemême sujet, en faisant valoir que« l'Instruction du 28 février 1918 dugénéral en chef, subordonnantcomplètement la gendarmerie territoriale àla gendarmerie de campagne ne sauraitrecevoir une application intégrale et c'estau contraire l'instruction ministérielle du18 juillet 1917, créant la gendarmerie
(25) AD 67, AL 121/421.
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
DOSSIER
LA rEConSTITuTIon DE LA GEnDArmErIE En ALSACE ET LorrAInE À LA FIn DE LA PrEmIèrE GuErrE monDIALE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page136
nécessaire de recourir à la collaborationde la légion d'Alsace-Lorraine ».
Parallèlement à cette démarche, le chefd'escadron michel, dans le même butd'acquérir, pour sa légion, l'indépendancequ'il estime nécessaire, saisit de sesproblèmes son supérieur hiérarchique, legénéral Bouchez auquel il adresse lesdeux premiers rapports d'inspection deses unités. Dans celui du 14 décembre1918, on lit qu’« actuellement on peut direque tout le monde commande lepersonnel de la gendarmerie territorialed'Alsace-Lorraine, laquelle ne devraitnormalement relever que du haut-commissariat. Souvent les ordres donnéssont contradictoires et le personnel nesait plus comment opérer, ni à qui obéir....Les armées donnent directement desordres en dehors des chefs de l'armée,les commandants de secteur également,les prévôts aussi.... Tout cela crée uneconfusion extrêmement préjudiciable à labonne exécution du service. Aujourd'huioù, après les fêtes, les lampions sontéteints et où les populations vont setrouver en face des réalités de la vie, ilimporterait tant d'agir avec l'unité de vuesvoulue pour réduire au minimum les à-coups, les chassés-croisés et lesflottements et donner au publicl'impression de l'ordre, de la méthode et
de l'impulsionunique »(27) Ce
rapport est joint à la lettre que le généralBouchez adresse le 21 décembre 1918
(27) AD 67, AL 121/424.
au maréchal commandant en chef et quidénonce un certain nombre d'emploisabusifs des gendarmes territoriauxd'Alsace et de Lorraine par l'autoritémilitaire.
La réponse ne se fait pas attendre. Dansune lettre du 30 décembre 1918, lemaréchal commandant en chef donne augénéral commandant la IVe armée, lesinstructions suivantes : « En vue d'éviterle retour de semblables errements desordres seront donnés pour que, à l'avenir,les autorités militaires ou les officiers de laprévôté s'adressent directement au haut-commissaire de la République àStrasbourg ou aux commissaires de laRépublique de Colmar et Metz, lorsqu'illeur paraîtra nécessaire de recourir à lacollaboration des gendarmes de la légiond'Alsace-Lorraine ». La conclusion estferme : « Vous voudrez bien le caséchéant, veiller à la stricte application de
cesprescriptions ! »(28).
Ainsi le jour de sa naissance officielle(décret du 30 décembre 1918) la légionde gendarmerie d'Alsace et Lorraine abien rompu le cordon ombilical qui lareliait à l'institution qui l'avait portée. maiscette relative indépendance varapidement être remise en cause d'uneautre manière. C’est sa propre hiérarchie,la sous-direction de la gendarmerie, quele chef d’escadron, puis lieutenant-colonelmichel, va devoir affronter.
(28) SHD, 16 n 191.
1371ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
DOSSIER
LA rEConSTITuTIon DE LA GEnDArmErIE En ALSACE ET LorrAInE À LA FIn DE LA PrEmIèrE GuErrE monDIALE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page137
138
situation actuelle, il ne m'est pas possiblede donner satisfaction à votre demande ».
Le 2 janvier 1919, nouvelle offensive duministère de la Guerre (sous-direction dela gendarmerie) qui adresse aucommandant en chef une lettre d'où ilressort que « la libération de toutes lesclasses de la RAT va diminuer les effectifsde la gendarmerie à l'Intérieur d'unnombre total de 6 041 hommes qui,ajouté à un déficit déjà existant de 5 924,portera ce déficit à 11 965 » (en 1919l'effectif théorique global de lagendarmerie est de 27 000 hommes).Pour remédier à cette situation, la sous-direction de la gendarmerie envisage « ladésignation d'office de gendarmesauxiliaires, parmi les hommes âgés de25 ans qui seraient ultérieurementdémobilisés ou rendus à leur corps et lerenvoi à l'Intérieur de 2 500 prévôtaux »...au moment où, le 6 janvier, par exemple,le général mangin, commandant laXe armée, de même que le gouverneurmilitaire de metz réclame de nouveauxgendarmes.
La tension est perceptible dans lemessage que le ministre adresse aumaréchal le 15 janvier 1919 : « Il est d’uneimportance capitale que les demandesqui ont fait l’objet de mes notes...reçoivent satisfaction la plus large et laplus rapide.... Les besoins de l'Intérieursont de plus en plus pressants, il ne fautpas que, par suite retard à donnersatisfaction à mes demandes, les
En effet, en cette fin d'année 1918, lasous-direction de la gendarmerie n'aqu'un seul grave souci : commentreconstituer les effectifs de lagendarmerie ? Dès le 20 novembre, lecabinet du président du Conseil, ministrede la Guerre, attire l'attention du maréchalcommandant en chef sur lesconséquences de la démobilisation desclasses 87, 88 et 89 qui « a brusquementprivé la gendarmerie de l'Intérieur de1 388 gendarmes dont cinq cents chefsde brigade.... N'ayant aucun autre moyende remédier à cette situation, la sous-direction de la gendarmerie propose lerenvoi à l'Intérieur de mille gendarmesprévôtaux avec, autant que possible, uncinquième de gradés... ». Le généralBouchez, consulté par le commandant enchef est loin d'approuver cetteproposition. Dans sa lettre au maréchal,du 27 novembre 1918, il écrit : « Il résultede la lettre ministérielle du 20 novembredernier que la sous-direction de lagendarmerie n'est pas au courant deschoses de la gendarmerie aux armées »,et de fournir un argumentaire solide etdétaillé avant de conclure : « Je ne perdspas de vue la situation de l'Intérieur etj'aurai été le premier à proposer deséconomies sur les armées, comme je l'aidéjà fait, si j'avais su la chose
possible »(29). Cetargumentaire est
repris par le maréchal commandant enchef qui dans sa lettre du 29 novembre1918 répond au ministre : « Dans la
(29) SHD, 16 n 191.
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page138
139
circonstances amènent à vous imposerd'urgence prélèvements indispensables et
qu'il seraitimpossible de
différer »(30).
À compter de la fin janvier 1919, dessections de gendarmes prévôtaux sontdonc progressivement remises à ladisposition du ministre (sous-direction dela gendarmerie). mais à metz et àStrasbourg, quand sont créés en février,les commandements supérieurs desterritoires de Lorraine et d'Alsace, leschefs désignés ne peuvent que constaterl'insuffisance numérique de leursprévôtaux pour assurer les missions dontils ont la charge. Aussi l'idée toute simplede se partager la légion de gendarmeried'Alsace et Lorraine et de réintégrerchaque part dans leur propre dispositiffait-elle son chemin. C'est en tout cas lesens de la proposition du généralcommandant la IVe armée dont le chefd'état-major ne semble pas avoirparticulièrement apprécié la lettre deremontrances du commandant en chef du30 décembre 1918 dont il a parfaitement
identifié l'initiateur(31).Cette proposition estreprise par lemaréchal dans la
lettre qu'il adresse le 9 mars 1919 augénéral Bouchez pour avis : « Lesrapports que doivent avoir les différentschefs de la gendarmerie d'Alsace-Lorraine entre eux et avec les autorités
(30) ibid.
(31) AD 67, AL 121/421,rapport du 29 mars 1919 dela IVe armée, signé« Gouraud, P.A. le chefd’état-major Blanchard ».
civiles et militaires en Alsace et enLorraine paraissent incomplètementdéfinis ou tout au moins mal connus : il enest ainsi notamment en ce qui concernela situation de la gendarmerie d'Alsace-Lorraine vis-à-vis du prévôt de la IVearmée et du commandant de lagendarmerie du territoire de Lorraine. Ilsemble indispensable pour éviter lesdoubles emplois que, tant en Lorrainequ'en Alsace, un seul prévôt ait la hautemain sur l'ensemble des forces degendarmerie, y compris celles ditesd'Alsace-Lorraine ».
Cette fois, l'existence de la toute nouvellelégion de gendarmerie d'Alsace etLorraine est sérieusement menacée. Legénéral Bouchez le perçoit bien. Le16 mars, il fait une inspection en Lorraineet le 21, il donne son avis au maréchal. IIexplique que dans son projet initiald'organisation de la légion d'Alsace etLorraine « c'était au chef de légion quedevait revenir la direction supérieure duservice, mais que le choix d'un chefd'escadron pour commander la légion nepermit pas de lui donner cette situation ».Devant la difficulté à maintenir intact ledispositif qu'il a lui-même mis en place, iltente d'enterrer le nouveau projet enproposant une autre solutionsuffisamment inacceptable pour mériterl'appréciation de l'officier d'état-majorchargé au GQG de traiter la question :« Le projet est aussi compliqué que ce quiexiste actuellement.... Il ne présente pas
1ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page139
140
Affermissement et développementLa fin du système de l'administrationdirecte qui s'était montré tout à faitinadapté pour résoudre les problèmesposés par la réintégration de l'Alsace etLorraine, l'instauration d'un commissariatgénéral à Strasbourg et la désignationd'Alexandre millerand à ce poste allaientcontribuer largement à mettre de l'ordreau sein des administrations, à rétablir,pour un temps, la confiance avec leshommes politiques locaux et la populationainsi qu'à faire avancer un certain nombrede solutions dont la mise en œuvre était
urgente(33). Pour cequi concerne lalégion de
gendarmerie d'Alsace et Lorraine,millerand allait définitivement asseoir son
(33) Bulletin officield’Alsace et Lorraine, décretdu 21 mars 1919.
d'avantages marqués sur l'organisationactuelle. Il semble inutile de l'adopter ».Sur cette même note est portée aucrayon l'annotation « Exact, préparer lasolution logique du chef et l'envoyer pouravis à Monsieur Millerand ».
La « solution logique du chef » consiste àcréer un commandement unique detoutes les formations de gendarmeried'Alsace et de Lorraine, placé dans lesattributions du général commandant la IVearmée et, à la dissolution de celle-ci, sousles ordres du commandant supérieur duterritoire d'Alsace à Strasbourg. Cetteproposition est adressée au commissaire
général à Strasbourgle 4 avril(32).
(32) SHD, 16 n 191.
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
Gendarme pendant une cérémonie (milieu de la photographie).
Ser
vice
his
toriq
ue d
e la
Déf
ense
DOSSIER
LA rEConSTITuTIon DE LA GEnDArmErIE En ALSACE ET LorrAInE À LA FIn DE LA PrEmIèrE GuErrE monDIALE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page140
141
autorité. En quelques semaines sesproblèmes existentiels étaient réglés.Soutenue par le pouvoir politique,renforcée en personnels sélectionnés, elleallait enfin pouvoir se consacreressentiellement à la tâche primordiale quelui assignait son chef, Albert michel,promu lieutenant-colonel le 25 décembre1918 : « faire pénétrer en Alsace etLorraine les idées françaises ».
Le décret du 21 mars 1919, qui institue àStrasbourg le commissariat général de larépublique, donne au détenteur de ceposte des prérogatives exceptionnelles.« Il exerce sous l'autorité directe et pardélégation permanente du président duConseil, ministre de la Guerre,l'administration générale des territoiresd'Alsace et Lorraine. Il réunit sous sonautorité tous les services afférents à cetteadministration. Il a entrée au Conseil desministres pour les affaires d'Alsace et deLorraine. Il pourvoit à tous les emplois ».
Armé de ces pouvoirs considérables,millerand va donner une très forteimpulsion à la réintégration. II est, pourdivers motifs, l'homme de la situation. Sadéjà longue carrière et sa forte staturepolitiques lui confèrent une autoritésuffisante pour être reconnu par lespopulations alsaciennes et lorraines, enimposer aux ministres qui ont à connaîtredes affaires d'Alsace-Lorraine et faire plierles administrations centrales quirechignent à toute déconcentration. Parailleurs c'est un régionaliste convaincu.
En 1893, il avait déclaré : « nous seronsrégionalistes jusqu’au fédéralisme ». Enjanvier 1920, il déposera un projet de loiau parlement visant à créer un conseilrégional d'Alsace et de Lorraine en
substitution auconseil supérieur(34).Ces convictions sontbien évidemmentappréciées en Alsace
et Lorraine où elles trouvent matière às'exprimer pleinement. Elles expliquentaussi le solide soutien qu'il apporte sansdiscontinuer au commandant de la légionde gendarmerie d'Alsace et Lorraine.
Dès le 1er avril, il adresse une note auxgénéraux commandants la IVe armée, leterritoire d'Alsace, le territoire de Lorraine,ainsi qu'aux commissaires de larépublique de la Haute-Alsace, Basse-Alsace et la moselle conviant leursreprésentants à une réunion « pourétudier les mesures à prendre pourréaliser l'accord complet et la coopérationconstante entre ces deux gendarmeries[légion de gendarmerie d'Alsace etLorraine et gendarmeries prévôtales] lesdifférents services qui incombent à lagendarmerie prenant de jour en jour enAlsace-Lorraine une importance plusgrande ». on ne trouve pas trace d'uncompte rendu de cette réunion, mais le21 avril le commissaire général répond àla lettre du 4 avril du maréchalcommandant en chef « que, dèsmaintenant, l'organisation de la légion
(34) Le projet seraabandonné, mais le décretdu 9 septembre 1920 quicrée le Conseil Consultatifd’Alsace et Lorraine y faitencore allusion, dans sonpréambule.
1ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
DOSSIER
LA rEConSTITuTIon DE LA GEnDArmErIE En ALSACE ET LorrAInE À LA FIn DE LA PrEmIèrE GuErrE monDIALE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page141
142
service de la gendarmerie, les rapports àfournir aux autorités ne seront plus établisqu'en une seule expédition qui seraadressée au commissariat général de laRépublique (direction des affairesmilitaires) à Strasbourg.... S'il y a lieu, ladirection des affaires militaires feraparvenir au ministère de la Guerre, auxautorités militaires et aux autoritésadministratives et judiciaires, copie durapport ».
Dans la seconde, il est demandé auxautorités destinataires que « lagendarmerie d'Alsace - Lorraine soitlaissée à son véritable service qui est toutde police et de surveillance ». Doivent êtreexclus du service de la gendarmerie « lesenquêtes judiciaires et administrativesdans les localités pourvues d'uncommissaire de police, les demandes derenseignement n'offrant pas un réel intérêtde police ou de justice, lesétablissements, recherches, ou comptesrendus d'état civil... les remises de piècesdiverses... en général toutes autresopérations...n'exigeant pas vraimentl'emploi de la gendarmerie ».
Ainsi la position très contestée, en mars1919, de la gendarmerie d'Alsace etLorraine se trouve-t-elle clarifiée,renforcée et définitivement établie deuxmois plus tard. Le lieutenant-colonelmichel qui, en décembre 1918, seplaignait de ce que tout le mondecommande la gendarmerie territorialed'Alsace-Lorraine, est satisfait. II n'a plus
d'Alsace-Lorraine doit tendre à laréalisation de sa constitution du temps depaix... Le lieutenant-colonel commandantla légion d'Alsace-Lorraine relevantdirectement du commissaire généraldirigera l'ensemble du service. Pour lapériode transitoire, je suis convaincu qu'ilsuffira de faire appel à l'esprit decamaraderie qui anime le prévôt de la IVearmée et le lieutenant-colonelcommandant la gendarmerie d'Alsace-Lorraine pour qu'ils s'entendent, sansintermédiaire, au sujet des servicescommuns qu'ils ont à fournir.... C'estpourquoi je suis d'avis que la créationd'un commandement supérieur de lagendarmerie en Alsace-Lorraine... n 'est
pas à réaliser »(35).
Pour bien marquer, sans ambiguïté, qu'ilplace la légion de gendarmerie d'Alsaceet Lorraine directement et quasimentexclusivement dans ses attributions,Alexandre millerand adresse le 9 mai1919 au lieutenant-colonel commandantla légion de gendarmerie d'Alsace etLorraine, aux généraux commandantssupérieurs des territoires d'Alsace et deLorraine, aux commissaires de larépublique de Strasbourg, metz etColmar ainsi qu'au directeur de la Justicedu commissariat général, deuxcorrespondances. Dans la première, « enraison de la situation spéciale de lagendarmerie d'Alsace-Lorraine, jeprescris que, par dérogation aux articles52 et 53 du décret du 20 mai 1903 sur le
(35) AD 57, 5 r 687.
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
DOSSIER
LA rEConSTITuTIon DE LA GEnDArmErIE En ALSACE ET LorrAInE À LA FIn DE LA PrEmIèrE GuErrE monDIALE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page142
143
qu'un seul chef, Alexandre millerand,commissaire général de la république,résidant à Strasbourg. Cette organisationhiérarchique se montrera particulièrementefficace, y compris dans des actions àcaractère opérationnel telles que l'affairedu pillage des trains à Forbach en
octobre 1919(36). Elleest admise par tous
les responsables sauf par la sous-direction de la gendarmerie qui se voit,non seulement privée de la majeure partiede ses prérogatives mais, qui plus est,contrainte par millerand, via le présidentdu Conseil des ministres, de satisfaire sesexigences.
La position de la sous-direction de lagendarmerie vis-à-vis de la gendarmeriede l'Alsace et Lorraine procède d'unraisonnement technocratique élémentaireparfaitement limpide. La guerre terminée,les 200 gendarmes alsaciens et lorrainsinitialement prévus étant formés, ilconvient d'abord de dissoudre le Centred'instruction de gendarmerie deStrasbourg et de former à l'Intérieur lesautres gendarmes alsaciens ou lorrains,ensuite de contenir les effectifs de lalégion d'Alsace et Lorraine dans leslimites définies par le taux habituel dunombre de gendarmes rapporté à l’effectifde la population, éventuellement dedissoudre cette légion pour rattacher lagendarmerie de la moselle à la légion deChâlons-sur-marne, celle du Haut-rhin àla légion de Besançon et celle du Bas-
(36) AD 57, 304 m 31.
rhin à la légion denancy(37). Jamais la
sous-direction de la gendarmerie neprendra en compte la situation localeparticulière à l'Alsace-Lorraine qui, ausortir de la guerre, après un demi-siècled'acculturation germanique, a toutes lespeines du monde à retrouver sesmarques françaises. Ce comportement nelui sera pas spécifique. Beaucoupd'administrations centrales auront cettemême attitude qui sera dénoncée, àl'époque, par la population, les hommespolitiques et la presse d'Alsace etLorraine comme l'une des causesprincipales de ce qui sera appelé « lemalaise alsacien ». Le lieutenant-colonelmichel ne cessera, en permanence, des'opposer à cette conceptioncentralisatrice, affirmant avec d'autresqu'il faut une génération « jusqu’à ce queles enfants soient passés par l'école et lerégiment français » pour une assimilationcomplète et que pendant la période
transitoire, il fautdévelopper unepolitiqueparticulière(38).
Dans les relationsconflictuelles avec la
sous-direction de la gendarmerieengendrées par l'organisation de lagendarmerie d'Alsace et Lorraine, tant ence qui concerne la légion que le centred'instruction, le lieutenant-colonel michelaura le soutien constant aussi bien des
(37) AD 67, AL 121/421,
(38) Lettre du 12 octobre1925 du chef d’escadronmuller, commandant lacompagnie de gendarmeriedu Bas-rhin et anciencommandant de l’écolepréparatoire de Strasbourg.Propositions faites dans lalettre du 8 août 1925 maisqui ne seront pas retenues.
1ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
DOSSIER
LA rEConSTITuTIon DE LA GEnDArmErIE En ALSACE ET LorrAInE À LA FIn DE LA PrEmIèrE GuErrE monDIALE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page143
144
deux commissaires généraux qui sesuccéderont à Strasbourg, millerand etAlapetite, que de sa hiérarchie directe qui,même dans ses fonctions réduitesd'inspection, appuiera de tout son poids,les initiatives du commandant de légion,qu'il s'agisse jusqu'en juillet 1919 dugénéral de division Bouchez, inspecteurgénéral de la gendarmerie aux armées, ouensuite du colonel puis général Bonnet,commandant le 6e secteur degendarmerie. Ainsi couvert et soutenu, il
va pouvoir mettre enœuvre, à compter demai 1919, unepolitique renforcéede francisation(39).
(39) Cf. Georges Philippot,« Le colonel michel et sesgendarmes en alsace-Lorraine après 1918 »,Revue de la Gendarmerienationale, Hors série histoire,2000, pp. 113-130.
l’AUTEUR
Georges Philippot, ancien élève de l’écolespéciale militaire, est docteur en histoire.Après avoir notamment commandé lacompagnie de gendarmeriedépartementale de Calvi, le groupementdu Finistère et la 7e légion de gendarmeriemobile, il est nommé général en 1994 etachève sa carrière à la tête de lacirconscription de Gendarmerie d’Orléans.Admis dans la 2e section des officiersgénéraux en 1996, il dirige le Servicehistorique de la Gendarmerie nationale de1997 à 2003. Officier de la Légiond’honneur, de l’Ordre national du mérite etdes Arts et lettres, il est titulaire de lamédaille de la gendarmerie avec citation.
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
DOSSIER
LA rEConSTITuTIon DE LA GEnDArmErIE En ALSACE ET LorrAInE À LA FIn DE LA PrEmIèrE GuErrE monDIALE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page144
UN OFFICIER D’UNE GRANDE FORCE DE CARACTERE
Cet officier a démontré au cours de sa carrière militaire une exceptionnellecapacité à gérer des crises, s'illustrant d'abord comme officier dechasseurs alpins lors d'une catastrophe en montagne, puis en tantqu’officier de la garde républicaine, dans le cadre de l’arrestation del'anarchiste Jules Bonnot. En 1914, ayant intégré sur sa demande unrégiment de ligne, il est nommé commandant de compagnie et tué auxarmées.
Ce modèle d’officier de gendarmerie a donné son nom à la promotion1995-1996 de l’école des officiers de la gendarmerie nationale.
PORTRAIT
145
Gard
e Ré
publi
caine
Revue de la Gendarmerie Nationale 4e trimestre 2014
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:01 Page145
capitaine Fontan, héros malgré lui ?
une version de cet article a été publiée en 2009 dans
la Revue de la gendarmerie nationale n° 231.
Officier à la Légion de la Garderépublicaine, le capitaine Paul Fontans'est illustré en arrêtant l'anarchisteBonnot en 1912. Cette action d'éclatn'est pourtant qu'un épisode d'unparcours militaire ponctué d’actesméritoires et entièrement voué auservice des armes de la France et de lapopulation. Il nous est apparuintéressant de vous faire connaître lageste de cet officier déterminé, habileet courageux.
Issu d'une familled'instituteurs, Félix,Paul, émile Fontannaît le 30 octobre1880 à Aignan, dansle Gers. Après lesbancs de l'école, ilest interne au collègede Vic-Bigorre, puis
Osuit les classes préparatoires du lycée deTarbes. En dépit des projets de sa mèrequi désire le garder à la maison, son pèreétant décédé en 1894, Paul affirme savocation pour l'armée, compréhensible àune époque où chacun aspire à la“revanche”. reçu simultanément àl'école normale supérieure et à Saint-Cyraux concours de 1900, il opte pour cettedernière école et signe son engagementle 23 octobre devant l'adjoint au maire
de mirande(1). Ilrejoint l'écolespéciale militaireprès de Versailles.
Des troupesalpines à la garderépublicaineSorti dans lapremière moitié de
la promotion du Tchad, il choisit de servirdans l'infanterie de ligne(2). Attiréinitialement par les troupes coloniales, ilne veut pas s'éloigner de sa mère, restée
(1) Service historique de laDéfense, dossier personnelde l’officier, 5 Ye 95 377. Lesactes d'engagement sontreçus à cette époque par lesmaires ou leurs adjoints,avant de l'être par lesintendants militaires. Parailleurs, avant leur majorité,les engagés doivent obtenirl'aval de leurs parents.
(2) Saint-Cyr forme alors desofficiers d’infanterie et decavalerie, tandis que ceuxde l'artillerie et du géniesortent de Polytechnique.
HISTOIRE
1461ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
par vINceNT ossADzow
Gard
e Ré
publi
caine
vINceNT ossADzow Chef d’escadront, DEA enhistoireSous-direction de la policejudiciaire de la DGGN.
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:02 Page146
147
prudemment quand, soudain, l'avant-garde voit le sol se dérober sous sespieds. La section de tête est emportéepar une avalanche dans une chute de500 mètres. Le reste de la colonnen’atteint les victimes, dans la nuit, qu'aubout de deux heures. Les premiersblessés sont alors évacués et l'alerte estdonnée dans la vallée. À minuit, unecolonne de secours de Barcelonnette semet en route. Le sauvetage dure deux
jours, au boutdesquels on
dénombre six morts et treize blessés(4).
Au cours de l'opération, le sous-lieutenantFontan dirige le sauvetage en faisantpreuve d’une énergie remarquable.retirant des corps de la neige en pleinenuit pendant plus de trois heures, il faitévacuer les blessés et prend égalementen compte les cadavres. Il repart à l'aubeavec une deuxième colonne composée
de pompiers(5) pourtrouver le dernierdisparu. Son
dynamisme et sa détermination sontfavorablement remarqués par sessupérieurs. Il est cité à l'ordre du14e corps d'armée le 4 mars suivant :« [...] s'est porté sans hésitation ausecours des victimes sur le terrain del'accident avec tous les militaires dudétachement. Ne tenant pas compte dudanger, n'a pas cessé, pendant plus dedeux heures, de prodiguer des soins auxblessés. Pendant la marche s'estappliqué à maintenir le moral de la troupeet a donné, en cette circonstance, un belexemple de dévouement et de
(4) Journal de Barcelonnette,28 février 1904.
(5) Correspondance,25 février 1904. Collectionparticulière.
veuve, qui élève son frère, de treize ansson cadet ; il reste, en effet, le seulhomme de la famille. Il est donc nommé,le 1er octobre 1902, sous-lieutenant au157e régiment d'infanterie alpine dontl'état-major est basé à Lyon. Lesbataillons alternent des garnisons dans lavallée de l'ubaye, à Tournoux et
Jausiers(3). Lescourses enmontagne,l'occupation des
forts d'altitude et les travaux dedésenclavement des routes du massifalpin conviennent tout à fait à la soifd'activité de ce jeune officier.
Paul Fontan s'illustre une première fois le22 février 1904. À six heures du matin,une colonne de 80 fantassins quitte lacaserne de Jausiers pour se rendre au colde La Pare, à 2 661 mètres, avecl'intention de le franchir et de faire retourpar Barcelonnette. Après avoir atteint lecol dans l'après-midi, la descente se fait
(3) Les régiments changentà l'époque fréquemment deville de garnison, de manièreà ne pas trop y attacher leshommes.
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
HISTOIRE
LE CAPITAInE FonTAn : HéroS mALGré LuI ?
mus
ée d
e la
gen
dar
mer
ie n
atio
nale
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:02 Page147
courage »(6). Legénéral de Lacroix,
gouverneur militaire de Lyon, relève dansson discours lors des funérailles desvictimes que l'officier « s'est dépenséavec le plus grand dévouement et la plusintelligente activité, pour diriger lesauvetage des soldats enfouis dans la
neige et la recherchedes disparus »(7). Pardécisionprésidentielle, endate du 4 juin 1904,la médaille d'honneuren bronze duministère del'Intérieur pour actesde courage lui estattribuée.
En 1907, il épouse lafille d'un sous-intendant militaire deLyon(8). Cherchantalors une carrièreplus adaptée à sa viefamiliale et des
responsabilités, il opte pour lagendarmerie. Admis à l'examen, le18 janvier 1906, il attend le 11 juillet 1908pour rejoindre, comme lieutenant etcommandant de section l'arrondissementde mauléon dans les Basses-Pyrénées(Pyrénées-Atlantiques)(9). Après quatreannées passées dans le Sud-ouest, ildemande et obtient sa mutation à lalégion de la garde républicaine.
la fin de ‘‘la bande à bonnot’’Affecté à compter du 10 avril 1912 à la 8e
(6) Dossier personnel del'officier, op. cit.
(7) Journal de Barcelonnette,op. cit.
(8) Après autorisation dugénéral gouverneur militaire.Dossier personnel del'officier, op. cit.
(9) Aucune formation n'estalors prévue pour lesofficiers venus desrégiments. L'école des sous-officiers de gendarmerie,installée en 1901 à lacaserne Schomberg, sous lecommandement ducommandant de légion de laGarde républicaine, nes'adresse qu'aux élèves-officiers issus des rangs dela gendarmerie. Ce n’estqu’une fois l'école déplacéeà Versailles, en 1918, quetous les officiers y passeront.Cf. Louis n. Panel, « Lecorps des officiers degendarmerie en 1906 et lanaissance du Trèfle », LeTrèfle, n° 106, mars 2006,pp. 38-45 ; François Alègrede la Soujeole, Les officiersde gendarmerie sous laTroisième République (1880-1913), DEA, Paris I, 1991,pp. 20-22.
compagnie du régiment d'infanterie, enrésidence à la caserne napoléon, Paul
Fontan rejoint lacapitale le 24 avril(10).Quatre jours plustard, l'officierinconnu desparisiens acquiert,
par son courage et son sens tactique,une renommée qui le dépasse àl'occasion de l'arrestation de JulesBonnot. Ce dernier vit depuis un an avecraymond Callemin, André Soudy, Antoinemonier et Eugène Dieudonné, uneépopée sanglante de vols à main arméeen France et en Belgique(11). Au printemps1912, on compte à son palmarès19 crimes et délits, notamment lebraquage de la Société Générale de la rueordener à Paris le 21 décembre 1911, etles homicides de plusieurs gendarmes etpoliciers.
Le samedi 27 avril 1912, Bonnot estrepéré avec un seul complice dans ungarage du sud-est du département de laSeine, à Choisy-le-roi. Sa réputation, quiterrorise la population, est telle que lechef de la sûreté à la Préfecture de police,Xavier Guichard, se déplace en personnele lendemain à 7 heures et demie dumatin pour l'appréhender, accompagné
d'une vingtained'inspecteurs(12).
Bonnot, depuis une fenêtre del'appartement du premier étage, d’où ilcontrôle l'unique accès par l'escalier, abatl’inspecteur Augène, qui avait repéré laretraite du bandit la veille. obligé au repli,Guichard, prend conscience que la
(10) Légion de la Garderépublicaine, décisions ducorps, 1912. SHD, 1 H 148.
(11) Interpellés peu aprèsleur chef, ces complicessont condamnés à la peinecapitale par la courd'assises de la Seine le 27février 1913.
(12) Le Journal, 29 avril1912.
1481ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
HISTOIRE
LE CAPITAInE FonTAn : HéroS mALGré LuI ?
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:02 Page148
position à soixante mètres de la bâtisseisolée(13).
Quand les premiers gardes républicainsarrivent, Bonnot, décidé à faire un « fortChabrol » avec ses cinq pistolets, tienttoujours à distance les forces de l'ordre,le garage se trouvant dans un espacedécouvert de tous côtés. Tandis que leforcené tire ses cartouches par dizaines,un conciliabule débute entre Lépine,Guichard, Lescouvé, procureur de larépublique, Gilbert, juge d'instruction, etPaul, médecin légiste. Fontan jaugerapidement la situation. Le siège s'enlise,attire une foule de 10 000 à 20 000badauds et journalistes. La disproportionentre l'objectif et les moyens del'intervention est flagrante. S'agissantd'agir rapidement et de mettre fin à lafusillade qui dure depuis des heures, ilpropose à Lépine de faire sauter lebâtiment à la dynamite, fournie par un
situation atteint unedimension imprévueet demanded'urgence le renfortde la gendarmerie.Dix gendarmesdépartementauxarrivent, suivis parune quarantained'habitants armésde revolvers et defusils de chasse,monsieur rondu,maire de Choisy-le-roi, étant à leurtête.
Prévenu, le préfet de police Lépine, rejointle théâtre des opérations pour en prendrela direction. Entre-temps, devantl'ampleur prise par l'événement, il a requisle concours de la garde républicaine.C'est ainsi qu'un premier renfort de vingtgardes, commandés par le lieutenantFontan, se rend d'urgence sur place àneuf heures trente, en taxis-autosréquisitionnés, suivi par la 6e compagnieau complet (100 gardes) qui rejoint les
lieux à 10 heures 15par voie ferrée.Plusieurs centainesde gardiens de lapaix viennentcompléter ledispositif. En tout,plus de 500 hommesarmés, dont deszouaves du régimentde nogent, prennent
(13) Laurent López, « Labande à Bonnot : l’assautfinal à nogent (14-15 mai1912) »,http://criminocorpus.revues.org/269. Après Bonnot, lesdeux derniers membres dela bande en liberté sont Valetet surtout Garnier, auteur dela plupart des meurtres. Le14 mai 1912, ils sontlocalisés dans un pavillonde nogent sur marne. unnouveau siège commence,pratiquement identique àcelui de Choisy. L’autoritéordonne de faire sauter lamaison. La police, ayantdonné l’assaut, abat lesdeux hommes.
149 Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
HISTOIRE
LE CAPITAInE FonTAn : HéroS mALGré LuI ?
mus
ée d
e la
gen
dar
mer
ie n
atio
nale
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:02 Page149
puisatier voisin, « [...] pour terminer viteune affaire qui tourneau ridicule »14.
Cette tactique adoptée, l'officier fait venirune charrette bourrée de paille et dematelas. Progressant derrière ce bouclierde fortune, il aborde le garage pour placerla charge. Celle-ci fait deux fois long feu.À la troisième tentative, la déflagrationdétruit une partie du bâtiment. Aussitôt, lelieutenant Fontan et Guichard gravissentl'escalier, se protégeant derrière unmatelas, et pénètrent les lieux quicommencent à brûler. Bonnot, blessé à lapoitrine, tire depuis son lit mais l'officierriposte et neutralise le forcené, mettant findéfinitivement aux agissements de la
bande à Bonnot(15). Àmidi, l'affaire estterminée. Bonnot,protégé par lesforces de l'ordre dela vindicte populaire,
est transporté à l'Hôtel-Dieu où il décèdede ses blessures à son arrivée.
ovationné par la foule, Paul Fontandécouvre alors une popularité quil'embarrasse. Les journalistesn'obtiennent que des paroles lapidaires :« Je n'ai fait que mon devoir de soldat enallant au feu. Je n'ai pas d'impression. Jesuis satisfait seulement d'avoir bien rempli
ma mission »(16). Lahiérarchie, dépasséepar la presse, citel'officier à l'ordre dela légion le 4 mai1912 : « [...]
(15) Dans la lignée desbrigades du Tigre de 1907,cette affaire entraîne lacréation, par décret du29 avril 1912, de la brigadecriminelle à la préfecture depolice et la dotation deboucliers blindés pour lespoliciers.
(14) Correspondance,1er mai 1912.
(16) « Il se dérobe à toutinterview ». Le Journal, op.cit.
(17) Légion de la Garderépublicaine, ordres ducorps, 1910-1914. SHD, 1 H4.
commandant un détachement pour prêtermain-forte, à Choisy-le-Roi, à l'occasionde l'arrestation de deux assassinsdangereux et armés de revolvers réfugiésdans une maison isolée, a fait preuve deréelles qualités militaires et a contribuéactivement à leur capture en plaçant aupéril de sa vie, à trois reprises différentes,des explosifs au pied de cette maison, eten pénétrant ensuite un des premiersdans l'immeuble en flamme qu'il avaitréussi à faire sauter en partie »(17).
Sur rapport du ministre de l'Intérieur, leprésident de la république attribue àl'officier la médaille d'honneur en or pouractes de courage le 31 mai. Lelendemain, la décoration lui est remise etil est reçu par la reine des Pays-Bas, envisite à Paris, qui lui remet à son tour lacroix de chevalier dans l'ordre d'orange-nassau. En dépit de ces honneurslégitimes, il fuit le retentissementprovoqué par l'affaire : « Oui, c'est bienmoi l'officier sur lequel la presse fait unbruit ridicule et qui commence à megêner. [...] J'étais dans mon rôle, et j'aisimplement soufflé le plaisir de faire unpeu de tapage à nos camarades du géniede Versailles qui arrivaient sur les lieuxquand tout était fini. [...] Les parisiens
sont ridicules, je suismême ennuyé detout ce bruit [...] »(18).
la fièvre de l'été1914Après cette
épopée(19), le lieutenant Fontan reprendles activités ordinaires d'un officier de la
(18) Correspondance,1er mai 1912.
(19) Certains qualifierontl'officier d'« ancêtre duGIGn » (Jean-Pierre Bernier,La Garde républicaine,Hervas, 1989, p. 40).
(20) Correspondance,16 décembre 1912.
1501ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
HISTOIRE
LE CAPITAInE FonTAn : HéroS mALGré LuI ?
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:02 Page150
151
jeune pour être utilement classé cetteannée »(22).
L'été 1914 est particulièrement chaud,non seulement en raison des tensionsinternationales qui précèdent la guerremais encore du fait d’affaires intérieuresdélicates(23). Le 20 juillet 1914 débute, à laCour d'assises de la Seine, le ‘‘procèsCaillaux’’, au cours duquel la garderépublicaine va consacrer une partconséquente de ses moyens. madameCaillaux, épouse du ministre des Financesdu cabinet Doumergue, exaspérée par lesviolentes attaques subies par son maridans la presse, avait assassiné GastonCalmette, directeur du Figaro, le 16 mars1914(24). Le débat politique divise, eneffet, les radicaux plutôt pacifistes, dontJoseph Caillaux, et une droite nationalistesoutenue par Le Figaro, prête à un conflitarmé. Pendant la durée des débats, lelieutenant Fontan est désigné à la tête dudétachement chargé du service d'ordre,dans la salle d'audience et à l'intérieur dupalais de Justice, avec trente gardes
(sans fusil) issus des5e, 6e, 7e et 8e
compagnies(25). Dèsle premier jourd'audience, le climat
est si tendu qu'un renfort de 60 gardesest envoyé à la caserne de la Cité, le21 juillet, pour le service d'ordre àl'extérieur du palais. Ces effectifssupplémentaires sont portés à 600gardes d'infanterie, 175 cavaliers et 60cyclistes, le 28 juillet 1914, tant la fouleest houleuse dans la rue en attente du
(25) Décision du 18 juillet1914. Légion de la Garderépublicaine, décisions ducorps, 1914. SHD, 1 H 154.
(26) Décision du 1er août,ibid.
garde : services d'honneur et servicesd'ordre sur réquisition du préfet de policeou sur ordre du général commandant laplace, services à la Cour d'assises surréquisition du procureur général près laCour d'appel de Paris, ronde desthéâtres, etc. Au printemps 1913, c'est lagrève des terrassiers du métropolitain. Endécembre, il intervient avec ses gardes àLevallois au dépôt de la principalecompagnie des taxis-autos de Paris oùdes bagarres éclatent(20).
L'ancien étudiant, reçu autrefois ànormale, est mis à contribution pourl'épreuve de calcul du brevet d'instructionprimaire en 1912 ainsi qu'au courspréparatoire. Il est chargé, par ailleurs, defaire l'instruction des nouveaux admis à lagarde pendant six mois. Le 6 mars 1913,il donne aux officiers une conférence sur« le service en campagne dans lagendarmerie allemande »(21). Au printemps1914, il commence la préparation del'école de Guerre. Le colonel Kern,commandant la légion, le note « Très bon
officier, calme, froid,énergique,courageux. Apportede l'activité et duzèle dans sesfonctions [...] », maisle général michel,gouverneur militairede Paris, ne le retientpas pour autant àl'avancement :
« Officier énergique et dévoué ayant deuxbelles citations à son actif ; encore un peu
(21) Décision du 27 janvier1913. Légion de la Garderépublicaine, décisions ducorps, 1913. SHD, 1 H 148.
(22) relevé des notes ettravail d'avancement de1913. Dossier personnel del'officier, op. cit.
(23) Le 31 juillet 1914, JeanJaurès, chef de la SFIo, estainsi assassiné dans un caféde la rue montmartre parraoul Villain.
(24) Gaston Calmette avaitmenacé Joseph Caillaux dela divulgation d'unecorrespondance intime.
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
HISTOIRE
LE CAPITAInE FonTAn : HéroS mALGré LuI ?
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:02 Page151
152
verdict qui finalement acquitte l'accuséele lendemain. Le colonel Kern,commandant la légion, félicite lesmilitaires à l'issue de ce service particulier,rempli « avec tact, fermeté et doigté » etcite nommément le lieutenant Fontan àcette occasion(26). L'officier nous relatel'atmosphère fiévreuse de ce procès :« La dernière journée du procès Caillauxn'a pas été la moins fatigante. Jamais laCour d'assises n'avait présenté un pareilspectacle que celui qui a eu lieu hier à lalecture du verdict. [...] Heureusement queCaillaux était parti un peu avant, sans celaje n'aurai pu le protéger, bien qu'il eûtautour de lui une garde sérieuse. Pendantdix jours, je peux dire que j'ai été l'hommede Paris le plus sollicité, mais le plusincorruptible, et je suis sûr que tout lemonde a été content de moi, ou, dumoins, me l'a témoigné à la fin du procès.J'obtenais plus de la salle par unedemande que le président des assisesdont tout le monde se moquait quand on
ne l'injuriait pas »(27).
les prémices de laGrande GuerreLa déclaration de guerre et le premier jourde la mobilisation, le 1er août 1914, neconcernent qu’indirectement la garderépublicaine. En cas de conflit, en effet, ilest prévu de ne pas mobiliser celle-cipour le front, mais de conserver sonorganisation de temps de paix pourqu'elle continue d'assurer son servicedans la capitale. Celui-ci s'intensifiequelque peu. C'est ainsi que Paul Fontanpasse les premiers jours de la mobilisation
(27) Correspondance,30 juillet 1914.
1ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
HISTOIRE
LE CAPITAInE FonTAn : HéroS mALGré LuI ?
à assurer le service d'ordre àmontparnasse, les gares parisiennesétant prises d'assaut dans la journée.L'effervescence créée par la montée enpuissance de la mobilisation dure unedizaine de jours puis le service dans lesgares se calme. Le 15 août, la capitale sevide, « Paris est d'un calme parfait », à telpoint « qu'il n'y a même plus un ivrogne à
ramasser »(28).
outre l'adoption, àcompter du début du conflit, de la tenuede campagne, plus appropriée et discrèteque la grande tenue, la 8e compagnie estsurtout occupée par son transfert denapoléon à la caserne du Prince Eugène
(actuellementcaserne Vérines)(29).Cependant,nombreux sont lesgardes qui veulentprendre égalementleur part au conflit et
rejoindre le front. « Pour le moment, j'ai untravail qui ne me déplairait pas, s'il ne meretenait loin de mes camarades » écritl'officier(30). Son ardeur l'entraîne à vouloirse joindre à son frère Jules qui, entamantsa deuxième année d'élève à l'écolepolytechnique, vient d'être versé au frontcomme sous-lieutenant au 40e régimentd'artillerie. Dans un premier temps, lesgardes républicains se voient opposer unrefus ferme, tant du ministre de la Guerreque du commandant de légion, qui lesrenvoie à leurs missions prioritaires deservice d'ordre dans Paris(31). « Pour moi,je suis navré, le colonel n'avait pas encore
(29) Décision du 1er août.Légion de la Garderépublicaine, op. cit.
(30) Correspondance,2 août 1914.
(31) Décisions des 25 et30 août 1914, op. cit.
(32) Correspondance, 9 août1914.
(28) Correspondance,16 août 1914.
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:02 Page152
Fontan rejoint ainsi ses camaradesofficiers du 14e corps d'armée qu'il avaitquittés six ans plus tôt. nommé capitaineà titre temporaire, le 25 octobre, il reçoitson baptême du feu la veille en premièreligne entre Amiens et Péronne où sonrégiment est engagé. L'officier commenceson service en remplaçant pendantquelques jours son commandant debataillon, blessé. Le 24 octobre, il prendle commandement de la 12e compagnie.
Chef de guerre accompli, il est proche deses 200 fantassins et économe de leursvies, tout en cherchant constamment àavancer, en habile tacticien. Partageantles conditions de vie de ses soldats, ilessaie d'en améliorer le quotidien. Ainsi, ilpermet la confection de feux de cuisinedans les tranchées, avec du charbon deboulanger qui ne dégage pas de fuméevisible. La troupe l'apprécie et le suit sansse plaindre : « Le capitaine est un bonbougre, il sait bien que nous sommespères de famille, et ne nous crèvera pas
de travail »(35). « Ilétait très bon pour
ses hommes : debout toute la nuit, il allaiten patrouille tout seul ; ce fut un miraclequ'il ne soit pas blessé. [...] Un jour, dansla nuit, il reconnut à l'avant un petit posteennemi, [...] nous partîmes après avoirgagné 80 mètres de terrain sans perdreplus d'un homme et plus d'un blessé, etceci grâce à notre capitaine. La nuit, ilallait avec les hommes qui travaillaient àl'avant. Un jour, un homme lui dit : ‘‘Vousn'allez donc pas vous reposer, moncapitaine ? Non, mon ami, du moment
(35) Correspondance,2 décembre 1914.
transmis ma demande pour partir aufront ; il m'a fait appeler pour me dire qu'ils'y opposait. J'ai exigé qu'il la transmettequand même, il a dû s'incliner, mais il memet un avis défavorable »(32).
Volontaire pour tout service aux armées,le lieutenant Fontan est désigné, le24 août, officier de liaison entre leministère de la Guerre et le GrandQuartier Général ; pendant dix jours, ilporte les plis confidentiels entre Alexandremillerand et le général Joffre. Cettemission de confiance prend fin le2 septembre quand, sous la menace del'avancée ennemie, le gouvernement sereplie provisoirement à Bordeaux.
L'autorisation de servir au front n'estaccordée que le 26 septembre : 194gardes volontaires peuvent partir au seindes régiments de ligne, avec le grade
supérieur(33). Deuxchefs d'escadron,cinq capitaines et six
lieutenants, dont Fontan, font partis dusecond contingent qui quitte
Paris le 17octobre(34). Au final,la Garde envoie auxarmées pendant laPremière Guerre
mondiale 76 officiers et 1 050 hommes,soit la totalité de ses officiers d'active etplus du tiers de la troupe ; le prix estsignificatif, puisque 218 d'entre euxtombent morts pour la France.
Retour en régiment d'infanterieAffecté au 99e régiment d'infanterie, Paul
(33) 22 sous-officiers partentainsi comme sous-lieutenants. Décision du26 septembre 1914, op. cit.
(34) L'accord pour lesofficiers n'intervient qu'unmois après celui de latroupe. 12 lieutenants sontvolontaires, parmi lesquels 6sont tirés au sort. Décisiondu 11 octobre 1914, ibid.
153 Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
HISTOIRE
LE CAPITAInE FonTAn : HéroS mALGré LuI ?
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:02 Page153
que vous êtes exposé, il n'y a aucuneraison que je n'y sois pas’’. [...] Avec des
officiers tels que lui,nous les hommes,on va partout »(36).
Depuis deux mois, le 99e rI cherche àreprendre le village de Fay, dans laSomme. Le 18 décembre 1914, legénéral commandant la 55e brigade, dontfait partie le régiment, commande uneattaque de cet objectif par le nord,suivant le plan tactique proposé par PaulFontan. Lors de cette préparation legénéral lance même à l'officier, avec unepointe d'ironie : « D'ailleurs, moncapitaine, ça vous connaît, c'est uneseconde affaire Bonnot ! » A son avant-poste, en tête des lignes, le capitaineeffectue une reconnaissance à neufheures, avec un officier du génie. Aumoment où il installe un périscope pourrepérer les barbelés à détruire, une ballel'atteint à la tempe. Immédiatementtransporté à l'ambulance, il expire à
Villers-Bretonneux lanuit même à uneheure du matin (37).
Le 20 décembre, lecolonel marty, sonchef de corps,
« s'incline devant une tombe siprématurément ouverte et salue en lapersonne du capitaine Fontan un modèled'énergie et de courage »(38). Le 29 janvier1915, Paul Fontan est cité à l'ordre del'armée : « Officier d'une bravoure etd'une énergie à toute épreuve. Est tombé
(36) Lettre du brancardierGuérin, du 99e régimentd'infanterie, à madameFontan, 24 janvier 1915.Collection particulière.
(37) état des services,dossier personnel del'officier, op. cit.
(38) Légion de la Garderépublicaine, op. cit.
(39) état des services,dossier personnel del'officier, op. cit.
glorieusement à la tête de sa compagnieen donnant des ordres pour lapréparation de l'attaque de la positionennemie, le 18 décembre 1914 »(39).Auparavant, la nouvelle est parvenue à lagarde républicaine en créant un certainémoi, si bien que le colonel commandantla légion organise un service solennel à samémoire en l'église Saint-Paul, enprésence de l'ensemble des officiers etdu président du conseil municipal(40). Pardécret du 19 avril 1920, la Légiond'honneur lui est décernée à titreposthume. Cette ultime récompense,c'est son jeune fils robert, âgé de onzeans, qui la reçoit à l'occasion d'une prised'armes au quartier des Célestins le30 octobre suivant. Le colonel Somprou,commandant la légion, remet diversescroix de la Légion d'honneur et croix deguerre à des officiers de la garde, pourleur brillante conduite sur le front. Legarçon est sur les rangs, aux côtés deslieutenants, et reçoit la croix de son pèreavec une intense émotion(41).
Du col de La Pare aux combats de laSomme, le capitaine Paul Fontan a doncconnu une carrière brillante, tant dans lesrangs de l’infanterie qu’au sein de lagendarmerie nationale. reconnu et saluépar ses supérieurs, respecté de seshommes, il restera avant tout dans lesmémoires comme celui qui procéda àl’arrestation de la bande à Bonnot.
1541ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
HISTOIRE
LE CAPITAInE FonTAn : HéroS mALGré LuI ?
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:02 Page154
JOSEPH PlIQUE : UN REFORMATEUR PRAGMATIQUE
Sous-directeur de la gendarmerie en 1918, puis premier directeur en1920, Joseph Plique est un officier réformateur doublé d'un historien.Chargé par Georges Clemenceau de rénover l'institution dans un contextepolitique et social difficile, il accorde aux gendarmes le statut de sous-officier, améliore leurs conditions de vie, met en place leur formation.De1919 à 1921, il crée une gendarmerie mobile chargée du maintien del'ordre dans le pays, démontrant une connaissance aigüe des mécanismesde l’arme et un jugement sûr. Nommé général de brigade le 24 juin 1923,placé dans la section de réserve le 1er décembre 1926, il se consacrealors à l'histoire de la gendarmerie dont il disait : « si ceux à qui lesdestinées de notre Arme ont été confiées jadis avaient eu l'occasiond'étudier cette histoire et de méditer sur ses leçons, ils auraient évitébien des erreurs ».
PORTRAIT
Gard
e Ré
publi
caine
155 Revue de la Gendarmerie Nationale 4e trimestre 2014
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:02 Page155
Joseph Plique, premier directeur de la gendarmerie
Cet article a été publié en 2002 dans le hors-série n°3
de la revue de la gendarmerie nationale.
Si l’actuelle direction générale de laGendarmerie nationale a été créée le10 novembre 1981, la question ducommandement supérieur del’institution s’est posée dès larévolution française. Représentée, sousle Premier Empire, par une inspectiongénérale confiée au maréchal Moncey,
la gendarmerie dutattendre le début duXXe siècle et la findu premier conflitmondial pour se voirdoter d’un organeautonome dedirection. Cetteréforme importanteest en grande partiele fait d’un officiersouvent méconnudes gendarmes, legénéral Plique,
Spremier sous-directeur puis premierdirecteur de la Gendarmerie maiségalement historien de laMaréchaussée.
Dans l'un de ses premiers numéros del'entre-deux-guerres, la revue de lagendarmerie faisait paraître un courtarticle sur l'une des grandes figures de lagendarmerie sous la III° république et luirendait ainsi hommage : « Du fond de saretraite, que le général Plique trouve iciles remerciements de toute une armequ'il a sauvée de la misère morale et,sans doute, de la décadence, en luirendant la juste compréhension de sa
mission »(1).Pourtant, le rôleessentiel de cet
officier reste méconnu dans la vastecampagne de réformes qui toucha lagendarmerie au lendemain de laPremière Guerre mondiale.
(1) Revue de lagendarmerie, n° 2, 1928, p.180.
HISTOIRE
1561ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
par XAvIer BorDA
XAvIer BorDA Conservateur desbibliothèques, titulaired’un DEA d’histoire del’Institut d’EtudesPolitiques de Paris, Xavierborda a rejoint labibliothèque Mazarine en2014, après avoir exercédans les établissementsde la Ville de Paris et à labibliothèque nationale deFrance.
Gard
e Ré
publi
caine
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:02 Page156
157
le territoire français et qui comptait plusde vingt-cinq mille hommes. Les journauxspécialisés avaient ainsi dénoncé àplusieurs reprises cette situation, estimantque la gendarmerie se trouvait « vis-à-visde la cavalerie, à l'état de provinceannexée ayant perdu sa vie propre et son
autonomie »(3). Cescritiques trouvèrentégalement des
échos à la Chambre des députés où lesélus réclamèrent à plusieurs reprises lacréation d'une direction, ou tout au moinsd'une sous-direction de la gendarmerieau ministère de la Guerre.
Une gendarmerie reconnue La Première Guerre mondiale et lanécessité d'une force militaire del'intérieur forte et organisée conduisirentle gouvernement de Georges
(3) Journal de lagendarmerie, n° 1454, 11mars 1886.
Une gendarmerie délaisséeL'institution avait en effet longtempssouffert d'un désintérêt général de la partdes autorités politiques et militaires.L'absence d'un organe supérieur decommandement au sein del'administration centrale du ministère de la
Guerre étaitdurement ressentie(2).Depuis la chute dupremier Empire en
1815, la gendarmerie dépendait en effetde la direction de la cavalerie et n'étaitreprésentée que par un simple bureau, leplus souvent confié à un officier supérieurou à un fonctionnaire civil. Cetteincohérence avait nourri de nombreusescritiques de la part des gendarmes quiréclamèrent à plusieurs reprises lacréation d'une direction autonome pourune institution qui était présente sur tout
(2) Xavier Borda, Histoire ducommandement supérieurde la Gendarmerie nationale(1791-1981), SHGn,maisons-Alfort, 111 p.
La nouvelle promotion du « Grand renfort » (1920) de l’école des officiers de la gendarmerie à Versailles.Futur compagnon de la Libération et parrain de promotion, Maurice Guillaudot est au 1er rang, 3e àgauche.
mus
ée d
e la
Gen
dar
mer
ie.
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
HISTOIRE
JoSEPH PLIQuE, PrEmIEr DIrECTEur DE LA GEnDArmErIE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:02 Page157
Clemenceau à modifier cette situation.Conscient du rôle difficile que devait tenirla gendarmerie dans un pays en guerre etoù le problème du maintien de l'ordre seposait de façon cruciale, le « Tigre »décida de créer, pour la durée deshostilités, un « organe de centralisation etde coordination » pour la gendarmerie afinde l'affranchir de « la tutelle » quis'exerçait sur elle. Le décret du 16 février1918 créa donc une sous-direction de lagendarmerie et, trois jours plus tard, unedécision ministérielle portait nominationdu lieutenant-colonel Plique à l'emploi desous-directeur de la gendarmerie.
Joseph Plique (1866-1949) avaitjusqu'alors effectué un parcours modèled'officier de gendarmerie. élève de l'écolespéciale militaire de Saint-Cyr, entre 1887et 1889, il fut affecté à sa sortie au156e régiment d'infanterie avant d'êtreversé en 1893 dans la garde républicaineavec le grade de lieutenant. Ses diversesaffectations le conduisirentsuccessivement à Domfront, Saint-maloet Lille, où « il se distingua lors d'uneémeute en dispersant des attroupementshostiles qui s'en prenaient à la troupe »,action pour laquelle il reçut une citation à
l'ordre de l'armée(4).Chef d'escadron en1908, il fut affectépar la suite à mende
puis commanda la XIIe légion degendarmerie à Limoges en juillet 1917,avant d'être appelé à prendre les
(4) Vincennes, Servicehistorique de la Défense(SHD), dossier personnel deJoseph Plique, 5 Yf 100749.
fonctions de premier sous-directeur de lagendarmerie. Il fut, du reste, promucolonel peu après, en septembre 1918.
L'importance du rôle personnel du colonelPlique fut incontestable et il recueillitl'unanimité sur son action et sonengagement pour entreprendre lesgrandes réformes attendues, au premierrang desquelles la reconstitution d'unegendarmerie mobile chargée du maintiende l'ordre dans le pays. Son dynamismefut reconnu par tous les militaires del'institution et il prit part aux débatsparlementaires devant les chambres au
titre de commissairedu gouvernement(5).Le sous-directeur
reçut dans ses attributions les questionsrelatives à la gendarmerie et devait traitertoutes celles de son ressort ou les faitsétudiés par les organes placés sous sonautorité. Le colonel Plique organisa parconséquent la sous-direction en y créantun bureau technique chargé del'organisation militaire et administrative, unbureau du personnel et une sectionadministrative qui devait s'occuper des
questionsd'application desrèglements et du
casernement(6).
Des avancées importantesLa sous-direction fournit au cours desdeux années de son existence un travailconsidérable pour améliorer le sort desgendarmes et pour accroître la qualité du
(5) Revue historique del’armée, numéro spécialGendarmerie, 1961, p. 48.
(6) SHD, archives de lasous-direction de lagendarmerie, 16 n 191.
1581ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
HISTOIRE
JoSEPH PLIQuE, PrEmIEr DIrECTEur DE LA GEnDArmErIE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:02 Page158
organisme reçut l’appellation de13e direction, tandis que le colonel Plique,qui avait entre-temps été affecté à lalégion de Paris, était nommé directeur dela gendarmerie le 29 octobre de la mêmeannée.
Le colonel Plique fut ainsi le premier sous-directeur puis premier directeur de lagendarmerie. Il acheva les réformesentreprises au cours des deux annéesprécédentes et notamment la création dela gendarmerie mobile, rendue officiellepar la loi du 22 juillet 1921. Toutefois, lecolonel Plique, après plus de trois annéesde mandat, demanda lui-même àreprendre un commandement actif et futnommé commandant du deuxièmesecteur de gendarmerie à Tours. Lecabinet du ministre salua ainsi le directeuret son action : « Exerce depuis plus d’unan les fonctions de directeur de lagendarmerie qu’il n’a pas sollicitées,marquant sa préférence pour uncommandement de secteur. A témoigné,comme directeur, d’une très complèteconnaissance de son arme et d’un solidejugement. A établi un programmed’améliorations à apporter dans le servicede la gendarmerie tout à fait judicieux. Enrésumé, a réussi dans ce poste. Mérite lapremière place vacante dans lagendarmerie pour passer général ».
Promu officier de la Légion d’honneur, le10 janvier 1921, et général de brigade, le24 juin 1923, il fut placé dans la sectionde réserve le 1er décembre 1926, et se
service de l’institution. un mémoire,présenté en 1921 par le colonel Plique auministre de la Guerre, résuma ainsi lesgrands thèmes des changements opérés
par la sous-direction(7) :
augmentation de la solde et des retraites,augmentation du nombre des médaillesmilitaires et gratifications décernées,statut de sous-officier accordé auxgendarmes, remplacement desinspections générales par les générauxcommandant de secteur, créationd’écoles préparatoires de gendarmerie,création de l’Ecole d’officiers degendarmerie de Versailles, modernisationdu matériel et projet de reconstitutiond’une gendarmerie mobile.
malheureusement, la sous-directionn’étant prévue que pour la durée deshostilités, un arrêté maintint celle-cijusqu’au 15 février 1920, date de sasuppression pour raison d’économies. Lanécessité d’un organe supérieur decommandement ayant été démontrée, lesparlementaires de la Chambre desdéputés nouvellement élue défendirent àleur tour la création d’une direction de la
gendarmerie(8). Aprèsde nouveaux débatsparlementaires, la loide finances du31 juillet 1920
autorisa finalement la création d’un emploide directeur à l’administration centrale duministère de la Guerre. Le nouvel
(7) SHD, rapport du colonelPlique, 9 n 272.
(8) Xavier Borda, « Lanaissance de la direction dela gendarmerie sous laTroisième république »,Revue historique desarmées, numéro spécialGendarmerie, 1998, pp. 43-51.
159 Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
HISTOIRE
JoSEPH PLIQuE, PrEmIEr DIrECTEur DE LA GEnDArmErIE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:02 Page159
consacra alors à ses activités historiques.En effet, Joseph Plique montra un intérêtsoutenu pour l’histoire de l’institution.Chef d’escadron affecté à mende dans laXVIe légion de gendarmerie, il avait publiéune Histoire de la maréchaussée duGévaudan en s’appuyant en grande partiesur les archives départementales pourillustrer l’évolution des missions deprévôts des maréchaux du XVIe siècle à la
révolutionfrançaise(9). Aprèsson passage dans ladeuxième section, le
général Plique collabora à plusieursreprises à la nouvelle Revue de lagendarmerie, en publiant ses Notes pourservir à l’histoire des compagnies demaréchaussée. Il souhaitait ainsi quel’histoire de la gendarmerie fût« enseignée à l’école des officiers degendarmerie » afin qu’ils aient « l’occasionde méditer sur ses leçons ». regrettantl’absence d’une réflexion sur l’histoire dela gendarmerie, il affirmait : « Si ceux à quiles destinées de notre arme ont étéconfiées jadis avaient eu l’occasiond’étudier cette histoire et de méditer surses leçons, ils auraient évité bien deserreurs ». Conscient du vaste champd’études qui s’offrait aux officiers désireuxd’approfondir la connaissance del’institution, il appelait de ses vœuxl’entreprise d’une « histoire complète » dela gendarmerie en insistant sur lanécessaire précision des référenceshistoriques et sur la contribution qu’elle
(9) Joseph Plique, Histoirede la maréchaussée duGévaudan, Privat, 1912,réédité dans Force publique,n° 4, 2009, 252 p.
fournirait pourl’histoire locale(10). undemi-siècle après
son décès, la création du servicehistorique de la gendarmerie nationale etle lancement de recherches universitairessur l’institution confirment la pertinence del’analyse du général Plique.
(10) Revue de lagendarmerie, n° 5, 1928,pp. 535-537
1601ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
HISTOIRE
JoSEPH PLIQuE, PrEmIEr DIrECTEur DE LA GEnDArmErIE
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:02 Page160
161
BLOC-NOTES
Ce livre, issu de la thèse que Louis n.Panel a soutenu sous la direction deJean-noël Luc en 2010, réussit le tour deforce de dresser une synthèse del’ensemble des différents engagements etmissions de la gendarmerie durant laPremière Guerre mondiale. Construit àpartir de sources de première mainglanées à Vincennes dans les archives dela gendarmerie, de l’armée de Terre, de leJustice militaire et du personnel, maiségalement aux Archives nationales(Intérieur et Justice) et dans un échantillonde départements, il choisit de reprendre àla base le dossier délicat des gendarmesde la Grande Guerre, notamment eninterrogeant les témoins, qu’il s’agisse detémoignages littéraires ou d’enquête oraleauprès des derniers poilus.
L’ambitionpremière del’ouvrage,avouée dèsl’introduction,semble d’établirles faits,dénombrer leshommes et lescas, et fixer lachronologie fined’un sujet ensomme fort mal connu. L’étude adopteune facture classique, mais sansdédaignerl’apport de lasociologie ou del’anthropologie,notamment
la Grande Guerre des gendarme
Louis N. Panel, LaGrande guerre desgendarmes. « Forcer,au besoin, leurobéissance » ?, Paris,Nouveau Monde, 2013,611 p.
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:02 Page161
BLOC NOTES
LIVrES, CoLLoQuES, mAnIFESTATIonS…
162
lorsqu’il s’agit d’étudier les suicides (p.267-270) ou la construction d’une rumeur(p. 537-540)Dans un premier temps, l’étude confirmece que l’on soupçonnait : l’engagementdans des unités combattantes futminoritaire – moins d’un millierd’hommes, dont tous n’étaient pasvolontaires, sur 27 000 actifs – maisl’action prévôtale protéiforme, s’étendantdu service de la circulation à lasurveillance sanitaire et de la garde desprisonniers à la « police des débineurs ».L’ouvrage s’attarde ensuite sur lacomplexité de la police judiciaire auxarmées, et notamment des prisons ettribunaux prévôtaux. Enfin, l’auteur tord lecou à un certain nombre d’idées fausses,dont la légende des gendarmes pendus àVerdun, à laquelle il consacre undéveloppement stimulant (p. 533-536).La mobilisation est présentée comme unsuccès opérationnel, fondée sur unepréparation de près de trente ans, menéepar des gendarmes aux moyens pourtantsi limités que leur propre mise sur le piedde guerre est difficile. Espérant la guerrecourte, les brigades transmettent leursfonctions à d’éphémères garde civiles (p.88), dissoute après l’échec de la course àla mer, puis incorporent bon an mal andes cadres de compléments, gendarmesretraités, auxiliaires issus de l’arméeterritoriale, enfin magistrats et avocatspromus commandant d’arrondissementpour la durée de la guerre (p. 120-140).L’année de Verdun met en lumière lafaiblesse des moyens humains, maisaussi matériels et réglementaires
accordés à la gendarmerie. on compteun gendarme pour mille hommes dans lazone des armées, médiocrement armé etmal soutenu par le commandement, cequi démonte les interprétations fondéessur la ‘‘contrainte’’ ou la ‘‘peur dugendarme’’. La crise de 1917 estl’occasion d’une « crise de conscience »du commandement en matièred’encadrement du front. Elle sembledirectement à l’origine des réformesentreprises sous le ministère Clemenceauà un rythme tel que l’auteur qualifie de« printemps de la gendarmerie » lemouvement qui entraine la création d’unesous-direction et d’un corps d’officiersgénéraux, l’attribution aux hommes dustatut de sous-officiers, l’ouvertured’écoles, une modernisation techniquepermettant la promotion de la policejudiciaire… toutes choses dont ildémontre qu’elles constituent l’ossaturede la gendarmerie contemporaine.on suit également l’enquête pistant,« des tranchées aux pavés », l’apparitiond’une gendarmerie mobile pérenne. Pourl’auteur, son origine réside dans les« sections prévôtales » mobiles crées à lafaveur de la crise de 1917 pour réprimerles mutineries, mais déployées à partir de1918 à l’intérieur pour y assurer lemaintien de l’ordre, et maintenues au seindes légions départementales lors de ladémobilisation. Ainsi, avec la loi de 1921portant création des ‘‘premiers’’ pelotonsmobiles de la gendarmerie, « la Chambrene fait que reconnaître l’enfant né dans lesecret en 1917-1919 » (p. 511).on regrette toutefois plusieurs absences,
1ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:02 Page162
Journal d’un gendarme 1914-1918
163
à commencer par celle de toutdéveloppement sur l’outre-mer, où lesgendarmes durent également assurerl’état de guerre, l’auteur s’étant fixé pourlimites celles de la métropole. Labibliographie finale est également peuconsistante et l’on déplore le manqued’un cahier central qui aurait pu rendrecompte par l’image des richestransformations techniques,architecturales et vestimentaires queconnut la gendarmerie au cours de laguerre, et que l’ouvrage analyse àdifférentes reprises.Au total, le livre représente toutefois une
somme indispensable pour mieuxcomprendre la nature de l’effort de guerreenduré pas les Français en 1914-1919 etobserver dans le détail la lutte anti-subversive conduite par les pouvoirspublics - on relève au passage desdonnées nouvelles sur la lutte contrel’espionnage, la désertion et le marchénoir. Plus généralement, l’étude éclaire surle long terme le positionnement historiquede la gendarmerie vis-à-vis des armées etde la société.Benoit Haberbusch
La Grande Guerre a incontestablementmarqué une étape dans l’écriture du soiau sein de la gendarmerie. Celle-ci a étéencouragée, au vrai dès la Belle Epoque,par un commandement réclamant descandidats à l’Ecole de Guerre, et plusgénéralement de ses officiers subalternesdésireux de faire carrière, qu’ils produisentdes études de terrain. mais il a surtoutbénéficié de la demande faite en 1919aux prévôts démobilisés qu’ils consignentleurs observations de la guerre en vue deréformer le service prévôtal.Ainsi connaissait-on les récits de plusieursprévôts de la Grande Guerre, commeBon, Forestier, mahé... Pourtant lecontexte de leur rédaction, dans desannées d’entre-deux-guerres propices à
une réécriture dusouvenir auprisme du genreanciencombattant – unequalité dénié auxprévôts par la loide 1927 – donneencore plus deprix auxmémoires restés inédits, et du resteconçus pour rester confidentiels, ainsiceux des lieutenants Charles Faivre, JulienDuhamel, ou encore du gendarme mariusPerroud, et, endernier lieu, lescarnets de JulesAllard. C’est dire
Capitaine Jules Allard,Journal d’un gendarme1914-1918, présentationd’Arlette Farge, Paris,Bayard, 2010, 259 p.
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:02 Page163
BLOC NOTES
LIVrES, CoLLoQuES, mAnIFESTATIonS…
164
tout ce que la publication de cedocument, resté en mains privées jusqu’àsa découverte et son édition par ArletteFarge, peut apporter à la connaissance,pourtant récente, de la Grande Guerredes gendarmes.Jules Allard est né en 1872 dans unefamille de vignerons du Loiret. Entré dansl’infanterie par effet du tirage au sortimposé à sa classe, il a obtenu les galonsde sous-officier, et s’est rengagé pourtrois ans pour entrer finalement à Saint-maixent en 1896, dont il sortira 14e. Enmars 1914, alors qu’il est déjà capitaine, ilpasse dans la gendarmerie et commande,quelques semaines, l’arrondissementd’Angers. Il n’a donc jamais faitcampagne lorsqu’il est nommé à la têtede la prévôté de la 18e divisiond’infanterie, le 2 août 1914, niaccompagné ses gendarmes auxmanœuvres, voire aux grèves qui tiennentlieu, pour la majorité d’entre eux,d’expérience opérationnelle. Cette faibleexpérience de l’arme explique aussi saproximité, tout au long de la guerre, avecles troupes de ligne au sein desquelles ilcroise de nombreux amis. Prévôt dedivision durant près de deux ans, Allardaccepte en juin 1916 un poste moinsexposé à la prévôté des étapes, puis estrenvoyé sur Angers, vraisemblablement àl’été 1917. Il y meurt en décembre 1918de la grippe espagnole, dont on saitl’impact sur la gendarmerie de la GrandeGuerre. Cité à deux reprises aux armées,il y avait été décoré de la Légiond’honneur.Ses deux carnets de campagne (1914-1915 et janvier-octobre 1916), de tout
petit format, se présentent comme unrécit au jour le jour de son serviceprévôtal, relaté au présent,vraisemblablement sur le vif. Ces carnetspersonnels, toutefois, font plus quedoubler le Journal des marches etopérations (Jmo) tenu parallèlement parAllard et conservé au château deVincennes. Leur auteur en effet, qui apourtant résolu de « se cuirasser contreles émotions » (p. 96), s’exprimebeaucoup plus largement sur desévénements dont le récit s’accompagnede ses impressions, parfois de ses étatsd’âme. on suit avec intérêt seshésitations au moment de permuter avecun camarade pour passer dans la zonedes étapes (p. 195-196), son jugementsur l’arbitraire du code de justice militaire(p. 138), sa mansuétude envers lesofficiers surpris durant leurs « sottisesnocturnes » (p. 119).
En somme, cette vision intériorisée, au rasdu terrain, du service prévôtal, où nemanquent ni le contact avec lesdéserteurs, ni le récit de la lutte contre lesespions ou des parades d’exécution, necherche pas l’objectivité, mais la fixationdu souvenir. Elle revêt donc une grandesincérité, plus suspecte dans les récitsreconstruits après-guerre.on regrettera donc d’autant plus que tantl’introduction – où Lélu et Vohl sontdevenus « Vélu » et « Kohl », et la division,une « décision » – que le texte établi parEmilie Giaime, ne soit pas toujours sûrs.Les patronymes sont remplacés par uneinitiale que ne justifie pas la loi sur lesarchives publiques et que les annexes (p.
1ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:02 Page164
165
237 à 241) rendent généralement transparentes. Le manque de familiarité avec lapériode, assumée p. 255, entraine également un grand nombre d’erreurs de détailsdans la transcription de carnets qu’on devine délicats à interpréter, mais dont larépétition finit par gêner la compréhension : ainsi rencontre-t-on « un chef de bataillond’infanterie colonel » [sic, pour coloniale, p. 77], les « lisiers » [lisières ?] du boisd’Hoéville (p. 80), les « soutiers [soutiens ?] d’infanterie » (p. 81), « l’attitude du tueur[tireur, p. 96] », etc.Sans doute pourrait-on faire également l’économie de notes inutiles, comme cetteinterprétation de l’expression, commune à tous les lecteurs d’Eugène Sue, d’une « viede juifs errants » (p. 181), ou cette curieuse explicitation des « élévations de service »matérialisées par les galons (p. 182), ou encore ce commentaire ambigu sur les « joyeuxbataillons de condamnés » croisés par Allard, quand il s’agit naturellement de « Batd’Af » (p. 189). Quant à l’illustration de couverture, elle représente non la gendarmeriede la Grande Guerre, mais un civil emmené par deux fantassins, vraisemblablement àl’occasion de l’une des grèves des années 1900. En lieu et place, des extraits dudossier de carrière de Jules Allard et de son Jmo, évoqué en introduction, auraientsans doute permis de mesurer la rigueur de ses carnets, mais aussi de mesurer ladistance maintenue entre l’écrit intime et sa version administrative.un dernier regret porte enfin sur le fait que le témoignage de Jules Allard ne soit jamaiscroisé avec celui du gendarme Brothier, son subordonné au sein de la prévôté de la18e DI, mais auquel le lecteur pourra se reporter dans l’édition qu’en ont donné EricKocher-marbeuf et raymond Azaïs en 2008.En définitive, le journal du capitaine Allard reste un document précieux pour l’histoire dela Grande Guerre. Sa découverte par Arlette Farge, qui suggère d’ailleurs d’autresdécouvertes possibles, est aussi un apport conséquent à l’histoire de la gendarmerie,dont chercheurs et amateurs lui sauront gré.Louis n. Panel
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
la formation de l’arme des carabiniersdans l’Italie de GiolittiLe livre de Flavio Carbone est issu de lathèse consacrée à la formation desofficiers de l’arme des carabiniers dansl’Italie de Giolitti qu’il a soutenu àl’université de la Sapienza de rome, sousla direction de Fabrizio Bellini et de Jean-noël Luc. Première pierre d’une histoireplus globale des officiers de carabiniers en
cours d’édification– l’auteur a publiédeux répertoiresbiographiques ducorps decommandementde cette arme auXIXe siècle – le
Flavio Carbone, Gliufficiali dei CarabinieriReali tra reclutamento eformazione (1883-1926),Catanzaro, Rubbettino,2013, 292 p.
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:02 Page165
BLOC NOTES
LIVrES, CoLLoQuES, mAnIFESTATIonS…
1661ertrimestre 2015 Revue de la Gendarmerie Nationale
volume fait aussi figure de pierre angulaire.Dans un volume ramassé, il parvient en effetà présenter l’histoire du recrutement et de laformation des officiers de l’arme descarabiniers sur un demi-siècle, des années1880 au début du fascisme. Le livre estconstruit en neuf brefs chapitreschronologiques, interrompus par d’utilesannexes présentées à l’issue des chapitre IVet IX, sans doute témoins de la divisioninitiale de l’ouvrage en deux parties. Sontainsi rendus directement disponibles lestextes réglementaires, le programme descours, les taux de réussite aux examens,mais aussi les budgets dédiés à la formation,auxquels le texte renvoie désormaislibrement. Auteur et éditeur n’ont pas faitl’impasse sur des tables et index quifacilitent grandement la recherche.L’introduction ravira le lecteur peut familierde l’histoire des carabiniers. En quelquespages (14-23) sont rappelés la fondation ducorps en 1814, sur les cendres du royaumenapoléonien d’Italie ; son rôle essentiel dansl’unification politique de l’Italie, parabsorption des polices locales ; lamultiplicité des formes d’engagement en1915-1918. Aussi la question centrale del’ouvrage se pose-t-elle d’elle-même : à quiconfier le commandement de ce corpsmilitaire dédié à la sûreté du jeuneroyaume ? Si les répertoires précitésapportent une réponse sociologique pour lesdécennies courant de la fondation du corpsau parachèvement de l’unité italienne, leprésent volume apporte, pour la période dela monarchie libérale, une réponse pluspolitique. L’usage, confortée par des lois de 1853 et
1861 (p. 27 et 34), est alors d’admettrechaque année dans le corps des officiers decarabiniers deux tiers de lieutenantsprovenant des armes de ligne, et un tiers demaréchaux des logis –le grade de sous-officier alors le plus élevé – nommés sous-lieutenants au choix.Dans le sillage de la grande loi de 1880 surla réorganisation de l’arme des Carabiniers,le général roissard de Bellet, bientôt nommécommandant en chef de son corps, en élèvela proportion à 50%. Face à l’afflux prévisibled’anciens sous-officiers, qui n’ont jamaisconnu que la « scuola di esperienza »,l’école du terrain, se pose alors la questionde la professionnalisation de leur formation.Ainsi est créé, en 1883, un cours prévuspour accueillir « les maréchaux des logisproposés pour le grade de sous-lieutenantde l’arme ». L’expérience ayant étéconcluante, le principe est formalisé etpérennisée en 1884 par la création à Turind’une école de sous-officiers « aspirants augrade de sous-lieutenant ». Transféré àrome l’année suivante, l’établissementprospère, et se restructure en 1907 pouraccueillir des candidats choisis surl’ensemble des gradés de carabiniers.Autant que les évolutions du schéma derecrutement et de formation, nettementsoulignées par la succession des textes, lemouvement des effectifs rend compte de lademande du gouvernement vis-à-vis de soncorps de police militaire. Alors que lapremière école ne compte que trois élèvesen 1883, l’effectif s’élève progressivementjusqu’à 25 aspirants de 1907 à 1910, pourrefluer progressivement jusqu’à huit à laveille de la Première Guerre mondiale, durant
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:02 Page166
167
laquelle il culmine, sous la pression exercée par les besoins des armées, à 44 en 1916.Sur le long terme, apparaît une tendance de fond de la monarchie libérale : permettrel’accession de jeunes soldats issus des classes moyennes jusqu’à des postesd’officiers supérieurs jadis majoritairement occupés par la noblesse, en insistant lesvaleurs et les mérites mis en avant à travers le plan de formation.Entretemps, l’établissement fait lui-même école à l’étranger, et tout particulièrement enFrance. Au-delà de ses grandes qualités intrinsèques, le livre de Flavio carbone est eneffet particulièrement précieux pour le lecteur désireux de mieux comprendre l’histoirede la gendarmerie nationale, tant l’évolution de la formation des officiers degendarmerie a suivi celle de leurs homologues transalpins.La création de l’école des« maréchaux des logis proposés pour le grade de sous-lieutenant » coïncide en effet avec celle des écoles de Saint-maixent, Versailles ouSaumur destinés à sélectionner, parmi les sous-officiers des diverses armes, de futursofficiers. Elle est en outre un modèle évident, quoique jamais évoqué dans les archives,pour le général mourlan lorsqu’il crée, en 1901, une « école des sous-officiers degendarmerie » au quartier Schomberg, laquelle forme, de 1901 à 1914, une quinzained’élèves-officiers par an parmi les maréchaux des logis et maréchaux des logis chefsdes légions de gendarmerie.Lorsqu’en 1907, l’école de rome est transformée en une « école des élèves-officiers decarabiniers », destinée cette fois à la promotion des brigadiers et maréchaux des logisau grade de sous-lieutenant, le général Quincy, inspecteur général de la gendarmerienationale et président de son comité technique, s’y rend en visite, à l’instar de seshomologues espagnols et chiliens. A la rentrée suivante, l’émule parisienne estrebaptisée « école des aspirants de gendarmerie », et il n’y a pas jusqu’à la courbe deses effectifs, de 1906 à 1917, qui ne suggère d’étroites comparaisons avec sa sœurainée italienne.outre l’apport décisif qu’elle représente pour l’histoire politique et sociale de lamonarchie libérale italienne, l’étude de Flavio Carbone est donc importante égalementpour l’histoire internationale des gendarmeries, et l’on ne peut qu’espérer unetraduction la rendant accessible à tous.Louis n. Panel
Revue de la Gendarmerie Nationale 1er trimestre 2015
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:02 Page167
DIRECTEUR DE lA PUblICATIONGénéral de brigade Didier BOLOT
RédactionDirecteur de la rédaction :
général d’armée (2S) Marc WATIN-AUGOUARD,directeur du centre de recherche de l’EoGn
Rédacteur en chef : colonel (Er) Philippe DURAND
Maquettiste PAO :major Carl GILLOT
COMITÉ DE RÉDACTIONGénéral de corps d’armée Richard LIzUREy,
major général de la gendarmerie nationaleGénéral de corps d’armée Alain GIORGIS,
commandant des écoles de la gendarmerie nationaleGénéral de brigade Didier BOLOT,
conseiller communication du directeur général de la gendarmerie nationale - chef du Sirpa-gendarmerie
Colonel Bernard CLOUzOT, cabinetColonel Laurent VIDAL,
directeur-adjoint au centre de recherche de l’EoGn
COMITÉ DE lECTUREGénéral d’armée Laurent MULLER,
inspecteur général des armées – gendarmerieGénéral de corps d’armée Richard LIzUREy
major général de la gendarmerie nationaleGénéral de corps d’armée Alain GIORGIS,
commandant des écoles de la gendarmerie nationaleGénéral de corps d’armée Michel PATTIN,
directeur des opérations et de l’emploiGénéral de brigade Didier BOLOT,
conseiller communication du directeur général de la gendarmerie nationale - chef du Sirpa-gendarmerie
Lieutenant-colonel Édouard EBEL,département gendarmerie
au sein du service historique de la DéfenseColonel Bernard CLOUzOT, cabinet
Message aux abonnés
La veille juridique de la gendarme-rie nationale et la revue du centre
de recherche de l’EoGn sontmaintenant consultables sur le site
internet du CrEoGnwww.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
crgn/publications
revue252V11.qxp_Mise en page 1 13/04/2015 12:02 Page168
Gestion des crises extérieuresles nouveaux théâtres d'opération comportent des contextescritiques : états faillis, transitions démocratiques difficiles ensortie de guerres civiles, etc. asymétriques, transfrontaliers, ilsmêlent des phases opérationnelles classiques à des opérationshumanitaires et civilo-militaires. les forces de police à statutmilitaire semblent, en partenariat étroit avec les forces arméesengagées et les autorités locales, être un moyen pertinent pourrestaurer l'ordre public et des conditions de vie acceptablespour les populations. l'exploration de leur mise en œuvre dansle cadre de mandats internationaux, de leur expressionlogistique et juridique éclaire une facette des conflitsmodernes.
LES GENDARMES DANS LA GRANDE GUERRE
RE
VU
E D
E L
A G
EN
DA
RM
ER
IE N
ATI
ON
ALE PORTRAIT > CNE Fontan,
héros malgré lui ?
N°
252
/ 1er
TRIM
ES
TRE
201
5
THÈME DU PROCHAIN DOSSIER
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
MUSÉE > La Grande Guerreau musée de la gendarmerie
INTERNATIONAL >Carabiniers 1915-1918
REVUEde la gendarmerie nationalerEvuE triMEstriEllE / Mars 2015 / n° 252 / prix 6 Euros
LE COMBAT DE LA ROUGEMARE
GENDARMES ET COMBATTANTS DU CIEL
GÉOPOLITIQUE DE LA GENDARMERIE AU LEVANT
Les gendarmes dans la grande guerre
avEc la collaboration du cEntrE dE rEcHErcHE dE l'écolE dEs oFFiciErs dE la GEndarMEriE nationalE
Edition spécialE réaliséE sous la dirEction dE louis n. panEl
COUV N°252.qxp_Mise en page 1 Copier 12 09/04/2015 11:08 Page1









































































































































































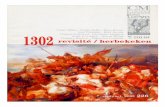
![[Dien Bien Phu, Military Casualties] Diên Bien Phu : les pertes militaires](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6313b9b385333559270c5e30/dien-bien-phu-military-casualties-dien-bien-phu-les-pertes-militaires.jpg)






![[Care of staphylococcal skin infections by doctors and nurses deployed in Guyana]. Prise en charge des infections cutanées staphylococciques par les médecins et infirmiers militaires](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6331e74983bb92fe9804268f/care-of-staphylococcal-skin-infections-by-doctors-and-nurses-deployed-in-guyana.jpg)


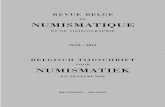




![Pierre-Ernest de Mansfeld et les ingénieurs militaires: la défense du territoire [2007]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633256718d2c463a5800d382/pierre-ernest-de-mansfeld-et-les-ingenieurs-militaires-la-defense-du-territoire.jpg)

