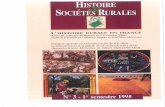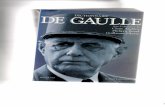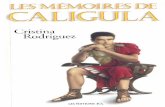La diplomatie en mémoires. Étude sur les mémoires de diplomates belges et suédois du e siècle
Transcript of La diplomatie en mémoires. Étude sur les mémoires de diplomates belges et suédois du e siècle
10
La diplomatie en mémoires. Étude sur les mémoires de diplomates
belges et suédois du xxe siècle
Michael Auwers et Nevra Biltekin Research Foundation Flanders (FWO) et Université de Stockholm
D ans une « note au lecteur » de ses très remarqués mémoires sur la fin de la guerre de Bosnie en 1995, le défunt représentant des États-Unis Richard
Holbrooke reconnaît sans fard que les mémoires de diplomates se situent fonda-mentalement « au délicat point nodal de la politique, d’une ambition et de l’his-toire ». Selon lui, cela est dû, d’une part, au besoin qu’éprouve l’auteur d’arranger des faits souvent contradictoires en de l’histoire logique. Logique, ou plutôt téléologique, car, comme il le dit si bien par ailleurs, les mémorialistes sont natu-rellement enclins à se montrer sous leur jour le plus avantageux : les hauts faits sont magnifiés, les erreurs passées sous silence 1. Cela expliquerait pourquoi les historiens et les politologues ont rarement considéré les mémoires diplomatiques comme de précieuses sources dans la connaissance des relations internationales. En outre, les quelques études consacrées à ce genre d’écrits ne s’y intéressent que pour les seules informations politiques fiables qu’ils peuvent receler. C’est-à-dire très peu, en vérité 2. Quant à la question des raisons qui ont poussé des diplomates
1. Richard Holbrooke, To End a War, New York, Modern Library, 1999, p. XVI-XVII.2. Zara Steiner, « The Diplomatic Life : Reflections on Selected British Diplomatic Mem-
oirs Written Before and After the Great War », dans George Egerton (dir.), 1994, Political Memoir : Essays on the Politics of Memory, Portland, Frank Cass, p. 167-187 ; Stefano Baldi et Pasquale Balducci, 2007, Through the Diplomatic Looking Glass. Books Published by Italian Diplomats since 1946, Malte, DiploFoundation, p. 23-31.
badel-001-416.indd 179 16/05/12 14:39
180
Écrivains et diplomates
à la retraite à écrire leurs mémoires, elle ne semble pas retenir l’attention des rares chercheurs travaillant dans ce secteur.
Et pourtant, cette question des raisons qui ont présidé à la rédaction de ces mémoires, nous semble très importante. Nous pensons effectivement qu’elles sont intimement liées à la nature et à l’évolution de la profession de diplomate tout au long du xxe siècle (et pourraient par là même aider à l’approfondisse-ment de notre connaissance de celle-ci). Nous montrerons que les processus de démocratisation politique à l’œuvre au début du xxe siècle et surtout après la Seconde Guerre mondiale ont fortement poussé des diplomates à prendre la plume pour la défense de leur profession. Pour y parvenir, ils ont été obligés de réinventer leur propre image, afin de l’accorder à un monde en mutation et à une opinion publique de plus en plus critique. Nous partons de l’idée selon laquelle l’écriture de mémoires diplomatiques, comme celle de n’importe quel autre récit autobiographique, doit être considérée comme une pratique cultu-relle et non comme une porte ouverte sur la vie intérieure de leur auteur. Il s’agit en réalité d’une exposition publique, dans laquelle ce dernier construit des images de lui-même et de la réalité 1. Comme nous le verrons par la suite, les diplomates y ont une fâcheuse tendance à forcer le côté héroïque de leur identité professionnelle.
La démarche de cet article est à la fois globale et singulière. Dans un premier temps, nous donnerons un bref aperçu des défis auxquels la profession diploma-tique aura dû faire face au cours du xxe siècle, puis, dans un deuxième temps, nous établirons un lien entre ces défis et les diverses raisons qui auront pu pousser des diplomates belges et suédois à écrire leurs mémoires. Il convient de noter que la Belgique et la Suède, contrairement à d’anciennes « grandes puissances » telles que la Grande-Bretagne ou la France, ne disposaient pas d’une longue tradition de diplomates écrivains mémorialistes. Avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, très rares ont été ceux qui ont publié les souvenirs de leur action sur la scène internationale 2. En revanche, dans l’après-guerre, plus d’une douzaine de Suédois ainsi qu’un nombre croissant de Belges ont commencé à porter l’histoire de leur carrière diplomatique à la connaissance d’un large public. Ces autobiographies
1. Arianne Baggerman et Rudolf Dekker, 2004, « “De gevaarlijkste van alle bronnen”. Egodo-cumenten : nieuwe wegen en perspectieven », Tijdschrift voor sociale en economische geschie-denis, n° 1, p. 3-22.
2. Pour la Belgique, voir Émile de Borchgrave, 1908, Souvenirs diplomatiques de quarante ans, 1863-1903, Bruxelles, Vromant & Cie ; Eugène-Napoléon Beyens, 1924-1926, Le Second Empire vu par un diplomate belge, 2 vol., Lille, Desclée de Brouwer ; 1927, « Une mission en Perse 1896-1898 », Revue générale, n° 60, p. 19-47, 157-182, 318-350 et 461-471 ; 1931, Deux Années à Berlin, 1912-1914, 2 vol., Paris, Plon ; 1934, Quatre Ans à Rome, 1921-1926, Paris, Plon ; Albert de Bassompierre, 1943, Dix-Huit Ans d’ambassade au Japon, Bruxelles, Libris. Pour la Suède, voir Einar af Wirsén, 1942, Minnen från fred och krig [Mémoires de paix et de guerre], Stockholm, Bonnier ; 1943, Från Balkan till Berlin [Des Balkans à Berlin], Stockholm, Bonnier.
badel-001-416.indd 180 16/05/12 14:39
La diplomatie en mémoires
181
professionnelles sont venues gonfler la vague des mémoires écrits par des diplo-mates de petits États 1.
De la diplomatie « traditionnelle » à une diplomatie « moderne »
Le début du xxe siècle a vu surgir d’importants changements dans la nature des relations internationales. L’extension du suffrage universel et l’essor des médias de masse ont incité les gouvernements occidentaux à se soucier de plus en plus d’une opinion publique désireuse de transparence et exigeant des comptes sur la conduite de la politique étrangère. C’est après la Grande Guerre que le système alors en place des relations internationales s’est révélé obsolète. L’idée s’est lar-gement répandue que les conspirations des diplomates avaient une grande part de responsabilité dans le déclenchement de la guerre. Et de nombreuses voix se sont élevées pour demander le remplacement de « la grande puissance », c’est-à-dire de la vieille diplomatie. Devait s’y substituer un nouveau genre de relations internationales, basé sur leur caractère public, l’ouverture et la coopération entre les nations et les peuples. Ce sont ces critiques mêmes qui ont poussé à la création de la Société des nations après la guerre et permis l’essor de la « diplomatie de conférences » dans les années vingt. Menaçant de les mettre sur la touche, ces bou-leversements ont profondément remis en cause le champ d’action des diplomates traditionnels 2.
Les enseignements de la Seconde Guerre mondiale ont permis d’accélérer les progrès amorcés dans l’entre-deux-guerres. C’est ainsi que d’anciens, mais égale-ment de nouveaux États ont rejoint les rangs d’organisations multilatérales telles que les Nations unies ou l’OCDE, et que la diplomatie de conférences s’est toujours plus institutionnalisée sous forme de sommets. En outre, alors que la plupart des diplomates étaient des généralistes, la diplomatie moderne avait besoin, de par sa croissante technicité, de spécialistes capables d’assister les dirigeants politiques dans leurs échanges internationaux. Si ces pressions « externes » étaient sans grande consé-quence pour les diplomates des petits États, il n’en allait pas de même avec l’exigence croissante de démocratisation administrative du corps diplomatique. On se deman-
1. Pour les Pays-Bas, voir Bob De Graaff, 2005, « Het belang van de anekdote in diplomatenme-moires voor de historische kennis van de buitenlandse dienst », disponible sur http ://www.mfa.nl/contents/pages/10569/diplomatenlezingbobdegraaff.doc. (consulté le 28 juin 2011) Pour la Norvège, voir Norsk Utenrikspolitisk Institutt, 2008, « Memoarer, intervjuer og biografier », disponible sur http://www.nupi.no/Arrangementer/NUPI-50-aar-i-2009/Norsk-Utenrikspolitisk-Bibliografi-1905-2005/Memoarer-intervjuer-og-biografier. (con-sulté le 28 juin 2011)
2. Keith Hamilton et Richard Langhorne, 2011, The Practice of Diplomacy. Its Evolution, Theory and Administration, Londres et New York, Routledge, p. 141-184 ; Matthew Smith Anderson, 1993, The Rise of Modern Diplomacy, 1454-1919, Harlow, Longman, p. 136-148.
badel-001-416.indd 181 16/05/12 14:39
182
Écrivains et diplomates
dait même ouvertement s’ils avaient encore une quelconque utilité dans ce monde moderne, étant donné que leur seule occupation semblait être d’assister à de somp-tueuses réceptions 1. Heureusement pour eux, la rédaction de mémoires leur offrait une occasion rêvée de s’expliquer et de défendre l’existence même de leur profession.
Les mémoires de diplomates belges
Des diplomates belges ont ainsi saisi cette opportunité. L’un des premiers fut le baron Eugène-Napoléon Beyens, considéré comme le « maître de la diplomatie belge 2 » dans les premières années du xxe siècle. Bien que représentant d’un pays dont la neutralité était de rigueur, Beyens, à l’aube de la Première Guerre mon-diale, répugnait encore à dire quoi que ce soit sur sa vie de diplomate. Comme bon nombre de ses pairs, il était convaincu que « les souvenirs des diplomates [appar-tenaient] exclusivement à l’Histoire et à leur éditeur 3 ». Cependant, conscient des changements survenus dans la culture politique internationale de l’après-guerre, il a finalement rédigé de nombreux mémoires, qui ont été publiés dans les années vingt et au début des années trente. On peut y sentir clairement son hostilité à l’égard de la médiatisation de la diplomatie, conséquence directe de l’émergence d’une opinion publique sur les sujets de politique étrangère 4. Ainsi, quand au début des années vingt, plusieurs articles de journaux dressent de son père, qui avait été à la tête de la légation belge à Paris trente ans plus tôt, un portrait d’anti-démocrate, le baron Beyens décide de raconter toute la carrière professionnelle de son père, vue à travers les yeux du jeune diplomate qu’il était alors 5. Dans l’intro-
1. Keith Hamilton et Richard Langhorne, op. cit., p. 185-271 ; Brian Hocking et David Spence (dir.), 2005, Foreign Ministries in the European Union : Integrating Diplomats, Bas-ingstoke, Palgrave Macmillan, p. 1.
2. Voir par exemple Jacques Davignon, 1951, Berlin 1936-1940. Souvenirs d’une mission, Bruxelles et Paris, Éditions Universitaires, p. 171. Une biographie critique du baron Beyens reste encore à écrire. Cependant, sa carrière a été glorifiée dans de nombreuses publica-tions : voir Fernand Vanlangenhove, 1968, « Beyens », Biographie nationale, Bruxelles, Aca-démie royale de Belgique, n° 34, p. 71-79 ; Monseigneur Schyrgens, « Le baron Beyens », Revue générale, 15 octobre 1934, p. 385-415 ; Jules Cambon, « Le baron Beyens », Revue des deux mondes, 1er février 1934, p. 624-634 ; Henri Carton de Wiart, 1936, « Notice sur le baron Beyens, membre de l’Académie », Annuaire de l’Académie royale de Belgique, n° 12, p. 61-103. Pour un compte rendu fidèle des activités du baron Beyens en tant que ministre des Affaires étrangères pendant la Première Guerre mondiale, voir Michael F. Palo, 2000, « The Question of Neutrality and Belgium’s Security Dilemma during the First World War. The Search for a Politically Acceptable Solution », Revue belge d’histoire contemporaine, n° 1-2, p. 227-304.
3. Citation du baron Beyens dans Firmin Van den Bosch, Le Petit Lézard sous le rocher, 1916 [manuscrit non publié, détenu par M. Baudouin Houtart]. Michael Auwers remercie le baron Henri Beyens de lui avoir fourni cette référence.
4. Huub Wijfjes, « Introduction. Mediatization of Politics in History », dans Huub Wijfes et Gerrit Voerman (dir.), 2009, Mediatization of Politics in History, Louvain, Peeters, p. IX-XXII.
5. Voir par exemple Maurice des Ombiaux [pseudonyme de Jules Renkin], 1920, « La léga-tion belge de Paris », L’Horizon (politique, économique et littéraire), 29 mai.
badel-001-416.indd 182 16/05/12 14:39
La diplomatie en mémoires
183
duction de ses mémoires en deux volumes, il rejette catégoriquement les critiques portées à l’encontre de son père :
Quelques publicistes belges qui ont parlé de lui dans des chroniques de journaux semblent l’avoir considéré comme un diplomate de salon, préoccupé du person-nage mondain qu’il avait à jouer […] plutôt que de son métier d’informateur politique. Qu’on lise […] ses rapports, on reconnaîtra que ses obligations de société ne l’empêchaient pas de noter avec une rare sagacité les incidents qui se succédaient sous ses yeux et d’en peser les conséquences dans de longues et fréquentes dépêches. Il passait à les rédiger une partie de ses nuits 1.
La démocratisation de la politique internationale, consécutive à l’établissement de la SDN et au développement de la diplomatie de conférences, semble aussi avoir contrarié Beyens, car ces deux institutions avaient considérablement affaibli l’in-fluence des diplomates traditionnels et réduit leur champ d’action. Il exprima toute sa consternation dans la conclusion de ses mémoires de 1934, Quatre Ans à Rome :
Pour stabiliser la paix on a eu recours à des conférences périodiques et à la Société des nations. Les conférences se multiplient, où siègent des chefs de gouvernement et des hommes politiques, mais où les diplomates brillent par leur absence. Leurs discussions sont radiodiffusées pêle-mêle avec les dernières nouvelles du jour et les airs à succès des chanteurs à la mode. C’est la diplomatie au grand jour, la diplo-matie de la place publique. […] Ces dangereux moyens de pacifier l’Europe n’ont eu d’autre résultat que d’envenimer les controverses et d’irriter tous les esprits 2.
La mort du baron Beyens survint cinq ans avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Il n’eut donc pas à connaître les défis plus grands encore qu’allait affronter la profession diplomatique dans l’après-guerre. Ajouté à la réserve à laquelle était tenu l’agent d’un pays neutre, cela aurait pu constituer une raison supplémentaire pour plaider secrètement en faveur du maintien de la diplomatie traditionnelle.
Les auteurs de mémoires belges qui l’ont suivi ont défendu leur métier beau-coup plus ouvertement. À la fin de ses Souvenirs d’un diplomate, publiés en 1983, le baron Freddy Cogels fait remarquer que « la carrière diplomatique ne consiste pas seulement à manger des gâteaux avec les duchesses 3 ». Au contraire, selon Cogels, les diplomates travaillaient extrêmement dur, et les vertus de leur polyva-lence étaient plus précieuses que jamais. Clairement contrarié par la méconnais-sance du public concernant la profession diplomatique, Cogels explique que les diplomates ne partageaient pas leur temps entre espionnage et mondanités. Ils étaient, tout au contraire, très bien servis par leurs compétences généralistes et faisaient tout leur possible pour bien disposer les dirigeants des pays où ils étaient en poste, ils défendaient avec habileté les intérêts économiques et commerciaux de
1. Baron Beyens, Le Second Empire, op. cit., vol. 1, p. 7-8.2. Baron Beyens, Quatre Ans à Rome, op. cit., p. 299-300.3. Freddy Cogels, 1983, Souvenirs d’un diplomate. Du gâteau chez les Duchesses ?, Bruxelles,
Hervé Douxchamps, p. 301.
badel-001-416.indd 183 16/05/12 14:39
184
Écrivains et diplomates
leur pays, et ils transmettaient en continu à leur gouvernement des informations politiques fiables. Et si l’opinion publique en venait à penser que les avancées en matière de transport permettaient aux hommes politiques de résoudre des ques-tions d’ordre diplomatique sans l’assistance des diplomates, Cogels se devait de faire observer : « Il faut hélas déplorer de nombreux cas où nos politiciens arrivent en trombe dans un pays étranger et, en quarante-huit heures, y accumulent tant de gaffes que les diplomates doivent ensuite, patiemment, en réparer les dégâts 1. »
Bien que rarement exprimées avec autant de franchise, des affirmations telles que celles-ci occupent une place de choix dans les textes et notamment dans les conclusions de la plupart des mémoires diplomatique 2. Elles tendent toutes à convaincre que « “l’Internationale de la Carrière” présente encore une utilité évi-dente 3 ». L’évidence de cette utilité réside précisément dans sa légitimité démo-cratique ou dans le fait que, selon les termes d’un autre diplomate belge, « la carrière diplomatique […] s’est adaptée à un monde […] plus égalitaire 4 ». Pour emporter l’adhésion de leurs lecteurs, les diplomates se voient donc obligés, dans leurs mémoires, de montrer leur profession sous un jour qui justifierait ces apolo-gies. Mais pourquoi en sont-ils arrivés là ?
Afin de répondre à cette question, nous devons en appeler à l’anthropologue et politologue norvégien Iver Neumann. Selon ce dernier, être un diplomate consiste à jongler constamment avec trois figures contradictoires du moi. Il y a d’abord la figure « bureaucratique », selon laquelle le diplomate doit veiller au bon déroulement des affaires courantes de l’ambassade. Vient ensuite la figure du « médiateur effacé », qui exige de lui qu’il oublie ses ambitions personnelles et accorde la politique étrangère de son gouvernement à celle du pays où il est en poste. Enfin, la figure « héroïque » autorise tout de même le diplomate à s’illustrer en laissant son empreinte dans ce monde, pour son propre bien comme pour celui de la société. Pour Neumann, le héros est le « diplomate de terrain », capable d’« établir de nouvelles bases dans les conditions les plus défavorables, de s’engager dans une mission d’enquête particuliè-rement délicate, ou de préparer et réussir un fait accompli dans un cadre politique 5 ».
1. Ibid., p. 302.2. Voir aussi Jacques Davignon, Berlin 1936-1940, op. cit., p. 14, 69, 109, 203 et 255 ; Jacques
Groothaert, 1991, Le Passage du témoin, Paris et Louvain-la-Neuve, Duculot, p. 222-223 ; Luc Putman, 1994, Van Kinshasa tot Moskou. Herinneringen van een ambassadeur [De Kins-hasa à Moscou. Souvenirs d’un ambassadeur], Sint Martens-Latem, Aurelia Books, p. 418.
3. Marcel-Henri Jaspar, 1972, Changements de décors, souvenirs sans retouche : Londres, Prague, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Paris, Fayard, p. 248.
4. Jacques de Thier, 1990, Un diplomate au XXe siècle, Bruxelles, Le Cri, p. 173.5. Iver B. Neumann, 2005, « To be a Diplomat », International Studies Perspectives, n° 6, 1,
p. 72-93 (p. 73). Neumann a tiré ces trois figures de l’œuvre du philosophe canadien Charles Taylor, qui distinguait deux conduites adoptées par les Occidentaux. La première conduite concerne la décence dans la vie de tous les jours, la deuxième les faits sortant de l’ordinaire. Selon Neumann, pour comprendre ce que signifie être diplomate, il faut comprendre ce que signifie être occidental, puisque la diplomatie est essentielle à l’his-toire occidentale. Voir également James Der Derian, 1987, On Diplomacy : a Genealogy of Western Estrangement, Oxford, Blackwell.
badel-001-416.indd 184 16/05/12 14:39
La diplomatie en mémoires
185
Dans les mémoires diplomatiques belges, cette figure vient supplanter les deux autres. Cela est particulièrement vrai pour les diplomates ayant été en poste dans des régimes totalitaires. Selon un ancien conseiller en poste à Moscou sous Staline, « la peur était dans l’air que nous respirions et s’installait même chez les diplo-mates que nous étions 1 ». L’ambassadeur belge en Allemagne nazie semblait fier, en tant que représentant d’un petit État dans un régime hostile aux diplomates, des louanges de ses collègues qui le considéraient comme « la gazette de l’endroit », l’homme qui était au courant de tout. Ce même diplomate, en conclusion de ses mémoires, se demande s’il est indispensable d’envoyer un ambassadeur dans un régime totalitaire, étant donné les épreuves qu’il lui faut surmonter. « Bien évi-demment », répond-il, car « cette difficulté exalte le diplomate 2 ». Son ancienne secrétaire, qui publia ces mémoires presque quarante ans plus tard, aurait certaine-ment approuvé. Il alla même jusqu’à affirmer que cette bataille de tous les instants faisait des diplomates la « cible de certains terroristes » et que « plusieurs ont été assassinés », mais que cela n’enlevait rien à l’attrait de la profession 3. Un véritable héros diplomatique ne saurait être découragé par les aléas et les rebondissements de la politique internationale.
Mais les diplomates ayant fait carrière dans des régimes moins autoritaires revendiquent eux aussi leur part d’héroïsme. Le baron Cogels s’est félicité, dans ses mémoires, d’avoir été celui qui (et non le prince belge, contrairement à ce qu’avaient laissé croire les médias) avait réussi à convaincre l’empereur du Japon de faire de la Belgique sa première destination lors de sa venue en Europe. La seule reconnaissance dont il s’était satisfait 4, selon lui, était cette discrète petite tape qu’il avait reçue du frère de l’empereur. Cependant, après avoir lu de nom-breuses petites histoires similaires, le lecteur se doit forcément d’admettre que l’au-teur, comme nombre de ses pairs, semble remettre les choses à leur juste place. Après s’être effacés tout au long de leur carrière, après avoir laissé les honneurs aux hommes politiques, les diplomates rétablissent la vérité dans leurs mémoires, où ils s’attribuent enfin les mérites de leurs réussites 5. Non sans vanité, il va sans dire, mais les lecteurs se rendent ainsi compte qu’ils sont indispensables au bon fonctionnement de la politique internationale.
Les mémoires diplomatiques suédois
En Suède, Einar af Wirsén fut l’un des rares diplomates à avoir publié ses mémoires avant les années cinquante. Il en fit paraître les deux volumes en 1942
1. Harold Eeman, 1977, Inside Stalin’s Russia : Memories of a Diplomat, 1936-1941, London, R. Hale, p. 45.
2. Jacques Davignon, Berlin 1936-1940, op. cit., p. 70 et 255.3. Jacques Davignon, Un diplomate au XXe siècle, op. cit., p. 51 et 172-173.4. Freddy Cogels, Souvenirs d’un diplomate, op. cit., p. 297-298.5. Ce qui signifiait parfois régler des comptes avec les dirigeants politiques. Voir Jan Hollants
van Loocke, 1999, De la colonie à la diplomatie. Une carrière en toutes latitudes, Paris, L’Har-mattan, p. 295-298 et 331-332.
badel-001-416.indd 185 16/05/12 14:39
186
Écrivains et diplomates
et 1943 et centra son récit sur ses impressions de la Première Guerre mondiale et ses observations sur les pays où il avait été en poste. En tant que témoin, et quelquefois médiateur, Wirsén avait recueilli des informations de première main sur les guerres, les révolutions et les conflits internationaux 1. Ce qui le poussa à publier non seulement ses mémoires, mais aussi d’autres ouvrages sur des person-nalités et des lieux dont il avait une connaissance approfondie 2. Cependant, tout comme Beyens, son intention n’était pas de défendre ou d’expliquer ouvertement sa profession. À l’inverse, les diplomates suédois qui ont publié leurs mémoires après la Seconde Guerre mondiale, ont parlé plus librement de leur volonté de montrer toute l’importance de la profession et de leur rôle de diplomate.
L’un d’entre eux, Wilhelm Wachtmeister, dans l’introduction à son ouvrage Comme je l’ai vu. Faits et personnages de la scène internationale, annonce qu’il focalisera son exposé sur les aspects personnels de sa carrière professionnelle. Il était persuadé que ses écrits pouvaient présenter un intérêt historique, culturel et social. Selon lui, les mémoires pouvaient fournir des informations subjectives d’une grande valeur à la recherche historique 3. Le peu de fois où Wachtmeister eut des propos de nature privée, il ne révéla rien qui pût aller à l’encontre de la politique du gouvernement suédois. Il insistait d’ailleurs sur le fait qu’il apparte-nait à un corps apolitique dont l’esprit de service public était très fort 4. Alströmer, l’un des collègues de Wachtmeister, affirma dans ses mémoires qu’il avait voyagé dans le monde entier et qu’il avait pu voir de près certains acteurs des événements qui avaient marqué l’Histoire. Alströmer espérait que ses observations personnelles et ses écrits sur les événements mondiaux et les puissants susciteraient l’intérêt d’un plus large public 5. D’une manière similaire, le secrétaire d’État aux Affaires étrangères suédois discuta, entre 1938 et 1945, de l’importance de ses observa-tions personnelles sur la Seconde Guerre mondiale. « Sans vouloir être prétentieux, j’ai été l’un des seuls à avoir rempli tous les rôles diplomatiques possibles et ima-ginables », a-t-il déclaré. Il pensait donc utile de faire part de ses impressions pour l’instruction des générations futures. Boheman, quant à lui, essaya d’être plus modeste, quand il déclara que son intention n’était pas de raconter l’histoire de la Suède, car cela aurait voulu dire qu’il avait une haute opinion de lui-même. De plus, son récit était loin d’être objectif. Malgré tout, le lecteur constate que Boheman était persuadé de communiquer au grand public des informations de la
1. Einar af Wirsén, Minnen från fred och krig, op. cit., et Från Balkan till Berlin, op. cit.2. Wirsén, 1909, a, par exemple, publié des ouvrages sur les Balkans, la Russie et la Finlande :
Balkanfolken och stormakterna : historiskt politiska orientstudier [Les habitants des Balkans et les grands pouvoirs : études politico-historiques de l’Orient], Uppsala, Akademiska bokförlag ; 1942, Funderingar om Ryssland [Pensées de Russie], Göteborg ; 1943, Ryska problem [La Question russe], Stockholm, Bonnier ; 1942, Finlands framtid [L’Avenir de la Finlande], Stockholm, Inapress.
3. Wilhelm Wachtmeister, 1996, Som jag såg det : händelser och människor på världsscenen [Comme je l’ai vu. Faits et personnages de la scène internationale], Stockholm, Norstedt, p. 9.
4. Ibid., p. 329.5. Jonas Magnus Alströmer, 1951, Diplomatminnen från tio huvudstäder 1908-1933
[Mémoires diplomatiques de dix capitales, 1908-1933], Stockholm, Hökerbergs, p. 6.
badel-001-416.indd 186 16/05/12 14:39
La diplomatie en mémoires
187
plus haute importance 1. Il devient clair, à travers ces exemples, que les écrivains diplomates suédois ont précisé qu’ils faisaient part d’une expérience personnelle de leur carrière. Mais qu’est-ce que cela peut-il bien vouloir dire ? Afin de répondre à cette question, nous citerons à nouveau Neumann sur ce que signifie être un diplomate.
Selon lui, les diplomates font la distinction entre ce qui est privé, personnel et public. Ils recourent à cette tripartition dans la représentation du moi diplo-matique. Public fait référence à la politique d’État officielle, tandis que personnel renvoie à ce qui ne ressortit pas spécifiquement à la ligne officielle. Privé signifie quelque chose de complètement différent, par rapport au public et au personnel. Pour illustrer cela, Neumann s’est aperçu que les mémoires diplomatiques nor-végiens ne contenaient que très peu d’informations d’ordre privé, c’est-à-dire des informations qui ne seraient pas en accord avec la politique officielle de l’État. De plus, lorsque l’on demandait aux diplomates au cours d’interviews quelle était leur opinion privée, ils éludaient la question et parlaient de leur point de vue per-sonnel. Un bon diplomate sait en effet gérer ce genre de distinctions 2. Comme dans le cas belge, les diplomates suédois ont eux aussi dépeint la figure héroïque dans leurs mémoires. Cela devient particulièrement clair au lecteur dans la façon qu’ils ont eue de gérer la relation entre le public, le personnel et le privé. En accord avec l’étude de Neumann, il semblerait que les diplomates suédois n’aient abso-lument rien écrit de nature privée. En revanche, ils se sont longuement exprimés dans leurs mémoires sur les raisons pour lesquelles leurs expériences personnelles faisaient d’eux des héros. Ils purent par conséquent indiquer dans leurs introduc-tions respectives qu’« ils avaient assisté aux événements politiques » et avaient eu « des informations historiques de première main ».
Bien que de façon plus subtile, la figure héroïque apparaît également sous d’autres formes. Ainsi, après avoir expliqué pourquoi leurs récits personnels devaient être publiés, les mémorialistes suédois en ont profité pour défendre leur profession et expliquer leur rôle exact. Wachtmeister, par exemple, trouvait que la description que faisaient les médias des ambassadeurs, assistant à d’élégantes récep-tions sur le dos des contribuables, était exagérée. Le lecteur devait être conscient que l’aptitude à entrer en relations avec autrui dans un cadre informel était l’une des nombreuses qualités requises pour « faire des affaires », c’est-à-dire négocier 3. Le diplomate Gunnar Hägglöf déclara, dans l’un de ses nombreux ouvrages auto-biographiques, qu’en tant qu’ambassadeur à Londres, il avait effectué plus de trois cents visites mondaines en une seule année. Il ne s’agissait pas toujours d’une partie de plaisir, car c’était parfois difficile mais cependant toujours indispen-sable pour l’accomplissement de sa tâche 4. Ainsi Wachtmeister défendait-il ces
1. Erik Boheman, 1964, På vakt. från attaché till sändebud : Minnesanteckningar [En poste, d’attaché à ambassadeur. Notes], Stockholm, Norstedt, p. 7-10.
2. Iver B. Neumann, « To be a diplomat », op. cit., p. 73-74 et 91.3. Wilhelm Wachtmeister, Som jag såg det, op. cit., p. 266.4. Gunnar Hägglöf, 1975, Minnen inför framtiden : 1961-1971 [Mémoires du futur : 1961-
1971], Stockholm, Norstedt, p. 140.
badel-001-416.indd 187 16/05/12 14:39
188
Écrivains et diplomates
qualités dites générales, et Hägglöf mettait l’accent sur les difficultés de la vie sociale diplomatique. Les diplomates ne se mouvaient pas uniquement dans un milieu luxueux, ils étaient également des hommes de terrain dévoués.
De plus, les diplomates mémorialistes ont insisté sur la nature changeante de leur profession et de la diplomatie. Le diplomate travailleur savait aussi s’adapter. Carl Henrik von Platen dédia la dernière section de son ouvrage à la diplomatie « moderne ». Après la Seconde Guerre mondiale, ses fonctions exigeaient des com-pétences techniques et une capacité à employer des techniques de négociation « modernes ». En tant que diplomate, il était partie prenante de ces changements. Et, afin de le montrer au lecteur, il énuméra toutes les tâches internationales qui lui avaient été confiées. Platen croyait que ces missions lui avaient été confiées non pas parce que ses compétences étaient appréciées, mais plutôt parce qu’il représentait un petit pays neutre, inoffensif et à la bonne réputation. Mais il finit tout de même par dire que son travail lui avait procuré une grande satisfac-tion 1. Avoir fait partie de la profession pendant plusieurs décennies signifiait que les diplomates disposaient d’informations de première main sur son évolution. Boheman consacra un chapitre entier de son ouvrage au corps diplomatique, qui déjà pendant l’entre-deux-guerres avait inauguré un processus de démocratisation en élargissant son système de recrutement, désormais ouvert à d’autres classes que l’aristocratie 2. Platen et Boheman voulaient convaincre leurs lecteurs que le corps diplomatique suédois s’était adapté avec succès à la diplomatie moderne. Mais ils n’ont pas été les seuls à vouloir le faire. D’autres auteurs ont publié des mémoires portant des titres ambitieux tels qu’Une vie entre guerre et paix : les mémoires d’un diplomate, Instants de vie : un quart de siècle au service des Affaires étrangères, ou encore, La Suède dans la cour des grands : le reflet de quarante années passées au service des Affaires étrangères, qui indiquaient bien qu’ils avaient eux aussi vu la profession évoluer au fil des ans 3.
Les diplomates suédois mettaient en avant leur expérience personnelle des évé-nements mondiaux et montraient à quel point ils avaient travaillé sans relâche pour servir leur pays. Ils se sont également penchés sur les profonds changements qu’ont connus la profession et la diplomatie en général au cours du xxe siècle. Ils avaient le sentiment d’avoir très certainement marqué de leur empreinte le cours de l’Histoire, quelquefois en tant que simples observateurs ou témoins et quelque-fois en tant que médiateurs. Ces récits sont venus compléter les histoires héroïques déjà connues de certains intermédiaires tels que Folke Bernadotte, Raoul Wallen-
1. Carl Henrik von Platen, 1986, Strängt förtroligt [Strictement confidentiel], Stockholm, Nor-stedt, p. 204-214.
2. Erik Boheman, På vakt, op. cit., p. 123-138.3. Tord Hagen, 2000, Ett liv i krig och fred : en diplomats minnen [Une vie entre guerre et paix :
les mémoires d’un diplomate], Stockholm, Carlsson ; Sverker Åström, 2003, Ögonblick : från ett halvsekel i UD-tjänst [Instants de vie : un quart de siècle au service des Affaires étrangères], Stockholm, Lind & Co ; Lennart Petri, 1996, Sverige i stora världen : minnen och reflexioner från 40 års diplomattjänst [La Suède dans la cour des grands : le reflet de quarante années pas-sées au service des Affaires étrangères], Stockholm, Atlantis.
badel-001-416.indd 188 16/05/12 14:39
La diplomatie en mémoires
189
berg ou Dag Hammarskjöld 1. Ensemble, ils ont composé le plus beau tableau de la politique étrangère suédoise : un petit État neutre promouvant la démocratie et la paix au travers d’un corps diplomatique apolitique. Les modestes contributions de diplomates individuels ont également signifié de petites victoires sur le terrain. Dans le cas suédois, la figure du médiateur effacé était alors quelquefois intime-ment liée à la figure héroïque, et le moyen qu’ont trouvé les diplomates suédois pour informer le public de leurs contributions et de leurs expériences a été de publier des mémoires. Mais aussi, comme dans le cas belge, et non sans préten-tion, ils estimaient qu’ils avaient de solides arguments à faire valoir pour que leurs histoires héroïques personnelles intéressent et recueillent l’approbation du plus large public, et servent un idéal démocratique.
Conclusion
Selon l’historien George Egerton, la rédaction des mémoires a, tout au long de l’Histoire, généralement tenu à la réunion de trois conditions : « la survenue d’événements dramatiques tels qu’une guerre ou une révolution ; le désir des par-ticipants ou des témoins de laisser une trace de leur vécu de ces événements ; et la disposition du loisir nécessaire à la production de ces écrits 2 ». La multiplication des mémoires diplomatiques en Belgique et en Suède au cours du xxe siècle cor-robore tout à fait cette analyse. Effectivement, la plupart des mémorialistes ont vécu de près des guerres et des révolutions, mais la profonde démocratisation de la profession diplomatique à laquelle ils ont assisté au fil de leur carrière pouvait éga-lement être considérée comme un événement dramatique. « La diplomatie n’a plus jamais été tout à fait ce qu’elle avait été », comme le reconnaissaient très justement Keith Hamilton et Richard Langhorne, et le « monde perçu par un diplomate à la fin de sa carrière est voué à être complètement différent de celui qu’il a connu… en tant qu’attaché 3 ». Ensuite, alors que la démocratisation poussait l’opinion à critiquer les diplomates, le genre des mémoires diplomatiques leur fournissait le moyen de répondre à ces critiques. Enfin, les diplomates à la retraite disposaient de suffisamment de loisir pour exposer en long et en large en quoi consistait leur profession. Ils pouvaient y donner les raisons pour lesquelles leurs expériences per-sonnelles méritaient de retenir l’attention d’un large public et prouver en quoi leur profession était encore utile. Ainsi, les mémoires offraient une excellente occa-sion aux diplomates de construire « démocratiquement » de nouvelles images de
1. Folke Bernadotte œuvra à la libération de milliers de prisonniers des camps de concentra-tion pendant la Seconde Guerre mondiale. Raoul Wallenberg réussit à soustraire à l’Holo-causte de nombreux Juifs de Hongrie. Pour un aperçu de son action, se reporter à l’étude de Tanja Schult, 2009, A Hero’s Many Faces : Raoul Wallenberg in Contemporary Monuments, Basingstoke, Palgrave Macmillan. Dag Hammarskjöld, secrétaire général des Nations unies, s’est vu décerner le prix Nobel de la Paix pour ses œuvres. Il publia ses mémoires en 1963 : Vägmärken [Évaluations], Stockholm, Bonnier.
2. George Egerton, « Introduction », Political Memoir, op. cit., p. XV.3. Keith Hamilton et Richard Langhorne, The Practice of Diplomacy, op. cit., p. 93.
badel-001-416.indd 189 16/05/12 14:39
leur profession, même si, pour accroître leur crédibilité, ils devaient se présenter comme des héros.
Si nous comparons nos deux cas, il semble pourtant que les diplomates belges et suédois tendent à incarner cette figure héroïque de façon quelque peu diffé-rente. Les mémorialistes belges donnent plus d’importance à leur influence dans la politique internationale ; ils veulent convaincre l’opinion qu’ils y ont pris une part active, que ce sont eux qui ont « fait » l’Histoire 1. Cela expliquerait leur anta-gonisme vis-à-vis de leurs dirigeants politiques. Les diplomates suédois, quant à eux, semblent penser que le simple fait d’avoir été des spectateurs privilégiés des événements politiques internationaux fait d’eux des héros. C’est peut-être la raison pour laquelle ils ont une position apolitique et donc plus modérée. Selon eux, la valeur ajoutée de leurs mémoires réside dans leur récit personnel des évé-nements, ou – pour citer à nouveau Neumann – dans cette part d’eux-mêmes qu’ils ont effacée pendant leur carrière. Car, en fin de compte, qu’y a-t-il de plus héroïque qu’un médiateur de l’ombre ?
Dans cet article, nous avons tenté de savoir pourquoi les représentants à l’étranger de deux petits États, à savoir des diplomates belges et suédois, avaient écrit leurs mémoires tout au long du xxe siècle. Nous sommes parfaitement conscients qu’en pointant les conséquences de la démocratisation et la profession-nalisation de la carrière diplomatique, nous n’avons été capables que d’apporter un élément de réponse. Il reste encore beaucoup à faire dans la recherche sur les mémoires diplomatiques. Par exemple, comment expliquer l’apparition relative-ment tardive des premiers mémoires diplomatiques belges et suédois, comparati-vement aux traditions beaucoup plus anciennes des « grandes puissances » ? Cette évolution est-elle liée à ce qui pourrait être défini comme la « démocratisation de l’État », qui s’est amplifiée après la Première et plus particulièrement après la Seconde Guerre mondiale ? Ce développement a permis aux diplomates de petits États de participer plus activement aux tractations internationales et leur a éga-lement donné des raisons valables d’écrire leur propre histoire professionnelle. Beaucoup d’entre eux ont alors pressenti que leur expérience pouvait susciter l’in-térêt général, puisqu’eux aussi avaient pris part aux événements mondiaux.
1. Le journaliste Manu Ruy est très explicite dans le quatrième de couverture de Putman, Van Kinshasa tot Moskou : « Quoi qu’il en soit, Putman n’est jamais un figurant, mais toujours un participant et un témoin actif. »
badel-001-416.indd 190 16/05/12 14:39