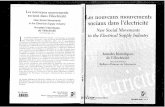La diplomatie henricienne et les ambitions françaises de suprématie temporelle sur la république...
Transcript of La diplomatie henricienne et les ambitions françaises de suprématie temporelle sur la république...
Sylvio Hermann De Franceschi
La diplomatie henricienne et les ambitions françaises desuprématie temporelle sur la république chrétienneIn: Histoire, économie et société. 2004, 23e année, n°4. Etat et administrateurs de rang moyen à l'époque moderne.pp. 551-585.
AbstractA favourite assumption of the french historian Alphonse Dupront is the idea that the death of Christendom is a crucial element ofeuropean modernity. The present work, based on an interpretation of the diplomatic dispatches of Philippe Canaye de Fresnes,the french ambassador in Venice during the Venetian Interdict (1606-1607), deals with the survival of the idea of Christendom atthe beginning of the 17th century. Through the letters of Canaye de Fresnes, one can see that a catholic but antiromanist use ofthe conceipt of Christendom seems possible.
RésuméUne des thèses les plus importantes de l'historien français Alphonse Dupront affirme que la mort de la Chrétienté est un élémentcrucial de la modernité européenne. Le présent article, fondé sur une interprétation de la correspondance diplomatique dePhilippe Canaye de Fresnes, ambassadeur de France à Venise durant l'Interdit vénitien (1606-1607), étudie la survie de l'idée deChrétienté au début du XVIIe siècle. À travers les lettres de Canaye de Fresnes, on peut voir qu'un usage catholique maisantiromain du concept de Chrétienté semble possible.
Citer ce document / Cite this document :
De Franceschi Sylvio Hermann. La diplomatie henricienne et les ambitions françaises de suprématie temporelle sur larépublique chrétienne. In: Histoire, économie et société. 2004, 23e année, n°4. Etat et administrateurs de rang moyen àl'époque moderne. pp. 551-585.
doi : 10.3406/hes.2004.2444
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hes_0752-5702_2004_num_23_4_2444
La diplomatie henricienne et les ambitions
françaises de suprématie temporelle
sur la république chrétienne
par Sylvio Hermann DE FRANCESCHI
Résumé Une des thèses les plus importantes de l'historien français Alphonse Dupront affirme que la
mort de la Chrétienté est un élément crucial de la modernité européenne. Le présent article, fondé sur une interprétation de la correspondance diplomatique de Philippe Canaye de Fresnes, ambassadeur de France à Venise durant l'Interdit vénitien (1606-1607), étudie la survie de l'idée de Chrétienté au début du XVIIe siècle. À travers les lettres de Canaye de Fresnes, on peut voir qu'un usage catholique mais antiromain du concept de Chrétienté semble possible.
Abstract A favourite assumption of the french historian Alphonse Dupront is the idea that the death of
Christendom is a crucial element of european modernity. The present work, based on an interpretation of the diplomatic dispatches of Philippe Canaye de Fresnes, the french ambassador in Venice during the Venetian Interdict (1606-1607), deals with the survival of the idea of Christendom at the beginning of the 17th century. Through the letters of Canaye de Fresnes, one can see that a catholic but antiromanist use of the conceipt of Christendom seems possible.
De définition fuyante, parce qu'elle signifie primordialement espace de conscience religieuse dont l'étendue est sans cesse à déployer, à défendre et à consolider, pour toujours mouvante et à jamais insaisissable, l'idée de Christianitas semble échapper irrésistiblement à autre analyse qu'extrinsèque: hors la Chrétienté, l'Infidèle; hors l'Infidèle, la Chrétienté. Idéal à réaliser plutôt que notion a posteriori réifiante: ce qui est entendu par Christianitas est essentiellement projet d'action temporelle dans un cadre confessionnel unifié, qui est devenu -ainsi que l'ont indiqué les travaux de Daniele Menozzi l - définitivement mythe au XIXe siècle. Irréelle, la Chrétienté, mais
1. Voir D. Menozzi, «Intorno aile origini del mito délia cristianità», Cristianesimo nella storia, V, 1984, p. 523-564; idem, dans G. Chittolini (dir.), «Tra riforma e restaurazione. Dalla crisi délia società cristiana al mito délia cristianità medievale (1758-1848)», Storia d'Italia, Annali IX, La Chiesa e il potere politico, Turin, 1986, p. 767-806 et aussi G. Miccoli, «Chiesa e società in Italia tra Ottocento e Novecento: il mito délia cristianità», Chiese nella società. Verso un superamento délia cristianità, Turin, 1980, p. 151-245.
n° 4, 2004 /fe
552 Sylvio Hermann De Franceschi
réelle son espérance millénaire: le fait est indiscutable, sa genèse rarement évoquée. D'une progressive mythification dont le processus a sourdement occupé la première modernité européenne, il reste encore à rendre compte.
Il n'était pas certain que l'utopie médiévale d'une république chrétienne uniment pacifiée dût survivre à la rupture théologico-politique introduite en Europe par la Réforme, puis confirmée par les guerres de Religion de la deuxième moitié du XVIe siècle, ni même que l'on voulût éventuellement la réhabiliter une fois enregistrée son obsolescence ou constaté un décès peut-être trop prématurément annoncé. A partir de sondages ponctuels qui ne peuvent livrer, par nature, que des indications parcellaires et dont le caractère fatalement limité rend difficile une éventuelle extrapolation, on a récemment tenté de montrer qu'à l'âge baroque, l'espoir de Christianitas avait pu parfois perdurer paradoxalement grâce au développement de l'absolutisme des pouvoirs civils -le cas de la diplomatie vénitienne en semblait illustration-, dont il avait accompagné et sans doute nourri, davantage qu'affaibli ou condamné, la croissante volonté de puissance: les catholiques d'État ont soutenu en France la politique de rapprochement menée par Richelieu à l'égard des États protestants européens parce qu'ils désiraient le rétablissement d'un ordre de Chrétienté mis à mal par les prétentions hégémoniques de l'Espagne2. On ne souhaite, et on ne peut, toujours rien proposer de plus sûr ni de plus solide que de premiers jalons pour une histoire de l'imaginaire chrétientaire encore à écrire — perspective sur laquelle il a paru nécessaire de revenir, notamment les interprétations proposées il y a presque un demi-siècle par Alphonse Dupront, seul auteur à avoir directement affronté une question singulièrement délaissée par les historiens. L'épisode de l'Interdit vénitien (1606-1607) a connu en son temps un immense retentissement; les enjeux qu'il recouvrait en étaient cause suffisante: crise de l'imbrication du spirituel et du temporel, mais aussi, à l'évidence, adieu à l'ancien idéal de Chrétienté, écartelé désormais entre l'impérieuse volonté de puissance développée par la papauté posttridentine et l'affirmation impétueuse du récent principe de souveraineté -contradiction où se dédit brusquement le principe chrétientaire. À partir du témoignage donné par la correspondance diplomatique de Philippe Canaye de Fresnes, ambassadeur de France à Venise au moment du conflit et esprit marqué de l'empreinte d'un catholicisme critique, on a tenté de retrouver le destin persistant de l'idée de Chrétienté au cours d'un âge qui semblait devoir la récuser absolument pour imposer au monde les acquis de l'absolutisme
Sinon de mythes, la modernité européenne a été créatrice ou réceptacle passif de nébuleuses mythologiques. À qui veut approcher l'histoire de la représentation de Christianitas aux Temps modernes se pose inévitablement la question de la nature de l'objet Chrétienté: de lui, il faut arriver à savoir s'il s'agit d'un mythe, en son vécu comme en son fonctionnement.
Repères pour une mythistoire de la Chrétienté
Retracer dans le temps l'évolution de la présence vive d'une représentation et de ses usages parfois à peine conscients est une entreprise historiographique qui a suscité
2. Voir S. Hermann De Franceschi, «La Chrétienté au miroir de la diplomatie vénitienne, et l'alliance de l'antiromanisme vénitien et du gallicanisme contre l'ecclésiologie catholique posttridentine (1601- 1620)», Cahiers René de Lucinge, s. 4, 37, 2003, p. 98-119 et idem, «Les catholiques d'État en France et leur tentative de sauvegarde d'un ordre de Chrétienté à l'âge pré-absolutiste: la rupture du ministériat de Richelieu », à paraître dans Stratégies et contradictions de la réforme catholique en France et en Pologne du xvř au XVIIIe siècle, Actes des Journées d'études franco-polonaises organisées par C. Grell et M. Serwamki, Versailles, 27-28 octobre 2000.
<#sEn° 4, 2004
La diplomatie henricienne et les ambitions françaises ... 553
attrait et défiance. Mythe, imaginaire, symbole, idée: confrontés à de légitimes hésitations épistémologiques, les historiens n'ont pas toujours su caractériser nettement la nature parfois très floue de l'objet qu'ils voulaient étudier et qui se révélait rétif à un traitement strictement positiviste.
Appréhender le mythe à l'époque moderne, circonscrire la sphère de son influence, oblige à travailler aux confins de trois disciplines très proches, mais inégalement âgées: l'ancienne histoire des idées, qui bénéficie d'une longue tradition, la «mythis- toire», dont les efforts ont d'abord naturellement porté sur les temps archaïques et antiques, et la Begriffsgeschichte, soit l'histoire des concepts, développée par l'École anglo-saxonne de Г History of concepts, et surtout par les Allemands, sous l'impulsion des recherches de Reinhart Koselleck, l'un des initiateurs du monumental Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland 3. Sans nier les résultats novateurs acquis par une démarche encore récente, on ne peut s'empêcher de remarquer qu'elle répond tardivement aux exigences d'une sémantique historique dont Marc Bloch vantait déjà les mérites dans son Apologie pour l'histoire4. De surcroît, séparer les différentes approches revient à trancher trop hâtivement sur la nature de l'objet visé. Faire l'histoire d'une idée, d'un concept ou d'un mythe aux Temps modernes: à ne considérer que des entités comme Chrétienté - pour Alphonse Dupront, un mythe -, Europe ou nation - pour Federico Chabod, des idées 5 —, la question demeure ouverte de savoir s'il y a fondamentalement différences pertinentes de pratiques historiogra- phiques et de natures d'objets entre les trois voies.
Première constatation, d'importance, parce qu'elle est déterminante d'un point de vue méthodologique: à l'époque moderne, la Christianitas n'a pas donné lieu à l'écriture de traités qui fussent consacrés à sa définition, elle n'a pas eu besoin de se faire discours ; elle est considérée par les hommes des XVIe et XVIIe siècles comme un donné évident; à eux, point n'a été besoin d'en transmettre explication raisonnée ou description codifiée et figeante.
L'approche dupronienne du mythe de la Chrétienté Les anciennes mythologies grecques et romaines étaient surtout des narrations
d'événements survenus in illo tempore -dont la religion chrétienne est pour Jean- Claude Schmitt un équivalent possible au Moyen Âge, mutatis mutandis 6 -, le mythe moderne est le plus fréquemment tenu pour hantise ou manie, inconsciente puisqu'elle refuse de s'admettre obsessionnelle. Mythe-récit et mythe-obsession sont les deux modèles fondamentaux autour desquels s'organise très souvent l'analyse traditionnelle des mythologies modernes.
L'histoire des mentalités est depuis longtemps familière de l'étude des idées fixes d'un âge. Il est curieusement revenu à Alphonse Dupront (1905-1990), historien resté
3. Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, dans O. Brunner, W. Conze, et R. Koselleck (dir.), 7 vol., Stuttgart, 1972-1992. Sur l'idée de Chrétienté, voir T. Rendtorff, «Christentum», ibid., vol. 1, Stuttgart, 1972, p. 772-814. Pour un bilan récent de la discipline, voir I. Hampsher- Monk, K. Tilmans, et F. van VreE (éd.), History of concepts: comparative perspectives, Amsterdam, 1998.
4. M. Bloch, Apologie pour l'histoire ou métier d'historien, E. Bloch (éd.), préface J. Le Goff, Paris, 1997 (1993), p. 142.
5. F. Chabod, Storia dell'idea d'Europa, E. Sestán et A. Saitta (éd.), Rome-Bari, 1991 (1961) et idem, L'idea di nazione, Bari, 1962.
6. J.-C. Schmitt, «Problèmes du mythe dans l'Occident médiéval», Razo, Cahiers du Centre d'études médiévales de Nice, 8, 1988, p. 3-17, repris dans idem, Le corps, les rites, les rêves, le temps. Essais d'anthropologie médiévale, Paris, 2001, p. 53-76.
n° 4, 2004
554 Sylvio Hermann De Franceschi
volontairement en marge des orthodoxies febvrienne puis braudélienne, de fournir en 1956, avec sa thèse de doctorat d'État soutenue en Sorbonně sur le mythe de croisade, la plus brillante illustration à la fois des dangers et de la fécondité recelés par l'histoire d'un donné mythique aux Temps modernes 7. De la tentative d'Alphonse Dupront, l'écho a été largement retardé. Il y a d'abord eu, autour du Mythe de croisade, une incompréhension que Gabriel Le Bras, membre du jury, avait manifestée lors de la soutenance. Il y a eu ensuite le long temps de latence durant lequel l'auteur semble s'être incessamment ingénié à refuser son travail à la publication: la thèse n'a été éditée qu'en 1997, soit plus de quarante ans après sa première rédaction complète et sept ans après la mort d'Alphonse Dupront. L'originalité de son dessein n'a jamais fait aucun doute, ni celle de sa méthode, encore moins, ainsi que l'a rappelé Etienne Bro- glin, celle de son style. De son objet et de sa singulière essence, il a été finalement fort peu question, comme si, d'un point de vue méthodologique, appréhender la genèse puis la survie - notion dont Paul Ricœur a montré le caractère central dans la leçon historiographique d'Alphonse Dupront 8 — du mythe de croisade ne différait pas foncièrement de l'étude flamboyante du mythe de Rimbaud menée à la même époque par René Etiemble, né en 1909 -le premier volume de son Mythe de Rimbaud paraît en 1952 à Paris, ouvrage consacré à «une affection de l'imaginaire collectif» qui engage l'histoire littéraire à élaborer une «mythistoire» sous l'influence avouée des travaux de Georges Dumézil. La singularité de l'objet que s'était proposé Alphonse Dupront - la geste croisée et son souvenir vivace, les affleurements successifs de sa postérité - permet de se placer au croisement du légendaire individuel et de la fortune d'une notion générale: la croisade est nom propre pour se faire ensuite nom commun, elle fonctionne mythiquement comme récit, mais aussi comme obsession -à partir du moment où l'espérance de sa réalisation intramondaine semble être morte. De l'approche dupro- nienne ressort le caractère inéluctable d'une dilution du mythe par sa mise en concept quand il devient notion en cessant d'être principe exemplaire.
Il faut reconnaître que l'indéniable capacité de séduction que démontre le grand œuvre d'Alphonse Dupront repose sur la rareté du type de sujet qui y est traité. La croisade présente la particularité unique de se survivre; de la crucesignatio, la résurrection de l'âme décharnée est l'objet étudié par Alphonse Dupront, non sa réincarnation jamais réalisée. Il y a une véritable métempsychose de la croisade - survivance impalpable sous autre forme que celle de la naissance incarnée: la réalité primordialement signifiée a disparu. L'entreprise croisée s'est posée en universal par son décès, elle s'est conceptualisée pour devenir presque un idéal-type, sans atteindre à l'extension d'une notion générale. Parce qu'elle est désormais mythe, elle reste une entité naturellement ancrée dans un contexte culturel et historique spécifique, celui du christianisme se considérant assiégé par les Infidèles - crainte obsidionale de son propre amenuisement.
7. Voir A. Dupront, Le mythe de croisade, 4 vol., Paris, 1997. Sur les conceptions historiographiques duproniennes, consulter D. Julia et P. Boutry, «Introduction», dans A. Dupront, Genèses des Temps modernes. Rome, les Réformes et le Nouveau Monde, Paris, 2001, p. 7-45 et F. Crouzet et F. Furet, préface P. Chaunu (dir.), L'Europe et son histoire. La vision d'Alphonse Dupront, Journées d'études organisées par la Société des Amis d'Alphonse Dupront avec le concours du Centre Robert Schuman de l'Institut universitaire européen (Florence, 26-28 septembre 1996), Paris, 1998, notamment B. Neveu, «Naissance de la modernité: l'Europe, les Églises», ibid., p. 79-99, et J. Mesnard, «L'Europe classique: une quête des valeurs», ibid., p. 107-119. Voir aussi «Présence d'Alphonse Dupront», Le débat, 99, 1998, p. 33-92, notamment D. Julia, «L'historien et le pouvoir des clés», p. 34-52; E. Broglin, «Le désir et l'ordre», p. 53-66, et D. Crouzet, «L'étrange génie du Mythe de croisade», p. 85-92.
8. Voir les actes du colloque Mythe, histoire, croisade. En lisant Alphonse Dupront, P. Levillain (dir.), Paris, 29-30 mars 2001 (à paraître).
n° 4, 2004
La diplomatie henricienne et les ambitions françaises ... 555
L'incontestable originalité du travail d'Alphonse Dupront trouve sa source dans une configuration problématique d'exception. Le singulier génie de la croisade -dont témoigne la formidable vivacité de l'interpellation que son souvenir a été aux fidèles chrétiens - se révèle, malgré son unicité, exemplaire en l'interprétation qu'en fournit Alphonse Dupront pour qui veut approcher la nature rétive des hantises que comporte, parfois inconsciemment, la modernité.
Plus généralement, la réflexion dupronienne voulait introduire à la nécessité de fonder une sociologie historique des mythiques modernes, dont l'existence semblait niée à l'avance par la conviction répandue selon quoi la modernité est seulement désenchantement, laïcisation, sécularisation ou désacralisation. Les analyses d'Alphonse Dupront ont permis de souligner le synchronisme des tribulations endurées par croisade, guerre sainte et Chrétienté9, trois «complexes historico-mythiques» 10 - caractérisation hybride qui est indice de la protéiformité de ses signifiés, à la fois mythe et histoire. Premier constat: entreprise croisée et représentation chrétientaire ont eu vie plus courte que le bellům sanctum. La croisade est née aux environs des années 1090, elle meurt avec la fin de la guerre turque et la Question d'Orient à la mi-xixe siècle, soit huit cents ans d'existence. Plus brève, pour Alphonse Dupront, est la durée d'influence réelle de la Christianitas: «Si de nos jours, reflux des pays de mission, la réalité de chrétienté retrouve une fraîcheur vigoureuse d'Église neuve, la Chrétienté de l'histoire agonise au long du XVIIe siècle, quand se fait l'Europe dynastique et politique; elle meurt au temps des Lumières.» n Surgie de la croisade, la Christianitas a vécu sept cents ans; les deux entités ont cheminé parallèlement avant de se séparer, leur dissociation est fondatrice de deux mythes désormais pleinement autonomes l'un par rapport à l'autre.
D'un essai de phénoménologie comparée des deux représentations, longtemps liées, Alphonse Dupront constate d'abord qu'elles sont formes éminentes de totalité, «c'est-à-dire des cadres ou des puissances de l'unité» 12: «La Christianitas unit, dans ce vocable unique, la réception baptismale, le corps des chrétiens ensemble, leur présence dans le monde, cette présence dans le monde qui tend d'ailleurs à devenir le monde même.» 13 Elles sont ensuite états aninstitutionnels. La Chrétienté est corps sans centre, sans visible hiérarchie, une étendue à la mesure du monde. Jamais guerre sainte et Christianitas ne se définissent par des règles connues et admises, elles se veulent toujours «des états suprêmes ou extrêmes et anarchiques, mieux encore, des états d'exception, qui définissent dans les groupes humains qu'ils tiennent et un extraordinaire peu passible des formes de l'existence collective normale et une société aussi essentielle qu'instable, à la limite des possibilités et du grégaire humain et de la sociabilité» 14. La Chrétienté est une société d'accomplissement -représentation religieuse qui n'a pu être institutionnalisée, ou si peu. Pour Alphonse Dupront, il semble que l'adversaire le plus dangereux de la puissance d'incarnation revendiquée par la Christianitas ait été l'Église comme institution -une monarchie spirituelle qui s'est pleinement intégrée dans la sphère de la société civile. Après la conclusion de la lutte
9. A. Dupront, «Guerre sainte et Chrétienté», Paix de Dieu et guerre sainte en Languedoc au XIW siècle, Cahiers de Fanjaux, 4, 1969, p. 17-50, repris dans idem, Du Sacré, op. cit., p. 264-287.
10. Ibid., p. 264. 11. Ibid., p. 265-266. 12. Ibid., p. 282. 13. Ibid., p. 282. 14. Ibid., p. 285.
n° 4, 2004 ifc
556 Sylvio Hermann De Franceschi
du Sacerdoce et de l'Empire, il s'avère que «les deux moitiés de Dieu ne parviennent pas à unir leur règne en ce corps et âme du monde chrétien qu'offrait d'être la Chrétienté, dès lors, idéal celle-ci, ou mythe invocatoire comme une nostalgie ou espérance sans plus» 15. À peine née, la Christianitas se rêve plus qu'elle ne se vit. Elle se relie au complexe de guerre sainte, puisqu'elles sont ensemble sotériologie et eschatologie, se voulant sociétés de salut commun.
Les considérations duproniennes, forcément linéamentaires, parce qu'elles osaient s'aventurer en leur temps sur un terrain encore à délimiter scientifiquement, affirmaient un besoin nouveau d'étudier la vie des mythes aux Temps modernes, nécessité qu'Alphonse Dupront associait en 1960 à celle de fonder une histoire de la psychologie collective, en accord avec les vœux formulés un an plus tôt par Fernand Braudel, dans un rapport sur la recherche en histoire moderne et contemporaine présenté devant les instances politiques du CNRS et signé également de Pierre Renouvin et Ernest Labrousse 16. Parmi les orientations dont Fernand Braudel prônait l'encouragement dans les domaines relatifs à l'histoire des idées, figure celle d'une étude de l'influence des doctrines politiques sur la littérature, la religion, la pensée sociale, mais aussi de la réaction des structures de la société, du mouvement économique et des révolutions scientifiques sur les formulations successives des théories de l'État et du pouvoir civil. Fernand Braudel précisait qu'il fallait atteindre les «mentalités collectives»: «Dans ce domaine, jusqu'ici rarement exploré, les initiatives peuvent s'inspirer du vaste programme établi par M. Alphonse Dupront.» n L'un des représentants les plus éminents d'une École des Annales désormais triomphante insistait sur l'intérêt de réaliser nomenclature et analyse de notions fondamentales du discours historique moderne, comme «civilisation», et des «représentations collectives» 18, telles Europe et Chrétienté. Le contexte du traité de Rome (1957) était sans nul doute pregnant dans les considérations braudéliennes, auxquelles Alphonse Dupront faisait écho, dans un autre rapport 19, quand il soutenait en 1960 le projet d'établir un inventaire «des formes, créations, images, valeurs, des expressions tant saines que morbides, par quoi se manifeste, au travers du temps de l'histoire, le mental collectif ou bien s'exprime l'âme collective»20. À titre d'exemples, Dupront citait le mythe du progrès, la notion de civilisation, ou encore la Chrétienté, forme médiévale indéfinie mais essentielle du désir occidental d'unité. Son programme n'a été que très partiellement réalisé.
Le projet dupronien se voulait finalement tentative d'élaborer une psychologie historique des profondeurs d'un «inconscient collectif», dont Dupront se garde de mettre en cause l'existence - sans pour autant en résoudre la fondamentale indétermination, problématique à la discipline psychanalytique elle-même- afin d'accéder à l'arrière- plan des actes du sujet pris dans l'histoire, par une approche, en son principe, d'immanence.
15. Ibid., p. 286. 16. F. Braudel, E. Labrousse et P. Renouvin, «Les orientations de la recherche historique. Enquête du
CNRS. Les recherches d'histoire moderne et contemporaine», Revue historique, ccxxn/1, 1959, p. 34-50. 17. Ibid., p. 42. 18. Ibid., p. 42. 19. A. DUPRONT, «Problèmes et méthodes d'une histoire de la psychologie collective», communication
présentée au XIe Congrès International des Sciences Historiques, Stockholm, 24 août 1960, Ire Section, Méthodologie historique, repris dans Annales. ES., xvi/1, 1961, p. 3-11.
20. Ibid., p. 4.
n° 4, 2004
La diplomatie henricienne et les ambitions françaises ... 557
Les jalons chronologiques provisoires Au sein de l'entreprise dupronienne, la singulière confiance accordée au langage
mérite d'être davantage cernée qu'elle ne l'a été. Dominique Julia a récemment rappelé que les analyses menées par Alphonse Dupront considèrent la sémantique historique comme «l'outil qui rendra manifestes les voix du silence»21. Pour se faire mythe, la croisade est morte et s'est survécu22, intuition directrice qui a autorisé l'élaboration du maître livre d'Alphonse Dupront en même temps qu'elle était accompagnée d'une réflexion méthodologique sur la permanence et l'étude des comportements mythiques ainsi que sur la survie, parfois exténuée, de formes symboliques médiévales à l'époque moderne. La matière était abondante, mais les indications n'ont rencontré que peu d'émulés.
À la différence de l'ancienne croisade, dont le signifiant tend à devenir un nom commun, la Christianitas présente la particularité d'être concept à sa naissance - éty- mologiquement, le fait d'être chrétien- pour devenir presque immédiatement une dénomination particulière. Au rebours de la crucesignatio, chrétienté est un universal qui s'est, si l'on peut dire, immédiatement déconceptualisé afin de se faire nom propre. Le champ de l'historiographie fourmille de voies déjà ouvertes, qui contraignent partiellement les travaux des historiens successifs. L'opposition entre Europe et Chrétienté en est une, probablement d'abord frayée par l'École allemande, qui a subi l'influence d'un essai du poète catholique Novalis (1772-1801) -texte composé en 1799 et intitulé Die Christenheit oder Europa23- et dont les intérêts à l'égard d'une problématique issue du romantisme naissant ont été confortés en 1931 par un ouvrage de Werner Fritzemeyer 24. Relier Europa et Christianitas correspondait à une conception - naguère encore retenue 25 - du mythe moderne, qui fonctionnait comme une ramification de décompositions en éléments simples, parallélismes ou antithèses, et à qui étaient toujours adjoints ses propres contre-mythes.
L'apparition d'une conscience européenne et l'éventuelle disparition concomitante de l'idée de Chrétienté font depuis longtemps l'objet d'investigations historiogra- phiques 26. De la Christianitas, Alphonse Dupront avait plusieurs fois tenté d'établir
21. D. Julia, op. cit., p. 43. 22. Sur la survivance du thème croisé à la fin du XVIe siècle, voir M.J. Heath, Crusading Commonplaces:
La Noue, Lucinge and Rhetoric against the Turks, Genève, 1986. 23. Novalis, Schriften. Die Werke Friedrich von Hardenbergs, dans P. Kluckhohn et R. Samuel (éd.),
t. Ill, Das philosophische Werk, Darmstadt, 1986, «Die Christenheit oder Europa», p. 497-524. 24. W. Fritzemeyer, Christenheit und Europa. Zur Geschichte des europaischen Gemeinschaftsgefuhls
von Dante zu Leibniz, Munich-Berlin, 1931. 25. Voir R. Girardet, Mythes et mythologies politiques, Paris, 1986. 26. L'ouvrage fondateur est le livre classique de P. Hazard, La Crise de la conscience européenne
(1680-1715), Paris, 1935, rééd. Paris, 1961. Voir aussi F. Autrand, N. Cazauran, et S. Follet (dir.), La conscience européenne aux XVe et XV f siècles. Actes du Colloque international organisé à l'École normale supérieure de jeunes filles, 30 septembre-2 octobre 1980, Paris, 1982. Sur les idées d'Europe et de Chrétienté dans leurs rapports, voir F. Chabod, Storia dell'idea ď Europa, op. cit.; consulter aussi D. Hay, Europe, the emergence of an idea, Edimbourg, 1957; idem, «Sur un problème de terminologie historique: Europe et Chrétienté», Diogène, 17, 1957, p. 50-62; idem, «Europe revisited: 1979», History of European Ideas, 1980, I/I, p. 1-6; A. Annoni, L' Europa nel pensiero italiano del Settecento, Milan, 1958 et С. Curcio, Europa, storia di un idea, 2 vol., Florence, 1958. L'étude des rapports entre Europe et Chrétienté a été récemment renouvelée par Imaginer l'Europe, K. Malettke (dir.), Paris, 1998, notamment D. Kurze, «La Respublica Christiana et l'Europe médiévale», ibid., p. 11-49, G. Chaix, «L'Europe à l'époque de la Renaissance. Conceptions et réalisations», ibid., p. 51-70 et K. Malettke, «Les manifestations de la conscience européenne aux XVIIe et xvnT siècles», ibid., p. 124-128. Pour un point de vue anglais, voir F. Le Van Baumer, «The conception of Christendom in Renaissance England», Journal of History of Ideas, 6, 1945, p. 131-156.
n° 4, 2004
558 Sylvio Hermann De Franceschi
une chronologie d'existence par opposition à une réalité envahissante ď Europe21. Évidente, pour lui, une césure à la mi-XVlle siècle, visible à travers la correspondance diplomatique de Fabio Chigi, nonce extraordinaire à Munster lors de la négociation des traités de Westphalie (1648). Selon Alphonse Dupront, avec la fin de la guerre de Trente Ans se clôt en Europe l'âge des conflits modernes de religion et de la guerre sainte -mutation à quoi ne peut rester insensible la représentation du corpus Christianům: «À mesure que faiblit le sens et la justice du combat pour Dieu et avec Dieu, à mesure surtout qu'il est devenu patent, à longueur de guerres, de tueries et de destructions, qu'il n'y a plus unité, fraternité comme on disait au Moyen Âge, du corps chrétien, l'image ou Г idée-force de Chrétienté se défait lentement.» 28 Pour Alphonse Dupront, le dépérissement de la Christianitas et la présence encore discrète de l'idée d'Europe, qu'il considère comme son dégradé séculier, marquent la libération de la modernité. De Chrétienté, Chigi utilise rarement le nom: «Ne la susciterait-il qu'à des moments rares, solennels, comme une invocation souveraine? Manifestement la Chrétienté demeure, dans son univers mental, une présence. Présence encore sentie, même si les frontières en sont imprécises, comme une totalité.»29 Dans la cursivité révélatrice de l'écriture du nonce, la Christianitas affleure comme réalité humaine, mais dolente. Instance glorieuse, elle continue à conserver la plus haute dignité; aux puissances temporelles, Chigi ne reconnaît qu'« intérêts» et «avantages», éthique qui est d'une sphère autre que celle du corpus Christianům à préserver: «Un seul mot convient, comme de nature ou d'ordre, pour exprimer la vie éminente de Chrétienté: il bene. Valeur suprême encore intacte, ou du moins conjurable: // bene délia Christianitá.»30 Très peu invoquée, la Christianitas a irrévocablement cessé d'être une idée-force —pour reprendre une catégorie typiquement dupronienne; son évocation n'est plus qu'une habitude résiduelle.
Signe de décadence, la dissociation apparemment définitive de la croisade et de la Chrétienté: Chigi peut écrire du péril turc sans en appeler aussitôt à la défense de la Christianitas. La représentation chrétientaire se désagrège lentement, pour être remplacée par de nouveaux corps collectifs à invoquer. Si les notions de respublica Christiana et de respublica catholica ne sont que des équivalences, au même titre que l'intitulation du souverain pontife en père commun de la Chrétienté, trois expressions sont des nouveautés par leur inhabituelle présence: Religione Cattolica, Christiane simo et Sangue Christiano. La première est «d'une instance quantitativement si dense, qu'elle est la plus sûre preuve d'un effacement progressif de la présence de la Chrétienté: le combat ou le service de Chrétienté ont fait place au combat ou au service de la Religion Catholique»31. Entre Christianisme et Chrétienté, la distinction est souvent ténue, mais le premier paraît plus partiel que la seconde, qui peut encore obscurément comprendre
27. Voir essentiellement A. Dupront, Europe et Chrétienté dans la seconde moitié du XVIIe siècle. lre partie, Paris, 1957; «De la Chrétienté à l'Europe», La Table Ronde, 113, 1957, p. 54-67; «De la Chrétienté à l'Europe», Revue de l'Université Laval, XVm/7, 1964, p. 627-642; «De la Chrétienté à l'Europe: la passion westphalienne du nonce Fabio Chigi», Forschungen und Studien zur Geschichte des Westfàlischen Friedens: Vortrage bei dem Colloquium franzôsischer und deutscher Historiker vom 28. April- 30. April 1963 in Munster, Munster, 1965, p. 49-84 et «Unité des chrétiens et unité de l'Europe dans la période moderne», Actes du XIIIe Congrès International des Sciences Historiques (Moscou, 1970), 1. 1, 5e partie, Moscou, 1973, p. 207-250.
28. Idem, «De la Chrétienté à l'Europe: la passion westphalienne du nonce Fabio Chigi», op. cit., p. 50. 29. Ibid., p. 57. 30. Ibid., p. 57. 31. Ibid., p. 60.
n° 4, 2004
La diplomatie henricienne et les ambitions françaises ... 559
l'hérétique dans son acception la plus large, ainsi que Sangue Christiano. Au Christia- nesimo, martèle Chigi, il faut quiète et tranquillitá - vocabulaire humain appliqué à un corps chrétien usé par les guerres fratricides: «Ce qu'il y avait de marche au règne, voire d'imposition dans l'acte dominateur de Chrétienté, disparaît dans un Christianisme souffrant, plus passif que conscient, et déjà marqué dans ses épreuves d'un langage seulement temporel. » 32 Le Christiane simo se comprend dans le monde, plus grand que lui; il vit dans un temps profane, alors que la Christianitas était espoir eschatologi- que, puisque destinée à s'étendre indéfiniment à l'entière Création: «Toujours expansionniste certes, Christiane simo exprime une grande réalité collective de religion, mais dans un univers désormais physique. » 33 La notion collective de Religion Catholique n'a pas de réalité spirituelle, elle sépare, elle répartit, elle distingue, elle avoue une ségrégation désormais nécessaire. La Christianitas était corps social d'accomplissement à venir, la Religione Cattolica ne se veut pas société: «Elle l'implique certes, mais en en dépendant, partie intégrante de celle-ci. Dès lors elle s'analyse en doctrine, en institutions, plus combattante dans le siècle que salvatrice pour l'éternité.»34 À la mi-XViie siècle, les milieux romains semblent avoir eux-mêmes entériné, dans une prise de conscience nostalgique, la dissolution de l'ancien idéal de république chrétienne.
Quand la tendance absolutiste des pouvoirs civils semble devenir prédominante, il y a négation de ce qui a fondé l'idéal de Christianitas. L'approche d'une sémantique historique permet de mettre en valeur un affaiblissement incontestable de la puissance d'influence propre à l'idée de Chrétienté dans un corpus documentaire qui était censé, plus qu'un autre, la véhiculer au milieu de circonstances apparemment favorables à son invocation.
Le catholicisme critique: un entre-deux confessionnel On souhaite ici mettre à l'épreuve hypothèses et méthode duproniennes pour
essayer de saisir une évolution chronologique encore trop imprécise. Les circonstances retenues sont celles d'une crise évidente de la Christianitas, que prouvent les causes et le règlement du conflit de l'Interdit vénitien (1606-1607); le témoin convoqué est Philippe Canaye de Fresnes (1551-1610), alors ambassadeur ordinaire d'Henri IV à Venise35, qui a dû assurer une délicate représentation auprès d'autorités politiques ouvertement antiromaines.
Personnalité peu commune que celle du représentant diplomatique du souverain français auprès de la Sérénissime - qui, en sa singularité, se rattache sans doute à la mouvance des «catholiques critiques», longtemps mal connue avant que Thierry Wanegffelen ne l'exhume récemment 36. Né à Paris dans une famille de confession romaine, Canaye de Fresnes embrasse le calvinisme en 1566 à l'âge de quinze ans,
32. Ibid., p. 62. 33. Ibid., p. 62-63. 34. Ibid., p. 68. 35. Sur Philippe Canaye de Fresnes, voir P. Roman d'Amat, «Philippe Canaye de Fresnes», Diction
naire de biographie française, t. VII, fasc. XLI, Paris, 1955, p. 1025-1026, T. Wanegffelen, M Rome ni Genève. Des fidèles entre deux chaires en France au XVř siècle, Paris, 1997, «Le choix de Philippe Canaye, sieur de Fresnes: confessionnel ou religieux?», p. 446-450, et surtout G. Cozzi, «Paolo Sarpi tra il cattolico Philippe Canaye de Fresnes e il calvinista Isaac Casaubon», Bollettino dell'Istituto di Storia délia Societa e dello Stato veneziano, 1, 1959, p. 27-154, repris dans idem, Paolo Sarpi tra Venezia e l'Europa, Turin, 1979, p. 3-133.
36. Voir T. Wanegffelen, Une difficile fidélité. Catholiques malgré le concile en France, XVř-xvíř siècles, préface P. Chaunu, Paris, 1999.
n° 4, 2004
560 Sylvio Hermann De Franceschi
influencé par des amis protestants. Juriste de formation - il fait ses études à Heidelberg-, avocat, puis membre du Grand Conseil (1580), il démontre de profonds intérêts pour le droit, la philologie classique et la philosophie. Il est à Rome le 14 mai 1572 et à Venise le 14 octobre, d'où il part pour Raguse puis Constantinople, dans la suite de François de Noailles, évêque de Dax suspect de sympathies à l'égard de la Réforme, envoyé par Charles IX en ambassade auprès du sultan. Pour le roi de France, il s'agissait de reprendre au Levant une prépondérance diplomatique entamée après 1571 par les conséquences de la bataille de Lépante et les actions de la Sainte Ligue, constituée entre l'Espagne, la Sérénissime et le Saint-Siège. Revenu à Venise le 17 octobre 1573, Canaye de Fresnes fait un récit italien de son séjour levantin 37. En terre infidèle, il a éprouvé sa conscience de Chrisîianitas ; son voyage le marque assez durablement pour que la puissance ottomane ne soit jamais totalement absente de ses préoccupations.
Sa conversion au protestantisme lui vaut également d'efficaces recommandations. Rapidement introduit dans l'entourage d'Henri de Navarre, Canaye de Fresnes obtient de lui une place de conseiller au Parlement de Toulouse, où il siège de 1584 à 1585. Le 20 janvier 1586, il est envoyé par son nouveau protecteur en mission à Genève. Il y rencontre les protestants François de La Noue et Isaac Casaubon avec lesquels il se lie d'amitié. La Noue lui confie le manuscrit de ses Discours politiques, que Canaye de Fresnes se hâte de faire éditer en 1587 à Bâle. Les deux hommes partagent une volonté de croisade. Les rapproche aussi, avec Isaac Casaubon, un désir d'unité chrétienne, de réforme ecclésiale et de modération religieuse. En 1589, Canaye de Fresnes publie à Genève L'Organe, c'est-à-dire l'instrument du discours puisé de /'Organe d'Aristote3*. Dans sa lettre dédicatoire à Henri III, il proclame que le roi a pour devoir de mettre fin aux conflits de religion, et dans sa préface au lecteur, il exprime le sentiment de la nécessaire convocation d'un nouveau concile.
Son engagement en faveur de l'hérésie paraît inébranlable, son rejet de la romanité ecclésiale est patent. Après l'avènement d'Henri IV, Canaye de Fresnes jouit de la faveur du souverain et s'attache à faire venir en France Casaubon, à qui il suggère dans un premier temps de s'installer à Montpellier, dont l'Université demeure prestigieuse. Casaubon y arrive en février 1597, avant d'être solennellement invité par le roi de France en janvier 1599 à prendre résidence parisienne. Le protestant décide finalement de s'installer dans la capitale en 1600, trop tard pour empêcher la conversion de son ami. Juge à la conférence tenue le 4 mai 1600 à Fontainebleau entre le cardinal du Perron et Philippe Duplessis-Mornay, Canaye de Fresnes en sort profondément bouleversé: il effectue son retour dans le giron de l'Église romaine en avril 1601 — après avoir vainement insisté pour que Casaubon reconnût avec lui la légitimité de la seule confession catholique. Les deux hommes se brouillent presque définitivement. Nommé en mai 1601 ambassadeur ordinaire de France à Venise, Canaye de Fresnes y fréquente bientôt le servite vénitien Paolo Sarpi et le jésuite Antonio Possevino, deux personnalités destinées à jouer des rôles contradictoires dans le conflit qui est en train de s'élever entre la Sérénissime et le Saint-Siège. Marqué des alternatives qui sont propres à l'âge posttridentin, Canaye de Fresnes se signale par l'originalité de son parcours et une capacité particulièrement rare de perméabilité confessionnelle.
37. Voir P. Canaye de Fresnes, Voyage au Levant, éd. et trad. fr. H. Hauser, Paris, 1 897. 38. Idem, L'Organe, c'est-à-dire l'instrument du discours, divisé en deux parties, sçavoir est, l'analytique,
pour discourir véritablement, et la dialectique, pour discourir vraisemblablement. Le tout puisé de /'Organe d'Aristote, Genève, 1589.
?E n° 4, 2004
La diplomatie henricienne et les ambitions françaises ... 561
De sa carrière antérieure à l'ambassade vénitienne, le diplomate français a pu acquérir une connaissance exceptionnelle de l'état de la Chrétienté en ses confins. Pour lui, la puissance ottomane est irrémédiablement affaiblie. Il l'affirme depuis Venise le 2 novembre 1601 : «Le grand Empire a passé son midy.» 39 II le répète avec insistance le 23 novembre: «Je crois qu'il seroit temps de nous offrir à avoir part à l'honneur et au profit de la ruine qu'il semble que Dieu prepare à ces Barbares»40; une fois reprise Buda, «je ne voy plus rien qui puisse arrester les armes chrestiennes jusques au siege de l'Empire»41. A en croire Thierry Wanegffelen -dont la minutieuse et novatrice analyse se fonde sur les Harangues et actions publiques des plus rares esprits de nostre temps publiées par l'ancien ambassadeur—, les conceptions théolo- gico-politiques de Canaye de Fresnes se développent à partir de convictions iréniques selon lesquelles Dieu a créé la société humaine de telle sorte que la diversité confessionnelle ne fût pas empêchement de concorde civile ni d'harmonie sociale: «Ce n'est pas l'unité, mais c'est l'égalité des Eglises et des opinions qui maintient et conserve Г Estât.»42 Proche, selon Thierry Wanegffelen, de la doctrine des Politiques, Canaye de Fresnes ne leur est pas complètement assimilable ; il dépasse la simple tolérance pour poser l'égalité effective de confessions adverses et aller encore plus loin que les dispositions prises par Г Edit de Nantes, promulgué en 1598. La possibilité d'une parité confessionnelle est le résultat d'une action divine dont l'application doit être relayée par la royauté française -en charge de réussir œuvre à quoi l'Espagne a déjà échoué. Pour y parvenir, Canaye de Fresnes pense spontanément à la revendication d'une monarchie universelle de la France sur la Chrétienté: «A vez- vous jamais ouy dire que l'Empereur Charles le Quint, désirant de pourveoir aux differens qui commencèrent à s'esmouvoir de son temps en la religion, et reformer l'Eglise, se délibéra de jetter ses desseins à la Monarchie universelle de la Chrestienté, pour parvenir à ceste fin-là? Il nous faut faire quelque chose de pareil. » 43 Henri IV ne peut devenir chef de la Chris- tianitas sans l'assistance de la providence divine; en signe de gratitude, il lui doit de mettre ensuite fin aux différends entre confessions rivales. Canaye de Fresnes souhaite une réformation de la communauté ecclésiale, mais il maintient que nul ne se peut prévaloir du retard apporté à sa mise en œuvre pour rejeter son appartenance à l'Église romaine -volonté d'une «Réforme non schismatique», pour reprendre l'heureuse expression de Thierry Wanegffelen. Entre Rome et Genève, Canaye de Fresnes a tranché; en témoigne la conversion de 1601. D'une décision strictement religieuse, il tire les conséquences diplomatiques logiques en soutenant, comme l'a montré Gaetano Cozzi, que la France doit assumer, d'élection naturelle, un rôle de tête temporelle en Chrétienté; il lui faut mettre fin à la mainmise espagnole sur la papauté, cause de l'échec essuyé par les réformes tridentines.
La stratégie politique du diplomate français ne cesse d'être animée par la recherche d'une alliance catholique entre France, Saint-Siège et Venise; elle part du constat de
39. Canaye de Fresnes à Savary de Brèves, Venise, 2 novembre 1601, dans P. Canaye de Fresnes, Lettres et ambassades de Messire Philippe Canaye seigneur de Fresne, conseiller du Roy en son Conseil ď Estât, t. II, Paris, 1635, p. 18, cité par T. Wanegffelen, M Rome ni Genève, op. cit., p. 446.
40. Canaye de Fresnes à Ancel, Venise, 23 novembre 1601, ibid., p. 50, T. Wanegffelen, op. cit., p. 446.
4t. Ibid., p. 50, T. Wanegffelen, op. cit., p. 447. 42. P. Canaye de Fresnes, Harangues et actions publiques des plus rares esprits de nostre temps, Paris,
1609, p. 313-315, T. Wanegffelen, op. cit., p. 447. 43. Canaye de Fresnes à La Boderie, Venise, 24 mai 1602, dans P. Canaye de Fresnes, Lettres et
ambassades, op. cit., t. II, p. 276, T. Wanegffelen, op. cit., p. 448.
n° 4, 2004
562 Sylvio Hermann De Franceschi
l'impuissance manifestée par les pouvoirs européens face à la crise ouverte par l'apparition du protestantisme.
À un double mouvement d'interprétation on souhaite ici s'attacher. D'une part, compte tenu des caractéristiques biographiques qui déterminent la genèse houleuse d'une foi personnelle singulièrement hétéroclite, tenter d'appréhender chez Canaye de Fresnes une réalité de Chrétienté - si réelle elle est. D'autre part, comme un retour de balancier, vérifier les hypothèses historiographiques avancées par Thierry Wanegffelen et par Gaetano Cozzi à partir de ce qu'il est possible de percevoir -au travers du témoignage apporté par le diplomate- d'un vécu de Christianitas. Issues d'une violente crise de Chrétienté, les dépêches écrites par Canaye de Fresnes au cours de l'Interdit vénitien se révèlent particulièrement éloquentes; elles sont matériau suffisamment cohérent, ponctuel et maîtrisable pour permettre de suivre le destin de la représentation de Christianitas y symbolique ou mythique, durant un conflit qui en a été, de causes et d'effets, reniement brutal.
Les catholiques critiques face à l'autorité pontificale au temporel
Malaisément saisissable, parce qu'elle semble condamnée à ne pouvoir être appréhendée qu'à partir de cas singuliers, la genèse du catholicisme critique a accompagné -ainsi que le soulignait en 1981 Giuseppe Alberigo44- le développement de la réforme tridentine. Pour les tenants d'une attitude plus que réservée, sans être irréconciliablement hostile à l'égard des décisions conciliaires, Trente a été un échec: insuffisamment audacieuse, l'assemblée des pères tridentins n'a pu réconcilier la Chrétienté malgré les espoirs brièvement entretenus lors de l'envoi à Trente d'une délégation luthérienne - admise à la reprise des travaux conciliaires en 1551. D'où la nécessité, affirmée par Canaye de Fresnes dans L'Organe, de réunir un nouveau concile. Une difficile fidélité mûrie dans l'expectative d'une véritable réforme de l'Église romaine caractérise les positions ecclésiologiques de catholiques à la fois prudents et déçus 45.
Le tridentinisme à l'épreuve du conflit vénitien Quand la consolidation ecclésiale du tridentinisme paraît inéluctable, le déclen
chement de l'Interdit vénitien est le signe de la révolte d'un catholicisme critique qui prend appui sur la naissance de la raison d'État46 - le traité Delia rag ion di S tato de Giovanni Botero a été publié en 1589. La lutte entre la papauté et la Sérénissime est hybride; elle ne peut pas être une guerre de religion, elle ne se veut pas encore affrontement complètement sécularisé, elle est un rejet de la nouvelle tridentinité autant que de la récente catholicité.
44. Voir G. Alberigo, «Du concile de Trente au tridentinisme», Irénikon, Liv/l, 1981, p. 192-210. Consulter aussi ID., «Vues nouvelles sur le concile de Trente», Concilium, 7, 1965, p. 65-79.
45. Voir T. Wanegffelen, Une difficile fidélité, op. cit., «La fidélité, même critique, à l'Église visible: une spécificité catholique?», p. 2-12.
46. Pour une narration événementielle de l'Interdit, voir L. von Pastor, Geschichte der Papste, t. XII, Fribourg-en-Brisgau, 1927, Storia dei Papi, trad, ital., t. XII, Rome, 1943, p. 85-159. Sur l'idée républicaine à Venise à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, consulter W.J. Bouwsma, Venice and the defense of republican liberty. Renaissance values in the age of the Counter-Reform, Berkeley-Los Angeles, 1968, Venezia e la difesa della liberta repubblicana, trad, ital., Bologne, 1977 et surtout G. Cozzi, // Doge Nicolà Contarini. Ricerche sul patriziato veneziano agli inizi del Seicento, Venise-Rome, 1958. Pour une approche de la doctrine de Paolo Sarpi au moment de l'Interdit, voir G. Cozzi, Paolo Sarpi tra Venezia e l'Europa, Turin, 1979; H. Wootton, Paolo Sarpi. Between Renaissance and Enlightenment, Cambridge, 1983 et G. et L. Cozzi, «Paolo Sarpi», Storia della cultura veneta-Il Seicento, II, Vicenza, 1984, p. 1-36. Le livre de V. Frajese, Sarpi scet- tico. Stato e Chiesa a Venezia tra cinque e seicento, Bologne, 1994, est désormais fondamental.
•SE n° 4, 2004
La diplomatie henricienne et les ambitions françaises . . . 563
Conflit qui est modeme, sans aucun doute, mais où demeure pleinement impliquée la Chrétienté. Au moment de livrer à leurs lecteurs, en 1636, les dépêches diplomatiques écrites par Canaye de Fresnes de 1606 à 1607, l'imprimeur ne peut s'empêcher de poser le roi Henri IV en sauveur de Christianitas. Dans une courte préface, il vante les mérites de l'ambassadeur français, «destiné par le Roy Henry le Grand, seul & unique arbitre de la Chrestienté, pour estre l'Ange de la reconciliation»47. Le titre à" Arbiter Christianitatis est accordé à Henri IV, désormais Henri le Grand: il a permis au royaume de France de célébrer en 1607 ses retrouvailles avec une antique intitulation de couronne très-chrétienne -mise en cause par l'Espagne avant l'absolution du souverain français par le pape Clément VIII le 17 septembre 1595. D'un basculement du rapport de forces entre la maison d'Autriche et les nouveaux détenteurs du trône de Clovis, l'Interdit vénitien s'est fait le révélateur et l'occasion -dispute «à l'accommodement de laquelle s'employa Sa Majesté Tres-Chrestienne, seul Arbitre de la Chrestienté»48. Dans le conflit de 1606-1607, la représentation de la Christianitas a été un protagoniste essentiel. Significativement, le vocabulaire témoigne d'une remarquable vitalité de l'instance du corpus christianum chez Canaye de Fresnes. Si les emplois de christianisme sont inexistants, peu nombreux ceux de Religion Catholique, encore plus rares les références à la métaphore paternelle pour qualifier le pontife romain, Église catholique surgit spontanément de la plume du diplomate et l'invocation de la Chrétienté est écrasante -jusque dans l'expression une fois utilisée, mais précieusement, de Chrétienté catholique 49 -, fréquentes, aussi, les allusions aux Princes chrétiens ou aux Princes catholiques. La Christianitas s'est dissociée de la croisade — le Turc est très peu évoqué -, il devient possible de la saisir indépendamment d'un mythe qui lui avait été sans cesse conjoint.
Les causes sont connues du conflit qui oppose, à l'orée de la première modernité en Europe, Venise au Saint-Siège. Elles se rattachent à une volonté manifestée par la Sérénissime de limiter les empiétements temporels du pouvoir ecclésial. Il y a d'abord eu la promulgation de trois lois. Contre les gens d'Église, le Sénat de la République tranche le 23 mai 1602 en faveur des laïcs dans le cas de litiges touchant les biens ecclésiastiques détenus en emphytéose par des particuliers. Le 10 janvier 1604, défense est faite d'ériger des édifices religieux sans accord de la puissance civile. Le 26 mars 1605, enfin, est interdite l'aliénation de biens-fonds au profit de l'Église s'il n'y a pas eu auparavant autorisation des institutions républicaines. La situation est aggravée en 1605 par l'emprisonnement à Venise, pour des délits de droit commun, de deux ecclésiastiques, directement déférés devant la justice de la Sérénissime. Le 17 avril 1606, après l'envoi d'un monitoire considéré comme nul et non avenu, le pape Paul V excommunie les autorités vénitiennes et place la ville, ainsi que son territoire, sous interdit.
S'il y a eu rapidement des préparatifs ostentatoires de guerre, tant du côté romain que du côté de Venise, le déroulement de la crise n'a été surtout qu'une longue suite de négociations diplomatiques par quoi France et Espagne se sont disputé le monopole d'une médiation où se jouait l'influence habsbourgeoise en Italie. Les Vénitiens ont
47. Voir P. Canaye de Fresnes, Lettres et ambassades de Messire Philippe Canaye seigneur de Fresne, conseiller du Roy en son Conseil ď Estât. Troisiesme tome, où il est traité particulièrement du différend du Pape Paul V avec la Republique de Venise, de l'ordre que l'on a tenu au procédé de cet affaire, et de tout le traité jusque s à l'accommodement, Paris, 1636, p. 1-П.
48. «Avant-propos, sur les causes du different entre les Papes Clement VIII & Paul V & la Republique de Venise, ez années MDCV, MDCVI, & MDCVII», ibid., p. IX.
49. Canaye de Fresnes à Salagnac, Venise, 6 avril 1607, ibid., p. 517.
n° 4, 2004
564 Sylvio Hermann De Franceschi
été surpris par l'opiniâtreté du souverain pontife, qui réclamait la révocation des trois lois incriminées et la remise des deux prisonniers à un tribunal ecclésiastique. Les justifications de la Sérénissime se sont immédiatement fondées sur la nécessité de conserver souveraineté et libertés. L'opposition de la raison d'État à la raison d'Église est évidente, mais aussi le risque de voir détruite l'unité de Chrétienté, ainsi qu'en témoigne dès le 15 avril 1606 Canaye de Fresnes à l'intention de son collègue François d'Alincourt, ambassadeur ordinaire de France à Rome: «Sa Saincteté, considérant par sa prudence le temps present de la Chrestienté, jugera à mon advis estre beaucoup plus expedient & plus à propos, pour le repos de son esprit & la descharge de sa conscience, de maintenir l'Eglise de Dieu en Testât qu'elle l'a trouvée & la garder d'empirer, que désirant meliorer sa condition par l'amplification de l'autorité Pontificale, se mettre au hazard de ne voir de sa vie l'accomplissement de son dessein & donner grand subject de scandale aux ennemis de la foy.»50 La direction de YEcclesia Dei, qui est une mission imprescriptible du pontife romain, et la conservation du corps de la Christianitas peuvent être parfois incompatibles. L'accroissement de la puissance du pape est bénéfique à la première, mais à la seconde, sans nul doute, dangereux. Pour Canaye de Fresnes, les prétentions romaines sont irrecevables: «Qui joindra la prudence Politique à l'estude des Loix & des Canons reconnoistra avec moy que ce seroit une entreprise bien haute de vouloir faire un monde nouveau & hurter toutes les Couronnes de la Chrestienté.»51 L'analyse de Canaye de Fresnes se montre consciente d'un désaccord, à l'intérieur de la république chrétienne, entre les prémices de l'absolutisme des puissances temporelles et une papauté moderne qui tente de faire son profit du tridentinisme.
La tridentinité ecclésiale, parce qu'elle impose la catholicité romaine comme note critériologique d'appartenance confessionnelle, tend à reléguer le paradigme de Christianitas pour le remplacer par celui de la Romanitas - en un déplacement symbolique dont l'Interdit vénitien met en lumière le caractère concerté. Pour Canaye de Fresnes et les défenseurs de la Sérénissime, le Saint-Siège cause réversion d'un ordre de Chrétienté rétabli à grand-peine au lendemain des paix de Vervins (1598) et de Lyon (1601); l'Église est présentée en puissance conquérante aux ambitions universelles: «Veronne & Bresse ont remonstré de mesme que l'Eglise continuant à tousjours acquérir sans jamais rien aliéner, elle ne tardera plus guère à depoiiiller entièrement les autres Estais, & demeurer seule Dame de toute la terre.»52 L'universalité de Chrétienté a été cyniquement récupérée par un primat romain qui se veut monarchie universelle. Dès lors, l'Interdit vénitien est un événement qui concerne l'ensemble de la Christianitas: «Les rigoureuses demandes de Sa Saincteté n'offencent pas seulement la souveraineté de la Republique, mais hurtent également tous les Estats & Couronnes Chrestiennes.»53 Conflit de Chrétienté, l'Interdit l'était naturellement -caractéristique que les Vénitiens se sont efforcés de renforcer afin d'intéresser à leur sort les autres princes chrétiens.
Ce qui transparaît dès à présent à travers la conscience des protagonistes favorables à Venise - telle que le témoignage de Canaye de Fresnes permet de la saisir - est le sentiment qu'au début du xvne siècle, la papauté a cru pouvoir réaliser les virtualités politiques recelées par un tridentinisme auquel s'opposaient les catholiques critiques.
50. Canaye de Fresnes à d'Alincourt, Venise, 15 avril 1606, ibid., p. 2. 51./Ш., p. 3. 52. Canaye de Fresnes à Henri IV, Venise, 15 avril 1606, ibid., p. 7. 53. Ibid., p. 7-8.
pE n° 4, 2004
La diplomatie henricienne et les ambitions françaises ... 565
Le Saint-Siège semble être devenu l'ennemi de la Chrétienté. Dans le combat qui est mené lors des événements vénitiens se joue aussi le sort de la modernité européenne. Du catholicisme critique, la conviction que le pouvoir romain revendique la détention de YImperium mundi est patente. La puissance pontificale est accusée d'être déséquilibre destructeur d'un ordre mythique de Christianitas où temporel et spirituel étaient censés coexister harmonieusement pour assurer le salut des fidèles.
Primauté romaine et monarchie universelle Après l'affaiblissement de l'idée impériale, qui demeure désormais seulement
latente au début du XVIIe siècle - ainsi que l'a montré Alexandre Yali Haran 54 -, la primauté romaine a vu se libérer devant elle un champ ouvert à la possible réalisation de ses revendications de domination universelle 55.
La défense des intérêts vénitiens, renforcée par le développement d'un étatisme chrétien, a pu légitimement intéresser les catholiques critiques. Pour Canaye de Fresnes, Venise est obstacle ultime à l'érection du dominium uniuersale auquel aspire l'Eglise de Rome. Il l'écrit à Henri IV le 15 avril 1606: «Le commun des Sénateurs dient en pleine place que le Pape bute à se faire seul Monarque Souverain tant du temporel que du Spirituel, & tous autres Roys & Princes subalternes & relevans de luy.»56 A l'attention du secrétaire d'État Villeroy, Canaye de Fresnes souligne le 20 avril le danger qu'encourt la Christianitas en raison des prétentions hégémoniques affichées par le pape. Il informe son supérieur qu'après la publication romaine de la bulle d'excommunication, les Vénitiens ont pris des mesures pour en interdire la diffusion sur le territoire de la République: ils ont même fait courir le bruit que le collège des cardinaux désapprouvait le procédé du souverain pontife, «qui ne tend qu'à se faire Monarque du Temporel & Spirituel, & après avoir foulé aux pieds la liberté de cette Republique, faire le mesme des autres Couronnes de la Chrestienté»57. Le spectre de la théocratie pontificale, en soi désagrégation de l'idéal de Christianitas, hante l'esprit des contemporains, qui ont pu ainsi trouver la justification d'un catholicisme critique. Son désir de monarchie universelle empêche le pontife romain d'être garant d'un ordre de Chrétienté dont la protection est finalement remise aux autorités temporelles. S'il importe «à l'honneur du Sainct Siege & au bien de toute la Chrestienté»58 qu'il n'y ait pas
54. Voir A.Y. Haran, Le lys et le globe. Messianisme dynastique et rêve impérial en France aux XVle et xviř siècles, Paris, 2000, chap. VI, «La thématique impériale au XVIIe siècle», p. 215-268. Sur l'idée impériale, consulter W. Goez, Translatio Imperii. Ein Beitrag zur Geschichte des Geschichtsdenkens und der politischen Theorien im Mittelalter und in der friihen Neuzeit, Tubingen, 1958 et F. A. Yates, Astrœa. The Imperial Theme in the Sixteenth Century, Londres-Boston, 1975, Astrée. Le symbolisme impérial au xvie siècle, trad, fr., Paris, 1989.
55. Sur la généalogie médiévale du concept de monarchie universelle, voir F. Baethgen, «Zur Geschichte der Weltherrschaftsidee im spàteren Mittelalter», Festschrift fur Percy Ernst Schramm zu seinem Siebzigsten Geburtstag, 1. 1, Wiesbaden, 1964, p. 189-203 et О. Hageneder, «Weltherrschaft im Mittelalter», Mitteilungen des Instituts fur Osterreichische Geschichtsforschung, 93, 1985, p. 257-278. Sur l'idée de monarchie universelle à l'époque moderne, consulter R. De Mattei, «Polemiche secentesche italiane sulla monarchia universale», Archivio storico italiano, CCCXCVIII, 1952, p. 145-165 et F. Bosbach, Monarchia Universalis. Ein politischer Leitbegriff der Friihen Neuzeit, Gôttingen, 1988, Monarchia Universalis. Storia di un concetto cardine délia politica europea (secoli xvi-xviu), trad, ital., Milan, 1998. Pour une mise en rapport de l'idée d'Europe et du concept de monarchie universelle, voir J. Bérenger, «La Monarchie universelle de Charles Quint», Imaginer l'Europe, op. cit., p. 71-91 et K. Malettke, «L'équilibre européen face à la monarchia universalis: les réactions européennes aux ambitions hégémoniques», ibid., p. 117-124.
56. Canaye de Fresnes à Henri IV, Venise, 15 avril 1606, dans P. Canaye de Fresnes, Lettres et ambassades, t. III, op. cit., p. 8.
57. Canaye de Fresnes à Villeroy, Venise, 20 avril 1606, ibid., p. 14. 58. Canaye de Fresnes à Henri IV, Venise, 15 avril 1606, ibid., p. 9.
n° 4, 2004
566 Sylvio Hermann De Franceschi
rapture entre le pape et la Sérénissime, et s'il est probable que «ce scandale ne produira autre bien que de faire reconnoistre que la corruption qui se voit à Rome & à Venise, plus qu'en aucun autre lieu de la Chrestienté, attire sur soy le jugement de Dieu»59, il n'en demeure pas moins que la fidélité au prince est désormais l'un des nouveaux fondements de l'appartenance à la Christianitas, puisque Rome, autrefois axis mundi, a failli à sa mission. Pour les catholiques critiques, le tridentinisme a engendré la volonté de puissance universelle développée par la chaire de saint Pierre et ses détenteurs; il a été reniement de Chrétienté, à la conservation de quoi le bras séculier est alors en charge de parvenir, parce que seul capable de l'assurer.
Le basculement paradigmatique du spirituel au temporel qui affecte soudainement la représentation de la Christianitas est manifeste chez Canaye de Fresnes dès les débuts de l'Interdit - par où peut être mise en lumière son appartenance à la mouvance des catholiques critiques. Henri IV a remplacé l'Empereur à la tête de la république chrétienne, mais il est aussi de droit gardien du corpus Christianům, il se substitue insensiblement au pape: «Dieu a orné nostre grand Maistre exprez des graces extraordinaires pour subvenir aux nécessitez extraordinaires de la Chrestienté.»60 Defensor Christianitatis, le souverain français converti à la religion romaine l'est devenu après la venue à résipiscence du duc de Bouillon, dont le rêve d'une union protestante au sein du royaume de France a été brutalement anéanti. Henri IV reçoit le 6 avril 1606 à Sedan la reddition de son ancien compagnon d'armes. Le roi est confirmé en son intitulation de Très-Chrétien. Depuis Venise, Canaye de Fresnes y voit le signe d'une salvatrice mission de Christianitas remise par Dieu à son souverain. Le succès du voyage de Sedan a délivré «en un instant vos voisins & vos subjects, voire toute la Chrestienté, des diverses apprehensions que chacun se donnoit de vos desseins, de sorte que toute l'Europe admire également en cette action la prudence de vos conseils, la diligence de vos executions & la plus qu'humaine bonté de vos jugemens»61. Surhumaine, la puissance d'Henri IV est le signe d'une élection divine dont doivent être conscients les pouvoirs européens - ici, Europa est encore synonyme de Christianitas. Entre Venise et la papauté, l'entremise du roi de France semble la plus naturelle, mais aussi la plus désirable pour les princes qui veulent éviter un accroissement de la puissance espagnole en Italie. Le 18 mai, Canaye de Fresnes rend compte à Henri IV d'une récente entrevue avec l'ambassadeur toscan Guicciardini : «Ne sçachant par quel bout commencer à dévider ce peloton, il concluoit que la gloire & tout l'honneur de cet accommodement estoit réservé à Vostre Majesté.»62 Au cours de l'Interdit vénitien s'effectue une translatio capitis tempo ralis Christianitatis par quoi la France supplante l'Espagne comme lieu d'élection naturelle du corpus christianum. Pour Canaye de Fresnes, la rameur est mensongère selon quoi Francesco Priuli, ambassadeur de Venise auprès d'Henri IV, ne trouve pas à Paris le soutien qu'il souhaite avoir; des besoins de Christianitas, le roi de France est trop conscient pour pouvoir hésiter, rien ne peut l'empêcher «de rendre en ce besoin à la Chrestienté ce qu'elle peut désirer d'un Prince esleu exprèz pour pourvoir à toutes ses nécessitez»63. La diplomatie française cherche à imposer l'idée de la nécessaire médiation henricienne en un conflit dont le règlement est, pour le catholique critique, du ressort exclusif d'une autorité temporelle surémi-
59. Canaye de Fresnes à Villeroy, Venise, 20 avril 1606, ibid., p. 15. 60. Canaye de Fresnes à d'Alincourt, Venise, 29 avril 1606, ibid., p. 21. 61. Canaye de Fresnes à Henri IV, Venise, 3 mai 1606, ibid., p. 22. 62. Canaye de Fresnes à Henri IV, Venise, 18 mai 1606, ibid., p. 37. 63. Ibid., p. 38.
&E n° 4, 2004
La diplomatie henricienne et les ambitions françaises . . . 567
nente au sein de la Chrétienté. Le princeps christianus, le souverain en Christianitas, n'est plus obligatoirement l'allié inconditionnel d'une papauté éversive de l'harmonie chrétientaire. La définition du prince chrétien en acquiert une autonomie fondamentale à l'âge pré-absolutiste.
Ambitieux de monarchie universelle, le pontife romain perd son rôle de gardien en Chrétienté -perte inévitable puisque, moderne elle aussi, l'institution pontificale issue du concile de Trente s'est jugée capable de se faire juge et partie dans un conflit où s'affrontent raison d'État et raison d'Église. Parce qu'il est descendu dans l'arène où les pouvoirs temporels sont en compétition, le pape libère la place d'un chef eminent de Christianitas pour laquelle diplomaties espagnole et française luttent au cours des événements vénitiens.
La romanité pontificale et l'ombre du schisme Pour les catholiques critiques, hostiles à un tridentinisme accusé non seulement
d'avoir manqué à ses devoirs de réforme ecclésiale mais aussi d'avoir engendré une crise de la Christianitas, l'Interdit vénitien est l'illustration d'une configuration politique où le Saint-Siège est devenu facteur de troubles en Chrétienté; d'elle, le pape renie la capacité d'encadrement religieuse et civile pour favoriser le schisme, sa négation dernière.
Le renversement des perspectives est diamétral, la tridentinité n'est pas un sauvetage de Christianitas mais sa perdition. Exagérément soumis à l'autorité romaine, Trente n'a été qu'une assemblée particulière - non pas le Concile, auquel les Vénitiens semblent vouloir adresser leur appel de la sentence excommunicatoire fulminée par Paul V : « Ils délibèrent maintenant s'ils doivent appeller de ladite excommunication au Concile ou s'ils se doivent contenter d'avoir fait sçavoir qu'ils la tiennent pour nulle & abusive.»64 La nouvelle intransigeance du siège romain est source de déchirements à venir dans la Chrétienté. La réforme catholique est un échec, de la seule responsabilité des souverains pontifes, tributaires, il est vrai, de la politique espagnole. De la Christianitas, le pape favorise un éclatement schismatique. Pour Canaye de Fresnes, le risque n'est pas mince, puisque les Vénitiens entendent publier «un Manifeste de leur justification pour en informer le peuple, qui sera, si Dieu n'y pourvoit, le commencement d'un grand & dangereux schisme»65. En une terrible réminiscence, la plume du diplomate évoque l'excommunication du roi Henry VIII d'Angleterre - à l'origine de la rupture anglicane. Pour les catholiques critiques, la papauté tridentine est susceptible de provoquer un comportement schismatique jusqu'en Italie, centre de Christianitas', à Venise circulent des écrits contre l'autorité pontificale qui font craindre «que cette excommunication n'ait aussi mauvais succès en Italie comme eut celle du Roy Henry VIII d'Angleterre, n'y ayant pas faute de matière par deçà disposée à produire pareils ou plus dangereux effects» 66. La paix de Chrétienté est ignorée par l'institution qui devait, plus que n'importe quelle autre, la préserver - le Saint-Siège. Parce qu'il a créé une papauté excessivement fière de ses nouvelles prérogatives, Trente, impuissant à réformer la communauté ecclésiale, se révèle cause prochaine d'une destruction de la cohésion chrétientaire. La contenance impassible de Paul V engendre une solidarité monstrueuse entre Venise et les anglicans; en témoigne Canaye de Fresnes: «L'ambassadeur d'Angleterre dit en plein College qu'il se resjouyssoit de ce que la Republique
64. Canaye de Fresnes à Henri IV, Venise, 3 mai 1606, ibid., p. 25. 65. Ibid., p. 25. 66. Ibid., p. 25-26.
n° 4, 2004
568 Sylvio Hermann De Franceschi
commencent à se douloir de la tyrannie du Pape & à connoistre son ambition démesurée d'où procedoient tous les maux de la Chrestienté.»67 La conscience anglaise de Chris- tianitas n'est que déguisement: pour Jacques Ier, qui, au lendemain de la Conspiration des Poudres du 5 novembre 1605, a imposé à ses sujets catholiques la prestation d'un serment d'allégeance à l'autorité royale, le conflit vénitien est surtout une occasion inespérée de contrer l'influence diplomatique du pouvoir romain.
Dans l'espace italien, l'effroi du schisme acquiert des résonances démultipliées. Pour les catholiques critiques, la nouvelle libido dominandi du souverain pontife est un déséquilibre majeur de la Christianitas. Le pape a abandonné son rôle de père commun -fonction qui était fondatrice de l'ancienne représentation organique de Chrétienté - pour porter ses censures dans une précipitation irréfléchie selon Canaye de Fresnes: «Je ne croy point qu'il reste autre expedient pour éviter un schisme tout entier sinon que le Pape, donnant lieu à la charité Pastorale & cédant comme un bon Pere à la protervité de ses enfans, quite volontairement la verge & reprenne un parler plus gracieux.»68 Par l'Interdit vénitien se révèle la contradiction de l'ancien idéal de Chrétienté et d'une réalité tridentine qui lui est incompatible. Les catholiques critiques en sont conscients, puisqu'ils tentent la réhabilitation d'une représentation de Christianitas qui était, après Trente, en voie de péremption : « Dieu veuille que ces commence- mens ne soient suivis de consequence trop plus préjudiciable à la Chrestienté que tout ce qui a causé cette monstrueuse rupture», écrit Canaye de Fresnes à ď Alincourt 69. Catholique, parce qu'il refuse le schisme, mais sévère à l'égard d'une papauté irresponsable dans son appétit de puissance, le diplomate s'est résolument détaché de ses anciens coreligionnaires protestants sans se faire antiromain. Terrifié par une éventuelle pluralité confessionnelle en Italie, Canaye de Fresnes condamne la publication d'ouvrages qui défendent les droits des Vénitiens en attaquant la primauté romaine et qui «porteront sans doute bien plus de prejudice à l'authorité Pontificale que ne fera l'excommunication à l'Estat Vénitien.»70 Antitridentin catholique, Canaye de Fresnes n'est pas gallican. Dans son choix de 1601, il y avait sans nul doute l'allégeance du fidèle au Saint-Siège, mais aussi une conviction de Chrétienté qui le porte ensuite à blâmer le comportement politique du chef spirituel de la communauté ecclésiale.
Aux catholiques critiques, le respect de l'idéal chrétientaire est nécessité. Pour eux, la Christianitas est une réalité à construire et à défendre, tandis que doit être éradiqué le risque de schisme. D'où la perplexité de Canaye de Fresnes face aux développements de l'Interdit vénitien: «II faut advouer qu'il y a quelque jugement divin en cecy qui empesche les uns & les autres de se prévaloir de leur prudence ordinaire, & qui les porte à une iliade d'inconvénients pour une Heleně de si peu de mérite qu'il ne se trouve point d'exemple en toute l'Histoire du passé que pour chose si légère la Chrestienté ait esté troublée.»71 L'ancien protestant revenu dans l'Église romaine n'est pas défenseur de la raison d'État - à la différence des tenants d'un étatisme chrétien -, il a pris acte de son existence, mais il ne pense pas qu'elle vaille qu'on lui sacrifie l'ordre traditionnel d'une Christianitas dont elle paraît ignorer contraintes éthiques et aspirations unitaires: «Sur cette belle question l'Italie est sur le poinct de produire un monstrueux schisme, qui sera (si Dieu n'y met la main) de trop périlleuse consequence
67. Ibid., p. 26. 68. Canaye de Fresnes à ď Alincourt, Venise, 6 mai 1606, ibid., p. 31. 69. Canaye de Fresnes à d'Alincourt, Venise, 13 mai 1606, ibid., p. 32. 70. Canaye de Fresnes à d'Alincourt, Venise, 6 mai 1606, ibid., p. 31. 71. Canaye de Fresnes à Henri IV, Venise, 18 mai 1606, ibid., p. 33.
n° 4, 2004
La diplomatie henricienne et les ambitions françaises . . . 569
à toute la Chrestienté que celuy de tous les hérétiques de ce temps. » 72 Calviniste, Canaye de Fresnes ne l'est plus; il est devenu catholique, mais sans avaliser la construction tridentine d'une papauté trop avide d'accroître démesurément sa puissance. Il faut insister sur le sentiment que les contemporains ont eu d'assister à une mutation inattendue de l'institution pontificale. La proximité ressentie par Canaye de Fresnes à l'égard du combat entamé par les Vénitiens y trouve peut-être son explication la plus logique. L'ambassadeur demeure persuadé que la fragilisation de la Chrétienté est susceptible d'entraîner en retour une dissolution du charisme papal et de provoquer l'effondrement de la structure hiérarchique de l'Église - ce qu'aux fidèles, critiques ou non, il est besoin de conjurer. L'ancien huguenot défend la conception d'une Chrétienté où spirituel et temporel cohabitent paisiblement en garantissant l'un pour l'autre stabilité et légitimité.
Une romanité doctrinale en définitive modérée, qui s'exprime à travers la peur irrépressible du schisme et le souci de maîtriser les débordements du pouvoir pontifical, caractérise, lors de l'Interdit vénitien, les positions d'un catholicisme critique qui rejette les acquis ecclésiologiques tridentins.
Parce qu'il a remis le soin de la confirmation et de l'interprétation de ses canons au pontife romain, le récent concile a paradoxalement -compte tenu du fait que le conciliarisme est né d'une volonté de brider la puissance du successeur de saint Pierre - favorisé l'édification d'une papauté omnipotente dans l'Église; il a aussi entraîné, aux yeux des catholiques critiques, un déséquilibre maladif de la Chrétienté. Contre les protestants, qui ont développé une vision de la réforme ecclésiale par rupture, les fidèles de l'Église romaine qui refusent le tridentinisme se font les tenants, ainsi que l'a montré Thierry Wanegffelen, d'une évolution par continuité73. Anachronique, leur défense de l'ancien idéal de Christianitas est cohérente avec leur choix confessionnel; elle illustre leur refus de la nouvelle catholicité imposée par le déploiement romain des décisions conciliaires.
Les contradictions ecclésiologiques de la catholicité tridentine
La question a souvent été posée de l'existence d'une doctrine ecclésiologique volontairement produite par le concile de Trente. Pour les représentants du catholicisme antiromain, Paolo Sarpi au premier rang, les décrets tridentins sont porteurs d'une ecclésiologie qui est plus déformation que réformation -position retenue par leurs coreligionnaires critiques. Confrontée à une problématique ouverte, l'historiographie a longtemps renoncé à trancher74. À en croire Yves Congar, Trente n'a pas accouché d'une œuvre ecclésiologique - qui a été finalement réalisée par Robert Bellarmin dans ses Disputationes de controuersiis christiance fidei publiées entre 1586 et 1593. Si Giuseppe Alberigo n'a pas mis en cause une conception largement dominante, il a néanmoins souligné la présence latente d'un contenu de Ecclesia dans les canons tri-
72. Ibid., p. 34. 73. Voir T. Wanegffelen, Une difficile fidélité, op. cit., «Fidélité et continuité catholiques: la réforme,
non la rupture», p. 57-67. 74. Voir essentiellement G. Alberigo, «L'ecclesiologia del concilio di Trento», Rivista di Storia délia
Chiesa in Italia, XViil/2, 1964, p. 227-242 et Y. Congar, «Romanité et catholicité. Histoire de la conjonction changeante de deux dimensions de l'Église», Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques, LXXI/1, 1987, p. 161-190. Le débat a été largement repris dans H. Jedin et P. Prodi (din), II concilio di Trento come crocevia délia politica europea, Bologne, 1979, en particulier P. Prodi, «La sovranità temporale dei papi e il concilio di Trento», ibid., p. 65-83 et B. Ulianich, «II significato politico délia Istoria del Concilio Tri- dentino di Paolo Sarpi», ibid., p. 179-213.
n° 4, 2004 Mb
570 Sylvio Hermann De Franceschi
dentins -sous-entendue, mais présente, une définition essentielle de l'Église romaine, une, sainte, catholique et apostolique, selon les termes du Credo, comme lieu naturel où se construit le rapport religieux des chrétiens. Il s'agit plutôt d'un postulat que de l'expression d'un enseignement littéralement formulé: pour Giuseppe Alberigo, le concile n'a pas voulu fonder une ecclésiologie ; quand il a été obligé d'en aborder des aspects spécifiques, il l'a fait, avec prudence; il n'y a eu de définitions qu'implicites - dont les virtualités ont été ensuite exploitées pour remplacer l'ancienne représentation de Christianitas par la catholicité ecclésiale. Le rapport entre les deux entités doit être au centre d'une caractérisation du catholicisme critique.
Le scandaleux effondrement de l'ordre chrétientaire Avant l'essor du protestantisme, le caractère organique de la république chrétienne
se fondait sur un besoin de religieuse unanimité; il s'était exprimé de tradition immémoriale sous la forme de la Chrétienté -partiellement reléguée, ainsi que l'a noté Alphonse Dupront, au profit de l'intronisation tridentine d'une catholicité qui lui est désormais instance concurrente.
La compétition des deux représentations est vive à suivre les analyses proposées par Canaye de Fresnes au fur et à mesure que se déroule le conflit de la Sérénissime avec le Saint-Siège. L'ambassadeur déplore l'unité perdue de la Christianitas; dans une louable volonté de défendre leur souveraineté et leurs libertés contre les prétentions romaines, les Vénitiens ont fini par dépasser les pires outrances de la Réforme; leurs justifications publiées contiennent «des paroles autant contraires à l'authorité Pontificale que jamais les Protestants d'Allemagne en ayent publié, quoy qu'en apparence elles ne s'addressent qu'à la personne & non au Sainct Siege»75. Le comportement vénitien n'est pas encore schisme, mais il est déjà scandaleux - du latin scandalum, pierre d'achoppement ou ce qui fait tomber dans le mal, repris du grec skandalon, piège, devenu sous l'influence de ses emplois bibliques occasion de péché. Le scandale est une porte ouverte au schisme; le mot revient sans cesse sous la plume de Canaye de Fresnes, qui appelle les souverains à y remédier: «Tous les Princes Chrestiens, & nostre Maistre plus que tous, taschent à jetter de l'eau sur ce feu; j'ay opinion qu'ils n'en viendront pas si-tost à bout & que Dieu n'a permis ce scandale qu'il n'en veuille tirer quelque grand effect.»76 Scandalum dans la Chrétienté, l'Interdit lancé par le pape est réversion d'un ordre qu'il fallait protéger; il favorise l'éclatement confessionnel d'un espace dont il convenait de préserver la paix. Pour Canaye de Fresnes, le souverain pontife s'est fait fauteur de troubles en Christianitas par sa bulle: il n'en peut espérer «d'autre fruict que la dissipation d'une notable partie de son troupeau, un mespris manifeste de son authorité, & une mer de scandales prodigieux, dont il est à craindre qu'il ait un jour à respondre » 77. Par le surcroît de puissance obtenu au lendemain du concile de Trente, la papauté s'est vu remettre proportionnelle responsabilité de Chrétienté, dont les catholiques critiques tirent profit en 1606: responsable de l'Interdit, le pontife romain l'est aussi du scandale, il en est l'auteur désigné, il est le coupable recherché. À lui, comme aux Vénitiens, Canaye de Fresnes fait obligation de se repentir pour que cessent les troubles en Italie, c'est-à-dire en Chrétienté: «Je seray fort trompé si ce mal, après avoir dormy quelque temps, n'esclate en fin au scandale de toute la
75. Canaye de Fresnes à Caumartin, Venise, 19 mai 1606, dans P. Canaye de Fresnes, Lettres et ambassades, t. III, op. cit., p. 42.
76. Ibid., p. 42. 77. Canaye de Fresnes à Henri IV, Venise, 29 mai 1606, ibid., p. 52.
Sp n° 4, 2004
La diplomatie henricienne et les ambitions françaises ... 571
Chrestienté & à la desolation de l'Italie.»78 Dans la conception organique de la Chris- tianitas qui sous-tend les analyses des catholiques critiques, en particulier de Canaye de Fresnes, le corps entier est attaqué par la maladie de l'une de ses parties. Roi en Chrétienté superlativement, Henri IV doit agir pour mettre fin à un scandale qui, pour être éloigné de son royaume, ne l'en touche pas moins. Le souverain, ému par «la consideratione dello stato universelle délia Christianitá & il danno particolare che riceve la Francia da questo enormissimo scandalo»19, ne peut que s'attacher «a mirar piú tosto all' obligo di Re Christianissimo ch'alla dignita o riputatione sua propria» 80. Le scandale est maladie; fléau engendré par les ambitions de la papauté, il se répand par contagion. La métaphore corporelle revient subitement dans le discours de Canaye de Fresnes pour regretter le triste état de «l'Église catholique» -comme si de Chrétienté, alors, il ne pouvait plus être question; l'ambassadeur déplore les méfaits d'un siècle qui «au lieu de travailler à cicatrizer les vieilles playes de ce beau corps d'Église Catholique, descrie & ulcère ce qui y restoit de plus entier; Dieu pardonne à qui est cause d'un si grand scandale & si dangereux mal, ou plustost le descouvre à sa confusion & punition»81. Pour les catholiques critiques, l'Interdit vénitien a administré la preuve que la papauté tridentine n'était pas service ministériel de la république chrétienne, mais plutôt la cause de son déséquilibre.
Le paradigme pontifical sur lequel s'était bâtie la modernité tridentine a été fragilisé. L'idéal de la Christianitas s'est effondré sous le choc produit par la manifestation d'une papauté qui s'investit massivement dans les affaires d'ici-bas. La Chrétienté est dissociée de l'idée de croisade parce que le Turc est dans ses murs, non plus en son au-delà. Pour les catholiques critiques, la romanité ecclésiale fait le jeu de l'Infidèle. Quand en septembre 1606 le pape fait entreprendre des préparatifs de guerre pour intimider les Vénitiens, l'effroyable comparaison s'impose. À Canaye de Fresnes, le doge Leonardo Donà déclare froidement: «Un qui estoit nagueres icy (e'estoit l'ambassadeur d'Angleterre) a eu raison de dire que Sa Saincteté se conforme plus à l'exemple & doctrine Turquesque qu'à celle des Apostres, car c'est une maxime Tur- quesque de ne disputer de la Religion que par les armes, & c'est chose estrange que le Pape les veuille employer pour persuader au monde que ce qu'il dispute contre la Republique interesse l'honneur de Dieu & la foy Catholique.»82 À point, dans le discours du Doge devant l'ambassadeur, la Christianitas surgit surabondamment - comme pour souligner davantage la monstruosité du geste pontifical. Inquiétée par les intentions belliqueuses du pape, la Sérénissime supplie le roi de France de vouloir s'employer à «preserver la Chrestienté des maux qu'une si estrange & si précipitée resolution de Sa Saincteté produirait» 83. La dénonciation d'une papauté qui favorise les infidèles est patente dès les débuts de l'Interdit. Pour garantir l'impartialité de l'entremise proposée par son souverain, Canaye de Fresnes rappelle qu'Henri IV a eu l'occasion de subir lui-même les foudres excommunicatoires du souverain pontife: «Qui ne sçait que les Papes ont plus dépendu pour vous despouiller de vostre heritage paternel qu'ils n'ont jamais fait contre le Turc?» 84 Paul V devient un moderne Jules II, le pape guerrier par
78. Canaye de Fresnes à Villeroy, Venise, 28 juin 1606, ibid., p. 95. 79. Canaye de Fresnes à Welser, Venise, 7 juillet 1606, ibid., p. 108. 80. Ibid., p. 108. 81. Canaye de Fresnes à Salagnac, Venise, 8 février 1607, ibid., p. 440. 82. Canaye de Fresnes à Henri IV, Venise, 20 septembre 1606, ibid., p. 209. 83. Ibid, p. 209. 84. Canaye de Fresnes à Henri IV, Venise, 26 juillet 1606, ibid, p. 135.
H_
572 Sylvio Hermann De Franceschi
excellence. Cyniquement, ainsi que la rumeur publique l'en accuse à Venise au mois de juin 1606, le premier des évêques, le chef spirituel de la Chrétienté, n'hésite pas à abandonner l'entreprise croisée pour concentrer ses forces contre la Sérénissime. Le bruit court que «Sa Saincteté exhorte l'Empereur de faire la paix avec ses rebelles & la trefve avec le Turc, & qu'il tourne ses forces contre cette Republique.» 85 L'ancienne dyarchie de Chrétienté, l'autorité pontificale et le pouvoir impérial, pour une fois réunie, montre la démoniaque intention de faire la paix avec l'Infidèle pour mieux combattre des membres de l'Église; au grand scandale des catholiques critiques, la Christianitas n'est plus qu'un souvenir affaibli dont l'efficace a cessé de définir les actions de ceux qui en étaient les protecteurs naturels. De croisade et Chrétienté, la liaison est désormais impossible: le pape et l'Empereur ne font plus guerre à l'Infidèle, mais aux Vénitiens. Canaye de Fresnes le déplore, qui appelait en 1601 à une réunion des princes chrétiens contre l'ennemi musulman. Blasé, il constate le 6 octobre 1606 que « le miserable estât du Turc donne grande occasion à la Chrestienté de gémir de ce que ses chefs ne pensent à s'en prévaloir» 86. Le corpus Christianům a été trahi par ses deux têtes, la spirituelle et la temporelle. Elles ont chacune délaissé leur mission d'accomplissement du salut.
À l'évidence, le catholique critique continue à rêver de croisade; se trouve sans doute là l'une des raisons qui le pousse à souhaiter la restauration d'une Chrétienté effondrée sous le poids des scandales. La catholicité moderne n'est pour lui qu'une pâle substitution.
Chrétienté et catholicité: deux représentations concurrentes L'âge posttridentin est le temps d'une concurrence entre les deux représentations
de Chrétienté et de catholicité. Nouvelle venue, la seconde est plus partielle que celle qui Га précédée; elle exclut par définition l'hérétique, elle ne comprend plus nécessairement le projet croisé.
Le rapport des deux instances concurrentes est crucial pour tenter de définir le catholicisme critique d'un ancien protestant converti à la romanité ecclésiale. Chez Canaye de Fresnes, la catholicité apparaît comme une appartenance superlative à la Christianitas, qui englobe et donc dépasse le cadre de la respublica catholica. De la Chrétienté, le Turc est l'ennemi naturel 87, de l'hérétique aussi, même si le geste excommunicatoire du pape peut aboutir à l'alliance temporaire du protestant et du musulman: «Sera-t-il donc dit que le Pape n'ait colère ny amertume que contre les plus francs Catholiques & qu'au lieu de se servir des armes Chrestiennes contre les vrays ennemis de la Chrestienté, il les veuille tourner contre sa propre patrie & appeller la fureur des hérétiques & infidelles à la dissipation de son troupeau?» 88 Amoindrissante émanation de Christianitas, la catholicité n'a plus besoin d'unanimité pour exister. Elle est moins sensible aux effets du scandale, elle ne prétend pas à un caractère organique. Avec pudeur significative, Canaye de Fresnes renonce parfois à évoquer la Chrétienté en face de la catholicité pour user de la notion plus neutre d'Europe: «Pour vous dire franchement ce que je recognois de l'opinion commune & des meilleurs &
85. Canaye de Fresnes à Villeroy, Venise, 28 juin 1606, ibid., p. 93. 86. Canaye de Fresnes à d'Alincourt, Venise, 6 octobre 1606, ibid., p. 230. 87. Sur la représentation du Turc en France à l'âge baroque, voir F. Billacois, «Le Turc: image mentale
et mythe politique dans la France du début du XVIIe siècle», Revue de psychologie des peuples, XXI/2, 1966, p. 233-246.
88. Canaye de Fresnes à d'Alincourt, Venise, 15 juillet 1606, dans P. Canaye de Fresnes, Lettres et ambassades, t. III, op. cit., p. 124.
n° 4, 2004
La diplomatie henricienne et les ambitions françaises ... 573
plus doctes Catholiques qui soient en toute l'Europe, la vérité est, Monsieur, que nul de ceux qui osent dire ce qu'ils pensent n'approuve la sévérité de Sa Saincteté.»89 De la respublica catholica comme de la Christianitas, la romanité est une faiblesse. La défense du droit du pape dans l'affaire de l'Interdit vénitien ne peut légitimement s'appuyer ni sur la raison ni sur la foi. Père de la catholicité, le tridentinisme en est aussi fragilité. Facteurs de l'éclatement de la Chrétienté, les ambitions pontificales vont à terme ruiner la respublica catholica. Catholique, Venise l'est assurément: l'idéal de la Christianitas selon Canaye de Fresnes ressemble fort à une catholicité sans romanité. Fidèle mais critique, le diplomate renvoie l'Église tridentine face à ses contradictions. Pour lui, le pape n'a que peu de raisons de se plaindre «que tout le monde voye qu'il ait si rudement traicté une Republique si Catholique pour des raisons si peu fondées que les plus doctes plumes d'Italie n'en ont pu entreprendre la deffense qu'à leur confusion»90. Si un antiromanisme catholique est possible, il ne l'est que parce qu'il rejette la catholicité romaine pour espérer une restauration de l'ancienne idée de Chrétienté. Canaye de Fresnes n'est pas gallican, il n'en estime pas moins orthodoxes les Consider azioni sopra le censure di Paulo V contra la Republica di Venezia (1606) de Paolo Sarpi, qui condamnent sans appel les censures pontificales: «Je fais ce que je puis pour empescher l'impression de ce dernier escrit, quoy qu'en vérité il ne se puisse rien voir ny plus Catholique, ny plus modeste.»91 Grâce à l'Interdit, se dévoile une catholicité factice derrière laquelle se dissimule une romanité ecclé- siale qui est empêchement aux aspirations unitaires du corps chrétien.
Qu'il en ait été persuadé ou qu'il ait seulement fait semblant d'y croire pour les besoins de son argumentation, Canaye de Fresnes tend à assimiler son catholicisme critique et Г antiromanisme catholique des Vénitiens. Pour lui, la Sérénissime rejette la catholicité tridentine sans mettre en cause la primauté romaine in rebus spiritualibus. Les hérétiques ne doivent rien espérer de l'Interdit pour une éventuelle et future propagation italienne de leur confession erronée: «Ceux de Geneve se trompent à leur escient s'ils croient que cette Republique, deffendant sa liberté, ait jamais pensé à denier au Pape l'obeyssance qu'elle lui a rendue de tout temps en la spiritualité.»92 Illusions, sans doute, d'un fidèle critique mais non schismatique -qui ne peut décidément pas être conjoint aux représentants parisiens de la tradition gallicane-, puisque au lendemain de l'Interdit, les relations de Sarpi et des réformés se renforcent inexorablement. Pour Canaye de Fresnes, les Vénitiens restent catholiques ; dépositaires eux aussi du sort de la Chrétienté, ils refusent les avances de l'hérésie: «Ces Seigneurs sont Catholiques jusques à la moiielle & ne peuvent souffrir que le devoir qu'ils rendent à la deffense de la liberté favorise la rebellion & felonnie de ceux qui ont si témérairement desmembré l'union Chrestienne. » 93 Le balancement de la catholicité à la cohésion de Christianitas est ici particulièrement évident: Canaye de Fresnes a trouvé à Venise une sincère conscience de Chrétienté chez des catholiques antitridentins. Plus sympto- matique encore, l'hésitation entre Christianitas et union catholique que manifeste l'ambassadeur après la réconciliation du pape et de la Sérénissime: «Persuadendomi che la Beatitudine vostra non riceverâ in se stessa minor consolatione délia paterna clemenza usata da Lei verso cotesta Republica che tutta la Christianitâ, vengo con
$9. Ibid., p. 124. 90. Canaye de Fresnes à Villeroy, Venise, 5 octobre 1606, ibid., p. 229. 91. Canaye de Fresnes à Caumartin, Venise, 17 novembre 1606, ibid., p. 286. 92. Canaye de Fresnes à Caumartin, Venise, 3 novembre 1606, ibid., p. 262-263. 93. Ibid., p. 263.
574 Sylvio Hermann De Franceschi
questo a congratularmi con la Vostra Santitá del glorioso nome che ha acquistato appresso tutti gli amatori dell' unione Catholica di verissimamente ripresentante délia misericordia divina.»94 Ce qui est célébré avec la fin de l'Interdit est le retour de la concorde catholique refondatrice de Christianitas. Parce qu'il a cessé de s'obstiner, le souverain pontife peut être à nouveau père commun, et la respublica catholica Chrétienté. Les événements vénitiens n'ont été que péripéties qui n'ont pu imposer la disjonction de deux représentations qui menaçaient de devenir autonomes.
À l'époque posttridentine, la montée en puissance du complexe de catholicité est resistible. D'elle, l'ultime réalisation doit être Christianitas pour des catholiques critiques qui ne sont finalement pas autres fidèles que des chrétiens opposés au schisme, protestant ou catholique antiromain.
Les nouvelles instances du corps catholique D'un ancien hérétique récemment converti, la perception de la catholicité est pro
blématique. Sous la notion de catholicus gît sans nul doute l'étymologique universalité, mais pour Canaye de Fresnes, la Chrétienté seule est universelle: la respublica catholica n'est que l'émanation d'une vision separative et centrifuge qui a échoué à restaurer l'unité du corps chrétien.
À partir des rapports de proximité sémantique observés dans la correspondance de l'ambassadeur, il est possible de tenter un inventaire des instances propres à la catholicité et d'appréhender leur réception par les tenants d'un catholicisme critique. Il y a d'abord, pour eux, la reconnaissance de l'existence d'une foi spécifique, soit l'aveu de la constitution ségrégante d'un ensemble confessionnel. Catholiques, leurs convictions religieuses ne sont pas systématiquement inféodées aux décisions romaines. Le 2 juin 1606, Canaye de Fresnes proclame: «Combien que la docte Compagnie des Jésuites soit d'autre advis & deffende cette Bulle comme ouvrage du Sainct Esprit, si ne me puis-je persuader que le Sainct Esprit mette la main à chose où il y a tant à redire & qui importe si peu au bien de la foy Catholique.»95 La. fide s catholica ici invoquée par le diplomate n'est apparemment pas celle du concile de Trente, elle est plutôt l'âme d'un corps de Chrétienté démembré par les prétentions pontificales. Pour Canaye de Fresnes et les Vénitiens, une respublica catholica n'est concevable que si elle est aussi et surtout Christianitas. Romains, les défenseurs des prérogatives du pape et de son pouvoir indirect in rebus temporalibus ne sont catholiques que lorsqu'ils maintiennent que la puissance des souverains civils vient immédiatement de Dieu; a contrario, ainsi que l'indique véhémentement le Doge en présence de Canaye de Fresnes, ils cessent de l'être quand ils soutiennent que le successeur de Pierre peut diminuer ou accroître la puissance des autorités temporelles, «chose manifestement répugnante à la parole de Dieu, à la doctrine des saincts Peres & aux escrits mesmes de ceux qui ont de nostre temps catholiquement escrit de la puissance Papale, & du Cardinal Belarmin entr' autres» 96. Les théocrates pontificaux sont impitoyablement renvoyés face à leurs propres contradictions. Pour être étatiste chrétien, on n'en est pas moins catholique.
La foi se professe devant le monde, elle est religion. Deuxième complexe engendré par la naissance de la catholicité, la religio catholica est rare chez Canaye de Fresnes, mais présente. Indubitablement dans le siècle, elle est une institution - témoignage de
94. Canaye de Fresnes à Paul V, Venise, 4 mai 1607, ibid., p. 553. 95. Canaye de Fresnes à Caumartin, Venise, 2 juin 1606, ibid., p. 66. 96. Canaye de Fresnes à Henri IV, Venise, 30 juin 1606, ibid., p. 99-100.
SE n° 4, 2004
La diplomatie henricienne et les ambitions françaises . . . 575
la confessionnalisation ecclésiale: «Cette Republique veut que tout le monde cognoisse qu'elle est si ferme & constante en la religion Catholique que les injures qu'elle reçoit de Sa Saincteté ne la pousseront jamais à se départir du respect & obeïssance deuë au Sainct Siege.»97 Désormais envahissante, très proche de la notion de religio catholica, parfois à s'y confondre, mais beaucoup plus insolite que Christianitas, l'Église Catholique mène la catholicité. Elle est souvent assimilable à la Chrétienté. Le 11 août 1606, Canaye de Fresnes affirme: «Pour cette heure, Sa Majesté, préférant le bien general de l'Église Catholique à toute autre consideration, ne pense qu'à l'accommodement de ce fascheux différend.»98 Ecclesia catholica signifie ici Christianitas, mais elle est plus fréquemment encore une limite confessionnelle dont la visibilité s'incarne en hiérarchie institutionnelle, humaine et terrestre, comme le montrent les propositions vénitiennes transmises en novembre 1606 par Canaye de Fresnes: «La Republique protestera de se vouloir maintenir en l'union de l'Eglise Catholique & en obedience & respect deu à Sa Saincteté comme chef d'icelle & Vicaire de nostre Seigneur Jesus- Christ.»99 Partielle, la catholicité n'a pas vocation d'universalité, elle n'en peut revêtir la puissance. L'Église catholique fait partie de la Chrétienté, elle lui est subsumée. Du rapport de subordination qui est établi entre les deux représentations, Canaye de Fresnes est le témoin involontaire quand il félicite Henri IV le 21 avril 1607 du succès de sa médiation. Après avoir évoqué «la fin de cette grande & importante négociation, qu'il vous avoit pieu entreprendre pour le salut de toute la Chrestienté» 10°, l'ambassadeur se réjouit de voir fortifié le respect que l'Italie porte au roi de France: «II ne sera jamais au pouvoir de tous les siècles à venir d'effacer de la mémoire des hommes le singulier benefice que toute l'Église Catholique reçoit ce jourd'huy par le moyen de vostre Royale entremise.» 101 À la Christianitas, le réconfort salvifique, à Y Ecclesia catholica, le gain temporel — inégale répartition d'avantages qui est aussi significative d'une irréductibilité l'une à l'autre des deux entités.
Des aspirations universalistes du corps chrétien, la catholicité est par nature impuissante à assumer la réalisation. Si les catholiques critiques semblent avoir fait choix de Chrétienté, ils ont également pris acte de l'apparition des nouvelles instances induites par la tridentinité ecclésiale. Au princeps christianus s'est substitué le princeps catholicus. Dès le commencement de l'Interdit, Canaye de Fresnes affirme que les Français ne doivent pas rechercher autre honneur «que de nous estre loyaument acqui- téz du devoir que la Chrestienté peut attendre de nous en si importante occasion» 102; pour lui, « Г interest est general à tous les Princes Catholiques, aussi est-il nécessaire à mon advis qu'il soit traicté d'une commune main» 103. Le princeps christianus était en charge du salut terrestre de la Chrétienté, le princeps catholicus défend l'Église romaine parce qu'elle lui est facteur de légitimité; l'un acceptait ses obligations, l'autre est intéressé. Les princes catholiques sont autorités purement temporelles, le pape est le premier d'entre eux. Le princeps christianus subit une indubitable désacralisation de sa fonction — de chrétien, il est devenu catholicus -, patente à lire Canaye de Fresnes au moment où, en octobre 1606, la crise vénitienne semble irrémédiable: «Ce qui
97. Canaye de Fresnes à Henri IV, Venise, 2 juin 1606, ibid., p. 61. 98. Canaye de Fresnes à Caumartin, Venise, 11 août 1606, ibid., p. 161. 99. Canaye de Fresnes à d'Alincourt, Venise, 5 novembre 1606, ibid., p. 268. 100. Canaye de Fresnes à Henri IV, Venise, 21 avril 1607, ibid., p. 540. 101. Ibid., p. 540. 102. Canaye de Fresnes à d'Alincourt, Venise, 27 mai 1606, ibid., p. 49. 103. Ibid., p. 49.
576 Sylvio Hermann De Franceschi
retient les parties d'en venir aux mains, c'est que Sa Saincteté en a peu de moyen s'il n'est aydé d'ailleurs; & les Vénitiens craignent d'irriter Sa Majesté & tous les Princes Catholiques s'ils s'y jettent les premiers.» 104 Le princeps christianus devait entreprendre la croisade contre l'Infidèle; son successeur peut guerroyer en Chrétienté, mais il se discrédite définitivement aux yeux des catholiques critiques. Ultime instance mondaine de la catholicité, la Monarchia caîholica revendiquée par le roi d'Espagne est illégitime: «Ce qui rend cette négociation plus difficile, c'est la jalousie Espagnole, qui ne peut supporter de s'en veoir excluse & que tout le monde recognoisse qu'elle est encore bien loin de cette imaginaire monarchie Catholique dont elle pensoit estre en paisible possession.» 105 Pour Canaye de Fresnes, la Chrétienté est une réalité perdue qu'il convient de restaurer; tronquée, la catholicité n'est que mythe instrumentalisé par une papauté soumise aux directives de la maison d'Autriche, elle n'est pas un corps représentatif d'universalité. Les événements vénitiens révèlent un éclatement du corpus christianum et seulement ensuite de YEcclesia catholica. Dans leur conscience de Christianitas, les catholiques critiques faisaient encore faible mais essentielle place à l'hérétique. Pour eux, l'Interdit a montré que la république chrétienne avait été ébranlée par la montée en puissance de la catholicité et qu'il fallait désormais compter avec une nouvelle réalité, monstrueuse en son hybridité, celle de la Christianitas catholica. Après la réconciliation du pape et de la Sérénissime, négociée grâce à la seule médiation française sans que les Espagnols aient eu le temps d'intervenir, Canaye de Fresnes affirme: «Nous & tous les serviteurs de Sa Majesté avons grande occasion de loiier Dieu, car c'est chose incroyable comme Rome & toute l'Italie retentist des louanges de Sa Majesté & des benedictions que tout le monde luy donne pour avoir si dextrement esteint un feu qui sembloit aller embraser toute la Chrestienté Catholique.» 106 Apparemment contradictoire, l'idée de Christianitas catholica suppose qu'aux réformés, espace ait été laissé en Chrétienté - même ténu. Les catholiques critiques n'ont pas abandonné le fol espoir d'une réduction ultime du schisme.
Aux yeux des tenants de l'antitridentinisme, les diverses instances par quoi se confesse l'appartenance à la catholicité témoignent, par leur multiplicité, de la primitive incohérence du nouveau corps ecclésial inauguré à Trente. Pour Canaye de Fresnes, seule la Chrétienté est représentation à la fois unitaire et unifiante, capable d'être l'étendard de l'universalité du christianisme.
Originellement, la définition du catholique était négative, elle ne pouvait se construire qu'à partir de celle du protestant: catholicus, celui qui n'avait pas rompu avec l'Eglise romaine. À lire les dépêches de Canaye de Fresnes, on a cru retrouver l'une des intuitions fondamentales sur lesquelles s'appuient les récents travaux de Thierry Wanegffelen: parce qu'il codifie, durcit et délimite les positions avouées par la roma- nité ecclésiale, le concile de Trente sépare et confessionnalise, il crée la possibilité, face au protestant, d'être catholique sans accepter les acquis tridentins. Pour l'ambassadeur, le rejet de la moderne catholicité provoque la réhabilitation de l'ancienne idée de Chrétienté, fondée sur l'espoir d'une réunification du corps chrétien, empêchée par le donné conciliaire. La concurrence des deux instances révèle la tension qui a présidé à l'éclosion tourmentée du catholicisme critique.
104. Canaye de Fresnes à Jean de Villiers Hotman, Venise, 12 octobre 1606, ibid., p. 234. 105. Canaye de Fresnes à La Boderie, Venise, 18 août 1606, ibid., p. 170-171. 106. Canaye de Fresnes à Salagnac, Venise, 6 avril 1607, ibid., p. 517.
n° 4, 2004
La diplomatie henricienne et les ambitions françaises ... 577
Perspectives politiques pour la restauration d'un ordre chrétientaire
La catholicité tridentine est incapable de maintenir en elle un état organique de paix et de repos; au reste, elle n'en a pas mission: pour Canaye de Fresnes, il y a eu à Trente trahison par l'Église de l'ancien idéal de la respublica Christiana. À une défection capitale, les catholiques critiques tentent de porter remède sans prôner la solution schismatique ; ils entendent pleinement remettre la protection temporelle de la Chris- tianitas au Très-Chrétien. La superlative chrétienté du roi de France devient un besoin politique dont Armando Saitta a essayé en 1948 -au lendemain de la Seconde Guerre mondiale - de faire la genèse explicative 107. Pour l'historien italien, il ne peut y avoir de développement des courants de pensée pacifiste que dans un temps où s'impose une Weltanschauung fondée sur une vision unitaire et une conception universelle de l'humanité. L'universalisme médiéval en est Г exemple-type, qui a élaboré un idéal de Christianitas repris à l'orée de la modernité européenne par les ministres d'Henri IV. Il s'agissait d'établir alors, contre l'Espagne et sous l'égide de la France, la quiétude de la respublica Christiana. En 1608, Villeroy, secrétaire d'État des affaires étrangères, affirme à La Boderie, ambassadeur de France en Angleterre: «Nous sommes en train et avons de quoy faire des alliances en divers endroicts, et vous diray, si les occasions qui s'offrent sont mesnagées comme elles peuvent estre, que nous pouvons bastir et rendre durable pour nos jours une paix universelle en la Chrestienté.» 108 Complètement ignoré par Armando Saitta, l'impact de l'Interdit vénitien a probablement été une condition nécessaire à l'expression, un an seulement après sa conclusion, des espoirs affichés par la diplomatie française.
Le modèle rémanent du prince chrétien
L'instance du prince chrétien rayonne à travers les justifications des catholiques critiques; son modèle est partie intégrante de la représentation de la Christianitas qu'ils défendent contre les innovations théologico-politiques tridentines, créatrices de la catholicité.
Sans nul doute pétries d'érasmisme, les positions arborées par les partisans de la cause vénitienne essaient de réhabiliter la fonction du princeps christianus en Chrétienté 109. Composée en 1516, alors que le nouveau roi d'Espagne Charles Ier -élu Empereur en 1519 sous le nom de Charles Quint- vient de désigner Érasme pour être l'un de ses conseillers, Ylnstitutio Principis Christiani a fixé durablement les règles de comportement que doit respecter le souverain qui souhaite convenablement régner en Christianitas; il est possible de les retrouver à l'œuvre dans les conceptions propres à Canaye de Fresnes. Pour Érasme, comme pour le diplomate français, l'exigence d'une conscience de religieuse communauté est essentielle. Les événements vénitiens sont affaires générales de la Chrétienté, communes doivent être les actions entreprises afin de résoudre la crise: «Quelque diligence que fassent tous les Princes Chrestiens, & nostre bon Maistre sur tous, pour moyenner l'accord, je seray le plus trompé du
107. Voir A. Saitta, Dalla Res Publica Christiana agli Stati Uniti di Europa. Sviluppo dell'idea pacifista in Francia nei secoli XVII-XIX, Rome, 1948. Sur la tradition pacifiste modeme, consulter K. von Raumer, Ewiger Friede. Friedensrufe und Friedenspldne seit der Renaissance, Fribourg-Munich, 1953.
108. Cité par A. Saitta, op. cit., p. 25. 109. Sur les catholiques critiques et le legs érasmien, voir T. Wanegffelen, Une difficile fidélité, op. cit.,
«Érasme, une figure tutélaire», p. 15-18. Consulter aussi S. Seidel Menchi, Erasmo in Italia, 1520-1580, Turin, 1986, Érasme hérétique. Réforme et inquisition dans l'Italie du XVť siècle, trad, fr., Paris, 1996.
578 Sylvio Hermann De Franceschi
monde s'ils en viennent à bout de cette année.» u0 L'intérêt commun prime les convoitises particulières, dont le princeps christianus doit rejeter la pernicieuse influence. Parce qu'elle n'a en vue que l'accroissement de sa puissance, la royauté espagnole est accusée d'avoir déchu de son rang, elle a cessé d'être protectrice de la Christianitas: «Ceux qui regardent plus à leur ambition qu'au bien general, c'est-à-dire les Espagnols, traversent nos bons offices tant qu'ils peuvent.» in La Chrétienté est un dépôt précieux dont chaque souverain chrétien a garde imprescriptible; sa représentation est un argument en faveur d'une sainte union des principes christiani pour faire comprendre au pontife romain l'inanité de ses revendications in rebus temporalibus. Que le pape finisse par entendre raison, le Sénat vénitien en est persuadé «tant pour Testât présent des affaires de la Chrestienté que parce qu'il croit que son interest soit joinct avec celuy de tous les autres Princes» 112. Le souverain chrétien se reconnaît en situation de crise de la Christianitas; il agit pour le bien commun de la religion, non pour favoriser ses intérêts. Entre la nouvelle raison d'État et la raison d'Église s'interpose une raison de Chrétienté. Canaye de Fresnes se réjouit à la fin du mois de juin 1606 qu'Henri IV soit disposé à intervenir pour réconcilier les protagonistes; il loue Dieu «de l'admirable prudence & rare pieté dont il vous a remply pour le bien de la Chrestienté en ces temps calamiteux» из. Princeps christianus, le roi de France l'est davantage que le pontife romain, qui s'est laissé convaincre «qu'il y ait plus d'honneur à maintenir sa Bulle qu'à maintenir la paix & l'union de la Chrestienté» m. Désormais ennemi de la respublica Christiana, le pape a permis que fussent tenus en sa présence des discours «si extravagants & si préjudiciables à toutes les Couronnes Chrestiennes que quand il les auroit toutes subjuguées à force d'armes, il ne pourrait plus insolemment triompher de leur submission» 1I5. Par son intrusion dans le champ politique, la puissance pontificale subit une désacralisation. Le pape a renié l'idéal du prince chrétien, il laisse vide une place enviable d'arbitre de Chrétienté. Avec l'Interdit, les catholiques critiques ont enfin trouvé l'occasion de ravir au pontife romain une glorieuse intitulation de souveraineté suprêmement chrétienne.
À l'orée de la première modernité européenne se trouve revivifié le modèle éras- mien du princeps christianus en même temps qu'une conscience de Chrétienté —reviviscence anachronique, quand se développe une production pamphlétaire sans précédent autour de la naissante raison d'État. Les événements vénitiens ont mis en lumière l'apparentement monstrueux de la papauté avec des monarchies qui se veulent absolutistes. En juillet 1606, le Sénat fait savoir à Canaye de Fresnes qu'il supplie le roi de France de ne pas permettre «qu'une Republique qui seule maintient ce peu qui reste d'ombre de liberté en Italie soit abandonnée en la deffence d'une cause qui interesse généralement tous les Princes Souverains & en laquelle elle n'a d'autre but que de se maintenir en la liberté dont elle jouît depuis tant de siècles, en rendant au Sainct Siege tout ce qu'un Prince Chrestien luy peut rendre de devoir» 116. Le princeps christianus n'est pas tenu de reconnaître une quelconque autorité du pape au temporel.
110. Canaye de Fresnes à Salagnac, Venise, 29 mai 1606, dans P. Canaye de Fresnes, Lettres et ambassades, t. III, op. cit., p. 57.
111. Ibid., p. 57. 1 12. Canaye de Fresnes à Henri IV, Venise, 28 juin 1606, ibid., p. 87. 113. Ibid., p. 87. 114. Ibid., p. 88. 115. Ibid., p. 88-89. 116. Canaye de Fresnes à Henri IV, Venise, 26 juillet 1606, ibid., p. 134.
n° 4, 2004
La diplomatie henricienne et les ambitions françaises ... 579
Inversement, parce que la couronne espagnole instumentalise à son profit le pouvoir ecclésial du pontife romain, elle perd sa caution de Chrétienté: «II importe à tous les Princes Chrestiens de ne souffrir que toutes les fois que le Roy d'Espagne, ayant un Pape à sa devotion, fera menacer quelque Prince de l'excommunication, le contraigne de se soubsmettre à toutes ses volontéz.» 117 L'ancienne hiérarchie des principes chris- tiani a été bouleversée: le Catholique a trahi les intérêts de Chrétienté, le pape s'est soumis à ses injonctions. L'Empereur n'est plus une autorité suréminente; d'où la stupéfaction éprouvée par Canaye de Fresnes lorsqu'en novembre 1606, le Doge lui affirme qu'Henri IV a demandé à Rodolphe II d'assister la médiation proposée par la France. L'ambassadeur se déclare certain que son souverain n'a «autre but en cet affaire que de le voir au plustost composé à la gloire de Dieu & au repos de la Chrestienté» 118; son roi a pu inviter l'Empereur à collaborer avec lui comme les autres princes chrétiens, mais Canaye de Fresnes refuse d'admettre qu'une garantie éventuellement apportée par l'Empire puisse être de quelque utilité pour renforcer les interventions françaises -Henri IV est évidemment le roi Très-Chrétien: «II m'estoit dificile de croire que Vostre Majesté eust imploré l'ayde de l'authorité Impériale pour surmonter les dificultéz de cette négociation, parce que du costé du Pape, Vostre Majesté est recogneuë pour fils aisné de l'Eglise, & du costé de la Republique, je suis certain que Vostre Majesté est trop asseuré de son amitié pour croire que l'Empereur ou autre Prince aye plus de credit envers elle que Vostre Majesté.» m Lors de l'Interdit vénitien se manifeste une translatio Imperii symbolique, par quoi la maison d'Autriche est dépossédée de sa mythique dignité impériale au profit du souverain français. La Chris- tianitas y gagne un nouveau chef temporel qui est véritablement prince chrétien, soucieux de protéger le bien commun des fidèles.
La résurrection d'un idéal de république chrétienne que l'on pouvait croire définitivement amoindri est revigorée par l'insistance avec laquelle les catholiques critiques promeuvent de nouveau un modèle cohérent de princeps christianus - par eux chargé de combattre en faveur d'intérêts religieux délaissés par la catholicité tridentine.
La majesté très-chrétienne du souverain français Le basculement opéré par les événements vénitiens est diplomatique, puisque la
puissance espagnole essuie un échec cuisant -l'Interdit n'est réglé que par la seule médiation française et les représentants de Philippe III ont été écartés des négociations -, il est aussi révélateur d'une mutation des configurations de pouvoirs symboliques au sein de l'orbe chrétien.
Dès le début du conflit, la diplomatie henricienne affirme le rôle prédominant du roi de France en Christianitas. Son but est de présenter Henri IV en arbitre souverain de la Chrétienté au détriment de l'Empire et de l'Espagne: le Catholique doit s'effacer devant le Très-Chrétien. À la fin du mois de mai 1606, Canaye de Fresnes assure les Vénitiens que «Sa Majesté ne cessera qu'elle ne les ait tirez honorablement de ce fascheux affaire, pourveu qu'elle recognoisse que ses bons offices soient aussi bien receus comme ils partent d'une très bonne & très saincte intention tant envers le bien general de la Chrestienté comme au particulier de cette Republique» 12°. Le 29 mai, l'ambassadeur informe son souverain que les sénateurs de la Sérénissime entendent
m. Ibid., p. 134. 118. Canaye de Fresnes à Henri IV, Venise, 16 novembre 1606, ibid., p. 280. 119. Ibid., p. 280. 120. Canaye de Fresnes à d'Alincourt, Venise, 27 mai 1606, ibid., p. 48.
580 Sylvio Hermann De Franceschi
faire leur possible pour contenter le pontife romain, mais qu'ils refusent de toucher aux libertés et autorité temporelles de Venise. Canaye de Fresnes leur a répondu «que pourveu qu'ils fassent tant soit peu d'ouverture, Vostre Majesté n'abandonnera point cet affaire qu'elle ne le termine à leur contentement & au bien de toute la Chres- tienté» m. Henri IV conjoint indissolublement en son projet médiateur restauration du bonum commune Christianitatis et défense des intérêts vénitiens - conjonction qui est un argument diplomatique en sa faveur, puisqu'il importe à la Sérénissime «de remettre plustost ce différend à Vostre Majesté, qui n'y a autre interest quelconque que du bien general de toute la Chrestienté, qu'à un Prince qui voudrait profiter de cette occasion pour en accroistre sa grandeur» ш. Au cours de son audience du 1er juin, Canaye de Fresnes s'est vu signifier que la République faisait le plus grand cas des propositions de médiation française. Henri IV est tenu pour «le premier Roy Chrestien» 123, et les Vénitiens reconnaissent que «Vostre Majesté est conduite par une grace de Dieu spéciale» 124. La superlative chrétienté du souverain français est acquise, il est l'élu de la Christianitas ; de lui seul, le corpus Christianům attend son salut: «II appartient à Vostre Majesté plustost qu'à nul autre de procurer le bien & l'union de l'Eglise, dont vous estes l'aisné.» 125 Pleinement arbiter Christianitatis, le roi de France est médiateur désigné, il est celui par qui la paix chrétienne doit être ressuscitée, celui qui doit modérer le pontife romain.
En provoquant un conflit purement temporel, le pape a créé une occasion de déséquilibre dans la répartition symbolique des pouvoirs en Chrétienté; impliqué dans la dispute, il a abandonné le rôle de juge eminent - vacance d'autorité qui permet à la royauté française, intronisée en lieu et place de père commun des chrétiens, de bénéficier du nouveau charisme de réconciliateur de l'Église. Canaye de Fresnes est conscient de la mission remise à Henri IV: «Je veux espérer que Dieu adjoustera encores ce beau tiltre à ses trophées d'avoir tranché la racine à un schisme le plus périlleux que l'Italie ait encore veu.»126 La puissance pontificale, temporalisée par l'Interdit, n'est plus capable d'accomplir sa charge propre, le roi de France en acquiert un devoir confessionnel; en lui, les catholiques critiques ont pu croire avoir trouvé leur chef. Contre l'Espagne, qui défend ses avantages particuliers, Henri IV, rex Christianissi- mus, ne recherche que la consolidation d'un bonum publicum qui est la propriété commune des fidèles du Christ. À d'Alincourt, Canaye de Fresnes écrit le 10 juin 1606: «Chacun sçait que les Espagnols n'ont autre but que leur interest, là où toute la Chrestienté reconnoist que Sa Majesté n'a regardé qu'au bien public.» 127 La preuve d'une désacralisation de l'autorité ecclésiale doit être cherchée dans les écrits des jésuites, par excellence créatures du pape. Après qu'ils ont été bannis de Venise, Padoue et Brescia, si brutalement qu'ils n'ont pu brûler leurs manuscrits, Canaye de Fresnes a entendu dire «qu'il s'y est trouvé des mémoires plus appartenans à la Monarchie du monde qu'au Royaume des Cieux» ш. Il y a eu démission des pouvoirs ecclésiastiques, qui ont renié leur vocation spirituelle pour s'immiscer dans les affaires temporelles. Le
121. Canaye de Fresnes à Henri IV, Venise, 29 mai 1606, ibid., p. 54. 122. Canaye de Fresnes à Henri IV, Venise, 2 juin 1606, ibid., p. 59. 123. Ibid., p. 60. 124. Ibid., p. 60. 125. Ibid., p. 62. 126. Canaye de Fresnes à Villeroy, Venise, 2 juin 1606, ibid., p. 63. 127. Canaye de Fresnes à d'Alincourt, Venise, 10 juin 1606, ibid., p. 70. 128. Canaye de Fresnes à Caumartin, Venise, 16 juin 1606, ibid., p. 80.
£E n° 4, 2004 S
La diplomatie henricienne et les ambitions françaises ... 581
roi de France peut y remédier en faisant «pour la descharge de sa conscience ce qui se peut attendre d'un Roy tres-Chrestien pour le repos de la Chrestienté» 129, et en assurant les deux parties «de son affection non partiale, ains toute dédiée à la gloire de Dieu & au bien general de toute la Chrestienté» 13°. Ad maiorem Dei gloriam et pro bono Christianitatis: l'action diplomatique d'Henri IV est religieuse, elle est celle d'une puissance souveraine véritablement ecclésiale, son sort est celui de la république chrétienne. La pieuse intitulation du Très-Chrétien est un argument pour repousser les autres propositions de médiation. Face aux tentatives du duc de Savoie Charles-Emmanuel Ier, Henri IV ne peut que maintenir ses prétentions de chef de Christianitas par divine élection, il est seul arbitre admissible entre les princes chrétiens: «Le zèle de tous ceux qui procurent la paix & union de la Chrestienté est louable, mais je crois qu'il ne s'y peut mieux faire que ce qu'y fait Vostre Majesté.» ш Au cours de l'Interdit vénitien se joue symboliquement une translatio capitis temporalis Christianitatis dont bénéficie la royauté de France au détriment de la couronne espagnole, sans doute aussi au dam de la papauté, qui y perd un rôle traditionnel de père commun.
La majesté très-chrétienne du souverain français s'impose aux belligérants; pour les autorités vénitiennes, elle est instrument d'une eradication de l'influence hispanique en Italie; aux catholiques critiques, elle est ressource inespérée afin de restaurer un ordre chrétientaire détérioré par les décisions tridentines.
Le repos et l 'union de la république chrétienne La suréminente chrétienté de la monarchie française est réhabilitée quand se
développent des courants pacifistes, dont le Grand Dessein d'Henri IV, projet mythique de confédération chrétienne à l'échelle de l'Europe, est expression emblématique - encore empreinte de l'idée de respublica Christiana élaborée au Moyen Âge par des fidèles qui concevaient la paix du corps chrétien comme la conséquence de leurs propres définitions d'une Christianitas organiquement universelle. Pour Armando Saitta, il semble difficile d'évoquer un pacifisme médiéval: la concorde fraternelle en Chrétienté était un résultat logique, non un problème; pour qu'elle devînt problématique, il a fallu que l'Europe assistât à un processus de particularisation des États et que s'affaiblît une conception œcuménique de l'humanité ш. Le rêve pacifiste est la quête d'une restauration de ce qui a été détruit. Si Armando Saitta s'est attaché à montrer que le règne d'Henri IV était précurseur d'un mouvement qui connaît son apogée en France au XVIIIe siècle, avec notamment les écrits de l'abbé Charles de Saint-Pierre - auteur d'un Projet de paix perpétuelle édité en 1713 -, puis plus tard en Allemagne avec la publication en 1795 de l'opuscule d'Emmanuel Kant intitulé Vers la paix perpétuelle, il a négligé ce qui perdurait pour souligner ce qui naissait; de l'ancien ordre, il a laissé de côté des vestiges qui méritaient pourtant d'être analysés.
Le temps du conflit vénitien avec la papauté est celui de la coexistence contradictoire entre une idée de Christianitas dépérissante et les débuts de la réflexion sur les
129. Ibid., p. 80. 130. Canaye de Fresnes à d'Alincourt, Venise, 24 juin 1606, ibid., p. 84. 131. Canaye de Fresnes à Henri IV, Venise, 17 juillet 1606, ibid., p. 117. 132. Sur la genèse médiévale de l'idée de Chrétienté, voir B. Landry, L'idée de Chrétienté chez les
scolastiques du xiiie siècle, Paris, 1929; G.B. Ladner, «The Concepts t>/Ecclesia and Christianitas and their Relation to the Idea of Papal Plenitudo Potestatis from Gregory VII to Boniface VIII», Sacerdozio e regno da Gregorio VII a Bonifazio VIII. Studi presentati alia sezione storica del congresso della Pontificia Universita Gregoriana 13-17 Ottobre 1953, Rome, 1954 et F. Kempf, «Das Problem der Christianitas im 12. und 13. Jahrhundert», Historisches Jahrbuch, 79, 1960, p. 104-123.
582 Sylvio Hermann De Franceschi
moyens d'assurer une paix qui n'est plus que temporelle par la construction du modèle d'une balance des forces équilibrée 133. D'autant plus crucial paraît le combat des catholiques critiques en faveur de l'idéal chrétientaire. Peu invoquée, la notion de raison d'État n'est pas inconnue à Canaye de Fresnes. Le 26 juillet 1606, il insiste pour que les jésuites français n'interviennent pas dans la controverse écrite: «Ce sera une grande louange à nostre nation qu'elle mérite de couvrir l'imprudence des Italiens, qui font estât de faire des livres délia ragion di Stato & enseigner la discretion aux autres.» 134 Le diplomate n'est guère favorable à une ratio Status inventée en Italie; probablement songe-t-il à Machiavel. La raison d'État n'est pour lui qu'une contrainte, elle induit une attitude politique, elle ne peut la légitimer religieusement. Quand en mars 1607, les Espagnols entravent la médiation française, Canaye de Fresnes explique à d'Alincourt: «Aussi semble-t-il que la raison d'Estat ne permette pas que la Republique s'oblige à un Prince voisin & si puissant en Italie comme est un Roy d'Espagne.» 135 Quelques lignes plus bas,^ la Christianitas revient sous la plume de l'ambassadeur, comme si la seule raison d'État était impuissante à justifier l'entreprise diplomatique du cardinal de Joyeuse, désigné médiateur par Henri IV: «J'attends vos premieres avec grande inquietude, Dieu veuille qu'elles soient telles qu'il est nécessaire pour le bien de la Chrestienté & le contentement de Sa Majesté.» 136 Beaucoup plus pregnant que la référence à la ratio Status, l'appel à une cohésion de la Christianitas est omniprésent chez Canaye de Fresnes. Le 1er juillet 1606, il informe son homologue à Rome d'un projet d'accord proposé aux Vénitiens, et espère que le pape est prêt à l'accepter afin de «s'obliger par ce moyen de plus en plus les affections de tous les Souverains à la conservation de l'union tant nécessaire à la Chrestienté» ш. Le 8 juillet, Canaye de Fresnes revient à la charge. Il dénonce vigoureusement les «adulations de ceux qui font accroire à Sa Saincteté qu'il ait pouvoir temporel sur les Princes temporels» 138: «Dieu veuille que le Pape fasse une resolution telle que nous la desirons, tant pour son honneur que pour le repos de toute la Chrestienté.» ш La diplomatie henricienne est dépositaire de la mission de pacifier la Christianitas', d'elle, repos et union -mis en cause par les prétentions pontificales - sont les ultimes visées de Politiques qui sont catholiques, mais critiques: «Je veux donc espérer que soit par une voye ou par une autre, vous remporterez l'honneur d'avoir coupé la teste à ce malheureux différend & conservé l'union de la Chrestienté, en laquelle consiste tout nostre bien spirituel & temporel.» 140 Chez Canaye de Fresnes, la raison d'État n'est pas un facteur déterminant de l'intervention française; le diplomate est animé par le souci de conserver une entente confraternelle dans la république chrétienne.
133. Sur la notion de balance des forces et d'équilibre diplomatique, voir E. Kaeber, Die Idee des Gleichgewichts in der publizisîischen Literatur vont 16. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts, Berlin, 1907; G. Zeller, «Le principe d'équilibre dans la politique internationale avant 1789», Revue historique, 215, 1956, p. 25-57; H. Fenske, «Gleichgewicht, Balance», Geschichtliche G rundbe griffe, op. cit., t. II, Stuttgart, 1975, p. 959-996 et E. Luard, The balance of power. The system of international relations, 1648-1815, Londres, 1992. Consulter aussi W.D. Gruner (éd.), Gleichgewichte in Geschichte und Gegenwart, Hambourg, 1989.
134. Canaye de Fresnes à Villeroy, Venise, 26 juillet 1606, dans P. Canaye de Fresnes, Lettres et ambassades, t. Ill, op. cit., p. 139.
135. Canaye de Fresnes à d'Alincourt, Venise, 31 mars 1607, ibid., p. 503. 136. Ibid., p. 504. 137. Canaye de Fresnes à d'Alincourt, Venise, 1er juillet 1606, ibid., p. 106. 138. Canaye de Fresnes à d'Alincourt, Venise, 8 juillet 1606, ibid., p. 111. 139. Ibid., p. 111. 140. Ibid., p. 112.
i& n° 4, 2004
La diplomatie henricienne et les ambitions françaises ... 583
Coupable d'avoir provoqué la discorde des fidèles, la papauté doit assouplir sa position: les Vénitiens estiment que leur soumission éventuelle ne peut que renforcer l'arbitraire du pontife romain. Pour Canaye de Fresnes, Paul V doit se ressaisir; il faut lui montrer «combien il luy sera plus utile & plus honorable de maintenir l'union entre les Chrestiens que de les jetter au desespoir par une sévérité disproportionnée au temps present & donner subject à tous les hérétiques de ce siècle de se roidir plus que jamais en leur obstination» 141. L'union du corps chrétien est l'idée maîtresse que martèle sans cesse Canaye de Fresnes. S'il est convaincu que l'excommunication fulminée à l'encontre de la Sérénissime a été le geste d'un grand pape, soucieux d'affermir la dignité de la chaire de Pierre, il estime aussi que le durcissement du conflit peut favoriser les protestants, et «la pieté de Sa Saincteté sera sans comparaison plus recom- mandable si de son bon gré elle ayme mieux remettre quelque chose de ses prétentions que de les obtenir aux despens du repos & de l'union Chrestienne» 142. La paix et la concorde de la Chrétienté sont les préoccupations majeures de Canaye de Fresnes, il en répète inlassablement les instances. Le 2 décembre 1 606, au moment où la controverse écrite sur les événements vénitiens a pris sa plus large ampleur, il dénonce l'effet désastreux des condamnations portées par le Saint-Office contre les défenseurs de la Sérénissime et leurs ouvrages imprimés: «Sa Saincteté a très-grande occasion de louer Dieu de l'observance & respect que ces Seigneurs portent à Sa Majesté, car sans cela il ne faut point douter que le monde seroit remply d'escrits qui ne seraient gueres moins préjudiciables à l'union de la Chrestienté qu'une guerre.» 143 Pendant une année de conflit, la visée constante de l'ambassadeur a été la réconciliation et l'union de la république chrétienne. La médiation menée par le cardinal de Joyeuse au nom d'Henri IV est pour lui l'occasion de voir peut-être réalisé son rêve d'une Chrétienté apaisée. Le 24 mars 1607, il témoigne de son espoir au cardinal de Givry: «Nous attendons icy avec grande impatience le retour de Monseigneur le Cardinal de Joyeuse. Dieu veuille qu'il soit tel que tous les amateurs du repos public & de l'union de la Chrestienté le désirent.» 144 La conclusion de l'Interdit, obtenue de vive lutte par Joyeuse, marque la fin d'une crise de la Christianitas, désunie par la faute de qui avait le devoir d'en préserver l'intégrité. Il reste le sentiment d'un profond traumatisme subi par les catholiques critiques; pour Canaye de Fresnes, le traité «a esté enfin heureusement conduit à bon port, dont nous avons très-grande occasion de rendre graces à Dieu & le supplier que la Chrestienté ne retombe plus en semblables inconveniens» 145. Avec les événements italiens de 1606-1607 s'achève sans doute le dernier conflit purement de Christianitas. La guerre de Trente Ans est déjà affrontement moderne -trop temporel pour n'être que de religion. Des traités de Westphalie, à en croire Alphonse Dupront, l'idée de Chrétienté est quasi absente. Elle était encore très présente au cours des affaires vénitiennes.
Quand s'instaure la modernité politique européenne, subsiste une vision universalisante de l'humanité chrétienne -conception anachronique fondée sur la foi accordée à l'existence d'une Chrétienté dont il faut restaurer l'union. Les espoirs des catholiques critiques y ont trouvé leur raison d'être.
141. Canaye de Fresnes à d'Alincourt, Venise, 22 juillet 1606, ibid., p. 131. 142. Canaye de Fresnes à d'Alincourt, Venise, 12 août 1606, ibid., p. 164. 143. Canaye de Fresnes à d'Alincourt, Venise, 2 décembre 1606, ibid., p. 308. 144. Canaye de Fresnes à Givry, Venise, 24 mars 1607, ibid., p. 501. 145. Canaye de Fresnes à Brûlait de Puisieux, Venise, 19 avril 1607, ibid., p. 530.
584 Sylvio Hermann De Franceschi
Si lettrés et juristes européens reprennent généralement le thème antique de la renouatio d'un empire universel, le catholicisme antitridentin, quant à lui, fait porter l'accent de sa démarche sur un renouveau de la Chrétienté, dont le mythe réorchestré succède en France à l'inflation d'un discours encomiastique tendant à assimiler dès la fin du XVIe siècle Henri IV au descendant de l'Hercule Gaulois. Corrado Vivanti l'a montré: la comparaison du roi avec des personnages mythiques n'a pas seule fonction hagiographique, elle est aussi révélatrice des attentes que les sujets ont pu avoir à l'égard de la politique que leur souverain devait mener. Le mythe d'Hercule s' insert justement dans un complexe de représentations et d'idéalisations qui servent à exprimer des idéaux de restauration 146. D'un mouvement qui a débuté au moment où se jouait le destin de la Ligue, la reviviscence de l'idée de Christianitas participe pleinement, elle en est l'aboutissement ultime, par où l'ancien prince protestant devient le garant de l'harmonie du monde chrétien. La nécessité d'une pacification de la communauté des fidèles a été proclamée par la diplomatie française lors de l'Interdit vénitien. Il est vraisemblablement licite de considérer que dès 1606 est à l'œuvre, dans l'entourage d'Henri IV, une réflexion qui a donné naissance plus tard au mythe du Grand Dessein, dont le but était de «trouver des moyens faciles pour former un corps commun de republique chrestienne, tousjours pacifique dans elle mesme, qui soit composée de tous les Estats, royaumes, republiques et seigneuries, faisans profession du nom de Jésus Christ, dans l'Europe» 147. Dans l'histoire de l'évolution des rapports entre Christianitas et Europa, deux représentations concurrentes, le conflit de Venise avec la papauté a été important; il a permis de retarder l'inflation des références à la seconde entité en revivifiant l'ancienne conscience de Chrétienté. Pour un catholique critique comme Canaye de Fresnes, il s'agissait de poser le roi de France en arbitre de Christianitas — revanche inattendue d'une absolution chèrement acquise en 1595. Le souverain converti est devenu chef temporel de la Chrétienté, mais aussi de la catholicité, puis- qu'à lui, le Saint-Siège a dû avoir recours. D'un sondage très partiel, on n'entend pas extrapoler des résultats exagérément généraux. Canaye de Fresnes est peut-être une exception, il est aussi probable qu'il ne l'est pas totalement. Ses dépêches sont celles d'un serviteur à son souverain, mais leur logique discursive a dû correspondre à une attente.
Afin de contrer la puissance espagnole, l'ambassadeur procède à une recharge sacrale de Christianitas et sous-entend que la lutte contre l'hégémonie hispanique, finalement diabolisée, est guerre sainte. Chez lui, pourtant, est manifeste une évolution
146. C. Vivanti, Lotta politico e pace religiosa in Francia fra Cinque e Seicento, Turin, 1963, lre partie, chap. II, «II mito dell'Ercole Gallico e gli ideali monarchici di renouatio», p. 74-131, et idem, «Henry IV, the Gallic Hercules», Journal of Warburg and Courtauld Institutes, 30, 1967, p. 176-197, repris dans idem, Incontri con la storia. Politica, cultura e società nell' Europa moderna, M. Gotor et G. PedullÀ (éd.), préface M. Aymard, Rome, 2001, p. 265-291. Voir aussi F. Polleross, «From the exemplum uirtutis to the Apotheosis. Hercules as an Identification Figure in Portraiture. An Example of the Adoption of Classical Forms of Representation», dans A. Ellenius (dir.), Iconography, Propaganda and Legitimation, Oxford, 1998, p. 37-62.
147. Sully, Mémoires des sages et royales œconomies d'Estat, J.-F. Michaud et J.-J.-F. Poujoulat (éd.), Paris, 1837, t. II, p. 213, cité par A. Saitta, op. cit., p. 43. Sur le Grand Dessein, voir K. von Raumer, «Sully, Crucé und das Problem des ewigen Friedens», Historische Zeitschrift, 175, 1953, p. 1-39, J.T. O'Connor, «Politique et utopie au début du XVIIe siècle: le Grand Dessein de Henri IV et de Sully», xvíř siècle, 174, 1992, p. 33-42; K. Malettke, « Konzeptionen kollektiver Sicherheit in Europa bei Sully und Richelieu», dans A. Buck (éd.), Der Europa-Gedanke, Tubingen, 1992, p. 83-106; idem, «L'Europe dans le Grand Dessein de Sully», Imaginer l'Europe, op. cit., p. 93-105, et A.V. Hartmann, Rêveurs de Paix? Friedensplane bei Crucé, Richelieu und Sully, Hambourg, 1995. Le Grand Dessein a lui-même été l'une des composantes essentielles du mythe de Sully: voir L. Avezou, Sully à travers l'histoire. Les avatars d'un mythe politique, préface B. Barbiche, Paris, 2001, «Le Grand Dessein, première gloire posthume de Sully?», p. 166-172.
n° 4, 2004
La diplomatie henricienne et les ambitions françaises ... 585
de l'idée de Chrétienté. En 1648, selon Alphonse Dupront, la Chrisîianitas est dissociée de la croisade tandis que sa caractérisation éclate entre plusieurs corps collectifs; au début du XVIIe siècle, le processus n'est entamé que pour moitié: la Chrétienté demeure un ensemble unitaire dans les conceptions de Canaye de Fresnes, qui la réhabilitent afin de nier la force institutionnelle de la romanité ecclésiale. La Chrisîianitas devient une icône de l'antitridentinisme, elle est instrumentalisée par le catholicisme critique. La catholicité - entité symbolique dont il reste encore à faire l'histoire - ne peut comprendre l'ensemble des vertus propres à la Christianitas, le catholicus n'a vocation d'universalité que par son nom. Le concile devait être institution de Chrétienté, mais Trente n'a pu en assumer la capacité d'œcuménicité. Par l'Interdit se découvre une désacralisation de la papauté dont la monarchie française a été bénéficiaire: récemment converti, le roi de France est élu chef de Chrétienté et retrouve le charisme d'un rex Christianissimus. Entre la Christianitas et la respublica catholica s'interpose le paradigme pontifical: la première est défendue par le princeps christianus, la seconde est dominée par le premier des évêques. Rêve religieux, la Chrétienté s'est corrompue pour donner naissance à un mythe politique; référence nostalgique dont les racines médiévales sont encore perceptibles, elle continue à se vouloir principe d'action exemplaire.
ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME