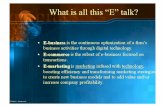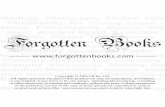Un établissement rural au bord de l’eau au Ve s. avant notre ère (Les Prêles,...
Transcript of Un établissement rural au bord de l’eau au Ve s. avant notre ère (Les Prêles,...
Un établissement rural au bord de l’eau au ve siècle a.C. (Les Prêles, Romans-sur-Isère, Drôme)
Éric Durand, Odile Franc*
– Les Gaulois au fil de l’eau, p. XXXX
L es opérations Inrap de diagnostic 1 et de fouilles préventives 2 réalisées en 2007-2008 sur les 3,5 km du tracé du contournement nord-ouest de Romans-sur-Isère (Drôme) ont permis de mettre au jour les premiers sites de l’âge du Fer de la basse vallée de l’Isère : Hallstatt C1 (seconde moitié du viiie s. a.C) à Meilleux,
Hallstatt C2 (première moitié du viie s.), La Tène A (ve s.-début ive s.) et La Tène D (ier s.) au lieu-dit Les Prêles (fig. 1).
* Nous remercions ici les nombreux collaborateurs : Philippe Allix, Ines Balzer, David Bardel, Jacques-Léopold Brochier, Stéphane Carrara, Claire-Anne de Chazelles, Jullien Collombet, Isabelle Daveau, Dominique Lalaï, Monique Le Nézet-Célestin, Ghislaine Macabéo, Guillaume Maza, Agatha Poirot, André Rivalan, Sylvie Saintot, Mickaël Seigle et Jean-Michel Treffort.
1. Réthoré et al. 2006.2. Le Nézet-Célestin et al. 2009.
| Fig. 1. Contexte géologique, réseau hydrographique actuel et sites des âges du Fer (DAO É. Durand Inrap 2014 d’après BRGM, feuille Romans).
14DURAND,FRANC.indd 71 30/03/15 15:23
72 – É. DuranD, O. Franc
| Fig. 2. Habitats ruraux en moyenne vallée du Rhône entre Ha D3 et LT A (fin vie-début ive s. a.C.) : état de la recherche (DAO É. Durand Inrap 2014).
14DURAND,FRANC.indd 72 30/03/15 15:23
un Établissement rural au bOrD De l’eau au ve s. a.c. – 73
En l’état actuel de la recherche, les sites d’habitat de la transition HaD3/LTA1, contemporains de Romans-Les Prêles, sont établis dans un rayon minimum de 15 km. L’occupation la plus proche est située à Tournon-sur-Rhône 3. D’autres sont connues plus au sud à Guilherand-Granges 4, à Chabeuil 5, à Valence 6 et à Montvendre 7. Encore plus éloignés, les sites de Soyons 8 et ceux de la vallée de la Drôme à Crest 9, Chabrillan 10 et Loriol-sur-Drôme 11 complètent le contexte archéologique du ve s. a.C de cette région médio-rhodanienne (fig. 1).
La découverte de ce nouvel établissement rural de plaine, pour l’instant isolé, comble en partie le vide archéologique observé pour le ve s. a.C entre Valence et Vienne et constitue en tous cas un nouveau jalon du réseau commercial sur la rive gauche du Rhône entre mondes hallstattien et méditerranéen.
Contexte géographique, stratigraphique et taphonomique
Le site des Prêles est localisé en rive droite de la Basse-Isère, actuellement à 167,50 m d’altitude, dans les alluvions fluviatiles holocènes (Fz1) déposées en cône alluvial très plat au débouché des collines molassiques du plateau de Chambaran au nord, dans la région du Bas-Dauphiné (fig. 2). Apportées par les petits cours d’eau de la Savasse et de la Chorache divaguant en plusieurs bras au cours de l’Holocène, ces alluvions se sont accumulées sur près de 6 m d’épaisseur au-dessus des terrasses fluvio-glaciaires à galets de l’Isère (Fyb) mises en place du Würm moyen à récent soit entre 40 000 et 21 000 ans cal BP 12.
Une stabilité du milieu à l’époque Tardiglaciaire et première moitié de l’Holocène
Le cailloutis de la terrasse fluvio-glaciaire montre quelques dépressions le long du tracé notamment au droit du site des Prêles, où il est profond de 5,50 m et fait place à des argiles sableuses noirâtres jusqu’à 162,60 m d’altitude. Atteintes ponctuellement, elles permettent de mentionner un milieu palustre qui devait être fréquenté dès le Néolithique sur la foi de quelques fragments de céramique récupérés lors du diagnostic 13. Du fait de la présence de céramiques, la formation de ce sol noir pourrait se rapporter à l’Atlantique moyen autour de 6 500 BP 14. La sédimentation post-glaciaire jusqu’à l’âge du Bronze est peu importante puisque 1,20 m au maximum de sédiments se dépose en 12 000 ans. Hors des dépressions la sédimentation est même quasi nulle ; une fersiallitisation de la frange supérieure de la terrasse s’observe alors à Meilleux sur la partie la plus éloignée des collines (fig. 1).
L’homme et la recrudescence des ruisseaux à la fin du Premier âge du Fer
Des alluvions limono-sableuses et argileuses, dépôts de crue plus ou moins boueuse des ruisseaux, se superposent ensuite et exhaussent rapidement la séquence sédimentaire jusqu’à 166 m d’altitude au Premier âge du Fer (antérieurement à la première moitié du viie s. a.C d’après la céramique de la seule fosse conservée 20 m à l’est du site laténien) avec une alternance de dépôts sableux érodant des alluvions argileuses. C’est le cas aux Prêles de l’horizon 237 incluant quelques tessons du Bronze ancien et final (identification J. Vital), niveau érodé par l’US 236b (fig. 5), antérieure à la première moitié du viie s. a.C d’après la céramique de la fosse précédemment citée. La couche sommitale, brunifiée (US 236), supporte les occupations du Premier âge du Fer. Aucune stratification évidente n’a été observée entre la fosse du HaC2 qui s’ouvre sur l’US 236 et les structures du ve s. a.C qui s’ouvrent sur 236 ou à la base de 235, sus-jacente (fig. 5).
3. Collombet et al. 2014.4. Robert 2013.5. Billaud 2002 ; Réthoré 1996.6. Argant et al. 2009 ; Réthoré-Conjard et al. 2014.7. Saintot 2002.8. Dutreuil & Gilles 2013 ; Delrieu et al. dans ce volume p. .9. Treffort 2002 ; Treffort 2009.10. Vermeulen 2002 ; Réthoré 1997.11. Lurol 2013.12. Mandier 1988 ; Mandier et al. 2003.13. Réthoré et al. 2006.14. Berger 2003, 96.
14DURAND,FRANC.indd 73 30/03/15 15:23
74 – É. DuranD, O. Franc
Les ruissellements peuvent se concentrer comme dans le cas du chenal F271, qui traverse du nord-ouest au sud-est le site fouillé (fig. 3). Il présente une largeur variant de 7 m au sud (C18) à 9 m (C15) au nord pour une profondeur de 1,5 m (C18) à 2,7 m au nord (C15) (fig. 4 et 5).
Les prélèvements paléobiologiques effectués dans le chenal ont apporté peu d’information sur le paléoenvironnement. Si les échantillons palynologiques (J. Argant) ont été négatifs, les 75 charbons de bois prélevés dans le chenal 271 n’ont mis en valeur pour le ve s. a.C qu’une dominance quasi exclusive du chêne caducifolié accompagné ponctuellement par le frêne (fosse 270), les pomoïdées et le genévrier 15.
Le rejet de nombreuses céramiques (4713 fragments, 109 kg ; fig. 8 à 10) et d’objets lithiques (mouture, galets divers) depuis la berge constituée par l’US 236 indique que ce chenal était actif au ve s. a.C et sans doute avant. Des couches de rejet bien identifiées sur les berges, interstratifiées dans le chenal contenant par exemple un vase de stockage entier (US 271.4 ; fig. 10, obj. 132) conservé entre deux blocs permettent de s’assurer du caractère actif du ruisseau pendant l’occupation laténienne. Il s’agit même ici d’une dynamique très active car le remplissage est constitué de galets, graviers et sables grossiers très fluides au fond (US 271.7 et 271.8) puis d’une majorité de sables grossiers à moyens, fluides, à
15. Delhon & Thiebault 2009.
| Fig. 3. CNOR, secteur 2 ouest, paléotopographie et structures archéologiques (ve s. a.C.) conservées en bordure du paléochenal (relevé topographique S. Couteau, Inrap 2008 ; DAO P. Rigaud, N. Saadi, É. Durand, Inrap 2014).
14DURAND,FRANC.indd 74 30/03/15 15:23
un Établissement rural au bOrD De l’eau au ve s. a.c. – 75
litages obliques (US 271.9, 271.7 et 271.2) et avec quelques lits de graviers et petits galets (US 271.4 et 271.5) (fig. 4 et 5). Les nombreux objets déversés dans le chenal de Romans pourraient avoir entre autre un rôle de confortement des berges (fig. 4) avec la présence notamment de nombreux galets de quartzite, de quelques fragments de mouture (fig. 9, obj. 122), d’une vingtaine de blocs molassiques (module moyen de 0,1 à 0,3 m) et d’une centaine de gros fragments de sole de foyer (fig. 6). Leur présence aux côtés des nombreuses céramiques (certaines quasi entières ; fig. 10) interdit d’envisager un transport important. La présence systématique plus ou moins concentrée de céramique, de faune, d’objets métalliques et lithiques, de matériaux de construction et autres foyers détruits dans toute la séquence stratigraphique témoigne en tous cas d’une perduration des alluvionnements pendant le siècle d’occupation du site et par conséquent d’un comblement rapide du chenal. En choisissant d’implanter ces habitations de part et d’autre de ce chenal en eau, l’accès et le passage des 7-9 m d’une rive à l’autre a dû être quoiqu’il en soit un problème récurrent. Si cette excavation naturelle située à proximité immédiate des unités domestiques a été utilisée logiquement comme zone de rejet, la volonté de remblayer et d’assainir le cours d’eau doit être prise en compte comme à Lattes-la Cougourlude 16 ou à Courthezon-Grange Blanche 17.
Nous précisons ici que sur les 210 m2 décapés du cours du chenal 271 (fig. 3), seuls 36 m2 ont été observés précisément en plan et fouillés à la main (fig. 6). Le reste des 437 m3 du comblement sableux anthropisé du chenal a été entièrement prélevé à la mini-pelle mécanique.
Le comblement du chenal se termine en dôme avec un profil souligné par des oxydations (fig. 5), ce qui permet d’envisager le dépôt final comme une décharge brutale du cours d’eau avant un changement probable de
16. Daveau & Py 2015.17. Fouilles 2013 Mosaïque Archéologie, dir. L. Buffat.
| Fig. 4>. Vue générale du paléochenal : stratigraphie nord (cl. E. Durand, Inrap 2008).
| Fig. 5. Profil du paléochenal et de ses berges aménagées (?), stratigraphie nord (C15) (relevé O. Franc, Inrap 2008 ; DAO P. Rigaud, É. Durand, Inrap 2014).
14DURAND,FRANC.indd 75 30/03/15 15:23
76 – É. DuranD, O. Franc
cours ou l’affaiblissement de la dynamique. D’autres chenaux protohistoriques, à profil supérieur en dôme souligné par des précipitations ferro-manganiques, sont envisageables 200 m à l’est du site des Prêles.
Toutes ces couches alluviales déposées en moins d’un millénaire sur une puissance de presque 3 m traduisent une phase très active du cône de déjection des ruisseaux de Chorache et de La Savasse suite aux défrichements antérieurs (?) mais surtout en conséquence de la phase de péjoration climatique du Premier âge du Fer connue sur toute l’Europe 18. Dans la moyenne vallée du Rhône, une crise d’érosion majeure sur les versants périphériques culmine entre 700 et 600 a.C 19. Un exhaussement très rapide prévaut puisqu’on passe d’une zone palustre à des épandages sableux plutôt xériques. Le sol s’exhausse et plusieurs chenaux s’observent entre lesquels plusieurs occupations sont possibles sur des couches (US 236 puis 235) moins bien triées et brunifiées. Un débordement plus intempestif pourrait expliquer la destruction des probables vestiges entourant l’unique fosse du Hallstatt C2 malgré l’absence de signatures sédimentaires. De même, malgré la présence de quelques artefacts de La Tène D (céramiques non tournées et un bracelet en verre du ier s. a.C), aucune sédimentation particulière ne peut s’y rapporter.
indiCes et restes d’habitations du début du seCond âge du Fer (450-375 a.C)
Un des faits marquants de l’opération de fouille du secteur 2 Ouest est la découverte d’un gisement structuré, stratifié et bien documenté par un abondant mobilier du ve s. a.C
Le site décapé sur une largeur moyenne de 30 m a été reconnu vers l’est sur une longueur de 55 m (fig. 3). Même si seule
sa limite orientale a pu être clairement définie, la superficie totale de la quarantaine de structures reconnues et conservées in situ avoisine les 1500 m2.
Sur les quatorze faits archéologiques bien datés, trois fosses, un empierrement, des calages de poteau et une sole de foyer sont situés en rive gauche du paléochenal (fig. 3). Sur la berge orientale un abondant mobilier céramique a été mis au jour dans quatre fosses et dans quatre trous de poteau. D’autres aménagements anthropiques présentant soit un faible échantillonnage de mobilier soit une insertion stratigraphique contemporaine peuvent être rattachés à cet ensemble. Ils complètent la vision en plan et l’organisation spatiale conservée du site pendant le ve s. a.C Il s’agit en majorité de trous ou de calages de poteau.
Architecture, matériaux de construction et aménagements domestiques
Si la présence des vingt trous ou calages de poteaux implantés sur une surface d’environ 700 m2 (fig. 3) renvoie à l’existence de superstructures en matériaux périssables, l’hétérogénéité des plans de répartition (aucun alignement), le degré de conservation (souvent seulement un ou deux galets/blocs de calage) et la synchronie entre structures limitent fortement l’interprétation. Deux zones distinctes peuvent toutefois être mises en valeur.
18. Bravard et al. 1992.19. Berger et al. 2009, 32.
| Fig. 6. Paléochenal, berge orientale, vue générale du dépotoir 271-4 (cl. E. Durand, Inrap 2008).
14DURAND,FRANC.indd 76 30/03/15 15:23
un Établissement rural au bOrD De l’eau au ve s. a.c. – 77
Un premier groupement de poteaux est conservé à l’ouest du chenal 271 en périphérie du foyer 82 (TP 90, 457, 36) et de la fosse 30 (TP 32, 31, 29). Malgré l’hétérogénéité des données morphométriques (diamètre d’ouverture entre 0,1 et 0,4 m), une projection pourrait relier à angle droit les TP 457, 36 et 31 (fig. 3). Une concentration relative de neuf négatifs de poteaux est située sur la berge orientale. Un premier groupe peut être distingué en périphérie est des fosses 39 et 233 où un ensemble de trois calages (TP 44, 45, 46) non fouillés pourraient être mis en relation. De diamètre proche (0,25 à 0,35 m), leur implantation à angle droit présente un entraxe régulier de 0,9 m et évoque un grenier sur poteaux similaire à celui de Bourbousson 20. Plus à l’est, trois autres trous de poteaux “isolés” (TP 293, 48 et 49) annoncent la limite orientale du site.
D’autres indices de construction ont été mis au jour en position secondaire dans les fosses de rejet (F270, 30, 275), dans le niveau “d’occupation” (US 236) et dans la dépression creusée par le chenal 271. Ils concernent quelques restes d’architecture de terre matérialisés par du torchis (20 fragments avec négatif de clayonnage prélevés dans trois fosses), par de nombreux nodules de terre cuite et plus exceptionnel par quelques fragments de terre crue architecturale mis au jour dans le chenal.
Cinq fragments de terre crue/recuite évoquent la présence de brique modelée ou moulée (?). Les deux exemplaires les plus représentatifs sont composés d’un limon fin compact brun à brun noir d’aspect organique. Un examen au microscope réalisé par J.-L. Brochier (Capra, Valence) a permis de discriminer un travail de malaxage, l’inclusion de nombreuses pailles de graminées et la présence sur un exemplaire d’un enduit de surface (litage de 6 micro-couches). Ce travail “soigné” nécessite une bonne maîtrise de la technique de la terre crue. L’exemplaire le mieux conservé présente deux faces parallèles et un angle trièdre (L. 8 x l. 6,5 x H. 4 cm ; poids 200 g) qui ne permettent pas de restituer un module de briquette (?). D’après le corpus disponible, les briques les plus fines mesurent au moins 6 cm d’épaisseur d’où l’hypothèse d’un fragment d’objet non architectural (C.-A. de Chazelles). L’emploi de briques de terre crue est à l’heure actuelle totalement inconnu en moyenne vallée du Rhône 21 même si la littérature 22 évoque au Pègue un mur de pierres sèches doublé à l’intérieur par un mur de briques d’adobe 23 et un dallage de briques d’adobe à Soyons 24. L’emploi de la terre crue dans l’architecture du site est peut être confirmé par la découverte de deux grosses scories (10 x 9 cm ; 150 g) identifiées par J.-L. Brochier comme le résultat de “briques” de terre fondue (sommet de mur ?) ou d’une meule/botte de pailles de graminées (toiture végétale ?) comprimées et chargées en phytolithes (silice), qui a brûlé à plus de 900° (fig. 9).
Le premier indice d’activité de combustion conservé in situ est fourni par la structure 24 (fig. 3) mise au jour sur un peu plus d’1 m2. Elle se présente comme un épandage sur un seul niveau de blocs (molasse) et de gros galets (quartzite) thermofractés et rubéfiés pour certains. Même si aucun creusement ne la circonscrit, elle pourrait s’apparenter à un fond de fosse à pierres chauffées, structure reconnue à Lattes, La Cougourlude et à Soyons, la mairie, dans des contextes du vie s. a.C, mais habituellement caractéristique des ixe-viiie s. a.C
L’autre découverte remarquable du site laténien est la très bonne conservation d’une sole de foyer (fig. 7). Localisée à seulement 4 m de la bordure occidentale du chenal, cette structure de combustion (F82) présente un plan circulaire régulier de 0,8 m de diamètre. La sole plane est conservée sur une épaisseur variant de 4 à 8 cm. Elle est constituée par une chape indurée de sable limoneux rubéfié dont la couleur varie du brun rouge dominant au brun noir avec ponctuellement quelques traces de marbrures jaunâtres. Elle est installée sur un radier composé de deux recharges de galets rubéfiés, de cailloutis d’éclats de quartzite (module 2 à 10 cm) et de 46 tessons de céramique non tournée liés à une matrice sablo-limoneuse brun rouge. Si la présence d’une plaque foyère témoigne de la proximité d’une habitation, elle est fréquemment localisée à l’extérieur de la cellule domestique comme c’est le cas à Bourbousson (500-450 a.C) ou à la Cougourlude (phase 550-475 a.C) où un seul foyer construit sur les cinq reconnus par la fouille est intégré dans un bâtiment (information I. Daveau). Ce type de foyer est l’un des plus répandus depuis le Bronze final comme sur de nombreux sites du Languedoc oriental 25, de Provence 26 ou de la région lyonnaise 27. En plus des six fragments de sole mis au jour dans le niveau d’occupation (US 236),
20. Treffort 2002, 384.21. Chazelles 2010.22. Planchon et al. 2010, 471.23. Lagrand & Thalmann 1973.24. Perrin & Bellon 1992, 426.25. Garcia & Rancoule 1989, 118 ; Gascó 2002, 9-1326. Nin 1999.27. Bellon et al. 2009, 121 ; Carrara et al. 2009, 214.
14DURAND,FRANC.indd 77 30/03/15 15:23
78 – É. DuranD, O. Franc
127 fragments de plaques foyères retrouvés en position secondaire dans le dépotoir du chenal (US 271-4 et 271-9) complètent le corpus des structures de combustion. La majorité des exemplaires présente une surface lissée noircie ou non par le feu avec quelques traces de calcite et une épaisseur moyenne conservée de 6 cm. D’une taille moyenne de 50 cm2, l’ensemble de ce corpus correspondrait théoriquement à au moins six autres foyers démantelés et rejetés dans le dépotoir du chenal.
Parmi les huit fosses mises au jour, cinq structures en creux dont la fonction primaire nous échappe souvent ont été, d’après leur abondant mobilier, réutilisées comme dépotoirs : F270-433 et F30 sur la rive ouest du chenal et F279, F39 et F275 en bordure orientale (fig. 3).
Si le profil de certaines fosses, comme la mieux conservée F279 (diamètre 1,2 m, H. 0,7 m) (fig 5), pourrait évoquer la moitié inférieure d’un silo à fond plat, le plan “polylobé” de la fosse 270-433 (L. 2,3 x 0,7 m) (fig. 3), le creusement “bosselé” de son fond et la présence d’éléments phosphato-organiques inclus dans son comblement pourraient renvoyer à un abreuvoir pour animaux même si la fonction admise pour ces structures à plan polylobé s’oriente vers l’extraction d’argile 28. Pour les autres fosses, le relatif dérasement (0,4 m de puissance maximum) des fosses ne permet aucune interprétation fonctionnelle. L’observation stratigraphique des dynamiques de remplissage (profil plan en F30, F39 et F279) dénote globalement un abandon relativement rapide, colmatage confirmé par ailleurs par l’absence de traces de dégradations sur le corpus faunique 29.
Culture matérielle et activités artisanales
Les 6364 fragments de céramique (552 NMI bord, 125 kg), 10 outils lithiques, 20 objets métalliques, 764 restes fauniques mis au jour dans dix-sept structures et autre niveau d’occupation ont fourni l’essentiel des données chrono-culturelles du site.
28. Ramponi 2009, 156.29. Lalaï in : Le Nézet-Célestin et al. 2009.
| Fig. 7. Rive ouest, aménagement domestique, foyer 82, sole rubéfiée sur radier (cl. E. Durand, Inrap 2008).
14DURAND,FRANC.indd 78 30/03/15 15:23
un Établissement rural au bOrD De l’eau au ve s. a.c. – 79
La céramique non tournée (514 NMI) est classiquement très largement majoritaire avec 95,9 % de la vaisselle. L’étude de ce corpus 30 a permis de constater de fortes ressemblances avec le faciès de Bourbousson 31, Guilherand-Granges 32, Tournon 33, Vaise 34 et de l’Est lyonnais 35. À l’exception de quelques caractères d’inspiration méridionale (décors de ligne brisée en chevrons 36), la typologie met en évidence des affinités quasi exclusives avec le domaine septentrional : jattes à profil en S ou à bord concave, pots en tonneau à décor d’impressions et surtout de cordons, pots sinueux hauts à décor de cordon (fig. 8 et 10).
Les 251 fragments de céramiques tournées représentent 4,1 % du total de la vaisselle. La céramique cannelée compte 141 fragments : 18 NMI ; 55,7 % du total des céramiques fines d’importation. Le répertoire peu varié avec de rares formes hautes (forme 9000 : fig. 8, objet 45) et une majorité de jattes/écuelles à profil sinueux à cannelures peu nombreuses et larges en bourrelets (forme 2200B et C : fig. 8, objet 61, 65 ; fig. 9, objet 40, 44, 53, 88) évoquent des formes “évoluées” connues par exemple à Bragny dans un contexte de la seconde moitié du ve s. a.C 37 et plus globalement renvoient au répertoire du groupe Centre et Centre-Est 38. Cette vaisselle est présente sporadiquement sur quelques autres sites de la moyenne vallée du Rhône au sud de Lyon (Tournon, Soyons, Crest, Chabrillan, Saint-Marcel-d’Ardèche) mais ne semblent pas dépasser le site du Pègue (vases de la fin du ve s. a.C d’après C. Lagrand). La céramique tournée à pâte sableuse de production certainement locale complète le corpus des communes et compte 65 tessons pour 6 individus (fig. 8, objet 46).
La céramique à pâte claire peinte produite en Provence (Le Pègue ? 39) ou en nord-Languedoc 40 comptabilise 35 fragments et 2 individus dont 1 décor “subgéométrique rhodanien” et une cruche CL-MAS 561 (?) (fig. 9, objet 35). La grise monochrome 41 à pâte de type groupe 3 défini par C. Arcelin-Pradelle (12 nfr ; 3 NMI dont une oenoché 8 et une coupe 2a ou 2e ; fig. 8, objet 64) et un tesson d’attique à vernis noir complètent les productions de vaisselle méditerranéenne avec 0,8 % du total vase et 18,5 % du total céramique fine. L’amphore massaliète micacée attestée par 191 fragments (11 NMI ; 2,9 % du total céramique) est représentée surtout par les types Py 3 et 4 et quelques types 1 (fig. 9, objet 50), 4 et 3/5 (fig. 8 et 9 : objet 33, 47, 62, 63, 97).
Si les données statistiques de ce nouveau site de plaine sont très éloignées de celles des sites du Midi ou de Lyon-Vaise, elles sont proches de celles des petits établissements de la plaine du Tricastin (Pont-de-Pierre 2 42), des garrigues d’Ardèche méridionale (Bois Sorbier 43, Les Conchettes 44) ou de l’Est lyonnais (Les Luèpes, Les Perches, Vénissieux 45) qui ont fonctionné surtout dans la seconde moitié du ve s. a.C.
Le corpus métallique compte 14 objets en alliage cuivreux et 6 objets en fer mis au jour principalement dans le dépotoir du chenal (14 objets provenant surtout des US 271-4 et 271-9). Si la catégorie des parures prédomine (6 fibules en F271, 2 bracelets, 1 anneau), quelques objets témoignent d’activités liées à l’artisanat domestique comme les trois aiguilles à chas mis au jour dans l’US 271.4.
30. Durand in : Le Nézet-Célestin et al. 2009.31. Treffort 2009.32. Dutreuil in : Robert et al. 2013.33. Maza in : Collombet et al. 2014.34. Bellon 2009.35. Nourissat 2009 ; Ramponi 2009.36. Arcelin 1993.37. Collet & Flouest 1997.38. Augier et al. 2013.39. Lagrand & Thalmann 1973 ; Bats 1993.40. Goury 1995.41. Py 1993.42. Durand 2002.43. Durand et al. 2012.44. Durand 2001.45. Ramponi 2009 ; Nourissat 2009.
14DURAND,FRANC.indd 79 30/03/15 15:23
80 – É. DuranD, O. Franc
| Fig. 8. Paléochenal, dépotoir “médian” 271-9 et 271-6 : exemples de mobilier céramique, métallique et lithique (dessin céramique E. Durand, Inrap 2008 ; dessin lithique P. Allix, Inrap 2008 ; cl. objet E. Durand ; DAO G. Macabéo, Inrap 2014).
14DURAND,FRANC.indd 80 30/03/15 15:23
| Fig. 9. Paléochenal, dépotoir “médian” 271-4/9 : exemples de céramique tournée, objets métalliques et lithiques (dessin céramique E. Durand, Inrap 2008 ; dessin lithique P. Allix, Inrap 2008 ; cl. objet E. Durand ; dessin objet A. Poirot ; DAO G. Macabéo, Inrap 2014).
14DURAND,FRANC.indd 81 30/03/15 15:23
| Fig. 10. Paléochenal, dépotoir “médian et inférieur” 271-4/9 et 271-7/8 : exemples de céramique non tournée (dessin céramique E. Durand, Inrap 2008 ; DAO G. Macabéo, Inrap 2014).
14DURAND,FRANC.indd 82 30/03/15 15:23
un Établissement rural au bOrD De l’eau au ve s. a.c. – 83
L’une d’elles se distingue par sa grande taille (L. sup. à 104 mm ; fig. 9, objet 30) et évoque une activité spécialisée : travail du cuir, des peaux, des fourrures ou de la laine, confection ou réparation de filets 46. Outre les exemplaires de Gorge-de-Loup 47, des parallèles peuvent être établis avec ceux de Bourguignon-lès-Morey 48, Salins-les-bains 49, Vix 50 et Chassey 51. Le caractère allongé des aiguilles serait caractéristique de La Tène A 52.
En revanche, aucun petit bracelet rubané et décoré d’incisions n’est à signaler, alors que ces armilles présentes à Bourbousson, Tournon et Soyons paraissent assez typiques de cette région médio-rhodanienne et ont été produites à Tournon 53 et peut-être à Bourbousson 54. La fosse 70 a livré deux bracelets : un exemplaire à globules espacés et un ouvert à fermoir et tenon typique de LTA1 comparable à ceux de Vaise, Messein ou Vix 55. Comme à Bourbousson ou à Tournon, cet ensemble paraît globalement caractéristique d’un site d’habitat et d’un contexte domestique, où le travail du textile est bien attesté par quelques fusaïoles (fig. 8, objet 27 ; fig. 10, objets 36 et 37) et trois aiguilles (fig. 9, objet 30).
La typologie des six fibules en alliage cuivreux a permis de confirmer la datation fournie par le corpus céramique et de préciser le contexte chrono-culturel du site. La fibule à petit arc et timbale hypertrophiée (Weidach, Mansfeld P4y ; fig. 8, objet 26) est l’un des marqueurs de la transition HaD3-LTA qui perdure au début de LTA1 56. Celle à pied en timbale replié sur l’arc triangulaire (fig. 9, objet 67) est une Mansfeld F4 57 ou une Tendille 6 58, à l’exception de la petite excroissance sommitale sur la timbale, décor connu à Vix 59 ou dans les Alpes 60. Cette fibule produite à partir d’une préforme coulée semble caractéristique des types Bourges-Lyon 61. Enfin la fibule à pied à retour horizontal situé nettement sous le sommet de l’arc et gros ressort (fig. 9, objet 66) semble caractéristique des types de LT A et pourrait se situer à LTA1b comme sur les exemplaires de Saint-Dizier et Vitry-les-Nogent 62. Le retour du pied remonte durant LT B1 pour se placer vers le sommet de l’arc, ce qui est la norme à LT B2 (information B. Girard). Un même type en fer existe en Indre-et-Loire dans un contexte du ive-début iiie s. 63. Si un autre ressort en arbalète serait peut-être à rattacher aux types Mansfeld F4, dP4, P4 ou dZ3, un dernier exemplaire moins bien conservé pourrait provenir d’une fibule de schéma laténien à quatre grosses spires 64.
Le matériel lithique, composé de neuf outils sur galets de quartzite (percuteur/abraseur, pilon/broyon et lissoir ; fig. 8, objet 128, fig. 9, objet 119) et de deux fragments de meule (basalte, molasse ; fig. 9, objet 122), provient principalement du chenal (US 271-4 et 271-9) et de la fosse polylobée 270 (un outil sur galet). Son étude a permis d’entrevoir les diverses activités réalisées à proximité des habitations 65. Il s’agit d’outillages bien souvent standardisés et parfois facettés, adaptés à des activités spécialisées comme le travail des métaux (martelage et lissage), la boucherie et la pelleterie (concassage des os et lissage des peaux) et le travail des roches (réaménagement de meules, bouchardage de blocs). De tels outils ont déjà été mis en évidence par S. Saintot sur les sites de Vaise (Horand III, IV et Berthet 2) et de Bourbousson.
En complément de ces indices d’activité, la mise au jour de deux fragments de cheville osseuse de caprin sectionnée par sciage illustre le prélèvement des étuis cornés afin d’approvisionner vraisemblablement en matière première un artisanat
46. Treffort 2009.47. Bellon et al. 1991.48. Dubreucq 2013, 140.49. Dubreucq 2013, 200.50. Chaume 2001.51. Dubreucq 2013, 416.52. Feugère & Guillot 1986, 217.53. Collombet et al. 2014.54. Hypothèse Carrara et al. 2013.55. Chaume 2001 ; Milcent 2004.56. Chaume 2001, 120.57. Mansfeld 1973.58. Tendille 1978.59. Chaume 2001.60. Willigens 1991.61. Carrara et al. 2013.62. Villes 2003, 304.63. Di Napoli & Lusson 2011, 141.64. Information S. Carrara.65. Saintot in : Le Nézet-Célestin et al. 2009.
14DURAND,FRANC.indd 83 30/03/15 15:23
84 – É. DuranD, O. Franc
de corneterie 66 bien connu par ailleurs comme à Lyon-Vaise sur les sites de Horand I-IV, Métro Gorge-de-Loup et 16-28 rue des Tuileries 67.
La faune identifiée (45 NMI sur les 764 restes) est essentiellement domestique même si la présence de cervidés (2 ind.) est reconnue 68. Parmi les taxons domestiques, ceux de la triade classique sont prédominants : bovins (7 NMI et 50,3 % des restes déterminés), ovicaprins (5 ind.) et porcins (5 ind.). Le cheval (2 NMI) et le chien (3 NMI) sont également attestés ainsi que le coq domestique. La présence de cette espèce aviaire pourrait donner au site de Romans un statut particulier. Ce seul reste (coracoïde) de coq constitue avec ceux de poules lattoises de la première moitié du ive s. a.C (information A. Gardeisen, V. Forest), les seuls témoins connus de cette espèce pour le Midi. Ce gallinacé d’origine orientale qui fait son apparition dès la fin du vie s. a.C sur quelques sites comme à Lyon, Gorge-de-wLoup (fin vie s. a.C), Horand I, 65 rue du Souvenir, Berthet 2 et Tuileries I 69 et récemment à Basly (Calvados) à la fin du Hallstatt pourrait être un témoin de contacts privilégiés avec le réseau étrusque ou grec 70.
un établissement rural indépendant ?Tous les critères structurels et mobiliers sont réunis pour attester la présence aux Prêles d’habitations installées
au ve s. a.C sur au moins 1500 m2 en bordure d’un ruisseau, d’activités domestiques tournées vers l’agro-pastoralisme (mouture, stockage, textile, travail du cuir, boucherie, corneterie) et d’une culture matérielle très septentrionale (faciès de la céramique et du mobilier métallique). L’emploi possible d’adobe pour la construction, la présence de onze conteneurs vinaires importés de Massalia, de six vases fins d’accompagnement méditerranéens, de quinze jattes cannelées provenant de la sphère hallstattienne, de nombreuses fibules et autres parures annulaires et de coq domestique interrogent sur le statut même de ce site. En l’absence apparente d’un habitat groupé installé sur les hauteurs des lobes du massif molassique voisin, peut-on classer le site a priori “isolé” des Prêles dans la catégorie des habitats de plaine indépendants ? Cette catégorie de sites isolés de toute structure centralisatrice et implantés en dehors du territoire vivrier d’une agglomération est bien représentée par exemple dans le Gard et l’Hérault 71.
Quoi qu’il en soit, la position géographique de cet établissement rural, à 30 km au nord de la vallée de la Drôme, frontière culturelle théorique entre sphère hallstattienne et méditerranéenne 72 et peut-être au carrefour de plusieurs itinéraires entre vallées de l’Isère et du Rhône, lui confère une vocation d’échanges très bien attestée par cette fouille préventive.
Références bibliographiques
66. Lalaï in : Le Nézet-Célestin et al. 2009.67. Kuntz et al. 2000 ; Carrara 2009 .68. Lalaï in : Le Nézet-Célestin et al. 200969. Argant 1996.70. Seigle 2013.71. Bagan 2007, 27.72. Treffort 2009, 467.
Arcelin, P. (1993) : “Céramique non tournée protohistorique de Provence occidentale”, in : Py, éd. 1993, 311-330.
Arcelin, P., M. Bats, D. Garcia, G. Marchand et M. Schaller, éd. (1995) : Sur les pas des Grecs en Occident, Études massa-liètes 4, Lattes-Paris.
Argant, T. (1996) : Approche archéo-zoologique du premier âge du Fer de la plaine de Vaise à Lyon, mémoire de DEA, Université Lumière Lyon II.
Argant, T., collab. C. Argant, B. Clément, M.-C. Kurzaj, G. Maza, L. Robin, S. Charbouillot et S. Carrara (2009) : Mauboule,
Le Champ du Pont (Valence, Drôme), rapport final d’opé-ration d’archéologie préventive, SRA Rhône-Alpes, Lyon.
Association pour la recherche archéologique en Languedoc orien-tal (2002) : Archéologie du TGV Méditerranée, Fiches de Synthèse, II : La Protohistoire, MAM 9, Lattes.
Augier, L., I. Balzer, D. Bardel, S. Deffressigne, É. Bertrand, F. Fleischer, S. Hopert-Hagmann, M. Landolt, C. Mennessier-Jouannet, C. Mège, M. Roth-Zehner, M. Saurel, C. Tappert, G. Thierrin-Michael et N. Tikonoff (2013) : “La céramique façonnée au tour : témoin privilégié de la diffusion des tech-
14DURAND,FRANC.indd 84 30/03/15 15:23
un Établissement rural au bOrD De l’eau au ve s. a.c. – 85
niques au Hallstatt D2-D3 et à La Tène A-B1”, in : Colin & Verdin, éd. 2013, 563-594.
Bagan, G. (2007) : “L’habitat dispersé protohistorique dans le Midi de la France entre le viie s. et le iiie s. av. J.-C.”, Histoire et Sociétés Rurales, 27, 7-36.
Bats, M. (1993) : “Céramique à pâte claire massaliète et de tradition massaliète”, in : Py, éd. 1993, 206-221.
Bats, M. G. Bertucchi, G. Conges et H. Treziny, éd. (1992) : Marseille grecque et la Gaule, Actes du colloque international d’His-toire et d’Archéologie et du Ve congrès archéologique de Gaule méridionale, Marseille, 18-23 novembre 1990, Études massaliètes 3, Lattes-Aix-en-Provence.
Béal, J.-C. et J.-C. Goyon, éd. (2000) : Des ivoires et des cornes dans les mondes anciens (Orient-Occident), Collection de l’Institut d’Archéologie et d’Histoire de l’Antiquité 4, Lyon.
Bellon, C. (2009) : “Quelques réflexions autour du vaisselier du Ier âge du Fer de Lyon”, in : Chaume, éd. 2009, 427-447.
Bellon, C., J. Burnouf, J.-M. Martin et A. Verot-Bourrely (1991) : “Premiers résultats de fouille sur le site de Gorge de Loup (Lyon-Vaise, 69)”, in : Duval, éd. 1991, 3-20.
Bellon, C., O. Franc, collab. T. Argant (2009) : “Lyon avant Lugdunum. L’occupation du premier âge du Fer dans son environnement naturel : synthèse de 20 ans de fouille archéologique”, in : Lambert-Roulière et al., éd. 2009, 111-132.
Berger, J.- F. (2003) : “La ‘dégradation des sols’ à l’Holocène dans la moyenne vallée du Rhône : contextes morpho-clima-tique, paléobotanique et culturel”, in : Van der Leeuw et al., éd. 2003, 43-167.
Berger, J.- F., J.- P. Bravard, J.- L. Brochier, O. Franc, P.-G. Salvador et A. Vérot-Bourrély (2009) : “La géo-archéologie fluviale dans la vallée du Rhône (Seyssel-Donzère). Bilan de 25 ans de recherche”, in : Lambert-Roulière et al., éd. 2009, 27-37.
Billaud, Y. (2002) : “L’occupation du Hallstatt final des Gachets 2 à Chabeuil (Drôme)”, in : Association pour la recherche archéologique en Languedoc oriental 2002, 359-366.
Bravard, J.-P., A. Vérot-Bourrély et P.-G. Salvador (1992) : “Le climat d’après les informations fournies par les environne-ments sédimentaires fluviatiles étudiés sur les sites archéo-logiques”, in : Magny & Richard 1992, 7-13.
Brun, P. et B. Chaume, éd. (1997) : Vix et les éphémères princi-pautés celtiques, les vie et ve siècles avant J.-C. en Europe centre-occidentale, Actes du colloque de Châtillon-sur-Seine, 27-29 octobre 1993, Paris.
Buchsenschutz, O., éd. (2009) : L’âge du Fer dans la boucle de la Loire – Les Gaulois sont dans la ville, XXXIIe colloque de l’AFEAF, Bourges, 1-5 mai 2008, RAC Suppl. 35, Tours.
Carrara, S., collab. G. Maza et S. Rottier (2009) : “L’agglomération proto-urbaine de Lyon-Vaise aux vie-ve s. av. J.-C.”, in : Buchsenschutz, éd. 2009, 207-235.
Carrara, S., E. Dubreucq et B. Pescher (2013) : “La fabrication des fibules à timbale comme marqueur des contacts et des transferts technologique au cours du Ha D-LT A1. Nouvelles données d’après les sites de Bourges, Lyon et Plombières-les-Dijon”, in : Colin & Verdin, éd. 2013, 595-608.
Chaume, B. (2001) : Vix et son territoire à l’âge du Fer. Fouilles du mont Lassois et environnement du site princier, Protohistoire européenne 6, Montagnac.
Chaume, B., éd. (2009) : La Céramique Hallstattienne, approches typologique et chrono-culturelle, Actes du colloque interna-
tional de Dijon, 21-22 novembre 2006, Art, archéologie et patrimoine, Dijon.
Chazelles, C.-A. de (2010) : “Quelques pistes de recherche sur la construction en terre crue et l’emploi des terres cuites archi-tecturales pendant l’Âge du fer dans le bassin occidental de la Méditerranée”, in : Tréziny, éd. 2010, 309-318.
Colin, A. et F. Verdin, éd. (2013) : L’âge du Fer en Aquitaine et sur ses marges. Mobilité des hommes, diffusion des idées, circulation des biens dans l’espace européen à l’âge du Fer, Actes du XXXVe colloque de l’AFEAF, Bordeaux, 2-5 juin 2011, Aquitania Suppl. 30, Bordeaux.
Collet, S. et J.-L. Flouest (1997) : “Activités métallurgiques et commerce avec le monde méditerranéen au Ve siècle avant J.-C. à Bragny-sur-Saône (Saône-et-Loire)”, in : Brun & Chaume, éd. 1997, 157-164.
Collombet, J., T. Argant, H. Djerbi, F. Granier, G. Maza, Q. Rochet et F. Ruzzu (2014) : Rhône-Alpes, département de l’Ardèche (07), Tournon-sur-Rhône - Place Jean Jaurès, rapport final d’opération d’archéologie préventive, SRA Rhône-Alpes, Lyon.
Daveau, I. et M. Py (2015) : ”Grecs et Étrusques à Lattes : nouvelles données à partir des fouilles de la Cougourlude”, in : Roure, éd. 2015, 31-42.
Di Napoli, F. et D. Lusson (2011) : “Deux occupations rurales de La Tène ancienne à Sainte-Maure-de-Touraine, Les Chauffeaux (Indre-et-Loire)”, RACF, 50, 109-174.
Dubreucq, E. (2013) : Métal des premiers celtes. Productions métal-liques sur les habitats dans les provinces du Hallstatt centre-occidental, Art, archéologie et patrimoine, Dijon.
Dupraz, J. et C. Fraisse, éd. (2001) : L’Ardèche, CAG 7, Paris.
Durand, E. (2001) : “L’Ardèche à la fin de l’âge du Bronze et aux âges du Fer (ixe siècle-ier siècle avant notre ère)”, in : Dupraz & Fraisse, éd. 2001, 70-81.
— (2002) : “Un habitat des basses plaines rhodaniennes du milieu de l’âge du Fer”, in : Association pour la recherche archéo-logique en Languedoc oriental 2002, 479-488.
Durand, E., collab. L. Fabre et J.-C. Ozanne (2000) : “L’habitat perché et fortifié des Conchettes (Grospierres) aux ve et au début du ive siècle avant notre ère”, Les nouveaux cahiers du Grospierrois, 4, 1-16.
Durand, E., M. Matal, L. Fabre et H. Sidi Maamar (2012) : “L’éperon barré protohistorique (-450/-375) de Bois Sorbier, Bourg-Saint-Andéol (Ardèche)”, Ardèche Archéologie, 29, 26-36.
Dutreuil, P. et A. Gilles (2013) : “L’occupation du site de Soyons au Bronze final et aux âges du fer : bilan et perspectives”, Ardèche Archéologie, 30, 57-63.
Duval, A., éd. (1991) : Les Alpes à l’âge du Fer, Actes du Xe colloque de l’AFEAF, Yenne-Chambéry, 1986, RAN Suppl. 22, Paris.
Fechner, K. et M. Mesnil, éd. (2002) : Pain, fours et foyers des temps passés. Archéologie et traditions boulangères des peuples agriculteurs d’Europe et du Proche Orient, Civilisations 49 (1-2), Bruxelles.
Feugère, M., B. Dedet, S. Leconte et G. Rancoule (1994) : “Les parures du ve au iie siècle av. J.-C. en Gaule méridionale : composantes indigènes, ibériques et celtiques”, Aquitania, 12, 237-281.
Feugère, M. et A. Guillot (1986) : “Fouilles de Bragny. 1. Les petits objets dans leur contexte du Hallstatt final”, RAE, 37, 159-221.
14DURAND,FRANC.indd 85 30/03/15 15:23
86 – É. DuranD, O. Franc
Garcia, D. et G. Rancoule (1989) : Les aménagements des espaces domestiques prorohistoriques en Languedoc-Roussillon, Habitats et structures domestiques en Méditerranée occi-dentale durant la Protohistoire, pré-actes, colloque inter-national, Arles-sur-Rhône, 19-21 octobre 1989, Aix-en-Provence, 117-122.
Gascó, J. (2002) : “Structures de combustion et préparation des végétaux de la préhistoire récente et de la protohistoire en France méditéranéenne”, in : Fechner & Mesnil, éd. 2002, 285-309.
Goury, D. (1995) : “Les vases pseudo-ioniens des vallées de la Cèze et de la Tave (Gard)”, in : Arcelin et al., éd. 1995, 309-324.
Kuntz, L., T. Argant et C. Bellon (2000) : “Un atelier de cornetier du Ier âge du Fer à Lyon”, in : Béal & Goyon, éd. 2000, 67-74.
Lagrand, C. et J.-P. Thalmann (1973) : Les Habitats protohistoriques du Pègue (Drôme), Le sondage n° 8 (1957-1971), Cahier du Centre de documentation de la préhistoire Alpine 2, Grenoble.
Lambert-Roulière, M.-J., A. Daubigney, P.-Y. Milcent, M. Talon et J. Vital, éd. (2009) : De l’âge du Bronze à l’âge du Fer en France et en Europe occidentale (xe-viie s. av. J.-C.). La moyenne vallée du Rhône aux âges du Fer, Actes du XXXe colloque de l’AFEAF, Saint-Romain-en-Gal, 25-28 mai 2006, RAE Suppl. 27, Dijon.
Le Nézet-Célestin, M., E. Durand, O. Franc, M. Goy, P. Rigaud, V. Savino, A. Horry, C. Vermeulen, N. Attiah, A. Poirot, C. Bonnet, D. Lalaï, C. Cecillon et S. Saintot (2009) : Contournement nord-ouest de Romans (CNOR), rapport final d’opération, Inrap, Romans.
Lurol, J.-M., coll. E. Durand (2013) : “Loriol-sur-Drôme, Riboulin (Drôme)”, Bilan scientifique Rhône-Alpes, Lyon, 86-87
Magny, M., collab. H. Richard (1992) : Le climat à la fin de l’âge du Fer et dans l’Antiquité (500 BC-500 AD). Méthodes d’approches et résultats, Les Nouvelles de l’Archéologie 50, Paris.
Mandier, P. (1988) : Le relief de la moyenne vallée du Rhône au Tertiaire et au Quaternaire. Essai de synthèse paléogéogra-phique, Documents du BRGM 151, Lyon.
Mandier, P., J. Evin, J. Argant et R. Petiot (2003) : “Chronostratigraphie des accumulations würmiennes dans la moyenne vallée du Rhône : l’apport des dates radiocarbones”, Quaternaire, 14 (1), 113-127.
Mansfeld, G. (1973) : Die Fibeln der Heuneburg 1950-1970: ein Beitrag zur Geschichte der Späthallstattfibel, Römisch-germanische Forschungen 33, Berlin.
Milcent, P.-Y. (2004) : Le premier âge du Fer en France centrale, Mémoire de la Société préhistorique française 34, Paris.
Nin, N. (1999) : “Les espaces domestiques en Provence durant la Protohistoire, Aménagements et pratiques rituelles du vie s. av. n. è. à l’époque augustéenne”, DAM, 22, 221-278.
Nourissat, S. (2009) : “Vénissieux (Rhône) à l’âge du Fer”, in : Lambert-Roulière et al., éd. 2009, 143-164.
Perrin, F. et C. Bellon (1992) : “Mobilier d’origine et de filiation méditerranéenne dans la moyenne vallée du Rhône, entre Alpes et Massif Central”, in : Bats et al., éd. 1992, 419-430.
Planchon, J., M. Bois et P. Conjard-Réthoré (2010) : La Drôme, CAG 26, Paris.
Plouin, S. et P. Jud (2003) : Habitats, mobiliers et groupes régionaux à l’Âge du Fer, Actes du XXe colloque de l’AFEAF, Colmar-Mittelwihr, 16-19 mai 1996, RAN Suppl. 20, Dijon.
Py, M. (1993) : “Céramique grise monochrome”, in : Py, éd. 1993, 445-452.
Py, M., éd. (1993) : Dicocer. Dictionnaire des céramiques antiques (viie s. av. n. è.-viie s. de n. è.) en Méditerranée nord-occidentale (Provence, Languedoc, Ampurdan), Lattara 6, Lattes.
Ramponi, C. (2009) : “L’occupation du sol dans l’est lyonnais de la fin de l’âge du Bronze à la fin de l’âge du Fer”, in : Lambert-Roulière et al., éd. 2009, 143-164.
Réthoré, P. (1996) : Chabeuil “Brocards”, Drôme (26), AFAN-TGV ligne 5 : Archéologie et TGV, rapport d’évaluation, SRA Rhône-Alpes, Lyon.
— (1997) : Lot 12 : Chabrillan “L’Hortal”, Drôme (26), AFAN-TGV ligne 5 : Archéologie et TGV, rapport d’évaluation, SRA Rhône-Alpes, Lyon.
Réthoré, P., O. Franc, J. Vital, A. Horry, J.- L. Gisclon, B. Rambault et V. Vachon (2006) : Romans, rocade nord-ouest (Drôme), rapport de diagnostic, DRAC Rhône-Alpes, Lyon.
Réthoré-Conjard, P., C. Bonnet, C. Cécillon, D. Frascone, E. Morin et E. Néré (2014) : Valence, ZAC Mauboule, tranche 3 (Drôme), rapport de diagnostic, DRAC Rhône-Alpes, Lyon.
Robert, J. (2013) : “Guilherand-Granges (Ardèche, Rhône-Alpes) Bayard-Nord RD 96”, Bilan scientifique Rhône-Alpes, 54.
Roure, R., éd. (2015) : Contacts et acculturations en Méditerranée Occidentale. Hommages à Michel Bats, Actes du colloque international d’archéologie, Hyères-les-Palmiers, 15-18 septembre 2011, Bibliothèque d’Archéologie Méditerranéenne et Africaine 15 / Études Massaliètes 12, Arles.
Saintot, S. (2002) : “Traces d’occupation hallstattienne des Châtaigners-nord à Montvendre (Drôme)”, in : Association pour la recherche archéologique en Languedoc oriental 2002, 367-374.
Seigle, M. (2013) : Les animaux de basse-cour en Rhône-Alpes aux âges du Fer, mémoire de recherche, Université Lumière Lyon II.
Tendille, C. (1978) : “Fibules protohistoriques de la région nîmoise”, DAM, 1, 77-112.
Treffort, J.-M. (2002) : “L’habitat du Hallstatt final de Crest-Bourbousson 1 (Drôme)”, in : Association pour la recherche archéologique en Languedoc oriental 2002, 381-396.
— (2009) : “La céramique du site de Crest-Bourbousson (Drôme) dans son contexte rhodanien”, in : Chaume, éd. 2009, 449-468.
Tréziny, H., éd. (2010) : Grecs et indigènes de la Catalogne à la Mer Noire, Actes des rencontres du programme européen Ramses 2 (2006-2008), BIAMA 3, Aix-en-Provence.
Van der Leeuw, S., F. Favory et J.- L. Fiches, éd. (2003) : Archéologie et systèmes socio-environnementaux, Etudes multiscalaires sur la vallée du Rhône dans le programme ARCHAEOMEDES, CRA Monographies 27, Paris.
Vermeulen, C. (2002) : “Structures d’habitat de l’âge du Fer à Chabrillan - Les Plots (Drôme)”, in : Association pour la recherche archéologique en Languedoc oriental 2002, 397-400.
Villes, A. (2003) : “Les limites méridionales du ‘Jogassien’ et du ‘Marnien’ ”, in : Plouin & Jud 2003, 301-347.
Willigens, M.-P. (1991) : “L’âge du Fer en Savoie et Haute-Savoie”, in : Duval, éd. 1991, 157-226.
14DURAND,FRANC.indd 86 30/03/15 15:23