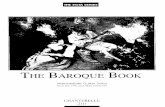Imposteurs et policiers au siècle des Lumières/Impersonators and policemen in 18th-century France
-
Upload
univ-paris1 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Imposteurs et policiers au siècle des Lumières/Impersonators and policemen in 18th-century France
Vincent Denis Imposteurs et policiers au siècle des Lumières
Résumés
Imposteurs et policiers au siècle des Lumières Dans la France du XVIIIe siècle se développent les pratiques d’imposture et le recours à de fausses identités. Cet article est une étude de ces pratiques à partir des dossiers de prisonniers de la Bastille. L’observation des imposteurs révèle les codes de l’identité en vigueur dans la société française. Mais elle montre aussi les limites intrinsèques de l’imposture. Enfin, l’étude de leur répression permet de s’interroger sur le rôle de la police dans la fixation et le respect des identités dans la société du XVIIIe siècle Impostors and the police in 18th-century France At the midst of the Enlightenment, France was testimony to the increasing practices of false identities.The present article aims at analysing these practices through a number of related documents on the prisoners in the Bastille Prison. The analysis demonstrates the codes surrounding the question of identity at that time in the French society. It also brought us to understand intrinsic limitations faced by these practionners of a false identity. Studying their punishments enables us to probe into the role played by the Police, within the social fabric of the 18th century, in protecting personal identities. Auteur Vincent Denis est maître de conférences en histoire moderne à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Centre de Recherche sur l’histoire du monde moderne et des révolutions, CRHMR). Il est l’auteur d’une thèse de doctorat sur l’identification des individus en France du début du XVIIIe siècle jusqu’au Premier Empire. Il consacre ses travaux au rôle de la construction de l’Etat moderne dans la fabrication du social, du dix-huitième siècle à l’époque napoléonienne. C’est ce qui l’a conduit à s’intéresser à la police, comme un observatoire pour saisir une nouvelle forme de rationalité étatique, ainsi que les savoirs qu’elle produit et utilise pour agir. Parmi ses publications récentes : (avec Vincent Milliot) « Police et identification dans la France des Lumières », Genèses, 54, mars 2004, pp 4-27 ; « Inventeurs en uniformes : gendarmes et policiers de la Restauration face à l’amélioration des feuilles de signalement », Cahiers de la Sécurité Intérieure, 56, 1er trimestre 2005, pp 271-289. Contact [email protected]
Imposteurs et policiers
Le siècle des Lumières est par excellence le siècle des aventuriers. A juste titre,
plusieurs études, venues de l'histoire et de la sociologie des lettres, ont souligné les liens entre la civilisation du dix-huitième siècle et les aventuriers, les arrachant à des décennies d'histoire anecdotique1. Leurs ascensions et leurs chutes fracassantes exercent une fascination durable. Cependant l’attention privilégiée qui leur est portée a conduit à occulter un phénomène moins spectaculaire, mais peut-être plus répandu, celui du développement des pratiques d’imposture au dix-huitième siècle. Aventuriers, escrocs ou même simples "fols" qui s'imaginent nobles ont souvent en commun le recours à une identité inventée ou usurpée. Au-delà de la diversité des motivations des conduites, force est de constater l’existence d’un socle commun de gestes et de techniques qu’on peut appeler des pratiques d’imposture. Le mystérieux personnage qui tente de s’introduire à la Cour sous l’identité d’un « prince de l’Arabie heureuse », l’escroc qui déménage à la cloche-de-bois pour se réinstaller sous un faux nom, ou même le cas psychiatrique qui se prend pour un fils de noble et agit comme tel, partagent ainsi l’usage de formes de dissimulation et de manipulation de la « mise en scène de soi », pour reprendre la terminologie d’Erwin Goffmann, au service d’une stratégie spécifique2. Si l’on ne s’arrête pas à la diversité des qualifications parfois hésitantes données par les contemporains et qu’on s’attache à l’observation des gestes et du fond des affaires, on est frappé par la fréquence de ces pratiques d’imposture au-delà du cercle étroit des aventuriers, à la fois dans les préoccupations de la police telles qu’on peut les lire dans les écrits de ses responsables et dans les archives de police elles-mêmes. Les responsables de la justice et du maintien de l'ordre se trouvent confrontés à des formes variables d'usurpation de l’identité individuelle et du rang social.
A cet égard, les archives de la Bastille, contenant les dossiers des individus arrêtés par lettre de cachet et passés par la plus célèbre prison parisienne, se révèlent particulièrement riches de ce point de vue : aux interrogatoires des détenus s’ajoutent parfois leurs papiers personnels et toujours la correspondance de la police à leur égard3. Ces dossiers ne permettraient pas d’embrasser la totalité du phénomène : formés à l’occasion d’une procédure spécifique, l’arrestation sur « ordre du roi », devenue depuis la fin du dix-septième siècle la mesure de police par excellence, les
1 ROTH (S.), Les Aventuriers au XVIIIe siècle, Galilée, 1987 ; STROEV (A.), Les Aventuriers des Lumières, Presses Universitaires de France, 1997. 2 GOFFMAN (E.), La Mise en scène de la vie quotidienne, Paris, 1973 (pour la trad. française). 3 Ces documents sont conservés aujourd’hui à la Bibliothèque de l’Arsenal. Une grande partie d’entre eux ont été publiés leur archiviste : RAVAISSON (F.), Archives de la Bastille., Pedone, 1904.
dossiers laissent dans l’obscurité les imposteurs passés devant les tribunaux ordinaires. A cette limitation procédurale s’ajoute une limitation géographique et sociale, puisque les dossiers concernent exclusivement des individus incarcérés d’abord à Paris et donc généralement arrêtés sur place ou à proximité. Il s’agit enfin d’archives qui sanctionnent l’échec même de tactiques d’imposture et il s’avère particulièrement difficile d’étudier l’histoire d’imposteurs heureux, c’est-à-dire jamais découverts.
Leur étude présente cependant des intérêts multiples. La mobilisation policière à leur encontre a souvent laissé des dossiers fort documentés et les détails des procédures pour les confondre permet d’esquisser une ethnographie de l’imposture. Ceux qui ont recours à l’imposture agissent en mimant et en détournant à leur profit les codes identitaires de groupes dont ils cherchent à abuser. L’examen de leurs faits et gestes peut être un biais privilégié pour approcher les signes sur lesquels se construisent les relations sociales, dans une société donnée. Mais si les succès temporaires des pratiques d’imposture peuvent nous montrer ce qui fait l’identité dans la France du dix-huitième siècle, leur échec final et l’arrestation de ceux qui s’y livrent signalent également à l’observateur l’existence d’interactions et d’épreuves dont même l’imposteur le plus virtuose ne peut sortir vainqueur et au terme desquelles sa fausse identité se défait. La réussite et la chute de ceux qui recourent à l’imposture nous met ainsi au coeur des mécanismes par lesquels existe l’identité individuelle. Qu’est-ce donc qui fait que l’on reconnaisse quelqu’un, mais aussi que l’on puisse refuser de le reconnaître ? Par ailleurs, les formes de répression des pratiques d’imposture ne laissent pas d’étonner : le contraste est souvent frappant entre la faible gravité apparente des affaires et la vigilance, voire la fébrilité des agents de la police à leur égard. Sans être particulièrement nombreuses (les affaires de libelles, les jansénistes, les « affaires d’Etat » ou l’escroquerie pure et simple sont beaucoup plus fréquentes à la Bastille), les affaires qui mobilisent l’imposture occupent régulièrement la police parisienne qui les traite toujours avec un grand luxe de détails. Enfin, la grande variété des conduites délinquantes où intervient l’imposture (de l’escroquerie à l’usurpation d’identité per se) entraîne une réponse répressive relativement indifférenciée, au-delà de la diversité des griefs et des dommages. Est-ce « l’escroc » ou « l’imposteur » que l’on veut punir ? L’étude des procédures peut alors éclairer les justifications et le rôle que se voient reconnaître les agents de la police face aux imposteurs.
Ce que dit l’imposture sur la société Les causes de cette prospérité de l’imposture sont à chercher du côté de la
permanence de modes de construction de l’identité largement dominés par
l’interconnaissance, où les apparences et la mise en scène du moi sont encore décisives pour se faire reconnaître4. Le monde de la noblesse, marqué par le cosmopolitisme et l’hospitalité, est particulièrement vulnérable. Les conduites d’impostures sont ainsi un puissant révélateur sociologique du fonctionnement de la société d’Ancien Régime.
Apparences et apparat L’identité s’y construit largement par l’apparence et le corps. C’est
principalement sur cette dimension que jouent les « chevaliers d’industrie », des escrocs qui se font passer pour de riches aristocrates, vivant sur un grand pied, par esprit de lucre, mais aussi parfois par désir de revanche sociale : Pierre Tiercelin, installé à Paris en 1765 sous le nom de « Comte de Tiercelin » est ainsi le fils naturel de feu le comte de Tiercelin, un gentilhomme normand. Il usurpe le titre de son demi-frère, qui refuse de le reconnaître5. Leur stratégie repose sur quelques éléments qu’on retrouve toujours à l’œuvre. Plus qu’un simple faux nom, les aventuriers s’inventent un personnage complet. Ils jouent sur tous les signes de reconnaissance sociale, vis-à-vis des autres groupes sociaux, en mimant tout ce qui peut les faire passer pour des aristocrates fortunés. De ce point de vue, ils projettent des signes à profusion et sont rien moins que discrets. La beauté physique, généralement associée à la noblesse dans l’imaginaire social, est un atout, mais elle n’est pas suffisante6. Dans la construction du personnage, tous les signes apparents sont essentiels : aussi l’une des premières manœuvres du « comte de Tiercelin » installé à Paris est de commander à un marchand de galons une fourniture considérable « pour monter une maison brillante » : « il y a mention de Suisses, de postillon, de housses de chevaux », écrit son créancier7. L’apparat est essentiel au faux noble pour qu’il puisse tenir son rang et son rôle. Ceux dont l’apparence extérieure ne correspond pas au rang social revendiqué – et c’est souvent le cas pour ceux qui pratiquent l’imposture, puisqu’elle est au service d’une ascension – doivent alors s’engager dans des stratagèmes complexes pour rendre plausible aux yeux d’autrui cet écart entre l’être (supposé) et le paraître. Le faux Gariod de Choulans révèle à son logeur qu’il représente les intérêts d’une très riche princesse germanique amoureuse de lui et dont il n’est encore que l’émissaire secret. Secret encore de l’origine noble que révèle Louis Roger, un
4 ROCHE (D.), La Culture des apparences, Fayard, 1988. 5 AdB, Ms 12270, fol. 24, lettre du commissaire Dupuy à Sartine, 15 février 1765. 6 Cette prisonnière, folle, ouvrière plus jolie que les autres, s’imaginait par ce fait qu’elle avait une origine noble. Le rôle de la beauté physique a été finement étudié par Déborah Cohen : COHEN (D.), « Trois vies emprisonnées à la Bastille au XVIIIe siècle : du discours du corps au discours sur les corps », Hypothèses 2002 : Travaux de l’Ecole doctorale d’histoire, Publications de la Sorbonne, pp 69-85. 7 AdB, Ms 12270, fol. 22, « Extrait concernant une dettes de 600 # ».
soldat prisonnier, à l’aumônier des prisons militaires de Brest : il prétend être le fils caché de feu le marquis de Flavacourt, lieutenant du roi, dont il n’aura de cesse d’importuner la veuve, qui le fera embastiller. Ce sont le secret et l’indicible qui viennent commodément satisfaire la curiosité de leurs interlocuteurs. A l’explication logique qu’on attend sur le fossé entre les apparences et le statut revendiqué, les praticiens de l’imposture répondent par l’inexplicable. Les stratagèmes révèlent ainsi a contrario le poids des apparences et le rôle taxinomique de la mise en scène corporelle dans la société.
Mais le jeu sur les apparences ne vaut pas que pour les inférieurs. Escroquer aubergistes et fournisseurs n’est souvent qu’une étape, un expédient sur la route qui doit conduire l’aventurier vers la fortune : il vise à s’infilter au cœur des élites de la naissance et de l’argent. C’est dans cette fréquentation qu’il pourra s’enrichir en dupant de crédules nantis comme en monnayant leurs relations et leur « crédit » parmi les grands auprès de personnages plus ordinaires. Pour faire bonne figure et se faire accepter par ceux qu’il a choisi pour pairs, l’imposteur doit soigner sa composition, être capable d’un mimétisme social qui trompe même les individus pris pour modèles.
Les manoeuvres des uns et des autres montrent également la prégnance de valeurs aristocratiques dont ils savent jouer soit pour parfaire leur personnage, soit pour désarmer la méfiance de leurs interlocuteurs. Ils font des dettes et accumulent les dépenses ? Cela va sans s’expliquer, car la libéralité fait aussi partie des signes extérieurs de noblesse : nos aventuriers multiplient ainsi les dettes, jusqu’à ce que les créanciers s’impatientent. Ils jouent également du respect de la parole donnée, particulièrement entre gens du monde, les aubergistes se montrant généralement plus méfiants.
Les usages du nom
Dans ces stratégies de reconnaissance, l’usage du nom et du titre mérite une
mention particulière. A l'époque, ni l'imposture ni l'usurpation ne peuvent se réduire à l'apparence et au travestissement. Le nom constitue le premier élément de l'imposteur, mais son premier capital également, puisqu'il s'agit de le faire accepter ou de le faire fructifier : par le nom on espère gagner la reconnaissance, l'argent et les honneurs auxquels on prétend. Aussi l'imposteur, peut-être avant même d'être une silhouette avenante, est-il un nom. Il n'est jamais anonyme : c'est bien volontiers que la comtesse de Falckenstein, le baron de Winfeld ou le comte Tiercelin déclinent leur identité, à leurs hôtes comme à ceux qu'ils rencontrent. Plus tard, interrogés par la police, ils s'y accrochent comme à une planche de salut. Il est bien le dernier élément sur lesquels les imposteurs tardent à revenir : ils peuvent bien avouer jusqu'à leurs
escroqueries et leurs dettes impayées, mais ils ne renoncent pas à leur nom. Apposé sur les mémoires (factures) des fournisseurs, décliné dans les interrogatoires de police et même signé au bas des procès-verbaux, le nom est exhibé et arboré : Tiercelin de la Colleterie, parmi ses premières démarches arrivé à Paris, commande des costumes et des livrées pour un équipage à son nom. Le nom et le titre qu'il comporte signifient un rang social, assignent à leur porteur une position précise et, même inconnus, emportent avec eux crédit et respectabilité. On en use pour marquer la différence avec les inférieurs et revendiquer l'égalité sinon la reconnaissance par les "personnes de qualité", selon l'expression consacrée. Il est l’arme première des imposteurs, la pierre de touche de leurs manœuvres : ils le brandissent et l’exhibent à tout va. Généralement désargenté, l’aventurier est prodigue de billets et de reconnaissances de dettes qu’il signe complaisamment. Le nom est un capital primitif. Pour cela, il le considère comme une part incessible de lui-même et le défend bec et ongles. Emprisonné à la Bastille, Louis Roger ne répond qu’au nom de Mailly de Flavacourt et signe ainsi son premier interrogatoire. Plus tard, emprisonné à l’île de Ré, il écrit encore à Madame de Flavacourt en prenant le nom du frère du marquis, Fouilleuse de Flavacourt. Captif à Bicêtre, de 1768 à 1773, il persiste à ne répondre qu’au nom de Flavacourt8. Le pseudo comte se présente lors de son arrestation sur ordre du Roi comme « Pierre Dutiercelin chevalier seigneur de la Collatoire âgé de 40 ans natif de Saint Hubert de Villiers province du Perche près Mortagne »9. Il y a dans la prolixité à se nommer et à se faire nommer une dimension performative essentielle.
Bâtir sa réputation : le rôle des intermédiaires
Les agissements de ceux qui pratiquent l’imposture mettent à nu le
fonctionnement d’une société largement régie par la réputation. C’est ici que s’explique le recours obligé à des intermédiaires pour accréditer leur identité auprès de ceux qui sont leurs véritables cibles. Dans une société où l’individu n’est rien sans les liens communautaires qui l’enserrent, l’imposteur ne peut rester seul et son nom ne peut suffire. L’imposteur doit s’entourer. Il a parfois recours à des complices dans la confidence, comme Madame de Monsamois, qui sert d’intermédiaire à Tiercelin. Mais le plus souvent l’imposteur s’appuie sur des individus de bonne foi. Il s’emploie rapidement à convaincre un dupe de son identité et trouve en lui son meilleur allié : sincèrement convaincu, il n’hésite pas à mettre son crédit au service de son nouvel ami et à l’aider dans ses démarches. Louis Roger, de retour des troupes coloniales de Saint-Domingue, a manifestement trouvé quelqu’un de tout disposé à croire à sa noble
8 AdB, Ms 12323, fol. 47, 141 et 180-201. 9 AdB, Ms 12270, fol. 34, procès-verbal de capture, 5 mai 1765.
parenté et à son histoire de fils de bonne famille exilé aux « isles » en la personne de l’aumônier Godefroy :
« J’ai toujours pensé, écrit ce dernier à Madame de Flavacourt, que ce Monsieur avait fait
quelques folies de jeunesse, et que par conséquent il n’osait approcher de la maison paternelle »10. L’aumônier Godefroy devient un instrument dans les mains de Roger, qui lui
fait écrire au duc de Lauragais pour prévenir sa famille et se faire libérer de la prison de Brest11. De même Tiercelin s’est appuyé sur la douteuse Madame de Monsamois qui lui a servi d’intermédiaire, mais aussi sur un nommé Hérault, à qui il a fait quitter son emploi dans une auberge en lui faisant miroiter un emploi de magasinier grâce à son immense fortune faite à l’étranger. Il a promis entretemps de le placer « chez une grande dame ». Dans un placet au lieutenant général de police Sartine, c’est la propre mère de Hérault qui dénonce l’influence de Tiercelin sur son fils, voyant sa bru et leurs enfants réduits à la mendicité12. La comtesse de Falckenstein a su apparemment convaincre toutes sortes de gens, parfois bien établis, dont plusieurs membres du Sénat de la ville de Strasbourg et même « un Mr de la police » (un magistrat de la Police), venus lui rendre régulièrement visite pendant sa détention dans les prisons de Strasbourg. Au final, la comtesse a pu s’évader grâce à la complicité passive du geôlier et de son fils, qui ont laissé à sa servante avoir le libre accès auprès d’elle. Bientôt réfugiée sur les terres voisine de Darmstadt, elle s’appuie sur les fils du Prince pour empêcher son extradition du village où elle se trouve, provoquant des incidents armés entre ses protecteurs et un « parti » strasbourgeois venu l’enlever : le Maréchal de Contades, gouverneur de la province, doit s’en expliquer au ministre13 ! Par ses manœuvres, chaque aventurier tend à recréer autour de lui la sphère des relations d’interconnaissance qui vont garantir son identité et donner à son personnage sa véritable existence, avec une fortune variable. Plus ses protecteurs et garants sont puissants, moins son identité peut être mise en question. La comtesse de Falckenstein a fait envoyer des prisons de Strasbourg une lettre au duc de Colloredo, par les soins duquel elle aurait été élevée14. Tout dépend aussi de la solidité des liens qui l’attachent à ceux qui sont ses complices, à leur insu le plus souvent. Dans l’embrigadement de ses premiers alliés, l’aventurier subjugue, promet et met en fait sous sa dépendance : les témoignages de Godefroy ou de Hérault, dupes de Roger et de Tiercelin, portent les traces d’une relation de soumission, plus ou moins servile. De bonne foi, ces premières victimes de la crédulité sont aussi directement intéressés au succès de leur
10 Ibid. 11 AdB, Ms 12323, fol. 10 , 6 janvier 1767. 12 AdB, Ms 12270, fol. 41 13 AM Strasbourg, AA 2508, lettre de Holz au préteur royal, 4 juin 1781. 14 AM Strasbourg AA 2508.
mentor et à la reconnaissance ou à la reconquête de son statut et de ses droits : Hérault s’est vu promettre un nouvel emploi et monts et merveilles, Godefroy a payé la pension de Roger pendant sa détention et espère recouvrir sa dette et obtenir une récompense de ce jeune homme de grande famille qu’il a sorti d’un mauvais pas.
Ceux qui pratiquent l’imposture savent délivrer avec doigté les signes de révélation qui accréditent leur fortune, leur rang et leur histoire aux yeux des dupes. Sur le mode de la confidence ou du dévoilement de l’intimité, faussement accidentel, ils mettent sous leurs yeux quelques accessoires tangibles qui donnent corps à leur histoire. Garriod de Choulans comme la prétendue comtesse de Brulh prétendent chacun avoir un conjoint infiniment riche. Le comte de Choulans se dit « libérateur et agent » d’une mystérieuse et richissime princesse étrangère, amoureuse de lui. Il prétendra désirer acheter pour elle le domaine de Montretout à Saint-Cloud puis le château de Sceaux, préparant son arrivée en France. Il ira jusqu’à se faire envoyer des lettres d’elles, qu’il a lui-même rédigées dans un français fantaisiste truffé de mots doux (la princesse est censée être de langue allemande) :
"au chapitre de Remiremont le 6e 7bre 1770 Je vous ai déjà dit dans plusieurs lettres Monsieur le Comte que vous fassie absolument
rien que je vous dise, vous an sauré la raison dans peu de tans, ainsi poin dabit jusqua nouvel ordre expecté un seul négligé bien honnete tant seulement pour la fin de ce mois. Vous avé mal fait de prendre des dautes acredi, il faut rien prendre a credi, parce set de consequance a present. Je vous expliqueré cela dans moins dun moi, car il y a encore de canaille qui remue qui faut fair taire. Vous auré un grand lettre de moi avant la fin du moi qui vous instruira baucoup de tout ce que vous auré à fair, elle sera votre melieur guides, j'ai encore plus de dis lettres afair auchourdui pour le nord, jai pas le tans de dire davantage, adieu monsieur le comte, ir lieb tir fon ertz
la princesse Ulricq Sophie Julie comtesse de Stranstleme"15
L’escroc s’était déjà livré à ce jeu auparavant : le 9 décembre 1771 le commissaire Rochebrune reçoit une plainte d'une victime ruinée en 1758, pour avoir cru à l'histoire de la princesse, abusée par des papiers de Gariod dont une lettre du roi Stanislas (le monarque de Lorraine) au sujet de la princesse étrangère. L’argument de « l’éternel absent » permet d’invoquer un puissant protecteur (sans jamais le montrer) dont on prépare l’installation, toujours remise par de malencontreux incidents. Elle justifie pourtant de nombreuses dépenses et dettes, tout en faisant patienter les créanciers, éventuellement lettres à l’appui.
Gariod, sur le même mode de la demi-révélation, abuse de la confiance de plusieurs personnes dont il fait ses dupes, en leur confiant des boîtes aussi
15 AdB, Ms 12394, fol. 141.
mystérieuses que précieuses. Le sieur Tiron, officier de cavalerie, écuyer du duc de la Trémoille, a conservé chez lui une « malle contenant des effets importants » pendant deux ans. Baltard, un aubergiste dont Gariod s’est fait l’auxiliaire le plus dévoué, s’est vu confier la garde d’une cassette contenant soi-disant une fortune en bijoux. Ouvertes à la Bastille sur ordre du Roi, la malle contient seulement « une méchante redingotte, un plumet blanc une boîte de bois vernis à mettre une savonnette, l'almanach royal de l'année 1764, des cordes, un bas, une culotte, deux vieilles paires de pantoufles », et la cassette quelques morceaux de plomb enveloppés d’étoffe. La tactique de la « boîte mystérieuse » permet de gagner les confiances (en flattant les dépositaires) comme de fournir des garanties pour des emprunts. Les praticiens de l’imposture manipulent ainsi les sentiments de leurs victimes. Ils jouent sur la fidélité et les liens tissés par le secret partagé. Mais ils exaltent aussi leurs espoirs d’ascension sociale en les faisant participer à la leur (avec d’autant plus de facilité pour jouer sur ces ressorts que les imposteurs sont eux aussi habités par des espoirs semblables). A cet égard, la crédulité de nombreux intermédiaires montre que la population urbaine ordinaire partage ces rêves d’ascension sociale et que celle-ci est davantage imaginée sous la forme de la « bonne fortune » ou du merveilleux. De tous les méfaits de Gariod de Choulans, c’est d’ailleurs la manipulation perverse des sentiments et de valeurs comme la fidélité ou l’amitié qui choque le plus le commissaire de Rochebrune, comme le prouve ses mentions dans ses rapports et même les reproches qu’il fait à Gariod pendant ses interrogatoires. La véhémence du commissaire de Rochebrune signale finalement un monde où l’on veut croire à la parole donnée et aux liens d’homme à homme. Les dupes sont doublement pathétiques, par la misère matérielle à laquelle ils sont parfois réduits, mais aussi par la détresse morale dans laquelle ils sont plongés après avoir découvert l’imposture et l’abus de confiance dont ils ont été victimes.
En définitive, les pratiques d’imposture mettent ainsi à jour une société où l’identité se construit sur des bases archaïques, fondées sur l’oralité, les relations de face-à-face, la réputation et l’appartenance à des réseaux familiaux ou communautaires, et non sur des procédés d’identification rationnelle, dont la diffusion est encore limitée à des secteurs spécifiques des strates inférieures de la société ou à des situations très spécifiques comme les missions diplomatiques. Les valeurs dominantes de certains groupes comme l’aristocratie s’opposent même aux procédés rationnels et les exposent davantage encore aux manipulations identitaires. La détermination de l’identité nobiliaire par les apparences se trouve compliquée par les dynamiques sociales du dix-huitième siècle : même si la noblesse fascine et demeure l’horizon des rêves d’ascension sociale, l’image du « second ordre du royaume » est également brouillée par les comportements scandaleux, déviants ou délinquants de certains de ses membres, faisant d’une gageure la détection des imposteurs.
Cependant, ceux-ci ne peuvent poursuivre leurs activités à l’infini malgré la virtuosité de certaines pratiques d’imposture. Les archives de police montrent en effet l’existence de limites au-delà desquelles ceux qui travestissent ou inventent leur identité sont découverts.
Les récits de dévoilement ou les limites de l’imposture On a souligné plus haut la richesse mais aussi l’insuffisance des archives de
police sur les pratiques d’imposture : elles n’ont conservé la trace que de tentatives finalement avortées et réprimées, laissant ouverte la question de l’existence d’imposteurs suffisamment habiles pour ne jamais être découverts, qui doit être résolue avec d’autres sources. Les récits de dévoilement comme les efforts des policiers pour faire tomber les masques (c’est-à-dire tout autant démolir les fausses identités et faire apparaître une identité véritable) se révèlent pourtant tout autant intéressants, sinon davantage que les descriptions des stratagèmes de l’imposture en posant la question de la nature des limites de ces pratiques. En effet, on a montré précédemment comment les praticiens de l’imposture prospéraient grâce à leur maîtrise et à leur connaissance sociologique (intuitive plutôt qu’objectivée) des milieux qu’ils tentent d’infiltrer. Il s’agit de compétences plus proches d’ailleurs de la micro-sociologie, liées à la mise en scène de soi comme aux règles des interactions sociales à l’intérieur d’un milieu. Certains se révèlent particulièrement virtuoses dans l’observation des gestes sociaux et leur réplication pour faire illusion et se fondre parmi les insiders, comme le chevalier de Bon. Bien que l’on soit mal renseigné sur les origines sociales et géographiques des détenus, on devine comment certains ont pu utiliser leur position originelle comme un observatoire avant de se lancer dans l’imposture. Le chevalier de Bon se fait ainsi passer pour le fils d’un président de la Cour des Aides de Montpellier. Interrogé sur la Cour des aides languedocienne, il livre quantité d’anecdotes sur ses magistrats et leurs familles, le tout parlant comme un Montpelliérain, montrant pour son interlocuteur qu’il a bien passé sa jeunesse dans ce milieu :
« C’est un jeune homme qui a infiniment d’esprit ; il connaît tout Montpellier, comme un enfant
de la ville ; il m’a nommé tous les parents de feu ma femme, qui sont des présidents et conseillers de la Cour des aides ; il parlait le patois de ce pays-là à merveille », écrit un des officiers qui l’a reçu16.
16 Du Pras, commandant du fort de Saint-François, à Aire, à Marville, lieutenant général de police, 11 mars 1741, in RAVAISSON (F.), op. cit., t. XV, p 119.
Confondu, l’homme est en fait le fils d’un simple procureur à la Cour des aides, ce qui explique sa familiarité avec le rôle17. De même, Louis Roger, dont la conduite obéit à d’autres mobiles, qui se prétend fils naturel de la marquise de Flavacourt, veuve d’un lieutenant général des armées, a probablement jeté son dévolu sur cette famille parce qu’elle a une seigneurie près de son village, Nesle, à côté de Noyon18. Les récits laissent supposer l’existence de talents et de compétences spécifiques nécessaires à l’imposture. Or ces compétences peuvent avoir leurs propres limites, d’autant plus que le recours à l’imposture doit être souvent perpétué pour en toucher les fruits, entraînant une performance physique qui est probalement loin d’être de tout repos. L’imposteur est à la merci d’un faux-pas, d’un geste ou d’une parole qui brisera la cohérence de son rôle. Ses connaissances peuvent être mises en défaut s’il est convenablement interrogé : le prétendu de Flavacourt, qui dit être passé par le collège Louis le Grand, ne fait pas illusion devant le commissaire de police qui l’interroge sur la définition de figures rhétoriques. Mais les limitations internes des compétences des imposteurs ne peuvent à elles seules expliquer l’échec de leurs manoeuvres. Les récits de dévoilement suggèrent l’existence de phénomènes sociologiques difficilement définissables sur lesquels viennent pourtant buter les imposteurs les plus virtuoses.
Le prétendu chevalier de Bon éveille immédiatement la suspicion du le lieutenant du roi à Calais, Barberay, alors qu’il tente de s’introduire dans la haute société locale :
« Personne ne doutait nullement qu’il disait vrai ; pour moi, qui ai coutume de voir ces sortes
d’aventuriers, j’ai toujours soupçonné... »19 Barberay, préposé à la surveillance de la frontière et des étrangers de passage, a
probablement plus d’expérience que d’autres. Il s’est bien gardé cependant d’attaquer de front l’imposteur, se bornant à écrire à Montpellier aux personnes censées le connaître, pendant que le chevalier de Bon continuait ses menées. Les soupçons sont de l’ordre de l’ineffable : Barberay ne peut expliquer ce qui motive sa suspicion, à la différence du commandant de la garnison d’Aire, Du Pras, victime de l’escroc mais qui s’est résolu à porter plainte auprès de la police. Du Pras connaît le président de Bon, mais ignore tout d’un de ses fils « dans les pays étrangers ». Lorsque l’imposteur vient lui rendre visite, il se méfie, « lui ayant dit plusieurs fois qu’[il] ne l’avait pas vu
17 Lettre de Marville à Barberay, lieutenant du roi à Saint-Omer, 18 mars 1741, in RAVAISSON (F.), op. cit., t. XV, p 122. 18 AdB, 12323, fol. 4 et 47, interrogatoire par le commissaire Rochebrune, 21 mai 1767. 19 RAVAISSON (F.), op. cit., t. XV, p 118.
à Montpellier »20. Il accepte de lui prêter 5 louis d’or, mais refuse de lui prendre une reconnaissance de dette :
« Je me dis en moi-même que s’il est le fils du premier président, il ne me convient pas d’en
prendre un, et s’il ne l’est pas, il me serait inutile ; ce qui me fit prendre le parti de n’en point prendre ».
Lui aussi reste finalement dans un entre-deux, hésitant sur un homme qui a
toutes les apparences d’être ce qu’il est. Barberay est un des rares témoins à avoir explicité ses soupçons qui ne reposent pas sur une faille visible dans la performance du faux chevalier de Bon. Son échec suggère l’existence dans les interactions sociales d’éléments irréductibles à une compétence mimétique, même très développée, et qui restent à déterminer. Pour l’heure, on peut relever d’autres caractères propres à la société française du dix-huitième siècle sur lesquels les espoirs des imposteurs viennent se briser.
La mémoire semble ainsi un élément déterminant. Même l’imposteur le plus doué et le plus convaincu ne peut oblitérer les souvenirs des individus dont il tente d’abuser. Louis Le Roger, une fois arrêté, raconte à la police qu’il a été rejeté par ses vrais parents et élevé sous un faux nom dans une paroisse rurale par une nourrice, dont il donne les noms. L’enquête dans les registres de la paroisse, auprès du curé et des nourrices du lieu menée sur ordre du lieutenant général de police ne vient pas corroborer ses déclarations, puisqu’aucune trace de ce qu’il affirme n’est découverte. Le chevalier de Bon, malgré sa virtuosité, ne peut manquer d’éveiller les soupçons des relations de son père, qui connaissent ses frères mais n’ont jamais entendu parler de l’existence de ce garçon. Ce sont la lettre de l’un d’eux au président de Bon et la méfiance de Barberay qui décident le lieutenant général de police à faire arrêter le suspect à son arrivée à Paris.
Face à la mémoire, les imposteurs doivent recourir à des stratagèmes souvent complexes, qui reviennent à inventer une identité dont ils sont les seuls maîtres, une biographie qui ne peut être mise en doute, c’est-à-dire susceptible de ne pas entrer en contradiction avec la mémoire d’autrui. Elle peut être totalement imaginaire, soit au contraire s’appuyer sur des éléments réels. La création d’un personnage repose sur l’invention d’une identité complète, dont le nom et les apparences ne constituent que les éléments visibles, qui n’est pas sans rappeler ce que le monde de l’espionnage bureaucratisé du vingtième siècle appelle « une légende »21. Sans les raffinements qu’a entraînés la professionalisation de cette technique au sein des services de
20 Ibid., p 120. 21 Cf. DEWERPE (A.), Espion : une anthropologie historique du secret d’Etat contemporain, Gallimard, 1994. Ces récits fictifs portent la marque de l’appropriation de modèles littéraires ou
renseignements contemporains, ceux qui se livrent à l’imposture fabriquent une fiction avec leurs propres moyens. Primitive ou élaborée, elle peut aller jusqu’à comporter une véritable histoire, qui inscrit l’identité créée dans une continuité temporelle et donne au personnage épaisseur et profondeur. La biographie doit être solide pour résister aux questions. Elle doit d’abord expliquer l’inexpliquable, c’est-à-dire le surgissement d’un personnage nouveau dans un univers où il n’a pas encore sa place. Les plus convaincants des « clandestins » s’y emploient avec diligence.
La biographie doit réussir l’exercice périlleux de rendre compte des origines comme de l’absence, pour justifier la place qu’on cherche à reprendre. L’histoire inventée est une stratégie de reconquête, faite aussi pour résister aux interrogatoires et aux doutes. Le flou sur les origines est ainsi volontaire et assumé parce qu’il sert d’arme contre les curieux, en allant au-devant des lacunes et des incohérences constatées dans la biographie. Une naissance à l’étranger, de parents inconnus, mais de noble lignage, sert aussi d’alibi. La comtesse de Falckenstein raconte complaisamment une enfance mystérieuse, née d’un père qui « se nommait François et avait été en son vivant un grand seigneur à Vienne en Autriche, où elle était née, mais qu’elle ne l’avait jamais connu », pas plus qu’elle n’a connu sa mère, affirmant seulement « qu’après ce qu’elle avait appris, elle avait été une Dame de qualité de la Hongrie »22. Elle prétend ensuite avoir été confiée à diverses familles et élevée en France. Louis Le Roger se prétend le fils naturel du marquis (décédé) puis de la marquise de Flavacourt. Ces récits justifient aux yeux des tiers la réapparition d’un enfant caché, mais aussi la volonté de la famille de ne pas le reconnaître. Louis Le Roger va le plus loin dans cette direction, qui tient aux troubles psychiatriques dont il est l’objet, pour s’enfermer complaisamment dans une histoire qui relève davantage du délire de persécution. Plutôt que d’écrire lui-même à sa « mère », il procède en faisant appel à une série de tiers qui, de proche en proche découvrent – mais sans pouvoir le vérifier – l’existence d’un fils de Flavacourt. Le fidèle Godefroy envoie ainsi plusieurs lettres à la parentéle supposée de Louis Le Roger depuis la prison de Brest, comme celle-ci, adressée au duc de Lauragais :
« Aujourd’hui six de janvier Mr de Mailly de Flavacourt retenu prisonnier à Brest au Château de
Pontanion a pu me faire passer une lettre par laquelle il me charge d’écrire en diligence à M. son père, à Madame sa mère, et à toute sa parenté pour leur faire savoir qu’il n’a reçu d’aucun aucune lettre quoiqu’il les ait tous informés de tout ce qui s’est passé depuis son retour de Saint Domingue »23.
L’imposteur va ainsi au-devant des tentatives de dénégation, en les entâchant de
suspicion : si Madame de Flavacourt refuse de reconnaître son fils, c’est-à-cause du
romanesques par leurs auteurs. Voir STROEV (A.), op. cit. Aventuriers et imposteurs sont fréquemment liés au monde des agents secrets et des espions : cf. ROTH (S.), op. cit. 22 Ibid.
scandale de sa naissance. Louis Roger se plaint complaisamment de l’ingratitude de sa famille lors de son incarcération à Brest, puis de « la vindication d’une mère qui ne [l’] a jamais aimé » lorsqu’il est à nouveau emprisonné à Saint-Martin de Ré24. L’imposteur joue ainsi sur le code de l’honneur des familles et la défense de leurs secrets, en ruinant d’avance les dénégations éventuelles. Si les preuves ont disparu, si ses proches le rejettent, c’est la preuve d’un complot contre lui : l’histoire du fils naturel dissimulé justifie a priori l’absence de preuves en sa faveur et ruine tous les arguments rationnels et objectifs. Il faudra une série d’interrogatoires et une enquête minutieuse sur les dires de Louis Roger pour que toutes ses prétentions soient ruinées, faute de témoins pour les appuyer. En dernier recours, c’est la mémoire qui l’emporte.
Contre la mémoire, les imposteurs ont enfin pour ultime recours la mobilité. Le pseudo-fils du président de la cour des Aides de Montpellier, débarquant à Calais, se présente au commandant de la garnison du fort d’Aire, un ami de son « père », comme officier ayant servi à la cour de Russie, de retour de Saint Petersbourg, vêtu d’une somptueuse veste rouge25. Louis Roger donne à penser à ses interlocuteurs qu’il s’est enfui du collège Louis Le Grand pour s’engager pour Saint-Domingue sur « un coup de jeunesse »26. La comtesse de Falckenstein prétend être née en Autriche27. Les fictions semblent s’inventer dans des espaces liminaires, les imposteurs endossent leur rôle en mettant pied dans le royaume, dans des espaces qui sont de véritables seuils : Roger dans les prisons de Brest, le faux chevalier de Bon à Calais, la comtesse en arrivant à Strasbourg. Quant à Gariod de Choulans, sa vie réelle n’est qu’une longue série d’épisodes d’imposture entrecoupés de fuite. Changeant de ville, parfois traversant une frontière (il vit un temps à Milan), il finit par être rattrapé à Paris par ses créanciers, après avoir seulement changé de quartier. Longtemps encore les imposteurs profiteront de l’inégale maîtrise de l’espace par les autorités pour disparaître et réapparaître sous une nouvelle identité, sans pouvoir être reconnu. Cela dit, la police n’est pas inefficace face à ces personnages.
La police face aux imposteurs L’intervention policière par laquelle s’achève la trajectoire des imposteurs que
nous connaissons est rarement à l’initiative des responsables du maintien de l’ordre. A Paris, la surveillance que les inspecteurs de police exercent dans chaque quartier dans les auberges et les « garnis », des chambres et appartements loués meublés, le mode
23 AdB, Ms 12323, fol. 10 , 6 janvier 1767. 24 AdB, Ms 12323, fol. 140, lettre à M. de Fallières, 2 mai 1768. 25 Lettre de Du Pras, commandant du fort de Saint-François, à Aire, à Marville, lieutenant général de police, 11 mars 1741, in RAVAISSON (F.), op. cit., t. XV, p 119. 26 Voir la lettre de Godefroy et son interrogatoire par Rochebrune, AdB Ms 12270, fol. 18 et 79, 30 mars et 1er juin 1767. 27 AM Strasbourg AA 2508, interrogatoire du 15 mai 1781.
d’hébergement le plus répandu, leur permettent de capturer des individus douteux ou qui ont déjà eu maille à partir avec eux. En 1725, la prétendue comtesse de Horn est découverte en garni, rue Coquillière, dans le quartier des Halles, par l’inspecteur Buttay. La dame a « refusé de dire son nom, ce qui l’a obligé de s’en informer plus particulièrement »28. Il découvre ainsi qu’elle a escroqué plusieurs bourgeois du quartier (tout en les menaçant de mauvais traitements) qui ont porté plainte auprès du commissaire de police du quartier. Derrière la pseudo « duchesse de Bruhl », arrivée depuis peu à Paris, la police reconnaît une intrigante qui a déjà été arrêtée quelques années auparavant pour les mêmes raisons : au sein des bureaux du lieutenant général de police se construit peu à peu une mémoire policière collective, fondée sur les registres et les archives, qui pallie les défaillances de la mémoire collective comme l’anonymat de la grande ville. D’autres imposteurs se signalent à l’attention de la police par leur comportement, au risque de voir celle-ci s’intéresser à eux d’un peu trop près, comme le baron de Winfeld. Le « baron » débarque à Calais en prétendant avoir été employé par l’Empereur, l’Electeur de Cologne et la Maison de Bavière. Il se fait prêter sur ce prétexte 240 livres par le trésorier de Dunkerke ainsi qu’une chaise de poste par le commandant pour se rendre à Paris29. Prévenu de son arrivée, le ministre des Affaires Etrangères d’Argenson prit des renseignements auprès de l’ambassadeur de l’Empereur à Paris et, convaincu d’avoir affaire à un intrigant, le fit arrêter par la police30.
La police intervient plus fréquemment sur les plaintes de tiers. Le créancier curieux finit par faire quelques recherches, les rumeurs défavorables finissent par s’accumuler et à inquiéter même les fournisseurs et les entremetteurs les plus bienveillants. Le marchand de galons Thibert, victime du comte de Thiercelin l’explique ainsi à la police parisienne :
« Diverses personnes [lui dirent] qu’ils (sic) ne connaissaient point à Paris de comte de
Tiercelin, mais un particulier dans la vue d’obliger le Sr Thibert écrivait à Mortagne au Perche d’où selon est M. le Comte de Tiercelin pour s’en informer [...]. On lui dit que M. le Comte de Tiercelin n’était point de la maison des Tiercelin qu’il se nommait Lacolleterie que l’on ne connaissait point d’autres Tiercelin dans le pays qu’un gentilhomme ancien officier de marine qui n’était jamais venu à Paris »31.
C’est alors que les créanciers et même ceux qui avaient été les plus fidèles
soutiens de l’imposteur se retournent contre lui et portent plainte. De même Du Pras et Barberay demandent chacun au lieutenant général de police Marville l’arrestation
28 RAVAISSON (F.), op. cit., t. XIV, p 118, rapport de Buttay au lieutenant général de police, 26 avril 1725. 29 AdB, Ms 11543, fol. 8 30 Entretemps le « baron » avait déjà revendu la chaise. 31 AdB, Ms 12270, fol. 22, « Extrait concernant une dettes de 600 # ».
de celui qui se fait passer pour le chevalier de Bon, en route pour Paris, une fois que leurs propres vérifications les ont assurés d’avoir affaire à un imposteur. Il est inutile de multiplier les exemples d’arrestations opérées sur les plaintes de particuliers contre les imposteurs.
Sur quels motifs et comment intervient la police ? De ce point de vue, l’examen des affaires d’imposture révèle une grande disparité des situations. Le cas le plus courant est l’escroc, encore appelé « fripon » ou « chevalier d’industrie »32. Accumulant des dettes ou empruntant sur le crédit de son nom (inventé ou usurpé), pour ensuite partir sans laisser d’adresse, c’est aux biens des personnes qu’il s’attaque. Le contentieux porte sur des sommes prêtées ou des créances. La fausse comtesse de Horn, la Bruhl, la comtesse de Falcken ou encore Gariod de Choulans appartiennent sans hésitation à cette espèce.
Dans un deuxième type de cas, plus rare, on peut parler d’action préventive de la police. Il n’y a pas encore eu de dommage financier, mais la police intervient pour faire cesser l’imposture. Au sujet du chevalier de Bon, Barberay se dit « instruit que c’était un fripon quoiqu’il n’ait rien fait dont [il] puisse l’accuser »33. Il n’en demande pas moins au commandant d’Aire de l’arrêter et de le mettre en prison, avant même de s’adresser au lieutenant général de police à Paris. Le cas de Louis Le Roger, se prétendant fils de feu le marquis de Flavacourt, est encore plus caractéristique d’une intervention policière destinée avant tout à mettre littéralement hors-jeu un importun, avant même de faire scandale par ses déclarations. De sa prison de Brest, Le Roger écrit à celle qu’il imagine être sa mère. Elle s’adresse au lieutenant général de police Sartine pour prendre des informations sur lui et « le prie de bien vouloir la débarrasser de ce commerce épistolaire »34. Dans un second temps, an avril 1767, libéré de prison et de l’armée, Le Roger reprend ses lettres et annonce qu’il va se rendre chez la marquise. Affolée, elle transmet les lettres au ministre de la Maison du Roi, Saint-Florentin, qui demande à Sartine de le faire arrêter sur sa route, à Morlaix35.
Dans tous les cas, l’intervention de la police se déroule sur le même mode : l’enfermement de l’importun sur « ordre du roi », c’est-à-dire du lieutenant général de police. « L’ordre du roi » permet de détenir sans procès et indéfiniment une personne, indépendamment de toute procédure judiciaire. Une réponse judiciaire serait possible, en dépit de la diversité des situations. Le délit d’escroquerie n’est pas absent du droit d’Ancien Régime et émerge à travers la jurisprudence des cours souveraines au cours du dix-huitième siècle36. Les impostures elles-mêmes peuvent être sanctionnées
32 C’est ainsi que Barberay qualifie le faux chevalier de Bon. Voir RAVAISSON (F.), op. cit., t. XV, p 120. 33 Ibid., p 118. 34 RAVAISSON (F.), op. cit., t. XIX, Madame de Flavacourt à Sartine, 29 janvier 1767, p 356. 35 Ibid., p 357. 36 SAMET (C.), L’émergence du délit d’escroquerie au dix-huitième siècle, d’après les arrêts du Parlement de Paris (1700-1790), L’Harmattan, 2005.
devant les tribunaux. La « supposition de personne » constitue un crime, dont la justice distingue trois espèces :
« Ce crime se commet principalement de trois manières : 1° en se donnant pour Fils d’un autre
Père que le sien, afin de s’approprier les Biens d’une Famille étrangère ; 2°, en voulant passer pour Mari d’une autre femme que la sienne, afin de s’arroger des Droits attachés à cette qualité ; 3°, en présentant des Personnes pour d’autres à des Notaires, Greffiers, et autres Officiers publics, dans la vue de se constituer des Créances, ou se libérer de ses Dettes. »37
Plusieurs imposteurs tombent dans la deuxième catégorie, à commencer par le
chevalier de Bon comme Louis Roger. Enfin, tous ceux qui arborent titres et armoiries commettent un « changement ou déguisement de noms et de qualités ». Selon le criminaliste Muyart de Vouglans,
« Si ce n’est que pour satisfaire sa vanité, comme un Roturier qui s’arrogerait la qualité de
Noble, il n’y a lieu de prononcer aucune peine : ce qui s’entend néanmoins, lorsqu’on s’en tient à de simples déclarations verbales ; cas si l’on y joint l’USURPATION des Titres ou des Armoiries, c’set alors un Crime punissable, aux termes des Ordonnances du Royaume »38.
Des recours devant la justice seraient donc indiqués. Cependant les dossiers
évoqués ici et conservés avec les archives de la Bastille y font tous exception. Dans tous les cas, les imposteurs sont arrêtés sur un « ordre du Roi », c’est-à-dire par une lettre de cachet, selon la procédure dite « extraordinaire ». On ne peut affirmer avec certitude que les imposteurs sont essentiellement réprimés par cette procédure, faute d’une comparaison avec les archives des cours de justice. Cependant, la régularité de la présence de ces affaires parmi les prisonniers d’Etat et les individus enfermés à la demande des familles – « clients » principaux de la Bastille – permet d’avancer une telle hypothèse. Autre caractéristique de ces procédures : à aucun moment la justice ordinaire n’y est mêlée, pas même lorsque les imposteurs sont libérés. Cette soustraction des imposteurs à la justice des cours pour les confier aux ordres du Roi revient à mettre leur sort entre les mains de la police exclusivement.
Le recours aux lettres de cachet pourrait d’abord s’expliquer par des considérations pratiques, valables pour de nombreux délits, mais tout particulièrement contre les imposteurs39. Il est vrai que la ressource principale des escrocs et des faussaires demeure la mobilité. Gariod de Choulans, âgé de 48 ans, « n’ayant appris aucune profession », dont le commissaire Rochebrune reconstitue les agissements au terme de six interrogatoires (pas moins), a fait de sa vie un périple perpétuel et
37 MUYART DE VOUGLANS (P.-F.), Institutes au droit criminel, ou Principes généraux sur ces matières, suivant le droit civil, canonique, et la jurisprudence du royaume, avec un Traité particulier des crimes, Le Breton, Paris, 1767, p 614. 38 Ibid., p 616. 39 QUETEL (C.), De par le roi : essai sur les lettres de cachet, PUF, 1981.
solitaire : Paris, Tours, Bordeaux, Montpellier, Dijon, Strasbourg, Lyon puis Marseille, Lunéville puis Rouen, Bruxelles, Etampes, puis Paris à nouveau (1762-1763), chaque fois en empruntant de l'argent sous des noms divers comme celui de marquis de Loysieux, Orléans, Nantes, Grenoble, Milan, Lyon puis à nouveau Paris, où il finit par être arrêté en 177140. Le chevalier de Bon a lui aussi glissé entre les mains de Barberay qui voulait le faire arrêter. Pour qu’un individu soit arrêté par la justice, il faut que soit rendu un décret de prise de corps : la procédure serait trop lente face à des individus extrêmement mobiles. La lenteur des communications dans le royaume ainsi que la fragmentation de la justice – en dépit de la demande plus fréquente d’information sur des prisonniers dans les registres du lieutenant général de Paris ou des chiourmes par les cours du royaume – leur facilitent la tâche d’échapper à leurs poursuivants sans même quitter le royaume41. La comtesse de Falckenstein, prisonnière à Strasbourg, a fait l’objet d’une prise de corps pour dettes. Mais elle parvient à s’évader au bout de quelques semaines.
En réalité les lettres de cachet ne peuvent être réduites à un simple moyen pour se saisir des imposteurs et leur faire cesser leur menées. Dans la suite des procédures, l’absence d’intervention de la justice ordinaire et le maintien d’un traitement strictement policier montrent qu’il faut les envisager comme une véritable technique punitive42. Dans les cas étudiés, l’enfermement par ordre du roi permet de soustraire aux yeux du monde l’imposteur et d’éviter la poursuite de ce qui est jugé scandaleux. L’affaire Louis Le Roger en est un exemple manifeste, mais la remarque vaut aussi pour de nombreuses escroqueries ou « friponneries » qui lèsent des « gens de qualité », individus dont les identités sont usurpées ou abusées par les imposteurs. L’incarcération à la Bastille met hors-jeu l’imposteur, en favorisant un règlement du contentieux dans le huis clos de la prison, hors de toute procédure judiciaire. La fréquence des lettres au lieutenant général de police et inversement la rareté des témoignages directs montre dans ces affaires la volonté de mettre à distance les victimes et l’imposteur, comme si leur association était vécue comme une véritable souillure. A plusieurs reprises, des poursuites semblent avoir été abandonnées par honte du scandale. Ainsi, à Ostende, le faux chevalier de Bon a usurpé l’identité d’un officier en garnison à Calais, M. de Beaulieu, et sous ce nom a épousé une demoiselle du May. Lorsque le bailli d’Ostende a débuté une procédure contre lui (ayant dérobé des patentes d’officier et usurpé un titre, l’imposteur était passible de la peine capitale), M. de Beaulieu refusa finalement de participer à la confrontation :
40 Ses créanciers et son ancien logeur finissent cependant par le retrouver (AdB, Ms 12394). 41 Sur ce point voir CASTAN (N.), Justice et criminalité en Languedoc au siècle des Lumières, Aubier-Flammarion, 1980 ; DENIS (V.), Individu, identité et identification en France, thèse, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2003. 42 Comme l’avaient mis en évidence Michel Foucault et Arlette Farge pour le cas des demandes d’enfermement des familles : FARGE (A.) et FOUCAULT (M.), Le désordre des familles, Gallimard, 1982.
« je m’aperçus bien qu’il s’excusait autant qu’il lui était possible pour ne pas faire peine à M. du
May [dont l’imposteur a épousé la fille avec le titre usurpé], qui certainement est d’ailleurs assez à plaindre, sans qu’il aurait peut-être encore eu la douleur de voir un gendre exposé à la face du régiment à un supplice honteux »43.
Du coup le faux officier échappa à son châtiment et fut simplement exilé pour
protéger ses victimes. La publicité des affaires expose les familles à la honte et on s’explique ainsi la longue impunité des imposteurs comme la soustraction de ces affaires à la justice ordinaire. Le cas du faux M. de Beaulieu montre aussi les limites des peines effectivement rendues contre les imposteurs. L’exil et le bannissement ne provoquent que leur déplacement.
Dans les demandes d’enfermement se lit la volonté de les mettre hors d’état de nuire, mais aussi de purger définitivement le corps social de ces individus : « je vous supplie très humblement de délivrer le public d’un si insigne fripon », écrit le président de Bon au lieutenant général de police Marville44. « Je crois que ce sont des personnes de mauvaises intrigues dont il faut purger Paris, pour éviter qu'ils n'occasionnent de plus grands désordres », ajoute le commissaire Langlois dans son rapport sur la comtesse de Bruhl45. Il ne peut être question de peine capitale, puisque celle-ci ne peut être prononcée que par une cour, ce qui signifierait l’organisation d’un procès. La police de Paris ne semble pas non plus animée d’intentions particulièrement répressives à l’égard des imposteurs. Il faut donc inventer des peines qui soient aussi des solutions. L’enfermement à la Bastille reste bref : quelques mois pour la plupart des imposteurs, à l’exception du baron de Winfeld (alias Rheiner) pour avoir multiplié les incivilités pendant sa détention. Pour les hommes, l’enrôlement dans les troupes coloniales aux « îles » est privilégié, plutôt que l’enfermement perpétuel dans une maison de force : c’est le cas du faux chevalier de Bon, ou encore de Choulans. Pour les femmes, on préfère la relégation et l’exil. Les individus réputés « fols » comme Le Roger sont internés aux « petites maisons » de Bicêtre. Les peines décidées (par ordre du roi) correspondent bien à la volonté de purger le corps social et de mettre à distance les imposteurs, dont la récidive semble certaine (la plupart ont déjà été inquiétés).
Conclusion
43 RAVAISSON (F.), op. cit., t. XV, p 126, le bailli Pitet à De Verbier, grand bailli d’Aire, 5 avril 1741. 44 RAVAISSON (F.), op. cit., t. XV, p 128, 10 avril 1741. 45 RAVAISSON (F.), op. cit. t. XIV, p 118, 1er mai 1725.
En définitive, le traitement policier et pénal effectif des imposteurs contraste avec les prescriptions de la justice criminelle d’Ancien Régime. Faut-il les réduire à la simple volonté de faire cesser des agissements face auxquels la justice ordinaire réagit avec lourdeur et maladresse ? L’appel au roi et à la police vise à régler ces cas dans l’entre-soi, dans le huis-clos des prisons d’Etat. Ce constat n’est pas nouveau46. Mais son application à l’imposture est éclairant sur le rôle dévolu à l’Etat royal. La police – et à travers elle le roi – est érigée en instance régulatrice des identités respectives des uns et des autres, beaucoup plus capable de réparer et de restaurer les situations anormales créées par les imposteurs. Michel Foucault et Arlette Farge notaient que les commissaires de police parisiens souffraient des demandes incessantes d’enfermement des familles. Pour l’imposture, les témoignages des lieutenants généraux de police comme de leurs agents montrent un empressement certain à mettre hors d’état de nuire des individus dangereux pour l’ensemble de la société et fauteurs de troubles potentiels47. Elle voit ce rôle se développer dans les failles de la justice royale.
Enfin, on sait que la police a été érigée en instrument d’action privilégié par un Etat royal soucieux de traduire sa souveraineté sur son territoire par d’autres voies que la justice, son mode d’intervention traditionnel48. Or ce pouvoir continu sur les individus et les choses demande pour être exercé une identification exhaustive et rigoureuse des objets auxquels il doit s’appliquer. Une des dimensions constantes de la police du dix-huitième siècle est justement l’extension de systèmes d’identification rationnelle, fondés sur l’écrit, dans la société française49. « Fixer» les identités individuelles par tous les moyens possibles est une véritable obsession pour les administrateurs de la France des Lumières parce que c’est un préalable à l’action de l’Etat royal sur la société. Il n’est donc pas étonnant de voir la police et ses responsables réprimer avec la plus grande diligence ceux qui viennent contester et saper par leurs comportements individuels le « grand oeuvre » policier. Bien plus que le crime de faux ou les « friponneries », c’est le jeu avec les identités que la police s’emploie à faire cesser et à réparer.
46 Voir FARGE (A.) et FOUCAULT (M), Le Désordre des familles, op. cit. 47 C’est plutôt la nature des peines à leur appliquer et la recherche de solutions définitives qui semble déconcerter le lieutenant général de police. 48 C’est notamment l’hypothèse de Paolo Napoli. Voir NAPOLI (P.), Naissance de la police moderne, La Découverte, 2003. 49 Voir DENIS (V.) et MILLIOT (V.), « Police et identification au siècle des Lumières », Genèses, 54, mars 2004, pp 4-26 ; DENIS (V.), thèse citée.