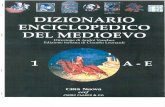Le mariage homosexuel dans les jurisprudences constitutionnelles
\"Mariage et relations internationales : l'amitié en question\" dans Le relazioni internazionali...
-
Upload
univ-paris1 -
Category
Documents
-
view
11 -
download
0
Transcript of \"Mariage et relations internationales : l'amitié en question\" dans Le relazioni internazionali...
1
Mariage et relations internationales : l'amitié en question?
Régine Le Jan
En 1018, le prince polonais Boleslav Chobry vient de prendre Kiev au prince Iaroslav,
pour y installer son gendre Sviatopolk, frère de Iaroslav. Selon Thietmar de Mersebourg, il
envoie comme émissaire à Iaroslav l'archevêque de la ville et promet de lui rendre sa fille, sa
femme, sa belle-mère et ses sœurs. Puis il adresse à l'empereur Henri II de grands présents
pour obtenir sa grâce et son aide et lui faire savoir qu'il ferait tout ce qui lui plairait. Enfin il
envoie des émissaires à "la Grèce toute proche, [c'est-à-dire à l'empereur Basile II], " pour
promettre à l'empereur de bonnes choses, s'il voulait l'avoir pour ami fidèle, mais dans le cas
contraire il serait son ennemi (hostis) le plus ferme et irréductible"1. Le récit de Thietmar ins-
crit clairement les relations entre princes dans la dialectique de la solidarité-affrontement, de
l'amitié-hostilité. La recherche de l'amitié, la rupture de l'amitié, le refus d'entrer dans une
relation d'amitié constituent la trame des relations internationales au haut Moyen Âge2. Les
messages de Boleslav définissent son attitude à l'égard de ses correspondants -déférente en
apparence envers Henri II, condescendante envers Iaroslav, menaçante à l'égard de Basile II-,
ils recouvrent aussi des relations changeantes, où l'on passe aisément de la solidarité à l'af-
frontement3.
Le concept de "parentélisation du social" permet de formuler l'idée, déjà bien connue,
que la parenté est l'élément structurant les groupements autour desquels s'articule le rapport
amitié-inimitié4. Le système de parenté cognatique, qui est celui de la société médiévale, per-
met en effet de créer de la parenté pratique par l'alliance et de redéfinir en permanence la
forme des groupements qui soutiennent "les amitiés et les ambitions mutuelles" contre les
groupes adverses. Au sommet de la hiérarchie, la dimension politique du mariage est donc
essentielle, en créant une interaction positive entre des acteurs qui s'engagent à l'amitié. Tou-
tefois, si les relations sociales peuvent s'analyser en termes de solidarité/affrontement, d'ami-
1THIETMAR de MERSEBURG, Chronicon, VIII, 33, MGH Scriptores Nova Series, IX, p. 530. 2 V. EPP, Amicitia. Zur Geschichte personaler, sozialer, politischer und geistlicher Beziehungen im frühen
Mittelalter, Stuttgart 1999 (Monographien zur Geschichte des Mittelalters, 44),. G. ALTHOFF, Amicitiae
[Friendships] as Relationships between States and People in Debating the Middle Ages. Issues and readings, ed.
L. LITTLE et B. H. ROSENWEIN, Oxford 1998, pp. 191-210. 3 Sur les Rus, S. FRANKLIN et J. SHEPARD, The emergence of Rus 750-1200, Londres et New York 1996, pp. 183-
207. 4 M. BLOCH, La société féodale, Les classes et le gouvernement des hommes, 3e éd., Paris 1970 . R. LE JAN,
Famille et pouvoir dans le monde franc (VIIe-Xe siècle). Essai d'anthropologie sociale, Paris 1995. J. MORSEL,
L'histoire (du Moyen Âge) est un sport de combat…, Publication en ligne, http://lamop.univ-paris1.fr.
2
tié/hostilité, et si le mariage est un moyen essentiel pour établir la paix et créer de l'amitié, il
n'est qu'une forme d'interaction parmi d'autres et son importance dans les relations intereth-
niques a beaucoup varié selon les périodes. En effet, le mariage est soumis à des contraintes
spécifiques, à la fois démographiques, politiques et culturelles, religieuses, il recouvre de mul-
tiples enjeux et de complexes rapports de force. Enfin, sa performativité en matière diploma-
tique dépend étroitement des motivations des partenaires et du contexte des relations. On dé-
finira donc d'abord les pesanteurs qui affectent le mariage en général et les mariages diploma-
tiques en particulier (I), on examinera ensuite comment la place du mariage a varié dans les
relations internationales (II), on tentera enfin de mesurer la performativité du mariage diplo-
matique en utilisant le critère du genre (III).
1. Altérité/identité
Au chapitre 12 du De administrando imperio, Constantin VII Porphyrogénète
(913-959) interdit formellement, en se fondant sur une loi de Constantin, qu'un empereur
épouse une étrangère, ou qu'une princesse porphyrogénète soit donnée en mariage à un étran-
ger, qui serait issu des peuples païens du Nord. Les Francs échappaient à l'interdit, parce qu'ils
étaient originaires de la même région que les Romains, faisant ainsi référence à l'origine
troyenne des Francs, parce qu'ils avaient été souvent liés à eux dans le passé et qu'ils étaient
de bonne naissance5. Cette règle, qui se référait au passé du grand fondateur et qui se fondait
sur le rapport altérité/identité, est probablement liée au contexte du Xe siècle où les Rus, les
Hongrois, les Khazars demandaient à épouser des princesses byzantines et où on cherchait à
écarter les étrangers des honneurs. La règle venait d'être tournée avec le mariage de Maria,
petite-fille de l'empereur Romain Ier, avec le prince bulgare Pierre, qui suscitait la colère de
Constantin VII, elle le serait encore, par souci de pragmatisme, mais elle souligne le fait qu'au
plan de la représentation, on ne peut devenir parent que d'un autre soi-même67. L'altérité em-
5 Constantin VII, De administrando imperio, ed. and tr. G. MORAVCIK and R.J.H. JENKINS,, Washington D.C.
1967. R. MACRIDES, Dynastic marriages and political kinship, in Byzantine Diplomacy. papers from the Twenty-
fourth Spring Symposium of Byzantine Studies, Cambridge, March 1990, ed. J. SHEPARD and S. FRANKLIN,
Aldeshot 1992, pp. 263-280, 266-267. F. TINNENFELD, Byzantinische auswärtige Heiratspolitik vom 9. zum 12.
Jahrhundert. Koninuität und Wandel der Prinzipien und der praktischen Ziele, in Byzantium and its neighbours
from the mid-9th till the 12th centuries, ed. V. VARINEK, Byzantinoslavica. Revue internationale d'études
byzantines, LIV, 1993 pp. 21-28. 6 Il est vrai que les épouses des empereurs byzantins venaient de Syrie, de Grèce, de chez les Khazars, ou encore
de familles de riches propriétaires ou de hauts fonctionnaires, sans que l'on s'intéressât particulièrement à
l'ascendance noble (Cf. la communication de K. SCHREINER, Die kaiserliche Familie, dans ce volume).
3
pêche donc l'intégration par le mariage : il y a des peuples avec lesquels on n'échange pas les
femmes, même si l'on peut entretenir des relations diplomatiques et établir la paix avec eux.
Pour Constantin VII, comme pour tous les empereurs chrétiens qui l'avaient précédé,
l'Autre se définit comme le non-Romain et le non-chrétien, celui qui est en dehors de l'empire.
En Occident, les choses avaient été et étaient encore différentes. La question de la définition
de l'Autre dans le contexte des royaumes barbares post-romain, multiethnique et multiconfes-
sionnel ne s'était guère posée qu'entre Romains et Barbares, mais progressivement, la religion
est devenue le principal facteur d'exclusion. Au VIe siècle, les mariages interethniques sont
encore conclus sans qu'on prenne en compte les différences de religion, mais un tournant
s'amorce à la fin du siècle8. Si une princesse mérovingienne chrétienne est encore mariée à un
fils de roi païen, Æthelbert du Kent, sans assurance qu'il se convertisse, à peu près au même
moment, le roi d'Austrasie Childebert II prend prétexte de ce que le roi des Lombards Authari
est arien, alors que le roi des Wisigoths vient de se convertir au catholicisme, pour rompre la
promesse qu'il avait faite de donner au Lombard sa sœur en mariage et il la donne au Wisi-
goth. La volteface cachait en réalité un changement dans les rapports de force internationaux,
mais à partir du VIIe siècle et pendant toute la période, l'altérité s'est clairement définie par la
religion : l'Autre est le non-chrétien, le païen, celui qu'on traite de chien aux Xe et XIe siècles.
Selon Adam de Brême, repris par Helmold de Bosau, la grande révolte des Slaves contre les
Saxons en 983 aurait été provoquée par une injure proférée contre le prince slave Misti-
slav auquel le duc de Saxe Bernard Billung avait promis sa nièce en mariage. Lorsque Misti-
slav réclama sa fiancée, le marchio Thierry s’interposa, « proclamant qu’on ne pouvait pas
donner une parente (consanguinea) du duc à un chien ». Mistislav appela alors tous les
peuples qui habitaient à l’est de la cité de Rethra en leur racontant que les Saxons traitaient les
Slaves de chiens. Il s’ensuivit la dévastation de toutes les églises situées au-delà de l’Elbe,
accompagnée de la mise à mort de tous les prêtres et d’une bonne partie des chrétiens, saxons
et slaves convertis9. Néanmoins, cette anecdote tardive, qui suggère la possibilité d'un ma-
8 B. DUMEZIL, Les racines chrétiennes de l’Europe. Conversion et liberté dans les royaumes barbares Ve-VIIIe
siècles, Paris 2005. 9 G. BÜHRER-THIERRY, Étrangers par la foi, étrangers par la langue: les missionnaires du monde germanique à
la rencontre des peoples païens, in L'étranger au Moyen Âge, Actes du XXXe congrès de la SHMESP (Göttingen
1999), Paris 2000, pp. 259-270, 263. H. RÖCKELEIN, Heiraten. Ein Instrument hochmittelalterlicher Politik, in
Der Hoftag in Quedlinburg 973 : von den historischen Wurzel zum Neuen Europa, ed. A. RANFT, Berlin, 2006,
pp. 99-135.
4
riage entre une princesse chrétienne et un prince slave païen, pourrait être en partie légen-
daire10.
L'altérité religieuse n'empêche pas que l'amitié soit possible avec des partenaires non-
chrétiens. Avec les califes par exemple, l'éloignement permet de transcender aisément les dif-
férences religieuses, en mettant l'accent sur les facteurs d'identité définis par la richesse et le
prestige. Les Carolingiens et les empereurs germaniques ont entretenu des relations diploma-
tiques assidues et amicales avec les califes, échangeant des ambassadeurs et des cadeaux,
mais pas leurs femmes. En revanche, le rapport se modifie quand l'Autre se rapproche. La
proximité géographique rend les relations beaucoup plus complexes, changeantes et difficiles,
avec les Musulmans d'Espagne, les Scandinaves, les Slaves ou les Pictes païens. Les phases
d'affrontement alternent alors avec des phases d'apaisement, qui sont sanctionnées par des
tributs, des échanges d'otages, sans rentrer, sauf exception, dans le circuit des échanges ma-
trimoniaux. Le rapt apparaît donc comme le seul moyen pour un chef païen d'obtenir une
femme de l'élite chrétienne, sauf à accepter de se convertir. Même s'il y eut des accommode-
ments au niveau local, aux frontières, ou des unions secondaires, il n'y eut pas de mariages
royaux, dans le cadre de relations internationales formalisées, avant la conversion.
L'intégration des Vikings et des Slaves commença au IXe siècle, avec le baptême de
chefs païens qui ouvrit la possibilité de nouvelles formes relations, fondées sur l'amitié. Le
traité obtenu de Louis le Pieux par le chef danois Harald Klak en 826 fut conditionné par le
baptême du chef viking, comme celui du chef Guthrum avec Alfred de Wessex en 87811. Les
festivités qui accompagnaient les baptêmes témoignaient du prestige des "parrains" et de l'im-
portance politique de la conversion. La paix et l'amitié étaient assorties du don ou de
l'échange d'otages, pris parmi les proches du chef, qui garantissaient le pacte, en même temps
qu'ils rendaient visible le caractère dissymétrique de la relation ainsi établie. Cependant, la
promesse de baptême n'ouvrit la possibilité d'un mariage qu'à partir de la fin du IXe siècle : en
882-883, l'empereur Charles le Gros fut contraint de conclure le traité d'Asselt avec quatre
chefs normands, confiant la Frise à l'un d'entre eux, Godfrid, qui accepta le baptême et reçut
en mariage Gisèle, fille du roi Lothaire II et de Waldrade, soit de l'empereur lui-même, soit de
Hugues, frère de Gisèle, l'année suivante12. D'après l'annaliste mayençais, Hugues espérait
ainsi conquérir le royaume de son père avec l'aide de son beau-frère. Ce mariage, quoique mal
10 C. LÜBKE, Die Elbslaven-Polens Nachbarn im Westen, in The Neighbours of Poland in the Tenth Century, ed.
P. URBANCZYK, Varsovie 2000, pp. 61-77, 70. 11 P. BAUDUIN, Le monde franc et les Vikings VIIIe-Xe siècle, Paris 2009, p. 99. 12 Ibid., pp. 218-223.
5
perçu par les chroniqueurs francs, inaugurait néanmoins des possibilités de rapprochement
entre des Vikings en voie d'intégration et les Francs. Le chef Rollon comprit sans doute l'inté-
rêt du mariage, puisque, encore païen, il épousa, probablement après l'avoir emmenée comme
otage, une femme de l'aristocratie franque nommée Popa, d'ascendance carolingienne. Il se
trouva ainsi intégré aux groupes aristocratiques francs, bien avant son mariage avec Gisèle,
fille de Charles le Simple, que le roi lui donna en mariage en 911, au traité de Saint-Clair sur
Epte, au moment de son baptême13.
Du côté des princes slaves, l'intégration, plus tardive, passa également par le mariage
avec des femmes de l'aristocratie de Saxe orientale, plus tard de la famille royale ottonienne14.
Le Piast Mieszko Ier de Pologne se convertit en 966 après avoir épousé une fille du duc Bole-
slav Ier de Bohème, probablement déjà chrétienne, et en secondes noces Oda, une aristocrate
saxonne. Du côté Hongrois, des chefs s'étaient convertis dès le milieu du Xe siècle sous
l'influence byzantine (Bulcsú et Gyula), mais la conversion ne devint officielle qu'avec Géza
(†997), qui envoya une ambassade à la cour ottonienne en 973 et qui se convertit, peut-être
avec son fils István/Etienne encore enfant, négociant ensuite le mariage d'Etienne avec Gisèle,
fille du duc de Bavière Henri le Querelleur, vers 99515. Vladimir de Kiev se convertit et épou-
sa la princesse Anna Porphyrogénète, sœur de Basile II, en 989. Selon Adam de Brême, le roi
de Suède Erik le Victorieux fut baptisé au Danemark, il épousa une princesse chrétienne,
nommée Gunhilde, probablement fille de Mieszko Ier de Pologne, mais, rentré en Suède, il
retourna au paganisme. Le premier roi chrétien fut son fils Olof Skötkonung. Donc, même s'il
y avait parfois des retours de paganisme, la conversion permettait l'intégration par le mariage,
c'est-à-dire non seulement la possibilité de participer aux relations déterminées par le rapport
amitié/inimitié mais aussi la reconnaissance d'une forme d'égalité.
La conversion des princes païens élargissait donc considérablement le champ matri-
monial. En même temps, les familles royales et princières ont toujours eu la possibilité de
retirer du marché matrimonial un certain nombre de femmes en les plaçant dans des monas-
tères. Cette pratique, attestée dès l'époque mérovingienne, poursuivie à l'époque carolin-
13 P. BAUDUIN, La première Normandie (Xe-XIe siècle). Sur les frontières de la haute Normandie: identité et
construction d'une principauté , Caen 2004, pp. 131-132. 14 Sur les mariages politiques entre Francs et Slaves, entre Slaves, H. RÖCKELEIN, Heiraten cit., pp.99-136. 15 N. BEREND, J. LASZLOWSKY, B. ZSOLT SZAKÁCS, The kingdom of Hungary, in Christianiszation and the Rise
of Christian monarchy. Scandinavian, Central Europe and Rus' c. 900-1200, , ed. N. BEREND, Cambridge 2007,
pp. 328-331.
6
gienne16, est bien visible dans la famille ottonienne, où, après une phase de large ouverture
dans la première moitié du Xe siècle, on restreint ensuite drastiquement le mariage des filles
en les plaçant à la tête des monastères familiaux de Gandersheim et Quedlinburg, et en sélec-
tionnant pour certaines les alliances les plus prestigieuses et les moins dangereuses17. Enfin,
les pressions ecclésiastiques, qui rendaient également la recherche du conjoint plus difficile,
avec l'accroissement démesuré des interdits de mariage pour raison de consanguinité,
d’affinité ou de parenté spirituelle, ont gêné les stratégies matrimoniales et diplomatiques et
contribué à dilater le champ matrimonial, mais rois et princes n'hésitaient pas à enfreindre les
interdits18 : en France, tous les mariages capétiens des Xe et XIe siècles se situent en-deçà des
limites autorisées (le 7e degré), y compris celui d'Henri Ier avec Anne de Kiev, pourtant appa-
remment justifié par le souci de respecter les normes ecclésiastiques, mais seul le mariage de
Robert le Pieux avec Berte de Bourgogne fut rompu pour cause de trop grande proximité.
L'intérêt politique de ce mariage pour le roi semblait pourtant fondamental, puisque Berte
était à la fois veuve d'Eudes Ier de Blois, principal rival du roi, et fille du roi de Bourgogne
Conrad le Pacifique (937-993) et de la Carolingienne Mathilde, mais l’empêchement était
énorme : Robert était le cousin au 3e degré de Berte et le parrain de son fils. Le pape Grégoire
V excommunia les époux au synode de Pavie en 997 et, en 1004, le roi se sépara de son
épouse, sans doute parce qu'elle ne lui avait pas donné d’enfant. Retournant ses alliances, il
épousa Constance, fille du comte Guillaume Ier d’Arles-Provence et d’Adelaïde d’Anjou, re-
trouvant ainsi l'appui du comte d’Anjou, ennemi des comtes de Blois-Champagne, dans l'hy-
pothèse d'une rupture avec ces derniers19. À la génération suivante, le roi Henri Ier et
l’empereur Conrad II, lors d'une rencontre destinée à établir la paix entre eux en mai 1033,
assortirent leur pacte d’un projet de mariage entre le roi de France et Mathilde, fille de
l’empereur et de Gisèle : ils étaient cousins aux quatrième et cinquième degrés. Comme la
jeune Mathilde , âgée de 6 ans, mourut l’année suivante, Conrad II offrit à Henri une autre
16 S. MACLEAN, Queenship, nunneries and royal widowhood in Carolingian Europe, in Past and Present 178
(2003), pp. 3-38. 17 L. LELEU, Semper patrui fratrum filios seviunt. Les oncles se déchaînent toujours contre les fils de leurs frères.
Autour de Thietmar de Mersebourg et de sa chronique. Représentations de la parenté aristocratique vers l'an
mille dans les sources narratives, Thèse de doctorat d'histoire, Université Paris1 Panthéon-Sorbonne, Paris 2010,
pp. 538-539. 18 R. LE JAN, Famille et pouvoir dans le monde franc (VIIe-Xe siècle). Essai d’anthropologie sociale, Paris 1995.
P. CORBET, Autour de Burchard de Worms. L’Église et les interdits de parenté (IXe-XIIe siècle), Francfort-sur-le-
Main 2001. 19 Deuxième mariage de Guillaume et quatrième d’Adelaïde qui était la sœur du comte d'Anjou Foulque III
Nerra. Ses frères étaient comtes dans le Midi.
7
Mathilde, petite-fille de l’impératrice Gisèle20. De leur côté, les Saliens, dont les unions
étaient toutes prohibées, résistèrent à toutes les pressions : l'impératrice Gisèle était la sœur de
la tante par alliance du roi et tous deux descendaient d'Henri Ier de Germanie. Les évêques
germaniques essayèrent en vain de contraindre les époux à se séparer. Leur fils Henri III
épousa Gunhilde, fille du roi Cnut le Grand qui, par sa mère Emma, descendait elle aussi
d'Henri Ier de Germanie. Le mariage (aux quatrième et cinquième degrés) était interdit, tout
comme le second mariage d'Henri III avec Agnès de Poitou, sa cousine aux quatrième et cin-
quième degrés. De la même manière le duc de Normandie Guillaume le Conquérant sut résis-
ter aux pressions des évêques qui condamnaient son mariage avec sa cousine Mathilde de
Flandre. En définitive, si les pressions ecclésiastiques ont certainement gêné les alliances,
elles ne les ont pas empêchées.
2 Mariage et amitié diplomatiques
Les relations internationales s'inscrivent dans un cadre global, celui des échanges
compétitifs, qui se déclinent en termes politiques (guerre ou paix, affrontement ou coopéra-
tion) mais aussi économiques, religieux ou culturels, et qui doivent s'analyser en termes de
réseau21. Le choix des modes d'interactions positives dans les relations diplomatiques dépend
de multiples facteurs : la distance sociale et physique entre les acteurs, les répercussions en
chaîne de l'interaction par le mariage sur la structure des groupements, à l'intérieur et à l'exté-
rieur des frontières, la forme des relations politiques et des rapports de compétition internes et
externes, les rapports de genre, etc. L'analyse de réseaux permet d'envisager les interactions
dans une perspective large et évolutive. On peut distinguer trois périodes : 1) les Ve et VIe
siècles où le réseau romain se transforme par le recours aux mariages extérieurs, avant que
ceux-ci ne se raréfient au VIIe siècle dans un contexte de forts antagonismes, 2) l'époque caro-
lingienne qui correspond aux grands empires et à un faible recours au mariage dans les rela-
tions internationales, enfin 3) la période d'expansion, de compétition et de densification des
relations par mariage aux Xe et XIe siècles.
1) Les Ve et VIe siècles
20 Cette Mathilde était la fille de Liudolf de Brunswick, margrave de Frise, lui-même fils du premier mariage de
Gisèle, avec Brunon de Brunswick (†avant 1012). Il y avait double empêchement, par la parenté entre les deux
Mathilde et par le cousinage entre Henri et Mathilde de Frise. 21 M. MCCORMICK, Origins of the European economy : communications and commerce, A1.D. 300-900,
Cambridge 2001. C. WICKHAM, Framing The Early Middle Ages, Oxford 2005.
8
Dans le cadre de l'empire romain, les relations internationales déterminaient un réseau
fortement orienté, avec pour seule tête l'État romain, et les mariages ne jouaient qu'un rôle
marginal dans les interactions : l'amitié entre les peuples servait à l'État romain à lier les
peuples soumis dans une relation fortement dissymétrique où l'empire passait avec les peuples
étrangers vaincus militairement des traités d'amitié, qui intégraient les amici populi romani au
monde romain comme États clients. Des changements fondamentaux sont intervenus à partir
du milieu du Ve siècle : d'une part, Rome a perdu la maîtrise de son territoire et les alliances
diplomatiques ont été déconnectées des entreprises militaires22, ce qui eut pour conséquence
un affaiblissement de la position romaine comme tête de réseau; d'autre part, les relations se
sont personnalisées et les pactes d'amitié sont devenus des engagements liant des chefs bar-
bares à l'empereur, et non plus ceux d'États représentés par leur roi. C'est dans cette perspec-
tive que le mariage est devenu un instrument diplomatique essentiel pour les chefs barbares
qui réussissaient à épouser une femme de la famille impériale et à accroître ainsi leur capital
symbolique, dans des rapports de force puisque ces femmes étaient captives ou otages et que
ces mariages étaient imposés aux empereurs : Athaulf, roi des Goths, épousa Galla Placidia,
fille d'Honorius, en 411, et Hunéric, fils du roi des Vandales Genséric, épousa Eudocia, fille
de Valentinien III, en 45523. La pratique du mariage de femmes captives ou otages ne disparut
pas complètement par la suite : au VIe siècle, le roi franc Clotaire Ier épousa la jeune princesse
thuringienne Radegonde qu'il avait emmenée comme captive après la mort de son frère, et le
roi des Lombards Alboin épousa Rosamund, fille du roi des Gépides vaincu, pour légitimer un
pouvoir acquis par force.
Avec la chute de Rome, le mariage devint un instrument diplomatique essentiel en Oc-
cident : devenu maître de l'Italie en 493, Théodoric, roi des Ostrogoths, conclut une série
d’alliances matrimoniales destinées à maintenir la paix et à établir des amitiés, tout en renfor-
çant son prestige et son hégémonie. Il épousa Audoflède, sœur du roi des Francs Clovis, entre
493 et 49824 et maria ensuite ses filles Théodegothe et Ostrogothe (filles d'une première
union), la première à Alaric II, roi des Wisigoths, et la seconde à Sigismond, roi des Bur-
gondes25. Vers 500, il maria sa sœur Amalafride en secondes noces à Thrasamund, roi des
22 Y. MODERAN, L’établissement de barbares sur le territoire romain à l’époque impériale, in La mobilité des
personnes en Méditerranée de l’Antiquité à l’Époque moderne : procédures de contrôle et documents
d’identification, ed. C. MOATTI, Paris 2004, pp. 337-397, p. 338. 23A. BECKER-PIRIOU, De Galla Placidia à Amalasonthe, des femmes dans la diplomatie romanobarbare en
Occident?, in Revue historique, 647 (2008/3), p p. 507-543, p. 511. 24 P. AMORY, People and identity in Ostrogothic Italy, 489-554, Cambridge 1997, p. 449. 25 Vers 493 et 494 selon H. WOLFRAM, Histoire des Goths, (traduit de l'anglais), Paris 1990, pp. 327-328.
9
Vandales, et enfin vers 511, sa nièce Amalaberge épousa Herminafrid, roi des Thuringiens. Sa
fille Amalasonte, destinée à assurer la succession en Italie, épousa quant à elle un Amale
nommé Eutharic. Théodoric était en position de donneur de femmes, dans un échange qui lui
était favorable, sauf à l'égard de Clovis dont il avait épousé la sœur et qui épousa lui-même
d'abord une princesse franque rhénane, puis la nièce du roi des Burgondes Gondebaud. Le
sang amale se diffusait dans les principales familles royales barbares et semblait ainsi unifier
l'ancien empire d'Occident. Ce système se doublait d'autres formes de relations familiales, qui
marquaient la dépendance d'autres peuples barbares: ainsi, l'adoption du roi des Hérules en
511 par Théodoric souligna la dépendance de ce peuple à l'égard des Goths26. Le réseau de
parenté diplomatique ainsi formé s'insérait lui-même dans un vaste réseau international, éten-
du à l'ensemble de l'ancien empire romain, dont la tête principale restait l'empereur qui, de
Constantinople, maintenant sa suprématie, au moins symbolique, sur l'Occident par les pres-
sions militaires et par des relations de dépendance : Théodoric était le fils adoptif de l'empe-
reur Zénon, qui l'avait envoyé en Italie, il était aussi maître de la milice et patrice, son gendre
Eutharic avait lui aussi été adopté en armes par l'empereur Zénon, le roi des Burgondes Gon-
debaud avait été reconnu par l'empereur comme patrice et Clovis lui-même reçut les insignes
consulaires en 508. L'empereur se posait ainsi en chef suprême, jouant la carte gothe avant de
choisir la carte franque, sans jamais se lier par mariage à aucun d'entre eux.
Le réseau de Théodoric s'est révélé fragile. On sait par Grégoire de Tours et Cassio-
dore que le roi des Goths réussit à empêcher une première guerre entre Clovis et Alaric II,
organisant une rencontre entre son beau-frère et son gendre en 502, près d'Amboise, qui abou-
tit à une paix27. On sait aussi par les Variae de Cassiodore que Theodoric déploya une grande
activité diplomatique, par ses lettres aux rois des Francs, des Wisigoths, des Burgondes, des
Hérules, des Thuringiens, pour tenter d'empêcher la guerre entre Alaric II et Clovis, en faisant
jouer les liens de parenté28, ce qui n'empêcha pas Clovis d'attaquer les Wisigoths et de tuer
Alaric II de ses propres mains, selon Grégoire de Tours. Le mariage d'Amalaberge avec Her-
minafrid, roi des Thuringiens, était destiné à contrer les ambitions orientales et peut-être ita-
liennes du roi des Francs, désormais libre du côté de la Rhénanie et de l'Alémanie par l'élec-
tion de Clovis comme roi des Francs rhénans et sa victoire définitive sur les Alamans. Quant
au roi des Burgondes Sigismond, après la mort de son épouse amale, il se remaria en 520 et fit
26 CASSIODORE, Variae, IV,2, MGH Auctores Antiquissimi XII, Berlin 1894, p. 120. 27 GREGOIRE DE TOURS, X Libri Historiarum, II, 35, CASSIODORE, Variaie, III,4,2, p.79. 28 CASSIODORE, Variae, III,1,2,3,4 , pp. 78-81.
10
mettre à mort son propre fils Sigeric en 523, du vivant même de Théodoric. Enfin, en 525,
Amalafride mourut dans la prison où elle avait été enfermée par Hilderic, successeur et neveu
de Thrasamund et seule la mort de Théodoric empêcha une guerre punitive des Goths contre
les Vandales. Après la mort de Théodoric en 526, plus rien ne restait des amitiés construites
par le mariage, si ce n'est l'alliance avec les Wisigoths. Cet échec tient à ce que la politique
matrimoniale de Théodoric s'inscrivait encore dans le cadre de l'unité romaine et qu'elle se
caractérisait par la dispersion des cibles destinée à maintenir une unité fictive. Or, dans le
contexte de l'instabilité politique profonde du début du VIe siècle, l'entreprise était vouée à
l'échec, sans un appui solide des Byzantins.
***
La reconquête byzantine entraîna l'effondrement du royaume vandale, les guerres go-
thiques et fit définitivement disparaître la fiction d'une unité romaine, même si les relations
avec Byzance firent plus que jamais partie du jeu international. Dans un contexte de compéti-
tion accrue, les Francs, dont la prééminence s'affirma avec la conquête du royaume burgonde,
l'annexion de la Provence et l'expansion en Germanie, menèrent une active politique diploma-
tique et militaire pour contrôler les cités d'Italie du Nord. Le mariage fut un instrument de leur
politique expansionniste : contre les Goths d'Italie, ils conclurent ainsi des mariages avec les
Lombards tant que ces derniers restèrent en Pannonie : Théodebert Ier, fils du roi de l'Est
Thierri Ier, épousa Wisigarde, fille du roi lombard Wacho, vers 540, au moment où les Francs
envahissaient l'Italie du Nord; après la mort de Théodebert, son fils Théodebald, né d'un pre-
mier mariage, renouvela l'alliance en épousant Waldrade, autre fille de Wacho, vers 554. Une
fois le royaume franc réunifié au profit de Clotaire Ier, sa fille Chlodoswinde est mariée vers
556-560 au roi Alboin, lui-même fils du roi Audoin et d'une princesse thuringienne. Mais
après l'entrée d'Alboin en Italie en 568, les Francs, alliés aux Byzantins, cessèrent tout
échange matrimonial avec les Lombards. Dans les années 580, ils les attaquèrent même à plu-
sieurs reprises, mais le roi Authari (584-590) leur résista et fut même en mesure de demander
et d'obtenir du roi Childebert II la promesse qu'il lui donnerait sa sœur Chlodoswinde en ma-
riage. Childebert II n'honora pas sa promesse, envahissant à nouveau l'Italie en 590, sans suc-
cès, mais sans concéder la paix. Quand le roi des Lombards Agilulf (591-616) eut levé l'hypo-
thèque orientale en concluant la paix avec les Avars, ce qui renforça ses positions dans le
nord-est de l'Italie, il put, en 604, faire élever comme roi son fils Adaloald au cirque de Milan,
en présence des ambassadeurs du roi Théodebert II d'Austrasie, dont "la fille fut fiancée à
11
l'enfant royal en même temps qu'était signée une paix éternelle avec les Francs"29. Adaloald
avait été baptisé dans la foi catholique mais le mariage ne se fit pas davantage, car l'alliance
matrimoniale perdit tout intérêt pour les Lombards avec la disparition de Théodebert II, tué
dans la guerre civile avec son frère Thierri (612) et la victoire de Clotaire II en 613.
L'hostilité des Francs de l'Est à l'égard des Lombards en Italie s'est doublée d'un souci
de rapprochement avec les Wisigoths Les mariages franco-wisigothiques apportaient aux
Francs du prestige et des richesses, ils permettaient de stabiliser la frontière en Go-
thie/Septimanie et de contenir plus efficacement les Vascons, menaçant pour eux comme pour
les Wisigoths30, mais ils s’inscrivaient aussi dans le cadre des rivalités internes et des haines
entre Mérovingiens. En 566, Sigebert Ier d'Austrasie obtint en mariage Brunehaut, fille du roi
Athanagild, et peu après, son demi-frère Chilpéric Ier de Neustrie épousa Galswinthe, fille
aînée du même roi. Grégoire de Tours inscrit clairement le mariage de Chilpéric dans le cadre
de la rivalité entre les frères mérovingiens. L'assassinat de Galswinthe quelque temps plus
tard déclencha la vengeance de Brunehaut et en retour le meurtre de Sigebert en 575. Désor-
mais, et pour un demi-siècle, les relations franco-wisigothiques allaient se définir en fonction
de cette haine familiale doublée d'une compétition politique au plan international. Les al-
liances franco-wisigothiques furent renouvelées à la génération suivante, dans le même con-
texte de rivalité et d'hostilité entre les deux branches de la famille mérovingienne : en 579,
Brunehaut maria sa fille Ingonde à Hermenegild, fils du roi Leovigild, dont la première
épouse était sa mère Galswinthe. Chilpéric négocia un mariage pour sa fille Rigonthe avec
Reccared, autre fils de Leovigild mais quand Rigonthe partit en 584 pour se marier, son père
mourut et Reccared arrêta le mariage. Il aurait alors demandé en mariage Chlodoswinde, sœur
de Childebert II, mais le mariage ne se fit pas davantage. Il apparaît que Leovigild, qui avait
partagé son royaume entre ses deux fils, avait cherché à maintenir la balance en s'alliant aux
deux branches mérovingiennes, jouant sans doute de leurs rivalités. Enfin Thierri II, petit-fils
de Sigebert et Brunehaut, tenta en 607 une dernière alliance en épousant la fille du roi Witte-
ric, mais il la renvoya un an plus tard31.
Les mobiles des mariages entre Francs et Anglo-Saxons s'inscrivent dans un système
d'échanges nettement dissymétriques en faveur des Francs, qui fait intervenir d'autres formes
29 PAUL DIACRE, Histoire des Lombards, III, 30. 30Sur le territoire vascon, C. MARTIN, La géographie du pouvoir dans l'Espagne visigothique, Villeneuve d'Ascq
2003, pp. 289-291. 31Selon Frédégaire, Brunehaut aurait tout fait pour rendre la reine odieuse à son époux, qui la renvoie au bout
d'un an (Fred IV,30).
12
de relations. Chilpéric Ier, qui avait recueilli l'héritage de son frère Charibert de Paris, fut sans
doute à l'origine du mariage de sa nièce Berte, fille de Charibert, avec Æethelbert, qui n'était
pas encore roi du Kent. Ce mariage, renouvelé par celui d'Emma/Ymma avec le roi du Kent
Eadwald avant 618, atteste le développement des relations entre l'Angleterre et le continent,
illustré par l'essor des ports de Quentovic et de Rouen au VIIe siècle32.
***
En avançant dans le VIIe siècle, l'absence de transmission directe de la royauté et un
mode de légitimation par les femmes dans l'Italie lombarde, le principe électif en Espagne,
l'existence de plusieurs familles royales anglo-saxonnes concurrentes et de plusieurs regna
francs, conduisent à réduire les mariages interethniques. Dans les îles britanniques, le mariage
entre les multiples familles royales anglo-saxonnes était à la fois un instrument de stabilisa-
tion et de compétition, tandis qu'en Italie comme en Espagne, le mariage avec la veuve ou la
fille du prédécesseur, en cas d'absence de succession directe, était le moyen le plus commode
et le plus courant d’assurer la légitimité du nouveau roi. En Gaule, où les Mérovingiens ont
plusieurs fois pris leurs épouses parmi les non-libres, on a aussi pratiqué des renouvellements
d’alliance avec la veuve d’un parent défunt, en cas de nécessité : après la mort de Clodomir en
524, son frère Clotaire Ier épousa sa veuve Guntheuc, Mérovée, fils de Chilpéric Ier, épousa
Brunehaut, veuve de son oncle Sigebert. De telles pratiques, prohibées par les conciles dès le
VIe siècle, étaient en accord avec le système de parenté cognatique qui favorisait les renouvel-
lements d’alliance dans l’affinité. En revanche, le mariage de Childéric II avec sa cousine
Bilechilde, fille de son oncle paternel Sigebert III, en 662 est une exception. Leudegar, alors
archidiacre d’Autun, s’en offusqua, comme en témoigne sa Vie33, mais ses protestations ca-
chent des intérêts politiques puisque lui et son oncle Didon, précédemment évêque de Poi-
tiers, avaient soutenu activement le coup d'État de Grimoald, qui avait écarté du trône le fils
de Sigebert III, au profit de Childebert l'Adopté, fils de Grimoald. Le mariage de Childéric II
32 Cette Emma, que des sources anglo-saxonnes tardives, datant des XIe et XIIe siècles, donnent comme une fille
de roi, c’est-à-dire de Clotaire II lui-même, ne l’était sans doute pas, mais son nom, qui est une forme
hypocoristique d’Earmen/Earem-, conduit à Erchinoald (Earconwald), lui-même apparenté à la mère de
Dagobert. Emma transmit à ses descendants de nombreux noms en Earcon et Earem et il y eut même un évêque
de Londres nommé Earconwald. Ymma/Emma était très probablement une parente proche d’Erchinoald, soit sa
fille comme le pensaient Karl Ferdinand Werner et nombre d’historiens à sa suite (KF WERNER, Les rouages de
l’administration, in La Neustrie, ed. P. Périn et L.C. Feffer, Rouen 1985, p.42), soit plus probablement, pour des
raisons chronologiques, une sœur ou une cousine d’Erchinoald, lui-même apparenté à Clotaire II par affinité. Sur
les relations entre les Mérovingiens et les familles royales anglo-saxonnes, voir la contribution de Ian Wood dans
ce même volume. 33 Passiones Leudegari episcopi et martyris Augustudunensis I, c. 8, MGH Scriptores rerum merovingicarum 5,
ed. B. Krusch, Hanovre 1910.
13
et de Bilechilde répondait probablement à une situation d’urgence provoquée par la mort de
Childebert l’Adopté et par la nécessité pour la reine Bathilde d’assurer la succession à l’un de
ses fils, en l’occurrence le troisième, en le mariant à la fille de Sigebert III, réfugiée à la cour
neustrienne avec sa mère depuis 65634. En d'autres termes, dans le contexte de fragmentation
et de diminution global des échanges qui est celui de la seconde moitié du VIIe siècle et du
début du VIIIe siècle, les mariages interethniques ne jouent qu'un rôle très marginal dans les
relations internationales.
2) La période carolingienne
Après le repli de la fin du VIIe siècle et la phase de reprise en main du royaume franc,
le réseau de relations internationales se densifie. Les Carolingiens ont été en mesure de prati-
quer une active politique diplomatique qui les mit en relation avec l'Orient, par la Méditerra-
née, et qui s'inscrit dans le cadre de l'élargissement des horizons et de la reprise des échanges
à longue distance au milieu du VIIIe siècle35. Les années 750-770 apparaissent comme une
période de transition, qui suit leur accession à la royauté grâce au soutien de la papauté qui
s'émancipait ainsi de la tutelle byzantine et qui cherchait auprès d'eux un appui contre les
Lombards. Dans ce contexte, les Byzantins ont pris l'initiative de nouvelles relations avec les
Carolingiens en envoyant une ambassade en 756, avec des cadeaux extraordinaires, dont un
orgue, symbole royal ancien et prestigieux, proposant de surcroît un mariage entre Gisèle,
fille de Pépin, et Léon VI, co-empereur. Une telle proposition était la première en date,
puisque jusqu'alors, seuls les Khazars avaient été inclus dans la "famille des rois", sous Justi-
nien II36. En 763, Pépin envoya une deuxième ambassade à Constantinople, qui rentra en 766
et qui est à nouveau sur le Bosphore en 767, sans doute pour finaliser le projet de mariage37.
Parallèlement, une première ambassade franque fut envoyée à Bagdad, probablement en 765
et trois ans plus tard les ambassadeurs de l'émir Al Mansur arrivaient en Francie, comme le
signale une seule source, très proche des Carolingiens, la continuation de Frédégaire. Dans ce
cas bien entendu, aucun mariage n'était envisagé.
34 J. HOFMANN, The Marriage of Childeric II and Bilichild in the Context of the Grimoald Coup, in Peritia.
Journal of the Medieval Academy of Ireland, 17-18 (2003-2004), pp.382-393. 35 M. MCCORMICK, Pippin III, the Embassy of Caliph al Mansur, and the Mediterranean World, in Der
Dynastiewechsel von 751: Vorgeschichte, Legitimationsstrategien und Erinnerung, ed. M. BECHER et J. JARNUT,
Münster 2004, pp.220-241. 36 J. HERRIN, Constantinople, Rome and the Franks in the seventh and eighth centuries, in S. FRANKLIN et J.
SHEPARD ed., Byzantine diplomacy, Aldeshot 1992, pp. 91-107, 100.et S. 37 Codex Carolinus, MGH Epp 3, n°45, p. 562.
14
Dans le cadre occidental, les relations diplomatiques franco-lombardes témoignent
des ambiguïtés des mariages. À l'époque de Liutprand (712-744) et de Charles Martel (715-
743), Francs et Lombards avaient entretenu des relations d'amitié, dans un rapport favorable
aux Lombards, comme le symbolisa l'envoi du jeune Pépin par son père auprès du roi Liut-
prand, au moment de sa première coupe de cheveux38. Après son second sacre à Saint-Denis
par le pape Etienne II en 754, Pépin III dut soutenir le pape contre les Lombards mais après sa
mort en 768, sa veuve Bertrade et le roi des Lombards Didier négocièrent deux mariages, ce-
lui de Charles avec une fille de Didier, celui de Gisèle (sœur de Charles et Carloman) avec
Adelchis, fils de Didier, en un échange parfaitement équilibré qui devait rétablir l'amitié fran-
co-lombarde affaiblie par le soutien des Francs à la papauté. Le pape Etienne III ne manqua
pas de dénoncer ces mariages39, mais les intérêts politiques en jeu étaient trop importants pour
qu'ils ne se fassent pas: outre l'assurance de l'amitié avec les Lombards, le mariage de Charles
avec la fille de Didier devait conforter ses positions face à son frère Carloman et renforcer ses
liens avec son cousin Tassilon de Bavière, qui avait épousé Liutberge, une autre fille de Di-
dier et Ansa, en 763. La mort brutale de Carloman en 771 changea la donne et conduisit
Charles à renvoyer son épouse lombarde pour épouser la Souabe Hildegarde et faciliter sa
prise en main du royaume de Carloman. La veuve de Carloman s'enfuit auprès du roi Didier
avec ses enfants, rendant ainsi la guerre inévitable: elle se termina par la chute de Pavie et
l'annexion du royaume lombard en 774, puis la destitution de Tassilon en 78140.
Charlemagne et ses successeurs étaient désormais en relation avec toutes les puis-
sances chrétiennes d'Occident, avec l'empire de Byzance et même les Rus, qui envoyèrent
une mission diplomatique en 838 pour demander l'aide des Francs41, et bien sûr avec le califat
de Bagdad. Dans le cadre du royaume franc, désormais dilaté à la quasi-totalité de la chrétien-
té occidentale, les possibilités de mariages extérieurs étaient limitées aux familles royales
chrétiennes d'Espagne et d'Angleterre. Or avec l'Espagne chrétienne, les relations étaient trop
dissymétriques pour qu'un mariage fût envisageable et utile, et d'ailleurs les dynastes espa-
gnols se servaient eux-mêmes des alliances matrimoniales dans leurs politiques de consolida-
38 PAUL DIACRE, Histoire des Lombards, VI, 53. 39 Codex Carolinus, MGH Epp 3, n°45, p. 561. 40 J.L. NELSON, Making a Difference in Eighth-Century Politics: The Daughters of King Desiderius, in After
Rome's fall. Narrators and Sources of early Medieval History. Essays presented to Walter Goffart, ed. A.C.
MURRAY, Toronto 1998, pp. 171-190. 41 J. SHEPARD, Rus' cit., pp. 369-407.
15
tion et d'expansion territoriales à l'intérieur de la péninsule42. Le projet de mariage entre
Charles le Jeune, fils aîné de Charlemagne et d'Hildegarde, et la fille du roi Offa de Mercie
échoua, car il s'inscrivait dans un contexte de forte compétition43, si bien que le seul mariage
extérieur carolingien fut celui de Judith, fille de Charles le Chauve, avec le roi anglo-saxon
Ethelwulf en 856. Les deux rois avaient alors des objectifs politiques convergents, en dehors
de l'alliance contre les Vikings: Ethelwulf cherchait à contrer les velléités de révolte de son
fils Ethelbald, en espérant obtenir un nouvel héritier et en accroissant son prestige par ce ma-
riage prestigieux avec une Carolingienne. De son côté Charles le Chauve, qui pouvait espérait
voir un petit-fils sur le trône de Wessex, cherchait à renforcer son influence en Angleterre et
confortait son ambition de ceindre un jour la couronne impériale44.
En définitive, les Carolingiens ont pratiqué une diplomatie internationale de prestige,
dont les interactions étaient faibles, et une diplomatie intérieure beaucoup plus active et
pragmatique. Le mariage est pour eux un instrument politique mais ils ne l'ont pas utilisé à
l'extérieur, se donnant ainsi la possibilité de se lier à l'aristocratie en prenant leurs épouses au
sein des groupes dirigeants et en donnant leurs filles, avec parcimonie et seulement à partir de
Louis le Pieux, à ces mêmes groupes. Jusque dans les années 880, les échanges diplomatiques
avec l'extérieur se firent donc par les moyens traditionnels, c'est-à-dire l'échange d'ambassa-
deurs, de cadeaux, voire d'otages.
3) Les Xe et XIe siècles
À partir de la fin du IXe siècle, la fragmentation politique de l'Occident postcarolin-
gien entraina une transformation des équilibres et une recomposition des forces : dans l'Occi-
dent où se dessinent les quatre royaumes post-carolingiens, on passe d'une seule famille
royale à plusieurs familles princières qui rivalisent et qui s'affrontent pour les titres royaux, en
42 Ainsi pour le royaume asturien, cf C. ESPETA DIEZ, Configuración y primera expansión del reino astur. Si-
glos VIII y IX in De Constantino a Carlomagno. Disidentes, heterodoxos, marginados, ed. F. J. LOMAS et F.
DEVIS, Cadix 1992, p. 182 et S. RUIZ DE LA PENA, El rey y el reino en la alta Edad media. III : La monarquía
astur-leonesa. De Pelayo a Alfonso VI (718-1109), León 1995 (coll. Fuentes y Estudios de historia leonesa, 50),
pp. 66-68. 43 Si l'on suit la chronique des abbés de Fontenelle (XII,2), Charles le Jeune a été l'initiateur de la demande
auprès d'Offa, qui aurait aussitôt demandé en retour à Charlemagne sa fille Berte en mariage, irritant fortement
Charlemagne. Plusieurs explications ont été données, dont aucune n'est satisfaisante, mais le projet de mariage
de Charles le Jeune s'inscrit clairement dans un contexte de tensions diplomatiques et de surenchères. 44 M.J. ENRIGHT, Charles the Bald and Aethelwulf of Wessex: The Alliance of 856 and Strategies of Royal
Succession, in Journal of Medieval History, 5 (1979), p. 291. P. STAFFORD, Charles the Bald, Judith and
England, in Charles the Bald. Court and Kingdom, ed. M.T. GIBSON et J.L. NELSON, Londres 2e éd. 1990, pp.
139-153, 143, J.L. NELSON, The Franks and the English in the ninth century reconsidered, in P.E. SZARMACH et
J.T. ROSENTHAL, The Preservation and Transmission of Anglo-Saxon Culture, Kalamazoo, 1997, p. 143. M.
HARTMANN, Die Königinnen im Frühmittelalter, Stuttgart 2009, p. 193.
16
mettant en avant leurs droits et le prestige de leurs origines. Les rencontres de rois et les ma-
riages apparaissent alors comme les meilleurs moyens de sceller les alliances et de stabiliser
les relations dans un mode de gestion personnalisée des pouvoirs et un réseau multipolaire.
La série de mariages entre Francs et Anglo-Saxons illustre le changement. La montée
du pouvoir royal en Wessex et le prestige de ses rois, qui contrastent avec l'affaiblissement du
pouvoir royal sur le continent, se traduisent directement par des mariages. Les rois de Wessex
deviennent donneurs de femmes, dans un système où les preneurs sont demandeurs et où ils se
servent du mariage dans la compétition sur le continent45. Entre 893 et 899, Alfred de Wessex
donne sa fille Aelfthryth au comte de Flandre Bauduin II, carolingien par sa mère Judith. Ce
mariage sert Bauduin dans sa lutte contre le roi Eudes, il lui permet d'asseoir ses positions en
Flandre occidentale et de jeter les bases de la principauté flamande46. Vers 917/918, Edouard
l'Ancien (899-924), fils d'Alfred, donne sa fille Eadgifu en mariage au roi Charles le Simple47
qui cherchait peut-être là l'occasion de se rapprocher de Bauduin II, époux de la sœur
d'Edouard. Vers 926, Hugues le Grand épouse Eadhild, fille d'Edouard et sœur du roi
Athelstan (924-939 ), neutralisant ainsi les soutiens anglo-saxons que Charles le Simple, em-
prisonné, aurait encore pu obtenir contre le roi Raoul, beau-frère d'Hugues le Grand48. Le roi
Henri Ier de Germanie, dont la légitimité n'était pas très assurée, envoya lui aussi une ambas-
sade au roi Athelstan pour lui demander une de ses sœurs en mariage pour son fils Otton en
929: ce fut Edith et c'est à l'occasion de ce mariage prestigieux, qui confortait la légitimité des
Liudolfingiens qu'Henri fit d'Otton, désormais appelé rex, son successeur désigné49. Edgiva
épousa Louis, frère du roi Rodolphe II de Bourgogne, et une cinquième sœur ou demi-sœur
d'Athelstan se maria avec Sihtric, un chef viking de Northumbrie. Les alliances continentales
de la famille royale de Wessex ne relevaient pas d'un système hégémonique qui aurait visé à
assurer une paix anglo-saxonne en Occident, mais elles consacrent le prestige acquis, à la fin
du IXe siècle et jusque dans les années 930, par la dynastie de Wessex et la nécessité pour les
familles royales et princières de légitimer un pouvoir toujours contesté dans un contexte de
45 S. MACLEAN, Making a difference in tenth-century politics: King Athelstan's sisters and Frankish queenship,
in Frankland: The Franks and the World of the Early Middle Ages. Essays in Honour of Dame Jinty Nelson, ed.
P. FOURACRE and D. GANZ, Manchester 2008, pp. 167-190.
46 J. DHONDT, La donation d'Elstrude à Saint-Pierre de Gand, in Revue belge de Philologie et d'histoire, t. CV,
1940, p. 118. 47 GUILLAUME de MALMESBURY, Gesta Regnum Anglorum, c.126, ed. et trad. R.A.B. MYNORS, R.M. THOMAS,
M. WINTERBOTTOM, Oxford 1998-1999. 48 RICHER, Histoire de France, t. I, 55, I, éd. et trad. R. LATOUCHE, Paris 1930, pp.108-109, 49 Voir à ce propos, H. KELLER, Ottonsiche Königsherrschaft et la bibliographie, Darmstadt 2002, pp. 92-95.
17
compétition très vive. Elles créaient également un réseau de relations orientées vers l'Angle-
terre qui furent actionnées à plusieurs reprises, par les uns et par les autres50.
Dans les années 940-960, les mariages ottoniens traduisent la montée en puissance de
la Germanie en Europe occidentale. Sous Otton Ier en effet, le genus saxon s'étend sur les
royaumes issus de l'empire carolingien par une série d'intermariages : du côté de la Francie
occidentale, ses sœurs Hadwige et Gerberge sont respectivement mariées au duc Hugues le
Grand et au roi Louis IV, tandis qu'Otton épouse en secondes noces Adélaïde, sœur du roi
Conrad de Bourgogne et veuve du roi d'Italie Lothaire. Il donne à Conrad de Bourgogne sa
nièce en mariage et se sert de son mariage avec Adélaïde pour devenir roi d'Italie, puis pour
rétablir l'empire. Le prestige ottonien, lié aux victoires militaires, est sorti grandi des mariages
avec des membres des familles royales, d'ascendance carolingienne, mais Otton Ier ne négli-
gea pas pour autant les alliances avec les ducs : son frère Henri épousa entre 937 et 940 Ju-
dith, fille du duc de Bavière et d'une Hunrochide, d'ascendance carolingienne elle aussi, et son
fils Liudolf se maria en 947 avec Ida, fille unique du duc Hermann de Souabe. Les mariages
ottoniens visaient donc à stabiliser les relations, à définir la hiérarchie et à assurer la fidélité
par les liens personnels, à la fois avec les familles royales voisines et avec les familles ducales
dans le royaume de Germanie. C'est dans ce contexte hégémonique qu'Otton II épousa en 972
la nièce de l'empereur Jean Tzymyskès. Ce mariage était une grande victoire diplomatique qui
rehaussait le prestige ottonien en Occident, si bien que le roi Hugues Capet, peu après avoir
associé son fils Robert au trône, à la fin 988-début 989, chercha lui aussi à obtenir pour Ro-
bert une princesse byzantine en mariage, dans un contexte de compétition et un souci de légi-
timité, mais il n'y parvint pas et il dut se rabattre sur une Carolingienne, fille du roi d'Italie et
veuve du comte de Flandre51. Au tournant du siècle, Otton III envoya trois ambassades suc-
cessives pour obtenir une princesse byzantine en mariage et on s'accorda en 1002 sur la fille
de Constantin VIII Porphyrogénète, mais la princesse fut renvoyée chez elle, à la nouvelle de
la mort de l'empereur.
***
Les Byzantins ont utilisé le mariage diplomatique pour des raisons essentiellement mi-
litaires. Cinq projets de mariage au moins furent établis entre Byzantins et Carolingiens entre
781 et la fin du IXe siècle, toujours à la demande des Byzantins, sans qu'aucun n'aboutisse, à
50 S. MACLEAN, Athelstan's sisters cit., pp. 176-177. 51 C. WOLL, Die Königinnen des hochmittelalterlichen Frankreich 987-1237/38, Stuttgart 2002 (Historische
Forschungen 24), pp. 46-50.
18
chaque fois pour des raisons conjoncturelles, tenant à la mort ou à la chute du souverain by-
zantin52. À partir du milieu du IXe siècle, les projets concernent l'Italie, à cause des pressions
musulmanes en Méditerranée, en particulier sur la Sicile et l'Italie du Sud. Le mariage de
Constantin VII avec Ermengarde, fille de Louis II, ne se fit pas, à la suite du refus de Louis II,
mais en 900, les négociations pour un mariage entre Louis III de Provence et Anna, fille de
Léon VI, aboutirent, mais les Byzantins avaient misé sur le mauvais cheval puisque Louis III
fut vaincu et aveuglé par Bérenger Ier en 90553. Dans les années 930, ils cherchèrent à contrô-
ler Rome contre Hugues de Provence en s'alliant aux Théophylactes par le mariage du fils de
Romain Ier Lécapène avec une fille de Marozia, suivi par celui d'Albéric II, fils de Marozia,
avec une princesse byzantine. Le mariage de Romain avec Berte-Eudokia, fille d'Hugues de
Provence, devenu roi d'Italie en 944, illustre bien le pragmatisme byzantin, quand il s'agissait
de trouver des alliés contre les Musulmans et de conclure un mariage de prestige avec une
descendante de Charlemagne.
À partir du milieu du Xe siècle, la victoire d'Otton Ier au Lechfeld, son accession à la
couronne d'Italie et son couronnement impérial à Rome d'un côté, la montée du pouvoir rus
dans la région du Danube inférieur et le nord des Balkans d'autre part, confirment de nou-
veaux rapports de force. Le prestige byzantin reste intact, mais le réseau se transforme avec
de nouvelles têtes polarisatrices. En 967, Nicephore II avait refusé une Porphyrogénète aux
ambassadeurs d'Otton Ier pour son fils Otton II mais deux ans plus tard, il tenta de bloquer
l'avance des Rus dans les Balkans en proposant de marier ses fils Basile et Constantin à des
princesses bulgares et la troisième ambassade envoyée par Otton en 970-1 obtint du nouvel
empereur Jean Tsymyskès sa nièce Theophano, sans doute à cause de la pression exercée sur
les Byzantins par les Rus d'un côté, et la pression fatimide de l'autre. Ce mariage revenait
pour les Byzantins à reconnaître symboliquement l'égalité entre les deux empereurs, sous
couvert d'une alliance contre les "ennemis communs" . En 988, Basile II accepta de donner sa
52 F. TINNENFELD, Byzantinische auswärtige Heiratspolitik vom 9. zum 12. Jahrhundert. Kontinuität und Wandel
der Prinzipien und der praktischen Ziele, in Byzantium and its neighbours from the mid-9th till the 12th
centuries, ed. V. Vařínek, Byzantinoslavica. Revue internationale d'études byzantines, LIV, 1993 p. 21-28 : En
780, alors que Charlemagne est en Italie, l'impératrice Irène envoie une demande en mariage pour son jeune fils
Constantin (né vers 771) avec Rotrude. Charles accepte et des Grecs sont envoyés à Aix pour la préparer, mais
quand Charles établit son pouvoir sur Bénévent en 787, Irène considère que les conditions ne sont plus réunies
pour un mariage et rompt les fiançailles. Après son couronnement, Charles aurait demandé Irène en mariage en
802, peu avant la chute de l'impératrice. En 811/2, un projet de mariage entre le fils de Michel Ier et une fille de
Charles échoue à cause de la chute de l'empereur byzantin. En 841, l'empereur Theophilos espère une alliance
contre les Sarrazins d'un mariage entre une de ses filles et Louis II, mais il meurt en 842. En 867, l'empereur
Basile Ier accepte de reconnaître le titre impérial de Louis II contre un mariage de son fils Constantin avec
Ermengarde, fille de Louis II. Le plan échoue. 53 J. SHEPARD, Marriages cit., pp. 6-7.
19
sœur Anna en mariage au prince rus Vladimir, en échange de son aide militaire contre le re-
belle Bardas Phocas, assortie de sa conversion54.
Les nouveaux convertis slaves, rus' et scandinaves faisaient désormais partie inté-
grante du jeu international, où ils jouaient leurs propres cartes, en se servant du mariage
comme d'un instrument diplomatique privilégié pour nouer les alliances. L'exemple rus est
emblématique : Iaroslav, fils de Vladimir, devenu seul prince de Kiev en 1019, créa un véri-
table réseau d'alliances matrimoniales, étendu vers les Scandinaves -il épousa vers 1019 Ingi-
gerd-Irène, fille du roi de Suède Olaf Skötkonung, il maria sa fille Elizabeth en 1044 à Harald
III de Norvège-, vers les Hongrois et les Polonais -il maria en 1046 sa fille Anastasia à An-
dreas de Hongrie, sa sœur Dobrogniega Maria à Casimir, fils de Miezsko II et Richeza en
1041, son fils Isiaslav Ier épousa Gertrude, sœur de Casimir de Pologne- vers les Saxons -son
fils Sviatoslav II épousa Oda, fille du comte Lippold de Stade et d'Ida de Elsdorf-, vers les
Francs puisque sa fille Anna épousa le roi Henri Ier de France à défaut de l'empereur Henri III-
, mais aussi vers Byzance où son fils Vsevolod épousa une princesse byzantine55.
Avec ses spécificités propres, le mariage permettait de jouer sur plusieurs registres,
comme en témoignent les mariages saliens, qui ont servi à conforter leurs prétentions territo-
riales sur la Bourgogne, à garantir le passage vers l'Italie et la sécurité des frontières orien-
tales, à neutraliser ou contrer les Capétiens tout en cherchant à renforcer leur pouvoir en Ger-
manie56. Dans le contexte politique du XIe siècle, marqué par une forte compétition, y com-
pris intrafamiliale, par des formes d'hérédité mal définies et des fidélités instables, le réseau
de relations internationales s'est densifié et le mariage est devenu l'instrument privilégié des
alliances diplomatiques, à l'intérieur de la chrétienté.
3 La performativité des mariages diplomatiques
Dans l'interaction diplomatique fondée sur le mariage, la position de l'épouse corres-
pond à ce que les sociologues appellent une « centralité d’intermédiarité» qui la rendait indis-
54 Ibid., pp. 13-16. 55 J. SHEPARD, Rus's cit., p. 386. H. RÖCKELEIN, Heiraten cit., pp. 107-109. 56 La politique matrimoniale des Saliens est bien connue. Elle leur a servi à confirmer leurs droits et la mainmise
sur la Bourgogne transjurane (1039), préparée de longue date : Adélaïde, épouse d'Otton Ier, était la sœur du roi
Conrad le Pacifique, Mathilde et Gisèle de Souabe étaient ses petites-filles. Agnès de Poitou était la petite-fille
du comte de Bourgogne Otte-Guillaume, le comté ayant été rattaché au royaume de France en 1016 et ayant
désormais à sa tête un Capétien. Les mariages du roi Henri Ier avec des Saliennes neutralisaient le Capétien. Ils
garantissent leur sécurité à l'Est par les alliances slaves: Judith-Sophie, fille d'Henri III, épouse en premières
noces le roi Salomon de Hongrie et en secondes noces le duc Wladislaw-Hermann de Pologne. Ils contrôlent la
sécurité du passage vers l'Italie par le mariage en 1037 de Beatrice de Lorraine et Boniface de Toscane, puis par
les fiançailles en 1066 du jeune Henri IV avec Berte de Savoie.
20
pensable aux échanges et qui, selon les cas et les périodes, pouvait faire d'elle une véritable
actrice dans la relation. L'analyse par le genre permet donc de mesurer la performativité du
mariage dans les relations internationales.
Les lettres de Théodoric à ses "parents" affins attestent que la femme donnée et reçue
en mariage était à la fois vecteur de prestige et gage de paix entre le donneur et le preneur,
dans une relation égalitaire et honorable, même si le rapport de force était dissymétrique : le
mariage de Thrasamund avec Amalafride offrit aux Vandales "un pacte d'amitié au lieu du
tribut annuel", c'est-à-dire des garanties de paix et de sécurité leur interdisant des gestes
d’inimitié l’un envers l’autre57. Le gage était d'autant plus fort que le mariage était assorti de
transferts de richesses et de cadeaux précieux, qui servaient à consolider le lien et l'affect.
Quand Grégoire de Tours écrit que le roi Chilpéric Ier commença par aimer beaucoup son
épouse Galswinthe parce qu'elle était arrivée avec de grands trésors, il souligne la relation
entre la qualité et la quantité des biens offerts par le donneur -sa fille et de grands trésors- et
celles de l'affect, stigmatisant d'autant le meurtre de Galswinthe par Chilpéric. Dans l'échange
entre les familles royales, les femmes étaient donc d'abord des trésors animés, dont on usait
pour s'assurer des alliés, établir la paix, obtenir des richesses et des droits.
La solidité des amitiés issues des mariages diplomatiques dépendait ensuite beaucoup
des motivations ayant conduit à l'alliance et des intérêts à la maintenir. Dans le jeu de la com-
pétition, chacun développait ses propres stratégies, en vue de trouver le meilleur moyen de
renforcer ses positions. Les objectifs du mariage dépassaient toujours le simple fait de garantir
la paix, surtout quand celle-ci s'inscrivait dans une succession de phases de paix et d'hostilité.
Ainsi quand Boleslav Chobry négocia avec Henri II en 1013 une paix assortie d'un mariage
entre son fils Mieszko II et Richeza, fille d'Ezzo et cousine de l'empereur Otton III dont il
avait été l'ami, il renforçait aussi ses soutiens du côté des Ezzonides qui ne comptaient pas
parmi les soutiens d'Henri II. Après sa victoire sur les troupes impériales en 1017, il accepta la
paix de Bautzen, pour s'assurer l'aide d'Henri II contre Iaroslav de Kiev, mais il négocia son
propre mariage avec Oda, sœur du comte Hermann de Meissen, qui lui garantissait une cer-
taine autonomie à l'égard de l'empereur58. D'autre part, les considérations intérieures pesaient
souvent autant que les relations extérieures dans les choix et les négociations, comme l'attes-
tent les mariages d'Ethelwulf puis Ethelbald de Wessex avec la princesse carolingienne Ju-
dith.
57 V. Epp, Rituale frühmittelalterliche Amicitia, p. 11, 23-24 58 H. RÖCKELEIN, Heiraten cit., p. 113.
21
Le devenir de l'alliance était lié au sort de l'épouse, qui restait incertain tant qu'elle
n'avait pas mis au monde d'héritiers et qu'elle restait à la merci des aléas de la politique, des
retournements d'alliance, des opportunités à saisir sur le marché matrimonial pouvant entraî-
ner sa répudiation. En 445/446, Geiseric, roi des Vandales, renvoya l'épouse wisigothique de
son fils Huneric à son père et rompit ainsi le lien avec eux, pour lui permettre d'épouser la
fille de Valentinien III59. Le poids des rivalités fraternelles a non seulement déterminé le ma-
riage de Chilpéric avec Galswinthe mais aussi le sort tragique de la princesse, quoi qu'en ait
dit Grégoire de Tours de la haine de Frédégonde pour sa rivale. La tentative de Lothaire II de
faire rompre son mariage avec Theutberge à partir de 856 s'inscrit dans un retournement d'al-
liances qui rendait ce mariage sans intérêt, puisque par ailleurs la reine n'avait pas mis au
monde de fils60. Le renvoi de Rozala-Susanna par le roi Robert le Pieux en 996 s'explique par
l'antipathie du roi à l'égard d'une épouse âgée et surtout stérile, et aussi par les avantages d'un
mariage avec Berte de Bourgogne, opportunément libérée par la mort de son mari Eudes de
Blois, avantages qui étaient bien supérieurs, en termes de prestige et de consolidation poli-
tique, aux risques encourus par le divorce.
La naissance d'héritiers garantissait le statut de l'épouse, mais non la pérennité de l'al-
liance extérieure car le décès d'un conjoint affaiblissait rapidement le lien en ouvrant la possi-
bilité d'une nouvelle alliance matrimoniale. Beaucoup d'épouses étrangères devenues veuves
sont retournées dans leur patrie où elles se sont remariées comme Judith, veuve d'Ethelbald,
qui épousa Bauduin, ou encore Oda de Stade, veuve de Sviatoslav de Kiev, qui rentra en Saxe
et s'y remaria. D'autres revenaient dans leur patrie pour entrer au monastère, comme Gisela,
reine de Hongrie et abbesse de Passau-Niedernburg. Cependant, certaines restaient dans le
pays de leur défunt mari et pouvait y jouer un rôle politique important, auprès de leurs fils
mineurs, comme Brunehaut au VIe siècle, la reine Gerberge et l'impératrice Theophano au Xe
siècle61.
Pour consolider une alliance après le décès d'un des partenaires, il fallait la renouveler
rapidement par l'envoi d'ambassadeurs, la conclusion d'un pacte, la remise de cadeaux ou un
nouveau mariage. L'alliance entre la famille des margraves de Meissen et celle des Piast polo-
nais fut ainsi renouvelée à plusieurs reprises, tant elle était importante pour chacun des parte-
naires. En revanche, si le rapprochement entre le roi de France Henri Ier et l'empereur Henri
59 M. STRATMANN, Die Königinen des Frühmittelalters, Stuttgart 2009, pp. 6-7. 60 F. BOUGARD, En marge du divorce de Lothaire II: Boson de Vienne, le cocu qui fut fait roi?, in Francia 27,1,
2000, pp. 33-5 61 J. SHEPARD, Marriages cit., pp. 19-29.
22
III, scellé par les fiançailles du roi avec la fille de l'empereur en 1034, fut renouvelé par le
mariage du roi avec une autre Mathilde, la mort de celle-ci en 1044 sonna le glas de cette ami-
tié et le roi épousa en 1051 Anne de Kiev pour contourner la pression salienne et gêner la di-
plomatie d'Henri III62.
***
Les épouses étrangères ne pouvaient oublier leurs origines puisqu'elles avaient pour
fonction l'intermédiarité. Certaines d'entre elles furent de véritables médiatrices culturelles,
comme en témoignent les lettres de Brunehaut au VIe siècle, les modes introduites en France
du Nord par la reine Constance, les intérêts jamais démentis de Théophano ou d'Anna Porphy-
rogénète pour les modes et la culture grecques. L'influence de cette dernière à la cour de son
époux Vladimir de Kiev fut considérable dans la diffusion des modèles culturels grecs dans le
palais de Kiev, dans la construction de nombreuses églises et l'éducation qu'elle donna à ses
enfants. Leur position de "passeurs culturels" entre des mondes parfois fort éloignés l'un de
l'autre contribuaient à unifier le réseau de relations internationales.
La question de leur action dans les affaires internationales, entre leur famille d'origine
et celle de leur mari permet de mesurer leur centralité d'intermédiarité. Dès le VIe siècle, les
évêques avaient reconnu l'influence des épouses sur leur mari et les avaient incitées à être de
bonnes conseillères, à l'image d'Esther63, mais il n'est pas facile de mesurer leur capacité à
agir dans la diplomatie. Au début du VIe siècle, Théodoric ne fait appel ni à ses sœurs ni à ses
filles et semble intervenir lui-même pour tenter de maintenir la paix ou pour menacer ses af-
fins, selon les cas. Mais quelques décennies plus tard, les sources attestent des relations qu'ont
entretenues certaines reines ou princesses avec leurs parents à l'étranger. Originaire de la Thu-
ringe, liée aux Amales et mariée au roi mérovingien Clotaire Ier , la reine Radegonde, retirée
au monastère Sainte-Croix de Poitiers, envoie à son cousin Amalafrid, réfugié à Constanti-
nople, un poème rédigé par Fortunat sur la chute de la Thuringe. Ayant appris qu'il était mort,
elle écrit à un autre de ses parents, Artachis, toujours par l'intermédiaire de Fortunat. Enfin,
elle s'adresse à l'empereur Justin et à l'impératrice Sophie pour leur demander une relique de
la croix du Christ. La reine Brunehaut envoie des lettres au roi Leovigild, son beau-père, pour
62 C. WOLL, Die Königinnen cit., pp.109-110: La mission envoyée par Iaroslav de Kiev en 1042 à l'empereur
Henri III pour lui proposer sa fille en mariage avait échoué. L'ambassade que le roi Henri Ier, sans doute poussé
par le comte de Flandre, envoya à Iaroslav n'est pas antérieure à 1049. Le roi cherchait peut-être à éviter de se
lier à des familles princières dans le cadre de l’instabilité intérieure et ses relations avec l’empire s'était beaucoup
dégradées. Le mariage eut lieu en 1051 et le premier fils, né en 1052, fut appelé Philippe, nom grec rappelant les
origines byzantino-russes de sa mère. 63 C. Nolte, Conversio und christianitas. Frauen in der Christianisierung vom 5. bis 8. Jahrhundert,
Stuttgart1985.
23
protester contre le sort malheureux réservé à sa fille Ingonde. Au VIe siècle, les princesses
mariées à l'étranger ne coupaient donc pas les ponts avec leurs parents et intervenaient même
directement, dans le cadre familial.
À l'époque carolingienne, le champ d'action des épouses royales s'inscrit dans le cadre
de l'empire, où elles ont pu jouer le rôle d'intermédiaires avec les groupes dirigeants régio-
naux dont elles étaient issues et auxquels elles restaient liées64, mais leur rôle "international"
se limite alors aux relations avec la papauté, un rôle traditionnel depuis Grégoire le Grand au
moins : les papes s'adressent à elles, comme ils l'avaient toujours fait, pour des demandes
d'intercession auprès du roi. Les changements intervenus à partir de la fin du IXe siècle en
matière de géopolitique et de géostratégie, dans le mode de transmission et d'exercice du pou-
voir et dans les relations familiales accroissent ensuite la capacité d'action des reines et prin-
cesses dans les relations internationales65. Le passage d'une seule famille royale à plusieurs
familles concurrentes, l'affaiblissement du pouvoir royal et l'enchevêtrement des droits accen-
tuent les tendances isogamiques. La reine accède alors au devant de la scène politique par une
association plus étroite à l'exercice du pouvoir, qu'elle ait le titre de consors comme les reines
d'Italie puis les impératrices, ou qu'elle ne l'ait pas comme les reines de Francie ou d'Angle-
terre66.
La lettre de Berte de Toscane, fille du roi carolingien Lothaire II (†869) et épouse en
secondes noces du marquis Adalbert II de Toscane, au calife abbaside de Bagdad al-Muktafi
en 905-906 illustre les changements. Elle a été envoyée avec des cadeaux et mentionne une
réponse du calife. Berte y proposait un pacte au calife après que sa flotte eut intercepté les
navires arabes en Méditerranée et fait prisonnier le commandant eunuque de la flotte. La
lettre, qui n'a été conservée que dans des sources arabes, a été replacée par Giovana Gandino
et Tiziana Lazarri dans le contexte de la politique italienne et byzantine des années 905-906,
après la mise hors jeu de Louis III, beau-frère de l'empereur byzantin, aveuglé par les parti-
sans de Bérenger Ier67. L'objectif était de conforter l'amitié entre Berte et le calife, en se fon-
dant aussi sur les relations amicales entre le calife et l'empereur byzantin. Berte, qualifiée de
64 R. LE JAN, Douaires et pouvoirs des reines en Francie et en Germanie, i n Ead, Femmes, pouvoir et société
dans le haut Moyen Âge, Paris 2001, pp. 68-88; S. MACLEAN, Queenship cit., pp. 3-38. 65 R. LE JAN, L'épouse du comte du IXe au XIe siècle: transformation d'un modèle et idéologie du pouvoir, in
Ead., Femmes, pouvoir…, pp. 21-29. 66 R. LE JAN, Douaires cit. pp. 76-88. 67 Sur cette lettre, G. CANDIDO, Aspirare al regno: Berta di Toscana, in C. La Rocca (dir.), Agire da donna.
Modelli e pratiche di rappresentazione (secoii VI-X), Turnhout, 2007 (Haut Moyen Âge 3), p. 249-268 et T.
LAZARRI, La rapprezentatione dei legami di parentela e il ruolo delle donne nell'alta aristocrazia del regno
italico (secc. IX-X): l'esempio di Berta di Toscana, dans le même volume, pp. 129-149.
24
"reine des Francs", est ainsi placée au cœur d'un réseau dont elle apparaît comme un acteur
direct. Liutprand de Crémone confirme par ailleurs que Berte, du vivant même de son mari,
dirigeait la politique familiale68.
Si Berte de Toscane est sans doute une femme d'exception, son cas est emblématique
d'un changement d'échelle au Xe siècle. Du côté franc, le reine Gerberge, fille du roi Henri Ier
de Germanie, a utilisé son réseau familial pour conforter sa propre position, servir les intérêts
politiques de son mari Louis IV et de son fils Lothaire, sans négliger ceux de sa famille. En
946, quand le roi est retenu prisonnier par le duc des Francs Hugues le Grand, elle fait de-
mander l'aide de son frère Otton par des ambassades et des lettres, et Otton finit par répondre
à l'appel de sa sœur. En 949, elle fait seule le voyage à Aix-la-Chapelle pour les fêtes de
Pâques et elle y sollicite une nouvelle fois l'aide de son frère contre Hugues le Grand69. Sa
belle-fille Emma, épouse du roi Lothaire (954-986), qui était, par sa mère Adélaïde, la nièce
du roi de Bourgogne Conrad le Pacifique et la belle-fille d'Otton Ier, est restée en relation
constante avec sa mère, par des lettres ou des messagers : en 980, elle s'adresse à elle par écrit
pour lui demander de l'aide contre le duc Hugues Capet qui menace alors le roi Lothaire tan-
dis que Lothaire s'adresse à son beau-frère, le roi Conrad de Bourgogne, qui était en même
temps l’oncle d’Emma, pour lui demander son aide contre le duc. Devenue veuve en 986, c'est
elle qui présente son fils Louis V à sa mère et à son oncle à Remiremont70. Du côté germa-
nique, l'intermédiarité des femmes n'est pas moins grande. Non seulement les reines et impé-
ratrices jouent un rôle de premier plan dans les questions internationales, mais les princesses
également71. Mathilde, duchesse de Haute-Lotharingie, fille du duc Hermann II de Souabe et
sœur de l'impératrice Gisèle, remercie Mieszko II de Pologne pour sa fidélité en lui envoyant
un livre liturgique accompagné d'une lettre de dédicace. Richeza joue un rôle actif dans les
relations internationales. Devenue veuve de Mieszko II en 1034, elle revient en Germanie où
elle se fait intituler regina quondam Poloniae, et poursuit le but de placer son fils Casimir sur
le trône de Pologne. Elle y parvient en 1041, grâce au réseau qui la soutient, avec son frère
68 LIUTPRAND DE CREMONE, Antapodosis, II, 39, p. 55 et T. LAZZARI, La rappresentazione cit., pp. 139-140.. 69 R. LE JAN, La reine Gerberge, entre Carolingiens et Ottoniens, in Ead. Femmes, pouvoir cit., pp. 30-38. 70 R. LE JAN, D'une cour à l'autre: les voyages des reines de Francie au Xe siècle, in Ead., Femmes,
pouvoir cit., pp. 40-52. 71 K. GÖRICH, Mathilde-Edgith-Adelheid: Ottonische Königinnen als Fürsprecherinnen, in B. SCHNEIDMÜLLER
et S. WEINFURTER ed, Ottonische Neuanfänge. Symposien zur Austellung "Otto der grosse, Magdeburg und
Europa", Mayence 2001, pp. 251-291; L. KÖRNTGEN, Starke Frauen: Edgith-Adelheid-Theophanu, in M. PUHLE
ed., Otto der Grosse: Magdeburg und Europa, Mayence 2001, pp. 119-132, 120-122. D. MÜLLER-WIEGAND,
Vermitteln-Beraten-Erinnern. Funktionen und Aufgabenfelder von Frauen in der ottonischen Herrscherfamilie
(919-1024), Kassel 2005, pp.148-200.
25
Hermann, archevêque de Cologne (1036-1056), son beau-frère Iaroslav de Kiev (1016-1054),
Aaron, probablement d'origine écossaise, et des appuis au sein de l'élite polonaise.
La médiation dans les conflits est une autre facette de la centralité d'intermédiarité des
femmes dans les relations internationales. La première à être mentionnée dans un tel rôle est
Gisèle, sœur de Berte de Toscane, donnée comme épouse au Normand Godfrid. Les Francs
lui demandèrent d'intervenir pour rétablir la paix avec Godfrid. D'autres femmes s'illustrèrent
ensuite dans ce rôle de médiation, facilité par les intermariages. À la fin du Xe siècle, la du-
chesse Beatrice de Haute-Lotharingie intervint à plusieurs reprises entre la cour ottonienne et
son frère Hugues Capet. L'impératrice Adelaïde, sœur du roi Conrad de Bourgogne, entra
dans le duché de Transjurane en 999 pour y arbitrer le différend entre son neveu Rodolphe III
et le comte Otte-Guillaume72. L'impératrice Théophano négocia avec les Hongrois, comme le
fit aussi l'impératrice Agnès, qui obtint un traité de paix avec eux en 1063 et qui négocia le
mariage de sa fille Judith avec l'héritier du trône, Salomon. Les médiations de l'impératrice
Gisèle (†1043) entre son mari Conrad II (1024-1039) et son oncle Rodolphe III de Bourgogne
sont rapportées par Wipon, biographe de l'empereur. Comme tous ses prédécesseurs, Conrad
II dut faire face à des révoltes ou des contestations dans les premiers mois de son règne, en
Lotharingie, en Saxe et en Franconie. Rodolphe III n'avait pas d'héritier direct mais beaucoup
pouvaient prétendre à sa succession, à commencer par Ernst de Souabe, fils du deuxième ma-
riage de l'impératrice Gisèle. Conrad II devait donc obtenir le renouvellement de l'accord con-
clu par l'empereur Henri II, qui avait été désigné héritier et pour ce faire, il envoya Gisèle
négocier avec son oncle. Selon Wipon, "la reine Gisèle, fille de la sœur de Rodolphe, obtint
une bonne paix" en 102573: Rodolphe III fut en effet contraint de reconnaître Conrad et son
fils comme ses héritiers, en échange de quoi il récupéra les terres prises en gage l'année pré-
cédente74. Le roi de Bourgogne assista ensuite au couronnement impérial de Conrad et de Gi-
sèle, en même temps que le roi de Danemark Cnut, et quand Ernst de Souabe, fils de Gisèle,
voulut faire valoir ses droits sur l'héritage bourguignon, Rodolphe III ne le soutint pas. Après
la soumission d'Ernst de Souabe, une nouvelle rencontre eut lieu à Bâle en 1027, entre l'empe-
72 G. CASTELNUOVO, Un regno, un viaggio, una princessa: l'imperatrice Adelaide e il regno di Borgogna (931-
999), in Le Storie et la memoria. In onore di Arnold Esch, R. Della Donne, A. Zorzi ed., Florence 2001 (e-book:
http://www.rm.unina.it/e.book/festesch.html) , pp. 215-234. 73 WIPO, Vita Chuonradi, c.8, MGH Scriptores rerum germanicarum in usum schorarum, éd. H. BRESSLAU, Die
Werke Wipos, 3e édition, Hanovre et Leipzig 1915. 74 F. DEMOTZ, La Bourgogne, dernier des royaumes carolingiens (855-1056). Rois, pouvoirs et élites autour du
Léman, Lausanne 2006, pp. 601-602.
26
reur et le roi, pour confirmer les accords précédents. La rencontre fut organisée et l'accord
conclu grâce à la médiation de Gisèle75.
Cependant, la variabilité des situations dans un système de relations de pouvoir per-
sonnalisées rend toute généralisation impossible. Le mariage d'Henri Ier avec Anne de Kiev
eut une importance symbolique certaine, puisque leur premier fils fut nommé Philippe, un
nom complètement étranger au stock anthroponymique capétien, et occidental en général.
Néanmoins, la reine Anne ne fut jamais mise en avant et ne prit aucune part visible à la poli-
tique de son mari, ni à l'intérieur ni sur la scène internationale, bien qu'elle n'y fût pas incon-
nue. Sa famille d'origine était sans doute trop éloignée pour que des contacts suivis aient eu de
l'intérêt pour Henri Ier, mais elle aurait pu jouer un rôle par ses liens avec ses tantes et sœurs
mariées aux quatre coins de l'Europe76. Le cas de la reine d'Angleterre Emma est plus com-
plexe encore. Fille du duc Richard Ier de Normandie et d'Emma, sœur d'Hugues Capet, elle fut
d'abord mariée au roi d'Angleterre Ethelred, puis à Cnut le Grand qui, après la conquête de
l'Angleterre, l'épousa en 1017, pour légitimer son pouvoir, selon le procédé bien connu con-
sistant à épouser la veuve de son prédécesseur. Pour les Anglo-Saxons, le premier mariage
d'Emma était destiné à obtenir l'alliance normande, mais la reine ne joua qu'un rôle effacé
durant cette période, car ses origines ne pouvaient faire d'elle un symbole de paix dans une
Angleterre menacée par le danger viking. En revanche, comme épouse de Cnut, ses origines
contribuèrent à lui conférer un statut élevé et lui permirent de jouer un rôle d'intermédiaire
actif entre l'Angleterre et le continent77.
Le rôle diplomatique des femmes culmine au moment de la réforme grégorienne.
L'impératrice Agnès, les comtesses Beatrice et Mathilde de Toscane, Adelaïde de Turin et
d'autres ont été "médiatrices de paix" entre le pape et l'empereur. Elles le devaient à leurs ori-
gines familiales mais surtout à leur statut d'épouses ou de veuves, puisqu'au final si des
évêques et des abbés jouèrent ce même rôle médiateur, les abbesses n'y participèrent pas.
Conclusion
Le mariage diplomatique est un acte d'échange extrêmement complexe, soumis à de
multiples contraintes. Premièrement, comme tout autre mariage, il crée une nouvelle cellule
75 WIPO, c. 21 : Confirmata inter eos pace, Gisela imperatrice haec omnia mediante, regnoque Burgundiae
imperatori tradito eodem pacto…." 76 C. WOLL, Die Königinnen. cit., p. 111. 77 P. STAFFORD, Emma: The Powers of the Queen in the Eleventh Century, in Queens and Queenship in Medieval
Europe, ed. A. DUGGAN, Woodbridge 1997, pp.3-27, spécialement 17-18.
27
conjugale, il engage l'avenir des parentés, leur capital symbolique, il suppose l'identité qui
permet l'amitié entre donneur et preneur; deuxièmement, l'amitié diplomatique créée par les
mariages extérieurs s'inscrit dans un réseau d'interactions positives et négatives, le mariage
n'étant qu'un moyen parmi d'autres de créer une alliance diplomatique; troisièmement, chaque
mariage diplomatique a ses propres finalités, pour chaque partenaire, qui ne se réduisent pas
aux seules relations internationales, mais qui impliquent aussi, et parfois d'abord, les relations
politiques intérieures : les réseaux de parenté créés par les intermariages extérieurs ne se su-
perposent donc jamais exactement au réseau de relations internationales; quatrièmement, la
parenté diplomatique n'est réellement efficace que dans le présent, du vivant des partenaires.
Le réseau de relations internationales romain était fortement centré, mais il devient
multipolaires aux Ve-VIIe siècles. Dans ce cadre éclaté, les mariages extérieurs soutiennent les
ambitions des dynastes aussi longtemps que le cadre général des échanges le permet. À
l'époque carolingienne, l'unification de l'Occident chrétien limite l'intérêt des mariages exté-
rieurs, mais à partir de la fin du IXe siècle, le fractionnement politique de l'Occident postcaro-
lingien, l'émergence des nouvelles forces politiques chez les peuples convertis, le contexte
général d'ouverture des échanges, multiplient les acteurs politiques et les interactions. Le ma-
riage devient alors un instrument privilégié des alliances, ce qui étend le réseau de parenté à
l'échelle de la chrétienté, avec les pôles principaux que sont les empereurs, et des pôles se-
condaires qui assurent la transitivité du réseau. Pour autant, les mariages diplomatiques ne se
comprennent qu'en prenant en compte l'ensemble des alliances matrimoniales et tous les rap-
ports de force, intérieurs et extérieurs. La question du mariage dans les relations internatio-
nales est donc celle des rapports politiques, dans des cadres aussi mouvants que le pouvoir
lui-même. Au tournant de l'an mille, l'empereur Otton III, qui se voyait comme le nouveau
Charlemagne, pensait d'ailleurs la chrétienté en terme d'empire universel, l'Occident et
l'Orient étant unis par les mariages, celui de ses parents Théophano et Otton II, le sien propre
avec la princesse porphyrogénète attendue. Aux Xe et XIe siècles, dans ce cadre où l'enchevê-
trement des liens de parenté soutient l'équilibre international, sans empêcher les affrontements
locaux, les femmes ont naturellement acquis une forte centralité d'intermédiarité qui confère à
certaines d'entre elles, et à certains moments, une capacité d'action directe qu'elles n'avaient
encore jamais acquise.




























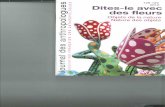








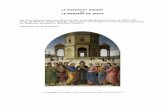
![Signori-trovieri in Borgogna: una lirica attribuita a Gautier de Berzé ["Medioevo romanzo", 21, 1997]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633d61679dcb0c30ee05f092/signori-trovieri-in-borgogna-una-lirica-attribuita-a-gautier-de-berze-medioevo.jpg)