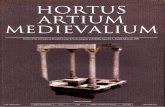Velika Gospa près de Bale (Istrie) : quatrième campagne de fouille (1998)
Les monnaies de Bourlon : un contexte monétaire d'époque carolingienne, dans Th. MARCY (dir.),...
-
Upload
univ-lille -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Les monnaies de Bourlon : un contexte monétaire d'époque carolingienne, dans Th. MARCY (dir.),...
sous la direction de
Thierry Marcy
Coordination Canal Seine-Nord Europejanvier 2014
Canal Seine-Nord Europe, fouille 33, Nord-Pas-de-Calais, Pas-de-Calais, Bourlon
Une implantation rurale du haut Moyen-Age au lieu-dit «La Vallée de Marquion»
Volume II
Can
al S
eine
-Nor
d Eu
rope
foui
lle 3
3ra
ppor
t de
foui
lle
Inrap Canal Seine-Nord Europe16 rue du Général Leclerc, 80 400 Croix-MoligneauxTél. 03 22 37 59 20
janvier 2014
Rap
port
de
foui
lleCo
de IN
SEE
6216
4
Nr s
ite
—En
tité
arch
éolo
giqu
e
—Ar
rêté
de
pres
crip
tion
SRA
1100
4/FO
UILL
E
Syst
ème
d’in
form
atio
n
5613
Code
Inra
p
GB
1591
2401
/
F021
188
par
Thierry Marcysous la direction de
Thierry Marcyavec la collaboration de
Joël BlondiauxFrédéric BroesHugues DoutrelepontJean-Marc DoyenKaï FechnerSalomé GranaiMarie GroussetGuillaume HulinBenjamin JagouChristine KeyserVincent LegrosPierre-Marie LeroyNicole Limondin-LozouetAurore LouisPaul PicavetNicolas SchifauerAnnick ThuetJean-Hervé YvinecNicolas Warme
Canal Seine-Nord Europe, fouille 33, Nord-Pas-de-Calais, Pas-de-Calais, Bourlon
Une implantation rurale du haut Moyen-Age au lieu-dit «La Vallée de Marquion»
Volume IIEtudes
2
Sommaire
Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 33, Nord-Pas-de-Calais, Pas-de-Calais, Bourlon
4 1. Etude pédologique (K. Fechner et F. Broes)
4 1.1 Contexte et questions5 1.2 Méthodes utilisées 5 1.2.1 Méthodes de terrain générales6 1.2.2 Utilisation d’une fiche d’enregistrement systématique des indices pédo-sédimentaires sur le terrain 6 1.2.2.1 Types de structures à aborder par les enregistrements d’indices
6 1.2.2.2 Pourquoi et comment observer les indices pédologiques de manière plus systématique ?
10 1.2.3 L’application de tests de phosphore à la sortie du terrain10 1.2.3.1 Cadre pratique général
10 1.2.3.2 Détails de la démarche
13 1.2.4 Méthodes d’analyse de laboratoire des sols (général)14 1.2.5 Analyses quantitatives du phosphate total14 1.3 Observations de terrain14 1.3.1 Les profils14 1.3.1.1 Introduction
14 1.3.1.2 Le profil LOG 1
17 1.3.1.3 Le profil LOG 2
18 1.3.1.4 Le profil LOG 3
19 1.3.1.5 Le profil LOG 4
21 1.3.1.6 Le profil LOG 5
23 1.3.1.7 Les profils LOG 6-15
26 1.3.1.8 Le profil LOG 16
28 1.3.1.9 Le profil LOG 17
29 1.3.2 Autres phénomènes décrits29 1.3.2.1 Le fond de cabane 2272 : traces d’un plancher ?
30 1.4 Analyses30 1.4.1 Priorités données pour l’étude post-fouille30 1.4.2 Choix des profils LOG 5 et LOG 16-1731 1.4.3 Résultats des analyses granulométriques dans les profils LOG 5 et LOG 16-1731 1.4.3.1 Discussion
32 1.4.3.2 Résultats
32 1.4.4 Confrontation avec les résultats des analyses malacologiques dans les profils LOG 5 et LOG 16-1732 1.5 Tentatives d’interpétration33 1.6 Conclusions et perspectives33 1.6.1 Conclusions33 1.6.2 Perspectives 34 1.7 Annexes
38 2. Rapport d’intervention pédologique : tests de phosphore (F. Broes)
38 2.1 Motivation de l’intervention38 2.2 Cartographie du phosphore sur fonds de cabanes38 2.2.1 Tests de phosphore39 2.2.2 Méthode39 2.2.3 Analyses chiffrées40 2.2.4 Résultats des tests de phosphore40 2.3 Conclusions
42 3. Déterminations taxonomiques (H. Doutrelepont)
42 3.1 Objectif42 3.2 Matériel
I. Données administratives, techniques et scientifiques Sommaire 3
42 3.3 Méthodologie42 3.4 Contamination43 3.5 Remarque
44 4. Etude malacologique des profils P17 et P5 (S. Granai et N. Limondin-Lozouet)
44 4.1. Introduction44 4.2. Méthode49 4.3. Analyse49 4.3.1. Coupe P1749 4.3.2. Coupe P551 4.4. Synthèse 52 4.5. Discussion52 4.6. Conclusion
54 5. Etude micromorphologique (M. Grousset et C. Cammas)
54 5.1 Etude préliminaire : un four, un fond de cabane et une fosse quadrangulaire.54 5.1.1 Matériel et méthode54 5.1.1.1 Matériel
55 5.1.1.2 Approche micromorphologique (d’après Cammas, 2000)
56 5.1.2 Résultats58 5.1.3 Interprétations63 5.1.4 Conclusion64 5.2 Rapport complémentaire : cinq fonds de cabane, un cendrier de four et un silo64 5.2.1 Introduction64 5.2.2 Matériel64 5.2.3 Méthode (d’après Cammas, 2000)64 5.2.3.1 Démarche
65 5.2.3.2 Fabrication des lames minces
65 5.2.4 Résultats66 5.2.3 Interprétations72 5.2.6 Conclusion
73 6. Etude géophysique (G. Hulin)
73 6.1 Introduction à l’étude de paramètres magnétiques73 6.2 Mesure du champ magnétique et calcul de la susceptibilité d’une couche équivalente74 6.3 Résultats
77 7. Etude anthropologique (N. Schifauer)
77 7.1 Introduction77 7.2 Contexte historique et archéologique79 7.3 Localisation des faits funéraires80 7.4 Traitement primaire du matériel80 7.5 Protocole méthodologique et résultats80 7.5.1 Les gestes funéraires84 7.5.2 L’évaluation de l’état de conservation88 7.5.3 L’estimation de l’âge88 7.5.3.1 Les individus de moins de 20 ans*
89 7.5.3.2 Les individus de 20 ans et plus
90 7.5.4 La détermination du sexe91 7.5.5 Le recrutement funéraire92 7.5.6 Les variations antomiques non métriques93 7.5.7 Etat sanitaire93 7.6 Organisation et fonctionnement de l’espace funéraire
4 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 33, Nord-Pas-de-Calais, Pas-de-Calais, Bourlon
93 .6.1 Des faits funéraires chronologiquement cohérents95 7.6.2 Des pratiques différentes selon la localisation des sépultures ?96 7.6.3 Une volonté commune de regrouper ?96 7.6.4 Une localisation des sépultures différente selon l’âge ?97 7.7 Conclusion99 7.8 Catalogue des sépultures et des restes osseux humains99 7.7.1 Structure n°1077 99 Localisation99 Contexte de découverte99 Les restes osseux100 7.7.2 Structure n°1115 101 7.7.3 Structure n°1196 104 7.7.4 Structure n°1232 105 7.7.5 Structure n°1298 107 7.7.6 Structure n°1340109 7.7.7 Structure N°1443 110 7.7.8 Structure n°1537115 7.7.9 Structure n°1566117 7.7.10 Structure n°2268 119 7.7.11 Structure n°2269122 7.7.12 Structure n°2270 125 7.7.13 Structure n°2272 128 7.7.14 Structure n°2360 134 7.7.15 Structure n°2362 136 7.7.16 Structure n°2363 139 7.7.16 Structure n°2364 142 7.7.17 Structure n°2365 146 7.7.18 Structure n°2367 149 7.7.19 Structure n°2475 152 7.7.20 Structure n°2490 155 7.7.21 Structure n°2533 157 7.7.22 Structure n°2534 160 7.7.23 Structure n°2535 163 7.7.24 Structure n°2536 165 7.7.25 Structure n°2537
173 8. Etude paléopathologique (J. Blondiaux, CEPN)
173 8.1 Structure 1537, individu 2173 8.2 Structure 2535 (ex 1648_2)174 8.3 Structure 2534 (ex 1648_1)175 8.4 Structure 2269176 8.5 Structure 2270 :177 8.6 Structure n°2360, individu 1 (ex 2360_1)179 8.7 Structure n°2360, individu 2 (ex 2360_2)179 8.8 Structure 2365181 8.9 Structure n°2533 (ex 1857)
182 9. Etude paléogénétique (Pr. C. Keyser, Archéogène-IMLS)
187 10. Etude archéozoologique (J.-H. Yvinec)
187 10.1 Introduction.188 10.2 Présentation des données188 10.2.1 Phase B1 (fin VIe-début VIIe siècle)189 10.2.2 Phase B2 - VIIe siècle.191 10.2.3 Phase B3 (VIIIe siècle)192 10.2.4 Phase B4 (fin VIIIe)
I. Données administratives, techniques et scientifiques Sommaire 5
193 10.2.5 Phase CD (IXe-début Xe siècle) 194 10.3 Analyse des données.194 10.3.1 Évolution chronologique de la part des différentes 194 espèces domestiques.195 10.3.1.1 Comparaison avec Fontaine-Notre-Dame :
198 10.3.1.2.Proportion d’équidés :
201 10.3.1.3 La basse-cour
202 10.3.2 La faune sauvage202 10.3.3 Choix des individus et des morceaux pour les principales espèces domestiques202 10.3.3.1 Choix des individus
203 10.3.3.2 Les bovins
205 10.3.3.3 Le porc
206 10.3.3.4 Les caprinés
208 10.3.4 Des témoignages de boucherie208 10.3.5 Mouton209 10.3.6 Boeuf210 10.3.7 Cheval 210 10.3.8 Porc211 10.3.9 Boeuf et caprinés211 10.4 Synthèse et comparaisons.214 10.5 Conclusion214 10.5.1 L’accroissement de la production de lait et des reproductrices.214 10.5.2 Modification des stratégies d’élevage des caprinés (mouton et chèvre)217 10.6 Petite notice méthodologique.
219 11. Etude céramique (T. Marcy)
219 11.1 Introduction219 11.2 Préambule221 11.2.1 Les caractères morphologiques 222 11.2.2 La décoration226 11.2.3 Synthèse et Conclusion227 11.3 Catalogue
282 12. Etude du mobilier en verre (A. Louis)
282 12.1 Contexte282 12.2 Tri et comptage283 12.3 Critique du corpus283 12.4 Résultats283 12.5 Horizon 1 du site 285 12.6 Horizon 2 du site 286 12.7 Horizon 3 du site : VIIe siècle286 12.7.1 Les récipients 287 12.7.2 Les perles290 12.8 Horizon 4 : IXe-Xe siècles292 12.9 Synthèse
299 13. Etude des objets en matières dures d’origine animale : identification, répartition par catégorie fonctionnelle et par domaine (A. Thuet)
299 13.1. Production - Travail de l’os299 13.2. Produits finis299 13.2.1. Travail textile299 13.2.1.1. Outils, Poinçons, « broches de tisserand »
307 13.1.1.2 Autre outil lié au travail textile
310 13.2 Parure310 13.2.1 Soin des cheveux
6 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 33, Nord-Pas-de-Calais, Pas-de-Calais, Bourlon
310 13.3. Ameublement310 13.3.1. Elément de décoration312 13.4. Indéterminé
316 14. Etude du mobilier métallique (V. Legros)
316 14.1 Présentation du corpus316 14.2 Approche quantitative317 14.3 Approche fonctionnelle318 14.4 Catalogue318 14.4.1 Période antique318 14.4.2 Période fin VIe-VIIe siècle : sépultures318 14.4.2.1 Sépulture 1537
319 14.4.2.2 Sépulture 1648
321 14.4.2.3 Sépulture 2269
321 14.4.3 Période fin VIe-début VIIe siècle (phase B1)323 14.4.4 Période VIIe siècle (phase B2)326 14.4.5 Période VIIIe siècle (phase B3)336 14.4.6 Période du dernier quart du VIIIe siècle (phase B4)338 14.4.7 Période du début IXe siècle (phase C)338 14.4.8 Période des IXe-Xe siècles (phase D)343 14.4.9 Mobilier non phasé
346 15. Les monnaies de Bourlon : un contexte monétaire d’époque carolingienne
346 (J.-M. Doyen)
346 15.1 Etude 346 15.1.1 Structure de la phase A346 15.1.2 Structures d’époque mérovingienne tardive ou carolingienne349 15.2 Catalogue349 15.2.1 St 1092349 15.2.2 St 1111349 15.2.3 St 1342350 15.2.4 St 1518350 15.2.5 St 1913350 15.2.6 St 2428 (à l’intérieur de 2429)350 15.2.7 Zone d’inhumation : décapage.
351 16. Une meule rotative à Bourlon (P. Picavet)
351 16.1. Le calcaire gréseux à glauconie et rares nummulites352 16.2. Morphologie352 16.3 Contexte et usage
353 17. Etude paléométallurgique (B. Jagou et P.-M. Leroy)
353 17.1 Introduction353 17.2 Méthodologie353 17.2.1 Méthodologie de terrain353 17.2.2 Méthodologie en post-fouille353 17.3 Inventaire général354 17.3.1 Les scories en culot354 17.3.1.1 Les culots en scorie gris dense (SGD) (fig.4)
355 17.3.1.2 Les culots en scorie ferreuse rouillée (SFR) (fig.5)
356 17.3.1.3 Les culots en scorie argilo-sableuse (SAS) (fig.6)
357 17.3.1.4 Les culots en scorie mixte (SM) (fig.7)
358 17.3.1.5 L’orientation des culots
I. Données administratives, techniques et scientifiques Sommaire 7
359 17.3.1.6 Etude métrologique
360 17.3.2 Les déchets de production360 17.3.2.1 Fragments de scorie écoulée (fig.11)
360 17.3.2.2 Les coulures de scorie écoulée (fig.12)
361 17.3.2.3 Fragments de minerai de fer (fig.13)
361 17.3.3 Les éléments liés au foyer361 17.3.3.1 Les parois de foyer (fig.14)
362 17.3.3.2 Les parois de fourneaux (fig.15)
362 17.3.3.3 Eléments de terre-cuite
362 17.3.4 Les éléments oxydés363 17.3.4.1 Les éléments oxydés en « tige »
363 17.3.4.2 Les éléments oxydés en « nodule »
363 17.3.4.3 Les éléments oxydés en « plaque »
363 17.3.5 Les scories informes363 17.4 Les structures métallurgiques363 17.4.1 Le fond de cabane 1498366 17.4.2 Le fond de cabane 1737367 17.4.3 La fosse 1106368 17.4.4 Les autres structures369 17.5 Interprétations369 17.5.1 Les phases de la chaîne opératoire sur le site369 17.5.1.1 Une possible production de fer brut ?
369 17.5.1.2 Un travail du fer en forge
370 17.5.2 L’organisation et la chronologie de l’activité370 17.5.2.1 L’organisation de l’activité à Bourlon
372 17.5.2.2 La chronologie de l’activité
372 17.6 Conclusion
374 18. Etude archéomagnétique de trois fours à usage culinaire (N. Warme)
374 18.1 Principes généraux d’une datation archéomagnétique375 18.2 Rappels sur la méthode utilisée375 18.2.1 Remarque générale sur les prélèvements375 18.2.2 Protocole de mesure de l’aimantation des échantillons375 18.2.3 Traitement des données archéomagnétiques 375 18.2.3.1 Calcul de la direction magnétique moyenne
376 18.2.3.2 Calcul de l’intervalle d’âge
376 18.3 Présentation des résultats archéomagnétiques377 18.3.1 Four 1474377 18.3.1.1 Commentaire sur le prélèvement
378 18.3.1.2 Calcul de la direction moyenne
378 18.3.1.3 Datation archéomagnétique de la structure 1414
379 18.3.2 Four 2335379 18.3.2.1 Commentaire sur le prélèvement
380 18.3.2.2 Calcul de la direction moyenne
381 18.3.2.3 Datation archéomagnétique du four 2335
381 18.3.3 Four 2432381 18.3.3.1 Commentaire sur le prélèvement
383 18.3.2 Calcul de la direction moyenne384 18.3.3.3 Datation archéomagnétique du four 2432
386 Bibliographie
396 Liste des illustrations
350 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 33, Nord-Pas-de-Calais, Pas-de-Calais, Bourlon
15. Les monnaies de Bourlon : un contexte monétaire d’époque carolingienne (J.-M. Doyen)1
15.1 Etude
Le petit ensemble de Bourlon2 permet de poser une fois de plus la question du statut véritable du monnayage antique dans les contextes alto-médiévaux et plus particulièrement ceux d’époque carolingienne. Cette problématique, longtemps négligée, semble désormais retenir l’attention des numismates (Cardon 2013).Les fouilles du site rural de Bourlon ont livré sept monnaies, à savoir six antiques (IIIe-IVe s.) et un denier carolingien. Si l’on excepte deux monnaies (n° 6-7), l’une issue d’un contexte sans doute bioturbé (n° 6), l’autre récolté au décapage de la zone funéraire (n° 7), ce sont quatre monnaies antiques qui viennent de quatre ensembles fermés différents, largement dispersés dans l’espace (fig.1)
15.1.1 Structure de la phase A
• La St1092 (monnaie n° 1) est une fosse (ou un silo) qui semble antérieure au VIe s. Elle contenait un nummus fort usé de Constant Ier, émis en 340/341. Si l’on applique le barème fixé il y a quelques années (Doyen 2010, p. 339, tabl. 98), pour des grands bronzes du Haut-Empire il est vrai3, l’indice 6-7 de cette monnaie correspond à une quarantaine d’années de circulation, ce qui nous reporte au plus tôt dans les années 380, mais sans doute beaucoup plus tard puisque la céramique la plus ancienne du site n’est pas antérieure au milieu du VIe s.
15.1.2 Structures d’époque mérovingienne tardive ou carolingienne
• Le fond de cabane St 1111 est daté du VIIIe s. Il a livré un denier fourré (subaeratus) de Sévère Alexandre (n°2), une production illégale copiant un type émis à Rome en 232. L’exemplaire, une âme en cuivre recouverte d’une pellicule d’argent en bonne partie disparue suite à la corrosion, est dans un état de fraîcheur étonnant. La monnaie n’a jamais circulé : elle doit avoir été immobilisée pour une raison ou pour une autre pour réapparaître au VIIIe s.• La fosse St 1518 est datée du IXe s. Elle a livré un nummus (n° 4) émis à Trèves en 337-341, présentant un indice d’usure 2-3, correspondant à une circulation minimale d’une dizaine d’années seulement.• Le trou de poteau St 1913 est non daté. Il a produit un aes 3 d’époque valentinienne (n° 5), moyennement usé : indice 4-5 correspondant à une trentaine d’années de circulation.• La fosse 1342, datée par la céramique de phase D (IXe-début Xe siècle) a livré une monnaie contemporaine de sa phase d’utilisation. Il s’agit d’un denier fragmentaire et brûlé de Louis le Pieux, du type XPISTIANA RELIGIO sans nom d’atelier. Les travaux récents de S. Coupland permettent parfois d’attribuer, sur la base du style, certaines de ces
1. UMR 8164 du CNRS (HALMA-IPEL, Université de Lille 3), CReA-Patrimoine (Université libre de Bruxelles). Je remercie Th. Cardon pour son aide dans la définition des contextes de Champagne-Ardenne.
2. Fouille Inrap du Canal Seine - Nord-Europe, F33, sous la responsabilité de Thierry Marcy.
3. L’application de ce barème aux monnaies médiévales ou modernes est plus délicat : voir à ce propos Cardon & Doyen 2012, p. 26.
351II. Résultats 15. Les monnaies de Bourlon : un contexte monétaire d’époque carolingienne (J.-M. Doyen)
Fig.1 Répartition spatiale des monnaies
1111
1342
1518
1092
2428
1913
Mise au jour lors du décapage
707850 707900 707950
7010
450
7010
500
7010
550
7010
600
0 50m
CANAL SEINE-NORD EUROPE
Bourlon (62)R.O. : Thierry Marcy
Patriarche 5613GB15912401/F021188
Topographe : A. BoloD.A.O. : C. Font
Ech.
RGF 93 - Levé ST
Fouille 33
1:1 000
vnfvoies
de Francenavigables
Croix-Moligneaux
Localisation des découvertesde monnaies
Autre fait
352 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 33, Nord-Pas-de-Calais, Pas-de-Calais, Bourlon
monnaies. Ce n’est malheureusement pas le cas pour l’exemplaire de Bourlon4. Son état d’usure quasi nul montre qu’il n’a circulé que peu de temps, quelques années tout au plus. Le terminus post quem de la fosse doit donc être fixé aux années 830. Les deniers carolingiens sont réformés en 822, avec un passage au 1/264ème de la livre, soit 1,55 g (Depeyrot 2008, p. 22-23). Les changements métrologiques intervenant au Xe s. interdisent de prolonger la durée de vie des deniers carolingiens au delà du milieu du IXe s. • Les deux monnaies hors-contexte sont deux petits bronzes tardo-romains. L’un (n° 6) a été émis entre 355 et 360, mais il est fort usé. Le second (n° 7) est une imitation gauloise au nom de Tétricus II (271-274), frappée sans doute vers 280-320. Ces productions extrêmement abondantes sont toujours fréquentes dans les niveaux du Ve s.
L’ensemble de Bourlon semble montrer un usage effectif de la monnaie en milieu rural non funéraire. De plus, l’absence d’occupation tardoromaine classique à cet endroit interdit d’y voir systématiquement du matériel en position secondaire5. Les sites romains les plus proches, une nécropole et deux villae, sont situés à plus d’un kilomètre.
Le denier de Louis le Pieux est la seule espèce récente mais sa présence est déjà remarquable en soi. En effet, une étude encore inédite relève seulement 11 sites de Champagne-Ardenne, sur 51 occupés du Ve au XIIe s., à avoir livré des monnaies (Cardon, à paraître). Sur ces 11 habitats, 5 seulement ont livré du numéraire carolingien.
Selon Th. Cardon, « l’étude des – rares – monnaies en contextes archéologiques pourrait permettre d’esquisser des pistes d’étude. Trois visions différentes, mais dont la complémentarité ne fait pas de doute, sont mises en avant dans les récents travaux. Deux visions proprement économiques : pour l’une la fonction économique de la monnaie serait essentiellement fiscale et aurait pour but de faciliter les prélèvements, pour l’autre la monnaie serait un réel outil des échanges interpersonnels ou intercommunautaires, témoignant par là d’une véritable monétarisation de la société rurale (Metcalf 2006, p. 342-343 ; Moesgaard 2005). La troisième vision est tirée des approches anthropologiques de la monnaie, notamment par l’étude à la fois des sociétés contemporaines (Zelizer 2005) et des sociétés utilisant des paléo-monnaies (Servet 2012) : les monnaies, et surtout les usages qui en sont fait, auraient pour fonction de marquer et de reproduire des relations sociales, notamment des relations d’alliance ou de domination ».
Dans notre cas, l’usage de très petites dénominations tardo-antiques (module de l’aes 4), de faible valeur6, semble appuyer l’hypothèse d’un usage purement économique. Les contextes de Champagne-Ardenne montrent que le numéraire antique n’y apparaît pas dans la phase ancienne (fin Ve-mi VIIe s.) mais plutôt au cours de la phase suivante (fin VIIIe-Xe s.).La production importante d’oboles d’argent dans la première moitié du VIIIe s. est sans doute l’indication d’un besoin de petites valeurs destinées à un usage journalier de la monnaie. Il est en revanche actuellement impossible de mettre en relation un statut social ou une activité économique spécifique en corrélation avec la présence du numéraire, qu’il soit résiduel (romain) ou contemporain (carolingien).
4. Je remercie Jens-Christian Moesgaard (Copenhague) et S. Coupland pour leur aide dans le classement de cette monnaie.
5. Notons cependant la présence d’éléments tardo-antiques ou d’époque mérovingienne classique à proximité, comme de la céramique par exemple qui fournit un nombre assez important de tessons résiduels laissant apparaitre la possibilité d’une occupation préalable à proximité mais hors de l’emprise du chantier actuel, peut être dès le Vème siècle.
6. Sauf en ce qui concerne le denier fourré : si la fraude n’avait pas été relevée, cette pièce pouvait avoir conservé le même pouvoir libératoire que le denier carolingien.
353II. Résultats
15.2 Catalogue
15.2.1 St 1092
1. Constant I, Arles, 340-341. ]/PFAVG Buste [diadémé, cuirassé et drapé] à dr. ]LORI/[ ]EXE[ G/ [ ]ARL Une enseigne entre deux soldats. Nummus : 1,07 g ; 12 ; 15,2 mm; usure 6-7. RIC 57/58 ; FERRANDO 1205-1206.
15.2.2 St 1111
2. Sévère Alexandre, [Rome, 232]. IMPALEXANDERPIVSAVG Buste lauré, cuirassé et drapé à dr., vu de face. ]/RS/V/LTOR Mars casqué, en habit militaire, marchant à dr., tenant une lance pointée vers l’avant et un bouclier rond. Ae argenté : 2,88 g ; 6 ; 19,4 mm ; usure 0-1. Faux denier : prototype BMC 833 (Rome, émission 15, 232).
15.2.3 St 1342 éch. 2 : 1
3. Louis le Pieux, atelier indéterminé, 822-840. ]HLVDOVVI[ Croix pattée, cantonnée de quatre globules. XPIST[ ]LIGIO Croix pattée dans un édifice tétrastyle à fronton triangulaire sommé d’une croix, placé sur deux degrés. Denier (deux fragments jointifs) : [1,05] g ; 9 ; 20,2 mm ; usure 0. Monnaie brûlée. MG 472 et pl. XVII, n° 472 ; MEC 791-808 ; DEPEYROT 1177.
Fig.2 Monnaie de la structure 1092
Fig.3 Monnaie de la structure 1111
Fig.4 Monnaie de la structure 1342
15. Les monnaies de Bourlon : un contexte monétaire d’époque carolingienne (J.-M. Doyen)
354 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 33, Nord-Pas-de-Calais, Pas-de-Calais, Bourlon
15.2.4 St 1518
4. Constantin II auguste, Trèves, 337-341. ]VLCONSTANTIVSAVG Buste (lauré ?), cuirassé (et drapé ?) à dr. ]AEXER/CI[ ]V[ -/-/[ ]TRS[ Une enseigne entre deux soldats. Nummus : 1,18 g ; 11h30 ; 13,4 mm ; usure 2-3.
15.2.5 St 1913
5. Empereur indéterminé, Lyon ou Arles, 364-375. Légende illisible. Buste diadémé (perles), cuirassé et drapé à dr. GLORIARO/[ O/F/II//[ ] L’empereur en habit militaire marchant à dr., la tête à g., traînant un captif et tenant un labarum. Aes 3 : 2,27 g ; 6/7 ; 16,5 mm ; usure 4/5 (forte corrosion). Avers : buste de petites dimensions.
15.2.6 St 2428 (à l’intérieur de 2429) éch. 2 : 1
6. Imitation de Fel Temp Reparatio (type «au cavalier tombant»). Légende hors-flan. Buste diadémé [cuirassé et drapé] à dr. ]MY Virtus debout à g., en habit militaire, perçant de sa lance un ennemi tombé de son cheval. Ae : 0,42 g ; 1 ; 8,9 mm ; usure 6-7.
15.2.7 Zone d’inhumation : décapage.
7. Tétricus II : imitation. Légende illisible. Buste imberbe, radié et drapé à dr., vu de dos.D2[ (sic !) Personnification debout à g. tenant une patère (disque fermé) et un sceptre vertical. Ae : 1,04 g ; 12 ; 10,8 x 12,9 mm ; usure 2-3. Classe 3.
Fig.5 Monnaie de la structure 1518
Fig.6 Monnaie de la structure 1913
Fig.7 Monnaie de la structure 2428
Fig.8 Monnaie de la zone d’inhumation lors du décapage
397II. Résultats
Monique Mergoil, 2003, p. 101-108.
Isings C. 1957, Roman Glass from Dated Finds, Groningen-Djakarta.
Legoux R., Périn P., Vallet F. 2004 : «Chronologie normalisée du mobilier funéraire mérovingien entre Manche et Lorraine», in Bull. liaison AFAM, H.S., 62 p.
Louis A. à paraître : « Les récipients en verre des inhumations de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Age en Picardie (France) », Actes du 19e congrès international de l’AIHV, 17-21 septembre 2012, Piran (Slovénie).
Louis A. 2011, « Le mobilier en verre » in Marchaisseau 2011.
Louis E. 2004, Cantin « Rue du Château » (Nord), Rapport de fouilles préventives, Service archéologique du Douaisis, 70 p.
Macquet 1990 : Macquet C., «Les Lissoirs de verre, approche technique et bibliographique», dans Archéologie médiévale, t. XX, CNRS, p. 319-334.
Marchaisseau V. 2011, Pont-sur-Seine « La Gravière » (Aube), Rapport de fouilles archéologiques préventives, Inrap GEN, Saint-Martin-sur-le-Pré, 2011.
Maul 2002 : Maul B. Frühmittelalterliche Gläser des 5.-7./8. Jahrhunderts n. Chr. – Sturzbecher, glockenförmigen Becher, Tummler und Glockentummler, Verlag Dr. Rudolph Habelt GMBH, Bonn, 2 Bände.
Michel K. 2012, « Les lissoirs en verre du site de Nubécourt « Aux Villées » (Meuse) et en région Lorraine », in Arveiller, Cabart 2012, pp. 269-278.
Munier C. 2009, « Nevers, 12 rue Saint-Genest : étude du verre médiéval (VIIe, IXe-XIIe siècles), in Bull. AFAV, pp. 59-70.
Nice A. 1998, “La nécropole
mérovingienne de Goudelancourt-les-Pierrepont (Aisne) », in Actes des VIIIe journées internationales d’archéologie mérovingienne de Soissons (19-22 juin 1986), RAP n°3-4, pp. 127-143.
Etude de la tabletterie
Chandevau 2001 : CHANDEVAU (F.).- La tabletterie et les petits artéfacts de la motte castrale de Boves – Xè-XVIè siècles, mémoire de maîtrise dactylographié, sous la direction de G. Jehel et Ph. Racinet, Université de Picardie Jules Verne, Amiens.
Chandevau 2002 : CHANDEVAU (F.).- La motte castrale de Boves (Somme), Tabletterie et petits artéfacts (Xè-XVIè siècles), Revue Archéologique de Picardie, n° 1-2, 2002.
Couanon, Forfait 1991 : COUANON (P.), FORFAIT (N.).- Les Gaudines, Vieux (Calvados), Synthèse provisoire, Janvier 1991. Fouilles de sauvetage programmé 1988-1990. Conseil Général du Calvados, Circonscription des antiquités de Basse-Normandie.
Goret 1997 : GORET (J.-F.).- Le mobilier osseux travaillé découvert sur le site du «Vieux Château » de Château-Thierry (Aisne). IXè-XIIè Siècles. Revue Archéologique de Picardie N° 3-4, 1997, p. 101-136.
Goret 2011 : GORET (J.-F.).- Mobilier en matière dure d’origine animale, in Martin (J.-F.) dir. Le site de « Jeoffrécourt » à Sissonne (Aisne). Cimetière et unités domestiques du VIè au IXè siècle après J.-C. Revue Archéologique de Picardie, n° 1-2 – 2011. Petitjean 1995 : PETITJEAN (M.).- Les peignes en os à l’époque mérovingienne : évolution depuis l’Antiquité tardive. Antiquités Nationales, 1995.
Stopp and Kunst 2005: STOPP (B.), KUNST (G.K.) : Sledge runners made of cattle mandibles?
– Evidence for jawbone sledges from the Late Iron Age and the Roman Period in Switzerland and Austria. In : From Hooves to Horns, from Mollusc to Mammoth – Manufacture and Use of Bone Artefacts from Prehistoric Times to the Present – Proceedings of the 4th Meeting of the ICAZ Worked Bone Research Group at Tallinn, 26th–31st of August 2003.
Etude numismatique
BMCR.A.G. CARSON, Coins of the Roman Empire in the British Museum.Volume VI. Severus Alexander to Balbinus and Pupienus, Londres, 1962, 311 p., 47 pl.
CARDON 2013Th. Cardon, « Habitat rural du haut-Moyen Age en Champagne-Ardenne, approche numismatique », in Marie-Cécile Truc et Arnaud Rémy (resp.), Archéologie de l’habitat rural du haut Moyen Âge en Champagne-Ardenne (fin Ve-XIIe siècle), Projet d’activité scientifique, rapport d’activité 2013, Inrap Grand Est-Nord.
CARDON & DOYEN 2012Th. CARDON & J.-M. DOYEN, Les monnaies médiévales et modernes des « Bons-Villers » à Liberchies (Pont-à-Celles, Hainaut, B.) : étude quantitative et contextuelle, dans J.-M. DOYEN & J. MOENS (ed.), Monnaies de sites et trésors de l’Antiquité aux Temps Modernes. Volume I, Bruxelles, 2012 (DCEN 3), p. 16-41.
DEPEYROTG. DEPEYROT, Le numéraire carolingien. Corpus des monnaies. Troisième édition augmentée, Wetteren, 2008 (Collection Moneta 77), 496 p.
DOYEN 2010J.-M. DOYEN, avec la coll. de X. DERU, B. DUCHÊNE, S. FEROOZ, A. FOSSION,
Bibliographie
398 Inrap · Rapport de fouille Canal Seine-Nord Europe, fouille 33, Nord-Pas-de-Calais, Pas-de-Calais, Bourlon
B. GRATUZE, S. NIETO-PELLETIER et Ph. ROLLET, Les monnaies du sanctuaire celtique et de l’agglomération romaine de Ville-sur-Lumes / Saint-Laurent (dép. des Ardennes, France), Wetteren – Charleville-Mézières, 2010 (Collection Moneta, 106), 408 p., 33 pl.
FERRANDOPh. FERRANDO, L’atelier monétaire d’Arles de Constantin le Grand à Romulus Augustule 313-476, Arles, 2011, 398 p.
MGK.F. MORRISON & H. GRUNTHAL, Carolingian coinage, New York, 1967 (Numismatic Notes and Monographs 158), 465 p., XLVIII pl.
MECPh. GRIERSON & M. BLACKBURN, Medieval European Coinage. 1. The Early Middle Ages (5th-10th centuries), Cambridge, 1986, 674 p., 65 pl.
METCALF 2006M. METCALF, Monetary circulation in merovingian Gaul, 561-674, Revue Numismatique, 2006, p. 337-393.
MOESGAARD 2005J.-C. MOESGAARD, Monnaies à la campagne au Moyen Âge, remarques de méthode, dans J. LEFORT, C. MORRISSON, J.-P. SODINI (éd), Les Villages dans l’Empire byzantin IVe-XVe siècle, Paris, 2005, p. 135-148.
RICJ.P.C. KENT, The Roman Imperial Coinage. Volume VIII. The Family of Constantine A.D. 337-364, Londres, 1981, 605 p., 28 pl.
SERVET 2012J.-M. SERVET, Les monnaies du lien, Presses Universitaires de Lyon, 2012, 454 p.
ZELIZER 2005V. ZELIZER, La signification
sociale de l’argent, Paris, 2005, 348 p.
Etude des meules
BUCHSENSCHUTZ et al. 2011 : BUCHSENSCHUTZ O., JACCOTTEY L, BLANCHARD J.-L. (dir.), Évolution typologique et technique des meules du Néolithique à l’an mille sur le territoire français, actes des IIIe rencontres de l’Archéosite gaulois, Bordeaux, 2011, 479 p. (Aquitania, suppl., 23)
CHAUSSAT 2011 : CHAUSSAT A.-G., « Les œils des meta à partir de la base de données du Groupe Meule », dans BUCHSENSCHUTZ et al. (dir.) 2011, p. 359-366.
JACCOTTEY et al. 2011 : JACCOTTEY L., JODRY F., LONGEPIERRE S., ROBIN B., « Chronologie et diamètres des meules à bras à la fin de La Tène et à l’époque antique », dans BUCHSENSCHUTZ et al. (dir.) 2011, p. 291-298.
JACCOTTEY, FARGET 2011 : JACCOTTEY L., FARGET V., « Les normes de dessin des meules rotatives », dans BUCHSENSCHUTZ et al. (dir.) 2011, p. 51-68.
PICAVET 2011 : PICAVET P., « Les meules romaines de sept chefs-lieux de cité de Gaule Belgique occidentale, étude du matériel et synthèse bibliographique », Revue du Nord, 93 (393), 2011 (parution 2012), p. 167-226.
POMEROL 1984 : POMEROL C., avec la collaboration de BOUREAUX M., BOURNERIAS M., DORIGNY A., MAUCORPS J., SOLAU J.-L., VATINEL M., Soissons, Orléans, 1984, 46 p. (Notice de la Carte géologique de la France au 1/50000, 106)
ROBERT, LANDREAT 2005 : ROBERT B., LANDREAT J.-L.,
« Les meules rotatives en calcaire à glauconie grossière et l’atelier de Vauxrezis (Aisne). Un état de la question », dans AUXIETTE G., MALRAIN Fr., Hommage à Claudine Pommepuy, Amiens, 2005, p. 105-114. (Revue Archéologique de Picardie, n° spé. 22)
Etude paléométallurgiste
ANDERSON 2004 : Anderson, Timothy, Clara Agustoni, Anika Duvauchelle, et Vincent Serneels. Des artisans à la campagne: carrière de meules, forge et voie gallo-romaines à Châbles (FR). 1 vol. Archéologie fribourgeoise, 19. Fribourg: Academic Press Fribourg, 2003.
DAVEAU 2000 : DAVEAU I., GOUSTARD V., « Un complexe métallurgique et minier du haut Moyen Âge, le site des fourneaux à Vert-Saint-Denis », Gallia, 57, CNRS, Paris, 2000, p. 77-99.
DUNIKOWSKI 1996 : Dunikowski, Christophe, Marc Leroy, et Paul Merluzzo. « L’atelier de forge Gallo-Romain de Nailly (Yonne): Contribution à l’étude des déchets de production ». Revue Archéologique de l’Est, no. 47 (1996): 97–121.
ESCHENLOHR 2007 : Eschenlohr, Ludwig, Vincent Friedli, et Céline Robert-Charrue Linder. Develier-Courtételle, un habitat rural mérovingien. 2, Métallurgie du fer et mobilier métallique. Vol. 2. 1 vol. Cahier d’archéologie jurassienne 14. Porrentruy: Office de la culture: Société jurassienne d’émulation, 2007.
JAGOU 2008 : JAGOU B., La production de fer en Île-de-France à la période médiévale, mémoire de Master 1, Université Paris 1, 2008, 100p.
LE CARLIER 2007 : Le Carlier, Cécile, Marc Leroy, et Paul Merluzzo. « L’apport de l’analyse