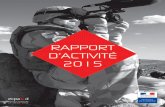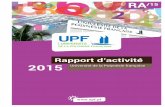2013 - Cuciurpula (2A) - Rapport de fouille programmée
-
Upload
museu-altarocca -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of 2013 - Cuciurpula (2A) - Rapport de fouille programmée
Opération réalisée avec le concours de la Collectivité Territoriale de Corse, le Service Régional de l’Archéologie, l’associu Cuciurpula et la municipalité de Serra-di-Scopamena
CUCIURPULA
COMMUNES DE SERRA-DI-SCOPAMENE ET DE SORBOLLANO (CORSE-DU-SUD)
RAPPORT DE FOUILLE TRIANNUELLE Premier Rapport Intermédiaire
2013
Sous la direction de
Kewin PECHE-QUILIC HINI, Simon DELVA UX, Thibault LACHENAL et Matteo MILLETT I
et la collaboration de
Charlène DELEFOSSE, Lucie MARTIN et Vanessa PY
DDDDirection irection irection irection RRRRégionale des égionale des égionale des égionale des AAAAffaires ffaires ffaires ffaires CCCCulturellesulturellesulturellesulturelles
SSSService ervice ervice ervice RRRRégional de L’égional de L’égional de L’égional de L’ArchéologieArchéologieArchéologieArchéologie Università di Roma «Università di Roma «Università di Roma «Università di Roma « La SaLa SaLa SaLa Sapienzapienzapienzapienza »»»»
Dipartimento di Scienze Storiche Archeologiche e AntropoDipartimento di Scienze Storiche Archeologiche e AntropoDipartimento di Scienze Storiche Archeologiche e AntropoDipartimento di Scienze Storiche Archeologiche e Antropologiche dell’Antichitàlogiche dell’Antichitàlogiche dell’Antichitàlogiche dell’Antichità 2012012012013333
1
CUCIURPULA
COMMUNES DE SERRA-DI-SCOPAMENE ET DE SORBOLLANO (CORSE-DU-SUD)
RAPPORT DE FOUILLE TRIANNUELLE
Premier Rapport Intermédiaire
2013
Sous la direction de
Kewin PECHE-QUILICHINI, Simon DELVAUX, Thibault LACHENAL et Matteo MILLETTI
et la collaboration de
Charlène DELEFOSSE, Lucie MARTIN et Vanessa PY
Direction Régionale des Affaires Culturelles Service Régional de l’Archéologie
Università di Roma « La Sapienza » Dipartimento di Scienze dell’Antichità
4
FICHE SIGNALETIQUE
Identité du site Département : Corse-du-Sud (2A) Commune : Sorbollano Code INSEE : 2A285(0012) Localisation : Punta di a Cuciurpula PATRIARCHE : 4555 Cadastre : Section A (1937) Parcelles : 1 et 2 Coordonnées Lambert IV (centrales) : X : 563,330 Y : 4163,420 Z : 1020 m NGF Propriétaire du terrain : Municipalité de Serra-di-Scopamène (Corse-du-Sud) Opération archéologique N° de dossier PATRIARCHE : à définir Nom donné à l’opération : Cuciurpula Arrêté préfectoral n° : SRA/2012/264 Titulaire : Kewin Peche-Quilichini Organisme de rattachement : LAMPEA (UMR 7269) Type d’intervention : fouille programmée triannuelle Surface fouillée : environ 40 m² (structures 3 et 38) Dates d’intervention : du 25/08/2013 au 15/09/2013 Résultats Mots-clés :
- Chronologie : Bronze final, âge du Fer - Nature des vestiges immobiliers : habitations, murs, terrassements, sols, trous de poteaux, abris sépulcraux, réseau viaire - Nature des vestiges mobiliers : céramique, métal (bronze et fer), industrie lithique, faune, charbon de bois, verre
Lieu de dépôt temporaire du mobilier archéologique : Mairie de Serra-di-Scopamène, 20127 Serra-di-Scopamène Lieu de dépôt définitif du mobilier archéologique :
Musée Départemental de Préhistoire Corse, Dépôt de fouille, Rue Croce, 20100 Sartène (à certifier)
5
REMERCIEMENTS Nous tenons à remercier : La mairie de Serra-di-Scopamène, en particulier M. le maire Jean-Paul Rocca Serra, et Dominique Rocca-Serra, pour avoir très largement contribué à la réussite de l’opération au niveau matériel, logistique et humain. Dominique Martinetti, pour sa participation active à tous les niveaux de l’opération. Le Poznán Radiocarbon Laboratory, et en particulier le professeur Tomász Goslar, pour la rapidité de la prise en compte des échantillons du site. L’association Cuciurpula, le S.R.A. de Corse, la Collectivité Territoriale de Corse, la Communauté de Communes de l’Alta Rocca, le musée de l’Alta Rocca et le musée de Préhistoire de Sartène pour leur soutien moral, logistique et matériel.
6
EQUIPE DE RECHERCHE
Direction Kewin PECHE-QUILICHINI – Docteur en Archéologie protohistorique, UMR 7269 Aix-en-Provence ; post-doctorant, UMR 5140 Lattes
- organisation, gestion, coordination et direction des travaux - étude céramologique - relevés et DAO
Simon DELVAUX – Doctorant en Égyptologie, UMR 5140 Montpellier 3 Paul-Valéry
- étude des paléo-circulations Thibault LACHENAL – Chargé de recherches, UMR 5140 Lattes
- co-direction des travaux - relevés et DAO
Matteo MILLETTI – Docteur en Archéologie protohistorique, Université de Rome I
- co-direction des travaux - étude du mobilier métallique
Etudes et travaux spécifiques Laurent BERGEROT – Ingénieur d’études, UMR 3495 Marseille
- imagerie Elisa BIANCIFIORI – Doctorante en Archéologie protohistorique, Université de Rome I
- théodolite - relevés et DAO
Pierre COMITI – Docteur en Archéologie protohistorique, UMR 7298 Aix-en-Provence
- étude des scories Charlène DELEFOSSE – Master d’Archéologie préhistorique, UMR 7269 Aix-en-Provence
- étude du mobilier lithique pondéral Bernard GRATUZE – Directeur de recherches, UMR 5060 Orléans
- analyse de composition des matériaux vitreux Maryline LAMBERT – Maitrise en Sciences des Matériaux archéologiques, Université de Nottingham
- spectrométrie sur hématite Franck LEANDRI – Conservateur Régional de l’Archéologie, DRAC de Corse
- topographie Lucie MARTIN – Docteur en Archéologie préhistorique, UMR 5204 Chambéry
- détermination carpologique/analyse des macrorestes végétaux Dominique MARTINETTI – Association Cuciurpula
- organisation des travaux - prospection pédestre
Justine MAYCA – Doctorante en Archéologie préhistorique, UMR 7269 Aix-en-Provence
- étude de la faune Vanessa PY – Chargée de recherches, UMR 5602 Toulouse
- détermination anthracologique
7
Maxime RAGEOT – Doctorant en chimie des matériaux archéologiques, UMR 7264
- détermination de la composition des adhésifs utilisés pour la vaisselle céramique par spectrométrie infrarouge, spectrométrie de masse (introduction directe, impact électronique) et chromatographie en phase gazeuse
Martine REGERT – Directeur de Recherches, UMR 7264
- détermination de la composition des adhésifs utilisés pour la vaisselle céramique par spectrométrie infrarouge, spectrométrie de masse (introduction directe, impact électronique) et chromatographie en phase gazeuse
8
EQUIPE DE FOUILLE
Simone AMICI – Master d’étruscologie, Université de Rome (Italie) Mattia BISCHERI – Licence d’archéologie, Université de Rome (Italie) Sonia DJIDEL – Master d’étruscologie, Université de Turin (Italie) Daniel « Renly » DONCARLI – Licence d’archéologie, Université de Lyon Francesca FARRONI GALLO – Licence d’archéologie, Université de Rome (Italie) Alessandra GOBBI – Master d’archéologie, Université de Salerno (Italie) Anne-Laure GREVEY – Licence d’archéologie, Université de Dijon Aurélie GUIGNARD – Licence d’archéologie, Université Aix-Marseille Phoebe Pao Yu HUANG – Doctorante en géologie, Université de Perth (Australie) Andrea LONGO – Master de géographie, Université de Rome (Italie) Annette PALMADE – Passionnée d’archéologie Raphaël « Greyjoy » SUSO – Master d’archéologie protohistorique, Université de Bordeaux Eymerick TOMASINI – Tailleur de pierre Alessandro VOLPI – Master d’étruscologie, Université de Rome (Italie)
Cuciurpula sous la neige, février 2013
10
1. Achèvement des travaux dans et devant la structure 3 1.1 Présentation La structure 3 fait partie des unités domestiques les plus méridionales du site de Cuciurpula. En l’état actuel des prospections, elle marque par ailleurs la limite est du site protohistorique (fig. 41). Elle est implantée sur un replat de faible extension, à une altitude de 960 m, en bordure d’un thalweg constituant un chemin d’accès naturel, aménagé au siècle dernier en sentier muletier. Elle présente également la particularité d’être à faible distance d’une source constituant le point d’eau principal reconnu dans l’enceinte du site, et dont l’aménagement remonte peut-être à des périodes anciennes. Ces deux caractéristiques semblent être également à l’origine de l’installation, à une dizaine de mètres au-dessus de la structure 3, d’une famille de charbonniers entre 1946 et 19591. Les vestiges de leur habitation, de leur four à pain et des cuves de charbonnage en acier y sont d’ailleurs encore visibles. La structure proprement dite, telle qu’elle était visible en surface avant la fouille, mesure 8,80 m de longueur pour 3,70 m de largeur maximale (fig. 1). Elle est constituée de 9 blocs principaux placés de champs et présentant une face d’éclatement disposée vers l’intérieur, comme c’est le cas pour la plupart des structures d’habitats recensées sur le site. Elle s’en distingue cependant par l’emploi de pierres de dimensions plus importantes. Les longs côtés sont parallèles. Ils se rejoignent au sud dans une abside formée par quatre blocs, parmi lesquels une dalle de chevet dont la hauteur supère toutes les autres. L’ensemble de la couronne de pierre délimite un espace interne d’un peu plus de 12 m², ce qui est relativement réduit par rapport à l’habitation 1. Cependant, au nord de la structure, on remarque un espace libre d’une quarantaine de mètres carrés délimité au nord par des blocs de substrats, disposés en arc de cercle, ayant peut-être fait l’objet d’un aménagement, ou d’un déplacement volontaire (fig. 2).
Figure 1 – Prise de vue générale de la structure 3 pendant la fouille de 2013
1 D’après une enquête orale réalisée au village de Serra-di-Scopamène (Peche-Quilichini et Lachenal, 2008, p. 19).
11
1.2 Problématiques Les objectifs de l’intervention sur cette structure s’inscrivent dans la poursuite de la caractérisation des espaces domestiques protohistoriques sur le site de Cuciurpula, conjointement à la recherche d’éléments de datation permettent de compléter la chronotypologie du site en particulier et du faciès de Nuciaresa de façon plus générale. Il s’agissait également de tester le modèle architectural élaboré à partir de la fouille de la structure 1, de contrôler la contemporanéité des habitations reconnues en prospection sur le site et d’apporter des éléments de réflexion quant à la compréhension du développement spatial du village, ainsi qu’à son organisation fonctionnelle. Cette structure a été choisie en raison de la bonne conservation de sa couronne mégalithique et de sa position topographique, sur un replat, laissant présager une préservation satisfaisante de son remplissage sédimentaire et des vestiges associés. 1.3 Méthodologie et historique de l’intervention En préalable, un carroyage d’1 m2 a été mis en place sur la zone de fouille afin de faciliter l’enregistrement des vestiges. Tous les travaux ont été réalisés manuellement à l’aide de matériel léger (truelle, grattoir, etc.). Des tests de tamisage des déblais réalisés lors des premiers jours de l’intervention (maille de 5 mm) n’ont pas fourni de résultats significatifs justifiant le maintien de cette pratique. Des prélèvements de sédiments ont cependant été effectués afin d’y rechercher la présence de macrorestes végétaux. Les objets supérieurs à 2 cm de longueur ont été côtés en trois dimensions, le mobilier de taille inférieur a été enregistré par unité stratigraphique et mètre carré. Enfin, les structurations observées ont fait l’objet de relevés en plan à l’échelle 1/20 ou 1/10 et de couvertures photographiques. Dans un premier temps, un sondage de 4 m² a été ouvert au centre de la structure, à l’emplacement des carrés G-H/7-8. L’objectif était de garantir la conservation des niveaux archéologiques, de vérifier la datation de la structure et de disposer d’une première stratigraphie des remplissages, permettant un meilleur contrôle lors de la fouille planimétrique des unités sédimentaires. Lors de la campagne de 2011, la partie interne de la structure, délimitée par les blocs, a été fouillée par décapages successifs, visant à appréhender l’organisation interne des vestiges. La travée 6 avait toutefois été préservée, afin de disposer d’un profil longitudinal complet du remplissage de la structure. L’opération de 2012 avait consisté en l’achèvement de la fouille de l’espace interne de la structure et en la poursuite du dégagement de l’aménagement de l’entrée par l’ouverture d’une nouvelle fenêtre de 4 m² dans les carrés E-F/7-8, au nord du sondage. La campagne de 2013, qui s’est déroulée sur trois semaines, du 26 août au 14 septembre, avait comme objectif d’achever la caractérisation du système d’entrée de l’habitation au nord. Pour cela, une zone de fouille de 16 m² a été ouverte en avant de la structure (Figure 2). En fin de campagne, l’ensemble des différentes zones de fouilles a été rebouché, mais de façon à laisser les structures architecturales visibles (Figure 40).
13
1.4 Résumé des travaux antérieurs - Stratigraphie générale Le sondage avait permis de caractériser la stratigraphie générale de la structure (Figure 3), laquelle s’est confirmée lors des opérations ultérieures (fig. 4-6). Ainsi on distingue, de haut en bas : US 400 : Sol actuel. US 401 : Couche superficielle d’humus, limon argileux brun-sombre d’une épaisseur de 2 cm. US 402a : Limon sableux brun clair tirant vers le jaune, plus foncé dans les zones remaniées par les souches. Rares inclusions granitiques millimétriques et centimétriques, racines fréquentes, pores de taille moyenne fréquents et rares charbons de bois. Cette unité stratigraphique d’une épaisseur de 7 cm contient du mobilier protohistorique roulé. US 406 : Il s’agit d’un niveau de sol localisé à la base de l’US 402a et au sommet de l’US 402b, matérialisé par un épandage de céramiques et de pierres de moyen module posées à plat. Une des dalles de la couronne périphérique (US 407) s’était d’ailleurs effondrée sur ce niveau (carrés L/8-9). US 402b : Limon sableux brun-moyen, de même composition sédimentaire que l’US 402a. Les racines y sont également très fréquentes. D’une épaisseur de 10 à 30 cm, cette couche a livré du mobilier protohistorique mieux conservé que dans la couche supérieure, souvent retrouvé à plat, bien que les souches en aient majoritairement perturbé la disposition. US 405 : Limon brun foncé friable contenant des inclusions granitiques plus fréquentes que dans les unités supérieures, vraisemblablement issues de l’érosion du substratum. Les racines y sont également fréquentes et on compte de rares charbons de bois. Elle repose sur un niveau d’arène provenant du substrat.
Figure 3 – Structure 3 : coupe stratigraphique du sondage, profil est-ouest
14
Figure 4 - coupe stratigraphique de la structure 3, profil sud-nord
Figure 5 - coupe stratigraphique au nord de la structure 3, profil ouest-est
15
Figure 6 - coupe stratigraphique à l’est de la structure 3, profil sud-nord
- Données architecturales La structure 3 se matérialise dans sa partie sud par un ensemble de dix-huit blocs (US 407), dont la plupart ont été disposés avec leur face d’éclatement naturellement plane vers l’intérieur, comme c’est la norme sur de nombreux habitats protohistoriques de l’Alta Rocca (Lanfranchi et Alessandri, 2013 ; Peche-Quilichini et al., 2013). Ces dalles ont vraisemblablement été placées dans des tranchées de fondation réalisées au dépend de l’US 405, comme l’indique la découverte de pierres de calage. Au nord de la structure, au niveau de son entrée, la file est des blocs de l’US 407 est renforcée à l’intérieur par un système plus complexe à double parement et blocage interne (US 404), reposant sur le sommet de l’US 405. Cette structuration permet de conserver la rectitude du côté est de l’habitation tout en réduisant l’espace d’accès à la structure au nord. La découverte d’un foyer à proximité lors
16
des fouilles de 2013 (FY 433) laisse également penser que cette structuration pouvait servir de banquette. Dans la partie est de la structure (carrés K-J/6-7), la fouille de l’US 402b a mis au jour une accumulation de pierres de moyen modules qui reposent sur le sommet de l’US 405, pouvant être interprété comme les ruines d’un système de renfort similaire à l’US 404 (US 408). Non loin de ces vestiges, une fosse (US 410) était creusée dans l’US 405 et recouverte d’un bloc rectangulaire. Elle contenait les fragments d’un vase presque entièrement conservé, mais sa fonction (stockage, rejet) reste obscure. Au centre de la structure 3, une rangée de 5 trous de poteaux (TP 414, 418, 420, 422 et 424) matérialise l’axe qui soutenait la poutre faîtière du toit de l’habitation. Celui-ci accuse une forme étonnamment oblique par rapport aux murs latéraux, mais qui se positionne dans l’axe de l’entrée supposée de l’habitation. Les travaux de 2013 - Stratigraphie La poursuite des travaux au nord au niveau de l’entrée a permis de confirmer la succession stratigraphique identifiée précédemment pour l’intérieur de l’habitation. A l’extérieur de celle-ci, les unités supérieures (US 401, 402a et 402b) se sont révélées identiques. En revanche, la base de la séquence se distingue par une couche différente de l’US 405 (fig. 4-6) : US 425 : limon brun tendant vers le rouge, riche en inclusions de quartz, mise en évidence dans les carrés C-F/9-11 et en C/7-8. Cette couche d’une vingtaine de centimètres d’épaisseur repose sur le substrat et en épouse le pendage E-O. Légèrement plus graveleuse, et surtout plus rougeâtre que l’US 405, on peut suivre une transition latérale graduelle entre ces deux unités stratigraphiques. Deux explications peuvent être avancées pour expliquer cette différence sédimentaire. Soit elle correspond à la dégradation de substrats de nature légèrement différente (la roche et plus rouge dans les carrés C-F/9-11), soit à un apport moindre de matière organique dans l’US 425. En effet, sa localisation en plan épouse les contours de l’unité d’habitation (Figure 7). US 405 : La poursuite des investigations a permis de mieux cerner le profil de l’US 405. Cette dernière accuse un net pendage de direction ouest-est, et devient plus puissante à l’extérieur de la structure à l’Est. Dans cette zone, de nombreux tessons ont été retrouvés jusqu’à la base de la couche (Figure 6). Ces derniers présentent un aspect roulé et n’ont pas fait l’objet de remontages avec les fragments provenant de la structure. Il est donc possible qu’ils soient en position secondaire et correspondent à des occupations antérieures. La présence parmi cet ensemble d’un cordon légèrement arqué, d’aspect archaïque, pourrait conforter cette hypothèse. D’autres tessons proviennent de cette couche à l’intérieur de la structure 3, mais pourraient être issus des occupations postérieures, ce que ne contredisent pas les quelques remontages effectués.
18
1.5 Les aménagements domestiques et architecturaux Les unités stratigraphiques construites US 404 : La poursuite de la fouille a permis de dégager l’ensemble de l’aménagement 404. Le système de blocs posé et calés sur le sommet de l’US 405 est similaire à ce qui avait déjà été observé. En revanche, le blocage interne (US 403) qui caractérisait l’aménagement précédent s’est fortement érodé, probablement suite au déplacement de certains blocs qui le maintenaient. Ce système se ferme au nord par une unique pierre placée dans l’axe de l’US 407 (fig. 7-9).
Figure 8 - Structure 3 : vue zénithale des US 403 et 404
Figure 9 - Structure 3 : vue générale de l’entrée de l’habitation en cours de fouille
19
US 407 : La partie nord de la file Ouest de l’US 407, faisant face à l’US 407, a fortement été bouleversé, notamment par l’action des racines de chênes. Les blocs prolongeant en faisant partie se sont pour la plupart effondrés dans l’US 402b (fig. 4 ; fig. 7 : pierres notées d’un T ; Figure 10). La présence de calages permet toutefois de restituer leur position initiale (fig. 11 et 22), comme cela avait été possible pour un bloc proche de l’abside dont nous avions retrouvé la trace de la fosse d’implantation (Peche-Quilichini et al., 2012). Il apparaît que l’US 407 se terminait au nord-ouest par trois pierres alignées de champs. Contrairement aux autres dalles constituant le parement externe de la structure 3, elles ne sont pas dressées sur leur longueur, mais sur leur largeur. Seule l’une d’entre elles, fermant la file au nord, a conservé son emplacement d’origine. Elle repose sur une dalle de calage oblique révélant le creusement d’une petite fosse d’implantation dans l’US 425, bien qu’aucune trace n’ait pu en être décelée à la fouille, comme c’est généralement le cas ici (Figure 12). A l’ouest de la file, une rangée de petits blocs peut être interprétée comme un renfort externe de l’US 407 (Figure 7). Il semble que la mise en place de la file Ouest ait profité du pendage naturel du substrat et de l’US 425, de direction ouest-est, auquel elle est perpendiculaire.
Figure 10 - Structure 3 : vue de la file ouest de l’US 407, au niveau de l’entrée de l’habitation
20
Figure 11 - Structure 3 : détail de la file ouest de l’US 407, au niveau de l’entrée de l’habitation
Figure 12 - Structure 3 : détail du bloc marquant l’extrémité de la file ouest de l’US 407 et de sa pierre de calage US 432 : A l’est de la structure 3 sont deux grosses boules de granite dont l’une au moins était présente antérieurement à l’installation de l’habitat puisque, ainsi que l’ont révélé les fouilles, elle repose sur la roche mère. Entre ces rochers ont été mis en place deux blocs plus au moins
21
ovales d’une quarantaine de centimètres de longueur calés par des pierres de plus petites dimensions (Figure 7). Cet aménagement repose sur l’US 425, il doit donc être daté de la même phase que la structure 3. Il clos véritablement l’intervalle entre ces rochers et doit donc jouer un rôle dans la structuration de l’espace externe de l’habitation. Il contraint en effet l’axe de circulation naturelle qui correspondrait à passer entre ces blocs pour accéder à la structure 3 et impose de les contourner pour se retrouver dans l’alignement de l’entrée de l’habitation.
Figure 13 - Structure 3 : vue depuis le nord-ouest de l’US 432
Figure 14 - Structure 3 : vue depuis l’est de l’US 432
22
Les foyers FY 423 : La fouille des carrés C-D/6 a révélé la présence d’une lentille de limon jaune marbré de noir de 60 cm de longueur pour 45 cm de largeur, reposant sur le niveau supérieur de l’US 402a (fig. 15 et 23). Elle contenait quelques charbons dont certains appartenaient visiblement à des brindilles. La coloration correspond à la rubéfaction des sédiments sous-jacents. Il est donc possible d’interpréter cette anomalie comme un foyer, réalisé à même le sol ou dans une petite cuvette n’excédant pas les 2 cm de profondeur, ayant été nettoyé ou lessivé après son utilisation. Compte tenu de sa position dans la stratigraphie, il s’agit vraisemblablement d’une structure récente, contemporaine d’une des exploitations charbonnières.
Figure 15 - Structure 3 : vue depuis l’ouest du foyer 423
FY 433 : Cette structure de 126 cm de longueur pour 90 cm de largeur et d’une trentaine de centimètres de profondeur accuse une forme « en haricot » qui est vraisemblablement due à l’existence de deux creusements successifs, de formes ovales, aux parois convexes et arrondies (US 434 et 435), réalisées en partie dans le substrat et en partie dans les US 405 et 425. Deux remplissages peuvent être identifiés. Le plus ancien, à la base de la structure, est très riche en cendre et en charbons de bois (US 433). Des bûches intactes ont d’ailleurs été découvertes dans la partie est de cette structure de combustion, correspondant à sa dernière utilisation. Celles-ci ont été prélevées pour identification, de même que 30 litres de sédiments qui feront l’objet de tamisages, en vue d’analyses anthracologique et carpologique2. De rares tessons de céramiques (3 fragments), ayant subi une seconde chauffe, étaient également présents dans cette unité stratigraphique. Le remplissage supérieur (US 428) correspond à un limon brun moyen friable contenant des inclusions granitiques. Quelques pierres décimétriques sont également contenues dans cette couche, apposées sur les bords du creusement du foyer. Elle correspond au comblement de la structure après son utilisation (fig. 16-19).
2 Etudes V. Py et L. Martin.
23
Figure 16 - Structure 3 : niveau d’apparition du foyer 433 (US 428), les limites sont bien visibles au nord, mais
ne sont pas perceptibles à l’intérieur de la structure 3
Figure 17 - Structure 3 : le foyer FY 433 pendant la fouille, niveau d’apparition de l’US charbonneuse
24
Figure 18 - Structure 3 : niveau de base du foyer FY 433 comprenant les bûches du dernier feu
Figure 19 – Relevé en plan et en coupe du foyer FY 433
25
Les trous de poteaux Comme lors des campagnes précédentes, les négatifs de poteaux porteurs n’ont que difficilement été identifiés dans la structure 3. C’est principalement par un nettoyage attentif du substrat, rendu malaisé par la nature de ce dernier3, que des structures négatives peuvent être identifiées. Ces dernières correspondent généralement à des creusements superficiels, ce qui indique que seule leur partie inférieure a été observée. C’est le en particulier cas du TP 429. En revanche, un autre négatif de poteau a pu être identifié par la présence de pierres de calages organisés en arc de cercle, sans qu’aucune distinction sédimentaire ne permette de lire le creusement initial (TP 436). L’une d’entre elles est un fragment de meule : il s’agit d’un type de remploi fréquent sur le site de Cuciurpula.
• TP 429 : Diamètre : 19 cm. Profondeur conservée : 8 cm. Comblement : US 430. Localisation : À proximité de l’US 404 dans le carré F7, à l’aplomb de deux blocs. Compte tenu de sa forme et de sa position, il s’agit plus probablement d’un élément de renfort latéral (Figure 20).
Figure 20 – Relevé en plan et en coupe du TP 429
• TP 436 : Diamètre : 38 cm. Profondeur conservée : ? Comblement : ? Localisation : Ce trou de poteau est localisé à proximité de l’US 407, au nord-ouest de la structure (Figure 7). Néanmoins, il est dans l’axe de l’alignement principal matérialisé par les TP 416, 418, 420 et 422. La déviation de la poutre faîtière dans l’axe de l’entrée, en oblique par rapport aux parements en pierre de l’habitation, semble donc se confirmer.
3 En phase d’arénisation avancée dans cette partie du site.
26
1.6 Phasage de l’occupation de la structure 3 Les données récoltées en 2013 permettent de conforter le phasage proposé pour l’occupation de la structure 3 (Figure 21). La phase 0 précède l’installation de la structure en pierre. Elle correspond à des niveaux d’arénisation du granite dans lequel du mobilier protohistorique a été découvert, mais qui pourrait provenir des niveaux supérieurs, ou d’occupations antérieures à la structure 3 (US 405 et 425). La phase 1 (Figure 22) voit l’aménagement de la structure mégalithique délimitant l’habitation, dont les dalles ont été placées dans des tranchées de fondation. Dans le même temps, le dispositif de rétrécissement de l’entrée (US 403-404) et l’aménagement latéral (US 408), sont mis en place. Ce niveau correspond également à l’excavation de la fosse 410, ainsi que probablement du foyer 433, dont le creusement atteint le substrat. Le TP 436 est lui aussi mis en place dans cette unité stratigraphique, ce qui doit également être le cas des autres trous de poteaux. L’US 402b qui scelle ces aménagements correspond donc à la première phase d’occupation de la structure.
Figure 21 - Structure 3 : diagramme stratigraphique et phasage
27
Figure 22 - Structure 3 : relevé planimétrique de la phase 1, avec hypothèse de restitution des blocs tombés
Le début de la phase 2 est matérialisé par un sol (US 406) qui scelle cette première occupation, et sur laquelle vient s’effondrer une dalle de l’US 407 et une partie du blocage de l’US 408, déjà partiellement érodé. Elle correspond donc à une phase d’abandon et de destruction de l’habitation, ce que ne contredit pas la mauvaise qualité du mobilier mis au jour dans l’US 402a.
28
Figure 23 - Structure 3 : relevé planimétrique de la phase 2
La phase 3, enfin, matérialisée par un niveau d’humus de faible puissance (US 401), correspond vraisemblablement à l’époque subactuelle. Ainsi, la présence de charbons de bois diffus dans ce niveau doit probablement être reliée aux activités de charbonnage du siècle dernier, de même que le foyer 423, creusé au sommet de l’US 402a.
29
Figure 24 - Structure 3 : relevé planimétrique de la phase 3
Contrairement aux autres habitations fouillées à Cuciurpula (str. 1 et 6), la structure 3 semble donc avoir eu une durée de vie courte, correspondant à une unique phase d’occupation.
30
1.7 Le mobilier de la structure 3 La céramique Un total de 582 tessons a été récolté lors des fouilles de 2013, ce qui porte à 2012 le nombre total de céramiques mis au jour dans la structure 3, toutes unités stratigraphiques confondues (Figure 25). D’après les remontages effectués, le mobilier des niveaux supérieurs de l’US 405 provient de la même occupation que ceux mis au jour dans l’US 402b. Sa position résulte plus probablement du tassement des premières fréquentations, ainsi qu’à des perturbations dues aux racines. Ce n’est pas le cas en revanche des éléments découverts à la base de cette même US 405 à l’extérieur de la structure (carrés C-E/6), qui doivent provenir d’occupations antérieures (Figure 27, n° 11-13).
US Années prec. 2013 Total 401 1 1 402a 58 2 60 402b 887 117 1004 405 375 361 736 425 94 94 403 11 5 16 409 27 27 433 3 3
Nett. 71 71 Total 1430 582 2012
Figure 25 – Répartition du Nombre de Restes de céramiques par Unité Stratigraphique
D’après les éléments diagnostiques récoltés en 2013, le NMI peut être évalué à 13 récipients seulement4, ce qui porte à 23 le nombre minimum d’individus différents dans la structure (fig. 26-27). Ce chiffre relativement faible converge avec l’idée d’une occupation de courte durée de l’habitation 3. Parmi les récipients découverts en 2013, on note une majorité de gobelets et pots sinueux aux parois parallèles et au bord bien individualisé (Figure 27, n° 2-5, 11). Leurs surfaces ont été sommairement lissées, probablement à l’aide d’un outil mousse (galet ou estèque), ils contiennent tous un dégraissant granitique grossier et ont été cuit en atmosphère réductrice ou faiblement oxydante. Cette forme de récipient est fréquente dans la série de l’abri funéraire de Tappa 2 à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud) dont le mobilier est daté entre le VIe et le IVe siècle av. J.-C. (Milanini et al., 2008, formes IA et IIA : fig. 8 n° 2-7, 9 ; fig. 9 n° 20-24, 26-27, 31-35 ; fig. 10 n° 36-42). On les retrouve également sur l’habitat de Cozza Torta, également à Porto-Vecchio, daté du VIe siècle av. J.-C. par la présence de céramiques d’importation méditerranéennes (Milanini et al., 2012, fig. 8 n° 16-19). Le mobilier de la structure 1 de Nuciaresa à Lévie (Corse-du-Sud), daté pour sa part du début du VIe siècle av. J.-C. par la présence d’une amphore corinthienne, comprend également des récipients de morphologie similaire (Peche-Quilichini et al., à paraître, n° 184). A Cuciurpula même, un rapprochement peut notamment être fait avec des récipients de l’US 103 et 135 de la structure 1 (Peche-Quilichini et al., 2012, pl. 1, n° 1839 ; Peche-Quilichini et al., 2010, p. 37). Des vases de même morphologie sont également connus dans la série funéraire d’Acciola (Giuncheto, Corse-du-Sud), attribuée à la fin du VIIIe ou au VIIe siècle av. J.-C. (Peche-Quilichini, 2011,
4 Comptabilisé à partir du nombre de bords différents.
31
type ACCI-7, p. 192). Enfin, il faut noter la persistance de ce type au second âge du Fer dans la sépulture de Santa Catalina à Lévie (Lanfranchi, 1968, fig. 43, n° 3, 8). Ces vases de la structure 3 proviennent du niveau d’occupation principal, à l’exception d’un fragment découvert dans les niveaux profonds de l’US 405 à l’extérieur de l’habitation. Il est orné du départ d’une file d’impressions verticales en « grain de riz » (Figure 27, n° 11). D’autres récipients, présentant les mêmes caractéristiques technologiques, correspondent à des pots convexes (Figure 27, n° 1 et 7). L’un d’eux est orné d’une file d’impressions obliques sous le bord. Il se rapproche en cela d’un individu de l’US 103 de la structure 1 de Cuciurpula (Peche-Quilichini et al., 2010, p. 36, n° 2680). La forme générale se retrouve aussi dans l’US 105 de cette même structure 1, datée de la fin du VIIe ou de la première moitié du VIe siècle av. J.-C. (Peche-Quilichini et al., 2012, pl. 2, n° 545 ; pl. 3, n° 1050), ainsi qu’à Nuciaresa, parmi le mobilier des fouilles anciennes de F. de Lanfranchi (1978). Une préhension perforée verticalement s’ajoute aux deux exemplaires découverts les années précédentes (Figure 27, n° 9). Elle évoque des individus de l’US 135 de la structure 1, datée du VIIe siècle av. J.-C. (Peche-Quilichini et al., 2010, p. 38, n° 4634 et 3919) et d’Acciola (Peche-Quilichini, 2011, p. 191, type ACCI-2, n° 4). D’autres préhensions massives, mais perforées horizontalement proviennent pour leur part des ensembles de Tappa 2 (Milanini et al., 2008, fig. 8, n° 21, fig. 9 n° 34) et de Cozza Torta (Milanini et al., 2012, fig. 8, n° 21). Deux cordons complètent l’inventaire, l’un d’entre eux est orné d’une impression rectangulaire (Figure 27, n° 10), comme dans l’US 106d de la structure 1 de Cuciurpula et sur le vase de fondation zoomorphe de cette habitation (Peche-Quilichini et al., 2012b, pl. 2, n° 1583 ; pl. 5, n° 1574). On en retrouve aussi des exemplaires à Cozza Torta (Milanini et al., 2012, fig. 8, n° 20, fig. 9, n° 22, 15). Le second, provenant des niveaux profonds de l’US 405 à l’extérieur de l’habitat accuse une forme légèrement arquée le rapprochant également des ornementations des vases à protomé zoomorphe (Figure 27, n° 12). Pour finir, il faut signaler la présence d’un probable fragment de couvercle (Figure 27, n° 6), pour lequel nous ne connaissons pas de parallèle. La série compte également 12 portions de fonds (Figure 27, n° 8), deux fragments d’anses en boudins, sept bords peu caractéristiques et un décor de lignes d’impressions verticales en « grains de riz » (Figure 27, n° 13).
34
L’industrie lithique
• L’industrie lithique taillée en quartz Huit fragments de quartz laiteux découverts en 2013 s’ajoutent aux 19 fragments découverts les années précédentes. Il s’agit principalement de cassons, mais on peut déceler la présence d’un nucléus et de 2 petits éclats offrant un tranchant. Le faible effectif de la série indique une taille expédiente et occasionnelle.
• L’hématite Un fragment de bloc d’hématite de forme prismatique, mesurant 88 mm de longueur pour 62 mm de largeur et 52 mm d’épaisseur, provient de l’extérieur de la structure (US 402b, F10, n° 589). Il présente deux faces polies, vraisemblablement consécutives d’une abrasion destinée à la fabrication de colorant rouge. C’est le plus gros support de ce type découvert sur le site (Figure 28).
Figure 28 – Structure 3 : bloc d’hématite
35
• Le mobilier de mouture et de broyage (Charlène Delefosse) Quatre artefacts, pour la plupart découverts à l’état de fragments : Le premier (US 402a, C9) présente une surface polie plano-convexe pouvant être due à une percussion oblique posée diffuse (Leroi-Gourhan, 1945, fig. 56), qui correspondrait à une utilisation comme meule, molette, molette à main ou polissoir (dim. : 39 x 29 x 27 mm pour 30 g). Cet éclat est en grès fin à ciment induré. Il s’agit d’une matière première difficile à mettre en forme et à travailler, elle requiert un important effort en « coût de production » (Schoumacker, 1993). L’incertitude de sa fonction ne permet cependant pas d’établir le « coût d’entretien » de cet objet, ni la vitesse d’usure (Figure 29).
Figure 29 – Structure 3 : éclat d’un probable artefact de mouture
Le deuxième artefact (US 402a, F9, n° 598) est un galet en quartzite utilisé comme percuteur de morphologie semi-circulaire, de section losangique, dont les dimensions sont 67 x 63 x 44 mm et qui pèse 230 g. La surface active concave montre des enlèvements dus à des percussions lancées (Figure 30).
Figure 30 – Structure 3 : galet de quartzite utilisé comme percuteur
Le troisième (US 402b, F9, n° 590) est un fragment circulaire et de section semi-circulaire pouvant être une molette ou un broyon, ou encore l’extrémité d’un pilon. Ces dimensions sont de 68 x 62 x 42 mm pour 236 g. La surface active est légèrement grenue avec des traces de piquetage. La matière première est un granit à grains moyens et à liant moyennement indurés : le granit est composé de quartz, feldspaths et en plus faible quantité de micas et biotites. Ses
36
deux minéraux principaux ont une dureté de respective de 7 et 6. Si l’on reprend l’étude de Schoumacker (1993), cette matière première nécessite un faible « cout de production », puisque le liant peu induré facilite le façonnage et une usure moyenne nécessitant un ravivage d’une fréquence relative. En effet bien que les cristaux de quartz se polissent facilement, le liant présent ici permet un faible remplacement à l’usage des cristaux (Figure 31).
Figure 31 – Structure 3 : fragment de molette ou broyon en granit
Un fragment de meule en granit provient du trou de poteau 436. Ses dimensions sont de 94 x 76 x 63 mm et il pèse 752 g. La surface active est polie, mais encore légèrement abrasive et faiblement plano-concave. Elle n’a conservé aucune trace de mise en forme. Le granit de cet artefact est constitué de cristaux de taille plus importante que le précédent. La matière première permet donc un faible « cout de production » en ainsi qu’un ravivage quasi-automatique grâce à la faible induration du liant. Il s’agit d’une matière première fortement adaptée aux activités de mouture (Figure 32).
Figure 32 – Structure 3 : fragment de meule provenant du TP 436
37
Analyse spatiale L’exploitation des données des fouilles précédentes avait permis de proposer un schéma d’organisation interne de la structure 3 d’après la position des vases (Peche-Quilichini et al., 2012a). L’analyse de la dispersion des tessons des principaux récipients autorisait en effet une restitution de leur position initiale et ainsi d’identifier une zone d’activité privilégiée, localisée dans les carrés I-K/7, à proximité de la fosse 410. Celle-ci était dévolue principalement au stockage, au moins dans sa partie sud à faible distance d’un poteau porteur, où étaient notamment dispersés les fragments de deux jarres. La partie ouest de la structure, dont l’espace était encombré des piliers supportant le toit, et qui se trouvait dans l’axe de l’entrée, avait pour sa part été interprétée comme une zone de circulation. L’exploitation des fouilles de l’espace d’entrée en 2013 vient enrichir le schéma proposé. Il faut d’ores et déjà noter que les vases récoltés sont différents de ceux provenant du sud de la structure. Des remontages ont en revanche été possibles avec des récipients de la zone précédant le seuil. La dispersion des tessons et des remontages indique donc la présence d’une autre aire d’activité dans l’entrée de la structure (fig. 33 et 34), vraisemblablement en lien avec le foyer 433 (cuisine, etc.). Certains tessons des vases de cette zone se retrouvent également à l’extérieur à l’Est. Cette localisation doit être la conséquence du balayage de la structure. Une concentration de mobilier apparait d’ailleurs dans cette zone si on analyse la densité des tessons en surface5 (Figure 35). La localisation du mobilier lithique complète également les conclusions émises précédemment (Figure 36). La concentration des éclats de quartz signale en effet deux concentrations interprétées comme deux épisodes de taille expédiente, visant à l’obtention d’un outillage tranchant. L’une d’entre elles est localisée dans les carrés J-K/8, en bordure de la zone d’activité mise en évidence par la répartition de la céramique et l’autre dans les carrés F-H/8, à proximité de l’entrée et non loin du foyer. Un percuteur en quartzite découvert dans cette zone pourrait d’ailleurs être lié à cette activité de taille (Figure 30). A l’extérieur de l’habitation à l’ouest, la présence d’un gros nodule d’hématite laisse penser que la fabrication de colorant s’effectuait en périphérie de la maison (Figure 28). En effet, la présence de ce matériau est très anecdotique dans l’enceinte de la structure 3, avec un seul fragment répertorié. De même, un élément semi-sphérique en granite interprété comme une molette, un broyon ou un pilon (Figure 31) se retrouve dans cette zone comprise entre les US 407 et 432, ce qui indique que les activités de broyages s’effectuaient à l’extérieur de l’habitation. La fouille de 2013 permet ainsi de compléter utilement le schéma d’occupation spatiale proposée pour la structure 3 en 2012 (Figure 37). La découverte du foyer de l’habitation permet notamment de parfaire notre perception de l’organisation des activités. Ce dernier est localisé dans l’entrée de la maison, entre le seuil et l’extérieur, contrairement aux autres structures de combustion du site qui avaient jusqu’à présent été découvertes à l’intérieur des habitats. Il en diffère aussi par sa morphologie, correspondant à une fosse creusée jusqu’au substrat. Sa position permettait probablement de couper le froid à l’entrée de l’habitation, tout en autorisant l’évacuation des fumées de combustion.
5 Réalisé à partir d’un graphe en courbe de niveau sous Excel (Chenorkian, 1996).
43
Faciès et datation En dépit du petit nombre de récipients caractérisant l’occupation de la structure 3 (fig. 26 et 27), ces derniers s’inscrivent clairement dans la tradition du faciès de Nuciaresa, représentatif du premier âge du Fer du sud de la Corse (Peche-Quilichini, 2012). Les comparaisons effectuées pièce par pièce renvoient à une chronologie assez lâche, du VIIIe au IVe siècle av. J.-C. Cela reflète une certaine difficulté à dater les productions du premier âge du Fer de Corse, dont la chronotypologie précise est en cours de constitution depuis quelques années seulement. Mais elle témoigne aussi et surtout de traditions communes, dans le sud de l’île, aux différentes phases de cette plage chronologique. Une datation basse, du Ve-IVe siècle av. J.-C. semble toutefois pouvoir être écartée, en l’absence de décor au peigne, se développant dans le sud de l’île vers le IVe siècle avant J.-C. (Milanini et al., 2008, p. 143 ; Peche-Quilichini, 2012, p. 217). L’un des assemblages les plus significatifs de ce faciès est le dépôt de céramique de l’abri 3 de Cuciurpula. Cet assemblage amène à douter de l’homogénéité de celui de Tappa 2, avec lequel la série de la structure 3 trouve de nombreux points de comparaison. L’absence de caractère de tradition Bronze final dans le mobilier de la structure 3, comme les fonds à impressions de vannerie ou les vases à rebord très segmentés, implique d’autre part une datation postérieure au début du VIIe siècle av. J.-C. Ces traits typologiques trouvent en effet leur origine dans le faciès A.C.C. du Bronze final et perdurent au début du premier âge du Fer, ou Fer 1A (Peche-Quilichini, 2010, 2012). Une datation du Fer 1B, dont le début est placé vers 650 av. J.-C. (Peche-Quilichini, 2012, p. 215) peut donc être proposée pour l’occupation de la structure 3, à l’instar de l’occupation principale des structures 1 de Cuciurpula et Nuciaresa, de Cozza Torta et d’une partie au moins de l’abri funéraire de Tappa 2, avec lesquels elle partage de nombreux traits morphologiques. Les datations fournies par les céramiques d’importation livrées par certains de ces sites confirment une extension du faciès jusqu’à la fin du VIe siècle av. J.-C. Dans l’optique d’affiner et de contrôler cette proposition typochronologique, une datation 14C a été effectuée à partir d’un résidu carbonisé d’origine alimentaire recueilli sur un tesson de céramique de l’US 402b, assurant ainsi sa contemporanéité avec la série. Comme il était attendu, l’interprétation du résultat se heurte à une irrégularité de la courbe de calibration dendrochronologique du radiocarbone, également connue par le terme de « plateau du Hallstatt ». Le résultat couvre donc le VIIIe et le VIe siècle av. J.-C., ce qui est certes cohérent avec les comparaisons effectuées, mais ne permet pas d’affiner notre datation de l’assemblage de la structure 3 (Figure 38) : Poz-57989 : 2495 ± 35 BP = 787-507 Cal BC (à 92,7 %), avec toutefois un pic de probabilité pour la période 651-544 Cal BC (à 46 %). Il faut noter que cette date est particulièrement cohérente avec celles obtenues pour l’US 105 de la structure 1 de Cuciurpula et l’US 112 de la structure 1 de Nuciaresa (Figure 39). Une modélisation statistique bayésienne des différents éléments de datation connus pour le Fer 1A et 1B du sud de la Corse6 (datations isotopiques, éléments de succession typologique ou stratigraphique, chronologie des importations) confirme une datation du Fer 1B entre 650 et 500 av. J.-C. Une sériation plus fine des différents assemblages permettra à l’avenir de resserrer les datations de chaque site, malgré la déficience de la courbe de calibration du radiocarbone pour cette période, comme cela avait été possible pour la séquence stratigraphique de la structure 1 (Peche-Quilichini et al., 2012b, fig. 4). A l’heure actuelle, il semble difficile d’affiner plus avant la datation de l’assemblage de la structure 3. La présence de décors d’incisions verticales est un caractère archaïque, présent dès le VIIIe siècle dans les niveaux précédents la structure 1, mais qui ne disparaît pas pour autant par la suite. De même, l’absence d’importation est-elle un indicateur chronologique ou dépend-elle de la position géographique du site ?
6 Réalisée à l’aide du logiciel OxCal© 4.2.
44
Une datation de la fin du VIIe ou du VIe siècle av. J.-C. de l’occupation de la structure 3 semble donc, à ce stade des recherches, la plus cohérente et la plus prudente. Cet assemblage céramique peut toutefois être considéré comme une série de référence et un resserrement de sa chronologie est tout à fait envisageable à l’avenir.
Figure 38 – Structure 3 : résultat de la calibration de la datation radiocarbone
Figure 39 – Modélisation bayésienne des datations du premier âge du Fer du sud de la Corse
46
2. La structure 38 2.1 Description et problématiques d’étude La structure 38 se trouve dans la parte nord-occidentale du site de Cuciurpula (fig. 42). Elle se trouve sur un axe de circulation aménagé par dégagement, reliant les habitations 8 et 9, à mi-distance (environ 20 m) desquelles elle est implantée. Immédiatement au nord-est se trouve la zone d’abris étudiée cette année (taffoni 3 et 4). Son altitude moyenne est de 1058 m. Au premier abord, la structure 38 se présentait comme un trapèze long d’environ 4 m pour une largeur de 1,5 à 2,3 m (fig. 43), matérialisé par des blocs de granit leucocrate dressés7 et organisés de façon à créer un parement interne rectiligne et relativement régulier. Ces blocs dépassent nettement du sol actuel. L’ensemble est implanté contre une énorme boule de granit, à l’est, et est coincée entre plusieurs affleurements d’un substrat très diaclasé et irrégulier. Le secteur est caractérisé par un fort pendage vers le sud, ce qui se traduit par une érosion du secteur, contrebalancé par sa position à la base d’une sorte de cône de déjection. La zone connaît également une bioturbation permanente, causée par les sangliers et la croissance des chênes, dont le développement racinaire a considérablement gêné la fouille et la compréhension des enchainements stratigraphiques.
Figure 42 – Situation de la structure 38
7 Dont une meule à va-et-vient en remploi, martelée sur ses longs côtés afin de parfaitement s’imbriquer dans le solin une fois dressée (fig. 47).
47
Le choix de fouiller cette construction se justifie par son caractère anthropique certain, notamment concernant l’aspect structurel le plus évident (choix, dimensions et disposition intrinsèque des matériaux de construction), mais aussi et surtout par l’originalité de la structure (plan d’ensemble et dimensions), qui contraste avec les observations faites jusqu’à présent, essentiellement pour les habitations. En effet, les dimensions réduites et le plan sub-trapézoïdal de la structure 38 tranchent fortement avec les données produites pour la plupart des aménagements observés sur le site.
Figure 43 – Planimétrie de la structure 38
(carroyage : 1 m, orientation cardinale avec nord vers la gauche) Les problématiques d’étude découlent naturellement de ce constat. Il s’agit de préciser la fonction et la chronologie de cet édifice afin de tenter d’établir les raisons particulières de son originalité.
48
Figure 44 – Vue de la structure 38 depuis le sud après le dégagement du niveau humique
2.2 Aspects stratigraphiques La fouille a concerné l’ensemble de l’espace interne, défini par la disposition des blocs et des affleurements substratiques, ainsi qu’une bande de 100 cm de large à l’extérieur, contre le mur ouest. Dans cette zone, les différents niveaux de sols ont été laissés en témoin afin de ne pas fragiliser la structure durant l’excavation interne. 2.2.1 Liste des unités stratigraphiques US 0 : sol actuel. Surface irrégulière, en pente, avec un grand nombre de dépressions lenticulaires emboitées. En grande partie formé d’un tapis végétal. US 1 : niveau humique. Epais de 20 à 30 cm, il est plus dilaté vers le sud. Sa composition inclut essentiellement une terre très végétale peu compactée, ainsi que quelques éléments granitiques pluricentimétriques et de l’arène granitique non concentrée. Il s’agit d’un niveau constamment remué par les sangliers.
49
US 2 : empierrement/sol. Observé essentiellement dans la partie nord de la structure (fig. 44), il s’agit d’un lit de blocs dont certains atteignent une quarantaine de centimètres. Ils sont disposés à plat et soulignent un paléosol recouvert par les colluvions, de formation assez récente. US 3 : niveau humique. Sur une épaisseur d’environ 20 cm, constante dans la moitié nord de la structure, un second niveau de terre végétale a été identifié. Bien plus minéralisé que l’US 1, il est également plus compact. Le sédiment y est brun foncé et ne montre que peu d’inclusions détritiques. L’origine de sa formation est à chercher dans un apport gravitaire lent qui se fait en continu depuis le cône de déjection précité. US 4 : empierrement/sol. Cette pellicule stratigraphique, de pendage sud (fig. 45), inclut essentiellement des pierres posées à plat sur un seul niveau, trahissant une déposition non violente. L’unité est matérialisée par trois concentrations distinctes (fig. 53) mais résultant d’un phénomène contemporain. En termes d’altimétrie, l’US 4 correspond peu ou prou au niveau de circulation ancien, ce qui, pour l’interprétation du fonctionnement sédimentaire du secteur, est lourd de sens. On reviendra plus tard sur ce point. Ce paléosol constitue le niveau d’ouverture du TP1 et du TP3 (trous de poteau), ce qui confirme son statut.
Figure 45 – Concentration de blocs disposés à plat (US 4) dans la partie sud de la structure 38
50
Figure 46 – Vue générale de la structure 38 depuis le sud après démontage de l’US 4
US 5 : remblais anthropique. Niveau de sédiment noir de composition et texture hétérogènes (fig. 46), caractérisé par l’abondance de mobilier céramique. Ce dernier inclut de nombreux tessons dont les orientations très diverses trahissent une déposition violente, très probablement intentionnelle. Les rares inclusions détritiques ont été sujettes au même phénomène. L’US 5 correspond vraisemblablement à un niveau de remblais de nivellement, anthropique et rapidement mis en œuvre à partir de terres situées à proximité. Dans la partie sud de la structure, l’US 5 est soumise à un sous-tirage en raison de la présence d’une importante diaclase non comblée. US 6 : couronne/solin de blocs. La structure est composée de 9 blocs principaux, de longueur supérieure à 40 cm, et de quelques blocs secondaires pour lesquels il est difficile de préciser la stricte position originelle. Certains, notamment sur le flanc oriental, sont munis de pierres de calage. Le bloc nord-est est une meule en remploi (fig. 47), amincie volontairement sur ses flancs pour mieux cadrer à l’architecture. L’ensemble des blocs est dressé et disposé de façon à créer un fil régulier en parement interne, de la même façon que pour toutes les structures domestiques du site. Au final, la structure a un plan en trapèze si l’on excepte le bloc sud-est, positionné en prolongement du mur oriental, dont la fonction est indéterminée. La partie nord-ouest de la construction semble avoir subi quelques dégradations en raison de l’activité végétale.
51
Figures 47a et 47b – Vues frontale et latérale de la meule en remploi dans le solin de la structure 38
52
US 7 : Remblais naturel (ou indirectement anthropique). Niveau épais, caractérisé par la fréquence de blocs dans la partie septentrionale du remplissage, à la base du cône de déjection (fig. 47). Le sédiment, noir, y est assez homogène et meuble. Un pendage vers le sud a été remarqué. Cette couche vient colmater les diaclases souvent profondes qui séparent les différents bancs de substrat. Son sommet correspond au niveau d’ouverture du TP2. Elle inclut beaucoup de mobilier, dont la répartition altimétrique obéit toutefois à un gradient de fréquence marqué par une raréfaction graduelle vers le bas (fig. 49). On suppose que ce niveau s’est formé par un apport continu et lent depuis le nord, avant et pendant l’occupation des secteurs placés en amont, et probablement selon un rythme dicté par les activités anthropiques à partir de l’installation du groupe dans cette partie du site. La fouille s’est achevée à l’intérieur de ce niveau, à partir du moment où le sédiment devenait stérile en mobilier (fig. 54-56).
Figures 48a et 48b – Le sommet de l’US 7 depuis le sud (à gauche) ; vue de détail (à droite)
Figure 49 – Fréquence du mobilier céramique (points rouges) au sein des différentes unités stratigraphiques
dans une bande de 20 cm de large sur l’axe longitudinal
53
Structures en creux : au moins trois à quatre trous de poteau ont été observés dans l’espace interne de la structure 38 (fig. 50) :
- TP1 se trouve dans le carré I5. Il s’agit d’une fosse ovalaire (45 cm de long) creusée à partir du sol US 4, dans la partie sud-occidentale de la structure. La partie haute de la fosse a été comblée par quatre blocs faisant office de calages. L’ensemble a récemment été endommagé par des racines (fig. 51) ; - TP2 se trouve à cheval sur les bandes G, H, 5 et 6, approximativement au centre de la structure, à proximité de son axe longitudinal. Il s’agit d’une fosse subcirculaire (environ 30 cm de diamètre) en partie comblée par trois blocs de calage en position verticale (fig. 52), qui s’ouvre à partir du sommet de l’US 7. La paroi latérale du banc de substrat affleurant au centre de la structure sert également de calage8 ; - TP 3 est positionné entre E5 et E6, dans la partie nord de la structure, sur l’axe longitudinale. Il s’agit d’une fosse circulaire (25 cm de diamètre maximal) matérialisée par une colonne de sédiment jaunâtre qui s’ouvre dans l’US 4 et perfore les US 5 et 7 ; - TP 4 est plus hypothétique. Il s’agit d’une fosse circulaire (environ 25 cm de diamètre) difficilement individualisable, placée en I7. Son existence pourrait être confortée par sa symétrie avec TP1 par rapport à l’axe longitudinal. Elle s’ouvre dans l’US 4.
Ces structures sont toutes implantées dans les comblements diaclasiques. L’organisation des trous de poteau fait apparaître un plan en T (fig. 50), permettant d’établir l’existence d’un faîtage au moins partiel, posé sur TP2 et TP3, et probablement sur la poutre reliant TP1 à TP4.
Figure 50 – Hypothèse de restitution de la charpente
8 Le même dispositif a été observé dans une maison de la fin du VIIe siècle av. J.-C., à Nuciaresa-Levie (Peche-Quilichini et al., à paraître), également pour le poteau central.
54
Du point de vue stratigraphique, TP2 apparaît comme le plus ancien, puisqu’aménagé à partir du remblai « naturel » (US 7), alors que les trois autres ont été creusés dans le remblai « artificiel » (US 5). Cet écart sédimentaire n’a pas grande signification puisque le sédiment de l’US 5 a pu être apporté immédiatement après la mise en place de TP2, dans le cadre de la construction de la structure. Selon cette vision de l’évolution de la construction, l’ordre des opérations serait le suivant : - choix du lien d’implantation ; - mise en place du poteau central (TP2) ; - remblais de nivellement (US 5) ;
- mise en place des poteaux latéraux (TP1, TP3 et TP4) et de la couronne (US 6).
Figure 51 – Vue zénithale du TP1 pris dans un réseau racinaire
Figure 52 – Vue zénithale des calages du TP2, implanté contre un affleurement de substrat en banc
55
Figure 53 – Planimétrie et section des différentes unités stratigraphiques et aménagements reconnus.
En vert : US 4 ; en gris clair : US 6 ; en gris foncé : creusements et calages des trous de poteau
56
Figure 54 – La structure 38 en fin de campagne, vue depuis le nord
Figure 55 – La structure 38 en fin de campagne, vue depuis le sud
58
2.3 Mobilier L’ US 1 a livré 205 tessons de poterie, un fragment de torchis, un éclat de quartz laiteux un galet et deux fragments de galet. Les formes de la vaisselle incluent essentiellement des vases de taille plus importante que la moyenne du site, de profil fermé, à col ou non. Deux récipients portent un original cordon sub-labial, simple (fig. 38, n° 5) ou incisé (fig. 38, n° 2). Ce dernier élément est plus particulièrement typique des phases médianes et finales du premier âge du Fer. La même chronologie s’applique à un vase ovoïde à cordon sub-labial (fig. 38, n° 4). Deux exemplaires de jeton, sur paroi (fig. 38, n° 6) ou, plus grand, sur fond (fig. 38, n° 7). A Cuciurpula, ces éléments semblent plus particulièrement fréquents au VIIIe siècle (Peche-Quilichini, à paraître). Cependant, leur morphologie, intimement liée à un caractère fonctionnel, ne peut être considérée comme discriminante dans le cadre d’une diagnose chronologique (Peche-Quilichini et al., à paraître). Enfin, un fragment mésial de couvercle discoïdal perforé rappelle le bronze final 3 de l’abri de Cucuruzzu (Peche-Quilichini, à paraître). La considération globale des informations typo-chronologiques fournies par les mobiliers de l’US 1 permet de conclure à une certaine hétérogénéité, à corréler avec la formation humique et gravitaire de la strate.
Fig. 57 – Structure 38, mobilier céramique de l’US 1
59
L’ US 3 a livré 357 tessons, trois éclats de quartz, deux molettes, trois galets (dont un en quartzite) et un éclat de galet. La variété typologique est plus importante ici que dans l’US 3. La présence d’un bol caréné en partie supérieure (fig. 58, n° 1) permet d’établir un pont avec certains récipients des phases 0 et 1 de la structure 1, autour du VIIIe siècle. Une jarre ovoïde fermée présentant un profil semblable quoique convergent (fig. 58, n° 4) est à rapprocher du même contexte chronologique. Une autre jarre ovoïde portant une languette (fig. 58, n° 3) appartient vraisemblablement au premier âge du Fer. Deux jattes à rebord rectiligne ouvert (fig. 58, n° 2 et 5) renvoient plutôt aux contextes du Bronze final. Parmi les récipients de taille plus importante, des jarres bitronconiques à col évasé non articulé (fig. 58, n° 6) ou présentant une articulation interne (fig. 58, n° 7) sont assez caractéristiques de la fin du Bronze final. Un rebord de forme très originale (fig. 58, n° 8) est assez atypique. L’élément à col allongé ouvert et rectiligne (fig. 58, n° 9) est clairement à fixer dans le Bronze final 2 ou 3 et trouve une bonne correspondance dans les mobiliers des terrasses voisines de la structure 6, fouillées en 2012. La jarre ovoïde à lèvre digitée (fig. 58, n° 10) est une forme rare à Cuciurpula. On la retrouve cependant dans la phase 2 de la structure 1, vers la fin du VIIe et le début du VIe siècle. Les éléments perforés (fig. 58, n° 12-14), qui montrent une fois encore l’association de ces jours avec des cordons verticaux et surtout l’utilisation de procédés de façonnage globalement sommaires, sont fréquents sur le site, notamment durant la phase 0 de la structure 1. On se gardera toutefois de retenir cette fréquence comme un indice chronologique à l’échelle de la durée d’occupation, en raison d’un supposé caractère fonctionnel particulier de ces récipients perforés (utilisés dans le cadre de la production du brai de bouleau ; Peche-Quilichini et al., à paraître). Une languette à perforation verticale incomplète (fig. 58, n° 16) date vraisemblablement du premier âge du Fer. Un fragment de fond aplati sur disque de vannerie (fig. 58, n° 17) évoque quant à lui le Bronze final, même si l’on sait que la technique existe toujours de façon marginale au moins jusqu’au début du second âge du Fer (Peche-Quilichini, 2009, à paraître ; Peche-Quilichini et al., à paraître). Toutes les époques d’occupation du site, à l’exception du début du Bronze final, semblent représentées dans ce niveau. Cet état de fait confirme la formation humico-gravitaire de la sédimentation. En amont de la structure 38, on signale en effet un nombre conséquent de constructions protohistoriques, souvent partiellement détruites, placées sur des pentes importantes aboutissant pour la plupart à un goulet qui domine la zone fouillée en 2013.
60
Fig. 58 – Structure 38, mobilier céramique de l’US 3
L’ US 5 a livré 52 tessons, quatre fragments de torchis et un éclat de galet. Parmi les éléments de vaisselle les plus caractéristiques, trois fragments de partie supérieure de jarres bitronconiques à rebord évasé, plus ou moins articulé (fig. 59, n° 1-3) sont à replacer vers la fin du Bronze final, voire au VIIIe siècle. Deux fragments de vases perforés (fig. 59, n° 4 et 5) complètent ce mince lot. Cet ensemble s’insère vraisemblablement entre le Xe et le VIIIe siècle avant J.-C. Au vu de la position des tessons et du non-comblement de la profonde et large diaclase méridionale, on sait que le sédiment a subi une déposition rapide, de type remblaiement. Dès lors, il faut imaginer que cet apport a été réalisé au moyen de terres récupérées à proximité (en amont ?) dans des niveaux d’occupation. Selon les lois universelles de la stratigraphie, l’élément mobilier le plus récent de l’ensemble offre un terminus post quem à la datation du comblement. Dans le cas de l’US 5 de la structure 38, il est difficile de proposer une chronologie précise mais il est raisonnable de penser que la formation de ce niveau, qui précède immédiatement la construction, se situe au IXe ou au début du VIIIe siècle, soit vers la transition Bronze/Fer telle qu’elle peut être définie dans le sud de la Corse (Peche-Quilichini, 2012, à paraître).
61
Fig. 59 – Structure 38, mobilier céramique de l’US 5
Fig. 60 – Structure 38, mobilier céramique de l’US 7
L’US 7 a livré 202 tessons. Parmi les éléments les plus caractéristiques, il faut en premier lieu citer une forme basse (fig. 60, n° 1) et une deuxième probable (fig. 60, n° 2). Il s’agit de morphotypes à paroi rectiligne évasée, portant une anse rubanée et à fond aplati sur vannerie pour la seconde. Il s’agit de formes très typiques du Bronze final (Peche-Quilichini, 2009, à paraître). Du même horizon chronologique datent vraisemblablement plusieurs exemplaires de jarres bitronconiques à col évasé plus ou moins articulé (fig. 60, n° 3, 4, 7-9 et 12). La jarre fermé à lèvre à inflexion interne segmentée (fig. 60, n° 11) autorise d’intéressants rapprochements avec le Bronze final 2 de la structure 6. En revanche, la jarre ovoïdale à cordon digité (fig. 60, n° 5) appartient sans conteste au premier âge du Fer. La présence d’un vase à paroi portant des jours subcirculaires alignés (fig. 60, n° 13) est une constante déjà évoquée pour les US sus-jacentes.
62
Particulièrement originale est une grande jatte tronconique ouverte, qui porte des bandes peintes légèrement obliques (fig. 60, n° 10). Ces traits parallèles d’épaisseur variable partent de la lèvre. La « peinture » utilisée semble être la même matière que celle utilisée pour les étanchéifiants mis en évidence par le passé (Rageot et al., à paraître). Il s’agit d’un cas unique sur le site. La forme du récipient évoque le Bronze final. Enfin, il faut noter la reconnaissance d’une empreinte de penne de fougère sur la face interne d’un fond (fig. 61), montrant que les vases étaient mis à sécher en position normale (et non renversés)9.
Figure 61 – US 7 ; face interne d’un fond plat avec empreinte de penne de fougère (Pteridium aquilinum)
uniquement observable en lumière rasante artificielle. Remarquer l’aménagement crénelé de la zone accueillant la paroi, destiné à améliorer l’accroche (variante de guillochage)
L’US 7, comme l’US 5, est un remblai de nivellement. Le mobilier provient d’un contexte probablement voisin. Si les formes du bronze final sont plus ici majoritaires, c’est toutefois l’élément le plus récent qui permet de dater cet apport sédimentaire anthropique rapide du début du premier âge du Fer. On peut donc raisonnablement envisager une contiguïté chronologique entre les deux niveaux de remblaiement.
9 En 2012, l’individualisation de traces de tissu sur la face externe d’un fond avaient permis d’établir les mêmes conclusions qui, en soi, sont très logiques, mais peuvent ici être directement observées.
63
2.4 Premières conclusions chrono-fonctionnelles La structure 38 se démarque nettement des autres constructions « domestiques » du site de par sa taille. En revanche, formes et techniques d’aménagement du soubassement de gros blocs est assez classique, même si le remploi d’une meule constitue ici une petite originalité. La fouille a permis d’observer une disposition des poteaux porteurs partiellement superposable à celles observées dans les structures 1, 3 et 6. C’est avec la structure 1 de Nuciaresa (Peche-Quilichini et al., à paraître), probablement construite vers la fin du VIIe siècle, que les analogies sont le plus flagrantes. La préparation du terrain ayant précédé la construction a été pensée par remblaiements successifs, suivant une organisation raisonnée, puisque les trous de poteau ont été installés avant le soubassement. Les mêmes conclusions ont été proposées pour la voisine structure 6, construite au début du XIIe siècle (Peche-Quilichini et al., à paraître). Un deuxième parallèle structurel, résidant dans l’optimisation des faces verticales des blocs alentours, peut être proposé pour les structures 6 et 38. Parmi les vides documentaires, il faut noter que la construction ne présente, en son état actuel, pas d’entrée aménagée. On pourrait cependant imaginer un accès sous forme de rampe, par le nord. Aucune banquette, foyer ou autre type de structuration interne n’a été identifié. Cette absence, ainsi que le caractère secondaire de la position des mobiliers, ne permet pas d’approcher la fonctionnalité, supposée particulière en raison des dimensions modestes, de la structure 38. En conséquence, les hypothèses initiales, qui en faisaient un réduit, une zone de réserves ou la dépendance10 d’une habitation voisine (structure 9 ?), ne peuvent être ni confirmées ni infirmées. En partie pour les mêmes raisons, la chronologie de la construction, de l’occupation et de l’abandon ne peut être fixée avec certitude. Les niveaux de construction sont constitués d’apports sédimentaires anthropiques massifs, que l’on fixe aux IXe/VIIIe siècles, dont le matériau a vraisemblablement été pris dans les couches d’occupation d’un contexte voisin occupé durant toute la seconde moitié du Bronze final. Les niveaux d’occupation de la structure 38 ont été lessivés et remplacés par un sédiment humique et colluvial issu de la dégradation de plusieurs structures placées immédiatement en amont. En dépit des informations lacunaires fournies par la fouille, la structure 38 offre un nouveau degré de diversité au sein de l’entité villageoise de Cuciurpula et renforce un peu plus le caractère complexe de l’organisation du site.
10 Le cas avait été observé pour les petites structures 14 et 15, établies à quelques mètres au nord et à l’est de la structure 1.
65
1. Rappel des campagnes précédentes L’étude des cheminements sur le site de Cuciurpula a débuté en 2011 avec l’identification et l’exploration en surface de quatre d’entre eux. Le chemin A, reliant la structure 21 aux structures 26 et 31, sur lequel plusieurs structures ont été identifiées. Le chemin A’ , dont le départ se situe à proximité de la structure 26. Le chemin B, reliant la fontaine des charbonniers à la structure 20 à l’aide d’une rampe (B1). Le chemin C, reliant plusieurs structures, et sur lequel de nombreux aménagements légers ont été remarqués, notamment un escalier (C1). En 2012, l’étude s’est poursuivie avec la fouille de trois structures sur un chemin nouvellement identifié, le chemin D. Ont ainsi été fouillés les rampes D3 et D7, ainsi que l’escalier D4. Ces fouilles avaient permis de mettre en évidence certains principes architecturaux valables pour la construction, comme pour l’utilisation de toutes les structures, comme l’utilisation des affleurements granitiques naturels. C’est également lors de cette campagne que le problème de la datation de ces aménagements, déjà envisagé lors de la campagne précédente, s’était précisé, tout comme les problèmes de sécurité pour la fouille de ces structures, très instables une fois le niveau d’empierrement atteint. En parallèle de ces recherches, un recensement de tous les aménagements existant sur le chemin D a été réalisé, mettant en avant la présence sur son tracé de six escaliers, sept rampes, une plateforme et un carrefour. De nombreuses voies secondaires partant de ce chemin ont également été cataloguées. Plusieurs d’entre elles mènent à de petites terrasses à vocation probablement agricole.
Fig. 62 – Vue d’ensemble de la structure fouillée en 2013 (rampe A’’1)
66
2. Campagne 2013 Cette année, les recherches ont porté sur le chemin A’’1 (fig. 62). Situé à proximité de la structure 21, il part du chemin A et descend vers un replat. Les différents aménagements sur son tracé ont été identifiés et répertoriés. L’un d’entre eux, la rampe A’’1, a été fouillé. Comme les rampes D3 et D7, fouillées en 2012, cette structure prend place sur les affleurements granitiques ; des murs de soutènement venant compléter les espaces vacants. Toutefois, cette rampe présente de nombreuses particularités dues à son orientation nord/sud. Effectivement, à l’inverse des rampes D3 et D7, son axe longitudinal suit le dénivelé de la montagne, augmentant ainsi le pourcentage de déclivité (40%), bien plus élevé que celui de D3 (25%) ou D7 (30%). Ainsi, pour les aménagements étudiés jusqu’à maintenant, on avait comme organisation architecturale (fig. 63) :
- Partie basse : affleurement granitique / petit blocs de dallage / mur de soutènement ; - Partie haute : affleurement granitique / gros blocs de dallage / affleurement granitique.
Fig. 63 – Schéma d’organisation architecturale des rampes D3 ou D7
La rampe A’’1 présente comme organisation architecturale (fig. 64) :
- Partie basse : mur de soutènement / escalier / affleurement granitique ; - Partie médiane : affleurement granitique / petits blocs puis gros blocs de dallage / mur
de soutènement ; - Partie haute : affleurement granitique / gros blocs de dallage / affleurement granitique.
Fig. 64 – Schéma d’organisation architecturale de la rampe A’’1
67
Trois changements majeurs sont donc à noter pour cette rampe. Premièrement, la rupture de pente, avec le passage d’une aire de marche étagée (escalier), à une aire de marche plane (rampe). Deuxièmement, le mur de soutènement médian qui doit supporter des blocs de gros calibre, et non plus seulement des blocs de petits ou moyen calibre. Enfin, la présence d’aménagements de part et d’autre du chemin et non plus d’un seul côté comme c’était le cas jusque-là.
Fig. 65 – Relevé en coupe de la section longitudinale
La coupe nord-sud (section 1 ; fig. 65), installée au seul endroit possible avant la mise au jour du niveau d’empierrement, s’est révélée assez décevante ; son tracé se trouvant systématiquement sur les pointes des blocs ou sur les espaces inter-blocs. C’est pourquoi un relevé stratigraphique (section 2 ; fig. 70A), un relevé en coupe de la chaussée (section 3 ; fig. 70B) et un relevé en coupe de l’escalier (section 4 ; fig. 67) ont été réalisés. À cela s’ajoute un relevé d’élévation du mur 1 (fig. 72) et un relevé du niveau d’empierrement (fig. 69)
Fig. 66 – Vue en contre-plongée de l’escalier
68
Fig. 67 – Relevé en coupe de l’escalier
L’escalier est composé de cinq marches et prend appui sur un mur sommaire (M. 2) constitué de blocs de moyen et gros calibre s’appuyant au nord sur le substrat. L’escalier a connu de légères perturbations. La marche du haut a en effet légèrement basculé, inclinant ainsi l’aire de marche. En bas, on remarque également un espace laissé vacant par une pierre probablement déplacée par un phénomène érosif11 (droite sur les figures 66-68).
Fig. 68 – Vue zénithale de l’escalier
Le sondage 1 a été ouvert au pied de l’escalier. Sous un niveau constitué d’humus (US 1), puis un niveau d’humus altéré (US 2), nous avons atteint un niveau de dégradation organique (US 3) sur lequel repose la pierre déplacée de l’escalier. Cette US, au sédiment pulvérulent et fortement perturbée par des racines ne contenait que peu de céramique. Se sont ensuivis des niveaux de comblements : L’US 4, épaisse d’une dizaine de centimètres est composée d’un sédiment brun foncé, compact et homogène. Elle ne comprenait que peu de tessons, ceux-ci étant cependant bien
11 Le niveau d’humus, important par endroits et presque absent à d’autres, laisse penser que ces structures subissent assez fortement l’érosion. Cela semble être confirmé par l’état du niveau d’empierrement des rampes fouillées l’an dernier, et plus particulièrement de celui de la rampe D7, qui, n’ayant pas été recouvert après la campagne de 2012, a connu de nombreuses modifications gravitaires ; la majorité des blocs s’étant déplacés.
69
conservés. On y a retrouvé également du matériel lithique (trois éclats de quartz et un probable polissoir). L’US 7, épaisse de 30 centimètres est composée d’un sédiment noir compact et riche en arène granitique. Le mobilier céramique retrouvé était très dégradé, tout comme les blocs de granite qui se délitaient, témoignant sans doute de l’acidité du sédiment. On y note également la présence de charbons et d’un fragment de molette. L’US 8, épaisse de 20 centimètres est composée d’un sédiment gris très compact. Elle a fourni du mobilier céramique en quantité, dont pour les plus notables, cinq panses, un bord, une carène et deux languettes, qui nous ont permis de la dater des environs du VIIe siècle avant J.-C. Cette US comprenait également des blocs de petit calibre ainsi que de petites pierres. L’US 10, est située à environ un mètre de profondeur. Il s’agit d’un niveau de comblement naturel.
Fig. 69 – Relevé planimétrique du niveau d’empierrement de la rampe et de l’escalier
Comme nous l’avons vu auparavant, l’organisation architecturale de cette rampe diffère totalement de celle observée les années précédentes. Le niveau d’empierrement (US 5) était recouvert par un niveau d’humus (US 1) et un niveau d’humus altéré (US 2), dans lequel des tessons roulés, un éclat de quartz et une molette ont été retrouvés. L’US 5 est hétérogène, passant de blocs de moyen voire gros calibre en haut de la rampe, elle est constituée de blocs de petits calibres sur le bas (fig. 69 et fig. 70B). Le sondage 2, ouvert en bas de la rampe, nous a donné des informations sur les différentes couches de préparation de l’US 512. On constate ainsi la présence d’un niveau constitué de pierres plates de petit calibre (US 6 ; fig. 71A), reposant lui-même sur un niveau de pierres plus petites (US 9 ; fig. 71B) dans lequel du mobilier céramique, deux fragments de panse et un bord datables du premier âge du Fer, a été retrouvé. Le sondage s’est arrêté sur l’US 11, correspondante au comblement de la rampe. En
12 L’installation d’un sondage sur ce type de structure n’est pas aisée. Effectivement, au regard de la stabilité de l’ensemble, du poids de certains blocs, mais aussi, et surtout, de la sécurité des fouilleurs, peu d’endroits se prêtent à la fouille. C’est pourquoi il faut garder à l’esprit que ce qui a pu être constaté sur ce sondage ne l’a été que sur une fenêtre étroite et ne saurait donc, pour l’heure, être généralisé à l’ensemble de ce type de structures.
70
reprenant la terminologie moderne13, l’US 11 est la couche de mise en forme, les US 9 et 6 sont les couches de fondation, l’US 5 est la couche de base, au-dessus de laquelle reposait la couche de surface, aujourd’hui disparue.
Fig. 70 – A : coupe ouest/est réalisée en bordure du sondage, en haut de la rampe ;
B : coupe ouest/est de la chaussée Le mur de soutènement M. 1 (fig. 72) prend appui, sur deux affleurements granitiques massifs. Son sommet présente une organisation sommaire en écailles de poisson. Avec ses 2,5 m de long, il est bien plus grand que ceux observés jusqu’alors. Le contrefort, qui assurait sa stabilité, a glissé vers l’est, laissant un espace vacant d’environ 20 cm entre lui et le mur (fig. 73). Si ce dernier est encore debout, sa stabilité à long terme semble cependant compromise.
Fig. 71 – A : Sondage 2, US 6 ; B : Sondage 2, US 9
13 Cette terminologie, qui reste pour l’heure la plus adaptée, n’a cependant pas vocation à être définitive. Nous espérons pouvoir l’affiner dans les années à venir.
71
3. Datation et contexte L’ensemble du mobilier céramique retrouvé était datable du premier âge du fer, avec pour l’un des niveaux de comblement observé dans le sondage 1 (US 8), une datation tournant autour du VIIe siècle. Cette datation correspond d’ailleurs à celle de la structure 2114 et donc probablement du secteur.
Fig. 72 – Relevé d’élévation du mur 1
L’intégralité du chemin A’’ a été parcouru. On y dénombre :
- La rampe A’’1, - Les rampes A’’2 et A’’3, assez longues et en pente douce, - Une grande charbonnière, peut-être installée sur une terrasse protohistorique, - Les rampe A’’4 et A’’5, endommagées et ne présentant que peu d’aménagements, - Arrivée sur un replat formé de plusieurs grandes terrasses naturelles.
Ce chemin semble donc avoir été bâti pour faciliter des trajets dont la vocation serait l’accès à une possible zone agricole. Il est également fort probable qu’il ait fonctionné avec la structure 21 qui est contemporaine. Cependant, et comme cela a été souligné les années précédentes, la rareté des informations empêche toute certitude quant à la chronologie d’édification et de fonctionnement de la structure.
Fig. 73 – Vue zénithale du contrefort du mur 1
14 Voir rapport d’opération 2010, p. 50-56.
72
4. Perspectives De la campagne 2013, nous retiendrons principalement la mise en évidence d’une architecture différente pour les rampes selon leur orientation, témoignant, s’il en était besoin, de l’adaptabilité des habitants de Cuciurpula à la configuration du terrain. La question de la datation précise de ces rampes reste toujours sur la table, et si leur appartenance à l’occupation du site est quasiment certaine, nous espérons cependant parvenir à le prouver de façon définitive dans les années à venir. Ainsi, pour les campagnes futures nous préconisons de fouiller la portion du chemin A, identifiée en 2011, qui comprend dans ce secteur des aménagements encore inédits, comme la plateforme A3 ou le chemin en lacet A’1, ainsi qu’une portion plate de chemin ne présentant que peu, voire pas, d’aménagements.
74
1. Principaux acquis de la campagne 2013 L’achèvement de la fouille de l’espace interne de la structure 3 a permis de compléter le schéma d’organisation spatiale de cette habitation que son faciès céramique attribue à la fin du VIIe ou au VIe siècle av. J.-C., ce que confirme une datation isotopique réalisée sur des résidus carbonisés conservés sur un tesson. En dépit de remaniements importants dus aux racines, l’étude de la répartition des mobiliers montre une organisation cohérente des vestiges. Elle autorise notamment à identifier deux aires d’activités principales. L’une, en partie dévolue au stockage, à l’intérieur de l’habitation, et une seconde organisée autour d’un foyer dans l’entrée de celle-ci. Cette structure de combustion excavée jusqu’au substrat se démarque des autres foyers reconnus sur le site. Elle conservait les charbons du combustible utilisés pour sa dernière utilisation, ce qui nous fournira de précieuses indications sur l’approvisionnement en bois des habitants et sur l’environnement du site, qui pourront compléter celles déjà acquises sur la structure 1. La fouille de 2013 a également permis de finaliser la lecture de l’organisation architecturale de la structure 3 et en particulier de son système d’entrée. A l’est comme à l’ouest, on observe une modification structurelle de l’architecture par rapport à celle du corps de la structure caractérisée par de grandes dalles dressées sur leur longueur. A l’est un système de renfort constitué d’un second parement et d’un blocage interne avait déjà en partie été observé. L’achèvement de la fouille a confirmé cette organisation, qui joue probablement un double rôle : celui de rétrécir l’entrée de l’habitation tout proposant une banquette à proximité du foyer. A l’ouest, l’architecture en pierre a fortement été bouleversée par un arbre et son réseau racinaire, l’observation des calages permet toutefois d’en restituer une partie. On note ici l’emploi de pierres de plus petite taille dressées de champs et disposées en file régulière. Enfin, la présence d’un nouveau trou de poteau, comportant une meule parmi ses pierres de calages, vient confirmer la présence d’une toiture oblique par rapport aux parois de l’habitation. Le modèle architectural de la structure 3 est donc à la fois proche et différent de celui des autres habitations fouillées sur le site. Son système d’entrée, ses dimensions, son architecture en matériau périssable et la forme de son foyer se distinguent notamment de la structure 1 à laquelle elle pourrait être en partie contemporaine, ou du moins proche chronologiquement. Ces deux habitations témoignent néanmoins de principes communs dans les techniques mises en œuvre pour l’architecture en pierre et dans l’occupation de l’espace interne. La fouille de la structure 3 enrichie donc significativement notre connaissance de l’habitat du premier âge du Fer de l’Alta Rocca et illustre la variabilité des choix pouvant être exercé par les habitants d’un même village en dépit de critères techniques et symboliques communs. Le choix de fouiller la structure 38 a été réalisé car l’édifice se démarque nettement des autres constructions « domestiques » du site de par sa taille réduite. Sa forme générale et la technique d’aménagement du soubassement de gros blocs est toutefois assez classique, même si le remploi d’une meule constitue une originalité certaine. La fouille a permis d’observer une disposition des trous de poteau partiellement superposable à celles observées dans les autres habitations. C’est avec la structure 1 de Nuciaresa, à Lévie, probablement construite vers la fin du VIIe siècle, que les analogies sont le plus flagrantes. La préparation du terrain ayant précédé la construction a été réalisée en deux remblaiements successifs, suivant une organisation planifiée, puisque les poteaux ont été installés avant le solin pérenne. Les mêmes conclusions avaient été proposées pour la structure 6, construite au Bronze final (Peche-Quilichini et al., à paraître). Parmi les vides documentaires, il faut noter que la construction ne présente, en son état actuel, pas d’entrée aménagée, même si on suppose un accès sous forme de déclivité aménagée, par le nord. Aucune autre structuration interne n’a été identifiée. Cette absence, ainsi que le caractère secondaire de la position des mobiliers, ne permet pas
75
d’approcher la fonctionnalité, supposée particulière en raison des dimensions modestes, de la structure 38. En conséquence, les hypothèses initiales, qui en faisaient un réduit, une zone de réserves ou la dépendance d’une habitation voisine (structure 9 ?), ne peuvent être ni confirmées ni infirmées. La chronologie de la construction, de l’occupation et de l’abandon ne peut, pour les mêmes raisons, être fixée avec certitude. Les niveaux de construction sont constitués d’apports sédimentaires anthropiques massifs, que l’on fixe aux IXe/VIIIe siècles, soit durant la transition bronze/Fer. Le matériau constituant le remblai a vraisemblablement été pris dans les couches d’occupation d’un contexte voisin occupé durant la seconde moitié du Bronze final. Les niveaux d’occupation de la structure 38 ont été lessivés et remplacés par un sédiment humique et colluvial issu de la dégradation de plusieurs structures placées immédiatement au-dessus d’elle. En dépit des informations lacunaires fournies par la fouille, la structure 38 offre donc un nouveau degré de diversité au sein de l’entité villageoise de Cuciurpula et renforce un peu plus le caractère complexe de l’organisation du site. Depuis les premières constatations en 2010, la problématique d’étude des paléocheminements intra-site a pu se développer grâce au rodage des méthodes d’investigations. Aujourd’hui, les circuits de cheminement, lorsqu’ils ont été aménagés, que ce soit par une construction ou, au contraire, par un dégagement. La poursuite des travaux a consisté à dégager la rampe A’’1, édifiée sur un secteur de fort pendage. La fouille a permis de collecter plusieurs indices tendant à démontrer que la construction date des environs de 900-700 avant notre ère. En outre, ces recherches ont permis d’observer des récurrences et des nouveautés dans les modes d’agencement, étape préalable et nécessaire à la réalisation progressive d’une typologie. Enfin, on notera avec intérêt deux découvertes effectuées en surface, en 2013, à proximité de la structure 38 et de l’abri 3. La première est un anneau de pâte de verre blanc, ou « anneau porcelainique » dans la littérature régionale. Il s’agit d’un élément extrêmement fréquent dans les contextes sépulcraux des IIIe-Ier siècles, qui pourrait donc trahir l’existence sur le site de tels contextes, jamais observés jusqu’à présent mais seulement supposés d’après l’interprétation du mobilier du second âge du Fer de l’abri 3, présenté dans le rapport d’opération 2011. Un fragment de récipient appartenant à une vaisselle tournée à pâte orangée a été collecté juste à côté. Son identification chrono-culturelle pose problème mais sa présence montre que du mobilier céramique d’importation a pu, comme à Nuciaresa, pénétrer jusqu’en Alta Rocca, à une époque qui reste à déterminer.
76
2. Perspectives 2014-2015 Les opérations 2014 et 2015 viseront à améliorer notre connaissance des espaces domestiques du site de par l’ouverture des habitations 26 (près du chemin A’’1 ; direction T. Lachenal) et 23 (à proximité de la structure 3; direction K. Peche-Quilichini), qui permettra d’approcher une certaine exhaustivité dans la couverture du site (fig. 74). Les recherches sur les structures de circulation se poursuivront à proximité, en amont et en aval, de la rampe A’’1, en lien direct avec l’excavation de la structure 26, afin d’estimer au mieux les liens entre ce chemin et l’habitation (direction S. Delvaux). L’équipe italienne engagera des recherches d’ampleur limitée dans les abris 4 et 5 (direction M. Milletti), qui se trouvent autour de l’abri 3, présenté lors de l’opération 2011, afin de cerner le contexte d’utilisation des cavités, bien plus complexe (et probablement multiple) que celui des autres structures du site.
Figure 74 – Situation des structures 23 et 26 (en rouge) et des habitations fouillées jusqu’en 2013 (en noir)
77
Les travaux se poursuivent au-delà des phases de terrain. Les études anthracologiques et carpologiques s’enrichissent chaque année de nouveaux corpus, pour des époques et des contextes différents. Les travaux sur les matières synthétiques (étanchéifiants, peintures et adhésifs) feront l’objet d’une réunion de travail spécifique le 27 janvier 2014 au sein du CEPAM, afin de préciser l’orientation à leur donner et d’évoquer le cas de l’énorme corpus de résidus alimentaires, aujourd’hui toujours inédit. Le mobilier céramique fera en 2014 l’objet d’une approche synthétique, contextualisée et comparée avec la Sardaigne septentrionale, dans le cadre d’un contrat post-doctoral LABEX au sein l’UMR 5140. Les analyses tracéologiques et spectrométriques sur hématite réalisées par Maryline Lambert ont fourni cette année leurs premiers résultats, montrant un probable frottage de ces éléments (fig. 74), à l’origine de leur mise en forme particulière.
Figures 74a et 74b – Macroclichés de l’élément en hématite n° 3149 de l’US 103 de la structure 1
(photos : M. Lambert) Enfin, on signale que Cuciurpula sera l’objet, courant 2014, d’une première monographie destinée au grand public.
78
3. Résumé L’opération 2013 a consisté en la poursuite et l’achèvement de l’étude de l’habitation 3, en l’ouverture de la structure 38 et en le prolongement des fouilles sur les cheminements aménagés. L’achèvement de la fouille de l’espace interne de la structure 3 a permis de compléter le schéma d’organisation spatiale de cette habitation de la fin du VIIe ou du VIe siècle av. J.-C. Elle autorise notamment à identifier deux aires d’activités principales. L’une, en partie dévolue au stockage, à l’intérieur de l’habitation, et une seconde organisée autour d’un foyer dans l’entrée de celle-ci. Cette structure de combustion excavée jusqu’au substrat, qui conservait les charbons de sa dernière utilisation, se démarque en cela des autres foyers reconnus sur le site. La fouille a également permis de finaliser la lecture de l’organisation architecturale de la structure 3 et en particulier de son système d’entrée, composé à l’est d’un système de renfort constitué d’un second parement et d’un blocage interne, et à l’ouest de l’emploi de pierres dressées de champs et disposées en file régulière. La présence d’un nouveau trou de poteau vient par ailleurs confirmer la présence d’une toiture oblique par rapport aux parois de l’habitation. Le modèle architectural de la structure 3 est donc à la fois proche et différent de celui des autres habitations fouillées sur le site. Il illustre en cela la variabilité des choix pouvant être exercé par les occupants d’un même village en dépit de critères techniques et symboliques communs. La fouille de la structure 38, un édifice dont le plan évoque une habitation aux dimensions réduites (4 x 2 m), n’a pas permis de préciser ses aspects fonctionnels. Les niveaux inférieurs, sont constitués d’un remblai riche en mobilier céramique, datable jusqu’au tout début du premier âge du Fer, ce qui permet de situer la construction sur l’échelle chronologique. Quatre trous de poteau, agencés de façon assez classique pour le site et aménagés dans cette couche, renseignent l’aspect des parties aériennes. Les niveaux d’occupation ont été emportés. La structure 38 apparaît comme un type de bâtiment intimement lié au fonctionnement général de l’habitat, peut-être de la voisine habitation 9, avec un rôle qui reste à préciser. Concernant les aménagements de circulation, la structure A’’1 témoigne, comme celles fouillées l’an passé, de l’adaptabilité de l’architecture à la morphologie du terrain, avec ici une construction qui combine rampe et escalier, seule solution trouvée pour contrer la forte déclivité de la pente. Cette structure, qui s’inscrit dans l’aménagement global de la zone, où habitation et terrasses agricoles sont reliées, n’est cependant toujours pas datable avec précision.
79
4. Bibliographie exhaustive sur la problématique AMICI S. – Studio dei materiali ceramici dell’US 105 della Capanna 1 di Cuciurpula, un abitato dell'età del Ferro nell'Alta Rocca, Corsica, Tesi di Laurea Triennale, Università di Roma I, en cours. ANTOLINI G.F. – L’âge du Fer dans le Niolu, dans : PECHE-QUILICHINI K. (dir.) – L’âge du Fer en Corse – Acquis et perspectives, Actes de la table ronde de Serra-di-Scopamène (août 2009), Associu Cuciurpula, 2012, pp. 58-75. CHENORKIAN R. – Pratique archéologique statistique et graphique, Paris, Errance, 1996, 162 p. DELEFOSSE C. – Production domestique et consommation du matériel de mouture et broyage à la fin du Néolithique en Provence Occidentale, Master 2 d'Archéologie, Université Aix-Marseille, Aix-en-Provence, 2012, 220 p. GROUPE MEULE – Les meules du Néolithique au Moyen Âge : élaboration de protocoles d'enregistrement et premières analyses, Archéopages, 28, 2010, pp. 84-93. HAMON C. – Broyage et abrasion au Néolithique ancien : caractérisation technique et fonctionnelle des outillages en grès du Bassin parisien, Oxford, Archaeopress, 2006, 342 p. (British archaeological Reports - International Series, 1551). HAMON C., FARGET V., JACCOTTEY L., MILLEVILLE A. et MONCHABLON C. – Propositions de normes de dessin et d'une grille d'analyse pour l'étude des meules va-et-vient du Néolithique à l'Age du Fer, dans : BUCHSENSCHUTZ O., JACOTTEY L. et JODRY F. (dir.) – Evolution typologique et technique des meules du Néolithique à l'an mille. Actes des IIIe rencontres archéologiques de l'Archéosite gaulois, Bordeaux, 2011, pp. 39-50 (Aquitania, supplément 23). LAMBERT M. – Haematite supplies in the Late Bronze Age / Early Iron Age at Cuciurpula, Southern Corsica. Chemical characterization and determination of provenance, Mémoire de master, University of Nottingham, en cours. LANFRANCHI (de) F. – Les sépultures de Santa Catalina et de Cucuruzzu. Communication préliminaire, Corse Historique, 29-30, 1968, pp. 67-87. LANFRANCHI (de) F. – Capula. Quatre millénaires de survivances et de traditions, Centre Archéologique de Lévie, 1978, 390 p. LANFRANCHI (de) F. – Les résultats d’un premier sondage dans le village protohistorique de Cucuruzzu (Lévie, Corse), Bulletin de la Société Préhistorique Française, LXXVI, 1979, pp. 80-86. LANFRANCHI (de) F. – La station préhistorique de Compolaggia, Archeologia Corsa, 4, 1979, pp. 49-51. LANFRANCHI (de) F. et ALESSANDRI J. – Nouvelles données sur l’habitat du premier âge du Fer en Alta Rocca (première partie), dans : LANFRANCHI (de) J. (dir.) – Quoi de neuf en archéologie ? Actes des XIIIe Rencontres du Musée de l’Alta Rocca (Levie, novembre 2011), Levie, 2013, pp. 79-101. LECHENAULT M. et PECHE-QUILICHINI K. – L’âge du Fer, dans : PASQUALAGGI D. et MICHEL F. (dir.) – La Corse, Cartes Archéologiques de la Gaule, Bordeaux, à paraître. LEROI-GOURHAN A. – Milieu et techniques : évolution et techniques, Paris, Albin Michel, 1945 (rééd. 1992), 475 p. (Sciences d'aujourd'hui, 2). MILANINI J.-L. – Cozza Torta et la question du premier âge du Fer dans l’extrême sud de la Corse, dans : PECHE-QUILICHINI K. (dir.) – L’âge du Fer en Corse – Acquis et perspectives, Actes de la table ronde de Serra-di-Scopamène (août 2009), Associu Cuciurpula, 2012, pp. 27-34. MILANINI J.-L., DAVID H., PASQUET A. et TRAMONI P., La sépulture de l’Age du Fer de Tappa 2 (Purtivecchju, Corse-du-Sud), Documents d’Archéologie Méridionale, 31, 2008, pp. 131-151.
80
MILANINI J.-L., TRAMONI P., GANTES L.-F. et PASQUET A. – Cozza Torta (Porto-Vecchio, Corse-du-Sud), habitat indigène du VIe s av J-C : note préliminaire sur les rapports entre indigènes, Étrusques et Massaliètes, Bulletin de la Société Préhistorique Française, CIX, 2012, pp. 689-730. MILLETTI M., PECHE-QUILICHINI K., AMICI S., BIANCIFIORI E., DELVAUX S., LACHENAL T., MOTTOLESE C., PALLONE V., PALMIERI S., PRETTA G., PY V., SACRIPANTI L. et SARTINI E. – Cuciurpula, Serra-di-Scopamena/Sorbollano (Corse-du-Sud): nuovi dati su un insediamento protostorico corso (campagne 2008-2011), Materiali per Populonia, 9-10, 2012, pp. 377-444. MILLETTI M., PECHE-QUILICHINI K., AMICI S., BIANCIFIORI E., DELVAUX S., LAMBERT M., MARTIN L., MAYCA J., PALMIERI S. et SARTINI E. – Cuciurpula, Serra-di-Scopamena/Sorbollano (Corse-du-Sud), scavi 2012, Materiali per Populonia, 11, à paraître. MILLEVILLE A., « De la pierre à la meule » durant le Néolithique, circulation et gestion des matières premières entre Rhin et Rhône, thèse de doctorat en archéologie, Université de Franche-Comté, 2006, 414 p. MOTTOLESE C., COLOMBA CARRARO C., PECHE-QUILICHINI K., AMICI S., MILLETTI M. et VOLPI A. – Puzzonu (Quenza, Corsica): gli scavi della capanna 7 e la problematica dell’abitato in Corsica e in Sardegna durante la transizione Bronzo/Ferro (sec. IX-VIII a.C.), Materiali per Populonia, 11, à paraître. PECHE-QUILICHINI K. – Le vase de fondation zoomorphe du premier âge du Fer de Cuciurpula (Serra-di-Scopamène/Sorbollano, Corse-du-Sud), Bulletin de la Société Préhistorique Française, CVII, 2010, pp. 371-381. PECHE-QUILICHINI K. – Cuciurpula : un village de l’âge du Fer dans la montagne corse, Archeologia, 477, 2010, pp. 16-26. PECHE-QUILICHINI K. – La maison 6 de Cuciurpula et l’émergence des villages « ouverts » au Bronze final dans le sud de la Corse, Stantari, 29, 2012, pp. 64-65. PECHE-QUILICHINI K. (dir.) – L’âge du Fer en Corse – Acquis et perspectives, Actes de la table ronde de Serra-di-Scopamène (août 2009), Associu Cuciurpula, Ajaccio, 2012, 130 p. PECHE-QUILICHINI K. – Dal Bronzo finale al primo Ferro nell’altro lato delle Bocche… Evidenze archeologiche di trasformazioni culturali in Corsica meridionale nei secoli XIII a VII a.C., dans : LUGLIE C. (dir.) – Preistoria e Protostoria della Sardegna, Atti della XLIV Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (Cagliari, novembre 2009), 2012, pp. 1109-1114. PECHE-QUILICHINI K. – Le Bronze final et le premier âge du Fer de la Corse : chronologie, production céramique et espaces culturels, Acta Archaeologica, 83, 2012, p. 203-223. PECHE-QUILICHINI K. – Villages et fortifications indigènes de l’âge du Fer en Corse, Archéo-Théma, 28, 2013, pp. 74-79. PECHE-QUILICHINI K. (dir.) – Cuciurpula, un grand habitat des environs de l’an 1000 av. J.-C. dans les montagnes de l’Alta Rocca, Guides Archéologiques de la Corse, 2, Piazzola-Mediani, Ajaccio, à paraître. PECHE-QUILICHINI K. – « Bols, paniers et grains de riz ». Les vaisselles céramiques du Bronze final et du premier âge du Fer de Corse. Façonnage, morphologie, modes de consommation, chronologie et significations culturelles d’une production insulaire, Monographies d’Archéologie Méditerranéenne, Montpellier-Lattes, à paraître. PECHE-QUILICHINI K. – Interactions culturelles ? Oui et non. Processus de régionalisation des productions matérielles et des modes d’acquisition de modèles exogènes en Corse à l’âge du Bronze et au premier âge du Fer, dans : BARBAU C. et LABRUDE A. (dir.) – Actes du Séminaire doctoral de Protohistoire « Les interactions culturelles en Europe » (Strasbourg, novembre 2012), à paraître.
81
PECHE-QUILICHINI K. – « Entre riz et peigne… ». Le mobilier du deuxième âge du Fer initial de l’abri 3 de Cuciurpula (Corse) : une illustration de la reprise funéraire d’un espace domestique délaissé ?, Rassegna di Archeologia, à paraître. PECHE-QUILICHINI K. – Influences, inspirations ou transferts ? La question des affinités corso-toscanes dans les productions matérielles protohistoriques, dans : CAMPOREALE G. et BRIQUEL D. (dir.) – Aleria e Populonia. Atti del XXVIIIo Convegno di Studi Etruschi ed Italici (Bastia, Piombino, octobre 2011), à paraître. PECHE-QUILICHINI K. – Contributo cronologico e culturale dell’analisi dei vasellami ceramici del Bronzo finale e della prima età del Ferro di Corsica, Rivista di Scienze Preistoriche, à paraître. PECHE-QUILICHINI K. et LEANDRI F. – L’âge du Fer en Corse : un passé à l’imparfait. Acquis et perspectives, dans : PECHE-QUILICHINI K. (dir.) – L’âge du Fer en Corse – Acquis et perspectives, Actes de la table ronde de Serra-di-Scopamène (août 2009), Associu Cuciurpula, Ajaccio, 2012, pp. 7-12. PECHE-QUILICHINI K., TOMAS E. et BILARDI D. – La fortification médiévale de Cuciurpula (Serra-di-Scopamène et Sorbollano, Corse-du-Sud) : premiers éléments d’approche, Archéologie Médiévale, XXXIX, 2009, pp. 296-297. PECHE-QUILICHINI K., PY V. et REGERT M. – Exploitation des matières premières végétales en contexte insulaire montagnard : l’exemple de l’habitat du premier âge du Fer de Cuciurpula (Serra-di-Scopamène et Sorbollano, Corse-du-Sud), dans : DELHON C., THÉRY-PARISOT I. et THIÉBAULT S. (dir.) – Des hommes et des plantes : exploitation du milieu et gestion des ressources végétales de la Préhistoire à nos jours, Actes des XXXes Rencontres Internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes (Juan-les-Pins, octobre 2009), Anthropobotanica, 1, 2010, pp. 3-20. PECHE-QUILICHINI K., BERGEROT L., LACHENAL T., MARTINETTI D., PY V. et REGERT M. – Les fouilles de Cuciurpula : la structure 1, dans : PECHE-QUILICHINI K. (dir.) – L’âge du Fer en Corse – Acquis et perspectives, Actes de la table ronde de Serra-di-Scopamène (août 2009), Associu Cuciurpula, Ajaccio, 2012, pp. 35-57. PECHE-QUILICHINI K., LACHENAL T. et PRETTA G. – Nouvelles données sur l’habitat du premier âge du Fer en Alta Rocca (deuxième partie), dans : LANFRANCHI (de) J. (dir.) – Quoi de neuf en archéologie ? Actes des XIIIe Rencontres du Musée de l’Alta Rocca (Levie, novembre 2011), Levie, 2013, pp. 103-123. PECHE-QUILICHINI K., DELVAUX S., LACHENAL T. et LANFRANCHI (de) F. – Espaces de circulation, espaces de cheminement. Quelques « pistes » de réflexion pour le sud de la Corse entre Bronze final et premier âge du Fer, Bulletin de la Société Préhistorique Française, à paraître. PECHE-QUILICHINI K., LANFRANCHI (de) F. et SOURISSEAU J.-C. – Les fouilles de Nuciaresa (Levie, Corse-du-Sud) : l’habitation 1 (fin VIIe-VIe siècles av. J.-C.), Bulletin de la Société Préhistorique Française, à paraître. PECHE-QUILICHINI K., RAGEOT M. et REGERT M. – Procédés de réparation des récipients, recyclage et valorisation des déchets céramiques et lithiques chez les groupes protohistoriques corso-sardes, Bulletin de la Société Préhistorique Française, à paraître. PECHE-QUILICHINI K., BEC DRELON N., BIANCIFIORI E., BOUTOILLE L., MARTIN L., MAYCA J., RAGEOT M. et RECCHIA-QUINIOU J. – L’habitation 6 de Cuciurpula (Serra-di-Scopamena et Sorbollano, Corse-du-Sud). Eléments de définition chronologique, culturelle et économique du Bronze final 2-3 de Corse méridionale, dans : PERRIN T., SENEPART I., LEANDRI F. et CAULIEZ J. (dir.) – Chronologie de la Préhistoire Récente dans le Sud de la France. Acquis 1992-2012. Actualités de la recherche. Actes des Xes Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente (Ajaccio, octobre 2012), à paraître. PECHE-QUILICHINI K., CESARI J., BELLOT-GURLET L., CANOBBIO E., GRATUZE B., LEANDRI F., LEANDRI C., NEBBIA P. et PARIS C. – La Corse à l’aube des colonisations : les mobiliers d’importations antérieurs à la fondation phocéenne d’Alalia (565 av. J.-C.), dans : BARTOLONI P. (dir.) – Proceedings of the 8th International Congress of Phoenician and Punic studies (Carbonia-Sant’Antioco, octobre 2013), à paraître.
82
PICCARDI E., BONTEMPI J.-M., GRATUZE B., MARCHETTI M.-L., MILLETTI M. et PECHE-QUILICHINI K. – Iron Age glass objects in Corsica: evidences and analyses, dans : Living with Glass from Prehistory to the Early Middle Ages, Proceedings of the 19th International Archaeological Symposium (Pula-Zadar, novembre 2013), à paraître. PRETTA G. – La prima età del Ferro in Corsica: l’esmpio degli abitati in Alta Rocca, Corsica, Tesi di Laurea Specialistica, Università degli Studi di Padova, 2011, 153 p. RAGEOT M., PECHE-QUILICHINI K. et REGERT M. – Quand les Corses cherchaient du Bouleau… Archéologie, histoire et chimie des colles autour de 1000 av. J.-C., Stantari, 32, 2013, pp. 32-39. RAGEOT M., FERNANDEZ X., FILLIPPI J.-J., SACCHETTI F., PECHE-QUILICHINI K. et REGERT M. – Géochimie et archéologie des résines et des goudrons végétaux : nouveaux résultats pour les périodes néolithique et protohistorique dans le nord-ouest méditerranéen, dans : Actes de la 1ère Réunion Annuelle des Géochimistes Organiciens Français (Orléans, août 2012), à paraître. RAGEOT M., PECHE-QUILICHINI K., PY V., FILIPPI J.-J., FERNANDEZ X. et REGERT M. – Strategies of procurement, manufacturing and use of plant exudates and tars in Corsica during Iron Age, Journal of Archaeological Science, à paraître. RAGEOT M., FERNANDEZ X., FILLIPPI J.-J., SARRAZIN E., PECHE-QUILICHINI K., PY V., DELHON C. et REGERT M. – Du brai de bouleau en Corse à l’âge du Fer : nouvelles données chimiques, environnementales et archéologiques, dans : Archéométrie 2011, Actes du colloque du G.M.P.C.A. (Liège, Avril 2011), à paraître. RAGEOT M., PECHE-QUILICHINI K., SACCHETTI F., SAUREL M., LE HÔ A.-S., DELHON C., FILLIPPI J.-J., FERNANDEZ X. et REGERT M. – Résines et goudrons végétaux à l’âge du Fer en Méditerranée nord-occidentale : entre anciennes traditions et innovations ?, dans : Archéométrie 2013, Actes du colloque du G.M.P.C.A. (Caen, Avril 2013), à paraître. RAGEOT M., PECHE-QUILICHINI K., SACCHETI F., SAUREL S., FILIPPI J.-J., FERNANDEZ X. et REGERT M. – Résines et goudrons végétaux à l'âge du Fer en Méditerranée nord-occidentale : entre traditions et innovations, dans : Des amphores chez les Celtes hallstattiens. L’Europe et le vin de la Méditerranée archaïque, Actes du colloque international (Aix-en-Provence, novembre 2012), à paraître. RAGEOT M., PECHE-QUILICHINI K., FILLIPPI J.-J., FERNANDEZ X., PY V., DELHON C. et REGERT M. – Birch bark tar and Pine tar at Cuciurpula (Corsica, France) during the first Iron Age: between ancestral traditions and innovations ? dans : Proceedings of the Second International Symposium on Wood Tar and Pitch (Biskupin-Varsovie-Berlin, octobre 2012), à paraître. RECCHIA-QUINIOU J., PECHE-QUILICHINI K. et GIANNESINI G. – Neolithic and metal ages anthropomorphic and zoomorphic pots from Mediterranean contexts. Cases studies, sociological approach and persistence grade in the sub-actual societies, dans : IIo Congreso Internacional de Estudios Cerámicos. Etnoarqueología y experimentación. Más allá de la analogía (Grenade, mars 2013), à paraître. SCHOUMACKER A – Apports de la technologie et de la pétrographie pour la caractérisation des meules, dans : Traces et fonction : les gestes retrouvés. Actes du colloque international de Liège (décembre 1990), Etudes et Recherches archéologiques de l'Université de Liège (ERAUL), 50, Liège, Service de Préhistoire - Université, 1993, p. 165-174.
83
5. Table des matières ASPECTS ADMINISTRATIFS (p. 3) FICHE SIGNALETIQUE (p. 4) REMERCIEMENTS (p. 5) EQUIPE DE RECHERCHE (p. 6) EQUIPE DE FOUILLE (p. 8) I – LES HABITATIONS (p. 9) 1. Achèvement des travaux dans et devant la structure 3 (p. 10) 1.1 Présentation (p. 10) 1.2 Problématiques (p. 11) 1.3 Méthodologie et historique de l’intervention (p. 11) 1.4 Résumé des travaux antérieurs (p. 13) 1.5 Les aménagements domestiques et architecturaux (p. 18) 1.6 Phasage de l’occupation de la structure 3 (p. 26) 1.7 Le mobilier de la structure 3 (p. 30) 2. La structure 38 (p. 46) 2.1 Description et problématiques de l’étude (p.46) 2.2 Aspects stratigraphiques (p. 48) 2.3 Mobilier (p. 58) 2.4 Premières conclusions chrono-fonctionnelles (p. 63) II – LES CHEMINEMENTS AMÉNAGÉS (p. 64) 1. Rappel des campagnes précédentes (p. 65) 2. Campagne 2013 (p. 66) 3. Datation et contexte (p. 71) 4. Perspectives (p. 72) III – BILAN PRÉLIMINAIRE (p. 73) 1. Principaux acquis de la campagne 2013 (p. 74) 2. Perspectives 2014-2015 (p. 76) 3. Résumé (p. 78) 4. Bibliographie exhaustive sur la problématique (p. 79) 5. Table des matières (p. 83)