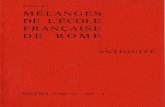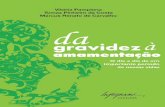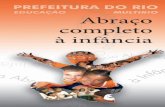Les mondes à part. Représentation des esprits à travers un roman népalais de la fin du XIXe...
Transcript of Les mondes à part. Représentation des esprits à travers un roman népalais de la fin du XIXe...
Marie Lecomte-Tilouine
Les mondes à part. Représentation des esprits à travers unroman népalais de la fin du XIXe siècleIn: Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient. Tome 89, 2002. pp. 107-126.
Citer ce document / Cite this document :
Lecomte-Tilouine Marie. Les mondes à part. Représentation des esprits à travers un roman népalais de la fin du XIXe siècle. In:Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient. Tome 89, 2002. pp. 107-126.
doi : 10.3406/befeo.2002.3563
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/befeo_0336-1519_2002_num_89_1_3563
RésuméMarie Lecomte-TilouineLes mondes apartReprésentation des esprits à travers un roman népalais de la fin du XIXe siècle
Vīr Caritra, premier roman écrit en népali, fut composé en 1899 par G. Joshi. Il relate le voyage d'unjeune homme dans le monde des esprits, fournissant une précieuse description de ces derniers etexposant clairement la conception d'un monde phénoménal comme parsemé de failles ouvrant sur desmondes surnaturels où les hommes se trouvent happés. Ces anti-mondes sont habités par différentescatégories d'êtres : démons hindous, chamanes tribaux et gentlemen anglais. Vīr caritra expose laconstitution de l'identité humaine à partir des figures de l'Autre incarnées dans les esprits. L'adoption deleur point de vue opère un déplacement de perspective, où l'homme, réduit à sa matérialité vidée deprincipe vital et spirituel, n'est plus que de la viande et devient la nourriture de ses monstrueux alterego. Elle suscite chez l'homme l'image du chasseur chassé et l'amène à s'identifier à eux, soulignantson propre instinct meurtrier et carnassier. Tout étranger, les tribaux comme les Occidentaux, estrenvoyé dans la catégorie des esprits qui permet aux Népalais de penser l'existence de l'autre, tout enlui conservant une place à part dans leur univers mental. De nature chamanique, la geste d'Agnidattapose le voyage comme pérégrination dans l'altérité des anti-mondes, et l'alliance avec les êtres de lasurnature comme le garant de l'ordre de l'univers.
AbstractMarie Lecomte-TilouineWorlds ApartRepresentation of the Spirits in a Nepalese Novel of the end of the 19th century
Vīr Caritra, the first novel written in Nepali, was composed in 1899 by G. Joshi. It describes the journeyof a young man in the world of the spirits, providing an invaluable description of the latter and exposingthe structure of the phenomenal world, which is strewn with faults opening on supernatural worlds intowhich men find themselves seized. These anti-worlds are inhabited by various categories of beings:Hindu demons, tribal shamans and English gentlemen. Vír caritra treats of the nature of human identityby using the figures of the Other that the spirits represent. The adoption of their point of view offers achanged perspective in which man, emptied of vital and spiritual principle, is nothing more than meatand becomes the food of his monstrous alter ego. It shows man as the hunted hunter and leads him toidentify himself with them, underlining his own carnivorous instincts. All foreigners, tribal groups andWesterners alike, fall into the category of spirits, thus allowing the Nepalese to conceive the existence ofthe Other while placing it apart in their mental universe. Shamanic in nature, the epic of Agnidattapresents the journey as a peregrination in the otherness of the anti-worlds, and the alliance withsupernatural beings as guaranteeing the order of the universe.
Les mondes à part
Représentation des esprits à travers un roman népalais de la fin du XIXe siècle
Marie Lecomte-Tilouine*
Rares sont les textes himalayens mentionnant ou décrivant les esprits1. Leur statut subordonné dans le panthéon hindou où ils s'insèrent les fait presque passer pour inexistants au regard des documents historiques, donations, manuels de rituels ou hymnes. Quant aux spécialistes qui s'adressent à eux, prêtres, chamanes et maîtres de maison, ils n'ont jamais recours à l'écrit. Pourtant, ces êtres forment un groupe surnaturel très proche des hommes et dont l'influence sur la vie quotidienne est prépondérante au Népal. Rapporté à notre ignorance des idées anciennes relatives aux esprits, le texte de Girishavallabha Joshi (1867-1923) apparaît comme un document exceptionnel, apportant un peu de profondeur historique aux religions himalayennes. En 1899, ce lettré népalais de haute caste, médecin ayurvédique par profession, composa un long texte en népali intitulé Vír caritra1, titre que l'on peut traduire par «Les aventures d'un héros», mais qui contient vraisemblablement un jeu de mot, puisque vïr est aussi le nom d'une catégorie d'esprits mis en scène dans le roman, suggérant également le sens de : « Aventures de vïr». Sous le titre, Joshi a précisé entre parenthèses qu'il s'agissait d'un «roman», upanyâs, et de fait, le texte s'apparente par son genre littéraire au roman d'aventure et d'initiation et représente le premier roman rédigé en népali, langue considérée jusqu'alors comme parlée3. La première partie du texte parut en 1903, tandis que l'intégralité ne fut éditée qu'en 1965, sans que l'on sache la raison de ce si long délai4.
Vïr caritra reflète clairement le contexte très particulier de la fin du XIXe siècle au Népal, placé sous le règne des Premiers ministres Rana, où la cour se trouvait sous l'influence du luxe de la mode anglaise tandis que le reste du pays, plongé dans un
* Ethnologue, chargée de recherches au CNRS (UPR 299). 1. J'emploie dans ce texte le terme « esprit » pour désigner les êtres de la surnature, mais il va sans
dire qu'il ne s'agit pas d'êtres dénués de corporalité. 2. Les termes népali sont translitérés selon le système de Turner, qui omet les a finaux ; les termes
sanskrits, selon le système usuel. Les noms de lieux, de personnes et de groupes humains sont francisés. Toutes les orthographes sont celles employées dans le roman.
3. Mais toutefois utilisée dans les documents administratifs, depuis le xive siècle. 4. La première partie de ce roman, de 120 pages environ, fut publiée en 1960 V.S. (soit 1903) aux
éditions Pashupat Press, Katmandou. Selon Kamal Diksit, l'auteur de l'introduction au roman dans son édition intégrale (1965), cette première partie connut un très grand succès auprès du public. Les jeunes gens se cachaient pour le lire, car à cette époque, les personnes âgées ne permettaient pas aux plus jeunes de lire en népali, mais seulement en sanskrit, des œuvres littéraires. La première édition complète du roman (511 pages) ne parut pourtant qu'en 2022 V.S. (soit 1965), aux éditions Jagadamba Prakashan, Lalitpur.
Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient, 89 (2002), p. 107-126.
108 Marie LECOMTE-TiLOurNE
isolement absolu, se trouvait replié sur ses traditions. En guise de relations avec le monde, les lettrés n'avaient d'autres perspectives que l'imagination d'un Occident ou d'un Extrême-Orient rêvé, à travers ce qu'ils pouvaient en voir par le biais de la cour. Or Vír caritra fut, semble-t-il, composé afin de divertir les femmes du harem Rana où l'auteur, qui se trouvait être handicapé, était conduit en palanquin tous les jours, pour y faire la lecture d'un nouvel épisode. Cette composante exerça certainement une influence sur le texte, rédigé de toute évidence de sorte à plaire aux Rana. Ainsi, et ce pour des raisons diplomatiques évidentes, il se déroule dans la région de la Kali Gandaki au Népal central, loin de la cour et des royaumes de Gorkha, Kaski et Lamjung d'où les rois destitués Shah et les Premiers ministres usurpateurs Rana sont originaires. Les costumes, les palais et les jardins, thèmes chers à l'aristocratie au Népal comme ailleurs, sont abondamment décrits. Enfin, et cela aussi peut-être afin de flatter les prétentions Rana, l'auteur vient plaquer en des lieux situés au Népal toutes sortes d'innovations techniques de la Compagnie des Indes. Il est difficile de juger de l'impression qUe ce roman fit sur ses lecteurs népalais, mais pour le lecteur occidental contemporain, le récit paraît sans fin, embrouillé et franchement vertigineux. Mon postulat est que cette impression très étrange que laisse la lecture du roman reflète une conception particulière du monde, notamment liée à la présence des esprits. La structure du récit et la façon dont le monde est décrit dans Vîr caritra sont étroitement apparentées à la littérature indienne, persane ou arabe. En particulier, ce roman, que K. Pradhan (1984 : 168) qualifie de « gothique », présente de fortes analogies avec le conte indien, kathâ, et la geste d'Agnidatta emprunte ainsi à plusieurs contes du Livre V du recueil Kathâsaritsâgara, qui fut lui-même écrit, selon la légende, avec du sang des esprits Pisâca et dans leur langue (L. Verschaeve 1979 : 8). Plus précisément, à l'instar de l'histoire des Dix princes, Vîr caritra est une sorte, un peu particulière, de digvijaya ou « conquête des régions ».
L'intrigue du récit est à rebondissements et par conséquent difficile à résumer. Un brahmane et sa femme distribuent leurs biens à leurs proches lors d'une disette et s'en vont, accompagnés de leurs deux jeunes fils, vers le saint confluent de Ridi où ils ont décidé de vivre en ascètes. En chemin, l'un des fils devient râksas5 et commande peu après le royaume des mašán6. L'autre, Agnidatta, pénètre avec ses parents dans le royaume de Ban Jhâkri7, l'esprit chamane de la forêt. Il met fin à son règne, puis à celui de Sunâ JMkrï, « le chamane doré », à celui de Ritthe Jhâkrï, « le chamane au collier de perles ritthâ8» et à celui de Tukucâ Prasâd Dânava, démon cannibale. Dans chacun des royaumes ennemis, il établit ses alliés, ses « enfants spirituels », pour enfin conclure lui- même trois alliances, avec une femme-serpent, nâg kanyà, une démone, râksasarii et encore avec la fille du roi de Palpa. Le fils né de son union avec la femme râksas devient roi des masân à la suite de son frère qui, lui, retrouve son apparence humaine. Et, comme si rien ne s'était passé entre-temps, les deux frères retournent vivre auprès de leurs parents à Ridi.
Jean-Pierre Vernant (1999) spécifie l'intérêt des récits pour l'anthropologue en ce qu'ils présentent de façon sous-jacente une vision du monde. Si cette formule reste vraie
5. Le terme de râksas est généralement traduit par démon. Il s'agit d'une catégorie d'esprits proches de la malemort, anthropophages, velus et pouvant se déplacer dans les airs.
6. Mašán désigne les « champs de crémation » et la catégorie d'esprits anthropophages qui les hantent.
7. Ce terme est tantôt orthographié ainsi, tantôt avec un a nasalisé, dans le roman. 8. Cette traduction est celle que me proposa un villageois du Népal central, mais le terme ritthe
signifie également « très noir », en analogie à la couleur de la graine du Sapindus mukerossi que ce terme désigne.
Les mondes à part 1 09
pour tout type de récit, il me semble qu'au-delà de leur contenu, leur forme même peut également être révélatrice d'une vision particulière du monde. Ainsi Vîr caritra, comme le récit des Mille et une nuits, est de forme arborescente : le déroulement d'une histoire donne lieu, comme autant de ramifications, à plusieurs autres reliées à l'intrigue principale par des fils ténus. Dans le texte ici étudié toutefois, une nécessité sous-tend le hasard apparent des rebondissements, car le monde dans lequel évolue le héros présente une structure similaire à celle du récit. Forme et contenu se renforcent mutuellement. Si une histoire peut en cacher une autre, c'est qu'un monde en cache un autre. Contrairement au conte indien tel que F. Lacôte (1924 : 13) le définit : « (...) récit mis dans la bouche de l'un des héros (...) contant sa propre histoire et rapportant les récits à lui faits par d'autres personnages, lesquels contiennent, à leur tour, ceux que ces derniers ont entendus de diverses personnes, et ainsi de suite » ou aux Mille et une nuits, où les héros sont également des « hommes-récits » 9, Vîr caritra présente un enchâssement non pas de récits, mais d'aventures se déroulant dans des mondes eux-mêmes enchâssés. Si dans Vír caritra, l'enchâssement est plus celui d'aventures contenues dans l'aventure principale que d'histoires annexes contenues dans l'histoire, on peut penser qu'il existe tout de même là une structure commune et essentielle, qui est de nature prolifère 10. Dans ce contexte, l'art du narrateur consiste apparemment surtout à enivrer, emboîtant les épisodes jusqu'à requérir un réel effort de mémoire du lecteur, susceptible de lâcher le fil pour se faire alors emporter, sans repère ni amarre, dans le flot tumultueux du récit où défilent à allure vertigineuse des images fantasmagoriques, rappelant les visions qui apparaissent au bateau ivre, une fois ses haleurs exécutés au poteau de torture.
Au cours de déplacements ordinaires, les personnages se trouvent comme happés dans des mondes séparés, reliés au monde des hommes par des passages secrets. Leur pouvoir d'attraction évoque les trous noirs du cosmos, absorbant la matière dans le monde de l'antimatière. Dans ces anti-mondes, la ruse et le déguisement sont les seules armes contre la perdition. Par une adoption contrôlée et raisonnée de l'altérité, le héros a la possibilité d'en ressortir pour aboutir à son lieu de destination initiale. La concomitance de la structure du récit et de celle du monde n'est donc pas fortuite et souligne une forme de pensée proliférante et à « parenthèses » qui se referment sur elles-mêmes tout en étant reliées, tel l'univers clos mais dangereusement percé d'étroits passages vers des antimondes.
Un peu à la façon dont Raymond Roussel explorait dans ses romans toutes les possibilités du langage, filant les sens possibles des termes d'une phrase première afin de la reconstituer en phrase ultime au terme d'une histoire extravagante, le récit de Vîr caritra paraît explorer les possibilités infinies de voyages dans les mondes qui se greffent sur notre monde phénoménal comme des boursouflures étranges, au sein d'un trajet ordinaire dont le départ et l'arrivée ouvre et clôt respectivement le récit. À l'instar des romans à procédés de Raymond Roussel, où l'enchaînement apparemment arbitraire des événements obéit en fait à une logique soigneusement pensée par l'auteur, visant à filer les sens des mots par des homophonies approximatives, il semble ici que l'arbitraire du récit est fondé sur une logique sous-jacente, qui est celle des esprits.
Ces « mondes à part » sont partout présents, insoupçonnables, séparés du monde auquel ils se relient par des voies dérobées, gardées de mécanismes secrets ou par des
9. Selon l'expression de T. Todorov 1978, p. 37. 10. On ne peut évidemment se contenter de qualifier les récits annexes du conte indien d'« inutiles »
(F. Lacôte 1924 : 18) ou de penser que ce n'est que par « goût de variété » que « (...) le cours du récit était agrémenté de contes n'ayant pas de lien direct avec le sujet et placés là plus ou moins artificiellement (...) » (L. Verschaeve 1979 : 9).
1 1 0 Marie Lecomte-Tilouine
murailles infranchissables. Tels les points de capitons rattachant l'Un à l'Autre, mis en évidence par J. Lacan, ces passages séparant et reliant à la fois les mondes des esprits et celui des hommes sont de nature proprement rituelle et détiennent une importance capitale dans la constitution de l'identité humaine à partir des figures de l'Autre incarnées dans les esprits. Cette idée que notre univers familier est parsemé d'ouvertures par où l'on glisse dans des répétitions monstrueuses du monde n'est pas une invention romanesque : on la retrouve chez les enfants népalais qui racontent comment les petits trous des rochers sont les ouvertures qui conduisent aux immenses palais des esprits Bhut, où l'on se régale d'une sorte d'anti-nourriture, de vers de terre et de sable. D'ailleurs, si invention il y a dans le roman de Vîr caritra, c'est plus dans l'agencement hétéroclite de représentations issues de divers groupes que dans des conceptions idiosyncrasiques, reflétant bien la métaphore du « bricolage » chère à С Lévi-Strauss. Le merveilleux est ici remplacé par le voyage chez les autres : esprits tribaux et gentlemen anglais, qui occupent Г en-deçà du monde et dont les us et coutumes vont êtres combattus, détournés ou déjoués par le héros.
Les hommes peuvent pénétrer par inadvertance dans ces mondes parallèles, auquel cas ils y sont mangés ou y demeurent à tout jamais asservis. D'autres, choisis par les esprits, y sont appelés.
L'appel des esprits
Les deux jeunes héros du roman sont élus par les esprits, d'une façon qui rappelle la « crise chamanique ». Vishnudatta, le cadet, est pris d'un malaise en haut d'un arbre où il a grimpé pour couper du bois. Il tombe. Plus tard dans la nuit, il se réveille fiévreux et grelottant de froid. Il convainc alors son père de l'emmener se réchauffer auprès de feux crématoires qu'il aperçoit au loin. Tous deux assistent là à une scène épouvantable, où des goules se repaissent de la chair des cadavres, se battent, ricanent. Mais le jeune homme affiche une détermination extraordinaire, comme possédé. Il avance sans crainte et se réchauffe près d'un bûcher quand tout à coup, le crâne du cadavre qui s'y consume éclate, projetant des débris de cervelle. Du jus parvient aux lèvres du jeune homme affamé, qui l'avale. Aussitôt la déesse des masàn surgit de terre, lui déclare que le général de l'armée des râksas est mort et qu'elle a vu combien il était courageux : « (...) par mon pouvoir tantrique je t'ai rendu malade et, t'ayant conduit jusqu'ici, je t'ai fait manger la pâture des démons ». Lui offrant un sabre, un crâne et un collier, elle le nomme général en chef, le baptise Démon-de-la-tête-brisée et lui annonce qu'il deviendra bientôt roi. Après son départ, le jeune homme regarde son corps : « quatre crocs blancs d'une coudée lui étaient sortis de la bouche. Des poils noirs semblables à ceux d'un bouc lui ornaient les yeux. Sa bouche était rouge comme celle de Lâkhe11. Il fut très surpris de voir ses cheveux d'un noir d'encre et dressés sur sa tête ». Le jeune homme s'élance aussitôt vers son père pour le tuer et le manger, quand la Déesse réapparaît pour l'arrêter dans son élan. Toute la scène - champ crématoire, démons et goules - disparaît alors sous les yeux du père ébahi.
Le comportement étrange du jeune homme, sa maladie, son attirance soudaine et impérieuse pour les feux crématoires et même l'explosion intempestive du crâne d'où jaillit le jus de la cervelle, ne sont pas dus au hasard, mais le fruit de la volonté d'un esprit, comme pour réaffirmer ce principe fondamental qui ordonne et donne sens au monde phénoménal : l'arbitraire du monde des hommes est causalité dans le monde des esprits. L'absorption de chair humaine transforme instantanément le jeune homme en ràksas, car
1 1 . Le plus terrifiant des démons néwar.
Les mondes à part 111
dans la société hindoue, on se définit avant tout par ce que l'on mange. Nous reviendrons sur la conception des esprits comme cannibales et la portée de cette représentation du point de vue des hommes, leur pâture. Un autre trait frappant dans cet épisode est l'oubli total de son passé qu'affiche immédiatement le jeune homme à la suite de sa métamorphose, indiquant qu'il ne s'agit pas là seulement d'une transformation physique, mais bien d'un changement essentiel 12.
Il est difficile de dire comment le monde des râksas et des ma'sàn s'organise par rapport à celui des hommes. Un peu comme la déesse qui le préside, il semble surgir et disparaître uniquement pour la circonstance, peut-être du sol comme celle-ci. Ici, l'appel des esprits est doublé par la matérialisation de leur monde à proximité du héros, suscité pour former le cadre de son initiation, laquelle est marquée par l'absorption de la matière oblatoire la plus taboue pour l'homme, sa propre chair, et plus encore la quintessence de cette substance qu'est la cervelle. Le champ crématoire fait partie de la surnature, il présente un renversement où l'homme se transforme en victime sacrificielle, dont les esprits commanditaires se repaissent. Ces cadavres illusoires invitent le lecteur dans la logique des récits népalais relatifs à l'au-delà où il n'est jamais clair de ce qu'il advient de l'homme après la mort : dévoré par les goules, il rejoint leur troupe tout en effectuant un voyage au terme duquel il devient ancêtre. Un peu comme si, dans chacun de nous coexistaient deux principes : l'un, animal et physique, se repaît de la chair des animaux de son vivant, est mangé à son tour dans la tombe, ou encore cuisiné sur les feux de crémation, et reste là par la suite pour manger les autres hommes. L'autre, spirituel, assure la pérennité du lignage des hommes, en devenant ancêtre. Telle un seuil, la mort fait passer dans le monde des esprits. Elle opère un déplacement de perspective, où l'homme dans sa matérialité vidée de principe vital et spirituel n'est plus que de la viande et devient la nourriture de ses monstrueux alter ego.
Après que Vishnudatta est ainsi élu roi des râksas, son frère Agnidatta est également appelé dans un autre monde. Avec ses parents, il s'installe dans une grotte pour y passer la nuit, lorsqu'un bloc de roche se détache du fond de celle-ci et ouvre accès à une deuxième pièce dans laquelle le jeune homme et ses parents sont contraints de se réfugier à l'approche d'une tigresse à l'entrée de la caverne. Au fond de cette deuxième salle, ils découvrent une porte de fer. Actionnant son étrange mécanisme d'ouverture en forme de serpent, ils pénètrent dans un jardin extraordinaire où une vieille femme les attend pour les conduire à sa maîtresse.
On comprend dès lors que tout ce qui vient de leur arriver était également prévu et suscité par un esprit. Le jeune homme est ensuite conduit par un chemin compliqué et par de nombreux auxiliaires monstrueux jusqu'à Nidhinï, la maîtresse des lieux, qui lui déclare (p. 16) : « Ô Pandit, avant-hier soir, vous vous reposiez sous un pipai. Je prenais l'air en volant dans le ciel. J'ai été charmée en vous apercevant et vous ai donc fait venir jusqu'ici, vous occasionnant bien des difficultés ! (...) Je souhaite que nous connaissions ensemble les plaisirs amoureux et ceux de la vie. Vous serez roi sur mon trône, pensez- y (...) ». L'appel de l'esprit Nidhinï répond à une autre logique, il ne s'agit pas de l'élection d'un homme exceptionnel, mais du ravissement d'un partenaire sexuel. En fait, le héros comme le lecteur apprendront rapidement comment Nidhinï appelle sans cesse de nouveaux amants depuis le monde des humains, dont elle se lasse fort vite et qu'elle transforme alors en statues de pierre, dont son immense jardin est parsemé. Agnidatta réveillera quatre de ces statues, qui racontent leur histoire : la première est le prince de Bhirkot. Il fut capturé une nuit qu'il avait perdu sa suite dans la forêt lors d'une chasse et conduit par un être à la tête de chien jusqu'à la Maîtresse, dont il fut l'amant une dizaine
12. De la même façon que les médiums oublient tout de leur état de possédé.
1 12 Marie LECOMTE-TlLOUlNE
de jours. La seconde est le prince de Tanahun, qui fut avalé par un énorme poisson alors qu'il se baignait dans une rivière et conduit également auprès de Nidhinï, dont il resta un mois durant l'amant. Le troisième, prince de Dhvankot, fut enlevé par un éléphant sauvage alors qu'il dormait dans une forêt, en route pour le pèlerinage de Deughat. Le dernier enfin, prince de Musikot, fut enlevé par la fille de Nidhinï passant dans son chariot volant, alors qu'il se promenait la nuit dans son jardin.
Tout le personnel humain du royaume de Nidhinï a également été enlevé. C'est ainsi que Latamaya, servante néwar, rencontra Nidhinï en personne alors qu'elle traversait un pont de la Bagmati, et que la Bangali fut appelée par les formules mantra de la Maîtresse qui s'était rendue sur le champ de crémation de la terrible déesse Kâmâksâ, laissant un doute au lecteur sur son état de vivante ou de morte.
Outre ces appels, ces rapts des hommes par les esprits, le roman mentionne également le cas des malheureux qui pénètrent par inadvertance dans leur royaume, impitoyablement mangés après avoir été engraissés quelque temps.
Aucun des personnages du roman n'est enlevé depuis chez lui, dans l'espace clos et sécurisé de la maison, mais bien toujours en voyage, lors de la traversée de zones liminales telles les rivières, les chemins, la forêt, et plus spécialement durant la nuit, délimitant clairement les domaines d'intervention des esprits. En cela, le roman n'apporte pas d'éléments nouveaux, mais rend plus explicites des croyances largement répandues relatives au surnaturel. Le rapt a lieu à l'aide d'auxiliaires sauvages, des animaux surtout : tigresse, éléphant sauvage, poisson, ou encore ces auxiliaires spécifiques que sont les vïr, êtres mi-humain, mi-animal.
L'appel des esprits est véritablement initiatique, comme dans les phénomènes de chamanisme. Les faibles y succombent et ne reviennent pas du monde où ils ont été appelés, tandis que le héros y trouve une maturité nouvelle, une maîtrise de la ruse. Ainsi Agnidatta, présenté comme un jeune adolescent, se conduit en adulte dès qu'il pénètre dans le royaume de Nidhinï. Le voyage initiatique renverse les rôles : c'est l'adolescent qui prend les initiatives et sauve ses parents en danger, tandis que ces derniers retrouvent leur rôle et leur autorité dès que le récit se déroule chez les hommes. Ce premier voyage en appelle d'autres : ressorti de chez Nidhinï, le jeune homme est comme attiré par ces mondes étranges dans lesquels il évolue habilement, déjouant les embûches et comprenant les ruses. La pénétration initiatique et initiale dans le monde de Ban Jhâkrï et de Nidhinï donne naissance à une répétition d'expériences semblables, mais non tout à fait identiques, au terme desquelles ne subsiste plus aucun monde qui ne soit allié au héros, que celui-ci n'ait « lié », comme dirait un médium népalais.
Les mondes « à part » des esprits forment ainsi comme des pôles d'attraction vers lesquels des élus sont conduits à leur insu par les esprits du lieu qui, contrôlant les éléments du monde sauvage, suscitent des circonstances apparemment fortuites et « naturelles », dans ce dessein. L'homme est particulièrement vulnérable à ces téléguidages lors de ses déplacements en des zones sauvages et liminales, qui forment comme une sorte de territoire tampon entre univers des hommes et mondes des esprits. Le roman présente deux types d'appel étrangement opposés : l'élection d'un homme appelé à régner dans le monde des esprits-démons et le ravissement de personnes visant à leur asservissement, physique ou sexuel. Nous verrons que ces deux attitudes opposées de ceux qui forment les esprits sont respectivement associées à deux catégories nettement distinguées au sein de cet ensemble et qui entretiennent des relations contrastées avec les hommes hindous de hautes castes ici présentés.
Les mondes apart 113
Femmes lubriques et mangeurs d'hommes
L'enlèvement des hommes par les esprits féminins répond sous forme inversée au rapt des femmes par leur prétendant, fait courant dans l'Himalaya. Les femmes, elles, sont moins nombreuses à être enlevées par les esprits, et lorsqu'elles le sont, c'est pour devenir servantes, car les esprits masculins n'ont visiblement pas le même appétit sexuel que leurs homologues féminins, soulignant là encore l'inversion des caractères humains prêtée aux esprits13. Au-delà de ce trait récurrent et typique d'inversion, la nette différence de comportement des esprits des deux sexes vis-à-vis des humains souligne peut-être également une logique d'alliance propre aux esprits, que nous allons examiner ci-après.
Les esprits féminins sont lubriques et repèrent de beaux hommes pour en faire leurs amants. L'union débouche sur la perte de l'amant, transformé en statue, comme on l'a vu, ou tout simplement mangé. C'est ainsi qu'un des princes pétrifiés délivré par Agnidatta est ensuite capturé par un esprit-chamane qui le drogue et l'enterre. Il est peu après sorti de sa tombe par des femmes tibétaines et Thakali, qui le conduisent dans un royaume auprès d'une femme : « Elle avait seize ans, un visage lumineux comme la lune, la peau de la couleur d'une fleur de magnolia et ses joues celle d'une rose rouge, ses dents semblaient être des perles, ses cheveux noirs comme les poils d'un bourdon, élégamment coiffés à la chinoise, pendaient des deux côtés du visage, ses seins ressemblaient à des citrons, sa taille était fine ; elle portait un costume de soie jaune, une bague de diamant et un collier d'émeraudes (...) ». Cette créature idyllique lui déclare qu'elle est la fille du roi du Mustang et qu'elle souhaite devenir sa femme. Bien que « percé par la flèche du dieu amour », le prince se méfie de son avance et se renseigne prudemment sur son compte. Il apprend par un brahmane au service de cette femme qu'il s'agit en fait de la cinquième épouse du roi Tukucâ Prasâd Dânava, à laquelle incombe de veiller aux cuisines. Le brahmane lui explique que le roi consomme rituellement de la viande de « Brahmane- Kshatri » avant son repas, tout comme eux, brahmanes, se purifient en absorbant une feuille de tulasi avant de manger. C'est pourquoi sa cinquième femme doit veiller à ce qu'il en ait tous les jours. Elle s'arrange pour trouver de la viande de Brahmane-Kshatri « vivante ou bien enterrée ». Par ailleurs, elle est débauchée, et si possible, quand arrive un Brahmane-Kshatri, elle fornique avec lui pendant un mois ou deux, en ayant soin de l'engraisser, avant de le tuer et de le faire manger à son mari. Le vieux brahmane a échappé à ce sort « parce qu'il est vieux et maigre ».
Pour les esprits, on le voit, les hommes sont réduits à leur aspect le plus physique : instrument de jouissance pour les esprits féminins et repas préféré des esprits masculins. Les esprits profitent de l'homme, en tirent tout ce qu'ils peuvent. Après leurs brefs exploits amoureux, ils sont destinés à les nourrir ou à embellir leurs jardins, devenant littéralement des hommes-objets. L'attitude des esprits renvoie à l'homme l'image douloureuse de sa seule matérialité. Choisis jeunes et gras, tels des animaux, ils sont non seulement le mets de prédilection des esprits, mais encore leur nourriture rituelle. Vîr caritra revient souvent sur ce point : dans les cuisines de Nidhinï et de Ban Jhâkrï, des corps humains sont débités et cuisinés, comme chez le Dânava. Sur les champs de crémation, les bhut-pret et les masan se repaissent de la chair chaude des cadavres en train de se consumer, ou encore suivent l'armée pour faire bombance sur les champs de bataille, de sorte que toute mort, même naturelle, signe la transformation de l'homme en pâture.
13. Rappelons que l'inversion des traits humains : traits de caractère, usages sociaux et même caractéristiques physiques, est typique des esprits himalayens {cf. M. Lecomte-Tilouine 1987).
1 14 Marie Lecomte-Tilouine
Le cannibalisme forme d'ailleurs peut-être l'unique dénominateur commun de tous les esprits, leur trait distinctif. Plus encore, l'accomplissement de cet acte transforme l'homme en esprit, comme s'il s'agissait là de l'essence de leur nature. Il est frappant de constater que cette caractéristique valait déjà aux esprits dans l'Inde ancienne l'appellation générique de « mangeurs d'hommes » 14. Frappant également l'aspect d'animaux carnassiers de ces êtres, poilus, aux longs crocs. L'existence des esprits cannibales suscite chez l'homme l'image du chasseur chassé et l'amène à s'identifier à eux, soulignant son propre instinct meurtrier et carnassier. C'est ainsi que de nombreux villageois déclarent qu'ils se conduisent comme des ràksas vis-à-vis des animaux. Le modèle des esprits renvoie ainsi à une sorte de portrait de l'homme dans ses relations aux autres catégories du vivant, opérant une translation de point de vue. Sauvagerie, sexualité féminine débridée, boucherie humaine et anthropophagie régnent chez les esprits, comme un amalgame, étonnant tellement il est peu déguisé, codé, de l'effroi que l'Autre, sous ses différents aspects, suscite chez l'homme et de façon plus subtile, comme une image de l'effroyable traitement de l'Autre par l'homme. Au Népal, peut-être comme ailleurs, les esprits permettent aux hommes de se mettre mentalement à la place de l'autre : le chasseur se voit mangé, l'homme, capturé par des femmes lubriques. Le vivant est traité comme un mort, enterré vivant ou rappelé depuis le champ de crémation pour vivre chez les esprits, brouillant les frontières des registres habituels de l'ordre des choses. Enfin, la surprenante modernité des mondes surnaturels, dont nous allons parler, peut être également vue comme le « repoussoir » de la sauvagerie de l'homme.
L'alliance avec les esprits
Tout cannibales qu'ils sont, les esprits peuvent s'allier aux hommes et dès lors, non seulement ne plus les considérer comme de la viande, mais aller jusqu'à prendre leur apparence et respecter leurs tabous alimentaires. Ainsi le « petit bhut » 15 s'allie à la bande du héros et l'accompagne dans ses déplacements, sous forme humaine. Lors d'un combat dans la forêt, il reprend son apparence pour se faire reconnaître d'un ràksas qui lui apporte alors aussitôt en hommage la nourriture des bhut sur des plateaux : viandes d'hommes et d'autres animaux, bières et alcools. Horrifié qu'une telle nourriture lui soit offerte en présence du jeune brahmane, il injurie le ràksas et le somme de remporter ces immondices, se plaçant ainsi littéralement à la place de l'autre, du jeune brahmane dont il a adopté la cause.
Les identifications entre hommes et esprits sont ainsi possibles dans les deux sens - le Petit bhut se fait homme comme l'un des deux héros est devenu ràksas -, soulignant une nature commune ou du moins un seuil franchissable entre les deux catégories d'êtres.
L'alliance avec les esprits se marque cependant le plus souvent par une alliance matrimoniale et cela, toujours dans le même sens, entre un homme de ce monde et une femme de l'au-delà, soulignant le statut inférieur de la catégorie des esprits 16.
Agnidatta a fait renaître quatre princes transformés en statue de pierre et de ce fait, se trouve considéré par ces derniers comme leur père. Il placera ses quatre fils spirituels à la
14. W. Hopkins 1969. 15. Les bhut sont les esprits des morts. 16. Seules l'isogamie et l'hypergamie sont permises dans la société hindoue. Dans les deux cas, le
donneur de femme est considéré comme d'un statut inférieur à celui du preneur de femme. Cette règle fondamentale explique peut-être également l'absence d'alliances et de relations sexuelles entre esprits masculins et femmes humaines.
Les mondes à part 115
tête d'un royaume surnaturel, procédant toujours de la même façon. Éliminant le roi, il marie la fille de ce dernier à l'un des princes, puis consacre le couple et le place sur le trône. Aucun mal n'est fait à la population, qui n'est considérée comme mauvaise, semble- t-il, même s'agissant d'ogres sanguinaires, que si celui qui la gouverne l'est17. Le premier prince épouse la fille de Nidhinï et de Ban Jhâkrï, le second celle de Sunâ Jhâkrï, le troisième celle de Kâlu Prasâd Dânava et le dernier reçoit la forteresse du roi Daitya Vajradatta et la fille du roi de Rukum qui se trouvait prisonnière en ces lieux.
Par la suite, le héros Agnidatta devient lui-même « gendre des esprits » 18, tel un chamane, en épousant successivement une nàg kanyâ, femme-serpent du monde souterrain, une râksasariï, démone des airs, et une femme bien terrestre en la personne de la fille du roi Mukunda Sen de Palpa, monarque au pouvoir immense. Par ses alliances, Agnidatta maîtrise les trois étages de l'univers, mais refuse d'y régner car, dit-il, le pouvoir temporel ne convient pas à un brahmane.
Entre les esprits, les alliances sont principalement des amitiés rituelles. De très nombreuses sont mentionnées : celles qui unissent Ban Jhâkrï et Sunâ Jhâkrï, Sunâ Jhâkrï et Ritthe Jhâkrï, Ritthe Jhâkrï et Tukucâ Prasâd Dânava, Vajradatta Daitya et le roi des Nâg. Tous les monarques de la surnature sont ainsi liés entre eux par une amitié fidé-jurée au nom de laquelle ils se portent assistance. À l'inverse, aucune amitié fidé-jurée ne noue les esprits aux hommes, peut-être parce que cette relation implique et surtout induit une certaine égalité 19. Pour les Népalais de hautes castes, l'alliance matrimoniale est vue comme un assujettissement de la femme et par extension, du groupe dont elle provient, ce qui explique qu'elle s'apparente au vasselage du royaume. Être gendre des esprits chez les tribaux Magar, par exemple, implique une tout autre conception de la relation avec les esprits, compte tenu du fait que dans ce groupe, l'épouse n'est pas ou peu assujettie.
Il me semble que l'on trouve trace de la vue des gens de hautes castes sur cette inversion tribale dans les pratiques des esprits. Pour les esprits féminins au caractère séducteur, l'union sexuelle n'a rien de subordonnant, ils en contrôlent toute conséquence néfaste possible en éliminant peu après le partenaire. Le contexte matrimonial dans lequel s'inscrit nécessairement l'union sexuelle pour les hindous de hautes castes importe peu aux esprits lubriques, dans leur relation aux hommes, et n'est proposé qu'à titre de ruse, comme dans cette scène où Nidhinï demande au héros de devenir son amant (p. 29) :
« Agnidatta : (...) Je ne suis pas marié et ne puis devenir votre amant tant que mon mariage n'a pas eu lieu. Nidhinï : Si c'est ainsi, épousez-moi. Agnidatta : Je ne connais pas votre caste, jât. Comment vous épouserais-je ? Nidhinï : Je suis la fille du Ban Jhâkrï du Mont Sakhi. Agnidatta : Dans les Dharmasâstra, les brahmanes n'ont traité que du mariage des filles des quatre castes : Brahmane, Kshetri, Vaisya et Shudra. Ban Jhankri ne fait pas partie de ces castes, il ne respecte pas non plus les Veda, comment épouser la fille d'une telle personne ?
17. Cette idée est explicite dans la chronique de Gorkha (Naraharinath 2021 V.S. : 60) où l'on peut lire ce dicton :jasto ràjà bhayà tastai pràjâ hunchan, « tel roi, tel peuple ».
18. Selon l'expression d'Anne de Sales (1991). En fait, dans le roman, Agnidatta est le seul à être véritablement gendre des esprits, puisque ses relations avec sa belle-mère ràksas et son beau-père nâg sont amplement décrites, tandis que les princes, eux, n'ont pas de beaux-parents, qui ont été éliminés, et sont plutôt de ce fait des « époux d'esprits ».
19. En effet, si ce type d'amitié peut être noué entre individus de statut différent, elle crée un lien de parenté fictive très particulier entre eux, marqué entre autres par la seule forme d'égalité que j'ai pu constater au Népal central, matérialisée par la remise réciproque et simultanée de la marque frontale tiká qui, d'ordinaire, réaffirme une relation inégalitaire, distinguant le donneur du receveur de la marque.
1 16 Marie Lecomte-Tilouine
Nidhinï : Quoi que disent les sâstra, il est d'usage que les Cepang et les Danuvar 20 mangent de la main de Ban Jhâkrï, quant aux lois du gouvernement concernant le mariage d'une fille de Ban Jhâkrî, vous n'en savez rien. » Au sujet de l'alliance, comme dans bien d'autres domaines, le roman de G. Joshi est
pour ainsi dire ethnographique, reflétant avec minutie les règles des relations inter-castes. On le voit, le jeune héros reproche à Nidhinï d'être hors caste, de ne pas faire partie de l'univers hindou. Elle-même se situe clairement du côté des groupes tribaux, Chepang et Danuvar, afin de défendre son statut et rabroue le brahmane qui lui parle d'un ton sentencieux en lui faisant remarquer qu'il ne sait rien des pratiques tribales. Face au jeune brahmane qui lui reproche d'être hors de la société hindoue des castes, la Maîtresse Nidhinï clame ainsi littéralement son origine tribale, origine qui, dans le contexte de la société des castes népalaise, la situe à une position intermédiaire et non pas externe, dans l'ensemble hiérarchisé des groupes.
On peut opposer cette scène aux unions surnaturelles que contracte par la suite Agnidatta où une différence fondamentale entre deux groupes d'esprits est dessinée. Ainsi, lorsque le héros tombe amoureux d'une jeune fille inconnue qui a juré de n'épouser qu'un dieu ou un homme, il lui fait savoir par personne interposée que si elle épouse un brahmane son voeu sera doublement comblé car « les brahmanes sont des dieux ». La jeune personne ainsi convaincue, c'est au tour du jeune homme d'émettre une réserve quand il apprend qu'elle est une fille-serpent, nàg kanyâ.
« Agnidatta : Moi je suis brahmane et toi une fille de Nâg, nos castes ne s'entendent pas, que faire ? La fille-serpent : Vedvyas a écrit dans les Puràna que l'enfant né d'un homme avec une fille de dieu, de Nâg ou une Apsarâ, reçoit la même caste que son père. L'enfant né du sage Adhika et d'une fille- Nâg fut brahmane. Celui du sage Vasista et d'une Apsarâ également. Aussi n'y aurait-il aucun mal à ce que vous fassiez vous aussi un tel mariage » (p. 401). L'alliance aura lieu, mais après moult péripéties, car Agnidatta apprend que l'usage
chez les nàg est Fuxorilocalité, ce qui lui répugne. Là encore, chez ces esprits familiers de l'univers hindou, l'altérité se marque par des pratiques opposées relatives à l'alliance.
Le jeune héros, en bon brahmane, est, on le voit, très sourcilleux quant aux règles de castes. Il est ici fait une nette distinction entre les esprits « hindous » et les esprits que l'on peut qualifier de « tribaux », entre ceux avec lesquels un brahmane peut s'unir sans perte de statut pour la descendance et les autres. Pourtant, Agnidatta n'hésite pas à marier le prince de Musikot avec la fille de Ban Jhâkrï et Nidhinï. Là encore, il ne s'agit pas d'une invention de l'auteur, car les alliances entre princes Thakuri et filles de chefs tribaux furent nombreuses dans l'histoire du Népal, assurant très certainement la légitimité locale des souverains conquérants étrangers. D'ailleurs, l'enfant né d'un père Thakuri et d'une femme tribale conserve le statut de son père, contrairement aux brahmanes.
La différence de traitement des deux groupes d'esprits - tribaux et hindous - se fait également sentir dans le fait que les premiers voient leur roi éliminé et remplacé par un suzerain hindou, tandis que le roi des nâg est non seulement conservé sur son trône mais
20. Les Chepang sont un ancien groupe de chasseurs-cueilleurs aujourd'hui sédentarisés et les Danuvar, une tribu des rivières du Népal. Il est intéressant que Nidhinï se rattache plus particulièrement à ces deux groupes vivant dans le sud de la région des collines népalaises, mais il n'est pas possible d'en conclure que les Jhankri leur étaient plus spécialement rattachés il y a un siècle, car l'auteur a peut-être placé ces noms de tribus marginales dans la bouche de Nidhinï pour ne froisser personne. Reste qu'il s'agit tout de même d'une indication d'un lien privilégié entre Jhâkri et groupes tribaux du sud du Népal. On notera également que Nidhinï est ici présentée non seulement comme l'épouse mais aussi comme la fille d'un Ban Jhâkri, un peu comme si les correspondants féminins de ces Jhâkri étaient des Nidhinï.
Les mondes à part 117
obtient aussi une extension de son royaume grâce à l'alliance de sa fille avec le jeune brahmane.
L'alliance avec les râksas est la plus compliquée à comprendre dans le roman. Au tout départ, on l'a vu, le jeune frère du héros est transformé en râksas par la déesse des ma'sàn et devient leur roi. Tout au long du roman, il combat sous sa forme de démon aux côtés de son frère humain, et cela sans savoir qui il est, mais parce que la déesse des masân le lui a demandé. Par la suite, Agnidatta rencontre dans un champ de crémation une femme raksas qui lui offre sa fille en mariage et ne se fait pas prier pour l'accepter. Il relève cependant qu'elle n'est pas de sa caste et qu'il ne l'épousera pas selon les rites brahmaniques, mais par une cérémonie brève appelée « mariage Gandharva ». Là encore, le texte ne présente pas d'anomalie car il s'agit d'un second mariage pour le brahmane et, s'il est essentiel de contracter une première alliance dans sa caste, les suivantes peuvent se faire avec des femmes de rang inférieur. Le fils qu'il obtient de cette union n'a d'ailleurs pas le rang de son père, conformément aux canons hindous, sans que l'on sache précisément s'il est considéré comme un raksas ou comme une caste à part comme peuvent en constituer les bâtards. Toujours est-il que lorsque le héros doit désigner un de ses fils pour succéder sur le trône des raksas à son frère redevenu humain, il déclare (p. 507) : « Mon fils aîné s'appelle Kumardatta. Toutefois, comme il est brahmane, il ne serait pas désirable qu'il devienne le roi des raksas. Il convient de placer mon fils Jvaladatta que voici, né d'une râksasariï », laissant supposer que ce deuxième fils est bien un raksas.
Ce n'est qu'à la fin de ce long roman que l'on comprend la raison de l'alliance répétée des esprits râksas, présidés par Masân Devï, avec les brahmanes. Lorsque les deux frères se retrouvent face à face, alors qu'ils étaient sur le point de se livrer bataille à la suite d'un quiproquo, la déesse Masân Devï surgit encore du sol et s'adresse à Agnidatta en ces termes :
« Hé grand-père 21 Agnidatta ! Je suis la déesse Kâlikâ du village de Baglung que tes ancêtres ont vénérée. Parce que ton petit frère était faible, au moment où Yamarâj 22 allait l'emporter, par la force du yoga j'en ai fait le roi des râksas et l'ai gardé sous ma protection jusqu'à aujourd'hui. À partir de maintenant, ses jours néfastes sont terminés. Je te le confie » (p. 505-506). Les esprits râksas sont subordonnés à la déesse tantrique Masân Devï. Vénérée par la
lignée de brahmanes du héros, elle trompe la mort en faisant momentanément passer Vishnudatta du côté des esprits, afin de le protéger. L'alliance répétée avec les esprits râksas s'explique donc doublement. La Déesse intègre l'un des deux frères dans sa horde démoniaque pour le soustraire à son funeste destin et envoie cette dernière porter main- forte à ses dévots dans le combat qui les oppose aux esprits « tribaux », les Jhâkrï, Kâlu Dânava (entouré de Mustangi et de Thakali) et Vajradatta. L'autre frère s'allie par mariage à une démone et donne ainsi naissance à un fils amené à régner sur leur groupe. Dans ce scénario, les râksas apparaissent comme des agents du pouvoir hindou, contrôlé par la Déesse, pour le bénéfice des meilleurs d'entre ses dévots : les brahmanes de sa localité. La relation aux râksas prend la forme d'un échange circulaire où le brahmane-démon qui vient remplir le trône vacant des démons, frère du héros, est finalement remplacé, après sa restitution au monde des hommes, par un démon-brahmane, fils du héros. L'ensemble est présenté comme une série de retours de services autour de la mort et de la royauté. On est là placé dans une relation d'échanges répétés et réciproques, d'alliance entre brahmanes et démons, face aux ennemis à pacifier : les chamanes et rois tribaux cannibales. D'une certaine façon, Vír caritra peut donc être lu comme l'image de la conquête du Népal sur les tribaux, de l'hindouisation, puisque tous les esprits chamaniques seront anéantis ou
21. Même très jeunes, il est d'usage d'appeler les brahmanes « grand-père », en signe de respect. 22. Dieu de la mort.
1 1 8 Marie LECOMTE-TiLOUiNE
assujettis par le jeune brahmane, tandis qu'il s'allie avec les esprits néfastes hindous, démons râksas, esprits de mort bhut et serpents divins, nàg, eux-mêmes subordonnés à la déesse.
Au pays des chamanes
Un des intérêts du roman de Girishavallabha Joshi réside en la description abondante des royaumes des esprits. Aussi loufoques qu'apparaissent parfois les descriptions à nos yeux, il est clair qu'elles ne sont pas uniquement nées de l'imagination de l'auteur. Je m'en tiendrai ici aux royaumes des esprits chamanes ou Jhâkrï, tout en notant qu'ils ne sont guère différents de ceux des autres classes d'esprits.
Les mondes des esprits sont des forteresses kilïâ, image que l'on retrouve ailleurs en Asie, et qui dénote à la fois leur inaccessibilité, leur puissance et leur caractère clos, à part, véritables mondes dans le monde. La plupart ont en sus un caractère souterrain.
Dans le royaume du chamane de la forêt Ban Jhâkrï et de son épouse Nidhinï, c'est Nidhinï qui gouverne, tandis que son mari reste confiné dans une grotte d'où il ne sort qu'une fois l'an, le jour de la remise des tiká23. De très nombreux groupes y sont représentés : Thara, Chepang, Bangeli, etc. Le jardin est paradisiaque, regorgeant de fleurs exhalant de délicieux parfums, de lotus couvrant ruisseaux et pièces d'eau. Il est également très moderne, parsemé de lanternes électriques, de bancs, de trônes, de tables pourvues de papier, encre et crayons. Les chemins y sont recouverts de poudre de brique. L'endroit est enfin merveilleux. On y voit des fontaines ayant l'aspect d'êtres humains ou d'animaux, des statues de marbre, d'or, d'argent et de cuivre. Çà et là des groupes de musiciens jouent d'instruments traditionnels (pancai bàja) et étrangers (orgue, harmonium, guitare). En même temps, tout y semble être factice, artificiel : fausse montagne, faux buissons, animaux factices, lumières électriques24. Dans ce premier jardin où l'on accède par le fond d'une grotte, une colonne s'ouvre sur un escalier qui descend. À l'étage inférieur, on parvient à un autre jardin où se trouve un bungalow prévu pour le héros et ses parents. À peu de distance, une porte dissimulée au pied d'un arbre pipai ouvre sur un profond escalier de 100 marches. Parvenu en bas, « on ne voit toujours pas le sol et regardant vers le ciel, on ne voit pas non plus les étoiles, mais seulement des ampoules électriques brillant dans des lampes et lanternes. Dans une telle lumière, [Agnidatta] fut emporté depuis ce monde intermédiaire, en s'envolant » (p. 22). Le héros et ses guides parviennent après un long voyage dans les airs, à un petit jardin. Là, la sorcière dâkiriî qui l'avait accompagné lui explique (p. 23) : « Toutes les plantes que tu vois aux alentours sont de papier. Les lanternes allumées çà et là sont de bronze. L'étang que tu vois est de verre. Il n'y a pas d'eau dedans (...) ». À cet étage n'habitent que les vîr, chaudâ, bhut, prêt, pišác, sahakadâ, dâkiriî, car les hommes n'ont pas le droit d'y résider mais seulement dans le jardin précédent où se trouvait le pipai.
C'est là que demeure Nidhinï, la Maîtresse. Fantasque, elle aime le faste. Il lui faut résider chaque jour dans une maison différente. L'auteur la décrit ainsi :
« II vit une femme âgée de quarante ou quarante-cinq ans, portant des vêtements de brocart tibétain noir, les cheveux bruns et laqués, partagés en deux par du vermillon ; sa poitrine moulée exhibait
23. Marque frontale que les chefs et les rois remettent à leurs subordonnés lors de la fête de la Déesse.
24. Ce jardin paradisiaque fait penser au jardin suspendu de Bombay, ses larges allées, ses buissons aux formes d'animaux ou d'êtres humains, ses arches et fontaines.
Les mondes à part 119
deux mamelons semblables à deux mesures à grain de quatre litres. Habillée à la mode chinoise, elle portait en main un crâne recouvert d'or dans lequel elle buvait de l'alcool ». Pour les paysans du Népal central, les Nidhinï sont les esprits des femmes mortes en
couche : elles hantent les forêts qu'elles sillonnent à toute allure, malgré leurs pieds tournés à l'envers, hirsutes et torse nu, à la recherche de proies masculines. Comme dans la figure royale de Nidhinï, les villageois soulignent la grosseur de leurs seins, si lourds et pendants qu'il faut les fuir dans le sens de la pente, où elles se trouvent gênées par eux.
Dans le roman, la cour de Nidhinï est digne d'une reine. Des danses et des concerts s'y déroulent devant une riche assemblée de femmes de tous les pays : Parsi, Nagarni, Marhatteni, Panchabini, Kasmiri, Madesani, Tharuni, Bangali, Udeseni, d'Angleterre, de France, d'Allemagne, d'Italie, de Russie, du Tibet, de Chine, du Japon, de Malaisie, de Birmanie, de Ceylan. Pourtant, ce cadre princier familier est émaillé de traits étranges, tant pour le héros que pour le lecteur népalais. Ainsi la coutume de se prosterner n'existe pas, mais il faut saluer de loin. De même, lorsqu'il s'agit de prendre conseil auprès des parents d'Agnidatta, c'est sa mère qui est consultée et non son père, car, comme le dit la sorcière boksï : « les femmes ont un naturel vif et éveillé, elles parlent comme il convient ». Enfin, c'est une femme qui gouverne tandis que son mari vit reclus dans une grotte.
On l'a vu, depuis l'entrée dérobée au fond de la caverne, le royaume de Nidhinï et de Ban Jhâkrï se compose de trois étages : le premier est un jardin, dans le second vivent des esprits et des hommes et dans le troisième, la Maîtresse et des esprits exclusivement. Ceci ne constitue qu'une partie du royaume, sillonné de galeries souterraines, d'escaliers et de portes secrètes. Depuis le second étage où il réside, Agnidatta va en explorer une autre partie en compagnie d'une jeune servante néwar. Prenant un autre chemin, ils parviennent à un mât bleu couvert de lianes, d'où l'on entre dans une forêt. Là se trouve une arche flanquée d'une porte, dont il faut frapper l'anneau pour qu'une tête de lion en sorte ; un coup asséné sur la tête de l'animal provoque l'ouverture de la porte qui débouche sur des escaliers gardés par deux sentinelles. Au bas des escaliers s'étend une plaine traversée par trois chemins : l'un mène à la cuisine de Gurumâ, l'autre à la maison du trésor, le troisième à la prison. Pour se rendre à la maison du trésor, il faut traverser un souterrain tapissé de velours, éclairé de lampes électriques. Parvenu à une porte couverte de plaques de verre multicolores, il faut jeter des grains de haricot mâs pour qu'un gros serpent venimeux en surgisse, tirant la langue. La servante explique que si l'on parvient à saisir sa langue au moment où il ouvre la gueule, la porte s'ouvre, sans quoi, il vous coupe les doigts. Derrière se dresse une grande maison où sont entassées quantité de richesses.
De là, une galerie souterraine conduit vers le sud, aux cuisines. Une porte de fer où dort un ours de fer en garde l'accès. Pour l'ouvrir, il faut réciter une formule et lui arracher la patte. Dans les cuisines, toutes sortes de viandes infâmes pour les hommes sont préparées : homme, cheval, vache, chien, cochon, éléphant, tigre, corbeau, vautour...
De là encore, un chemin souterrain conduit vers l'ouest, à la prison. Il débouche sur une plaine couverte de pelouse et éclairée par des lampes à gaz. De tous côtés s'élève une forêt de fer, au milieu de laquelle se dresse une maison de pierres noires, à la porte de fer gardée par deux auxiliaires vïr, qui se trouve être la prison.
Enfin, ressortant des souterrains par un autre chemin, on parvient à une grande forêt, au milieu de laquelle s'étend un lac. Au centre de celui-ci se trouve une île flanquée d'une plate-forme surmontée d'une arche, de quatre mâts de fer aux angles, de canons et de canonniers, le tout éclairé par de grandes lampes aux ampoules électriques. Sur la berge, se tiennent des hommes et des animaux de fer. C'est l'entrée du repère de Ban Jhâkrï, « le chamane de la forêt », qui règne sur ce monde. Quand le héros s'y rend, il se présente en parlant à l'oreille d'un chien de fer. Alors les soldats postés sur l'île frappent sept fois le
120 Marie LECOMTE-TlLOUlNE
bras d'un homme de fer et l'un des mâts s'abaisse, formant un pont, que le héros traverse. Il est accueilli par un Vïr qui jette du riz sacrificiel sur un pilier en récitant des formules, puis frappe sept fois la terre de son pied, provoquant l'ouverture d'une porte dans le pilier qui ouvre sur un escalier de fer très profond conduisant à une petite pièce en fer éclairée d'une faible lampe à huile. De là, une autre porte mène à un tunnel de pierre éclairé par des lampes à gaz, où l'eau arrive jusqu'aux genoux et qui débouche sur un étang profond, que l'on doit traverser dans un canot de peau. Sur l'autre berge se dresse une montagne recouverte d'une épaisse forêt de papayers regorgeant de fruits et de fleurs odorantes et qui semble comme « enflammée par les lampes électriques disposées (...) ». Un long escalier de pierres rouges gravit la montagne, jusqu'à un ermitage. À l'intérieur, une grotte de marbre poli, de cinquante coudées de long et de trente de large, constitue le repère de Ban Jhâkrï. Assis à côté d'un feu dhuni où se consument d'énormes bûches de genévrier et de santal, il semble avoir quatre-vingts ans, sa peau est noire, ses crocs lui descendent jusqu'au nombril et ses cheveux emmêlés jusqu'à la taille. Il porte une peau de tigre à la ceinture, un collier de pierres vertes, un rosaire de graines de ritthâ et un collier d'os de serpents. Assis sur une peau d'ours, il égraine son rosaire. Silencieux, il parle par signes et ne prend la parole qu'au bout de longtemps pour s'adresser au héros, déguisé en messager de l'ami rituel du chamane.
Depuis le deuxième étage d'où il est parti, le héros a découvert les dédales d'un troisième étage où se trouvent prison, trésor et cuisines. Plus bas encore, dans un quatrième étage et en un lieu invraisemblable tant il paraît inaccessible, l'on parvient au repère du Maître, Ban Jhâkrï, clairement dépeint sous les traits d'un ascète, reclus dans son ermitage, absorbé par lectures et prières, noyé dans les fumées de cannabis et des bois odoriférants du feu du renonçant. Quelques leitmotivs reviennent partout dans la description de ce royaume qui allie démons et merveilles : les colonnes, les escaliers, les portes gardées par des mécanismes en forme d'animaux, la reproduction factice du monde des hommes, et le fer. Portes en fer, forêts de fer, animaux en fer et hommes en fer. Ce trait fait évidemment penser au voyage dans le monde souterrain du premier chamane magar, qui en ressort comme forgeron... au corps de fer qui constitue le chamane.
Le royaume de Nidhinï est une répétition monstrueuse et illusoire du monde car tout y est factice : l'eau, les plantes, les animaux et même la lumière25. Le monde sauvage recèle ainsi une sophistication extrême, un monde fabriqué, comme une contre-nature dans laquelle on sombre à partir des failles les plus sauvages de la nature : les grottes, les rivières, la forêt. La géographie du royaume de Ban Jhâkrï évoque l'infini : les étages se succèdent jusqu'à parvenir à une sorte de cosmos souterrain qui sépare le repaire de la Maîtresse des autres. C'est également un labyrinthe de corridors, de passages secrets, de portes initiatiques gardées par des animaux, qui évoquent un monde où les repères spatiaux de l'homme sont désorientés, inadaptés, un monde réservé aux seuls initiés. Seules l'audace et la ruse du héros, manifestées dans ses déguisements successifs, lui permettent d'en comprendre les secrets et c'est peut-être cette faculté d'adaptation à
25. On retrouve ce goût pour l'artifice chez les gouverneurs Rana. En témoigne cette description du palais de Singh darbar en 1929, que l'on croirait tirée du roman Vïr caritra : « Tout à coup, je crus rêver. En me retournant, j'aperçus le général Krishna dont l'image était reflétée dans une glace, mais une glace convexe qui étirait sa silhouette le plus drôlement du monde. (...) La chambre des miroirs précédait une sorte de galeries des glaces normales où le maharaja donne ses réceptions de gala assis sur un trône flanqué des bustes de feu Edouard VII et de la reine Alexandra. Au milieu de cette salle trop dorée, il y avait un bassin de marbre surmonté d'une vasque en verre de Venise, avec un mécanisme compliqué qui permet de déclencher tout à coup des fontaines lumineuses à couleurs interchangeables » (M. Dekobra 1929).
Les mondes apart 121
l'altérité qui est encore ici soulignée. Le dédale du monde à part de Nidhinï, constitué lui- même d'un réseau d'autres mondes à part reliés entre eux par des passages ténus et pratiquement infranchissables, démultiplie l'effet d'enchâssement et l'ivresse qu'il procure.
La page de couverture de l'édition complète du roman dépeint le jeune héros, Agnidatta, entouré du monde des esprits, plongé dans les ténèbres.
122 Marie LECOMTE-TiLOUiNE
La modernité surnaturelle
Quand le lecteur pénètre dans le royaume de Sunâ Jhâkrï, le chamane doré, il est directement conduit dans sa surprenante salle d'audience (p. 115) : « Sunâ Jhâkrï était dans la salle d'audience en compagnie de Rithe Jhâkrï, Masân Jhâkrï, Khole Jhâkrï, Sâte Jhâkrï, Rukh Jhâkrï, Bhïr Jhâkrï, Serphâ Lâmâ, Murmï Lâmâ, Khole Lâmâ, Bhote Lâmâ, Potâle Lâmâ, Guru Dhâmï, Magar Dhâmï, Hâyu Dhâmï, Barâmu Dhâmï, Pahari Dhâmï, Gurhaun, Tharu, Cepang, Gubhaju, Kusle, etc. et toutes sortes d'exorcistes, jhârphuke, tous en train de boire de l'alcool, de fumer et de blaguer. » Cette assemblée de médiums et d'intercesseurs, exclusivement composée de tribaux et de Tibétains, donne une idée précise des spécialistes religieux attribués à cette époque, et par un brahmane, aux différents groupes de population. Tous ceux qui sont appelés Jhâkrï sont visiblement des esprits et leurs noms ne se rapportent pas à une ethnie, mais à des éléments du paysage. Il est successivement question du « chamane doré », du « chamane de la graine rithâ », du « chamane des champs de crémation », du « chamane de l'eau », du « chamane errant », du « chamane des arbres », du « chamane des précipices ». L'association des Jhâkrï au monde sauvage est ici amplement soulignée, comme dans la religion populaire du Népal central ; dans cette région comme dans le texte, ce terme désigne tantôt des intercesseurs humains, tantôt une classe d'esprits liés au chamanisme, le dernier sens prévalant le plus souvent. Suit une série de Lamas, en rapport avec des noms tibétains ou tibétoïdes : « le lama Murmi (ancien nom des Tamang), le lama tibétain, le lama du Potala, le lama Khôl26 ». Viennent ensuite les médiums, dhâmï : « Magar, Hayu, montagnard, Baramu et Guru », clairement associés aux tibéto-birmans. Enfin, pêle-mêle, des Gurung, Tharu, Chepang, Gubhaju et Kusle sont cités dans la description. Les esprits-chamanes, les prêtres bouddhistes, les médiums et les tribaux forment ainsi une communauté communiant dans l'alcool, dont la consommation est strictement interdite aux gens de hautes castes. Dans le royaume de Sunâ Jhâkrï, contrairement au précédent, il n'y a pas de personnage féminin d'importance et les chamanes y jouent davantage leur rôle. On voit ainsi Sunâ Jhâkrï prendre le pouls de Ban Jhâkrï pour le soigner (ce qu'il fera toutefois avec des médicaments ayurvédiques). Plus tard, pour savoir où se trouve Agnidatta, Sunâ Jhâkrï demandent à tous les dhâmïjhàkrî de regarder les présages (jokhânâ herné). Pour cela, il touche de la main du riz sacrificiel et de l'argent qu'il distribue à chacun. Les « dhâmïjhàkrî regardent le riz » et déclarent tous qu'il se trouve près de la rivière à Balahari.
De façon surprenante, la ville du chamane doré est un univers qui nous est beaucoup plus familier que le dédale souterrain du royaume de Ban Jhâkrï, une véritable ville moderne. Ce spectacle, en revanche, avait tout pour paraître merveilleux au lecteur népalais de l'époque :
« Au milieu de la montagne se dressait une forteresse, à l'intérieur de laquelle s'élevait une ville de belles maisons crépies de chaux. Des deux côtés de la route se tenaient d'immenses boutiques. Des bus, des trams et des Victorias roulaient. Sur les trottoirs, des piétons marchaient tout en regardant les boutiques (...). Des fontaines à eau automatiques étaient disposées toutes les cinquante coudées. Des voitures citernes versaient de l'eau sur la chaussée. Des éboueurs enlevaient les ordures de la route et les emportaient dans une charrette. Des Népalais, Panjabi, chrétiens, Français et des gens de tous les pays commerçaient ensemble. (...) Aux carrefours, de très grandes tours sur lesquelles il y avait des horloges pour regarder l'heure. Il y avait des théâtres, des cinémas, des cirques et des salles de danse. Également des cours de justice, militaire et civile, des banques, des imprimeries.
26. Les Kol ou Khôl sont décrits par les Gurung interrogés par D. Thapa (2041 V.S.) comme un groupe anthropophage qui habitait leur région avant qu'ils ne s'y établissent. Dans l'Himalaya occidental, ils sont décrits comme une population munda aujourd'hui disparue.
Les mondes à part 123
(...) À l'extérieur de la ville, sur une plaine, des jeunes gens anglais, musulmans et hindous jouaient au bhakundo, au tennis, au hockey, au polo et à d'autres jeux. Sous la forteresse, des bateaux à vapeur et des canots voguaient sur la Modiganga » (p. 92). « Des vaisseaux de marchandises qui faisaient des trajets entre Kagbeni, Tukuce, Dana, Modibeni, Ridi, Palpa et Dyaughat laissaient entendre leur sirène. De la station de chemin de fer, circulaient des wagons postaux, de marchandises et de passagers depuis la Meci à l'est jusqu'à la Mahakali à l'ouest ; on en entendait les sifflets. (...) Des saheb s'envolaient pour le Mustang dans un ballon qui crachait de la fumée » (p. 162). Cette ville, qui fait clairement référence à l'Inde britannique27, est en fait une société
de chamanes très fermée, puisqu'à l'exception des marchands, « seuls les dhàmïjhàkrï peuvent entrer dans la ville de Sunâ Jhàkrï » (p. 143). Les chamanes y régnent en maître, contrôlant le gouvernement et l'éducation : « Dans la ville, des jhâkri qui venaient faire passer des examens dans les différentes écoles passaient dans un buggy tiré par quatre chevaux, revêtus d'une jupe de brocart tibétain, de colliers de ritthà, d'une coiffe de satin jaune, et frappant leur tambour dhyangro. Dès que la voiture des chamanes s'approchait, les marchands se levaient et les saluaient en se penchant profondément ». On se prend dès lors à imaginer le cursus scolaire des habitants de la ville...
Ce mélange de modernité et de chamanisme est-il pure invention de G. Joshi ? Semblait-il incongru aux Népalais du début de ce siècle ? Nous ne saurons y répondre avec certitude. Toutefois, il est sûr que la première partie du roman, qui se déroule chez les chamanes et qui fut publiée séparément au début du siècle, connut un grand succès auprès du public. L'idée était donc acceptable, et son large développement, plaisant. Dans les textes indiens, les dieux ne possèdent-ils pas des machines extraordinaires, chars volants et armes invincibles ? D'ailleurs, il est dit au Népal que « les "Américains" ont fabriqué les machines que les hindous avaient inventées dans leurs mythes ». Plus directement, cette association entre modernité occidentale et monde des esprits m'a également été formulée à plusieurs reprises au Népal, où je fus apostrophée par des personnes âgées qui m'expliquèrent qu'en fait ce qu'ils appelaient le pàtal, le monde souterrain où régnent les esprits, c'était mon pays à moi, celui des Blancs. En népali effectivement, le terme pàtal désigne non seulement le monde souterrain, mais aussi la direction de l'ouest, opposée à l'est, qui est le paradis, svarga. Ceci peut renforcer l'idée que les Occidentaux sont des êtres chthoniens. Mais les représentations du « Blanc » rejoignent celles des esprits sur bien d'autres points : pâles, ils sont comparés aux morts dont le sang a quitté le visage ou encore aux malades, notamment ceux atteints d'amibes. Poilus, ils sont assimilés à la sauvagerie, aux singes surtout. Leurs pratiques d'ablutions sont inversées et ils mangent des viandes interdites comme celle de la vache, ce qui en fait de véritables bhut. Leurs femmes courtisent les hommes et connaissent plusieurs maris. Enfin, pour ceux qui n'ont qu'une idée embrouillée du décalage horaire, ils vivent la nuit. Comme dans le roman de Vïr caritra, cette monstruosité se double de richesses extraordinaires, de machines merveilleuses, d'une puissance incontestée sur le monde.
27. On retrouve, de façon un peu différente, ce curieux mélange dans le Népal des Rana, comme dans cette scène décrite en 1929 lors de la fête de nouvel an de la très traditionnelle ville de Bhaktapur : « Je m'attendais à voir surgir le cortège imposant des princes en somptueuses robes népâliennes, montés sur des éléphants caparaçonnés de brocart d'or. Mais le Népal me réservait encore une surprise. Les fils du maharajah parurent, montés sur des chevaux en selle, en costumes de cavalier élégant fournis par les meilleurs tailleurs de Londres... Nous échangeâmes des poignées de main. Étais-je à Bhatgaon ou bien en présence de parfaits gentlemen riders habitués du Rotten Row ? Nouvelle stupéfaction : trois conduites intérieures américaines surgirent, rideaux baissés. (...) Ces voitures, dont les occupantes ne devaient pas être dévisagées par la foule, transportaient les femmes des fils du maharajah. » (M. Dekobra 1929).
124 Marie Lecomte-Tilouine
De manière plus structurelle, le classement des Occidentaux dans le monde des esprits, auquel participent toutes ces analogies en le renforçant, s'explique peut-être avant tout par une logique classificatoire reposant sur le principe général à l'œuvre dans ce roman du renvoi de toute forme d'altérité dans le registre des esprits, où se côtoient pêle- mêle diverses sortes d'êtres étranges et malfaisants, des animaux sauvages, des tribaux et des Occidentaux. Ce procédé de renvoi dans la catégorie des esprits permet aux Népalais de penser l'existence de l'autre, tout en lui conservant une place à part dans leur univers mental. Le roman présente en fait deux catégories au sein de cet ensemble, dont nous avons vu l'opposition de traitement : les esprits néfastes hindous sont des alliés possibles, tandis que les esprits tribaux sont conciliés par le remplacement de leur roi par un roi guerrier hindou. Ici encore le roman de Vír caritra semble exposer un modèle fondamental de l'hindouisme himalayen où le roi (ou son substitut le chef de village) est par excellence la personne qui traite avec l'étranger28, lequel renforce son prestige, tandis qu'il confie les relations avec les forces obscures du royaume à des spécialistes - ascètes et chamanes.
La geste d'Agnidatta se situe à n'en point douter à la frontière de tous les mondes, visibles et invisibles. C'est une pérégrination dans l'altérité sous toutes ses formes, dont ressort indemne le héros. Son voyage jusqu'à Ridi est proprement chamanique : sauvant les hommes en perdition dans les mondes des esprits, le héros passe sans cesse d'un plan humain à des plans surnaturels, déguisé, rusé. Il noue des alliances avec l'au-delà, devenant gendre des esprits à deux reprises, et maîtrise les trois étages de l'univers, qu'il parcourt, descendant au plus profond du royaume des Jhankri et s 'envolant dans les airs dans le ballon des râksas. Comme le chamane, sa relation aux esprits est un combat, mais il prend ici une forme particulière. Il ne s'agit pas de se battre en face-à-face ou de se démêler avec des esprits assaillants comme le décrivent les chamanes, mais d'un combat organisé, gigantesque, où des armées entières s'affrontent, sous la direction du héros. De même, les armes utilisées sont proprement fantastiques en ce Népal de 1900 : c'est à coup de fusils, de revolvers, de bombes et même de torpilles que les deux camps se déchirent.
Toutes ces techniques contrastent fortement avec les conceptions actuelles relatives aux esprits, qui sont pensés comme rétrogrades et détestant la modernité, reflétant sans doute combien les Népalais ont depuis lors fait leur la technologie occidentale, en pensée tout du moins, reléguant l'Altérité dans la seule sauvagerie.
Comme un chamane également, le héros est neutralisé pour un temps par les esprits, rendu muet et enfermé dans une cage de fer, et sa personne plaît particulièrement aux esprits féminins qui le courtisent. Tous ces traits sont très proches de ce que décrivent les chamanes du Népal central, qui racontent souvent comment ils furent capturés, rendus muets et prostrés avant de posséder leur art et comment par la suite, ils sont l'objet des avances obscènes des sorcières. Enfin, le cadre général hindou dans lequel s'insèrent ici les esprits chamaniques reflète très précisément la religion populaire du Moyen-Pays népalais.
De nature chamanique, la geste d'Agnidatta pose le voyage comme pérégrination dans l'altérité des anti-mondes, et l'alliance avec les êtres de la surnature comme garant de
28. Comme la note précédente l'aura souligné, les dirigeants Rana pouvaient certainement être perçus eux-mêmes comme relevant d'un monde extérieur, comme des étrangers. Ce phénomène ne date toutefois pas des Rana, puisque dès le XVIIe siècle, le souverain de Katmandou, Pratap Malla, commandita non seulement une monumentale inscription comprenant des mots de diverses langues qu'il plaça dans son palais, mais également une œuvre où un homme portant des jumelles est représenté. Il se trouve qu'il avait reçu lui-même des jumelles des premiers Occidentaux à pénétrer dans son royaume, deux pères capucins retournant de la Chine vers l'Inde.
Les mondes à part 125
l'ordre de l'univers29. C'est autour de ces alliances que s'articulent et se comprennent les relations des hommes aux différents types d'esprits, et probablement de groupes humains auxquels ils renvoient, mais les relations qu'elles expriment ne sont jamais simples, tout comme la logique qui sous-tend les événements. Chaque groupe a ses propres valeurs qui se confrontent au contact de ses membres, au sujet des tabous alimentaires, de la pureté, et surtout, bien entendu, des règles d'alliance. Même si le récit souligne abondamment à quel point la logique des esprits organise notre monde phénoménal à notre insu, le héros se distingue précisément de l'homme ordinaire par le fait qu'il déjoue ces pièges par une adoption contrôlée de l'altérité, endossant diverses identités qui lui permettent d'apparaître comme un intrus tolerable dans le domaine de l'Autre, en tant qu'intermédiaire, par exemple sous le déguisement d'un messager ou d'un marchand itinérant. Adoptant ainsi la logique des esprits pour les tromper, il parvient à les subjuguer et à leur imposer un ordre hindou, par le moyen d'alliances répétées.
Vîr caritra est une vaste métaphore du monde tel que le conçoivent les Népalais. Il souligne combien le hasard n'a pas de place dans l'explication du monde phénoménal, si ce n'est comme preuve de l'existence des esprits. La geste d'Agnidatta n'est pas une quête dans les mondes imaginaires ; elle ne vise même pas à en modifier la nature, mais à se les allier, à les lier, bàndhne, pour clore le monde et parvenir au point de départ, tout comme un simple point transforme la droite infinie en cercle. Cet exercice mental de circonscription rappelle l'opération qui permet - entre autres ? - au chamane de traiter des afflictions en les insérant par la récitation dans un monde clos, idéel, mythique et construit, où lui-même a tout pouvoir30. Dans ce monde parallèle dont le chamane maîtrise les composantes, les afflictions sont réduites à des épiphénomènes de causes malignes essentielles : le hasard, l'inconnu, l'inexplicable n'existent pas. Ainsi, par de multiples aspects et non pas seulement parce qu'il se déroule chez les esprits chamaniques, Vîr caritra apparaît comme un récit chamanique, mais la question de savoir si l'enchâssement est la forme narrative qui serait propre à ce genre reste, elle, ouverte.
Références bibliographiques
Dandin 1995 Histoire des dix princes, (traduit du sanskrit, présenté et annoté par Marie-
Claude Porcher), Paris, Gallimard. Dekobra, M.
1929 « Le Népal, royaume interdit », L 'illustration (3 août 1929), p. 110-117. Foucault, M.
1963 Raymond Roussel, Paris, Gallimard. Hamayon, R.
1990 La chasse à l'âme, Nanterre, Société d'ethnologie. Hopkins, W.
1969 Epic mythology, New York, Biblo and Tannen.
29. Cette alliance avec la surnature est, pour Roberte Hamayon (1990 : 738-739), constitutive du chamanisme : « (...) le chamanisme est un système symbolique fondé sur une conception dualiste du monde, impliquant que l'humanité entretient des relations d'alliance et d'échange avec les êtres surnaturels censés gouverner les êtres naturels dont dépend sa subsistance, plus largement les facteurs aléatoires de son existence ».
30. Cette idée a été développée par G. Maskarinec 1995.
126 Marie Lecomte-Tilouine
Joshi, G. 1965 [2022 V.S.] Vir caritra, (édité et introduit par Kamal Diksit), Lalitpur,
Jagadamba Prakashan. Lacôte, F. (intro., trad, et notes)
1924 L 'histoire romanesque d'U day ana, roi de Vatsa, Paris, éd. Bossard. Lecomte-Tilouine, M.
1987 «Hommes/divinités de la forêt. À travers le miroir au Népal central», Études rurales 107-108, p. 55-69.
Maskarinec, G. 1 995 The Rulings of the Night, Madison, University of Wisconsin Press.
Naraharinath, Yogi, éd. 1964 [2021 V.S.] Gorkhâ Vamsâvalî, Kaši, Aryabirsangh.
Pradhan, Kumar 1984 A History of Nepali Literature, Delhi, Sahitya Akademi.
Sales, A. de 1991 Je suis né de vos jeux de tambours, Nanterre, Société d'ethnologie.
Thapa, Dharmaraj 1984 [2041 V.S.] Lok samskrtiko gherâmâ Lamjung, Sajha Prakashan, Kathmandu.
TODOROV, T. 1978 Poétique de la prose, Paris, Seuil.
Vernant, J.-P. 1999 L'univers, les dieux, les hommes, Paris, Seuil.
Verschaeve, L. (trad, et intro.) 1979 La cité d'or et autre contes, Paris, Gallimard.