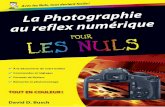Face aux images médiatiques : enjeux politiques du numérique au cinéma
NUMISMATIQUE - Bibliothèque numérique de l'Ecole ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of NUMISMATIQUE - Bibliothèque numérique de l'Ecole ...
REVUE
NUMISMATIQUE DIRIGÉE PAR
A. BLANCHET, A. DIEUDONNÉ et J. BABELON
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : P. LE GENTILHOMME
Ostendite mihi numisma census Cujus est imago lune, et superscriptio ?
MATTH., XXII, 19, 20.
CINQUIÈME SÈME — TOME CINQUIÈME
PROCÈS-VERBAUX DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE NUMISMATIQUE
PARIS
SOCIÉTÉ D'ÉDITION « LES BELLES LETTRES »
95, BOULEVARD RASPAIL, 95
1941
SOMMAIRE
du volume de 1941.
Mémoires et dissertations :
BLANCHET (Adrien). Le rhinocéros de l'empereur Domitien 5 VIAN (C.). Quelques trouvailles monétaires dans le Vaucluse et
la région, faites de 1920 à 1941 11 DIEUDONNÉ (A.). Essai , sur l'histoire monétaire de l'Artois, d'après
Alex. Hermand (Hist. monét. de l'Artois). 33 BABELON (Jean). Sur un médaillon de cire de Louis XIV. — Pl. I
et II 57 BAILLE. Sur un jeton conservé au Musée Carnavalet 65 Mélanges et Documents. — BLANCHET (Adrien). Note sur un jeton
de Garcia Loppez de Roncevails (xive s.) 69
Chronique 73 Bulletin bibliographique 79
Procès-verbaux de la Soc. fr. de Numismatique.
COMITÉ DE PUBLICATION
BABELON (J.).
BAILHACHE (D' J.).
BLANCHET (Adr.), de l'Institut.
David LE SUFFLEUR (A.).
DIEUDONNE (A.).
LE GENTILHOMME (P.).
et le Président de la Société française de numismatique.
Le prix de l'abonnement pour l'année 1940 est fixé à : France 80 francs ; Étranger : 100 francs. La correspondance relative aux abonnements devra être adressée à M. Jean MALYE, délégué général de l'Association Guillaume Budé, 95, boulevard Raspail, Paris (6e ).
Les abonnements sont payables à la
SOCIÉTÉ D ' ÉDITION OE LES BELLES LETTRES »
Compte de chèques postaux : 336.57.
La Revue numismatique ne rend compte que des ouvrages qui lui sont envoyés. Ils doivent être adressés à M. P. LE GENTILHOMME, à la Bibliothèque Nationale (Cabinet des Médailles), 58, rue de Richelieu, Paris (2 e ), avec la mention : pour la Revue Numismatique.
Avis. — Par suite des circonstances, la Revue numismatique paraît, pour 1941, en un seul volume, réduit pour la quantité de .matières.
ADR. Br,.
•
REVUE
NUMISMATIQ CE DIRIGÉE PAR
A. BLANCHET, A. DIEUDONNÉ et J. BABELON
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : P. LE GENTILHOMME
Ostendite mihi numisma census Cujus est imago 'ec, et superscriptio
MATTII., XXII, 19, 20.
CINQUIÈME SÉRIE — TOME CINQUIÈME
PROCÈS-VERBAUX DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE NUMISMATIQUE
PARIS
SOCIÉTÉ D'ÉDITION « LES BELLES LETTRES »
95, BOULEVARD RASPAIL, 95
1941
' if -- ....—". ....\
1\81-1C I - 4,, / leme,„ .......... ,.. 4. ,
"... 1 t ....., .............,
LE RHINOCÉROS
DE L'EMPEREUR DOMITIEN
11 y a, dans la série des de bronze, d'un petit module, au nom de Domitien, quatre variétés au moins d'une pièce qui porte, d'un côté, circulairement, la légende IMP . DOMIT GERM. Au centre, S. C. Au revers, sans légende, un quadrupède de structure massive, qui est ma-nifestement un rhinocéros. Sur une des variétés, l'animal est à droite ; sur les autres, il se tourne vers la gauche.
La deuxième et la troisième variétés se distinguent sur-tout par de menus détails, par exemple un module plus grand, l'animal et les lettres S. C . un peu plus importants. Sur la quatrième variété, le revers ne comporte que la marque S . C. et une branche d'olivier.
La présence d'animaux de provenance lointaine sur les monnaies romaines n'est pas exceptionnelle. L'éléphant y est relativement fréquent 1 .
Toutefois, le rhinocéros ne paraît que sur des pièces de Domitien 2 , espèces assez exceptionnelles, auxquelles on ne saurait cependant refuser la qualité de monnaies, car la marque du Sénat, Senatus consulto, ne permet pas de croire qu'il s'agit de simples tessères.
6 ADRIEN BLANCHET
Ce qui doit retenir spécialement notre attention, au sujet du type de ces petites pièces, c'est que le poète Martial a précisément consacré deux menus poèmes de son livre De
spectaculis à un rhinocéros, qui avait paru dans l'arène. Répétons les vers les plus caractéristiques de ces deux
morceaux :
I° Praestitit exhibitus Iota tibi, Caesar, arena
Qua,e non promisit, prœlia rhinoceros.
(De spect., § IX.)
2° Sollicitant pavidi dura rhinocerota magistri..
•
Namq- ue gravem gemino cornu sic extulit ursum,
Jactat ut irnpositas taurus in astra pilas.
(Ibid., §XXII.)
Il est à peu près indiscutable que les petites monnaies de bronze, au nom de l'empereur Domitien, ont été créées pour conserver le souvenir du rhinocéros dont l'apparition avait frappé si intensément l'esprit du peuple amateur de spec-tacles.
Dans son Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, Sté-
phane Gsell n'a pas parlé du rhinocéros 3 . C'est évidemment parce que cet animal n'habite pas l'Afrique septentrionale et ne l'a pas fréquentée probablement à l'époque romaine.
Le type monétaire de Domitien n'est pas demeuré in-aperçu ; on s'en doute bien. Eckhel, dont la science pro-fonde et sagace n'a guère laissé de côté les faits qui inté-ressent la numismatique antique, n'oublia pas de citer Martial à propos des monnaies au type du rhinocéros, dont trois variétés existaient dans le Cabinet impérial de Vienne. Il dit que, sur toutes, deux cornes surplombent le mufle de l'animal, dont l'une plus près des narines et plus
LE RHINOCÉROS DE L ' EMPEREUR DOMITIEN
longue, tandis que la seconde, au-dessus, est plus courte. C'est effectivement ce que l'on peut distinguer sur certains exemplaires plus nets que d'autres.
Et ainsi, le vers de Martial s'accorde avec les .petits mo-numents contemporains, ce qui est assez normal, car le rhinocéros de Domitien devait être à deux cornes, comme nous allons le voir, en nous permettant une petite incur-sion dans le domaine de l'Histoire naturelle.
Le vieux numismate Jean Hardouin, polygraphe assez paradoxal (1646-1729), croyait qu'il n'y avait qu'une corne sur le nez de• l'animal représenté dans la numismatique de Domitien. Il est certain que, même plus tard, on aurait pu parler du rhinocéros africain à corne unique. Effective-ment, le voyageur James Bruce croyait avoir.vu autant de ces pachydermes à une corne unique que de spécimens à deux cornes 4 . C'est peut-être que cet explorateur de la vallée du Nil avait rencontré quelques spécimens du grand rhinocéros « camus » (Rh. simus), dont la corne antérieure (quelquefois longue d'un mètre) dépassait tellement la seconde, placée immédiatement en arrière qu'elle pouvait de loin, paraître unique. Cette espèce de l'Afrique centrale a probablement disparu depuis plus d'un demi-siècle 5 .
L'espèce africaine, dont il existe, encore aujourd'hui, beaucoup de spécimens, depuis l'Abyssinie jusqu'à l'An-gola, présente toujours deux cornes, dont une nasale anté-rieure, atteignant jusqu'à 0 m. 75, tandis que la posté-rieure n'a généralement que 0 m. 25, et ne dépasse guère fi in. 45.
Il est donc probable que les rhinocéros, transportés à Ilorne, étaient venus par l'Égypte, et qu'ils étaient bien de la race de ceux que Pausanias, un demi-siècle plus tard, dénommait AiO ottxoi Tccopot ".
Le problème n'a pas éveillé l'attention d'un auteur con-
8 ADRIEN BLANCHET
temporain 7 , qui se borne à dire que Martial a consacré plusieurs épigrammes à cet animal. Un autre auteur a éga-lement négligé le problème et s'est borné à citer les petits bronzes de Domitien 8 . -
La question de la race du pachyderme est tranchée. Il reste un autre problème moins aisé peut-être, d'au -tant plus qu'à ma connaissance, il n'a pas reçu de solution définitive.
Depuis la préface que Friedlânder a placé en tête de l'édition des œuvres de Martial 9 , on admet généralement que le Liber spectaculorum du poète latin a été publié par lui en 80 de notre ère.
Or,. d'autre part, c'est après la campagne contre les Chatti, par laquelle le territoire de l'Empire avait été accru, que Domitien prit le surnom de Germanicus, en 83 de notre ère 10 . Et les quadrantes de bronze au type du rhi-nocéros portent précisément ce surnom de « germanique ».
Par conséquent, il y a une contradiction entre la date admise pour le « livre des Spectacles » de Martial et celle que nous devons accepter pour les quadrantes, qui ne doivent pas être antérieurs à 83.
Or, nous avons admis que le type de ces pièces fait cer-tainement allusion à l'arrivée à Rome du rhinocéros de Domitien, et il semble que ce point de vue est incontes-table.
Il faudrait donc remettre en question la date de la pu-blication du livre De spectaculis; c'est un point relative-ment important et je me garde évidemment de conclure.
Du reste, ne pourrait-on accepter que Martial ait rendu public ce livre-là en 83 ou 84, plutôt qu'en 80 ? Aussi bien, il y a d'autres anomalies apparentes dans la chronologie adoptée pour les œuvres du poète ; et, d'ailleurs, on peut bien ad-mettre que Martial a publié une seconde édition de son
LE RHINOCÉROS DE L'EMPEREUR DOMITIEN 9
recueil sur les spectacles, puisque l'on sait qu'en 98, il donna une seconde édition de son sixième livre d'épi-grammes.
ADRIEN BLANCHET.
P.-S. — Au cours de l'impression de mon modeste ar-ticle, j'ai pu, grâce à l'obligeance de mon confrère Alfred Ernout, Président de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, recevoir des renseignements intéressants de M. Henri Frère, professeur à la Faculté des Lettres de l'Université de Nancy. Cet érudit, qui prépare un ouvrage sur Martial, s'est occupé de la question que j'effleure dans mes dernières lignes. -
Il y a bien une réticence chez Friedlânder, qui admet que si, dans- le livre des spectacles, diverses pièces ont rap-port à l'inauguration de l'Amphithéâtre par Titus, d'autres poèmes sont de l'époque de Domitien. Au contraire, A. Dau (De Martialis libellorum ratione temporibusque diss., Rostock, 1887) croit que le fond du livre sur les spectacles est du temps de Domitien et que des additions y furent faites plus tard. D'autres travaux de Friedlânder lui-même, de Gilbert, de Weinreich, de Kenneth Scott (de 1888 à 1936) ont de nouveau soulevé la question et M. Frère lui-même l'a examinée dans un compte rendu (Supplément critique Budé, 2, 1930, p. 157 et s.).
M. Frère donnera certainement la solution du problème ; je m'en voudrais d'insister sur cette question littéraire : je ne l'ai soulevée que pour démontrer que les numismates méconnaissaient le plus souvent, l'intérêt général des qua-drantes au type du rhinocéros".
1. C'est celui d'Afrique, à grandes oreilles que les monnaies ont représenté. Voy. par exemple, un aureus de Titus et un as d'Antonin le Pieux.
L'hippopotame est moins fréquent. Un très bon exemple est celui d'un sesterce d'Otacilia Severa.
10 ADRIEN BLANCHET
2. Je veux parler de monnaies. Car ce n'est pas la seule fois que les Romains ont représenté cet animal (cf. Otto Keller, Die antike Tierwelt, Leipzig, 1909).
Le Musée archéologique du Mans conserve une figure de bronze où le rhinocé-ros fait corps avec le socle ; voy. Robert Triger, dans la Revue histor. et archéo-logique du Maine, 1914, p. 29-34, fig. p. 30. . 3. S'il mentionne le lion, c'est seulement d'après Stace, je le crois du moins (op.
cit., t. I", 1913, pp. 111-2). Cependant, des épigrammes de Martial nous parlent, plusieurs fois, de ce fauvè à l'occasion des jeux (1. I, VII et XV). Gustave Loisel (Hist. des Ménageries, t. I", 1912, p. 104) a cité brièvement le lion de Domitien et le rhinocéros.
4. Travels..., 1768-1772. Edimbourg, 1788; 2e éd. 1805. Cet auteur a mêlé ses affirmations et ses réserves. Cependant, il paraît enclin
à croire à l'existence, dans certaines parties de l'Afrique, du rhinocéros à corne unique. Cf. la traduction Castera : James Bruce, Voyage en Nubie et en Abyssi-nie, t. V (1791, Paris ; Voyage aux sources du Nil), p. 105 ; p. 112 : affirme que le rhinocéros des pièces de Domitien n'a qu'une corne).
5. Il existe bien des rhinocéros à corne unique ; mais c'est d'abord celui de l'Inde, qui habite entre l'Himalaya et le Gange, et ensuite' celui, dit de Java, qui habite aussi la Birmanie, etc.
6. El., c, xu ; Bœot., c. xxi. Pausanias dit bien qu'ils ont une corne à l'extré-mité du nez et une autre plus petite au-dessus.
7. Harold Mattingly, Coins of the Ronian Empire in the British Museum, t. II, 1930, p. 411, n" 496-500, pl. 81, n°' 16 et 17. L'auteur classe les bronzes avec le rhinocéros parmi les pièces non datées. Et ces mêmes monnaies sont encore plus négligées dans l'ouvrage du même auteur, en collaboration avec Edw. A. Syden-ham (The Roman imperial Coinage, t.ol. II, 1926, p. 152 et 208, pl. VII, 108).
8. Fr. Gnecchi, dans Rivista ital. di Numismatica, 1916, p. 69, pl. III, 25. Il a reproduit une pièce considérée comme portant la figure d'un hippopotame : c'est un rhinocéros.
9. Leipzig, 1886, 2 vol., pp. 51, 136 et s. 10. Cf. Asbach dans Westd. Zeitschrift f. Gesch. u. Kunst, t. III, 1884, p. 17;
cf. Th. Mommsen, H. R., t. IX, p. 189. — Et même, d'après d'autres auteurs, qui placent cette campagne en 84, le titre de Germanicus pourrait être postérieur à 83 (cf. Eckhel, D. N., t. VI, p. 378 ; Schiller, G. der rôm. Kaiserzeit, t. I", 1881, p. 527).
Stephane Gsell admettait la date de 83 pour le triomphe de Domitien sur les Chatti.
QUELQUES TROUVAILLES MONÉTAIRES
DANS LE VAUCLUSE ET LA RÉGION FAITES DE 1920 à 1941 1
Il semble résulter, de ce bref inventaire, qui malheureu-sement ne comprend qu'une partie des trouvailles de la région, de 1920 à 1941, que, de beaucoup, les petits bronzes de Massalia au taureau cornupète dominent dans les oppida, des environs d'Avignon.
On en trouve à Avignon, Barry près de Bollène, Boni-bon, Calissanne, Cavaillon, Istres, Laudun (Camp de César), Maussanne, Mouriès, Noves, Orgon, La Roque d'Antheron, Montfaucon, Saint-Gabriel, Saint-Remy, Vaison, etc.
Les moyens bronzes au taureau cornupète sont, par contre, assez rares, de même que les PB. au taureau mar-chant. Ces derniers ont été trouvés dans les oppida de ,
Calissanne, Cavaillon, Mouriès. Les PB. de Massalia,. de la décadence, à l'aigle, au caducée, au lion, ne sont pas très communs dans le Vaucluse.
Se fondant sur la lettre K, souvent très visible au droit du PB. au taureau marchant, quelques érudits ont cru qu'il s'agissait d'une monnaie d'alliance entre Marseille et Ca-vaillon. Le grand nombre, relativement, des trouvailles de PB. de cette variété, à Cavaillon même, semblerait donner quelque fondement à cette supposition.
On pourrait également penser à des monnaies frappées à Cavaillon sous la dépendance de Marseille.
12 C. VIAN
Les oboles aux anciens types sont rares : 2 oboles au crabe (Cavaillon et Robion), 1 au casque (Orgon), plusieurs à la tête casquée (Cavaillon, Saint-Remy). Celles à la roue sont très communes et se trouvent dans presque tous les oppida, lorsqu'ils sont quelque peu importants.
A Cavaillon nous trouvons de nombreuses dégénéres-cences des oboles à la roue ainsi que des PB. au taureau cornupète. Les drachmes de Massalia, en général d'une basse époque, sont un peu plus rares et sans doute leur volume en est quelque peu la cause, car les chercheurs les ramassent plus aisément et se gardent de le dire.
Les dioboles à l'aigle et à la tête de Pallas sont rares : la collection de Mile Jouve, à Cavaillon, en renferme un exemplaire trouvé autrefois au mont Caveau. Et pour ce qui concerne spécialement les monnaies de Massalia, si abondantes dans la vallée du Rhône et même ailleurs, M. Blanchet avait noté, pour le département de Vaucluse, des provenances dans les localités suivantes : Apt, Ansouis, Le Castelar de Cadenet, Orange, Beauregard, Barry près de Bollène, Beaumes-de-Venise, Cavaillon, Malemort (Re-cherches sur l'influence commerciale de Massalia..., dans la Revue belge de Numismatique, 1913, et dans Mémoires et notes de Numism., 2e sie, 1920, p 236-7).
Les oboles de Cabellio, peu communes en général, se trouvent à Cavaillon, à Barry près de Bollène, au Camp de César, mais toujours par unités. Les Cabellio aux deux têtes, en bronze, sont plus communs que les Cabellio à la corne d'abondance, et ces deux variétés se rencontrent dans les mêmes oppida (voyez : Adrien Blanchet, Traité des Monnaies gauloises, pages 502 à 504 (circulation des monnaies) et 597-598 (Trésors dans le Vaucluse).
Les bronzes d'Avenio au sanglier, toujours en mauvais état, se rencontrent parfois à Cavaillon. A Calissanne
TROUVAILLES MONÉTAIRES DANS LE VAUCLUSE ET LA RÉGION 13
(oppidum de Constantine), M. Gauthier a découvert un bronze, imitation de Marseille avec légende « pouvant » se rapporter à Avignon (La Tour 2520).
Le bronze Krisso se trouve à Cavaillon. M. Luneau avait trouvé celui de sa collection. à Laudun (Camp de César).
Les drachmes argent des Arecomiques, avec ou sans légende, se rencontrent à Barry, près de Bollène (dont des exemplaires fourrés), Cavaillon (ex. fourré), Orgon, Ve-nasque (fourrée). M. Adrien Blanchet (page 504) en signale également au Camp de César près de Laudun. Cette pièce se trouve assez fréquemment dans le Vaucluse : on m'en a offert de nombreux exemplaires, le plus souvent sans légende, mais dont la provenance ne pouvait être pré-cisée.
Les petits bronzes des Volques Arcomiques, avec le Démos debout ou la colonie sacrifiant, sont très communs : on en a trouvé à Bollène, Calissanne, Cavaillon, Eygalières, l'Isle-sur-Sorgues, Lagnes, Saint-Remy, Vaison. Ceux avec la figure de la colonie debout sont moins communs que ceux au Démos.
Les « Samnagenses » se rencontrent, assez rares, à Cavail-lon, Bollène. On en a trouvé également au Camp de Cé-sar (Laudun). Les oboles de Nîmes sont rares (Cavaillon).
Les oppida de Boulbon, Cavaillon, Saint-Remy ont fourni des PB. de Nîmes au sanglier. Les as d'Auguste et Agrippa sont très communs dans la région.
Les drachmes allobroges au quadrupède courant sont assez rares : à part les trois grands oppida de la région (Cavaillon, Barry près de Bollène, Camp de César près de Laudun), on en a trouvé un exemplaire à Caumont.
On a recueilli leS Allobroges à l'hippocampe, à Bollène, Cavaillon ; les pièces de la Vallée du Rhône au buste du cheval, rares (Kasios), seul exemplaire à Bollène. Il
14. C. VIAN
semble que ces pièces puissent être attribuées aux Cavares On m'en avait signalé un autre exemplaire, trouvé à Pont-Saint-Esprit, mais je n'ai pu vérifier.
Les monnaies de la Vallée du Rhône au cavalier (Vo-conces?) se sont rencontrées fréquemment dans le Vau-
cluse : je n'en mentionne qu'une seule dans la liste, trouvée à Velleron ; mais d'autres exemplaires ont été récoltés : deux à Avignon (ex-collection Roux, actuellement coll. d'Aulan); à Caumont, à l'Isle, etc.
Les PB. d'Antibes se trouvent à Cavaillon, mais peu souvent. Les GB. de Vienne, toujours assez rares, à Bol-lène et au Camp de César (parfois divisés en deux) ; un PB. de Germanus (B1., fig. 119) a été trouvé dans la ville d'Apt, un PB. de Sextus Faix (T. Pom.) à Avignon. Deux autres Sextus Faix m'ont été présentés comme trouvés dans la région, mais je ne les ai pas acquis.
Les potins, imitations de Marseille, attribués aux Eduens, Sequanes, Turones, etc. (?), se sont rencontrés, la plupart du temps dans un si mauvais état de conservation qu'on ne peut les rattacher à une variété étudiée : à Avignon, Calis-sanne, Cavaillon.
Des Volcae Tectosages nous signalerons seulement la drachme à la tête de nègre trouvée au Camp de César. M. Adrien Blanchet mentionne dans son ouvrage quelques
exemplaires trouvés à Cavaillon, Barry près de Bollène, et. au Camp de César même (voy. pages 502 et suiv.).
Un PB. des Arverni IIPAD a été découvert à l'oppidum de Cadenet, près de Chusclan (Gard).
Si l'on excepte le bronze de Carthage, trouvé à Bollène, aucune monnaie lointaine n'est venue échouer dans cette partie de la Gaule. Et si l'on note une monnaie celtibé-
rienne d'Ilerda, il faut être surpris qu'elle soit -seule de son pays, car les monnaies de l'Espagne antique ont été
TROUVAILLES MONÉTAIRES DANS LE VAUCLUSE ET LA RÉGION 15
rencontrées assez fréquemment dans le Midi de la Gaule (voy. A. Blanchet, Traité m. p. 183-4). Il est surpre-nant aussi- qu'aucun spécimen de monnaie à légende ibé-rique de Narbonne, des Longostalètes de Béziers, n'ait été rencontré davantage.
Quant au monnayage romain, si les pièces de la Répu-blique sont exceptionnelles, celles de l'Empire sont très nombreuses jusqu'à la fin du ive siècle, attestant ainsi le degré de romanisation du Sud-Est de la Gaule. On remar-quera que les monnaies des empereurs gaulois du 111e quart du 111e siècle ont été recueillies en très petit nombre, puisque l'on a pu noter seulement 6 Tetricus, à Vaison. Il y a de bonnes raisons pour n'être point surpris par cette constatation. Le gouvernement de Postumus et de ses suc-cesseurs s'est exercé surtout au nord de Lyon et de la Loire en général.
Notons encore que l'on a recueilli, à Cavaillon, une petite pièce qui porte TYPA dans les cantons d'une roue (type des oboles de Syracuse, prototype de celles de Massalia. Cf. A. Blanchet, Centenaire des Antiquaires de France et Tr. des m. g., p. 229, fig.).
En somme, en combinant les renseignements publiés antérieurement et ceux que nous avons réunis, spéciale-ment pour le département de Vaucluse, on aura probable-ment l'inventaire le plus complet ; qui ait été donné pour les monnaies antiques, dans une région de la Gaule.
C. VIAN.
APT (Vaucluse). (Fouilles dans Apt même.)
a) Coll. Gay à Apt.
1 PB. de Germanus (Blanchet, fig. 119).
16 VIAN
AVIGNON.
(Rocher des Doms.)
a) Coll. Gagnière à Avignon.
1 MB. de Massalia au taureau cornupète (Blanchet, fig. 89).
(Fouilles dans la Balance.)
b) Coll. Vian à Avignon.
3 PB. de Massalia au taureau cornupète (Blanchet, fig. 91).
1 PB de Sextus Relis (B1., fig. 121). 1 MB. de Sequani (B1., fig. 102 var.). 1 PB. d'Auguste à l'aigle. 1 MB. de Faustine mère. / 5 PB. de Tétricus dégénérés.
(Fouilles des Dames de France.)
1 PB. de Massalia au taureau cornupète (B1., fig. 91). 1 PB. de Massalia au caducée. 1 MB. de Vespasien. 1 MB_ d'Antonin.
BOLLÈNE.
(Oppidum de Bart-y.)
a) Coll. Gauthier à Cavaillon.
1 dr. argt. Allobroges à l'hippocampe (B1., fig. 128).
b) Coll. Vian.
6 oboles Massalia à la roue (B1., fig. 79). 2 drachmes Massalia dont 1 fourrée (B1., fig. 85). 1 dr. Volcae Arecomici fourré avec légende (B1., fig. 123). 2 dr. Volcae Arecomici sans légende. Même type.
TROUVAILLES MONÉTAIRES DANS LE VAUCLUSE ET LA RÉGION 17
I PB. Samnagenses (B1., fig. 98). 8 PB. Massalia au taureau cornupète (Bi., fig. 91). I PB. Arecomici au Démos (BI., fig. 475). 2 dr. argent au Cavalier. BRI et COMA . (B1., fig.
126). 6 MB. de Nîmes, Auguste et Agrippa.
(Il y en avait beaucoup .d'autres.) 1/2 MB. de Nimes, partagé au milieu. 1/2 GB.' de Vienne, aux cieux têtes (B1., fig. 472), par-
tagé en deux. I drachme argt. Kasios au buste de cheval (B1., p. 257). 1 GB. Antonin le Pieux. 1 MB, Adrien.
(A Bollène même.)
(Autrefois coll. Paul Manivet, actuellement coll. Vian.) 1 MB. de Carthage au cheval.
BOULBON (Bouches-du-Rhône).
(Quartier de la Montagnette.)
a) Coll. Dumoulin à Cavaillon.
I PB. de Nîmes au sanglier (Blanchet, fig. 476).
b) Coll. Gauthier.
1 denier fruste argent fourré, République Romaine. I PB. de Massalia au taureau cornupète (B1., fig. 91)
CABRIÈRES D ' AVIGNON (Vaucluse).
a) Coll. Gauthier..
I denier République Romaine, famille Caecilia. 1 PB. de Constance II. 1941. - I. 2
18 C. VIAN
CADENET près CHUSCLAN (Gard).
(Bords du Rhône.)
a) Coll. Vian.
1 PB. Arverni EPAD. (B1., fig. 458). 1 denier arg. Priscus Attalus.
CALISSANNE (Bouches-du-Rhône).
(Oppidum de Constantine.)
a) Coll. Junger à Avignon.
1 Bronze Turones? (Blanchet, fig. 115 var.).
b) Coll. Dumoulin.
6 PB. de Massalia au taureau cornupète (Bl., fig. 91). 2 oboles argent à la roue Massalia (B1., fig. 79). 1 MB. Gaulois, fruste.
c) Coll. Bastide à Cavaillon.
1 obole arg. Massalia à la roue (B1., fig. 79).
d) Coll. Gauthier.
9 PB. de Massalia au taureau cornupète (B1., fig. 91). 1 P13. de Massalia au taureau marchant. 1 PB. de Massalia au taureau cornupète, lég. ACCA. 1 PB. gaulois, imitation de Massalia au taureau cornu-
pète. 22 oboles Massalia à la roue (B1., fig. 79).
2 drachmes Massalia argt. (B1., fig. 85 var.). 1 P13. Volcae Arecomici (B1., fig. 475). 1 PB. Avignon? au taureau cornupète (La Tour 2520). 2 PB. Bas-Empire, indéterminables.
TROUVAILLES MONÉTAIRES DANS LE VAUCLUSE ET LA RÉGION 19
CAUMONT (Vaucluse).
(Près du Château.)
a) Coll. Gauthier.
1 PB. Licinius père. 2 PB. Constance II. 1 PB. époque de Constance, URBS ROMA à la Louve.
b) Coll. Vian.
(Quartier des Carrières.)
1 drachme Allobroge (Blanchet, fig. 127 var.).
CAVAILLON.
(Quartier Mont-Caveau ou Saint-Jacques.)
a) Coll. Gauthier.
26 PB. de Massalia au taureau cornupète (B1., fig. 91). 4 PB. au taureau marchant.
16 oboles de Massalia à la roue (B1., fig. 79 et 81). 1 obole, légende A M. 1 obole, légende M. 2 oboles avec roue dégénérée. 3 drachmes Massalia dont 1 fourrée (B1., fig. 8 2i et 85). 1 drachme Allobroge à l'hippocampe fourrée (B1.,
fig. 125). 1 gauloise argent incertaine, fruste. 1 PB. Volcae Arecomici au Démos (B1., fig. 475). 1 obole arg. Cabellio (B1., p. 439). 1 PB. de Cabellio aux 2 têtes (B1., fig. 480).
b) Coll. Bastide.
3 oboles de Massalia à la roue (BI., fig. 79). 9 PB. au taureau cornupète (B1., fig. 91).
20 C. VIAN
1.
I .PB. au sanglier de Nîmes (BI., fig. 476). I PB. Arecomici au Démos debout (B1., fig. 475).
drachme arg. fourré Volcae Arecomici (B1., fig. 123 var.).
I PB. de Cabellio à la corne (B1., fig. 479).
c) Coll. Étienne Quintand, à Cavaillon.
2 oboles Cabellio arg. (BI., p. 439).
d) Coll. Dr Montagné, à Cavaillon.
PB. de Nîmes à la colonie sacrifiant (BI., fig. 477). obole de Nîmes NEM. COL. (B1., p. 436).
e) Coll. de feu Mlle Jouve, à Cavaillon (pièces acquises par elle peu avant sa mort).
2 oboles de Cabellio arg. (BI., p. 439). PB. de Cabellio aux deux têtes (BI., fig. 480).
2 PB. de Cabellio à la corne (B1., fig. 479). 2 PB. d'Auguste, frappés à Lyon. I denier arg. Auguste. 1 denier consulaire Fabatus. Roscius (?).
f) Coll. A. Dumoulin. •
2 PB. de Cabellio à la corne (B1., fig. 479). 2 PB. de Nîmes à la Colonie sacrifiant (BI., fig. 477). 1 MB. de Nîmes, Auguste et Agrippa. I /2 MB. de Nîmes (coupé au milieu). I PB. de KPIMO (B1., p. 240). 1 obole de Massalia au crabe (B1., fig. 73). 1 obole de Massalia au type d'Apollon casqué (BI.,
fig. 76).
De nombreux bronzes au taureau cornupète et quelques-uns au taureau marchant.
TROUVAILLES _MONÉTAIRES DANS LE VAUCLUSE ET LA RÉGION 21
I PB. d'Antipolis à la colonie debout. I PB. imitation au taureau barbare de Massalia. I PB. d'Avenio au sanglier (fruste). I denier arg. Trajan. I PB. de Constantin.
g) Coll. Vian.
3 oboles Massalia à la roue (B1., fig. 79). 1 obole Massalia à la roue dégénérée, avec globule dans
un canton' 2 drachmes arg. Massalia dont 1 fourrée (B1., fig. 85). I PB. Cabellio à la corne (B1., fig. 479). I PB. de Syracuse à la roue. 2 PB. de Cabellio aux deux têtes (B1., fig. 480).
II PB. au taureau cornupète (B1., fig. 91 et var.). 4 PB. au taureau marchant. 2 PB. au lion (B1., fig. 94). 2 PB. au caducée (B1., p. 237). I PB. à l'aigle (B1., fig. 95). 2 PB. imitation Marseille au taureau cornupète. I GB. Marc-Aurèle.
EYGALIÈRES (Bouches-du.Rhône).
(Près de la colline Sainte-Cécile.)
a) Ancienne coll. Huc à Avignon.
5 PB. Volcae Arecomici au Démos (B1., fig. 475).
(Quartier Saint-Pierre de Vence.)
b) Coll. Gauthier.
I PB. Volcae Arecomici au Démos (BI., fig. 475). I PB. de Gallien.
22 c. VIAN
L ' ISLE-SUR-SORGUES (Vaucluse).
(Quartier de Sorguettes.)
a) Coll. Vian.
2 PB. des Arecornici au Démos (B1., fig. 475). (Il y en avait d'autres.)
ISTRES ( Bouches-du-Rhône).
a) Coll. Gauthier.
I P13. Massalia au taureau cornupète (B1., fig. 91).
LA BASTIDONNE (Vaucluse).
a) Coll. Sylvestre à la Bastidonne.
Nombreux MB. de Nîmes, Auguste et Agrippa.
(Quartier Saint-Julien.)
b) Coll. Gauthier.
I obole Massalia à la roue (B1., fig. 79).
LAGNES (Vaucluse).
a) Coll. Gauthier.
1 quinaire bronze Mag. Maxime. I P13. Crispus?
b) Autrefois coll. M Douzon à Lagnes.
4 PB. Volcae Arecomici au Démos (B1., fig. 475).
LAMBESC (Bouches-du-Rhône),
(Quartier Chapelle Sainte-Anne.)
a) Coll. Vian.
I PB. Massalia au lion (B1., fig. 94 var.).
TROUVAILLES MONÉTAIRES DANS LE VAUCLUSE ET LA RÉGION 23
LAUDUN (Gard).
(Quartier du Camp de César..)
a) Coll. Dumoulin.
5 PB. de Marseille au taureau cornupète (B1,, fig. 91). 1 obole Massalia à la roue (Bi., fig. 79). 1 MB. Massalia au taureau cornupète (BI., fig. 89).
b) Coll. Vian.
2 PB. Massalia au taureau cornupète (BI., fig. 91). 6 MB. Agrippa et Auguste de Nîmes (B1., fig. 478). 1 GB. de Vienne (Bl., fig. 472). 1 GB. Adrien. 1 GB. Antonin. 2 PB. Constance II. I PB. Constantin II?
e) Coll. Gagnière et Germand.
4 PB. de Massalia au taureau cornupète (B1., fig. 91). I drachme arg. Volcae Tectosages, tête de nègre.
MAUSSANNE (Bouches-du-Rhône).
(Quartier de Vérassy.)
a) Coll. Gauthier.
I PB. Massalia au taureau cornupète (BI., fig. 91).
MONFAUCON (Gard).
(Oppidum de Saint-Maur.)
a) Coll. Gagnière.
4 PB. de Massalia au taureau cornupète (B1., fig. 91).
b) Coll. Germand à Avignon.
I MB. de Vespasien.
2i C. VIAN
MOURIES (Bouches-du-Rhône).
(Quartier des Caisses de Servannes: )
a) Coll. Gauthier.
5 PB. au taureau cornupète, Massalia (B1., fig. 91). I P13. au taureau marchant. I Bronze gaulois très fruste. 6 oboles de Massalia à la roue (B1., fig. 79). I denier arg. Claude Pr . I as République Romaine. 1 PB. du bas-empire romain très fruste.
b) Coll. Durnoulin.
1 PB. Massalia au taureau cornupète (B1., fig. 91).
NOVES (Bouches-du-Rhône).
(Bords de la Durance.)
a) Coll. Gauthier.
1 obole à la roue de Massalia (B1., fig. 79). I P13. au taureau cornupète de Massalia (B1., fig. 91). 1 bronze gaulois fruste.
b) Coll. Dumoulin.
1 drachme argent de Massalia (B1., fig. 85 var.). 1 PB. Massalia au taureau cornupète (B1., fig. 91).
ORGON (Bouches-du-Rhône).
(Colline de Beauregard.)
a) Coll. Gauthier.
2 PB. Massalia au taureau cornupète (B1., fig. 91). 1 obole Massalia à la roue (B1., fig. 79). 1 Volcae Arecomici au cheval (B1., fig. 123 var.).
TROUVAILLES MONÉTAIRES DANS LE VAUCLUSE ET LA RÉGION 25
b) Coll. Dumoulin.
I obole Massalia au casque. (LT. N° 180 var.). 1 MB. Massalia au taureau cornupète (B1., fig. 89). I PB. Massalia au taureau cornupète (Bi., fig. 91). 3 PB. Bas-empire, indéterminables.
(Chapelle de Saint-Véran.)
a) Coll. Dumoulin.
I PB. Massalia au taureau cornupète à gauche. 1 MB. d'Ilerda fr. sous Auguste.
ROBION (Vaucluse).
(Sources du Boulon.)
a) Coll. Gagnière à Avignon.
1 obole au crabe de Massalia (B1., fig. 73).
LA ROQUE D'ANTHERON (Bouches-du-Rhône).
a) Coll. Gauthier.
1 PB. Massalia au taureau cornupète (B1., fig. 91).
LA ROQUE-SUR-PERNES (Vaucluse).
(Quartier de Saint-Léger.)
a) Coll. Vian.
1 obole Massalia à la roue (B1., fig. 79). PB. Ville de Constantinople, à la Victoire debout
2 PB. Constance II. 1 PB. Valens. 1 PB, Valentinien ier.
26 C. VLAN
SAINTE—ANASTASIE (Gard).
(Oppidum de « Marhacum
a) Coll. Gagnière.
1 MB. de Néron.
SAINT—BLAIZE, par SAINT-MITRE (Bouches-du-Rhône).
a) Coll. Dumoulin.
1 PB. du Bas-Empire très fruste.
SAINT— ÉTIENNE—DU—GRÈS (Bouches-du-Rhône).
(Notre-Dame du Château.)
a) Coll. Gauthier.
1 PB. de Constant I er .
SAINT—GABRIEL.
a) Coll. Gauthier.
hémi-obole? de Massalia à la roue ? 1 PB. de Massalia au taureau cornupète (B1., fig. 91).
SAINT-REMY (Bouches-du-Rhône).
a) Coll. Gauthier.
1 PB. de Massalia au taureau cornupète (B1., fig. 91). 1 MB. de Marc-Aurèle.
b) Coll. Vian.
1 PB. des Volcae Arecomici au Démos (B1., fig. 475). 2 oboles à la roue de Massalia (B1., fig. 79). 2 PB. Volcae, Nîmes au sanglier (B1., fig. 476). 1 PB. NEM. COL. à la Colonie debout (B1., fig. 477). 1 obole Massalia à la tête casquée (B1., fig. 76).
TROUVAILLES MONÉTAIRES DANS LE VAUCLUSE ET LA RÉGION 27
SAINT-SATURNIN-LÈS-AVIGNON.
(Domaine de la France.)
a) Coll. Vian.
2 MB. Claude Ier. 1 MB. Néron. 1 MB. Vespasien. 1 MB. Titus.
ÉTANG DE VACCARES (Bouches-du-Rhône).
(La Capelière.)
a) Coll. Jean Maureau à Avignon.
1 MB. Vespasien? 7 PB. Constantin Pr . I PB. Valens. 1 PB. Constant. 1 PB. Julien II. 2 PB. Valentinien. 1 PB. Constance II. 2 PB. incertaine époque de Constance II.
b) Coll. Charles Guien à Cavaillon.
2 PB. Constance II. 5 PB. époque de Constance II. 1 PB. Magnence. 1 MB. Décence.
VAISON-LA-ROMAINE.
a) Musée Municipal.
1 drachme argent Volcae Arecomici. 1 PB. Arecomici au Démos debout (B1., fig. 475). 2 PB. Massalia au taureau cornupète (131., fig. 91).
28 C. VIAN
I as République Romaine. Auguste, I. GB., 11 MB. Auguste et Agrippa, Nîmes, 6 MB. Agrippa, 'I MB. Néron, 6 MB. Tibère, 2 MB. Claude lei , 3 MB. Vitellius, 1 GB. Vespasien, 1 GB., 1 MB. Domitien, I denier arg, 1 GB., 9 MB. Nerva, 2 MB. Trajan, 4 GB., 5 MB. Adrien, I denier argt. 4 GB., 3 MB., I PB, Sabine, 1 MB. Antonin, 5 GB, 5 MB. Faustine mère, 3 GB., 7 MB. Marc-Aurèle, 3 GB., 8 MB. Lucilie, 1 MB. Commode, 4 GB., 3 MB. Caracalla, 3 MB., I PB. Géta, 1 MB. Alexandre Sévère, 1 denier argt. 1 GB., 1 MB. Gordien III, I denier argent, 2 GB., 2 MB. Philippe père, I denier argent Gallien, 7 PB. Salonine, 1 billon. Claude II, 1 PB. Tétricus père, 6 PB. Aurélien, 2 PB. Probus 1 PB Dioclétien, 1 MB (Follis). Maximien Hercule, 2 MB. Constance Chlore, 2 MB.
TROUVAILLES MONÉTAIRES DANS LE VAUCLUSE ET LA RÉGION 29
Licinius père, 1 MB. Constantin Ter, I argent, 1 MB., 4 PB., 1 quinaire br. Crispus, I PB. Constance II, 2 MB., 3 PB. Théodose, - 1 PH.
Cf. pour le département et surtout pour Vaison : Carte
archéologique de la Gaule rom., 7e fasc., 1939, par M. le
Chan. J. Sautel, p. 95 et passim.
b) Coll. Marius Bresson, à Vaison.
3 oboles de Massalia (B1., fig. 79). 5 MB. Auguste. 3 MB. Adrien. 2 GB. Antonin.
GB. Marc-Aurèle. 2 PB. Gallien.
c) Coll. Vian.
2 MB. Auguste. 2 MB. Auguste et Agrippa de Nîmes. 3 MB. Claude Ier . 1 MB. Néron. 1 GB. Domitien. I MB. Vespasien.
VELLERON (Vaucluse).
a) Coll. Vian.
1 drachme arg. Voconces au cavalier (B1., fig. 124 var.).
VENASQUE (Vaucluse).
1 drachme Volcae Arecomici fourrée (B1., fig. '123).
(De la coll. Bastide à Cavaillon.)
30 C. VIAN
VERNEGUE (Gard).
a) Coll. Gautier.
1 MB. Auguste et Agrippa (Nîmes).
Additions (Pièces trouvées depuis 1939).
ÉTANG DE VACCARIS (Quartier Fiélouse).
1 GB. de Maxime. 1 PB. de Constance II. 3 PB. du Bas-Empire. 1 PB. de Massalia. 1 Drachme fourrée des Volques Tectosages.
VAISON.
1 Denier de la gens Tituria.
AUREL, PRÉS DE S AUL T
1 MB. d'Auguste (Providentia).
CAVAILLON. 1 GB. d'Hadrien. 1 MB. d'Auguste. 1 PB. de Julien II.
SAINT-REM Y.
1 GB. et MB. de Trajan. 2 MB. de Marc-Aurèle. 1 MB. d'Auguste. 1 MB. Col. Nem. 1 PB. de Nîmes avec Hygie. 1 Auguste d'Antioche.
TROUVAILLES MONÉTAIRES DANS LE VAUCLUSE ET LA RÉGION 31
LA MOTTE D ' AIGUES.
1 GB. et 2 MB. de Marc-Aurèle. 2 MB. d'Auguste. 1 GB. de Lucille. 1 MB. de Septime Sévère I PB. de Gallien.
AVIGNON.
1 GB. d'Antonin (Bonne Foi debout).
ORANGE.
1 MB. de Domitien (Pallas debout).
BEAUMES DE VENISE (Chapelle d'Aubun).
1 PB. de l'époque de Constance II.
TARASCON (Déblais du Château).
I PB. de Cabellio aux deux têtes.
CAMP DE CÉSAR, LAUDUN.
2 PB. de Massalia au Taureau.
1. Avec les indications des collections régionales dont elles font partie.
ESSAI SUR L'HISTOIRE MONÉTAIRE DE L'ARTOIS
D'APRÈS ALEX. HEBMAND (Hist. monét. de l'Artois, Paris)
A. Hermand a écrit sur l'histoire monétaire de l'Artois un livre où il y a de fort bonnes choses, mais déjà ancien, de sorte que tout, faits et doctrines, appelle une impérieuse révision.
Hermand a très bien vu que le Denier primitif du comte de Flandre fut et resta longtemps l'Artésien ; il a très bien vu aussi que l'Artois, d'abord compris dans la Flandre, qui ne dégagea que peu à peu son propre système, garda, quoique soumis à la même domination, son régime moné-taire sous le contrôle direct du roi ; que le Parisis fut dans cette province au fond de toutes les tractations, enfin que la conversion en monnaie royale s'établit, lors du retour à la couronne, au pair du Parisis.
L'exposé d'Hermand est conftis, mais il a réuni un grand nombre de textes que nous reproduisons ici en les mettant par ordre chronologique.
[Les ateliers royaux d'Arras, Gand et Bruges passent entre les mains du comte de Flandre, qui possédait l'Artois, alors principale partie de la Flandre, capitale Arras]
1. 1055. P. 98. Le comte de Fl. dispose des bénéfices de l'hôtel des monnaies de Lille : in moneta islensi (M. Prou, Actes de Philippe ier).
1941. — T.
A. DIEUDONNÉ
2. 1063. In Flandria in pago atrehatensi. 3. 1066. P. 98. Autre titre, du même genre que le nd 1. 4. 1092. P. 100. La m. postcarolingienne du comte de Fl. est qua-
lifiée Flandrensis moneta. 5. 1093. P. 101. A Flandrensis moneta on ajoute : publica.
[Vers 1100, le Denier du comte, peu à peu réduit - de mo-dule, prend son aspect de Maille, tout en conservant le
titre d'un bon Denier.] 6. 1119. P. 101. Flandrensis monela. 7, 1127. P. 220. Texte qui distingue Arras de la Flandre. 8. 1127. P. 124. Sous Charles le Bon, Nummus fortis (Denier) est
opposé à Obolus (Maille) pour la fabrication et la vente du pain. Cf. a. 1355.
9. 1127. P. 139. Guillaume. Cliton abandonne sa m. de Saint-Omer aux bourgeois de la ville.
10. 1128. P. 140. Guillaume Cliton revient sur sa concession.
11. 1132. P. 150. L'abbé de Saint-Bertin de Saint-Omer a un moné-taire (à lui ou au comte ?).
12. 1148. P. 138. Le comte réserve ses droits de m. à Saint-Orner exceptis in gladio et moneta.
13. 1165. P. 136. Quingentas libras artesiensium. 14. 1173. P. 167. Convention avec Frédéric Barberousse poür la
circulation monétaire. 15. 1173. P. 137. La même m. est dite Atrebatensis moneta (à Arras).
16, 1173. P. 159. XX libras Flandrensis monete (à l'abbaye de Saint-Bertin).
17. 1173. P. 159. Unam marcam, Flandrensis monele. 18. 1177. P. 120 et 202. Numerate pecunie septuaginla libras de
blanchez.
[1179. Mariage d'Isabelle, nièce du comte Philippe d'Alsace, avec Louis, fils de Ph. Aug. Elle reçoit en dot : Arras, Aire, Saint-Orner, etc...]
19. 1180. P. 128 et 159. Quadra,ginta marcas argenti flandrensis ponderis (au petit marc de Flandre ?).
20. 1185. P. 143. Première mention de la Moneta duacensis (de Douai).
2L 1186. P. 159. Centum solides flandrensis monete. 22. 1187. P. 137. Atrebatensis moneta. 23. 1190. P. 137. Atrebatensis moneta.
ESSAI SUR L ' HISTOIRE MONÉTAIRE DE L 'ARTOIS 35
[1191. Mort de Ph. d'Alsace. Conquête de l'Artois par Ph. Aug. Il commence à frapper des Deniers parisis royaux à Arras. et à Saint-Orner].
24. 1193. P. 206. Moneta, regalis à Saint-Omer. 25. 1194. P. 210. Centum marcas velerum de pagamento ; centûm
• marcas novorum Saint-Bertin de Saint-Orner). 26. 1194. P. 208. Moneta, audomarensis (à Saint-Omer). 27. 1196. P. 126. Triginta et duobus solidis flamingorum per sin-
gulas marcas (à Tournai).
[1197. Ph. Aug. perd les villes d'Aire et de Saint-Omer.]
28. 1197. P. 127. XXXIII solidos et IIII denarios flandrensis monete pro singulis marcis (à Tournai).
29. 1197. P. 207. Pro centum et decem marcis parisiensium (à Saint-Orner).
30. 1199. 'P. 137. Atrebatensis moneta. 31. 1199. P. 143. Moneta duacensis (de Douai). 32. 1199. P. 207. Pro XXXV marchis parisiensis monete (à Saint-
Orner). 33. 1200. P. 210. Viginti libris veteris atrebatensis monete. 34. 1200. P. 221. Texte tout à fait explicite distinguant l'Artois et
la Flandre. 35.- Vers 1200-1210. P. 213. Centum solidos nigroruni vel atrebatensis
monete. . 36. 1201. P. 115. Deux marcs et demi de « vieille monnoie », 40 livres
« vieille monnoie ». 37. 1202. P. 128. Ad parvam, marcam Flandrie (Ph. Aug. à Tour-
nai). 38. 1203. P. 127. Triq inta tribus solidis et IV denarits Flandrie
per singulas marcas computatis. 39. 1201. P. 115. XX et XL libras ad minus Flandrie monete baleat
(à Courtrai). .40. 1206. P. 212. Pro 200 lib. atrebatensis monete (à Walencourt). .
41. 1208. P. 115. Nova Flandrie moneta. 42. 1210. P. 209. L li bras flandrensis monete Saint-Omer). 43. 1212. P. 178. Ph. Auguste donne cours à la m. royale de-
Bourges.
[1212. Reprise d'Aire et de Saint-Omer par Louis de Fr., futur Louis VIII]
36 A. DIEUDON1NÉ
44. 1212. P. 149. Philippes cornes habuit in terra beati Vedasti sicut in civitate atrebatensi monetam (texte rétrospectif).
45. 1220. P. 110. Sexaginta solidos de doisiens. 46. 1220. P. 110. Quadraginta solidos de artisiens. 47. 1.220. P. 110. Dimidiam marcam de artisiens. 48. 1220. Première mention de la m. de Béthune. 49. 1222. P. 125. Centirm et septuaginta libras flandrensium. 50. 1222. P. 125. Pro centum et viginti lihris parisiensium. 51. 1224. P. 129. 100 marcs parisis à 28 sous le marc. 52. 1227. P. 127. Triginta tribus solidis et quatuor denarits pro
marcha. 53. 1228. P. 111. XLVII lib. art., et redevances en nature. 54. 1228. P. 111. Sexaginta quatuor solidos artisiensium.
55. 1229. P. 192. Et se on treuve... il est à trois hlans d'escondit.
[1237. Saint Louis met son frère Robert en possession de l'Ar-tois; il lui donne le comitatus d'Arras qui avait appartenu au comte de Flandre (voir la charte dans Ord. des rois de Fr., t. XI, p. 329.)]
56. 1242. P. 112. Artisiens (à Saint-Pierre de Lille). 57. 1242. P. 116. Artésiens. 58. 1242. P. 117. Moneta Flandrie usualis et legalis. 59. 1245. P. 273. XXVI libras artigiensium,. 60. 1246. P. 2. Charte confirmative de celle de 1228 : Centum soit-
dos artisiensium. 61. 1246. P. 111. A duodecim libris artisiensis rnonete, à Saint-
Orner. 62. 1247. P. 273. Deux cens mars d'artisiens. 63. 1248. P. 274. Quadraginta solidorum artisiensium. 64. ire moitié du xine s. Pour 4 Douibiens 1 Artésien:
[1250. Robert II succède à Robert Ier.]
65. 1251. P. 131. XVIII Deniers douisiens, soit VI Artésiens. 66. 1254. P. 274. Pro sexies viginti libris artisiensium, omni excep-
tione detrimenti non numerate pecunie, non tradite, non solu te.
67. 1255. P. 223. Apparition du titre « comte d'Artois » dans un diplôme (au lieu de comte d'Arras).
ESSAI SUR L ' HISTOIRE MONÉTAIRE DE L'ARTOIS 37
68. 1255. P. 223. Sul) censu octo solidorum et quatuor denariorum pro quinque marchis flandrensium.
69. 1257. P. 128. Triginta quatuor solidos pro qualibet marcha. 70. 1264. P. 115. Flandrensium novorum. 71. 1270. P. 227. Titre constatant que Thérouanne relève directe-
ment du roi par son évêque. 72. 1270. P. 274. Falsos et pravos artesianos et stellingos. 73: 1271. P. 131. Cinq sols douisiens faisant quatre deniers flamenis
et trois sols douisiens ung sol parisis. S'il s'agit de Gros, ce texte est à reporter plus bas.
74. 1271. P. 305. Quinze cens livres d'art, de le monoie de Flandres. 75. 1273. P. 274. Pro sexcentis et triginta libris arthesiensium, de
eisdem in pecunia, numerata de quibus deliberavi et tra-didi trecentas libras arthesiensium.
76. 1275. Pp. 107, 113, 114, 133, 134. Marguerite, comtesse de Hai-naut, dans son bail des Gros, se réserve le droit de faire artésiens, mailles artésiennes rondes ou valenciennoises.
77. 1278. P. 106. Dix lib. d'art. de le monoie de Flandres. 78. 1278. P. 107. Lettres de Philippe III autorisant pour un temps
les m. de Valenciennes et d'Alost déjà frappées, mais défendant le cours de toutes autres que les siennes, les m. du comte et les Esterlins d'Angleterre.
79. 1279. P. 107. Guy, comte de Flandre, annonce (anc. st . ?) qu'il a frappé des artésiens. (R. /V., 1837, p. 124.)
80. 1279. P. 118. Duohus denariis flandrens. veteris monete. 81 . 1280. P. 118. Denariorum flandrensium antique monete. 82. 1280. P. 112. Guy exige des Brugeois cent quatre mille livres
d'Artésiens. 83. 1282. - Le Comte de FI. assigne une rente sur l'atelier de Douai
(R. 1V. 1837, 211). 84. 1283. P. 275. Sissante lib. d'artis. 85. 1286. P. 129 et 280. Bail de Robert II, comte d'Artois. - Arté-
siens (pièce justif. n° 6). 86. 1291. Pièce justif. n° 2. Ordee de Ph. III pour tout le royaume :
Que circulent dans tout le royaume uniquement nos mon-noies et, dans chaque seigneurie, celle du baron qui y frappe m. [c'est une erreur : pour 1271].
87. 1292. P. 118. Duodecim denariis flandrensium novorum.
3g A. DIEUDONNÉ
88. 1294. P. 368. Robert d'Artois use du Tournois dans son testa-ment.
89. 1295. Début des mutations de Philippe le Bel. Introduction, en Artois et en Flandre, des Doubles altérés. La devise arté-sienne chancelle : en 1290 au pair du D. t. fort, en 1300 aux deux tiers. Elle reprend sa place de Denier parisis en 1306 (mon art. de la Bey. num. belge de 1933).
90. Bail monétaire de Mahaut, fille de Robert II. 91. 1310. P. 266. Rente de 5 Sols parisis à Aire. 92. 1314. P. 221-222. Les avoueries de Béthume et de Thérouanne
sont encore distinguées de l'Atrébatie et dites Flandrie. 93. 1320. P. 246. Ce diplôme, qui mentionne Arras comme atelier
monétaire du roi, est de 1420. 94. 1328. P. 297. Testament de Mahaut. Il n'y est question que de
la m. royale tournois. 95. 1330. P. 367 n. La forte m. française (D. p.) est à la m. fla-
mande comme 8 est à 6, 40 (c.-à-d. 5 à 4).
[1330-1384. Après la mort de Mahaut se succèdent en Artois plu-sieurs comtesses qui ne frappent aucune m., jusqu'à l'entrée en possession de Philippe le Hardi, duc de Bour-gogne, en 1382.]
96. 1345. P. 276. Ad valorem duodeeim argenteorum(àThérouarme). 97. 1346. P. 251. Le receveur pour l'Artois vend des marcs à la M.
de Tournai. 98. 1350. P. 142. Le roi de France fait acte de propriétaire à la M.
de Douai. 99. 1355. P. 297. Faire du pain à 2 Den., 1 Den., 1 N'aille. Cf. 1127.
100. 1356. P. 282. Ordee de Jean II le Bon (IV, 345) distinguant la cité et la ville d'Arras.
101. 1356. P. 369. Une ore royale (XIV, 325) appelle l'Artois, pays à paresis.
102. 1361. P. 367. Pro quadraginla sex libris parisiensis monete. 103. 1364.r P. 370. Livres, gros, deniers parisis à monnoie de Flandres. 101. 1364J P. 370. Livres parisis Flandres. 105. 1372. P. 251: Ateliers de Saint-Quentin et Tournai. Arras n'est
pas nommé. 106. 1372. P. 297. Comme en 1355. 107. 1376-1380-1384. P. 238-239. Règlements royaux sur la circula-
tion des m.
39 ESSAI SUR L HISTOIRE MONÉTAIRE DE L ARTOIS
[1382. Marguerite, comtesse d'Artois, épouse Louis de Male, qui réunit de nouveau l'Artois à la Flandre.]
[1384. Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, et cte de Fl.,, devient comte d'Artois.]
108. 1392. P. 362. Condamnation d'un bourgeois d'Arras à 4 1: p. d'amende.
109. 1395. P. 239. Le roi nomme des commissaires afin de pourchas-ser les m. étrangères en Artois.
110. 1395. Ordee du roi. P. 239. 111. Début xve s. P. 239. Les gens de Saint-Omer demandent qu'il
leur soit permis de recevoir la m. de Flandre. 112, 1406. P. 278. Vint livres d'artisiens de rente. 113. 1406. P. 372n. XV/ s. Fland. valent VIII s. curant. 114. 1406. P. 373 ////s. parisis valent IIII s. VI d. curant (4 à _ 115. 1406. P. 373 X s. parisis valent XI s. III d. curant (4 à 4,5). 116. 1414. P. 305. Le duc lève une composition sur la ville d'Aire
en m. royale. 117. 14.20. P. 253. Le roi Charles VI ouvre une M. dans la cité
d'Arras. 118. 1421. P. 306. L'abbé de Saint-Bertin de Saint-Omer signale la
debilitatem monete. 119. 1421. Requête des habitants de Saint-Omer au roi de Fr., pour
qu'il autorise le cours des m. flamandes à Saint-Omer. 120. 1422. P. 255. Un général maitre visite l'atelier d'Arras.
[1422. Mort de Charles VI. L'Artois passe, avec Philippe le Bon, duc de Bgg. et comte de FI., sous la suzeraineté d'Henri VI, roi d'Angleterre et de France.]
121. 1423. P. 369. La livre est de 40 Gros à Saint-Omer. 122a 1424. P. 308. Ordee de circulation d'Henri VI. Il tolère provi-
soirement les m. flamandes en Artois. 123. 1425. P. 362. Les habitants d'Arras payent 800 1. p. 124. 1425. P. 278. Vingt livres de loyaulz arlisiens de rente. 125. 1426. P. 308 et 370. Ordee de circulation d'Henri VI conforme
à la précédente. 126. 1426. P. 370. Lors estoit la in. de Fl. sans diminution ; par ce
se fonda-t-on en Artois de prendre IX doubles gros de Fl. (9 S. art.) pour VIII s. parisis ; les 3 doubles gras
40 A. DIEUDONNÉ
de Fl. (3 S. art.) auroient cours pour quatre doubles blans du roi. (2 S. 8 d. p.).
127. 1.430. P. 372. XV frans n'ormoie courante en Artois. 128. 1430. Défense de battre m. partout ailleurs que dans les villes
dénommées, dont n'est pas Arras. (Ord., XIII, 166 et 514.)
129. 1433. P. 371. 16 1. de gros et 6 sols m. courante. 130. 1433. P. 308. Orde• de circulation. Le duc met ses m. sur le
même pied que celles du roi. 131. 1435. P. 308. Même langage.
[1435. Traité d'Arras. Charles VII succède à Henri VI en Ar- tois
132. 1435. P. 372. VIII 1. XIII s. VIII d. monnoye courante et un pattars pour XII deniers.
133. 1437. P. 372. Trois livres monnoie courante, XXXX gros pour lyvres.
134. 1440. P. 372. Huit cent francs deniers waris, monnoie à pré-sent courant en Artois, XXXII gros monoie de' Flandre pour chaque franc.
135. 1440. P. 371. Summa octoginta libr. monele Artesii. 136. 1441. P. 308. Ordonnance sur la circulation (lettre ducale). 137. 1441. P. 373. La m. courante est à la m. de Parisis comme 6
à 7. 138. 1444-1469. P. 369. A Thérouanne, toutes les pénalités sont en
Parisis. 139. 1451. P. 374. On oppose l'ordee royale prescrivant 9 d. m. cou-
rante pour 8 d. p. à l'usage courant : 7 pour 6. 140. 1454. P. 369. La livre de gros est de six livres courant mon-
noie de Flandre. 141. 1464. P. 371. LXX sous monnoie d'Artois. 142. 1464. P. 372. Quinze lions d'or au pris de trente solz courans
la pièce. 143. 1465. P. 312. Ordonnance de circulation (lettre ducale). 144. 1466. - Autre. 145. 1466. P. 371. Summam centum quinque librarum monete arthe-
siensis. 146. 1468. P. 313 et 367. Quatorze livres parisis monnoie d'Artois. 147. 1469. P. 372. Quinze frans de tète et assez bonne monnoie que
ESSAI SUR L'HISTOIRE MONÉTAIRE DE L 'ARTOIS Il
ung patard nouviau de Flandre pour douze deniers et les vingt pour une livre d'Artois, rapporté au marcq et au billon.
148. 1472. P. 371. Trois livres monnoie d'Artois et chinq sols, franc argent (bon argent ?).
[1477. Mort de Charles le Téméraire.] [1477-1482. Le roi de France envahit l'Artois, qui lui est cédé
par le traité d'Arras de 1482.]
149. 1487. P. 257. C'est Saint-Quentin qui est désigné comme atelier pour l'Artois.
150. 1488. Pièce justif. n° 8 et p. 314. Ore du maréchal d'Esquerdes au nom du roi tolérant le cours de diverses m., flot' le Griffon.
151. 1489-95. P. 315-316. Règlements de Philippe le Beau.
[1493. Traité de Senlis, qui restitue l'Artois à Ph. le Beau sous la suzeraineté du roi, et toujours sans le droit de mon-naie.]
152. 1496. P. 371. Libras quingentum monete Artesii (pour quin-gentorum).
153. 1500-01. P. 374. Huit solz parisis pour noèf solz courant. 154. 1505. P. 316 et 367. Diplôme de Ph. le Beau : cent sols parisis,
monoie de rostre dit pays d'Artois. 155. 1507. P. 372. Dix-huit libres monnoie courante en Artois,
chacune libre à compter pour quarante gros monnoie de Flandre.
[A Ph. le Beau succède Ch. Quint, emp. et roi d'Espagne. En 1525, par le traité de Madrid imposé à Fr. l er , il libère l'Artois de tout lien de vassalité à l'égard de la France. Cependant il n'a pas frappé m. en Artois.]
156. 1530. Institution d'un Conseil provincial supérieur pour les ni. d'Artois.
157. 1531. Une ordee interdit le cours des m. royales de France. 158. 1532. P. 325. Une émeute éclate ; le peuple exige qu'on reçoive
la m. de Fr. L'empereur cède. 159. 1536. P. 362. Les habitants d'Arras payent 100 1. p. 160. 1539. Confirmation de l'ordre de 1532.
4.2 A. DIEUDONNÉ
[1555. Avènement de Ph. H, qui ouvre un atelier à Arras. j
161. 1582. i re émission de Ph. à Arras. 162. 1592. Dernière émission de Ph. II à Arras.
[Régence d'Albert et Isabelle. Pas de frappes.]
163. 1601. Un édit mentionne la Livre d'Artois de 20 s. et 12 Den. au Sou.
164. 1611. P. 345. Un texte constate qu'il y a surabondance de m. dans la circulation.
165. 1623. Réouverture de l'atelier sous Philippe IV.
[1640. Prise d'Arras par les Français. L'atelier d'Arras est main-tenu.]
166. 1650 ou 1656. Fermeture de l'atelier d'Arras.
[1659. Traité des Pyrénées, qui restitue l'Artois à la France.]
167. 1670. P. 378. Douze sols monnoye d'Artois font quinze sols courant.
168. 1671. Remontrances des Étatsde la province qui demandent un atelier.
169. 1671. P. 355. Réouverture (?). 170. 1679. L'atelier sera transféré à Lille. 171. 1685. P. 358. Ouverture de l'atelier de Lille. 172. 1685. Les Réaux d'Espagne sont décriés. 173. 1686. P. 381. Trente sept livres dix sols monnoie courante fai-
sant à celle de Flandre trente florins (à Saint-Omer). 174. 1690. Nouveau décri des m. espagnoles. 175. xviie s. Placards 379 et 380. Demy pattars de par deçà à VI
deniers Artois ; lyart d'argent de par deçà à III deniers Artois. Les gigots à 1 112 deniers Artois ou six mites Flandre ; les doubles deniers à II deniers Artois ou huit mites Flandre; - parisis faisant un tournois moiioie cou-rante... ou... monoie de Fl. faisant à celle de Fr. pré-sentemt courante.
176. Fin xviie P. 380-381. Mêmes expressions. 177. 1723. 1800 livres m. courante en Artois faisant 1440 florins. 178. 1748. Un patard est dit valoir 15 Deniers (tournois). 179. 1765. P. 378. Avis des États d'Artois, que Livres, Florins, Caro-
lus sont trois expressions à prendre clans le même sens de 20 Sous, à 12 D. le Sou.
ESSAI SUR • L'HISTOIRE MONÉTAIRE DE L 'ARTOIS 43
Dans les premiers temps de la monnaie postcarolingienne ou féodale, en Flandre et en Artois comme ailleurs, ,la considération du marc de fin (marca argenti) domine sou-vent les transactions, que l'argent soit employé sous forme de lingot (n° 19), ou qu'une équivalence soit spécifiée entre le paiement en numéraire et l'argent brut. De ce dernier cas nous avons l'exemple dans un texte invoqué par M. Totir-neur pour l'explication de la charte (le 1202 de Tournai, marca argenti pagamenti monete Flandrie, et que j'inter-prète, autrement que mon prédécesseur : « marc d'argent fin payé en monnaie de Flandre » ainsi, l'usage courant de la monnaie n'avait pas banni toute trace . de pratiques différentes. Quand on avait délivré les monnaies, le compte de Deniers était censé dénombré, remis et acquitté en bonnes mains, et l'on spécifiait qu'aucune réclamation ne serait admise (n° 66). Quelquefois encore, on préférait l'énoncé en poids (n°s 29, 32), plutôt qu'en Livres et Sous de compte.
Le monnayage n'a pas eu d'interruption à la chute de la dynastie. Aux ateliers qu'il tenait des rois carolingiens, Arras, Gand, Bruges, le comte de Flandre ajoute, au me siècle, celui de Lille (nos I et 3). J'ai rappelé dans une note publiée par la Revue numismatique (de 1940) qu'il s'agissait bien d'un atelier dû comte et non d'une monnaie munici-pale. Mais cette monnaie, toute carolingienne, ne s'appelait pas encore Flandrensis monela. C'est en_ 1092 (ne 4) qu'on voit apparaître cette dénomination, et l'on ajoute publica
(n° 5), comme il arriva fréquemment pour l'ancienne mon-naie royale carolingienne, devenue monnaie comtale (mon Manuel des M. féod., p. 5).
Comme Arras était la capitale de l'Artois et même de la Flandre qui comprenait l'Artois, et_comme ces deux pays sont d'abord associés dans les textes (n° 2l (ils ne com-
44 A. DIEUDONNÉ
mentent à être distingués que vers 1100 (n° 7) et surtout à partir de 1200 (n° 34)), le nom de « monnaie flamande (et cette pratique dura jusqu'à la fin du xime siècle (n° 81)) est appliqué au numéraire d'Artois comme à celui de Flandre, et le nom « d'Artésien » à la Flandre comme à l'Artois. Que l'on énonce la monnaie de Flandre (Flandren-sis monete, passim, ou Flamingi au n° 27) ou l'Artésien (depuis le n° 13) (Artesiensis, Artisiensis,'Arthesiensis, Artisiani, Artigiensis, Atrebatensis moneta, cette dernière expression à Arras de préférence), c'est même monnaie. Les nos 74 et 77 affirment cette identité, et, outre les diplômes, il y a à ce sujet un passage curieux du trouvère Rutebeuf au mue siècle (A. Hermand, p. 264).
Cet Artésien, frappé par les comtes en Flandre et en Artois, fut « amenuisé » comme tous les autres Deniers du royaume, mais, au lieu d'admettre une proportion notable de métal vil, il conserve la plus grande partie de son aloi, sous un module et un poids réduits (entre les nos 5 et 6). L'Artésien ainsi compris ne comportait pas d'Obole ou Maille (elle eût été trop menue). Les n0° 8 et 99 de notre liste, qui parlent d'Obole, désignent une valeur de compte à acquitter à raison de 2 Mailles pour t Denier. C'est par abus que l'Artésien lui-même (le Denier) a été, à cause de son aspect, qualifié de Maille artésienne. Dans le bail du Gros de 1275 (no 76), la mention qui suit « Artésien », savoir « Mailles artésiennes rondes ou valenciennoises », désigne des Deniers locaux d'ordre inférieur à moindre aloi.
La question des monnayages de ville ou d'abbaye est obscure. Il est certain que le comte a frappé parfois dans une abbaye, comme en lieu sûr, sa propre monnaie, sans doute avec dédommagement pour l'abbé ; mais certaines abbayes ou villes, et peut-être des châtelains, eurent aussi
ESSAI SUR L'HISTOIRE MONÉTAIRE DE L'ARTOIS 45
leurs monnaies. Nous avons en témoignage ce qui se passe à Saint-Omer (n°s 9, 10, 11, 12) où il y eut une monnaie des bourgeois et une monnaie de l'abbé de Saint-Bertin. Le n° 48 concerne Béthune (seigneur ou ville ?)-; les nos 20, 31, 45, 64, 65, 73, s'appliquent à Douai, dont le Denier eut parfois une valeur très différente de celle de l'Artésien. lie n° 44 atteste que le monastère de Saint-Vaast d'Arras, dont le nom est donné soit comme pouvoir émetteur soit comme lieu de frappe, ou bien n'a jamais eu le droit de monnaie, ou bien ne l'avait plus sous Philippe d'Alsace à la fin du xiie siècle.
En tout cas, aucun texte ne corrobore l'opinion que ces privilèges auraient été concédés par l'empereur (l'empire s'arrêtait à l'Escaut) ; ils provenaient soit de la complai-sance intéressée des comtes, soit de la force des choses qui isolait les unes des autres des communautés animées d'une intense vie municipale, et les obligeait à se créer une éco-nomie particulière ou du moins à se forger sur le type commun une petite masse. Les monnaies urbaines sont du xiie siècle ; elles se sont survécu au xIIIe ; elles ont sombré définitivement dans la grande tourmente qui éclata en 1295.
Ajoutons, pour compléter ces renseignements d'ordre géographique et territorial, que Saint-Omer, orienté vers la Flandre, établit une sorte de transition entre Arras et ce pays, et que l'évêché de Thérouanne était comme une enclave relevant directement du roi (n°' 71 et 92).
Du point de vue de la circulation, l'Artois, comme la Flandre, était exposé à l'invasion des monnaies d'Empire, de celles même que le comte frappait dans la Flandre impériale (atelier d'Alost), et des conventions intervenaient (no 14). Peut-être les k( Blanchez », dont il est question aux n° 18 et 55, sont-ils une monnaie d'Empire ?
46 A. DIEUDONNÉ
• En 1191, Philippe Auguste conquiert l'Artois, et il se met à frapper ses Parisis à Arras et à Saint-Orner, pareils de poids, module et titre à ceux dé Paris, quoique diffé-renciés par le nom, inscrit tout au long, de l'atelier.
D'après mon article de la Bibliothèque de l'École des cartes de 1920, le Parisis aurait 0 gr. 482 de fin.
L'Artésien, à en juger par celui de Robert ci-dessous, serait de 34 sous au marc de Paris : 0 gr. 60 et 0,800 de titre. Cela donnerait 0 gr. 480 poids de fin. On voit qu'il allait bien de pair avec le Parisis.
Louis VIII n'a plus frappé la monnaie royale, mais Phi-lippe Auguste l'avait fabriquée en grande quantité. Les deux Monnaies circulaient dOnc conjointement en, Artois.' En 1'193 (no 24), le Parisis est dit moneta regalis; on le mentionne en 1197 (n° 29) et 1199 , (n° 32) ; on l'appelle Nova moneta en 1208 (n°41). La « vieille monnaie » d'Ar-ras est désignée ainsi en 1200 (n° 33), en 1201 (n° 36). Le n° 35 fait du Parisis (nigrorum) l'équivalent (vel) de l'Atre-batensis môneta.
En 1222, les nos 49 et 50 nous apprennent que le Parisis avait gagné du terrain au change ; il suffisait d'après ce texte de 120 Livres parisis pour balancer 170 Livres de Flamands ou Artésiens, disproportion considérable, mais la comparaison des res 51 et 38 (cf. 52) réduit cet écart, puisque le Parisis serait de 28 Sous au marc et l'Artésien de 33 Sous 1/3. C'est à peu près 7 Parisis polir 8,333 Artésiens, rapport de 4,2 à 5.
Il faut bien comprendre cette question de change. Le Parisis fabriqué en Artois ou introduit de Paris en espèces circulait au pair de l'Artésien dans notre province ; mais un règlement intervenu en Artois ne pouvait être soldé à Paris que pour 1,333 Parisis en moins par 8,333 unités, et
ESSAI SUR L'HISTOIRE MONÉTAIRE DE L'ARTOIS tin
à l'inverse un règlement établi à Paris n'était valable en Artois qu'à raison de 1,333 Parisis en plus pour 7 ; quant à l'Artésien, en nature aussi bien qu'en valeur de compte, il subit le change dès qu'on l'exporte. La solidarité écono-mique avec la Flandre maintenait, en dépit de l'extension à l'Artois de la devise royale, une frontière le long du royaume.
Elle va encore être renforcée. En 1237, commence le règne de Robert Ier, comte d'Artois, frère de saint Louis, mais ce prince attendra pour frapper monnaie : le stock était sans doute suffisant. Les expressions Artésien ou Artisien (le français devient plus fréquent) et Moneta, Fla,ndrie (usualis et legalis au n° 58) continuent de se disputer la faveur des contractants, et des nos 56 à 85 (1237-1286), le Parisis n'est .pas désigné expressément, tout abondant qu'il soit, à moins qu'il ne se dissimule en 1264 (n° 70) sous l'ap-pellation Flandrensium novorum. En revanche, le comte Guy de Flandre, qui est pourtant évincé de l'Artois, appelle les monnaies qu'il fait frapper des Artésiens
(n° 79). Entre temps, le n° 68 parait désigner d'une part une rente
(8 s. 4 d.) et d'autre part le capital : 5 marcs qui au fin seraient 5>< 33,333 = 166,665 Sous et qui en Artésiens valent (au titre 8/10) 133,333 Sous, d'où .un revenu de 6,2 0/0 .
En 1275, entrent en scène les Gros de Marguerite, com-tesse de Hainaut et de Flandre (n° 76) non seulement ceux qui sont fabriqués à Gand au type du lion, mais ceux de Valenciennes au cavalier et ceux d'Alost en terre d'empire, au type de l'aigle. Ce sont ceux-ci dont Philippe III en 1278 (no 78) autorise le cours• en Flandre et vraisemblable-ment en Artois. Comme ces Gros sont, suivant l'usage de l'époque, appelés Deniers, il y a dès lors deux sortes de
48 A. DIEUDONNÉ
Deniers en Flandre comme en Artois, et pour désigner ceux que nous connaissions jusqu'à présent, les seuls véri-tables Deniers dans notre langage à nous, on les qualifie veteris monete, antique monete (nos 80 et 81) : les Gros sont les Flandrensium novorum du n° 87, à moins que ce terme n'ait le même sens qu'en 1264. Mais je suis porté à croire que le texte de 1264 est mal daté, à en juger par celui de 1292 (n° 87), et désigne aussi des Gros.
Quant au Gros du roi de France, qui datait de 1266, c'est à lui que se rapporte le n° 96. Les moines de Saint-Bertin devaient à l'évêque de Thérouanne une redevance de 12 argentei (c'est l'expression même de la Bible) et prétendaient la payer en 12 Artésiens, qui, disaient-ils, étaient normale-ment qualifiés de la sorte ; mais l'évêque réclame 12 Gros du roi, tant parce qu'ils méritaient seuls de représenter des argentei, que parce que la monnaie royale était la monnaie d'usage à Thérouanne.
Le bail de Robert II, fils de Robert Ier, est de 1286 (n° 85), bai]. d'Artésiens dont nous avons donné par avance les conditions ; nous avons vu que c'était là une monnaie de redressement, dônt il fut sans doute par suite peu frappé. Robert d'Artois (nos 88 et 94) (comme fera après lui Mahaut) use du Tournois dans son testament, mais cela ne préjuge rien de la eirculation monétaire en Artois, car Robert pos-sédait de nombreux domaines à faire valoir en Berry et en Normandie. Nous sommes toujours sous le régime de l'Ar-tésien, Artésiens anciens et Artésiens de Robert.
Les mutations de Philippe le Bel vont introduire du nouveau. Ainsi que je l'ai expliqué dans un article de la Revue belge de numismatique (1933), l'Artésien, débordé par la monnaie déficiente venue du dehors, est en 1290 au pair du Denier tournois, en 1300 aux deux tiers de celui-ci,
ESSAI SUR L ' HISTOIRE MONETAIRE DE L'ARTOIS
2 8 3 = 15), de ce Denier ou à la moitié du Denier parisis
parisis dont il avait primitivement connu le pair. Il reprend sa place de Denier parisis lors du redressement de 1306. Et c'est à cette occasion que le Double tournois de Philippe le Bel, fixé à 2/3 d. t., est égal à 1/2 d. p., ce qui repré-sente la valeur d'un Denier flamand nouveau-né ou Mite. Ainsi le Demi denier parisis est devenu Denier flamand dans cette incarnation, tandis que le D. p. restauré pour-suivait ses destinées d'Artésien. Par suite des mutations de Charles IV, c'est la Double mite qui représentera désor-mais le Denier flamand, mais toujours à l'échelle du Demi-parisis. Tel sera le rapport du Flamand et de l'Artésien, un demi à un (par ex. n° 1.13). Mais, tandis que le Denier fla-mand était lié par le change au Tournois, l'Artésien l'était au Parisis dans le même rythme, ce qui, on le conçoit aisé-ment, maintenait la distance, puisque le Tournois et le Parisis, en tant que devises, restaient dans un rapport constant, comme l'Artésien avec le Flamand, » (mon Ma-nuel, p. 80).
Le change est de 6,40 à 8 à la monnaie forte du roi en 1330, soit de 5 à 4 : le Denier artésien serait tombé au niveau du Tournois ! Mais il faut considérer que cette mon-naie forte du roi était artificielle en 1330 et ne se soutint pas plus de 5 ou 6 ans ; si on la ramène du pied 12 au 15e qui était au fond le véritable, il n'y a au contraire plus de change du tout (n° 95).
Mahaut, fille de Robert, a encore frappé des Artésiens (n° 90), mais, après elle, l'atelier d'Arras est fermé (nos 97 et 105) : Saint-Quentin et Tournai sont nos pourvoyeurs, le Parisis submerge l'Artésien, et c'est alors qu'en prenant sa succession, il reçoit ce nom qui apparaît pour la pre-mière fois :parisis à monnoie de Flandres, parisis Flandres
1941. — I. 4
A. DIEUDONNÉ
(res 103, 104). Au reste, c'est un Parisis de compte, sous-multiple des espèces supérieures, car le Denier n'est plus de mise que dans les menues dépenses de chaque jour.
Plusieurs titulaires se succèdent alors au comté d'Artois, des femmes dont la filiation est capricieuse, à la faveur de quoi l'Artois est déclaré fief masculin et transmis en cette qualité à Philippe le Hardi, duc de Bourgogne et comte de Flandre, sans le droit de monnaie.
Voici donc quelle est la situation à partir de 1384. Pour la Flandre comme pour la Bourgogne, comme pour l'Artois, le roi conserve le droit de faire des ordonnances d'un caractère général. Celle de 1271 (n° 86), par laquelle Phi-lippe III déclarait « que circulent dans tout le royaume . uniquement nos monnaies, et, dans chaque seigneurie, celle du baron qui y frappe monnaie », était valable pour la Flandre, puisque le comte s'y était arrogé le droit de frapper monnaie et même de la monnaie d'or ; elle ne l'é-tait plus pour le duché de Bourgogne où le roi, possesseur exclusif du droit, avait son atelier à Dijon, ni pour l'Artois, où il n'y avait plus aucun atelier. Et même en Bourgogne, cet atelier, dans la capitale du duc, ne put la plupart du temps échapper à son contrôle, tandis qu'en Artois les espèces frappées à Saint-Quentin et Tournai entraient librement.
Le roi règlemente la circulation en Artois (nos 107, 110) comme ailleurs, par exemple, en proscrivant les monnaies étrangères ; mais, tandis qu'en Flandre et en Bourgogne, pour faire sa police, il a recours au duc, qui répète ses ordonnances, en Artois, il commande directement par ses commissaires (n° 109).
Tout cela, le duc le supporte impatiemment, mais il doit s'y conformer, même à l'heure où il tient le roi et la cour à Paris.
ESSAI SUR L ' HISTOIRE MONETAIRE DE L 'ARTOIS 51
En principe, l'Artois est fermé à la monnaie du duc, mais on demande au roi des licences (nt's 111, 119). Le nom « monnaie de Flandre » sera encore quelquefois appliqué par abus à la monnaie d'Artois ; mais le contexte nous donne l'explication (nos 137, 140 et après 1659). Le nom d'Artésiens n'est plus employé que pour le règlement des rentes provenant de privilèges anciens (nos 112, 124) ; la monnaie est le Parisis, quelquefois qualifié royal (n° 116), ailleurs Sou courant (n° 5 113, 114, 115).
Le change est en 1406 de 4 à 4,5 (n°5 114, 115) ou 4,444 à 5. Ce change explique qu'il n'était pas besoin d'atelier en Artois, car une devise afflue aisément dans une région où elle est favorisée.
Cependant, en 1420, le gouvernement du roi ouvre pour quelque temps un atelier dans la cité d'Arras qu'il possé-dait en propre par l'évêque (les bourgeois avaient la ville, et le comte le château), mais c'était pour des raisons poli-tiques, parce que Saint-Quentin et Tournai se révélaient vraiment trop encerclés par le duc, parvenu à la faveur de la folie de Charles VI au plus haut degré de puissance (nos 117, 120).
Henri VI se montra d'abord de meilleure composition. Il n'insista pas pour maintenir l'atelier d'Arras (n° 128), et il donna libre accès dans le royaume aux monnaies des ducs de Bourgogne et de Bretagne ; mais bientôt, endoctriné par les conseillers ordinaires de là royauté, il reprit la politique autoritaire de ses prédécesseurs, ce qui mécon-tenta. fort Philippe le Bon. Celui-ci le prit de haut, tenta de substituer ses ordonnances à celles du roi (no 130) et finalement par le traité d'Arras, en 1435, se réconcilia avec Charles VII avec qui il put en user quelque temps comme il avait agi à la fin du règne d'Henri VI (lettres ducales, n°s 136, 143, 144).
52 A. DIEUDONNÉ
ti oici quelques évaluations d'après les textes :
Nos 121, 155. — La Livre est de 40 Gros, parce que le Gros en Flandre est assimilé au Sou, donc au Demi-sou en Artois.
N° '126. — Les 9 Doubles gros de Flandre, ou 18 Sous de Flandre, font 9 Sous parisis d'Artois, ramenés par le change à 8 Parisis du roi. Les 3 Doubles gros de Flandre (6 Sous) auront cours pour 3 Sous ou 36 Deniers parisis d'Artois ou pour 4 Doubles blancs du roi qui à Paris font 32 Deniers parisis (40 d. t.), toujours suivant lé rapport 9/8 que nous verrons se confirmer tout à l'heure.
N° 127. — Quinze Francs, c'est 15 Livres tournois. Nous dirons que les 12 Livres parisis que représente cette somme en Artois seraient, en deçà de la frontière, ramenées à 10 Livres 13 Sous 4 Den. parisis.
N° 132. — Le Patard, Sou ou 12 Deniers d'Artois, c'est 24 Deniers ou 1 Double gros en Flandre.
N° 134. Si la Livre pariSis est de 40 Gros, la Livre tour, nois ou Franc sera de 32 Gros.
Nos 137, 139. — Aux calculs que nous venons de faire sur le rapport 8 à 9 des deux Parisis, on oppose 6 à 7. Le change 8 à 9 est même chose que 4 à 4,5 (4,444 à 5), mais il arrivait que l'usage empiràtce change (4 à 4,666 ou 4,28 à 5).
N° 140. — Quand on dit « 1 Livre ou 20 Gros », « 1 Livre ou 40 Gros », c'est toujours 240 Deniers ; mais 1 livre de Gros (je supprime la majuscule), c'est 240 Gros, le mot livre se réduisant ici à une expression numérique, 240 unités. Par suite, la livre de Gros, c'est-à-dire 240 Gros ou Sous de Flandre, c'est 120 Sous du Pari-sis d'Artois, ou 120 : 20 = 6 Livres courant. On ajoute « monnaie de Flandre », ce qui à première vue est déconcer-
ESSAI SUR L ' HISTOIRE MONÉTAIRE DE L 'ARTOIS - 53
tant, mais cette expression commande tout le paragraphe pour signifier qu'il ne s'agit pas du Gros du roi de 12- à la Livre, mais du Gros de Flandre-Artois.
Nos 146 et 148. — Ici, 14 Livres parisis monnaie d'Artois, 3 Livres monnaie d'Artois, c'est 14 Livres et 3 Livres qui seraient éventuellement à ramener, dans le centre du royaume, à 12 1. 8 s. et 2 1. 13 s. 4 d. p.
N° 147. — Un Patard ou Double sou de Flandre, c'est le Sou d'Artois, 12 Deniers, et 20 Patards, c'est 240 Deniers ou 1 Livre.
Sous Philippe le Beau et dans les premiers temps de Charles-Quint, le régime est le même (nos 153, 154, '155) que précédemment, sauf que le pouvoir royal est un peu moins agissant, moins redouté.
Je ne sais sur quelle autorité j'ai écrit dans mon Manuel que le Parisis d'Artois était tombé au niveau du Tournois royal ou même au-dessous ; il reste comme d'ordinaire un peu supérieur, son rapport au Parisis royal étant de 4,444 (8/9) ou 4,28 (6/7) et non 4 à 5.
Puis, à la suite du traité de Madrid (1525), l'Artois échappe au roi de France et devient province intégrante de la maison d'Autriche.
Charles-Quint ne rouvre pas l'atelier d'Arras sous sa domination, - mais il institue un Conseil (n° 156), et il interdit le cours des monnaies royales (n° 457) qu'il veut voir remplacer par les monnaies d'Empire, mesure de rigueur sur laquelle il est obligé de revenir (n 0s 158, 160).
Philippe H et Philippe IV ont frappé quelques monnaies à Arras avec leur titre de « comte d'Artois » (no 161, 162, 165, 166). Ce Parisis d'Artois n'a plus de Parisis que le nom, puisque son empreinte est étrangère à la France, mais le change, qui avait oscillé, on l'a vu, de 4,2 à 4,4 pour
54 A. DIEUDONNÉ
5, se relève en sa faveur (est-ce parce qu'il ne fait plus appel pour se recruter au Parisis hors frontière ?), de sorte que, à l'heure du retour de notre province au royaume, le pair est établi avec le Parisis de Paris.
A partir de ce moment, les Sous et Deniers courants étant les Livres, Sous et Deniers tournois de France (n°s 167, 173, 177), on voit que 12 Sous d'Artois font 15 Deniers tournois (n° 167).
On rétablit quelque temps (1640-1656) (n° 166) (cf. '168-171) un atelier à Arras, pour ménager l'amour-propre de sujets nouvellement réintégrés et pour rendre l'accès dans la province aux Parisis du roi (nos 168, 169), et puis on y renonce, preuve que entre Amiens et Saint-Quentin, l'ate-lier d'Arras ne s'imposait pas ; mais on n'avait plus Tour-nai, on installa un atelier à Lille, proche de la frontière {n°s 170), afin de recueillir le billon de l'étranger. Il va de soi que les pièces espagnoles sont décriées (nos 172, 174).
Et nous retrouvons dans les placards du xvire siècle nos vieilleséxpressions : Monnaie de Flandre pour désigner celle d'Artois au n° 173 ; la même, prise successivement dans les deux sens, au n°175 ; Pata,rds ('1 Sou d'Artois, 2 Sous de Flandre), Mites (Demi-deniers de Flandre, Quarts du Denier d'Artois) (n° 5 175, 176, 178) et, au xvine siècle, des termes nouveaux : Florins, Carolus (n05 173, 177, 179) qui sont l'équivalent de Livres parisis (n°177), comme Francs l'était de Livres tournois.
Telle est l'histoire monétaire d'une province où le droit royal et le droit féodal se sont associés et pénétrés plus étroitement que partout ailleurs.
A. DIEUDONNÉ.
SUR UN MÉDAILLON DE CIRE
DE LOUIS XIV
Pl. I et II.
La récente acquisition qui vient d'être faite par le Cabi-net des médailles de la Bibliothèque nationale, d'un très beau médaillon de cire représentant Louis XIV, fournit une occasion de plus d'étudier une des manifestations artis-tiques du règne du Grand Roi, qui n'est pas aussi bien con-nue qu'on le croit communément. Les réflexions que l'on peut faire à son sujet rejoignent celles que je consignais ici même, en 1934, à propos de François Chéron et de la médaille baroque en France, au XVIIe siècle 1 .
La pièce en question se recommande à nous par son caractère unique, du moins pour autant qu'on le sache. Je ne crois pas que les amateurs connaissent un autre exem-plaire d'un modèle de médaille de cette nature : c'est un disque de cuivre d'un diamètre de 110 mm., qui sert de support à l'effigie du Roi, modelée en une cire rouge qui a durci en prenant un beau poli couleur de sang (il ne s'agit pas de cire à cacheter). Mais cette rareté serait un motif insuffisant pour attirer notre intérêt, si la qualité de l'ou-vrage ne l'imposait pas à notre attention. En vérité ce por-trait de Louis XIV est l'un des plus accomplis que nous ayons sous les yeux. Le dessin du profil est d'une fermeté admirable, la plastique du visage d'une souplesse et d'une délicatesse exquises, et la chevelure est traitée avec une
515
JEAN BABELON
indiscutable maîtrise. Le tout respirela majesté dans toute sa plénitude, et peut être pris pour le parangon du style classique. Pour achever la description, notons que le disque de métal est percé de quatre trous destinés à l'assujettir sur un cadre. Ce modèle de médaille a été conçu pour être préservé en raison de sa nature précieuse, c'est un « chef-d'oeuvre », au sens propre du terme, une pièce de présentation. Ce qui le prouve encore, c'est son origine : ce médaillon a été conservé dans les collections de la mar-quise de Prie jusqu'au siècle dernier.
Or, il suffit de prononcer le mot de médaillon de cire pour qu'aussitôt on pense à Bertinet, et c'est sous le nom de cet ,artiste que, sans autres preuves à l'appui, celui-ci, rara avis, est parvenu en nos mains.
Francesco Bertinetti, qui fut en France, François Berthi-net, ou Bertinet, était le fils de petits bourgeois d'Ostie. Il fut d'abord enfant de choeur à Sainte-Marie-Majeure, puis il soutint ses thèses de philosophie et de théologie, et, à vingt ans, il était chanoine. Mais il rencontra Antonina Borromei... Il fit alors bon marché du petit collet, et non content de briser son épée contre la canne du chevalier Urbini, il fit assassiner ce rival incommode par des braves à trois poils qu'il paya sept à huit pistoles. Sur quoi, il se déguisa en pèlerin et prit la fuite. On le vit à Lorette, • Ancône, Bologne, à Venise c'était fatal — où il fut assez adroit pour attirer sur sa rusée personne l'attention de l'ambassadeur de France. Celui-ci était parent de Nicolas Fouquet, et ce fut le commencement de la fortune de Ber-tinet. Le ministre, alors au faîte de sa fortune, prit à son service cet aventurier, à qui il confia diverses missions délicates, avant d'en faire son premier secrétaire. En voyage d'affaires à Cologne, Bertinet fut rejoint inopinément par sou Antonina, et l'épousa. Par la suite, il fut payeur des
SUR UN MÉDAILLON DE LOUIS XIV 57
rentes de l'Hôtel de Ville, et s'engraissa dans ces fonctions. Mais la disgrâce était proche. Fouquet s'effondra, le secré-taire fut emprisonné à la Conciergerie, et il y demeura huit ans, en compagnie de la plus fidèle des épouses, qui lui rendit ainsi un peu de ce qu'il avait risqué pour elle. Il sortit des fers par la grâce de Dieu et celle de Sa Majesté, quitta la France à la fin du siècle, et s'en alla mourir à Rome, après 1706.
Telle est en bref la vie de cette esquisse de Casanova, si du moins nous en tenons au roman bâti sur ce thème par un avocat de ses amis : L'heureux chanoine de Rome, nou-velle galante, ou la Résurrection prédestinée, contenant diverses aventures agréables et divertissantes, arrivées du temps du Ministère de M. Fouquet, Surintendant des Finances (Paris, chez Michel Brunet, 1707) 2 .
Le plus vrai de tout cela, c'est que Bertinet, bon joueur de luth, de guitare et de basse viole, « avait un génie tout particulier pour représenter en cire au naturel, sur de petits morceaux d'ardoise, et pour faire des moules avec du plâtre, dans lesquels, fondant différents métaux, il en tirait toute sorte de figures telles qu'il se les imaginait, qui pouvaient passer dès ces commencements pour chefs-d'oeuvre et de très bon originaux. » C'en est assez déjà pour justifier une attribution qui semble évidente.
Mais poursuivons. Dans sa prison, l'ex-chanoine mor-fondu employa ses loisirs à faire, en 1664, une médaille de son maître Fouquet, assez méritoire témoignage de son savoir-faire, en même temps que de sa constance dans le malheur 3 . Mais l'ancien agent secret comptait aussi sur Son art pour obtenir sa libération, en quoi il calcula bien., une fois de plus. Il exécuta un portrait de Louis XIV, pas plus grand que l'ongle, qui fit se récrier toute la cour, et qui eut l'agrément de Sa Majesté quand il lui fut présenté
58 JEAN BABELON
Un médaillon suivit, en 1671-'1672, avec une légende qui était un placet :
Si ce petit essay pouvoit plaire à la cour,
Et me retrouver mon bien à la faveur du jour (sic) Je ne languirois plus, j'aurois d'autres offices
Pour rendre au grand Louis mes très humbles services.
Pour le coup, le Roi se laissa attendrir. Bertinet, éperdu de reconnaissance, multiplia ses médaillons qu'il enguir-landait de louanges en vers pas toujours boiteux :
Qu'avons-nous fait, ma main, quelle métamorphose !
Au lieu de peindre Mars, nous avons peint Louis.
Quoy donc, tous nos projets sont-ils évanouis ?
Non, non, Louis et Mars sont une même chose.
Et il ajoutait, faisant parler le roi vainqueur :
Aigles, hydres, lions, ma force fut extrême :
Vous sentîtes mes coups, je suis toujours le même.
Ces exemples suffisent pour faire connaître le tempéra-ment de cet Italien qui n'eut pas le temps de se franciser. C'est celui d'un homme à tout faire, plein de faconde, prolixe et exubérant, qui demande le succès à l'improvi-sation. Le style de ses ouvrage s'accorde à ce pathos et à cet amphigouri. On y trouve le reflet assez fidèle de ce baroque dont, comme nous l'avons dit, Chéron s'engoua à la Zecca pontificale, en compagnie des Moro, des Mola, des Cor;nano, des Hamerani, et qu'il rapporta en France avec le souvenir des monuments dont le Bernin ennoblit Rome. Mais le baroque de Bertinet ne s'élève pas à de bien grandes hauteurs. Il s'encombre d'enjolivements décoratifs, comme il s'empêtre dans sa grandiloquence, aux dépens de la qualité du portrait. En vérité, rien n'est plus
SUR UN MÉDAILLON DE LOUIS XIV 59
loin de cette fantaisie débridée que l'image sévère que nous offre notre Louis XIV de cire.
Les médaillons datés de Bertinet s'échelonnent de 1672 à 1684 et 1686. Le dernier de la série est celui qui commé-more la Révocation de l'Édit de N'antes, et où le Roi paraît comme le vainqueur de l'hérésie : Haereseos extirpator : Bertinet fecit cum privilegio. 1686. On en connaît au moins deux autres non datés, mais la liste complète n'a pas encore pu être dressée. Il faut joindre à cela une cire disparue, représentant le docteur Jacques de Saint-Beuve, exécutée de mémoire, après la mort du personnage, en 1677, plus le médaillon d'un abbé commendataire, peut-être Feydeau de Brou, abbé de Notre-Dame de Bernay, un portrait de Michel Le Tellier, chancelier de France en 1678, sans revers et signé 4 . Quelques-uns des médaillons que nous possédons de sa main, sont composés de deux plaques fondues, ajustées et maintenues jointes par une armature. Enfin, Bertinet travailla à l'Histoire métallique, où sa signa-ture s'allie à celle d'Aury 5 .
Les portraits en médaille de Louis XIV n'ont pour ainsi dire pas été pris en considératiOn par les auteurs de l'Ico-nographie des Rois de France 6 , et c'est là une lacune dont ils se sont eux-mêmes excusés. Ceux que nous avons sous les yeux, notamment notre cire, et le médaillon dela Révo-cation de l'Édit de Nantes de Bertinet, qui, comme nous le verrons, est de la même époque, sinon de la même année, prennent place dans une suite de monuments ana-logues.
On sait les jalons chronologiques de l'iconographie du Roi Soleil : 1658, la fièvre maligne, qui lui fait perdre ses che-veux pendant la campagne des Dunes, à Dunkerque —1669-1670, l'abandon de la moustache — 1696, la fluxion. Mais ce n'est pas tant sur ces détails physiologiques que nous
60 JEAN BARELON
voudrions insister, que sur des traits d'ordre esthétique où
nous confine l'histoire de l'art. Notre cire s'intercale assez exactement entre le fameux
médaillon de marbre de Puget, exécuté en 1686, qui est au Musée de Marseille', et le médaillon de Girardon, fait en 1687, pour la Ville de Troyes 8 . Il est presque inutile de souligner qu'elle est fort loin du grand médaillon d'or de Jean Varin, qui commémore le projet de la colonnade du Louvre, telle que l'avait conçue le Bernin, et qui date de 1665. Là, le Roi paraît dans tout l'éclat d'une jeunesse encore ingénue, dirait-on, et d'une majesté qui n'est pas encore devenue un type. A l'opposé, les ouvrages de la nature de celui qui nous occupe, et qui datent de la vieil-lesse du monarque, sont le médaillon de bronze d'Antoine Benoist 9 , l'auteur des miniatures en grisaille du Cabinet des médailles, peintes pour l'Histoire métallique, et qui nous montrent Louis XIV à ses différents âges, et du grand médaillon dû au même artiste, en cire coloriée, de grandeur naturelle, pourvu d'une perruque de vrais cheveux, qui se trouve dans la chambre du Roi, à Versailles, daté de 1706.
La cire, attribuée inconsidérément à Bertinet, est loin de ce réalisme hallucinant. Elle évoque non pas la décrépi-tude, mais les jours de gloire et de possession de soi. On remarquera toutefois que cet admirable portrait se tient dans les bornes d'une relative sobriété. Aucune draperie,. aucun développement du buste ne prêtent ici à la boursou-flure, et l'arrangement des cheveux ne contredit point à la pondération des traits du visage. En somme, rien de ber-ninesque, l'ouvrage est tout français. De sorte que nous pouvons instituer à ce propos la comparaison que nous faisions ailleurs, à l'intérieur pour ainsi dire de l'oeuvre d'un seul artiste, Chéron, dont une partie est franchement baroque, imbue des enseignements puisés en Italie, et
SUR UN MÉDAILLON DE LOUIS XIV 61
l'autre assagie, disciplinée, à l'ordonnance, quand le médail-leur est embrigadé dans l'équipe de l'Histoire métallique, et au lieu de fondre ses médailles, grave des coins sur les patrons qu'on lui fournit, comme à ses camarades.
Or, si nous plaçons notre cire à côté d'une médaille frappée de l'Histoire métallique, avec l'effigie de Louis XIV signée par Jérôme Roussel, l'identité presque absolue des deux images se révèle avec évidence. La couronne de lau-rier fait ici défaut, mais l'arrangement de la perruque est le même, la coupe du buste analogue, et surtout les deux pro-fils sont presque superposables, le dessein de l'ail est exac-tement reproduit de l'une à l'autre. C'est peu de dire que le Roi est représenté exactement au même âge sur les deux pièces, celles-ci sont étroitement apparentées par leur facture.
C'est donc sur Jérôme Roussel que se concentre notre attention. Jêrôme, ou Hiérôme B.oussel, était né en 1663. Il fut recruté, comme Bernard, Manger, 'Molart, Aury, Marteau, C. Martin, Dufour, Delahaye, Le Blanc, Germain, Meybusch, et d'autres encore, pour exécuter les projets de médailles conçus par la Petite Académie, fondée ad hoc, en '1663, et où se rencontraient depuis 1694, Racine et Boileau, Charpentier, l'abbé Tallemant, Tourreil, l'abbé Renaudot, Dacier et le numismate Rainssant. Dans les inven-taires des carrés on relève les noms de Manger, F. Ché-ron, H. Roussel, Breton, Ant. Meybusch, Molart, Nilis, F. Dufour, R. Faltz, de la Haye, T. Bernard, Hupierre, F. Warin".
Roussel fut reçu à l'Académie en 1709, sur présentation d'un carré en creux du .duc d'Antin, qui devait servir de sceau à la Compagnie. I1 apparaît sur les registre des Bâti-ments du Roi, précisémen t depuis 1686, pour des fournitures de cires, de poinçons et de carrés. On connaît de sa main
62 JEAN BABELON
environ quarante-deux médailles de l'Histoire métallique Prise de Besançon, Ville de Cambrai, Prise de Philipps-bourg, Les trois Victoire, Prise d'Heidelberg, etc. Il fit frapper à Genève une série de jetons pour le jeu de l'hombre, avec pour thème les Métamorphoses d'Ovide. On sait d'autre part qu'il se rendit à Versailles pour modeler d'après nature les portraits des princes.
La faveur qui s'attachait à ses ouvrages est attestée par de fort mauvais vers — mais bien intentionnés — que cite M. A. Blanchet :
Toy qui chaque jour, d'un pénétrant burin Creuses un dur acier dans le goût de Varin. Et fais voir sans relâche, en diverses médailles, Les vertus de Louis, ses sièges, ses batailles,
Redouble tes efforts, et surpassant l'antique, Laisse aux siècles futurs des témoins éternels... 12
Jérôme Roussel est encore l'auteur des jetons de la duchesse du Maine, pour l'Ordre de la mouche à miel, fondé en 1703.
Je crois donc.qu'il faut corriger l'attribution du médail-lon de cire que nous avons entre les mains, et qui offre toutes les apparences d'avoir été exécuté ad vivum. C'est bien l'oeuvre de Jérôme Roussel, et sans doute l'un des premiers, sinon le premier des portraits du Roi qu'il ait faits. Quand à sa date elle ne saurait s'éloigner de l'année 1686, qui est à la fois celle du médaillon de Bertinet com-mémorant la Révocation et celle du début de la carrière de Roussel. C'est aussi celle du médaillon de Puget où l'on remarque la même structure de la tête, avec le nez courbe, le maxillaire très puissant, la forme conique du crâne avec son front fuyant, et qui par conséquent nous fournit un
SUR UN MÉDAILLON DE LOUIS XIV 63
autre repère iconographique. Cette date indiquerait assez bien la nature de l'ouvrage. Roussel avait alors vingt-trois ans, il en était alors à ses premiers essais officiels. Quand il eut exécuté ce portrait du Roi, qu'il n'est pas excessif de qualifier de magistral, il le présenta comme un exemple de son savoir-faire, et comme pour justifier une candida-ture. Le soin qu'on prit de conserver ce chef-d'oeuvre marque rétrospectivement son succès. Ce succès est aussi attesté par la copie qui en fut tirée en un coin gravé pour l'Histoire métallique.
Nous ne perdons rien à voir Bertinet disparaître de la scène, bien au contraire. Et l'examen que nous avons fait nous permet de saisir deux « moments » de l'art du Grand Siècle, partagé entre l'italianisme envahissant, et un goût classique qu'il faut bien qualifier de français. Sur le champ étroit de la médaille s'affrontent les deux tendances en un conflit d'où nous pouvons tirer notre instruction.
Jean BABELON.
1. Revue numismatique, 1934, p. 221. Le médaillon de cire qui fait l'objet de la présente notice a été acquis en 1940, sous les auspices de M. Bernard Fay, administrateur général de la Bibliothèque nationale.
2. Dédié à Son Altesse Roiale, Madame la duchesse de Lorraine, par C. M. D. R.
3. Ces médailles de Fouquet ont été étudiées par M. J. Cordey dans Aréthuse, avril, 1927 : Berthinet, portraitiste de Nicolas Fouquet. Voyez l'abbé Poret, François Bertinet, modeleur et fondeur en médailles, Paris, Plon, 1891, in-8°. La médaille de Fouquet exécutée à la Conciergerie porte la date de 1665, et la men-tion : idee. Bertinet avait le don de travailler de mémoire. Le médaillon de la Révocation de l'Édit de Nantes est reproduit dans le Trésor de Numismatique, t. III, p. 23, pl. XXVII.
4. Trésor de Numismatique, III, p. 17, pl. XIX. -
5. Voir encore à son sujet : Revue belge de numismatique, 1859, p. 161. —Fr. Vermeylen, Revue belge de numismatique, 1902, p..343, pl. VII. — Jean Babelon, Histoire de l'Art d'André Michel, t. VII, p. 396. --- Adrien Blanchet, Manuel de numismatique fr., t. III, 1930, pp. 64, 161, 16v. La médaille signée avec Aury date de 1673. Celle de Le Tellier est reproduite dans le Trésor de numismatique, t. III, p. 17, pl. XIX. Cf. A. de Montaiglon, Archives de l'Art français, 1" série, t. VII, p. 11 -15.
6. Le lieutenant-colonel Ch. Maumené et le comte Louis d'Harcourt, Lcono-
64 JEAN BABELON
graphie des rois de France, seconde partie, Louis XIV, Louis XV, Louis X VI, Archives de l'Art français, nouvelle série, t. XVI, 1931.
7. Marbre blanc, provenant de la collection du marquis de Panisse. Il en existe un moulage au Musée de Chaillot. Diam. : 0 m. 66. On en connaît des copies.
8. Francastel, Girardon, pl. I. Sur ce médaillon, le Roi porte une fine mous-tache qui est absente de notre cire.
9. Signé et daté de 1705. Ad vivum. 10. Voir à ce sujet J. J. Guiffrey, La monnaie des médailles, Histoire métallique
de Louis XIV et de Louis XV, Revue numismatique, 1884, 1885, 1888, 1889, 1891 ; Jean Babelon, Histoire de l'Art d'André Michel, t. VII, p. 402-410; du même, La médaille et les médailleurs, Paris, 1927, p. 145 et ss. , A. Blanchet, Manuel de numismatique française, t. III, p. 20 et ss., 65 et ss.
11. Voir, à la Bibliothèque de l'Institut de France, le recueil intitulé : Portraits de Louis le Grand suivant ses différents âges, pour servir à l'Histoire des princi-paux événements de son règne, par les médailles.
12. Le Poète sans fard, contenant satires, épîtres et épigrammes sur toutes sortes de sujets, à Libreville, chez Paul, 1698 (Épitre à M. Roussel, graveur des médailles du Roy). A. Blanchet, op. Laud., p. 25.
NOTE SUR UN JETON CONSERVÉ AU MUSÉE CARNAVALET
Le Musée Carnavalet possède un jeton de cuivre peu connu dont l'interprétation semble avoir été découverte par M. Bordeaux, dans une note lue à la séance de la Société de Numismatique du 6 janvier 1917.
La pièce montre d'un côté six poules avec des têtes de jeunes femmes, coiffées suivant la mode du milieu du xvne siècle. Il est aisé de reconnaître que l'artiste a repré- senté, non pas des volatiles, mais des femmes costumées en poules ; le jeton est daté 1750. En légende circulaire, on lit :
O POULES EN VOYANT VOS TRAITS ET VOS APPAS
Sur l'autre face, un coq chantant, passant, de profil à droite avec, en légende circulaire, le vers suivant faisant suite au précédent :
QUEL EST LE COQ MAUDIT QUI NE CHANTEROIT PAS.
Pour saisir le sens de cette allusion, il est intéressant de se reporter aux événements du temps. Edmond et Jules de Goncourt, qui certainement ont ignoré ce jeton, vont nous éclairer. Dans leur livre « M Ille de Pompadour » nous lisons au chapitre V :
« L'Hermitage de Fontainebleau, bâti pour offrir de temps en temps, à Louis XV, deux oeufs à la coque, ne con-tenait au rez-de-chaussée qu'une salle à manger... etc. —
1941. — I. 5
66 BAILLE
Une grande basse-cour avec quatre poulaillers pour toutes les espèces de poules, était la curiosité de cette rustique habitation, qui revenait à 216.382 livres. Le jardin, dessiné par Lassurance, avait 67 toises de long sur 60 de large (soit environ 130X 120 mètrres). »
Et plus loin « La véritable inauguration du château de Bellevue n'était vraiment qu'à la date du 2 décembre 1750, où sur le petit théâtre décoré à la chinoise, se jouait, pour l'amusement du Roy, un charmant ballet l'Amour archi-
tecte. Dans ce ballet on voyait... et, sur la route de Bellevue une de ces voitures appelées « Pot de chambre » culbuter et verser sur là scène une pleine corbeille de femmes : un ballet et ses danseuses. »
Ce jeton semble donc avoir été composé et frappé à l'oc-casion de l'inauguration du château de Bellvue, pour commémorer ce menu fait divers : l'arrivée des Poules chères à Mme de Pompadour et au Monarque. Le scénario. de l'opéra-ballet devait comporter les deux vers inscrits sur le jeton, allusion directe à la beauté des actrices ou des ballerines.
Il nous a paru intéressant de poursuivre nos recherches sur le ballet l'Amour architecte. L'ouvrage de Goizet nous apprend que la pièce, représentée pour la première fois au Théâtre de Bellevue, le 27 janvier 1751, n'a pas été imprimée .
D'autre part, en feuilletant l'ouvrage de Camprodon (1867) Mme de Pompadour, nous voyons la relation de la repré-sentation de la pièce, à peu près dans les mêmes termes qu'ont repris les Goncourt. Mais si le texte de la pièce elle-même a disparu, si la distribution des rôles principaux n'a pas été conservée, du moins les recherches sur les person-nages qui composaient la petite troupe qui, aux côtés de la Marquise de Pompadour, brillait dans les divertissements les plus divers, ballets, opéras, comédies, sous la direction
NOTE SUR UN JETON CONSERVÉ AU MUSÉE CARNAVALET 67
du Marquis de Vallière, à Trianon et à Bellevue, nous ont-elles permis de vérifier l'hypothèse de M. Bordeaux.
Qui voyons-nous, en effet, à côté des acteurs titrés et de haute lignée ? un petit corps de ballet, composé de six jeunes danseuses, dont la plus âgée, en 1750, ne devait guère avoir plus de 11 ans :
Mesdemoiselles ASTRODY CAMILLE CHEVRIER DORFEUIL MARQUISE PUVIGNÉ
(Disons en passant que toutes devaient, par la suite, se distinguer dans le monde du théâtre et de la galanterie.)
Et précisément le nombre des figurantes costumées en poulettes sur notre jeton est exactement celui des ballerines habituelles de Bellevue. C'est donc le ballet au grand com-plet que le graveur a représenté sur le jeton. Le déchiffrage de ce petit monument, plaisant et délicat, n'est-il pas pré-férable à la lecture d'un livret aux paroles mortes depuis deux siècles, et n'est-il pas fort intéressant d'assister à une scène inédite de l'Amour architecte, pièce qui semblait> être à tout jamais tombée dans l'oubli ?
BAILLE.
MÉLANGES ET DOCUMENTS
NOTE SUR UN JETON
DE GARCIA LOPPEZ DE RONCEVAILS (XlV e S.).
Jules Rouyer, que j'ai beaucoup connu et dont j'appréciais vivement la grande finesse et l'érudition solide, avait, comme on le sait, formé une superbe collection de jetons qu'il légua au Cabinet de France. Henri de la Tour lui rendit un hommage mérité en publiant le catalogue de cette collection, qui est au-jourd'hui un excellent instrument de travail. Il est évident que ce livre, publié relativement peu de temps après l'entrée de la collection à la Bibliothèque Nationale, ne pouvait fournir, géné-ralement d'après les notes publiées ou inédites de Jules Rouyer, que des renseignements limités. C'est peut-être le cas pour le jeton dont voici la description.
Garcia I Loppiz de I Boncevails, trésorier, en onciale, en quatre lignes. Ave Maria gracia, autour. n - . Bonnefoy (deux fois). Champ écartelé de Navarre-Évreux. Cuivre.
Catal. de la Coll. Rouler, 1899, t. n° 351, pl. IX, 7 (avec la lecture Roncevains, que je crois moins bonne et qui, d'ailleurs„ ne saurait changer l'attribution).
Ce jeton, intéressant en particulier pour les armoiries qu'il porte, est resté sans attribution précise. Il ne convient pas de le reprocher à Jules Rouyer, ni à Henri de la Tour : ils n'eurent pas la chance dont le hasard m'a favorisé.
Au cours de recherches entreprises pour d'autres sujets, j'ai trouvé dans un volume de l'inventaire des Archives des Basses-Pyrénées, la mention suivante : E 35. 1348-13i9. Garcia de Roncevaux, marchand de Pampelune, reçoit du sire d'Albret, 1250 écus d'or, à condition de lui amener, à Tartas ou dans un. autre château de ce seigneur, 10 bons chevaux. »
70 MÉLANGES ET DOCUMENTS
Cette mention avait éveillé mon attention, car j'avais con-servé le souvenir du jeton, entrevu autrefois, et dont les armoi-ries me paraissaient toujours soulever une question intéressante.
Le document des Archives des Basses-Pyrénées apporte cer-tainement la solution du problème, car, ainsi que nous allons le voir, tout concorde à établir l'identité du personnage.
En 13i8-13i9, Garcia n'était qu'un marchand de Pampelune, capitale de la Navarre ; mais il était déjà en relations avec le sire d'Albret, alors Bernard-Ezi II (depuis 1328). Le succcesseur de celui-ci, Arnaud-Amanieu (1358) eut des différends avec le roi d'Angleterre ; ses terres furent saisies et il fut fait prisonnier par Gaston-Phoebus, comte de Foix, au combat de Launac, en 1362. Ensuite, il obtint la charge de capitaine général au service de Charles le Mauvais, roi de Navarre, en 1365.
Ce prince, qui avait eu jusqu'alors une fortune très incertaine et qui avait été sauvé par la défaite de Poitiers, avait peu à peu regagné une popularité funeste et obtenu de grands avantages, en partie à l'aide d'Étienne Marcel. Le régent fut même obligé de conclure avec le roi de Navarre, le 22 août 1359, un traité qui assurait à celui-ci 600.000 écus d'or en douze ans et de nom-breuses terres.
Le roi de Navarre ne respecta pas plus qu'auparaant ses en-gagements. Il retourna d'ailleurs en Navarre, qui, sous l'admi-nistration de son frère D. Louis, était redevenue prospère. Charles le Mauvais, en 136i, réforma l'administration financière de la Navarre et créa une chambre des Comptes. Est-ce vers cette date que Garcia Loppiz de Roncevails devint trésorier de cette chambre ou d'un autre service '?
En effet, la collection Rouyer, entre autres, renferme d'autres jetons analogues dont l'un, avec le même champ écartelé, porte, au ty, la légende Du Contrero..., qui est plus complète sur un exemplaire de l'ancienne collection du Cabinet de France : t Du. Contreroul : de : Navarre. Bande enroulée chargée du mot Ave; deux palmes (Rouyer et Hucher, Hist. du jeton au M. Age, 1858, p. 123, fig. 90. Les auteurs ont précisé la question des
MÉLANGES ET DOCUMENTS 71
quartiers fleurdelisés d'Évreux employés par les rois de Navarre, depuis Philippe d'Évreux, 1319).
Ce « contrôle » était-il un autre service que la chambre des Comptes ?
En tout cas, que Garcia, marchand de Pampelune, en 1349, soit parvenu, par la réussite de ses affaires, à devenir un person-nage assez important pour être nommé trésorier d'un service de l'administration du royaume de Navarre, c'est là une hypothèse très vraisemblable, qu'appuient encore les anciennes relations de Garcia avec les sires d'Albret.
Quant au nom Loppiz, révélé par le jeton et passé sous si-lence par le document, il n'est pas essentiel. En tout cas, il pré-sente quelque intérêt, car le nom espagnol Lopez est dérivé -du mot loba, qui désigne le loup (Cf. l'exemple de Juda Lobel sur un sceau juif espagnol du me s., où le champ est occupé par un quadrupède qui est très probablement un loup. Voyez : Adrien Blanchet, dans Bey. Num., 1889, p. 424, et Études de Num., I, 1892, p. 126).
C'est d'ailleurs comme deux loups que l'on a considéré les quadrupèdes, passant l'un sur l'autre, sur un jeton fruste, attri-bué également à Garcia (voy. F. Feuardent, Jetons et Méreaux, t. II, 1907, p. 302, n° 9308 A. — Je crois qu'il en existe un exemplaire meilleur au Musée ..de Cluny).
La devise Bonne foi n'est probablement pas celle de Charles le Mauvais, à qui on en a donné une autre (Dominos meus adju-for, etc.), d'ailleurs peu certaine. L'expression convient parfaite-ment à une chambre des comptes, à un contrôle quelconque.
Aussi bien, les deux mots, Bonne foy, se retrouvent sur un hanap d'argent, qui faisait partie, vers 1380, des biens de Louis I", duc d'Anjou (voy. H. Moranvillé, Inventaire de l'orfèvrerie et des joyaux de L. Pr , duc d'Anjou, 1904, p. 320, n° 988).
ADRIEN BLANCHET.
(Communication faite à la Société française de Numismatique, le 12 juil-let 1941.)
CHRONIQUE
■•■
Le sicle clans le royaume d'Ugarit. — Dans un mémoire intitulé
Les villes et les corporations du royaume d'Ugarit, M. Ch. Virolleaud
a signalé la présence d'un groupe de trois lettres (,q/), dans les inscrip-
tions, qui révèle un sicle, mentionné quatre fois pour des villes qui devaient fournir ou payer un demi-sicle d'argent, un sicle, un sicle et demi, deux sicles et demi. — Syria, t, XXI, 1940, p. 133.
On sait que Ugarit, c'est Ras-Shamrà. La date de ces mentions
n'est pas précise. ADR. BL.
4.4.
Poids préhistoriques grecs. — Ces poids trouvés à Malthi, en Messé-nie, sont de 7 étalons différents : une mine de 60 unités de 8 gr . (système babylonien, connu en Crète); — une mine de 50 unités de 9 gr. et une fraction (système égyptien); une mine de 60 unités de 13 gr. et fraction (étalon-or égyptien). — N. Valmin, dans Bull. Soc. roy. des
lettres de Lund, 1936-7, II. Cf. Rev. études anc., 1937, p. 432.
ADR. BL.
* *
Un atelier séleucide à Doura-Europos. — On a trouvé à Doura des bronzes de deux dimensions, avec la tête de Seleucus, et au nom d'An-
tiochus l er , avec une tête de cheval cornu. Ces pièces de mauvaise.
fabrique auraient été émises à Doura-Europos et un autre bronze avec
Ey paraît à deux auteurs prouver l'existence de l'atelier. On y aurait apposé aussi des contremarques avec une lyre. Bien que sédui-sante, l'hypothèse demeure encore douteuse, et adhuc sui) judice... D'ailleurs les auteurs ne dissimulent pas le doute possible. — Alfred R. Bellinger et Edward T. Newell, A Seleucid 'Vint at Dura-Euro-
pos, dans Syria, XXI, 1940, p. 77-81, pl. XIV et fig. ADR. BL.
CHRONIQUE
Monnaies d'Éphèse. — Lorsque j'ai publié ma note sur les statères d'or d'Éphèse (Procès-v. de la Soc. fr. de Num., 1936, p. xiv-xvi), l'article de M. Fernand Chapouthier (La Coiffe d'Arténzis dans Éphèse trois fois néocore, dans Bey. Études anciennes, t. XL, 1938_, p. 125-130, pl. III, m. d'Éphèse), n'avait pas paru. Je dois donc signaler cette notice intéressante.
ADR. BL.
Premières monnaies arabes. — M. R. Ghirshmann a publié une note intéressante dans les Mélanges syriens H. Dussaud, 1939, p. 697- 70E, pl.). Il s'agit d'une monnaie de Zyad I, Abu Sofian, gouverneur du Fars, personnage connu. On y trouvera une explication du pyrée des m. sassanides dont l'origine est le feu allumé à l'avènement de chaque roi et considéré comme le symbole protecteur de son règne.
ADR. BL.
Médaillon contorniate ? — Au Mont Hiéraple (Moselle), on a trouvé un objet de bronze que M. Espérandieu a considéré comme un objet de cuite. 11 représenterait le Soleil dans un quadrige de face.
Je pense qu'il s'agit d'un médaillon contorniate. — Voy. Bulletin archéol. du Comité, 1936-7 (paru en septembre 1941), p. 317.
ADR. BL. ,* *
Fortuna. — Même pour des numismates, il sera utile de consulter un article de Wolf (II. Friedrich), Cato, Caesar und Fortuna bei Lu-can, dans Hernies (Berlin), 73 e vol., 1938, p. 391 et s. ; et particuliè-rement : Fortuna und Fatum bei Lucan, p. 405-411.
ADR. BL. * *
Exagium de 6 solidi. — Un poids d'une vencia-solidi sex, en bronze incrusté d'argent, a été trouvé dans la forêt située au sud d'EE-1Vlabder (Algérie) ; il pèse 26 gr. 5 (pour 27 gr. — Leschi, dans Bull. archéol. du Comité des tr. hist. et Sc. du Min., 1936-37 (paru septembre 1941), p. 33-4.
Cet exagium s'est déjà rencontré souvent, avec quelques variantes. . ADR. BL.
CHRONIQUE 75
Numismatique mérovingienne. — Le secrétaire de notre Revue était malheureusement prisonnier; mais son nom vient, — s'il en eût été besoin, — de nous être rappelé par le dépôt à la Société d'édition « Les Belles-Lettres » (adresse sur le titre de la R. N.),
d'un précieux volume.: Mélanges de Numismatique mérovingienne (1940, gr. in-8°, 155 p., cartes et fig., VI pl. photot. Préface de M. A. Dieudonné).
Le recueil était presque entièrement imprimé au moment où la guerre commença. Il contient cinq mémoires,, parus déjà dans notre Revue et c'est pour cette raison que nous n'en donnons pas un compte rendu plus étendu dans le Bulletin bibliographique. On se reportera donc aux années 1936, 1937, 1938 et 1940 ; mais on prendra en note que ces Mélanges contiennent un index des ateliers monétaires.
ADR. BL. * *
Le « denier de paix », en Picardie. — M. Bonnand, de la Soc. des Se. L. et ar s de l'Aveyron, a étudié un des anciens deniers d'Amiens qui porte Pax, au droit, dans le champ (x ►° s. environ). Laissant de côté l'hypothèse de l'influence municipale, l'auteur croit que le denier a été frappé à la suite du pacte qui unit Amiens à Corbie en 1031. De plus Pax devrait être entendu, « ainsi que le disent les théologiens du Xe et x ►° siècle, comme le monogramme de la Sainte-Trinité. L'as-semblée de paix de 1031, ...revêtit en effet, un caractère nettement religieux ».
L'hypothèse est intéressante ; mais peut-être l'interprétation est-elle trop étroite. — Bull. archéol. du Comité des tr. hist. et se. du
Min. I. P., 1936-37 (paru en septembre 1941), p. 267. ADR. BL.
* *
Médailles de la première République. — Le tome II (1800-1805)
des Procès-verbaux de l'Académie des Beaux-Arts (Paris, 1840), contient des notes sur l'adoption de divers projets de médailles, par exemple : 13 ventôse an 9° , mercredi 4 mars 1801. Médailles sur la prise d'Alexandrie, sur la bataille des Pyramides, pour le passage
du Désert, pour la conquête de la Haute Egypte, pour l'occupation
du Cosséir, pour la bataille d'Aboukir, pour la bataille d'Héliopolis
76 CHRONIQUE
(p. 29-30 et 31. Désignation de Chaudet, etc.). Autres médailles (passim). On sait que les dessins de Chaudet ont fait l'objet d'une publication du regretté Ernest Babelon.
ADR. BL.
44.
Numismatique politique. — Sous le titre de : La Numismatique politique au XXe siècle, M. Henry Bauquier a publié un article de trois colonnes dans Le Temps (de Lyon ; 22 déc. 1940). Il rappelle quelques faits bien connus et aussi quelques autres qui le sont beau-coup moins, par exemple à propos des émissions lyonnaises de pièces à l'effigie du comte de Chambord, dont certains coins de 1871 et 1873 sont entre les mains de l'auteur.
On trouvera encore, dans cet article, quelques renseignements sur divers projets de monnaies, non réalisés.
L'auteur a choisi un titre un peu trop général, puisqu'il ne parle pas de médailles et jetons qui appartiennent bien à la Numismatique, par exemple les pièces de propagande du duc d'Orléans (1869) et des Camelots du roi (1912).
ADR.
Monnaie-matières, — L'Illustration du 4 octobre 1941 (,( L'Auto-mobile » ; n° 5143) a reproduit un billet que l'on doit signaler ici. Il porte, en outre des n°' de séries, la mention : Billet de I kiloq. de produits moulés bruts en fonte et acier. ()K F. 0,557 .446. Monnaie-Matières O.F.F. A . Sections des fontes, fers et aciers. Office Centrai de répartition des produits industriels.
ADR. BL.
La Monnaie de Paris. — Édifice, ateliers, fabrication. Médaille du Maréchal Philippe Pétain, chef de l'État. — Art. de Marcel Lasseaux, dans L'Illustration,. n° 5109, 8 février 1941, p. 151-3, 8 fig.
4. 4.
Prix Allier de Ilanieroche. — Pour 1941, l'Académie des Inscrip-tions et Belles-Lettres a décerné le prix Allier de Hauteroche (Numis-matique ancienne) à M. Henri Seyrig, directeur des Antiquités en Syrie, pour ses recherches sur la numismatique syrienne (publiées en majeure partie dans Stria).
CHRONIQUE 77
e
TROUVAILLES.
1. — En février 1935, à 1.400 mètres environ de l'église de Met-ternich (Cercle d'Euskirchen, région de Cologne), on a découvert deux cruches de terre à une anse, au milieu de débris divers indiquant des constructions antiques. Ces vases contenaient environ 4.000 pièces de bronze, surtout des folles, depuis Constantin ler jusqu'à MagnenCe. Une douzaine d'ateliers représentés. Un certain nombre de pièces de types barbares. — La trouvaille a fait l'objet d'une étude bien faite : Wilhelmine Hagen, Miinzschatz von M. aus der Zeit des Kaisers Magnentius, dans les Bonne!. Jahrbücher, f. 145, 1940, p. 80-125, pl. 15à 23.
2. — A Etréchet (Cne de Neuvy-Saint-Sépulchre, Indre), on a trouvé un dépôt de 700 à 800 pièces d'argent des xve et xvfe siècles. — Renseignement de M. Jambut, à Briantes.
3. — A Volubilis (Maroc), on a trouvé un lot de pièces arabes du viii siècle dont plusieurs sont inédites, avec des formules particulières, et dont un certain nombre sont frappés à Walila (identifié au lieu antique). D'autres ateliers ont fourni de ces pièces, par exemple Tond-
ghâ, (série entre 173 et 188 ; localité du Tafilalt). Deux ateliers incon-nus Taghaccà, et Tihart sont nouveaux. Outre les noms d'Idris l u. et d'Idris II, on a relevé les noms de Khalaf ben el Madhà, de Qis ou
Fis ibn Youssef, de Rachid ben Qàsim. — Voy. Colin (dans Hespéris, t. XXII, 1936), article analysé par M. Gaudefroy-llemombynes, dans Bull. archéol. du Comité Min. I. P., 1936-7 (septembre 1941), p. 330-1.
ADR. BL.
BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE
.DiEtruoNxi: (Adolphe). Les origines de la livre anglaise. Paris, 1940, in-4°, 10 p. (Extr. des Mélanges en l'honneur de M. Fr. Martroye, publiées par la Soc. Nat. des Antiquaires de France, 1940.)
C'est une question difficile, comme la plupart de celles de métrolo-gie, que M. Dieudonné aborde dans cette notice. Reprenant les études de Schive et de Guilhermoz •en particulier, il rappelle que la livre anglaise, dite livre de la Tour de Londres, était soit les 16/15e de la livre romaine, soit les 15/16° de la livre de Troyes, ce qui donnait, soit 348 gr., soit 344 gr.
Le marc de Troyes serait issu du marc de la livre de Venise et de Gênes, par l'intermédiaire des marchands italiens qui fréquentaient, en grand nombre, les foires de Champagne (sur ce point et sur l'in-fluence également possible de Florence, il ne serait pas inutile de consulter l'ouvrage suivant : El. Chapin, Le.; villes de foires de Cham-pagne, des orig. au début du XIVe s., Paris, 1937, gr. in-8°).
La livre de 15 onces de Troyes serait devenue l'origine du marc de Cologne, qui aurait passé en Angleterre, selon plusieurs auteurs.
M. Dieudonné, discutant une idée de Blancard, relative à une ori-gine anglo-saxonne, ne l'admet pas .telle quelle. Trouvant en Angle-terre, dès le xe siècle, un marc, dit danois, de 8 onces 16 deniers (ou 128 deniers), il paraît croire à une origine plus nordique ; mais il comprend-bien les influences des divers systèmes qui, selon les époques, auraient plus ou moins prévalu. Il est certain que, dans beaucoup de pays, les transformations pondérales et monétaires ont subi des in-fluences, que je nommerai économiques. La politique, les victoires et les défaites, ont eu aussi une grande part dans ces influences.
Et, à mon sens, il convient de n'oublier pas que les rois anglo-saxons ont payé à Rome, un « denier de saint Pierre », dèS le ixe s. (Cf. Lois (l'Édouard le Confesseur, c. 10 : De denario S. Petri).
ADRIEN BLANCHET.
TABLE
MÉTHODIQUE DES -RATIÈRES CONTENUES DANS LA
REVUE NUMISMATIQUE
CINQUIÈME SÉRIE — TOME CINQUIÈME
1941
NUMISMATIQUE DE L'ANTIQUITÉ
BLANCHET (Adrien). Le rhinocéros de l'empereur Domitien 5
VIAN (Carlo). Quelques trouvailles monétaires dans le Vaucluse et la région, faites de 1920 à 1941 11
Chronique : Trouvailles, 77. — Le sicle dans le royaume d'Ugarit, 73. — Poids préhistoriques grecs, 73. — Un atelier séleucide à Doura-Europos, 73. — Monnaies d'Ephèse, 74. — Médaillon contorniate ? 74. —Fortune, 74. — Exagium de 6 solidi, 74.
NUMISMATIQUE DU MOYEN AGE ET MODERNE
Monnaies françaises.
DIEUDONNÉ (A.). Essai sur l'Histoire monétaire de l'Artois,
d'après Alex. Hermand
Chronique : Numismatique mérovingienne, 75. — Le « denier de paix » en Picardie, 75. — Monnaies-matière, 76.
Médailles et jetons.
BABELON (Jean). Sur un médaillon de cire de Louis XIV. — PI. I et II. 55
BAILLE. Note sur un jeton conservé au Musée Carnavalet 65
33
80 TABLE MÉTHODIQUE DES MATIÈRES
BLANCHET (Adrien). Note sur un jeton de Garcia Loppez de Boncevails (xive s.)
Chronique : Médailles de la première République, 75. — Numisma-tique politique, 76. — Monnaie de Paris, 76.
Monnaies étrangères.
Chronique : Premières monnaies arabes, 74.
Prix de Numismatique Allier de Hauteroche, 76.
BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE
DIEUDONNÉ (A.) Les origines de la livre anglaise (A. Blanchet).
69
(o °- 7& ‘er --‘4•
amenitou o ---i es. k
cHe
Le Gérant : Jean MALYE.
MACON, rnoTAT FFtkliES, - MCMXLII.
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE
NUMISMATIQUE HONORÉE PAR L 'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES
DU PRIX DUCHALA1S (1910 et 1930)
ET
RECONNUE COMME ÉTABLISSEMENT D' UTILITÉ PUBLIQUE PAR DÉCRET
DU 4 JANVIER 1924.
SIèGE SOCIAL : HÔTEL DE LA MONNAIE, QUAI CONTI, PARIS VIe
LISTE DES MEMBRES AU 31 DÉCEMBRE 1941 (sans-les modifications que les Circonstances
ne nous permettent pas d'introduire pour l'année 1941)
ET MENTION DES SÉRIES FAISANT L'OBJET DE LEURS ÉTUDES
Gr. grecques. R. romaines. B. byzantines.
G. gauloises. F. françaises. F. f. féodales françaises.
Fr. royales françaises. E. étrangères. J. jetons.
MEMBRE D'HONNEUR
S. M. VICTOR-EMMANUEL lir, ROI D' ITALIE.
PRÉSIDENTS HONORAIRES (2)
MM. BLANCHET (Adrien), Ye, Membre de l'Institut, Bibliothécaire hono-raire à la Bibl. Nat., 10, boulevard Émile-Augier, Paris XVI.
DIEUDONNÉ. (Adolphe), *, Conservateur honoraire du Cabinet des Médailles et :Antiques à la Bibliothèque Nationale, 14, rue Worth, Suresnes (Seine).
MEMBRES HONORAIRES (7)
MM. ALLAN (J.), Conservateur du Cabinet des Médailles du British Museum, Londres W. C. (Angleterre).
BAILIIACHE (D r Julien), ye, ;, 1, place de la Mairie, Gennevil- liers (Seine) Mon. F.
BOUCLIER (Albert), 90, boulevard Malesherbes, Paris VIII. Mon. F., E., Méd., J.
1939. — 1.
Il LISTE DES MEMBRES
MM. CESANO (Mlle), Conservatrice au Musée national des Thermes, à Rome.
HILL (Sir G.-F.), Directeur honoraire du British Museum, 12, Sussex Place, Londres N. W. 1. (Angleterre).
MIN (Mlle Marie DE), rue Saint-Pierre, F, 39, Middelbourg (Pays-Bas).
TOURNEUR (V.), Conservateur en chef de la Bibliothèque royale de Belgique, à Bruxelles (Belgique).
MEMBRES TITULAIRES (43)
MM. BABELON (Jean), .4y, Conservateur du Cabinet des Médailles, 106 bis, rue de Rennes, Paris VI.
BÉZAGU (Louis), 61, cours d'Aquitaine, Bordeaux (Gironde). (Membre à vie.)
BLANDIN (Roger), 22, rue de Nancy, Épinal (Vosges). BOULOT (Edmond), Inspecteur des Postes et des Télégraphes,
54, rue du Jeu-de-Paume, à Moulins (Allier). Mon. F., de Louis XI à nos jours.
BURCKHARDT (D r ), Bibliothèque de la Ville de Zurich (Suisse). CAZALAS (Gal), C *, 20, rue des États-Généraux, Versailles
(Seine-et-Oise). CORA (Louis), Rapallo (Italie). CÔTE (Claudius), 33, rue du Plat, Lyon (Rhône).
Mon. F., de Savoie et des Dombes. Sceaux gothiques. COUDURIER DE CHASSAIGNR (J.), 4,, 14, rue Raynouard, Paris XVI.
Mon., Méd., J. du Lyonnais et de la Bourgogne. DELEPIERRE (Jean), , 2, rue Gerbillon, Paris VI. Mon. Gr. et R. DORY (Cel), C e ; , 27, boulevard Gambetta, Grenoble (Isère).
Mon. F. r., Poids monétaires. ESPEZEL (Pierre D'), 7, rue Delaizement , Paris XVII. FLORANGE (Charles), *, conseiller du commerce extérieur de
la France, 19, Avenue d'Orléans, Paris XIV. FORRER (Léonard), Helvetia 24, Homefield Road, Bromley, Kent
(Angleterre). GUILLON (René),*, Directeur honoraire de la Banque de France,
9, avenue d'Épineuil, Pontoise (Seine-et-Oise). HANIN (R.), 45, boulevard Suchet, Paris XVI. HEss (Georges), 23, boulevard Foch, Le Havre (Seine-Inférieure).
DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE NUMISMATIQUE III
MM. HOLLANDE (Dr), *, 3, rue Pierre-Haret, Paris IX. HYDE (James H.), G.O. Ye, 18, rue Adolphe-Yvon, Paris XVI
(Membre à vie.) JACQUIOT (M lle Josèphe), 20, rue Molière, IVIontgerou (Seine-et-
Ois e) . JAGUENEAU (Frédéric), 34, boulevard des Belges, Nantes (Loire-
Inférieure) Mon. R. et F. JAMESON (Robert), ye, 8, avenue Velasquez, Paris VIII. (Membre
à vie.) Mon. Gr. d'or et d'argent et iconogr. des empereurs romains (or).
JEULIN (Paul), 3, rue Raymond-Poincaré, Troyes. KOLB (Dr P.), O. ye, 178, rue de Courcelles, Paris XVII,
(Membre à vie.) Mon. R. Gr. et G. LE GENTILHOMME (P.), Bibliothécaire au Cabinet des Médailles,
98, rue Erlanger, Paris XVI. LHÙRITIER (Gal Jacques), Paris. LONGUET (Dr), O. *, ;, médecin-colonel, Hôpital du Val-de-
Grâce, Paris.... Mon. B. mérovingiennes et de l'Orient latin. MANTEYER (Georges DE), Archiviste honoraire des Hautes-Alpes,
Gap, et à Manteyer, par la Roche des Arnauds (Hautes-Alpes). MONTANDON (Léon), Conservateur du Cabinet des Médailles au
Musée historique de Neufchâtel (Suisse). MULLER (Dr Camille), 8, boulevard du Champ-de-Mars, Colmar
( Han t-R hin). PATRIGNANI (A.), 7, Piazza Umberto P, Bologne (Italie).
Mon. et Méd. napoléoniennes, Méd. papales depuis Martin V. PAYEUR (G.), Propriétaire à Dijon, Saint-Dié (Vosges).
Mon. R. et lorrains du M. A. PERRIGAULT (Albert-Oscar), 22, rue de Bordeaux, Le Havre
(Seine-Inférieure). Mon. F. de la République, de l'Empire et des colonies.
PRIEUR (Pierre), 115, rue Lauriston, Paris XVI. Mon. F. r. de Hugues Capet à Louis XVI.
PROTAT (Émile), Les Chanaux, à Mâcon (Saône-et-Loire). RICKLIN—SERY (J.), 29, rue d'Épinal, Golbey (Vosges).
Mon. R., B. et F. ROLLAND (Henri), *, ;, Correspondant du Ministère de l'Édu-
cation Nationale, Voie Aurélienne, à Saint-Remy-de-Pro- vence (B.-du-R.).
IV LISTE DES MEMBRES
MM. ROMANOS (Athos), ancien Ministre de Grèce, 14, rue Dumont-d'Urville, Paris XVI.
SCHOTT (Édouard), 26, rue des Murs, Saverne (Bas-Rhin). Mon. Gr. R. et F.
SI LliERNIANN (Victor), à Thann (Haut-Rhin). THERY (Louis),. 39, rue de Bourgogne, à Lille (Nord). THIOLLIER (Noël), Archiviste-Paléographe, 28, rue de la Bourse,
à Saint-Étienne (Loire). VILLIERS (Henry), 1, rue de la Platière, à Lyon (Rhône).
MEMBRES CORRESPONDANTS (94)
MM. ABEILHOU (D r Paul), à Elne (Pyrénées-Orientales). ALVARO DE SALLES OLIVEIRA, 54 Quintino Bocay, Sao Paulo
(Brésil). A SSALET (Ct), 50 bis, rue d'Autun, à Chalon-s.-Saône (S.-et-L.). AUBEY (C t Joseph), O. ;, Château de la Cour, Verdun-en-
Berry (Cher). AVOT (Louis), 19, rue de la Trémoille, Paris VIII. BAILLE (Marcel), 46, avenue Charles-Floquet, Paris VII. BON (Mme ), 11, rue Rondelet, Montpellier (Hérault). BONNET (Émile), Président de la Société archéologique de
Montpellier, 11, rue du Faub:- Saint -Jaumes, Montpellier • (Hérault) Mon. G., F. f. et J. du Languedoc.
BouRoEy (Étienne), 7, rue Drouot, Paris IX. BO YER (Pierre), 17, rue de Metz, Toulouse (Haute-Garonne). BUJEAUD (André), Sainte-Hermine (Vendée). BURGUBURU (Germain-Paul), ye, 30, rue Hériard-Dubreuil, Bor-
deaux (Gironde). Poids monétaires, documents métrologiques. CASTAING (Roger), 25, avenue Auguste-Bracquemond, Sèvres
(Seine). CÉLORON DE BLAINVILLE (Paul), 3, rue Amand Louis, Vert-le-Petit
(S.-et-O.).
CERCLE NUMISMATIQUE D'ALSACE, 1, rue du Dôme, Strasbourg (Bas-Rhin).
COMTE CHANDON DE BRIAILLES , La Cordelière, Chaource (Aube). CHARNOZ (Pierre), 47, rue de Berri, Paris VIII.
CH ARVILHAT (D r Gaston), à Issoire (Puy-de-Dôme).
Mon. Gr., R. et de l'Orient latin.
DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE NUMISMATIQUE
MM. CHENU (Lt-Cel P.-A.), *, Chezal Benoît (Cher). Mon. F. r. et Sceaux matrices.
CHERONNET (Dr), 24, rue Thoré, Le Mans (Sarthe). CIÂNI (L.), 54, rue Taitbout, Paris IX.
CRÉPY (Max), 8, place des Trois-Villes, Marcq-en-Baroeul (Nord). DAVIDOVITCH (B.)-, 17, rue d'Hauteville, Paris X. DAYET (Dr Jean), rue de Besançon, Pont-de-Roide (Doubs). DucLos (Armand), 58, , rue de Paris à. Essonnes (Seine-et-Oise). Du MESNIL DU BUISSON (C te), 63, rue de Varennes, Paris VII. DupoNT (Camille), 4, rue Saint-François-de-Sales, Annecy (Haute-
Savoie) Mon. R., B. et F. r. DUQUÉNOY (Alfred), 30, rue Gambetta, Arras (Pas-de-Calais). Ecx. (D r), Riedesheim (1Iaut-Rhin). EMPEDOCLES (Grégoire), 34, rue de l'Acadéniie, Athènes (Grèce).
Mon. Gr. ESKELL (Eustace-L.), 30, Old Bromptan Rond, South. Kinsin-
gton Londres. S. W. 7. (Angleterre). FEUARDENT (Robert), 4, place Louvois, Paris II. FLORANGE (Jules), 17, rue de la Banque, Paris II. FORIEN (Jean-Georges), 18, rue Paul-Déroulède, Bois-Colombes
(Seine) Mon. d'ext. Orient GAUTHIER (Dr Octave), 6, boulevard Dubouchage à Nice (Alpes,
Maritimes).. Mon. G. F. r. et J. GÉRARD (Lucien), 55, rue Jean-Macé à Brest (Finistère). GROUPE NUMISMATIQUE DU COMTAT à Avignon (Vaucluse). GUILLER (Pierre), 21, rue de la Commanderie à Fontenay-le-
Comte (Vendée). HELO (Ch.), Villa Les Palmiers, La Forest-Fouesnant (Finistère). HEWLET (Lionel M.), Greenbank. Harrow-on-the-Hill, Middlesex
(Angleterre). (Membre à vie.) Mon. anglo-françaises. HIQUILY, Directeur des Contributions indirectes, 21, rue des Mur-
lins, Orléans (Loiret). JÉQUIER (Hugues), 2, . villa Niel, Paris XVII. JOUGLA (Mile Ant.), 88, rue Chèvre, Angers (Maine-et-Loire). JUNGFLEISCH (Marcel), 32, rue Saptieh, Le Caire (Égypte). LABOURET (Henri), ye, Conseiller à la Cour d'appel de Paris,
24, avenue du Petit-Chambord, Bourg-la-Reine (Seine)... J. LA CHAUSSÉE (C el ), O. *, 6, place Pasteur, Bayonne (B.-P.). LAFOLIE (Paul), 23, rue Chapon, Paris III.
VI LISTE DES MEMBRES
MM. LAGASSE (Maurice), 3, Place de la Madeleine, Paris VIII.
LALLEMANT (Jean), à Sommevoire (Haute-Marne). LAMOUROUX, 135, boulevard Haussmann, Paris IX. LEFÙBURE (Étienne), 65, avenue Ortolan, Toulon (Var). LEREüIL (Maurice), O.*, ; , Président de la Société d'Archéologie
et des Beaux-Arts de Chaumont, 12, rue de l'Odéon, Paris VI. LINARD (Pierre-Émile), rue du Bel-Air, Montgeron (Seine-et-
Oise). MACÉ (Dr Alex.-Julien-Charles), I., place de Verdun, à Guin-
gamp (Côtes-du-Nord). MARCHAND (Jean), archiviste paléographe, 3, rue Lincoln,
Paris VIII. MARTIN (Edmond), 48, rue de Château-Landon, Paris X. MAZARD (Jean), substitut du procureur de la République, 16,
place de l'Hôtel-de-Ville, au Havre (Seine-Inférieure). MICHEL-DANSAC (René), 24, rue de Verneuil, Paris VII. MILESI (François), villa Chantecler, Ault-Onival (Somme). MiNssiEux (Jean), 4, avenue Jules-Ferry, à Lyon (Rhône). MocuDA (Ludovic), Président du tribunal civil de Guingamp
(C.-du-N.). Mon., Méd., J. concernant la Bretagne. MORGAN DAY (William), 19, The Park Golders Hill, London
N. W. 11 (Angleterre). MOTTE (Georges), *, 69, boulevard de la République, à Roubaix
(Nord) Mon. F. r. MULLER-VANISTERBECK (Paul), 6, rue Jules-Lejeune, Bruxelles
(Belgique). MUSÉE DE LA VILLE DE METZ (Moselle). NAVILLE (Lucien), Couches, Canton de Genève (Suisse). Nuss (Modeste), 68, rue des Vosges, à Strasbourg. NUSSBAUM (Hans), Bahnhofstrasse, 32, Zürich (Suisse). PAGE (Alfred), 16, rue Milton, Paris IX. PARUCK (Furdoonjee D. J.), Gool. Mansion, 141 Tardeo, Bombay
7 (Indes Anglaises). PÉLOT (D r), 2, rue de l'Hôtel-de-Ville, à Montbéliard (Doubs). PERRET (Victor), 30, rue de la Villette, Paris XIX. PIERFITTE (Georges), 1, rue du Poids-de-l'Huile, Toulouse (H.-G.). PONROY (Henri), *, 21, rue Coursarton, Bourges (Cher). RAIMBAULT (Maurice), Archiviste-adj. e. r. du département des
Bouches-du-Rhône, Conservateur du Musée Arbaud, rue
DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE NUMISMATIQUE VII
du Quatre-Septembre, 2 a , Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). m., M., J. de la Provence, du Comtat et d'Orange.
MM. RATTO (Mario), 77, rue de Richelieu, Paris II. RAVEL (0.), 7, boulevard de Lorraine, Pointe Rouge, Marseille
(Bouches-du-Rhône) Mon. Gr. et R. RITTER (Maurice), 8, Place Voltaire, Narbonne (Aude).
Mon. Gr., IL et F. RIVES (Lucien-Louis), 6, rue Victor-Hugo, Périgueux (Dordogne). SAVALLE (Raymond), 140, rue du Château, Boulogne-sur-Seine
(Seine). SC FLEFFER (Claude), Conservateur-adjoint du Musée des Antiqui-
tés nationales, Château de Saint-Germain-en-Laye (S.-et-O.). SCHULMAN (M.), Keizersgracht 448, Amsterdam-C (Hollande). SENGER (Agénor Hugo DE), pasteur .de l'Église réformée évangé-
lique, à Beaumont-lès-Valence (Drôme). SÉitù (CLJ. DE), O. ; , 22, rue de Brissac, Angers (M.-et-L.). SHEPARD POND, Président de la Société de Numismatique de
Boston, 141, Longwood Avenue, Brookline Mass. (U.S.A.). Mon. et Méd. F. de la Révolution et de l'Empire.
SOULLARD (Marcel), 14, rue Crébillon, Nantes (Loire-Inférieure). SPINK (MM.), 5-7, King Street Saint-James's, Londres, S.W.I.
(Angleterre). SPOERRY (Henri), ye, 1, rue du Sundgau, à Mulhouse (Haut-Rhin).
m. Gr. F. f., de l'Orient latin des Indes et d'Extrême-Orient. THIBAULT (Pierre), 18, rue Sainte-Adélaïde, Versailles (S.-et-0.), THIRIOT (Louis), 23, rue Raymond-Poincaré, Commercy (Meuse). THOULET (0.), 37, rue de la Gare, Saint-Brieuc (Côtes-du-
Nord) Mon. F. TOURRES (A.), 15 bis, rue du Maréchal-Joffre, Le Havre (Seine-. Inférieure). TRASSAGNAC (Dr), Médecin-général, 0. Ye, 15, quai Voltaire,
Paris VII Mon. Gr., R., G. et F. r. •
TRAVAILLEUR (Paul), 27a, rue du Contrat-Social, Rouen (SA.). TRICOU (Jean), 90, quai Pierre-Seize, Lyon (Rhône). VASSY (Albert), Conservateur du Musée Archéologique de Vienne
(Isère). VERRET (Pierre), le Donjon, Suresnes (Seine). VIAN (Carlo), huissier, 7, rue A.-de-Pontmartin, Avignon (Vau-
cluse) Mon. R. G. F. r. et f. (Avignon et Orange). Ir
VIII LISTE DES MEMBRES
MM. VILLEFAIGNE (J DE), 1, rue Delaizement, Neuilly-sur-Seine (Seine), VISART DE BOCARMÉ (Albert), 18., rue Saint-Jean, Bruges (Belgique).
Méd., J. hi s toriques et méreaux des Pays-Bas, Méd. artistiques • modernes. Poids monétaires.
• WEBER (Jean), 1, rue du Dôme, à Strasbourg.
ANCIENS PRÉSIDENTS •
Vte DE PONTON D'AMÉCOURT. - V te J. DE BOUGÉ, 1889. — A. DE BELFORT,
1890-91. — E. CARON, 1892. — M. DE MARCHÉVILLE, 1893-4, 1900-01. — P. BORDEAUX, 1895-96-97, 1905-06. — Comte de CASTELLANE,
1898-99, 1902 et 18-19. — Adrien BLANCHET, 1903-04 et 11. — Com-mandant BABUT, 1907-08, 12-13. — SUDRE, 1909-10. — Ce' ALLOTTE DE LA FUYE, 1914-15, 20-21. — A. DIEUDONNÉ, 1916-17. — A. Bou-- CLIER, 1922-23. — Docteur J. BAILHACHE, 1924-25 et 32. — R. RICHEBIl, 1926-27. — Ph. MORICAND, 1928. — Général CAZALAS, 1929-30 et 1937-38. — CH. PRIEUR, 1931. — J. COUDURIER DE CHASSAIGNE, 1933- 1934. -- A. DE BARY, 1935-1936. — Henri ROLLAND, 1938-1940.
BUREAU 1941-1942
M. Adrien BLANCHET, membre de l'Institut, président. — M. Jean BABELON, conservateur au département des Médailles et Antiques, vice-président. — M. P. LE GENTILHOMME, du Cabinet des Médailles, secrétaire. — Mile Josèphe JACQUIOT, du Cabinet des Médailles, trésorière. — MM. BAILLE, CHANDON DE BRIAILLES, et P. LAFOLIE,
membres du Conseil.
PRIX DE NUMISMATIQUE FONDÉ PAR Mme Vve BABUT •
Une fondation faite en souvenir du commandant A . Bahut permet à la Société française de numismatique de décerner un prix biennal, d'une somme qui ne saurait être inférieure à mille francs, à un auteur de nationalité française, membre honoraire, titulaire ou correspon-' dant de la Société, pour un livre ou mémoire sur notre numisma-tique nationale; ancienne ou moderne, publié dans les deux années précédant le concours. Exceptionnellement, le prix pourra être décerné à un travail dactylographié.
Le prix Babut, aurait dû être décerné pour la troisième fois en juillet 1940.
PROCÈS-VERBAUX DE L'ANNÉE 1941
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 12 JUILLET.
Ont été élus membres du bureau :
Président : M. Adrien Blanchet, membre de l'Institut, Directeur de la Revue Numismatique;
Vice-Président : M. Jean Babelon, conservateur du département des Médailles, Directeur de la Revue Numis-
matique; Secrétaire : M. le D' Longuet, médecin lieutenant-colo-
nel au Val-de-Grâce ; Trésorière : Mlle Josèphe Jacquiot, du cabinet des
Médailles; Bibliothécaire : M. Baille, du Musée Carnavalet ; Membres du Conseil : le Comte Chandon de Briailles ;
M. Lafolie. MM. Michel-Dansac et Marchand présentent leur candi-
dature comme membres correspondants de la Société.
M. Dieudonné fait la communication suivante au sujet de la fleur de lis :
« C'était l'emblème de la Vierge ; cela est prouvé par les monuments byzantins (Dictionnaire de dom Cabrol). Diverses monnaies féodales portent la fleur de lis, et c'étaient celles de cités consacrées à Notre-Dame : Cler-mont-Ferrand, Strasbourg, Florence (où elle a une autre forme) ; à Lille, à Bruges, il semble qu'on l'adopta dans la même intention.
X PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
« Quant à la royauté, nous ignorons pourquoi elle s'attri-bue cet emblème ; cherchons du moins à quelle date. Le tombeau de Frédégonde, qui en donnerait le premier exemple, ne remonte pas à son époque, et les fleurons des premiers rois sur leurs sceaux ne sont pas caractéristiques (Trésor de Numismatique), pas même celui de Robert C'est sous Louis VI, à Dreux, que nous rencontrons d'abord la fleur de lis sur une monnaie, mais à base tron-quée, et c'était peut-être un emblème local. C'est le sceau de Philippe-Auguste sur lequel la fleur de lis apparaît à titre d'emblème royal et, sur son contre-sceau, avec l'ornemen-tation de base que nous lui connaissons.
On se demandera si Louis VII, près de désespérer d'avoir • jamais un héritier,• n'avait pas fait quelque - voeu. à la Vierge, analogue à celui de Louis XIII, et adopté à cette occasion la fleur de lis, lorsque naquit si tardivement Philippe-Auguste, dénommé pour ce fait, comme Louis XIV, Dieudonné, mais aucun chroniqueur ne fait la moindre allusion à pareil événement.
« Louis VIII adopte sur son sceau une fleur de lis où les pendants sont surmontés d'un pétale ouvert, vu de face, et saint Louis orne. la sienne de deux étamines intercalaires. C'est alors, sous saint Louis, que la monnaie s'empare de la fleur de lis sans les étamines, et ce modèle reste constant.
« En somme, au xne siècle, la fleur de lis conquiert la vogue, soit par l'extension du culte de la Sainte Vierge, soit par le prestige croissant de la royauté capétienne. Des fleurons qui jusqu'alors étaient assez indéterminés, comme en Angleterre, se tournent en fleurs de lis.
« La fleur de lis a pris quelquefois la place de l'( A) dans le groupe A(.) (le Mansois de Charles Pi»), mais ce n'est pas une raison pour voir dans cet ( A) retourné l'origine de la fleur de lis. »
DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE NUMISMATIQUE XI
M. le Dr Longuet présente : 1° un exemplaire du double tournois de Charles VII, figuré dans le t. II du Manuel de MM. Blanchet et Dieudonné, et qui semble le seul exemplaire connu.
2° Un hardi de François ter , signalé par Hoffmann, non retrouvé jusqu'à maintenant.
3° Deux pièces d'Eudes de Blois, comte de Champagne, frappées sà Reims, déjà décrites- par F. de . Saulcy dans la Revue Numism. (1834, 36) et dans Poëy d'Avant.
M. Blanchet a fait une communication sur les jetons de Garcia Lopez de Boncevails. (Voy. plus haut, R. N., p. 69.)
SÉANCE DU 2 AOUT 1941.
Étaient présents : MM. Adrien Blanchet, président ; Jean Babelon, vice-président ; D e Longuet, secrétaire ; Baille, bibliothécaire.
M. Bahelon annonce la trouvaille de monnaies gauloises du type armoricain, près de Rennes.
M. Dieudonné fait la communication suivante : « Qui ne se souvient des brillantes conférences du Col-
lège de France dont M. Tourneur, conservateur en chef de la Bibliothèque royale de Belgique, nous a honorés et charmés en 1938? I1. a su donner du piquant aux matières les plus ardues et en a composé un savoureux récit' ; mais je ne saurais souscrire sans réserves à ses opinions. C'est ainsi qu'il a présenté, de la charte de Philippe-Auguste de 1202, relative à la monnaie de Tournai, un commentaire sur lequel j'ai des observations à développer.
« L'évêque, propriétaire de cette monnaie, l'avait cédée à forfait à la famille Evrard des Vignes ou de la Vingne, qui
XII PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
frappait au nom du prélat, et cet Evrard des Vignes III, châtelain, était l'homme lige du roi de France (homo nos-
ter) 2 , qui fit avec lui un contrat par lequel le souverain se réservait le tiers des bénéfices de la fabrication 3 .
« Nous avons là-dessus trois clauses à examiner. « I. Currat ad medietatem argenti ou Faciet fieri ad
medietatem argenti (dans la seconde charte). M. Tourneur interprète : à moitié de l'argent [du roi], c.-à-d. du Parisis, soit pour une Maille parisis. Nous ne croyons pas que celte condition préliminaire ait pareille signification.
« D'abord, on ne lit pas a,rgentei, à moitié de la pièce d'argent, et, lirait-on argentei, il paraîtra étrange que le Parisis, quelquefois qualifié figer, noir 4 , soit ici appelé d'argent de préférence à l'Artésien, son égal, pièce cou-rante de Flandre, qui, plus menue, paraissait à l'oeil plus riche de fin. Reste à traduire : à moitié de l'argent Imon-nayé du roi], mais l'argent monnayé ne représente pas ipso facto une pièce déterminée, et parler d'une espèce à fabriquer comme « demie d'argent monnayé » est assez in-correct.
« De plus, je ne crois pas que argentum ait jamais dési-gné, même en Flandre à cette époque, l'argent monnayé. M. Tourneur cite plusieurs textes : I° marca, argenti paga-
menti mmete Flandrie. Je traduis : marc d'argent fin payé en monnaie de Flandre. 2° dimidia marca de argent() Flan-
drie, c.-k-d. un demi-marc d'argent de Flandre, argent tout voisin du fin comme sera l'argent-le-roi et en tenant lieu 5 . Argentum tout court, c'est l'argent fin ou considéré comme tel, au moyen âge 5a .
Donc « que. la monnaie courre à moitié de l'argent fin », c.-à-d. pour son demi-poids de fin, dans les contrats.
« Ce n'est pas à dire que, par cette clause, le roi n'ait pas voulu assimiler la pièce projetée au Denier parisis ou à la
DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE NUMISMATIQUE XIII
Maille (nous verrons lequel des deux). Pareille condition leur est attribuée dans une charte de Louis VI pour Com-piègne", et il est probable que, si nous possédions l'ordon-nance de Philippe-Auguste pour sa monnaie de Paris ou d'Arras, nous rencontrerions la même expression, soit que l'abaissement de la loi de 6 den. à 5 deniers 7 n'ait pas dû exclure cette équivalence dans la pensée du souverain, soit que la clause ait été maintenue par habitude. Nous sommes à une époque où l'argent fin était, sinon d'un emploi cou-rant, du moins fréquemment encore confronté avec le numéraire.
« II. Exiet de ferris per XXX Solidos ad parvam mar-
cham Flandrie. Ceci, c'est le. poids de la monnaie à fabriquer. On est généralement assez d'accord sur le chiffre à attribuer au petit marc de Flandre 8 . Disons : '185 gr. 96. A diviser par 30 Sous ou 360 Deniers, on obtient à la pièce 0 gr. 50. Ce poids convient assez à une Maille parisis, observe M. Tour-neur. Des considérations de mon article de la Bibliothèque
de l'École des Chartes de 1920, résulterait plutôt pour celle-ci 0 gr. 60
« III. Tenebit de lege quatuor sterlingorum (ou sterlin-
gos) marca. Voici incontestablement le titre ou loi. Elle ne s'exprime pas directement, comme l'a cru M. Tourneur, mais ainsi que l'a pressenti Guilhiermoz, par voie de sous-traction. La « tenue de loi », en effet, est la retenue sur la loi. « 23 Karats et '1 Karat de tenue » (sur 24), dit un texte, de l'Écu d'or. De même, 4 esterlins de retenue, c'est 6 es-terlins de loi, puisque les esterlins étaient des dixièmes (comme les deniers français des douzièmes) 9 a. Quatuor
sterlingorum ou quatuor sterlingos tenebit, c'est tout un, parce que dans la première formule on sous-entend dena-
rios avec lequel sterlingorum, parisiensium, etc. est tou-jours au génitif 10.
XIV PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
« Ce titre supérieur au demi-fin, tandis que celui de la Maille de Paris et d'Arras lui est inférieur, rachète la dif-férence de poids de la pièce avec celle du roi et la rapproche pour l'alliage de l'Artésien ".
« Au lieu de 0 gr. 60 et 5 deniers ou douzièmes, soit 0,60 x5/12 0 gr. 25 de fin, on a, 0,50 x6/10=0 gr. 30.
« Pourquoi Philippe-Auguste a-t-il choisi la Maille et non le Denier comme modèle pour la monnaie de Tournai ? C'est que telle était dans la coutume la valeur intrinsèque de cette espèce locale ; seulement, il a voulu que la pièce d'Evrard fût un peu plus chargée de fin, pour conserver à l'étalon de sa devise, sur le pied de la même valeur de compte, un avantage que la supériorité de rayonnement d'une part, le faible débit de l'autre, ne pouvaient manquer de confirmer.
« Le résultat, et ici nous sommes d'accord avec M. Tour-neur, devait être l'arrêt escompté à brève échéance de cette fabrication »
M. Venet présente les billets de - nécessité de 100 fr., 50 fr. et 10 fr. émis par la commune Salins du Jura.
M. Adrien Blanchet fait la communication suivante :
« En novembre 1940, à Alger, au cours des travaux de transformation du quartier de « la Marine », on a trouvé les débris d'un vase et environ 150 pièces de plomb et 4 de bronze, qui y étaient contenues. MM. Leschi et Cantineau ont envoyé à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres une communication que le Bureau de cette compagnie me chargea d'examiner. Des renseignements complémentaires et un envoi de 5 pièces de plomb, par l'intermédiaire du Ministère de l'Instruction publique, à Vichy, m'ont permis de faire quelques remarques personnelles, que j'ai commu-
DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE NUMISMATIQUE XV
piquées à la même Académie, après avoir lu le mémoire de MM. Leschi et Cantineau.
Contrairement à l'idée de ces érudits, le type des mon-naies étudiées n'est pas sans analogue, du moins - pour la tête de déesse couronnée d'une sorte de bandeau plat, avec voile, tête couronnée par une Victoire qui plane devant le visage. C'est certainement l'imitation des monnaies de bronze de Cossyra (auj. Pantelleria), île qui fut occupée par. les Romains, vers 217 av. J.-C.
Quant au entièrement nouveau, il porte une inscrip- tion punique, où, malgré la présence de deux lettres anor-males (surtout l'une, un iod), on peut lire, comme l'a fait. M. Cantineau, Ikosim, très voisin du nom latin d'Alger, Icosium.
J'ajoute que le monnayage punique de Cossyra, étant évidemment antérieur au monnayage latin, aux mêmes. types, mais avec COSSVRA, on a un jalon chronologique pour la date des pièces trouvées à « La Marine ».
J'écourte mes observations. Toutefois, je dois en résumer-encore deux. C'est d'abord sur le type du dieu figuré au dont la coiffure, formée de trois plumes (?), ou ornements. analogues, peut être comparée à celle du Cabire (?) des. monnaies d'Ebusus (Iviza) ; les plus anciennes de celles-ci portent une inscription punique, dont les caractères doivent être à peu près contemporains de ceux des pièces d'Alger.. Enfin la nature du métal amène un rapprochement, utile pour l'époque de l'émission, avec les pièces de plomb, si nombreuses des rois numides, qui ont été émises depuis 212 av. J.-C. jusque vers le milieu du 11 e siècle avant notre ère. »
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
SÉANCE DU 6 SEPTEMBRE 1941.
Étaient présents : MM. Adrien Blanchet ; Jean Babelon ; D r Longuet ; M"e Josèphe Jacquiot ; M. Baille.
M. Blanchet expose diverses questions administratives, concernant la marché de la Société et de la Revue Numismatique.
Le Dr Longuet présente .un coin de l'écu de Thann, daté de 1556, et la série ,des Médailles frappées annuellerrient par le Cercle numismatique d'Alsace avec les coins origi-naux existant dans le pays (Thann, Mulhouse, Colmar, Haguenau).
M. A. Blanchet fait la communication suivante :
« Dans le Manuel Numismatique (t. I, 1912, p. 151), j'ai signalé un certain nombre de coins monétaires romains, en m'attachant surtout à ceux qui ont. une origine cer-taine.
Je ferai aujourd'hui une addition, qui, bien que moins précise, présente. cependant un petit intérêt, parce qu'il s'agit d'un empereur dont je ne connais pas d'instrument monétaire.
D. Martène et Durand, dans leur recueil, si instructif à divers titres (Voyage lift. de deux Bénédictins, 1724, Ire partie, p. 147), ont signalé, qu'il y avait, à Dijon, dans le Cabinet de Monsieur le Conseiller de Requelaine, « un ancien coin de Néron., qui *est fort estimable ».
Peut-être ce rappel aidera-t-il à faire retrouver le précieux petit monument? »
M. Adrien Blanchet fait une seconde communication
« En 1937, mon regretté ami, Ernest Bertrand, de Dijon,
X VI
DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE NUMISMATIQUE XVII
qui fut membre titulaire de notre Société, me communi-qua le moulage d'une pièce, vue chez un marchand, qui la considérait comme d'argent et en voulait un prix exagéré. J'avais donné mon avis à mon ami, et j'avais laissé le mou-lage de côté, avec l'intention de le communiquer à la Société. Beaucoup de circonstances m'ont fait différer mon projet que je réalise aujourd'hui seulement .
La pièce présente une imitation d'un sicle, avec inscrip-tions hébraïques, dont certaines lettres sont déformées, mais dont la lecture n'est cependant pas douteuse. En voici la transcription en lettres romaines et la traduction : Shekel Israel, Calice, et Jerushalaim ha-Kedoshah, Rameau. « Sicle d'Israel » ; « Jérusalem la Sainte ».
Comme le fait est fréquent dans des imitations analogues du sicle, le module est supérieur à celui de la monnaie juive. Ce qui est particulier à la pièce que je vous présente, c'est qu'elle est frappée sur un sesterce de Trajan, ainsi que le démontre les restes d'une légende extérieure, bor-dànt la première face de la pièce juive : IMP CAES NERVA TRAIA.... le type primitif est indistinct ; le mou-lage est d'ailleurs incomplet pour ce côté, car il a quatre millimètres de moins que celui de l'autre face. J'ai dit que
le flan était celui d'un sesterce (de bronze). En effet, si la pièce a été signalée comme étant d'argent, c'est qu'elle devait être fortement argentée. La légende de la monnaie
XVIII PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
romaine est tellement caractéristique que l'on ne saurait croire qu'un cistophore d'argent aurait été ainsi surfrappé ; le module inférieur de cette espèce monétaire s'oppose d'ailleurs à l'hypothèse.
Cette pièce curieuse a peut-être passé pour un denier de Juda ; on peut la considérer comme fabriquée au cours du XVIe siècle ».
1. Rev. belge num., 1939, pp. 13-23. 2. Nous ne savons si Evrard était d'ores et déjà l' « homme du roi » par suite
de circonstances antérieures, ou s'il prêta serment à cette occasion, ou s'il n'est pas dénommé ainsi simplement parce que le roi exerçait sur l'évêque de Tournai et ses vassaux un pouvoir comtal.
3. On a dit que ce tiers était la part de la commune, à laquelle Philippe-Auguste se serait substitué, mais cette présomption n'a jamais été confirmée.
4. A. Hermand, Hist. monét. de l'Artois (vers 1200-1210), p. 213. 5. Sur l'argent de Flandre, voy. H. Hall, The red Book of the Exchequer,
pp. 979 et 995. 5a. Voyez par ex. l'ordonnance de 1204 sur le change des monnaies en Nor-
mandie. 6. Notre chronologie dans Rev. num., 1929, p. 211, n° 16. Sur la réclamation des
gens de Compiègne, le roi renonce à établir un atelier monétaire dans cette ville, mais il se réserve le droit d'y faire circuler sa monnaie, venue de Paris ou d'ail-leurs, « à demie d'argent fin », c'est-à-dire à calculer sur le pied du demi-fin dans les contrats.
7. Mon article de la Bibi. de l'Éc. des Ch. de 1920. Pour considérer le rapport entre le marc de fin et l'argent monnayé, il n'y a pas lieu de se demander si on pratiquait à la base dès cette époque l'argent-le-roi ou son similaire l'argent esterlin, parce que pareil usage aurait affecté également le lingot dit au fin et la loi de l'espèce.
8. Calculs de Prou, Guilhiermoz, Tourneur. 9. C'est la moitié du poids du Denier, si on admet, sauf témoignage contraire,
que le titre était le même pour la Maille et pour le Denier ; mais, si la Maille était à un titre inférieur (et le contraire n'a jamais été pratiqué), son poids n'en devait être que plus fort.
9». Saulcy, Documents, t. I, p. 116 ; conversion de 4 esterlins de loi en 4 d. 19 g. 1/5, dans le rapport 10 à 12.
10. Mon art. Denier parisis et Denier tournois, dans Moyen âge, 1938. • 11. Le Denier artésien, équivalent du Parisis, avait un titre supérieur et un poids moindre. Voy. le bail de Robert II dans A. Hermand.
12. Dans une des clauses accessoires, la leçon non poneremus ibi plus quam quod ibi caperemus est une lecture due à Prou. Le texte porte : quam ibi q (sans abréviation ou avec abréviation incertaine) (donc : quam ou quod?) caperemus. Prou ne donne d'autre raison à cette inversion que l'inattention du copiste. On pourra aussi supposer que le sens était : quam illam [partent], quam ibi capere-mus. Illam disparaît d'après les lois de la latinité, et la rencontre choquante des deux quam incite le rédacteur à déplacer ibi.
r .
VELIC t;
\s' r .P
TABLE DES PROCÈS-VERBAUX
DE LA SOCIÉTÉ, FRANÇAISE DE NUMISMATIQUE
POUR 1941.
Liste des membres Prix de Numismatique. VIII BABELON (Jean). Trouv. de m. gauloises xi BLANCHET (Adrien). Jeton
M. de Cossyra et d'Alger. xiv Coin de Néron xvi Sesterce de Nerva surfrappé au type
d'un sicle (xvie s. ?) xvi DIEUDONNL' (A.). Sur la fleur de lis ix
Sur les monnaies à Tournai xi
LONGUET (D r). Monnaies diverses xi
Écu de Thann xvi VENET. Billets de Salins du Jura xiv
MACON, PROTAT FRÎMES, IMPRIMEURS. - MCMXLII.