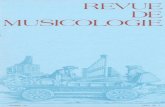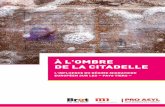De l’incastellamento à l’inecclesiamento. Monachisme et logiques spatiales du féodalisme
Les logiques professionnelles des conseillers en communication politique en France: entre travail de...
Transcript of Les logiques professionnelles des conseillers en communication politique en France: entre travail de...
UNIVERSITÉ SORBONNE NOUVELLE – PARIS 3
UFR ARTS ET MÉDIAS
INSTITUT DE LA COMMUNICATION ET DES MÉDIAS
Mémoire de Master 2 Recherche
en Sciences de l'Information et de la Communication
LES LOGIQUES PROFESSIONNELLES DES CONSEILLERS
EN COMMUNICATION POLITIQUE EN FRANCE :
ENTRE TRAVAIL DE L'OMBRE
ET INSTITUTIONNALISATION
Camila MOREIRA CESAR
Sous la direction de M. Jamil DAKHLIA15 juin 2015
REMERCIEMENTS
Je souhaite remercier le Conseil Régional Île-de-France, de m'avoir permis de
financer mon séjour en France et de poursuivre ma formation universitaire.
Je tiens à remercier chaleureusement Monsieur Jamil DAKHLIA, de m'avoir guidée,
accompagnée et soutenue tout au long de ces deux ans et de faire toujours confiance à mon
travail. Ses contributions ont été très enrichissantes et déterminantes à cette étude.
Les enseignants de l'Institut des Arts et Médias à l'Université Sorbonne Nouvelle, qui
m'ont apporté d'autres perspectives à l'égard de l'univers de la Communication et
l'Information.
Ma famille, pour me soutenir et m'encourager à suivre mes ambitions personnelles et
professionnelles. Je vous serai toujours reconnaissante. Et Antoine Martin dit Neuville, pour
sa compréhension et patience.
Mes camarades de l'Université Sorbonne Nouvelle, spécialement Bárbara NÓR,
Laura GERTZ, Camila SALLES et Marina TRAVASSOS, et aussi Larissa SANTOS et Elis
DE AQUINO, de m'avoir soutenue et de rendre cette tâche plus facile. Vous avez été
indispensables pendant l'élaboration de cette recherche.
Mes amis brésiliens, spécialement Mônica CARVALHO, Carina DALSOTO, Bruno
GUIMARÃES, Pedro BRITES, Athos MUNHOZ, Francisco GUAZZELLI et Eduardo
OSORIO, qui malgré la distance ont toujours été à mes côtés.
Finalement, ma pensée va à Pierre-Emmanuel GUIGO, pour ses précieux conseils,
ses séminaires sur la Communication Politique et son intérêt pour mon mémoire.
2
SOMMAIRE
INTRODUCTION...................................................................................................................5
1 LA POLITIQUE MÉDIATISÉE.......................................................................................11
1.1 Les médias comme instance de légitimation des discours............................................12
1.2 L'émergence d'un espace public médiatisé....................................................................16
1.3 L'espace public à l'ère numérique : quelques remarques..............................................19
2 CE QUE VEUT DIRE « COMMUNICATION POLITIQUE ».....................................23
2.1 Pour une définition d'une notion de Communication Politique....................................24
2.2 Bref aperçu historique...................................................................................................26
2.3 La recherche en Communication Politique en France..................................................28
2.4 La Communication Politique experte en France : quelle place dans
le champ politique ?...........................................................................................................31
A) Un métier en voie de professionnalisation ?.............................................................33
B) Le développement d'une expertise...........................................................................37
C) La quête d'une légitimité professionnelle.................................................................39
2.5 Le discours politique contemporain : innovation ou détérioration ?.............................43
A) Le rôle du langage....................................................................................................44
B) Communiquer ou « mentir vrai » en politique ?......................................................47
3 LES CONSEILLERS EN COMMUNICATION POLITIQUE
EN FRANCE EN 2015 : QUELLES IDENTITES ET QUELLES
LOGIQUES PROFESSIONNELLES ?...............................................................................50
3.1 Méthodologie................................................................................................................51
Les apports de l'analyse du discours et de la sociologie compréhensive.......................52
3.2 Présentation de l'échantillon..........................................................................................54
3.3 La Communication Politique vue par les communicants :
quelles représentations ?.....................................................................................................60
A) Communicant politique : un profil type ?.................................................................61
B) La valorisation d'une attitude distanciée par rapport au politique............................64
3
C) L'image de stratégiste...............................................................................................69
D) L'image d'expert.......................................................................................................72
E) La prédominance d'une performance démocratique des
pratiques en communication politique............................................................................76
F) Médias et Politique : le « couple maudit »................................................................81
G) La communication politique comme un outil d'harmonisation
entre discours voulu et discours perçu............................................................................86
H) L'espace social comme vecteur de professionnalisation
de la Communication Politique......................................................................................90
CONCLUSION …................................................................................................................. 94
REFERENCES …............................................................................................................... 105
ANNEXES.............................................................................................................................112
Entretien 1 : Philippe Moreau-Chevrolet..........................................................................113
Entretien 2 : Ludivine Moles.............................................................................................116
Entretien 3 : Nicolas Baygert............................................................................................119
Entretien 4 : Robert Zarader..............................................................................................123
Entretien 5 : Jean-Luc Mano.............................................................................................126
Entretien 6 : Anne Dorsemaine.........................................................................................130
Entretien 7 : Benjamin Guy...............................................................................................132
Entretien 8 : Interviewé 1..................................................................................................135
Entretien 9 : Gaspard Gantzer...........................................................................................137
4
INTRODUCTION
De nombreuses études ont déjà mis en avant les changements profonds apportés par
les médias de masse depuis le 19e siècle. L'instance médiatique joue un rôle central dans
les démocraties modernes : a priori, c'est à travers les médias que les intérêts et discours
des différents acteurs sociaux, parfois contradictoires, deviennent visibles en s’inscrivant
dans le débat public. Par leur capacité à influencer les agendas publics et
gouvernementaux, les relations entre les différents groupes sociaux et l'opinion des
citoyens sur des sujets spécifiques, les médias occupent une place plus que significative
dans le fonctionnement des sociétés contemporaines.
En construisant une nouvelle conception du « public » et de la sociabilité, les
médias affectent directement l'exercice de l'activité politique dans toutes ses dimensions.
D'abord, il faut souligner que l'accès à l'information et aux actions politiques n’est
quasiment possible que par les médias – démarche toujours soumise aux particularités des
différents groupes médiatiques et à leurs spécificités de production. Cette réalité s'est
imposée à la sphère politique, en la conduisant à s’adapter aux dispositifs informationnels,
où maîtriser la communication et le modus operandi des instances médiatiques est devenu
incontournable pour les agents du pouvoir. Les mutations pragmatiques de l'activité
politique conduisent alors à un changement structurel, par lequel l'intégration de nouveaux
acteurs, tels les conseillers de communication, les publicitaires ou les spécialistes des
instituts de sondage, figure une nouvelle étape de la politique moderne.
En considérant la sphère médiatique et la sphère politique comme deux pôles parfois
opposés mais entretenant une relation de rétroaction marquée alternativement par la dispute
et la concertation permanentes, ce mémoire a pour objectif d'approfondir le débat autour des
rapports de force existant entre ces deux domaines et d'éclairer les transformations du jeu
politique à partir d'une perspective communicationnelle. Ainsi, nous allons nous pencher sur
le poids de la communication politique dans la vie publique actuelle, en mettant l'accent sur
une catégorie d'acteurs qui participent à l'élaboration des stratégies et des actions qui y sont
mises en place : les conseillers en communication politique.
Certes, les relations complexes entre médias et politique soulèvent des questions qui
ne sont pas inédites. Rappelons l’attachement au pouvoir politique de la presse des origines1,
1 Durant le 19e siècle, la conception de la presse était étroitement liée aux rapports entre les journaux et lapropagande politique et ses professionnels étaient considérés comme des fanatiques, des démagogues oudes écrivains sans aucune importance. La reconnaissance de l'activité journalistique au sein des sociétés
5
héritage dont les effets sont perceptibles jusqu'à nos jours. Mais quels sont les enjeux de la
médiatisation toujours plus poussée de la politique, et de la visibilité qui en découle ? A quels
défis doivent faire face les agents de l'instance politique dès lors que les logiques médiatiques
favorisent l'image avant tout ? Dans quelle mesure les évolutions du paysage médiatique
induisent-elles une professionnalisation de la communication en politique ? Quels sont les
intérêts et les paramètres favorisant ou au contraire freinant cette professionnalisation ? Et
quels sont les enjeux d’une telle professionnalisation en termes démocratiques, à l’heure d’un
désaveu de la classe politique ?
Assurément, ces questionnements appellent une recherche plus approfondie encore
pour rendre compte de façon satisfaisante de tous les enjeux qui les sous-tendent. Ainsi, avant
de nous lancer dans une étude comparative entre la France et le Brésil sur
l'institutionnalisation de la communication politique qui fera l’objet d’un doctorat à partir des
pratiques et des profils des communicants politiques, nous avons décidé de mener une étude
à titre exploratoire sur le cas français.
Ainsi, au lieu d'explorer les conséquences possibles d'une professionnalisation de la
communication politique, il nous semble plus pertinent aujourd’hui de nous pencher sur les
indices qui suggèrent un tel processus. Notre but a été donc celui de mettre en cause le
paradoxe qui entoure la communication politique contemporaine, où l'efervescence de
l'environnement informationnel et l'évolution du propre monde social exigent une innovation
en permanence des pratiques communicationnelles dans ce domaine. Néanmoins, en même
temps qu'une logique de professionnalisation de la communication en générale s'impose
comme un aspect incontournable, cela fait objet de critiques quand il s'agit du champ de la
communication politique, travail qui doit rester discret, notamment en France. En partant
d’une perspective épistémologique de la sociologie compréhensive, nous avons cherché à
identifier quelles conceptions les acteurs développent-ils au sujet de leur propre action, c'est-
à-dire, quelles représentations font-ils de ce qu'ils font et la façon dont ils font. Ce dernier
point doit rendre plus nettes à quelles dimensions de la communication politique –
pragmatique, symbolique ou structurelle, pour reprendre la taxinomie proposée par Jacques
Gertslé2 – leur vision de leur activité renvoie-t-elle.
démocratiques a eu lieu en 1828, quand le député du Parlement anglais, McCaulay, s'est tourné vers le côtéoù étaient les journalistes et les a baptisés de "Quatrième Pouvoir". Dans le nouveau scénario de ladémocratie, sous-tendu par le principe du "pouvoir contrôle le pouvoir", la presse deviendrait le quatrièmedevant les autres : l'Exécutif, le Législatif et le Judiciaire. Dans le cadre des théories démocratiques,l'opinion publique occupait une place centrale, et c'est justement cela que va favoriser la presse (lejournalisme) : promouvoir son importance en tant qu'institution. (Traquina, 2008).
2 GERSTLÉ Jacques, La communication politique, Armand Colin, Paris, 2008.
6
Différentes pistes de réflexion ont orienté notre travail. Elles peuvent être résumées
dans quatre points : i) les médias ont amené à une reconfiguration de la relation entre
gouvernants et gouvernés ; ii) le pouvoir de légitimation des discours de la sphère médiatique
se pose comme un défi pour la politique contemporaine ; iii) les principes démocratiques et
républicains sont à la base des pratiques de la Communication Politique et iv) les
communicants politiques possèdent des formations, intérêts et pratiques très proches, ce qui
irait dans le sens de leur professionnalisation, dans la mesure où se produirait une
homogénéisation des profils, des identités et des routines les concernant.
Pour vérifier nos hypothèses, nous avons sélectionné un échantillon de neuf
personnes qui travaillent / ont travaillé dans le secteur politique en France. L’objectif ne
pouvant être celui de l'exhaustivité ou de la représentativité dans les délais impartis, il s'est
agi de rendre compte de la plus grande diversité possible dans les profils de nos
interlocuteurs à partir de leur parcours, leur formation, leur métier actuel et leur rapport avec
la communication. Notre intention a été de rencontrer des communicants possédant une
solide connaissance de la sphère médiatique et appliquant leur savoir-faire au profit des
hommes et femmes politiques dont ils s'occupent. Après avoir pris contact avec d'autres
chercheurs qui s'intéressaient aux relations entre médias et politique, nous avons élaboré une
liste de noms significative, en respectant ces critères. Malgré certains obstacles pour les
joindre, nous avons réussi à nous entretenir avec neuf interlocuteurs. En s’appuyant sur un
guide d'entretien, nos questions devaient nous permettre d’identifier et de comparer les points
de vue, notamment sur trois axes d'intérêt majeurs : les rapports entre médias et politique en
France, l'importance de la communication (notamment en termes de conception et de
performance des pratiques en communication politique), l’identification de ses
transformations les plus récentes et de ce qu’elles impliquaient pour les conseillers en
communication politique. Les détails concernant les démarches mises en œuvre dans cette
étape seront présentés dans notre chapitre méthodologique.
L'étude de notre corpus est adossée à un cadre théorique interdisciplinaire, se référant
à des recherches aussi bien en communication politique, sociologie politique, sociologie des
professions, linguistique que sociologie des médias. En reliant ces approches avec nos
préoccupations de recherche, nous verrons l'importance des systèmes de communication et
d'information dans la discussion publique en vue de leur position stratégique de médiation et
d'organisation du système politique. Nous allons présenter l'émergence conjuguée des
médias, la personnalisation du politique et l’influence des sondages (à partir des années
7
1960) comme autant de facteurs favorisant l'émergence de nouveaux acteurs dans l'échiquier
du pouvoir : les conseillers en communication.
L'importance des recherches en communication politique réside dans le fait qu'elles
rendent visible le rôle des médias et de l'opinion publique dans la construction des nouvelles
formes de légitimité politique. Néanmoins, analyser le poids de la communication dans le
champ politique demande avant tout de prendre en compte le rôle ambigu de l’exploitation
des outils médiatiques par les représentants du pouvoir à certaines périodes.
L'instrumentalisation des médias dans les moments de crise – par exemple, pendant les deux
conflits mondiaux – a alimenté une méfiance profonde envers le politique, qui en subit les
conséquences aujourd'hui encore. Ainsi, la consolidation d'une spécialité appelée
Communication Politique s’imposera de façon assez conflictuelle, et se confrontera souvent à
l’ambiguïté de son rôle en tant que composante de l'activité politique et de l'exercice du
pouvoir. Comme l’explique Jean-Baptiste Legavre (2005), le premier problème concerne les
origines complexes et variées de cette spécialité communicationnelle : « [...] la
communication politique est faite d'héritages pluriels complexes à distinguer (une part de
propagande, une part de savoir-faire permettant de disposer de « relais » dans la presse, une
part de manières d'être et de penser, issue de ce qu'on a pu appeler l' « américanisation » de la
société française, ou encore une part de techniques « nouvelles » qui tendent à s'imposer,
etc.) »3. C’est pourquoi une difficulté demeure quant à la définition de ce terme : en quoi la
communication politique est-elle différente de la publicité politique, de la propagande ? Doit-
on parler de « communicateur » ou de « communicant » ? Est-il besoin d'un code
déontologique ? Cette spécialité doit-elle être d'abord le fait de « militants » ou bien de
« professionnels » ? Une autre question concerne la difficulté d'envisager le domaine de la
communication politique en considérant l'ensemble des acteurs qui en font partie et leurs
rapports de force. D'un côté, les hommes politiques dotés d'un bagage spécifique et des
connaissances des professionnels de la communication qui travaillent auprès d'eux ; de
l'autre, les médias, responsables de la construction de représentations sur la réalité politique
par le biais du journalisme, qui nourrit néanmoins le plus souvent une méfiance vis-à-vis du
politique. C'est dans le cadre de ces luttes symboliques de l'instance politique pour le contrôle
de l'agenda médiatique et des actualités afin d’imposer leur conception de la réalité, souvent
très différente de la perception qu’en ont les journalistes, qui s'inscrit notre mémoire.
3 LEGAVRE Jean-Baptiste, « La quête des origines », Questions de communication [En ligne], 7 | 2005, pp.323-343, mis en ligne le 23 mai 2012, consulté le 13 septembre 2013. URL :http://questionsdecommunication.revues.org/5669, pp. 325.
8
Pour en rendre compte, cette étude a été divisée en trois parties. D'abord, nous avons
réalisé une revue de la littérature nécessaire pour aborder la question de l’institutionnalisation
de la communication politique en France. Cet état de l’art nous a permis de contextualiser
l'émergence d'un espace public médiatisé et de mettre en perspective les différentes
approches de l'objet communication politique. Ainsi, la première partie La politique
médiatisée sera centrée sur les rapports entre médias et politique, en mettant l'accent
notamment sur les transformations de l'espace public à partir de l'avènement des mass media
et plus récemment d'Internet. Cette première étape a pour but d'évoquer les points
fondamentaux qui nourrissent le débat et de problématiser la relation entre politique et
médias en tenant compte de la place centrale des ces derniers dans le processus de
représentation de la réalité et en matière de socialisation politique (Braud, 2008).
La deuxième partie – Ce que veut dire « communication politique » – fera dialoguer
les principaux travaux qui ont tenté d’élaborer une conception du terme. À partir de là, nous
présenterons les caractéristiques les plus souvent invoquées par les chercheurs dans ce
domaine pour définir cette spécialité communicationnelle. Un dernier point à cet égard
concerne les critiques autour du discours politique contemporain, lequel se situerait entre
l'innovation et la détérioration. À partir de ces réflexions autour du concept de
communication politique, nous nous nous efforcerons d'éclairer le processus d'évolution
voire la mise en place d'une professionnalisation de ce domaine. En outre, nous tenterons
d’identifier les enjeux de ce processus paradoxal qui suppose à la fois une désaffection du
politique par les médias et les citoyens et et une réinvention de la politique à partir des
transformations des systèmes de l'information et de la communication.
La dernière partie – Les conseillers en communication politique en France en 2015 :
Quelles identités et quelles logiques professionnelles ? – portera sur notre terrain, dont
l'objectif est de mettre en exergue les enjeux démocratiques de l’évolution des pratiques des
conseillers en communication politique. La démarche méthodologique transdisciplinaire mise
en place conjugue les outils de l'analyse du discours et ceux de la sociologie compréhensive.
Cette combinaison nous semble assez pertinente par rapport à nos objectifs de recherche, qui
s'intéressent aux transformations structurelles du champ politique, notamment en ce qui
concerne sa communication. A cet effet, il semble indispensable de dégager les
représentations que ces communicants, en tant que professionnels de l'instance politique, se
font de leur propre activité à travers leur discours. Ainsi, nous allons présenter et discuter
autour des images que ces acteurs font d'eux-mêmes dans le jeu politique (tels que stratégiste,
9
expert) ainsi que de leurs pratiques professionnelles, où la prédominance d'une performance
démocratique et d'une vision horizontale de la communication politique ont été repérées.
Suivra ensuite l'interprétation des résultats, l’objectif restant de mettre en lumière l'hypothèse
de l'émergence d'une nouvelle catégorie professionnelle appelée communicants politiques et
de présenter leur rôle et leur place dans le champ politique.
10
2 LA POLITIQUE MÉDIATISÉE
À coup sûr, le développement des médias de masse a apporté des changements
profonds au sein des sociétés contemporaines. L'abondance des informations diffusées par les
canaux les plus variés a contribué à l'élargissement de l'espace public contemporain, dans
lequel les médias jouent un rôle central au sein et entre les sociétés civiles et leurs
institutions. Ainsi, loin d'une conception normative et consensuelle au sens habermassien du
terme, la notion d'espace public à l'heure actuelle doit absolument être comprise en prenant
en compte le rôle de la sphère de visibilité médiatique et le caractère conflictuel intrinsèque
qui entretient cette relation (Macé, Maigret, 2005).
Si l'univers politique a subi les effets des médias dès le surgissement de la presse, le
contexte actuel représente une période de défis sans précédent pour les acteurs du champ
politique. L'interdépendance entre l'instance médiatique et l’instance politique soulève des
débats autour des paradoxes qui caractérisent leur relation. D'un côté, le surgissement de la
presse a permis aux citoyens d'accompagner et de contrôler – en quelque sorte – les actions
mises en place dans la sphère du pouvoir. De l'autre, les différents intérêts personnels,
économiques et politiques, qui font partie de l'univers médiatique auraient contribué à miner
l’intérêt général et la capacité des citoyens à faire entendre leur parole par le biais de la
communication4.
Ainsi, cette partie a pour objectif de mettre en avant les enjeux des rapports de force
entre médias et pouvoir politique afin de mettre en perspective la portée d’une
professionnalisation de la communication politique. Pour y arriver, nous allons nous focaliser
sur les trois points qui nous semblent les plus pertinents pour nourrir le débat à ce sujet : la
légitimation des discours par l'institution journalistique, les tensions entre la sphère
médiatique et la sphère politique et les nouvelles modalités de mise en scène du pouvoir à
l'heure actuelle, dont l'émergence d'une spécialité appelée « Communication Politique »
4 L'élaboration de la théorie de l'agir communicationnel marque la deuxième phase de la pensée de JurgenHabermas et son ouverture aux critiques. Dans cet ouvrage publié en 1981, le philosophe abandonne saconception de supériorité de l'espace public bourgeois au profit d'une théorie appuyée sur les actescommunicationnels, en considérant l'intercompréhension à travers la communication la seule solution pourl'aboutissement de la démocratie. Pour présenter cette nouvelle conception de l'espace public, Habermas vas'appuyer sur le pragmatisme (notamment Mead), la théorie des actes de langage (Searle, Austin), endéveloppant une discussion propre autour des quatre idéaux-types de Max Weber. Ainsi, il présente unesynthèse où il parle des trois façons d'agir de l'être humain : 1) agir instrumental : l'agir téléologique quipossède une visée technique, laquelle est efficace mais vide de sens ; 2) agir stratégique : lié auxintéractions sociales, aussi téléologique mais orienté par un intérêt en relation avec les décisions d'unpartenaire rationnel ; et 3) agir communicationnel : recherche non téléologique et fondée surl'intercompréhension, à une définition commune des situations. (Maigret, 2013)
11
devient un objet très fécond. Ces réflexions nous paraissent indispensables face à la réalité
actuelle du paysage médiatique et à la place centrale des systèmes d’information et de
communication, dont l'accès à la visibilité favorable est devenu une préoccupation
permanente pour l'instance politique.
1.1 Les médias comme instance de légitimation des discours
Comment l'instance politique réagit-elle face à la place centrale des médias dans les
démocraties modernes ? Plusieurs pistes se mettent en place pour répondre à cette question.
D'abord, il faut aborder la problématique du rôle des médias en prenant en compte leur statut
de grandes machineries sociales (Braud, 2008). De nos jours, il est impossible d'envisager
une analyse de la société hors son rapport avec les médias : ayant le pouvoir d'influencer les
agendas publics et gouvernementaux, de rendre visibles certains sujets au détriment d'autres
et de construire des représentations de la réalité, l'instance médiatique doit nécessairement
être saisie comme une composante du processus d'évolution des pratiques sociales.
Philippe Braud (2008) explique que les médias jouent un rôle d'intégration sociale à
travers la construction d'une histoire et d’une mémoire communes appuyées sur la notion du
« voir ensemble », ce qui représente une démarche importante pour le lien social. Les médias
figurent une arène moderne où circulent et s'opposent les discours des différents acteurs
sociaux. Ayant le pouvoir de sélectionner et de rendre visibles certains thèmes en dépit
d'autres, l'instance médiatique – à travers les routines journalistiques – est investie d'une
sorte d'autorité légitimatrice, reléguant tout ce qu’elle exclut de son champ à un niveau de
marginalité politique. Ainsi, s'y introduire devient une condition vitale pour l'acquisition de
capital politique.
Avec la publication du dense ouvrage « Strukturwandel der Öffentlichkeit » en 1962,
Jürgen Habermas a soulevé la discussion autour de la notion d'espace public et des
contradictions existant dans la conception bourgeoise de la liberté d'expression, laquelle
serait toujours associée aux intérêts d'une classe sociale spécifique. Dans cette première
phase, l'espace public habermasien est conçu dans une relation dialectique entre espace
public et espace privé, dont le choc d'intérêts et de points de vue conflictuels amènerait à la
dégénérescence de l'espace public en raison de l'impossibilité d'établir un consensus,
condition indispensable pour une vie commune. Pour le philosophe, le surgissement des
12
médias de masse et la prédominance des intérêts économiques dans leur fonctionnement vont
mettre en avant ces contradictions, qui empêcheraient la mise en place d'une vraie
démocratie.
Les transformations subies par la presse depuis le 18e siècle – période de
consolidation de la bourgeoisie, qui va trouver dans le journalisme un outil de lutte contre le
statu quo – ont mis en place une nouvelle conception du champ journalistique5, divisé
désormais en deux pôles opposés : un pôle idéologique et un pôle économique, comme le
souligne Nelson Traquina6. Ainsi, les conflits d'intérêts, à l'intérieur même du champ
journalistique, présenteront des effets à long terme, s'étendant à toutes les formes médiatiques
qui en découleront. De même, le métier journalistique se trouve condamné à une série de
contraintes d'ordre économique, idéologique et temporels qui vont orienter ses pratiques et
les angles adoptés pour représenter certains sujets.
À cet égard, Denis Ruellan (2006)7 met en avant la place de l'angle dans la routine des
professionnels de l'information. L'auteur souligne les différents invariants qui en font partie
(la proximité, l'actualité, l'originalité…) en mettant en avant l'importance de l'angle choisi par
les journalistes, complètement distinct, pour traiter un même sujet. En se focalisant sur cet
important aspect du discours journalistique, D. Ruellan situe le journaliste dans un espace
concurrentiel de production discursive et attire l'attention sur les rapports de force existant
dans l'instance médiatique et pesant sur le travail des journalistes, amenant ainsi à différentes
représentations discursives du réel. Ainsi, l'angle consisterait en une pré-rationalisation, une
manière propre à celui qui informe de décider de ce qu'il va raconter et de la façon dont il va
le faire selon son positionnement dans l'instance de production de l'information. En ce sens,
analyser le journalisme en tant que pratique discursive exigerait une double démarche : d'un
côté, prendre en compte sa position dans un espace concurrentiel marchand et, de l'autre, sa
position dans un espace de batailles discursives, c'est-à-dire sa posture énonciative dans un
espace public fragmenté. Ainsi, en tant que professionnels de l'information légitimés
socialement et dont les pratiques sont fondées sur la crédibilité, les journalistes ont le pouvoir
de sélectionner ce qu'ils vont raconter et la façon dont ils vont le raconter, en favorisant par
là-même certaines visions de monde en dépit d'autres. En présentant la réalité au travers d'un
prisme, c'est-à-dire d'un filtre, l'instance journalistique promeut un processus de
« thématisation » du monde (Charaudeau, 2006).
5 Dans ce mémoire, nous utilisons la notion de « champ » au sens bourdieusien du terme. 6 TRAQUINA Nelson, Teorias do Jornalismo. Porque as notícias são como são, Florianópolis: Insular,
2005.7 RUELLAN Denis, « La routine de l'angle », Questions de Communication, 2006, 10, pp. 360-390.
13
Cependant, Patrick Charaudeau (2006)8 rappelle la double finalité du contrat
d'énonciation de ce champ. Selon l'auteur, l'activité journalistique possède une finalité
éthique orientée vers les valeurs démocratiques, dont le but est d'informer le citoyen pour
qu'il puisse prendre part à la vie publique, et une finalité commerciale de conquête de la plus
grande audience, vu que l'organe d'information est soumis aux lois du marché et de la
concurrence. Ainsi, « la finalité éthique oblige l'instance de production à traiter l'information,
à rapporter et commenter les événements de la façon la plus crédible possible : elle se trouve
surdéterminée par un enjeu de crédibilité. La finalité commerciale oblige l'instance
médiatique à traiter l'information de façon à capter le plus grand nombre de récepteurs
possible : elle se trouve surdéterminée par un enjeu de captation »9. Ainsi, l'auteur souligne
l'ambiguïté intrinsèque du rôle de journaliste : d'un côté, les enjeux de crédibilité et
d’objectivité exigent son effacement énonciatif ; de l'autre, les enjeux de la captation
l’obligent très souvent à prendre position – par exemple à travers l'abondance des
témoignages, présentés comme preuves d’authenticité par l'emploi des guillemets, ou encore
la mise en cause de certaines personnes du monde politique, assurant alors un rôle de
dénonciateur. Cette situation révèle la complexité et les contours assez flous à la base de
l'instance de production d'information. En plus de rapporter les choses qui arrivent dans le
monde, le journaliste doit aussi en expliquer les causes et les raisons. Car son rôle reste
d’éclairer le citoyen. En ce sens, l'instance journalistique joue un rôle crucial d'animation des
débats en alimentant l'espace de discussion publique à travers ce que les médias racontent et
révèlent de la réalité.
Cependant, même si les visées d'information et de « faire savoir » s’offrent comme
des guides du travail journalistique, il ne faut pas négliger les effets de la situation de
concurrence. Les différents organes d'information opèrent dans une logique de « suivisme »,
et créent par là-même la diffusion d'informations en boucle dans les différents médias et
groupes médiatiques. Comme l'explique Pierre Bourdieu (1996)10, pour savoir ce qu'il faut
dire, les journalistes doivent savoir ce que les autres journalistes ont dit, en appuyant les
choix des sujets dont ils vont traiter sur les choix des autres journalistes. Cette lutte pour « ne
pas passer à côté » obéit à la loi du marché qui pèse sur l'activité journalistique et promeut
une homogénéisation de la production, amenant à une diffusion circulaire de l'information.
Cette logique de répétition opère un processus d'inscription dans la mémoire du public,
8 CHARAUDEAU Patrick, « Discours journalistique et positionnements énonciatifs. Frontières et dérives »,Semen [En ligne], 22 | 2006, mis en ligne le 01 mai 2007.
9 Idem, pp. 3.10 Bourdieu, 1996.
14
donnant ainsi une impression de vérité. En imposant ces thématisations du monde, le
prémisse du « faire savoir » du discours journalistique glisse vers le « faire penser ». Cela
nous permet de comprendre la nécessité de poser un regard critique sur l'activité
journalistique et l'instance médiatique dans un contexte démocratique : les médias ont
l'obligation d'informer, en même temps qu'ils ont le pouvoir de fabriquer et de déformer les
versions de ce qu'ils racontent.
À cet égard, les élections présidentielles de 2002 en France sont un exemple concret
de la capacité des médias à influencer et à orienter les décisions des citoyens. À partir d'une
analyse sémio-discursive des journaux télévisés de 20 heures des deux principales chaînes
françaises, TF1 et France 2, Julien Terral (2004)11 a mis l'accent sur le traitement médiatique
– notamment par la télévision – du thème de l'insécurité pendant les mois précédant le
premier tour du scrutin. Dans une campagne dont l'attente était une confrontation entre
Lionel Jospin et Jacques Chirac, l'arrivée de Jean-Marie Le Pen, leader du Front National,
jusqu’à la dernière étape de l'élection a représenté une vraie rupture de l'équilibre des forces
existant jusqu'à ce moment-là dans la démocratie française. Les manifestations qui suivirent
les résultats du premier tour du processus électoral parlent d'un « complot sécuritaire »,
mettant en cause le rôle joué par les journalistes en ce qui concerne la surmédiatisation de la
problématique sécuritaire en France pendant les mois précédant l'élection. D'après les
protestations relevées à l’époque, la focalisation des médias sur ce thème a fini par faire le
jeu du Front National, d’où ce résultat inattendu.
Comme l’explique Éric Macé (2005), les journalistes jouent un rôle central dans
l'espace public médiatique parce qu'ils possèdent le monopole de l'accès à la scène publique.
Ainsi, ils détiennent le pouvoir de faire d’un « problème » un « problème public ». En ce
sens, le cas des élections de 2002 représente un cas exemplaire de l'agenda-setting theory12,
selon laquelle les médias nous diraient ce à quoi il faut penser. Cette capacité de la sphère
médiatique favorise la construction et la circulation des images et des discours dominants,
une fois que « les mots eux-mêmes constituent des 'coups de force symboliques' dans la
définition des situations »13. Ainsi, l'évolution de l'ensemble de cette sphère de visibilité dans
11 TERRAL Julien, L’insécurité au journal télévisé, la campagne présidentielle de 2002, Paris,L’Harmattan, 2004.
12 La notion d'agenda (agenda-setting theory) de Maxwell McCombs et Donald Shaw a permis lacomparaison entre les opinions véhiculées par médias et celles des citoyens à l'occasion des élections de1968 aux États-Unis. L'agenda représente un classement de priorités, une liste de sujets classés parimportance croissante. Ainsi, la corrélation entre les agendas public et médiatique vérifiée par les auteurs arévelé l'influence décisive de la presse sur la perception du monde. Pour reprendre Bernard Cohen, la presserarement arrive à dire quoi penser aux gens, mais à quoi il faut penser.
13 MACE Eric, Les faits divers de « violence urbaine » : effets d’agenda et de cadrage journalistique , LesCahiers du Journalisme, nº14, Printemps-Été 2005, pp. 188-201, pp. 189.
15
la scène démocratique contemporaine anime les débats à propos de ses effets sur la relation
entre gouvernants et gouvernés et les défis qui se posent pour la mise en scène de l'action
politique dans une ambiance informationnelle de plus en plus dynamique.
1.2 L'émergence d'un espace public médiatisé
J. Habermas a proposé un modèle d'espace public dans une perspective idéaliste, qui
cherche le consensus et ne prend pas en compte les mouvements qui ont lieu dans les sociétés
tout au long de l'histoire. Prenant l'emblématique conception habermassienne de 1962
comme point de départ, de nombreux chercheurs vont réinterpréter cette notion initiale et
envisager des nouvelles définitions de ce que serait effectivement ce domaine commun.
Néanmoins, avant J. Habermas, Hannah Arendt (2012 [1958]) introduit déjà la
problématique autour de cette notion. H. Arendt préesente l'espace public comme le lieu où
les individus apparaissent et acquièrent de fait leur existence, soit le lieu où ils doivent
chercher non seulement à maintenir leur vie, à dépasser le confinement biologique dans la
famille, mais aussi à transcender, grâce à des mots et des actions, leur passage éphémère dans
le monde. Les réflexions de H. Arendt portent sur la crise de l'espace public contemporain et
les risques que cela peut entraîner pour les sociétés modernes. La dichotomie public / privé
est de même au cœur des réflexions de l'auteure. La philosophe attaque la question sous
l'optique de la vita activa en partant de la relation dialectique entre singulier et universel, soit
en analysant les relations que l'individu entretient avec les autres et leurs conséquences. Chez
H. Arendt, c'est une demande naturelle de l'homme que de chercher dans l'universalité du
public ce dont il a besoin pour s'assurer de la réalité dans sa particularité. Autrement dit, c'est
dans le public qu'il s'aperçoit de lui-même et découvre sa propre façon de jouer son rôle. Ce
point de vue nous permet d'identifier dans la pensée arendtienne une conception
aristotélicienne de l'aretè (la vertu, l'excellence), à laquelle l'homme n'avait accès que par la
vie en public en tant que citoyen de la polis. L'auteure ajoute que le problème de l'espace
public contemporain réside dans son échec à réunir les différentes singularités issues de
l'hétérogénéité caractérisant ce souhaitable « domaine commun », problématique qui nous
amène à penser la notion d'espace public moins comme une structure unique et universelle
que dans une perspective d'éclatement, de « mosaïque » pour reprendre la proposition de
Bastien François et Érik Neveu14.
14 FRANÇOIS Bastien, NEVEU Érik, Espaces publiques mosaiques : Acteurs, arènes et rhétoriques des
16
Ultérieurement, la philosophe Nancy Fraser (1991)15 va s'appuyer sur la théorie
habermassienne pour proposer le modèle d'une sphère publique fondée essentiellement sur le
conflit des perspectives généré par les conflits de points de vue. Chez N. Fraser, nous ne
voyons jamais la même perspective ni le même point de vue chez autrui parce que nous
avons tous des origines et des savoirs différents. Ainsi, l'importance accordée à la dialectique
public / privé différencie les deux théoriciens : la théorie habermassienne exclut les questions
privées de l'espace public ; Fraser explique que ce sont des intérêts partiels et des problèmes
dits privés qui dessinent les contours de la sphère publique.
Pour revenir aux débats contemporains, il faut noter qu'à l'époque à laquelle H.
Arendt, J. Habermas et N. Fraser ont mené leurs travaux les médias n'avaient ni la puissance
ni l'influence qu'ils possèdent aujourd'hui. En effet, l'émergence d'une nouvelle ambiance
informationnelle s'imposera ensuite comme une composante indispensable des discussions,
bouleversant complètement le rapport entre les acteurs sociaux.
Ainsi, Dominique Wolton (1990) mettra-t-il l'accent sur les contradictions des
sociétés actuelles en deux dimensions : d'un côté, la priorité accordée à tout ce qui facilite
l'expression, la liberté et l'identité de l'individu ; de l'autre, la façon dont cette même société,
sur le plan économique, politique et culturel, repose sur la notion du grand nombre. Selon
l'auteur, l'opposition intrinsèque entre ces deux logiques requerrait l'existence d'un espace
public médiatisé élargi pour que leurs contradictions ne soient pas trop violentes. Ainsi,
«l'espace public médiatisé est un des lieux symboliques, parfois le seu1, où peut se gérer
cette caractéristique contradictoire des sociétés actuelles »16.
À propos de cette nouvelle ambiance socio-politique, Louis Quéré (2005)17 souligne
l’impossibilité d’être témoins de tout ce qui arrive dans le monde, de même que nous ne
pouvons participer à tous les débats publics et enquêtes du moment, pourtant autant d’aspects
importants d'une société démocratique. Ainsi, l'auteur met en avant le rôle joué par les
médias dans l'espace public, médias auxquels nous avons besoin d’accorder du crédit et de la
confiance sur ce qu’ils racontent et expliquent du monde. L'auteur souligne leur place dans
l'architecture institutionnelle des démocraties modernes et leur rôle en ce qui concerne
l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble social. En fonctionnant comme supports de
débats publics contemporains. Presses Universitaires de Rennes, Collection Res Publica, 1999.15 FRASER Nancy, « Repenser la sphère publique : une contribution à la critique de la démocratie telle
qu’elle existe réellement », Extrait de Habermas and the public sphere, 1992, Hermès nº 31, 2001, pp 125-156.
16 WOLTON Dominique, Éloge du grand public : une théorie critique de la télévision, Paris, Flammarion,1990.
17 QUERE Louis, « Les « dispositifs de confiance » dans l'espace public », Réseaux, 2005/4 no 132, p. 185-217. DOI : 10.3917/res.132.0185
17
visibilité, ils permettent d'élargir le processus de publicisation et de participation à la vie
publique. Ainsi le complexe médiatique va-t-il désormais amener à une reconfiguration des
relations de la triade « Politique-Médias-Publics ». Cette métamorphose de l'espace public
placera l'instance médiatique dans une condition d'ágora moderne, tout en donnant des
nouveaux contours au sens du concept de démocratie et aux actions politiques, qui exigent
désormais l'accès à la tribune médiatique pour être légitimées.
Figure 1 : Rôle de l'instance médiatique dans une démocratie. (Source : L'auteure)
Comme le montre la figure 1 ci-dessus, la première instance correspond aux acteurs et
institutions qui produisent des messages en pensant promouvoir une image positive auprès
des publics. Dans une démocratie, les médias sont l'interface entre ces deux domaines. Ainsi,
l'instance médiatique va opérer une série de procédures de sélection et de légitimation des
messages produits par les acteurs et institutions en filtrant les contenus. Conséquence, ces
démarches de rationalisation du traitement de l'information par la sphère médiatique –
notamment à travers le journalisme – finissent par livrer aux publics des messages qui ne
correspondent pas forcément à ceux envisagés par ses émetteurs, mais plutôt un message
perçu comme réel.
Ces réflexions nous amènent à un autre point important dans le cadre de notre
analyse: le rôle des médias en tant qu'agents de la socialisation politique. L'évolution des
technologies de l'information et de la communication vont entretenir une transformation des
habitudes informationnelles chez les citoyens et par là même un changement de leur rapport
au politique. À ces mutations technologiques suivront parallèlement des mutations
18
socioculturelles. À cet égard, la montée d'Internet est très significative : elle représente
l'émergence de l'intérêt des publics pour l'information strictement factuelle tandis que la
presse quotidienne subit une période de vieillissement du lectorat. Le début du 21e siècle et la
montée en puissance des blogs et des sites d'échanges ont donné un nouveau souffle aux
rapports entre l'instance politique et l'instance citoyenne. Mais quels sont les enjeux de ce
basculement du paysage informationnel ? Quels sont les contradictions du principe de
démocratisation de l'accès à l'information ? Même s'ils ne sont pas nouveaux, ces
questionnements demeurent au cœur de récents travaux sur l'émergence d'un nouvel espace
public de discussion appuyé sur le numérique.
1.3 L'espace public à l'ère numérique : quelques remarques
Ainsi, comme à l’époque des mass media, l'apparition des nouvelles formes de prise
de parole en dehors des médias traditionnels va bouleverser la relation « médias-publics » et
rouvrir les débats autour de la problématique de l'espace public. Dans les grandes lignes,
l'ouverture de l'internet vers le grand public lui permet de quitter sa condition de récepteur
pour devenir plus autonome et actif.
Si dans les années 1970-1980 le mythe s'appelle « télédémocratie », la décennie
suivante va concentrer ses espoirs dans la notion d'une « démocratie électronique » et
« cyberdémocratie », « actualisant le rêve d'une société sans intermédiaires où les citoyens
'éclairés' seraient mieux informés et actifs par l'accès aux sites web, libres de s'exprimer sur
les forums électroniques, de nommer et de révoquer les élus et de définir les priorités
politiques »18. Ainsi, le début de cette ambiance informationnelle dynamique émerge comme
une « (…) revanche des citoyens de base contre l'hégémonie des journalistes professionnels
et d'autres 'faiseurs d'opinion' »19 capable de menacer l'ordre établi et d’élargir la notion
d'espace commun de discussion dans le contexte des médias.
Néanmoins, si la définition d'un espace public politique était déjà une tâche difficile
pour les théoriciens du dernier siècle, la montée en puissance du réseau et son ouverture vers
le grand public vont la transformer en un véritable défi. Malgré les incontestables apports
positifs de cette nouveauté technologique pour le perfectionnement de la démocratie,
quelques questions restent ouvertes. Les transformations apportées par Internet sont-elles
18 Maigret, 2013, pp. 266. 19 Braud, 2008, pp. 370.
19
assez profondes pour vraiment élargir la notion d'espace public contemporain et, par là, l'idée
même de démocratie ? Quels sont les limites d'une telle notion ?
D'abord, l'utopie de l'accès, via Internet, à un savoir universel, qui sous-tend le
principe de « démocratisation de l'information » est déjà en soi une erreur : il n'y a pas
forcément une démocratisation de l'accès et de production à l'information quand cela ne
concerne qu'une tranche de la population. L'âge, le niveau d'études, le sexe, le statut social, le
rapport au politique etc. sont autant de caractéristiques socio-démographiques qui vont
influencer les pratiques informationnelles en ligne des internautes, et renforcer l'existence
d'une fracture numérique issue des inégalités économiques et structurelles, notamment dans
les usages et appropriations ainsi que dans le rapport des usagers à l'information20. Autrement
dit, même si l'Internet est capable de réduire les disparités d'accès à l'information et de prise
de parole des différents publics, il n'échappe pas à la logique de distribution des ressources
sociodémographiques qui orientent les pratiques médiatiques et culturelles des individus
(Rebillard, 2007).
À ce sujet, l'étude sur les pratiques informationnelles des Français en politique menée
par Viviane Le Hay, Thierry Vedel et Flora Chanvril (2011)21 s'est interrogée sur le pouvoir
des différentes sources d’information et d’expression des opinions offertes par l’internet de
changer vraiment le comportement des individus face à leur manière de s’informer sur
l’univers politique. Leur analyse a révélé l'influence des variables sociodémographiques dans
le comportement informationnel des internautes et la faiblesse de l'hypothèse préalable que la
pluralité des contenus disponibles sur le réseau changerait véritablement les écarts entre les
différentes groupes sociaux. Les auteurs soulignent qu'il se trouve ici un débat ouvert il y a
plus de quarante ans autour du knowledge gap22, concept qui stipule que l’intensification des
flux d’information n’apporte pas une meilleure information de tous les individus, mais qu’au
contraire elle élargit les connaissances parmi les individus qui possèdent les niveaux d’études
les plus élevés, ce qui s'oppose aux principes égalitaires du réseau. En ce sens, malgré la mise
en place d'un processus de revendications micro-politiques qui mettent en cause la légitimité
de certaines professions – comme celle de journaliste – et des décisions politiques, il n'est pas
possible de parler d'un véritable élargissement de la démocratie par le biais de l'information
dans un contexte où l'accès à ces outils reste restreint à une tranche sociale très sélective.
20 Voir: GRANJON Fabien, « Les sociologies de la fracture numérique. Jalons critiques pour une revue de lalittérature », Questions de communication [En ligne], 6 | 2004, mis en ligne le 15 mai 2012, consulté le 02mai 2015. URL : http://questionsdecommunication.revues.org/4390.
21 LE HAY Viviane, VEDEL Thierry, CHANVRIL Flora, 2011, Usages des médias et politique: uneécologie des pratiques informationnelles, Réseaux, nº 170, pp. 45-73.
22 Tichenor et al., 1970 apud Le Hay, Vedel, Chanvril, 2011.
20
Ces remarques révèlent le pouvoir d'Internet en tant qu'allié important de la
démocratie à travers la diffusion et la circulation des discours alternatifs et des points de vue
diversifiés qui peuvent relativiser les effets d'homogénéisation culturelle et politique exercés
par la presse traditionnelle. Néanmoins, les usages et appropriations de cet outil ont montré
qu'il opère dans une logique à la fois de lien social et d'exclusion23. L'étude des espaces de
discussion électroniques révèlent qu'ils se définissent par l'émergence d'une culture et d'une
hiérarchie propres, dont les acteurs acquièrent des statuts spécifiques liés en réalité à leurs
origines socioculturelles. Ainsi, « en distinguant des usagers ordinaires et occasionnels,
habitués, modérateurs et administrateurs »24, les normes de fonctionnement d'Internet
finissent pour tenir les classes populaires à l'écart d'une autonomie et d'une influence pourtant
légitimes sur les discussions menées par rapport aux classes dominantes, renforçant alors les
inégalités de la structure sociale et déplaçant le problème en lieu de le résoudre (Mattelart,
2001).
Deuxièmement, si le réseau s’est appuyé sur l'idée d'égalité, de libre accès et de
partage de l'information, comprendre la façon dont il s'organise devient fondamental pour
éclairer la notion démocratique qui lui est particulière. Ainsi, une deuxième remarque
s'adresse aux enjeux économiques du Web. Dominique Cardon (2010) affirme que l'Internet
offre une très bonne opportunité pour la démocratie, mais il attire l'attention sur les fortes
tendances marchandes dont ce média reste le vecteur. La découverte de sa puissance en tant
que marché à exploiter va attirer l'attention des investisseurs du secteur et inscrire le Web
dans une logique orientée vers l'audience et dont la hiérarchisation des contenus par des
moteurs de recherche selon leur popularité (numéro d'accès, commentaires, citations etc.) et
la mise en œuvre des publicités spécifiques selon les « traces » des internautes sont des
exemples mettant en avant les lourds poids industriels qui pèsent sur ce dispositif, en
l'éloignant des idéaux démocratiques qui président ses débuts.
En outre, si l'Internet a permis une autonomie d'usage par l'individu, cela a par
ailleurs engendré une explosion informationnelle pas nécessairement bénéfique. P. Braud
souligne que « Les effets pervers d'une saturation d'informations ne doivent pas être sous-
estimés ; elle peut produire banalisation, indifférence, paralysie du jugement sous l'effet de
messages contradictoires »25. En même temps, l'éclosion des rumeurs, parfois incontrôlée,
peut créer de la confusion auprès du public au lieu de l’éclairer dans l’exercice de sa
23 MERCKLE Pierre, Sociologie des réseaux sociaux, Collection Repères, La Découverte, 2011.24 Idem, pp. 89-90.25 Braud, 2008, , pp. 364.
21
citoyenneté. Alors, la montée en puissance du flux informationnel ne fonctionne pas toujours
au profit de l'information stricto sensu : en lieu d'éclairer les publics, la surcharge
informationnelle, à travers les différents canaux – sites Internet, mails, réseaux sociaux
numériques etc. –, finit pour leur donner une fausse impression d'être informés. Le sentiment
d'urgence qui oriente la logique de la production et de la diffusion de l'information dans le
contexte actuel rend les destinataires incapables d’agir ou de maîtriser le bombardement de
données qu'ils reçoivent quotidiennement26.
Comme nous l’avons montré, cette métamorphose du paysage informationnel
bouscule complètement l'organisation de l'espace social dans toutes ses dimensions. C'est
dans cette ambiance dynamique que les acteurs de l'instance politique vont se confronter aux
nouveaux défis pour la conquête et l'exercice du pouvoir. Plus que gagner une élection, les
représentants politiques seront contraints de repenser de façon permanente la mise en place
de leurs actions et décisions en prenant en compte le poids de l'ensemble médiatique en tant
que zone de contact avec les citoyens. Ainsi, les évolutions de l'instance médiatique, en tant
que composante du processus d'évolution de l'activité sociale, vont nous amener à interroger
le renouvellement des pratiques communicationnelles en politique dans un contexte où la
maîtrise de l'information et de la communication devient un aspect fondamental pour les
acteurs de l'instance politique contemporaine.
26 Pour savoir plus à ce sujet, voir SAUVAJOL-RIALLAND Caroline, Infobésité : comprendre et maîtriserla déferlante d'information, Paris : Vuibert, 2013.
22
2 CE QUE VEUT DIRE « COMMUNICATION POLITIQUE »
La parole est une composante intrinsèque de l'activité politique dès l'Antiquité. Les
réflexions sur le langage et leur effet chez les publics est une tradition ancienne en Grèce, de
même que les études ultérieures sur la rhétorique. Il n'est donc pas étonnant que les études
sur le discours politique emprunte ces contributions pour analyser les performances
politiques actuelles.
Mais si l'analyse du discours politique présente des racines disciplinaires plus nettes,
les études sur la définition et la place de la communication politique manquent encore de
quelques précisions. Comment aborder cette spécialité au niveau théorique et pragmatique en
prenant en compte la fluidité sémantique propre de l'objet « communication »? Comment
éviter le piège du média-centrisme et ne pas enfermer le champ politique et ses actions dans
cette sphère de visibilité ? Est-il possible d'envisager les nouvelles performances des acteurs
politiques comme un processus naturel face à la médiatisation de la vie publique
contemporaine ?
De nos jours, la communication politique est une composante essentielle de son
activité. De façon générale, cette activité peut être définie comme un ensemble de pratiques
de valorisation du travail et du pouvoir politiques (Riutort, 2007). Cela met en avant
l'importance de cette spécialité communicationnelle et la nature de la relation établie entre
représentants et représentés. À ce propos, P. Braud rappelle que la crédibilité des gouvernants
entremêle des éléments d'ordre rationnel et émotionnel. Ainsi, l'homme politique est
représenté par un profil symbolique – construit simultanément par les médias et par la
communication politique – qui possède une base concrète mais s'appuie sur l'étiquette
politique du personnage.
Face à ces réflexions, cette partie se consacrera à la discussion autour du concept de
communication politique, faisant dialoguer différents chercheurs. De même, nous porterons
notre attention aux critiques adressées à cette spécialité communicationnelle souvent associée
à la propagande et qui aurait colonisé et détérioré l'activité politique. Ensuite, nous nous
focaliserons sur les changements de la mise en scène de la parole politique dans une période
marquée par la désaffection du politique face aux médias et qui représente parallèlement un
moment de créativité de la sphère du pouvoir autour des évolutions des dispositifs
informationnels.
23
2.1 Pour une définition d'une notion de Communication Politique
La nécessité de légitimer le pouvoir va de pair avec l'activité politique. Même dans
les démocraties antiques, les leaders avaient besoin de montrer leur autorité et leur
importance vis-à-vis du peuple, voire d’établir une relation de dépendance de celui-ci à leur
égard (Riutort, 2007). A Athènes, à une époque où les relations entre les dirigeants et le
peuple s’établissaient sans intermédiaires, ceux-là profitaient déjà de leurs qualités oratoires
pour convaincre et persuader l'auditoire. À Rome, la réalisation des banquets et fêtes était
une stratégie des dirigeants pour maintenir la proximité avec le peuple et renforcer leur
puissance. Néanmoins, cette démarche amenait de même à une dépolitisation généralisée qui
éloignait la plèbe des « choses importantes » de la Cité en les reléguant aux magisters lettrés
et compétents. De toute façon, dans un cas comme dans l'autre, ces comportements révèlent
la soumission de l'instance politique aux jugements du peuple.
P. Riutort souligne ainsi que le soutien de l'opinion représente un point central pour
les leaders politiques à toutes les époques parce qu'il est à la base des principes de
légitimation du pouvoir. Mais comment incarner la société dans toute sa diversité ? Comment
rendre compte d'un espace public dynamique et pluriel ? Certes, l'existence des mécanismes
de représentation en tant que composante substantielle de l'exercice de l'autorité du pouvoir
n'est pas inédite dans ce domaine d'études. Néanmoins, les réactions du personnel politique
face aux nouveaux besoins qui découlent des mutations de l'espace public constituent un
horizon d'analyse des évolutions du jeu et du métier politiques. En ce sens, la communication
politique constitue un champ d'étude très fécond mais oppose des conceptions assez
différentes sur la nature et les objectifs de cette spécialité. Tantôt considérée comme un
ensemble de techniques orientées vers la manipulation et la séduction des publics, tantôt
envisagée en tant que preuve de l'identité voire de l’autonomie de l'instance politique dans la
société informationnelle, l'analyse des enjeux qui enveloppent la communication politique à
l'heure actuelle se pose comme une condition fondamentale pour comprendre l'évolution de
l'activité politique proprement dite.
J. Gerstlé (2008) rappelle les impasses qui enveloppent l'objet d'étude
« Communication Politique », qui présente des contours incertains et demeure souvent défini
comme l'ensemble de théories, de techniques ou de pratiques faisant l'objet d'interrogation
des différentes disciplines, telles que la sociologie, la linguistique, le droit, l'anthropologie,
l'histoire, la psychologie, la science politique etc. En essayant d'établir l'interface entre les
24
domaines de la communication et de la politique, l'auteur souligne la place centrale de la
première pour les théories sociales puisqu’à la base de pratiquement tous les autres faits
sociaux. Alors, deux approches prédominent dans le champ de la Communication Politique :
l'une prévoit la dissociation entre les deux domaines, en survalorisant le premier pour rompre
la nature de la Communication Politique ; l'autre propose la consubstantialité entre les deux,
une fois que la politique est une composante intrinsèque de la vie sociale et la
communication un prérequis du lien social. Cela justifie donc la pertinence d'aborder
l'activité politique sous une perspective communicationnelle, vu que « la communication
imprègne donc toute l'activité politique dans la mesure où presque tous les comportements de
ce type impliquent un recours à une forme quelconque de communication »27.
J. Gerstlé souligne que la communication joue un rôle central dans la socialisation
politique, dans la mise en visibilité des problèmes collectifs ainsi que dans l'élaboration puis
la présentation des solutions, enfin dans la concertation entre l'instance citoyenne et l'instance
politique. Trois dimensions peuvent alors rendre compte de la communication politique :
• une dimension pragmatique, de communication effective pour persuader,
convaincre, séduire et informer selon l'interaction sociale que s'établit ;
• une dimension symbolique, dont le langage joue un rôle central dans le combat
politique caractérisé par les batailles discursives ;
• une dimension structurelle, soit les canaux, les réseaux, les médias qui
permettent les flux d'information et de communication.
Ainsi, les différentes théories sur la communication politique rivalisent selon
l'attention portée à chacune de ses dimensions, mais l'auteur propose que « la communication
politique c'est avant tout de la politique. Nous la définissions comme l'ensemble des efforts
s'appuyant sur des ressources structurelles, symboliques et pragmatiques pour mobiliser des
soutiens et faire prévaloir une définition de la situation qui est censée contribuer au règlement
d'un problème collectif et/ou bien rendre efficaces les préférences de l'acteur, c'est-à-dire son
pouvoir, selon la définition de Lumieux (1970) »28. Cela révèle donc le caractère complexe de
ce domaine, marqué par la concertation permanente entre le personnel politique et son
entourage, les médias et les citoyens à travers le langage, la persuasion et les canaux de
27 Gerstlé, 2008, pp. 17.28 Idem, pp. 28.
25
diffusion d'informations de la vie politique.
2.2 Bref aperçu historique
Rendre compte d'une « vraie » histoire de la communication politique experte risque
de constituer une erreur. Sujet dynamique et polémique à la fois, « (…) la communication
politique est faite d'héritages pluriels complexes à distinguer : une part de propagande, une
part de savoir-faire permettant de disposer de 'relais' dans la presse, une part de manières
d'être et de penser, issue de ce qu'on a pu appeler l''américanisation' de la société française,
ou encore une part de techniques 'nouvelles' qui tendent à s'imposer »29. Pour J.B. Legavre
(2005) comme pour J. Gerstlé (2008), les impasses commencent d’abord par la fragilité
sémantique du terme : en quoi la communication politique serait-elle distincte de la
propagande politique ? Comment doit-on désigner les professionnels qui y travaillent,
« communicateur » ou « communicant » ? La communication politique serait-elle un affaire
d'abord de militants ou de professionnels ?
Les origines des travaux sur les relations entre médias et politique se trouvent dans les
réflexions liées au rôle de la communication dans les régimes totalitaires, dont la période de
l'entre-deux guerres a été extrêmement riche pour le développement des recherches sur les
médias et la socialisation politique. En mettant en avant la méfiance envers les médias,
l'ouvrage « Le viol des foules par la propagande politique », de Serge Tchakhotine représente
un symbole. Malgré les approches cherchant à rapprocher la communication politique de la
propagande, il faut comprendre qu'il s'agit de deux domaines complètement différents. Le
premier prend en compte l'existence d'une opinion publique légitime et reconnue comme
telle, le deuxième non. C'est pour cette raison que Christian Delporte (2007) affirme qu'il n'y
a pas de communication politique en dehors de la démocratie. Pour l'auteur, la
communication politique est avant tout un dialogue permanent avec l'opinion publique pour
établir un contrat fondé sur la confiance. Autrement dit, la propagande cherche à convaincre
et à persuader les citoyens à travers la mise en œuvre de stratégies voire de
l'instrumentalisation des médias de façon illégitime ; à l’inverse, la communication politique
tend à établir des liens entre les acteurs de l'univers politique et les citoyens par l'usage
29 LEGAVRE Jean-Baptiste, « La quête des origines », Questions de communication [En ligne], 7 | 2005, misen ligne le 23 mai 2012, consulté le 13 septembre 2013. URL:http://questionsdecommunication.revues.org/5669.
26
légitime des médias – notamment à travers le journalisme.
Cette orientation vers l'opinion publique est née aux États-Unis, où la préoccupation
des effets des messages des médias sur les citoyens – spécialement au cours des campagnes
électorales – et l'amélioration de la démocratie ont suscité des questionnements sur les
logiques de réception des contenus ainsi que sur les usages des discours politiques par les
citoyens (Riutort, 2007). Cela met en évidence la place privilégiée de l'opinion publique pour
faire vivre la démocratie et légitimer l'action des gouvernants. Ainsi, « Le 'modèle' de
communication politique moderne qui émerge aux États-Unis, dès le début du 20e siècle,
provient de l'intrication de trois activités : le monde de la presse (notamment audiovisuelle),
ceux des sciences sociales et du marketing et celui des experts en communication présents
dans l'entourage des professionnels de la politique »30. En ce sens, la visée empirique des
recherches sera au cœur des analyses sur la propagande, les études électorales, les effets de la
communication de masse et les relations entre la presse, l'opinion et les autorités publiques
(Nimmo, 1977 apud Gerstlé, 2008). Même si ces premières études ne se focalisent pas sur la
communication politique proprement dite, elles ont beaucoup contribué et ont rapidement
évolué vers le développement des recherches ultérieures dans ce domaine.
En 1927, la propagande est l'objet d'intérêt de Harold Dwight Lasswell. Pour le
sociologue, celle-ci peut être délimitée comme « le management des attitudes collectives par
la manipulation des symboles », et certaines définitions sont assez proches de la
communication politique. En 1946, l'ouvrage Propaganda, Communication and Public
Opinion portera sur les effets du rôle du langage en politique. Les effets de la radio et des
médias dans les campagnes présidentielles aux États-Unis constitueront l'objet d'étude de
Paul Lazarsfeld à partir de 1944 et seront à la base de la consolidation de la communication
politique comme discipline à part entière. L'analyse des campagnes pendant les années 1950
et 1960 vont rendre visible le pouvoir d'influence et de résistance aux médias des groupes
primaires, tels que les famille, le voisinage et les leaders d'opinion. En socialisant l'individu,
les contributions de P. Lazarsfeld révèlent que l'impact de l'influence personnelle est plus fort
que celui des médias – c'est l'émergence du modèle des « deux étages de la communication »
(two-step-flow of communication).
En France, les usages politiques des médias animent les débats scientifiques au début
des années 1960 et rendent visibles les impasses de l'approche critique et de l'approche
empirique de la communication. Les oppositions scientifiques, spécialement en ce qui
30 Riutort, 2007, pp. 28.
27
concerne la problématique de l'opinion publique, est aussi l'une des marques de ces
recherches. Pour Érik Neveu (1998), cela mettra l'accent sur les mécanismes de domination
sociale et de violence symbolique qui peuvent être à la base des spécificités du processus de
communication politique. Les années 1970 sont marquées par le retour des études sur les
usages politiques des médias, notamment en fonction de la place privilégiée de la télévision
dans la vie politique. L'analyse sur ces appropriations des dispositifs informationnels par la
sphère politique insiste alors sur l'aspect de la séduction, de la dépolitisation et de la mise en
valeur du leader partisan au lieu de la dimension collective de la mobilisation militante et
idéologique d'autrefois.
Ainsi, l'ère de la communication politique remplace celle de la propagande.
L'importance de cette transition dans les débats contemporains suscite une abondance de
littérature produite par les journalistes, des professionnels de la communication et par les
universitaires, qui tentent de comprendre et d'expliquer ce nouveau terrain.
2.3 La recherche en Communication Politique en France
En France, la communication politique est restée pendant longtemps un domaine de
recherche marginal. É. Neveu (1998) attribue cette faiblesse initiale à trois raisons : i) l'état
du champ scientifique, marqué par la faiblesse de la science politique jusqu'aux années 1960
et par la crise de la sociologie française ; ii) la professionnalisation tardive des pratiques
communicationnelles en politique en France, usages considérés péjoratifs, et iii) les années
1960, dont l'élection de 1965 représente un acte de rupture pour la communication politique
en tant qu'objet scientifique légitime. Ce scrutin mérite une attention spéciale pour trois
raisons : en premier lieu, parce que c'est la première élection du président au suffrage
universel direct après la réforme de 1962 ; c'est aussi le moment où les instituts de sondage
occupent une place de relief vis-à-vis des élections, rendant une légitimité au rôle des
sondeurs à cet égard31 ; enfin, 1965 présente aussi le général de Gaulle, 72 ans, parmi les
candidats, mais le grand personnage de la dispute sera le centriste Jean Lecanuet, 49 ans, qui
va concentrer sa campagne sur le « renouvellement » et la « jeunesse ». Ainsi, les
communicants insisteront sur le fait que les résultats positifs obtenus par le candidat à
l'occasion de l'élection de 1965 sont le résultat de sa stratégie de communication, dont la
31 Le ballottage du général de Gaulle annoncé par la Société Française d’Études par Sondage / SOFRES acontribué considérablement à la légitimation des sondeurs et de leurs instruments.
28
télévision a été la grande alliée.
Mais si les usages de la télévision figurent au cœur des préoccupations du personnel
politique au cours des années 1970, la décennie suivante est marquée par une vaste
production d'articles par les professionnels (tels que M. Bongrand, B. Rideau, J. Séguéla, T.
Saussez) et les journalistes politiques, qui essaient de traiter des changements de leur métier.
De son côté, le milieu universitaire va approfondir et problématiser les discussions autour des
changements de l'instance politique en cours depuis les années 1960. Même si ces études
pionnières apparaîtront en tant que thèmes plutôt que comme des courants de recherche, ils
signalent l'entrée de la « communication politique » dans le débat scientifique, initialement
dans le cadre de la science politique mais rapidement au sein d'autres disciplines, à travers
une approche interdisciplinaire.
Pour Arnaud Mercier (2001), malgré le progrès dans la production des études, il n'est
pas encore possible de parler de traditions de recherche, de filiations clairement identifiées ou
de laboratoires de recherche dont l'objet se tourne spécifiquement vers la communication
politique. Ainsi, l'interdisciplinarité inhérente à ce champ d'étude conduira des chercheurs de
différentes chantiers scientifiques à s'intéresser aux enjeux qui entourent la communication
politique. Pour les questions de communication politique en général, l'auteur attire
notamment l'attention sur les travaux de S. Albouy, R. Cayrol, P. Champagne, J. Gerstlé, É.
Neveu. Des chercheurs venus de la discipline sont apparus, tels que L. Blondiaux, D.
Georgakakis, J.B. Legavre, A. Mercier. Au vu de la relative faiblesse des politologues, le
champ est aussi souvent exploité par des sociologues et spécialistes en sciences de
l'information et de la communication, à l'instar de J. Bourdon, D. Wolton, É. Maigret, J.
Bourdon... Concernant les thèmes privilégiés de ces travaux, A. Mercier mentionne i) la
publicité et le marketing des hommes politiques, l'un des sujets centraux des recherches dans
ce domaine et les élections présidentielles l'occasion de nouvelles études ; ii) l'influence des
médias dans l'évolution du discours et du fonctionnement de la démocratie médiatique ; iii)
les travaux sur la communication politique et la rhétorique lors des campagnes ; iv) la
communication politique locale, qui tend à devenir majeure ; v) les interactions entre les
acteurs politiques et les différents acteurs du champ de la communication en générale ; vi) les
interactions entre les champs médiatique et politique prennent forme également à travers les
études sur l'agenda-setting et enfin vii) les études sur l'influence des informations reçues par
les électeurs sur leur position politique. Cet aperçu révèle donc la pluralité et l'hétérogénéité
des perspectives, mais aussi les divergences qui entourent les différents rattachements
29
disciplinaires possibles.
En se focalisant sur les particularités du thème en France, É. Neveu (1992) évoque
trois équivoques qui enveloppent le traitement de la communication politique. Le premier
concerne la nouveauté du phénomène. L'auteur souligne les rappels de Max Weber et P.
Bourdieu sur le maniement des mots et symboles par les acteurs de la sphère politique,
pratique usuelle indépendamment des époques. La deuxième approche trompeuse est la
confusion entre le discours des professionnels et le discours des universitaires sur le sujet.
D'après le chercheur, d'un côté se situe la prise en compte des contributions scientifiques des
praticiens, de l’autre la redécouverte des méthodes des sciences sociales comme innovatrices,
mais sans mise en valeur des apports de leur activité au savoir. Enfin, É. Neveu mentionne la
communication politique serait née des besoins professionnelles. Ainsi l’objectif des
représentants politiques de maximiser leurs chances et de s'adapter aux médias, et celui des
publicitaires d'élargir leur champ d'action auraient conduit au développement de cette
spécialité communicationnelle. De ce point de vue, cet ensemble, appelé « communication
politique », représenterait une sorte de rhétorique moderne soumise aux impératifs et
obstacles des différents médias, tels que l'attention au temps et au langage ainsi qu'à leurs
logiques de production, ce qui demande une certaine maîtrise des outils médiatiques par le
personnel politique.
Au-delà de ces pistes, É. Neveu (1998) affirme que « Le concept réducteur de
'communication politique' cache en réalité une réorganisation fondamentale du modèle
'représentatif' du métier politique et de son rapport aux mondes du journalisme et des
sciences sociales »32. Ainsi, l'auteur propose de penser l'évolution des mises en scène du
politique en prenant en compte les relations existant entre les divers protagonistes de la
communication politique, dont ceux de l'instance médiatique. Parallèlement, pour
comprendre ces interactions complexes entre le personnel politique, les conseillers en
communication et l'instance journalistique, il faut de même considérer les effets des usages
pratiques des outils des sciences sociales, tels que les sondages, sur l'émergence des formes
médiatisées de la vie publique.
Malgré certaines faiblesses des recherches dans ce domaine en France, elles ont posé
le débat sur le statut des sciences sociales dans le fonctionnement des relations entre les
instances politique et journalistique, dont les points les plus importants sont : i) le processus
de rationalisation des messages politiques, formatés selon les attentes des médias et orientés
32 Neveu, 1992, pp. 166.
30
par les attentes d'une opinion publique mesurée et « contrôlée » par les sondages ; ii) les
interrogations sur la professionnalisation de la vie politique, au sein de laquelle la relation
entre consultant et homme politique attire l'attention ; et iii) le renouvellement du propre
personnel politique, l'existence d'une capacité réflexive de gestion des médias et des
journalistes devenant une nécessité du politicien moderne. Ce dernier point est directement
lié à un changement fondamental subi par la sphère médiatique. En effet, la fin du contrôle
étatique de la télévision a engendré chez les journalistes une nouvelle dynamique de travail
marquée par l’autonomie, donc la possibilité de se présenter comme les juges d'une
« politique malade » constituée de « politiciens professionnels ».
D'après É. Neveu (1998), la mise en avant de la crise de la représentation, voire de la
démocratie, est aussi une autre problématique qui accompagne les études sur les rapports
entre le système et les enjeux politiques des réseaux de communication. L'auteur explique
que « Ce sont enfin les conditions même des interactions entre journalistes et hommes
politiques qui ont contribué à engendrer une forme de prise de distance au politique. La
combinaison des impératifs médiatiques et de leur analyse critique par les journalistes de la
presse écrite ont contribué à rendre visible à un large public le caractère artificiel d'une vie
politique colonisée par les petites phrases et les consultants »33. C'est à la lumière de ces
remarques et à travers cette perspective élargie des rapports entre les protagonistes de la
communication politique moderne que nous allons aborder notre objet lors de la discussion
de nos résultats.
2.4 La Communication Politique experte en France : quelle place dans le champ politique ?
L'introduction du savoir-faire du monde de la communication au sein du jeu politique
a eu lieu graduellement, comme on peut constater par l'apparition tardive des sondages
d'opinion dans la presse « de reférence » (Riutort, 2007). La fondation de l'Institut Français
d'Opinion Publique (Ifop) en 1938 par le psychosociologue Jean Stoezel annonce déjà le
début d'une nouvelle étape de la vie politique française qu i prendra son véritable envol
durant l'après-guerre. Face à une opinion publique difficile à saisir, la technique du sondage
s’affirme de plus en plus comme un outil intéressant pour le personnel politique, qui l'utilise
initialement de façon confidentielle. À partir des années 1950 et 1960, la publication des
33 NEVEU Érik, « La communication politique : un chantier fort de la recherche française », 1998, Polis, Vol5, disponible sur http://www.polis.sciencespobordeaux.fr/vol5n1/article3.html.
31
sondages dans les colonnes politiques des quotidiens français devient pratique commune.
L’objectif est de légitimer le comportement des représentants politiques auprès de l'opinion.
La généralisation des sondages marque le passage à une nouvelle conception de l'opinion
publique, qui n'est plus le produit de l'addition des opinions des gens face à un problème
donné, mais le produit du travail des enquêteurs sur des échantillons dits « représentatifs » de
la société (Champagne, 2001).
Autre élément important dans le cadre de la politique moderne, la communication a
acquis un statut important au sommet de l'État à partir de la Ve République. En raison de son
association souvent à la propagande, la création d'une structure institutionnalisée pour
l'information gouvernementale date de 1963, avec le Service de liaison interministérielle
pour l'information (SLII), responsable des politiques d'information et des relations presse sur
l'action gouvernementale. En 1968, le Comité Interministériel pour l'Information (CII) est
responsable des actions d'informations des ministères et de la diffusion dans l'opinion de
l'action des pouvoirs publics. En 1974, la Délégation générale à l'information (DGI) est
rattachée au ministère de l'Information. Sa mission consiste notamment à gérer les relations
avec la presse. Deux ans après, cette structure devient le Service d'information et de diffusion
(SID), rattaché au Premier ministre et responsable des actions d'information
interministérielle, de l'assistance technique aux administrations publiques et de la
coordination de leurs interventions, ainsi que de la diffusion des informations aux élus et à la
presse sur l'action des administrations de l'État français. Ainsi apparaît le service de
communication publique, caractérisé par les usages des instruments d'objectivation de
l'action publique, tels que les sondages, et par la présence des consultants auprès du
personnel politique.
Néanmoins, jusqu'aux années 1980, la majorité des hauts fonctionnaires du
gouvernement ne possédaient aucune familiarité avec l'univers de la communication,
considérée comme une activité subalterne et sans importance pour l'activité publique. En
1996, le SID devient le Service d'Information Gouvernementale (SIG), structure sous la
tutelle du Premier ministre et responsable de l'accompagnement de l'évolution de l'opinion
publique, du traitement médiatique des actions du gouvernement, de la diffusion des
informations au grand public des activités du Premier ministre et de la coordination au niveau
interministériel de l'action gouvernementale34. Cette première étape de la modernisation
34 Plus d'informations sur le Service d'information du gouvernement, voir http://www.gouvernement.fr/histoire-du-sig.
32
technique de l'espace politique va octroyer une certaine autorité professionnelle aux agents de
la communication gouvernementale en raison de l'attention portée aux données statistiques
pour mesurer l'opinion. À partir de là, la communication est devenue une préoccupation
permanente pour les acteurs de la scène politique dans la conquête et exercice du pouvoir.
Dans une ambiance informationnelle dynamique nourrie de flux ininterrompus, bien
communiquer et entretenir de bonnes relations avec les professionnels de l'information
deviennent deux points fondamentaux pour l'exercice de l'activité politique. Actuellement,
l'attention portée à la communication dans les différentes institutions politiques révèle que,
loin d'être une activité secondaire, la gestion de la communication est devenue l'une des
priorités des représentants de la sphère du pouvoir. La promotion médiatique des actions
gouvernementales est aujourd’hui une condition sine qua non de la visibilité sociale de
l'action politique (Riutort, 2007).
Ainsi, l'exercice de l'activité politique moderne impose certaines exigences à ses
praticiens. D'un côté, il faut se familiariser avec les outils informationnels et accompagner
leur évolution pour être capable d'établir et d’alimenter le lien avec le public. De l'autre, il
faut tenir compte des exigences des médias pour parvenir à cette sphère de visibilité
indispensable à la vie politique actuelle. À cet égard, J.B. Legavre (1994) soutient que le
recours croissant aux techniques et stratégies de communication en politique serait davantage
un signe qu'un vecteur de la rationalisation de l'activité politique face à l'affaiblissement des
contacts directs entre élus et électorat. Ainsi, le contexte informationnel, notamment à partir
de la télévision, l'impuissance du journalisme en tant que moyen efficace pour diffuser les
messages de l'instance politique, la position des acteurs dans le champ politique, ainsi que la
situation de compétition voire de concurrence permanente entre adversaires favorisent
l'entrée de nouveaux acteurs dans le champ politique. D'abord avec les spin doctors, ensuite à
travers des conseils de communication au sein des institutions politiques.
A) Un métier en voie de professionnalisation ?
Le processus de reconfiguration de l'espace social produira des effets structurels
directs sur le champ politique. Ainsi, ce contexte demande de nouvelles compétences au
personnel politique, dont l'incorporation des nouveaux acteurs dans les coulisses du pouvoir
représentent une étape importante du mouvement de rationalisation du jeu politique. En ce
33
sens, il nous semble pertinent de nous interroger sur la façon dont la montée en puissance des
médias de masse puis de l'Internet favorise non seulement une reconfiguration des routines
du champ politique et de sa façon de communiquer mais contribue aussi à l'émergence d'une
nouvelle profession au long terme – celle des communicants politiques.
Dans son article (à paraître en 2016) sur la professionnalisation de la communication
politique, Christina Holtz-Bacha (2016) met l'accent sur la polysémique de ce terme, souvent
associé à la notion d' « américanisation » des campagnes politiques. La chercheuse souligne
que la majorité des travaux consacrés à ce sujet portent sur la sophistication des partis et des
équipes lors d'une campagne, étant les études sociologiques à ce sujet très rares. À cet égard,
la création du CAMPROF Index35, un instrument développé par R.K. Gibson et A. Römmele
pour mesurer le degré de professionnalisation des partis et de leurs activités lors des
campagnes électorales, est un avancement très intéressant et révèle un intérêt en amont aux
modes opératoires et aux pratiques communicationnelles dans ce domaine. Au lieu de se
pencher uniquement sur les consultants politiques, cet outil permet une analyse de la
professionnalisation au sein des partis politiques en ce qui concerne leur organisation, les
instruments et stratégies mis en place, tenant en compte de leur positionnement idéologique,
de leur dimension et de leur soutien auprès de l'électorat. L'enquête fut réalisée auprès de
quatre partis qui participaient à la course électorale au Parlement Allemand en 2005 et la
réalisation d'entretiens avec les coordinateurs des campagnes a été complémentaire à
l'évaluation, d'ailleurs le Social Democratic Party (SPD) a présenté la campagne la plus
professionnalisée. Nonobstant son caractère pionnier, le COMPROF Index est limité aux
périodes électorales, ce qui ne permet pas son emploi à d'autres archétypes de la
communication politique, tel celui des instititutions gouvernementales, notre intérêt dans ce
mémoire. Au lieu de favoriser les approches instrumentalistes de la communication politique
électorale, nous proposons de penser la notion de professionnalisation des pratiques
communicationnelles en politique dans une perspective sociologique, en prenant en compte
les rapports de force dans ce domaine avec d'autres acteurs qui participent à sa construction.
L'acte de nommer une profession fonctionne en tant que marque distinctive, qui met
en avant la valeur de sa position dans l'espace social (Bourdieu, 1984). La définition du terme
« profession » demeure un objet de controverse théorique, notamment dans la courant
sociologique anglo-saxon, qui ne parvient pas à faire consensus sur les activités méritant
cette domination et celles plutôt désignées comme occupation. Cette problématique a des
35 Gibson, R. K. & Römmele, A. (2009). Measuring the professionalization of political campaigning. PartyPolitics, 15, 265–293. doi: 10.1177/1354068809102245
34
racines historiques, car certaines activités n’ayant pas été reconnues comme professions l'ont
été après-guerre en Angleterre, puis aux États-Unis. D'autres furent reconnues comme telles
durant une certaine époque mais non plus désormais. S'y ajoutent en outre les
questionnements sur les caractéristiques ou les raisons susceptibles de donner à un groupe
professionnel et à ses membres le statut de profession. Ainsi, la définition théorique d’une
profession oppose sociologues, historiens et juristes.
La sociologie française n’offre pas de mot équivalent au terme. En mettant l'accent
sur l'ambiguïté qui entoure cette problématique, Claude Dubar, Pierre Tripier et Valérie
Boussard (2011) repèrent trois univers de signification possibles selon les dictionnaires :
- (sens 1) La profession est une déclaration qui s'énonce publiquement et qui, comme la vocation, est
liée à des croyances idéologico-religieuses ;
- (sens 2) La profession est le travail que l'on fait, l'emploi que l'on occupe, dès lors qu'il permet d'en
vivre grâce à un revenu ;
- (sens 3) La profession est l'ensemble des personnes désignées (et se désignant) par le même nom de
métier au sens large d'activité semblable.
Face à ces trois champs sémantiques, les auteurs rappellent que le terme
« profession » désigne de plus en plus, en France, «(...) tous ceux [salariés, indépendants et
patrons] qui travaillent dans le même secteur [transport routier, chimie, grande distribution
ou impôts] et font donc partie de la même profession [on retrouve ici le sens 3] en se
reconnaissant dans les mêmes représentants patronaux ou syndicaux »36. En ce sens, C.
Dubar, P. Trippier et V. Bourrad ajoutent une quatrième définition – laquelle est centrale dans
le cadre de notre étude – en prenant en compte les usages de l'adjectif « professionnel », où
- (sens 4) La profession est une fonction, une compétence reconnue au sein d'une organisation : le
terme « reconnaissance » est au cœur de ce dernier univers de signification récemment remis à
l'ordre du jour par le discours politique.
Pour rendre compte des enjeux politiques, éthiques-culturels et économiques qui
encadrent cette problématique, la perspective de la sociologie des professions relie les
apports de la sociologie du travail et des organisations à ceux de la sociologie de l'éducation
36 DUBAR Claude, TRIPIER Pierre, BOUSSARD Valérie, Sociologie des professions, Armand Colin, 2011,pp. 12.
35
(formation professionnelle) et même de la sociologie politique et religieuse (relation entre
profession et croyances). En ce sens, « la sociologie des professions a donc un triple objet :
l'organisation sociale des activités de travail, la signification subjective de celles-ci et les
modes de structuration des marchés du travail »37.
Pour revenir à notre thématique de recherche, il faut placer les transformations
structurelles vécues par le champ politique français, notamment à partir des années 1960,
dans un processus majeur de reconfiguration de l'espace social qui a lieu à partir de la montée
en puissance des médias de masse. En ce sens, la demande de nouvelles compétences du
personnel politique en matière de communication peut être comprise dans le processus
d'innovation mis en œuvre par la réorganisation du scénario socio-informationnel. C'est au
cœur de cette dynamique inhérente aux évolutions de la société que se situe notre
problématique.
Ainsi, les auteurs expliquent que la notion de « professionnalisation », en France, est
centrée depuis les années 1990 sur le paradigme « de l'individu acteur et auteur de sa vie
professionnelle »38. Néanmoins, la circulation dans l'espace social a produit d'autres
significations et usages du terme, ce qui amène les auteurs à distinguer son emploi pour
parler de professionnalisme (dans le registre de l'injonction managériale ou étatique) et de
professionnalité (dans le cadre de la revendication identitaire). Les auteurs expliquent que,
dans un cas comme dans l'autre, l'utilisation du terme « professionnalisation » est liée à la
notion de subordination à un statut spécifique et à des règles formelles qui pèsent et orientent
leur activité. Le terme est aussi souvent employé pour remplacer celui de la création de
nouvelles activités par le management ou par l'État. Pourtant, les auteurs soulignent que
l'emploi du terme dans ce dernier cas signe l'existence de critères spécifiques de recrutement
appuyés sur les compétences. Mais cela ne qualifie pas ces activités de spécialisées et
qualifiées comme celles des « professionnels reconnus ».
Pour éclairer ces divergences, les auteurs reprennent la définition de Didier
Demazière (2009), pour qui le processus de professionnalisation serait le résultat
d'interactions, d'échanges, de conflits et négociations entre la multitude d'acteurs. D.
Demazière conclut que « La professionnalisation n'est pas donc la reconnaissance d'un
groupe professionnel, mais elle désigne un phénomène plus large : la diffusion de normes de
professionnalité sous la double impulsion de demandes de reconnaissance de travailleurs et
de formulations d'exigences de la part de leurs partenaires. La qualité de professionnel peut
37 Idem, pp. 14-15. 38 Wittorski, 2009 apud Dubar, Trippier, Bourrad, 2011, pp. 314.
36
alors être considérée comme une exigence généralisée dans le monde du travail : chacun se
doit d'être professionnel, de sorte que le professionnel renvoie de plus en plus à la figure du
travailleur qualifié, expert, autonome, animé par des valeurs d'engagement et de
responsabilité et impliqué dans une activité expressive et créative. »39
C. Dubar, P. Trippier et V. Boussard élargiront cette définition en proposant la
professionnalisation comme « un processus de fabrication par la formation, l'organisation et
l'expérience d'un membre s'intégrant à un collectif de travail et devenant reconnu par tous ses
partenaires »40. Cette proposition nous amène à la notion d'appartenance professionnelle,
dimension que nous allons discuter à l'occasion de la discussion des résultats de notre terrain.
Ainsi, ces repères sur la définition de profession et de professionnalisation orienteront
et éclaireront nos réflexions. Nous mettrons donc l'accent sur les conditions ayant favorisé la
mise en place de nouvelles compétences et critères d'excellence à l'égard du personnel
politique en matière de communication et montrerons comment cela contribuera à
l'émergence d'un nouveau type professionnel. Pour cela, l’objectif est d'esquisser le processus
de professionnalisation de la communication politique, de la fin des années 1950 jusqu'au
contexte actuel, en mettant en avant la nature conflictuelle entourant cette activité.
B) Le développement d'une expertise
Les tentatives de rendre compte d'un acte fondateur de la communication politique
experte se situent par rapport à Michel Bongrand, en 1965, et à Jean Lecanuet. Même si
certaines démarches spécialisées avaient déjà été mises en œuvre, c'est à partir de cette
élection que ce secteur commence à se professionnaliser.
Le spin doctor – ou conseiller en communication – est une importation des États-
Unis. Le terme désigne le professionnel qui, en s'appuyant sur les techniques du marketing,
travaille auprès des candidats et d'autres représentants politiques pour les aider à construire
une image publique favorable et attirante face aux médias de masse. À cet égard, le débat
télévisé opposant J. F. Kennedy et R. Nixon en 1960 représente un événement marquant et
souligne la puissance de ces professionnels dans le jeu politique, leur capacité à fabriquer un
président41. Cela conduit même à une reconfiguration de l'instance politique marquée par la
39 Demazière, 2009, pp. 88 apud Dubar, Trippier, Bourrad, 2011, pp. 316.40 Idem, pp. 31741 « Le célèbre face-à-face télévisé opposant Kennedy à Nixon au cours de la campagne présidentielle de 1960
est rétrospectiement érigé en cas exemplaire du « triomphe» des techniques modernes devant être importées
37
division du travail : conseillers, sondeurs et anciens journalistes jouent le rôle d'entraîneurs
des représentants du pouvoir face à l'univers médiatique. La légitimité attribuée à ce métier
aux États-Unis a d’ailleurs permis la fondation de l'International Association of Political
Communication (IAPC) en 1968 par Joseph Napolitan et Michel Bongrand. L'entité compte
aussi une association professionnelle et un code déontologique créé en 1975 (Riutort, 2007).
En France, à l'instar du retard pour la mise en œuvre des sondages après la fondation
de l'Ifop, la réglementation du métier avance lentement. Pour reprendre J. B. Legavre (1993),
les professionnels de la communication politique ont dû inventer leur propre rôle, leurs
responsabilités se limitant jusqu’alors à rapprocher les gouvernants des attentes des
gouvernés. Ainsi le succès de cette spécialité n’interviendra-t-il qu'après la montée en
puissance de la télévision, qui aurait « créé » de nouveaux besoins pour la mise en scène de
la vie politique.
Initialement, recourir aux conseillers en communication était une pratique commune
chez les outsiders du jeu politique, ceux qui avaient besoin de se rendre visibles et de
fabriquer leur identité et leur image auprès des électeurs. J. Lecanuet en représente un
exemple très net. Mais avec la montée des sondages dans la vie politique française (l'Élysée
possède une « cellule sondage » à partir de 1974), les conseils en communication sont placés
dans une position privilégiée qui culminera avec l'institutionnalisation d'une cellule
communication en 1984, sous la direction du publicitaire Jacques Pilhan et à l'occasion du
premier mandat de François Mitterrand42. Pour J. Pilhan, le rôle du conseiller en
communication est d’« Informer l'homme public qui va prendre une décision des
conséquences dans l'opinion qu'aura tel choix ou tel autre »43, conception stratégique qui reste
applicable au contexte actuel, comme nous allons le montrer plus loin.
Selon J.B. Legavre (1994), le représentant du pouvoir politique a un tribut quotidien à
la théâtralité. Dès l'Antiquité, le recours aux symboles s’avère nécessaire aux leaders pour
s'affirmer et se distinguer. Le symbolique demeure donc une dimension essentielle de
en France, puisque le résultat final – et surtout le faible écart de voix séparant les deux candidats – estentièrement imputé à la qualité de la performance télévisée du candidat démocrate » (Riutort, 2007, pp. 85)
42 L'élection de 1974 marque une nouvelle étape de la communication politique française, notamment dans lafigure de François Mitterrand. Face à la nouvelle ambiance informationnelle et au bouleversement apportépar la télévision comme outil de communication politique, la peopolisation prend son vol. Le présidentsocialiste a su s'en servir : il a compris que sa vie privée faisait partie de sa vie publique. Ainsi, enentremêlant trois tendances de l'époque (peopolisation, infotainment et usage des sondages comme mesured'opinion), Mitterrand émerge comme le leader le plus ajusté aux attents des électeurs et des journalistes àl'époque. Pour une bonne synthèse à ce sujet, voir: GUIGO Pierre-Emmanuel, « François Mitterrand et lacommunication: vocation ou conversion », 2013, disponible sur http://www.mitterrand.org/Francois-Mitterrand-et-la
43 Riutort, 2007, pp. 69.
38
l'exercice du pouvoir parce qu'il donne du sens à l'action politique, ce qui orientera la
division du travail vers la mise en place des conseils en communication. P. Riutort rappelle
que l'appellation « conseil » va nuancer et légitimer l'instauration au sein de l'activité
politique d'un métier dont les origines mêlent marketing et publicité, ce qui ne pose pas de
problèmes aux États-Unis mais rencontre des impasses pour acquérir sa légitimité en France.
Ainsi, la reconfiguration du scénario de la vie politique présente un ajustement structurel
entre ses acteurs, maintenant porteurs d'un rôle spécifique : le sondeur, qui mesure l'opinion,
le conseiller, qui entraîne l'homme ou la femme politique en fonction des résultats, et le
journaliste politique, juge du jeu politique moderne, qui évalue la performance du
représentant du pouvoir face à ses contraintes.
Cette situation rend visibles les rapports permanents entre « Politique – Média –
Publics » et soulève des débats sur les enjeux de la médiatisation de la vie publique
contemporaine. En outre, la mise en valeur des techniques et stratégies créées par ces
« professionnels de la communication » supposés saisir les attentes de cette opinion publique
mesurée par les sondages est renforcée par la croyance en une crise de la démocratie
représentative, notion largement partagée de notre temps. Alors, les conseillers
communicants seraient les sauveurs d’une vie politique en péril, et les responsables de la
mise en place d'une communication nouvelle en direction des gouvernés. Pour reprendre P.
Riutort (2007), « Il s'agirait alors, selon un credo qui se mue volontiers en novlangue, de
transformer le jeu politique en soumettant l'univers de la politique aux 'lois' de la
communication (simplifier le langage et les stratégies de présentation de soi mais aussi
transcender les clivages en pratiquant la « triangulation » qui consiste, à la manière des arts
martiaux, à s'approprier les arguments de l'adversaire afin de les retourner contre lui) »44.
Cette croyance place les conseillers en communication dans une position ambivalente entre la
communication et l'exercice du pouvoir politique lui-même, jouant de la complexité et des
contours flous de leur activité.
C) La quête d'une légitimité professionnelle
À coup sûr, les différentes étapes de la communication politique, de l'apparition des
premiers consultants des campagnes américaines à l'heure actuelle, révèlent une évolution
des pratiques communicationnelles et l’importance toujours plus significative de cette
44 Riutort, 2007, pp. 71.
39
activité dans les coulisses du pouvoir. Pour éviter une analyse excessivement technocratique
du phénomène, il faut réfléchir également, comme l'a proposé J.B. Legavre (1994), à la façon
dont ces pratiques sont traversées par des techniques et des règles formelles, mais aussi des
croyances. Il faut ensuite interroger la nature du phénomène en lui-même : ces différentes
étapes de la communication politique représentent-elles un symptôme de la
professionnalisation du champ politique ou sont-elles plutôt une conséquence naturelle face à
l'évolution de l'espace public médiatisé et désormais imposé ? Ou encore : ce processus
marque-t-il le passage d'un âge de l'amateurisme à l'ère d'une professionnalisation ou signe-t-
il une évolution des besoins du champ politique dans l'actuel contexte informationnel ?
La notion d'une professionnalisation de la sphère politique est liée au processus de
division du travail et à l'entrée d'autres acteurs dotés d’expertises spécifiques dans le domaine
politique. D. Demazière et Patrick Le Lidec (2014) metttent l'accent sur les contours flous du
« travail politique » pour démontrer la nature collective de cette activité sociale, marquée par
des négociations et ajustements permanents avec d'autres acteurs, groupes et institutions,
ainsi que par une logique très proche de l'univers du travail en ce qui concerne les
hiérarchies, les régulations et les contraintes qui pèsent sur la carrière de ceux qui en font
partie. En comprenant l'univers politique comme un univers professionnel très particulier, les
sociologues soulignent qu'il ne suffit plus au politique moderne de maîtriser les codes
inhérents à son rôle spécifique, mais qu’il lui faut aussi s'intégrer à un monde du travail
également monde social.
Néanmoins, la professionnalisation de l'instance politique est souvent associée à
l'abandon d'une représentation du travail politique sous-tendue par la « vocation » au profit
d'une conception plus pratique, dont les motivations ne sont plus de l'ordre du vivre « pour »
la politique mais plutôt celui du vivre « de » la politique. Lié à cette problématique,
l’argument de la rationalisation de l'activité politique est souvent utilisé pour mettre en cause
les effets néfastes d'une « professionnalisation excessive » de la communication politique.
L'insertion d'autres acteurs « non légitimes » dans la composition de l'entourage des hommes
et femmes politiques nourrit dès le début une méfiance envers ces professionnels, qui
contribueraient à une détérioration de la parole politique contemporaine. Or, cette activité
n'étant qu'une partie des responsabilités et préoccupations inhérentes à la vie politique, cette
approche semble à la fois simpliste et unidirectionnelle face à la complexité du jeu politique.
Ainsi, au poids croissant de la communication dans l'espace politique contemporain
s’ajoute l'image sociale des communicants politiques. D'un point de vue manichéen et
40
comme le souligne Didier Georgakakis (1995), leur représentation symbolique oppose
homme des ombres versus hommes publics d’une part, fossoyeurs de la démocratie versus
auxiliaires politiques légitimes d’autre part. Selon l'auteur, la polémique entourant ce débat
s'expliquerait par la concurrence entre un groupe constitué (les journalistes) et un autre en
voie de constitution (celui des conseillers en communication). D. Georgakakis attire
l'attention sur l'existence d'une compétition proprement politique entre ces deux types de
professionnels, ce qui enfermerait en quelque sorte les positions et images sociales des
communicants dans l'univers de l'ombre.
Face à cela, il est intéressant de réfléchir aussi à la façon dont ces hommes de l'ombre
essaient souvent de passer de l'autre côté de la scène pour acquérir de la notoriété. À cet
égard, Jacques Séguéla représente un modèle45. La participation du publicitaire à plusieurs
campagnes (1970, 1978 et 1981) lui permettra de profiter de la victoire des candidats
respectifs pour se faire valoir et légitimer le savoir-faire des « nouveaux publicitaires ». Ceux
derniers passent désormais à une nouvelle étape : celle de faire-savoir, marquée par la
publication de plusieurs ouvrages et par une présence affichée dans les médias expliquant les
stratégies du succès. Ainsi, l'argument technique des nouvelles mises en scène de la politique
devient une interprétation constante pour expliquer la défaite des candidats. D. Georgakakis
ajoute que la visibilité de J. Séguéla et de son agence Publicis durant cette période explique
les liens entre position et exposition dont le publicitaire a su profiter. En ce sens, « la figure
de Jacques Séguéla, publicitaire, nuit en effet à l'imposition (et à la visibilisation) de la
communication politique comme spécialité différenciée ».46 Étant donné l'incontestable
transformation structurelle de la vie politique de ces dernières décennies, discuter le statut et
la place de ce nouvel acteur du jeu politique devient un devoir permettant d’envisager de
nouveaux horizons de représentation sociale de la démocratie capables de les intégrer comme
composante de la machine politique.
Mais avant de placer les communicants politiques dans une position supérieure de
manipulateurs des leaders partisans, il est fondamental d'envisager leur rôle dans le dit
processus. Les représentants de la sphère du pouvoir possèdent tous des compétences
spécifiques, de même que leurs propres préférences et motivations. Ainsi, moins que celui de
manipulateur, le rôle du communicant politique consiste davantage « (..) à valoriser l'action
du dirigeant, façonnant son personnage et mettant en valeur ses qualités de gouvernance :
45 Pour savoir plus, GUIGO Pierre-Emmanuel, ROSE Christophe, 2014, « Entretien avec Jacques Séguéla »disponible sur http://www.mitterrand.org/Entretien-avec-Jacques-Seguela-1.html.
46 Georgakakis, 1995, pp. 9
41
déclarations face aux grands événements, association aux décisions les plus attendues,
capacité à s'identifier à de grands enjeux »47, pour reprendre les termes de Jean-Marie Charon
(2004). Ayant comme objectif la conquête de la popularité, l'approbation et le soutien de
l'opinion publique, et l’assurance de leur présence dans la sphère de visibilité médiatique, les
représentants politiques doivent suivre les conseils des professionnels de la communication.
À l'instar du modèle américain, où le recours aux sondages fut employé dès l'époque
de J. F. Kennedy pour contrôler les préférences de l'opinion publique, Nicolas Sarkozy en a
profité pour ajuster son gouvernement aux attentes du peuple, notamment grâce à de
nombreuses interventions télévisuelles, en particulier à l'occasion des enquêtes défavorables.
Prenant en compte la capacité de l'instance médiatique d'introduire dans le débat public
certains sujets au détriment d'autres, l'accompagnement de l'actualité médiatique devient une
obligation de l'homme politique moderne. Comme l'explique Jean-Louis Missika48, N.
Sarkozy a bien compris, lui aussi, la nécessité de se servir de l'actualité et le potentiel des
médias pour dialoguer avec les Français.
À l'ère des « campagnes permanentes », la préoccupation de la représentation
politique dépasse la période limitée à l'élection : plus encore que de façonner seulement leur
propre image, les représentants s’évertueront aussi à contrôler la façon dont les médias la
saisissent et la diffusent auprès du public, à la fois audience et électorat. Ainsi, les difficultés
d’interprétation de l'instance médiatique justifient l'intégration par les politiciens des « (…)
logiques communicationnelles dans leur activité en tentant d'anticiper les éventuels effets
produits par la médiatisation de leurs décisions, de leurs prises de position et de leur image
publique »49.
D'un côté, le glissement vers un paysage informationnel toujours plus dynamique
exige l'adaptation des leaders politiques ; de l'autre, le renouvellement du personnel politique
doit répondre aux besoins d'une ambiance sociale et médiatique réinventée. S’y ajoute le
poids des conseillers en communication politique dans un contexte historique où
communiquer devient plus que jamais un acte politique dans toutes ses dimensions. Les défis
de la vie politique médiatisée supposent de maîtriser les différentes présentations de soi – vie
privée versus vie publique – pour assurer son capital politique et sa légitimité auprès de
l'opinion.
47 CHARON Jean-Marie, « Les spin doctors au centre du pouvoir », Revue internationale et stratégique,2004/4 N°56, p. 99-108. DOI : 10.3917/ris.056.0099. pp. 9
48 Entretien au Le Monde disponible sur http://www.lemonde.fr/societe/article/2007/09/05/jean-louis-missika-la-strategie-mediatique-de-nicolas-sarkozy-finira-par-avoir-un-cout-politique_951401_3224.html.
49 Riutort, 2007, pp. 102.
42
2.5 Le discours politique contemporain : innovation ou détérioration ?
Jusqu'ici, nous avons présenté la façon dont l'instance politique s'est adaptée aux
évolutions du paysage informationnel et médiatique. Ces transformations ont institué un
nouveau répertoire des rituels propres à l'activité politique, concernant notamment la
représentation symbolique du pouvoir dans l'espace public médiatisé. À l’heure actuelle, les
possibilités d’une communication politique plus mûre et plus moderne deviennent alors
centrales.
Nous avons déjà souligné que l'homme politique est loin d'être un jouet dans les
mains des conseillers en communication. Néanmoins, les nouvelles règles du jeu politique
insistent sur le rôle de ce professionnel, dans les coulisses du pouvoir. D'un côté, il permet
aux hommes et femmes politiques d’identifier leurs points forts, leur « personnage », puis de
dessiner une stratégie permettant son identification par les médias et le public. De l'autre, le
communicant doit rester attentif aux enjeux et thèmes qui émergent du débat public
(notamment à travers les médias), et orienter le comportement et le moment d'intervenir
selon la conjoncture (Charon, 2004). Ce double rôle des conseillers est sous-tendu par la
fragilité de l'activité politique moderne, dont les représentants sont soumis à l'exposition, à
l'appréciation voire aux jugements permanents de l'ensemble des canaux médiatiques et
également de l'opinion.
Rappelons que le discours sur une « crise de la représentation démocratique »
accompagne les critiques de la professionnalisation excessive de la communication politique
qui serait en cours. En ce sens, de nombreuses recherches sur les transformations de la
politique à l'ère des médias de masse mettent souvent l'accent sur la détérioration du discours
politique.
Parler, en politique, signifie rendre compte i) d'un certain nombre de contraintes, ii)
des vecteurs de communication utilisés et des publics concernés (les professionnels de
l'instance médiatique et le « grand public » proprement dit). C'est un processus de
concertation permanente, parfois conflictuelle : l'instance politique doit concilier intérêts et
objectifs des différents secteurs de la société. P. Braud (2008) explique que l'acte de parler en
politique signifie « (…) s'insérer dans un système sans fin de prises de positions et réactions
où ce que s'est dit hier commande étroitement la façon de s'exprimer aujourd'hui, laquelle
doit anticiper ce qui se dira demain »50. Ainsi, dans l’arène, la position du représentant
50 Braud, 2008, pp. 673.
43
politique l'oblige à s’ajuster parfaitement aux différentes conjonctures, mais sans jamais se
contredire.
À partir des années 1950, avec l'introduction des nouvelles techniques du marketing
et de la publicité dans le jeu politique, les violences verbales caractéristiques des luttes
politiques s’effacent. En même temps, une désidéologisation progressive de la
communication politique s’impose au profit d'un discours plus neutre et plus moderne. Cette
transformation du discours politique est liée au processus de rationalisation de son action. Le
choix des mots se concentre dans l'intérêt collectif, référence légitime et universelle de
l'action du représentant du pouvoir dans la Cité.
P. Braud (2008) explique que la dimension symbolique du langage passe par
d’intéressants déplacements lexicaux. L'assignation des places et l'utilisation d'un langage
spécifique sont largement employés. Par exemple, au « maintien de l'ordre » dont parlent les
gouvernements libéraux et qui suggère la violence, les gouvernements de gauche préfèreront
le « maintien de l'ordre républicain ». Or, la notion de « République », représentation
suprême du bien collectif, légitime leur discours face à des adversaires alors subtilement et
indirectement disqualifiés.
À l'ère de l'image, la médiatisation de la vie politique est une composante de l'art de
gouverner. Ainsi, les batailles discursives sont au cœur de l'activité politique contemporaine
dans toutes ses dimensions. Il ne suffit pas d'être un bon leader ; il faut légitimer cette image
auprès de l'opinion, dont l’accès est essentiellement monopolisé par la sphère médiatique. La
conquête d’une visibilité favorable est donc une préoccupation constante des hommes et
femmes politiques, dont l’image publique demeure flottante et constamment soumise aux
interprétations des professionnels de l'instance médiatique. Ainsi, le fonctionnement même
des médias – phrases courtes, gestes et représentations caricaturaux, contraintes de temps etc.
– exige une posture réflexive du personnel politique, dont le lexique demeure un aspect
incontournable.
A) Le rôle du langage
La problématique de la communication politique est étroitement liée à celle du
discours politique : le langage est un élément crucial de la parole publique.
Chez P. Charaudeau (2005), « (…) tout discours s’inscrit dans un certain cadre
44
actionnel où sont déterminés les identités sociales, les buts et les rôles sociaux des partenaires
de l’échange langagier »51. Ce cadre, défini comme « situationnel » ou
« communicationnel », possède un certain nombre de contraintes déterminant le
comportement discursif de chacun, les modalités de la prise de parole, des rôles énonciatifs
de chaque partenaire et des modes d'organisation des discours attendus. D'après l'auteur, c'est
dans ce cadre que prend forme le projet d'influence du sujet communiquant, lequel résulte de
la combinaison des contraintes du cadre situationnel, d’une vision du monde social, de
l'expérience et des systèmes de valeur dans lequel le sujet parlant s’inscrit. Pour P.
Charaudeau, l'acte de langage se conçoit dans une perspective intentionnelle : le locuteur se
met en relation avec son interlocuteur (relation fondée sur un principe d'altérité) pour le
ramener à lui-même, à ce qu'il pense, à ce qu'il dit ou fait selon son intention (principe
d'influence). Ces principes sont au fondement de la communication politique car ils lui
donnent, dans le contexte de l'exercice du pouvoir, du sens, de la légitimité.
P. Charaudeau rappelle aussi le processus qui amène la communication et le langage à
l'action, aux stratégies et au rapport complexe entretenu entre les trois instances52
impliquées : l'instance politique, l'instance citoyenne et l'instance médiatique (comme nous
allons encore en parler plus loin). Autrement dit : « Le discours, d'une manière générale, rend
possible, justifie et transforme les rapports sociaux, et le discours politique rend possible,
justifie et transforme l'action politique »53. Nous comprenons que le discours politique
s'inscrit dans les stratégies et les objectifs des acteurs qui l'énoncent. En tant qu'activité
symbolique devenue possible grâce aux pratiques et activités à travers lesquelles ces acteurs
s'opposent les uns aux autres, s’esquisse un conflit entre une vérité des apparences mise en
scène par le discours et, d’autre part, une vérité des actions mise en place par les décisions
prises. Le positionnement de P. Charaudeau l'inscrit donc dans le cadre de la « politique
délibérative » habermasienne54 qui divise le pouvoir politique en deux sphères : celle du
débat d'idées, où ont lieu les discussions et échanges de l'espace public ; et celle du faire
politique, champ des prises de décisions et des actes. Le langage domine dans le premier cas,
dont l’objectif est l'acquisition d'une légitimité, pendant que l'action prédomine dans le
second, dont le but est l'exercice de l'autorité. Cela met en avant le caractère ambigu du
51 Idem.52 D'après P. Charaudeau, ces instances se définissent selon leurs attributs identitaires, lesquels définissent de
même leur finalité communicationnelle. 53 CHARAUDEAU Patrick, A quoi sert d’analyse le discours politique ?, in Análisis del discurso político,
IULA-UPF, Barcelone, 2002, consulté le 3 janvier 2015 sur le site de Patrick Charaudeau - Livres, articles,publications.
54 CORROYER Grégory, Lecture critique de l'ouvrage de Patrick Charaudeau, Le Discours politique.Les masques du pouvoir, Langage et société, 2008/4 n° 126, p. 95-106. DOI : 10.3917/ls.126.0095.
45
discours politique, construit sur une dialectique entre l'opinion et la vérité et qui se trouve
mélangé entre la parole qui doit fonder la politique et celle qui doit la gérer.
De son côté, J. Gertslé (2008) met l'accent sur la polysémie du terme Communication
Politique, dont il propose quatre conceptions. La première est une conception instrumentale
et réductrice du phénomène, envisagé comme une conception technique de la communication
et une conception manipulatoire de la politique, tels les premières approches sur les rapports
entre la télévision, les sondages et la publicité dans le domaine politique l’ont montré.
Ensuite, l'auteur parle d'une vision œcuménique, qui consisterait en « un processus interactif
concernant la transmission de l'information entre les acteurs politiques, les médias
d'information et le public »55. Cette représentation systémique ne tient pas compte des
rapports de force entre les acteurs, qui échangent d'autres biens symboliques tels les images,
les préférences et les représentations du politique. Une troisième définition rend compte
d'une conception compétitive de la communication politique, qui a pour but d’influencer et de
contrôler la perception publique des événements de la vie politique et dont le cognitif et le
symbolique jouent un rôle central. Dans cette proposition, la communication politique se
construit sur le conflit et la concertation avec les autres acteurs. L'intrusion des médias
participe alors à la construction du sens. Enfin, le débat et la discussion sont au centre de la
conception délibérative : la communication et la politique sont consubstantielles, l'idéal de la
démocratie élargi, et l'inclusion des citoyens permet l'émergence d'un véritable espace public
de discussion.
Considérant l'activité politique comme un champ de guerres symboliques dont le but
est d'établir des relations de domination ou des pactes de convention, la communication
politique, en tant que composante du discours politique, figure comme un objet complexe.
Cette discipline inclut les relations entre le personnel politique, les mises en scène du pouvoir
et ses contestations, l'électorat et les mutations du système médiatique lui-même (Riutort,
2007). Il semble donc pertinent de ne pas mettre seulement l'accent sur son aspect
pragmatique, mais de l'envisager en tant qu'annexe du métier politique, capable de mettre en
cause les jeux et enjeux de l'espace public contemporain et l'évolution structurelle de la
politique moderne.
55 Norris, 2000 apud Gerstlé, 2008, pp. 13.
46
B) Communiquer ou « mentir vrai » en politique ?
Certes, les transformations du champ politique relèvent d'un processus d'évolution
majeur par lequel passe l'activité politique. Plus qu'une seule reconfiguration structurelle et
pragmatique, ce domaine exige une revue théorique devant rendre compte de la complexité
des rapports des nouveaux et différents acteurs. Alors que les échos d'une crise de la
représentation, voire de la démocratie, s’imposent, la parole du discours politique, reprise par
l'instance médiatique et diffusée auprès du public, acquiert un poids fondamental.
Chez P. Charaudeau (2005), le discours politique est, par excellence, un espace de jeu
de masques, où chaque mot prononcé doit être considéré tant par ce qu'il dit que par ce qu'il
ne dit pas. Cet espace se situe entre l'instance politique et l'instance citoyenne, établissant
entre les deux un jeu de miroir : il doit à la fois correspondre aux attentes de la collectivité et
y articuler le pragmatisme nécessaire à la gestion du pouvoir. Cette proposition soulève la
question du mentir en politique, possible de différentes manières (le silence, l'omission, la
dissimulation etc.), et rejoint l'idée des masques du pouvoir, laquelle – explique l'auteur – ne
suppose pas simplement de cacher la réalité, mais révèle les diverses représentations
identitaires des acteurs qui s'affrontent et débattent. Ainsi s’affirme d’un côté la vérité des
apparences, mise en scène par le discours, de l'autre celle des actions, concrétisée par les
décisions. Emerge alors la notion de vraisemblance, concept fondamental de la parole
politique sans lequel l’action, dans l'espace public, ne serait pas possible.
Alexandre Eyriès (2013) propose à ce sujet une réflexion critique sur les nouvelles
stratégies de mise en scène, lesquelles reposeraient sur la légitimation du mentir-vrai.
L'auteur reprend les contributions de Christian Salmon pour expliquer que cette tendance
contribue à déborder l'espace symbolique de petites stories, empêchant finalement la mise en
place d'un véritable échange avec les citoyens, mais aussi l'exercice d'une réflexion critique
sur les pratiques politiques elles-mêmes. En envisageant la politique comme fictionnelle (les
mises en scènes et stratégies discursives et visuelles des leaders), et réelle (en tant qu'action
légitime de la vie publique), ce scénario construit une ambiance où il devient difficile, dans
les représentations du pouvoir, de distinguer le vrai du faux, le réel de la fiction. Malgré son
regard critique sur les transformations de la représentation symbolique du pouvoir, A. Eyriès
s’accorde avec P. Charaudeau pour proposer une conception de la communication politique
intégrée dans l'ensemble des modes de communication sociale, qui s’appuient sur les
échanges langagiers et leurs rapports de force, persuasion et séduction. De fait, les définitions
47
de cette spécialité communicationnelle sont toujours refondées, sans cesse renouvelées.
Sachant qu'entre l'instance politique et l'instance citoyenne s'installe une série de
relations complexes dont les échanges passent nécessairement par l'instance de médiation, le
phénomène politique est soumis, dans l’espace social, aux divers modes de circulation. P.
Charaudeau ajoute que l'analyse de la communication politique doit prendre en compte le
message (ce qui est dit), ses contraintes, son support de diffusion et l'impact qu'il peut avoir
auprès de l'opinion publique. Le linguiste remarque aussi la façon dont les représentants
politiques interviennent dans les médias, donc sur la scène publique, pour y construire leur
propre image. Ainsi observons-nous la nature collaborative du processus de construction de
l'image des hommes et des femmes politiques, liée aux rapports de ses acteurs (partis,
groupes de pression, opposition, conseillers, journalistes etc.).
En reliant les transformations de la politique à l'émergence de l'espace public
médiatisé, A. Eyriès souligne la dimension persuasive du langage politique. Selon lui, cette
stratégie permettrait de correspondre aux attentes de la sphère médiatique, très attentive aux
« petites phrases » synthétisant une idée ou un projet complexe en quelques mots. Ainsi, dans
l'ambiance informationnelle actuelle, la réorganisation des rapports des différents acteurs de
la sphère sociale, accompagnée par le rôle croissant des médias – principalement
audiovisuels – , conduit les médias à favoriser l'anecdote plutôt que l'analyse. Naît ici un
double phénomène : la spectacularisation et la peopolisation du politique. Favorisant les
stratégies aux problèmes publics, les émissions du type talk-show cherchent alors à
« révéler » ce qui se cache derrière le représentant du pouvoir, renforçant par là même le
sentiment de désenchantement et de confusion vis-à-vis de la classe politique.
Malgré toutes ces impasses, le discours produit par l'instance politique fonctionne
comme le grand lien de la trinité « Politique – Médias – Publics ». Pourtant, la logique propre
à l'espace public contemporain impose certaines contraintes à ceux qui souhaitent parvenir et
se maintenir au pouvoir : être politicien de nos jours signifie accepter de jouer le jeu du
symbolique et de maîtriser les différentes représentations de soi. Ainsi vont les évolutions de
la politique en France comme dans toutes les démocraties, lesquelles recourent toutes à une
véritable théâtralisation du jeu politico-médiatique, conséquence de l'émergence d'une
politique plus mediafriendly, et adaptée aux exigences des formes modernes de dialogue avec
le public.
Dans une période marquée par la méfiance, le désintérêt et l'éloignement des citoyens
de la vie politique sont les conséquences les plus nettes. Pour faire face à ces obstacles, les
48
représentants politiques sont contraints d’inventer de nouveaux moyens pour reconquérir la
proximité du peuple, donc sa participation aux décisions publiques. Suite à la montée en
puissance des différents supports et canaux de diffusion et de circulation d'information, la
sphère politique doit renouveler et adapter ses routines pour rendre compte de son
dynamisme. Ce paysage présente un nouveau souffle d'indépendance des acteurs politiques
vis-à-vis des médias traditionnels. Paradoxalement, ils ne parviennent pourtant pas à toucher
le citoyen, ni à le réintégrer à la vie politique.
C'est dans cette période d'instabilité de l'activité politique que s'inscrit notre
recherche. Dans les pages suivantes, nous allons donc présenter la façon dont nous avons
procédé pour mettre en place, puis présenter et interpréter nos résultats. Au-delà d'une simple
typologie des communicants politiques français, ou de l’identification des indices suggérant
leur professionnalisation effective, nous mettrons en perspective les principaux défis de la
politique actuelle ainsi que le rôle de ces professionnels, parties intégrantes de la structure du
champ politique contemporain.
49
3 LES CONSEILLERS EN COMMUNICATION POLITIQUE EN
FRANCE EN 2015 : QUELLES IDENTITES ET QUELLES
LOGIQUES PROFESSIONNELLES ?
Les parties 1 et 2 ont eu pour objectif de mettre en perspective la façon dont
l'évolution de l'espace social et les transformations structurelles amenées par les médias de
masse puis Internet présentent un impact direct sur l'ensemble des pratiques politiques et, de
façon plus ponctuelle, sur les modalités de mise en scène du pouvoir. Plus que gérer les
affaires de la Cité, les hommes et femmes politiques doivent également organiser leur
visibilité et être prêts à subir les apports positifs mais aussi négatifs des nouvelles possibilités
offertes par l'agora médiatique.
Nous avons vu que la mise en place d'un espace public médiatisé a reconfiguré le
champ politique, la décennie de 1960 marquant le début d'une nouvelle étape de la vie
politique française, notamment avec la montée en puissance de la télévision et l'entrée des
nouveaux acteurs dans la scène politique tels les spin doctors, personnages centraux des
coulisses du pouvoir dans une période de transition et de consolidation vers l’espace public
d'une démocratie de masse. Néanmoins, malgré le poids accordé à leur activité, le rôle des
communicants politiques demeure un peu dans l'ombre et soumis à une série de disputes
symboliques sur leur légitimité professionnelle.
Cette partie a donc l'objectif de mettre en avant le rôle de ces professionnels à travers
l'analyse d’entretiens approfondis menés auprès d'un échantillon de communicants politiques
en France. Souhaitant donner quelques pistes de réflexion, cette démarche nous permettra
d'éclairer les diverses conceptions du métier et de la communication politique en tant que
composante de l'activité politique contemporaine en cherchant les indices suggérant une voie
de professionnalisation. Les apports de cette étude sont des pistes fondamentales pour mettre
en lumière la réalité conflictuelle de la vie politique actuelle ainsi que les incertitudes sur
l'avenir démocratique, à l'heure d'un désintérêt majeur vis-à-vis de la classe politique. Cette
problématique sera approfondie par une étude comparative entre le Brésil et la France dans le
cadre de l’élaboration d'une thèse.
50
3.1 Méthodologie
Pour répondre aux questionnements de notre problématique, nous avons décidé de
rencontrer un certain nombre de communicants qui travaillent / ont travaillé dans le secteur
politique en France. Il fallait rencontrer des communicants possédant une solide connaissance
de l'univers de la communication et de la sphère médiatique et utilisent leur savoir-faire au
profit des hommes et des femmes politiques dont ils s'occupent.
Pour en rendre compte, nous avons pris contact avec d'autres chercheurs qui
s'intéressent aux relations entre médias et politique en France. A partir de là, nous avons
construit une liste avec plusieurs suggestions de noms. Nous avons tenté de les joindre par
mail, par téléphone et aussi sur LinkedIn56 (la plupart y possèdent un profil). Malgré certains
obstacles, nous avons réussi à rencontrer neuf personnes. Afin d’d'esquisser une typologie
des communicants politiques en France, notre analyse se focalisera sur des critères
spécifiques : parcours (personnel / professionnel), formation, métier actuel et rapport avec la
communication, caractéristiques toutes mises en dialogue le long de l'étude.
Pour rendre compte de nos objectifs de recherche, nous avons décidé de construire
notre corpus à partir du discours tenu lors des entretiens. Considérant la présence du sujet,
ainsi que ses manifestations et ses hésitations dans la situation d'enquête, extrêmement
enrichissantes pour éclairer nos réflexions, nous avons réalisé tous les entretiens face à face –
sauf celui de Nicolas Baygert, originaire de Belgique donc interviewé sur Skype. Ainsi, la
conduite de l'entretien et le choix des questions occupent une place très importante pour la
réussite de l'investigation. Pour cela, nous avons cherché à poser des questions que
permettent d'aider les acteurs à raconter ce qu'ils font et la façon dont ils comprennent ce
qu'ils font, en cherchant à identifier leurs points de vue, notamment sur trois axes d'intérêt
majeur : les rapports entre médias et politique en France, l'importance de la communication
en politique (notamment les conceptions et performances des pratiques de communication en
politique), les tendances qui s'en dégagent.
56 Réseau social professionnel en ligne crée en 2003 et qui possède actuellement 365 millions de membresdans plus de 200 pays.
51
Les apports de l'analyse du discours et de la sociologie compréhensive
Pour rendre compte de nos objectifs de recherche, nous avons mis en œuvre une
démarche coopérative entre sociologie compréhensive et analyse du discours, selon les
orientations de Claire Oger et Caroline Ollivier-Yaniv57. Pour les chercheuses, « La
sociologie compréhensive ne peut pas mettre au jour les représentations que se font les
acteurs sociaux de leurs activités, ainsi que leurs dispositions intériorisées, sans accorder une
grande partie de son attention au discours produit par les sujets de l'action eux-mêmes »58.
Cela révèle donc la subjectivité intrinsèque à cette démarche méthodologique, raison par
laquelle son hybridation avec l'analyse du discours a ses avantages : « (…) l'analyse du
discours a connu des évolutions qui ont contribué à la rapprocher des problématiques ethno-
sociologiques. (…) 'le tour ethnolinguistique de l'analyse du discours' a conduit un certain
nombre de chercheurs à s'intéresser à des communautés restreintes, à des rituels langagiers et
plus généralement à la manière dont 'dire, manières de dire, manières de faire et d'être
s'enchevêtrent pour 'incarner' le discours, provoquer l'incorporation' de ses usagers »59.
En rapprochant le sujet du discours et le sujet social, le lien entre ces deux disciplines
nous semble spécialement pertinent au vu de notre double préoccupation : d'une part, nous
nous sommes intéressés à répondre aux questionnements sur le sujet de l'énonciation, c'est-à-
dire le sens que les acteurs donnent à leurs activités à partir de ce qu'ils racontent. D’autre
part, nos objectifs relèvent de la sociologie des professions : les discours des acteurs
concernés sont alors également primordiaux. Dans un cas comme dans l'autre, le point
d'ancrage entre les deux procédures est la place accordée au discours. À cet égard, B. Miège
ajoute que l'étude sur les phénomènes de la communication appelle en effet la mise en place
de « méthodologies interscientifiques de recherche » dont « le cas le plus exemplaire mais
aussi le plus fréquent est la mise en correspondance de l'analyse de discours sociaux avec
celle des stratégies ou des pratiques d'acteurs sociaux »60.
La notion d'ethos est aussi centrale à l'égard de notre recherche. Pour Ruth Amossy
(1999), le moment de la prise de parole comporte lui-aussi une image de soi à travers les
modalités et postures d'énonciation du locuteur. Il n'est pas nécessaire qu'il parle
57 OGER Claire, OLLIVIER-YANIV Caroline, « Analyse du discours et sociologie compréhensive. Retourcritique sur une pratique de recherche transdisciplinaire » pp. 39-55. In. BONNAFOUS Simone, TEMMARMalika, Analyse du discours et sciences humaines et sociales, Collections « Les Chemins du Discours »,Editions Ophrys, Paris 2007.
58 Idem, pp. 40.59 MAINGUENEAU, 1992, pp. 123 apud BONNAFOUS, TAMMAR, 2007, pp. 4160 MIEGE 2005 apud BONNAFOUS, TEMMAR, 2007, pp. 29.
52
explicitement de lui : « Son style, ses compétences langagières et encyclopédiques, ses
croyances implicites suffisent à donner une représentation de sa personne »61, réalisant ainsi
une présentation de soi. La perspective d'Erving Goffmann à l'égard des études sur la
production d'une image de soi dans les interactions est aussi pertinente. Pour le sociologue, la
représentation est « la totalité de l'activité d'une personne donnée, dans une occasion donnée,
pour influencer d'une certaine façon un des participants »62. On trouve chez E. Goffmann
aussi la notion de rôle (part) ou de routine, qui seraient « le modèle d'action pré-établi que
l'on développe durant une conversation et que l'on peut présenter ou utiliser en d'autres
occasions »63. Ainsi, ces modèles de comportements préétablis correspondent à la manière
dont un directeur d'entreprise parle avec ses employés lors d'une réunion ou à la façon dont
un enseignant livre son cours à ses élèves. Ainsi, à la lumière des contributions de R. Amossy
et E. Goffmann et en partant d'une conception représentationniste du discours des acteurs
comme le propose Dominique Maingueneau (1992), l'analyse du corpus cherchera à
identifier l'émergence d'un territoire symbolique délimité par rapport à d'autres
positionnements discursifs, tel celui du champ journalistique. Cette démarche est centrale
dans notre analyse une fois qu'elle met l'accent sur les marques d'énonciation des acteurs
selon leur position dans le champ concerné, révélant par là-même l'existence d'un discours
commun qui légitime l'existence de la communauté (dans ce cas, des communicants
politiques) en tant que telle.
Ainsi, l'entretien fonctionne comme des séquences narratives permettant d'étudier le
discours des acteurs et d'en faire émerger des indices qui favorisent, freinent ou justifient
l'évolution, voire la professionnalisation de leur métier, ainsi que leur compréhension des
pratiques en communication politique. En outre, l'utilisation conjointe des deux méthodes
dans l'analyse des entretiens permettra d'identifier le continuum, c'est-à-dire les
caractéristiques discursives les plus régulières, les marqueurs du discours révélant leurs
motivations, leurs principes et leurs conceptions du métier et de la communication politique.
Enfin, à travers des grandes thématiques qui émergent de l'ensemble des discours, nous
esquisserons une notion d'ethos des communicants politiques par le biais des traces
identitaires visibles, et mettrons en perspective la réalité socio-politique de l'époque actuelle.
61 AMOSSY Ruth, « La notion d'éthos de la rhétorique à l'analyse du discours », pp. 9 In. : AMOSSY Ruth,Collectif. Images de soi dans le discours : la construction de l'ethos, Delachaux et Niestlé, 1999.
62 GOFFMANN, 1970 apud AMOSSY, 1999, pp. 13. 63 Ibidem.
53
3.2 Présentation de l'échantillon
Comme nous l’avons mentionné plus haut, notre but a été de construire un échantillon
avec des communicants qui travaillent / ou déjà travaillé pour le secteur politique. Pour
faciliter la façon d'attaquer notre objet d'étude, nous avons dans un premier temps essayé de
construire un échantillon des seuls communicants des équipes de communication d'Anne
Hidalgo (Parti Socialiste) et de Nathalie Kosciusko-Morizet (Union pour un mouvement
populaire), les deux principales candidates à la Mairie de Paris en 2014. Après plusieurs
tentatives, la difficulté à les joindre nous a amené à abandonner cette première idée, pour
finalement focaliser notre analyse sur les différentes types de communicants politiques selon
leur parcours, leur formation et leurs motivations.
Le choix des interviewés ainsi que les démarches méthodologiques mises en œuvre
dans le cadre de cette analyse doivent rendre compte des questionnements de notre
problématique. Entre novembre de 2014 et avril de 2015, nous avons pris contact et effectué
des entretiens approfondis auprès de neuf communicants politiques. En général, ils possèdent
des caractéristiques plurielles, notamment en ce qui concerne leur âge et leur parcours
professionnel, révélant la diversité des acteurs comme le montre le tableau ci-dessus, où
figure une brève présentation du profil de chacun.
54
Tableau 1 : Présentation des interviewés
Interviewé Date Lieu Durée Âge Formation Parcours Métier actuel
PhilippeMOREAU
CHEVROLET06.02.2015
Bureau MCBG Conseil(société de conseil en
communication etstratégie d'influence des
dirigeants, privés etpublics)
30min 41 ans- Sciences Politiques
- Centre de Formation des Journalistes Paris
- Chargé de cours à European Communication School (storytelling)
- Directeur conseil - Agence Care
- Directeur de Communication et conseiller du Président – Conseil Représentatif des Associations Noires de France
- Directeur Éditorial – Éditionsde la Martinière
- PDG Fondateur – Éditions Danger Public
- Reporter TV – France 5
- Réalisateur – Sunset Presse
- Rédacteur Junior – La Tribune
- Pigiste - Le Monde
- Président MCBG- Chargé de cours à Institut Mines Telecom (comm. Personnelle/stratégies d'influence)
- Intervenant à Sciences Po (cours : Political Communication in Contemporary Democracies)
Ludivine MOLES
06.02.2015Café La Dauphine
(à côté de l'AssembléeNationale)
50min 29 ans
- M2 Communication Politique et Collectivités Territoriales
- M1 Sciences Politiques
- Licence Sciences Politiques
- Licence Lettres Modernes Appliquées
- Conseiller Communication/Presse Campagne NKM 2014 ;
- Chef de projet Relations Publiques/consultant júnior à TBWA Corporate;
- Chargée Communication Mouvement Démocrate
- Chargée Communication UMP à l'Assemblée Nationale
- Consultant Communication institutionnelle et relations publiques à Albera Conseil
NicolasBAYGERT
20.02.2015
(sur Skype)
Skype (Il habite enBelgique)
50min 35 ans
- Doctorat Information et Communication
- DEA Sciences Politiques
- Chroniqueur Le Nouvel Observateur/L'Express
- Consultant freelance
- Maître de Conférences à l'Université de Bruxelles (communications des institutions/organisations /étude
- Master Relations Internationales
de cas de communication)
- Maître de Conférences invité à l'Université de Louvain (communication externe/politique de communication externe)
- Chargé de cours à Haute École Gallilee (Professeur dans le cadre du Executive Master enCommunication politique européenne)
- Chercheur Laboratoire d'Analyse des Systèmes de Communication des Organisations (LASCO) à l'Université de Louvain
Robert ZARADER
27.02.2015
Bureau EQUANCY&CO(conseil en
communicationcorporate)
35min60 ans
- Licence Histoire
- Doctorat Économie
- Vice-président TBWA Corporate ;
- Président et membre du directoire du BBDO Paris ;
- Directeur Centre de Recherche Économie Industrielle.
- Président EQUANCY & CO
Jean-Luc MANO
17.03.2015 Bureau Only Conseil 1h 59 ans- Sciences Politiques
- Maîtrise Histoire
- Président Directeur Général BFM
- Directeur de l'information France Soir
- Directeur de l'information France 2
- Chef du service politique TF1 (pendant 10 ans)
- Reporter L'Humanité
- Président Only Conseil
AnneDORSEMAINE
20.03.2015Bureau Emmaus/
Montreuil40min 50 ans
- Licence Lettres Modernes
- Maîtrise Langue Anglaise et Littérature
- Conseillère Communication/Presse Campagne NKM 2014 ;
- Conseillère Presse Écologie/Développement durable cabinet Premier ministre ;
- Conseillère communication/presse auprès de la secrétaire d'État ;
- Directrice adjointe du pôle Affaires Publics/Communication ;
- Directrice de la Communication M&M Conseil ;
- Directrice clientèle Point Virgule ;
- Consultante affaires publiques/relations presse Caroline Mondineu Conseil
- Déléguée à la CommunicationEMMAUS FRANCE
Interviewé 1 27.03.2015 Bureau Hôtel de Ville 30min 32 ans- Master Affaires Publiques Sciences Po
- Directeur de Cabinet de la Présidente de l'Université Sorbonne Nouvelle (4 ans)
- Consultant Affaires Publiques (3 ans)
- Directeur-Adjoint de Cabinet de l'élue Marie Paris Ve Arrondissement
Benjamin GUY
16.04.2015Bureau Parti SocialisteRégion Île-de-France
1h05min 36 ans- Formation CommunicationPolitique et Publique en France et en Europe
- pendant 10 ans, B. Guy a fait de la communication dans des associations, les ONGs
Directeur de Communication Parti Socialiste Région Île-de-France
GaspardGANTZER
29.04.2015 Bureau à l'Élysée 20min 36 ans
- École Nationale d'Administration (ENA)
- Master Affaires Publiques Sciences Po
- Maître de Conférence (Sciences Po)
- Directeur Adjoint de Cabinet,chargé du porte-parole
Conseiller chargé des relations avec la presse – Chef Pôle Communication Présidence de la République
(Ministère de l'Agriculture, porte-parole du Gouvernement)
- Conseiller communication et presse Ministère des Affaires Étrangères
- Conseiller Politique et Porte-parole auprès du Maire de Paris
- Conseiller Communication etPresse auprès du Maire de Paris
- Directeur de cabinet de l'Adjoint au Maire de Paris chargé de la Culture (Mairie de Paris)
- Directeur adjoint en charge du budget et des financements (Centre National de la cinématographie)
- Chef du bureau des relations collectives (Ministère du Travail, des Relations sociales,de la Famille, de la Solidarité et de la Ville)
Avant de passer à la présentation puis à la discussion autour des résultats de notre
analyse, il nous paraît judicieux de commenter quelque peu les informations présentées pour
faciliter la compréhension de notre démarche.
Comme nous l’avons déjà mentionné, la majorité des entretiens a eu lieu dans leurs
bureaux. À l'égard de nos objectifs de recherche, l'expérience in loco a été aussi
enrichissante. En ce sens, la situation d'entretien face à face nous a apporté davantage
d'informations de nature subjective, telles les expressions des visages ou les hésitations du
discours, ce qui a contribué à mieux analyser notre corpus.
La durée des entretiens fut également importante dans le cadre de notre analyse. Au
total, nous avons abouti à environ 4h30min d'entretien auprès des neuf communicants
politiques64. En raison des contraintes de temps et des difficultés à joindre notre échantillon,
nous n'avons pas eu l'occasion de mener plus d'un entretien avec chacun. Pour régler cet
obstacle sans poser de problèmes à l'efficacité de notre étude, nous avons développé un
guide d'entretien. Cet outil nous a permis de régler le problème dans deux dimensions.
Premièrement, en considérant notre démarche à l'éclairage de la sociologie compréhensive,
nous avons proposé des questions très ouvertes en cherchant à évaluer leurs réponses sur
trois plans : les rapports entre médias et politique en France, l'importance de la
communication en politique, les conceptions et performances des pratiques en
Communication Politique. Deuxièmement, la facilité de maniement de cet outil nous a
permis de l'adapter en fonction des agendas de nos interviewés, soit en sélectionnant les
questions-clés, soit en les réécrivant pour cibler certains aspects centraux de leur position, à
l'exemple de l'entretien avec le chef du Pôle Communication de l'Élysée, Gaspard Ganzter.
Ainsi ces ajustements justifient-ils les différentes durées de chaque entretien.
L'âge des interviewés a été un autre pont intéressant à l'égard de notre analyse. Cette
information a permis également d'éclairer, voire de justifier certaines conduites des
communicants, révélant un processus d'évolution du métier à long terme. Ainsi verrons-
nous, par exemple, la façon dont les communicants politiques de différentes générations
présentent aussi des différences de formation, de parcours et même de conception de leur
activité.
Liée à la variable de l'âge, nous avons porté également attention à la formation et au
64 La transcription des entretiens se trouve en annexe dans ce mémoire. En vue de notre délai, notre directeurde recherche n'a pas demandé la transcription intégrale des neuf enregistrements. Pour cela, nous avonsprocédé à une transcription partielle des entretiens, en focalisant sur les dimensions d'intérêt majeur à titrede notre travail.
59
parcours professionnel de chaque interviewé. La prise en compte de ces caractéristiques est
au cœur de notre analyse parce qu'elles peuvent à la fois révéler les différentes conduites,
principes et motivations qui orientent les pratiques des communicants politiques mais aussi
rendre visibles des indices suggérant un processus de professionnalisation de la
communication politique.
3.3 La Communication Politique vue par les communicants : quelles représentations ?
Envisageant la situation d'entretien en tant qu'un scénario où les rôles (locuteur et
interlocuteur) étaient préétablis, cet ensemble de représentations peut être associé à ce que
D. Maingueneau appelle la « position institutionnelle », c'est-à-dire l'adoption d'une attitude
discursive qui cherche à légitimer son dire et à marquer son rapport à un savoir spécifique.
En ce sens, nous chercherons, au-delà des énoncés, l’implicite des discours. Il nous semble
donc judicieux de relativiser la mise en valeur de leur image mais aussi celle de leur espace
d'activité dans l'ensemble social. Ainsi, lors de la présentation de nos résultats, l’analyse des
entretiens cherchera à mettre en relief les différentes tendances afin d'en discuter d’un point
de vue critique, selon les subjectivités.
Notre corpus nous a révélé une certaine régularité dans les discours des
communicants concernant leur rôle en tant que tel, et leurs conceptions sur la
communication politique. Quelle que soit la nature de leur attachement au représentant
politique auprès duquel ils travaillent (communicant interne / communicant externe, comme
ceux qui possèdent des agences de communication), quelques passages révèlent l'existence
de pratiques et de représentations communes.
Étant la communication le fondement de l'activité politique, son développement en
tant que spécialité n'est pas si étonnant. Ayant ce domaine d'activité un poids croissant dans
l'espace politique, aussi la représentation de ces « hommes des ombres » a également passé
par différentes phases. L'analyse de nos entretiens met en perspective leur représentation en
tant qu'auxiliaires légitimes des dirigeants politiques, notamment dans un contexte de crise
des institutions démocratiques où le temps de refléxion de l'activité politique se trouve
soumis à la dictature u temps court engendrée par l'apparat médiatique.
En revanche, notre étude permet aussi d'identifier une certaine pluralité en ce qui
concerne les origines de nos interviewés. Pour cela, nous allons nous intéresser aux
60
parcours professionnels de ces acteurs, en essayant d'esquisser l'existence d'un profil type
des communicants dans le domaine politique. En s'appuyant sur les apports de la sociologie
des professions et considérant la construction d'un territoire professionnel comme une
conséquence de l'évolution du propre corps social, les données recueillies permettent
d'identifier une proximité en ce qui concerne les pratiques et les représentations des
communicants politiques par rapport à leur métier et à leur place dans le champ politique.
L'adoption d'une attitude discursive d'autorité réperée par le constant des représentations
qu'ils font d'eux-mêmes et de leur domaine d'activité dans l'instance politique rend visible
une croyance commune à l'existence d'un rôle et à des principes spécifiques à cette catégorie
professionnelle.
Mais avant de mettre l'accent sur les similitudes qui paraissent unifier ces acteurs
dans un territoire partagé, il nous paraît plus raisonnable de nous concentrer dans un premier
temps sur leurs parcours universitaires et professionnels. Ces informations sont très
intéressantes à l'égard de nos intérêts de recherche, spécialement si on les relie aux
informations concernant leur âge, en ouvrant par là une perspective plus concrète en termes
de professionnalisation à long terme. Ainsi, dans les pages suivantes, nous allons présenter
les grandes tendances qui se sont dégagées d'après l'analyse des entretiens et qui peuvent
être considérées comme des indices très importants concernant la représentation du champ
de la communication politique vues par ses propres acteurs.
A) Communicant politique : un profil type ?
Comme nous l'avons souligné, malgré les similitudes repérées dans leur discours,
notre échantillon – encore que purement illustratif – permet d'identifier des origines assez
plurielles. Derrière la représentation a priori partagée en ce qui concerne leurs croyances à
l'égard de l'importance de la communication et de leur rôle vis-à-vis de la « tyrannie » socio-
médiatique, on trouve une hétérogénéité plus ou moins remarquable des acteurs de ce
secteur d'activité.
Sauf par Anne Dorsemaine et Robert Zarader, qui possèdent respectivement une
formation en Lettres et en Économie, la totalité de notre population possède une formation
plus ou moins proche de leur domaine d'activité, autrement dit de la communication et de la
politique. Au-delà sa formation, la particularité du parcours de Anne Dorsemaine concerne
son entrée dans l'univers de la communication : d'abord dans une agence de communication
61
lors de son premier emploi, ensuite à travers le contact avec des jeunes hommes et femmes
politiques, comme Christian Paul65 et Nathalie Kosciusko-Morizet. Parmi les neuf
communicants sondés, seulement Ludivine Moles et Benjamin Guy possèdent une
formation spécifique en Communication Politique, comme nous pouvons le remarquer par
les informations sur le tableau 1. À cet égard, quatre dimensions méritent une attention
spéciale : i) le choix d'un parcours en Science Politique suite à une formation
complémentaire en communication ou vice-versa ; ii) une formation orientée vers la carrière
publique ; iii) les communicants qui travaillent en externe dans les agences de
communication/conseil, donnant un support plus spécialisé au personnel politique et iv) un
parcours specialisé en Communication Politique.
Philippe-Moreau Chevrolet, président de l'agence MCBG Conseil, Jean-Luc Mano,
ancien journaliste et président de l'agence Only Conseil et Nicolas Baygert, spécialiste en
communication politique européenne, ancien consultant en communication auprès des
institutions européennes se trouvent dans le premier groupe. La caractéristique commune
aux trois communicants est leur proximité avec le journalisme. Philippe Moreau-Chevrolet a
été journaliste pendant 10 ans, ainsi que Jean-Luc Mano, journaliste politique pendant
presque 30 ans. De son côté, Nicolas Baygert a aussi joué un rôle dans ce domaine comme
chroniqueur du Nouvel Observateur. Il oriente sa carrière vers l'univers académique et
exerce le rôle de consultant de façon sporadique. Mais les deux autres partagent un autre
point commun : la préférence pour le travail en externe en agence, bien que Philippe
Moreau-Chevrolet se dédie aux deux milieux, comme l'on peut constater à travers des
informations sur le tableau 1. Nonobstant les différences, ce premier groupe réunit un
premier axe typologique des profils des communicants politiques repérés dans cette étude
exploratoire.
Dans le deuxième groupe se situent l'Interviewé 166, Directeur-Adjoint de Cabinet de
la Mairie du Ve Arrondissement de Paris et chef du Pôle Communication de l'Élysée,
Gaspard Gantzer. D'après les deux interviewés, leur rapport à la communication n'était que
secondaire, la carrière publique étant à la base de leur choix par la formation en Affaires
Publiques à Sciences Po – puis à l'ENA, dans le cas de Gaspard Gantzer. Ils mettent en
avant les apports positifs d'une formation plus approfondie sur le fonctionnement du
65 A. Dorsemaine fait son entrée dans la communication politique en travaillant auprès du député socialisteChristian Paul. Ensemble, ils créent la première rencontre sur "Internet et Société d'Information", fórumtoujours vivant. En 2000, C. Paul devient secrétaire d'État à l'Outre-Mer et demande à la communicante dele rejoindre.
66 Nous appellerons « Interviewé 1 » ce communicant qui n'a pas voulu révéler son identité en raison de saposition à la Mairie du Ve Arrondissement de Paris.
62
système politique et à la mise en place d'un modèle de communication politique « plus
efficace » - dimension elle aussi importante dans l'ensemble des discours – et adapté aux
enjeux du secteur dans le contexte actuel.
Un troisième axe typologique concerne les communicants qui travaillent en externe
dans leurs propres agences. Cette catégorie comporte spécialement les deux anciens
journalistes (qui se trouvent également dans la première catégorie) et aussi Robert Zarader,
économiste à la base et président de l'agence EQUANCY&Co, ayant travaillé pour la
campagne de François Hollande en 2012. La caractéristique commune à ces trois
communicants est son rapport a priori plus distancé et autonome à l'égard du secteur
politique, ce qui s'oppose un peu parfois avec leurs préférences partisanes, comme l'on
remarque chez Robert Zarader. Le communicant souligne qu'il ne fait de la communication
politique que pour ceux avec qui il s'identifie « intellectuellement » et toujours de manière
informelle. Or, même si l'engagement politique n'est pas déterminant, cela révèle l'existence
de certains critères de sélection (confiance, préférences) des clients chez les communicants
en externe aussi, en refusant ainsi une conclusion peut-être hâtée sur une représentation
plutôt mercenaire de ce type de professionnel, qui travaillerait pour n'importe quel camp
politique.
Un dernier univers possible comporte ceux qui possèdent une formation spécifique
en Communication Politique, à l'exemple de Ludivine Moles, chargée de la Communication
de l'UMP à l'Assemblée Nationale et Benjamin Guy, directeur de communication du Parti
Socialiste de la Région Île-de-France. Non sans surprise, ce sont ces deux communicants qui
possèdent un discours plus ostensible à l'égard du poids de la communication en politique,
en mettant en relief son caractère stratégique et sa compréhension en tant qu'outil accessoire
de l'exercice et légitimation du pouvoir. Néanmoins, l'analyse de ce profil spécifique de
communicant rend visible certaines différences dans leur parcours. Ludivine Moles est née
dans une famille de communicants, ce qui d'une certaine façon, d'après elle, l'a influencée à
poursuivre le même chemin. En plus, ses intérêts particuliers à propos du rôle du langage en
politique – peut être venus de sa formation précédente en Lettres – soulignent son
attachement à ce domaine d'activité, ce qui n'était pas le cas chez Benjamin Guy.
Curieusement, c'est la première fois que le directeur de Communication du PS travaille dans
son domaine de formation après 10 ans dans la communication des ONGs. C'est aussi lui
qui présente une posture plus critique sur la situation de la vie politique actuelle et le rôle
stratégique de la communication dans ce contexte, ayant pour mission de rendre visibles les
63
« vrais » changements de la politique dans le quotidien des citoyens, tandis que la
préoccupation autour des manières de s'adresser aux citoyens (notamment en ce qui
concerne l'élaboration des messages et discours politiques) semble centrale chez Ludivine
Moles.
Cette présentation nous conduit à envisager l'existence des profils possibles des
communicants politiques, dont les origines et les parcours n'obéissent pas à une tendance
spécifique. Nonobstant ces divergences, nous avons pu identifier une certaine cohérence en
ce qui concerne leurs formations universitaires, ce qui n'est pas toujours lié à un intérêt
préalable pour les enjeux de la communication en politique, comme le révèle le cas de
Benjamin Guy. D'une façon générale, nous pouvons saisir la prédominance des formations
en science politique dans l'ensemble des interviewés, ce qui est assez logique si on prend en
compte l'importance des connaissances de ce domaine d'étude pour mieux envisager la mise
en place des pratiques communicationnelles sur ce terrain. Enfin, à part quelques
divergences en ce qui concerne leurs parcours, nous avons pu repérer l'existence d'une visée
commune au sujet de leur attachement à certains principes et modes opératoires partagés,
suggérant une délimitation de cet environnement professionnel au sein de la structure
sociale.
B) La valorisation d'une attitude distanciée par rapport au politique
L'un des points intéressants repérés à travers l'analyse de notre corpus a été la
valorisation d'une posture distanciée du communicant par rapport à son objet de travail,
c'est-à-dire le politique, domaine d'action et des rapports de pouvoir. La compréhension
horizontale de la mise en œuvre des pratiques de communication en politique renforce par
ailleurs les représentations de stratégiste et d'expert – notions qu'on présentera plus loin –,
dont le maniement entremêlé de la gamme de techniques et de connaissances théoriques du
monde social correspond à leur critère d'excellence le plus important.
Passé par une préparation en Affaires Publiques à Sciences Po et ensuite à l'ENA –
les deux établissements les plus emblématiques de la formation des élites du pouvoir
françaises –, le chef du Pôle de Communication de l'Élysée accrédite l’idée que la
communication politique « est un métier à s'apprend à l'école » et se perfectionne par la
pratique. L'analyse de Gaspard Gantzer à ce sujet met l'accent sur les apports d'une
64
formation de niveau supérieur qui puisse améliorer la compréhension et les compétences du
communicant politique face à la hausse de la complexité de nos sociétés. D'après le
conseiller, « c'est un secteur où il y a de plus en plus de formations et de conquête
d'excellence », passage qui révèle un accord pour la création de diplômes capables de rendre
aux étudiants un savoir, un savoir-faire et même un savoir-être (Demazière, 2008), point de
vue peut être lié à son propre parcours, où se trouvent les deux établissements considérés
comme la « voie royale » pour accéder à une carrière publique.
G. Ganzer souligne aussi qu' « être engagé politiquement n'apporte absolument
rien », réduisant par-là l'importance des anciennes formes de militantisme dans le contexte
actuel, tendance repérée dans l'ensemble de notre population, plutôt orientée vers une
approche impartiale du phénomène qu'engagée politiquement. Tous les interviewés portent
une attention spéciale à l'adoption d'un regard critique par rapport à son objet de travail –
dont l'extrême se trouve chez Anne Dorsemaine, qui est abstentionniste – , ce qui explique
leur refus des liens strictement partisans au profit des préférences, comme le soulignent
Nicolas Baygert et Robert Zarader. À ce titre, ce dernier explique qu'il accepte de travailler
seulement pour les représentants politiques avec qui il « se sent bien » intellectuellement, en
ajoutant qu'il ne travaille jamais de manière contractuelle. « Je fais de la communication
politique mais à titre quasiment récréatif », explique le communicant. Cette posture rend
visible une autonomie très significative chez les communicants qui travaillent en externe,
révélant également l'influence d’une certaine sympathie envers des camps politiques aux
dépens d'autres sur le choix de leurs clients. En travaillant dans la pointe inverse du champ
de la communication politique, la valorisation d'une certaine neutralité et autonomie du
communicant apparaît aussi chez Benjamin Guy. Le directeur de Communication du PS
révèle aussi une vision critique par rapport aux apports de l'engagement politique en ce qui
concerne les pratiques en communication et ajoute avoir choisi de ne pas avoir la carte du
parti pour mieux pour faire sa communication. Le communicant part du principe qu' « il faut
conserver le plus d'objectivité possible et de lucidité sur le parti, sur ce qu'il est vis-à-vis du
regard de la population », révélant un éloignement de nature éthique par rapport à son rôle.
Il ajoute que même l'équipe de Communication du PS présente une diversité, entremêlant
militants et non-militants. Ce choix correspond aux exigences de Sarah Proust, Directrice de
Cabinet du Groupe Socialiste au Conseil Régional Île-de-France, ce qui représente une
transition très importante à l'égard des changements concernant la conception de la
communication politique au sein des partis politiques français.
65
Si être engagé politiquement n'est plus un critère pour travailler dans la
communication en politique, Gaspard Gantzer souligne que comprendre le fonctionnement
du champ politique est très enrichissant. Il met en valeur les apports de ses formations
universitaires dans le déroulement de ses responsabilités dans le domaine de la
communication politique. À l'instar de son opinion, et bien que notre échantillon ne soit pas
représentatif, on remarque qu'une formation spécialisée en Communication Politique se
trouve chez les plus jeunes (L. Moles, 29, N. Baygert, 35, B. Guy, 36)67 : ce peut être
envisagé comme un mouvement de sophistication parmi les nouvelles générations de
communicants. Pourtant, sauf pour Jean-Luc Mano, dont la formation en science politique et
la carrière de journaliste politique lui accorde un statut particulier en ce qui concerne son
rôle de communicant par rapport à sa génération, ce constat s'oppose clairement aux
parcours universitaires de Robert Zarader et Anne Dorsemaine.
Conformément à l'analyse des entretiens, cette inclination vers un perfectionnement
de haut niveau dans le champ de la communication politique s'explique notamment par la
pression médiatique, le raccourcissement du temps de réflexion par rapport aux décisions et
aux actions politiques et la bataille pour l'établissement d'un dialogue entre représentants et
représentés capable de relier ces derniers au débat public, soit les principales explications à
la nécessité d'être de plus en plus « pro » en ce qui concerne la façon de communiquer en
politique. À cela, Philippe Moreau-Chevrolet ajoute que « la communication se
professionnalise naturellement parce que la période est difficile ». Au vu du communicant,
c'est pour cette raison que le secteur de la communication politique est contraint d’innover
en permanence, pour trouver les moyens de contribuer à atténuer la faille entre l'opinion et
les décideurs.
De son côté, Benjamin Guy manifeste une posture assez critique par rapport à
l'actuelle période politique. Selon le communicant, l'aggravation du sentiment de manque de
représentation chez les citoyens est liée aussi aux différents contextes historiques et de
politisation de la population. Ainsi, la transition d'un modèle politique sous-tendu par le
militantisme, dont le leader et son entourage étaient les responsables par l'articulation d'une
pensée commune, vers un modèle médiatiquement appelatif qui tend à personnaliser les
décisions et actions politiques, est à l'origine de la situation de désenchantement envers la
chose publique. D'après lui, cette reconfiguration, marquée par la baisse de l'importance des
partis et des syndicats, amènera à long terme à un processus de financiarisation68 de la
67 Cf. Tableau 1.68 La financiarisation de la politique désigne la dépendance de celle-ci aux emprunts publics.
66
politique, en réduisant ainsi la marge de manœuvre financière et également politique, en
favorisant la valorisation du spectacle de l'action politique au lieu de l'action effective. Il cite
le quinquennat de N. Sarkozy comme un exemple à cet égard :
Ce qui était particulier avec Nicolas Sarkozyc'est qu'il était partout : il sauvait le monde, lesfinances, les entreprises à peu près trois fois parsemaine. (…) Il y a un fait divers, une émotion,une attention qui est portée sur un sujet, je traitedu sujet, j'ai un discours fort, dynamique, undiscours d'autorité, et ce discours équivaut àl'action, elle n'a même pas besoin d'arriver.
(B. GUY, 16.04.2015)
Ce passage met en avant le poids de l'actualité des médias pour la communication
politique contemporaine. L'omniprésence médiatique, stratégie employée ostensiblement par
l'ex-président français, est « efficace » au sens où elle donne l'impression que les dirigeants
politiques travaillent. Pourtant, cette pratique a ses limites parce qu'elle empêche d'identifier
dans quelle mesure l'action politique a véritablement été réalisée. Face aux problèmes
apportés à long terme par ce jeu d'apparences, dont la conséquence la plus visible est
l'affaiblissement de la citoyenneté, Benjamin Guy souligne l'importance de promouvoir la
valorisation des décisions politiques du bas vers le haut, c'est-à-dire de valoriser les actions
concrètes au niveau local pour remplir la dissonance existante au niveau global. Dans ce
contexte, les enjeux locaux et individuels deviennent primordiaux : pour être crédible, les
décideurs doivent démontrer des incidences concrètes du modèle global dans le cadre des
villes ou bien du strictement personnel, tels que la réduction des impôts ou le meilleur accès
aux services de santé publique.
Cela nous amène à la place du militantisme dans la période actuelle. À ce sujet, les
interviewés affirment qu'il ne s'agit pas de la fin du modèle du militantisme. Au contraire : le
moment actuel demande leur adaptation aux nouvelles modalités d'interaction avec les
citoyens – à l'instar de la proposition de création du statut d’e-militant chez l’UMP pour
prendre en compte les nouvelles formes d'engagement69. Dans un contexte où la parole
politique est commentée presque en temps réel sur les médias traditionnels et encore plus
vite sur les réseaux sociaux numériques et face à la difficulté de retrouver les liens entre
représentants et représentés, la reformulation des profils et des façons d'être ensemble
politiquement devient un véritable enjeu. Ainsi, à l'exemple des communicants qui
69 Pour plus d'informations, voir http://www.lexpress.fr/actualite/politique/ump/e-militant-big-data-l-ump-veut-faire-sa-revolution-numerique_1671169.html.
67
travaillent principalement en externe, les militants commencent à chercher à se spécialiser
dans leur rôle, soit à travers la réalisation d'une formation complémentaire en
communication, soit à travers la maîtrise des nouveaux outils d'information et de
communication qui émergent comme l'enjeu de la communication politique à l'ère
numérique. En insistant toujours sur l'importance d'aller sur le terrain pour parler
directement aux gens, le modèle du porte-à-porte apparaît comme une option intéressante et
efficace pour retrouver le dialogue avec les citoyens à travers la proximité et la
communication interpersonnelle.
La présentation de cet aperçu révèle la continuité du processus subi par la
communication en politique qui a commencé avec le renversement du champ politique au
profit des médias (surtout l'audiovisuel) à la fin des années 1950, en passant par
l'importance des techniques et des outils des sciences sociales et du marketing (tels les
sondages et la construction de l'image politique) jusqu'à l'éclosion du développement des
expertises dans ce domaine. Ainsi, les discours des interviewés suggèrent un processus de
rupture avec l'une des résistances du modèle français de communication politique : la
tradition partisane. En ce sens, l'apparition de deux catégories différentes de communicants
politiques – ceux qui travaillent en interne et ceux qui travaillent en externe, qui possèdent
des agences de communication ou de conseil et qui souvent travaillent pour un parti ou
l'autre (tout en prenant en compte les exceptions, à l'instar de Robert Zarader) et également
pour des entreprises – et la prédominance d'un rapport distancié à la politique peuvent être
prises comme des indices à cet égard.
En outre, il faut prendre en compte également le poids des enjeux économiques. La
financiarisation et la hausse de complexité de l'activité politique ont contribué à la mise en
place d'un processus de segmentation de ce milieu à l'exemple de ce qui a lieu dans le
monde du travail. Ainsi, le passage d'un modèle politique à l'autre conduit, comme nous
l'avons vu, à l'introduction d'autres acteurs et à la création de nouvelles positions dans le
champ politique (conseiller en communication / communicant politique et militant / e-
militant). Cette dynamique du scénario politique serait donc le résultat des évolutions du
système social lui-même, renforçant ainsi notre hypothèse de professionnalisation de la
communication politique en cours, dont l'innovation des pratiques et des profils
professionnels correspond aux nouvelles connaissances technique et théorique qui en
émergent.
68
C) L'image de stratégiste
D'après tous les interviewés, les pratiques de média-training, l'accompagnement de
l'actualité, en identifiant les sujets sur lesquels les journalistes peuvent tomber et la façon
dont l'homme ou la femme politique doit y réagir, ainsi que la contribution à la construction
et aux choix lexicaux du discours – les éléments de langage – et des canaux de diffusion,
sont des caractéristiques communes. En ce sens, le communicant politique joue un rôle très
important sur le plan de la stratégie, terme qui a été mentionné par tous les interviewés pour
décrire ses tâches. La réalisation des objectifs est accompagnée d’une démarche de
réflexion. Ce mot apparaît plusieurs fois dans l'ensemble des entretiens pour expliquer le
processus d'élaboration des actions stratégiques à partir de l'analyse de la conjoncture
politico-sociale globale.
Philippe Moreau-Chevrolet explique que son rôle consiste à aider ses clients à deux
niveaux : les « conséquences » de ce qu'ils veulent faire, et la « façon d'annoncer » leurs
décisions – conduites communes à tous les interviewés, indépendamment de leur position
dans le champ de la communication politique.
« Si vous dites ça, si vous faites ça, il faut qui voussachiez qu'il y aura telles conséquences » - mais ladécision ne m'appartient pas. Une deuxième chosequ'on fait c'est « si vous vouliez dire ça, si vous avieztelle décision à prendre, comment est-ce quevousl'annonceriez ? C'est quoi vos élémentsspontanés ? » - Et nous, on pense qu'il vaut mieuxdire plutôt de cette façon-là parce que cela n'est pasdavantage positif. »
(P. MOREAU-CHEVROLET, 06.02.2015)
Nonobstant les alertes du communicant et journaliste, le client conserve l'autonomie
de les prendre en compte ou pas, la décision finale lui incombant. Cette attitude révèle une
représentation très professionnalisée de leur rôle, renforcée par l'éloignement du politique,
domaine d'action et des rapports de pouvoir.
À la notion de stratégie s'associe celle de la « réflexion », mot-clé dans le travail des
communicants politiques, particulièrement à l'occasion d'une campagne, comme l'explique
Nicolas Baygert :
69
Il y a toujours un travail de préparation, desstratégies à mettre en place puis il faut réfléchir auxoutils, aux formes de communication. Est-ce qu'onfait une campagne d'affichage ou par la télévision ?Est-ce qu'on essaie de recruter ce qu'on appelle des'ambassadeurs', des personnalités qui ont certainenotoriété, pour porter un message, est-ce que celapasse uniquement à travers les décideurs européens ?Est-ce qu'on met en place la stratégie digitale ? Donctoutes ces questions-là font un peu partie de montravail. Parce qu'on réfléchit vraiment à la mise enplace de la stratégie.
(N. BAYGERT, 20.02.2015)
Au-delà des sujets à mettre en avant lors d'une campagne, ce passage rend très nette
l'importance de réfléchir à la dimension structurelle70 de la mise en œuvre de la stratégie.
Cette notion est mentionnée par tous les interviewés, pour qui l'efficacité du message
dépend également du meilleur choix pour le diffuser. À ce sujet, Robert Zarader ajoute que
le rôle du communicant politique doit rendre compte de la façon de se positionner – mot
étroitement lié à la notion stratégique – par rapport à un certain sujet, au message à
développer, au type de public concerné, sans oublier les relations avec la presse et tous les
types de médias, y compris le digital. À cela s'ajoute – selon lui – l'influence du type
d'orientation politique sur la définition du genre de message, à qui l'adresser et comment
l'adresser.
Présentant une conception de la stratégie davantage focalisée sur l'action politique
effective, Benjamin Guy soutient que l'approche locale devient une alliée des stratégies de
communication dans un contexte de désenchantement global. Pour le communicant, rendre
visible et valoriser les actions politiques concrètes dans le quotidien des citoyens, c'est-à-
dire ce qui a effectivement changé leur vie, sont les deux aspects qui orientent son travail. Il
met aussi l’accent sur l'importance de savoir si la situation demande une action de
communication « grand public » ou s'il serait plus efficace de la segmenter, en cherchant à
toucher des territoires ou des acteurs territoriaux spécifiques, telles les organisations ou
entreprises. Ainsi, la « sensibilité » aux opportunités ou aux obstacles du contexte socio-
politique, qui peuvent affecter l'efficacité stratégique des pratiques en communication,
apparaît comme une dimension centrale de son discours.
La prise en compte du climat social est également un point central chez Jean-Luc
Mano et chez Gaspard Gantzer. Pour les deux communicants, la dimension stratégique du
travail de communicant politique leur demande de jouer un « rôle d'alerte », c'est-à-dire
70 Cf. Gerstlé, 2008.
70
d'être attentif aux grandes tendances de nos sociétés. Pour l'ancien journaliste, la sensibilité
aux changements sociaux permettra au communicant de réfléchir et d'identifier les questions
qui peuvent s'imposer, puis d'orienter l'homme ou la femme politique sur les effets de ces
transformations sociales sur la perception de leur discours. Pour Gaspard Gantzer, moins
que d’aller plus loin dans la maîtrise des multicanaux d'information, il faut plutôt se
focaliser sur les échanges des citoyens au sein de la famille, dans les villages, dans les
groupes sociaux, pour comprendre comment cela façonnera leurs attentes.
En fait, il y a plein de choses que nous échappent dansla diffusion des informations entre les citoyens. Onvoit assez bien comment l'information passe par lebiais des médias, y compris Internet, mais ce qui estplus intéressant c'est comment circule l'informationentre les citoyens. Les secrets, les conséquences deces échanges.
(G. GANTZER, 29.04.2015)
De son côté, Anne Dorsemaine porte une attention spéciale au « fond », en le plaçant
à la base de la mise en place de la tactique dans ce champ. Pour elle, la notion de stratégie
est étroitement liée à celle de « compétence » du représentant politique. D'après la
communicante, qui a coordonné la campagne de NKM à la Mairie de Paris en 2014, cet
aspect devient central face au « circuit fermé » qui caractérise la sphère politique française,
dont l'accès est très restreint et demande d’importants efforts de la part des nouvelles
générations d’hommes et de femmes politiques. Son attitude discursive par rapport à son
rôle en tant que communicant offre une compréhension purement accessoire de la
communication, n'ayant de fondement que si elle sert un projet politique. Cela justifie par
ailleurs son intérêt à mettre en avant les propositions de fond et à les transformer en « sujets
de société », donc en axes de stratégie de communication. Pour Anne Dorsemaine, l'homme
ou la femme politique qui veut évoluer doit aborder des sujets et faire preuve de sa
compétence sur ces sujets. Elle cite l'exemple de NKM, d'abord secrétaire d'État à l'Écologie
(2007-2009), à la Prospective et au Développement de l'Économie Numérique (2009-2010),
ensuite Ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement
(2010-2012) et auprès de laquelle elle a été conseillère de communication. Selon la
communicante, le différentiel dans la carrière de NKM a été précisément le fait qu' « elle est
très politique et très polytechnicienne. Ça veut dire qu'elle est capable de comprendre des
sujets très techniques mais de les rendre politiques. C'est un art ». Ce point de vue, centré
sur le contenu (fond) de la politique en dépit d'une approche sur la forme, est partagé par
Philippe Moreau-Chevrolet. Plus qu'une bonne équipe de communicants et la
71
compréhension miraculeuse de cet outil, comme le croient encore aujourd'hui certains
candidats, il affirme que la meilleure base stratégique consiste à travailler certains thèmes
plusieurs années avant d'arriver au pouvoir. Selon lui, « il faut arriver à un thème d'intérêt
national et représenter ce thème. (…) Cela permet d'imposer leur [aux représentants
politiques] opinion au centre du débat, comme l'a fait N. Sarkozy en 2007 ».
On voit par ces exemples que le rôle de stratégiste chez les communicants politiques
est davantage ancré majoritairement sur un positionnement réflexif par rapport au contexte
social. En ce sens, l'attention aux changements sociaux et aux tendances qui s'en dégagent
fonctionne comme le plan de bataille des communicants politiques, aux niveaux
essentiellement politique (la mise en avant de certains questions de fond au dépens d'autres)
et structurel (les supports de diffusion des messages). La prise en compte de la nature
flottante du corps social apparaît dans leur discours comme une démarche obligatoire dans
le cadre du développement des schémas tactiques. S'appuyant sur l'argument des difficultés
imposées par les exigences d'une médiatisation de plus en plus poussée de la politique, nous
pouvons identifier la croyance en un savoir-faire exclusif des communicants politiques, en
renforçant l'émergence d'une notion d'appartenance à travers la délimitation d'un territoire
de connaissances et de compétences spécifiques.
D) L'image d'expert
Le discours des conseillers en communication à l'époque de leur apparition sur la
scène politique préconise la mise en place d'un mouvement de spécialisation et la croyance
en une expertise propre à ce domaine d'activité qui aura lieu dans les décennies suivantes.
En comprenant la définition des activités professionnelles comme un enjeu de luttes
continues, ces fluctuations de la division du travail doivent être comprises « comme le
produit d'interactions sociales et de rapports de pouvoir »71. Ainsi, la complexification de
l'espace social et des rapports de force entre les agents et les groupes qui en font partie, de
même que l'évolution des systèmes de communication et d’information qui l'accompagne,
seront déterminants dans l'évolution des pratiques du métier, en signalant le développement
d'une véritable expertise. Nonobstant les différents parcours des communicants interrogés,
nous constatons leur conviction face à leurs obligations et méthodes de travail. Nous
pouvons identifier ces tendances grâce à l'emploi de constructions explicitant la conception
71 Demazière, 2008, pp. 45.
72
de la communication comme un métier, comme un domaine porteur de spécificités et de
compétences professionnelles précises et légitimes par rapport à d'autres milieux.
Pour Philippe Moreau-Chevrolet, le travail consiste notamment à faire de
l’empowerment, c'est-à-dire à rendre les gens plus forts que ce qu'elles étaient en leur
fournissant les moyens d'atteindre leurs ambitions. Il affirme, par exemple, qu'il n'y a rien
d'évident à parler face à un public ou à faire passer un message à des millions de personnes
à la télévision. Ainsi, l'une de ses obligations est d'être-là pour rassurer les gens, en leur
fournissant les outils les rendant à l'aise lors d'une telle intervention. À l'instar de Jean-Luc
Mano, Philippe Moreau-Chevrolet mentionne lui aussi les apports de son ancien métier de
journaliste pour ses pratiques professionnelles actuelles. D'après lui, de même que le
journaliste doit sentir la société, le communicant doit percevoir ce qui se passe, ce qui rend
finalement la démarche propre au champ de la communication politique assez proche de
celle du champ journalistique. On voit chez les deux communicants la façon dont le cumul
des savoirs issus de deux sphères différentes est envisagé comme un différentiel dans la
réalisation de leur travail.
L'appréhension de la communication politique comme une spécialité se trouve aussi
chez Ludivine Moles. La communicante tient un discours de valorisation du professionnel
de la communication, en mettant en avant le fait que « ceux [hommes/femmes politiques]
qu'en n'ont pas, on voit tout de suite » et en soulignant l'existence de compétences et de
critères d'excellence spécifiques à ce domaine d'activité.
On dit que tout le monde peut faire de lacommunication, mais en fait non. Il y a desspécificités, (…) il y a des choses à savoir dans lacommunication, il y a des erreurs à ne pas commettre,(…) il faut aussi savoir comment fonctionne unjournaliste, parce qu'on en a besoin. Commentfonctionne la presse, comment faire diffuser uneinformation : Est-ce qu'il faut la diffuser ? Pourquoi ?Il y a une part de réflexion là-dedans.
(L. MOLES, 06.02.2015)
D'après Ludivine Moles, conseillère en Communication et de la Presse pendant la
campagne de NKM à la Mairie de Paris en 2014, le communicant porte un savoir-faire sur la
façon de diffuser les messages de la manière le plus efficace – à travers un processus de
réflexion puis une stratégie, comme nous l’avons montré – et une connaissance approfondie
de l'univers médiatique, spécialement du travail des journalistes. Pour la communicante, la
capacité à manier ces performances permet d'identifier les risques potentiels du discours du
73
représentant politique, en anticipant les mots ou expressions polémiques et polysémiques
potentiellement extraits.
Au-delà des compétences stricto sensu des communicants politiques, Nicolas
Baygert met en avant la dimension symbolique associée à leur reconnaissance vis-à-vis
d'autres professionnels, notamment en regard de leurs homologues du champ journalistique.
Il explique donc que les journalistes viennent souvent le « consulter d'un point de vue
académique, (...) chercher une expertise et un complément de l'information ». Dans le cas
spécifique de Nicolas Baygert, il est clair que le fait d'avoir orienté sa carrière vers l'univers
académique lui accorde un statut différent des autres communicants politiques, spécialement
à l'égard de ceux qui travaillent en externe. Ainsi, même s'il a été, initialement,
exclusivement communicant / consultant politique, devenir enseignant lui octroie une
certaine crédibilité et reconnait son expertise. Ce constat rend visible l'impasse qui entoure
la quête d'une légitimité professionnelle des communicants politiques : lorsqu'ils travaillent
auprès d'un parti ou d'un leader / candidat politique, ils doivent rester dans l’ombre et subir
la méfiance des journalistes. Cela se justifie par la nature conflictuelle de la relation entre le
champ politique et le champ journalistique, dont la dispute sur le contrôle de la mise en récit
de la vie politique demeure au cœur.
La croyance en la légitimité du métier de communicant politique est très nette dans
le discours de Jean-Luc Mano, qui place ce professionnel au même niveau que d'autres
positions dans le champ politique. Pour l'ancien journaliste, la position du conseiller en
communication se situe à un niveau d'égale importance à celle, par exemple, des conseillers
en matière d'économie ou de politique étrangère, qui possèdent une crédibilité en vue de leur
participation directe jeux bureaucratiques et leur relation avec les professionnels politiques
de premier plan (Riutort, 2007). Face à la complexité actuelle de l'espace social, dont
l'immédiateté dicte les règles de la mise en scène de l'activité politique, il est assez logique,
selon lui, que les représentants politiques cherchent aussi à s'entourer de conseillers en
communication. Pourtant, la peur et la méfiance d'un supposé pouvoir d'influence des
communicants sur la personnalité des dirigeants politiques sont encore aujourd'hui assez
fortes pour les maintenir dans l’ombre.
À ce propos, Anne Dorsemaine refuse catégoriquement l'existence d'une sorte de
« pouvoir secret » et miraculeux des communicants – point de vue partagé par tous les
interviewés – , arguant que la multiplication de ces acteurs dans les coulisses du pouvoir ne
fait pas la politique. Au contraire : « la communication pour la communication – explique-t-
74
elle – a ses limites, et cela s'exprime aujourd'hui dans les scrutins ». En ce sens, on remarque
chez la communicante un posture savante, qui révèle une expertise et une connaissance
approfondie des enjeux du métier de communicant politique vis-à-vis de l'image simpliste
qui lui est souvent associée par d'autres acteurs de l'espace social, tels les journalistes, voire
certains hommes ou femmes politiques.
Ainsi, l'existence de procédures spécifiques d'élaboration d'un discours ou de
diffusion des messages produits par l'instance politique sur les différents supports
médiatiques marque l'ensemble des entretiens. Cela renforce les prémisses d'une proximité
des pratiques et des intérêts des communicants politiques, et soutient notre hypothèse d'un
processus de professionnalisation de ce métier. Encore une fois, la complexité du contexte
socio-politique actuel et les défis posés par la dynamique des systèmes de communication et
d'information sont à la base des réflexions des communicants politiques. En ce sens,
l'Interviewé 1, Directeur-Adjoint de Cabinet de la Mairie du Ve Arrondissement de Paris,
affirme que la communication est avant tout un métier et qu'il faut maîtriser un certain
éventail d'outils d'ordre structurel et symbolique pour accomplir ses tâches, en prenant en
compte les influences de la conjoncture politique et sociale. Pour lui, les sujets sont de plus
en plus complexes et le personnel politique a de moins en moins du temps pour
communiquer. Donc « il faut trouver le bon équilibre, savoir identifier les bons mots »,
approfondir le sujet et le mettre en avant tout en sélectionnant les meilleurs supports pour
diffuser les messages. En mettant l'accent sur la nécessité de sélectionner ce qui sera dit et la
façon de le dire, le communicant renforce l'existence d'un côté toujours caché de l'activité
politique, domaine naturellement sous-tendu par le simulacre. En outre, son discours
renvoie à une représentation d'un savoir propre à ce rôle, dont la capacité à résoudre les
problèmes spécifiques à ce domaine et de manière efficace peut être comprise comme une
compétence particulière du communicant politique.
Si d'un côté les contraintes de temps issues de la logique de l'immédiateté, imposées
par les médias et amplifiées à l'ère numérique sont le défis numéro 1 du personnel politique,
de l'autre la reconfiguration de l'espace social exige un profil de communicant plus
spécifique. Ainsi retrouvons-nous la capacité réflexive face aux transformations de nos
sociétés comme un attribut de plus en plus valorisé chez les communicants politiques,
comme le souligne Gaspard Gantzer.
Donc aujourd'hui, quelqu'un qui travaille pour ledomaine de la communication politique doit
75
nécessairement comprendre cela : comprendrecomment fonctionne l'opinion publique, comprendrecomment font les médias. Il faut avoir cettecompréhension entre la chronologie des médias et del'information et puis l'importance déterminante dudigital, qui est devenu un élément déterminant dufonctionnement des médias.
(G. GANTZER, 29.04.2015)
Ce passage met en valeur trois notions communes à l'ensemble des entretiens en
matière de compétence professionnelle : i) la compréhension du fonctionnement du système
politique vis-à-vis de ii) l'évolution du système médiatique, en prenant en compte les iii)
variables sociologiques dans le même contexte. Ainsi, l'analyse de notre corpus révèle un
discours d'expertise des communicants politiques sous-tendu par les apports conjugués de
l'univers de affaires (comme le marketing), de la science politique et de la sociologie,
croisement fondamental pour répondre aux exigences de la communication politique
aujourd’hui. À l'exemple du discours de spécialiste des spin doctors à la fin des années
1950, dont la maîtrise des outils « modernes », tels que la télévision, les sondages, la
publicité rendrait le communicant indispensable (Riutort, 2007), les résultats de notre étude
suggèrent un élargissement de ces compétences, dont l'innovation des techniques et des
critères supplémentaires de qualification suivent la nature métamorphosable du paysage
médiatique autant que de l'espace social. Or, il est justifiable que les compétences et qualités
professionnelles demandées de la part des communicants politiques, elles aussi, se
complexifient.
E) La prédominance d'une performance démocratique des pratiques en
communication politique
Un autre univers de représentation repéré dans l'analyse des entretiens comprend une
dimension démocratique du rôle de communicant politique. Ainsi, plusieurs passages de
leurs discours révèlent un credo en une performance orientée vers l'intérêt collectif, la
transparence et la valorisation de la vie publique dans la Cité. D'après les interviewés, face à
la complexité de nos sociétés et les défis de la conquête et de l'exercice du pouvoir dans le
contexte actuel, le perfectionnement des pratiques communicationnelles devient l'alternative
possible d’une vie politique en crise de représentativité. Évidemment, il faut relativiser
cette image en prenant en compte l'intentionnalité comprise dans la situation d'enquête.
76
Considérant l'éthos comme « les traits de caractère que l'orateur doit montrer à l'auditoire
(peu importe sa sincérité) pour faire bonne impression », pour reprendre la définition de
Roland Barthes72, la façon dont ils disent ce qu'ils font peut être envisagée comme un mode
de persuasion non exclusivement par des arguments, mais dans un processus plus général
d'adhésion des sujets à une certaine position discursive, tel que le propose D. Maingueneau
(1999).
À cet égard, l'analyse de notre corpus révèle que le grand défi des communicants
politiques est de convaincre leurs représentants de parler aux gens et, par là, d’établir des
liens de proximité et de confiance. Lors d'un « divorce entre les citoyens et la politique »,
comme le soulignent Philippe Moreau-Chevrolet et Anne Dorsemaine, les techniques de
communication gagnent des nouveaux contours pour atteindre des objectifs ambitieux vis-à-
vis du scénario social contemporain.
En plaçant la communication au cœur de la politique, Philippe Moreau-Chevrolet
explique que communiquer avec les autres correspond à 80 % de la vie politique :
Communiquer pour vous faire élire, communiquerpour expliquer votre action, communiquer pourentraîner des gens avec vous, pour qu'ils votent pourvotre texte, pour qu'ils suivent votre action, pour qu'ilsvous aident. Communiquer avec des gens enpermanence pour les amener en fait dans le sens oùvous voulez qu'ils aillent.
(P. MOREAU-CHEVROLET, 06.02.2015)
Ainsi le communicant explique-t-il la nécessité croissante de travailler avec les
représentants politiques pour qu'ils s’imposent de communiquer avec le peuple en continu,
et non seulement lors d'une campagne. Chez P. Moreau-Chevrolet, nous identifions une
appropriation experte et stratégique de cette dimension par l'emploi de l’expression
« professionnaliser de manière intelligente » pour expliquer la façon dont les hommes et les
femmes politiques doivent gérer leurs activités au sein de la vie publique. En outre, ce
passage révèle une compréhension stratégique de la communication concernant la quête du
leadership (« Communiquer avec des gens en permanence pour les amener en fait dans le
sens où vous voulez qu'ils aillent »), composante vitale pour l'exercice du pouvoir politique
mais elle aussi affaiblie. Le communicant rappelle la nécessité d'accompagner les sondages
et les enquêtes d'opinion pour regarder comment vivent les Français. Il ajoute qu’« en tant
que communicants, notre rôle consiste à leur dire 'il y a le peuple qui est là, si vous ne
72 Barthes, 1966 apud Amossy, 1999, pp. 77.
77
prenez pas en compte le peuple tout le temps ça risque de ne pas bien se passer » ; il reprend
ainsi la dimension démocratique associée à son image de communicant politique, en
révélant en même temps la conscience d'appartenance à une catégorie socio-professionnelle
particulière, comme le montre l'emploi du pronom « notre ». Cette notion, également à
l’œuvre dans les autres discours à travers l'emploi des constructions telles que « nous, les
communicants », « notre activité » ou « notre fonction », est très représentative à l'égard de
nos questionnements sur la professionnalisation parce qu'elle met en avant une dimension
d'appartenance à un groupe professionnel spécifique.
Cette même représentation a été identifiée chez Ludivine Moles, pour qui la notion
de faire de la politique est associée à celle de « rencontrer des gens », « confronter des
points de vue », « savoir ce qu'ils aiment ou n'aiment pas ». En ce sens, l'analyse de son
discours révèle la croyance en une mission du communicant politique :
Ce qui me rend triste c'est de voir clairement que lesgens n'aiment pas la politique et pensent que la sphèrepolitique n'est qu'un ensemble de corrompus. Moimalheureusement je pense que les corrompus sontplus visibles et ceux qui travaillent sont plusinvisibles. Donc c'est peut-être au communicant derendre visible l'invisible.
(L. MOLES, 06.02.2015)
La nécessité de réagir aux conséquences d’une sorte d'oubli du peuple par ses
représentants et le rôle de la communication à cet égard apparaissent aussi dans le discours
de Nicolas Baygert. Pour le consultant, la transparence de la vie publique et la proximité
avec les citoyens doivent être comprises dans la mise en œuvre des pratiques
communicationnelles pour retrouver le leadership et la crédibilité de la parole politique. En
plus de la dimension démocratique qui doit orienter le travail des communicants politiques –
terme qu'il remplace souvent par « intermédiaires partisans » – , Nicolas Baygert souligne
aussi l’expertise de ces acteurs de la scène politique : « Les intermédiaires partisans sont
finalement considérés aujourd'hui comme essentiels. (...) Ils vont s'intéresser à la
personnalité des candidats, à ce qu'ils incarnent en tant que projet plutôt qu'aux
idéologies ». La mise en valeur de l'absence de liens partisans des communicants s'attache à
l'hypothèse centrale de notre recherche, en renforçant la construction d'une image d'expert et
de professionnel porteur de compétences spécifiques en matière de communication,
renouvelées par l'évolution et les temporalités complexes du système social (Demazière,
2007). Ce point sera repris plus loin quand nous étudierons la façon dont ces innovations
78
entraînent un processus de professionnalisation effective.
En s'appuyant sur ses connaissances de l'univers des affaires, Robert Zarader
compare le processus de prise de décision du dirigeant politique à celui des entreprises.
D'abord, il faut écouter les collaborateurs puis, à un moment donné, le dirigeant décide. Le
communicant attire l'attention sur l'importance de la transparence, et la nécessité de créer les
conditions de l'ouverture d’un vrai débat démocratique pour récupérer l'intérêt des citoyens,
et leur participation à la vie publique :
On arrive à un point où la conviction des politiques nefonctionne plus, donc il faut aller chercher d'autresformes de conviction. Moi je pense que ça doitbeaucoup être dans la capacité à propos du débat : ilfaut absolument créer des zones de discussion et departage. Si les communicants politiques ne prennentpas la main sur la façon de réguler ces débats, defaçonner les vrais sujets qui y sont traités, je penseque la communication politique va devenir de plus enplus inefficace.
(R. ZARADER, 27.02.2015)
Ce passage montre sa croyance en l’idéal démocratique du communicant politique,
auquel est attribuée la mission de modérateur dans une doxa caractéristique du débat
politique contemporain. En incarnant cette même représentation, Jean-Luc Mano revient sur
le poids de la transparence de la vie politique aux dépens du caractère sacré et restreint du
pouvoir d'autrefois.
Les politiques sont devenus des objets communicantspermanents. Auparavant on leur disait « fais attentionce soir » ; aujourd'hui on leur dit « fais attention toutle temps : à ce que tu vas dire en sortant de lavoiture, à la manière dont tu vas rentrer, à la manièredont tu vas répondre ou dont tu ne vas pas répondre, àla manière dont tu vas t'habiller, dont tu vasmarcher ». Tout est sujet de communication puisqu'onest entré dans une ère de transparence, que parailleurs il n'y a que des avantages pour ladémocratie. (J.L. MANO, 17.03.2015)
Avec les bénéfices de la transparence, il faut aussi prendre en compte des effets d'un
traitement médiatique focalisé sur le côté privé des protagonistes. Cette préférence pour « ce
qui est derrière » les hommes et femmes politiques tend souvent à négliger l'information et
79
les questions de fond au profit de questions a priori secondaires, telles que la vie privée, les
questions de famille, la psychologie des représentants politiques et leur comportement. Ce
nouveau paysage informationnel, dans lequel le dirigeant politique peut se trouver dans une
situation où il faut dire quelque chose de lui à chaque instant, amènera à une transformation
en ce qui concerne les conditions du discours politique lui-même. Ce rapprochement de
l'univers politique et des célébrités souligne un changement très profond de la traditionnelle
« exception française » d'opacité de la vie privée des représentants politiques notamment à
partir de l'élection de 2007, dont la vedettisation et la mise en valeur de l'intimité des
candidats a attiré l'attention73.
Malgré les apports positifs de cet environnement multi-informationnel, Jean-Luc
Mano attire l'attention sur les risques de cette surveillance, notamment dans le contexte de
surmédiatisation actuel, où le temps de réflexion est de plus en plus raccourci. En ce sens,
J.L. Mano souligne l'importance du communicant à propos des conseils sur la cohérence des
idées qui seront structurées dans le discours politique donc transmises à l'opinion. Pour lui,
« Faire de la politique c'est utiliser de la communication pour faire de la politique, et faire
de la politique c'est affirmer le leadership». Le perfectionnement des pratiques
communicationnelles doit ainsi contribuer à convaincre l'opinion, caractéristique inhérente à
l'art de gouverner quelle que ce soit l'époque. Cela nous amène à considérer ce domaine
comme une composante structurelle du champ politique, représentant donc une alliée des
dirigeants dans les luttes symboliques pour assurer leur légitimité devant ceux qui leur ont
accordé de la crédibilité à travers les vœux (Bourdieu, 1984).
À travers l'analyse des données recueillies, on remarque une représentation quasi
missionnaire du communicant politique à face aux défis et à la fragilité de la vie politique
moderne. Ce constat permet de retenir quelques comparaisons avec ses homologues des
années 1960 : si, au départ, les conseillers en communication ont cherché à construire une
image d'expert pragmatique, la vague des communicants politiques suggère une
représentation juxtaposée de ce professionnel, dont la maîtrise d'un répertoire moins
technique que conceptuel semble prévaloir. En ce sens, nous avons repéré dans les discours
la construction d'une image sous-tendue par la croyance en une performance éthique et
démocratique de leur rôle, dont la « rationalisation intelligente » acquiert un statut vis-à-vis
des transformations du système démocratique.
73 DAKHLIA Jamil, « People et politique : un mariage contre nature ? Critères et enjeux de lapeopolisation », Questions de communication [En ligne], 12 | 2007, mis en ligne le 11 avril 2012, consultéle 10 octobre 2012. URL : http:// questionsdecommunication.revues.org/2417.
80
F) Médias et Politique : le « couple maudit »
Les contraintes créées par le fonctionnement du système médiatique sont
mentionnées par l'ensemble des interviewés pour renforcer l'importance de leur rôle dans le
champ politique. Si dans le passé la distance renforçait le caractère sacré du pouvoir, de nos
jours, les systèmes de la communication et d'information ont bouleversé cette logique. En
comprenant la position stratégique du journalisme dans le système d'interactions que sous-
tend le champ politique, la gestion de la visibilité médiatique devient une composante
fondamentale de l'action des dirigeants politiques et dépasse les périodes électorales pour
devenir elle-même partie intégrante de l'art de gouverner. Néanmoins, l'exercice du pouvoir
étant directement lié au capital symbolique, ce qui sous-tend la légitimité du champ
politique, la relation à la fois conflictuelle et d'interdépendance entre ces deux sphères
posera souvent problème aux dirigeants politiques, notamment à travers le pouvoir des
médias de construire et détruire les réputations soit des individus, soit des institutions – à
l'exemple de l'histoire des « moments de grâce » dans la ligne 13 et des « dessins de
carottes » des enfants de NKM en 2014.
En France, la relation de connivence entre la presse, les journalistes et les
responsables politiques est due, parmi d'autres raisons, au contrôle des médias par l'État
pendant presque 40 ans. C'est seulement depuis le milieu des années 1980, avec la
privatisation de plusieurs chaînes et radios, que la « balance de pouvoirs » commence à
changer, en introduisant une série de transformations de l'espace politique à la télévision.
Néanmoins, encore aujourd'hui, ces deux instances entretiennent une relation très complexe.
Malgré le comportement parfois corrosif de la presse française à l'égard du champ politique
elle y reste étroitement attachée, notamment à travers la nomination des dirigeants des
chaînes publiques, des instances de contrôle de l'audiovisuel et la passation de contrats au
nom de l'État avec les principaux réseaux privés, comme le signale P. Riutort (2007). Pour
Ludivine Moles, ils ont constamment besoin l'un de l'autre, limite qui n'est pas toujours
facile à trouver. La communicante explique qu'il y a une sorte d'accord tacite entre les
journalistes et les représentants politiques, car ceux-ci doivent alimenter ceux-là avec les
informations dont ils ont besoin autant qu'ils ne cherchent pas au-delà (règle qui n'est pas
toujours respectée).
Pour moi, la spécificité française tient à l’importance
81
des médias pour la politique. Les médias et lapolitique sont un couple vraiment indissociable.Aujourd'hui les hommes politiques vont envoyer destextos aux journalistes pour leur confier des proposoff, et les journalistes sont à la recherche de lamoindre petite phrase.
(L. MOLES, 06.02.2015)
Historiquement, le couple médias et politique a toujours posé question du point de
vue démocratique. Dans le passage au-dessus, nous retrouvons la notion de symbiose et de
méfiance du journalisme à l'égard du pouvoir, caractéristique de la relation depuis le 18e
siècle. Néanmoins, d'autres facteurs s'y ajoutent et complexifient cette problématique dans
le contexte actuel, comme le recours souvent au off, stratégie dangereuse mais souvent
utilisée par le personnel politique pour « alimenter » la presse.
Une autre question repérée au cours de l'analyse des entretiens concerne la façon
dont le système médiatique va également influencer l'organisation de l'agenda-politique. P.
Moreau-Chevrolet rappelle qu'à partir de Michel Rocard74 la presse devient le seul
intermédiaire qui rend les politiques connus du public, les obligeant ainsi à passer par
l'apparat médiatique pour se faire connaître. Dans une situation de quasi monopole de
l'actualité politique, le traitement de l'information par l'instance médiatique donnera les
contours de la représentation de la vie politique à l'égard des citoyens. Ainsi, l'instance
politique est toujours confrontée à une situation de challenge, dont l'enjeu est l'influence
voire le contrôle de l'agenda médiatique et des actualités politiques pour imposer leur vision
de la réalité, souvent très différente de la perception des journalistes. Dans ce contexte, les
communicants et les hommes et femmes politiques essaient de construire un agenda par
rapport aux événements politiques couverts par les médias. En revanche, les journalistes
s'intéressent souvent aux petites choses en dépit des idées, obéissant à la logique
concurrentielle et aux nouveaux modes de consommation d'Internet, notamment des chaînes
d'informations en continu. Jean-Luc Mano soutient que l'explosion du nombre de médias a
favorisé la concurrence et la prise en compte de la volonté du public. Néanmoins, l'ancien
journaliste souligne qu’avec la liberté et l'indépendance, la presse est devenue aussi plus
incisive, parfois jusqu'à l'excès, en préférant la virulence de la question à sa pertinence. De
son côté, Robert Zarader soutient que l' « appauvrissement énorme du métier de
journaliste », de moins et moins payé et formé, renforce la condition de soumission de la
74 Le financement de la vie politique est revu en 1990 afin de moraliser la vie publique. La loi de 1990,connue comme « loi Rocard », prévoit la limitation des dépenses électorales et à la clarification desfinancements des activités politiques. Source : http://www.gouvernement.fr/michel-rocard
82
politique. Selon le communicant, la précarité professionnelle induit un manque de
journalistes d'expérience capables de traiter l'actualité politique de façon cohérente en
contribuant à éclairer les citoyens.
Anne Dorsemaine est très critique à ce sujet :
Le journaliste politique en France est une « race »spéciale. Il n'est intéressé par rien. La seule chose quil’intéresse c'est la tactique, les histoires des partis. Ilmet souvent en scène les combats de gladiateursparce que c'est ce qui fait vendre : les petites phrasesassassines, les coups médiatiques. Or les journalistespolitiques sont les Seigneurs de la rédaction.
(A. DORSEMAINE, 20.03.2015)
Pour la communicante, l'ère de la politique médiatisée opère dans une logique de
guerre, dont la lutte pour la visibilité médiatique s'impose comme une composante corrosive
de l'activité politique. Même si l'avènement des technologies numériques favorise
l'émergence de discours alternatifs, la presse profite encore aujourd'hui d'une place légitimée
socialement. Ainsi, il n'est pas si étonnant que « la défiance à l'égard des partis contraste
avec le degré de confiance dans les organes médiatiques »75 . Ainsi, les médias occupent une
position stratégique d' « interprétation » et de transmission des actions et décisions de la vie
politique vers les publics, en mettant souvent l'accent sur une représentation disqualifiante
du jeu politique76. En ce sens, Anne Dorsemaine reconnaît le décalage total entre les sujets
de société, c'est-à-dire des sujets de transformation qui intéresseraient véritablement les
gens, et les sujets qui intéressent les journalistes politiques, ce qui contribue à renforcer le
manque de représentativité dans le contexte politique actuel.
Cette situation conduit à une question de nature sociologique qui doit être prise en
compte pour mieux comprendre les spécificités de la relation entre ces deux espaces sociaux
et peut-être les raisons du désenchantement démocratique actuel. Jean-Luc Mano parle
même d'une « classe politico-médiatique » vu que les journalistes et les hommes et femmes
politiques viennent souvent des mêmes milieux sociaux, des mêmes écoles (ENA, Sciences
75 Gerstlé, 2008, pp. 105.76 À propos du traitement superficiel de la politique – la valorisation d'une compétition permanente, en
survalorisant l'échec des partis, la personnalisation du jeu politique et les petites phrases – Nicolas Kaciaf(2006) explique que ce serait le résultat d'un processus de transformation de la culture professionnellejournalistique qui commence sous la IVe République et l'un des principaux reproches des journalistes desautres générations par rapport à leurs collègues ultérieurs. Pour eux, les journalistes des dernièresdécennies auraient contribué au mépris de la vie publique et à l'intronisation d'un désenchantement chez lepublic. Néanmoins, ces professionnels justifient l'évolution des pratiques par un rejet du style précédent,lequel serait trop institutionnel et « suiviste » à l'égard du politique et sans aucun valeur journalistique.
83
Po, Institut d'Études Politiques de Paris)77, ont les mêmes loisirs etc. On voit ainsi que les
sphères journalistique et politique opèrent dans un circuit très fermé, où les sujets qui sont
en fait d'intérêt des citoyens sont placés sur un plan secondaire par rapport à ce que décident
de traiter journalistes et représentants politiques. L'actualité politique devient plutôt une
analyse des « jeux » aux dépens des « enjeux » : d'un côté il y a les journalistes politiques
dont la mission est d'aller chercher et décrypter les tactiques et les mensonges codés derrière
la parole politique ; de l'autre, les acteurs politiques qui, en toute connaissance de cause,
concevront leur discours et leurs actions en anticipant les réactions possibles des médias. P.
Riutort (2007) définit cette situation comme un phénomène d' « autoréférentialité » du jeu
politique « au sein duquel les 'coups' stratégiques des professionnels de la politique sont
élaborés en étroite collaboration avec les communicateurs, évalués en quasi 'temps réel' par
les sondeurs (à partir notamment du poids des cotes de popularité) et commentés par les
journalistes politiques qui se focalisent désormais plus sur les 'coulisses', le démontage des
'coups', notamment médiatiques, des professionnels de la politique et sur l’évolution de
l’'opinion' telle que la mesurent les sondages, plutôt que que sur les oppositions
idéologiques ou programmatiques des formations ou des candidats »78.
Pour Benjamin Guy, c'est à cause du traitement superficiel et de la logique
unilatérale de sélection de l'actualité politique que le Front National a réussi à se positionner
au centre de l'échiquier politique et médiatique.
Aujourd'hui c'est le Front National qui détermine laquasi intégralité des sujets, la prise de position desacteurs. (…) Ils jouent sur ce sentiment des citoyensd'être abandonnés par le politique, de ne pas êtreentendus, de ne pas être bénéficiaires des politiquespubliques, qui profitent à l'autre ou bien auxpolitiques eux-mêmes.
(B. GUY, 16.04.2015)
Face à la baisse de l'intérêt collectif des Français pour la politique et, à l'inverse, à la
hausse de la consommation des produits médiatiques, on remarque que l'univers politique
n'a qu'une place délimitée dans l'univers communicationnel (Padler, 2005). Ainsi, ce passage
renforce la représentation de l'activité politique comme un « jeu » qui se déroule sous les
règles de l'agora médiatique et où les citoyens n'interfèrent que dans les périodes de
77 À ce sujet, voir CHEVALLIER Jacques, « L'élite politico-administrative : une interprétation discutée », Pouvoirs, nº 80, 1997, pp. 89-100 et SANTOS-SAINZ Maria , L’élite journalistique et son pouvoir. Rennes, Éd. Apogée, coll. Médias & nouvelles technologies, 2006.
78 Riutort, 2007, pp. 91.
84
campagne, moment du spectacle de la démocratie, modèle sous-tendu par le dogme de la
souveraineté populaire, où le soutien de la société civile est décisif pour légitimer le
pouvoir.
Le discours de Jean-Luc Mano révèle pourtant une représentation plutôt optimiste du
fonctionnement du système politico-médiatique français, où la rétroaction entre ces deux
domaines se caractérise par la concertation permanente. Le communicant utilise le terme
partenariat pour définir la relation entre les communicants, les représentants politiques et
les journalistes, situation dans laquelle la demande du journaliste conduit le politique à
progresser dans la recherche de production d'idées. Le travail fait par le politique et le
conseiller en communication contribue aussi au travail du journaliste d'obtenir de réponses.
Ainsi, malgré les conflits et les malentendus intrinsèques de cette « relation dialectique » –
comme il la qualifie – c'est quand même un partenariat « parce que le but est d'arriver à des
résultats satisfaisants pour le client, pour les journalistes, pour les médias et pour le
public ».
Quelle que soit la situation, la communication politique est toujours confrontée aux
défis qui s'imposent à la relation intrinsèquement conflictuelle entre les journalistes et les
dirigeants politiques. S'ajoutent à la situation les contraintes commerciales qui pèsent sur
l'activité journalistique, renforçant la vision que « bad news make better news than good
news »79, logique prédominante quand il s'agit de l'actualité politique. Ainsi, plus que
répondre aux attaques des adversaires dans leur propre champ, les hommes et femmes
politiques sont aussi obligés de gérer leur image publique lors d'une reprise médiatique. En
ce sens, l'exemple de l'Interviewé 1 est très pertinent. Il explique qu'un sujet polémique
posait déjà de problèmes à la candidate à la mairie du Ve Arrondissement avant même la
campagne de 2014. Pourtant, la reprise des arguments de ses adversaires politiques par la
presse au cours de la compétition a aggravé la situation : le passage par l'instance
journalistique fonctionne comme un acte d'investiture et de légitimation de la parole des
adversaires vis-à-vis de l'opinion, situation possible grâce au statut social de l'instance
journalistique.
Ainsi, le champ politique étant un espace de luttes symboliques, sa logique repose
notamment sur la nécessité de prouver sa représentativité, de mobiliser les votes autour de
son projet par rapport à ceux de ses adversaires à travers un processus de distinction, c'est-à-
dire de se montrer différent par rapport aux autres acteurs contre lesquels ils faut se battre
79 Gerstlé, 2008, pp. 106.
85
(Bourdieu, 1984). Dans cette compétition, s'ajoute aussi la dispute entre deux groupes
opposants de « professionnels de l'information » : les journalistes et les communicants
politiques, dont la reconnaissance et la légitimité professionnelle est souvent mise en cause
par les premiers. Ayant d'un côté les journalistes politiques sous-tendus par la rhétorique de
l'objectivité journalistique – qui leur accorde une expertise dans le domaine politique, de
l'autre les communicants politiques, dont le maniement d'une rhétorique du bon démocrate
cherche à leur accorder une crédibilité professionnelle, la grande question qui se pose est :
'qui raconte l'histoire' ? Autrement dit, dans cette relation mi-conflictuelle, mi-consensuelle
qui caractérise les rapports entre médias et politique en France, nous avons au fond une lutte
pour i) la conquête de capital symbolique par les communicants politiques et ii) pour le
maintien de ce capital symbolique par le champ journalistique. Ainsi, la vraie dispute entre
ces deux domaines de l'espace social relève de la capacité de l'un ou de l'autre à imprimer sa
version auprès de l'opinion.
Les exigences structurelles de l'activité politique contemporaine sont le reflet des
singularités de la communication de nos sociétés actuelles, où la circulation des messages de
l'instance du pouvoir est soumise à un processus de filtre / décryptage des médias et de
réinterprétation par l'opinion (Delporte, 2006). Dans ce contexte, D. Georgakakis (1995)
attire l'attention sur la double fonction des journalistes : d'un côté, en faisant valoir leur
vigilance sur les « coulisses du pouvoir » et, de l'autre, en soulignant toute l'importance
d'une image médiatique des hommes politiques, dont ils sont par ailleurs les principaux
relais sinon les inventeurs. Ainsi, le processus d'autonomisation de la sphère journalistique
de la politique serait à la base de l'émergence de ce nouvel acteur de l'instance du pouvoir,
dont l’existence et le déroulement du travail sont étroitement liés à la structure
journalistique, scellant ces deux univers indissociables.
G) La communication politique comme un outil d'harmonisation entre discours
voulu et discours perçu
Si à ses débuts la maîtrise des techniques et outils de communication apparaît
comme une solution miraculeuse aux échecs politiques, la période actuelle ne fait que
refuser cette conception essentiellement instrumentale de la communication politique. La
hausse du flux d'informations qui a commencé avec l'avènement des médias et qui a atteint
son apogée lors de la révolution numérique a mis en place un nouveau zeitgeist ancré sur
86
l'immédiateté – dont les chaînes d'information en continu représentent le grand cauchemar
des dirigeants politiques. Ainsi, la combinaison médias de masse / Web favorise l'émergence
d'une nouvelle ambiance informationnelle caractérisée par la surmédiatisation de la société,
et conduit à une autre vague d'innovations et de défis des pratiques de communication, qui
cherchent à rendre compte des obstacles imposées à l'administration de la vie politique.
Le croisement des analyses de notre corpus a révélé un consensus autour de la
représentation de la communication politique comme un outil d'harmonisation entre le
discours politique « voulu » par le politique et le discours politique « perçu » par le public, à
la fois électeurs et audience des médias. A la base, la fragilité des liens entre les
représentants politiques et les citoyens et la pluralité des discours offerts par la multitude des
canaux de diffusion. L'analyse des données révèle une perspective holistique de la
communication politique, qui emprunte des connaissances des domaines théoriques très
diversifiés pour rendre compte de son ambition majeure : faire comprendre les idées du
représentant politique.
À cet égard, la définition de Ludivine Moles est claire :
La communication consiste surtout à savoir commentfaire comprendre aux gens les idées d'un hommepolitique. (…) Il s’agit surtout de simplifier aumaximum et de toucher le plus de gens. (…) On peuttout faire de A à Z. Ça veut dire qu’on peutdévelopper une idée auprès de l'homme politique pourvoir ensuite ensemble comment la diffuser, par quelsmoyens, et comment la faire comprendre.
(L. MOLES, 06.02.2015)
D'après la communicante, la communication politique est l'espace du champ
politique où s'opère une simplification des idées naturellement complexes des dirigeants en
cherchant à favoriser leur compréhension par le public. Autrement dit, la communication
politique serait une zone de traitement de la pensée brute des hommes et des femmes
politiques pour les diffuser auprès des citoyens de façon plus efficace. Ce passage à propos
du processus de traduction du message interne vers l'externe décrit par la communicante
rejoint précisément les trois dimensions de la communication politique proposées par J.
Gerstlé (2008) : i) une dimension pragmatique, révélée par le contrôle de la perception du
public, comme le montre l'emploi des expressions « faire comprendre » et « toucher les
gens » ; ii) une dimension symbolique, dont le langage joue un rôle très important, comme le
révèlent les expressions « simplifier au maximum », « la développer [l'idée] auprès de
l'homme politique » et « (..) comment la diffuser », et iii) une dimension structurelle,
87
visible par la préoccupation des canaux de diffusion du message.
La même conception se trouve dans le discours de Gaspard Gantzer :
La bonne communication politique c'est celle qui estau service du fond, qui aide d'une part à ce que queles décisions des politiques soient comprises, d'autrepart, celle qui permet une relation entre les citoyens etle politique – compréhension, dialogue, écoute. Ettroisièmement, celle qui parfois peut être accompliepar l'action. Qui peut aider à ce qu'une décisions'imprime dans l'opinion publique, soit appropriéepar les citoyens.
(G. GANTZER, 29.04.2015)
Et aussi de l'Interviewé 1 :
J'ai toujours eu envie de concevoir le mot« politique » dans le sens premier du terme, c'est-à-dire les choses de la Cité. Donc, je souhaite que lacommunication politique soit la communication surles affaires de la Cité et que ça permette au citoyend'être éclairé, de comprendre les décisions, de voteren conscience, d'avoir un dialogue avec sesreprésentants »
(Interviewé 1, 27.03.2015)
Ainsi la communication politique serait-elle un espace d'échange entre les citoyens
et les représentants politiques envisageant le dialogue comme la voie possible pour aboutir à
la compréhension des décisions des dirigeants, donc le soutien des citoyens. En portant une
attention très nette au débat et à la confrontation des points de vue, on remarque chez
Gaspard Gantzer et Interviewé 1 une conception délibérative de la communication politique
à l'image de la proposition de J. Gerstlé, où la participation des citoyens est une condition
fondamentale pour la démocratie.
L'acte de faire-valoir de l'activité politique est central dans la représentation de la
communication politique chez Benjamin Guy, pour qui la mission de la communication
politique, spécifiquement en ce qui concerne les élus locaux, est celle de démontrer la
capacité des représentants politiques d'agir sur le réel. Selon le communicant, celle-ci est
une forme de confiance des électeurs qui leur ont donné le pouvoir : « C'est pour ça qu'on
fait de plus en plus de communication. Parce qu'on doit traiter beaucoup plus de données et
démontrer des choses de moins en moins démontrables dans le fait ». Le discours de
88
Benjamin Guy octroie à la communication politique un rôle d'élucidation des actions
politiques à l'égard des citoyens dans un contexte d'extrême vulnérabilité de la parole
politique. D'après lui, c'est à cette modalité communicationnelle de faire preuve de
l'efficacité des actions invisibles médiatiquement. Dans un contexte de méfiance envers la
politique, la mise en avant des effets positifs de l'action politique sur le quotidien tangible
des citoyens devient l'une des fonctions les plus importantes de la communication. Ce point
de vue est aussi partagé par l'Interviewé 1, qui considère les nouvelles technologies de la
communication et de l'information de l'ère numérique – surtout Twitter – comme très
efficaces. En conférant à l'instance politique une certaine autonomie dans la construction et
l'appréhension de son message par les publics, ces outils acquièrent une place de plus en
plus significative dans les routines de travail des communicants politiques.
À l'instar de ces passages, l'analyse de l'ensemble des entretiens a repéré trois axes
principaux de la représentation de la communication politique contemporaine : i) une zone
de traduction des idées du représentant du pouvoir à travers le croisement des dimensions
pragmatique, symbolique et structurelle, telle que la proposition de J. Gerstlé ; ii) une rôle
actantiel de valorisation de l'action politique, en cherchant à attirer l'attention des citoyens
au-delà de la sphère de visibilité médiatique et iii) la compréhension d'une construction
collective de la gestion du pouvoir, en favorisant l'ouverture à de nouvelles modalités
d'interaction et de dialogue entre représentants et représentés. Ces trois notions émergent des
discours de tous les interviewés, révélant une image de la communication politique liée à
l'harmonisation de la parole politique dans une ambiance informationnelle frénétique, où
communiquer avec les citoyens devient de plus en plus difficile malgré la pluralité des
canaux de diffusion et de circulation des informations.
La notion de communication politique comme construction collective repérée dans
le discours des interviewés s'approche ainsi de la définition de D. Wolton (1995), pour
lequel cette activité est l'intersection entre l'espace public, l'espace public communicationnel
et l'espace public politique, arène symbolique où s'échangent les discours des représentants
politiques, des journalistes et de la représentation de l'opinion publique. Or, penser la
communication politique comme un outil d'harmonisation des discours sur le politique
signifie prendre en compte ces trois protagonistes, dans un « système complexe de
transactions dont le repérage peut aider à formuler l'activité politique en termes stratégiques
différents des schémas de la propagande politique »80. En ce sens, l'image des communicants
80 GOURÉVITCH Jean-Paul, L'image en politique, De Luther à Internet et de l'affiche au clip , Paris,Hachette Littérature, 1998, pp. 68.
89
à l'égard de leur espace d'activité rend visible une conception horizontale des pratiques
capable de surmonter les limites d'un contexte où les gouvernants sont exposés en
permanence, et valorisant le côté positif de la transparence apportée par la révolution du
paysage médiatique. Cette notion renforce leur image d’« agents de la démocratie », dont la
mission fondamentale est de promouvoir la publicisation de la chose publique, en refusant le
statut secret de la politique d'autrefois, désormais non admissible dans la structure de la
démocratie actuelle.
H) L'espace social comme vecteur de professionnalisation de la Communication
Politique
L'analyse de l'ensemble de données a fait ressortir quelques pistes pour éclairer la
problématique qui entoure les études dans le domaine de la communication politique. Les
transformations de l'espace public depuis l'avènement de la presse puis son élargissement à
l'heure de la révolution numérique apportent une série de changements substantiels dans
l'espace communicationnel social où le champ politique est potentiellement affecté. Ainsi, la
professionnalisation du personnel politique peut être associée à la complexification naturelle
du système social moderne, où la médiatisation de la vie politique finit par accélérer cette
situation déjà existante.
La communication politique, partie constitutive du discours politique, possède la
particularité d'être une démarche construite et re-construite ad infinitum à travers le
processus de réinterprétation de ce « qui est dit ». Autrement dit, la parole politique est
aussi « ce qui est perçu » de ce qui est dit, constamment soumise aux effets de la
médiatisation et de décodage de ces messages, pour reprendre le concept de Stuart Hall, par
le public. Toutefois, la nature métamorphosable du corps social et les innovations
incessantes du paysage informationnel restructurent constamment ce schéma, en
réorganisant pareillement les rapports de plus en plus complexes entre les décideurs et les
citoyens. Si d'un côté la pluralité des modes de diffusion et de circulation de messages a mis
en place une nouvelle ambiance informationnelle plus ouverte et démocratique, de l'autre
l'abondance des canaux a produit encore d'autres préoccupations pour le personnel politique.
Paradoxalement, c'est dans un moment d'extrême effervescence informationnelle que
communiquer, attribut indigène de l'art de gouverner, devient une tâche difficile à accomplir.
90
Comment établir des liens avec les citoyens et incarner l'intérêt collectif dans un
environnement si fugace, où les discours et les images se construisent et se détruisent de
façon presque immédiate ? Or, ces représentations éphémères, propres à la « modernité
liquide » pour reprendre l'heureuse expression de Zygmunt Bauman, justifient par ailleurs la
quête permanente du perfectionnement et de l’innovation dans toutes les dimensions
archétypales de la communication politique.
Cette réalité a pu être constatée à travers notre échantillon, notamment si on prend
en compte les communicants qui travaillent en externe, comme Jean-Luc Mano, Robert
Zarader et Philippe Moreau-Chevrolet, dont les équipes sont majoritairement formées de
jeunes communicants/universitaires avec une formation en communication ou en science
politique dans des établissements très reconnus, tel que le CELSA et Sciences Po. En ce
sens, la création de formations en science politique ou même celles spécifiques en
« communication politique » depuis les dernières années révèle très nettement la dimension
heuristique de la maîtrise de la communication dans ce domaine spécifique de l'univers
social et justifie également son émergence en tant que monde professionnel81. Or, dans un
contexte où la médiatisation imprègne ostensiblement les espaces d'échange entre les
individus, les hommes et femmes politiques sont incités à intégrer les logiques
communicationnelles dans leur routine afin d'anticiper et de nuancer les effets de ce
« passage obligatoire » par les médias sur leurs décisions et leur image publique (Riutort,
2007). C'est pour cela que le quinquennat de N. Sarkozy est si mémorable. Comme cela a
été rappelé par certains communicants, l'ancien-Président a su se servir de la logique de
fonctionnement des médias pour légitimer son pouvoir auprès de l'opinion, en profitant de
l'actualité médiatique pour donner le « rythme » à son gouvernement. L'attention portée à la
place centrale des médias au sein de l'opinion a façonné le style de communication adopté
par N. Sarkozy, caractérisé par les limites très fragiles avec le marketing politique, comme
le souligne J. L. Missika82.
De son côté, la révolution numérique a mis en place une gamme de nouveaux outils
et modalités d'interaction qui ouvrent une nouvelle perspective pour l'avenir démocratique.
L'exemple du fact-checking (vérification par les faits) est très emblématique à cet égard. La
81 L'apparition des débouchés professionnels issus des entreprises de presse, des instituts de sondage, decabinets spécialisés, d'agences de communication et de publicité justifie à partir des années 1980-1990l'accroissement de l'offre des formations universitaires liées au monde de la communication. Ce domainedevient clé, en détrônant le journalisme, qui ne devient qu'un débouchés parmi d'autres de la filière, « alorsque la frontière symbolique - revendiquée par les journalistes - séparant information et communicationapparaît obsolète au nom du réalisme des débouchés » (Riutort, 2007, pp. 82).
82 Entretien au Le Monde disponible sur http://www.lemonde.fr/societe/article/2007/09/05/jean-louis-missika-la-strategie-mediatique-de-nicolas-sarkozy-finira-par-avoir-un-cout-politique_951401_3224.html.
91
nouveauté, apparue lors de la campagne présidentielle française de 2012, permet de vérifier
en direct l'exactitude des chiffres et d'autres informations dans le discours des candidats.
Nonobstant les apports indubitablement positifs du Web, certaines contraintes demeurent un
obstacle à l'efficacité effective des nouvelles technologies de l'information et de la
communication à l'égard de la citoyenneté. D'un côté, il faut prendre en compte une
influence d'ordre socio-démographique, dont la disparité d'accès et même de maîtrise de ces
outils par le grand public représente un premier obstacle. De l'autre demeure la
prédominance d'une culture professionnelle des journalistes politiques plutôt combative que
pertinente, malgré leur niveau d'études et leur capacité cognitive à profiter à fond des
possibilités ouvertes par cet apparat technique. En ce sens, Benjamin Guy ajoute qu'il n'y a
donc pas de changement substantiel dans la façon dont ils structurent le discours sur le
politique, « en conditionnant ainsi la manière dont les citoyens appréhendent l'information
du type politique ». Ainsi, la dissonance des possibilités se confronte à la réalité des usages
et appropriations de ces outils par les professionnels de l'information et aussi par le grand
public, encore en voie d'adaptation au fonctionnement de l'environnement numérique. En
revanche, le Web étant un espace en constante transformation et négociation du sens, il se
fonde sur la « médiactivité », qui renforce l'importance de la communication politique en
tant qu'outil de consolidation de la parole des représentants politiques. La logique déjà
frénétique du flux d'informations à l'ère des mass media, notamment amplifiée par l'arrivée
des supports numériques, a considérablement réduit le temps de réflexion des décideurs
politiques, de plus en plus poussés à réfléchir et à réagir presque en temps réel à l'actualité.
À cela, Nicolas Baygert ajoute la situation d'élection permanente à laquelle sont soumis les
représentants politiques, où, même avant la période électorale, le horse race journalism
émet des spéculations sur les prochains compétiteurs de la bataille pour le pouvoir. Le
communicant parle d'un « phénomène d'hystérisation du champ politique », qui n’aide pas
les leaders politiques en mandat à effectuer une gestion cohérente, pragmatique et
rationnelle.
Ces constatations permettent un aperçu des défis et des contraintes de l'activité
politique contemporaine et mettent en avant la mise en place d'une « professionnalisation
naturelle » de la communication politique, argument majoritairement mentionné par la
population sondée. En ce sens, le passage à un système politique dont l'organisation suit une
tendance de plus en plus professionnelle83 restructure aussi les façons de lutter pour le
pouvoir dans l'arène politique, mobilisation qui – comme l'avait prévu P. Bourdieu (1981) –
83 Cf. Demazière, Le Lidec, 2014.
92
a lieu à deux degrés : dans un premier temps, une compétition entre les partisans pour entrer
dans la dispute ; ensuite, la dispute effective avec les représentants d'autres camps et les
espaces de production et de diffusion des principes de division du monde social, autrement
dit l'instance de visibilité médiatique, désormais substantiellement élargie par l'avènement
de l'ère numérique. Or, pour arriver et légitimer son pouvoir, l'homme ou la femme politique
est obligé de i) faire preuve de compétence à l'égard de ses confrères, ii) se distinguer des
adversaires, mais tout en cherchant un consensus avec les citoyens et iii) témoigner leur
crédibilité auprès de l'opinion, où la conquête d'une visibilité médiatique favorable est
fondamentale. Ainsi, à part les actions qui renvoient essentiellement à la politia, les
conseillers et communicants jouent un rôle heuristique auprès des décideurs publiques,
notamment pour les aider à anticiper et à réagir de façon plus rationnelle aux pièges
inhérents à la médiatisation de la vie politique.
93
CONCLUSION
Si d’un côté l'évolution des supports médiatiques a permis le partage et la diffusion
d'informations à grande échelle, de l'autre il faut prendre en compte les conséquences que
cet environnement surmédiatisé peut entraîner. Dans le cadre de ce mémoire, nous nous
sommes intéressés aux effets que cette conjoncture informationnelle a engendrés dans un
domaine d'activité sociale particulier : la communication politique.
Tout en rappelant nos limites en termes d’exhaustivité ou de représentativité dans les
délais impartis, notre objectif a été de présenter une palette de la plus grande diversité
possible parmi les profils et logiques de professionnalisation identifiés dans le discours des
neuf communicants politiques sondés. Grâce aux outils de l'analyse du discours, associés à
la perspective de la sociologie compréhensive, nous avons pu identifier, à travers les
réponses structurées de leur discours, les logiques professionnelles, principes et motivations
à l'égard de leur rôle en tant que communicant, mais aussi dans le champ de la
communication politique actuelle.
Un premier résultat révèle l'hétérogénéité des origines des communicants : formation
en communication politique, anciens journalistes, académiques, économistes, scientistes
politiques, hauts fonctionnaires de l'État. L'absence de profil type parmi les interviewés
montre la pluralité des parcours et rend visible l'influence générationnelle dans les
changements propres au milieu. Comme nous l’avons présenté dans la troisième partie,
notre échantillon peut être divisé en quatre axes typologiques : i) un parcours en Science
Politique suite à une formation complémentaire en communication ou vice-versa ; ii) une
formation orientée vers la carrière publique ; iii) les communicants qui travaillent en externe
dans les agences de communication/conseil, donnant un support plus spécialisé au personnel
politique et iv) un parcours spécifique en Communication Politique. Même si, a priori, la
diversité des profils semble indiquer une incohérence avec la notion de professionnalisation,
ces différences peuvent s’expliquer par l'influence du facteur générationnel et des
transformations de l'espace social au cours des années et à différents moments. Cela
justifierait, par exemple, la prédominance d'une formation plus spécialisée et plus
sophistiquée chez les communicants les plus jeunes, à l'instar de Ludivine Moles, Benjamin
Guy et Nicolas Baygert, tandis que les formations plus « éloignées » de leur domaine
d'activité se retrouvent chez les plus âgée, comme Robert Zarader et Anne Dorsemaine,
restant ces pistes à être approfondies dans une étude ultérieure.
94
L'analyse de notre corpus a aussi permis de repérer une visée partagée par nos
interlocuteurs à l'égard de leur rôle en tant que communicants politiques. La préférence pour
une performance distanciée plutôt qu’une posture engagée politiquement a été une constante
parmi l'ensemble des entretiens, renforçant un processus majeur en amont même de la
rationalisation du travail politique, comme l'indique D. Demazière (2014). En ce sens, nous
avons repéré dans le discours de nos interlocuteurs la prédominance d'un principe
professionnel fondé sur la séparation entre la forme (communication) et le fond (politique).
Étant donnée la place croissante et heuristique accordée ces dernières décennies par le
personnel politique à la communication, l'adoption d'une posture plus objective peut être
envisagée dans la continuité du processus de spécialisation qui a commencé à la fin des
années 1950, en passant par l'importance des techniques et des outils des sciences sociales et
du marketing (tels les sondages et la fabrication de l'image politique). En outre, la
prédominance de cette vision dans l'ensemble de notre échantillon suggère une rupture avec
l'une des résistances du modèle français de communication politique : la tradition partisane.
D'un côté, les exemples de Ludivine Moles et surtout de Benjamin Guy – qui refuse de se
procurer la carte du parti pour conserver davantage d'objectivité et de lucidité sur le parti et
sur son travail – peuvent être compris comme l'indice d'un renouvellement des critères
d'excellence au sein des partis concernant le profil des communicants, plus spécialisés et
capables de comprendre les enjeux de la communication politique actuelle. De l'autre, il faut
considérer les contraintes économiques directement liées à la ‘hiérarchie’ du champ
politique, ce qui ne permet pas une distribution égalitaire des ressources parmi les partis pas
plus qu’entre les différentes positions des acteurs. Cela justifierait, par exemple, le choix de
Gaspard Gantzer d’être le conseiller en Communication du président de la République, du
fait de son parcours universitaire – ses diplômes seraient une « attestation d'expertise » en
quelque sorte – et professionnel. Un critère de recrutement peut être particulier à cette
position spécifique, hypothèse à vérifier dans une étude ultérieure. De plus, l'apparition de
deux catégories différentes de communicants politiques – ceux qui travaillent en interne,
c'est-à-dire dans les partis, et ceux qui travaillent en externe, qui possèdent des agences de
communication ou de conseil et qui travaillent souvent pour camps politiques différents
(tout en prenant en compte les exceptions, à l'instar de Robert Zarader) et pour des
entreprises – et le recours usuel à leurs services révèlent une reconnaissance de leurs
compétences et savoir-faire, dont une performance plus objective et plus neutre apparaît
comme un prérequis pour l'efficacité des actions mises en place.
Sachant l'importance de l'agora médiatique en tant que vitrine et zone de
95
légitimation de la parole politique auprès du public, la représentation du communicant en
tant que « stratégiste » a été repérée dans le discours de nos interlocuteurs. L'analyse des
données recueillies a montré que ces acteurs jouent un rôle de « facilitateurs » auprès des
décideurs politiques. D'un côté, ils doivent les pousser à descendre de plus en plus dans
l'arène en cherchant à établir une relation de proximité avec les citoyens pour reprendre la
leadership politique (notion étroitement liée à la gestion du pouvoir mais très affaiblie en ce
moment). De l'autre, en jouant un rôle d'alerte et d' « agents de la démocratie », ils doivent
les aider à identifier les obstacles et les opportunités, tout en cherchant à orienter le débat
public vers les vrais sujets politiques aux dépens des questions périphériques souvent mises
en avant par les médias. Ainsi, les communicants ont souligné le poids de la réflexion à la
base des stratégies autour de trois dimensions de la communication politique – structurelle,
symbolique et pragmatique, selon J. Gerstlé. Cette démarche devient centrale pour
l'efficacité des pratiques communicationnelles mises en place par l'instance politique,
particulièrement en regard du désintérêt croissant pour ce type d'information par le public.
Notre étude a mis en avant les enjeux de la vie politique médiatisée et la façon dont
cela conduit à une restructuration de l'instance politique et à un renouvellement des propres
conditions du discours politique. Si dans un premier temps la vision médiacentrique, ancrée
dans la maîtrise des techniques du marketing politique et des sondages d'opinion pour
« fabriquer » un candidat, a marqué le discours d'expertise des spin doctors, leurs
homologues contemporains révèlent l'impuissance de ce modèle professionnel. À travers
l'analyse des entretiens, nous avons pu constater une croyance en une expertise propre
appuyée sur une vision globale de leur rôle face aux défis de la vie politique moderne, où la
compréhension approfondie des « médiamorphoses » et des évolutions de nos sociétés
apparaît comme un atout. Ainsi, loin de se présenter comme « les agents de la politique
moderne », nos interlocuteurs ont mis en avant la sophistication des pratiques
communicationnelles dans ce domaine comme une extension et une adaptation nécessaires
aux mutations de nos sociétés et des modes de socialisation et de participation politique, où
la communication politique est loin d'être une préoccupation secondaire.
Envisageant les enjeux de la communication politique à partir d'une vision holistique
de la gestion du pouvoir, la préoccupation généralisée de l'affaiblissement des liens entre
décideurs et citoyens a été repérée chez l'ensemble de la population sondée. Notre recherche
révèle la prédominance de la représentation d'un type idéal de communication politique,
orienté par les principes démocratiques et par les vertus éthiques des communicants ainsi
96
que par la frontière entre « communication » et « politique », la première demeurant
subalterne par rapport aux actions effectivement mises en place par les décideurs84. La
dimension dialogique de cette spécialité communicationnelle est omniprésente dans
l'ensemble de la population sondée, confirmant la définition de C. Delporte (2007) pour qui
communiquer en politique signifie chercher à établir un dialogue suivi avec l'opinion
publique. En ce sens, les pratiques communicationnelles en politique doivent être réinscrites
dans la perspective de leur « politicité », en tant que composantes de l'action politique
proprement dite, notamment dans le contexte de défiance qui frappe la classe politique. Cela
nous conduit à ne pas envisager ce domaine tout simplement comme un outil de production
et de transmission des messages de l'intérieur vers l'extérieur de l'instance politique, ce qui
serait une vision limitée ; nos résultats proposent une compréhension de la communication
politique comme un espace d'échange d’où émergent les rapports de force existant entre les
protagonistes des systèmes démocratiques contemporains : les dirigeants politiques, les
médias et les citoyens.
La réalisation de cette étude a offert un panorama de la place croissante de la
communication en politique et des paramètres conduisant à sa sophistication en regard des
enjeux de l'explosion des modes de communication et des médias d'information, ainsi que
de la complexification et de la technicisation de nos sociétés (Mercier, 2001). Tout en
prenant en compte les limites des démarches mises en œuvre dans cette première étape de
notre thèse, nous avons pu constater la symbiose caractéristique du couple médias et
politique en France et le poids de la sphère de visibilité médiatique pour la conquête du
capital politique. Nonobstant les apports incontestablement positifs de la révolution
numérique et du développement des nouveaux médias, la télévision demeure une instance
de médiation de l'information politique essentielle et joue un rôle central en termes de
formation civique et de socialisation politique des citoyens. Ainsi, ces deux sphères
entretiennent une relation de rétroaction et de concertation permanente. La posture
combative des journalistes politiques et leur préférence pour les « jeux » aux dépens des
« enjeux » demeure un obstacle constant pour les dirigeants, poussés à s’adapter aux
logiques des professionnels de l'information pour bénéficier d’une « la bonne
médiatisation ». Selon J. Gerstlé (2008), la baisse de l'engagement politique dans les partis
et les syndicats favorise la mise en place d'un processus de privatisation de l'espace public à
84 La capacité à proposer ds nouveaux projets et à gérer les situations de crise, ainsi que l'action politiqueeffective sont les vecteurs de confiance les plus importants chez les citoyens, comme le montre leBaromètre de la confiance en politique – Février 2015, disponible sur : http://www.cevipof.com/fr/le-barometre-de-la-confiance-politique-du-cevipof/resultats-1/vague6/vague6bis/
97
travers l'isolement du citoyen dans son espace privé. Conséquence, la dépolitisation le
rendrait plus susceptible aux effets des représentations spectaculaires du jeu politique
médiatisé, ce qui serait à l'origine des sentiments d'apathie, d'aliénation, de défiance, de
confusion voire de peur de la politique, l'instabilité électorale restant l'un des indices
d'affaiblissement des identifications partisanes et de l'intérêt pour l'actualité. Le passage
obligatoire par la tribune médiatique associé au scénario déclinant de la vie publique
contemporaine justifient les nouvelles possibilités ouvertes aux professionnels de la
communication politique dans une période d'extrême vulnérabilité de la parole politique, où
la quête permanente de l’efficacité en matière de communication change aussi les règles de
recrutement des agents, qui trouvent dans ce domaine les conditions favorables pour
consolider un nouveau territoire professionnel, comme nous le pouvons vérifier grâce aux
différentes étapes d'innovation et de sophistication des outils et pratiques mis en place.
Ainsi, le traitement superficiel de l'actualité politique médiatisée et commentée presque en
temps réel et ses effets sur l'opinion est une préoccupation omniprésente de nos
interlocuteurs, leur capacité à aider les représentants politiques à nuancer ces effets auprès
du public demeurant une attestation de compétence et d'expertise.
Penser la représentation des hommes et femmes politiques dans le contexte actuel
c'est d'ailleurs concevoir une image juxtaposée, issue de la sédimentation des différentes
interprétations et re-interprétations qui caractérisent les processus de communication de nos
sociétés. Pour cela, l'analyse des données recueillies souligne la représentation de la
communication politique en tant qu'outil d'harmonisation entre le discours voulu par le
politique et le discours perçu par le public, à la fois électorat et audience des médias. Cette
réalité oblige les postulants au pouvoir à rendre compte d'un double défi : exalter leurs
différences par rapport aux adversaires tout en cherchant à susciter le consensus de la part
du public et, en même temps, ajouter à leur performance une dimension médiatiquement
attirante, visant à s'inscrire dans cette sphère de visibilité pour légitimer leurs actions au
regard du public. Ces contraintes conduisent l'instance politique à adopter une certaine
routinisation des actions mais aussi à d’autres modalités de communication avec les publics.
L'émergence de nouveaux cadres de mise en scène de la vie politique, à l'instar des
programmes mélangeant discours et divertissement à partir des années 199085 – qui trouvent
leur validité en prétendant contribuer au débat public avec des succès plus ou moins
probants – , apparait comme une tentative d'attirer l'attention des citoyens-téléspectateurs de
85 Plus à ce sujet, voir COSSART Paula, TAIEB Emmanuel, « Spectacle politique et participation » Entremédiatisation nécessaire et idéal de la citoyenneté, Sociétés & Représentations, 2011/1 n° 31, p. 137-156.DOI : 10.3917/sr.031.0137.
98
moins en moins intéressés par l'actualité politique, spécialement les jeunes générations,
tranche sociale difficile à toucher et qui compte la majorité des cas d'abstention86. La
communication politique étant plus que jamais menacée par la faible implication des
citoyens dans la vie publique et par l’indifférence à l'égard de toute forme de gouvernance
(Zémor, 2007), les difficultés d'accès aux différents publics et la multitude des canaux de
diffusion et de circulation de l’information sont les barrières les plus difficiles à surmonter
par la communication politique moderne. Cela justifie, comme nous l’avons constaté tout au
long de ce mémoire, une nécessaire sophistication, visant davantage d’efficacité et
d'harmonisation des images produites par le jeu de miroir caractéristique de la médiatisation
de la vie politique.
Si, à ses débuts, l'expertise technique différenciait ces « hommes de l’ombre », le
contexte actuel fait appel à un professionnel plus segmenté et pluriel, capable de jouer tout à
la fois un rôle de sociologue, de politiste et de communicateur. À ce propos, l'analyse des
entretiens suggère l'émergence d'un nouveau type de communicant politique, capable non
seulement de comprendre le modus operandi de la machine médiatique et de maîtriser
l'éventail des technologies de la communication et de l'information, mais aussi d'être
sensible aux transformations des rapports sociaux et des modèles de comportement issus des
mutations des échanges médiatisés (Miège, 2010), en sachant anticiper les opportunités et
les obstacles qui peuvent se poser aux représentants politiques. La réalisation de cette
recherche nous a alors conduit à déplacer la focale des médias vers la réception, celle-ci
étant à l'origine des transformations de la communication politique depuis les dernières
décennies : ce sont les révolutions qui ont lieu du côté du public (à la fois audience et
électorat) qui conduisent à l'émergence de nouvelles demandes de qualification du personnel
politique. De même que la montée en puissance de la télévision à partir des années 1960 a
bouleversé les rapports entre représentants et représentés, les technologies numériques
commencent progressivement à reconfigurer cette relation. Cet environnement dynamique
et instable et le passage obligatoire par l'instance de visibilité médiatique imposent d'autres
contraintes aux communicants politiques, obligés d’être de plus en plus qualifiés pour
résoudre les problèmes qui se posent dans leur travail. Ainsi, la sophistication en termes de
formation, de savoirs, savoir-faire et capacité de compréhension des jeux et enjeux de la vie
politique contemporaine et des évolutions de l'espace social a contribué à l'édification d'une
86 Les élections municipales de 2014 ont enregistré un record d'abstention, au premier comme au deuxièmetour. Parmi les jeunes de 18-24 ans, l'abstention a atteint 59 %. Source : Élections municipales 2014 - LesEnjeux : La vague d'abstention, Avril 2014, disponible sur http://www.cevipof.com/rtefiles/File/Atlas%20Electoral/noteAnne.pdf.
99
représentation d'expertise chez ces professionnels, comme nous l'avons pu constater à
travers nos résultats.
Concernant les apports du Web à l'égard des pratiques communicationnelles en
politique, notre étude a mis en avant l'importance de la dimension technique dans ce
domaine, dans la mesure où la maîtrise efficace de ces outils devient aussi un critère
d'excellence chez les communicants politiques. Les nouveautés de la révolution numérique
ont créé d'autres lieux d'interface d'échange et de contact avec les publics, en introduisant
d'autres critères d'excellence et de savoir-faire spécifiques à la génération actuelle des
professionnels de la communication politique. La « médiactivité » intrinsèque du Web et les
constantes transformations et négociations du sens des discours qui y circulent renforce la
nécessité de la sophistication permanente des pratiques communicationnelles en politique.
En outre, la frénésie des données met en avant la fragilité des liens entre gouvernants et
gouvernés, rendant visibles les défis qui se posent au système démocratique dans une
période où la surmédiatisation de la parole politique annule curieusement la communication.
À l'instar de l'ère télévisuelle, l'ère numérique a elle aussi offert à la communication
politique une nouvelle vague d'espoir avec Internet et sa nature a priori ouverte à tous. Du
point de vue démocratique, la restructuration de l'espace social orchestrée par les médias et
les technologies de l'information et de la communication a permis également le
développement des systèmes de contrôle des actions publiques – à l'instar du fact checking
déjà mentionné plus haut mais aussi des big datas et open datas87 – qui ouvrent une nouvelle
interface d'accompagnement et de participation à la vie publique en refusant le « secret » et
la rétention d'informations, attributs du pouvoir dans le passé. Pourtant, même si l'Internet a
rendu possible un élargissement des preneurs de parole, il ne faut pas surestimer ses vrais
effets, comme l'indique Bernard Miège (2010). Nous avons vu que les promesses de
démocratisation de l'information n'étaient pas forcément valables : elles trouvent leurs
limites dans les fractures préalables du tissu social et aussi dans le potentiel marchand qui
tend à s'imposer sur le fonctionnement du réseau (Cardon, 2010 ; Rebillard, 2007). Ainsi, du
point de vue pragmatique, la maîtrise de ces outils par le politique et le public, mais aussi
l’insertion dans les pratiques informationnelles des citoyens demeurent un obstacle à
l'efficacité de ces nouveaux espaces d'exercice de la citoyenneté et de l'engagement
politique. Pour cela, les appropriations et usages effectifs de ces supports par l'instance
87 En France, la plateforme « data.gouv.fr » permet aux services publics de diffuser des données et à lasociété civile de les consulter, de les interpréter et de les enrichir, en cherchant à coproduire desinformations d'intérêt général.
100
politique doivent être envisagés à long terme, sans oublier la prédominance de la télévision,
grande arène des batailles discursives des agents politiques pour le contrôle d’une image
publique favorable.
Pour revenir sur nos questionnements sur un processus de professionnalisation
effective de la communication politique, l'analyse des entretiens, à la lumière des apports de
la sociologie des professions, nous a permis d'identifier certaines tendances intéressantes qui
fournissent des pistes fructueuses. D'abord, la croyance en un savoir-faire voire en un
savoir-être spécifique des communicants, l'existence de valeurs et principes communs, la
routinisation des pratiques et l'emploi de modes opératoires très proches, et la notion
d'appartenance à un groupe professionnel particulier – rendu visible notamment par l'emploi
de pronoms ou pronoms possessifs de la première personne du pluriel – apparaissent
comme des indices de la délimitation d'un territoire professionnel obéissant à une logique de
fonctionnement propre. Deuxièmement, la création de formations universitaires spécifiques
à partir des années 199088 révèle la reconnaissance de la communication en politique en tant
que domaine d'activité autonome par rapport à d'autres filières de la communication, comme
le journalisme, porteur de connaissances et de caractéristiques particulières, capables
d'atteindre une demande sociale latente. Or, ces observations correspondent aux critères
généraux de constitution de toutes les professions. Ainsi, en comprenant la
professionnalisation comme le produit de rapports sociaux et de jeux d'acteurs (Demazière,
2012), notre étude nous amène à considérer que même s'il est prématuré de parler d'une
« profession » de communicant politique proprement dite pour l'instant, nos résultats
suggèrent un mouvement vers une professionnalisation comprise comme « un processus qui
apparaît par définition inachevé et qui engage des temporalités complexes »89.
Au lieu de proposer une approche médiacentrique des transformations du champ de
la communication politique, nous avons cherché à saisir ces glissements à partir d'une
perspective dialectique par rapport aux évolutions du système social lui-même, mettant en
relation l'apparition de ces nouveaux dispositifs techniques et médiatiques et les forces
créatrices des innovations sociales au sens large (Mattelart, 2001). Nous avons donc mis en
avant la façon dont les transformations structurelles de l'instance politique accompagnent les
88 Selon P. Riutort (2007, pp, 80), « l’objet 'communication politique' finit par accéder au rangd’enseignement 'classique' d’un cursus de science politique au milieu des années 1990, occupant même letroisième rang des cours, en ne cédant la place qu’aux objets 'canoniques' tels que les partis politiques etl’État ». Pour voir l’article complet : RIUTORT Philippe, « Sociologiser la communication politique? Àpropos de quelques tendances de la science politique française », Politique et Sociétés, vol. 26, n° 1, 2007,p. 77-95.
89 DEMAZIÈRE Didier, ROQUET Pascal, WITTORSKI Richard, La professionnalisation mise en objet, Éditions L'Harmattan, 2012. pp. 7.
101
mutations du corps social, les modernisations des pratiques communicationnelles en
politique faisant partie d'un processus plus profond de spécialisation du travail politique
destiné à rendre compte d'une société de plus en plus complexe. En ce sens, la place de
premier plan prise par l'information dans nos sociétés est à la base des transformations des
structures politiques de ces dernières décennies, comme nous pouvons le constater par la
création et l'intégration dans les organigrammes des secteurs et des professionnels
compétents en matière de communication (Miège, 2010). Ainsi, la demande croissante de
méthodes de plus en plus sophistiquées et de professionnels plus qualifiés peut être
comprise dans la relation systémique d'influence entre les différents modèles médiatiques et
la complexification des rapports sociaux, dont la socialisation politique et la conquête de
l'attention du public dans ce que la doxa contemporaine appelle actualité médiatique devient
le grand enjeu.
Pippa Norris (2000) qualifie l'étape actuelle de « communication politique post-
moderne », caractérisée par la fragmentation des audiences, où la multitude des canaux de
diffusion des informations politiques conduit à une sorte d’homogénéisation des messages
politiques qui serait la conséquence de la professionnalisation. Néanmoins, même si une
compréhension plus neutre et plus objective de la communication politique tend à s'imposer
dans l'instance du pouvoir, l'appel aux « professionnels de com' » reste encore un objet de
méfiance pour d'autres acteurs de l'espace social, surtout les journalistes, qui ne veulent pas
être « manipulés » par les représentants politiques. Ainsi, malgré le progrès de ces dernières
décennies, l'image sociale de ces acteurs « illégitimes » du jeu politique reste controversée
et ambiguë, la conquête de la légitimité professionnelle des communicants politiques étant
en quelque sorte subjuguée par les luttes symboliques entre champ politique et champ
journalistique. P. Riutort (2007) explique que cette professionnalisation est comprise au sens
restreint d'automatisation, qui serait à l'origine de la crise de la citoyenneté, conduisant à
l'abstention, la montée des votes extrêmes, la faible audience des émissions politiques.
Ainsi, cette « professionnalisation excessive » de la communication politique serait la cause
même d'une déconsidération générale de l'activité politique. Le sociologue soutient que, loin
de régler les problèmes de communication entre le peuple et les décideurs, la
communication politique met en scène d'autres questionnements concernant la vie politique
actuelle en exposant ses faiblesses et les raisons qui seraient à la base d'une « crise de
représentation », ainsi que les tensions qui habitent le couple média-démocratie. En
comprenant la professionnalisation comme une évolution tendancielle et structurelle de
l'activité politique moderne, il semble cohérent de penser la problématique qui entoure la
102
communication politique dans un contexte de restructuration de l'instance politique face aux
nouveaux contours de l'espace public vis-à-vis de l'émergence des « espaces publics
partiels », comme le propose B. Miège. Ainsi, la combinaison de la modernisation de la
société, l'indécision des électeurs, la logique marchande des médias et l'importance central
des nouvelles technologies de l'information et de la communication se présente comme le
grand défi aux représentants politiques, poussés constamment à adapter leur discours pour
s'adresser aux publics (Holtz-Bacha, 2016). Face à cette réalité, en lieu de décrier les « arts
noirs de spin doctors », la professionnalisation de la communication politique peut être
considérée comme une extension du processus démocratique si les techniques mises en
place dans ce domaine permettent de toucher avec plus de pertinence les préoccupations des
citoyens (Norris, 2000).
C'est dans ce scénario complexe et extrêmement défiant pour l'activité politique
contemporaine que s'inscrit notre projet de thèse. La professionnalisation de la
communication politique présente une perspective fructueuse pour les études sur les jeux et
enjeux de la vie politique contemporaine, au cœur des réflexions, à l'intersection de la
science politique et des sciences de l'information et de la communication. Ayant une place
stratégique dans le champ politique à travers sa mission déterminante de promouvoir
d'autres modalités de dialoguer avec les citoyens en profitant des potentialités offertes par
les différentes étapes des systèmes de la communication et de l'information, la sophistication
des pratiques communicationnelles fait aussi l'objet de critiques dans les débats
contemporains sur l'avenir démocratique.
Pour cela, dans cette recherche, nous allons nous intéresser à une approche
comparatiste France-Brésil, en associant la problématique de la professionnalisation de la
communication politique à la question de la défiance envers la classe politique. Nous allons
nous interroger sur les défis de la démocratie face à la crise de la représentation politique
actuelle, en prenant en compte les impératifs qui régissent la constitution et le maintien du
pouvoir politique et la compatibilité d'une professionnalisation de la communication
politique avec les canons démocratiques : Quels sont les raisons qui expliquent cette réalité
des systèmes démocratiques ? C'est un problème inhérent à la démocratie, car les mêmes
interrogations travaillent une démocratie « jeune » et une démocratie plus « veille », malgré
les différences frappantes entre les deux pays. Dans quelle mesure une professionnalisation
de la communication politique et la conséquente sophistication des routines stratégiques
mises en place à l'égard des journalistes et de l'électorat peut être conciliable avec les
103
exigences démocratiques ? Comment envisager cette professionnalisation controversée ?
D'un côté, il faut professionnaliser la communication parce que le contexte social et
l'environnement informationnel exigent une innovation en ce sens ; de l'autre, cela renforce
le sentiment de désenchantement des citoyens, de plus en plus méfiants et apathiques à
l'égard de la chose publique. Robert Dahl (2000) utilise l'expression « paradoxe
démocratique » pour décrire ce phénomène, où les citoyens, très attachés aux canons
démocratiques, sont aussi largement désenchantés des institutions qui devraient les incarner.
C'est pour cela que de nombreuses études, ces dernières décennies, montrent que dans le
monde entier, les démocraties, jeunes ou anciennes, subissent le même problème : le
sentiment d'un manque de représentation chez les citoyens90.
Ainsi, notre proposition consiste à mettre l'accent sur le rôle de la communication
politique dans les deux pays et les conséquences possibles d'une professionnalisation en
termes démocratiques. Nous nous attacherons à identifier les particularités qui régissent
l'institutionnalisation de la Communication Politique en France et au Brésil puis les effets
possibles des différences (origines socio-culturelle des professionnels, appellation,
formation, fonctions, pratiques, motivations, représentations de leur rôle et leur domaine).
De même, nous considérerons les paramètres sociaux, juridiques et culturels de chaque pays
pouvant engendrer des modes de professionnalisation également différents. Pour en rendre
compte, nous allons nous focaliser sur quatre dimensions majeures : i) comparer le
processus de consolidation du domaine de la Communication Politique en France et au
Brésil en tenant compte des rapports de force entre l’instance médiatique et le pouvoir
politique de chaque pays ; ii) esquisser les profils des communicants qui travaillent auprès
des leaders politiques au niveau fédéral ; iii) évaluer dans quelle mesure le processus
d'innovation permanente de la communication politique vis-à-vis des transformations de
l'espace social et du paysage médiatique peut conduire à un processus de
professionnalisation, en introduisant d'autres critères d'excellence et d'expertise ; iv)
comprendre les enjeux d'une telle professionnalisation, si elle est effective, du point de vue
démocratique, prenant en compte la méfiance envers la spécialisation de l'instance politique
et la fragilité du discours politique dans un contexte d'hystérie des flux d'information.
90 L.F. Miguel (2008) évoque trois raisons pour expliquer ce phénomène : i) l'hypothèse du cynisme dupeuple, selon laquelle l'élite politique est aussi compétente que celle du passé, mais les citoyenscontemporains incapables ne le reconnaissent pas ; ii) l'hypothèse de la fin des illusions, l'élite politiqueétant si mauvaise qu'avant, mais désormais les citoyens s’en sont rendus compte et iii) l'hypothèse de laperception populaire correcte en continu, selon laquelle la qualité moyenne de la classe politique a baisséet, dans le passé ainsi que maintenant, les citoyens sont capables de l'évaluer correctement. Source :MIGUEL Luis Felipe, « A mídia e o declínio da confiança na política », Sociologia, Porto Alegre, Ano 10,nº 19, jan-jun 2008, pp. 250-273.
104
REFERENCES
ABELES Marc. « De la communication en négatif : l'échec politique ». Le Temps des
médias, 2006/2 n° 7, p. 151-160. DOI : 10.3917/tdm.007.0151.
ALDRIN Ph., HUBE N.. « La politique n’est plus ce qu’elle était, la communication non
plus. Pour un changement de perspective sur le travail de légitimation politique ». In
ALDRIN Ph., HUBE N.,OLLIVIER-YANIVC., UTARD J.-M. (dir.), Les mondes de la
communication publique. Légitimation et fabrique symbolique de l’action publique,
Rennes, Presses universitaires de Rennes,Coll. «Res Publica », 2013.
BEAUD Paul. La Société de Connivence : média, médiations et classes sociales. Aubier,
1984.
BOURDIEU Pierre. « La représentation politique [Éléments pour une théorie du champ
politique] ». In: Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 36-37, février/mars 1981.
La représentation politique-1. pp. 3-24. doi : 10.3406/arss.1981.2105
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/arss_0335-
5322_1981_num_36_1_2105
________________. « Espace social et genèse des « classes »». In: Actes de la recherche en
sciences sociales. Vol. 52-53, juin 1984. Le travail politique. pp. 3-14. doi :
10.3406/arss.1984.3327
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/arss_0335-
5322_1984_num_52_1_3327
_______________. Sur la télévision. Liber éd, 1996.
BOUSSARD Valérie, DUBAR Claude, TRIPIER Pierre. Sociologie des professions.
Armand Colin, 2011.
105
BRAUD Philippe. Sociologie Politique. 9e édition, Librairie Générale du Droit et de
Jurisprudence, lextenso éditions, 2008.
CARDON Dominique. La démocratie Internet. Promesses et limites. Éditions du Seuil,
coll. « La république des idées », 2010.
CHAMPAGNE Patrick. « Le sondage et la décision politique ». Revue Projet, 2001/4 n°
268, p. 65-73. DOI : 10.3917/pro.268.0065
CHARAUDEAU Patrick, « A quoi sert d’analyse le discours politique ? », in Análisis del
discurso político, IULA-UPF, Barcelone, 2002, consulté le 3 janvier 2015 sur le site de
Patrick Charaudeau - Livres, articles, publications.
____________________. Le discours politique : les masques du pouvoir. Paris, Vuibert,
2005.
____________________. « Discours journalistique et positionnements énonciatifs.
Frontières et dérives ». Semen [En ligne], 22 | 2006, mis en ligne le 01 mai 2007.
CHARON Jean-Marie. « Les spin doctors au centre du pouvoir ». Revue internationale et
stratégique, 2004/4 N°56, p. 99-108. DOI : 10.3917/ris.056.0099.
CORROYER Grégory. « Lecture critique de l'ouvrage de Patrick Charaudeau. Le Discours
politique. Les masques du pouvoir », Langage et société, 2008/4 n° 126, p. 95-106. DOI :
10.3917/ls.126.0095.
DAHL Robert A.. « A Democratic Paradox ? ». Political Science Quarterly, Vol. 115, No. 1.
(Spring, 2000), pp. 35-40.
DAKHLIA Jamil. « People et politique : un mariage contre nature ? Critères et enjeux de la
peopolisation ». Questions de communication [En ligne], 12 | 2007, mis en ligne le 11 avril
106
2012, consulté le 10 octobre 2012. URL : http:// questionsdecommunication.revues.org/2417
DARRAS Éric. « Le pouvoir «médiacratique» ? Les logiques du recrutement des invités
politiques à la télévision ». In: Politix. Vol. 8, N°30. Deuxième trimestre 1995. pp. 183-198.
DARRAS Éric. « Permanences et mutations des émissions politiques en France ».
Recherches en Communication, nº 24, 2005, pp. 109-128.
DELPORTE Christian. « Image, politique et communication sous la Cinquième République
». Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 2001/4 no 72, p. 109-123. DOI :
10.3917/ving.072.0109.
DELPORTE Christian, VEYRAT-MASSON Isabelle. « Campagnes politiques, tribunes
médiatiques ». Le Temps des médias, 2006/2 n° 7, p. 5-9. DOI : 10.3917/tdm.007.0005.
DEMAZIÈRE Didier, « L’ancien, l’établi, l’émergent et le nouveau : quelle dynamique des
activités professionnelles ? », Formation emploi [En ligne], 101 | janvier-mars 2008, mis en
ligne le 31 mars 2010, consulté le 11 octobre 2012. URL :
http://formationemploi.revues.org/1008
DEMAZIÈRE Didier, ROQUET Pascal, WITTORSKI Richard, La professionnalisation
mise en objet, Éditions L'Harmattan, 2012.
DEMAZIÈRE Dedier, LE LIDEC Patrick. Les mondes du travail politique : les élus et
leurs entourages. Presses Universitaires de Rennes, 2014.
DUBAR Claude, TRIPIER Pierre, BOUSSARD Valérie. Sociologie des professions.
Armand Colin, 2011.
EYRIES Alexandre. La communication politique ou le mentir vrai?. Éditions
L'Harmattan, 2013.
107
FRANÇOIS Bastien, NEVEU Érik. Espaces publiques mosaiques : Acteurs, arènes et
rhétoriques des débats publics contemporains. Presses Universitaires de Rennes,
Collection Res Publica, 1999.
FRASER Nancy. « Repenser la sphère publique : une contribution à la critique de la
démocratie telle qu’elle existe réellement ». Extrait de Habermas and the public sphere,
1992, Hermès nº 31, 2001, pp 125-156.
GEORGAKAKIS Didier. « La double figure des conseils en communication politique : mise
en scène des communicateurs et transformations du champ politique ». Sociétés
Contemporaines, nº 24, 1995, pp. 77-94.
GERSTLÉ Jacques. La communication politique. Armand Colin, Paris, 2008.
GOURÉVITCH Jean-Paul. L'image en politique, De Luther à Internet et de l'affiche au
clip. Paris, Hachette Littérature, 1998.
GRANJON Fabien. « Les sociologies de la fracture numérique. Jalons critiques pour une
revue de la littérature ». Questions de communication [En ligne], 6 | 2004, mis en ligne le 15
mai 2012, consulté le 02 mai 2015. URL :
http://questionsdecommunication.revues.org/4390.
HOLTZ-BACHA, C. « Professionalization ». In G. Mazzoleni (Ed.) The International
Encyclopedia of Political Communication, 2016, Oxford: Wiley Blackwell.
KACIAF Nicolas. « Communication politique et distanciation journalistique » Les
transformations contemporaines des pages Politique de la presse écrite française.
Savoir/Agir, 2014/2 n° 28, p. 13-18. DOI : 10.3917/sava.028.0013
LE HAY Viviane, VEDEL Thierry, CHANVRIL Flora, 2011. « Usages des médias et
politique: une écologie des pratiques informationnelles ». Réseaux, nº 170, pp. 45-73.
108
LEGAVRE Jean-Baptiste. « L'horizon local de la communication politique. Retour sur la
diffusion d'une expertise ». In: Politix. Vol. 7, N°28. Quatrième trimestre 1994. pp. 76-99.
doi : 10.3406/polix.1994.1884. URL :
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polix_0295-
2319_1994_num_7_28_1884.
_______________________. « La quête des origines », Questions de communication [En
ligne], 7 | 2005, mis en ligne le 23 mai 2012, consulté le 13 septembre 2013. URL :
http://questionsdecommunication.revues.org/5669.
MACE Eric. « Les faits divers de « violence urbaine » : effets d’agenda et de cadrage
journalistique ». Les Cahiers du Journalisme, nº14, Printemps-Été 2005, pp. 188-201.
MACE, 2005.
MAIGRET Éric, MACÉ Éric. Penser les médiacultures : Nouvelles pratiques et
nouvelles approches de la représentation du monde, Armand Colin, 2005.
MAIGRET Éric. Sociologie de la communication et des médias. 2e édition, Armand Colin,
Paris, 2013.
MAINGUENEAU Dominique. « Le tour ethnolinguistique de l'analyse du discours ». In:
Langages, 26e année, n°105, 1992. pp. 114-125. doi : 10.3406/lgge.1992.1628
MATTELART Armand. Histoire de la société de l'information. Paris : La Découverte,
2001
MERCIER Arnaud. « La communication politique en France : un champ de recherche qui
doit encore s'imposer ». L'Année sociologique, 2001/2 (Vol. 51), pp. 355-363.
MERCKLE Pierre. Sociologie des réseaux sociaux. Collection Repères, La Découverte,
109
2011.
MIEGE Bernard. L’Espace Public Contemporain – Approche info-communicationnelle.
Grenoble : PUG, Collection Communication Médias et Sociétés. 2010.
MIGUEL Luis Felipe. « A mídia e o declínio da confiança na política ». Sociologia, Porto
Alegre, Ano 10, nº 19, jan-jun 2008, pp. 250-273.
NEVEU Érik. « La communication politique : petit refus de contribution au dictionnaire des
idées reçues ». Cinémaction n° 63, 1992, pp. 161-167.
___________. «La communication politique : Un chantier fort de la recherche française».
Polis, vol. 5, 1998, disponible sur
http://www.polis.sciencespobordeaux.fr/vol5n1/article3.html
NORRIS Pippa. The Virtuous Circle : Political Communication in Post-Industrial
Societies. N.Y., Cambridge University Press, 2000.
PEDLER Emmanuel. Sociologie de la Communication. Armand Colin, 2005.
PLASSER Fritz. « American Campaign techniques worldwide ». In. : Harvard
International Journal of Press Politics 5 (4), 2000, pp. 33-54.
QUERE Louis. « Les « dispositifs de confiance » dans l'espace public ». Réseaux, 2005/4 no
132, p. 185-217. DOI : 10.3917/res.132.0185.
REBILLARD Franck. Le web 2.0 en perspective : une analyse sócio-économique de
l'internet. L'Harmattan, 2007.
RIUTORT Philippe. Sociologie de la communication politique. Collection Repères, La
Découverte, 2007.
110
________________. « Sociologiser la communication politique? À propos de quelques
tendances de la science politique française ». Politique et Sociétés, vol. 26, n° 1, 2007, p.
77-95.
RUELLAN Denis. « La routine de l'angle ». Questions de Communication, 2006, 10, pp.
360-390.
TERRAL Julien. L’insécurité au journal télévisé, la campagne présidentielle de 2002.
Paris, L’Harmattan, 2004.
THOMPSON John B. A mídia e a modernidade : uma teoria social da mídia, Petrópolis,
RJ : Vozes, 2012.
TRAQUINA, Nelson. Teorias do Jornalismo. A tribo jornalística – uma comunidade
interpretativa transnacional. Florianópolis: Insular, 2008.
TRAQUINA Nelson. Teorias do Jornalismo. Porque as notícias são como são.
Florianópolis: Insular, 2005.
WOLTON Dominique. Éloge du grand public : une théorie critique de la télévision.Paris, Flammarion, 1990.
__________________. « Les contradictions de l'espace public médiatisé », Hermès, La
Revue, 1992/1 n° 10, p. 95-114.
ZÉMOR Pierre, Le défi de gouverner : communication comprise : mieux comprendre
les citoyens ?, L'Harmattan, 2007.
Chapitres de livres
ARENDT Hannah. Domaine public : le commun, pp. 99-106. In L'Humaine Condition,
Quarto Gallimard, Paris, 2012.
111
Entretien 1 : Philippe Moreau-Chevrolet
Routine/tâches en tant que communicant
- « donner à une personne le moyen de ses ambitions par ce qui concerne la communication »- « on va lui fournir les outils et conseils qui vont le permettre de pouvoir prétendre d'une façon crédible etréaliste exercer ses responsabilités ou être élu à son poste »- « on va l'aider, en fait, on va luir faire la courte échelle, pour accéder à ses ambitions »- « on fait du media-training, ce qui consiste à apprendre aux gens à parler. En fait tout ce qui n'est pas naturelchez l'être humain, peut s'apprendre. Et ce qui n'est pas naturel chez l'être humain ce de parler devant decentaines de personnes ou de cent million de personnes. (…) c'est juste qu'on n'est pas programmé pour ça »- «la peur numéro 1 des gens, devant la peur de mourir, c'est la peur de parler en public, parce que c'est unstress monumental. Il faut tenir le fait qu'il y a des être humains devant vous, vous ne connaissez pas leursintentions, vous ne savez qui c'est »- « on est là pour rassurer les gens en fait, pour leur apprendre à être à l'aise »- «notre deuxième travail consiste à synthétiser le message qu'il veut faire passer. Ils ont un message, on ne vapas l'inventer, on ne va pas non plus inventer les décisions qu'ils prennent. »- « On peut les aider à deux niveaux, on va les donner des conséquences de ce qu'ils veulent faire. (…) 'si vousdites ça, si vous faites ça, il faut qui vous sachiez qu'il aura telle conséquences', mais la décision nem'appartient. Une deuxième chose qu'on fait c'est 'vous, vous voulez dire ça, vous avez telle décision à faire,comment est-ce que vous l'annonceriez, c'est quoi vos élements spontainés ? Et nous, on pense qu'il vautmieux dire plutôt de cette façon là parce que cela n'a pas des avantages positifs'»- « (…) c'est du empowerment ce qu'on fait. C'est ça que m'intéresse, rendre des gens plus fortes de ce qu'ellesétaient avant »- « on prendre de gens très fortes, comme des gens d'entreprise et des gens de la politique. Ce sont de gens quià la base sont redoutablement fort mais on va les rendre encore plus fort, en les humanisant un peu...souvent »
Importance de la communication pour le politique
- « Le métier du politique à 80 % c'est un métier qui consiste à communiquer avec les autres : communiquerpour vous faire élire, communiquer pour expliquer votre action, communiquer pour entrainer de gens avecvous, pour qu'ils votent pour votre texte, pour qu'ils suivent votre action, pour qu'ils vous aident .Communiquer avec des gens en permanence pour les amener en fait dans le sens où vous vous qu'ils allaient »- «le problème est que la plupart des candidats pensent que c'est fait le truc, une fois qu'ils sont élus pour eux[électeurs] le boulot est fait. Je pense qu'ils ont une compréhension un peu miraculeuse de la communication.Ils pensent qu'ils sont professionnels, et la c'est un vraie erreur parce que c'est faux. Il y a de gens très bien quine vont pas être rélus parce qu'ils ne font pas attention à ça, ils deviennent très impopulaire, ils vont justeparler pour faire passer leur mesures parce que les gens ne leur suivent pas, parce qu'ils communiquent mal,parce qu'ils ne savent pas parler aux gens »- « 'si vous ne contrôlez pas l'agenda des médias, ils vont saccager votre présidence' [citation d'un présidentaméricain?]. Donc, ça veut dire que le premier outil c'est l'agenda médiatique » - «typiquement, une conférence de presse de Hollande n'est pas suffisante pour créer de l'intérêt. Donc on va yajouter le voyage à Kiev, parce qu'on sait que les journalistes vont en parler. (…) c'est une manière de contrôlerson image. Le deuxième chose c'est de servir les médias d'informations, de nouveautés, ce qui a très bien faitl'équipe de Sarkozy, ce qui ne fait pas du tout l'équipe Hollande »- « la vraie solution consiste à travailler des thèmes, avant d'arriver au pouvoir. Trois, quatre, cinq ans ...avecdes experts, d'imposer leur opinion au centre du débat, comme l'a fait Sarkozy en 2007 »
Rapport médias et politique en France
- « en fait ils apprennent à communiquer entre eux, entre élite, mais il y a un moment où le peuple est dehors »- « plutôt une relation de cumplicité, je dirais. Ce n'est pas la notion anglo-saxonne d'affrontement. Rarement,
113
parfois, mais généralement c'est plutôt une relation de symbiose »- « en France ça commence à changer, il y a de jeunes journalistes qui font ça aussi (comme aux États-Unis) »- « il est obligé pour se faire connaître de passer par les médias, chaîne d'info, télé et journaux »- « l'entrée de la télévision pendant les années 1950, 1960 a complétement changé les règles du jeu. (…) Ça estdevenu un média dominant, ça a facilité parce que c'est 'gratuit' »
Mission accomplie- « quand on arrive à prendre un client, à faire un xxx qu'il soit bon dans ses interviews, bon dans ses relationspubliques, convaincant, il devient un leader, les gens le suivent, ils ont empathie pour lui, il arrive à passer sonmessage, les gens comprennent sa démarche, ils lui soutiennent, l'élisent »
Défis politique actuelle
« il faut travailler sur les candidats pour qu'ils soient vraiment convaincus que communiquer avec les gens ,vraiment les gens dans la rue, c'est important »- « c'est compliqué de convaincre les politiques qu'ils ont besoin de professionnaliser leur approche pour éviterde se retrouver dans de situations où ils sont bloqués, puis de les professionnaliser de manière intelligente. Pasfaire confiance aux services d'une grosse agence, par exemple »- « il faut que les politiques comprennent qu'il faut regarder les sondages, les enquêtes d'opinion, qu'il fautregarder comment les gens vivent en détails, pas juste une vague idée de comment vivent les Français. »- « la réalité du pays en ce moment, quand tu prends la peine de lire des études, elle est très claire, oncomprend pourquoi le pays vote Front National »- « avec l'internet, les politiques sont obligés de descendre de plus en plus dans l'arène. Certains refusent de lefaire, comme François Hollande. Il appartient à la vieille école, mais la plupart des gens en politiquecommencent à utiliser ce réseau là et ils savent l'utiliser »- « en France, on a un rapport à la démocratie qui est particulier, un considère la démocratie c'est une élite.C'est pour ça qu'on a des écoles, pour formes des élites. C'est un cercle complétement fermé »- « pour entrer dans ce cercle fermé il faut être très dur, très fort, très déterminé et très intelligent. C'est unsystème verrouillé, quasi monarchique »- « il est plus démocratique [le paysage informationnel], mais les politiques ne sont pas adaptés (…) alorsqu'ils sont peut-être très bien »- « il faut arriver à un thème d'intérêt national et représenter ce thème, puis que là vous avez ce que Gramsciappelé la conquête culturelle »
Professionnalisation de la politique / de la communication politique
« il n'y a rien d'évident de faire passer un message à de centaines, de millions de personnes. Il n'y a riend'évident là-dedans. C'est un métier en fait. C'est notre métier »- « pour le politique on le fait, mais ce n'est pas notre activité principale »- « c'est normal que la communication se profissionnalise parce que la politique se professionnalise. Ça devientde plus en plus difficile de communiquer avec des gens parce qu'il y a de plus en plus de canaux pour le faire ,ça va de plus en plus vite et les risques de dérapage sont beaucoup plus nombreux qu'avant. Et les gens sontbeaucoup plus méfiants à juste titre. Donc il faut être vraiment et particulièrement clair dans ce qu'on dit pourêtre compris. Ça c'est un métier. »- « si vous faites mal [la communication], vous n'existez plus. On n'est pas efficace. Et ça se professionnalisenaturellement parce que la période est difficile »- « les politiques ne sont pas assez professionnels en fait, c'est ça le vrai problème pour moi »- « le travail de journaliste c'est un travail qui consiste à sentir la société, en générale. On a un accord avec lasociété donc...ce n'est pas vraiment différent pour ça. La curiosité, l'adaptation, le sens de ce qui se passe c'estle même »- « avant j'écrivais pour les journaux, j'ai travaillé aussi pour la télévision avec une hiérarchie. Là je travaillepour un client, des clients, dans une entreprise qui est la mienne. Ce n'est pas la même chose. Mais au fond, ladémarche intériure n'est pas complétement différente » - « c'est une évolution du système, mais il y a de gens qui ne vont pas évoluer avec »- « je pense qu'aujourd'hui les hommes et les femmes politiques vont faire appel à des spécialistes encommunication (…) Il y a d'autre côté des militants qui sont tellement engagés dans le combat politique quivont chercher à se spécialiser dans ce côté là » « on va davantage vers une professionnalisation, parmi les jeunes militants, je dirais qu'il y a même beaucoupqui disposent d'une formation en communication ou qui disposent des outils qui sont aujourd'hui davantage
114
importants pour professionnaliser cette communication »
Qu'est-ce que ça veut dire « communication politique ? »
- « nous en tant que communicants, nos rôle consiste à leur dire 'il y a le peuple qui est là', si vous prenez pasen compte le peuple tout le temps ça risque de ne pas bien se passer »- « il y a un message, il y a une multitude de canaux, il y a une stratégie. C'est l'ensemble des canaux qui vaproduire du sens »- « la façon dont les gens parlent de vous (politique) constitue une partie de la communication »- « dans la communication politique et communication gouvernamental on a les électeurs, il faut lesconvaincre de voter pour vous, de vous soutenir aux sondages, de les faire confirmer leur choix [voter] »- « la communication politique, sa spécificité, c'est de parler aux électeurs, pour leur demander de fairequelque chose, pour vous, quelque chose de gratuit...de vous soutenir en fait, moralement. (…) il fautvraiment que les gens vous soutiennent, qu'ils soient pour vous »- « c'est de la communication la plus dure, surtout parce qu'ici en France, on n'a pas du tout d'argent. Cela nousempêche de faire de la publicité. La France est un pays très archaique, très fermé. Dans le contexte actuel,François Mitterrand, qui a été élu en 1981 avec plusieurs campagnes d'affichage, ne soit peut-etre pas élu,parce qu'il n'arriverait pas à se faire connaître »
115
Entretien 2 : Ludivine Moles
Routine/tâches en tant que communicant
« je ne m'occupe pas de la presse, je ne fais que de la communication interne, à la destination des députés, àleur proposer une formation, média-training et des choses comme ça. Aussi tout ce qui est mise en avant deleurs acativités parlamentaires, comme le journal du mi-mandat (…) pour faire un bilan de leurs activités »- « aussi tout ce qui concerne aussi le digital, la communication digitale, donc Twitter, Facebook. On a aussi unechaîne sur Youtube, où je mets beaucoup de choses dessus »- « le mardi et mercredi étant les jours où les députés sont là, donc je fais twitter, je vais faire un live twitter enfait des questions. Je mets toutes les interventions des députés en ligne »- « je finis … le président Christian Jacob, le mardi, à la conference de presse et ensuite la réunion du groupe »- « après, ça va être de choses plus ponctuelles. Des fiches d'actualité, (…) quand il y a une intervention média,il faut préparer un peu le sujet sur lesquels on peut potentiellement tomber. Aider le maximum la personne quiprendra la parole après »- « j'ai beaucoup travaillé avec la presse, ça fait partie de son métier, d'être toujours en intéraction avec lesjournalistes »- « ma motivation [pour choisir ce métier] a été double. Moi je suis née dans une famille de communicants. (…)et la communication, ça permet de toucher à beaucoup de choses, toucher à la forme et au fond. Ça touche auxidées, mais va égalémment toucher au fait de les diffuser »- « [élections mairie de Paris 2014] l'équipe était structurée dans le bordel, on n'était que de bénévoles. (…) onétait cinq à plus au moins au long terme (…), on n'avait pas d'attribution fixe, (…) il y avait deux personnesdessus [Anne Dorsemaine et Aurore xxx], parce qu'elle connaissait NKM depuis longtemps et par expérienceaussi, parce qu'elle était plus âgée. (…) NKM avait toujours un communicant qui l'accompagnait. (…) Il y avaitdes réunions, où les personnes les plus proches d'elle assistaient sur la stratégie. (…) Surtout le pôlecommunication était séparé du pôle web, et ça je ne sais pas si c'est une bonne idée. (…) La communicationparfois on avait du mal à se faire. (…) Je dirais qu'il y avait la plupart avec de formations en politique et unepersonne en communication »
Importance de la communication pour le politique
- « je pense que c'est surtout sur l'image. Je ne suis pas sûre qu'au niveau d'impact du vote y en a en réel, maisen tout cas je pense que l'image en politique c'est très important »- « en étant dans ce milieu, on se rend compte que tous les hommes et femmes politiques ont des communicants.Maintenant c''est complètement généralisé. Et justement ceux qui n'en ont pas, je pense que ça se voit tout desuite »- « (…) ça peut être au niveau des mots, donc des mots à ne pas dire, parce que des mots qui vont faire lapolémique. Ça peut être au niveau d'attitude, au niveau des réactions qui ne sont pas assez 'réflechies', qui n'ontpas assez de recul et qui vont répondre spontainé comme n'importe qui pourrait le faire »- « la communication sert un peu à aborder l'homme politique. Je pense qu'avant c'était moins important, mais jepense que ça a plus ou moins existait. François Mitterrand aussi avait des communicants politique, (…) et avecl'apparition des mass media vraiment je trouve que c'est très important »
Rapport médias et politique en France
- « c'est une relation très complexe parce que c'est une relation de 'je t'aime moi non plus', c'est-à-dire qu'ils ontconstamment besoin de nous et nous avons constamment besoin d'eux, et donc la limite est parfois difficile àtrouver » - « il y a aussi le 'off', et donc l'essai de les alimenter tout le temps en servant nous »- « c'est une relation compliqué parce que déjà les journalistes sont politiques, sont très souvent politisés, (…)c'est quand même un tout petit milieu, donc on se connait beaucoup. J'ai beaucoup d'amis qui sont journalisteset qui sont journalistes politiques, et du coup, suivent la droit »- « (…) trouver le juste milieu entre le 'tu as besoin de moi, je te donne l'info que t'il faut, mais moi j'ai besoinde toi là dessus, tu ne vas pas chercher trop loin'. (…) Le journaliste est très curieux, donc il a toujours envie dechercher plus loin, mais nous on n'a pas envie qu'il va chercher plus loin »- « j'ai l'impression que les journalistes pensent qu'on a plus besoin de lui qu'il a besoin de nous »- « pour moi, la spécificité en France c'est à quel point les médias sont importants pour la politique. Ça veutdire, vraiment, les médias et la politique sont un couple, mais vraiment, indissociable. Aujourd'hui les hommespolitiques vont envoyer leurs textos aux journalistes pour faire leur propre off, et les journalistes sont à la
116
recherche de la moindre petite phrase »- « aujourd'hui c'est moins les idées qui priment que les petites phrases qui comptent. Parce que c'est aussi lesnouveaux modes de consommation, de l'internet, la télé, les chaînes d'info en continu qui font ça »- « je trouve que certains médias jouent aussi le jeu du Front National, c'est tout à fait normal de parler d'eux,mais justement sur certaines choses je trouve qu'ils vont un peu trop loin et on repproche beaucoup un partitraditionnel, de la gauche et la droite, dans une élection, de dire 'ils n'ont pas joué le jeu, donc ça a alimenté lesvoeux du Front National' »- « les médias jouent beaucoup là dessus et alimentent ainsi ce qui est un peu la haine, l'aversion des gens versla politique. Les gens ont aujourd'hui un réel dégoût par la politique, pour des raisons qui se comprennent tout àfait, et ils ont besoin d'une autre voie. Ils pensent, malheuresement, certains pensent que le droit c'est le FrontNational, et je pense que les médias rentrent un peu dans ce jeu-là. De verbaliser, de dire que finalement, PS,UMP, ils ont tous été élus et ils n'ont rien fait changer, et que du coup une autre voie est doit être possible »- « les gens qui n'ont pas accès à tous les journaux vont regarder les chaînes d'information en continu, ce sontdes sujets qui sont très courts, donc on a besoin de condenser l'information, et je trouve que parfois le rendu del'information de la politique est erroné, sur le traitement de l'information »- « on va analyser la situation et voir si c'est outil ou pas de répondre [aux critiques des médias]. Il y a de chosesdont il n'y a rien à faire et d'autres en tout cas d'essayer de se retraiter »- « le communicant, l'homme politique, on essaie de construire un agenda par rapport aux événements qui vontse passer en politique où les médias vont être. Donc nous on va essayer de faire une construction de l'agendamédiatique, mais après eux vont s'attarder sur de petites choses »- « [sur le silence] lors des attaques à la personne, je dirais pas qu'il serait intéressant de réagir là dessus ouimportant. (…) Quand il y a une polémique, parfois le fait de s'expliquer peut alimenter la polémique »- «[sur l'histoire des 'moments de grâce' dans la ligne 13 et les dessins de carrottes des enfants de NKM] c'estencore une erreur de confondre la com' et la parole de l'homme politique, parce que n'est pas le communicantqui parle à sa place, il dit de choses de manière spontainée »- « toutes les bonnes idées, des projets, ils ne sont pas su ou peu connus. Je suis sûre que s'il y a quelque chose àdire sur NKM pendant cette campagne c'est ça qui restera »
Mission accomplie
- « c'est très compliqué à évaluer. Par exemple, lors d'une campagne électorale, là on va se rendre compterapidement des résultats. Donc si on ne parle pas trop ça veut dire que c'est bien a priori, si on parle ça veut direque ce n'est pas bien parce que ce qui anime beaucoup les gens des réseaux sociaux c'est tout ce qui estmauvais, généralement, tout ce qui fait tâche. Et donc là on dirait que du coup on a mal fait notre boulot. On sedit que pour nous initialement ça a été une bonne idée mais après ça a été mal perçue »- « la satisfaction on la voit moins parce que je trouve qu'elle plus difficile à capter. Parce que si un homme a étéélu, je ne pourrais jamais dire c'est grâce à un communicant. En revanche, s'il n'a pas été élu, je pourrais direque c'est à cause de ses erreurs de communication »- « (…) sauf quand quelqu'un va lire et dire 'mais les idées du monsieur le maire sont ça, ça, la', là je me dis qu'il[citoyen] a compris, donc le boulot a été bien fait. On a réussi quand quelqu'un comprendre ce qu'on écrit »
Défis politique actuelle
- « pour moi le seul défi, le réel défi de la politique et aussi du rôle du communicant c'est de redonner goût à lapolitique, justement. Beaucoup de gens ont perdu le goût de la politique, beacoup de gens n'en ont jamais eu,mais aujourd'hui encore moins. Il y a un désintérêt total par la politique, pour de raisons tout à fait justifiables,mais je trouve que certains hommes politiques sont plus dans le côté 'j'ai mon mandat, j'ai ma gratification et jeme contents' (…). C'est comme ça qu'on fait de la politique, en rencontrant des gens, en confrontant, en sachantce qu'elles aiment ou ce qu'elles n'aiment pas »- « ce qui me rend triste c'est de voir clairement que les gens qui n'aiment pas la politique et qu'ils pensent quela politique n'est qu'un ensemble de corrompus. Moi malheuresement je pense que les corrompus sont plusvisibles et ceux qui travaillent sont plus invisibles. Donc c'est peut-être au communicant de rendre visiblel'invisible »- « aujourd'hui je pense que le vrai défi c'est de dire nos idées. Voilà. Et de remettre les idées au bout du jeuplutôt que les petites phrases. Et je pense qu'avec le mode de consommation des médias ça va être compliqué,mais je pense qu'on va y arriver »- « on peut plus toucher les gens … ça, encore je ne suis pas sûre. Pour moi, finalement les gens qui sontvéritablement touchés ça va être des gens dans les territoires (...) et c'est encore des militants pour moi. (…) Jepense que ce qui va plus toucher les gens c'est d'aller les voir directement et pas de faire un discours sur TF1pendant une demie-heure »
117
- « le grand défi a été gagner, d'imposer NKM comme une candidate sérieuse par rapport à Anne Hidalgo. (…)Montrer que NKM connaissait Paris, qu'elle aimait Paris, qu'elle aimait ses défauts et ses qualités et qu'ellevoulait faire quelque chose parce que la politique actuelle était insufflée et elle voulait lui donner un nouveausouffle. (…) À un moment donné on a compris qu'on n'allait pas gagner, donc le but était que le score était trèsserré, et je pense que ça a été réussi. (…) Je pense que c'est plus intéressant de ne pas avoir un gros écart desvœux entre Anne Hidalgo et NKM »
Professionnalisation de la politique / de la communication politique
- « Je n'ai aucun lien de familiarité avec les hommes politiques pour qui j'ai travaillé »- « la professionnalisation de la communication va évoluer dans le sens où il faut qu'on soit bordé sur tout.Aujourd'hui on a beaucoup plus des moyens, des investigations qui vont être menées. (…) Si on prend undiscours, la personne mentionne un chiffre, dans deux minutes sur internet on va dire si ce chiffre était exact oupas »- « la rapidité de l'information sur l'internet pour moi c'est un contrôle assidu de tous ce qui est dit. Ça veut direque pour moi le rôle d'un communicant est d'encore plus border l'homme politique, ça veut dire, de tout vérifier,voire chaque mot, parce que le mot est polémique et aussi polysémique. C'est aussi de dire que dans undiscours, une phrase peut être extraite tout de suite » - « (...) ceux qui n'en ont pas, je pense que ça se voit tout de suite »- « l'idée n'est pas de rendre nos discours plus neutres, mais de vérifier tout, de faire attention à tout et surtout del'expliquer »- « on dit que tout le monde peut faire de la communication, mais en fait non. Il y a des spécificités, (…) il y ade choses à savoir dans la communication, il y a des erreurs à ne pas commettre, (…) il y a aussi à savoircomment fonctionne un journaliste, parce qu'on en a besoin, comment fonctionne la presse, comment fairediffuser une information, est-ce qu'il faut la faire diffuser, oui, non, pourquoi ?. Il y a quand même une part deréflexion dedans »
Qu'est-ce que ça veut dire « communication politique ? »
- « je pense que la communication en politique est très important parce qu'il y a aujourd'hui unereprofessionnalisation de ce métier [la politique] et que tout le monde jouit de ça. Donc ça veut dire, autant avecle développement des réseaux sociaux, d'internet, des médias en ligne, où la moindre faille ou la moindre erreurva peut-être être constatée »- « on peut tout faire l'A à Z. Ça veut dire, une idée on peut la développer auprès de l'homme politique et aprèson va voir ensemble comment la diffuser et justement par quels moyens et comment la faire comprendre »- « la communication en tout cas pour moi est surtout comment faire comprendre aux gens les idées d'unhomme politique. (…) c'est surtout de simplifier le maximum et de toucher le plus de gens. Et j'ai trouvé cepassage-là très intéressant, parce qu'on rend compte de l'interne vers l'externe »- « je ne vais pas du tout sur le terrain, néanmoins j'aime bien toucher les gens. Donc moi mon moyen detoucher les gens ce n'est pas de leur parler, c'est plus de leur donner des idées, de construire en tout cas desidées qui peuvent les toucher »- « parfois je pense que la communication politique est assez méprisée. Il faut peut-être lui donner une meilleureimage. (…) Aujourd'hui, les gens peuvent se dire 'il a été élu parce qu'il a un bon communicant', ce qui n'est pasvrai, pour moi c'est complètement faux »- « quand on fait une erreur... je pense notamment aux erreurs de la campagne municipale de 2014 à Paris, lesréseaux sociaux l'ont diffusé tout de suite »- « je pense que le problème des gens autant des communicants politiques, ceux qui font ce métier, autant desjournalistes qui vont traiter les erreurs des communicants confondre les erreurs d'un homme politique et leserreurs du communicant, ce qui pour moi n'a rien à voir, parce que le communicant ne décide pas tout »
118
Entretien 3 : Nicolas Baygert
Routine/tâches en tant que communicant
- « je suis aujourd'hui davantage dans l'enseignement, mais j'ai eu une période dans un rôle davantage deconsultant en communication auprès des institutions européennes »- « j'ai travaillé dans le passé également dans une unité de communication à la Comission Européenne, où làj'étais vraiment chargé des questions xxx ou de la communication du commissaire, donc ses interviews, sonimage, ses réponses aux journalistes »- « j'ai un peu passé par différentes phases et aujourd'hui je suis plutôt dans l'enseignement, mais il m'arriveencore de participer à de travaux, de petits conseils, on va dire, de certaine part politique, mais c'est plutôt d'unpoint de vue académique que d'un point de vue de consultant pur »- « (…) des conseils pour les hommes politiques, dans un contexte plutôt politique, j'étais dans un rapport, jedirais, presque utopique, que de regard critique par rapport aux campagnes, aux parcours, je dirais, demédiatisation des candidats ou des partis. Donc, de manière très concrète, soit des partis politiques ou soit despartis antipolitiques faisaient appel à moi simplement pour avoir une séance de brainstorming ou de réflexioncollective autour de leur campagne, pour savoir si de mon point de vue ils étaient un peu distanciés, si lesthèmes ont été mis en avant ou si les stratégies qui ont été proposées »- « de façon générale, l'intervention se faisait davantage en amont, donc avant le lancement véritablement d'unecampagne, ou elle pouvait se faire à la fin vu qu'il s'agit davantage de faire un débriefieng, ça veut dire, voir unpetit peu ce qui avait bien fonctionné ou pas. Donc là on est vraiment clairement dans une stratégie » - « Il y a aussi une dimension, je dirais, qu'on pourrais appeler l'incubation xxx, c'est-à-dire, réflechir vraimentavec les gens respectables dans le parti des idées, des sujets à mettre en avant, voilà, ce qui seraitstratégiquement bon d'insister dans une campagne »- « dans un contexte plus européen, mon travail a été auprès des institutions. Là on était davantage dans uncontexte de campagne 'grand public', donc on était moins dans la communication politique que dans lacommunication publique »- « (…) les pays qu'on voulait cibler pour telle ou telle question. Par exemple, la biodiversité. Il y a certainspays en Europe qui sont moins formés sur cette question-là. Donc il s'agissait là aussi d'éveiller l'attention descitoyens et des conservateurs sur cette question »- « Il y a toujours un travail de préparation, de stratégies à mettre en place et puis réflechir aux outils, quelleforme de communication, est-ce qu'on fait une campagne d'affichage, par la télévision, est-ce qu'on essaie derécruter ce qu'on appele des 'ambassadeurs', des personnalités qui ont certaine notoriété pour porter un message,est-ce que cela passe uniquement à travers les décideurs européens, est-ce qu'on met en place la stratégiedigitale. Donc toutes ces questions là faisaient un peu partie de mon travail. Parce qu'on réflechit vraiment à lamise en place de la stratégie » - « (…) soit je travaillais de manière seule, soit il y avait de classes politiques qui faisaient appel à moi. Oualors, je travaillais pour les agences de communication qui faisaient appel de manière très ponctuelle à messervices pour travailler à la stratégie »- « le travail d'un consultant en communication est plutôt stratégique que j'ai plus fait. (…) Il m'arrive encore detemps en temps, et je dis vraiment de façon très ponctuelle, de le faire, dans les cadres de missions trèsprécises » - « le travail du communicant c'est d'hamoniser ces deux discours [voulu et perçu], le discours du politique et lediscours sur le politique. Donc ça c'est vraiment un travail très important. C'est la façon dont les médias, lesjournalistes vont parler des actions d'un leader politique qui va influencer la façon dont elles seront comprisespar les citoyens »
Importance de la communication pour le politique
- « la communication publique vise soit à sensibiliser, soit à ce qu'ils appelent en anglais raise awareness, ce quiest d'une certaine manière attirer l'attention du grand public à une question (…) l'environnement, l'efficacitéénergétique, de questions très précises »- « dès le début de mes études universitaires, j'étais intéressé à la communication politique, donc à la façon d'unleader politique de s'adresser aux citoyens dans le contexte électoral. Ça a toujours quelque chose quim'intéressait »- « je suis passé par les études de communication, puis également en sciences politiques pour essayer de mefaçonner un parcours en communication politique »- « [démocratie] il y a un besoin – qu'on constate aussi dans les entreprises – de transparence d'une part, (…) çaest devenu un élement clé dans. (…) les consommateurs, les citoyens veulent être informés, (…) ils veulentd'une certaine manière avoir la possibilité d'avoir un feedback sur les élaborations des hommes politiques »
119
- « (…) le citoyens aujourd'hui aussi a la possibilité notamment à travers les technologies, donc les réseauxsociaux, d'accompager et de dialoguer en temps réel la prise de décision politique et les activités des acteurspolitiques »- « pour les hommes politiques, ça devient aujourd'hui essentiel d'abord de montrer qu'il est transparent et qu'ilaccepte de communiquer, qu'il accepte de dialoguer avec les citoyens »- « (…) les citoyens se posent vraiment de questions, et ne pas interagir donne l'impression qu'on va êtremanipulé ou d'être trompé »- « parfois cette volonté de communiquer de manière peut être exagérée, je parle dans le cas des institutions, oùdans le cadre de la communication publique il y a parfois une surinformation (…) qui vise seulement informersur tout et n'importe quoi, mais surtout pour éviter justement le sentiment d'opacité (…) qui pourraient ressentirles citoyens »- « dans le cadre d'une carrière d'un homme politique, c'est essentiel de communiquer pour exister. C'est-à-dire,aujourd'hui il n'y a pas du fait politique sans les recours médiatiques »- « il [l'homme politique] ne peut pas établir d'actions politiques s'il n'y a pas de visibilité et de notoriété qui estlié à cette action. (…) il faut travailler la manière dont vous en allez communiquer, quels canaux decommunication, quel média, quels mediums vous allez utiliser. Est-ce que vous avez l'accès à la télévision, est-ce que vous pouvez vous faire entendre ? Est-ce qu'il faut utiliser des canaux alternatifs, comme le font parfoisles petits partis et les petits candidats, qui passent davantage par les réseaux sociaux pour développer leuridentité et leur notoriété »
- « aujourd'hui on pense la politique autant dans le sens démocratique et pas seulement en temps des campagnesélectorales. (…) Il y a aujourd'hui presque une obligation de communiquer et de travailler cette transparencequ'aujourd'hui est-elle essentielle »
Rapport médias et politique en France
- « il y a eu de problèmes liés au couple journaliste / homme ou femme politique. Ça a toujours posé dequestions d'un point de vue démocratique. On questione sur la neutralité des journalistes lors qu'ils sont tropproches de tel ou tel leader, tel ou tel parti. Donc là il y a toujours une méfiance je dirais »- « il y a aussi une question de certains partis politiques qui estiment quand même que dans leur ensemble lesjournalistes sont dans la majorité sont plutôt à gauche, donc pour les partis plus à droite il y a aussi uneméfiance en tant que telle »- « aujourd'hui il y a un effort de mettre les limites (…) la question de la transparence, entre les différentessphères professionnelle et une sphère d'influence, comme les médias et le métier politique »- « [image politique médias x image politique instance politique] voulu versus le perçu, ce qui les partisvoulaient transmettre comme message sur leurs actions, et le perçu, comme cela a été perçu par la presse, par lesjournalistes, par les citoyens »
Mission accomplie
- « il y a des attentes qui sont très différentes selon les demandeurs. (…) Dans un contexte de campagne decommunication de sensibilisation, on voit des effets positifs à travers des études d'impact à la fin, donc voir si lemessage est passé etc., si les publics cibles déterminés en amont sont effectivement touchés par le campagne »- « (…) en termes de visibilité, (…) par les médias traditionnels ou d'autres réseaux. Là aussi il y a un travail, jedirais, post hoc, donc après la campagne qui peut être effectué »- « dans une dimension davantage politique, (…) on se sent util parce qu'au bout d'un moment on voir qu'on arésussi à structurer la réfléxion qu'un leader ou qu'un parti a par rapport à sa propre action. Donc vous êtes làplutôt comme un facilitateur voire un médiateur, en essayant de trouver dans ce que les partis politiques en ontdéjà dans leurs programmes, leurs pratiques, leurs idées des élements qui seraient peut-être intéressants demettre en avant »
Défis politique actuelle
- « combatter le sentiment d'instrumentalisation [de la communication politique], du public et des citoyens. Vousavez un certain nombre de politiques qui ne communiquent que par nécessité et presque un petit peu de manièreinstrumentale, ça veut dire, vous n'avez pas la sincérité qui ressort dans leur communication »- « il y a aussi un besoin d'adaptar la communication aux leaders politiques, à leur personnalité, donc, vous nepouvez pas communiquer de manière uniforme »- « [RSN] aujourd'hui beaucoup d'hommes politiques se sentent presque obligés d'utiliser Twitter pour
120
commenter l'actualité, en sachant que les citoyens savent très bien qu'il y a des communicants qui s'occupent deleur compte. Donc l'intérêt de ce média, de dialiague directe entre le leader politique et le citoyen finalementdevient un peu obsolet puisque il y a une équipe de communicants derrière, qui vont choisir de manièrestratégique ce qu'ils vont y publier »- « Il y a encore aujourd'hui de zones grises dans la communication politique, qui sont utilisées de manière peuréfléchies ou irréfléchis »- « (…) et peut être aussi, dans la mesure où le public devient de plus en plus critique, qu'il y a unedémocratisation je pense de la communication politique. C'est-à-dire, qui vous pouvez vous-même, comprendreet retwitter avec les mêmes outils de communication que le parti ou leader. Il y a aussi une éducation auxmédias qui est faite aussi dans le côté des citoyens. (…) ils sont aussi beaucoup par rapport au contenu qui sontvéhiculés, qui sont produits par es leaders et par les partis »- « (…) les intermédiaires partisans sont finalement considérés aujourd'hui comme essentiel. (..._ ils vonts'interesser à la personnalité des candidats, à ce qu'ils incarnent en tant que projet plutôt qu'aux idéologies. »- « aujourd'hui il y a une demande de proximité qui est beaucoup plus importante qu'avant »- « aujourd'hui les citoyens ont moins importance que les partis et les hommes politiques. (…) peut-être il y aaujourd'hui une désillusion, un désenchantement par rapport au politique. (…) Il y a une méfiance généralisée.(…) La question du leadership elle aussi doit être repensée. On voit que les leaders des partis, je dirais,davantage alternatifs qui ont aujourd'hui de plus en plus de succès partout en Europe, avec une communicationdirecte. (…) La parole politique aujourd'hui elle souffre d'un soupçon assez important »- « je crois aussi que la question de la transparence et de la proximité jouent un rôle très important. (…) Je pensequ'il y a une réfléxion très importante sur la manière dont les citoyens peuvent concevoir leur représentationpolitique, le lien du leadership, d'attirer des gens, doit être simplifié avec des intermédiares »- « (…) les partis sont en crise parce qu'ils n'arrivent plus à donner sens à auterité politique et à ouvrir de projetsde société clairs »- « le problème principal [de cette politique de plus en plus médiatisée] est l'absence du temps de réfléxion.Vous êtes obligé à réfléchir presque en temps réel et de réagir à l'actualité. Donc ces réactions là (…) ellesposent aussi de problèmes à la politique qui demanderait peut-être un peu de prise de distance, de prise dedécision à la fois »- « entre les élections et le temps de mettre en place les politiques... c'est vrai que la politique est dans unesituation d'élection permanente, ça veut dire que même 3, 4 ans avant l'élection présidentielle, les journalistes seposent déjà la question de 'qui va être le candidat', 'qui va être la personne présidentiable dans les différentscamps politiques. Il y a un phénomène d'hystérisation, je dirais, du champ politique qui amène énormément deproblèmes pour les leaders politiques qui sont au pouvoir, d'effectuer une gestion coéherente, pragmatique,rationnelle »- « (…) une transformation du temps politique qui a fortement été raccourci et accéleré. »
Professionnalisation de la politique / de la communication politique
- [rapport sphère journalistique] « (…) c'est plutôt un rapport d'expert , c'est-à-dire, les journalistes vont meconsulter davantage d'un point de vue académique, comme enseignant, comme maître de conférence. Ilsviennent plutôt chercher une expertise et un complément de l'information »- « pas réelement de liens de dimension partisane...il y a des partis pour lesquels je travaille en priorité. Il y aaussi un certain nombre de personnes parce qu'on a eu des parcours parallèles à un moment donné »- « ce qui a vraiment bouleversé la communication politique c'est l'arrivée des réseaux sociaux, c'est-à-dire, desoutils de communication numérique, qui ont aussi un effet sur les médias de masse. (..) il y a par exemple desémissions politiques qui sont commentées en temps réel. Donc je dirais que la grand révolution se situe là. »- « auparavant vous aviez de séquences, des volets, qui étaient réservés au traitement de la parole politique,aujourd'hui cette parole politique est commentée en temps réel. »- « les outils numériques supposent interaction et feedback en continu. Donc je dirais, effectivement, les deuxmédias [télévision et internet] ont eu un impact assez fondamental sur la façon dont les hommes politiques etleurs partis envisagent de faire leur communication »- « il n'y a pas de fait politique sans reprise médiatique, donc ces médias là ont une importance considérable.Mais je pense qu'aujourd'hui la télévision reste un média incontournable »- « il y a peut-être une différence dans la communication politique aujourd'hui entre les professionnels de lacommunication qui travaillent vraiment dans les partis politiques (…) et les communicants qui travaillent plutôten externe , qui ont des agences de communication, des agences de conseil, et qui peuvent souvent travaillerpour un parti ou un autre, qui peuvent également travailler aussi pour des entreprises. Donc peut-être là faire ladifférence entre les différents types de communicants qui interviennent dans la réalisation d'une campagne, letravail sur l'image d'un leader »
121
Qu'est-ce que ça veut dire « communication politique ? »
« la communication politique, on s'inspire des stratégies, des connaissances, des domaines théoriques trèsdiversifiés »- « il y a de gens qui travaillent sur davantage sur des aspects sémiotiques, donc, sur le message, il y a d'autresqui travaillent sur le comportement voire d'influence »- « j'ai fait une thèse de doctorat sur ces questions là, sur le comportement des citoyens, la manière dont ilss'engagent à la politique etc. ça a été toujours un sujet qui m'intéressait, et qui m'intéresse encore aujourd'hui,plutôt dans un contexte d'enseigment, à travers des études de cas, de travailler aussi avec les étudiants justementoiur décrypter d'une certaine manière la communication politique »- « je n'ai jamais été fasciné par la politique même, je n'ai jamais voulu le faire moi-même, mais davantage parvraiment la communication par les messages, par la manière dont un homme politique dans un contextedémocratique voulait s'adresser aux citoyens, de convaincre au maximum les citoyens sur tel ou tel sujet »- « la communication politique pour moi vise surtout à convaincre , à travailler l'image. (…) Elle vise à établirun rapport de confiance par les partis politiques et entre les leaders politiques et les citoyens »- « (…) la mise en place du gouvernement, la pacification aussi de l'espace public. Encore une fois, je pensequ'une question fondamentale pour la communication politique aujourd'hui c'est la confiance, la stabilité d'ungouvernement, et la transparence face aux actions. (…) C'est vraiment un chantier fondamental et principal , etde maintenir les liens avec les citoyens, avec les électeurs même après les élections. (…) Mission de convancreet de mobiliser les citoyens en direction à tel ou tel candidat, bien sûr »- « mais dans les periodes de non élection, c'est à la communication politique de travailler cette transparence, lalégitimité de l'action politique et maintenir la confiance »
122
Entretien 4 : Robert Zarader
Routine/tâches en tant que communicant
« la façon de se positionner, le message à développer, voir quel type de public ou l'analyse des publics etc, touten reliant avec les relations presse et tous les types de médias »- « et puis ce qu'on appelle des affaires publiques, dans le sens technique du terme, c'est-à-dire qu'en France letravail qu'on fait auprès du Parlement sur des amendements, sur des lois, qu'on n'aime pas appeler en France delobbying mais c'est carrément tout ça »- « Elle peut être à travers du discours, ce qu'on appelle les élements du langage, des stratégies, des relationspresse. (…) la façon d'exprimer elle peut être extrêment variée »- « moi je peux conseiller à la fois sur les mots et sur la façon de les diffuser..voilà »- « moi je travaille beaucoup sur la stratégie, j'ai travaillé beaucoup sur la façon par rapport à tel ou tel typed'orientation politique de définir 1) quel genre de message et 2) à qui on l'adresse et 3) comment on lesadresse ?»- « la réflexion par rapport à la situation politique donné, vers quel public qu'il faut aller et quel type de choixde communication »
Importance de la communication pour le politique
« un vrai sujet aujourd'hui c'est qu'on a l'impression que la politique ne serait plus que de la communication. Ona le sentiment que la politique serait dû à la communication. Ce n'est pas vrai. Les politiques ont la plupartoublié ça, ils ont tous de super communicants après ils ont une mauvaise communication. C'est un autre sujet »- « la communication est importé sur beaucoup de principes, du débat public, du débat d'idées, d'action publique»- « aujourd'hui quelqu'un qui ne maîtrise pas la communication, il est disqualifié dans le politique »- « aujourd'hui, l'arrivée d'un homme politique au pouvoir en négligeant les médias est complètementimpossible »- « si le 'produit' est mauvais, il [le communicant] n'a pas quoi faire, comme il a été le cas de Jospin en 2002 »- « la dimension du numérique elle déforme le sens de la communication politique (site internet, blog, facebook,twitter). (…) Elle a une implication avec les réseaux sociaux numérique en tant que telle parce que l'opinion seconsolide, se diffuse, favorise les gens à réagir. (…) il y a un troisième aspect c'est les outils de campagne,d'accompagnement de campagne (logiciels) »- « donc le digital c'est un outil d'opinion, d'accompagnement et d'influence de communication quoi »
Rapport médias et politique en France
- « je crois qu'il y avait quand même un mal français qu'il a été appelé la symbiose et qu'on est encore plus quec'est la consolidité quoi...c'est les mêmes qui se marient entre eux...il y a des hommes politique, quand ils sonten campagne, leurs femmes étaient des journalistes voilà (…) il y a quand même Hollande. (…) c'est un logiquenaturelle parce qu'ils sont souvent en contact, donc c'est normal qu'ils se marient. Donc je pense que cela n'estpas bon pour la politique » - « aujourd'hui ce qui change c'est la concurrence de l'information politique. La concurrence pour lesjournalistes elle a changé. Vous avez de Twitter, des bloggeurs qui ont d'influence dans tel ou tel domaine »- « donc on a ça qu'on appele 'combat', que c'est le résultat de la concurrence entre les journalistes et du modèleéconomique de la presse »- « il y a un appauvrissement énorme du métier de journaliste, ils sont de moins en mois bien payé, moinsformés. Et il y a de moins en moins des journalistes d'expérience. Et cela c'est aussi une conséquence del'appauvrissement des médias »- « je pense que ces évolutions (des médias) elles se superposent, elles ne se substituent pas. La télévision resteun média très important. Il y a le digital, on ne peut pas vivre sans le digital. Et il y a encore la presse écrite aencore sont statut face aux autres médias »- « il y a un point très négatif par rapport au temps. Il faut donner des réponses, réagir aux informations, et letemps politique mériterait être plus calmé, pour avoir un peu de refléxion. »- « il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas à quel moment elles ont été discutées, transformées endécisions. C'est tout une boîte noire, quoi. Il y a un flux d'information et la décision, mais entre les deux vousetiez complèment absent quoi »- « ce ne sont pas deux images, elles sont en amont. C'est qui raconte l'histoire ? [instance politique x instancejournalistique]. Si vous perdez la main et c'est les médias qui racontent l'histoire vous avez une image qui vaêtre peut-être bonne, peut-être mauvaise.(...) Est-ce que le politique a la capacité d'imposer son histoire aux
123
médias ? Ou les médias ont la capacité d'imposer leur point de vue sur les hommes politiques ?
Mission accomplie
« moi je suis très pragmatique, je pense que la communication politique a été bien faite, si elle est réalisée surune campagne, si le méc a été élu. Si le méc n'est pas élu c'est qu'elle n'a pas été bien réalisé voilà »
Défis politique actuelle
- « ils sont dans une situation très restreinte en termes de communication, et leur problème ce qu'ils n'arriventplus à la maîtriser quoi »- « le principal défis c'est de se mettre en capacité de créer de conditions, à la fois de la décision politique, de lacommunication politique et de l'action politique qui soit beaucoup plus proche des vrais gens »- « vous tranchez, comme vous faites dans une entreprise quoi. Vous écoutez des gens, vous écoutez descollaborateurs et puis à un moment donné il y a un patron et il tranche quoi. (…) Les hommes politiquesn'aiment pas trancher »- « on ne trouve pas le moyens de les agréger (les gens mécontents), ils vont à l'extrême. Il faut créer desmanières de créer le débat »- «il faut rendre effectivement à des espaces de décision, plus de visibilité, pour que les gens comprennentcomment se prend la décision. (…) au moins, savoir pourquoi elles ont été prises quoi. Mais si vous n'êtes pasd'accord, et vous ne comprenez pas la décision, là c'est très difficile. C'est le problème de l'Europe quoi. 'C'esttrès loin, je ne comprend rien' »- « on arrive dans un point où la conviction des politiques ne fonctionnent plus, donc il faut aller chercherd'autres formes de conviction quoi. Moi je pense que ça doit beaucoup être dans la capacité à propos du débatquoi »
Professionnalisation de la politique / de la communication politique
- « moi j'ai décidé par choix de ne pas faire de la communication politique marchande. Quand je fais de lacommunication politique, je la fais à titre personnel, avec plutôt des politiques avec lesquels j'ai de relationsquoi. Pas faire de la communication politique pour l'extrême droite »- « je la fais [la communication politique] à ma manière, plutôt sur de conseils, mais pas de manière formelle, jen'ai pas de contrat. Je ne travaille pas pour aucun politique de manière contractuel »- « donc je fais de la communication politique mais à titre quasiment recréatif ..voilà »- « moi je fais de la communication politique pour ceux avec qui je me sens bien, pou choix mais plusintellectuel, mais je ne remplace pas la politique. (…) J'essaie de répondre à son contexte politique à lui »- « il y a une filiation très forte entre économie, entreprises et communication »- « on crée des systèmes de communication pour créer de l'adhésion, la préférence (…), mais je pense que lesgens n'attendent plus ça, ce type de persuastion, ce type de message. Ça reste importante, mais ce n'est pas unesolution suffisante » - « il faut absolument la nécessité de créer des zones de discussion et de partage. (…) la communicationpolitique doit être fondée de plus en plus sur la capacité à partager, debattre et choisir quoi »- « si les communicants politiques ne prennent pas la main sur la façon de réguler un débat, de façon que ça soitles vrais sujets qui y soient traités, je pense que la communication politique va devenir de plus en plusinefficace »- « (…) les hommes politique savent ce qui je suis, il y a ceux qui me connaissent et ils m'appellent, je décide sije vais leur répondre...voilà. Moi je suis dans un cas particulier, parce que je ne suis pas payé pour ça, j'aichoisi de ne pas être payé pour ça. Je ne suis pas un méc à l'Élysée dont son job c'est de répondre auxjournalistes qui appellent le président de la République. Moi je fais ce que je veux quoi »
Qu'est-ce que ça veut dire « communication politique ? »
- « c'est un choix personnel, parce que je pense que c'est toujours très compliqué, même si la plupart descommunicants politiques défendent de mélanger la communication politique et d'autres formes decommunication parce qu'à un moment ou à l'autre les choses se dérapent un peu, parce qu'on prend lacommunication politique pour la communication d'entreprise … ce n'est pas trop mon truc »- « c'est qui est vraiment pour moi, c'est qui est intéressant, c'est de participer au débat public, au débat d'idéesquoi. Ça veut dire, c'est plutôt de porter des idées politiques, et après la façon d'importer ces idées politiqueselle peut être extrêmement variée »- « la difficulté de la communication politique c'est qu'il faut avoir l'esprit qu'on n'est pas de politiques. On ne
124
doit pas se mettre à la place des politiques. Ils ont leur rôle, leurs responsabilités, leurs inconvénients et leursavantages. Ils font de la politique..voilá »- « je pense qu'il faut la faire [la communication politique] de manière collective. Je ne crois pas du tout augourou quoi. Ça existait dans le passé. Jacques Pilhan auprès de Miterrand il a joué un rôle quasi gourou à lafois communicant avec une influence sur des réseaux politiques. Mais ça n'est plus notre contexte. On a uncontexte où les politiques sont exposés en permanence quoi »- « il y a aujourd'hui un déplacement qu'on est passé vraiment d'une logique très de persuasion, decommunication. Il faut absolument la basculer. Ça commence à changer. La société est de plus en plus fondéesur le partage. La communication n'échappe pas à ça. Elle doit aujurd'hui intégrer dans sa façon de se constituer,se consolider, la capacité à créer des zones de discussion »- « s'ils [politiques] gèrent mal, ils pendent des points, donc la communication ça ne veut pas dire grand chose »- « le marketing politique ça peut être une forme de communication politique, mais ce sont des chosesdifférentes »- « la communication politique c'est la communication de l'action politique, d'un homme politique, d'un parti oud'un groupe qui par rapport à un débat ou une décision d'opinion … c'est la décision politique quoi »
125
Entretien 5 : Jean-Luc Mano
Routine/tâches en tant que communicant
- « je suis communicant avec différents aspects de travail puisque je fais de la communication politique, mais jefais aussi de la communication institutionnelle et également la communication pour les entreprises »- « quelle est la tâche du communicant politique ? … moi en tout cas c'est d'exercer essentiellement un conseilauprès des mes clients »- « Un conseil qui a des aspects stratégiques, de définition des objectifs, des orientations et de parcours àaccomplir. Un deuxième aspect c'est sans doute d'accompagnement avec les médias, la préparation auxinterventions publiques, ce qu'on appelle les élements de langage, la pertinance du discours, donc quelquesaspects du média-training. - « il y a un rôle plus complexe qui est un rôle d'une sorte d'alerte, c'est-à-dire, d'être à la croisée de laformation de la sociologie, de la philosophie enfin... des questions autour des grandes tendances de nossociétés pour alerter le responsable politique sur les question qui vont se poser et des changements dans lasociété, parce que ces changements ils entrainnent des modifications de perception du discours »- « mois j'ai été journaliste politique d'abord (…) avec de la politique internationale et de la politique française »- « c'est singulier, c'est atypique, ça ne s'applique qu'à moi … je me suis un peu lassé de l'interview, ducommentaire politique … parce que l'interview c'était 'je savais ce que j'allais leur demander, ils savaient ce quej'allais leur demander, ils savaient ce qu'ils allaient me répondre' »- « j'ai évolué dans mes pratiques professionnelles dans cette voie. (…) je voulais mantenir un lien avec ça queme passionne, la politique française et internationale »- « une autre raison plus noble c'est qu'en France, dans les pays latins en général, mais en France, le conseil ilest caché »- « le métier de communicant pour moi n'est pas un métier d'attaché de presse. Moi je ne téléphone pas à mescontacts journalistiques pour leur parler d'un candidat ou d'un client. Il m'arrive de retrouver des amis à qui jepeux le dire 'je travaille avec tel ou telle'. (…) Ce n'est pas moi qui entretient le contact avec la presse »- « Il m'arrive de parler avec des journalistes sur ce qu'ils pensent du client avant que je le prenne en charge »- « quand je prépare un homme politique à être bon, à intéresser le public, je collabore à l'audimat, donc lesmédias vont lui chercher »- « quand je prépare mes clients à avoir trois, quatre formules qui vont faire l'événement, faire la dépêche, fairele lendemain, la presse va le reprendre, je collabore d'une certaine mesure, pas de la même place, mais dans maresponsabilité, et le journaliste dans la sienne . Et je collabore à l'intérêt journalistique »- « moi je suis plutôt un communicant pas assez ami des journalistes. (…) J'ai cette particularité, qui fait partiede ma singularité, je suis journaliste dans l'âme, je fais de la communication avec de reflets du journalisme. Jesais assez bien où ils ne le lacheront pas et pourquoi et puis ils ont raison de ne pas lâcher. Donc ça m'aide àpréparer mes clients »- « moi je suis quelqu'un qui pense que le numérique, l'internet c'est une révolution formidable, qu'elle vaglobalement dans le sens de plus de démocratie »- « le critère que j'essaie de faire respecter c'est que l'accès à la vie privée est légitime quand il produit du sens,quand il produit de l'information, quand il dit quelque chose »- « parfois mes clients me disent 'j'ai fait un truc, c'est terrible...sur l'internet c'est terrible. (…) Sur Twitter, ça aété terrible'. (…) Ce ne fabrique pas une idée. Ça joue un rôle, en tant que les journalistes mêmes sont acteurssur les réseaux sociaux, ça a une vraie puissance d'influence »- « il y a toujours un ou deux spécialistes en réseaux sociaux qui travaillent dans les équipes, particulièrementdans des périodes de campagne électorale »- « (…) la communication à 360 degrés, qui intègre tous les médias et évidemment le numérique »
Importance de la communication pour le politique
« il y a de politiques qui s'expriment correctement, qui sont alertés des problèmes et des changements de lasociété. C'est sans doute seulement une parti de la réponse à la crise confiance entre les politiques et lescitoyens »- « dans une époque où l'information est multiple, les chaînes sont permanentes, les réseaux sociaux jouent unrôle important... c'est sont des liens (entre les politiques et le peuple) très légers, qui peuvent se dissoudre trèsvite. Ils sont, en réalité, pour les politique, en construction permanente. Il n'y a pas des liens durables »- « moi je connais de gens qui sont de très bons politiques et qui ont échoué par la mauvaise communication.Mais je ne connais pas de mauvais politiques qui gagnent durablement avec de la bonne communication. Lacommunication elle ne change pas les choses fondamentales »- « faire de la politique ce n'est pas faire de la communication. Faire de la politique c'est utiliser de la
126
communication pour faire la politique, et faire de la politique c'est affirmer la leadership »- « il y a eu un gros bouleversement pendant les années 1950-1960, la révolution qui a passé du meeting à latélévision. Il y a une deuxième révolution qui c'est la révolution numérique, indiscutablement. Elle crée leschaînes d'info continu, elle crée un changement parce qu'on est dans la multiplicité, l'immédiateté et lacontroverse permanente. La communication est permanente, c'est tout le temps »- « il y a 15 ans, il y avait un représentant politique, un attaché de presse. Il partait le matin, de chez lui, il arriveau bureau, il travaille, il prend un verre, mange au resto avec quelqu'un, le soir il avait un meeting. Le momentde communication était le soir, pendant le meeting. Aujourd'hui, quand il descend de chez lui il peut être dansune situation de communication »- « les politiques ils sont devenus des objets communicants permanents. »- « Auparavant on lui disait 'fais attention ce soir', aujourd'hui on lui dit 'fais attention tout le temps. À ce que tuvas dire en sortant de la voiture, la manière dont tu vas rentrer, la manière dont tu vas répondre ou ce que tu nevas pas répondre, la manière dont tu vas t'habiller, tu vas marcher'. Tout est sujet de communication puisqu'onest entré dans une ère de transparence, que par ailleurs il n'y a que des avantages pour la démocratie »- « être politique il y a 15 ans c'était quelqu'un qui allait à la télé ou à la radio une fois par mois, quand c'étaitimportant. De nos jours, les solicitations sont permanentes. Moi je passe plus de temps à selectionner lesdemandes que à les chercher. (…) Ce qui n'était pas le cas avant »- « Parfois vous avez des politiques qui viennent de loin, qui sont nouveau, donc il faut se battre pour qu'ilspassent. »- « il faut être représenté médiatiquement, il y a l'immédiateté, donc le temps de refléxion se raccourci demanière considérable. (…), c'est refléchir à un quart d'heure »- « elle [révolution numérique] évite que les affaires importants ne soient gérés que par des élites dans l'opacité.Mais en même temps, est-ce qu'elle crée plus de sincérité, plus de vérité ? Je ne suis pas sûr de ça. (…) Parceque les politiques construisent des situations en fonction de ça »- « c'est parce qu'ils ont voulu tout caché [dans le passé] qu'aujourd'hui ils [public, médias] veulent tout savoir »- « que le président de la République a une maitrisse, ça ne change pas sa capacité à gouverner »- « est-ce que les informations sur leur vie privée influe sur l'action ? Pas plus ? Pas moins ? C'est comme laquestion de la santé des chef d'État. (…) s'il a une maladie qui peut l'enlever des moments de lucidité, desmoments de disponibilité dans la direction, le citoyen a le droit de savoir parce que ça pose une questionpolitique »- «c'est une question de dosage : est-ce que c'est utile à l'expression de la démocratie, à l'expression du débatpublic ? »- « la révolution numérique est virtuelement aussi importante que la télévision pendant les années 1950-1960.(…) Elle n'a pas aujourd'hui la même importance, parce que les mass media restent à la télévision. Lescampagnes electorales globalement se jouent quand même à la télévision. (…) Mais elle prend beaucoupd'importance parce que le public concerné est très présent sur les médias »- « une deuxiéme aspect important [des réseaux sociaux] c'est que ça crée des doutes légitimes, des doutesutiles. '(…) Ils disent ça, mais chez moi je n'ai pas de médecin (…)', ça va aider à relativiser la parole publique »- « en revanche, ça permet aussi la rumeur, les mensonges, la théorie du complot. (…) L'internet devient unsupermarché »- « communiquer c'est mettre un son audible dans le couloir. (…) Pendant la coupe du monde, il ne vaut la peineaux politiques de parler. Parce que les 'bruits de fond' de l'actualité sont trop forts, il n'a pas de possibilité deplus parler »- « il faut être honnête en tant que communicant là dessus [sur le silence] : il y a de moment pour l'hommepolitique qu'il est impossible de s'en sortir devant le questionnement d'un journaliste. (…) Il faut dire le moinspossible et passer à une autre chose. Utiliser toutes les ficelles qui vous permettent de changer de sujet »- « c'est qui est difficile pour le politique, et pour les gens en général...apprendre le silence c'est trèscompliqué »- « il y a deux sortes de politiques qui sont terribles pour la communication : les très cons, parce qu'ils sont cons,et ceux qui sont très intelligents, parce qu'ils ont la volonté absolue de convaincre »- « parfois il y a de thématiques que...voilà. Quand Hollande dit : 'je vous inverserai la courbe du chômage en unan, on est au bout de l'année et il n'a pas fait le truc qui s'est aggravé, il faut qu'il aille sur un autre terrain. (...)C'est un jeu tactique »
Rapport médias et politique en France
- « il y a eu pendant très, très longtemps, et il y en a encore, beaucoup de connivence entre la presse, desjournalistes et les responsables politiques. C'est due à plusieurs choses, dont la première est la fin du contrôledepuis 40 ans des médias par l'État »- « Il y a 50 ans, il n'y avait qu'une chaîne de télévision en France et elle était contrôlée par l'État. (…) Il y a eu
127
toujours en France un lien assez fort de la presse avec le pouvoir »- « la deuxième raison c'est qu'en termes sociologiques les hommes politiques et les journalistes sont lesmêmes : ils ont fait les mêmes écoles, ils viennent du même milieu social, ils habitent un peu dans les mêmesendroits, ils ont le même type de loisir, fréquentent les mêmes restaurants et j'ajoute pour faire sourire qu'ils ontles mêmes amants et les mêmes maitresses »- « ce n'est pas stupide de dire qu'il existe une classe politico-médiatique »- « l'explosion du nombre de médias a favorisé la concurrence, et dans la concurrence la prise en compte de lavolonté du public, de plus de liberté, de plus de transparence. (…) En 30 ans la presse française a beaucoupchangé, elle est devenue plus libre, plus indépendante et parfois plus incisive, même si parfois elle va jusqu'àl'excès en préferant la virulence de la question à sa pertinence »- « je commence à penser que si chacun est dans son rôle : le politique, le conseiller en communication, lejournaliste, c'est un partenariat, c'est un partenariat contradictoire qui se heurt parfois. Qui est fait decontradictions, mais de l'intérêt commun aussi. »- « c'est un partenariat quand même parce que le but est d'arriver à des résultats satisfaisants pour le client, pourles journalistes, pour les médias et pour le public »- « en philosophie on dirait que c'est une relation dialectique : la demande du journaliste conduit le politique àprogresser dans la recherche de production d'idées et du sens, et dans une certaine mesure le travaille fait par lepolitique et le conseiller en communication permet au journaliste d'obtenir de réponses »- «[lors d'un conférence/congrès] il faut ambiancer la presse, parler à la presse pour expliquer ce qu'il [hommepolitique] va dire et pourquoi il va le dire, pour qu'il n'y ait pas de contr-sens, pour que la chose soit comprisepositivement selon l'intérêt de votre client. Mais cela n'existe pas en permanence »
Mission accomplie
- « quand je vois les résultats de ce qu'ils produisent, ce qu'ils disent, de comment ils structurent leur discours,leurs idées, que je leur ai fait avancer dans le mouvement dans les interrogations que je leur ai posé, dans lesalertes que je leur ai mis, dans le warning que j'ai lancé. J'ai aidé à la fabrication de leur pensée, de leur idée »- « le travail a été bien fait quand un politique me dit soit 'les élements dont vous m'avez donné m'a fait changerd'avis', doit 'malgré les élements dont vous m'avez donné, je n'ai pas changé d'avis'. Je pense que le travail estbien fait quand tu leur as donné la masse d'information, d'élements, de reférences que leur permet de décider etquand à la fin ils ont gagné. Pas toujours...parfois on peut perd de bonne manière … enfin, l'idée c'est qu'ilsvont au moins gagner quelque chose dans la bataille »
Défis politique actuelle
« il y a deux défis de la politique aujourd'hui. La première c'est de gérer la la crise, nous sommes dans unepériode toujours en voie de progréssion de la crise confiance, d'une défiance. C'est crise confiance est le moteurde la progression des extrêmismes dans le pays et dans toute l'Europe en réalité »- « si on veut continuer à vivre dans de systèmes démocratiques, c'est de recréer des relations de confiance.Pour ça il y a des exigences, et le premier défis c'est que les politiques obtiennent des résultats. S'il donne lesentiment de n'être que dans la maîtrise du discours et pas dans la maîtrise de l'action, s'il n'y a pas de résultatsd'action, si le partage entre ce qu'ils peuvent faire et ce que d'autres font est deséquilibré. Pour être plus clair : sile sentiment est qui ce sont des bourses (Wall Street, la bourse parisienne) qui décident, alors la parole politiquen'a plus d'importance, elle est discréditée »- « l'enjeu c'est de retrouver le leadership du politique, c'est quelque part le leadership de la démocratie et de lavoie des gents »- « Lula, au Brésil : l'idée qu'il y avait une sorte de proximité entre l'exercice du pouvoir et les préoccupationsdes gens. Ensuite, l'arrivée de Dilma a complétement rompu avec ça. Donc on voit bien que les liens entre lepeuple et le pouvoir sont des liens qui sont extrêmement fragiles »- « la politique est le seul endroit où la volonté est de convaincre au moins la moitié des percents »
Professionnalisation de la politique / de la communication politique
- « Aux États-Unis, lors qu'on a une campagne, on annonce le nom de son conseiller en communication, parceque c'est une sorte de preuve d'assigne extérieure de richesse enfin... »- « En France c'est plus camuflé, parfois même un peu clandestin »- « à partir du moment où on accepte l'idée que le responsable politique a pour une part importante dans sesfonctions la fonction de parler aux gens, de mettre un discours, de produire du sens avec des mots qu'ilpronnonce. À partir du moment qu'on exige d'eux qu'ils rendent compte de leurs actions, de leurs mandats, qu'ilait une forme de transparence entre le discours et la réalité de ce qu'ils font, c'est un exercice qui leur prendbeaucoup du temps aujourd'hui, dont la multiplication des supports médiatiques est très importante. Il est assez
128
logique qu'ils aient de conseils dans ce domaine »- « je me suis dit que c'est assez amusant de voir que personne veut repprocher un responsable politique d'avoirun conseiller économique, conseiller en politique étrangère, conseiller pour le sociable, mais qu'en revanche onen a sur la communication, parce que là on touche la personnalité. C'est plus controversé on va dire »- « il fallait les [les politiques] préparer à l'épreuve qui est le dialogue, le contact avec les citoyens, la pressionmédiatique, en les aidant, contribuer un peu à la recéption de cette faille entre l'opinion et les décideurs »- « quand je vais voir un client, je passe dans la rue et je refléchis 'la personne qui je vais voir veut séduire cesgens là plus 1 %'. C'est une ambition extraordinaire »- « il m'arrive dans mon travail de demander aux gens de l'équipe qui sont là de prendre des contact dans lapresse pour la faire comprendre quelque chose et leur dire 'il faut ambiancer là dessus' »- « [sur son entreprise] c'est une petite structure, je ne voulais pas créer une agence, donc j'ai créé un cabinet, etje gère une vingtaine de clients »- « parfois j'ai des journalistes qui viennent juste pour le média-training (…) Je travaille plus moi plutôt avecdes universitaires, qui ont un parcours plus universitaire, des jeunes gens qui sortent de l'université. Ils ont faitSciences Po »
Qu'est-ce que ça veut dire « communication politique ?
- « une question fondamentale c'est que la communication politique reste à sa place. Je pense qu'elle a une placerespectable éminente, qu'elle est utile, mais pour qu'elle soit utile à la démocratie il ne faut pas qu'elle soit enpremier. Elle ne peut qu'arriver en tant qu'un exercice secondaire parce que la première responsabilité despolitiques est trouver des solutions »- « Si la communication politique est quelque chose qui dérive et qui devient uniquement du storytelling,uniquement de l'apparence, de la posture, ça n'est pas mis au service de la production du sens, ça devient unefacilité, une méthode assez vide »- « dans la révolution médiatique qui est en train de s'opérer – en particulier avec l'intervention citoyenne dansles réseaux sociaux qu'il n'y a que d'avantages, elle est là et c'est plutôt bien -, elle [communication politique]doit se préoccuper parce qu'il y a beaucoup de négations, parce que tout le monde font journalisme, parce quen'importe quelle idée peut s'imposer comme une idée vraie parce qu'elle n'a pas été travaillé avec de la rigueurprofessionnelle »- « l'enjeu de la communication politique aujourd'hui c'est qu'elle ne se substitue pas à la politique. Ça restequelque chose que c'est de s'adresser aux citoyens, leur proposé de corpus guidé, de projets, de programmes »- « la communication politique elle a pour base commune de la communication générale mais l'histoire de lacommunication politique est très liée au développement du marketing. (…) Elle a commencé aux Etats-Unis parla politique, puis elle s'est développée grâce aux méthodes du marketing, la publicité sur les marques. C'est lemême histoire que pour les sondages, qui sont nés pour savoir qui va gagner l'élection et après les marques s'ensont servies »- « l'objet de la communication politique est un homme ou une femme, c'est toujours symbolisé par unepersonne. (…) Il change, il évolue, il s'adapte. (…) Évidement ce n'est pas la même chose de promouvoir unhomme et un objet »- « la seconde différence c'est que vous communiques sur une science qui n'est pas exacte. La politique n'est pasexacte, science de l'humain, et donc il n'y a pas de chemin sans erreurs. Et c'est quelque chose très étrange lapolitique en effet. C'est pour cela que la communication est très particulière. C'est un exercice d'uneextraordinaire témérité, j'oserais dire presque arrogance »- « les pays où il n'y a pas de compétition électorale il n'y a pas de communication politique. Là on est plus dansla propagande. C'est ça ça grande différence entre la démocratie et la dictature. Dans la dictature on ne fait pasde la communication politique, on fait de la propagande. Et dans la démocratie on essaie de faire de lacommunication politique »- « [la communication politique] est structurée par des rendez-vous électoraux, d'assomption »
129
Entretien 6 : Anne Dorsemaine
Routine/tâches en tant que communicant
« je suis abstentionniste, je n'ai jamais voté, donc ça me permet d'être un peu une feuille blanche. À chacun onva dire...on va faire un parcours pour la compétence et par la reconnaissance de la compétence »- « il faut qu'on ait la reconnaissance des gens, de ceux qui sont impregnés dans ces milieux-là, donc l'écologie,les ONG etc il faut être capables de se mettre en situation de challenger. (…) même des gens qui seraient plutôtdes adversaires deviennent des gens qui acceptent leur compétence » « je n'ai jamais insisté à un entrevue avec un journaliste dans tout cela que je fais, ou j'avais un journalistepolitique intéressé à un sujet intéressant »- « on est devenu un producteur de contenu, on est quasiment une agence de presse à soi. On produit desimages, on essaie d'occuper à peu près tous les champs et la communication, la meilleure communication c'estcelle qui va être prise par la presse »- « l'importance des médias réduit parce qu'on a ces possibilités de produire les contenus à nous. C'est plutôt çaqu'on va développer »- « en ce qui concerne les médias, quelle a été notre stratégie … je ne sais rien, j'ai détesté cette campagne. Enfait ce que j'ai détesté dans cette campagne c'était le fait qu'elle a été éminemment politique, suivie par dejournalistes politiques »- « moi j'ai essayé de pousser, mais ça a pris pas mal de temps dans la rédaction, ce que se fait pas du tout enFrance, ce que les journalistes politiques viennent mais avec les journalistes de logement (…) et ça se fait très,très peu les deux »
Importance de la communication pour le politique
- « pour moi, ce qui est le plus important, c'est la capacité d'aller de dossier en dossier pour s'impregner assezrapidement du fond, et de pouvoir le transformer en axes et en stratégies de communication »- « la communication n'a de fondement que si elle sert à un projet, un fond. La communication pour lacommunication pour moi est un terrain totalement vain qui prend de plus en plus de place et qui fait également,pour moi, qui est-elle l'une des raisons de l'abstention aujourd'hui »- « on est arrivé au ministère du numérique et le gouvernement était detesté par c'était le gouvernement quiportait l'Hadopi – le loi contre le piratage -, donc très mal vécu du côté de la communauté digitale, très active.Le challenge a été de mettre en valeur de sujets très bons. (…) on a favorisé le déploiement de nouvelles formesde consommation de musique, de nouveaux modèles vers nos publics premiers »- « aujourd'hui il y a très peu de projets. Il y a plutôt 'qu'est-ce que je vais dire dans telle et telle réunion ?'.Sarkozy c'est intéressant parce qu'il adapte complétement son discours en fonction de son auditoire. Ça c'estquelque chose qui tue la politique aussi »
Rapport médias et politique en France
- « les journalistes politiques sont un peu les seigneurs de la rédaction » → il n'y a pas de la place pour lesjeunes politiques- « le boulot est de faire que les sujets deviennent des sujets de société, populaires. Et pour ça il faut avoir unbon politique qui sait investir ces sujets, les transformer, que les maîtrise, qui sait bien en parler. Enfin, faire desujets 'grand public' »- « les politiques, celui qui va parler de le smart grid, neutralité du Net etc, les journalistes politiques disent : 'ah,il est techno', alors qu'il s'occupe de vrais sujets politiques au sens grècque du terme, des sujets detransformation »- « le journaliste politique en France est une race spéciale. Il n'est intéressé par rien. La seule chose que l'uiintéresse c'est la tactique, les histoires des partis, il met en scène souvent les combats gladiateurs parce que c'estça qui fait vendre 'qui est méchant, qui n'est pas méchant', les petites phrases assassines, les coups médiatiques.Or, les journalistes politiques sont les seigneurs de la rédaction »- « il y a un décalage total entre les sujets qui sont des sujets de société, qui sont les sujets de transformation quiintéressent les gens, parce que c'est cela qui impacte leur vie, et les sujets qui intéressent les journalistespolitiques »- «le journaliste politique est paresseux intellectuelement, il met en scène des combats en pensant que c'est ça...donc les gens vont regarder ça, mais maintenant ils regardent ça comme si c'était Lara Loft, Secret Story... Leschaînes d'information ont fait beaucoup du mal, 24/24. (…) c'est pour ça aussi que les politiques font autant dedeplacements aujourd'hui (…) pour s'inscrire dans l'image »- « le programme n'intéressait personne. Si vous faites une recherche sur les articles de la campagne, vous allez
130
voir la disproportion, elle va être évidente entre les articles de nature tactique-politique (les alliances, lesméchants, les gens sont fous des alliances. Les gens veulent savoir 'est-ce que ça va être mieux, moins bien,différent, en quoi ?', voilà. C'est très bête, quoi. (…) vous allez voir la différence entre ces articles quiintéressent les gens et les autres qui n'intéressent qu'à un tout petit monde. En fait la politique c'est un tout petitmonde, c'est un cicuit fermé »
Mission accomplie
- « passser des sujets au premier pages, des sujets qui n'éxistaient pas médiatiquement »- « faire que des sujets techniques deviennent des sujets de société, des sujets politiques »
Défis politique actuelle
- « le méc quand il vaut grandir il se met sur des sujets, et il faut qu'il devienne bon sur ces sujets. C'est le casde Kosciusko. Elle est très politique et très polytechnicienne. Ça veut dire qu'elle est capable de comprendre dessujets très techniques mais de les rendre politiques. Ce qui est une art »- « ceux (les politiques) qui sont bons c'est comme ça qu'ils vont monter. En étant bons sur leur sujet »- « il y a une désaffection, un divorce entre les citoyens et la politique. (…) les médias, qui ne poussent pas doncles bons politiques, qui sont bons sur des sujets techniques, ce que fait avancer le monde, et il y a des sondages.L'enquête d'opinion est quelque chose qui tue, parce que avant, quand les gens ne savaient pas, ils avaient unevision, ils savaient où ils voulaient y aller. (…) aujourd'hui il n'y a pas ça, aujourd'hui il y a 'qu'est-ce que je doispenser ?'. Et ça c'est aussi à mon avis un des tue l'amour en politique »- « on explique comment on fait des grands écarts idéologiques pour essayer de ramener tout le monde, et de sepositionner et de penser par rapport à un assiete électorale...voilà »- « un politique ne doit pas se demander 'qu'est-ce que je dois penser ?', il ne doit pas se dire 'qu'est-ce que jedois penser pour plaire à'. Il doit savoir avoir de convictions, et être meilleur pour ramener tout le monde et faireune synthèse et proposer un projet. Avoir son intuition et après surtout sa vision, sa capacité de transformation »- « donc il y a les journalistes politiques qui sont nuls, qui ne poussent pas les politiques à travailler. On n'estjamais mieux que quand on est challenger ; il y a des sondeurs, qui donnent de photographies et leurtermomètre dans tous les domaines de l'opinion pour savoir ce qu'il faut dire etc. (…) la mise en scène enpolitique c'est plutôt une question d'ego, les politiques ont leur ambition de devenir numéro 1 à la place dunuméro 1, mais pourquoi faire ils ne savent pas. (il n'y a pas des projets qui s'incrivent dans un grand schémapolitique. Ça n'existe plus, on ne voit pas ça »- « la plèbe ils ont bien envie que le politique leur propose quelque chose à laquelle ils n'avaient pas pensé »- « la politique devient un truc people, très spectaculaire mais il n'y a plus de fond et que de la communication.Et le résultat, c'est quand même pas mal, c'est un divorce »- « il va être difficile pour un politique en France de rester bon et intelligent sur tout son parcours. En général,ils ne sont jamais meilleurs qu'au début et le système fait qu'après ils s'adaptent au jeu, la tactique »
Professionnalisation de la politique / de la communication politique
- « (…) la prise de pouvoir de la communication sur l'ensemble des terrains qui fait qu'aujourd'hui la politiqueest regardée comme un spectacle, comme de la télé-réalité, crée un grand désenchantement »- « ces désenchantement ont deux résultats : de nourrir les extrêmes et de nourrir le camp des abstentionnistes »- « donc le politique que grandit il est content de grandir et en même temps il abandonne un peu ses grosdossiers puisqu'il voit que ces grands dossiers n'intéressent personne, c'est extrêmement, énormément du travail,alors qu'il suffit de faire de la tactique et d'avoir une livraison de formule par quelques communicants qui viventdes formules »- « la campagne de Kosciusko, ce qu'elle a fait c'est qu'elle a fini avec les communicants et sondeurs d'opinion.Il n'y a plus de technique. Il y a un profil-technique pour plein de communicants. »- « La multiplication des communicants ne fait pas une politique, elle fait surtout des gens que s'attirent dans lespâtes et qui essaient de faire passer leurs idées non parce qu'elles sont bonnes mais pour l'importer sur celles duvoisin, et surtout la communication pour la communication a ses limites, et cela s'exprime aujourd'hui dans lescrutin »
Qu'est-ce que ça veut dire « communication politique ?- « (…) c'est que ce qui m'intéresse ce le fond, donc ce qui m'intéresse c'est le programme, travailler sur leprogramme. (…) ce n'est pas de la stratégie, c'est de la tactique »
131
Entretien 7 : Benjamin Guy
Routine/tâches en tant que communicant
- « Assurer la compréhension/valorisation des actions politiques et les rendre explicites sur le quotidien desgens, en direction à un certain public »; - « Communication des élus vers les publics, parce que les élus sont le relais principal en direction de leurterritoire [départements] »;- « Pour toucher le francilien, nous pouvons bien essayer d'accéder directement à lui dans le cadre d'une actionde communication 'grand public', ou bien de le segmenter, en touchant tel ou tel territoire, ou en touchant tels outels acteurs territoiriaux (organisations/entreprises, par exemple) »- « ( …) ou on passe par l'accès local, passant par le Parti Socialiste, à savoir, ces différentes subdivisions :région, fédération (par département) et séction, où c'est convaincre les militants de la nécessité d'aller à larencontre des franciliens, avec des outils de communication (tract, fórum de communication événementielle quipasse à la suite une réunion publique ou stand-ups) »- « mon travail est de donner les outils pour que toutes ces situations de communication soient possibles et queles outils soient adaptés à ces situations de communication, et de donner la possibilité à de différents porteurs demessages, ce soit les élus, les militants, les représentants de quórum intermédiaire , les élus locaux »- « on est deux personnes qui bossent sur la communication. On a la mains sur les différents réseaux sociauxqu'on utilise, qui sont principalement Facebook et Twitter, donc avec de stratégies qui sont un petit peudifférentes parce que ce sont de communautés différentes dans leur volume et leur composition. Donc ce sont deformes de messages et des interactions différentes »- « j'ai la tendance à privilégier Twitter parce que ce n'est pas un média grand public proprement dit et permetd'être en contact avec différents réseaux, beaucoup de journalistes, beaucoup de personnes publiques, beaucoupde tel et tel réseaux professionnels, sectoriels et territoriaux »- « notre site internet n'est pas un site grand public, parce que les franciliens n'attendent pas de la bonne parole.Ce qui les intéresse ce de savoir leur cadre de vie, si ça améliore ou pas »
Importance de la communication pour le politique
« (…) le public est de plus en plus sensible à son cadre de vie, à lui, le local, le quotidien. On assiste à uneremontée de cet intérêt aux cadres de vie aux dépends d'une approche plus globale »- « dans leur politisation, les gens s'intéressent toujours au fait politique, je pense qu'ils sont très sensibles à lachose publique, à travers un prisme qui a rélative défiance vis-à-vis le politique, je pense que malgré tout ilssont très sensibles à la différence entre la droite et la gauche, parce qu'ils l'apperçoivent dans leur quotidien »- « ils sont recentrés dans leur intérêt propre, personnelle, à leur territoire, d'où l'importance qu'on a decommuniquer de leur quotidien à eux »- « les élus sont le relais principal parce qu'ils font remonter la spécificité locale »- ((dans le cadre d'une campagne)) : « On est dans la préparation de la suite. On est dans la valorisation d'unbilan d'une action, de montrer comment j'ai accompli mes engagements ? Comment ces engagements ont permisd'atteindre les objectifs dont on avait fixé dans le quotidien des gens ? Et quel est notre projet pour la suite ? Etla crédibilité qu'on a sur notre projet dépend de la crédibilité qu'on a sur l'application de notre projet précédant »- « on fait de moins en moins de la communication print parce que ça n'intéresse pas les gens. Et au global, çacoût très cher pour un feedback quantitatif et qualitatif pas satisfaisant. On est plus sur des outils numériques,c'est les réseaux sociaux, site internet, newsletter, mais aussi dans les pratiques qu'on va qualifier les plustraditionnelles en politique, donc c'est du tractage, qui ont à la fois l'intention de toucher le grand public maisaussi de mobiliser des militants, les élus locaux, les élus régionaux »- « le politique doit démontrer qu'il a la capacité d'agir sur le réel, et là il y a une partie de la population quidénie ce pouvoir . C'est pour ça qu'on fait de plus en plus de communication. Parce qu'on doit traiter beaucoupplus de données, et démontrer de choses qui sont de moins en moins démontrables dans le fait. C'est pour ça quela communication devient de plus en plus importante, la Communication Politique »- « on joue sur ce côté symbolique et quasi mythologique de la communication, et donc on est sur l'irrationnel,mais on se doit d'être sur le rationnel. Notre point de départ c'est toujours le rationnel »- « les campagnes c'est le temps de la mobilisation communicationnelle et non pas de la mobilisation politique,c'est le temps de la radicalisation du discours et de la position, c'est le temps de la caricature de l'adversaire, dela caricature de ses propres valeurs. C'est pour ça qu'on est tout le temps en campagne »
Rapport médias et politique en France
132
« (…) les journalistes aussi et potentiellement le grand public de n'importe quel type ont à disposition desdonnées ouvertes très importantes, qui font le travail d'arbitrage d'un homme politique en campagne. S'il dit 'lavérité c'est ça', les français ont la posisbilité de vérifier, et ils le font. (…) chaque structure de presse a sesjournalistes qui font du fact checking, donc ils peuvent dire qui dit vrai, qui dit faux. Pourtant, ça n'a que peud'incidence sur la manière dont les gens structurent leur discours politique et leur communication. Du coup, çaconditionne la manière dont les citoyens appréhendent l'information du type politique »- «ce sont majoritairement la presse locale, qui, comme nous, parce qu'ils font la même analyse que nous, sonttrès fiants de 'quelles conséquences territoriale et physique de telles politiques publiques' »- « ces avis ne sont pas façonnés par les citoyens, mais par tout un système politico-médiatique qui en faits'autoalimente »- « nous sommes dans une logique où il y a de plus en plus d'information mais les gens ne prennent pas le tempsde traiter des informations du type politique parce que on a beaucoup trop, parce qu'ils n'ont pas nécessairementla grille de compréhension (…) parce qu'on est dans un système éducatif qui ne forme pas de gens à être descitoyens qui savent ce qui est le socialisme, qui savent ce qui est le capitalisme, être de droite, de gauche,libéral »- « le citoyen va plus être sur l'irrationnel, plus ou moins radical. Donc on doit y traiter, égalément. Ce n'est pasau communicant de traiter cette dimension citoyenne, ce n'est pas à nous de former les citoyens. On cherche àtransformer les citoyens en électeurs et, si possible, en électeurs pour nous »- « Le Front National est LE SUJET médiatique. Il s'est placé dans une position au centre de l'échiquierpolitique et médiatique. Donc aujourd'hui c'est le FN qui détermine sur la quasi intégralité des sujets la prise deposition des acteurs. (…) Ils jouent sur ce sentiment des citoyens d'être abandonnés par le politique, de ne pasêtre entendu, de ne pas être béneficiaire des politiques publiques, qui béneficient à l'autre ou bien aux politiqueseux-mêmes »- « le quinquennat de Nicolas Sarkozy a été très structurant sur l'importance de la Communication Politique.(…) on est arrivé dans un moment où le spectacle de l'action politique équivaut à l'action politique. C'est donnerl'impression qu'on agit, c'est plus important que les effets de l'action en lui-même. Avec Sarkozy c'était ça,c'était fondamental. »- « ce qui était particulier avec Nicolas Sarkozy c'est qu'il était partout : il sauvait le monde, les finances, lesentreprises à peu près trois fois par semaine. (…) le plus spectaculaire a été la crise en Georgie »- « Il y a un fait divers, une émotion, une attention qui est portée sur un sujet, je traite du sujet, j'ai un discoursfort, dynamique, un discours d'autorité, et ce discours équivaut à l'action, elle n'a même pas besoin d'arriver »
Mission accomplie
- « on doit être en capacité de démontrer l'efficacité au quotidien de tout ce qu'on vote et qui ont un partidéterminé, le Parti Socialiste. C'est la qui est un peu particulier dans le boulot que je fais ici en CommunicationPolitique dans une collectivité territoriale par rapport à ce qui est fait dans un parti »
Défis politique actuelle
« (…) un phénomène qui est plus lié à la communication et pas à la communication et l'information et pas liéau politique, c'est qu'on est sur une augmentation fondamentale de données dont disposent les citoyens (…) etmalgré tout on est dans une situation au moins de matière de défiance vis-à-vis du politique, alors même que lepolitique a de plus en plus de gage de transparence et multiplie les actions de communication »- « on n'a jamais eu autant d'information publique, brute, donc non mise en forme, non travestie, noninterprétée, pour donner à voir la réalité de l'action publique et politique, et malgré ça on n'a jamais été à monsens depuis au moins d'une cinquantaine d'années autant dans la caricature et dans l'irrationnel, dansl'appréhension de la chose politique »- « pour être crédible, tu dois démontrer des incidences concrètes du modèle global que tu vends. Donc leconcret c'est le cadre des villes, du territoire, ou bien du strictement personnel [tels que la réduction d'impôts oumeilleur accès aux services de santé publique, par exemple] »- « on a cette question du local et de l'individuel qui est devenue primordiale. Donc pour nous au quotidien c'està la fois de s'inscrire dans une dynamique globale, parce qu'on est de gauche (…), une politique de gauchefondée sur les engagement qu'on a pris, mais on se doit d'en concrétiser »- « (…) il y a en France et dans la plupart des démocraties représentatives occidentales (…) il y a une défiancetrès importante qui pousse toujours à dire 'oui, vous votez ça, mais c'est de l'intérêt d'autre'. (…) les gens sontpersuadées que 'ok, vous dîtes tout ça, mais votre action est au profit d'eux'. Donc c'est les assistés, les riches,les immigrés, les fonctionnaires. On est tous l'autre de quelqu'un. (…) On doit lutter contre ça sur la base duconcret »- « (…) plus on monte dans le champ politique, plus cette tâche devient difficile, (…) plus l'importance du jeu
133
politique est grande par rapport au quotidien »- « la marge de manouvre est de plus en plus courte (…). Il y a de moins en moins d'importance et de réalité desconséquences entre un homme politique de droite et un homme politique de gauche à partir du moment où lecadre financier impose la réduction du déficit à un rythme plus ou moins soutenu »- « être un élu de gauche dans un contexte comme ça … un élu de gauche, un président de gauche, bah c'est unpeu de malédiction quoi »« on est de moins en moins habitués à avoir de débats avec des gens parce que les avis sont très vite trinchés,presque passionnels et irrationnel. (…) c'est compliqué d'avoir un débat du type démocratique avec des gens quiont un avis trinché avant même le début du débat. Toute la difficulté est de résussir à trouver des manières deparler de manière indirecte aux gens ou indirecte à travers des moyens de communication, de supports différentset de les remettre en place dans le débat démocratique (…) et d'accepter de revenir au fait, et non pas au ressenti»- « ça fait six ans que je fais ce type de fonction et j'ai l'impression d'avoir vu une évolution assez préoccupanteparce qu'on va de plus en plus du ressenti par rapport au factuel »- « ce manque de sentiment d'être représenté. (...) les élus, leur image ne paraît pas être assez au service desgens que les élisent. C'est une partie vraie, mais c'est surtout je pense lié à l'absence de marge de manœuvrepolitique »- (lors du spectacle de l'action) → « les collectivités territoriales se doivent être plus près de l'action et duconcret des gens »- « on est obligé de faire un passage ou bien comme point de départ ou comme point d'arrivée à son quotidien età son cadre de vie et ses intérêts propres, ce qui n'était pas vrai à l'époque post-guerre, par exemple » ==>différents contextes historiques et de politisation de la population (appartenance aux partis/syndicats)
Professionnalisation de la politique / de la communication politique
- « les enjeux financiers politiques sont très importants aussi. Donc il faut qu'on se profissionnalise. C'estnormal »- « on se rapproche de plus en plus du MKT, en particulier pendant la période électorale, et ça fonctionne mêmeen cours d'un mandat (…) on doit 'vendre' de choses qui ne sont pas toujours perceptibles, et là pour le coup onest vraiment dans la communication du type commerciale/marketing, et on va vers ça, mais c'est lié à une margede manœuvre politique, la financiarisation de la politique, qui fait que la marge de manœuvre financière et doncpolitique est tellement tenue qu'il faut déployer de trésor d'efforts et d'imagination pour la vendrecorrectement »- « la Communication Politique se profissionnalise pour les raisons dont je vous disais, parce qu'on a moins àvendre, donc on doit mieux le vendre. Mais le plafond de cette professionnalisation se confronte au réel : si leproduit à vendre n'existe pas, ce qui est très compliqué de le vendre »- « tant que le citoyen n'aura pas la preuve tangible dans son quotidien que cette action politique a des effets sursa vie, la communication elle est très compliquée. Donc là on est dans une situation dont le rationnel n'est passuffisament palpable, pourtant on fait de la communication sur l'irrationnel»- « aujourd'hui ce qui fonctionne très, très bien c'est le dénigrement de l'adversaire plus que la valorisation de sapropre personne. On atteind à un tel niveau de cynisme et de désillusion sur le politique qu'on vote pour lemoins pire. (…) donc la question c'est de savoir qui c'est le moins pire » => trolling, petites phrases, coupsmédiatiques
Qu'est-ce que ça veut dire « communication politique ?
- « on a le temps du politique de voter les dispositifs. Après que le temps de négociation du dispositif est passé,c'est le moment de le valoriser auprès des béneficiaires. Et là nous sommes dans la communication politiquepure. Ainsi, dans un premier temps il faut expliquer ce qu'on a voté et ensuite montrer l'efficacité. »- « vous avez voté pour nous sous la base de tels engagements, je vous démontre que les engagements ont ététenus (…) et ils sont efficaces »- « l'efficacité d'une approche globale doit être démontré au local , parce qu'en fait les gens sont dans unesituation de défiance au globale »
134
Entretien 8 : Interviewé 1
Routine/tâches en tant que communicant
- « la note de synthèse (…) c'est un page où il faut résumer pour l'élu, qui connait pas le sujet, donc il faut qu'onlui explique les difficultés, les enjeux … voilà.»- « sur les sujets de sécurités, par exemple, il faut rassurer, il faut dire 'toutes les mesures sont prises pourassurer la sécurité'. Il faut dire ce qui s'est passé, mais il ne faut pas en dire trop pour quoi qui ce soit le sujet »- « on a mis en place très rapidement pour Marie-Christine Lemardeley des outils propres, et effectivement lepremier a été Twitter. »
Importance de la communication pour le politique
« quand on parle d'un sujet, on parle du fond du sujet et à la fin elle [Mme Rose Lemardeley] me demande : 'etalors, qu'est-ce que je peux dire ?'. Donc c'est ça les élements du langage »- « il faut trouver le bon équilibre. Il faut faire preuve de pédagogie, il faut valoriser l'action du politique, il fautrassurer, assez souvent, il faut être transparent, sans en dire trop »- « c'est un outil intéressant [le Twitter] parce que c'est un moyen de donner à voir au citoyen ce qui fait un éluou un candidat. Ça permet de dire 'ce matin j'ai fait ça', 'cet après-midi je vais là' . Je pense que cela crée unerelation, que je trouve bien, entre le citoyen et son élu » - « c'est une démarche volontaire, c'est quelqu'un qui va décider de suivre tel élu, ce qui est bien, puisque çaveut dire qu'il y a une démarche du citoyen, qui s'intéresse. (…) ce qui crée une relation assez saine parce que cen'est pas de la com' qu'on se prend comme ça passivement. C'est de l'information qu'on va chercher »- « ça touche quand même un public assez restreint. (…) je pense qu'on touche pas le grand public quoi, ontouche un les experts, les citoyens qui s'intéressent... »
Rapport médias et politique en France
- « le journaliste., il va considérer que dès qu'un homme politique, un candidat communique, il y a un part demensonge un peu dans la communication »- « il y a des journalistes qui considérent qu'ils ont pour mission d'aller gratter, d'aller trouver la vérité. L'hommepolitique considère, assez souvent, que les médias viennent chercher la petite bête, et qu'il ne va pas s'intéresserau fond du sujet. C'est une espèce de malentendu entre les deux quoi »- « le problème du Censier devient un sujet difficile pour Lemardeley. On a touvé la bonne solution pour reglerle problème. Mais les opposants de la candidate ont instrumentalisé ce sujet pedant la campagne dans le Vearrondissement, en disant 'voyez, elle fait partie d'une université du Quartier Latin, elle détruit le Quartier Latin'.(..) Mais quand la presse reprend les arguments des opposants, en considérant que ça ce n'est pas de lacommunication officielle, donc ça veut dire que c'est de la vérité, là je trouve que là on a un problème »- « elle est challenger par les journalistes qui vont chercher le problème, parce qu'ils vont jamais communiquersur quelque chose de positive. (…) C'est toujours sur les problèmes »- « quand les médias reprennent un discoirs des opposants, ils légitiment ce discours, qui est lui-même unecommunication politique »- (la presse locale – Le Parisien) : « je trouve ça assez intéressant parce qu'ils suivent des projets quoi. Ilssuivent des actions plus concrètes qui se passent dans l'arrondissement. Peut-être c'est ça qui intéresse le citoyen»- « peut-être ça crée une distorsion de la réalité »- « on dit quelque chose, dans les deux minutes d'après, c'est sur la chaîne d'info. (…) c'est un message qui estsimplifié et sursimplifié, on n'a pas même le temps de l'expliquer »
Mission accomplie
- « les sujets sont de plus en plus compliqués, et on a de moins en moins du temps pour communiquer dessus ,donc il faut trouver le bon équilibre »
Défis politique actuelle
- « globalement, les citoyens connaissent assez mal ce qui font leur représentants ou les hommes politiques »- « arriver à faire de la pédagogie, sans être taxé de faire de la communication politicienne, moi je pense quec'est ça le défis »- « je pense que les élus, les représentants font beaucoup de choses bien, mais il y a beaucoup de dérives , parce
135
qu'il y a effectivement quelques uns qui sont très tacticiens de la politique. Je pense que le message politique estdécrédibilisé »- « moi je crois encore à la chose publique, que les représentants politiques font ou peuvent avoir en tête dedéfendre l'intérêt général. Ils ne font ça que pour leur ego … il y en a...pour leurs intérêts particuliers, il y en a.mais il y en a aussi beaucoup qui travaillent et je pense que le vrai défis c'est d'arriver à mettre en place undiscours qui ne soit pas perçu comme un discours politicien quoi »- « il faut qu'il retrouve la confiance dans le discours, dans le message politique »- « la responsabilité est aussi de la part du citoyen, qui ne prend pas le temps de lire un article, parce qu'il estfatigué, parce qu'il faut se concentrer ... »
Professionnalisation de la politique / de la communication politique
- « comme c'est une formation qui prépare les futurs haut fonctionnaires en France, c'est vrai qu'on est très viteformé à plusieurs exercices qui sont on dirait de préalables à la communication politique »- « il faut bien savoir que la communication c'est un métier »- « on ne peut pas être purement factuel, donc évidement … de plus en plus, si vous voyez sur le Twitter deAnne Hidalgo, par exemple, elle fait ce qu'on appele des infographiques. Ça c'est un outil que je trouveintéressant, parce que c'est pédagogique »- « on n'a pas le temps de tout faire, donc on simplifie la communication, on la raccourci...donc tout ce qui estune simplification crée forcément une distorsion »- «(...) pour être efficace, pour gagner une élection, pour vendre sa politique il faut mettre en place un discoursqui parle aux gens. Donc pour gagner une élection aujourd'hui il faut être un bon communicant, évidemment. Ily a Manuel Valls et Sarkozy, c'est parce qu'ils sont de bons communicants. Toute leur communication repose surle principe d'être efficace. Ça marche, quand même, un peu...mais en même temps ça crée une perte deconfiance de plus en plus du citoyen »
Qu'est-ce que ça veut dire « communication politique ?
- « j'ai toujours considéré que pour bien communiquer il faut un bon produit. Avant de refléchir à quels sont lesoutils, il faut avant bien refléchir sur le message qu'on veut faire passer , qu'est-ce qu'on a à dire ? Est-ce quec'est le bon moment ou pas ? Pour c'est très important de ne pas faire de la surcommunication quoi »- « à travers Twitter on peut voir les actions concrètes sur le terrain et ne pas oublier quand même que leshommes politiques sont beaucoup sur le terrain et très impliqués, au-delà les discours démagogiques »- « j'ai toujours considéré, un peut pour naiveité, un peu pour idéalisme, j'ai toujours envie, par l'instant encorede concevoir le mot politique dans son sens premier du terme, c'est-à-dire, les choses de la cité. Donc j'ai envie,je souhaite, que la communication politique soit la communication sur les affaires de la cité et que ça permet lecitoyen d'être éclairé, de comprendre, de voter en conscience, d'avoir un dialogue avec ses représentants »
136
Entretien 9 : Gaspard Gantzer
Routine/tâches en tant que communicant
- « moi je parle beaucoup avec le Président, qui me demande parfois mon avis, je peux lui donner parfois monavis sur telle ou telle situation, la façon de la gérer »- « je passe beaucoup du temps au téléphone en rendez-vous avec des journalistes, alors...tentant de répondre àleur questions, leur donner des informations qu'ils en ont besoin »- « je travaille avec mon équipe ici, sur la traduction de la volonté présidentielle dans les élements decommunication, dans la presse, sur l'internet, dans l'audiovisuel »- « et parfois je discute beaucoup avec mes homologues de Matignon et des principaux ministères, pour quenous soyons bien toujours sur la même ligne, en matière d'action et de communication »- « il y a beaucoup de gens dans mon équipe qui ont une formation en communication, la majorité. Sciences Po,des écoles de commerce, la faculté et l'université »
Importance de la communication pour le politique
- « le champ social a plus changé c'est l'environnement et l'évolution des médias elle-même. Il y avait 30 ans,les années 1980, il y avait trois chaînes de télévision. On n'avait que des rendez-vous fixés à 13h et à 20h.Aujourd'hui il y a une explosion de l'offre de l'information, à la télévision, à la radio, dans la presse écrite, surl'internet »- « la mondialisation de l'information, des événements qui se passent à Dubai, ils ont de resonance en France ouà San Francisco. (…) La désynchronisation de l'information : à n'importe quel moment , une information peutêtre reliée, en direct, à la télévision – chaîne d'information continu sur l'internet – . Et enfin, il y a ladésintermédiation, sur le fait qu'aujourd'hui, au-délà des professionnels, des journalistes, d'autres personnespeuvent avoir ses médias, des français anonymes ou de gens qui vont sur internet »- « ça [changement paysage informationnel] évidemment bouleverse énormément le rapport avec le grandpublic »- « en fait il y a plein de choses que nous échappent dans la diffusion des l'information, au sens entre lescitoyens. On voit assez bien comment l'information passe par le biais des médias, y compris internet, mais cequi est plus intéressant c'est comment circule l'information entre les citoyens . Les secrets, les conséquences deces échanges »
Rapport médias et politique en France
- « je ne crois pas qu'il y a 'des médias' en général parce que chaque média fait son travail de manière assezdifférente. Je crois que depuis pas trop très nombreux années les médias ont pris leur indepéndance, qui esttotalement indispensable, et cette indépendance elle est respectée »- « je pense que les médias ont un pouvoir d'investigation … de critique, d'analyse, mais aussi parfoisd'impertinence. Et plus les médias sont libres, plus ils sont corrosifs. Plus ils approfondissent les analyses, plusils vont chercher une information »
Mission accomplie
- « je ne me dis jamais ça ['mon travail a été bien fait]. Ce n'est jamais parfait. (…) J'essaie de faire tout ce queje peux faire le mieux que je peux. Mais ce n'est vraiment jamais parfait. Je pense qu'en réalité, lacommunication … elle ne peut pas être évaluée hors l'intérêt des choses, ce qui intéresse c'est l'action réussie.C'est le chômage qui baisse. Voilà. Donc la communication elle n'est qu'une toute petite part de l'action »
Défis politique actuelle
- « il y a deux façons de lutter contre la crise de représentation qui touche la politique. Certainement, un déjà,c'est d'avoir de résultats, d'améliorer la vie des gens. Et deuxièment, d'améliorer la relation, le dialogue. Et ça jepense c'est une mission déterminante de la communication »- « l'époque actuelle nous offre des opportunités très fortes via internet, via l'association des français auxdécisions, via la communication médias et hors médias. Je pense que ça c'est un très bon défis pour lareprésentation. Après il y a le côté des élus, et de l'autre côté les Français, le côté des responsables politiques detraiter les citoyens. Il faut que toujours ce lien tendu, même hors la période électorale, qu'ils nourrissent undialogue, une conversation »
137
- « [défis de la communication politique présidentielle] c'est une chance ennouie de faire ça, une responsabilité,une honneur. C'est difficile, surtout les métiers sont difficiles. (…) Si on commit une erreur, ça se voit plus, c'estévidemment plus complexe. De l'autre côté, on prend l'élu actuel, il est quelqu'un qui a une intelligence, uneforce de travail exceptionnelle, et ça rend le travail avec lui assez facile. Parce que c'est un excellent menager,un excellent décideur, il est toujours en xxx avec ses collaborateurs, et ça c'est vraiment une chance »
Professionnalisation de la politique / de la communication politique
- « j'ai fait Sciences Po et l'ENA, donc je n'était pas du tout destiné au départ à faire de la communication. Jevoulais plutôt être haut fonctionnaire de l'État, travailler dans le champ des politiques publiques »- « j'ai commencé ma carrière en travaillant dans le domaine des affaires sociales, des droits de travail, desassociations pendant 3 ans. Après je suis parti dans le secteur culturel »- « (…) conseiller en communication, un métier en général à peu près tout. Et j'ai de la chance avec Delanoe quivoulait m'apprendre à la fois ses techniques, son mode de fonctionnement, son état d'esprit. J'ai tout appris à sescôtés »- « j'ai de la chance d'aussi apprendre beaucoup avec Laurent Fabius dans le Ministère des Affaires Étrangers »- « je pense oui, c'est un métier que s'apprendre [la communication politique]. Moi je suis un cas atypique. Jecrois que c'est un métier qui s'apprend à l'école. Puisque ça s'apprend par l'expérience »- « aujourd'hui il y a des très bonnes écoles en communication, de formation universitaire, des écolésspécialisées. Et je crois quant au contenu, des embauchés professionnels qui se développent, c'est un secteur oùil y a de plus en plus de formation et de conquête d'excellence »- « être engagé politiquement, je pense que ça n'apporte absolument rien. En revanche, comprendre le mode defonctionnement des institutions politiques, du champ politique, oui. Le fait d'avoir été militant peut y aider, maisce n'est pas une condition nécessaire et suffisante »- « Donc aujourd'hui, quelqu'un qui travaille pour le domaine de la communication politique, doitnécessairement comprendre cela : comprendre comment fonctionne l'opinion publique, comprendre commentfont les médias. Il faut avoir cette compréhension entre la chronologie des médias et de l'information et puisl'importance déterminante du digital, qui est devenu un élement déterminant du fonctionnement des médias »
Qu'est-ce que ça veut dire « communication politique ?
- « la bonne communication politique c'est celle qui est à service du fond, qui aide d'une part que les décisionsdes politiques soient comprises, d'autre part, celle qui permet une relation entre les citoyens et le politique –compréhension, dialogue, écoute. Et troisièment celle qui parfois peut être xxx par l'action. Qui peut aiderqu'une décision ...s'imprime dans l'opinion publique, soit appropriée par les citoyens »- « je pense qu'on peut toujours d'aller plus loin dans la maîtrise des multicanaux d'information, la connaissancedes attentes des personnes, la circulation de l'information. Ce sont de choses qu'on ne sait pas, de quoi parlentles gens dans leur quotidien, comment l'information circule, au sein d'un groupe, dans la famille, les villages, legroupe social. »
138















































































































































![« Webjournaliste : une identité fragile dans un contexte de mutations professionnelles »,(Lien) (avec A. Carbonnel), 22è congrès de l’AGRH, Marrakech. [actes en ligne] octobre](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631c5faba1cc32504f0c735d/-webjournaliste-une-identite-fragile-dans-un-contexte-de-mutations-professionnelles.jpg)