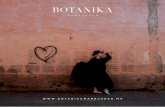« Webjournaliste : une identité fragile dans un contexte de mutations professionnelles »,(Lien)...
Transcript of « Webjournaliste : une identité fragile dans un contexte de mutations professionnelles »,(Lien)...
1
WEBJOURNALISTE : UNE IDENTITE FRAGILE DANS UN CONTEXTE DE MUTATIONS
PROFESSIONNELLES Anne Carbonnel CEREFIGE, Université de Metz & Arnaud Mercier CREM, Université de Metz
Contact : Anne Carbonnel, IUT de Metz, Ile du Saulcy, 57045 Metz Tél : 03 87 31 57 84 . Fax : 03 87 31 51 72 [email protected]
Résumé : Sous l’effet conjugué des évolutions technologiques et sociales, le journalisme se transforme, par une remise en cause des modèles économiques, stratégiques et organisationnels. Aux modalités d’écriture traditionnelles se rajoutent celles offertes par le multimédia (image, son, vidéo) ; la production temporelle unilatérale de l’information se complexifie par la gestion des commentaires en ligne ; la rapidité et la diversité des sources d’information peuvent être une opportunité mais aussi une menace pour la qualité de l’information produite.
Dans un tel contexte de mutations professionnelles, il convient d’accompagner au mieux les transformations du métier de journaliste dans la mesure où tous ces changements accroissent les sources de pression sur les acteurs et sont donc potentiellement porteurs de risques (notamment psychosociaux) pour la qualité de vie au travail, comme pour la performance du travail. Une redéfinition du rôle attendu du journaliste émerge donc, se traduisant par de nouvelles attentes en termes de compétences.
Peu de recherches en sciences de gestion se sont penchées sur l’étude de ce secteur d’activité, aussi notre contribution propose-t-elle d’apporter quelques éclairages sur les mutations qui sont à l’œuvre et leur impact sur la « »dynamique identitaire globale» » des webjournalistes.
Après un rappel des caractéristiques du cadre d’analyse mobilisé, nous proposons une analyse des fragilités de l’offre pour la «dynamique identitaire globale» dont semblent porteurs ces changements à l’appui d’une revue de l’état de l’art ; les premiers éléments de repérage de la demande de cette population sont par la suite analysés à partir d’une enquête récente identifiée dans la littérature ; nous terminons par quelques suggestions pour accompagner les transformations identitaires.
Mots clés : mutations professionnelles - webjournalisme – identité
2
WEBJOURNALISTE : UNE IDENTITE FRAGILE DANS UN CONTEXTE DE MUTATIONS
PROFESSIONNELLES
Résumé
Sous l’effet conjugué des évolutions technologiques et sociales, le journalisme se transforme, par une remise en cause des modèles économiques, stratégiques et organisationnels. Aux modalités d’écriture traditionnelles se rajoutent celles offertes par le multimédia (image, son, vidéo) ; la production temporelle unilatérale de l’information se complexifie par la gestion des commentaires en ligne ; la rapidité et la diversité des sources d’information peuvent être une opportunité mais aussi une menace pour la qualité de l’information produite.
Dans un tel contexte de mutations professionnelles, il convient d’accompagner au mieux les transformations du métier de journaliste dans la mesure où tous ces changements accroissent les sources de pression sur les acteurs et sont donc potentiellement porteurs de risques (notamment psychosociaux) pour la qualité de vie au travail, comme pour la performance du travail. Une redéfinition du rôle attendu du journaliste émerge donc, se traduisant par de nouvelles attentes en termes de compétences.
Peu de recherches en sciences de gestion se sont penchées sur l’étude de ce secteur d’activité, aussi notre contribution propose-t-elle d’apporter quelques éclairages sur les mutations qui sont à l’œuvre et leur impact sur la « »dynamique identitaire globale» » des webjournalistes.
Après un rappel des caractéristiques du cadre d’analyse mobilisé, nous proposons une analyse des fragilités de l’offre pour la «dynamique identitaire globale» dont semblent porteurs ces changements à l’appui d’une revue de l’état de l’art ; les premiers éléments de repérage de la demande de cette population sont par la suite analysés à partir d’une enquête récente identifiée dans la littérature ; nous terminons par quelques suggestions pour accompagner les transformations identitaires.
Mots clés
mutations professionnelles - webjournalisme – identité
3
Introduction
De nombreuses transformations organisationnelles sont à l’œuvre depuis les années 1980 dans la production, puis dans les années 1990 dans la conception et les services, avec pour impact la fragilisation des identités professionnelles, des collectifs de métier traditionnels (Sardas, 1997). Les métiers de l’information sont eux plus récemment touchés avec l’avènement du numérique. Sous l’effet conjugué des évolutions technologiques et sociales, le journalisme se transforme par une remise en cause des modèles économiques, stratégiques et organisationnels. Aux modalités d’écriture traditionnelles se rajoutent celles offertes par le multimédia (image, son, vidéo) ; la production temporelle unilatérale de l’information se complexifie par la gestion des commentaires en ligne ; la rapidité et la diversité des sources d’information peuvent être une opportunité mais aussi une menace pour la qualité de l’information produite.
Dans un tel contexte de mutations professionnelles, il convient d’accompagner au mieux les transformations du métier dans la mesure où tous ces changements accroissent les sources de pression sur les acteurs et sont donc potentiellement porteurs de risques (notamment psychosociaux) pour la qualité de vie au travail, comme pour la performance du travail. Une redéfinition du rôle attendu du journaliste émerge donc, se traduisant par de nouvelles attentes en termes de compétences.
Peu de recherches en sciences de gestion se sont penchées sur l’étude de ce secteur d’activité, aussi notre contribution propose-t-elle d’apporter quelques éclairages sur les mutations qui sont à l’œuvre et leur impact sur la « dynamique identitaire globale» des webjournalistes.
Le métier de journaliste qui hier était codifié, s’est profondément bouleversé tant du fait des nouvelles possibilités technologiques, que des nouvelles attentes des consommateurs d’information, que des nouveaux modèles économiques de la presse en ligne. Comment ces changements sont-ils vécus ? Sont-ils voulus ou subis ? Comment les journalistes traditionnels s’adaptent-ils aux nouvelles exigences de la presse en ligne ? Les changements affectent-ils leur identité professionnelle ? Quelles sont les modalités de formation mises en œuvre pour accompagner ces transformations ? Observe-t-on une « alternation »1(Berger, Luckmann, 1967) voulue ou subie ? Entre les anciennes représentations du métier et les nouvelles en cours de structuration, comment l’espace de construction des identités est-il investi ? Assite-t-on à une « conversion identitaire » (Dubar, 2000), est-on dans un « no man’s land du sens (Sainsaulieu, 1977) ou bien est-on dans une co-construction de l’identité professionnelle, résultat de l’interaction entre l’offre et la demande identitaire ?
La question principale que nous étudions ici est donc celle de l’équilibre identitaire des webjournalistes dans le contexte des mutations qui sont à l’œuvre.
Pour répondre à cette question, le cadre d’analyse de la « dynamique identitaire globale » (Sardas, 1994) nous apparaît pertinent. Après avoir présenté l’impact du numérique sur le journalisme et le cadre théorique de l’étude (1) une revue de littérature donne lieu à l’analyse des fragilités de l’offre identitaire dont semblent porteurs ces changements (2) ; les premiers éléments de repérage de la demande identitaire de cette population sont par la suite relevés à partir d’une récente enquête identifiée dans la littérature (3) ; nous terminons par quelques suggestions pour accompagner les transformations identitaires (4).
1 Fait de devenir autre
4
1. Un impact du numérique sur le journalisme : le risque de fragilisation des identités de métier, approche par la « dynamique identitaire globale » de l’acteur
Avec Internet, le journalisme connait de profondes mutations que nous nous attacherons à présenter à partir d’une revue de littérature (1.1). Par ailleurs, le métier, notion qui apparaît polysémique souvent associée à la profession dans l’état de l’art (Piotet 2002 ; Osty 2003) comme aux compétences, recouvre néanmoins des sens distincts qui seront précisés, de manière à présenter le cadre théorique des liens entre métier et identité des acteurs (1.2). La dynamique identitaire globale de l’acteur, approche retenue pour cette étude sera alors développée (1.3). 1.1 L’impact du numérique sur le journalisme Internet crée un contexte où les logiques d’organisation du travail sont à la valorisation d’un journalisme polyvalent et à la mise en place de nouvelles coopérations professionnelles. L’œuvre journalistique sera de plus en plus une création simultanée sur différents supports ou utilisant différentes ressources. Si la base du métier de journaliste reste exactement la même, le webjournaliste doit devenir un homme-orchestre, capable de maîtriser les différentes écritures journalistiques et les penser dans leur complémentarité. De plus, les nouvelles écritures et mises en forme induisent une acquisition de compétences nouvelles pour les journalistes traditionnels, avec des réaménagements organisationnels (fonctionner avec deux rédactions séparées ou au contraire fusionner désormais des rédactions qui étaient au départ séparées ; spécialiser des journalistes dans le web ou au contraire exiger de chacun qu’il sache passer aux écritures numériques, etc.). Une littérature déjà conséquente permet d’éclairer ces évolutions. Les travaux sur le journalisme en ligne ont débuté dès les années 1990 mais se sont surtout développés dans les années 2000. Les premières études sont marquées par une vision utopiste euphorique et enthousiaste, faisant des nouvelles technologies un puissant ferment a priori de renouvellement de la démocratie, de la gouvernance et du journalisme. Des écrits à caractère parfois prophétiques annonçaient la transformation complète des médias d’information et/ou du journalisme, (Heinonen, 1999), la fin des contraintes des vieux médias (Pavlik, 2001) voire la mort de la presse payante au profit d’une information renouvelée, en ligne, gratuite et participative (De Rosnay, Revelli, 2006). La perspective fut souvent sous-tendue par une vision déterministe des technologies, engageant l’analyse vers des théories des effets des technologies sur l’information et les médias. Mark Deuze a proposé très tôt (1999), un panorama des écrits sur la question, comme Barry Wellman un peu plus tard (2004) ou encore Domingo (2005) ou enfin Mitchelstein et Boczkowski (2009). Puis les travaux ont pris une tournure plus empirique, en appliquant notamment les acquis de la sociologie du journalisme et de la fabrication de l’information pour mettre en perspective le travail des journalistes dans les rédactions web avec ce que l’on peut connaître de leurs routines, de leur culture professionnelle, des relations entre les journalistes et leur hiérarchie au sein de groupes industriels de presse. Les méthodes de la sociologie du journalisme sont alors mises au service d’une étude plus détaillée, voire monographique, de la façon dont les nouvelles technologies sont introduites et utilisées dans diverses rédactions. (Cottle 2000 et 2003 ; Boczkowski, 2004 ou plus récemment, sur la rédaction d’un journal français, le Parisien (Cabrolié 2010). La notion même de professionnalisme est remise en débat à l’aune des évolutions du métier de journaliste, Aldridge & Evetts (2003) appelant à repenser le concept de professionnalisme.
5
Un auteur comme Jane Singer est représentatif de ce courant visant à questionner le journalisme en ligne à l’aune des concepts fondateurs de la sociologie du journalisme, étudiant « les défis à la notion de professionnalisme journalistique » (Singer, 2003), ou encore la « resocialisation des journalistes écrits dans des rédactions en convergence » (Singer, 2004). Convergence qui peut faire l’objet d’études spécifiques pour comparer les relations entre rédactions papier et rédaction web avec cinq critères de convergence : technologique, économique, sociale, culturelle et globale (Jenkins, 2006), étude qui montre que la convergence ne va pas de soi (Saltzis & Dickinson, 2008 ; Charon, 2010), qu’elle peut être « erratique » (Heinderyckx & Colson, 2008). Mark Deuze revisite « l’identité professionnelle et l‘idéologie des journalistes » (2005) et il avait déjà repris les notions de « compétences » et de « standards « dans un environnement numérique (1999). Yannick Estienne (2007) ayant conduit une étude des rédactions web, parle à cet égard d’un « professionnalisme hybride » opposant les « Travailleurs de l'information en ligne » à la figure du « journaliste professionnel ». On retrouve aussi toute une littérature sur les frontières mouvantes de la profession avec le journalisme amateur (Pignard-Cheynel, 2010) ou citoyen (Ruellan, 1997 et Tredan 2007) et les animateurs de weblogs (Le Cam, 2006), ou encore l’émergence des blogs de journalistes (Matheson, 2004). De tels défis induisent des attitudes, adaptations et réactions différentes, tant individuelles que collectives, qui fait que le webjournalisme se cherche encore (Pélissier, 2003). Les derniers écrits insistent donc sur la dialectique entre « transformations et continuités » (Meikle, Redden, 2011) ou entre « tradition et changement » (Mitchelstein, Boczkowski, 2009) que sur une rupture radicale. François Demers (2007) évoque une dialectique similaire : « les nouvelles technologies contribuent, en matière de journalisme, à désunir ce qui avait été assemblé et qui constituait les formules qui se sont révélées gagnantes du milieu du XIXe siècle à la fin du XXe. En même temps, poussés par les changements techniques, les acteurs tâtonnent, innovent et recherchent de nouvelles combinaisons d’éléments capables de durer. Une étude récente sur le bi-média souligne les réflexions nécessaires auxquelles doivent se livrer les gestionnaires de médias quant aux liens entre leur marque, leur territoire et leur identité de manière à gérer leur croissance sur le bi-média et la concevoir en complémentarité plutôt qu’en concurrence (De Barnier B. Augey D., Jammot A., 2011) Finalement, déstructuration et restructuration vont de pair dans les mutations qui sont à l’œuvre dans la presse en ligne. Dès lors, quels peuvent en être les impacts sur l’identité des acteurs ?
1.2 Le métier et ses impacts sur l’identité des acteurs
L’identité peut se définir comme « un ensemble de critères, de définitions d’un sujet et un sentiment interne (…) d’unité, de cohérence, d’appartenance, de valeur, d’autonomie et de confiance organisés autour d’une volonté d’existence » (Muchielli, 1986). L’identité dans la littérature apparaît comme un concept fécond pour de nombreux travaux dans différentes disciplines (philosophie, psychologie, sociologie) autour des problématiques de la structuration et des transformations identitaires (le même ou l’autre) des dimensions individuelles ou collectives, des représentations objectives ou subjectives, des identités pour soi ou pour autrui, de la conformité ou la différenciation, des identités attribuées ou revendiquées, héritées ou construites. Dans le cadre de cette communication, le propos est centré sur l’identité sociale et plus particulièrement professionnelle, conception de soi au travail, mettant en jeu un système complexe de relations entre identité personnelle et identifications collectives (Dubar, 1994).
La profession recouvre quatre sens d’un point de vue terminologique selon Dubar et Tripier, (2005) qui se livrent à l’analyse de définitions énoncées dans trois dictionnaires : le Littré, le
6
Robert et le Larousse. Le premier sens renvoie au fait de déclarer publiquement ses croyances (politiques ou religieuses par exemple) ou une vocation ; dans un deuxième sens, la profession réside dans l’exercice d’un métier rémunérateur ; le troisième sens s’attache à la fonction ou la position occupée par une personne dans une organisation donc sur l’organigramme ; dans un quatrième sens il s’agit d’un métier commun à un groupe de personnes, sens qu’il convient de retenir pour notre étude. La profession inclut donc quatre sens : identitaire (l’identité subjective se construit au travers des déclarations et visions du sens, des missions et du rapport à l’activité de travail) ; un sens économique (l’activité génère un revenu), un sens organisationnel (l’individu occupe une position dans une organisation), et un sens social, d’appartenance à une communauté caractérisée par des savoirs communs. La dimension collective est ici déterminante de la profession ; la corporation ou le communautarisme, caractérisent un groupe social donné adoptant des pratiques homogènes qui répondent à une demande sociale et comme telle légitimées, lui accordant de fait le statut de profession (Osty, 2003). Dans ce sens précis, profession et métier peuvent donc être considérés comme synonymes. Le métier est conceptualisé dans les approches sociologiques, en lien d’une part avec la construction des catégories sociales et d’autre part avec l’identité de métier, c'est-à-dire l’identité collective partagée par tous les acteurs exerçant le même métier (Dubar, Tripier, op.cit.). Deux logiques transversales président la conceptualisation des catégories sociales des métiers : la première transversale renvoie aux appellations du métier (métier, branche, institutions comme par exemple agriculteurs, profession libérale, artisan etc.) la seconde verticale, renvoie à la qualification (cadre, profession intermédiaire, ou exécution). En ce qui concerne l’identité de métier, il apparaît que c’est moins le niveau de qualification que l’apprentissage, l’expérience et l’appartenance à un groupe professionnel qui définissent l’identité de métier. L’identification à l’activité et au collectif d’appartenance repose par conséquent sur la compétence. Cette dernière apparaît ainsi indissociable de la conceptualisation du métier et des identités de métier. En témoigne la définition du métier comme « un ensemble de compétences directement applicables par un individu ou par une firme » réclame des précisions selon : « trois approches complémentaires (…) : le métier individuel, relié au concept de compétence individuelle ; la compétence de l’entreprise identifiée comme son ou un de ses métiers ; une vision plus sectorielle, marquée par les syndicats professionnels, et que l’on pourrait rapprocher de la notion de filière. » (Boyer, Scouarnec, 2002) Le rôle joué par le métier dans la structuration identitaire est également souligné dans la définition du métier de Sire (1999), selon lequel le métier désigne « l’ensemble des emplois qui dans l’organisation, sont caractérisés par une même finalité et une même technicité (…) le métier est au coeur de l’identité professionnelle, tant pour l’entreprise que pour l’individu ». Le métier permet à l’entreprise de se situer par rapport aux autres, tandis qu’il apporte à l’individu un statut professionnel. Exercer un métier, revient à s’inscrire dans une filière professionnelle, où les individus peuvent accéder à différents degrés de responsabilités et de compétences, ce qui finalement contribue à la structuration identitaire des acteurs. La structuration des identités professionnelles est abordée dans la littérature selon deux approches : fonctionnalistes et interractionnistes. Pour les fonctionnalistes (héritiers de Parsons) la profession se différencie de la simple occupation, par la réponse qu’elle apporte à une demande sociale. Selon cette approche, cette réponse est le fruit d’une formation intellectuelle spécialisée, posture contre laquelle s’inscrivent les interractionnistes. Ces derniers considèrent en effet avec un intérêt égal toute activité de travail, valorisant ainsi les
7
professions. Tout groupe professionnel dépend des trajectoires biographiques de chaque membre qui le compose, ces trajectoires étant elles mêmes en interaction avec l’environnement social dans lequel elles s’inscrivent. Il en résulte une dynamique interactionnelle centrale, objet d’étude des interactionnistes. A la différence du fonctionnalisme qui met l’enjeu sur l’organisation sociale, l’approche interactionniste est pertinente pour notre étude dans la mesure où elle se focalise sur les professions, pour les considérer comme des formes d’accomplissement de soi (Dubar et Tripier, op.cit.). Par ailleurs, ce courant distingue l’identité pour soi ou identité personnelle (significations que l’acteur donne à sa personne, qui le rendent singulier vis à vis d’autrui) de l’identité sociale ou identité pour autrui (significations sociales liées à un groupe d’appartenance) et dans le contexte organisationnel l’identité de rôle (ou rôle attendu de la part d’un acteur dans une organisation (Mead, 1934 ; Brewer, 1991 ; Hogg, Terry, 2000, Ashforth 2001). L’accent est mis alors sur la question des savoirs. Le rôle joué par les compétences dans le métier est en conséquence là encore fondamental. Finalement on retiendra de cette revue de littérature, que l’impact d’Internet sur le métier de journaliste se caractérise par de profondes transformations qui posent la question de l’évolution du métier. On assiste ainsi à l’émergence de nouvelles logiques professionnelles définies comme de « nouvelles combinaisons de connaissances, de compétences et de caractéristiques de champs professionnels autrefois considérées comme distinctes, exprimant de nouveaux rapports à l'organisation et au marché du travail. » (Pichault et al. 2002). Dès lors, pourrait-on assister à l’instar des phases traversées par les métiers de l’informatique étudiés par les auteurs, à une fin des journalistes au profit d’un journalisme communautaire partagé avec les usagers, les blogers, à une « re-spécialisation sous l’effet de la convergence des usagers », à l’éclatement des frontières organisationnelles et l’externalisation des compétences ou à leur internalisation basée sur une gestion spécifique et distinctive productrice d’une forte valeur ajoutée ? Ces questions ouvrent la voie de notre point de vue à de nombreux travaux en prospective des métiers, « démarche d’anticipation des futurs possibles en termes de compétences, d’activité, de responsabilités d’un métier (…) de manière à imaginer les possibles savoirs, qualifications, expersies ou savoir faire professionnel, comportements et savoir être, qui seront demain les plus à même de servir l’individu et l’orgnaisation » (Boyer, Scouarnec, 2009). En effet, les évolutions significatives économiques, technologiques, organisationnelles qui sont en cours créent finalement de nouvelles règles du jeu du métier, notamment en termes de nouvelles compétences stratégiques, organisationnelles, collectives, individuelles qui par conséquent représentent autant de facteurs de transformations des identités. Comme nous le verrons dans les lignes suivantes, la dynamique identitaire globale de l’acteur, cadre théorique retenu pour notre étude, mobilise également la compétence dans l’une des dimensions structurantes des identités : le savoir ou maîtrise cognitive de l’activité.
1.3 La « dynamique identitaire globale » de l’acteur
Des crises identitaires professionnelles ont été identifiées dans la littérature tant sous l’effet des mutations de l’emploi que celles du travail (Dubar, 1991). Les transformations qui sont à l’œuvre dans l’univers journalistique tendent à opérer un brouillage des repères professionnels et en conséquence à bouleverser les catégories identitaires qui hier faisaient référence. La crise identitaire est porteuse de risques psychosociaux significatifs (Dubar, op.cit.) aussi l’accompagnement des transformations et une certaine vigilance s’imposent-ils de notre point de vue, justifiant l’étude des mutations de l’identité professionnelle des webjournalistes. Nous présentons dans les lignes qui suivent le cadre d’analyse mobilisé.
8
« La dynamique globale de l’acteur » (Sardas, op.cit.), résulte de l’interaction des dynamiques des connaissances, du statut et de l’investissement subjectif dans le travail ; ce cadre nous apparaît pertinent pour étudier les équilibres identitaires de webjournalistes dans la mesure où il procède au croisement de l’offre identitaire organisationnelle et d’autre part, la demande identitaire des individus.
Conjuguant les apports psychanalytique, psychopathologique et sociologique, Sardas propose un cadre d’analyse intégrateur des investissements subjectifs de l’individu au travail et de la dynamique identitaire qui en résulte. Des travaux de Freud, deux liaisons actives dans le psychisme de l’individu sont mobilisées ; plaisir-savoir et plaisir-pouvoir, exprimés dans la pulsion d’apprentissage (générant le plaisir de réussir) et la pulsion d’emprise (conditionnant le plaisir procuré par la maîtrise de la relation aux autres). Des apports de la « psychodynamique du travail » (Dejours, 1990) il retient notamment « la résonnance symbolique » que permet le travail lorsqu’il donne l’occasion de rejouer un scénario similaire à celui de la souffrance initiale cristallisée dans l’enfance, pour la résoudre au moyen de l’imagination et la créativité dans le contexte professionnel. Des approches sociologiques, c’est notamment « la dualité de l’identité sociale » (Dubar, 1991) qui est mobilisée, résultat de la confrontation entre « l’identité pour autrui » et « l’identité pour soi ». Il en découle une structuration tantôt problématique tantôt favorable de l’identité, résultat de la rencontre entre l’offre identitaire organisationnelle et la demande identitaire propre aux individus.
Le cadre d’analyse intégrateur de la « dynamique globale identitaire de l’acteur » se caractérise par le renforcement mutuel (interactions) de trois dynamiques partielles : savoir, pouvoir, plaisir. La première renvoie à la maîtrise cognitive de l’activité, c’est à dire aux connaissances préalablement acquises, comme à celles acquises au cours de l’évolution de l’activité professionnelle, et pouvant être effectivement mises en œuvre. La deuxième concerne la reconnaissance par les autres acteurs (pairs, hiérarchiques, subordonnés) du rôle joué par l’acteur, mais également du statut (formel ou informel) qui lui est accordé dans l’organisation et de la valeur dont celui-ci est porteur (ou pas) ; sont ici en cause l’ensemble des relations stratégiques de l’acteur lui permettant d’assoir son pouvoir d’action et se traduisant par une reconnaissance externe de son rôle. La troisième renvoie au plaisir que retire l’individu de son travail, à la résonnance symbolique que ce dernier génère, en lien donc avec le contenu du travail et au sens que revêt l’exercice professionnel pour l’individu, qui se traduit en conséquence par l’investissement subjectif dans le travail.
Si l’une de ces trois dynamiques partielles est bloquée, la dynamique globale ne peut être opérante ; on assiste en effet moins à des mécanismes compensatoires qu’à un processus aggravant qui conduit au blocage des autres dynamiques.
Par ailleurs, il convient de prendre en compte dans l’étude de la «dynamique identitaire globale» l’adéquation entre l’offre organisationnelle et la demande identitaire (Sardas, 2008). Les organisations de par leurs caractéristiques organisationnelles et managériales offrent en effet un système de rôles qui rencontrent les attentes individuelles des acteurs en termes de statut, de contenu du travail et de perspectives pour la carrière notamment.
Nous observerons dans les lignes qui suivent à travers une revue de la littérature théorique et empirique certaines fragilités sociales et organisationnelles pour la « dynamique identitaire globale » de l’acteur, dans l’état actuel des mutations de la presse en ligne.
9
2. Evolutions de la profession et fragilités de l’offre identitaire Les évolutions structurelle (2.1) comme celles qui découlent de l’avènement du multimédia (2.2) sont porteurs de risques pour la dynamique identitaire des webjournalistes, comme nous nous attachons à le souligner dans les lignes qui suivent.
2.1 Evolution structurelle de la profession : impacts sur les dynamiques du pouvoir et du savoir Les journalistes sont marqués depuis longtemps par une identité incertaine que l’on peut rapprocher d’un « professionnalisme du flou » (Ruellan, 1993). Le « flou » étant moins « flottement incontrôlé des conceptions et des pratiques », que marges de manœuvre entre différentes conceptions du métier et diverses façons de le mettre en œuvre, dès lors qu’au-delà des compétences techniques (écriture, mise en sens) il existe aussi des cadres d’action plus incertains et subjectifs, comme le choix de « l’angle », base du reportage. L’analyse de ce qu’il nomme « procédés angulaires » révèle qu’ils sont bien peu codifiables. Nous verrons dans les lignes qui suivent comment l’évolution structurelle de la profession : stratégies françaises d’institutionnalisation de la profession (2.1.1), éclatement de la profession (2.1.2) et l’avènement de logiques managériales (2.1.3) ont contribué à fragiliser les dynamiques du pouvoir et du plaisir.
2.1.1 Des stratégies françaises d’institutionnalisation…à la précarité de certains statuts : fragilité de la dynamique identitaire du pouvoir
En France, pour limiter ce « flou », notamment à cause du discrédit dont a souffert le métier face à la corruption de la presse française des années 1920, le Syndicat national des journalistes (SNJ) a lutté et obtenu en 1935 un statut professionnel des journalistes, avec une commission ad hoc qui délivre une carte qui donne droit à certains avantages spécifiques (Mercier, 1994). Procédure qui garantit a priori la reconnaissance exclusive d’une compétence spécifique justifiant le monopole réglementé d’un travail. Cette loi n’a pas réglé pour autant tous les problèmes. Avec l’émergence de l’audiovisuel, les lieux d’exercice du métier se sont multipliés (radio, télévision, Internet) ; les façons de vivre son métier se sont éclatées de par les statuts divergents (pigiste régulier ou précaire face aux titulaires d’un CDI, jeunes entrants passant par un sas qui s’allonge de piges et de CDD) ; même les compétences mobilisées peinent à pouvoir servir de maître étalon de la profession, tant il est vrai que celles déployées pour un poste de secrétaire de rédaction ont peu à voir avec celles requises pour un grand reporter de télévision. Ecrire un article de fond de décryptage n’est pas de même nature qu’un court reportage sonore de 50 secondes en radio.
Si l’institutionnalisation de la profession a contribué à la structuration sociale de l’identité professionnelle, il en va différemment de la reconnaissance organisationnelle liée au statut. Ainsi sous l’angle de la dynamique identitaire partielle du pouvoir, la multiplication des piges et des CDD pour les jeunes entrants dans la profession, comme pour la suite pour la carrière, le statut de pigiste régulier, comme celui des correspondants de presse dont on peine parfois à obtenir une clarification du rôle joué par les rédaction dans la relation à leur égard, conduit au constat d’une fragilité significative pour l’identité des acteurs concernés par ces pratiques statutaires.
10
2.1.2 Une profession éclatée, une dynamique du pouvoir fragilisée
Dès 1993, Charon évoquait, suite au panorama dressé par les statistiques en provenance de la commission d’attribution de la carte professionnelle de journaliste, un « paysage morcelé », une « photo de famille… éclatée ». Constat toujours d’actualité dix ans après, face à « l’éclatement du métier ». Entre 1970 et 2000, en France, mais le phénomène se retrouve dans tous les pays occidentaux, on assiste à une explosion du nombre de travailleurs estampillés officiellement journalistes : de 11 943 on passe à 31 903. « Mais cette explosion des embauches a rimé avec diversification des situations et donc éclatement complet des conditions de travail, des parcours de formation et d’activité, des préoccupations quotidiennes et même des valeurs et des représentations ». Par une de ses ruses dont l’histoire est friande, la victoire sociale du métier de journaliste s’est traduite par son affaiblissement interne, la croissance ayant pour pendant l’éclatement.
Ainsi, la multiplication des embauches pouvait apparaître comme un signe de reconnaissance de la profession. Mais la réalité montre cependant que là encore la dynamique identitaire du pouvoir ne peut être opérante, du fait de l’éclatement des conditions de travail et des parcours de formation qui traduisent moins la reconnaissance professionnelle que son absence, du point de vue managérial. La profession de journaliste s’est donc retrouvée une nouvelle fois dans son histoire en crise identitaire. Crise aggravée par l’introduction des logiques se disant managériales, poursuivant bien souvent des finalités purement marketing, dans une activité qui s’y voulait réfractaire.
2.1.3 Logiques managériales : déstabilisation professionnelle, blocage des dynamiques du pouvoir et du plaisir
A partir des années 1980, les industries médiatiques ont imposé aux journalistes un nouveau défi, facteur de tension : l’introduction de logiques de management jusque là peu usitées en rédaction. L’essor des médias grand public audiovisuels et la constitution de grands groupes de communication intégrés, dans lesquels la presse et l’information n’étaient qu’un maillon au bout de la chaine économique, ont contribué à faire entrer dans les rédactions le « managérialisme » (Padioleau, Blanchot, 2003) au premier rang desquels on trouvera le marketing (qui doit être intégré dans les choix rédactionnels pour faire vendre) et le contrôle de gestion (qui conduit à voir s’affaiblir la figure du vieux journaliste maison qui finit patron, au profit de gestionnaires ou de banquiers). Ce climat de gestion professionnel induit la montée d’un esprit concurrentiel, « la compétition généralisée » et le « stratégisme », et on observe que « les acteurs individus ou firmes règlent sans cesse les conduites au vu des comportements réels ou anticipés des autres joueurs, collègues ou concurrents » (p.69) ; induit « le déploiement du rationalisme économique » et la recherche du profit (aux Etats-Unis, même le secteur de la presse, pourtant en crise est sujet à des attentes de taux de rentabilité à 10% en faveur des actionnaires d’où des plans de licenciement de journalistes pour rester assez rentable) ; induit l’abaissement des « attachements et des loyautés durables aux professions, des journalistes lorgnent vers la communication, des firmes sont perçues comme opportunistes, favorables à l’externalisation d’activités » (p.68) et la pression des annonceurs et du marché se font plus fortes pour faire franchir aux journalistes la barrière entre information, bien public au service du public, et la communication, bien privé au service du profit de ceux qui s’y livrent.
L’avènement du « culte de la performance » (Ehrenberg, 1991) avec pour pendant « les coûts de l’excellence » (Aubert, de Gauléjac, 1991) se traduit ainsi dans la presse non seulement par un blocage de la dynamique du pouvoir (avec notamment les licenciements) mais également
11
par celui de la dynamique du plaisir. Les logiques de performance ne font pas toujours en effet bon ménage avec celles du plaisir, se traduisant bien souvent par l’apparition de souffrances au travail et d’invalidation de soi (Dubar, op.cit.).
A peine ces changements opérés, l’avènement du journalisme en ligne représente une nouvelle menace pour les dynamiques identitaires.
2.2 Nouveaux défis pour la profession à l’heure du numérique, nouvelles fragilisation des dynamiques identitaires Aujourd’hui, l’information comme la profession font face à de profonds bouleversements qui mettent en cause bien des aspects du métier et de la relation aux audiences, au point que l’on peut diagnostiquer l’essor « d’un nouvel écosystème d’information »2 et un changement de « paradigme professionnel » pour les journalistes. « Un paradigme journalistique peut être défini comme un système normatif engendré par une pratique fondée sur l’exemple et l’imitation, constitué de postulats, de schémas d’interprétation, de valeurs et de modèles exemplaires auxquels s’identifient et se réfèrent les membres d’une communauté journalistique dans un cadre spatio-temporel donné, qui soudent l’appartenance à la communauté et servent à légitimer la pratique » (Brin et al. 2004). Comme à chaque période de changement de paradigme, les deux cohabitent un temps, l’un en déclin, l’autre en émergence et en fabrication progressive.
Examinons parmi les facteurs constitutifs de ces bouleversements ceux dont l’impact peut être considéré de notre point de vue comme significatif sur les dynamiques identitaires : montée de la culture de la gratuité (2.2.1), concurrence des journalistes amateurs (2.2.2), nouvelles compétences, course à l’innovation, incertitudes sur l’avenir (2.2.3), l’émergence de nouveaux métiers (2.2.4) et le changement de missions professionnelles (2.2.5).
2.2.1 Montée de la culture de la gratuité, fragilisation économique : des risques pour les dynamiques du savoir et du plaisir
La crise professionnelle se ressent face à la lente agonie d’une partie de la presse écrite payante, remplacée par des consommations d’information non payantes de la part d’usagers devenus très vite adeptes d’une culture de la gratuité constitutive de l’esprit du web 2.0 et importée dans un champ qui reposait sur un échange clair entre sélection et fourniture d’informations moyennant paiement direct ou acceptation d’un temps consacré à l’exposition de publicités.
Les journalistes en ligne sont donc amenés de facto à participer à l’émergence de nouveaux modèles d’équilibre économiques, non pas pour dégager des surprofits actionnariaux mais simplement pour vivre de leur métier en ligne et faire survivre leurs sites, surtout pour des médias nés en ligne. Cette nouvelle contrainte modifie les rôles attendus, ceux qui sont joués et les représentations qui en résultent ; un glissement s’opère des exigences de résultats techniques vers celles de résultats économiques. Les dynamiques du savoir comme du plaisir, peuvent être la cible d’altérations en conséquence, sous l’effet des transformations des modèles économiques qui sont à l’oeuvre.
12
2.2.2 Concurrence des journalistes amateurs et déprofessionnalisation : altération des dynamiques du savoir, du pouvoir et du plaisir
Avec l’avènement d’Internet, on a vu une nouvelle concurrence poindre : celle du journalisme participatif, où des citoyens profitent de la démocratisation de l’accès à un espace public de prise de parole pour s’affirmer comme eux-mêmes producteurs d’informations (Rebillard, 2010). Le célèbre et pionnier Ohmynews sud-coréen sert d’étendard à bien des expériences similaires de par le monde (Agoravox, en France par exemple). Dans une version plus allégée, le public intervient en déposant des commentaires ou en alimentant ses propres blogs plus ou moins spécialisés et en mettant sur des sites de dépôt photos et vidéos (Flickr, You Tube…) des documents de terrain inédits (de plus en plus réutilisés par les médias traditionnels lors des catastrophes notamment). Enfin, par sa propension à faire circuler dans ses propres réseaux, sociaux surtout, les particuliers interviennent dans la diffusion d’informations recueillies quelque part sur des blogs ou sur des sites d’information. Toutes ces potentialités révèlent un processus de « désintermédiation », où le journaliste n’est plus le producteur « naturel » et monopolistique de l’information, mais doit (re)trouver sa place dans l’espace public. Estienne (2007 : 217) va jusqu’à décrire ce processus comme une « déprofessionnalisation » à cause du « partage de compétences avec l’internaute », le journaliste subissant « la perte d’une partie de l’autorité rationnelle, pour reprendre la terminologie wébérienne, dont peut se prévaloir un professionnel du journalisme ».
Ainsi, au monopole succède le partage de la production de l’information entre journalistes et internautes. Dans cette redistribution des rôles informationnels sont mises en question les trois dynamiques identitaires. Premièrement une dynamique de savoir fragilisée : les compétences échappent en partie au journaliste. Deuxièmement la dynamique de pouvoir altérée sous l’effet d’une reconnaissance sociale diffuse. Troisièmement, fragilisation de la dynamique de plaisir, lorsqu’il s’agit de partager la paternité de la création, si non par procuration ou intermédiation.
2.2.3 Nouvelles compétences, course à l’innovation, incertitudes sur l’avenir : impacts sur la dynamique des savoirs, du pouvoir et du plaisir
Les journalistes voient émerger de nouvelles compétences qui peuvent aller jusqu’à se décliner en nouveaux métiers. C’est le cas du développement web et infographique, qui peuvent être très utiles à un journaliste pour jouer des plateformes de présentations numériques et enrichir ainsi la qualité graphique et visuelle de sa production en ligne. C’est vrai aussi des animateurs de communauté que la presse américaine a déjà mis en place depuis plus de deux ans souvent. Ils ont pour mission de fonder une communauté, d’aider à la diffusion dans le web profond des articles produits, d’identifier les attentes des publics qui s’expriment assez librement sur Internet. Est-ce à un journaliste de le faire ? Cela fait-il encore partie du métier ? La compétence requise est aussi de plus en plus multimédia et hypertexte, l’art devenant de savoir penser un reportage dans une logique « rich media » où chaque support s’enrichit et fait synergie, tout en enrichissant le contenu par des mises en liens avec d’autres contenus, offrant aux infonautes un chemin à parcourir dans une multitude d’informations potentielles, puisque sur Internet c’est « l’infobésité » qui règne en maître. Le webjournaliste peut donc devenir peu ou prou un homme-orchestre, un journaliste Shiva, (multi-bras avec une caméra, un micro, un appareil photo, un stylo) capable de générer par soi-même un contenu multimédia et en tirer profit par une mise en forme en synergie, réellement rich media. Joannès (2007) parle alors d’un « métier à reconfigurer » et fait « un éloge de la polyvalence », évoquant « un indispensable décloisonnement » et poussant un cri enthousiaste : « vive le bricolage informationnel », avec la prise en compte de nombreux
13
logiciels et l’apprivoisement de multiples possibilités techniques toujours plus larges et variées.
On peut par ailleurs décrire l’histoire récente du journalisme en ligne comme une course à l’innovation, aux voies incertaines et aux objectifs à atteindre loin d’être encore stabilisés. « Quiconque a vécu les années de pionniers de l’information en ligne peut en témoigner : s’installer au premier rang revenait pour une équipe rédactionnelle à installer de nouvelles interfaces sur son site. Succession ininterrompue d’innovations : texte, puis texte avec image, puis portfolio d’images et ainsi de suite, animation, newsletter, forum, chat, bande-son, blog, vidéo… Tout s’ajoute et se combine dans cette panoplie qui s’est étendue à de nouveaux territoires en passant du texte vers l’audiovisuel, le multimédia et l’interactivité » (Fogel, Patino, 2005 :77). L’incertitude règne dans ce contexte. Les effets de mode sont présents. Les blogs de journalistes apparaissaient il ya dix ans comme l’avenir incontournable du journalisme et les directions incitaient leurs journalistes à en ouvrir, alors qu’aujourd’hui le soufflet retombe et que les réseaux sociaux sont perçus comme le nouvel avenir, en attendant peut-être (sans doute ?) d’autres innovations, d’autres nouvelles pratiques sociales à adopter, auxquelles s’adapter. Défis qui imposent de s’autoformer en permanence, en restant en veille sur les innovations, ou de se faire accompagner par des politiques efficaces et réactives de formation.
Les pratiques diffèrent d’une rédaction à l’autre sur les modalités d’acquisition comme de valorisation de ces nouvelles compétences. Une des rares enquêtes réalisées à ce jour sur les pratiques de valorisation rend compte de la disparité des pratiques, mais dégage néanmoins des tendances communes (Carbonnel, Dollander, Sebbah, 2011). Les formations sont ainsi majoritairement de l’auto-formation. Entre le désir de certains journalistes d’acquérir de nouvelles compétences et l’impossibilité d’autres de les mettre en œuvre, il apparaît que les actions de formation soient déléguées aux intéressés sur leur temps personnel, ou en ayant recours à l’aide de collègues, tandis que dans d’autres rédactions ces compétences ne trouvent pas matière à s’actualiser. On assisterait ainsi à un certain « flou » de la GRH, ayant pour conséquence un risque pour la dynamique des savoirs. Dans un tel contexte, la dynamique du plaisir peut être également fragilisée. En effet la pulsion d’emprise visant à maîtriser une nouvelle technique, une nouvelle compétence peut rapidement s’émousser sous l’effet des évolutions successives qui caractérisent la demande de compétences : la maîtrise d’un blog d’hier est devenue caduque aujourd’hui, supplantée par la gestion et l’animation des réseaux sociaux, en attendant la nouvelle mutation des supports ou contenus informationnels demain. Dans un tel contexte d’accélération de la demande de compétences, la sollicitation récurrente des dynamiques du savoir est-elle possible, est-elle raisonnable est-elle durable, sans avoir pour conséquence des impacts négatifs sur la dynamique du plaisir ?
2.2.4 Émergence de nouveaux métiers et fragilisation identitaire
Les compétences et innovations sont telles parfois que la définition même du métier de journaliste est remise en cause, par l’émergence de fonctions qui méritent la création de nouvelles appellations et dont on peut se demander s’ils sont encore des métiers du journalisme. Ce sont des métiers au carrefour entre plusieurs univers professionnels dont la terminologie est loin d’être encore stabilisée (« webmestre éditorial », « chef de projet éditorial », animateur éditorial de site d’information », « content manager », « news community manager », « gestionnaire de contenu d’information »…). Estienne (op.cit, pp. 105, 140) évoque à leur propos « des métiers hybrides et instables » et définit du coup le journaliste web comme « une spécialité à construire », « la question de l’identité des journalistes en ligne restant ouverte ».
14
Un tel processus fragilise les constructions identitaires professionnelles, entendues comme des pôles de stabilité dans les représentations et les attentes. Voilà d’ailleurs pourquoi, Dubar (1992) privilégie le concept de « forme identitaire ». Il s’agit du « produit d’une double transaction structurant la socialisation professionnelle des individus. La transaction ‘biographique’ renvoie au processus temporel de construction d’une identité sociale. La transaction ‘relationnelle’ ou ‘structurelle’ concerne les relations entre acteurs au sein d’un espace structuré par des règles et renvoie au processus de reconnaissance de l’identité professionnelle et à ses évolutions ». Ces formes identitaires ne sont pas des identités sociales établies, mais bien des « configurations sociales pertinentes » qui permettent justement de définir et d’identifier des catégories d’individus, lorsque « les catégories officielles deviennent problématiques » (p.523) ce qui est typiquement le cas pour les journalistes en ligne.
On assiste ainsi premièrement à une fragilisation de la dynamique du pouvoir en l’absence d’une adéquation entre les catégories officielles et les pratiques réelles qui émergent. Deuxièmement, la dynamique des savoirs est également mise en question du fait de la poly-compétence attendue dans l’exercice des nouveaux métiers qui émergent avec l’avènement du multimédia. Troisièmement, tantôt choisis tantôt subis, ces changements se traduisent par une mise en question de la dynamique du plaisir.
2.2.5 Changement de mission professionnelle, impact sur les dynamiques du pouvoir et du savoir
Comprendre et identifier les nouveaux usages d’information est la pierre angulaire du développement du journalisme en ligne. Axel Bruns, de la Queensland University of technology s’emploie à étudier les usages journalistiques à l’heure des changements numériques. Il propose l’idée d’un changement assez conséquent du modèle journalistique. Passant d’un rôle bien identifié de « gatekeeper » selon l’expression célèbre de David White en 1964, consistant à filtrer ce qui advient dans le monde vécu pour décider d’en faire ou non un article et lui accorder plus ou moins de place et de temps, le journaliste serait désormais amené à exercer un rôle de gatewatching. Il postule que les publics ont de plus en plus accès par eux-mêmes à des informations produites par des non journalistes et qu’ils aspirent à recouper eux-mêmes les informations issues des institutions (officielles ou médiatiques) dans un esprit de suspicion voire de contestation. Dès lors, ses observations en rédaction lui font dire qu’il y un déclin du gatekeeping au profit d’une posture nouvelle, « une forme de reportage et de commentaire des infos qui n’opère pas depuis une position d’autorité inhérente à la marque et à l’imprimé et à la propriété et au contrôle de flux d’information, mais fonctionne en mobilisant l’intelligence et le savoir collectifs de communautés dédiées afin de filtrer le flux d’informations, d’éclairer et débattre les sujets les plus saillants importants pour la communauté » (Bruns, Axel, 2008). Ce gatewatching consiste dès lors « à observer les nombreuses barrières à travers lesquelles un courant stable d’informations passe depuis ces sources et à mettre en lumière à partir de ce courant l’information celle qui est la plus pertinente à son intérêt personnel ou à l’intérêt d’une communauté élargie » (p.177). Par conséquent, plutôt que de publier un produit fini en synthétisant plusieurs sources le journaliste gatewatcher, rassemble des données éparses, donnant de la publicité (publicizing plutôt que publishing) à un fait et aux histoires qui l’accompagnent sur la toile. C’est donc la mise en place d’un « processus de produsage », les publics étant utilisés comme « une ressource dynamique, évoluée et en expansion » (p.178).
Ce changement de mission impacte la dynamique du savoir : nouvelles compétences à sélectionner, à mettre en lumière l’information la plus pertinente, le journaliste devient moins
15
producteur que sélectionneur de l’information. Ses effets sont également à considérer sur la dynamique du pouvoir : partageant la paternité de l’information, il devient intermédiaire ; peut alors être mise en question sa légitimité professionnelle, diluée dans la pluralité des sources d’informations éparses qu’il est conduit à trier pour mettre en exergue tel ou tel fait.
Finalement, tous ces facteurs de changements contribuent à fragiliser la «dynamique identitaire globale», du fait de leur impact sur une, deux ou sur ses trois composantes à la fois comme nous l’avons souligné. Sachant que le blocage d’une seule dynamique entraîne des répercussions sur les deux autres, notre propos était moins d’étudier les effets en chaîne de ces blocages que de les pointer au regard des mutations qui sont à l’œuvre dans l’univers journalistique.
3. Premiers éléments d’analyse de la rencontre entre la demande identitaire et l’offre organisationnelle Peu de travaux en sciences de gestion ont investi notamment en GRH le champ d’étude du webjournalisme. Notre positionnement s’inscrit dans le cadre du paradigme de la complexité (Morin, 1990), tant pour des raisons ontologiques, épistémologiques, méthodologiques et téléologiques. Deux raisons plus particulières en lien avec notre objet de recherche et notre démarche de chercheurs, justifient ce positionnement : le webjournalisme est un champ d’étude complexe, en plein bouleversement, aux contours encore flous donc mal cernés. Notre parti pris : laisser aux éventuelles contradictions pour extraire des connaissances. A l’exposé de la méthodologie (3.1) succèdent les résultats (3.2) et l’impact peu favorable que les pratiques de GRH semblent avoir sur les dynamiques du pouvoir (3.2) et du savoir (3.3).
3.1 Questionnaire et entretiens réalisés au sein des Webrédactions Afin de procéder au repérage de premiers éléments d’analyse de la rencontre entre la demande et l’offre identitaire, nous mobilisons une étude récente identifiée dans la littérature (Carbonnel, Dollander, Sebbah, op.cit.). L’enquête quantitative (65 observations) et qualitative (22 entretiens) réalisée par les auteurs porte sur quatorze rédactions de médias de la presse nationale et régionale, mis en ligne et nés en ligne : Le Post, Le Monde.fr, Owni, Arrêts sur image, Marianne2.fr, Bakchich, Rue89, Le Républicain lorrain, Le Progrès, Le Dauphiné, le Figaro.fr, Libération.fr, France Bleu Lorraine Nord, Actualitté.
La méthodologie quantitative est caractérisée par l’admnistration en ligne du JDS (Hackman, Oldham 1980), modèle qui permet d’observer plus particulièrement l’impact de 5 caractéristiques du travail sur la satisfaction vis-à-vis de ce dernier. La polyvalence du JDS pour l’étude a permis de l’administrer à différents niveaux hiérarchiques dans l’organisation : représentations des encadrants (rédacteurs ou chefs d’agence) et des journalistes. L’équipe des auteurs, composée d’une journaliste et de chercheurs en gestion et information et communication a modifié en partie ce modèle pour l’adapter aux réalités de la pratique journalistique. Les variables étudiées sont les suivantes : caractéristiques du travail (identité, importance, variété des compétences et autonomie) ; états psychologiques (intérêt, responsabilité, connaissance des résultats) ; résultat (satisfaction vis-à-vis du travail). Les variables modératrices prises en compte sont la satisfaction vis-à-vis de la rémunération, et vis-à-vis de l’encadrement. Une échelle de Likert à quatre points d’ancrage a été utilisée pour la mesure des réponses. Par ailleurs, trois catégories de questions ont été intégrées dans le questionnaire. La première observe les représentations du passage au web (charge de travail,
16
acceptation du travail sur le web, enjeux personnels). La seconde porte sur les modalités de formation (mises en œuvre et souhaitées) pour l’avenir du métier. Et la troisième sur la clarté de la Direction quant aux adaptations à réaliser pour l’évolution du métier. La méthodologie qualitative repose sur l’administration de 22 entretiens réalisés entre juillet et novembre 2010. Ces derniers permettent d’aborder, sous un autre angle, les changements induits par le passage à l’information en ligne. L’étude avait pour but de circonscrire les évolutions des pratiques journalistiques, les appropriations ou rejets des changements induits par le passage en ligne de manière à souligner in fine l’éventuel chiasme entre ces pratiques et la représentation qu’en ont les journalistes et les directions. Deux types d’entretiens ont donc été réalisés et retranscrits intégralement par les auteurs auprès de professionnels exerçant dans des supports mis en ligne ou nés en ligne (médias MEL ou médias NEL, Mercier 2010) : un premier type d’entretiens semi directifs auprès de journalistes de MEL ou NEL et un second type d’entretiens semi directifs auprès de rédacteurs en chef, chefs d’édition, directeurs de MEL ou NEL. Les résultats présentés croisent les verbatims et les tendances quantitatives de l’enquête.
3.2 Des résultats plaidant en faveur d’une demande identitaire Les résultats quantitatifs font apparaître que la satisfaction vis-à-vis du travail effectivement réalisé est positive pour plus de 90 % des répondants. 85 % apprécient leurs tâches. En ce qui concerne les caractéristiques du travail, une personne sur trois déclare maîtriser l’ensemble du processus qui conduit à la publication de ses articles. Le travail réalisé apparaît donc comme un ensemble cohérent. Plus de 60 % des répondants estiment que leur travail a un impact significatif sur les lecteurs ; le travail apparaît donc important pour le bien-être d’autrui. Le multimédia exige de multiples compétences pour ¾ des personnes ; 90 % considèrent que leur travail mobilise des compétences toujours plus nombreuses et complexes. Plus de huit personnes sur dix s’estiment autonomes dans le choix de leurs articles et de leur réalisation. En ce qui concerne les états psychologiques qui résultent des caractéristiques du travail, 95 % des répondants estiment leur travail intéressant. Plus de 80 % se sentent responsables des bons ou mauvais résultats de leur travail ; on observe donc un sentiment de responsabilité élevé. Pour leur carrière, deux répondants sur trois estiment que le passage au multimédia représente une opportunité. 65% aspirent à utiliser les avantages offerts par les nouveaux outils, qui ne sont toutefois actuellement pas toujours accessibles dans les rédactions.
Les résultats qualitatifs mettent en exergue un clivage interne qui traverse la profession entre ceux qui pensent que le web est un facteur d’involution pour la profession et sa crédibilité et ceux qui défendent la thèse inverse, celle d’un progrès pour les journalistes. François Bonnet , directeur éditorial à Médiapart se dit ainsi consterné par ses confrères qui jettent le discrédit sur le journalisme en ligne, alors qu’au contraire, pense-t-il, il faut en faire un outil de relégitimation du métier qui peut servir à pérenniser son avenir. « Quand vous avez le patron du Nouvel Obs, qui a dit, le web c’est le tout à l’égout du journalisme, non seulement il est bête de dire ça, mais en plus il est fou ! Il est en train de se tuer lui-même…C’est exactement l’inverse qui est un train de se produire. C'est-à-dire que le web est le lieu du journalisme de qualité. Je m’explique. Sur le web, vous ne faites pas seulement un papier de 3 ou 4 feuillets, dans un jeu de contraintes de place. Vous faites un papier, vous pouvez donner tous les éléments de preuves, tout ce qui vient supporter votre enquête, c'est-à-dire que vous pouvez donner la vidéo, du son, tous les documents qui viennent à l’appui de ça. Vous pouvez donner en gros tout votre carnet de note. Vous pouvez donner tous les liens qui renvoient sur d’autres articles, d’autres enquêtes d’autres documents. Le web autorise un journalisme d’une qualité
17
infiniment plus grande que le papier. Je continue à écrire pour des journaux papier : c’est chaque fois une frustration. Voilà, le papier c’est un objet fini, qui est à plat, il y a une couche… Le web, c’est de l’infini, c’est de la profondeur, c’est du multicouches, c’est… Et donc ça va s’imposer ».
Ces premiers éléments pourraient plaider en faveur d’une demande identitaire significative du fait du contenu du travail perçu comme intéressant, mobilisant de nombreuses compétences, produisant un niveau élevé de responsabilité et de connaissance des résultats. Quelles sont en réponse à cette demande les offres identitaires organisationnelles ?
3.3 Encadrement et rémunération : des pratiques peu stimulantes pour la dynamique du pouvoir L’enquête quantitative permet d’identifier les pratiques d’encadrement et de rémunération comme peu stimulantes pour la dynamique du pouvoir.
Du point de vue de la reconnaissance, une première fragilité apparaît du fait d’une satisfaction vis-à-vis de l’encadrement majoritairement négative.
De même en ce qui concerne la rémunération, une personne sur trois se déclare insatisfaite ; plus d’une sur deux, lorsque qu’il s’agit des efforts fournis par rapport à la rémunération ; plus particulièrement, la reconnaissance des efforts consentis pour passer à l’écriture multimédia, qui fait apparaître 80 % de réponses insatisfaites.
Dans le schéma traditionnel de l’industrie de la presse, l’apport d’informations aux citoyens qui s’en remettent aux journalistes pour savoir ce qui se passe et avoir les informations qu’ils jugent utiles, justifie un paiement, le prix du journal, une redevance ou l’acceptation de coupures publicitaires. L’Internet a initié un cycle marqué au sceau de la gratuité, ne serait-ce que parce que les internautes s’informent entre eux. Du coup, l’arrivée de l’information professionnelle avec la reproduction pure et simple du schéma antérieur apparaît comme un idéal industriel inatteignable. Pour autant, la contradiction tient aussi au fait que l’information journalistique a un coût. Les sites d’information, qu’ils soient le fruit de médias ou de médias MEL, cherchent donc tous une martingale sur une palette qui va du tout gratuit avec publicité au quasi tout payant, en passant par l’accès partiellement payant ou encore la recherche de revenus annexes faisant le vivre le site par autre chose que l’information elle-même (petites annonces et e-commerce, formation professionnelle, prestation de service liée aux compétences internet acquises…). Mais la culture de la gratuité apparaît comme si constitutive du succès même d’Internet qu’il semble difficile d’imposer un modèle généralisé du tout payant. Et quand bien même cela serait possible, il faut alors offrir une information de qualité évidente et distinctive, il faut aussi maîtriser les fuites possibles au sein d’un tel dispositif (accès indirect via les moteurs de recherche, diffusion d’articles dans les réseaux sociaux via un abonné qui fait circuler un contenu payant, etc.). La gratuité peut mettre en péril la rémunération des journalistes salariés de ces sites d’informations, avec l’introduction de productions amateurs en plus (ou à la place ?) des produits journalistiques. C’est ce que dénonce Eric Marquis, secrétaire national du SNJ (syndicat national des journalistes) lors d’une journée d’étude à Lille en mai 2011 : « Sur Internet, l’espace est infini. Le modèle économique de l’info sur Internet est incertain. Ces deux caractéristiques amènent les éditeurs en ligne à promouvoir le « contenu » gratuit. Pour le SNJ, ce n’est pas le poids croissant du citoyen comme « source », son rôle et sa visibilité
18
accrus, qui posent problème, mais la mise en concurrence de l’amateur avec le journaliste professionnel. Le danger est le nivellement par le bas sur les plans social et éditorial ».3 Autre menace potentielle, la technologie de gestion en direct des flux de visiteurs sur site qui rend possible une estimation en temps réel de la performance des articles les plus lus. Cela donne déjà lieu à création de logiciels maintenant ou faisant automatiquement remonter en tête de la page d’accueil les articles les plus lus. Le risque pour la profession est de voir un jour ce dispositif technique censé servir aux internautes (en leur offrant immédiatement sous les yeux ce qui semble intéresser le plus grand nombre), être détourné au profit d’une politique de rémunération, une partie de la rémunération pouvant être indexée sur le nombre de clics et de visiteurs par articles mis en ligne. Ainsi le groupe américain Gannett (éditeur notamment de USA Today) a reconnu en avril 2011 avoir mis à l’étude la possibilité d’attribuer une prime annuelle en fonction du nombre de clics générés par article.
3.4 Charge de travail et modalités d’acquisition des nouvelles compétences : des freins à la dynamique du savoir Le passage au web se traduit par une charge de travail perçue comme trop lourde dans huit cas sur dix, notamment en lien avec la poly-compétence qu’exige le multimédia.
Interrogée sur ses attentes en matière de formation, une jeune journaliste du site Bakchich interrogée durant l’été 2010 déclare : « La vidéo, j’aimerais bien apprendre à monter, à cadrer, voilà ». Mais elle manifeste aussitôt son scepticisme face au défi qui s’ouvre à la profession sur Internet : « Mais bon, on ne peut pas tout faire. Je suis pas sûre que… Voilà, le côté je porte une caméra, je pose les questions, je ne pense que pas que ce soit l’avenir ! » (Lucie Delaporte, Bakchich). La vision des changements d’organisation du travail à effectuer apparaît peu claire pour les deux tiers des répondants. Plus d’une personne sur trois déclare que le passage au web lui a été imposé.
Ce discours peut s’accompagner de l’expression de craintes face à l’avenir. Mais, et pas toujours sur des critères générationnels, les rédactions sont assez divisées face aux changements à assumer. « Certains sont inquiets, d’autres ont au contraire de l’appétit pour ça… Personne ne le réfléchit, personne ne l’appréhende de la même façon. Certains y voient une menace, d’autres une opportunité… » (Ludovic Blecher, rédacteur en chef à Libération).
Par ailleurs, le multimédia exige de multiples compétences pour trois quart des répondants à l’enquête quantitative ; neuf personnes sur dix considèrent que leur travail mobilise des compétences toujours plus nombreuses et complexes. « Tout ça c’est des choses en plus, forcément. Qu’on a plus ou moins appris à l’école, mais qu’il faut toujours perfectionner. Parce que ça change. Il y a beaucoup de contingences techniques, en web. c’est vrai que c’est lourd. Moi je sais faire du montage, mais c’est pas toujours le même logiciel quand on arrive dans la boîte où on est, donc il faut apprendre le logiciel, apprendre le nouveau type d’encodage qui va pas être le même… Tout ça, c’est des compétences en plus » (Antonin Sabot, Le Monde).
En ce qui concerne les modalités de formation mises en œuvre, la plus citée est l’appui des collègues (45% des cas) ; vient ensuite l’auto formation dans plus d’un cas sur trois, avec le recours à Internet (20%) ou au livre (15%) ; un répondant sur quatre à bénéficié du plan de
3 http://bit.ly/iJXDPA
19
formation de l’entreprise ; 20% n’ont eu aucune formation. La gestion des compétences est de même déclarée comme insuffisante par plus de 80% des répondants ; pour six personnes sur dix, le plan de formation est peu ou pas du tout adapté au changement.
De l’autre côté un rédacteur en chef apparaît sceptique face à l’utilité d’un plan de formation sur la pluricompétence : « On a fait des grandes séries de formation, de trucs comme ça. Le problème c’est qu’ils font la formation et après ils s’en branlent. Il se remettent dans leur coin… C’est très dur. De convertir des gens du quotidien à ça. C’est pour ça que je pense que le seul endroit où on peut y arriver c’est sur la zone payante. Parce que, ce qui est très dur, c’est de faire de la valeur ajoutée pour le lendemain et de l’actu pour le moment même. Ça c’est très difficile » (Ludovic Blecher, rédacteur en chef à Libération). Finalement, une forte surcharge de travail apparaît. Conséquence d’une productivité attendue accrue, mais aussi d’accélération des rythmes de travail. « Travailler sur Internet, ça change vraiment que le temps. Ça va plus vite. Mais fondamentalement ça change pas le travail du
journaliste, puisqu’avant aller très vite et produire de l’info très vite c’était déjà le cas de certains journalistes, les journalistes d’agence aussi, d’ailleurs, pas que la radio. Internet, c’est un mix entre l’agence et la radio » (Thomas Vampouille, Le Figaro).
Dans une organisation collective de leur production, les journalistes perdent le sentiment de la paternité de l’œuvre. Les exigences du multimédia réclamant de nouvelles compétences, que les plans de formation tardent à accompagner, le recours à l’auto formation est prédominant, auto-formation réalisée sur le temps hors travail. « En fait, c’est plutôt une veille, sur les applications, et de voir comment est-ce qu’on peut les intégrer nous à notre travail. Donc c’est difficile de dire, on va faire une formation pour ça, parce que c’est en constante évolution. Ça, c’est plutôt à chacun de faire un peu sa veille dessus, de se dire ça pourrait être utilisable comme ça, ou quoi. Et ça, en l’occurrence, nous on a des chefs d’information, des chefs d’édition, qui sont…qui ont un petit côté geek. Et ça, ça aide. Parce qu’ils peuvent imaginer des manières d’appliquer certaines formes à notre métier » (Antonin Sabot, Le Monde). Dans de telles conditions, dynamiques du savoir comme du pouvoir sont mises en question. Dès lors, quelles préconisations envisager ?
4. Repenser les rédactions et accompagner les mutations identitaires
4.1 Repenser les rédactions Mark Deuze souligne avec pertinence que ces nouvelles potentialités, ces nouvelles pratiques des infonautes et des journalistes ne sont pas des ajustements au cas par cas, mais se lisent et se vivent comme un bouleversement complet du rapport au public et au métier et donc impactent les organisations. « De tels changements ont aussi à voir avec les modes d'organisation éditoriale, les arts de faire du journalisme établi, les normes et les valeurs de la narration. (…) Les valeurs ajoutées évoquées et les caractéristiques des journalismes en ligne ne peuvent être simplement incorporées au cas par cas, sans modifier fondamentalement la nature de la « bête » - la bête étant ici la culture particulière de la newsroom et des professionnels qui y sont impliqués. Des types différents et se chevauchant de journalisme en ligne changent ce que l'on perçoit comme le journalisme « réel », comme ses caractéristiques distinctives et leurs implications sur la manière dont les processus de production des médias sont fixés, comment les organisations productrices d’information sont gérées, et comment fonctionne une culture journalistique (en relation avec les publics et les technologies) » (Deuze 2003 : 216).
20
Au niveau des organisations rédactionnelles des médias « mis en ligne », avec une rédaction préexistante sur un autre support, une des questions est évidemment de définir des règles de coordination entre deux structures rédactionnelles ou pas, avec des choix qui vont des structures intégrées au séparatisme assez complet, en investissant ou pas dans une vraie rédaction à part. Des journaux américains ou anglais en sont déjà à penser la fusion de deux rédactions qu’ils avaient développées séparément à l’origine. L’avantage des rédactions séparées est « de créer un mécanisme pour générer des reportages originaux pour la publication en ligne » (Pavlik, 2001 : 101) et éviter des phénomènes de burn out, où les mêmes journalistes doivent alimenter à la fois le site et le support d’origine, phénomène qui crée des crispations et des conflits, comme l’illustre la longue grève au sein du groupe canadien Québecor, au moment de la redéfinition de la convention collective.
La question est aussi celle de la perception et de l’acceptation par des journalistes dans deux structures de rédaction différentes d’un éventuel exercice divergent du métier. Amandine Degand évoque alors une « crise conventionnelle » entre les anciens et les « nouveaux » journalistes. « L’introduction d’une stratégie bi- ou pluri-média dans une rédaction suscite visiblement un doute sur la normalité dans le travail des journalistes traditionnels. Nous pouvons donc supposer que ces derniers traversent une crise conventionnelle, soit, selon Pierre-Yves Gomez, « une situation telle que des acteurs […] témoignent d’une incertitude, du sentiment que les choses ne sont pas ce qu’elles devraient être ‘normalement’. Ce ‘normalement’ suppose qu’une règle implicite du normal existe, et qu’elle ne fonctionne pas très bien » (Amblard et al., 2003, p. 266), ce qui renvoie finalement à la question des mutations identitaires.
4.2 Accompagner les mutations identitaires Selon Berger et Lückman (1967), repris par Dubar (op.cit.), trois conditions sont nécessaires pour que s’opère de manière satisfaisante une mutation identitaire. Premièrement la constitution d’un « espace de transformation » au sein duquel les acteurs peuvent co-construire leur avenir, échanger leurs représentations, leurs difficultés, explorer les voies possibles et finalement prendre confiance pour s’engager dans la reconstruction de leur identité. La deuxième condition réside dans « l’appareil de conversation », permettant à l’individu tant d’extérioriser de manière intime ses ressentis, ses émotions, ses peurs, ses doutes, ses angoisses, que de verbaliser ses nouvelles représentations de soi. La troisième condition est une « structure de plausibilité » au sein de laquelle s’élaborent les nouvelles compétences, à la reconnaissance des nouveaux savoirs, savoirs faire, et savoirs être ; cette construction interne d’un autre soi-même repose sur l’élaboration de convictions profondes éthiques et professionnelles notamment de manière à favoriser la dynamique identitaire du changement personnel d’identité.
Soulignons enfin à la suite de Sardas (op.cit.), qu’au niveau de la conception de l’organisation, il conviendrait de clarifier l’organisation des webrédactions en fonction de finalités bien identifiées (clarifier les modèles économiques et les pratiques de GRH notamment). Elaborer des scénarii organisationnels cohérents par rapport à ces finalités. Prévoir les risques potentiels et les ajustements nécessaires en conséquence. Concevoir donc le changement comme « un processus d’exploration et d’apprentissage organisationnel, qui ne peut jamais être totalement maîtrisé, mais dont on peut améliorer la conduite ». L’accompagnement du changement par des intervenants chercheurs notamment présenterait l’avantage d’un enrichissement mutuel en aidant l’organisation à élaborer les scenarii
21
organisationnels, à prévoir les effets et les ajustements tout en analysant la « dynamique identitaire globale » qui en résulte.
Conclusion Pour étudier la question initiale de l’équilibre identitaire des webjournalistes dans le contexte des mutations engendrées par le passage en ligne de la presse, nous avons mobilisé le cadre d’analyse de la « dynamique identitaire globale ». L’analyse de la littérature nous a permis de dresser un premier bilan réservé sur l’offre socio-professionnelle et organisationnelle identitaire : précarité de certains statuts, éclatement de la profession, nouvelles logiques de productivité et de performance, concurrence des journalistes amateurs, course à l’innovation, émergence de nouveaux métiers et compétences ; autant de sources de fragilisation pour l’identité des webjournalistes. Ces derniers se révèlent néanmoins selon les résultats d’une récente enquête, satisfaits globalement vis-à-vis de leur travail, voyant le passage au numérique comme une opportunité pour leur carrière ; s’ils aspirent à utiliser les avantages offerts par les nouveaux outils, ils déplorent néanmoins le manque de soutien organisationnel, la surcharge de travail, l’urgence omniprésente, les risques que ces exigences représentent pour la qualité de l’information et la fragilité de la gestion des compétences, comme la faible reconnaissance de celles qui sont acquises bien souvent sur le temps hors-travail. A l’issue de cette étude une tension apparaît donc entre la demande et l’offre identitaire. Nous avons en conséquence suggéré d’une part de repenser les rédactions en termes de coordination des supports traditionnels et numériques mais également en termes de reconstruction des contours de la « normalité » du métier. L’accompagnement des transformations organisationnelles et identitaires a d’autre part été envisagé via des « espaces de transformation » de « conversation » et des « structures de plausibilité » pouvant être coordonnées par des chercheurs-intervenants, dans la perspective d’une fertilisation croisée des pratiques et de la recherche. Des travaux complémentaires (monographies, études comparatives) s’avèrent nécessaires afin d’élargir ce premier repérage des fragilités dont sont porteuses les pratiques sociales comme celles qui sont à l’œuvre au sein des rédactions, de manière à accompagner favorablement ces changements.
Si de nombreux travaux sont conduits dans des disciplines universitaires telles que la sociologie, les sciences politiques, l’information et la communication, peu de travaux en sciences de gestion ont investi le champ du journalisme. L’objectif poursuivi par notre étude exploratoire était donc de pointer les risques identitaires potentiels du passage au numérique des métiers de l’information, en centrant l’analyse sur le métier de journaliste. Au-delà de cet objectif, notre travail visait à présenter le champ du journalisme à la communauté des gestionnaires comme un véritable champ à investir. Les apports qui se dégagent de nos travaux rendent compte de la fertilisation croisée qu’offrent les travaux coopératifs entre chercheurs de différentes disciplines pour étudier la question de la fragilisation des identités professionnelles dans le contexte des mutations de la presse en ligne. Les premiers résultats de notre étude exploratoire par questionnaire (adaptation du job diagnostic survey pour le métier de journaliste) et par entretien (guide d’entretien spécifique sur les changements que génère le passage au web pour les journalistes) ont généré une nouvelle enquête en cours de réalisation auprès de seize acteurs en charge de la GRH dans quatre catégories de médias différents : quotidien national (Libération, Le Figaro, etc.), presse quotidienne régionale (Ouest France, Le Républicain Lorrain,…), Hebdomadaire national (Le nouvel observateur, l’Express,…) ; média né en ligne (Médiapart, Rue 89,…). La population de cette nouvelle enquête comporte un aspect innovant dans la mesure où ni en sociologie ni en sciences
22
politiques ni en information et communication, ces responsables ne sont enquêtés. L’étude que nous avons réalisée représente en conséquence un aspect novateur qui nous apparaît incitatif pour la communauté scientifique de la GRH. Le webjournalisme réserve en effet des espaces vierges d’investigation en sciences de gestion, aussi invitons-nous la communauté à œuvrer pour répondre aux nombreuses questions que soulèvent les mutations du journalisme.
Références Aldridge M., Evetts J. (2003), Rethinking the concept of professionalism: the case of
journalism, British Journal of Sociology, vol.54 (4), p.547-564.
Allan S. (2009), Online news. Journalism and the internet, Berkshire : Open University Press.
Ashforth B. (2001), Role transitions in organizational life: an identity-based perspective, Mahwah, NJ: Erlbaum.
Berger P., Luckmann T., (1967), The social construction of reality, Harmondsworth, Penguin, traduction française 1996, Paris : Armand Colin.
Boczkowski P. (2004), Digitizing the news. Innovation in online newspaper, Cambridge, Ma. : MIT press.
Boyer L., Scouarnec A. (2009), La prospective des métiers, Paris, EMS
Brewer M. B. (1991), The social self: on being the same and different at the same time, Personality and Social Psychology Bulletin, vol. 17, 475-482.
Brin, C., Charron, J., de Bonville, J., Nature et transformation du journalisme. Théorie et recherches empiriques, Québec, Presses de l’université Laval, 2004, p.36.
Bruns, Axel, (2008), The Active audience : transforming journalism from gatekeeping to gatewatching, in Paterson, C., Domingo, D. (ed.), Making online news. The ethnography of new media production, New York : Peter Lang, pp.176-177.
Cabrolié S. (2010), Les journalistes du Parisien.fr et le dispositif technique de production de l'information, Réseaux, n° 160-161, p.79-100.
Carbonnel A., Dollander T., Sebbah B. (2011), Quelle GRH pour les webjournalistes, Actes du Colloque Prospective des métiers, Paris, ESSEC.
Charon J-M. (2010), De la presse imprimée à la presse numérique. Le débat français, Réseaux, n°160/161, p.255-281.
Charon, J.-M. (1993), Cartes de presse. Enquête sur les journalistes, Paris : Stock.
Charon, J.-M., Mercier, A. (2003), Pour en finir avec « le pouvoir des journalistes », Hermès, n°35.
Cottle S. (ed) (2003), Media organization and production. Londres, Sage.
Cottle S., (2000), New(s) times : toward a ‘second wave’ of news ethnography, Communications, vol.25 (1), p.19-41.
De Barnier B. Augey D., Jammot A. (2011), « Le management du changement dans la presse : analyse du passage au bi-média à La Provence.com », Actes du colloque sur la communication numérique, Paris, ESSEC.
23
De Rosnay J., Revelli C., (2006), La révolte du pronétariat : Des mass média aux média des masses, Paris : Fayard.
Degand A. (2009), La presse en crise conventionnelle, État des lieux de l’intégration du journalisme en ligne en Belgique francophone, Colloque Médias 09, ISIM, Aix-en-Provence, 16 et 17 décembre.
Dejours C. (1990), Nouveau regard sur la souffrance humaine dans les organisations, in Chanlat J.F. (éd.) L’individu dans l’organisation, p. 687-708, Québec et Ottawa : Presses de l’université de Laval et Editions ESKA.
Demers F. (2007), Déstructuration et restructuration du journalisme, Tic & Société, Vol.1 (1), en ligne.
Deuze M. (1999), Journalism and the Web: An Analysis of Skills and Standards in an Online Environment, International Communication Gazette, Vol.61 (5), p.373-390.
Deuze M. (2005), What is journalism ? Professional identity and ideology of journalists reconsidered, Journalism Theory Practice & Criticism, vol.6 (4), p.443-465.
Domingo D., (2005), The difficult shift from utopia to realism in the Internet era. A decade of online journalism research, en ligne. http://www.makingonlinenews.net/docs/domingo_amsterdam2005.pdf
Dubar C. (1991), La socialisation. Construction des identités sociales et professionnelles, Paris : A. Colin.
Dubar C. (1994) « Identités collectives et individuelles dans le champ professionnel », Traité de sociologie du travail, Bruxelles, De Boeck.
Dubar C. (2000), La crise des identités. L’interprétation d’une mutation, Paris : PUF.
Dubar, C. (1992), Formes identitaires et socialisation professionnelle », Revue Française de Sociologie, n°33, p. 505-529.
Estienne Y., (2007), Le journalisme après Internet, Paris : L’Harmattan.
Estienne, Y. (2007), Le Journalisme après Internet, Paris : L’Harmattan.
Fogel, J.-F., Patino, B. (2005), Une presse sans Gutemberg, Paris : Grasset.
Heinderyckx F. Colson V. (2008), Do Online Journalists Belong into the Newsroom in C. Paterson, D. Domingo, D. Making Online News, New York : Peter Lang, p.143-154.
Heinonen A. (1999), Journalism in the Age of the Net, Tampere : Acta Universitatis Tamperensis.
Hogg M. A., Terry D. J. (2000), Social identity and self-categorization processes in organizational contexts, Academy of Management Review, vol. 25, n°1, 121-140.
Joannès, A. (2007), Le Journalisme à l’ère électronique, Paris : Vuibert.
Le Cam F. (2006), États-Unis : les weblogs d’actualité ravivent la question de l’identité journalistique, Réseaux, n°138, p.139-158.
Matheson D. (2004), Weblogs and the Epistemology of the News: Some Trends in Online Journalism, New Media & Society, vol.6 (4), p.443-468.
Mead G. H. (1934), Mind, Self and Society, Chicago: University of Chicago Press.
Meikle G. Redden G. (2011), News online : transformations and continuities, Palgrave : MacMillan.
24
Mercier, A. (1994), L'institutionnalisation de la profession de journaliste, Hermès, n°13-14, juillet, p.219-235.
Mercier, A. (2010), Défis du nouvel écosystème d’information et changement de paradigme journalistique, www.obsweb.net, 42p, mis en ligne en décembre 2010.
Mitchelstein E. Boczkowski P. (2009), Between tradition and change. A review of recent research on online news production, Journalism, vol.10 (5), p.562-586.
Muchielli A. (1986), L'identité , PUF, Paris.
Osty F. (2003), ≪ Le désir de métier : engagement, identite et reconnaissance au travail ≫, Rennes, PUR.
Padioleau, J.-G., Blanchot, F. (2003), Une économie politique du travail journalistique, Hermès, n°35, p. 63-71.
Paterson C. Domingo D. (ed.), (2008), Making online news. The ethnography of new media production, New York : Peter Lang.
Pavlik, J. (2001), Journalism and new media, New York, Columbia University Press.
Pavlik, J. V. (2001), Journalism and new media, New York : Columbia University Press.
Pélissier, Nicolas, (2003), Un cyberjournalisme qui se cherche, in Mercier A. Charon J-M. (dir.) Hermès, n°35, p.99-107.
Pichault F.,Rorive B., Zune M. (2002), Nouvelles technologies et métiers en émergence, rapport de recherche commanditée par la DiGITIP, Paris, SESSI
Pignard-Cheynel N. Noblet A. (2010), L’encadrement des contributions "amateurs" au sein des sites d’information : entre impératifs participatifs et exigences journalistiques, in Millerand F. Proulx S. Rueff J. (dir.), Web social. Mutation de la communication, Presses de l’université du Québec, p. 265-282.
Piotet F. (2002), ≪ ≫ La revolution des metiers , PUF, Paris.
Rebillard, F. (2010), Le journalisme participatif, un maillon dans la chaîne numérique de l'information d'actualité, in Millerand F., Proulx S., Rueff J., (dir.), Web social : mutation de la communication, Québec : P.U.Q., p. 353-365.
Ruellan D. (1993), Le journalisme ou le professionnalisme du flou, Grenoble : PUG.
Ruellan D. (1997), Les pro du journalisme : de l'état au statut, la construction d'un espace professionnel, Rennes : PUR.
Sainsaulieu R. (1997), L’identité au travail, Paris : Presses de la FNSP.
Saltzis K. Dickinson R. (2008), Inside the changing newsroom: journalists' responses to media convergence, Aslib Proceedings, vol.60 (3), p.216-228.
Sardas J.C. (1994), Dynamique de l’acteur et de l’organisation, Thèse de l’Ecole des Mines, Paris.
Sardas J.C. (1997), Ingénierie intégrée et mutation des métiers de la conception, Réalités industrielles, annales des Mines, février, p. 41-47.
Sardas J.C. (2008), L’approche des sciences de gestion, in Prévention du stress et des risques psychosociaux au travail, octobre, p. 10-21, Paris : Editions du réseau ANACT.
Singer J. (2003), Who are these guys ? The online challenge to the notion of journalistic professionalism, Journalism, vol.4 (2), p.139-163.
25
Singer J. (2004), More than ink-strained wretches : the resocialization of print journalists in converged newsroom, Journalism & Mass Communication Quarterly, vol.81 (4), p.838-856.
Trédan O. (2007), Le "journalisme citoyen" en ligne : un public réifié ?, Hermès, n° 47, p.115-122.
Wellman B. (2004), The three ages of internet studies: ten, five and zero years ago, New Media & Society, vol.6 (1), p.123-129.
![Page 1: « Webjournaliste : une identité fragile dans un contexte de mutations professionnelles »,(Lien) (avec A. Carbonnel), 22è congrès de l’AGRH, Marrakech. [actes en ligne] octobre](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013015/631c5faba1cc32504f0c735d/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: « Webjournaliste : une identité fragile dans un contexte de mutations professionnelles »,(Lien) (avec A. Carbonnel), 22è congrès de l’AGRH, Marrakech. [actes en ligne] octobre](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013015/631c5faba1cc32504f0c735d/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: « Webjournaliste : une identité fragile dans un contexte de mutations professionnelles »,(Lien) (avec A. Carbonnel), 22è congrès de l’AGRH, Marrakech. [actes en ligne] octobre](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013015/631c5faba1cc32504f0c735d/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: « Webjournaliste : une identité fragile dans un contexte de mutations professionnelles »,(Lien) (avec A. Carbonnel), 22è congrès de l’AGRH, Marrakech. [actes en ligne] octobre](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013015/631c5faba1cc32504f0c735d/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: « Webjournaliste : une identité fragile dans un contexte de mutations professionnelles »,(Lien) (avec A. Carbonnel), 22è congrès de l’AGRH, Marrakech. [actes en ligne] octobre](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013015/631c5faba1cc32504f0c735d/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: « Webjournaliste : une identité fragile dans un contexte de mutations professionnelles »,(Lien) (avec A. Carbonnel), 22è congrès de l’AGRH, Marrakech. [actes en ligne] octobre](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013015/631c5faba1cc32504f0c735d/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: « Webjournaliste : une identité fragile dans un contexte de mutations professionnelles »,(Lien) (avec A. Carbonnel), 22è congrès de l’AGRH, Marrakech. [actes en ligne] octobre](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013015/631c5faba1cc32504f0c735d/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: « Webjournaliste : une identité fragile dans un contexte de mutations professionnelles »,(Lien) (avec A. Carbonnel), 22è congrès de l’AGRH, Marrakech. [actes en ligne] octobre](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013015/631c5faba1cc32504f0c735d/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: « Webjournaliste : une identité fragile dans un contexte de mutations professionnelles »,(Lien) (avec A. Carbonnel), 22è congrès de l’AGRH, Marrakech. [actes en ligne] octobre](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013015/631c5faba1cc32504f0c735d/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: « Webjournaliste : une identité fragile dans un contexte de mutations professionnelles »,(Lien) (avec A. Carbonnel), 22è congrès de l’AGRH, Marrakech. [actes en ligne] octobre](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013015/631c5faba1cc32504f0c735d/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: « Webjournaliste : une identité fragile dans un contexte de mutations professionnelles »,(Lien) (avec A. Carbonnel), 22è congrès de l’AGRH, Marrakech. [actes en ligne] octobre](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013015/631c5faba1cc32504f0c735d/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: « Webjournaliste : une identité fragile dans un contexte de mutations professionnelles »,(Lien) (avec A. Carbonnel), 22è congrès de l’AGRH, Marrakech. [actes en ligne] octobre](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013015/631c5faba1cc32504f0c735d/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: « Webjournaliste : une identité fragile dans un contexte de mutations professionnelles »,(Lien) (avec A. Carbonnel), 22è congrès de l’AGRH, Marrakech. [actes en ligne] octobre](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013015/631c5faba1cc32504f0c735d/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: « Webjournaliste : une identité fragile dans un contexte de mutations professionnelles »,(Lien) (avec A. Carbonnel), 22è congrès de l’AGRH, Marrakech. [actes en ligne] octobre](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013015/631c5faba1cc32504f0c735d/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: « Webjournaliste : une identité fragile dans un contexte de mutations professionnelles »,(Lien) (avec A. Carbonnel), 22è congrès de l’AGRH, Marrakech. [actes en ligne] octobre](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013015/631c5faba1cc32504f0c735d/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: « Webjournaliste : une identité fragile dans un contexte de mutations professionnelles »,(Lien) (avec A. Carbonnel), 22è congrès de l’AGRH, Marrakech. [actes en ligne] octobre](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013015/631c5faba1cc32504f0c735d/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: « Webjournaliste : une identité fragile dans un contexte de mutations professionnelles »,(Lien) (avec A. Carbonnel), 22è congrès de l’AGRH, Marrakech. [actes en ligne] octobre](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013015/631c5faba1cc32504f0c735d/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: « Webjournaliste : une identité fragile dans un contexte de mutations professionnelles »,(Lien) (avec A. Carbonnel), 22è congrès de l’AGRH, Marrakech. [actes en ligne] octobre](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013015/631c5faba1cc32504f0c735d/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: « Webjournaliste : une identité fragile dans un contexte de mutations professionnelles »,(Lien) (avec A. Carbonnel), 22è congrès de l’AGRH, Marrakech. [actes en ligne] octobre](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013015/631c5faba1cc32504f0c735d/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: « Webjournaliste : une identité fragile dans un contexte de mutations professionnelles »,(Lien) (avec A. Carbonnel), 22è congrès de l’AGRH, Marrakech. [actes en ligne] octobre](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013015/631c5faba1cc32504f0c735d/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: « Webjournaliste : une identité fragile dans un contexte de mutations professionnelles »,(Lien) (avec A. Carbonnel), 22è congrès de l’AGRH, Marrakech. [actes en ligne] octobre](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013015/631c5faba1cc32504f0c735d/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: « Webjournaliste : une identité fragile dans un contexte de mutations professionnelles »,(Lien) (avec A. Carbonnel), 22è congrès de l’AGRH, Marrakech. [actes en ligne] octobre](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013015/631c5faba1cc32504f0c735d/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: « Webjournaliste : une identité fragile dans un contexte de mutations professionnelles »,(Lien) (avec A. Carbonnel), 22è congrès de l’AGRH, Marrakech. [actes en ligne] octobre](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013015/631c5faba1cc32504f0c735d/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: « Webjournaliste : une identité fragile dans un contexte de mutations professionnelles »,(Lien) (avec A. Carbonnel), 22è congrès de l’AGRH, Marrakech. [actes en ligne] octobre](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013015/631c5faba1cc32504f0c735d/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: « Webjournaliste : une identité fragile dans un contexte de mutations professionnelles »,(Lien) (avec A. Carbonnel), 22è congrès de l’AGRH, Marrakech. [actes en ligne] octobre](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013015/631c5faba1cc32504f0c735d/html5/thumbnails/25.jpg)





![[Article] Soins et lien social : à propos du Patchwork des Noms](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6314f5a83ed465f0570b5e93/article-soins-et-lien-social-a-propos-du-patchwork-des-noms.jpg)