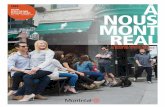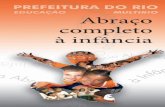“Le sanctuaire de Déméter de Bitalemi à Géla”, in Une Odyssée gauloise. Parures de femmes...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of “Le sanctuaire de Déméter de Bitalemi à Géla”, in Une Odyssée gauloise. Parures de femmes...
239
En Sicile : fragments d'objets gaulois, gestion du métal et pratiques cultuelles féminines CHAPITRE 5
LE SANCTUAIRE DE DÉMÉTER DE BITALEMI À GÉLA
Historique des fouillesÀ l’époque de Paolo Orsi, qui a effectué en 1901 les premières fouilles sur le site, il y avait
encore sur la colline de Bitalemi – aux portes de Géla – un modeste bâtiment rural qui avait incorporé les ruines d’une église médiévale dédiée à la Vierge de Bethléem. Les sondages de P. Orsi se sont donc limités à la bande de terre le long de la bordure ouest de la colline, en face de la ferme. Après un examen détaillé des données de fouilles, le chercheur a conclu qu’un sanctuaire grec datant probablement de l’époque de la fondation de la colonie rhodo-crétoise de Géla (689-688 avant J.-C. selon Thucydide) se trouvait sur la colline et qu’il avait dû être consacré à Déméter et Korè, qui jouissaient à Géla d’un culte important. La fréquentation de ce lieu sacré se poursuivra jusqu’à la destruction ou l’abandon du sanctuaire vers le milieu du Ve siècle avant J.-C. À l’époque chrétienne, la vénération des deux déesses est remplacée par celle de la Vierge de Bethléem.
Dans les années 1960, les fouilles reprennent sous la direction de Piero Orlandini, alors inspecteur à la Surintendance. Elles lui permettent de confirmer et de préciser les hypothèses formulées par P. Orsi.
Après deux sondages effectués à l’est et au sud de la ferme en 1963, l’abondance des vestiges incite à entamer de réelles campagnes de fouilles systématiques en 1964 et 1967. Celles-ci incluent toute la plateforme supérieure de la colline, y compris la zone de la ferme dont les ruines sont démolies : cela représente une aire d’environ 2 000 m! fouillée finement jusqu’au terrain naturel. P. Orlandini met en évidence cinq niveaux principaux.
Le premier contenait de nombreux squelettes disposés autour de l’ancienne église, témoi-gnage d’une sépulture collective liée à une épidémie de peste du XIVe siècle (probablement celle de 1348, restée célèbre grâce à Boccace), comme l’indiquent les monnaies et la céra-mique mises au jour.
Marina Albertocchi
5-chapitre 5-mep.indd 239 26/03/13 16:08
239
En Sicile : fragments d'objets gaulois, gestion du métal et pratiques cultuelles féminines CHAPITRE 5
LE SANCTUAIRE DE DÉMÉTER DE BITALEMI À GÉLA
Historique des fouillesÀ l’époque de Paolo Orsi, qui a effectué en 1901 les premières fouilles sur le site, il y avait
encore sur la colline de Bitalemi – aux portes de Géla – un modeste bâtiment rural qui avait incorporé les ruines d’une église médiévale dédiée à la Vierge de Bethléem. Les sondages de P. Orsi se sont donc limités à la bande de terre le long de la bordure ouest de la colline, en face de la ferme. Après un examen détaillé des données de fouilles, le chercheur a conclu qu’un sanctuaire grec datant probablement de l’époque de la fondation de la colonie rhodo-crétoise de Géla (689-688 avant J.-C. selon Thucydide) se trouvait sur la colline et qu’il avait dû être consacré à Déméter et Korè, qui jouissaient à Géla d’un culte important. La fréquentation de ce lieu sacré se poursuivra jusqu’à la destruction ou l’abandon du sanctuaire vers le milieu du Ve siècle avant J.-C. À l’époque chrétienne, la vénération des deux déesses est remplacée par celle de la Vierge de Bethléem.
Dans les années 1960, les fouilles reprennent sous la direction de Piero Orlandini, alors inspecteur à la Surintendance. Elles lui permettent de confirmer et de préciser les hypothèses formulées par P. Orsi.
Après deux sondages effectués à l’est et au sud de la ferme en 1963, l’abondance des vestiges incite à entamer de réelles campagnes de fouilles systématiques en 1964 et 1967. Celles-ci incluent toute la plateforme supérieure de la colline, y compris la zone de la ferme dont les ruines sont démolies : cela représente une aire d’environ 2 000 m! fouillée finement jusqu’au terrain naturel. P. Orlandini met en évidence cinq niveaux principaux.
Le premier contenait de nombreux squelettes disposés autour de l’ancienne église, témoi-gnage d’une sépulture collective liée à une épidémie de peste du XIVe siècle (probablement celle de 1348, restée célèbre grâce à Boccace), comme l’indiquent les monnaies et la céra-mique mises au jour.
Marina Albertocchi
5-chapitre 5-mep.indd 239 26/03/13 16:08
240
Une Odyssée gauloiseCHAPITRE 5
La deuxième couche est un niveau sableux et stérile lié à l’abandon du site avant la construction de l’église, datant de la fin du IVe siècle.
De cette époque (qui correspond à la troisième couche), sont datés les restes d’un établisse-ment rural romain s’appuyant directement sur les structures en blocs de pierre des sanc-tuaires grecs antérieurs. Cet établissement, qui couvre une période comprenant la plupart des IIIe et IVe siècles, faisait partie du latifundium de Calvisana (la plaga Calvisianis – plaine de Géla – mentionnée dans l’Itinerarium Antonini), du nom de Calvisianus qui fut Corrector Siciliae puis Consularis entre 290 et 304 après J.-C.
Vue de la colline de Bitalemi au début du XXe siècle avec une ferme construite sur les ruines d’une église médiévale.
Plan général de la cité grecque de Géla. !: lieux de culte attribués
aux divinités chtoniennes (1. Bitalemi ; 2. Acropole ; 3. Carrubazza ; 4. Via Fiume – Scalo ferroviario – Magazzino Alessi ; 5. Predio Sola).
: autres sanctuaires (A. Acropole, athénaïon ; B. Piazza del Calvario – Mulino di Pietro ; C. Héraïon ; D. Madonna del l’Alemanna ; E. Via Tucidide; F. Villa Iacona ; G. Capo Soprano). S1 : muraille archaïque et classique ; S2 : muraille hellénistique.
5-chapitre 5-mep.indd 240 26/03/13 16:08
241
En Sicile : fragments d'objets gaulois, gestion du métal et pratiques cultuelles féminines CHAPITRE 5
Les quelques objets des IVe-IIIe siècles avant J.-C. découverts dans la partie la plus profonde de ce troisième niveau indiquent une fréquentation occasionnelle à la période hellénistique.
La quatrième couche forme le niveau le plus récent de la fréquentation du sanctuaire grec qui, d’après le mobilier céramique trouvé, est daté entre le milieu du VIe siècle avant J.-C. et la destruction de Géla par Carthage en 405 avant J.-C. Dans ce niveau, les restes de six bâti-ments ont été mis au jour (G1-2-3-4-5-7 sur le plan).
La cinquième et dernière couche est sableuse. Elle contenait des milliers d’objets liés à la première phase de la vie du sanctuaire grec, datables entre le milieu du VIIe et le milieu du VIe siècle avant J.-C.
De cette fouille exceptionnelle, P. Orlandini n’a donné que deux rapports préliminaires dans la revue Kokalos de 1966 et de 1967. L’importance des découvertes l’avait en effet incité à publier inté-gralement les résultats de cette fouille une fois retraité de son activité académique. L’équipe de chercheurs constituée pour cette tâche, sous sa direction, a donc entrepris un réexamen des données de fouille, complétant ainsi la documentation photographique du mobilier et son catalogue au milieu des années 1990. Le premier volume de la série consacrée à Bitalemi, dédié aux niveaux archaïques du sanctuaire, est maintenant prêt pour la publication.
Stratigraphie du site de Bitalemi par P. Orlandini.
Piero Orlandini.
Les structuresDans la couche 5, de modestes constructions ont été mises au jour, datées du premier quart
du VIe siècle avant J.-C. sur la base des objets associés. Il s’agit d’un petit mur de briques en terre crue (G6 sur le plan) et du bâtiment rectangulaire G8, duquel sont conservées sur le côté ouest six rangées de briques en terre crue disposées en quinconce (appareil isodome), inter-prété comme un naïskos.
5-chapitre 5-mep.indd 241 26/03/13 16:08
242
Une Odyssée gauloiseCHAPITRE 5
La plupart des bâtiments présents dans l’aire sacrée appartiennent cependant à la couche 4 nettement distincte du niveau plus ancien par la présence d’une épaisse couche d’argile, coulée peu après le milieu du VIe siècle avant J.-C. pour fournir une solide base constructive sur le sable.
Sur ce sol induré furent posées plusieurs structures, desquelles deux phases peuvent être distinguées : trois naïskoi plus anciens (G4-5-7), en murs de briques de terre crue, détruits dans le milieu du Ve siècle avant J.-C. probablement suite à un incendie, et des structures plus pérennes en pierre et blocs de grès, destinées aussi à recevoir les fidèles. G1 a été en particu-lier interprété comme un sanctuaire de taille moyenne. Le bâtiment allongé G2, dont seules les fondations sont conservées, possède une ouverture à l’ouest et semble avoir les caractéris-tiques d’un espace de rencontre et de discussion (lesché). Au nord de ce dernier a été mis au jour un bâtiment carré (G3) en blocs de grès de fonction incertaine, presque entièrement détruit lors de la construction de la ferme romaine tardive.
Le passage de la première à la seconde phase de construction, qui caractérise la couche 4, est marqué par deux dépôts votifs particuliers, un de forme semi-circulaire, l’autre rectangulaire.
Plan des bâtiments mis au jour dans le niveau 4 de Bitalemi.
5-chapitre 5-mep.indd 242 26/03/13 16:08
243
En Sicile : fragments d'objets gaulois, gestion du métal et pratiques cultuelles féminines CHAPITRE 5
Le premier était rempli d’une centaine de coupes en pâte claire disposées à l’envers, avec une figurine en terre cuite placée dans l’angle sud-est, tandis que l’autre a révélé des œnochoés en pâte claire, à l’envers elles aussi, et se chevauchant.
Les offrandesLa plupart des découvertes proviennent de la couche 5, où les ex-voto ont été préservés
grâce aux conditions particulières de conservation dues à la composition de sable pur de ce niveau archaïque.
90 % sont constituées de vases à l’envers, isolés ou en groupes, souvent maintenus ensemble par des fragments de gros vases ou des morceaux d’argile. Parmi les offrandes de céramique prévalent les vases de fabrication locale, à pâte claire non vernie ou à décor géométrique (notamment de nombreuses petites hydries) ; les vases importés sont pour la plupart originaires de Corinthe (en particulier de la période « transitionnelle » à la fin du VIIe siècle avant J.-C.), avec une prévalence de kotylai et d’aryballes ; dans la partie la plus profonde de la couche ont également été trouvées des amphores corinthiennes, de Grèce orientale et d’Attique. Les productions ioniennes sont aussi bien représentées. L’aes rude associé à des objets en bronze représente une offrande typique, on en compte une trentaine similaires enfouies dans le sable. Les couteaux en fer sont eux aussi caractéristiques des offrandes de cette couche : ils sont interprétés comme les restes de sacrifices rituels. On trouve enfin aussi, plus rarement, des statuettes de terre cuite et des poids de métiers à tisser.
Dans la couche 4, moins riche en découvertes, les terres cuites de fabrication locale prédo-minent, surtout des protomés et des statuettes de femmes avec des porcelets prêts à être sacri-fiés, associées aux nombreux poids de métiers à tisser et vases achromes sans revêtement (coupes, cruches et petites hydries).
Pour l’identification du culte pratiqué dans ce sanctuaire, nous avons heureusement un certain nombre d’inscriptions sur des vases datant du Ve siècle avant J.-C. contenant le nom de la divinité honorée (Déméter) ainsi que la mention de la fête qui s’y célébrait en son honneur : les thesmophories. Rappelons brièvement quelques caractéristiques du culte de Déméter Thesmophoros fondées sur les rares sources littéraires et épigraphiques qui évoquent
Dépôt votif du niveau 4, remplie de coupes en pâte claire à l’envers.
5-chapitre 5-mep.indd 243 26/03/13 16:08
244
Une Odyssée gauloiseCHAPITRE 5
Dépôts de céramiques dans le sable dans le niveau 5, en lien avec le rituel des thesmophories attesté sur le site de Bitalemi.
Kotyles, pyxide globulaire et aryballe corinthiens issus du niveau 5.
5-chapitre 5-mep.indd 244 26/03/13 16:08
245
En Sicile : fragments d'objets gaulois, gestion du métal et pratiques cultuelles féminines CHAPITRE 5
ce rituel secret. Les protagonistes étaient incontestablement des citoyennes libres et légale-ment mariées, bien qu’il ait pu y être admis aussi, dans une partie des célébrations, les parthe-noi (jeunes femmes en âge de se marier). La discussion autour d’une éventuelle présence masculine pendant le rituel est plus polémique. Le cas échéant, il ne s’agirait que d’une présence liée à l’activité sacrificielle. Suivant une certaine récurrence de dates et des durées variables en fonction des régions où se tenait ce culte, les eugeneis gynaikes (les épouses légi-times et les mères qui participent à la fête) se retiraient sur l’aire consacrée aux célébrations et y séjournaient un certain temps, jeûnant dans un premier temps à la mémoire de la douleur de Déméter pour la perte de sa fille Perséphone, enlevée par Hadès, et partageant dans un second temps des repas rituels, ce qui augure d’une fécondité naturelle et agraire prolifique. Bien qu’il existe des variables, le faciès du rituel restait sensiblement le même dans toutes les thesmophories, caractérisé par une séparation complète des hommes et des femmes ainsi que par un régime sortant de l’ordinaire, où les femmes, célébrant rituellement la fertilité, jouaient, pour une fois, un rôle central dans la perpétuation de la vie de la cité.
(Traduction Lionel Pernet)
BibliographieOrlandini 1966 ; Orlandini 1968-1969.
PRATIQUES RITUELLES DANS UN SANCTUAIRE GREC DE SICILE : FEMMES AUX THESMOPHORIES
Le rite thesmophorique est la forme courante que revêt le culte de Déméter dans le monde grec, à côté du rite singulier pratiqué à Éleusis. Des sanctuaires de Déméter Thesmophoros sont bien connus par l’archéologie à Corinthe, Cnossos, Cyrène ou encore Thasos. Ils sont le plus souvent situés en zone suburbaine, à l’articulation topographique et religieuse de la ville et du territoire, dans une position plus liminale que marginale, puisqu’ils sont le théâtre de pratiques cultuelles qui sont au cœur de la vie religieuse des Grecques.
Les Thesmophories sont en effet un ensemble de pratiques rituelles festives réservées aux femmes dont le scénario, le sens religieux et le dispositif concret sont à peu près les mêmes partout en pays grec, malgré quelques variations et nuances régionales. L’ « universalité » de ces fêtes s’explique par leur ancienneté. Elles composent une véritable « religion des femmes » dont les cérémonies sont profondément enracinées dans la culture grecque car elles remontent vraisemblablement au VIIIe siècle avant J.-C. pendant lequel la conscience civique se forge. Chez Hérodote, ce sont des meurtrières de leurs maris, les Danaïdes, qui introduisent ces fêtes d’origine égyptienne (II, 171), ce qui montre que l’on reconnaissait dès l’époque clas-sique aux Thesmophories une étrangeté mâtinée d’inquiétude toute masculine. Des sources littéraires rapprochent les thesmophoria de « mystères » donnant lieu à des initiations comme à Mykonos, mais Hérodote considère, il est vrai, que la forme originelle de ces mystères de Déméter ne s'est conservée que dans le Péloponnèse. L’offrande recognitive de ce culte est le porc, dont on retrouve dans les sanctuaires les restes, des reliefs de repas, ou des représenta-tions sous la forme de figurines en terre cuite.
Le rite et le déroulement des célébrations thesmophoriques sont fondés sur un récit mythique. Déméter est fille de Cronos et de Rhéa et appartient donc à la génération des Olympiens, c’est-à-dire celle de Zeus, qui est de surcroît le père de sa fille Korè-Perséphone. Déméter n’est donc pas une ancienne divinité cosmogonique comme l’est Gaïa, mais une puissance actuelle et efficace. Sa mythologie est essentiellement composée d’un drame : l’enlèvement de sa fille par un frère de Zeus, Hadès, alors qu’elle grandissait avec ses sœurs
François Quantin
5-chapitre 5-mep.indd 245 26/03/13 16:08
240
Une Odyssée gauloiseCHAPITRE 5
La deuxième couche est un niveau sableux et stérile lié à l’abandon du site avant la construction de l’église, datant de la fin du IVe siècle.
De cette époque (qui correspond à la troisième couche), sont datés les restes d’un établisse-ment rural romain s’appuyant directement sur les structures en blocs de pierre des sanc-tuaires grecs antérieurs. Cet établissement, qui couvre une période comprenant la plupart des IIIe et IVe siècles, faisait partie du latifundium de Calvisana (la plaga Calvisianis – plaine de Géla – mentionnée dans l’Itinerarium Antonini), du nom de Calvisianus qui fut Corrector Siciliae puis Consularis entre 290 et 304 après J.-C.
Vue de la colline de Bitalemi au début du XXe siècle avec une ferme construite sur les ruines d’une église médiévale.
Plan général de la cité grecque de Géla. !: lieux de culte attribués
aux divinités chtoniennes (1. Bitalemi ; 2. Acropole ; 3. Carrubazza ; 4. Via Fiume – Scalo ferroviario – Magazzino Alessi ; 5. Predio Sola).
: autres sanctuaires (A. Acropole, athénaïon ; B. Piazza del Calvario – Mulino di Pietro ; C. Héraïon ; D. Madonna del l’Alemanna ; E. Via Tucidide; F. Villa Iacona ; G. Capo Soprano). S1 : muraille archaïque et classique ; S2 : muraille hellénistique.
5-chapitre 5-mep.indd 240 26/03/13 16:08
241
En Sicile : fragments d'objets gaulois, gestion du métal et pratiques cultuelles féminines CHAPITRE 5
Les quelques objets des IVe-IIIe siècles avant J.-C. découverts dans la partie la plus profonde de ce troisième niveau indiquent une fréquentation occasionnelle à la période hellénistique.
La quatrième couche forme le niveau le plus récent de la fréquentation du sanctuaire grec qui, d’après le mobilier céramique trouvé, est daté entre le milieu du VIe siècle avant J.-C. et la destruction de Géla par Carthage en 405 avant J.-C. Dans ce niveau, les restes de six bâti-ments ont été mis au jour (G1-2-3-4-5-7 sur le plan).
La cinquième et dernière couche est sableuse. Elle contenait des milliers d’objets liés à la première phase de la vie du sanctuaire grec, datables entre le milieu du VIIe et le milieu du VIe siècle avant J.-C.
De cette fouille exceptionnelle, P. Orlandini n’a donné que deux rapports préliminaires dans la revue Kokalos de 1966 et de 1967. L’importance des découvertes l’avait en effet incité à publier inté-gralement les résultats de cette fouille une fois retraité de son activité académique. L’équipe de chercheurs constituée pour cette tâche, sous sa direction, a donc entrepris un réexamen des données de fouille, complétant ainsi la documentation photographique du mobilier et son catalogue au milieu des années 1990. Le premier volume de la série consacrée à Bitalemi, dédié aux niveaux archaïques du sanctuaire, est maintenant prêt pour la publication.
Stratigraphie du site de Bitalemi par P. Orlandini.
Piero Orlandini.
Les structuresDans la couche 5, de modestes constructions ont été mises au jour, datées du premier quart
du VIe siècle avant J.-C. sur la base des objets associés. Il s’agit d’un petit mur de briques en terre crue (G6 sur le plan) et du bâtiment rectangulaire G8, duquel sont conservées sur le côté ouest six rangées de briques en terre crue disposées en quinconce (appareil isodome), inter-prété comme un naïskos.
5-chapitre 5-mep.indd 241 26/03/13 16:08
242
Une Odyssée gauloiseCHAPITRE 5
La plupart des bâtiments présents dans l’aire sacrée appartiennent cependant à la couche 4 nettement distincte du niveau plus ancien par la présence d’une épaisse couche d’argile, coulée peu après le milieu du VIe siècle avant J.-C. pour fournir une solide base constructive sur le sable.
Sur ce sol induré furent posées plusieurs structures, desquelles deux phases peuvent être distinguées : trois naïskoi plus anciens (G4-5-7), en murs de briques de terre crue, détruits dans le milieu du Ve siècle avant J.-C. probablement suite à un incendie, et des structures plus pérennes en pierre et blocs de grès, destinées aussi à recevoir les fidèles. G1 a été en particu-lier interprété comme un sanctuaire de taille moyenne. Le bâtiment allongé G2, dont seules les fondations sont conservées, possède une ouverture à l’ouest et semble avoir les caractéris-tiques d’un espace de rencontre et de discussion (lesché). Au nord de ce dernier a été mis au jour un bâtiment carré (G3) en blocs de grès de fonction incertaine, presque entièrement détruit lors de la construction de la ferme romaine tardive.
Le passage de la première à la seconde phase de construction, qui caractérise la couche 4, est marqué par deux dépôts votifs particuliers, un de forme semi-circulaire, l’autre rectangulaire.
Plan des bâtiments mis au jour dans le niveau 4 de Bitalemi.
5-chapitre 5-mep.indd 242 26/03/13 16:08
243
En Sicile : fragments d'objets gaulois, gestion du métal et pratiques cultuelles féminines CHAPITRE 5
Le premier était rempli d’une centaine de coupes en pâte claire disposées à l’envers, avec une figurine en terre cuite placée dans l’angle sud-est, tandis que l’autre a révélé des œnochoés en pâte claire, à l’envers elles aussi, et se chevauchant.
Les offrandesLa plupart des découvertes proviennent de la couche 5, où les ex-voto ont été préservés
grâce aux conditions particulières de conservation dues à la composition de sable pur de ce niveau archaïque.
90 % sont constituées de vases à l’envers, isolés ou en groupes, souvent maintenus ensemble par des fragments de gros vases ou des morceaux d’argile. Parmi les offrandes de céramique prévalent les vases de fabrication locale, à pâte claire non vernie ou à décor géométrique (notamment de nombreuses petites hydries) ; les vases importés sont pour la plupart originaires de Corinthe (en particulier de la période « transitionnelle » à la fin du VIIe siècle avant J.-C.), avec une prévalence de kotylai et d’aryballes ; dans la partie la plus profonde de la couche ont également été trouvées des amphores corinthiennes, de Grèce orientale et d’Attique. Les productions ioniennes sont aussi bien représentées. L’aes rude associé à des objets en bronze représente une offrande typique, on en compte une trentaine similaires enfouies dans le sable. Les couteaux en fer sont eux aussi caractéristiques des offrandes de cette couche : ils sont interprétés comme les restes de sacrifices rituels. On trouve enfin aussi, plus rarement, des statuettes de terre cuite et des poids de métiers à tisser.
Dans la couche 4, moins riche en découvertes, les terres cuites de fabrication locale prédo-minent, surtout des protomés et des statuettes de femmes avec des porcelets prêts à être sacri-fiés, associées aux nombreux poids de métiers à tisser et vases achromes sans revêtement (coupes, cruches et petites hydries).
Pour l’identification du culte pratiqué dans ce sanctuaire, nous avons heureusement un certain nombre d’inscriptions sur des vases datant du Ve siècle avant J.-C. contenant le nom de la divinité honorée (Déméter) ainsi que la mention de la fête qui s’y célébrait en son honneur : les thesmophories. Rappelons brièvement quelques caractéristiques du culte de Déméter Thesmophoros fondées sur les rares sources littéraires et épigraphiques qui évoquent
Dépôt votif du niveau 4, remplie de coupes en pâte claire à l’envers.
5-chapitre 5-mep.indd 243 26/03/13 16:08
244
Une Odyssée gauloiseCHAPITRE 5
Dépôts de céramiques dans le sable dans le niveau 5, en lien avec le rituel des thesmophories attesté sur le site de Bitalemi.
Kotyles, pyxide globulaire et aryballe corinthiens issus du niveau 5.
5-chapitre 5-mep.indd 244 26/03/13 16:08
245
En Sicile : fragments d'objets gaulois, gestion du métal et pratiques cultuelles féminines CHAPITRE 5
ce rituel secret. Les protagonistes étaient incontestablement des citoyennes libres et légale-ment mariées, bien qu’il ait pu y être admis aussi, dans une partie des célébrations, les parthe-noi (jeunes femmes en âge de se marier). La discussion autour d’une éventuelle présence masculine pendant le rituel est plus polémique. Le cas échéant, il ne s’agirait que d’une présence liée à l’activité sacrificielle. Suivant une certaine récurrence de dates et des durées variables en fonction des régions où se tenait ce culte, les eugeneis gynaikes (les épouses légi-times et les mères qui participent à la fête) se retiraient sur l’aire consacrée aux célébrations et y séjournaient un certain temps, jeûnant dans un premier temps à la mémoire de la douleur de Déméter pour la perte de sa fille Perséphone, enlevée par Hadès, et partageant dans un second temps des repas rituels, ce qui augure d’une fécondité naturelle et agraire prolifique. Bien qu’il existe des variables, le faciès du rituel restait sensiblement le même dans toutes les thesmophories, caractérisé par une séparation complète des hommes et des femmes ainsi que par un régime sortant de l’ordinaire, où les femmes, célébrant rituellement la fertilité, jouaient, pour une fois, un rôle central dans la perpétuation de la vie de la cité.
(Traduction Lionel Pernet)
BibliographieOrlandini 1966 ; Orlandini 1968-1969.
PRATIQUES RITUELLES DANS UN SANCTUAIRE GREC DE SICILE : FEMMES AUX THESMOPHORIES
Le rite thesmophorique est la forme courante que revêt le culte de Déméter dans le monde grec, à côté du rite singulier pratiqué à Éleusis. Des sanctuaires de Déméter Thesmophoros sont bien connus par l’archéologie à Corinthe, Cnossos, Cyrène ou encore Thasos. Ils sont le plus souvent situés en zone suburbaine, à l’articulation topographique et religieuse de la ville et du territoire, dans une position plus liminale que marginale, puisqu’ils sont le théâtre de pratiques cultuelles qui sont au cœur de la vie religieuse des Grecques.
Les Thesmophories sont en effet un ensemble de pratiques rituelles festives réservées aux femmes dont le scénario, le sens religieux et le dispositif concret sont à peu près les mêmes partout en pays grec, malgré quelques variations et nuances régionales. L’ « universalité » de ces fêtes s’explique par leur ancienneté. Elles composent une véritable « religion des femmes » dont les cérémonies sont profondément enracinées dans la culture grecque car elles remontent vraisemblablement au VIIIe siècle avant J.-C. pendant lequel la conscience civique se forge. Chez Hérodote, ce sont des meurtrières de leurs maris, les Danaïdes, qui introduisent ces fêtes d’origine égyptienne (II, 171), ce qui montre que l’on reconnaissait dès l’époque clas-sique aux Thesmophories une étrangeté mâtinée d’inquiétude toute masculine. Des sources littéraires rapprochent les thesmophoria de « mystères » donnant lieu à des initiations comme à Mykonos, mais Hérodote considère, il est vrai, que la forme originelle de ces mystères de Déméter ne s'est conservée que dans le Péloponnèse. L’offrande recognitive de ce culte est le porc, dont on retrouve dans les sanctuaires les restes, des reliefs de repas, ou des représenta-tions sous la forme de figurines en terre cuite.
Le rite et le déroulement des célébrations thesmophoriques sont fondés sur un récit mythique. Déméter est fille de Cronos et de Rhéa et appartient donc à la génération des Olympiens, c’est-à-dire celle de Zeus, qui est de surcroît le père de sa fille Korè-Perséphone. Déméter n’est donc pas une ancienne divinité cosmogonique comme l’est Gaïa, mais une puissance actuelle et efficace. Sa mythologie est essentiellement composée d’un drame : l’enlèvement de sa fille par un frère de Zeus, Hadès, alors qu’elle grandissait avec ses sœurs
François Quantin
5-chapitre 5-mep.indd 245 26/03/13 16:08