L'"Apollinisation" de l'imagerie légendaire à Athènes dans la seconde moitié du Ve siècle
-
Upload
univ-lyon2 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of L'"Apollinisation" de l'imagerie légendaire à Athènes dans la seconde moitié du Ve siècle
L, « APOLLINISATION »
DE L'IMAGERIE LEGENDAIREA ATHÈNES
DANS LA SECONDE MOITIE DU V" SÈCI,E
C'est au lendemain des guerres médiques, on l'a souvent dit, que la religion apol-linienne a trouvé, en Grèce, son expression la plus achevéel. Les odes dePindare, l'Orestie
d'Eschyle, le fronton Ouest d'Olympie témoignent du prestige sans faille du dieu de
Delphes. C'est paradoxal, puisque les prises de position de l'oracle, à la veille de l'invasionperse, auraient dû susciter, de la part des vainqueurs de 48o, une réaction négative2. Maisles prêtres de Delphes surent habilement exploiter l'élan de ferveur nationale à la gloiredu sanctuaire. Pendant trois quarts de siècle, Etats grecs et simples particuliers ont manifestéenvers Apollon une confiance et une fidélité inaliénables3, du moins en âpparencea. AAthènes, la crise religieuse n'éclata au grand jour qu'après la dure épreuve de la peste etles échecs de l'armée athénienne devant la coalition péloponnésienne5. Le malaise, pourtant,était plus ancien. Avant 45o déjà,I'imagerie en porte le reflet : non qu'Apollon y subisse
la moindre éclipse, mais la manière dont il est présenté trahit un doute, une inquiétude.Les mythes apolliniens sont les plus populaires du répertoire6 ; pourtant, le dieu de Delphesest, de tous les Olympiens, celui qu'on met le plus volontiers en questionT. Cette opposition
- cette polarité pourrait-on dire - se manifeste clairement chez Sophocle et chez Euripide.
r. K.A.Prrrrr,Apollon.DieWandlungseinesBildesindergriechischenKunst(1943),p.69;E.BTELEFEL»,WZGreifs-ualil, r954-t955, p. 38o et p. 398. Dms I'imagerie céramique, cependant, c'est entre 425 et 38o que Ie n répertoire delphique ,a connu son plus grand succès : H. Mstzcrn, Les représentations dans la céramique attique du IVe siècle (tg5t), pp. r85-r86.
z. Justification de ce paradoxe : E. R, Dooos, Les Grecs etl'irrationnel (trad.franç.,a977),pp.8r-83.Onn'auragarde d'oublier que, pour les Aüéniens, Apollon est aussi le dieu de Délos, et que les deux Apollon, le Pythien et le Délien,sont un seul et même dieu, vénéré sous des épithètes différentes. Apollon Délien,infra, n. 55.
J. Contra : W. Bumrnt, Griechische Religion der archaischen und der hlassischen Epoche (1977), p. r88.4. P. AlreNrnv, REAr6t, r9S9, p. 4rz i «... après les guerres médiques, le respect dont on entoure l'oracle paraît
plus formel et traditionnel que profond. , Cf. aussi M. P. NrLssoN, Cuhs, myths, oracles and politics in ancient Greece (t95t),p. 127.
5, BURxERT, o1t. cit, (supra, n. 3), pp, 465-466. Autre paradoxe : c'est précisément en cette époque de remise enquestion des croyances traditionnelles que les seuls procès en impiété que l'on connaisse ont été intentés à Athènes (B. SNrr,r,,Der Glaube an die olympischen Gôtter, in Die Entdeckung des Geistes [tgl1l,pp. lz-lù.
6. Mrrzcrn, op. cit. (supra, n. r)r pp. 25-27 et p. r55. De même les scènes de libation avec Apollon ou de sacrificeen son honneur : E. Srrrror.r, Opfernde Giitter (1953),pp.36-46; N. ArFrERr-P. E. Anres-M. HrRurn, Spina(r958),p.56et pl. 85-87 ; L. Lecnorx, Etudes d'archéologie numismatique (t974),pp. 46-47 etpl.6 ; Auktion, 56, r9 féwier r gïo,pp. 52-to7et pl. 49. Départ d'Apollon: V. Rrar,, Studien zur Entwicklung der Vasenmalerei im ausgehenilen 5. Jh, a. Chr. (t973),pp.28-?g.
7. F. BôMER, Gedanken über die Gestalt des Apollon und die Geschichte der griechischen Frômmigkeit, lrfte-naeun, 4t, 1963, p. 276,
109RBv. ARCH., r/r982
ApoUon srr p:esque :ouiours au centre du débat, mais, chez Euripide, le non-lieu prononcéau dénoue;::Ê':: i.e iai: pas oubiier les accusations et les condamnations morales dont ledieu a éré I'objer au cours du dramd.
L'iaraserie u-rfre la même vision kaléidoscopique. A côté des mlthes, nombreux,qü glori5en1 ie fils de Léro, i1 en est d.'autres, bien ancres dens la tradition figurée, qüdonnent du dieu une représentation moins flatteuse. Plus uoublânt encore : desormais,Apolion tigure fréquemment en bordure de scènes où sa presence ne se justifie en aucunefaçon du point de vue du m).thee. Dira-t-on qu'il est le témoin de l'action ? Ou l'incarnationde l'ordre universel ? Les choses ne sont pas aussi simples, car les mythes grecs nous fontassister à des renversements de siruation spectaculaires. Tel héros, favori des dieux, devientl'objet de leur courroux ; tel autre, d'abord malmené par le destin, voit sa vertu finalementrécompensée. Comment savoir si Àpolion, sur les images qui nous occupent, consacre letriomphe passager du héros, ou, au contraire, laisse présager la catastrophe finale ? L'inter-rogation sur le fond se double d'une interrogation sur la forme : ce dieu qui contemple,des coulisses, le déroulemenr de l'action, à quel niveau se situe-t-il et de quel côté se
trouve-t-il ? Est-il le garant d'une o moralisation , des mythes ?10. Est-il un sigrc quel'imagier utilise à l'intention de ceux qui regardent le vase ? Est-il simplement I'adversaireinvisible avec lequel le héros se bat ou l'allié grâce auquel il l'emportera dans une épreuvequi n'est plus à 1a mesure des seules capacités humaines ? Même si l'on connaissait tousles aléas des relations entre Delphes et Athènes, durant ces deux ou trois générations(entre 45o et 38o), on ne pourrait apporter une réponse univoquell. Le problème n'estpas seulement d'ordre religieux, politique ou social, il est d'ordre iconographiquel2. Lesvases rassemblés dans le Catalogue constituent une série homogène, non pas du point de
8. J' de RoMILLY' La tagédie grecquez (rg7ù, p. rr2 et p. r48, n. r (ion) ; S. Saib, La faute tragique (t978),pp. 235-238 ( Andromaque ) et pp. 258-259 ( Oreste ) ; R. Screenrn, L e héros, le sage et l'événement (196+), pp. 7t-72 ( Elecle etIon), Sw i'attitude respective des deux poètes en face d'Apollon : H. §[. Pemr - D. E. \ÿ. Wonmrlt, The Delphic oracte(i956), i, pp. r9z-r93.
9. On comparera l'insertion des oracles dans l'æuwe d'Hérodote : la plupart, apocryphes, reproduisent des motifsbien connus du folklore et de Ia mythologie. Cf. R. Cnena:r, La littérature oraculaire chez Hérodote (1956),passim. Voir aussiM' P. NILssoN, Geschichte der griechischen Religim,ls (1967),pp.763-764, et J. FoNreNnost, The-Delphic oracle (:,g78),p. 234. Prééminence d:Apollon chez Hérodote : A. Lrs«v, Geschichte der griechischen Literatuê (tg7t),p.369, Sur le canevas« tlagique » des Histoires d'Hérodote : SAio, op. cit. (n. pÉc.),pp.264-267.
ro. Selon O. Gnwnr, Griechische Mythologie unil Religionsgeschichte (t9o6),1I, pp. 999-roo4, la moralité des OlSxn-piens s'affirmerait essentiellement dans le châtiment des hybristai. C'est néanmoins au travers du mythe que s'est d'abordmanifestée la « dialectique des dieux immoraux et d'une morale religieusg » (BûRKEnt, op. cit. fsupra, n. 3]: pp, 37ri76).Sut la n morale » d'Apollon et de Delphes, voir les remarques restrictives de Nrr.ssoN, op. cit, (n. préc.), pp. 648-65r. Demême, M. Ertt,oE, Histoire des croyances et iles idées religieuses,l (t976), pp. z8o-z8z: Apollon ne mariifeste pas toujoursdes qualités « apolliniennes ».
rr. G. Derx, Athènes et Delphes, Suppl.IfSCP (n.d.), pp. 39-69, qui conclut : « La part d'Athènes dans ce que I'onpeut appeler, avec un peu d'exagération, la doctrine et l'éthique de Delphes, ne saurait être déterminée.., Il n'en reste pasmoins que des écrivains athéniens sont deÿenus en fait les apôtres zélés du culte delphique.,. Delphes et Athènes ont mieuxfait que se tolérer mutuellement; elles ont uni leurs forces morales , (pp. 58-59).
rz. Dâ.vx, loc. cir. (n. préc.), p. 58 : « Au clergé delphique il apparaît vite que l'agent de propagande le plus efficace.,.est Athènes : écrivains et potiers de l'Attique portent au loin la gloire d'Apollon Pythien. , Ce qui n'implique nullementque les ceuwes littéraires reflètent touiours et immédiatement les événements contemporains : J. C. KAMrRlrrx, Mythe etréalité dans I'æuwe d'Euripide, EntrFondHardt,6, 1958 (r96o), p. r8.
110
wg.i
rl.it::
vue chronologique, mais du point de vue structurel. A la question : « Quelle est la fonctiond'Apollon dans l'image ? », nous apporterons des réponses diverses, mais convergentes.Car l'insistance avec laquelle un phénomène se manifeste - en l'occurrence l'apparitiond'Apollon dans plusieurs scènes légendaires où on ne l'attendait pas - est souvent plusrévélatrice encore que le phénomène lui-mêmelB.
CATALOGUE
r. Cratère en calice d'Adolphseck 77 : Héraclès et le taureau (fig. r).Peinue de Cécrops (ARVL, p. ry461r; CVA, r, pl. 46-48).
z. Cratère en calice d'Adolphseck 78 : Thésée et le taureau (fig. z).Peintre de Cécrops (ARV'z, p. ry4612 i CVA, r, pl. 49-5r).
3. Cratère en calice de Léningrad b z68o : héros combattant le taureau (fig. :).Proche du peinue de Pronomos (ARVt, p. ry37 15; U. Hausmann, Hellenistische Reliefbecher ausattischen und bôotischen lVerkstiitten U95g), pl. 55 : détail).
4. Cratère à volutes du Louvre CA 3482: mort d'Àctéon (fig. +).Peintre des Satyres laineux (ARV2,p.6ryb;P. Devambez, Mon. Piot,55,1967,p.85, fig.6,pl. 3-4; K. Schauenbvg, JdI,84, 1969, pp. 30-33, fig. r et 3).
5. Pyxis jaüs à Heidelberg, collection privée : Penthée et les Ménades (fig. 5).(J. D. Beazley, CB,II [1954], p. z iL. Curtius, Pentheus, 88. BlVPr, 1929, pl. r ; H. Philippart,Iconographie des Bacchantes d'Euripide [r93o], p. 5rlryz, pl. I b.)
6. Lécythe pansu de Ruvo, J 1538 : Thamyris et les Muses.Peintre de Meidias (ARVt, p. 4l.4116; H. Sichtermann, Gùechische Vasen in Unteritalien[1966], p. zz,K rz, pl. r9-zz).
7. Cratère à volutes de Ferrare T e7 (inv.3o33) : Thamyris et les Muses.Polion (ARVL,p.n7tlt;N.Alfieri-P. E. Arias-M. Hirmer, Spina [rS58], pl. ro8-rrr;CVA,r, pl. rz).
8. Hydrie de Florence inv. 8r.947 : Phaon.Peintre de Meidias (ARV2, p. ryrzlz; E. Simon, Die griechischen Vasen 1rg76l, pl. zt7-zrï etpl. L couleur ; CVA, z, pl. 6o-65).
9. Lécythe pansu du British Museum E 696 : Gdipe combattant la Sphinx (fig. 6).Manière du peintre de Meidias (ARVI, p. ry25149; G. Murray, ÿHS, 8, 1887 pl. 8r).
ro. Cratère en calice de Lisbonne, Fondation Gulbenkian inv. 682 : rapt des Leucippides (fr9. ù.Peintre de Coghill (ARVL, p, ro4zlr; M. H. Rocha Pereira, Greek oases in Portugal 1196zl,pl. z83z); H. Metzger, Collection Hélène Stathatos,Ill [1963], p. r77, fig. 8z).
rr. Cratère en calice de Gênes r9rr.163 : Bellérophon et la Chimère (fig.8).Proche du peintre de Pronomos (ARV,, p. ry3716; K. Schauenbwg, JdI,7t, t956, p. 65, ûg. g).
rz. Fragment de cratère en calice de Corinthe C.3r.8z: Bellérophon et la Chimère (fig.S).Premier quart du rve siècle (F. Brommer, MlYPr, t91zl54, pl. l; I.D. Mac Phee, Hesperia,
45, 1976, pl. 9o).13. Hydrie de Berlin F z@4: Cadmos et le dragon.
Peintre de Cadmos (ARV2, p. n87fi3; F. Vian, Les origines de Thèbes [1963], pl. 5).
13. Nous tentons ainsi de répondre à la question que posait Henri Mrrzcrn, o1t. cit. (suprart r)rp. r85 : « Le succèsdu répenoire « delphique » dans la période qui va de 425 à 38o environ.,. répond-il aux tendances profondes de la religionathénienne ou n'est-il que l'effet d'une mode parmi les artisans du Câamique ? ,
111
r4.
r5.
Hydrie de Berlin F 2633: jugement de Pâris (fig. ro).Peintre de Cadmos (ARVZ, p. rû7fi2; §0'. Real, Studien zur Entasicklung dq Vasennalerei. imausgehenden S. ïh.o. Chr. lt97l, pl. rr).Cratère en calice de Berlin irlv.3974: supplication de Télèphe.Début du rve siècle (H. Metzger, Les représmtations dans la ceramique attique du IVe siècle
[r95r], pl.lSlr; J.-M. Moret, L'Ilioupersis dans la cérarnique italiote [tg757, pl. Sz).16. Fragment de lékanis de Tarente inv. 4529: scène myüologique perdue (fig. rr).
(Manière du ?) peintre de Meidias (ARVt, p. 42617).
Du « beistehender Gott ), an <( zuschauender Gott »
Apollon, le moins enclin de tous les dieux grecs à la fonction du BeistanüL, devient,aux côtés d'Athéna, le patron d'Héraclès et de Thésée. Si l'on ne connaissait que l'un des
deux vases (Cat. r et Cat. z) du peintre de Cécrops, on chercherait dans le mythe ce qui apu lui assurer cette préséance. Mais il n'existe aucun lien, sur le plan de l'action, entre lehéros et les divinités. Le geste d'Apollon, dont l'index est pointé sur le taureau (Cat. z),est purement déictiquels; quant à l'offrande d'Àthéna (Cat. r), elle n'influera en rien surle déroulement du combat d'Héraclès. La relation s'établit plutôt à un niveau conceptuel :
non pas en fonction de ce que les héros sont (entre Héraclès et Thésée, comme entitésmythiques, il existe des différences essentielles), mais de ce qu'ils représentent. Le peintrede Cécrops a conçu les deux mythes de façon convergente, on pourrait presque dire symé-trique. Athéna symbolise la victoire désormais acqüise; elle manifeste, pil sa présence, lareconnaissance des Olympiens envers les héros civilisateurs. Apollon incarne une tout autreéthique. Garant de l'ordre établi par Zeus, il personnifie l'équilibre universel; parce qu'ila vaincu le serpent Python, il est le patron, ou l'archétype, des héros tueurs de monstres.Inédite dans l'imagerie, une telle relation demande une explication. Dans la Vie de Thésée,
Apollon, ou son oracle, joue un rôle de tous les instants et on accuserait Plutarque de« delphisme », si l'imagerie de la fin du ve siècle ne laissait prévoir cette mutationlG. Le rôlesimilaire joué par Apollon dans l'&0Àov d'Héraclès (Cat. r) monrre qu'on n'a pas affaireà un phénomène isolé1?. Sur ce point, le peintre de Cécrops et ses émules font figure de
précurseurs, car l'intimité des liens entre Héraclès et Apollon ira se resserrant. Quelquesdécennies plus tard, les images à la mode montreront Apollon accueillant Héraclès sur
14. G. Brcrrr., Gôtterbeistand in iler Bililüberlieferung griechischer Heldensaget (196r), p. 78 et pp. 8z-84 : Apollonest' tout au plus, o 11919.1 aus der Feme. » Sur Apollon, « Gott der Feme » : V. F. Orro, Die G?itter Griechenlandss (1947),p. 65.
15. D'après ceftaines versions tardives, cependaot, Thésée avait sacrifié le taureau à Àpollon : Pr.ur., Thes., t4 iDroo.,IV, 59. Cf. Bccxnr., op. cit. (n. préc.), p. 7o.
16. Ptut., Thes., 18,24 et 26. Thésée et Àpollon : Brcxn, op. cit. (supra, n. r4), pp. 67-7r. Thésée et Delphes :]. Derne»as, Les thèmes de la proltagande delphique (1954), pp. r6g-t7o et pp. r9o-r94; FoNTENRosE, o1t. cit. (supra,n. 9),L zz, L 47 et L roz. Cependant, Ies oracles relatifs à Thésée concernent le fondateur de l'Etat athénien, non I'auteur des&.0Àa : Peaxr-§7oRMELL, op. cit. (supra, n. 8), I, pp. 3o9-3ro.
17. Héraclès et Apollon : BEcKEL, op. cit. (supra, n. r4): pp, 5o-5r, p. 53 et p. 57. Héraclès et I'oracle delphique :Pan«e-VoRMEu., op. cit. (supra, n.8), pp. 34o-343.
112
r
r
1. Cratère en calice d'Adolphseck77 : H&aclès et le tâureau (cat. r).
2. Cratère en calice d'Adolphseck78 : Thésée et le taureau (cat. z).
l'Olympe, ou, mieux encore, à Delphes, dans le sancftraire où iadis, encore ennemis, les
deux frères s'étaient disputé le trépied prophétique18.
Dans la tragédie grecque, les personnages ne sont pas tous engagés au même degrédans l'action. Certains se font les porte-parole du poète, établissant, au moins temporai-rement, un lien entre l'auteur et son public. Sur les vases, de même, Apollon sert de traitd'union entre le mythe et le spectateur. Il a une fonction ^xplicative. Il explicite une manièred'être des héros non seulement dans l'instant choisi par l'imagier, mais, plus généralement,dans l'ensemble cohérent que constitue leur histoire, c'est-à-dire leur m)"the propre.Dans l'imagerie archaïque, on observe une adéquation parfaite entre la psychologie des
héros et la volonté des dieux qui interviennent à leurs côtésle. Le beistehende Gott se révèle
r8. MErzcER, op.cit.(supra,n. r),pp. r8o-r8r etpp.zro-zz4.HéraclèsetDelphes: DEFRADAS, op.cit.(supra,n,L6),pp. r36-r43, Héraclès, alternativement champion et adversaire d'Apollon : ]. FoNrrNnose, Python : a stud,y oJ Delphic mythand its origins (ISSS), pp. 36-44 et pp. 4or-4o5.
r9. Action humaine et action divine progressent parallèlement, mais c'est celle-ci qui infléchit celle-là : B. SNrr,r,,opt. cit. (supra, n. 5), p. 35.
113
3. Cratère en calice deLéningrad b z68o (cat. 3).
tout entier dans cette action instantanée2o. A la fin du ve siècle, les héros qui agissent
- quand ils agissent encore - et les divinités qui les regardent, n'existent plus seulementen fonction de la scène représentée; ils sont présents par toutes les implications de leurbiographie mythique2l. Dans cette perspective, le combat contre le taureau a valeur de
paradigme, et le choix de n'importe quel autre exploit aurait pu y satisfaire, sauf que leparallélisme des deux destinées héroïques n'aurait pas été aussi évident. Dans cette méta-morphose du dieu-acteur en dieu-spectateur, Apollon a joué un rôle prépondérant. Incar-nation de la morale, dispensateur de l'oracle, maître du présent et de l'avenir, il appartientaux deux ordres simultanément : l'ordre narratif (du mythe représenté) et l'ordre normatif(du spectateur).
zo, Brcxrl, op. cit.(supra, n. r4), p, 55 et p. 70 : même s'il est inactif, le dieu indique, par sa seule présence, quele héros est son protégé ou qu'il a « conseillé » celui-ci.
zr. De même, les dieux d'Euripide « rattachent I'action propre de la pièce au contexte mythologique plus largedont la matière de celle-là a été tirée » (KAMERBEBK, loc, cit. lsupra, n. rz], p, rr).
115
e)d)
4. Cratère à volutes du Louvre CA 3482 : morr d,Actéon (cat. 4).
Sa position marginale, sur le cratère de Léningrad (Cat. 3), n'équivaut nullement àune relégation I s'il prend du recul, c'est parce qu'il est juge en même temps que partie.Le trépied monumental autour duquel les Létoides sont assemblés, et, plus encore, l,indif-férence de l'imagier dans la caractérisation du héros, montrent que la valeur connotative
- apollinienne - l'emporte sur la valeur dénotative - l'action représentée. En faveurde Thésée, on alléguera la présence du royal témoin et la suppression de la léontézz. Maisl'attitude du combattant et le mouvement de l'animal reproduisent exactement ceux d,Héra-clès et du taureau sur le cratère d'Adolphseck (cat. r). spectateurs « eljsçtifs ,, lesOlympiens constituent le principal centre d'intérêt, tandis qu'Apollon, spectâteur u sub-jectif », se détache de l'action, à l'instar du deus ex machina,ou, plutôt, du oeàq æpoÀoyi(ov.
Dans la scène d'Adéon (cat. 4), Apollon indique que nul ne peur échapper à lacolère divine s'il a enfreint la loi d'ordre universel23. Mais il n'est pas l'exécuteur de la
zz. Ala suite de F- Bnorrrmnn (CVA, Adotphseck, t frg56l, p.35), U. HausueNN (Hellenistische Reliefbecher ausattischen und biiotischen Werkstd,tten [r959], pp. 79-80) et sulizr.yi çÀÉVi, p, ,llù se sont prononcés en faveur d,Héraclès.Mais Pirithoüs est présent, comme sur le cratère d'Adolphseck 78 (Cat. jf , "ig"-""t de flus en faveur de Thésée. Dansla troisième édition de F. BRoMMER, Vasenlisten zur griechisehen Heldinsage (t973)-,1e vase n,afparaît ni dans Ia liste « Herakles-Stier », ni dans celle « Theseus-Stier ,. - ' '''"
23. P. Drvervrarz, Mon. Piot, 55, t967, Pp. 77-ro4, notarnment pp. 8o-9o, a étudié avec pénétration l,arrière-fonddelphique de cette image. Dans le mythe d'Actéon - par excellenc" te -yfre aét;nyU;t châtiée I k faute paraît pounanravoir été inventée après coup pour iustiûer la métamorlhose et la mise à mort, D,où Ies versions contrad.ictoires sur le crimed'Actéon : §f. BuRKERT, Homo necans (tg7z),pp. rz7-iz9 (références aux témoignageslittéraires : ibid.,n. rr et n. rz).
116
vengeance; ce rôle incombe à Artémis, qui frappe le coupable dans la sphère d'activitéqui lui est propre2a. Apollon assiste, de loin, à la passion du héros. Sa présence confèreà la scène une valeur double : à l'événement proprement dit s'ajoute la leçon qu'on peuten tirer. La tragédie est plus philosophique que l'histoire, disait Aristote. Vue par le détourd'Apollon, la destinée d'Actéon prend, de même, une valeur universelle2s. L'image n'estpas moralisante ; au contraire, c'est la moralité du mythe (au sens où l'on parle de la moralitéd'une fable) qui s'incarne en la personne d'Apollon26.
L'image, dès lors, se prête à une lecture qu'on pourrait appeler « méta-mythologique, :
l'interprétation apollinienne donne à deux mythes distincts, celui de Penthée et celuid'Àctéon, une signifrcation similaire. Dans les Bacchanres d'Euripide, Cadmos met en gardePenthée, à qui il rappelle la fin lamentable d'Actéon2?. L'avertissemenr souligne, par avance,le parallélisme des deux destinées. Sur la pyxis de Heidelberg (Cat. 5), Apollon se fair,au nom de Dionysos, le vengeur de l'hybris. Penthée est un contempteur des dieux, un0eopr,d,1oq28. Or, tous les Olympiens sont solidaires de l'affront infligé à un seul d'entre eux.La substitution d'Apollon à Dionysos, dans le plus dionysiaque des mythes grecs, nesignifie pas une assimilation des deux divinités, ni même une fusion de leurs pouvoirs2e.Le peintre de la pyxis n'a pas non plus illustré la nouvelle théologie delphique, qui paraitApollon d'attributs dionysiaques et réservait à Dionysos la place d'honneurso. Apollondéfend ici, contre Penthée, les prérogatives d'un frère bafoué. Habituellement, dans l'ima-gerie, on assiste à la mise à mort de Penthée, et c'est Dionysos qui dirige personnellementl'attaque3l. Apollon se distancie de l'action, sur le plan spatial et sur le plan temporel;il laisse seulement pressentir le drame qui se prépare. Isolé dans un Olympe abstrait que
24. Parfois, c'est Lyssa qui excite la meute à la place d'Artémis : crarère en cloche de Boston oo.346, du peintrede Lycaon (ARV2,p' to45l7; A. D. TRENDALL - T. B. L. Vrssrrn, Illustations of Greek Drama lrg1rl,n1, i, zS;. f-yssaest aussi fréquente dans l'imagerie italiote qu'Apollon y est rare. Apollon : cenochoé d.e Tarente, du peintre de Felton(RVAp,I,7163, pl. Sllz) et situle de Bloomington, Univ. of Ildiana Art Museum inv. 7o.g7.r @V,qp,II, r8/rr;K. ScnauBNgune, JdI,84, 1969, p. 34, frC. 4-6).
25. Le mythe d'Actéon permet de mettre en évidence une diférence essentielle entre la poésie et les arts figurés enGrèce : celle-là s'est interrogée sur Ia faute et ses mobiles, ceux-ci n'ont guère représenté que le Àâti-".rt. Dans l,imagerie,la scène finale, celle de l'expiation, suffisait à rappeler tout Ie déroulemeut antérieur de l'action.
26. A l'ü6pu6 s'oppose l'eùvoçr.la (déià dans }lor.z.., Od., XVII, 487), dont Apollon est le garanr. Cf. U. von Wra-Mowrrz, Der Glaube der Hellenen,Ils (1976),pp. t2r-r22. Eùvop.i,a, personnifi.ée, apparait avec Àpoilon sur l'hydrie du peinuede Meidias avec Phaon (Cat. 8) : infra, p. rzo.
27. Evn., Bacch.,23o,337-340, 1227 et r2gt.28. §7. Nrsrrr, Legenden vom Tod der Gottesverâcbter, it Griechische Studien (rg4l), pp. 567-596, notarnment
p. 573.29. Rapports Àpollon-Dionysos : BumrRr, op. cit. (supra, n. 3), pp. 34r-343 j H. JraNuarnr, Dionysos (rg5t),
pp. r87-r98; E. Roror, Psychez (tBgB), II, pp. 5z-6r. Apollon Isménios, principale divinité de Thèbes avec Dionysos :PArrs.,IV,27,6. Rapports Thèbes-Delphes : Drnneoas, op. cit.(st4tra,n, 16), pp. 19-6r. On remarquera qu,icic,estApollonqui s'immisce dans la sphère dionysiaque : Ie processus inverse surprendrait moins.
3o. Mtrzcrn, op. cit. (supra, n. r), pp. tg2-rgo, admet un « échange » des deux divinités sur quelques documentsexceotionnels. Cf. ibid., p. r9o : « Non content de régner sur Ie thiase, Apollon va jusqu'à se substituer à Dionysos dans lerôle d'amant d'Ariadne et à occuper, au centre du tableau, la place qui, su! tant d.'autres vâses contemporains, éiait réservéeà Dionysos. »
3 r. Ainsi sur le couvercle de pyxis du Louvre G 445 (H. Pxu.rrrAnr, Ico nographie des Bacchantes il'Euripiite ltg3o),pl. 8; E, Torus*lo, Sic. @mn., rr, 1958, p. 234, fig. to).
117
5. Pyxis, iadis à Hei-delberg, collectionprivée : Penthée et lesMénades (cat. 5).
la compagnie d'Artémis suffit à évoquer, il joue de la lyre. Cette superbe indifférencerappelle la plainte douloureuse de Créüse : où 8è xtïr*pq x),&(er.q1z. Mais l'instrumentd'Apollon a un pouvoir plus redoutable encore, nous le savons par Pindare : 6ooæ 8è g.inegLï,r,xe Ze[ç | dtü(owær,33.
32. EuR., Ion, go;.33. PrND, Pf,rlr. ,I, z5-z6,Polatité arc-lyre chez Apollon : Prrnr, op. cit. (supra,a. r), p. 69, et ELrAot, op. cit. (supra,
n. ro), pp. 286-287.
118
La oaleur allégorique
Ni Thamyris ni les Muses, sur le lécythe de Ruvo (Cat. 6), n'ont l'attitude qu'onattendrait compte tenu du mythee. Le peintre de Meidias a voulu rendre sensibles les
effets bienfaisants de la musique, évoquant les sentiments que le joueur de cithare éprouve
et fait rayonner autour de 1ui35. Àpollon et Aphrodite ne représentent pas des forces rivales ;ils expriment les composantes, distinctes mais complémentaires, de la pr.ouor,x! æcruàe[0c36.
Phaon (Cat. 8) et Àdonis, eux aussi, se font lyricinesBT pour séduire leur amante, tant ilest vrai que les joies de l'amour sont inconcevables sans celles de la musique. On ne pourraitmieux démontrer les pouvoirs réciproques d'Aphrodite et d'Àpollon38. Entre Thamyris, leprovocateur des Muses, et les bien-aimés d'Aphrodite, Adonis et Phaon, il n'y avait pourtantguère de ressemblance. Le peintre de Meidia§ a surmonté l'antinomie en prêtant aux
divinités (plan connotatif) un rôle différent de celui qu'on connaît au travers du mythe(plan dénotatif)3e. Sur le cratère de Ferrare (Cat.7), comme sur le lécythe de Ruvo (Cat. 6),Apollon reste en dehors de I'action I il n'est pas le rival de Thamyrisao. Placé en bordurede la scène, il a un rôle explicatif. Cette distanciation du dieu s'exprime, visuellement, parune figure avec laquelle il est en conversation (Léto : Cat. 8), ou par un élément de décorqui le sépare des autres personnages (le mépied : Cat. 7)a1. Il lui arrive de n'être présent
34. C. Roarnr, Die griechische Heldensagea (r9zo), p. 4t4t t, 5: « Es scheint hier eine literarisch nicht bezeugteSagenform vorzuliegen, wonach Thamyris entweder überhaupt oder wenigstens anfânglich ein Günstling der Musen war. »
Idée reprise par G. M. RTcHTER, in G. M. Rrcnrrn - L. F. Har.r-, Red-figvreil Athenian oases in the Metropolitap,Musewnof Art (1936), p. zo4.
35. HÉs., Th.,94-95 t
Èx .yctp ror, Mouoé<ov xal &x166).ou 'Aæ6).lovo6,iivSpeç &ouôoi, ëcrorv èæl 106va xai w.9agrc:uai.
36. Le peintre de Meidias, qui a représenté Aphrodite aux côtés de Phaon (Cat. 8) et d'Adonis (hydrie de Flo-rence 8r.948 : ARVZ,p. r3rzlt; G. Nrcor,r, Meiilias etle stylefleuri [r9o8],pl. 3lztG. BrcÂrrr, Meiilias : unmanieristaattico lr947l, pl. 3-4) l'a introduite aussi, contre toute attente, qon seulement dans le mythe de Thamyris (Cat. 6), maisencore dans celui de Mousaios (péliké de New York J7.tt.23t ARVz,p,t34h t G.M.RrcErER, 1JA,43,t939,pp.3-6,û9. r-3; BEcATTI, op. cit., pl. rz-r4).
37, Il pourrait s'agir encore d'une contamination, le motif ayant passé de Thamyris à Phaon (Cat. 8) et à Adonis(hydrie de Florence 8r.948 : n. préc.). Mais Anchise, lui aussi amant d'Aphrodite, ioue de la lyre sur I'Ida (Hym. hom.Aphr.,79-8o), tout corrme Pâris dans l'imagerie (I. RAAB, Zu den Darstellungen des Parisurteils in der grieehischen KunstIrg7zl,pp.65-66). Même Egisthe devient prouor,xà6 d,v{p sur les vases peints : J. G. Gxtrrtru, AJA,7t, 1967,pp. t76-r77 ;M. L Davrrs, BCH, 93, 1969, pp. z4o-z6o 1r»., Opusc. Rom., g, 1973, pp. r22-t23 i J. Mac lNrosn SNvonn, lÏ,4, 80, rgi6,pp. r89-r9o.
38. Àpollon inventeur de la musique :Ptvx-, De Mus., 14 (: r r:5). Cf. F. Drnrxrrrn, Apollon, Gott und Erzieherdes hellenischen Adels, in Ausgewii hbe SchriJten (r97o), p. 39.
39. Thamyris est mis en parallèle avec Marsyas (PAUS., X, 30, 8-9 : Nekyia de Polygnote), avec Amphion (Peus.,IX, 5, 9-r o) et avec Eurytos (Luc., Piscat, 6), tous trois des hybristai notoires. Sur la cécité cômme châtiment de l'hybristès :
GRUPPE, op. cit. (supra, n. ro), p. roo2, n. 3 ; A. LEsKy, Die Maske des Thamyris, in Gesammebe Schriften (1966), p. 169,
40. Conta : H. Kollrn, Musih und Dichtung im alten Griechenland (1963), pp. 39-4r, dont I'interprétation nousparaît inacceptable. Il n'y a qu'une seule mention d'Apollon comme adversaire de Thamyris i ctnta se (scil. Musas) etApoll'inem carmine suo contendentem (Myth. Vat., I, r97), On gardera en tête la distinction établie par Àpollodore entreMarsyas (1, 4, z l fiÀ0ev eiq ëpr,v zrepl g,ououxflÇ 'Ard).tr<»vu) et Thamyris (I,3, 3 : æepi pr.ouor,x!6 lpuoe Moüo*16). D'ail-leurs, sur les deux vases (Cat. 6 et Cat. 7), Apollon a pour attribut non pas la l1re, mais une branche de laurier : « als Schieds-richter beim Agon », selon L Vrrr,rn, Der Agon im Mythos (tg74,p.6g.
4r. Sur le lécythe de Ruvo (Cat. 6), il détourne la tête : VETLER, op. cit. (n. préc.), p. 69, reprenant une idée deFurtwângler, y voit le signe du mécontentement du dieu et du châtiment imminent,
119
qu'au üavers de son griffon, allusion symbolique qui confirme le sens que nous lui prêtonssur les autres imagesa2. Les xoana évoquent la présence divine des Muses (Cat. 7), le griffoncelle, invisible mais combien efficace, d'Apollon.
Le climat apollinien du vase de Phaon (Cat. 8) n'est pas moins inattendu. Les réunionsfamiliales autour d'Apollon ont pour cadre le sanctuaire de Délos, ou, plus fréquemmentencore, celui de Delphesa3. Ce groupe, étranger au mythe de Phaon, montre à quel niveauil faut chercher le sens de l'imagee. Apollon incarne l'amour juste, eüXocprç (Eur., Med.r63z),celui qu'apportent l'd.,pew. et l'eüào[iæ (ibid.r6z8-6zg)a5. Ce n'est pas un hasard si, sur lesvases de cette époque, les Olympiens apparaissent fréquemment entourés de personnifications(Er}à«rpovict, 'Tyleloc, Eùvoçr.ûæ, EùruX[æ, 'Aæovlcr, Ilar,8r,&) qui incarnent les bienfaits del'existencea6. Le plus remarquable est que ces vertus accompagnent, indifféremment,Apollon, Aphrodite et Dionysos - signe d'une conception plus abstraite des divinitésa?.Dans cette imagerie, la personnification naît de la combinaison de l'image et du moÉ8 :
nécessité iconographique, puisque la tradition n'avait pas encore inventé, pour chaquefigure allégorique, un attribut distinctifae. Chose curieuse, cet élément verbal entre en jeumême lorsqu'il s'agit des Olympiens, pourtant aisément identifiables. Apollon est, avecThamyris, la seule figure nommément désignée sur le lécphe de Ruvo (Cat. 6)50; dans lascène de Phaon (Cat. 8) aussi, le nom d'Àpollon, comme celui de Léto figurent en roureslettres. Ces « étiquettes » sont plus que des points de repère ; elles indiquent que la réferenceau mythe est touiours chère aux imagiers. Cela suppose un rapport nouveau, et plus complexe,entre le mot et la figure. Le nom fait partie de la personnalité du dieu : visualisé à côté de lafigure, il est comme un point d'ancrage pour qui regarde le vase.
42. Grifon : hydrie de New York 16.52, dans la manière du peintre de Meidias (ARVL,p. r3zrlr ; fucumR-I{ALL,op. cit. fsupra, n. 341, p. zo3-t62, pl. 16o). Sur les idoles qu'on rettouve d'ailleurs sur d'autres illustrations du même êpisode :RTcHTER, op. cit., p. 2o4, et K. Scarroto, JdI, 52, 1937, p. 47.
43. METZeER, op. cit. (supra, n. r), p. 269 et p. 279.44. Voir su?ra' î.36. Ici, au contraire, c'est Aphrodite qui a attiré dans son orbite Apollon et Léto.45. On pourrait presque dire qu'Apollon incarne I'amour du Bien et du Beau : où8év ye &À).o èoclv oû èpôor,v
&v0pcotou ! coü &140oü (Pt-l^t,, Symp.,zo5 e).En lout cas, il représenteun sentimentcompléméntaire àl'amour que syrn-bolise Aphrodite. Cf. aussi E. StuoN, Die griechischen Vasen (t976), p. r48.
46. Pour les Grecs, l'harmonie est indispensable même entre les verflls, et Ia santé est une condition sine qua nondu bonheur : B. Sxrr,r,, Mahnung zur Tugend, op. cit. (supra, n. 5), pp, r58-r59.
+1. Cfl. B. SNBr.r,, Der Glaube an die olympischen Gtitter, o2. cit. (supra, n. 5), p. 42, etM.P. NrssoN, KultischePersonifikationen, Eranos, 50, tg1z, p. 35.
48. E.PorrrERrLesreprésentationsallégoriquesdanslespeinturesdevasesgrecsrMon.grecsencour.ét.gr.r2,t8gr,pp, r-33, I'avait bien !n : «... les peintres trouvent dans leurs noms harmonieux un prétexte à allégories , (p. r4).
49. De telles allégories sont une création artificielle, puisque, en Grèce, on a passé du daimôn à l'abstraction : o nichtPersonifi.zierung von Abstrakten, sondern o Abstraktifizierung » von Dâmonen hat stattgefunden » (P. Knrrscnrurn, Glotta,13' tg24' p. ro6). Cf. aussi B. Sulr.r,, Die naturwissenschaftliche Begrifsbildung im Griechischen, op, cit. (supra, n. 5),p. zo7. C'est une création « poétique », comme I'a lu Lessing, création a posteriori, où la personnification naît du substantifpar la suppression de l'anicle : SNELL, o1t. cit., pp, 2o7-2o8. Le théâtre a peut-être exercé une influence : Ch. Prceno, Lethéâtre grec et l'allégorie, RE'G, 55,rg42,pp.25-49. De môme NnssoN,loc. cit.(supra,n.47),p. ZZ : « Ëuripides... bezeichnetals Gott das Erkennen von Freunden, das Vergessen von Unglück, den Kummer, den Frieden, den Ehrgeiz, den Reichtum,die Vernunft. Das Entscheidende ist das Ueberhandnehmen eines Sprachgebrauchs, der Àbstrakta als Gôttermâchte hinstellt. ,Chez Aristophane, il s'agit moins d'abstractions que de « collectifs ) : Démos, Boulé, etc. Cf. NrrssoN, loc, cit.,p. 3t,n, r.
5o. La troisième inscription, XAO, a donné lieu à d'innombrables conjectures.
120
L'ambiguîté d'Apollon
Est-ce une relation d'amitié ou d'hostilité qui unit Apollon à Gdipe (Cat. 9) ? Dupoint de vue du mythe, on serait tenté de penser que le dieu suit l'accomplissement inexo-rable de son oracle. Mais dans l'immédiateté de la représentation, on a plutôt l'impressionqu'il accorde à Gdipe sa protection bienveillante. Dans les Phéniciennes d'Euipide, æuvrecontemporaine du lécythe, Gdipe apparaît comme l'envoyé de Pythô51. Rare dans lamythologier l'action conjuguée d'Àthéna et d'Àpollon devient assez fréquente dans l'imageriede la f,n du ve siècle5z. Mais, sur le lécythe de Marion (Cat. 9), il est impossible de direlaquelle des deux divinités a attiré l'autre dans son orbite. Athéna est l'amie des tueursde monstres; sans doute intervient-elle ici en faveur d'Gdipe. Apollon manifesterait-ildes intentions et des sentiments opposés ? Une telle idée est difficilement soutenable,mais la présence de chacune des deux divinités s'exprime de façon originale. Athéna se
tient tout près du combattant; elle est la Promachos; Apollon, dieu lointain, est assis en
retrait. Le lécythe correspond à une phase de transition dans la conception des divinités-témoins de l'action : les divinités protectrices se transforment insensiblement en divinitésspectatrices. Apollon n'est pas le dieu actif et secourable, prêt à prendre en main, concrè-tement, le destin de son protégé58; mais il n'est pas non plus le figurant passif, tel que leconcevra l'imagerie du siècle suivant, simple incarnation des sentiments d'amitié ou d'ini-mitié qui l'uniront au héros de la scène5a. Sa position ambiguë, en bordure de l'image, traduitexactement l'ambivalence de sa nature : présent et absent, proche et lointain, bienveillantet redoutabless. Indifférent au combat et à la victoire d'Gdipe, il paraît scruter du regardl'avenir, c'est-à-dire l'accomplissement du destin56. L'assistance divine ne se justifre que
dans l'instantanéité de la représentation; elle ne durera que le temps du combars?. Apollonremplit ici la même fonction que l'Erinye sur le cratère apulien du peintre de Dariusss :
présage, au sein de l' « apothéose », de l'inceste et de l'anéantissement de la race de Laïos.Plus énigmatique encore est l'Apollon qui assiste au rapt des Leucippides (Cat. ro).
5r. Eun,, Phoen., to43-ro45.52. METZcER, opt. cit. (supra, n. r), p. 165, à propos de Marsyas,
53. Otro, op. cit. (supra, n r4), p. 65 : n Er begleitet keinen Helden als treuer Freund, als srets bereiter Helfer undBerater... \Vie sie (scdl. Athena) die Immernahe ist, so ist er der Enuückte... Dieses Fernsein ist für die Natur Apollonsungemein aufschlussreich,,
54. I.-M. isÂoesr, L'Ilioupersis dans la céramique italiote (1975), pp. 249-26o.55. Sur I'ambiguité d'Apollon : BURKERT, op, cit. (supra, n. 3), pp. 232-233, et DTRLMBTER, op. cit, (supra, n. 38),
p. 33. Plus négativement encore : BôÀtrn, /o c. cit, (supra, î. 7) , pp. 275-303. Cependant, voir aussi R. PrrrrrBn, The image ofthe Delian Apollo and Apolline ethics, in Ausgewàhlte Schriften (196o), pp. 55-7r : Àpollon aussi prompt à pardonner qu'àchâtier.
56. « Flier redet nur ein.,. triumphierendes Dasein zu uns, in dem alles Vorhandene vergôttlicht ist, gleichviel ob esgut oder bôse ist,, F. Nrnrzscrr, Die Geburt der Tragiid,ie, chap. 3 (: Ed. Carl Hanser [1977], I; p. z9),
57. V. I. Pxove, Ëdipo alla luce delJolhlore (trad. ital., r975)r pp. 90-98, a montré que l'oracle n'a aucun lien avecl'ascension au trône - qui est la récompense du combat - mais sert seulement à motiver le parricide.
58. Cratère à volutes de Naples H 3254 (inv. 8r.aql) | RVA7, II, 18/39 ; A. FuRrrtrÂNcLER, I'R, II, pp. 156-16o,frg. 5z et pl. 89 ; M, Scruar»t, Der Dareiosmaler und sein Umhreis (196o), p. 34 et pl. rr. Valeur de prolepse de cette Erinye :
L. BLocE, Die zuschauenilen Giitter in den rctfigurigen Vasengemàlden des malerischen Stiles (1888), pp. 65-66.
121
6. cat. 9. Lécythe pansu du British Museum E 696 : Gdipe combattanr la sphinx.
Il a surgi on ne sait d'où, et il regarde, impassible, les ravisseursse. Pas le moindre élémentde décor qui offrirait à l'æil un moment de repos; la course se poursuit, inexorable, surtout le pourtour du vase. Seul Apollon reste inébranlable au milieu du tumu1te60. Comme le
59, Habituellement, dans les scènes d'enlèvement, c'est Ie père de Ia ieune fille - ou du jeune gârçon - qui est letémoin du drame : ainsi Erechthée, père d'Oreithyie, quand le ravisseur est Borée : S. Karupr-DrMrrRraDou, Die Liebe derGôtterin der attischen Kunst des 5. Jhs, zt. Chr. (rg7qD,pp.36-4t. Maisil n'est pas touiourspossible de préciserl'identitéde ce spectateur, notarnment dans les scènes où le ravisseur est un dieu : Hadès-Perséphone (ibid.rno 338), Apollon-aimée(ibid.' p.33), Eos-garçon (ibid.' p. r9), Zeus-Ganymède (ibid., p. 9), Poséidon-Amphitrite (ibid., p. zf : Nereus), Zeus-aimée (ibiil., p. z4 : Asopos, et, même, dans un cas, Nereus t). Voir aussi l'hydrie la ktion, 56 (supra, n.6), pp. 5z-ro6, pl. 48.
6o. A l'époque précédente, Apollon était représenté le plus souvent à la poursuite de ses amanres : K.tmrpr-DrMrrRrÀDorr, op. cit. (n. préc,), pp. 3z-34. Désormais, les auteurs des rapts amoureux sont des héros, Pélops, Pâris, Echelos,les Dioscures (cf. ibiil., p.56). Chez le peintre de Coghill, Apollon est encore lui-même le ravisseur sur l;hydrie du BritishMuseum Eqo (ARVZ,p, ro4zlt; Karrvrnr-DrrrlrrRrADou, oqt, cit.,pp.33-34 et pl. z5 j LacRoIx, op. cit. lsupraru 61,p. 85, et pl. r7-r8).
122
dieu du fronton d'Olympie qui domine de sa stature la horde déchaînée des Centaures, ilparaît suspendre la fuite des personnages vers la droite61. Les textes ne disent rien des
réactions que provoqua dans l'Olympe la conduite des Dioscures. Seule l'issue est connue :
l'embuscade des Apharétides, la mort de Lyncée et celles, consécutives, de Castor et d'Idas62.
Alors que toutes les figures sont saisies dans l'instantané, entièrement absorbées dans l'actionen cours, Apollon regarde plus loin. Il a l'æil fixé sur l'avenir, dans une direction à laquelletous les acteurs du drame tournent le dos. La vision de l'homme est bornée, seul le dieuvoit le terme : 6p« cétro663. C'est ce précepte de la sagesse delphique qu'il représente ici.Il ne châtie pas, il ne juge pas, il incarne la transcendancee.
Une fois de plus, il s'agit d'un choix significatif. Le peintre a sacrifié, en faveurd'Apollon, les divinités qui figurent habituellement dans cette scène, Aphrodite et Eros,Athéna et même Zeu;s65. L'apparition d'Apollon modifie radicalement le rapport qui existaitentre la divinité et les personnages du mythe. Elle ne transforme pas seulement le contenuaffectif de la scène, mais la structure de l'image66. Quel qu'ait pu être le mobile du peintre,la raison d'une telle substitution n'est pas à chercher dans le mythe - la versiono? selonlaquelle Apollon aurait été le père des Leucippides est incompatible avec la scène duvase - mais bien dans la personnalité du dieu et le rôle d'arbitre qui lui était unanimemenrreconnuæ.
6r. Ce n'est peut-être pas un hasard si I'entrée en scène d'Àpollon coîncide avec les premières tentatives d'expressionspatiale. Il faut attendre la seconde moitié du ve siècle liour voir les peintres à figures rouges prendre conscience des problèmesque pose la relation des figures entre elles. Cf. B. Scnwnrrzrn, Vorn Sinn der Perspehtioe (1953), pp. 22-23 i « Durch diePerspektive wird die Obiektwelt nâher an das menschliche Subiekt herangezogen, und umgekehrt saugt die gemalte Pers-pektive das Subiekt in sich hinein, so dass es in die Obiektwelt sieh einbezogen fiiLhlt wie in seine natii,rliche Umwelt...Die §7elt verliert in der Perspektive ihre Transzendenz und wird spezifisch menschlich, » En se manifestant, même de loinet au loin, Apollon ne restitue-t-il pas à la scène la dimension sacrée qu'elle risquait de perdte par le nouveau rapport suiet-objet mis en évidence par Schweitzer ?
62. PrND., Nem.,X, ro3 sqq. ; Tnrocn., XXII, r37 sqq. Voir : Ronrnr, t4», cit. (supra, n. 34), pp. 3r4-3rg; U. vonVtr.ttrtowttz, Pindaros (rgzz),pp,428-429.Cf..V. ScuAorwAr,or,Pindars Zeirnte Nemeische Ode,inHellas und Hesperien,I2(r97o), pp. r78-r8o : o... das Râtsel, wie Gôttliches und Sterbliches sich ineinaniler verschlingen. ,
63, SNU-I., op. cit. (supra, n. 5): p. r54,64. Il n'impose pas non plus une ligne de conduite 3 « griechische Giitter geben keine Gesetze » (Bun«rnr, op. cir.
lsupra, n. 31, p. 37à.65. AphroditeetZeussurl'hydrieduBritishMuseumEzz4,dupeinttedeMeidias(ARVI,p. r3r3/5;P.E.ARrAs-
M. Hrn:vrrn, Le oase grec 1196zl,pl. zr4-zr5). Eros seul sur le cratère en calice de Ferare, Guardia Finanze Comacchio,peut-être du peintre des Satyres laineux (lR 22, p. r 68o bas ; Paralip., p.446 ; ALFTERT-ARras-HTRMER, op. cit. fsupra, n, 6),pI.68-73). Athéna, avec Aphrodite et Eros, sur le cratère à volutes apulien de Ruvo, J ro96, du peintre de Sisyphe (RIZp, I,tl5z' pl.5/r ; H, Stcutrnruexu, Griechische Vasen in Unteritalien [1966], p. 35, K 39r pl. 6r ; G. LrrpoLD, Antike Gemtil-ilekopien [rg5r], pI. +/rg).
66. L'enlèvement n'a pas pour cadre un lieu saint : il n'y a ni autel, ni effigie divine. Idole : cratère à volutes frag-mentaire de Halle, inv. zrr, du peintre des Mobides (ARV2,p. Sggl4 t T, B. L. §ÿEBsrER, Der Niobidenmaler 11935), p. 17,pl. rz) ; hydrie du British Museum E zz4 (n. préc,) ; cratère à volutes de Ruvo, ] ro96 (n. préc.). Autel : hydrie du BritishMuseum E zz4 (n. préc.); frise sud du Jrésor de Siphnos à Delphes (P. de Le Cosu-MBssrrrÈnr, Au musée de Delphes[1936], pp. 37o-388 : rapt des Leucippides ?).
- !1. Kü:rpræ fr 9 (: Paus. III, 16, r) : ô àè rcol,r;oa6 cù. ëtc1 d. Kûrpla 0uyacépa6 aùrdç 'Ar6),Àcovôq g1or,vei,vac. Voir aussi E. Brrur, Der toische Epenhreis (1966), p. 84.
68. Non pas arbitre entre deux héros luttant I'un contre I'autre, ni errre deux parties qu'il faudrait réconcilier(à ce propos : Brcxtl, op. cit. fsupra, n. r4], p. 8o). Ici, Apollon apparaît plutôt comme l'arbitre du destin, tel le 0e66
- dont l'identité n'est pas révélée - qui approuve l'idée du combat singulier chez Théocrite (XXII, r8r).
123
L'hostilité qu'Apollon voue aux monstres suffirait à justifier sa présence aux côtés
de Bellérophon (Cat. rr et Cat. rz). Dans l'Hymne homerique,le dieu évoque précisément
la Chimère, lorsqu'il proclame sa victoire sur le serpent Python. Tous les monstres, oupresque, sont issus d'Echidna : la Chimère, la Sphinx, l'Hydre6e. Les Anciens ont ainsiexprimé en termes généalogiques la fonction d'archétype que l'analyse structurale reconnaît
aujourd'hui au combat d'Apollon. Mais la sanction est-elle univoque ? Dans l'imagerie,Apollon se substitue à Athéna?o. Il entre en scène au moment précis - la fin du ve siècle -où le combat de Bellérophon se transforme en une scène à grand spectacle, dans laquelle
de nombreux Lyciens sont engagés comme auxiliaires et comme rabatteursTl. Réminiscence
de la Chasse de Calydon ? Peut-être, mais n'oublions pas que l'Orient était alors de mise
à Athènes. Jusque dans les scènes de beuverie, on aimait à remplacer les Grecs par des
Asiatiques?2. Artémis, qui apparaît aux côtés d'Apollon, sur le cratère de Gênes (Cat. rr),aurait-elle entraîné son frère dans son sillage ?73. Ce n'est pas sûr, car elle n'est pas attestée,
dans la Chasse de Calydon, avant le rvu siècle?a. La sagacité d'Gdipe paraissant trop peude chose, on a imaginé un combat dans lequel le héros pouvait faire montre de son couragephysique et de sa force surhumaine (Cat. 9). De même pour Bellérophon : il ne lui suffisaitplus de vaincre un monstre redoutable, il devait triompher là oùtoute une troupe de chasseurs
avait échoué.,S'étonnera-t-on que l'hyperbole envahisse l'imagerie à l'époque où l'hybrisde quelques aventuriers entraînait Athènes sur une voie périlleuse ? En politique commeen imagerie, on avait besoin de surhommes. Jamais les termes extrêmes - victoire etanéantissement, gloire et déchéance - n'avaient été aussi proches, dans l'histoire et dans
le mythe, dans l'imagerie et dans la réalité. Le témoignage du vase est clair : les peintresattiques n'ont pas introduit une divinité au hasard, pour donner au combat une dimensionolympienne. Ils ont voulu Àpollon, et ils n'ont pas hésité à lui sacrifier Athéna et Poséidon,qui sont les protecteurs attitrés de Bellérophon dans l'imagerie antérieure e/ postérieure?5.
Le triomphe de Bellérophon est éphémère, comme celui d'Gdipe. Désarçonné par lemême Pégase qui l'avait conduit à la victoire, le héros finira ses jours haï des dieux et
69. HÉs., Th.,3r3 sqq. Cf. FoNrrxnosr, op. cit. (supra, n. r8), pp. 3o8-3o9.7o. G,nochoé fragmentaire d'Athènes, NM r8or5 (F. Bnoruvun, MlYPr, g5zl14, p. 5,lI 4, pl. r) : Brcrrr, op. cir.
(supra, n. t4), p. 73.7r, Cratère en calice de Lecce 453o @norlrvrrn,loc. cit. [n. préc.], p. 6, II 5, pl. z; M. BERNARDTNT, I oasi Attici
del Museo proztinciale di Lecce [1965], pp. 67-7r avec ill.) I cratère en cloche de Naples H 3243, du groupe de Budapest (ARVL,p. t4lglz; K. Screurueuno, JdI, 7r, 1956, p.65 et p. 7r, fi,g, tz).
72. Ex. t cratère à colonnettes de Salerne (M. Nanorr, La tomba del tuffatore frgTo),p, tg7,frg. tt5-tr6; K. ScneurN-Bûr.c, AM, 90, r97St p. rt4, pl. 38lz).
73. Sur ce mécanisme : BLocH, o1t. cit. (supra, n, 58), p. 27, p. 52 et p.72.74. Péliké de Léningrad B 4528 (MErzczR, op. cit. lsu?ra,\. tl,p.34lz6,pl.4rlq et commentaire, p. 3r7).75. En Italie méridionale, Athéna appataît seule ou accompagnée de Poséidon; exceptionnellement, une assemblée
divine assiste au combal. Apollon frgure parmi ces Olympiens sur le cratère à volutes de Naples H 3253 (inv. 8r.947), dupeintre de Da;ius (RVAp,II, r8/38 ; A. FunrwÂNcr-rn, FR, II, p. r45, fig. 46 ; Soruror, op. cit. lsupra, n 581, pp. z6-zg,pl.5 : détail). Zeus avec Athéna : cratère à volutes apulien, du peintre de Baltimore, dans une collection ptivée(RVAp,Il,z7lzz 3 K. ScHÀmNBuRc, Meileil. Ned. Inst. Rom.,4r, n.s. 6, 1979, p. 13, pl. 7).
125
abandonné de tous76. L'Apollon des vases est porteur du même message que Pindare :
la mésaventure de Bellérophon rappelle au vainqueur qu'on ne peut pas outrepasser lamesure impunément?7.
Le dieu de l'oracle
L'irruption d'Apollon, dans l'imagerie légendaire du ve siècle, a été favorisée par lerôle que l'oracle ioue dans un nombre impressionnant de mythes. Il s'agit souvent d'uneévolution tardive de la légende, soit que le clergé delphique ait exploité à son avanrage unedonnée vague du mythe, soit que le thème oraculaire ait été artificiellement introduitcomme « ornement littéraire »78. Rares sont, dans la deuxième moitié du ve siècle, lestragédies où un oracle n'intervient pas, sinon dans le déroulement de l'action, au moinscomme antécédent?e. Le cas d'Gdipe permet de saisir sur le vif la manière dont la u delphisation » d'un mythe s'est opérée graduellementso. La légende de Cadmos, aussi, est placéesous le signe de l'oracle81. Même si les structures essentielles du mythe sont préapolli-nienness2, la version classique fait intervenir Apollon à chaque étape décisive. Plutôt quele combat contre le serpent, l'hydrie de Berlin (Cat. r3) représente la glorification du fonda-teur de Thèbes, sous le patronage des divinités poliadesss. Cadmos est figuré dans l'attitudedu combat, mais c'est pure convention : l'imagier a réussi, par ce biais, à incorporer à lascène l'avant et l'après. Le meurtre du dragon n'est qu'une étape préalable à la fondationde Thèbes, mais c'est une étape nécessaire. Elle fait partie du plan divin, révélé par l'oracled'Àpollon. Les divinités font allusion chacune à un moment déterminé de la carrière du
76. Déià chez Homère (/r,, VI, t55-zo5),1e destin de Bellérophon uaduit un brural renversement de situation.Cf. R. PrpprnrvrüLlaR, lYSt, 75, 196z, pp. 5-2rr et V. Kwr,lsuN, Das Virhen der Gôtter in der llias (1956), p. z4 : « Dasin ihm hervorgehobene Phânomen ist die Hybris des Menschen gegenüber den Gôttern. Das Motiv der gôttlichen Unrer-stiitzung bei Bestehen der voraufgegêngenen Abenteuer spricht nicht dagegen. » D'après M. PoHr.BNz, Die eriechischeTragôdie, I (tg54), p. z9z, le héros d'Euripide n'aurait tenté l'escalade du ciel que pour apaiser sa conscience : « DiesenBellerophontes treibt nicht Hybris zum Himmelflug. » Bunxrnt, op. cit. (supra, n. 3), pp. 466-467, remarque judicieuse-ment : «... doch das Ende ist nicht §7issen, sondern Absturz und Wahnsinn.,
77. PtN»,' Isth.' VII, 69 sqq. De même O/., XIII, r3o, oir cependant une réticence volontaire met un terme à l'énoncédes succès : Slcro<orc&oopa{, oi pr,6pov èy<i.
78. FoNrrNnose,op.cit.(supra,n.9),pg,95-to7 (nnarrativeoraclesoriginallynon-delphic»)etpp.ro7-rr7(«nar-rative oracles invented as delphic responses »).
79. Drnuvrrrn, op. cit. (su?ra, n. 38), p. 4o; J, de Ronr,ly, opt. cit. (supra, n. 8), p. ror.80, PARKt-§troRrvttt-t-, op. cit.(supra, * 8),I,pp.298-3oo et pp. 3ro-3r r ; FouuNnosr, op . cit. (supra,n. g), pp, 96-roo
et p. rro. Déjà C. Roarnt '
Oidipus (r9r5), I, pp. 42-70t avait montré qu'originellement c'est Teirésias, et lui seul, qui révèleà Laios le destin qui l'attend, Mais, comme l'a écrit FoNtrNnosv, op. cit., p. 96, c'est avec surprise qu'on apprend que niSophocle ni Euripide n'attribuent I'oracle en question à I'Apollon de Delphes. Pottr Gililte à Colone, voir \V. Elr.lcrn,Sophokles und Àpollon, in Synusia. Festgabe für V. Schailewaldt (1965), p. roo : « Nicht nur Gdipus, auch die Gegenseitekann sich auf ein Orakel Apollons berufen, was bedeutet, dass Handlung und Gegen-handlung durch den delphischen Gottkonstituiert werden. » Cf. aussi K. RnrNnen»r, Sophokles (rq3:), pp. ro8-ro9.
8r. PARKE-VoRMELL,op.cit.(supra,* 8),I,p.3ro;FoNrrNnosr,op.cit.(supra,n.9)rpp.175-176 (Lrr).Rapportscadmos-Apollon : DEFRÂDAs, ogt. cit. (supra, n. 16), pp. 58-59 et p. 66 ; FoNTENRoSE, o?. cit. (supra, n. rg), pp. 3o63zo;F. Vrat, Les origines ile Thèbes (1963), pp. 8z-ror.
82. VIAN, op. cit- (n. préc.), pp. 8z-87.83. VraN, op. cit. (süpra, n. 8r), pp. 47-49 i Btoctt, op. cit. (supra, n. 58), p. 56.
8. Cat. rr. Cratère en calice deGênes r9rr.163 : Bellérophon
et la Chimère.
héros; simultanément, elles symbolisent les cultes de la cité. Mais, dans l'image, routenotion de temporalité est abolie : l'avant et l'après se fondent en un présent abstrait etindéfini. Déméter, qui passait pour avoir conçu le dragon, trône sur la Cadmée; réconciliée,elle accepte le culte que lui rendront les fondateurs de la ville nouvelle. Arès seul est absent Isa fille, 'App.ovûa, le remplace, symbolisant la réconciliation future. Lors des noces deCadmos et d'Harmonie, Apollon jouera une « musique juste » (ôp0drv pouor,x{v), marquesuprême de l'estime dans laquelle les dieux tiennent le héros8a. La métamorphose d'Athénaest la plus significative. Elle reste, elle aussi, en dehors de l'action et manifeste seulement, par
84, PrND. fr. 3z (Hymn.), §NELL4, ap. Pr.ur., Pyth. or.,6. Cf. Vrarv, o2t. cit. (supra, n. gr), p. 27.
127
9. Cat. rz. Fragment de cratèreen calice de Corinthe C. 3r.82 :
Bellérophon et la Chimère.
la couronne qu'elle tend à Cadmos, la bienveillance des dieux à son égard85. La position
marginale d'Apollon ne doit pas faire sous-estimer son importance, car c'est la place qu'iloccupe traditionnellement chez le peintre de Cadmos86. La tonalité apollinienne de cette
scène à figuration multiple est soulignée par le griffon qui prend place sous l'anse de
l'hydrie. L'imagerie contemporaine permet d'en saisir la portée : c'est à cette époque,
précisément, que les représentations du dieu chevauchant l'animal merveilleux se répandent
à Athènes87.
Dans le dernier tiers du ve siècle, les mythes troyens ont connu une actualité que la
guerre du Péloponnèse rendait brirlante. Il n'est pas étonnant que les poètes tragiques aient
mis l'accent sur la catastrophe frnale, la chute d'Ilion, le meurtre des Priamides, l'asservis-
sement des Troyennes. Parmi les épisodes de l'avant, le jugement de Pâris revêt une
importance particulière88. L'Alexandros d'Euripide avait montré l'enchaînement inéluctabledes événements, de la naissance de Pâris, l'enfant maudit, jusqu'à la rivalité des déesses,
qui devait sceller le destin de Troiese. Semblablement, les peintres de vases introduisent
85, Sur le rôle d'Àthéna : VrAu, o2. cit, (supra, n. 8r), pp. rrr-rr2.86. Apollon est désigné ici en dialecte dorien (AfIEÀÂQN), comme la plupart des ûgures de cette hydrie et de
l'hydrie jumelle (Cat. 14) : voir ARVZ, p. rr84, et P. KRErscEMex, Die griechischen Vaseninschriften (t894), p. zrz. L'idéede G. Lrplor.» (op, cit. [supra, n. 65], p. 4o, n. z), celle d'une commande tarentine, permettrait d'expliquer à la fois ledialecte dorien et la présence du ieune garçon chevauchant un dauphin (Cat. r4). fnvoquant f institution des d,réD.ar, etle mois 'Are),).aTo6 -attestés
également à Delphes -Burkert
reconnaît dans Àpollon le dieu dorien par excellence, reprenântainsi à son compte une thèse fameuse de K, O. Müller : W, BURKIRT, Apellai und Apollon, RhMusPh, r48, t975, pp. r-2r.
87. METZcER, op. cit, (supra, n. r), pp. t6g-172, pL. z4lr et 4.88, J. de Rourr.r.y, op. cit. (supra, n. 8), p. 3r, n. 3r et n. 32.89. Il n'est p4s certâin, toutefois, qu'Euripide ait fait allusion au jugement dans la première pièce de la trilogie.
Chez Ennius, Cassandre le dévoile dans son délire :
iudicavit inclitum iud.icium inter deas tres aliquisquo iudicio Lacedaemonia mulier furiarum una adaeniet.
(fr. XVII, 48-49 Jocelyn).
Voir : RoBERT, op. cit. (supra,n. 34): p, 982; B. SNILL, Hermes, Einzelschr., S, tg37,pp.53-54 ;Porx-aNz, op. cit.(st4tra, n. 76), pp. t33-t34; T. C. §7. SrrNroN, Euripides and the judgement oJ Paris (rS6S), pp. 66-69 ; F. loutN, Euripideet les légendes des Chants capriens (r 966), pp. r33- r 34 ; R. CoLEs, BlC S, Suppl.,32, 1974, ÿ. 15,ÿ. 27 et pp. 33-34 ; R. Scoorl,The Trojan trilogy of Euripides (r98o), p. 97.
128
Zeus, Eris et Thémis pour rappeler que le jugement s'insère dans un plan plus vaste,celui que Zeus avait conçu pour décharger la Terre du poids des humainseo. Et Àpollon ?e1
Il concrétise l'avertissement divin, qui avait ordonné de tuer Pâris à sa naissance, et queCassandre, malgré tous ses efforts, ne pourra faire respectere2. L'idée qu'Apollon incarnele destin - ce faturn que Pâris, à son tour, représente pour sa cité - n'est pas nouvelle;on la rencontre déjà chez Homère. Mais aucun imagier, avant le peintre de Cadmos, n'avaitsongé à faire d'Apollon le « présentateur » du jugementes. L'hydrie de Berlin (Cat. l4)marque un tournant, car l'emprise apollinienne, dans cet épisode, ira grandissant. A lafin du ve siècle et au début du Ive siècle, deux vases montrent Apollon arbitrant lui-mêmele concours de beauté, ou, du moins, présidant un conseil de divinités, dans la dépendanceduquel Pâris rendra son verdictea. On a rejeté l'idée d'une consultation delphique, sousprétexte que les textes n'en disent rienes. Ne pourrajt-on admettre que le rôle d'arbitreprêté à Apollon par les imagiers a finalement fait croire que Pâris n'était que le porte-paroledu dieu ?
Le cratère de Berlin (Cat. r5) reflète fidèlement le rôle que la légende avait progressi-vement reconnu à Apollon dans la destinée de Télèphe. Le dieu suit attentivement lespéripéties d'une action dont il est le principal responsable et dont le peintre a représentéle moment culminanteG. Remarquons qu'il n'intervient pas directement dans les affaireshumaines, pas même comme témoin à décharge, malgré l'exemple donné par l,Apollon
9o. Eris, Thémis et Zeus : cratère en calice de Léningrad St. r8o7, du peintre de Cadmos (ARV|, p. :rlgllT tMETZGER, op. cit. fsupra, n' rl, p. 26915, pl. 37). Zeus et Eris : hydrie de Karlsruhe 259, du peintre du Pâris de Karlsruhe(ARVZ'p. r3r5/r ; MtrzceR, o?. cit.' p. z6g17 ; CVA, t, pl. zzl4-5, pl. z3 et pl. z4lr-). Le-,, dessein de Zeus » esr artesré,chez Euripide, par 1e fr, to8z N2 :
Ze[ç yù.p xaxôv p.àv Tpcooi, æiçr.a 8' 'E).Ict8r,OéÀ<ov 1evéo0at caüt' è6oüÀeuoev rrac{p.
9r. Il ne prononçait pas le prologue de l'Alexandros (car il y est mentionné à la troisième personne), et, selon toureprobabilité, il n'apparaissait pas non plus au dénou emert, Contra: SrrNror.r, op. c/ t. (supra, n,89),pp. 7o-7r ; T. B. L. §fnrsrrn,The tragedies of Euripides (t967),p. r7z. Mais son temple, qui était visible sur scène (§7rns mn , oj.i;i., p. r 67), est mentionnéà diverses reprises dans les fragments conservés.
92. Il s'agit d'un songe d'Hécube. Chez Lycophron (Alex., A19 sqq.) et chez Ennius (fr. XVIII, 58-6r ]ocell'n),PriamconsulteApollon(cf.RoBERr, op.cit.îsupra,n.34l:pp.979-98o),maislemotifdel'oraclenesemblàiasruoitngrr"echez Euripide. Contra : WEBsTER, op. cit. (n. préc,), p. 166. Sur la consultation delphique de Ménélas et dË pâris : panxr-Wonurr.r., op. cit.(supra, rr. 9), p. 18 (L gq). Représentation possible sur le fragmeni de sarcophage de Venise, Mus. Arch.,D 294 : L. GHar-r-KaHrr., Les enlèr)ernents et le retour d'Hélène (rS5S), p. 49ltgg, pl, 6fi.
93. Apollontientuneplacedechoixdansl'æuvredecepeintre:auxcôtésdeDionysos(z{RIl2,p.rr85/7),d,Héraclèsdomptant la biche (ARVZ,p. 118416), et, surrout, avec Marsyas (ARVL,p. ttï4lr: panse e, col; f. rrgJi5 ; p. rrg5/r3et p. rr85/14).
94. CratèreenclochedeViennerTTr,dupeintredesNocesd'Athènes(lRIl2,p.r3r8;Mrrzcen,op.cit.fsupra,n.r),P. z7ol9' pl. 4tlr ; CVA, 3, pl. rzo-tzr) et crâtère en cloche de Vienne 935, du débur du rve siècle (MgÏzesi, op. cii.,p.26918,pt. zzl4)- Cette thèse de \V. KrerN (JdI, g, 1894, pp. z5t-254), suggérée par o. BeNr»ont (Griecihische uni sicitischevasenbilder [r88:], p. 78), a été reprise par MerzcER, op. cit.,pp. r8r-r82, pp. z7j-z7a et p. 376, et par A. A. pÂpAroANNou,Xrcouôal ei6 ,riv propgo),oyi*v coü zr).ouo[ou pu0pr,oü (r97zJ, pp. roa-r3f
95. Entre autres : A. FrnrwÀNcten, La collection Sabouroff (1883-1887), II, p. 14; H. BmrNN, Kleine Schriften(1898-19o6), II, p. r3z ; O. BnrNDrt, ÿ,RS, 3r, r94rr p. r19; Ch. Cr.arnrrlôNr, ijas Parisurieil in iler antiken Kunst (r95r),pp. 99-roo; RAAB, op. cit. (supra, n. 37), p. r15, n. 36.
96. Mrrzcen, o1t. cit. (supra, n. r): pp. 287-zBB, et Mélanges Ch. picard (: RA, 1948), II, pp. 746_754C . BeucnræNss-TsüRrEDL, Der Mythos oon Telephos in der antiken Bitdkunst (r97r), pp. z6-z8,'pL. z. Oracies : panxr-lforuælr, op. cit. (sul,ra, n. 8), p. 3 15, et FoNrrNno sE, oI). cit. (supra, n. ù, OO, 7t-7".
129
des Euménides. Un lien purement affectif l'unit au héros. Euripide, dont la tragédie futreprésentée en 438, a peut-être ouvert la voie aux imagiers, mais Apollon ne figurait pas
dans son Télèphe, pas même comme deus ex machinaeT. Plus d'un demi-siècle, d'ailleurs,sépare le vase de la représentation théâtrale. Cet écart chronologique esr révélateur. Il a
fallu que les peintres de vases s'habituent à la présence d'Apollon, en bordure des scènes
légendaires, avant de l'accueillir comme dieu spectateur. C'est paradoxal, si l'on songequ'ici il a partie liée à l'action, alors qu'ailleurs sa présence ne s'imposait par aucune nécessitéintrinsèque. Dans le processus qui a vu les dieux se métamorphoser en spectateurs, Apollonoccupe une position clé. Sur la plupart des images que nous avons commentées, il apparaîtcomme arbitre ou comme « norme », suggérant au spectateur le sentiment d'une sagesse
et d'une justice plus hautes. Trop subtile, trop éloignée des modes d'expression habiruelsaux peintres de vases, cette structure du double registre ne pouvait s'imposer durablement.Les divinités spectatrices en sont la version simplifiée. La multiplicité des relations possiblesqui les liaient aux protagonistes faisait d'elles des figures passe-partout, à propos desquellesle spectateur ne se posait aucune question. Leur présence justifiait leur action. Les méca-nismes de l'iconographie conduisent parfois à de tels renversements de situation. Le rôlesécurisant des divinités spectatrices a fait oublier qu'Àpollon, originellement, s'érair dresséen bordure des scènes légendaires pour mettre en question le bien-fondé de l'action humaine
- que les dieux étaient censés condamner - ou: même, de l'action divine, car Apollon
- Euripide le montre bien - a été le premier visé par la critique « éclairée »e8.
L' u apollinisation » de l'imagerie
\Vilamowitzee a fait allusion, à diverses reprises, à cette « apollinisation » des myrhesdontl'Orestie d'Eschyle, et peut-être aussi l'Gdipe-Roi de Sophocle fournissent des témoi-gnages éclatants. Mais l'état lacuneux de la tradition manuscrite interdit, le plus souvent,d'aller au-delà des conjectures, et il n'est guère d'exemple où l'on puisse circonscrire entoute clarté le rôle de Delphes dans la formation ou la transformation d'un thème légen-daire100. La tentative est-elle plus légitime quand il s'agit de monuments figurés ? Production
97. Télèphe d'Euripide : E. V. HANDLEv- J. REA, The Telephus of Euripides (BICS, Suppl.,5,t957); H. Srnonu,Gnomon,32, 196o, pp. 6oo-6o5 ; H. J. MBrrs, Der zterlorene Aischylos (1963), pp. 8r-95. Mais il y avait alussi un Télèphed'Eschyle et une « Téléphie » de Sophocle : H. J. Merru, Die Fragmente der Tragôdien des Aischylos (1959), pp. r5o-r53,et S. Raor, Tragicorum Graecorum Fragmenta,IY (rg77), pp. l.4o-146, pp. 163-1 65, pp, 349-35r et p. 434. Pour la répartitiondes nombreux oracles (deux oracles tendus à Àléos, deux à Télèphe,le cinquième aux Grecs) entre ces diverses tragédies :Penxr-WonuBr-L,op.cit.(supra,n.8),p.3ozetp.315;FoNreNnosr,op.cit.(supra,n.g),pp.7B-Tgetp.92iMrittn,Verl.Aischylos,pp. TS-79 etpp. go-94 tlrÂ. Fnounor.o-Tnru, Die Telephos-Trilogie des Sophokles, Hermes,69,tg34,pp.324i38.
98, L'importance, dans notre corpus,drt fragment de lékanis de Tarente (Cat. 16) ne doit pas être sous-estimée, bienque la scène qu'Apollon et Artémis contemplaient ait disparu. La présence d'Agamemnon (nommément désigné), sur lecôté opposé, témoigne de l'intérêt du peintre pour des thèmes mythologiques qui n'étaient pas alors des plus répandus.
99. U. von 'Wrl.AMo\ryrrz, Aeschglol Orestie,ll ( r 896), pp. 246-256 ; t»., pindaros (supra, a.6z), pp. 83-87, notam-ment p. 85 ; rD., Glaube (supra, n. z6), p. 39. Cf. aussi A, Lrsxv, Vien. Stud.,8o, t967, p. g.
roo. Voir à ce propos 1es remarques, si pertinentes du point de vue méthodologique, d'O. RrvrnorN, La religion dela cité platonicienne (1945), pp. 89-90. D'une façon générale : DEFRADAs, op. cit. (supra, n. t6), passim.
130
10. Cat. 14. Hydrie de Berlin F z$3 : iugement de Pâris.
de masse, l'imagerie est plus sujette, sans doute, que la création littéraire, aux métamorphoses
inconscientes, par voie analogique ou par des procédés de contamination, qui sont des
phénomènes synchroniqaes. Depuis longtemps, les linguistes ont âttiré l'attention sur les
mutations en u tache d'huile », fréquemment repérées lorsque des locuteurs adoptent
soudainement une prononciation nouvelle ou un vocable jusqu'alors inusité. Même si
l'innovation se laisse décrire avec précision, la cause - et il y en a nécessairement une -échappe le plus souvent à l'analyse.
L'entrée en force d'Apollon, dans f imagerie de la deuxième moitié du ve siècle,
aurait-elle une origine similaire ? Les documents de notre Catalogue s'échelonnent sur plus
d'un demi-siècle, mais ils se prêtent à des groupements homogènes du point de vue des
attributions. Il y a quelques paires, dues à une même main : peintre de Cadmos (Cat. 13
et Cat. r4), peintre de Meidias (Cat. 6 et Cat. 8), peintre de Cécrops (Cat. r et Cat. 2).
D'autres images leur sont étroitement apparentées, étant sorties des mêmes ateliers (Cat. 9
et Cat. 16). S'étonnera-t-on que des mythes, même indépendants, aient évolué de manière
convergente, quand on sait qu'ils ont été illustrés par le même imagier ? Phénomène inverse :
deux peintres de vases contemporains, influencés l'un par l'autre, ont fort bien pu introduiredans le même mythe une même innovation - et c'est effectivement ce que nous avons
131
17. Cat. 16. Fragment delékanis de Tarente, irav. 4529.
observé dans Ia scène de Bellérophon (Cat. rr et Cat. rz) et dans celle de Thamyris (Cat. 6et Cat. 7).
Cette « apollinisation , soudaine et massive de l'imagerie est restée sans lendemain.Là où la vérification est possible, on s'aperçoit qu'Apollon ne s'est pas imposé durablement.Au tve siècle, on ne le rencontre plus, ni à Athènes, ni en Italie méridionale, la n d6spo11i-nisation , étant particulièrement frappante dans le domaine italiote. Le dieu de Delphesn'apparaît qu'une fois dans les thèmes qui nous intéressent, et au sein d'une assembléeoù son absence eût été plus surprenante encore que sa présencelo1. Une telle rupture decontinuité est significative. On ne ressentait plus en Grande-Grèce, pour Apollon, le mêmeintérêt qu'à Athènes trois quarts de siècle plus tôt. La situation politique, le climat spirituel,les préoccupations religieuses étaient tout autres. Du point de vue strictement iconogra-phique, on soulignera aussi les raisons différentes qui ont dicté l'apparition des divinitésspectatrices dans la céramique italiote. Les préoccupations morales - morales au senslarge - que nous avons cru déceler chez les peintres attiques sont absentes. Dans l'imagerieapulienne, le plan divin se superpose purement et simplement au plan humain, sans qu'onobserve de l'un à l'autre aucune interférence. Du moment où I'on renonçait à cette « marge
ror. Voir supta,i.75 et aussi n.24,
de réflexion », lieu privilégié de rencontre entre la réalité du mythe et le poinr de vue duspectateur, la présence d'Apollon devenait superflue.
L'apparition du dieu, sur un certain nombre de vases falisques, n'est pas moinsrévélatrice1oz. C'est sans doute par voie figurative que la tradition s'en est répandue enEtrurie. Plus fidèles que leurs collègues italiotes aux modèles importés d'Athènes, lesirnagiers locaux ont conservé à Apollon sa place prioritairelot. Nous ne saurons jamais ce
que les Etrusques pensaient en voyant Apollon suivre Ie combat de Bellérophon ou inrerveniren faveur de Télèphe. Peut-être représentait-il, à leurs yeux, le destin. Le potentiel séman-
tique que le dieu de Delphes incorporait sur les vases attiques leur a probablement échappé1@.
Malgré leur caractère provincial, ces documents constituent, dans notre dossier, des pièces
capitales. Ils prouvent que l' « apollinisation , de f imagerie attique a eu assez de retentis-sement pour se répaadre jusque dans les zones périphériques du rnonde grec.
Mais comment expliquer eue cette entrée en force d'Apollon se soit produite aumoment oir Athènes traversâit une crise religieuse ? La piété populaire, on le sait, se
cherchait de nouveaux protecteurs, dieux ou héros guérisseurs, susceptibles d'apporter auxsirnples particuliers le réconfort qu'ils ne trouvaient plus auprès des Olympiens,lo5. Le cas
de Sophocle est exemplaire. Sa réflexion religieuse l'a porté tout entier vers les divinitéstraditionnelles, vers ces Olympiens dont ses tragédies ne cessent de proclamer la toute-puissance. Or, l'unique fonction sacerdotale dont Ia tradition fasse état, c'est en faveurd'Àsclépios qu'il l'a remplie106. Peu de divinites ont été aussi souvent honorées par desreliefs votifs qu'Asclépios; et pourtant, les peintres du Céramique ne I'ont jamais repré-senté, même quand son sanctuaire du Pirée et, plus tard, celui de l'Acropole comptèrentparmi les plus fréquentés de l'Attique. La démonstration peut se faire en sens inverse.A Ia fin du ve siècle, la popularité d'Àpollon, sur les reliefs votifs, était en baisse; quant à
Aüéna, elle dut céder le pas, dans sa propre cité, devant les divinités guérisseuseslo?. Mais
roz. Supplication de Télèphe : stanlnos de Ia Villa Giulia DS 6208 (MErzcER, olt. cit. lsupra, n. rJ, p. 288, n. 4;ÀÂoYsr, ap. cit. fsupra, t. 541, p. r78, pI. 54lz) et cratère en calice de Boston, r 97o. 4 . 87, du peinrre de Nazzano (Baucnrrelrss-TEüRrEDL, op. cit, fsupra, n. 961, pp. z8-3o, pl. 3; TrcN»er.r.-§tEBsrER, ,p. cit. lsupra, n. z4], III, 3,49; Iy'rorrxr, op.cit.,pp. r78-r79). Bellérophon : cratère en calice de Ia Villa Giulia 9o6 (ScnaurNsrrRc, loc. cit. lwpra, n. 7rl, p. 66,p.74,etp. 76, frg. t7).
ro3. L'attitude plus passive, ou plus réceptive, des décorateurs falisques, transparaît aussi dans l'emploi éclectiquedes diünités spectatrices. Certains imagiers, comme le peintre de Nazzano, leur réservent une zone privilégiée, au-dessusde la scène humaine, à la rnanière des décorateurs apuliens. D'autres se contentent d'une ou deux divinités, qui sont assisesen retrait, ou qui se mêlent âux protagonistes.
ro4. Le stamnos de la Villa Giulia (surrd, n. roz) montre combien facilement le rôIe du dieu poulait être dénaturé.ro5. DoDDs, o1t. cit. (supra, n. z), pp. r79-r95, nomrrment p. r93, et M. P. NrrssoN, Greek popular religion (t94o),
pp. ro6-ro8, De même Dtvx, loc. cit, (supra, n. rr), p. 56 : « Quel que soit le rôle de son oracle, le culte pythique n'esr pasde ceux qui enthousiasment les foules... Ses propagandistes ont été des poètes, des prêtres, des afistocrates, une manièred'élite intellectuelle et sociale. »
ro6. §Trrelrowttz,op.c'it.(supra,n.z6),Iï,pp.22g-23o;M.P.Nrr,ssoN,ReflexevondemDurchbruchdesIndi-vidualismus in der griechischen Religion um die §ÿende des 5. und des 4. Jhs. v. Chr., in Mélanges F. Cumont (rg36),p.369.Sophocle avait composé un péan pour Asclépios : LEsKy, op. cit. (supra, n.9), p. 3r3. Mais, comme I'a montré ELLTGER,loc. eit. (supra, n 8o), p. 82, Apollon, père d'Asclépios et lui-même dieu guérisseur, a pu susciter cette vocarion de Sophocle.
ro7. Nrr,ssoN, loc. cit. (n. préc.), p. 371, n. 1 j VrLAMo\ÿrrz, op. cit. (supra, n. z6), II, pp. t66-t6T , Voir cependantSttrloN, o2. cit. (supra, n, 6), p. 13 et n. 4, p. 96.
133
Asclépios n'avait pas de mythe susceptible de fournir des sujets aux peintres de vases Iil n'a pas intéressé non plus les auteurs de tragédies, ou tout à fait exceptionnellementlæ.Les dieux traditionnels, dont la ferveur populaire s'était détachée, restaient les maîtresincontestés sur le théâtre et dans les arts figurés. Le mythe continuait, ici et là, à alimenterle répertoireloe.
La crise spirituelle n'a donc pas joué seulement en défaveur des Olympiens, ou, dumoins, elle n'a pas desservi tous les Olympiens de la même façon110. Si Apollon a ralliéà lui tous les suffrages, en cette ère de désacralisation, c'est sans doute en raison de l'idéalde justice et de moralité qu'il continuait d'incarner1I1. Les Àthéniens ont-ils eu plus forte-ment conscience de la fragilité de l'homme en face de la destin§s )1r'2. On comprendraitquelle impression profonde a pu leur faire cet Apollon des vases, qui surveille de loinl'accomplissement de ses oraclesl13. Mais simultanément le dieu leur apparaissait comme legarant de la iustice et de l'égalité11a. Les Euménides d'Eschyle avaient laissé une leçonineffaçable. L'Orestie date de 458, et c'est peu après, semble-t-il, qu'a été peinte la mortd'Actéon (Cat. 4), où Apollon frgure pour la première fois dans le même rôle : procpcup{o<ov
(Aesch., Eum., 576). A partir de là, le motif s'est répandu dans f iconographie, sans qu'onpuisse dire ce qui, dans chaque cas, en a suggéré l'idée aux imagiers. Un fait est digned'attention. Sur plusieurs vases, Apollon a partie liée avec Athéna, sans que le mythe aitpu servir de support à un tel rapprochement. Cette amitié inattendue - on dirait volontierscette connivence - d'Àpollon et d'Athéna, c'est Eschyle qui en a été l'instigateur. Le géniepatriotique de ce grand Athénien, profondément épris de l'idéal delphique, a fourni auxgénérations futures le modèle de cette association divine. En montrant Apollon qui secondeAthéna dans son rôle de protectrice des héros, les peintres de vases ne faisaient qu'illustrerl'engagement proféré par le dieu, dans la trilogie :
èyô 8é, IIaÀÀ&6, c&).Àæ 0' étç èæLo.cap.ar.
rà oàv æ6).r,oçr,a xat orporcàv cerS[to péyocv
(&um.,667-668).
ro8, Aristarque de Tégée, contemporain d'Euripide, a écrit une tragédie'Aoz).{ær.o6 : TrGrF, t4F t.ro9. Nrr,ssoN, o1t. cit. (supra, n. g), p. 652 : o Es werden die alten Mythen im delphischen Geist umgearbeitet. »
r r o. Voir les remarques de Scneorwer,ot, Delphi und die Hurnanitâtsidee , in op. cit. (supra, n. 6z), p. 475, à proposde l'Gdipe-Roi de Sophocle : o Delphisch-Apotlinisch... ist dies Drama des Sophokles in seinem deferen Grunde. ,
rrr. Dans la période d'hystéIie provoquée par l'état de guerre, Àpollon a incamé l'élément stabilisateur: DoDDs,op. cit. (supra, n. z), p. r9o.
rrz. Sur la distance qui sépare hommes et dieux et le rôle particulier d'Apollon dans cette o distanciation , :Scnenrwetor, op. cit. (supra, n. 6z), p. 676. De même K. RETNHARDT, op. cit. (supra, n. 8o), p. rro et p. r42 :Apollon : destin.
rr3. Cf. Sorn., O. C., t536-r537 z
0eoi yàp eü p,év, ôrfè I' eioopôo', 6taveù 0eî' d,ge[6 cr6 eiç tô pr.octveoOar, tpazrfr.
r 14. Àpollon comme élément traditionnel et « conservateur » dans la cité platonicienne : DoDDs, oit. cit. (supra, n, z),pp. zt\-zzr, Sur le problème en général : RrwnorN, op.cit.(supra,n.too),passim,o.otamment pp. 89-106 : « La primautéd'Apollon et de Delphes. »
134
L'entrée en scène d'Apollon, enfin, coïncide avec une nouvelle conception du rôlejoué par le temps dans le mythe. De même qu'au théâtre,les oracles permettent au poète
de prédire ce que la tragédie révélera, de même, dans l'imagerie, Apollon opère la jonction
entre l'avant et l'après. La valeur absolue de l'épisode s'estompe. L'enjeu se situe au-delà
de l'image. L'invisible, manifesté par Apollon, devient l'objet véritable de la représentation.
La scène du mythe reste celle que la tradition avait consacrée (le conservatisme figuratifest inébranlable), mais le spectateur la voit au travers du dieu. Non seulement parce que
l'épisode représenté se rattache à un temps plus vaste dont il n'est qu'un moment transitoire,
mais parce que le présent doit être lu en fonction d'un avenir qui seul lui donne son vrai
sens115. Euripide a largement utilisé les Olympiens comme æpdor»ra æpotanr.x&.rc'est-à-dire
pour exposer les antécédents du drame et indiquer d'avance l'orientation des événements116.
Sophocle, plus encore que son rival, donne au futur la primauté sur le passéll?. L'Apollondes vases fait également frgure de Oeàc æpocæ'cr.x6ç. Par sa présence, l'événement prend
valeur de démonstration; il apparaît comme l'accomplissement d'une volonté supérieure
dont Apollon - Sophocle ne le nomme-t-il pas 0eîov )118 - personnalise la puissance
inexorable. Cette ubiquité du dieu, dans l'imagerie et dans la tragédie, permet de parler
d'une vision apollinienne du monde.
Pour les Grecs, le temps n'est pas neutre; il est porteur d'incertitude; il est lourdde malheurs en puissancslle. Q'gs1 pourquoi il est difficile de dissocier temps et destinée :
celle-ci est la fâce concrète, visible, de celui-là12o. Mais, simultanément, le destin, chez les
Grecs, n'est pas une prédétermination; il est l'accomplissement de la volonté divine.L'oracle - et derrière l'oracle Apollon - est la cause efficiente de ce suspense qui, même
s'il ralentit parfois le déroulement des événements, conduit l'action à son terme inévitable.L'Apollon des vases rend sensible, sur le plan visuel, cette participation du temps qui est
« maître de tout ))121. La fonction du dieu - laisser présager la chute des héros, au moment
r r 5. Sur l'ambiguîté des rapports entre le temps et le mythe : I. PÉprN, Et. Philos., t7, 196z, pp. 55-68. La structuredu mythe est temporelle, même si la signification du mythe est atemporelle. o L'expression mythique,.. introduit nécessai-rement l'avant et l'après dans une réalité qui peut être tota sirlrul » (ibid.,p.59). Il est intéressant de relever que, dans l'ima-gerie de Ia fin du classicisme, cette temporalité tend à être niée. D'où la valeur générale, symbolique, de la scène. Pour latragédie attique : J. de RoMrLLy, Le temps dans la tragédiez (r97r),passim, notamment pp. 9-33.
r16. H. W, Scnuror, Die Struktur des Eingangs, iz W'. lzNs, Die Bauform der griechischen Tragiidie (tg7r), pp. 9-ro,p. 35 et p.43.
rr7. Scxnmr, loc. cit. (n. préc.), p. 29.rr8. Er.r-rcrn,/oc.cit.(supra,n.8o),p.8o:«...dassesfiiLrSophoklesletztlichnurer'zGôttlichesgibt,.Onagénéra-
lementleplurieltùOeïa:Sonn., Phil.,4Sz;O,C.,1537,etO,R.,9ro,où'Azrd).).<ovestnommédansleversprécédent.Cf, Scnaoewer.pr, Zum zweiten Stasimon des n Kônig Gdipus ,, in op. cit. (supra,n.6z),p. 482. Le début du même chceur,par l'invocation aux « lois nées dans l'éthe1 » (863-87r), débouche sur une religion métaphysique, en tout cas sur un u Nach-denken über Gôttliches » (BrrRrcRT, op. cit. fsulsra, u, 3], p. 468 et p. 47o).
rr9. H. FnÂNxrr,, Die Zeitauffassung in der friiLhgriechischen Literatur, in lYege und Formen frühgriechischenDenkens (r955), pp. r-zz; !. de Rorrlr.tv, op. cit.(supra, n. r15), p. 53 : 1pdvo6 et Oedq ont unesignification parallèle dansIa tragédie, ou, même, se confondent, Significatifaussi le passage d'Aristote : Phys.,zzt a,3o.
rzo. Pour aToupr.ov {prap : R. B. ONreNs, The origins of European thought (1954),pp.413-415: «fipr,ap is the fateexperienced by the individual... is a phase offortune ofgreater or less duration , (p, 4r4).
rzr. Dans Gdipe-Roi de Sophocle, c'est Àpollon lui-même qui se manifeste comme le grand révélateur, et non leTemps. Cf. ScuÂorw.tr-ot, op. cit. (supra, * 6z), p.468 : « .., das (Edipus-Drama des Sophokles als Enthüllungsdrama ,.
135
même de leur triomphe - est tragique par essence, car le passage inattendu du bonheurau malheur est le ressort de la tragédie, selon la défrnition d'Aristote. Que révèle, en défi-nitive, cette figuration d'Àpollon en bordure des scènes légendaires, sinon l'oppositionfondamentale entre le statut de la divinité et celui des héros ?a22 Le polythéisme grecprésuppose la condition mortelle des hommes, c'est-à-dire, dans le m1the, l'anéantissementdu héros. Selon un revirement qui s'inscrit dans la structure du mythe - I. Chirassi l'abien montré - le héros devient antagoniste, de protagoniste qu'il était, et c'est le dieu quiassume le rôle de protagonistel2B. L'efficacité d'Àpollon se manif-este souvent dans le non-agbr%: ainsi lorsqu'il renonce à protéger Hector125, ou lorsqu'il ne remplit pas, à l'égardd'Achille, l'engagement qu'il avait pris en présence de Thftis126. Cette passivité, lourde deconséquences, correspond au rôle que nous lui avons reconnu sur les vases. Si, d'Homèreaux tragiques, le pessimisme s'est accru, la vision profonde n'a pas changé. Protagoniste,mais protagoniste passif, Loxias - l'Ambigu - n'ssf jamais aussi redoutable que lorsqu'ils'éloigne1z7. Sa présence, sur les vases, a une sigaification aussi en raison de ce qui auraitpu ne pas être :
'Oæ6).Àcov ori æavcl gæetvetær,, d,ÀÀ' 6clç èo0À6e .
6ç çr,rv iàp, pr.é.1«ç oüroq ' ôç oüx T8e, Àr,càç èxeîvoç.
(Carr,., Hym. Apoll., 9-ro)rrt
J.-M. Moxrr.
Pour l'envoi des photographies, je suis redevable à : Mesdames M.-4. Andrade Maia (Lis-bonne), H. Gropengiesser (Heidelberg), L I. Saverkina (Léningrad), à Messieurs B. F. Cook(Londres), E. de Juliis (Tarente), Fr. Villard (Paris) et Ch. K. §Tilliams (Corinthe). Mes remercie-ments vont aussi à la Conservation du Musée de Gênes et à la Kurhessische Hausstiftung (Adolphseck).
r zz. Comme l'a montré Scttwttrzrn, op, cit. (supra, n. 6t), p. zo rla oisio perspectioa, qui subordonne toute l,actionau point de vue du spectateur, n'est concevable que dans f instantanéité : « §reil aber das Ganze sich einem Blick erôffnet,wirkt es als Momeatbild, und weil es in einem « Augenblick , zusamrnengefassr erscheint, trâgt es in sich die plôtzlichkeitieder sirrnlichen Erscheinung. » Le rôle d'Apollon est donc bien de restituer à l,image, sur le plan temporel, comme sur leplan spatial (cf. supra, n. 6r), cette dimension sacrée - on pourrait dire obfective ou üanscendante - que le nouveau pointde vue, éminemment subiectit du spectateur, risquait d'annihiler.
rz3' I. Cnrnessr, Heros Achilleus-Theos Apollon, in Il mito greco (1977), pp, z3t-26g, nota6ment pp. 232-2i,3,p,24retpp.25o-25r.PourlarivalitéApollon-Néoptolème:FoNrBNnosr,,opt.cit.(su1ra,rL. r8),p.398 etpp.4;,8-426.
rz4, §Trrarrlowtrz, op. cit. (supra, n.6z), p. 83.125, Ilo:l..4,,Il.,XXIl,zrz-2t3. Voir le cratère à volutes du British Museum E468, du peinue de Berlin(ARVI,
p. zo6lt3z; J. D. BEAZLEY , Der Berliner Maler frg3ol, pL.8 ; K. Fnrrs JoHANsEN, The lliad in early Greek art lt967J, p. zt5,fie. sr).
rz6. Aesch, fr.z84 a M (:.fSo N2). Le thème a été repris par Constantin Cevery dans Déloyauté (Poèmes,trad,M. YouncsNen et C. Drr{ARÀs [r978j, p. 86).
rz7' Sur la métope de l'Héraion du Sele, Apollon n'est pas présent au momenr otr Euphorbos frappe par derrièrePatrocle : c'est une main invisible qui lui arrache sa cuirasse. Voir : U. ZaNorrr-BreNco et p. ZeNcaNr-lrtoNrôno, Z' Heraionallafoce del Sele,IÏ (r954), pp. z5o-259,pL.82-83 ; K. Scæroro, Giitter- unil Heldensagen d,er Griechenin der spiiiarchaischenKunst (1978), p. zz3, frg. 3oz. Cf. aussi Becrrr, o1t. cit. (supra, n, r4), p. 9t, n, 26.
r28. SNELL, op. cit.(supra, n.5), P.4z : « Das Sinnvolle und NatiiLrliche der olympischen Gôfter lag nicht nur inihrem Ergreifen i schon ihre Existenz schlechthin gibt ein sinnvolles und natiirliches Bilà dèr Velt... In den èôttern deutetsich den Griechen das Dasein. »
136
































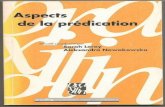









![Le Bas Danube dans la seconde moitié du XI-ème siècle: nouveaux États ou nouveaux peuples?, [w:] Byzantina et Slavica Cracoviensia, V: Byzantium, New Peoples, New Powers: The Byzantino-Slav](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6324f3e485efe380f30672ea/le-bas-danube-dans-la-seconde-moitie-du-xi-eme-siecle-nouveaux-etats-ou-nouveaux.jpg)




