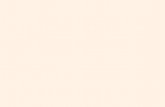Du Brabant au Hainaut, en passant par la Champagne : les avatars de l'Ecclesia semper reformanda...
-
Upload
usaintlouis -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Du Brabant au Hainaut, en passant par la Champagne : les avatars de l'Ecclesia semper reformanda...
67
Monique Maillard-luypaert
Grand Séminaire de TournaiFacultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles
Du BraBant au Hainaut, en passant par la CHampagne : les avatars De l’EcclEsia sEmpEr
rEformanda (première moitié Du Xve sièCle)1
le colloque organisé à tournai en 2004, autour du thème de l’Ecclesia semper reformanda, avait mis en évidence la difficulté, pour l’Église du XVe siècle, d’aboutir à une véritable réforme « dans la tête et dans les membres », selon l’expression consacrée2. Dans la foulée de ce colloque, nous présentons ici deux cas, quasiment inconnus, de réformes monastiques qui s’inscrivent dans le contexte international fort agité des conciles de pise, de Constance et de Bâle : la revitalisation programmée d’un prieuré champenois par des chanoines réguliers brabançons et la tentative, avortée, de transformation d’une communauté bénédictine hainuyère en un chapitre de chanoines séculiers.
––––––1 adresse électronique : [email protected]. nous tenons à remercier Mesdames anne
Dupont (Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve), Sylvette Guilbert (Université de Reims) et Béatrice Leroy (Université de Pau et pays de l’Adour), ainsi que Messieurs Éric Bousmar (Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles ; Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve), Jean-Marie Cauchies (Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles ; Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve), Jean-Vincent Jourd’heuil (Université de Bourgogne, Dijon – UMR 5594 Artehis), Alejandro Enrique Planchart (University of California, Santa Barbara) et le Père Georges-Henri Ruyssen, S.J. (Institut oriental pontifical, Rome ; Centre Sèvres, Paris).
2 De Pise à Trente : la réforme de l’Église en gestation. Regards croisés entre Escaut et Meuse, éd. M. Maillard-luypaert et J.-M. CauChies, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 2004 (Cahiers du Centre de recherches en histoire du droit et des institutions, 21-22).
68
La première réforme a pour cadre la Champagne, pendant le Grand Schisme, sous le pontificat de Jean XXIII3. Elle concerne un prieuré local, Notre-Dame de Cherrey, mais aussi un prieuré brabançon, Notre-Dame de Groenendael. Le lien entre ces deux institutions, c’est le cardinal louis de Bar4, à l’époque évêque de langres.
Fils cadet de Robert, duc de Bar, et de Marie de France, fille du roi Jean II le Bon, Louis de Bar a d’abord occupé le siège épiscopal de Poitiers avant de
––––––3 Ce sujet a été brièvement traité dans M. Maillard-luypaert, Papauté, clercs et laïcs. Le
diocèse de Cambrai à l’épreuve du Grand Schisme d’Occident (1378-1417), Bruxelles, 2001 (Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Collection générale, 88), p. 512-513. Sur le contexte général du Schisme, voir deux publications récentes : H. Millet, L’Église du Grand Schisme 1378-1417, Paris, 2009 (Coll. Les Médiévistes français, 9) ; P. payan, Entre Rome et Avignon. Une histoire du Grand Schisme (1378-1417), paris, 2009.
4 Louis de Bar (vers 1380-Varennes, 23 juin 1430), surnommé le « cardinal de Bar ». Originaire de Bar-le-Duc, Louis était le plus jeune fils de Robert de Bar, duc de Bar, et de Marie de France, fille du roi Jean II le Bon et sœur de Charles V. Sa sœur Yolande (Violante) devint reine d’Aragon. Louis de Bar collectionna les évêchés, dignités et autres bénéfices. Évêque de Poitiers de 1391 à 1395. Chanoine de Chalon-sur-Saône et de Paris jusqu’en 1395. Chanoine de Cambrai et archidiacre de Bruxelles jusqu’à cette même date. Évêque et administrateur de Langres de 1395 à 1413. Promu cardinal-diacre au titre de Sainte-Agathe par Benoît XIII le 21 décembre 1397. Chanoine de Châlons-en-Champagne et doyen du chapitre cathédral en 1405. Lors du concile de Perpignan en 1408, Louis de Bar fit dissidence et, l’année suivante, il n’arriva que tardivement au concile de Pise. Il fut promu cardinal-prêtre au titre des Saints-Apôtres en 1409, puis cardinal-évêque de Porto (évêché suburbicaire) en 1412. En 1413, il résigna son évêché de Langres pour occuper le siège de Châlons-en-Champagne jusqu’en 1420. Cette année-là, il obtint de Martin V l’évêché de Verdun, but ultime de ses ambitions. Il en fut l’administrateur de 1420 à 1423. De mars 1423 à février 1424, il occupa le siège de Poitiers. Il revint ensuite sur celui de Verdun jusqu’à sa mort. Entre-temps, son frère Édouard iii, duc de Bar, ayant été tué en 1415 à la bataille d’azincourt, louis hérita du duché de Bar, qu’il défendit contre les revendications de son beau-frère Adolphe, duc de Juliers et de Berg. en 1419, il arrangea le mariage de son petit-neveu rené d’anjou avec la fille et héritière de Charles ii de lorraine. C’est à René qu’il confia alors le gouvernement du duché de Bar. Louis de Bar fut inhumé dans la cathédrale de Verdun. Sur ce personnage, voir principalement C. eubel, Hierarchia catholica medii aevi, t. i, 2e éd., Münster, 1913, réimpr., 1968, p. 30, 37, 40, 48 ; M. leCoMte, art. Bar (Louis de), dans Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques (abrégé : DHGE), t. VI, Paris, 1932, col. 543-545 ; T. de MoreMbert, art. B[ar]. (Louis de), Dictionnaire de Biographie française, t. V, Paris, 1951, col. 134 ; M. parisse, art. Bar, Ludwig v., dans Lexikon des Mittelalters (abrégé : LM), t. I, Munich-Zurich, 1980, col. 1428-1429 ; H. Millet, Les pères du concile de Pise (1409) : édition d’une nouvelle liste, dans Mélanges de l’École Française de Rome. Moyen Âge, t. XCIII, 1981, p. 723 ; G. poull, La maison souveraine et ducale de Bar, Nancy, 1994, p. 385-393 ; r. Gane, Le chapitre de Notre-Dame de Paris au XIVe siècle, étude sociale d’un groupe canonial, Saint-Étienne, 1999 (C.E.R.C.O.R., Travaux et Recherches), p. 279 ; L. Vallière, Diocèse de Poitiers, Turnhout, 2008 (Fasti Ecclesiae Gallicanae. Répertoire prosopographique des évêques, dignitaires et chanoines de France de 1200 à 1500, 10), p. 149-153, 307 ; C. ponsiCh, La correspondance de Yolande de Bar, reine veuve d’Aragon : une source sur Benoît XIII et le concile de 1408, dans Le concile de Perpignan (15 novembre 1408-26 mars 1409), dir. H. Millet, Canet en Roussillon, 2009-2010 (Études Roussillonnaises. Revue d’Histoire et d’Archéologie Méditerranéennes, 24), p. 98-99.
69
devenir évêque de Langres en 1395 et de recevoir la pourpre en 1397. En 1409, le cardinal assiste au concile de Pise comme délégué du roi de France Charles VI. Il est accompagné de l’archevêque de Reims, Guy de Roye5, et de l’évêque de Cambrai, pierre d’ailly6. Le pape élu à Pise, Alexandre V, va nommer Louis de Bar légat dans les provinces ecclésiastiques de Reims, Sens, Rouen et Tours. C’est précisément dans le cadre d’une mission diplomatique en Brabant, en 1410, que le cardinal entre en contact avec les jeunes communautés de chanoines réguliers du diocèse de Cambrai : Korsendonk, dans le nord du duché, le Rouge-Cloître, Groenendael et Sept-Fontaines, au sud-est et au sud de Bruxelles, en forêt de Soignes7.
––––––5 Sur Guy de Roye († 8 juin 1409), voir M. hayez, Roye, Guy de, dans LM, t. VII, Munich
– Zurich, 1995, col. 1066-1067 ; V. tabbaGh, Guy de Roye, un évêque au temps du Grand Schisme, dans Revue Historique, t. CCXCVI, 1996, p. 29-58 ; P. desportes, Diocèse de Reims, Turnhout, 1998 (Fasti Ecclesiae Gallicanae, op. cit., 3), p. 188-193, 293.
6 Pierre d’Ailly (1351-1420). Né à Compiègne, de son vrai nom patronymique Marguerite, dans une famille bourgeoise d’origine picarde. Docteur en théologie. Chancelier de l’Université de Paris en 1389. Aumônier de Charles VI de 1389 à 1395. Chanoine de Soissons (1375), de Noyon (1381), d’Amiens (1389), de Meaux (1389), de Paris (1389-1395), de Rouen (1390-1395), chanoine et archidiacre de Cambrai (1391-1395). Chancelier de l’église de Paris (1389-1395). Chantre du chapitre de Rouen (1394-1395). Évêque du Puy de 1395 à 1396. Évêque de Cambrai de 1397 à 1411. Cardinal-prêtre au titre de Saint-Chrisogone à partir du 6 juin 1411 jusqu’à sa mort. Sa vie et ses œuvres ont donné lieu à une historiographie abondante. On renverra, pour l’essentiel, à la bibliographie fournie par b. Guenée, Entre l’Église et l’État. Quatre vies de prélats français à la fin du moyen âge (XIIIe – XVe siècle), paris, 1987. on y ajoutera les notices de r. Gane, Le chapitre de Notre-Dame de Paris, op. cit. (C.E.R.C.O.R., Travaux et Recherches), p. 272 ; P. desportes et H. Millet, Diocèse d’Amiens, Turnhout, 1996 (Fasti Ecclesiae Gallicanae, op. cit., 1), p. 181 ; V. tabbaGh, Diocèse de Rouen, Turnhout, 1998 (Fasti Ecclesiae Gallicanae, op. cit., 2), p. 308. Sur son épiscopat cambrésien, voir M. Maillard-luypaert, Papauté, clercs et laïcs, op. cit. (Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Collection générale, 88), p. 395-396 et passim ; id., Entre soustraction et restitution d’obédience : les relations « douces-amères » de Pierre d’Ailly, évêque de Cambrai, avec ses proches (1398-1408), dans À l’ombre du pouvoir. Les entourages princiers au Moyen Âge. Études réunies par A. MarChandisse et J.-L. Kupper, Genève, 2003 (Bibliothèque de la Faculté de philosophie et lettres de l’Université de Liège, 283), p. 13-27 ; id., Le duc de Bourgogne Philippe le Hardi a-t-il voulu faire assassiner l’évêque de Cambrai Pierre d’Ailly ?, dans L’envers du décor. Espionnage, complot, trahison, vengeance et violence en pays bourguignon et liégeois, Neuchâtel, 2008 (Publication du Centre européen d’études bourguignonnes, 48), p. 41-55 ; id., Pierre d’Ailly et le miracle eucharistique de Bois-Seigneur-Isaac : une enquête « fantôme » et une enquête « hâtive » (1405-1413) ?, dans Le miracle du Saint Sang : Bois-Seigneur-Isaac 1405 – 2005. Actes du colloque organisé au prieuré des Prémontrés de Bois-Seigneur-Isaac (Belgique, Brabant wallon) les 13 et 14 mai 2005, éd. J.-M. CauChies et M.-a. Collet-loMbard, Berlin, 2009 (Vita regularis. Ordnungen und Deutungen religiosen Lebens im Mittelalter, 41), p. 119-134.
7 Au cours de sa mission en Brabant, le cardinal de Bar concède divers privilèges d’ordre spirituel. À ce sujet, voir M. Maillard-luypaert, Papauté, clercs et laïcs, op. cit. (Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Collection générale, 88), p. 502-503, 511, 513, 527 et n. 123, p. 550.
70
Au début du XVe siècle, ces communautés brabançonnes sont confrontées au problème de leur adhésion au Chapitre de Windesheim, animé par le courant spirituel de la Devotio moderna8. Mais Windesheim a pris le parti du pape de Rome, Boniface IX. La perspective d’une affiliation à ce Chapitre n’est pas du goût de tous les religieux, surtout à Korsendonk et à Sept-Fontaines. Soucieux de faire avancer le dossier dans la sérénité, l’évêque Pierre d’Ailly propose une étape intermédiaire, qui se réalise en 1402 : la réunion des prieurés de Korsendonk9, de Groenendael10 et du Rouge-Cloître11 en un Chapitre brabançon, dont Groenendael prend la tête. Dès 1409, le prévôt de Groenendael et les représentants de Korsendonk entament de nouvelles discussions en vue de réaliser l’adhésion du Chapitre brabançon à Windesheim et ce malgré l’opposition tenace de certains chanoines. L’affaire est réglée en 1412, malgré quelques dernières réticences12. Sept-Fontaines, cependant, reste momentanément à l’écart en raison d’un grave conflit interne13.
––––––8 Sur ce courant spirituel, voir La dévotion moderne dans les pays bourguignons et rhénans des
origines à la fin du XVIe siècle, Neuchâtel, 1989 (Publication du Centre européen d’études bourguignonnes, 29).
9 La fondation du prieuré de Notre-Dame de Korsendonk remonte à 1394 ou 1395. Sur les origines de ce monastère, ainsi que sur ses premiers rapports avec Windesheim, voir e. persoons, Prieuré de Korsendonk à Oud-Turnhout, dans Monasticon belge (abrégé : MB), t. VIII : Province d’Anvers, vol. 2, Liège, 1993, p. 465-468, et id., Domus beatae Mariae Virginis in Korsendonk (Korsendonk, Oud-Turnhout), dans Monasticon Windeshemense (abrégé : MW), t. I, éd. W. Kohl, e. persoons et A.G. Weiler, Bruxelles, 1976 (numéro spécial de Archives et Bibliothèques de Belgique, 16), p. 67-82.
10 L’entrée des premiers religieux de Groenendael dans l’ordre des chanoines réguliers de saint Augustin remonte à 1350. Sur la vie de ce prieuré au XIVe siècle et sur ses rapports avec Windesheim, voir E. persoons, Prieuré de Groenendaal, à Hoeilaart, dans MB, t. IV : Province de Brabant, vol. 4, Liège, 1970, p. 1075-1077, et D. Verhelst, Domus beatae Mariae Virginis in Viridivalle prope Bruxellam (Groenendaal, Hoeilaart), dans MW, t. i, op. cit., p. 45-66.
11 Le passage des premiers religieux du Rouge-Cloître à la règle de saint Augustin remonte à 1373. Sur les premiers temps de cette communauté, ainsi que sur ses relations avec Windesheim, voir E. persoons, Prieuré du Rouge-Cloître, à Auderghem, dans MB, t. IV : Province de Brabant, op. cit., vol. 4, p. 1095-1096, et M. sMeyers, Domus sancti Pauli in Rubeavalle (Rooklooster, Oudergem), dans MW, t. i, op. cit., p. 108-130.
12 M. Maillard-luypaert, Papauté, clercs et laïcs, op. cit. (Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Collection générale, 88), p. 510-511.
13 La fondation du prieuré de Sept-Fontaines remonte à 1389. Le premier prieur de Sept-Fontaines était Gilles de Breedeyck, très lié à Gérard Groot qui fut à l’origine du courant spirituel de la Devotio moderna. Sur les origines de ce monastère, ainsi que sur la personnalité, l’action et l’œuvre de son premier prieur, notamment le conflit entre lui et sa communauté au sujet de l’affiliation à Windesheim, voir E. persoons, Prieuré de Sept-Fontaines, à Rhode-Saint-Genèse, dans MB, t. IV : Province de Brabant, op. cit., vol. 4, p. 1108-1109 ; M. haVerals, Domus beatae Mariae ad Septem Fontes (Zevenborren, Sint Genesius-Rode), dans MW, t. i, op. cit., p. 195-196 ; J. VanderborGht, Prieuré de Bois-Seigneur-Isaac, à Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, dans MB, t. IV : Province de Brabant, op. cit., vol. 4, p. 1046 et n. 1 ; M. Maillard-luypaert, Pierre d’Ailly et le miracle eucharistique de Bois-Seigneur-Isaac, op. cit. (Vita regularis. Ordnungen und Deutungen religiosen Lebens im Mittelalter, 41), p. 130-131.
71
C’est dans ce contexte délicat que le cardinal de Bar va prendre une décision importante qui concerne une communauté régulière de Champagne, dans son propre diocèse, Langres. Au lieu-dit Cherrey, au pied du castrum de Bourg, résidence des évêques, à 8 km au sud de Langres, Louis de Bar a fait construire à la fin du siècle précédent un monastère comprenant une église et divers bâtiments qu’il a dotés grâce aux revenus de la mense épiscopale14. avec le consentement des chanoines du chapitre cathédral, Louis de Bar a incorporé à ce monastère l’église paroissiale de Bourg, ainsi que l’hôpital Saint-Nicolas de Grosse-Sauve15.
L’objectif du cardinal était de faire dépendre ce complexe monastique d’un Ordre pour lequel il avait une affection toute particulière : l’Ordre de Saint-Jérôme, fondé en Espagne en 1370, qui rassemblait des chanoines réguliers sous la règle de saint augustin16. louis de Bar donna donc à la maison le double vocable de Notre-Dame et de Saint-Jérôme et y installa un prieur et douze frères appartenant à l’ordre hiéronymite, dont plusieurs venaient du royaume d’Aragon. Cette fondation fut approuvée et confirmée, comme toutes les autres, par Benoît XIII.
Malheureusement pour le cardinal, la deuxième soustraction d’obédience à Benoît XIII, en 1408, aura pour effet de faire partir de Cherrey les religieux
––––––14 Cherrey (Charello) (France, dép. Haute-Marne, arr. et cant. Langres, comm. Bourg). Bourg se
situe sur le rebord du plateau de Langres, à 436 m d’altitude. Bâti à l’extrémité du plateau, le castrum fut la résidence des évêques de Langres jusqu’au XIVe siècle. Cherrey était membre du prieuré augustinien de Saint-Geosmes. Les seuls renseignements dont nous disposons au sujet de ce prieuré, dont il ne reste aucun vestige, figurent dans J. laurent et F. Claudon, Abbayes et prieurés de l’ancienne France. Recueil historique des archevêchés, évêchés, abbayes et prieurés de France, t. XII : Province ecclésiastique de Lyon, 3e partie : Diocèses de Langres et de Dijon, Ligugé – Paris, 1941 (Archives de la France monastique, 45), p. 244, 465-466.
15 Grosse-Sauve (Grossosilve) (France, dép. Haute-Marne, arr. Langres, cant. Fayl-Billot, comm. Les Loges). L’hôpital Saint-Nicolas, ici désigné, était l’hôpital propre de l’Église de Langres. À partir de 1258, il fut administré sous l’autorité de cette Église par un maître et des frères formant un couvent placé sous la règle de saint Augustin. Au XVe siècle, l’hôpital était toujours conventuel : J. laurent et F. Claudon, Abbayes et prieurés, op. cit. (Archives de la France monastique, 45), p. 522.
16 L’Ordre des Ermites de Saint-Jérôme ou Ordre des Hiéronymites est un ordre religieux masculin de chanoines réguliers vivant sous la règle de saint augustin. Les premiers monastères sont fondés par le roi Jean Ier de Trastamare (1379-1390) à Lupiana (San Bartolomé), à La Sisla près de Tolède, à la Guadalupe (Santa Maria) en 1389. En 1392, c’est au tour de la reine veuve, Yolande (Violante), d’aider à la fondation en Catalogne, près de Barcelone, du monastère San Jeronimo del Valle de Hebrón. L’Ordre des jerónimos connut un grand succès dans la péninsule ibérique : trente monastères fondés en quarante ans ! Les prieurs hiéronymites devinrent les confesseurs des rois. Voir B. leroy, L’Église en Espagne au Moyen Âge. Ses combats du VIIe au XVe siècle, Limoges, 2009, p. 79-80 ; pour approfondir le sujet : a. linaGe Conde, art. Hiéronymiens. 1. Hiéronymites, dans DHGE, t. XXIV, Paris, 1991, col. 401-420 ; S. CousseMaCKer, Les confesseurs hiéronymites des souverains castillans de 1373 à 1474, quels confesseurs pour quels rois ?, dans Les serviteurs de l’État au Moyen Âge, XXIXe Congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur (Pau, mai 1998), Paris, 1999, p. 85-104, surtout p. 85.
72
hiéronymites originaires de l’Aragon, au point qu’en 1410, les frères ne sont plus que quatre. Le prieur, Jean de Campis, renonce alors à ses fonctions et résigne sa charge dans les mains du cardinal. alerté, ce dernier convoque un conseil. que faire ? Où aller ? Dans le royaume de France, il n’existe aucun autre monastère de cet Ordre espagnol. C’est alors que Louis de Bar a une idée, qu’il met à exécution le 24 juin 1410 en sa qualité « d’administrateur spirituel et temporel de l’Église et du duché de langres et de fondateur du monastère notre-dame de Cherrey »17. parmi tous les monastères soumis à la règle de saint augustin, il en est un où l’observance de cette règle « selon le cœur » du cardinal est plus grande que partout ailleurs : Notre-Dame de Groenendael, en forêt de Soignes, dans le diocèse de Cambrai. En présence de plusieurs témoins, dont le vicaire épiscopal Guillaume Antoine, chanoine de Langres et archidiacre du Tonnerrois, Louis de Bar prend trois mesures. Il libère d’abord Cherrey de l’Ordre de Saint-Jérôme. Ensuite, il convertit Cherrey en couvent de chanoines de l’Ordre de Saint-Augustin et le soumet, lui et ses membres, au prieuré de Groenendael, à son Ordre et à son chapitre. Le prieur sera désormais élu, institué et éventuellement déposé par le prévôt et le chapitre brabançons. Les fêtes traditionnelles seront toujours célébrées à Cherrey, tandis qu’à Groenendael, on fera commémoration, aux mâtines et aux vêpres, de saint Jérôme et de sainte Léa18. Enfin, le cardinal brise l’union de l’hôpital de Grosse-Sauve à Cherrey, en raison des difficultés que celle-ci présente, et demande que cette institution revienne à son statut antérieur.
Louis de Bar a manifestement préparé son affaire. Avant de faire instrumenter ses décisions, il a reçu une lettre du prévôt de Groenendael, datée du 23 mai. Trois candidats, trois chanoines réguliers, étaient proposés comme nouveau prieur de Cherrey : Gilbert Spronk, Jacques de Hallis et Jean Smeets ou Fabri. C’est ce dernier que choisit le cardinal. Le 14 novembre 1410, toutes les décisions prises par Louis de Bar sont confirmées par le pape Jean XXIII19.
La lettre du cardinal de Bar de juin et la bulle de Jean XXIII de novembre 1410 remettent en question les assertions de deux spécialistes de la France monastique, Jacques Laurent et Ferdinand Claudon : le prieuré de Cherrey, « sans origine connue », avait d’abord été augustinien avant l’introduction, par Louis de Bar en 1413, de moines ermites20. Déjà, il y a là un problème de chronologie. Par ailleurs,
––––––17 Comme le mentionne le cardinal lui-même dans l’acte notarié du 24 juin 1410, inséré dans
une bulle de Jean XXIII, datée de Bologne, au château Saint-Pierre, le 14 novembre 1410 : VatiCan, Archivio Segreto Vaticano (abrégé : ASV), Registra Lateranensia (abrégé : Reg. Lat.) 148, f. 151r-153v.
18 Léa (Leta), veuve romaine, disciple de saint Jérôme, morte en 384, était et est encore fêtée le 22 mars.
19 VatiCan, ASV, Reg. Lat. 148, f. 151r-153v. il n’est nulle question de cette affaire dans M. erKens, De geschiedenis van de priorij Groenendaal, dans Eigen Schoon en De Brabander, t. LXIV, 1981, p. 247-270.
20 J. laurent et F. Claudon, Abbayes et prieurés, op. cit. (Archives de la France monastique, 45), p. 465-466.
73
si l’on comprend l’attachement du cardinal aux hiéronymites espagnols, qui s’explique peut-être par l’influence de sa sœur Yolande, la reine veuve d’Aragon, on est davantage surpris par son engouement pour la communauté de Groenendael. Le départ de trois chanoines réguliers vers la Champagne n’a laissé aucune trace dans les archives du prieuré brabançon. Ni Jean Smeets, le nouveau prieur de Cherrey, ni Jacques de Hallis ne figurent dans l’obituaire de Groenendael, mais Gilbert Spronk, par contre, s’y trouve, car il est revenu mourir dans son ancien couvent en février 141221. En outre, si saint Jérôme est fêté à Groenendael le 30 septembre – le contraire serait surprenant ! –, on cherche vainement le nom de sainte Léa au 22 mars… Ce qui laisse supposer que le prieuré de Cherrey, nouvelle version, n’a peut-être pas survécu à son fondateur… La question mérite en tout cas d’être approfondie22.
La deuxième tentative de réforme se passe en Hainaut. Elle concerne l’abbaye bénédictine de Saint-Ghislain, située au cœur du comté, dans la vallée de la Haine. Le contexte international est celui de la fin du règne de Martin V à Rome et des débuts du concile de Bâle. Au plan régional, le règne hainuyer de la comtesse Jacqueline de Bavière s’achève bientôt23. Le personnage central, c’est l’abbé Jean de layens24. Comme précédemment, les sources dont on dispose pour connaître cette affaire sont extraites essentiellement des Archives Vaticanes. Dom Ursmer
––––––21 Gilbert ou Guilbert Spronc ou Spronck, cité à Groenendael vers 1406, décédé le 21 février
1412, était prêtre et maître ès arts. Il fut le 47e chanoine de Groenendael après avoir été recteur des écoles de Malines pendant plusieurs années : M. dyKMans, Obituaire du monastère de Groenendael dans la forêt de Soignes, Bruxelles, académie royale de Belgique, 1940, p. XXXVII, 19, 114, 355.
22 Les Archives départementales de la Haute-Marne ne conservent que très peu de documents relatifs à Bourg sous l’Ancien Régime, tout au plus dans la série F (Fonds Laloy), mais rien, en tout état de cause, sur le prieuré de Cherrey.
23 Pour rappel, c’est le 22 juin 1427 que les États de Hainaut reconnaissent Philippe le Bon, duc de Bourgogne et comte de Flandre, comme mambour et gouverneur du Hainaut, et plus proche héritier de la comtesse (L. deVillers, Cartulaire des comtes de Hainaut, t. IV, Bruxelles, 1889, p. 602-604, n° 1534). Et c’est le 3 juillet 1428, à Delft, que Jacqueline de Bavière reconnaît le duc comme héritier, au cas où elle mourrait sans enfant. Le duc et Jacqueline ont d’abord signé à Delft un traité de paix (L. deVillers, Cartulaire, op. cit., t. IV, p. 666-675, n° 1578, p. 675-677, n° 1579).
24 L’abbatiat de Jean de Layens, qui commença en 1402, a fait l’objet de longs développements dans les Annales de l’abbaye de Saint-Ghislain par dom Pierre Baudry, dans Monuments pour servir à l’histoire des provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg, éd. Baron de reiffenberG, t. VIII, Bruxelles, 1848, p. 529-560, surtout p. 529, 531-532, 535-538, 551-552, 555-556. Sur ce personnage, voir aussi u. berlière, MB, t. i : Province de Namur : Supplément, Province de Hainaut, Maredsous, 1897, p. 261.
74
Berlière, qui en a publié quelques-unes25, a prétendu que l’épisode était « resté inconnu » à dom pierre Baudry, l’auteur des Annales de l’abbaye de Saint-Ghislain au XVIIIe siècle26. Si cette assertion n’est pas entièrement vraie, elle n’est pas non plus tout à fait fausse… C’est en confrontant les documents vaticans, les Annales de l’abbaye et les sources cambrésiennes qu’il est possible de lever un coin du voile sur cette curieuse affaire.
Tout commence officiellement le 18 avril 1429 par une supplique de Jean de Layens adressée à Martin V. Jean de Layens était abbé de Saint-Ghislain depuis 1402. À l’époque des conciles de Pise et de Constance, ce docteur en théologie de l’université de paris s’était lié d’amitié avec l’évêque de Cambrai pierre d’ailly, qui venait le voir de temps à autre pour discuter du schisme qui sévissait alors dans l’Église. Jean de Layens était aussi un proche conseiller des comtes de Hainaut : de Guillaume IV de Bavière, qui lui confia à maintes reprises des missions politiques et diplomatiques en France, en Hollande, en Angleterre, puis de Jacqueline de Bavière27. dans ses Annales de l’abbaye de Saint-Ghislain, dom Baudry écrit que « notre abbé a été », pour le comte Guillaume IV, « le premier conseiller et le premier confident dans les affaires les plus secrètes et les plus importantes de ses
––––––25 u. berlière, Inventaire analytique des Diversa Cameralia des Archives Vaticanes (1389-
1500) au point de vue des anciens diocèses de Cambrai, Liège, Thérouanne et Tournai, rome, Institut historique belge de Rome, 1906, Annexes, p. 205-208, n° XXI, p. 212-215, n° XXIII, p. 215-217, n° XXIV, p. 218, n° XXV, p. 219, n° XXVI. Voir également id., Coup d’œil historique sur l’Ordre bénédictin en Belgique dans le passé et dans le présent, dans Revue Liturgique et Monastique, t. XIV, Maredsous, 1928-1929, p. 473, mais aussi Repertorium Germanicum. Regesten aus den päpstlichen Archiven zur Geschichte des Deutschen Reiches und seiner Territorien im XIV. und XV. Jahrhundert, t. i : Pontifikat Eugens IV. (1431-1447), éd. r. arnold, Berlin, 1897, p. 52, n° 271, p. 276-277, n° 1704, p. 277, n° 1705, p. 313, n° 1932 et F. baix, La Chambre apostolique et les « Libri annatarum » de Martin V (1417-1431). Première partie : Introduction et Textes, Bruxelles – Rome, 1942 (Analecta Vaticano-Belgica. Documents relatifs aux anciens diocèses de Cambrai, Liège, Thérouanne et Tournai, 14), p. XLVIII, n. 1, p. LXXIV, n. 12, p. LXXIX et n. 3, p. CXIII et note 4, p. CXIV et notes 2-3, p. 328, n° 887 et n. 4, p. 329 et n. 1.
26 u. berlière, Inventaire analytique des Diversa Cameralia, op. cit., p. 64-65, n. 1.27 Jean de Layens est cité comme premier membre du conseil du comte Guillaume IV en
1406 (Annales, op. cit., p. 533). Guillaume venait souvent chasser dans les bois de l’abbaye (Annales, op. cit., p. 536). L’abbé fit partie du conseil de Jacqueline en 1418 (L. deVillers, Cartulaire, op. cit., t. IV, p. 117-122, n° 1178, p. 123-131, n° 1179, p. 131-137, n° 1180, p. 143-144, n° 1181). Il assista au mariage de la comtesse avec Jean IV de Brabant, le 10 mars 1418, au château de La Haye (L. deVillers, Cartulaire, op. cit., t. IV, p. 146, n° 1187). Les démêlés sentimentaux et matrimoniaux de Jacqueline de Bavière eurent des répercussions fâcheuses jusqu’à Saint-Ghislain, où la population, tant de la ville que du monastère, craignit un siège par les troupes de Jean IV, le mari éconduit de la comtesse (Annales, op. cit., p. 542-544).
75
États »28. Jean de Layens assista d’ailleurs aux assemblées conciliaires de 1409 à Pise et 1415 à Constance en tant que délégué du comte de Hainaut29 et c’est là qu’il retrouva son ami pierre d’ailly. durant tout son abbatiat, cet homme, réputé pour sa science et ses grandes vertus, a été préoccupé par le déclin de la discipline monastique et par le faible niveau intellectuel du clergé en général et de sa communauté en particulier. Il tenta, vainement semble-t-il, de remédier à de nombreux abus, comme la présence, dans son monastère, d’enfants et d’adolescents de familles aristocratiques, placés par leurs parents sans aucun souci de vocation. Il rappela sans relâche l’exigence de la règle de saint Benoît, limita le nombre des moines à vingt-quatre et envoya les jeunes recrues à l’université de paris30. l’accession au cardinalat de pierre d’ailly, la résignation de son évêché et l’arrivée sur le siège de Cambrai de Jean de Gavre31 ne changèrent rien aux bonnes relations que Jean de Layens entretenait avec la curie épiscopale. L’abbé de Saint-Ghislain se rendait souvent à Cambrai. il y résida même longuement en 1428 et 1429, pour, écrit dom Baudry, « des affaires importantes concernant l’Église… comme nous l’apprenons des comptes de ce temps-là, qui ne disent pas quelles furent ces
––––––28 Annales, op. cit., p. 538. Comme abbé de Saint-Ghislain, Jean de Layens était membre des
États de Hainaut (L. deVillers, Cartulaire, op. cit., t. IV, p. 228, n° 1263, p. 235, n° 1269, p. 238, n° 1270, p. 241, n° 1273, p. 246, n° 1275).
29 De Constance, l’abbé écrivit à ses moines et au comte Guillaume IV en juillet 1415 (L. deVillers, Cartulaire, op. cit., t. IV, p. 41, n° 1122). Sur la participation de Jean de Layens aux assemblées conciliaires, voir M. Maillard-luypaert, Papauté, clercs et laïcs, op. cit., p. 375-377, 380-382.
30 Le 10 juin 1408, Jean de Layens obtint de l’évêque Pierre d’Ailly l’approbation et la confirmation des statuts qu’avait promulgués l’abbé Étienne de Warelles en 1354, statuts qu’il avait lui-même revus et complétés (Annales, op. cit., p. 532).
31 Jean de Gavre. Deuxième fils d’Arnold II de Gavre († 1414), seigneur de Lens, de Liedekerke, de Herchies et de Ressegem, et de Marguerite de Boutersem. Frère de Philippe, d’Henri et de Corneille. il fut évêque de Cambrai de 1412 à sa mort, le 10 mars 1439. en 1425, il dirigea l’ambassade que le duc de Brabant, Jean IV, envoya auprès du pape Martin V pour demander l’annulation de son mariage avec la comtesse de Hainaut, Jacqueline de Bavière. Il participa à l’ambassade du duc de Bourgogne, Philippe le Bon, au concile de Bâle, en 1433. Il fut inhumé dans le chœur de la cathédrale de Cambrai. Les dépouilles de ses frères Henri et Philippe, tués à Azincourt, furent amenées à Cambrai pour être inhumées en même temps que lui : lille, Archives départementales du Nord (abrégé : ADN), 3 G 685, f. 116v-119r ; ADN, 36 H 431, f. 191v ; dupont, Histoire ecclésiastique et civile de la ville de Cambrai et du Cambrésis, t. ii, Quatrième partie, s.l.n.d. [entre 1759 et 1767], p. 80-81 et p. I-IV (Description des funérailles de l’évêque Jean de Lens). Sur ce personnage, voir J. toussaint, Les relations diplomatiques de Philippe le Bon avec le concile de Bâle (1431-1449), Louvain, 1942 (Université de Louvain. Recueil de Travaux d’Histoire et de Philologie, 3e série, 9), p. 135 et 254, n. 2 ; G. de liedeKerKe, Histoire de la maison de Gavre et de Liedekerke, t. i, Bruxelles, 1957, p. 403-405 ; A. uyttebrouCK, Le gouvernement du duché de Brabant au bas moyen âge (1355-1430), t. II, Bruxelles, 1975 (Université libre de Bruxelles. Faculté de Philosophie et Lettres, 59), p. 708, n° 158 ; M. Maillard-luypaert, Papauté, clercs et laïcs, op. cit., p. 396, n. 54.
76
affaires »32. L’abbé logeait dans un hôtel mis en location par un chanoine de Saint-Géry, Pierre Politre33, cousin et chapelain du défunt Pierre d’Ailly.
C’est manifestement lors de son long séjour cambrésien, en novembre 142834, que l’abbé de Saint-Ghislain envoie à Rome une supplique, qui sera alors datée par la chancellerie pontificale du 18 avril 142935. Pour l’expédition, il utilise les services d’un chanoine de Sainte-Croix de Cambrai, Gérard Le Couturier36. D’emblée, Jean de Layens, affaibli par l’âge et manifestement découragé, expose la situation de son monastère, qu’il juge désastreuse en raison de la présence de plusieurs jeunes moines illettrés et inexpérimentés. Craignant pour l’avenir de sa communauté, il demande à Martin V de le dégager de son abbatiat, de relever les moines de leur observance, de libérer le monastère de l’Ordre de saint Benoît, d’octroyer des pensions aux membres de la communauté, d’ériger, en lieu et place de l’église abbatiale, une église collégiale, avec deux dignités – une prévôté et un décanat –,
––––––32 Annales, op. cit., p. 550, mais aussi p. 546 et 558. L’abbé revint de Cambrai le 13 octobre
1428, au plus tard, et il y retourna encore l’année suivante. Dans la cité épiscopale, Jean de Layens avait à son service un secrétaire et un valet de chambre. Il disposait aussi d’un cheval pour ses déplacements. Après son décès, une partie des meubles et la vaisselle en argent furent vendues pour rembourser les dettes qu’il avait contractées.
33 Pierre Politre. Prêtre originaire du diocèse de Soissons. Chapelain perpétuel dans l’église paroissiale de Grammont, au diocèse de Cambrai. Chanoine prébendé de Saint-Géry de Cambrai (cité en 1432 : lille, ADN, 7 G 573, f. 300r) et de Saint-Ursmer de Binche. Ancien titulaire de la cure de Chièvres, résignée avant le 1er juillet 1428. il fut l’un des exécuteurs testamentaires de Raoul Le Prêtre (ADN, 4 G 1090, f. 85v) [voir note 37]. Sur ce personnage, voir H. dubrulle, Les bénéficiers des diocèses d’Arras, Cambrai, Thérouanne, Tournai, pendant le pontificat de Martin V d’après les documents conservés aux Archives d’État, à Rome, dans Analectes pour servir à l’histoire ecclésiastique de la Belgique (abrégé : AHEB), t. XXXI, 1905, p. 279, n° 374 ; F. baix, La Chambre apostolique, op. cit. (Analecta Vaticano-Belgica. documents relatifs aux anciens diocèses de Cambrai, liège, thérouanne et tournai, 14), p. 254-255, n° 679 et n. 6 ; M.-J. tits-dieuaide, Lettres de Benoît XIII (1394-1422), t. ii (1395-1422), Bruxelles – Rome, 1960 (Analecta Vaticano-Belgica. Documents relatifs aux anciens diocèses de Cambrai, liège, thérouanne et tournai, 19. documents relatifs au Grand Schisme, 5), p. 106-107, n° 245 ; P. brieGleb et a. laret-Kayser, Suppliques de Benoît XIII (1394-1422). Première partie : Textes et analyses, Bruxelles – Rome, 1973 (Analecta Vaticano-Belgica. Documents relatifs aux anciens diocèses de Cambrai, Liège, Thérouanne et Tournai, 26. Documents relatifs au Grand Schisme, 6), p. 533, n° 2495.
34 Ces précisions sont fournies par dom Baudry, qui a épluché les comptes de son monastère (Annales, op. cit., p. 550).
35 VatiCan, ASV, Registra Supplicationum (abrégé: Reg. Suppl.) 233, f. 101v-102v. Document édité par H. dubrulle, Suppliques du pontificat de Martin V (1417-1431), Lille, 1922, p. 126-129, n° 174, avec une référence incomplète.
36 Gérard Le Couturier (Sutoris). Prêtre originaire de Lunéville, au diocèse de Toul. Bachelier en droit canon. Chapelain perpétuel à l’autel Sainte-Maxellende dans la cathédrale de Cambrai (collation apostolique du 21 juin 1426). Curé de Saint-Nicolas-du-Bruille à Tournai, au diocèse de Cambrai (cité en 1430). Chanoine de Sainte-Croix de Cambrai, puis de Saint-Géry. Sur ce personnage, voir Annales, op. cit., p. 550 et 559 ; H. dubrulle, Les bénéficiers des diocèses d’Arras, Cambrai, Thérouanne, Tournai, pendant le pontificat de Martin V, op. cit., dans AHEB, t. XXXI, p. 257, n° 201, p. 294, n° 491.
77
un simple office – une chantrerie –, ainsi que des canonicats avec prébendes, enfin, de désigner comme commissaires l’évêque de Cambrai Jean de Gavre, l’archidiacre de Hainaut Raoul Le Prêtre37 et le doyen du chapitre cathédral Jacques de Metz-Guichard38. l’abbé ajoute une dernière faveur : que le droit de collation aux futurs canonicats et dignités, ainsi qu’à tous les bénéfices dont disposent l’abbé et sa communauté, soit transféré aux prévôt, doyen et chapitre futurs et que ces derniers puissent juger les délits perpétrés par les futurs chanoines et leurs suppôts, comme cela se pratique à Saint-Vincent de Soignies, autre chapitre collégial du diocèse de Cambrai. Pourquoi Soignies ? La réponse viendra bientôt…
Martin V répondra par une bulle datée du lendemain, 19 avril 142939. Cette date concorde avec les indications fournies par l’annaliste Baudry, qui explique
––––––37 Raoul Le Prêtre (Presbiteri). Prêtre originaire de Compiègne, au diocèse de Soissons. Neveu
de Pierre d’Ailly, qui le fit entrer au Collège de Navarre comme boursier artien (1388). Bachelier en droit canon d’Angers (1397). Chanoine du chapitre cathédral de Cambrai depuis 1398. Vicaire épiscopal de 1398 à 1412. Scelleur de l’évêché depuis 1399 (lille, ADN, 3 G 537, n° 51 : acte inséré dans un vidimus du 26 octobre 1440) jusqu’en 1402. Archidiacre de Hainaut depuis 1402. Le Prêtre cumula les prébendes, entre autres à Laon, Noyon, Saint-Géry de Cambrai, Saint-Donatien de Bruges, Saint-Pierre de Lille et Tournai. Au sein du chapitre cathédral, il était tout à la fois l’œil, l’oreille et le bras de l’évêque. C’est à lui que les chanoines s’adressaient quand pierre d’ailly était absent. Ce dernier le désigna d’ailleurs premier de ses exécuteurs testamentaires. Le Prêtre mourut le 28 juin 1443 et ses funérailles eurent lieu le samedi 13 juillet (ADN, 4 G 1090, f. 88v ; 4 G 4650, f. 17r). À la suite de l. saleMbier, Petrus de Alliaco, Lille, 1886, p. 369, D. lourMe, Chanoines, officiers et dignitaires du chapitre cathédral de Cambrai (1357-1426). Étude prosopographique et institutionnelle, Paris, École Nationale des Chartes, 1991 (thèse inédite), notice biographique n° 208, a dédoublé ce personnage, distinguant un Raoul Le Prêtre l’aîné et un Raoul Le Prêtre le jeune, l’un qui aurait été simplement chanoine et archidiacre, l’autre, vicaire épiscopal et scelleur. Sur Raoul Le Prêtre, voir également J. houdoy, Histoire artistique de la cathédrale de Cambrai. Ancienne église métropolitaine Notre-Dame : comptes, inventaires et documents inédits, Lille, 1880, réimpr., Genève, 1972, p. 279, 352, 358 ; F. baix, La Chambre apostolique, op. cit. (Analecta Vaticano-Belgica. Documents relatifs aux anciens diocèses de Cambrai, Liège, Thérouanne et Tournai, 14), p. 324-325, note 4 ; N. GoroChoV, Le Collège de Navarre, de sa fondation (1305) au début du XVe siècle (1418) : histoire de l’institution, de sa vie intellectuelle et de son recrutement, Paris, 1997, p. 689, 728 ; d. Muzerelle, Manuscrits datés des bibliothèques de France, t. i : Cambrai, paris, institut de recherche et d’histoire des textes, 2000, p. XVI-XVIII ; M. Maillard-luypaert, Papauté, clercs et laïcs, op. cit., p. 229, n. 33, p. 374, n. 150, p. 395, 412.
38 Jacques de Metz-Guichard. Docteur in utroque jure. Chapelain de Benoît XIII, de Jean XXIII, de Martin V. Auditeur des causes du palais apostolique. Vicaire de l’évêque d’Amiens en 1395. Chanoine d’Amiens de 1403 à sa mort en 1430. Chanoine de Rouen (cité comme tel le 6 octobre 1404 : CaMbrai, Bibliothèque municipale (abrégé : BM), Ms. B 1055, f. 94v). Chanoine de Cambrai et doyen du chapitre cathédral de 1407 à 1430. Sur ce personnage, voir F. baix, La Chambre apostolique, op. cit. (Analecta Vaticano-Belgica. Documents relatifs aux anciens diocèses de Cambrai, Liège, Thérouanne et Tournai, 14), p. 221, n° 578, n. 3 ; P. desportes et H. Millet, Diocèse d’Amiens, Turnhout, 1996, p. 134 (Fasti Ecclesiae Gallicanae, op. cit., 1).
39 VatiCan, ASV, Reg. Lat. 285, f. 225r-226r. u. berlière, Inventaire analytique des Diversa Cameralia, op. cit., p. 64, n. 1 et Annexes, p. 205-208, n° XXI.
78
que l’abbé reçut des lettres de Rome, lesquelles, dit Baudry, « lui furent portées à Cambray, le lundi des Pâques, où il en reçut encore d’autres au mois de mai, dont il fut très satisfait ». Baudry ajoute que le 22 mai, l’abbé fit venir de Saint-Ghislain à Cambrai Jean Hecquet, « religieux très expérimenté et très habile, pour conférer avec lui sur les affaires contenues dans ces lettres, dont le compteur [receveur] de l’abbaye semble nous avoir voulu dérober à dessein la connaissance, s’étant contenté de nous apprendre seulement que ce prélat envoya Le Couturier à Rome pour les affaires de l’église »40. Dans sa bulle, le pape acquiesce à l’ensemble des demandes formulées par l’abbé et il renvoie l’affaire à l’Ordinaire du lieu, qu’il charge de diligenter une enquête sur la situation du monastère et de décider, en conscience, de la suppression de la communauté et de l’érection, à la place de l’abbaye, d’une collégiale. Les trois commissaires désignés ont aussi pour tâches d’assigner des pensions à l’abbé et aux moines, comme cela se fait à Soignies, d’instituer une prévôté, un décanat, une chantrerie, des canonicats dotés de prébendes, de fournir tous les renseignements nécessaires à la Chambre apostolique sur les futurs titulaires de ces dignités et bénéfices afin que celle-ci puisse établir la taxation du nouveau chapitre, et de transférer à ce dernier la collation de tous les bénéfices, à l’exception toutefois de la prévôté que le pape entend se réserver. Le prévôt, le doyen et le chapitre pourront exercer leur juridiction comme le font déjà ceux de Saint-Vincent de Soignies.
Le 11 janvier 1430, Gérard Le Couturier, le procureur de l’abbé de Saint-Ghislain, s’oblige vis-à-vis de la Chambre apostolique41. Il promet, si le monastère est transformé en collégiale, de faire connaître à la Chambre, dans les quatre mois sous peine de sanctions, les noms des futurs chanoines et la valeur des bénéfices qui leur seront attribués.
Mais les commissaires chargés de la sécularisation de l’abbaye vont commettre une erreur : ils prennent leur temps. Il est vrai que l’un des trois, Jacques de Metz-Guichard, va mourir en 1430. Ce n’est que le 23 mars 1431 que les deux survivants – l’évêque et l’archidiacre de Hainaut – désignent le doyen, le chantre et tous les autres titulaires de prébendes, insistant alors pour qu’ils prennent au plus vite possession de leurs stalles. L’acte42 est établi par un notaire et auditeur juré de la curie épiscopale, Jean de la Haie, en présence de plusieurs témoins dont le scelleur,
––––––40 Annales, op. cit., p. 550.41 H. dubrulle, Les bénéficiers des diocèses d’Arras, Cambrai, Thérouanne, Tournai, pendant
le pontificat de Martin V, op. cit., dans AHEB, t. XXXI, p. 294, n° 491 ; U. berlière, Inventaire analytique des Diversa Cameralia, op. cit., p. 64-65, n. 1. Le Couturier se trouvait à Rome comme procureur auprès de la Curie romaine depuis le mois d’octobre 1429 au moins (H. dubrulle, Les bénéficiers des diocèses d’Arras, Cambrai, Thérouanne, Tournai, pendant le pontificat de Martin V, op. cit., dans AHEB, t. XXXI, p. 291, n° 469).
42 VatiCan, ASV, Camera Apostolica (abrégé : Cam. Ap.), Diversa Cameralia (abrégé : Div. Cam.) 16, f. 111v-113r [regeste dans ASV, Schedarium Garampi, Vescovi, 9, n° 483, f . 89r]. Document publié par U. berlière, Inventaire analytique des Diversa Cameralia, op. cit., p. 64-65, n. 1 et Annexes, p. 212-215, n° XXIII.
79
Gilles Claren43, membre du chapitre cathédral et aussi du chapitre de Saint-Vincent de Soignies, et deux juristes, l’official de Cambrai Oudard Le Riche44 et celui qui sera plus tard son successeur, Grégoire Nicole45. Ce qu’à Cambrai on ignore au moment de l’établissement du document, c’est que Martin V est mort depuis plus d’un mois (23 février 1431) et qu’Eugène IV a déjà été élu et couronné (3 et 11 mars suivants). L’acte est remis à Gérard Le Couturier, chargé de l’apporter à la Curie romaine.
––––––43 Gilles Claren. Sous-diacre. Maître ès arts. Curé de Gooik en 1425, de Bray en 1428. Chanoine
du chapitre de Saint-Vincent de Soignies (collation pontificale du 1er janvier 1425), ensuite doyen de ce chapitre (cité en 1426). A. deMeuldre, Le chapitre de Saint-Vincent à Soignies, ses dignitaires et ses chanoines, Soignies, 1902 (Extrait des Annales du Cercle archéologique du Canton de Soignies, t. III) ne le cite ni dans la liste des chanoines ni dans celle des doyens : ou bien Claren n’est jamais entré en possession de sa stalle et de sa dignité, ou bien son passage au chapitre sonégien, en 1426, fut très bref et n’a guère laissé de traces dans les archives capitulaires ; peut-être exerça-t-il le décanat entre Thierry Le Moulnier, mort le 16 mai 1426 (A. deMeuldre, Le chapitre de Saint-Vincent, op. cit., p. 277-278), et Pierre Henne, cité le 30 janvier 1427 (op. cit., p. 250). Claren fut doyen du chapitre de Saint-Rombaut de Malines en 1429 (cité en 1429 ; décanat résigné avant le 4 août 1432). Scelleur de la curie épiscopale de 1428 à 1430. Chanoine de Sainte-Croix de Cambrai (cité le 6 novembre 1430 : lille, ADN, 6 G 177, f. 77v ; prébende résignée avant le 31 mars 1431 : ADN, 6 G 177, f. 80v). Chanoine du chapitre cathédral de Cambrai (cité en 1435 : CaMbrai, BM, Ms. B 1057, f. 13r). Sur ce personnage, voir H. dubrulle, Les bénéficiers des diocèses d’Arras, Cambrai, Thérouanne, Tournai, pendant le pontificat de Martin V, op. cit., dans AHEB, t. XXXI, p. 37, n° 170, p. 314, n° 671, p. 318, n° 710 ; F. baix, La Chambre apostolique, op. cit. (Analecta Vaticano-Belgica. Documents relatifs aux anciens diocèses de Cambrai, Liège, Thérouanne et Tournai, 14), p. 101-102, n° 312, p. 102, n. 1, p. 228, n. 3, p. 319, n° 863 et n. 4 ; C. VleesChouWers et M. VleesChouWers-Van MelKebeeK (éd.), Registres de sentences de l’officialité de Cambrai (1438-1453), t. I, Bruxelles, 1998, p. XII (Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique. Recueil de l’ancienne jurisprudence de la Belgique, 7e série).
44 Oudard Le Riche (Divitis). Originaire de Paris (CaMbrai, BM, Ms. B 1058, f. 2r). Licencié dans les deux droits. Sous-diacre (encore cité comme tel en 1445 : BM, Ms. B 1058, f. 25r). Official de Cambrai de 1430 à 1439, successeur de Jean de Saumer. Chanoine de Saint-Géry de Cambrai. Chanoine du chapitre cathédral de Cambrai (réception au chapitre entre le 24 juin 1438 et le 23 juin 1439 : lille, ADN, 4 G 4644, f. 11r ; 4 G 5073, f. 12r). Sur ce personnage, voir C. VleesChouWers et M. VleesChouWers-Van MelKebeeK (éd.), Registres de sentences, op. cit., t. I, p. IX-X.
45 Grégoire Nicole (Nicolai). Originaire de Cambrai. Prêtre. Licencié in utroque jure, formé à Bologne et à Paris. Chanoine de Laon. Sur ce personnage, qui deviendra chanoine d’Arras, de Notre-Dame d’Anvers, de Saint-Géry et de Sainte-Croix de Cambrai, enfin du chapitre cathédral de Cambrai, et qui exercera la fonction d’official de Cambrai de 1439 à 1466, voir essentiellement C. VleesChouWers et M. VleesChouWers-Van MelKebeeK (éd.), Liber sentenciarum van de officialiteit van Brussel (1448-1459), t. i : 1448-1454, Bruxelles, 1982 (Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique. Recueil de l’ancienne jurisprudence de la Belgique, 7e série), p. 37, 55 et n. 175 ; id. (éd.), Registres de sentences, op. cit., t. I, p. IX-XI.
80
Qui sont les titulaires du nouveau chapitre collégial, à l’exception du prévôt dont le pape s’est réservé la nomination ? Sur les quinze désignés, onze sont originaires du diocèse de Cambrai, deux de Soissons, un de Tournai et un de Langres. C’est précisément ce dernier, Guy Serrurier, qui reçoit le décanat46. Quant à Gérard Le Couturier, il est récompensé de ses services par la chantrerie. Pierre Politre, qui a hébergé Jean de Layens à Cambrai, est aussi du nombre47. Comme arnould de Gavre48, chanoine de Cambrai et de Soignies, Jean Lambert49 et nicolas le Jeune50. Parmi les prêtres encore, Henri de Platea et Jean Anseris, tous deux du diocèse de Cambrai, pierre Tornatoris, du diocèse de Soissons, et, parmi les non-prêtres, Jean Clabaut, Jean Eustache, Jean Terraut, bachelier en lois, Jean Haultain, Jacques Rosiel et Jean de Jeumont, du diocèse de Cambrai.––––––46 Guy Serrurier (Serrarii). Maître ès arts et bachelier en théologie. Secrétaire bourguignon.
Ambassadeur de Philippe le Bon au concile de Bâle en 1433. Sur ce personnage, voir J. toussaint, Les relations diplomatiques, op. cit. (Université de Louvain. Recueil de Travaux d’Histoire et de Philologie, 3e série, 9), p. 136 et n. 5, p. 254, n. 2 ; Prosopographie des secrétaires de la cour de Bourgogne (1384-1477), éd. p. CoCKshaW, 2006, p. 89-90.
47 Sur Pierre Politre, voir note 33.48 Arnould de Gavre. Fils du chevalier Guillaume de Gavre-Hérinnes, dit de Hérimez
(1390 ?-1447), seigneur de Steenkerque, qui fut chambellan de Jean sans Peur et conseiller du duc de Brabant et du comte d’Ostrevant, futur Guillaume IV de Bavière. Arnould était lui-même chevalier et seigneur d’Escornaix. Prêtre. Chanoine du chapitre cathédral de Cambrai (collation apostolique du 23 janvier 1426 ; encore cité en 1436 : CaMbrai, BM, Ms. B 1057, f. 20v). Théologal de ce même chapitre. Chanoine de Sainte-Waudru de Mons et de Saint-Vincent de Soignies, dont il sera le trésorier (cité de 1414 à 1432 dans la comptabilité du chapitre sonégien). Chanoine de Liège. Sur ce personnage, voir J. de theux de MontJardin, Le chapitre de Saint-Lambert à Liège, t. II, Bruxelles, 1871, p. 168 ; A. deMeuldre, Le chapitre de Saint-Vincent, op. cit., p. 131 ; H. dubrulle, Les bénéficiers des diocèses d’Arras, Cambrai, Thérouanne, Tournai, pendant le pontificat de Martin V, op. cit., dans AHEB, t. XXXI, p. 314, n° 672 ; L. deVillers, Chartes du chapitre de Sainte-Waudru de Mons, t. III, Bruxelles, 1908, p. 160, n° 1123 ; F. baix, La Chambre apostolique, op. cit. (Analecta Vaticano-Belgica. Documents relatifs aux anciens diocèses de Cambrai, Liège, Thérouanne et Tournai, 14), p. 103-104, n° 320, p. 104, n. 2 et 4 ; C. bozzolo et H. loyau, La Cour Amoureuse dite de Charles VI, t. i : Étude et édition critique des sources manuscrites. Armoiries et notices biographiques, 1-300, Paris, 1982, p. 173, n° 285 ; B. sChnerb, L’Hôtel et la chapelle de Jean sans Peur comte de Nevers puis duc de Bourgogne (1398-1419), corpus (abrégé : HotJsP) réalisé pour le LAMOP (Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris) : http://www.vjf.cnrs.fr/charlesVI.
49 Jean Lambert. Prêtre du diocèse de Cambrai. Chanoine du chapitre cathédral de Cambrai (cité en 1438-1439 : CaMbrai, BM, Ms. B 1058, passim). Cité comme vicaire général en 1448 (BM, Ms. B 1058, f. 161r).
50 Nicolas Le Jeune (Juvenis). Originaire du diocèse de Tournai. Sous-diacre (cité en 1436 : CaMbrai, BM, Ms. B 1057, f. 25v). Maître ès arts. Chapelain perpétuel ou des hautes formes (hautes stalles) dans la cathédrale de Tournai. Notaire de la curie épiscopale de Tournai. Chanoine du chapitre cathédral de Cambrai (cité en 1435 : BM, Ms. B 1057, f. 14r). Il fut le procureur de Gilles Claren au chapitre cathédral. Voir H. dubrulle, Les bénéficiers des diocèses d’Arras, Cambrai, Thérouanne, Tournai, pendant le pontificat de Martin V, op. cit., dans AHEB, t. XXXI, p. 37, n° 170, p. 314, n° 671 ; F. baix, La Chambre apostolique, op. cit. (Analecta Vaticano-Belgica. Documents relatifs aux anciens diocèses de Cambrai, Liège, Thérouanne et Tournai, 14), p. 92, n° 288 et n. 3, p. 101-102, n° 312, p. 102, n. 1, p. 113, n° 341 et n. 4, p. 131-132, n° 383, p. 132, n. 1.
81
L’affaire était dans le sac si l’émissaire des deux commissaires n’avait traîné à accomplir sa mission. Gérard le Couturier ne remet à la Chambre apostolique l’acte signé à Cambrai, portant désignation des prébendes canoniales, que le 31 octobre 1431, avec plus de trois mois de retard par rapport au délai prescrit51. Le 5 octobre précédent, un revirement complet de situation s’est produit. Le nouveau pape, Eugène IV, a révoqué la bulle de son prédécesseur par motu proprio, cassant la sécularisation de l’abbaye de Saint-Ghislain52. À ses yeux, la cause n’est pas suffisamment raisonnable. La suppression de l’abbaye bénédictine et sa transformation en chapitre séculier sont non seulement une atteinte à l’Ordre bénédictin et aux règles canoniques, mais aussi une source de scandale. Le préjudice est lourd pour les droits de l’Ordre, ses membres et son honneur, ainsi que pour les habitants de la région. Il l’est encore davantage pour les membres des États de Hainaut53 et pour les successeurs des fondateurs de l’abbaye. Enfin, le pape évoque l’intervention d’une noble dame, en l’occurrence Jacqueline de Bavière, comtesse de Hainaut : ses prédécesseurs, les comtes, ont pieusement doté cette abbaye qui se trouve sous son gouvernement temporel. Non, décidément, mettre des clercs séculiers à la tête d’une abbaye de l’Ordre de saint Benoît est une idée bien trop saugrenue…
Le chapitre collégial de Saint-Ghislain a fait long feu. Mais Eugène IV n’en reste pas là. Par une autre bulle, du même jour, il charge l’abbé bénédictin d’Hasnon, au diocèse d’Arras, l’abbé prémontré de Saint-Feuillien du Roeulx, au diocèse de Cambrai, et le doyen du chapitre cathédral de Cambrai de visiter personnellement le monastère de Saint-Ghislain, de s’informer auprès de l’abbé et de rechercher la vérité de manière à réformer l’institution tam in capite quam in membris, dans le respect de la règle de saint Benoît et des statuts légitimes de l’ordre54. Le pape accuse Jean de Layens d’incurie et de négligence. Si la situation spirituelle et matérielle de l’abbaye s’est à ce point détériorée, c’est de sa faute ! Eugène IV va encore plus loin : au terme de leur instruction, s’il s’avère nécessaire, les trois commissaires pourront procéder à la déposition de l’abbé.
Le projet de Jean de Layens a échoué. Le pape ayant cassé la bulle de son prédécesseur, l’acte des commissaires cambrésiens contenant les noms des futurs chanoines de Saint-Ghislain est désormais sans effet. Après avoir déposé
––––––51 u. berlière, Inventaire analytique des Diversa Cameralia, op. cit., p. 64, n° 279, p. 64-65,
n. 1 et Annexes, p. 212, n° XXIII, n. 1.52 VatiCan, ASV, Registra Vaticana (abrégé : Reg. Vat.) 371, f. 117v-119r. Document analysé et
édité par U. berlière, Inventaire analytique des Diversa Cameralia, op. cit., p. 64-65, n. 1 et Annexes, p. 215-217, n° XXIV.
53 Le chapitre cathédral était pourtant dûment représenté aux États de Hainaut. Un exemple parmi d’autres : le 3 février 1430, Jean Mutonis est envoyé à Mons, par le chapitre, pour représenter ce dernier in consilio trium statuum patrie congregatorum (lille, ADN, 4 G 5064, f. 19r).
54 VatiCan, ASV, Reg. Vat., 371, f. 119r-120r. Document édité par U. berlière, Inventaire analytique des Diversa Cameralia, op. cit., Annexes, p. 218, n° XXV.
82
le document à la Chambre apostolique le 31 octobre 1431, Gérard Le Couturier obtient du camérier, François Condulmer, le neveu du pape, l’abrogation de son obligation, échappant ainsi de justesse à une sentence d’excommunication55. en fait, Le Couturier avait été chargé d’une autre supplique par Jean de Layens, dont la santé s’était fortement dégradée depuis l’automne précédent. L’abbé demandait de pouvoir choisir lui-même son successeur, son prieur Pierre de Durmelz56. dom Baudry, l’annaliste du monastère, évoque une réponse positive d’Eugène IV, qui serait arrivée à Saint-Ghislain en janvier 1432, mais qui aurait été mystérieusement annulée peu de temps après. Nouvel échec pour Jean de Layens, qui mourut le 2 avril 1432, sans avoir pu atteindre les deux objectifs qu’il s’était assignés dans les dernières années de sa vie : réformer radicalement son monastère en choisissant la voie de la sécularisation et désigner lui-même son successeur…
Cet épisode suscite l’étonnement et génère maintes questions. Étonnant, en effet, ce projet d’un savant théologien, au terme d’une vie tout entière vouée à l’idéal bénédictin ! Pourquoi choisir la voie de la sécularisation ? Pourquoi ne pas opter plutôt pour la continuité d’une vie régulière mais sous la règle de saint Augustin ? Étonnant, ce long séjour de Jean de Layens à Cambrai. Qu’allait donc y faire notre abbé si ce n’est mûrir son projet et le mettre au point avec le concours bienveillant de l’évêque et de son entourage, qui connaissaient bien la situation du monastère57 ? Ceux-ci envisageaient-ils de faire de la future collégiale un relais de l’autorité épiscopale, davantage que ne pouvait l’être une abbaye bénédictine ? Mais dans ce cas, pourquoi avoir mis plus de deux ans pour désigner les futurs chanoines ?
Étonnant aussi, ce modèle sonégien. Le chapitre de Saint-Vincent de Soignies comptait trente chanoines. Il était le plus important après celui de Saint-Géry de Cambrai. À y regarder de près, on s’aperçoit que les statuts du chapitre de Soignies ont été précisément révisés et réformés en 1423 par Jacques de Metz-Guichard, le doyen du chapitre cathédral, avec l’approbation de Martin V58, que le trésorier de Soignies est Arnould de Gavre, cité comme titulaire du nouveau chapitre de
––––––55 VatiCan, ASV, Cam. Ap., Div. Cam. 16, f. 114v-115r. Document analysé et édité par
u. berlière, Inventaire analytique des Diversa Cameralia, op. cit., p. 64-65, n. 1, p. 65, n° 280 et Annexes, p. 219, n° XXVI.
56 Jean de Layens ne s’est plus rendu à Cambrai aux assemblées du clergé ni à celles des États de Hainaut à Mons, mais il s’y est fait représenter par son prieur, Pierre de Croix de Durmelz (Annales, op. cit., p. 551). Sur Pierre de Croix de Durmelz, qui décéda le 14 janvier 1457 après avoir rédigé pour son abbaye de nouveaux statuts, sur le modèle clunisien, voir Annales, op. cit., p. 551-552, 554 et u. berlière, MB, t. i : Province de Namur : Supplément, Province de Hainaut, op. cit., p. 261-262.
57 Jean de Gavre résidait de temps à autre à l’abbaye de Saint-Ghislain, quand il n’était pas à Liedekerke, au château familial. C’est d’ailleurs lui qui présida à l’élection du successeur de Jean de Layens durant la Semaine sainte d’avril 1432 (Annales, op. cit., p. 541, 557).
58 Bulle de Martin V du 12 février 1423, mise à exécution le 15 juillet suivant par Jacques de Metz-Guichard [note 38] : A. deMeuldre, Le chapitre de Saint-Vincent, op. cit., p. 16 et Les Preuves, I, p. 389-393.
83
Saint-Ghislain, qu’un autre membre du chapitre sonégien est Gilles Claren, le scelleur de la curie épiscopale…
Étonnant, le comportement de ce chanoine de Sainte-Croix de Cambrai, Gérard le Couturier. pourquoi avoir rendu si tard la lettre des commissaires cambrésiens ? Et justement après l’annulation par le pape de la bulle de son prédécesseur ? Quand il savait qu’il n’encourrait plus aucune sanction…
Étonnante, cette annulation par Eugène IV d’une décision de son prédécesseur. Et cette intervention de Jacqueline de Bavière, comme le suggère le texte de la bulle de 1431 ? La comtesse a-t-elle voulu contrecarrer le projet concocté dans un milieu qui s’était montré favorable au duc de Brabant, Jean IV, son ex-mari ? En effet, en 1425, l’évêque de Cambrai avait présidé la délégation envoyée à Rome, auprès de Martin V, par Jean IV pour plaider la validité de son mariage avec Jacqueline. Le prévôt du chapitre de Soignies, Jean de Segry, conseiller et trésorier du comté de Hainaut, était lui aussi du voyage59. L’abbé de Saint-Ghislain entretenait avec la comtesse, il est vrai, des relations parfois tendues60… alors, une vengeance de Jacqueline et peut-être aussi, dans l’ombre de celle-ci, de sa mère, la comtesse douairière61 ?
Étonnant, ce silence apparent de Philippe le Bon62. du moins jusqu’à la vacance du siège abbatial en avril 1432. Le duc de Bourgogne prétend alors avoir sa part ––––––59 Jean de Segry. Chanoine du chapitre de Saint-Hermès de Renaix (cité le 27 janvier 1413 :
VatiCan, ASV, Reg. Lat. 160, f. 72r-73v). Chanoine de Thérouanne (collation apostolique du 6 septembre 1420). Chanoine et prévôt du chapitre de Soignies de 1425 à 1450 au moins. Doyen (de longue date) du chapitre collégial de Notre-Dame-de-la-Salle à Valenciennes et chanoine d’Antoing (cité en 1446 : lille, ADN, 4 G 1086, n° 336, 364, 366-368). Sur ce personnage, voir A. deMeuldre, Le chapitre de Saint-Vincent, op. cit., p. 337-338 ; e. Matthieu, Biographie du Hainaut, t. II, Enghien, 1903, p. 325-326 ; P. berGMans, art. Segri (Jean de), dans Biographie Nationale, t. XXII, Bruxelles, 1914-1920, col. 184-185 ; F. baix, La Chambre apostolique, op. cit. (Analecta Vaticano-Belgica. Documents relatifs aux anciens diocèses de Cambrai, Liège, Thérouanne et Tournai, 14), p. 15, n° 48 ; A. uyttebrouCK, Le gouvernement, op. cit., t. II (Université libre de Bruxelles. Faculté de Philosophie et Lettres, 59), p. 735, n° 234.
60 Sur les tensions entre Jean de Layens et Jacqueline de Bavière, voir Annales, op. cit., p. 545-546, 549-550.
61 C’est l’hypothèse émise lors des discussions d’Avignon par Jean-Marie Cauchies. Mais les indices font encore défaut pour l’étayer.
62 Aucune trace, jusqu’à présent, d’une quelconque intervention du duc de Bourgogne dans cette affaire de sécularisation, ni dans ses ordonnances, ni dans sa correspondance, notamment avec la Curie romaine. On sait seulement que, sous l’abbatiat de Jean de Layens, les fréquents passages des gens de guerre de Philippe étaient pour l’abbaye une cause de grands soucis financiers. Le duc vint à Saint-Ghislain le 21 novembre 1431. Il défraya généreusement l’abbaye pour les grandes dépenses qu’elle consentit pour l’occasion (Annales, op. cit., p. 552). On ne connaît, pour l’année 1431, qu’une seule intervention ducale dans les affaires de l’abbaye : vers le 15 octobre, Philippe adressa des lettres au bailli et aux hommes de la Cour de Hainaut pour leur demander de lui renvoyer, ainsi qu’à son conseil, le procès intenté aux moines par Lambert de Binch au sujet des gages de l’office du bailliage de Saint-Ghislain (L. deVillers, Cartulaire, op. cit., t. V, Bruxelles, 1892, p. 474, n° 1982).
84
dans la nomination du nouvel abbé. Il envoie son secrétaire au monastère pour « s’informer de l’élection et d’autres affaires secrètes ». les moines, inquiets, en réfèrent à l’évêque Jean de Gavre qui les rassure en disant que le duc est « content de la communauté ». Philippe le Bon écrit alors à la Curie au sujet du futur abbé63. Il confie sa lettre à l’évêque et celui-ci charge Gérard Le Couturier, décidément habitué des voyages à Rome, de l’apporter à la chancellerie pontificale64…
Étonnante enfin, l’occultation de cette affaire dans l’historiographie ghislénienne et hainuyère. Comme le laisse entendre Baudry, les comptes du monastère en disent trop ou pas assez… L’affaire est-elle à ce point honteuse pour la mémoire du grand abbé, qu’il faille la cacher à tout prix à la postérité ?
Il faut croire que les temps n’étaient pas encore mûrs pour des initiatives audacieuses… C’est seulement sous l’abbatiat de Quentin Benoît, entre 1491 et 1528, que Saint-Ghislain devint un important foyer de réforme qui inspirera d’autres abbayes65 : lobbes66, Hautmont, Saint-Amand, Saint-André du Cateau, Saint-Denis-en-Broqueroie67.
Il est temps de conclure. L’intervention du cardinal de Bar visant à transformer le couvent hiéronymite de Cherrey atteste du rayonnement du prieuré de Groenendael, nourri de Devotio moderna, jusqu’aux forêts champenoises. Quant à la tentative, avortée, de l’abbé Jean de Layens de remplacer la communauté bénédictine de Saint-Ghislain par un chapitre de chanoines, elle est un indice du succès, toujours important en ce XVe siècle, du modèle de collégiale séculière. d’ailleurs, au moment où Jean de Layens conçoit son projet, une autre initiative fleurit dans
––––––63 Philippe le Bon était en séjour à Cambrai le 22 janvier 1432 (lille, ADN, 4 G 4637, f. 16r).
Pour qu’y faire ? Les comptes capitulaires de Cambrai ne le précisent pas.64 Annales, op. cit., p. 559.65 u. berlière, MB, t. i : Province de Namur : Supplément, Province de Hainaut, op. cit., p. 262-
263.66 En 1499, les chanoines de Binche protestent auprès de Philippe le Beau, archiduc d’Autriche :
l’abbé de Lobbes, leur prévôt, avait en effet le dessein de transformer le chapitre séculier de Binche en un chapitre régulier, au grand dam des Binchois ! Voir, à ce sujet, M. Maillard-luypaert, Le chapitre collégial de Saint-Ursmer déménagé de Lobbes, en principauté épiscopale de Liège, à Binche, « bonne ville » du comté de Hainaut (1409), dans Les collégiales et la ville dans la province ecclésiastique de Reims (IXe-XVIe siècles). Actes du colloque de Beauvais, 4-6 juillet 2009, Laboratoire d’Archéologie et d’Histoire de l’Université de Picardie-Jules Verne et du Centre d’Archéologie et d’Histoire Médiévales des Établissements Religieux (Collection Histoire Médiévale et Archéologie), sous presse.
67 Ce fut le thème étudié par A. dupont, Saint-Denis-en-Broqueroie : les préoccupations d’une communauté bénédictine en Hainaut (1374-1571), université catholique de louvain, 1997 (mémoire de licence inédit).
85
l’extrême nord du comté de Hainaut, celle consistant à ériger en collégiale l’église paroissiale de Hal, haut lieu du culte marial68. le mode de vie canonial restera attractif jusqu’à la réforme tridentine.
Entre ces deux affaires – Cherrey et Saint-Ghislain –, on ne peut s’empêcher de voir un fil conducteur, certes ténu, qui a pour nom Pierre d’Ailly. C’est lui, Pierre d’Ailly, évêque de Cambrai, qui a œuvré à la constitution d’un chapitre brabançon dont Groenendael a pris la tête en 1402, trouvant plus tard un allié dans la personne du cardinal de Bar. C’est en compagnie de ce même Pierre d’Ailly que Louis de Bar participe aux travaux du concile de Pise. C’est avec Pierre d’Ailly que l’abbé Jean de Layens noue des liens étroits d’amitié dès les préparatifs de ce concile. C’est dans la maison d’un cousin du défunt pierre d’ailly, pierre politre, que l’abbé de Saint-Ghislain séjourne à Cambrai pour préparer son projet de sécularisation. Et c’est un autre parent de Pierre d’Ailly, son neveu Raoul Le Prêtre, archidiacre de Hainaut, qui mène l’enquête et conclut à une suite favorable. Alors, hasard ou non ? Sur ces deux affaires plane l’ombre du grand prélat, quoi qu’on en pense… Pour y voir plus clair, il y aurait lieu d’approfondir l’étude, non seulement de l’épiscopat de Pierre d’Ailly, mais aussi des membres les plus jeunes de son entourage, ceux-là même qui sont demeurés au service de ses successeurs, Jean de Gavre et Jean de Bourgogne69, sur le siège épiscopal de Cambrai.
––––––68 C’est Anselme Smeets (Fabri), de Breda, qui prit cette initiative en 1428-1429. Ce licencié
en droit canon de Bologne fit partie, en 1425, de la même ambassade envoyée à Martin V par Jean IV, duc de Brabant. Sur ce personnage, qui mourut de la peste à Florence en 1449, et sur son initiative, voir essentiellement l. eVeraert, Du projet d’érection d’un chapitre collégial en l’église de Hal, dans Annales du Cercle archéologique d’Enghien, t. II, 1883, p. 118-119 ; a. uyttebrouCK, Le gouvernement, op. cit., t. II (Université libre de Bruxelles. Faculté de Philosophie et Lettres, 59), p. 736, n° 236 et surtout B. sChWarz, Anselmus Fabri (Smit) aus Breda in Brabant (1379-1449), Abbreviator, Referendar, Protonotar und – beinahe – Kardinal. Skizze einer Biografie, dans Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, t. LXXXVIII, 2008, p. 161-219, surtout p. 189-190.
69 À ce sujet, voir M. Maillard-luypaert, Jean de Bourgogne, bâtard de Jean sans Peur, évê-que de Cambrai de 1439 à 1480, dans La bâtardise et l’exercice du pouvoir (XIIIe-début XVIe siècle), Études réunies par É. bousMar, a. MarChandisse et B. sChnerb, Lille, sous presse.