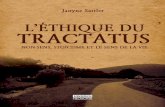Du sens du progrès de l'Histoire.
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Du sens du progrès de l'Histoire.
Du sens du progrès de l’histoire, de l’esclave ou du serf à la condition salariale….
Sous l’Antiquité, on devenait esclave soit parce que sa citée ou sa tribu avait été vaincue par une autre puissance. Mais contrairement aux légendes favorisées par les Péplums, les esclaves n’étaient pas tous destinés à casser des cailloux dans des carrières ou des mines. Les castes guerrières épargnaient ceux qui avaient des « talents » particuliers : Architectes, Tailleurs de Pierre, Maçon, Charpentiers, Orfèvres, Fondeurs, forgerons etc … mais aussi les lettrés. Il arriva même que prêtant allégeance au vainqueurs, les anciens ennemis auxquels on reconnaissait bravoure au combat, soient intégrés aux armées. Si certains chefs de guerre, connurent des destins tragiques une fois repris, c’est qu’ils étaient considérés comme parjure à leur serment. Ce fut le cas deVercingétorix qui servit et trahit d’ailleurs les Romains. Un autre cas pouvait se produire être conduit à la condition d’esclaves car on ne pouvait honorer une dette, voire être claniquement et solidairement condamné pour un crime.Le propriétaire d’esclave, s’éloignant de plusen plus des tâches quotidiennes et mortifères,eurent tendance à confier de plus en plus de responsabilité d’encadrement et de gestion auxesclaves. Ainsi de nombreux esclaves devinrentprécepteurs, chefs de chantiers, et gestionnaires de domaines. Sans parler de ceuxqui épousèrent des esclaves, les affranchissants. D’ailleurs rendre sa liberté 1
à un esclave, ce qui lui permettait de fonder une famille et devenir propriétaire, fut simplifié. Il suffisait pour affranchir, de le faire devant deux citoyens de la citée. L’esclave, contrairement au « métèque » indigène, représentait un investissement et uncapital, aussi il était logé, soigné et entretenu. Le fait de traiter « humainement » et correctement les esclaves devint même honorifique, il n’est pas rare de trouver sur des épitaphes gravés des témoignages en ce sens. L’esclavage dans l’antiquité ne repose pas sur des considérations racistes, ainsi des esclaves Numides, au même titre que des esclaves Scythes ou Germains devinrent des citoyens à part entière de par leurs qualités et leur dévotion à la citée. Il reste évident qu’à l’apogée de l’empire romain, la plupart des dits Romains n’avaient aucun lien de sang avec Rome. Un peu comme au Maghreb, où les descendants des Invasions Arabes sont minoritaires et relèvent du fantasme.
La Chrétienté et l’esclavage.« Les textes bibliques fournissent des arguments contradictoires sur la question de l’esclavage. » Ses études l’amènent à dire qued’après « les lectures qui sont opérées, parfois à la même époque, les auteurs chrétiens soutiennent le caractère légitime de l’esclavage, à condition de le réguler et de le moraliser, ou au contraire affirment son incompatibilité avec le message évangélique.
2
Les premiers se réfèrent aux passages de l’Ancien Testament qui mentionnent la présenced’esclaves et aux épîtres de Paul et de Pierrequi engagent l’esclave à l’obéissance. Les seconds insistent sur la nouveauté évangélique revendiquée par Jésus en matière de morale, notamment à travers le commandementde l’amour du prochain identifié à l’amour de Dieu. Mais le débat semble sans fin car Jésus n’aborde pas la question de l’esclavage commeinstitution. Quant aux recommandations données par Paul, elles proclament la fin des distinctions sociales au sein de la communauté des chrétiens : « Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme ; car tous vous êtes unen Jésus-Christ. » (Gal. 3/28). Mais elles n’interdisent pas de posséder des esclaves, exigent seulement de les traiter de manière humaine et invitent chacun à demeurer dans l’état où l’a trouvé l’appel de Dieu (1 Cor. 7/20).
La position de l’apôtre Paul est essentielle pour comprendre la manière dont le christianisme des origines envisage les conséquences de l’adhésion au christianisme. Son propos n’est pas de discuter la légitimité de l’esclavage mais de montrer comment la conversion à la nouvelle religion implique de vivre autrement, quel que soit sonétat. Si le christianisme commande de changer de vie, la transformation sociale ne semble pas un volet nécessaire de la conversion. L’abolition de toute distinction vise l’affirmation de l’égalité entre les hommes dupoint de vue de leur dignité et de leur aptitude au salut. »
3
Quelques auteurs ont tenté d’aller plus loin en faisant valoir que la possession d’esclavesn’est pas compatible avec l’exigence d’équité que comporte la foi. Le plus radical est Grégoire de Nysse. Il voit dans l’esclavage lamanifestation de l’orgueil humain qui prétend imposer une loi contraire à la loi de Dieu carDieu a fait l’homme « par nature libre et maître de lui-même » (IVeme Homélie sur l’Ecclésiaste). Néanmoins, aucun auteur ne réclame l’abolition et la doctrine majoritairemaintient un point de vue différent. »
« Bien qu’il rejette l’inégalité naturelle des hommes (Aristote), le christianisme antique légitime en définitive l’esclavage comme conséquence du péché. Durant le Haut Moyen-Age les conciles provinciaux incitent à l’affranchissement et plusieurs papes recommandent de libérer les captifs après leurachat « par amour du Christ ». « Mais cette démarche pastorale ne remet pas en cause la légalité de l’esclavage qui reste un châtimentprévu dans certains cas. »
« La théologie scolastique, n’a pas réussi à faire émerger une argumentation abolitionniste. Tributaire d’Aristote et de saint Augustin, saint Thomas d’Aquin recourt àune distinction subtile entre l’ordre de la nature en « première intention », qui interditl’esclavage, et en « seconde intention », après le péché originel, qui fait de l’esclavage la conséquence du péché. L’esclavage constitue un mal inévitable dansun monde terrestre imparfait. Dès lors la question n’est plus de savoir si l’esclavage est légitime mais de déterminer à quelles conditions il est légitime. »
4
Ces interrogations vont trouver une solution économique et pratique avec l’irruption de l’Islam.
Position de principe du Coran sur la question de l'esclavage
Le Coran accorde aux esclaves un statut différent de celui accordé aux esclaves chez les Grecs et les Romains avant lui. Néanmoins,des compagnons de Mahomet ont rapporté ces paroles : « Je serai l’adversaire de trois catégories de personnes le Jour du Jugement. Et parmi ces trois catégories, il cita celui qui asservit un homme libre, puis le vend et récolte cet argent. »
Seul livre religieux établissant un plan d'État et privé d'affranchissement systématique et progressif des esclaves, tel que l'allocation d'une part du budget de l'État pour l'émancipation, le Coran n'interdit pourtant pas formellement l'esclavageIl légalise en fait la pratique, en vigueur à l'époque en Arabie comme ailleurs.Le livre fondateur de l'islam évoque l'esclavage dans pas moins de 25 versets sans le condamner formellement et que l'abolition relève de la seule initiative personnelle du maître. Plusieurs versets entérinent au demeurant l'infériorité de l'esclave par rapport à son maître ».
« Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux » (Coran, sourate 24, verset 33)5
« Ô vous qui croyez ! La loi du Talion vous est prescrite en cas de meurtre : l’homme libre pour l’homme libre, l’esclave pour l’esclave, la femme pour la femme (…) » (Coran, sourate 2:178)
« À l’exception des hommes chastes, qui n’ont de rapports qu’avec leurs épouses et avec leurs esclaves [ou captives de guerre], ils nesont donc pas blâmables, tandis que ceux qui en convoitent d’autres sont transgresseurs » (Coran, sourate 70:29-31)
« Dieu favorise de ses dons certains plus que d'autres. Mais les favorisés ne donnent pas deNos dons à leurs esclaves pour égaliser les parts. Est-ce qu'ils ne nient pas là les bienfaits de Dieu ? » (Coran, sourate 16:71)
Du respect de l'interdiction d'asservir un musulman découle la nécessité de s'approvisionner en esclaves aux marges du monde sous domination musulmane : chacun de ses pôles, (Bagdad, Al-Andalus, Maghreb), va mettre en place ses filières d'approvisionnement.Le califat de Bagdad et l'Égypte ont les besoins les plus élevés en esclaves, et la richesse nécessaire pour en acquérir massivement.
Les guerres quasi continuelles contre l'Empire byzantin, puis contre les États d'Europe de l'Est et d'Europe centrale procurent pendant des siècles des captifs réduits en esclavage (les nobles ou commandants étaient détenus et libérables contre rançon, mais les simples soldats ou civils étaient vendus).
D'autres circuits d'importation se développent, moins aléatoires que les
6
expéditions militaires, donc plus lucratifs pour les intermédiaires. Des circuits de traite se créent avec leurs divers « gisements » :
Les slaves païens (« Esclavons ») apparaissent en Europe vers le VIIe siècle :combattus par les Francs, ils alimentent les marchés d'esclaves. Les commerçants vénitiens assurent leur acheminement vers l'Espagne musulmane et leMoyen-Orient. Cette source se tarit vers le IXe siècle, avec la christianisation et l'apparition d'États slaves organisés et capables de se défendre. L'« Esclavonie » (nom qui a donné la Slavonie actuelle) était nommée en arabe le « pays des
esclaves » (bilād aṣ-ṣaqāliba ال�ب� لاد ال�صق� Les .ب��Slaves sont acheminés depuis l'Europe centrale ou orientale vers Venise ou Marseille d'où ils sont ensuite transportésvers les pays musulmans. Un certain nombre d’esclaves sont ainsi vendu à Marseille et servent dans des maisons Provençales au grand dam des autorités ecclésiastiques. Ainsi des eunuques sont signalés à Verdun, destinés à être exportés vers les ports de l'Adriatique. L'approvisionnement en esclaves européens chrétiens débute avec la conquêtemusulmane de la péninsule Ibérique et les raids dans l'actuelle France, prend un grand essor lors de la conquête de l'Anatolie, puis de la Grèce et des Balkans par le sultanat ottoman, au sein duquel les chrétiens, en tant que « nation » soumise , devaient subir le kharadj (double-capitation), pouvant
7
tomber en esclavage pour dettes, et
la pédomazoma(παιδομάζωμα ou ي�رمه récolte" : دوش�des enfants", lesquels devenaient soit janissaires s'ils étaient aptes, soit esclaves) ; pour les chrétiens le seul moyen d'échapper à ces contraintes était laconversion à l'islam... que beaucoup choisirent, devenant ainsi Turcs, parfois par villages ou villes entières. Lors des croisades également, les armées musulmanes, défendant leurs terres au Proche-Orient contre les croisés, faisaientdes captifs, souvent réduits en esclavage, s'ils ne sont pas assez riches pour être rançonnés.
Une autre source, moins abondante mais plus constante d'esclaves européens, est l'attaque des navires chrétiens en Méditerranée et les razzias dans les pays européens par les corsaires barbaresques et les Turcs, qui durent jusqu'au début du XIXe siècle. Ces esclaves sont principalement espagnols, catalans, occitans, provençaux, italiens, croates,serbes, albanais ou grecs (des îles entières sont parfois vidées de leurs habitants ; dans les plus grandes, comme la Corse ou la Crète, les côtesse dépeuplent au profit de la montagne où les insulaires se réfugient).
Des esclaves blancs, ou mamelouks (arabe : mamlūk20, « possédé »), formés de Circassiens du Caucase ou d'autochtones d'Asie centrale, sont vendus par les peuples turcs sur les grands marchés que sont Samarcande,Boukhara, Herat, Meched et les ports ottomans ou tatars de la mer Noire. L'Asie centrale est alors nommée par
8
les Arabes le « pays des Turcs » (arabe : bilād al-atrāk21). Le calife de Bagdad possède 11 000 esclaves dans son palais au IXe siècle22.
Les esclaves noirs (en arabe Zendj23) du Soudan du Sud ou collectés sur les côtes d'Afrique noire, organisant une première traite des noirs. Le Soudan est alors nommé en arabe le « pays des noirs » (bilād as-sūdūn24). Dont la justification va se chercher dans la Malédiction de Cham. « « Noé partagea la terre entre ses fils, et assigna à chacunsa propriété. Il maudit Cham à cause de l'injure qu'il reçu de ce fils, ainsi qu'on le sait, et s'écria : « Maudit soitCham ! puisse-t-il être l'esclave de ses frères ! » (...) Cham s'éloigna, suivi deses enfants, et ils se fixèrent dans différentes portions de la terre ou dans des îles, ainsi que nous le dirons plus loin. Lorsque la postérité de Noé se répandit sur la terre, les fils de Kouch,fils de Canaan, se dirigèrent vers l'occident et traversèrent le Nil. Là, ils se partagèrent : les uns, c'est-à-dire les Nubiens, les Bedjah et les Zendjes, tournèrent à droite, entre l'orient et l'occident; les autres, en très-grand nombre, marchèrent vers le couchant, dans la direction de Zagawah, de Kanem, de Markah, de Rawkaw, de Ganah et d'autres parties du pays des Noirs et des Demdemeh. Ceux qui s'étaient dirigés sur la droite, entre l'est et l'ouest, sedisséminèrent à leur tour, et formèrent plusieurs nations : les Mékir, les Mechkir, les Berbera et d'autres tribus
9
des Zendjes. » Un siècle avant, le hanbalite Ibn Qoutayba attribue au traditionniste Wahb Ibn Munabbih (mort v.730) la tradition suivante : « Wahb IbnMunabbih a dit : Cham, le fils de Noé, était un homme blanc, beau de visage et de stature et Dieu Tout-Puissant changea sa couleur et la couleur de ses descendants en réponse à la malédiction de son père. Il partit, suivi de ses fils, et ils s'installèrent près du rivage où Dieu les multiplia. Ce sont lesNoirs [sûdan]. »
Des esclaves sous le califat accèdent parfois à des postes socialement "importants" : en plus des travaux domestiques, artisanaux ou agricoles (dans les plantations de canne à sucre par exemple25), les esclaves pouvaient devenir favoris, conseillers, chambellans, mais surtout des soldats d'élite. Les historiens estiment qu'au moins 500.000 enfants chrétiens dans les Balkans, 1 sur 5 dans les villages chrétiens, le devchirmé à devenir des janissairesL'autre différence est l'esclavage à destination des harems avec émasculation de l'homme non musulman: la femme esclave est souvent asservie sexuellement par son maître, les femmes vendues aux harems sont aussi des esclaves de plaisir (danse, chants, sexe). Desjeunes garçons étaient aussi placés dans les harems et pouvaient également servir au "plaisir". Selon la charia, en dehors du mariage, les seules relations sexuelles permises doivent être entre le maître et son esclave femme ou jeune fille pubère.
Les mamelouks pour les arabes et les janissaires pour les ottomans sont les
10
soldats les plus appréciés : mis en esclavage jeunes, environ 6 ans, ils sont formés et encasernés, autant pour créer un esprit de corps militaire que pour les isoler de la population. Leur nom qui veut simplement dire « esclave blanc » pour le mamelouk. Les mamelouks arrivent même au pouvoir suprême en Égypte pendant certainespériodes.
La garde personnelle du calife al-Mutasim (833-842) compte de nombreux esclaves soldats (entre 4 000 et 70 000 selon les sources).
Le calife Jafar al-Mutawakkil (846-861) metdes esclaves turcs à tous les postes de songouvernement, mais finit assassiné par sa garde mamelouk. Trois de ses quatre successeurs subissent la même fin.
Ahmad Ibn Touloun , turc envoyé au Caire en 868, se constitue une armée de Grecs, de Soudanais et de Turcs, et se rendindépendant en Égypte (dynastie des Toulounides).
À l'autre extrémité du monde sous domination musulmane, les Esclavons armés prennent une part active aux luttes qui divisent l'Espagne en taïfas, et se créent même un royaume à Valence.
Enfin, le califat de Bagdad connaît entre 869 et 883 sa grande révolte d'esclaves noirs, la révolte des Zanj dans les plantations du sud de l'Irak27. À la différencede la révolte de Spartacus contre Rome, cette révolte d'esclaves a un fondement idéologique,car elle est animée par un mouvement qui prôneviolemment un islam égalitaire, le kharidjisme. Les soldats noirs envoyés contre eux désertent et rallient la révolte ;
11
les mamelouks régnants mettent des années pouren venir à bout.Ainsi le monde musulman va devenir le pourvoyeur de l’esclavage, ce qui n’offusquerapas le monde chrétien méditerranéen.
Un épisode fort peu connu, la traite des esclaves en Provence.
L'esclavage en Provence et dans leComté de Nice au Moyen-ÂgeGrace aux travaux de Paul Louis Malaussena, onen sait un peu plus ; L'esclavage a subsisté pendant tout le Moyen Âge dans les zones périphériques et maritimes de l'Europe et particulièrement dans les régions méditerranéennes.Les marchés provençaux d'esclaves sont très modestes à côté de ceux de Gênes ou de Barcelone; il y avait à Gênes en 1400, 2.000 esclaves, un peu moins à Barcelone. Les archives notariales provençales possèdent un nombre d'actes suffisamment important pour quel'on puisse étudier l'esclavage dans notre région pendant la période médiévale au 14ème et au 15 ème siècle et entre autres les problèmes sociaux qu'il suscitait.Gênes avait des comptoirs. Ils sont désignés par le qualificatif "Tartare" (progenie tartarorum). Au 15ème siècle, les Russes et les Circassiens (de genere rubeorum) remplacent les Tartares. Cette évolution se constate aussi bien à Aix qu'à Avignon et Marseille, elle reflète les fluctuations du marché génois.Parmi ces esclaves en provenance de l'Europe centrale, qui représentent 80% de la population servile, on peut dire que 90% sont des femmes jeunes. Les 20% restant se
12
composent surtout de captifs de race noire (nationis barbarie) où prédomine le sexe masculin. Ce sont des barbaresques provenant d'Afrique du Nord; ils ont souvent été capturés en mer où chrétiens et musulmans se livrent à la guerre de course.Les esclaves d'autres provenances sont assez rares :- en 1445, un esclave bulgare de 16 ans est vendu à Aix pour 95 florins.- en 1490, une esclave de Cyrénaïque, Lucie, est vendue à Aix 40 écus d'or (environ 100 florins).- en 1505, une esclave originaire des Canaries, Espérance, âgée de 15 ans, est vendue à Avignon 40 écus d'or. Ceci paraît contraire à la bulle pontificale d'Eugène IV qui, en 1442, avait interdit de réduire en esclavage les indigènes de l'archipel.D'une façon analogue, les prescriptions des papes Urbain V et Clément VII, à la fin du 14ème siècle, ordonnant de libérer les esclaves orthodoxes, étaient restées lettres mortes.Les actes d'achat reproduisent les clauses de style que l'on rencontre dans tout contrat de vente; on précise si l'affaire a été conclue en présence ou non de l'esclave puis suivent les caractéristiques de la santé du captif, les signes particuliers.- en 1376, Magdeleine, tartare, est vendue 35 florins d'or; si une infirmité apparaît dans les dix jours suivant la vente, il y aura restitution de l'esclave et des florins.- en 1441, Aularia, tartare de 28 ans, est vendue 90 florins. Il est précisé qu'elle est en bonne santé, non épileptique, sans chancre
13
ni fistule, propre, continente au lit (non migentem in lecto). Dans ces textes les esclaves font l'objet d'actes d'achat et d'affranchissement, ils figurent dans les clauses testamentaires et les assignations de dot.Les filles apportaient en dot une esclave. C'est le cas, par exemple, de Heriane de Linguilla, en 1418. Sa mère, veuve d'un marchand génois habitant Aix, donne à son futur gendre, Guillaume de Blanchis, fils de Henri, 500 florins d'or et une esclave, Madeleine, à titre gracieux.Délicate attention pour une belle-mère.On trouve des esclaves à Aix, Avignon, Marseille, mais ce sont Nice et Toulon qui sont en liaison avec le principal foyer de la traite, Gênes.Les notaires indiquent presque toujours l'origine géographique des esclaves. Au 14ème siècle, la majorité des captifs est originairedes pourtours de la mer Noire, où - en 1445, Abdalla d'Alger, âgé de 18 ans, est vendu 60 florins; il est précisé qu'il -porte une blessure à l'épaule gauche. Si elle ne guérit pas, les 60 florins seraient rendus.- en 1446, Catherine, tartare de 24 ans, est vendue 75 florins. Dans un délai d'un an, si elle ne plaît pas, elle sera rendue et remboursée.S'il s'agit d'une captive, il est précisé, le cas échéant, si elle est enceinte ou si elle est vendue avec son enfant :- en 1448, Lucie, d'origine bulgare, âgée de 26 ans, est vendue 105 florins. Elle est enceinte et il est stipulé que la vente ne touche pas sa progéniture, qui appartiendra toujours au vendeur Ce dernier toutefois
14
supportera les risques si l'esclave décède en couches.De 1350 à 1450 eurent plusieurs dévaluations et il est difficile d'établir, avec précision,le prix des esclaves. Ce prix dépend d'ailleurs de la condition physique, de l'âge et des fluctuations du marché.Pour les femmes de race blanche, le prix, qui approchait 50 florins dans la seconde moitié du 14ème siècle, monte jusqu'à 200 florins au milieu du 15ème.Le prix des esclaves noires ou maures, des deux sexes, est nettement inférieur. Mais dansce cas, les hommes valent plus cher que les femmes. Le paiement se faisait en espèces ou en nature :- en 1444, Ali est vendu à Aix pour 20 quintaux de viande de porc salé.- en 1489, à Aix encore, Lucie, 28 ans, originaire de Barbarie est vendue 100 florins payables 25 comptant et le reste par un chevalà poil gris.Le prix d'un esclave représente une somme importante que ne peuvent consentir que les gens aisés.Au début du 15ème siècle, la dot d'une fille de petit commerçant ou de fermier aisé était de l'ordre de 1150 florins (en général payableen plusieurs annuités); c'est en gros le prix d'une jeune esclave, russe payée comptant.Il est bien certain qu'aujourd'hui, seuls les Emirs arabes peuvent se payer de jeunes esclaves européennes. Ils ne font d'ailleurs que poursuivre une voie déjà tracée. Car si, au Moyen Âge, les belles Tartares étaient esclaves dans les familles provençales, les
15
belles Provençales figuraient en bonne place dans les harems de Barbarie.Mais revenons au fait. Que représentaient 150 florins ? Il est bien difficile de convertir en francs 2002, d'autant plus que les biens deconsommation étaient rares à l'époque et que la valeur du florin varie du simple au quadruple suivant les auteurs.Si l'on considère qu'en 1400 un cheval hongre est vendu 14 florins et un mulet de deux ans et demi, 20 florins, cela donne approximativement 80 euros comme pouvoir d'achat du florin. On peut donc avancer, sous toute réserve, que le prix moyen d'une esclavese situait autour de 9000 euros; la très belleesclave russe pouvant valoir le double.C'est le prix d'une belle voiture mais l'objetdurait plus longtemps et pouvait même rapporter.L'attitude de l'Église, en principe opposée à l'esclavage, est plus que tolérante. Des membres du clergé détiennent des esclaves. - à Nice, en 1426, un esclave baptisé est qualifié "esclave des frères Prêcheurs".- en 1503, l'éthiopienne Pisana est achetée 30écus d'or par le révérend Père Roderico Reys, protonotaire du Saint Siège.Il est certain que l'esclavage ne choque pas les gens d'église. - en 1453, une esclave russe baptisée est vendue dans le palais épiscopal de Vence, dansla pièce d'honneur, au profit du frère de l'évêque, les principaux dignitaires du clergévençois en sont les témoins.La partie la plus importante de la population servile était composée de femmes originaires d'Orient, remplissant des fonctions domestiques.
16
C'est là le principal caractère de l'esclavageméridional, à Gênes comme en Provence :- en 1395, un médecin avignonnais réclame "unepetite esclave âgée de 12 à 14 ans, qui soit sérieuse, ni trop belle ni trop laide".Parmi les tâches domestiques remplies par les captives figurait souvent celle de nourrice. Un acte notarié conclu dans le château d'Antibes, porte témoignage de la donation de tous ses biens consentie par une esclave affranchie, du nom de Marie, à Lambert, fils du seigneur Nicolas Grimaldi. Les raisons de cette donation sont "l'affection qu'elle porteà Lambert qu'elle a allaité et élevé", et sa reconnaissance envers Nicolas Grimaldi "pour les soins qu'il n'a cessé de lui prodiguer".Ces esclaves vivaient dans l'entourage immédiat et constant des maîtres et il n'est pas étonnant de voir des affranchissements, auxquels l'intimité qui unissait maître et esclave n'était pas étrangère, venir récompenser des "bons et loyaux services".Les affranchissements étaient réalisés soit par clause testamentaire, soit par acte entre vifs.- en 1449, le marchand aixois Bertrand Reboul affranchit "Post mortem" son esclave nommée Marthe et lui lègue 5 florins et sa garde-robe.- en 1475, Jean Martin, conseiller du Roi René, lègue 25 florins à son esclave Antoine qu'il vient d'affranchir.Les affranchissements consentis par acte entrevifs impliquent l'intervention du notaire qui officie dans sa boutique ou dans la maison du maître, voire dans la rue.L'esclave, à genoux et mains jointes, .sollicite du maître sa libération.
17
Ce dernier le relève en le prenant par les mains et le déclare libre de toute servitude.Ces actes d'affranchissement présentent très souvent un préambule moralisateur ou religieuxassez hypocrite. Les uns font référence à la liberté naturelle des hommes, les autres déclarent que les chrétiens doivent libérer leurs esclaves, "à l'image du Christ qui a affranchi les hommes par son sang".L'affranchissement des esclaves servantes a certes un aspect juridique, mais il laisse aussi entrevoir l'ambiguïté des relations qui s'établissaient parfois entre maître et esclave.Il ne fait pas que traduire des pensées pieuses ou charitables, il révèle le souci de récompenser des mérites dont on ne sait s'ils sont ceux d'une simple esclave ou ceux d'une concubine.Le personnage de la servante-maîtresse tenait une grande place dans la société génoise où les esclaves étaient quasiment destinées au concubinat. La vie commune entre maître et esclave (more uxorio) était ouvertement acceptée. Le comportement en Provence ne devait guère être différent.Officiellement le servage et l’esclavage seront abolit dans les états de Savoie en 1769, mais ces pratiques avaient disparu dans le Countea de Nissa depuis le début du XVII ieme siècle. Dix ans plus tard, le 8 août 1779, une déclaration de Louis XVI (Le fameux tyran sanguinaire de l’histoire de France) abolit définitivement le servage sous toutes ses formes, servage de corps et servage d'héritage, dans toute l'étendue des domaines royaux et des domaines engagés de la couronne : "Nous avons été affecté en
18
considérant qu'un grand nombre de nos sujets, servilement encore attachés à la glèbe, sont regardés comme en faisant partie et confondus,pour ainsi dire, avec elle ; que, privés de laliberté de leurs personnes et des prérogativesde la propriété, ils sont mis eux-mêmes au nombre des possessions féodales ; qu'ils n'ontpas la consolation de disposer de leurs biens après eux et qu'excepté dans certains cas rigidement circonscrits ils ne peuvent même transmettre à leurs propres enfants le fruit de leurs travaux."
La position de l’église catholique.Unum est. Est une lettre écrite en 873 par le pape Jean VIII aux princes de Sardaigne, leur enjoignant d'affranchir les esclaves acquis auprès des Grecs :« Il est une chose pour laquelle nous devons paternellement vous admonester ; si vous ne lacorrigez pas, vous encourrez un grand péché, et par elle ce ne sont pas les gains que vous accroîtrez, comme vous l'espérez, mais bien plutôt les dommages. Comme nous l'avons appris, à l'instigation des Grecs, beaucoup qui ont été enlevés captifs par les païens sont donc vendus dans vos régions et, après avoir été achetés par vos compatriotes, ils sont gardés sous le joug de l'esclavage ; alors qu'il est avéré qu'il est pieux et saint, comme il convient pour des chrétiens, que lorsqu'ils les ont achetés des Grecs, vos compatriotes les renvoient libres pour l'amourdu Christ, et qu'ils reçoivent leur récompensenon pas des hommes, mais de notre Seigneur Jésus Christ lui-même. C'est pourquoi nous vous exhortons et nous vous commandons, avec un amour paternel, si vous leur avez acheté
19
des captifs, de les laisser aller libres pour le salut de votre âme. »Le pape Eugène IV publie le 13 janvier 1435 une courte encyclique sans appel sur le thème de l'esclavage, faisant ainsi pour la premièrefois de ce sujet un objet doctrinal. Sicut dudum fait état de dénonciations des mauvais traitements infligés aux indigènes des Iles Canaries, et fustige le comportement de chrétiens qui ont capturé ces indigènes, les ont privés de leurs biens et soumis à l'esclavage, quand bien même ceux-ci ne sont pas baptisés. Eugène IV exhorte ensuite les princes d'Occident, nobles et soldats à renoncer à ces pratiques. Enfin, il exige la libération immédiate de tous les esclaves des Iles Canaries sous peine d'excommunication.« Sous peine d’excommunication, tout maître d’esclave a quinze jours à compter de la réception de la bulle pour rendre leur libertéantérieure à toutes et chacune des personnes de l’un ou l’autre sexe qui étaient jusque-là résidentes desdites îles Canaries [...] Ces personnes devaient être totalement et à jamaislibres et devaient être relâchées sans exaction ni perception d’aucune somme d’argent. »Le 29 mai 1537, suite à la plainte des Dominicains au sujet de colons espagnols qui avaient soumis les indiens d’Amérique Centrale, le pape Paul III adresse au cardinalJuan de Tavera, l’assez véhément bref apostolique Pastorale Officium soutenant Charles Quint dans sa démarche d’abolition de l’esclavage des indigènes.Le 2 juin suivant, le même Paul III ré-écrit au même cardinal, la lettre Veritas ispa: confirme le droit humain à la liberté et la propriété.
20
Enfin, le 9 juin de la même année, le même pape confirme très officiellement les lettres précédentes dans la Bulle Sublimis Deus (la lire ici).Et pourtant c’est précisément ce que fit le Pape Paul III (de 1534 à 1549) sur cette question. Bien que membre d’une famille ecclésiastique Romaine, et quelquefois libertin dans ses premières années (il a été fait cardinal à vingt-cinq ans mais n’a pas accepté l’ordination jusqu’à ce qu’il ait eu cinquante ans). Paul se transforma et devint un pape efficace et pieux qui a pleinement reconnu la signification morale du Protestantisme et lança la Contre-Réforme. Sa Bulle magnifique contre l’esclavage dans le Nouveau Monde (aussi bien que les Bulles semblables par d’autres papes) furent d’une façon ou d’une autre «oubliées» des archives historiques jusque très récemment. Je crois que ceci est redevable aux polarisations extrêmes des historiens protestants, qui ont pu également avoir été méprisants de la prédication du pape affirmant que Satan était la cause de l’esclavage : « [ Satan, ] l’ennemi de la race humaine, s’oppose toujours à tout homme bon de sorte que sa course puisse se terminer, il a planifié d’une manière, inattendue bien avantmaintenant, un moyen par lequel il pourrait empêcher la parole salvatrice de Dieu d’être annoncée aux nations. Il a remué le monde de ses alliés qui, désirant satisfaire leur propre avarice, osent affirmer en long et en large que les Indiens de l’Ouest et du Sud quisont venus à notre connaissance en ces périodes puissent être réduits à notre servicecomme des animaux brutaux, sous le prétexte qu’ils ne connaissent pas la foi Catholique.
21
Et ils les réduisent ainsi à l’esclavage, les traitant par des afflictions qu’ils emploieraient à peine avec les animaux» «Par conséquent, Nous… considérant que les Indiens eux-mêmes sont en effet des hommes vrais… par notre décret Apostolique d’Autorité, décrétons et déclarons par ces lettres présentes que ces mêmes Indiens et tous autres peuples, même s’il sont en dehors de la foi, ne doivent pas être privés de leur liberté ou de leurs autres possessionset ne sont pas à être réduits en esclavage, oude ce qui en résulte, et quoi que ce soit qui soit fait en contradiction de ce que nous disons, est proclamé comme nul et non avenant. Dans une seconde Bulle sur l’esclavage, Paul appliqua la sanction de l’excommunication à quiconque sans regard pour: « sa dignité, son état, sa condition, ou safonction… qui de quelque façon que ce soit prétend réduire les dits Indiens à l’esclavageou de les dépouiller de leurs biens.» Mais rien ne s’est produit. Bientôt, en plus de l’exploitation brutale des Indiens,les bateaux esclavagistes Espagnols et Portugais ont commencé à naviguer entre l’Afrique et le Nouveau Monde. Et comme les missionnaires Catholiques d’outre-mer avaient éveillé Rome afin qu’elle condamne l’esclavagedes Indiens, des appels semblables ont été envoyés au sujet des esclaves noirs importés. Le 22 Avril 1639, le pape Urbain VIII (1623 à 1644), sur demande des Jésuites du Paraguay, publia une Bulle « Commissum Nobis» réaffirmant la loi de «notre prédécesseur PaulIII» pour ceux qui réduisent d’autres à l’esclavage puisqu’étant ainsi sujets à l’excommunication. Par la suite, la Congrégation du Saint Office (l’Inquisition Romaine) a même abordé la question. Le 20 Mars
22
1686. Elle intervint sous forme de questions et réponses : Il est demandé : S’il est permis de capturer par la force et la duperie des noirs ou autres indigènes qui n’ont porté préjudice à personne?Réponse : non. S’il est autorisé d’acheter, de vendre ou de faire des contrats en tout respect des noirs ou autres indigènes qui n’ont pas porté préjudice à personne et n’ont rien fait et quiont été faits captifs par la force de la duperie?Réponse : non Si les propriétaires de Noirs et autres natifs qui n’ont porté préjudice à personne etont été capturés par la force ou la ruse, doivent les remettre en liberté ?Réponse: OuiSi les ravisseurs, les acheteurs et les propriétaires de Noirs ou autres indigènes quin’ont porté préjudice à personne et qui ont été capturés par la force ou la duperie n’ont pas le droit de leur demander de payer compensation?Réponse : Oui. Rien d’ambigu ici. Le problème ne futpas que l’Église ne condamna pas l’esclavage; ce fut que peu entendirent et que la plupart d’entre eux refusèrent d’écouter. À cette époque, les papes avaient peu ou à peu près pas d’influence sur les Espagnols et les Portugais puisqu’à ce moment-là, l’Espagne même régnait sur la majeure partie de l’Italie; en 1527, sous la conduite de CharlesV, les espagnols ont même saccagé Rome. Si le pape avait si peu d’influences en Espagne ou au Portugal, il n’en avait à peu près aucune 23
dans le Nouveau Monde et les nouvelles colonies, excepté indirectement par le travaildes ordres religieux. En fait, il était illégal même d’éditer les décrets papaux « dans les possessions coloniales espagnoles sans le consentement royal,» et le roi s’arrogeait le droit de désigner également tous les évêques.Mais l’arrivé du schisme Protestant va calmer les ardeurs de l’église de Rome, il s’agit de préserver les intérêts économique des puissances du « Saint Empire Romain Catholique» face à l’émergence des puissances Protestantes ( Angleterre, Hollande etc…) qui elles investissent aussi un empire colonial prospère en échanges économiques s’appuyant sur des cultures d’outre-mer nécessitant une main d’œuvre nombreuse et peu couteuse.
Les protestants et l’esclavage.Il faut également prendre en compte que le protestantisme est tout sauf monolithique. Duquel parlons-nous ? La composition religieuse des États-Unis diffère de celle du Vieux-Continent : certaines traditions d’Églises historiques sont prééminentes (anglicane, congrégationaliste, presbytérienne…) au début des colonies, mais c’est souvent sous la forme de « secte » (Weber, Léonard, Lacorne) et de mutations constantes (scissions, Réveils, déplacements…)que le protestantisme présente sa spécificité sur le sol américain ; Fath le qualifie de « mosaïque confessionnelle » soumis à un processus de « diversification » dans le temps. Nous parlerons donc plus volontiers des« Églises issues de la Réforme ».
24
Ces églises se référant à l’interprétation destextes issus de l’Ancien Testament. La Genèse.« 20. Noé commença à cultiver la terre, et planta de la vigne.21. Il but du vin, s’enivra, et se découvrit au milieu de sa tente.22. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères.23. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons, et couvrirent la nudité de leurpère; comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père.24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. (Ou selon d'autres versions : il apprit ce que lui avait fait son plus jeune fils.2,3)25. Et il dit : Maudit soit Canaan ! Qu’il soit l’esclave des esclaves de ses frères ! 26. Il dit encore : Béni soit l’Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave ! 27. Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu’il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave ! »
En Europe, l’utilisation de la malédiction de Cham pour justifier l’infériorisation des peuples noirs et l’esclavage apparaît au XVIIesiècle, dans les milieux protestants de Hollande. Georg Horn, professeur d’histoire à l’Université de Leyde, serait le premier, en 1666, à avoir proposé une classification des races selon le modèle de la descendance de Noéde la Genèse Quelques années plus tard, Jean Louis Hannemann, s’appuyant sur un commentairede la Genèse de Martin Luther, évoque dans un exposé fondamentaliste le fait que les Éthiopiens sont devenus noirs et esclaves à cause de la malédiction de Cham. C’est donc dans le contexte du retour à une interprétation très littérale de la Bible,
25
dans la mouvance de la Réforme protestante, que commence à se développer l’utilisation de la malédiction de Cham comme instrument de justification de l’esclavage chez les chrétiens d’Occident.
Cette interprétation prendra de l’ampleur et trouvera un écho aux États-Unis, aux 18 iéme et 19 Iéme siècles, au fur et à mesure que le phénomène de la traite des Noirs s’amplifiera.Elle deviendra un objet de débat entre partisans de l’esclavagisme et de l’antiesclavagisme, débat qui mènera à la guerre de Sécession. En 1837, par exemple, le révérend Théodore Weld, antiesclavagiste, écrit dans un tract largement diffusé : « La prophétie de Noé est le vade-mecum qui accompagne tout le temps les esclavagistes, etils ne s’aventurent jamais à l’extérieur sans elle. » Dans son Avertissement aux protestants(1689-1691), Bossuet fait découler de la conquête un prétendu droit de tuer le vaincu et trouve en conséquence "un bienfait et un acte de clémence" dans le fait de réduire ce vaincu en esclavage... (5ème avertissement, art. 50, t. IV).
En Amérique du Nord, les premiers esclaves africains, au nombre de vingt, sont débarqués à Jamestown (Virginie) en août 1619, en tant que "travailleurs sous contrat". Emmenés par d'anciens corsaires britanniques, ils sont soumis à l'esclavage limité, statut légal des Indiens d'Amérique, des domestiques blancs et noirs avant l'esclavage, dans pratiquement toutes les colonies anglaises du Nouveau Monde.Le nombre d'esclaves importés n'étant pas trèsimportant au début, il n'apparaît pas nécessaire de définir leur statut légal.
26
Avec le développement du système de plantations dans les colonies du Sud au cours de la seconde moitié du XVIIe siècle, le nombre d'Africains importés pour servir d'ouvriers agricoles augmente considérablementet plusieurs villes côtières du Nord deviennent de grands ports négriers. Dans l'ensemble, dans les colonies du Nord, les esclaves sont utilisés à des tâches domestiques et dans le commerce. Dans les colonies du centre ils sont davantage employésdans l'agriculture. Dans les colonies du Sud où domine l'agriculture de plantations, presque tous les esclaves y travaillent.
L’« empreinte protestante » qui favorisa l’esclavage est plus subtile. Les puritains deNouvelle-Angleterre profitaient indirectement de l’esclavage par le biais de la traite, à laquelle un certain nombre d’entre eux participent. Générant des profits importants sur lesquels ils construisent leur fortune, latraite irrigue aussi l’économie locale des ports et des marchés. Nous avons donc plutôt affaire à un anglo-protestantisme d’imprégnation, qui favorise des pratiques capitalistes et une éthique pragmatique tout en reconnaissant que l’esclavage est une institution inique. Le conservatisme social sert des intérêts économiques et les colonies anglaises voient donc cohabiter deux types complémentaires de rentabilité : l’une agricole esclavagiste et l’autre industrielle marchande, qui, malgré la différence dans les modalités du travail, se retrouvent dans la même « éthique protestante des hommes d’affaires » : « Le management d’une plantation ne différait pas dans sa nature de celui d’une entreprise : ce que recherchaient les planteurs, c’était un travail soutenu,
27
régulier, productif… » C’est parce qu’il est partie prenante du facteur culturel et économique (anglo-protestantisme de type capitaliste) que le paramètre religieux des Églises issues de la Réforme semble avoir permis, accompagné et légitimé, dans une certaine mesure, l’institutionnalisation de l’esclavage, dans un esprit capitalistique.
Les débuts de l’abolitionnisme. Lecas français.1790 :
- Les décrets du 8 mars et du 12 octobre réaffirment la légalité de l'esclavage.
- La loi du 15 mars proclame l'abolition du servage sans aucune indemnité de tous les effets de la mainmorte réelle, personnelle ou mixte qui s'étendent sur les personnes et sur les biens.
1791 :
- 15 mai, l'assemblée constituante finit par reconnaître les droits politiques des gens de couleur nés de père et de mère libre (5 ou 6% d'entre eux). Le compromis est aberrant. Officialisant la condition inférieure de 95 % des gens de couleur, il constitue une nouvellenégation des principes du 26 août 1789. Et, violant le préjugé de couleur, il porte atteinte aux privilèges des blancs, déchaînantainsi la fureur des planteurs créoles et des petits blancs de Port-au-Prince.
- La Constitution (première Constitution) du 3septembre refuse l’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises, au motif que cela causerait la ruine de ces dernières.
28
- Le 24 septembre, arguant des troubles survenus à Saint-Domingue, Barnave fait décréter que la question du statut des gens decouleur relève de la compétence des assembléescoloniales auxquelles est laissé le soin "de faire des lois concernant l’état des personnesnon libres et l’état politique des hommes de couleur et nègres libres" (les métis, ndlr).
- Le 28 septembre, un décret porte que tout homme, de quelque couleur qu’il soit, jouit, en France (en métropole), de tous les droits de citoyen. Le seul projet de nature abolitionniste est présenté par Blangilly, un député des Bouches-du-Rhône : le projet prévoit, entre autres mesures, l’affranchissement au bout de huit ans des Noirs, qui deviendraient journaliers (le projet n’est ni discuté ni même porté à la tribune).
1793 :
- 3 janvier : la loi sur l'abolition de l'esclavage est appliquée au Haut-Canada (maintenant Ontario) par le lieutenant-gouverneur Simcoe ; elle libère tout esclave qui vient dans la province ; elle dit aussi que tout enfant né d'une mère esclave doit être libéré à l'âge de 25 ans.
- 21 juin, Sonthonax et Polverel proclament laliberté à tous les esclaves qui se battront pour la République.
- 9 juillet : une loi du Haut-Canada (Ontario)interdit de faire entrer de nouveaux esclaves dans la province et établit que les enfants qui naîtront d’une mère esclave deviendront libres à l’âge de 25 ans.
- 29 août, Sonthonax décrète l’abolition générale pour les esclaves de la province du 29
Nord de Saint-Domingue (assortie néanmoins du devoir de reprendre le travail sur les plantations pour ceux qui ne combattent pas). Dans son décret, il affirme que sa mission estde "préparer graduellement, sans déchirement et sans secousses, l’affranchissement général des esclaves".
- 4 septembre, Polverel abolit l’esclavage dans les parties ouest et sud de Saint-Domingue.
1794 :
- Le 4 février (16 pluviôse an II), à l'initiative de l'Abbé Henri Grégoire et sur proposition des députés Vadier, Levasseur et Lacroix, la décision de Sonthonax est généralisée, la Convention nationale abolit l'esclavage : « La Convention nationale déclare aboli l'esclavage des nègres dans toutes les colonies ; en conséquence, elle décrète que tous les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, sontcitoyens français, et jouiront de tous les droits assurés par la constitution » Robespierre s’écrie : « Périssent les coloniesplutôt que les principes ».
22 août 1795 : la Constitution de l’an III (article 15 de la Déclaration des droits de l’homme) maintient le principe de la suppression de l’esclavage.
1802, Bonaparte rétablie l’esclavage dans les colonies.
L’esclavage est rétabli à la Guadeloupe le 16 juillet.
- 20 mai (30 floréal an X), promulgation de laloi rétablissant la traite et l'esclavage dans
30
les colonies françaises (Martinique, Guadeloupe, Réunion).
- 28 septembre : l’esclavage est rétabli à la Réunion ; en novembre, il est rétabli en Guyane française.
1803 : Dans le Comté de Nice, occupé et annexé, le préfet français Châteauneuf Randon,prend au nom de l’état français un décret :
Nice, le 11 Pluviôse, an X de la République française, une et indivisible.Le Préfet du département des Alpes-Maritimes aux maires et Adjoints des Communes du Département : Le Grand Juge, Ministre de la Justice, vient de me faire connaître, Citoyens, l’intention où est le Gouvernement qu’il ne soit reçu aucun acte de mariage entredes blancs et des négresses, ni entre des nègres et des blanches. Vous voudrez bien vousconformer exactement à cette décision. Je vousprie d’accuser réception de la présente au Sous-Préfet de votre arrondissement. Je vous salue. Signé : CHÂTEAUNEUF RANDON.”1815 :
- Au congrès de Vienne, le 8 février, les grandes puissances (Angleterre, Autriche, France, Portugal, Russie, Espagne et Suède) décident l’abolition de la traite mais laissent à chaque pays le soin de déterminer le délai "le plus convenable" pour l’application de cette mesure. La traite des Noirs devient en partie clandestine. Elle est assimilée à la piraterie ; les navires de guerre français et anglais ont le droit de visite ; le navire, confisqué, peut être brûlé.
31
- Le 29 mars, Napoléon, influencé par Carnot, décide la suppression immédiate de la traite des Noirs.
- Le 30 juillet : Louis XVIII confirme l'abolition (mais elle ne sera pas appliquée malgré l’ordonnance du 8-11-1817 et la loi du 15-4-1818).Le 27 septembre 1818, le congrès d’Aix-la-Chapelle conseille l’abolition progressive de l’esclavage ; le 21 novembre, la France abolitla traite des Noirs.- La loi du 25 avril 1825 punit de peines d’amende, de prison et de déportation, les Français "engagés dans le commerce de la traite" des noirs.1834 : Création en France de la Société pour l'abolition de l’esclavage avec Tocqueville etLamartine.1835 : Dans un catéchisme à l'usage des paroisses des colonies françaises, publié avecl'approbation de Rome, M. l'abbé Fourdinier, supérieur du séminaire du Saint-Esprit, soutient que l'esclavage est d'institution chrétienne.1845. Votées les 18 et 19 juillet, les lois Mackau (du nom de leur initiateur, Ange René Armand de Mackau, ministre de la Marine et desColonies), dites "d'adoucissement de l'esclavage", préparent son abolition. Elles rendent obligatoire une durée minimale accordée à l'instruction des esclaves. Elles limitent à quinze le nombre de fouets que les propriétaires peuvent dispenser sans avoir à recourir à une autorisation judiciaire. Les esclaves mariés mais de maîtres différents obtiennent le droit de réunion 13.
1846 :
32
- En juillet, le roi Louis-Philippe abolit l'esclavage dans les domaines royaux de la Martinique et de la Guadeloupe et dans l'île de Mayotte qui vient d'être acquise par la France.La République Française abolit l’esclavage
La France interdit enfin l’esclavage.
Le 27 avril 1848, paraissent les décrets du gouvernement français abolissant l’esclavage, élaborés par une commission placée sous la présidence de Victor Schoelcher 14, sous-secrétaire aux Colonies, par le ministre de laMarine et des Colonies, Arago, rallié à la cause abolitionniste : « Au nom du peuple français. Le gouvernement provisoire de la République, considérant que nulle terre française ne peut plus porter d'esclaves, décrète : Une commission est instituée auprès,du ministre provisoire de la marine et des colonies, pour préparer ; dans le plus bref délai, l'acte d'émancipation immédiate dans toutes les colonies de la République. Le ministre de la marine pourvoira à l'exécution du présent décret. »
La citoyenneté française (droit de vote) est garantie aux nouveaux affranchis et les colonies obtiennent le statut de départements.
L’article 6 de la Constitution confirme : « L’esclavage ne peut exister sur aucune terre française. »
Le 23 mai, en Martinique, à la suite de désordres liés à la connaissance des décisionsparisiennes, les autorités de Saint-Pierre et Fort Royal, abolissent l'esclavage. Le 27 mai,alors que la situation est plus calme, le gouverneur de la Guadeloupe proclame l'abolition générale. Fin mai, l'île de la
33
Réunion est enfin mise au courant, mais le gouverneur attend le 20 décembre pour appliquer les décrets. Ce n'est que le 10 juinque le gouverneur de la Guyane prend la même décision (avec effets au 10 août). La situation est plus délicate en Algérie et au Sénégal, car une partie des esclaves appartiennent aux indigènes. En Algérie, le décret est mal appliqué dans les campagnes. AuSénégal pour ne pas mécontenter les Maures quisont esclavagistes, mais qui assurent le ravitaillement de la colonie, le gouverneur demande aux autorités locales de refouler les esclaves qui rechercheraient asile dans les colonies françaises.Il faudra attendre 1915 et le besoin de troupes coloniales pour que la loi fût effectivement appliquée à l’ensemble des territoires de l’Empire Colonial Français. Et 1930 pour que le travail forcé soit dénoncé.- Le 25 juin 1957, la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail adopte la Convention N 105 concernant l'abolition du travail forcé (entrée en vigueur : 17 janvier 1959).
La condition salariale.
Avec la révolution industrielle, expression d'Adolphe Blanqui mise ensuite en valeur par Friedrich Engels et par Arnold Toynbee, qui désigne le processus historique du XIXe sièclequi fait basculer — de manière plus ou moins rapide selon les pays et les régions — une société à dominante agraire et artisanale versune société commerciale et industrielle. Cettetransformation, tirée par le boom ferroviaire des années 1840, affecte profondément l'agriculture, l'économie, la politique, la
34
société et l'environnement.Les premiers espaces à s'être industrialisés sont la Grande-Bretagne à la fin du XVIIIe siècle, puis la France et la Belgique au débutdu XIXe siècle : ce sont les pays de la première vague. L'Allemagne et les États-Unis s'industrialisent à partir du milieu du XIXe, le Japon à partir de 1868 puis la Russie à la fin du XIXe : ils forment les pays de la deuxième vague.
Les transformations économiques, politiques etsociales sont telles que certains, comme Max Pietsch et David Landes, veulent y voir une rupture avec le passé. D'autres pointent plutôt la convergence d'éléments que le contexte historique favorise et diffuse au XIXe siècle. Karl Polanyi, dans La Grande Transformation (1944), expose notamment l'idéed'un siècle marqué par :
– un équilibre politique international : absence de grandes guerres entre 1815 et 1914 ;
– un équilibre monétaire : système de l'étalon-or et absence d'inflation ;
– un équilibre économique : acceptation de l'économie de marché.
L’esclavage traditionnel pour les sociétés quirentrent dans l’ère industrielle, n’est tout simplement plus rentable pour le nouveau système capitaliste.La révolution agricole est consécutive à la révolution industrielle, amorcée au début du XVIIIe siècle, elle va se poursuivre tout au long du XIXe siècle. L'apparition du machinisme agricole, est marquée par la moissonneuse mécanique de Cyrus Mac Cormick en
35
1824, sa moissonneuse-batteuse en 1834, la charrue de Mathieu de Dombasle en 1837. Les années 1840 voient naitre l'utilisation des engrais artificiels grâce à la chimie (recherches de Justus von Liebig). On aura de moins en moins besoin de main d’œuvre agricole.
L’esclave c’est un capital mobilier immobilisépeu productif, il faut le nourrir, le loger, le soigner quand il est malade, assurer les conditions de sa reproduction comme un éleveurde bétail, et continuer de l’entretenir lorsqu’avec la vieillesse sa productivité diminue.
Ainsi l’abolition de l’esclavage n’obéit pas àdes motifs humanitaires, philosophiques, moraux ou religieux, mais à des impératifs économiques.Le prolétaire salarié possède tous les avantages, venu de sa campagne pour vendre sa force de travail, c’est-à-dire sa productivité, il dépend entièrement grâce à laspécialisation des taches de travail sur la ligne de production du bon vouloir du patron.Il est facilement remplaçable et peut être misen concurrence.Sa rémunération, qui représente environ un quart à un tiers de la richesse qu’il produit,doit lui servir à se nourrir, se loger, donnerà manger à sa progéniture, se soigner lorsqu’il n’est plus en état de travailler, etassurer la période où il sera insuffisamment productif et sera mis à la porte de l’atelier.En contrepartie, il sera « libre » de choisir son exploiteur et « libre » d’avoir l’impression de choisir son gouvernement en devenant électeur.Ainsi, après la guerre de sécession 1861-
36