Etude préliminaire des amphores gauloises des fouilles de l'épave Arles-Rhône 3 (Arles, BDR) (2e...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Etude préliminaire des amphores gauloises des fouilles de l'épave Arles-Rhône 3 (Arles, BDR) (2e...
REVUE ARCHÉOLOGIQUE DE NARBONNAISE
◤◤ Directeur : Pierre GARMY :
Comité de lecture : Guy BARRUOL, Valérie BEL, Frédérique BERTONCELLO,Michel BONIFAY, Sandrine BOULAROT, Philippe BORGARD,Marie-Brigitte CARRE, Gaëtan CONGÈS, Isabelle DAVEAU,Dominique GARCIA, Pierre GARMY,Ricardo GONZÁLEZ VILLAESCUSA, Jean GUYON, Marc HEIJMANS,Cécile JUNG, Xavier LAFON, Fanette LAUBENHEIMER,David LAVERGNE, Philippe LEVEAU, Stéphane MAUNÉ,Jean-Marc MIGNON, Nuria NIN, Marie-Jeanne OURIACHI, Anne PARIENTE, Michel PASSELAC, Christophe PELLECUER,Hervé POMAREDES, Christian RICO, Claude RAYNAUD, Robert ROYET, Corinne SANCHEZ, Danielle TERRER,Patrick THOLLARD
Ont également contribué à la réalisation de ce volume :Michel AMANDRY, Jean-Pierre BOST, Michel CHRISTOL,Marie-Jeanne OURIACHI, Laurent SCHNEIDER,Marie-Dominique NENNA, Anne DE PURY-GYSEL
◤◤ Maquette et mise en page : Philippe WALEk
Pour les normes de la Revue et des Suppléments, l’envoi des manuscrits, ainsi que les échanges, s’adresser à la rédaction de la Revue :Revue archéologique de NarbonnaiseUMR 5140 Archéologie des sociétés méditerranéennes 390, avenue de Perols - 34970 LATTESTél. : +33(0)4 67 15 61 28 – Fax : +33(0)4 67 22 55 15E-mail : [email protected]
Pour la partie commerciale :PULM - Presses universitaires de la Méditerranée, 17 rue Abbé-de-l’Épée 34090 MontpellierE-mail : [email protected]
Suppléments nos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 et 10, s’adresser à :Édition-Diffusion de Boccard11, rue de Médicis, 75000 PARIS, Tél. : 01 43 26 00 37 – Fax : 01 43 54 85 83Autres Suppléments, s’adresser aux PULM Tél. : 04 99 63 69 25
Ce document a été réalisé à partir de papier blanchi sans chlore issu de forêts gérées de façon responsable et recyclé en partie ayant obtenue la certification FSC® mixte - FCBA-COC-000077.© 2010 pour tous paysÉditions de l’Association de la Revue archéologique de NarbonnaiseISSN : 0557-7705 - ISBN :979-10-92655-01-8 - EAN : 9791092655018Dépôt légal : 2012Pure Impression, 451, rue de la Mourre - 34130 Mauguio
Éditions de l’Association de la Revue archéologique de NarbonnaiseMontpellier
2014
REVUE ARCHÉOLOGIQUE DE NARBONNAISE
TOME 46
2013
Sommaire TOME46—2013
DOSSIER
–– Les–fortifications–de–la–ville–basse–du–castellas–à–Murviel-lès-Montpellier–(hérault)– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11––Claire-Anne–de–Chazelles,––Alexandre–Beylier––Michaël–Landolt–(dir .)avec–les–contributions–de–––Sébastien–Barberan––Marie-Laure–Berdeaux-Le–Brazidec––Gaspard–Pagès––Sarah–Silvéréanoavec–le–concours–de–––Virginie–Archimbeau––Céline–Capdeville––Eric–Dellong–––Handi–Gazzal––Delphine–Lopez–––Georges–Marchand–
VARIA
–– Pratiques–culturales–et–système–agraire–gallo-romain .–L’exemple–de–la–vallée–de–l’Hérault–et–du–Biterrois–(Hérault)– . . . . . . . . . . . . . . . . .159––Cécile–Jung––Hervé–Pomarèdesavec–la–collaboration–de–––Michel–Compan––Isabelle–Figueiral––Olivier–Ginouvez––Sophie–Martin––Christophe–Tardy
–– L’établissement–de–hauteur–du–Malpas–à–Soyons–(Ardèche)–durant–l’Antiquité–tardive–(IVe–––VIe–s .)– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179––Amaury–Gilles––Thierry–Argant––Stéphane–Carrara––Aline–Colombier-Gougouzian––Olivier–Darnaudavec–la–collaboration–de––––Fabien–Delrieu––Pierre–Dutreuil
–– Les–camps–romains–du–plateau–de–Lautagne–à–Valence–(26)–:–état–de–la–question– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201––Pascale–Conjard–Réthoré––Emmanuel–Ferber
–– L’aqueduc–romain–de–Causses-et-Veyran–(34)–et–son–septuple–siphon–inversé–– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221––Roland–Haurillon
–– Inscriptions–latines–inédites–d’Aix-en-Provence–et–de–son–territoire–(Aquae Sextiae).–Premier–supplément–aux–ILN Aix– . . . . . . . . . . . . .233––Sandrine–Agusta-Boularot––Núria–Nin–
Sommaire TOME46—2013
–– Une–inscription–fragmentaire–découverte–à–Néoules–(Var),–sur–le–territoire–d’Arles–antique – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305––Sandrine–Agusta-Boularot–––Yvon–Lemoine
–– L’artisanat–de–la–poterie–à–Boutae,–l’antique–Annecy–(Haute-Savoie)–– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311––Colette–Laroche–––Aline–Langlois––Liliana–Ceci––Anne–Schmittavec–la–collaboration–de–––Isabelle–André,––Franck–Gabayet––Joël–Serralongue
–– La–géographie–des–productions–des–ateliers–d’amphores–de–Gaule–Narbonnaise–pendant–le–Haut-Empire .–Nouvelles–données–et–perspectives– . . .335––Stéphane–Mauné–
–– Étude–préliminaire–des–amphores–gauloises–des–fouilles–de–l’épave–Arles-Rhône 3 (Arles,–B .-du-Rh .)(2e–moitié–du–Ier–s .–––1ère–moitié–du–IIe s .–ap .–J .-C) .– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375––Fabrice–Bigot––David–Djaoui
–– Nouvelles–données–sur–les–timbres–sur–amphores–et–couvercles–gaulois–d’Arles–(B .-du-Rh .)– – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395––Séverine–Corbeel–––Guillaume–Duperronavec–la–collaboration–de–––Fabrice–Bigot–––Luc–Long
–– Les–aryballes–de–verre–en–Narbonnaise,–témoins–de–la–circulation–des–huiles–corporelles–(fin–du–Ier–ap .–J .-C .–-–IIIe–s .)– . . . . . . . . . . . . . . . . .431––Danièle–Foyavec–la–collaboration–de–––Michel–Cruciani–––Souen–Fontaine
–– Un–nouvel–acrotère–en–forme–de–masque–tragique–dans–l’arrière-pays–aixois – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .459––Stéphanie–Satre–
–– –CORPUS–des–Trésors–monétaires–gaulois–et–romains–de–Narbonnaise– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .467–– I,–Cités–de–Béziers–et–de–Lodève – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .469––Marie-Laure–Berdeaux-Le–Brazidec
375
RAN 46 – pp. 375-394
◤◤ Abstract: Underwater excavations carried out prior to the raising of the ancient barge Arles-Rhône 3 have uncovered numerous ceramics and amphorae dating to between 60 and 140 C.E. Amphorae play the most important role in this assemblage, and almost half of these are locally produced Gallic amphorae. This proportion reflects the importance of wine from Narbonensis in this period in trade with both Rome and towards the Germanic limes, and confirms the important position of Arles with respect to the distribution of this product. The excellent state of preservation of the amphorae, a number of which are intact, allows for consideration of commercial networks between the last quarter of the 1st century and the mid-2nd century C.E., as well as for morphological and volumetric studies.
◤◤ keywords: Narbonensis, Arles, harbor’s dump, High Empire, Gallic amphorae, trade
◤◤ Résumé : Les fouilles subaquatiques, réalisées préalablement à l’opération de levage du chaland antique Arles-Rhône 3, ont permis de mettre au jour de très nom-breuses céramiques et d’amphores datées entre les années 60 ap. J.-C. et 140 ap. J.-C. Les amphores occupent la place la plus importante au sein de ce dépotoir portuaire. Parmi celles-ci, près de la moitié est gauloise (de prove-nance régionale). Cette proportion témoigne, pour cette période, de l’impor-tance du vin de Narbonnaise dans le grand commerce aussi bien vers Rome qu’en direction du limes germanique et confirme la place centrale occupée par Arles pour la distribution de cette denrée. L’excellent état de conservation des amphores dont plusieurs sont entières, permet également une réflexion sur les modèles commercialisés entre le dernier quart du Ier s. ap. J.-C. et le milieu du IIe s. ap. J.-C., ainsi qu’une étude morphologique et volumétrique.
◤◤ Mots-Clés : Narbonnaise, Arles, dépotoir portuaire, Haut-Empire, amphores gauloises, commerce.
– Fabrice Bigot– David Djaoui
1. INTRODUCTION
Les amphores gauloises ont fait l’objet d’une attention particulière, notamment depuis 1985, date de publi-cation par F. Laubenheimer de sa thèse sur les am-phores produites en Gaule Narbonnaise durant le Haut-Empire (Laubenheimer 1985). Leur typologie
ainsi que la carte de répartition des ateliers ont été, ensuite, rapi-dement enrichies par la poursuite des recherches (Laubenheimer 1989b ; Bertucchi 1992 ; Laubenheimer 2001 ; Mauné 2009). Le rôle majeur de la viticulture spéculative, dont les amphores sont des témoins privilégiés, a été mis en évidence par la multiplica-tion des études sur celles-ci tant en contexte de production qu’en contexte de consommation. Ainsi, le développement des ateliers d’amphores accompagne la montée en puissance puis l’apogée de l’économie de cette province (Brun, Laubenheimer 2001, 208-209 ; Brun 2005). Les recensements des amphores gauloises pré-sentes dans les centres de consommation entre le Ier s. ap. J.-C. et le IVe s. ap. J.-C. vont dans le même sens. Tant sur les grands marchés de l’Empire comme Rome ou encore les limes germa-nique et britannique (Laubenheimer 2001, 55) que dans les ag-glomérations régionales, comme Nîmes (Barberan 2013, 237 ; Laubenheimer, Schwaller, Vidal 1992) ou Ambrussum (Lau-benheimer 1989a), les amphores vinaires gauloises occupent une place prépondérante par rapport aux conteneurs des autres pro-vinces de Méditerranée.
Étude préliminaire des amphores gauloises des fouilles de l’épave Arles-Rhône 3(Arles, B.-du-Rh.) (2e moitié du Ier s. – 1ère moitié du IIe s. ap. J.-C.)
fichier ÉDITEUR destiné à un usage privé
376 – faBriCe Bigot – david dJaoui
revue arChéologique de narBonnaise, tome 46, 2013
Des travaux récents ont néanmoins mis en évidence plusieurs anomalies. En premier lieu, les analyses physico-chimiques menées par F. Laubenheimer et A. Schmitt sur une série d’amphores gauloises issues d’ateliers et de centres de consommation ont démontré la prépondérance des productions rhodaniennes par-mi les importations d’amphores gauloises à Ostie, sur le limes germanique et en Grande Bretagne (Lauben-heimer, Schmitt 2009, 156-157). Or, ces résultats ne concordent pas totalement avec les données archéo-logiques puisqu’une forte concentration d’officines, dans certaines zones de Narbonnaise plus ou moins éloignées de la vallée du Rhône (moyenne vallée de l’Hérault ou encore vallée de l’Arc dans les B.-du-Rh. ; Mauné, Silvéréano 2011, 668 ; S. Mauné dans ce vo-lume) a été mise en évidence alors que les ateliers sont très peu nombreux dans cette dernière. On ignore, par ailleurs, vers quelle(s) destination(s) était commercia-lisée la plus grande partie du vin de Narbonnaise oc-cidentale conditionnée en amphores. De plus, l’exis-tence de groupes d’ateliers localisés autour de Cannes et sur la côte languedocienne est également proposée respectivement par F. Laubenheimer et A. Schmitt à partir des analyses physico-chimiques (2009, 156) et
S. Mauné (voir dans ce volume). La faible concentra-tion d’ateliers littoraux en Narbonnaise constitue une anomalie par rapport aux autres provinces de l’Empire romain et par rapport au rôle capital du commerce ma-ritime durant l’Antiquité.
Ces observations suscitent plusieurs interrogations : où se trouvent précisément ces ateliers littoraux ? Quelle est leur concentration dans ces zones ? A partir de quels pôles étaient commercialisées les amphores ? Comment s’organisaient et s’articulaient entre eux les transports terrestres, fluviaux et maritimes ? Ré-pondre à ces questions nécessite de prendre en compte l’ensemble de la documentation disponible sur les am-phores gauloises dans les établissements et agglomé-rations littoraux de Narbonnaise1.
2. LE CONTEXTE DE DÉCOUvERTE
Vers le milieu du Ier siècle ap. J.-C., le chaland Arles-Rhône 3 a fait naufrage sur la rive droite du Rhône, dans la zone portuaire de l’antique Arelate. Il s’in-sère au sein d’un immense dépotoir portuaire, réfé-rencé comme « Gisement A », qui s’étend de part et
Figure 1 :Localisation de l’épave Arles-
Rhône 3
fichier ÉDITEUR destiné à un usage privé
377étude préliMinaire des aMphores gauloises des fouilles de l’épave ArLeS-rhôNe 3 (arles, B.-du-rh.) (2e Moitié du ier s. – 1ère Moitié du iie s. ap. J.-C
RAN 46 – pp. 375-394
d’autre du pont de la voie rapide (fig. 1) (Long et al. 2006). Il s’agit d’une partie du dépotoir qui se déve-loppe, sur plusieurs kilomètres, depuis le nord de la ville jusqu’au sud, à l’emplacement du Gisement B qui renferme des objets antiques détachés des zones amonts par les crues (Long 2009, 40-41). Lors de son naufrage, le bateau s’est déposé sur une couche d’ar-gile relativement stérile et a été recouvert par un en-chevêtrement de milliers de tessons d’amphores et de céramiques. L’interprétation de ce que l’on qua-lifie de vaste « dépotoir portuaire » est rendue com-plexe par la présence conjointe de rejets de consom-mation et d’ateliers urbains, d’objets du quotidien, de pièces d’accastillage et de vaisselles de bord des ba-teaux ainsi que par des pièces d’orfèvrerie empor-tées par les crues ou encore déposées volontairement à des fins cultuelles. À travers les 900 m3 de sédi-ments fouillés et déplacés pour atteindre et renflouer l’épave Arles-Rhône 3 (Djaoui et al. 2011), l’étude croisée des sigillées sud-gauloises des couches de surface et des monnaies antiques a permis de fixer à ces dépôts un terminus ante quem que l’on situe vers 140 ap. J.-C. (Djaoui, Martin à paraître). On notera également que les études quantitatives des sigillées et des parois fines de Bétique, rassemblant respecti-vement 28000 et 22000 fragments, s’accordent pour situer un pic d’activité à l’époque flavienne2.
Cette analyse préliminaire nous permettra d’abor-der une réflexion sur le commerce des amphores gauloises et la place qu’y occupe Arles, à partir des comptages de celles-ci et de l’étude des contenances de chaque type. L’établissement de la chronologie des strates et les analyses de pâtes sont actuellement en cours. Nous ne disposons donc pas de données concrètes sur ces points. C’est pourquoi, nous pren-drons comme horizon la datation de cette partie du gisement A. Une description de pâte n’est effectuée que lorsque l’analyse macroscopique, à l’œil nu, per-met de proposer la provenance d’un individu ou de mettre en évidence l’existence d’un atelier.
3. PROTOCOLE D’ÉTUDE
Le comptage a débuté en 2011 sur le chantier de fouille et relevage de l’épave Arles-Rhône 3. Compte tenu du volume très important d’amphores gauloises exhumées (NMI 1680) et des capacités de stockage limitées du Musée départemental de l’Arles antique (MdAa), il n’a été conservé qu’un échantillonnage de 20 %, soit 325 des 1110 individus. La grande majo-rité des amphores a par conséquent été inventoriée et replacée, au sein du négatif laissé par l’épave. En dehors de quelques enregistrements métriques (dia-mètre des bords et des fonds) du type de l’amphore et de l’U.S., l’inventaire précise également l’état de conservation en répartissant les catégories qui se différencient entre les cols à deux anses, les cols à
une anse, les cols sans anse et les éléments fragmen-tés (demi-lèvre, quart de lèvre, tiers de lèvre….). Le même protocole a été appliqué pour les fonds d’am-phores gauloises et les anses. L’objectif était de déter-miner assez rapidement le NMI en comptabilisant les totaux des bords conservés entiers et en divisant par l’état de fragmentation les autres. La même méthode de comptage a été appliquée aux amphores gauloises prélevées et conservées dans les réserves du musée ainsi qu’aux autres catégories d’amphores.
Dans cette étude, nous avons comptabilisé l’en-semble des amphores sans tenir compte de la strati-graphie. Les conditions de fouille dans les eaux obs-cures du Rhône ne permettent pas, en effet, d’assurer l’individualisation précise des couches et seule une étude exhaustive de la céramique fine permettra de tester la réalité du diagramme stratigraphique3. Si ces premiers chiffres donnent une idée assez fidèle des proportions, les comptages sont vraisemblablement sous-évalués et devront faire l’objet d’un deuxième inventaire après collage.
La détermination des types a été effectuée à partir de la typologie des amphores gauloises de F. Laubenhei-mer (1985 ; 1989b). Précisons enfin qu’à l’exception de certaines G.1 à pâte kaolinitique sableuse, les am-phores gauloises présentent toutes une pâte calcaire fine de couleur beige à rouge/orangée. Le dégraissant se compose le plus souvent de paillettes de mica et d’inclusions blanches dont la taille et la proportion varient. Cette homogénéité rend donc très difficile la détermination de l’origine de l’amphore. Néanmoins, la présence d’inclusions noires et d’oxydes de cou-leur rouge a été constatée pour l’ensemble des types, suite à l’observation macroscopique des pâtes. La grosseur et la quantité de ces éléments oscillent de faible à importante. Ils attestent l’existence de plu-sieurs groupes de pâtes. Des échantillons font actuel-lement l’objet d’analyses physico-chimiques par le laboratoire de céramologie de Lyon4.
4. LES AMPHORES
4.1. Comptages (fig.2 et 3)
L’inventaire des amphores importées rassemble 1118 individus dont une large majorité provient de Bé-tique (698 individus), mais également d’Orient (111 individus), d’Afrique (60 individus) et, dans des pro-portions moindres, d’Italie (36 individus), de Tar-raconaise (34 individus), de Lusitanie (2 individus) et d’Ibiza (12 individus). On comptabilise enfin 148 amphores dont l’origine n’est pas clairement établie. Les 1679 amphores gauloises constituent le volume le plus important. Parmi celles-ci, le type G.4, do-cumenté par 1110 exemplaires, est largement ma-joritaire avec 66,11 % du nombre total. Le dernier
fichier ÉDITEUR destiné à un usage privé
378 – faBriCe Bigot – david dJaoui
revue arChéologique de narBonnaise, tome 46, 2013
tiers se partage entre les types G.5 (11,55 %), G.2 (9,53 %), G.3 (5,06 %), G.1 (2,14 %), Dr.2/4 (1,79 %), Fréjus-Lenzbourg (0,18 %), Lyon 3B (0,12 %) et G.11 (0,12 %). Enfin, 3,40 % des individus ne peuvent pas être rattachés à un type. Cette catégorie regroupe à la fois les exemplaires indéterminés (3,40 %), ceux possédant des caractéristiques morphologiques liées à plusieurs types (0,01 %) et quelques indivi-dus atypiques (moins de 0,01 %).
Ces comptages mettent en évidence la domination des types produits à partir de la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C. (G.1 et G.5) ou de la période flavienne (G.4, Dr.7/11 lyonnaises type 3B, Fréjus-Lenz-bourg) (Laubenheimer 1985, 392 ; Laubenheimer 2001, 55, Desbat, Dangréaux 1997, 77 ; Laubenhei-mer et al. 1992, 19). En effet, ils constituent 80,10 % du nombre total d’amphores contre 16,38 % pour les productions fabriquées dès le début de l’époque ju-lio-claudienne (Dr.2/4, G.2, G.3) (Laubenheimer 1985, 385-386 ; Laubenheimer 2001, 53 ; Barbe-ran 2013, 266). Néanmoins, la forte proportion des amphores G.2 qui se répartissent dans l’ensemble des niveaux du dépotoir est remarquable et invite à prolonger la chronologie de ce type, qui est daté de la période julio-claudienne, dans le Haut-Empire (Mauné 2009, 37).
De la poix est systématiquement conservée sur la paroi interne des amphores, ce qui est caractéris-tique du conditionnement du vin ou des sauces et conserves de poisson (Lequément 1975, 181). La part des conteneurs destinés au transport des produits halieutiques (Fréjus-Lenzbourg, G.11 et Dr.7/11) est néanmoins anecdotique, loin derrière celle des am-phores vinaires (plus de 96 %)5.
4.2. Présentation des types d’amphores
Il convient maintenant de présenter, de façon synthé-tique, chacun des types en suivant leur ordre quantitatif.
4.2.1 Les amphores Gauloise 4Les G.4, représentées par 1110 amphores, se caracté-risent par la grande homogénéité de leur morpholo-gie générale, typique de ce modèle standardisé (Lau-benheimer 1989b, 132). Le col haut se termine par une lèvre en bourrelet, généralement bien marquée et parfois soulignée par un sillon. Leur diamètre os-cille entre 11,3 cm et 14,2 cm. Les anses sont fixées à mi-col et sur la partie supérieure de l’épaule. Elles possèdent un sillon médian. Le fond est, plat et annu-laire. Son diamètre mesure généralement entre 9 cm et 12 cm et, plus rarement, 14 cm. Le diamètre maxi-mum se situe environ aux deux tiers de la hauteur de l’amphore.
Deux modules de G.4 ont été identifiés à partir des exemplaires complets. Le conteneur de volume stan-dard est documenté par 10 amphores. Sa hauteur s’établit entre 59,8 cm et 66,6 cm et son diamètre maximum entre 38,4 cm et 42,4 cm (fig. 4 no 1). Ce dernier est situé à une hauteur comprise entre 35 cm et 40,2 cm. Un objet se démarque néanmoins de ce groupe en raison de son diamètre maximum faible (33 cm) (fig. 4 no 2). La variation de ces dimensions influe sur le volume de l’amphore qui a une capa-cité de 25,52 litres contre 37,6 litres pour les autres amphores, soit une différence de plus de 12 litres6 (fig. 5). Cette variabilité est due aux difficultés tech-niques liées au tournage d’une amphore G.4 (Lau-benheimer, Gisbert Santonja 2001, 37-39).
Une seule amphore complète demi-module est attes-tée (fig. 4 no 3). Elle possède une contenance de seu-lement 18,35 litres (fig. 5). Sa hauteur est de 50 cm et son diamètre maximum de 32,4 cm. Ce dernier est situé à 30 cm du fond de l’amphore. Le diamètre de sa lèvre est de 11,3 cm contre une valeur comprise entre 12,4 et 14,4 cm pour les amphores standards. Le diamètre du fond mesure 9,9 cm, dimension éga-lement observée sur les exemplaires standards. Il ne semble donc pas être un critère discriminant pour dé-finir la présence d’un module ou de son demi-mo-dule, contrairement à la hauteur, au diamètre maxi-mum de la panse et au diamètre de la lèvre.
Contenu Type NMI Pourcentage
Vin
G.1 36 2,14%G.2 160 9,53%G.3 85 5,06%G.4 1110 66,11%G.5 194 11,55%
Dr.2/4 30 1,79%
Salaisons et sauces de poissons
Fréjus-Len-zbourg 3 0,18%
G.11 2 0,12%Dr.7/11 2 0,12%
Indéterminé Indéter-miné 57 3,40%
Totaux 1679 100%
Figure 2 :Comptages des types
d’amphores.
Figure 3 :Diagramme de répartition des amphores gauloises par type.
fichier ÉDITEUR destiné à un usage privé
379étude préliMinaire des aMphores gauloises des fouilles de l’épave ArLeS-rhôNe 3 (arles, B.-du-rh.) (2e Moitié du ier s. – 1ère Moitié du iie s. ap. J.-C
RAN 46 – pp. 375-394
Figure 4 :Amphores G.4 (Ech. 1/5 – Dessins et DAO : F. Bigot).
fichier ÉDITEUR destiné à un usage privé
380 – faBriCe Bigot – david dJaoui
revue arChéologique de narBonnaise, tome 46, 2013
Les timbres
Quatorze des dix-sept estampilles recensées sont ap-posées sur des amphores G.4.
Neuf exemplaires du timbre A.P.M, en relief, sur anse, pour laquelle trois matrices sont connues (Lauben-heimer, Schmitt 2009, 117) ont été inventoriés. Les deux premières sont caractérisées par des triangles de ponctuation séparant chacune des lettres. Ces poinçons de 5,5 cm et 4,5 cm sont respectivement attestés par quatre (fig. 4 no 4) et trois marques (fig. 6 no 1). La troisième variante est caractérisée par des points qui séparent chacune des lettres (fig. 6 no 2). Comment interpréter la présence ici d’un nombre aussi important de timbres A.P.M ? Est-ce dû à la fonction de port fluvial d’Arles et à la présence, dans les entrepôts qui devaient exister à Trinquetaille, de grandes concentrations d’amphores en transit ? Ces timbres pourraient-ils appartenir à un atelier péri-ur-bain proche ce qui expliquerait leur nombre ?
Un col comporte, sur une de ses anses, un timbre S.P.S rétrograde, en creux dans un cartouche en re-lief (fig. 6 no 3). Une estampille T.V.P sur anse a éga-lement été mise au jour (fig. 6 no 4). Ses lettres, en relief, sont inscrites dans un cartouche rectangulaire. Un triangle est placé entre chacune d’entre elles. Deux marques sont placées sur le col. La première n’est que partiellement conservée (fig. 6 no 5). La gra-phie du P final et le triangle de ponctuation qui le précède permettent de proposer qu’il s’agit du timbre M.I.P. Proposition renforcée par le fait qu’il soit déjà documenté dans les fouille du cirque à Arles (Lau-
benheimer 1985, 430). La seconde, MFM (fig. 6 no 6), possède des lettres en relief et un cartouche rectan-gulaire.
Par ailleurs, trois estampilles sur anse, plate à sillon médian, doivent vraisemblablement être rattachées au type G.4, même si la lèvre n’est pas conservée. En effet, la marque C.M.S, en relief, (fig. 6 no 7) n’est attestée que sur ce type (Laubenheimer 1985, 428 ; Corbeel 2012, 381). C’est aussi le cas de T.CR.VIT, en relief, (fig. 6 no 8) (Corbeel, Duperron et coll. dans ce volume). L’estampille Q.C.H (fig. 6 no 9), en relief, est connue sur anse de G.1 (Laubenheimer, Schmitt 2009, 124-125) mais la section de l’anse ne corres-pond pas à ce type d’amphore et se rapproche plutôt de celle d’une G4.
Ces timbres renvoient à des citoyens romains dont le statut est clairement précisé par les initiales de tria nomina qu’il est malheureusement impossible d’identifier.
4.2.2 Les amphores Gauloise 5Les G.5 se reconnaissent par leur lèvre plate ou légè-rement inclinée vers l’extérieur, un diamètre maxi-mum situé légèrement au-dessus du milieu de l’am-phore et un fond à pied annulaire plat ou ombiliqué. Néanmoins, même s’il s’agit d’un type standardisé (Laubenheimer 1989b, 132), les 194 exemplaires de G.5 sont caractérisés par une certaine diversité mor-phologique. La hauteur du col varie, même s’il est, le plus souvent, haut. Par ailleurs, un tiers des G.5 ob-servées possède un anneau en relief situé au dessus de l’attache des anses. Celles-ci sont systématique-
Numéro d’inventaireDiamètre maxi-
mum(en cm)
Hauteur du diamètre maximum (en cm)
Hauteur (en cm)
Volume (en litres)
AR3-2031-7 39 37 64,6 30,71AR3-2031-7 39 37 64,6 30,71AR3-3007-32 42,4 36,3 59,8 34AR3-2029-47 39 40 66,6 31,48AR3-3029-61 38,4 36,5 61,7 28,88AR3-2001-71 40 35 64,5 37.60AR3-2031-7 39 37 64,6 30,71AR3-2031-7 39 37 64,6 30,71AR3-3007-32 42,4 36,3 59,8 34AR3-2029-47 39 40 66,6 31,48AR3-3029-61 38,4 36,5 61,7 28,88AR3-2001-71 40 35 64,5 37.60AR3-1001-14 41 37,5 64 33,3AR3-3001-86 41,8 35,5 63 35,51AR3-2004-12 41 40,2 63,8 35,46AR3-2019-2 33 36 60,5 25,52AR3-2031-5 40,5 36,2 59 31,63AR3-2001-47 32,4 30 50,5 18,35
Figure 5 :Volumes et dimensions des
amphores G.4.
fichier ÉDITEUR destiné à un usage privé
381étude préliMinaire des aMphores gauloises des fouilles de l’épave ArLeS-rhôNe 3 (arles, B.-du-rh.) (2e Moitié du ier s. – 1ère Moitié du iie s. ap. J.-C
RAN 46 – pp. 375-394
Figure 6 :Estampilles sur amphores G.4 (Ech. 1/5 – Estampilles Ech. 1 – Dessins et DAO : F. Bigot).
fichier ÉDITEUR destiné à un usage privé
382 – faBriCe Bigot – david dJaoui
revue arChéologique de narBonnaise, tome 46, 2013
ment plates avec un sillon médian bien incisé, ou plus rarement deux ou trois sillons.
Un volume standard et un demi-module ont été iden-tifiés à partir de cinq amphores complètes (fig.7). Le premier est représenté par deux amphores dont les diamètres maximum, situés à 32 cm et 37 cm de hau-teur, sont de 39 cm et 37 cm et les hauteurs totales de 60,5 cm et 66 cm (fig. 8 no 1). Elles possèdent un volume de 35,64 litres et 28,27 litres. Cet écart est comparable à celui observé sur les G.4. Par ailleurs, le diamètre de leur lèvre mesure 14,2 cm et 15,4 cm.
Le demi-module, documenté par deux exemplaires, comprend des objets d’une hauteur totale de 47,4 cm et 45,8 cm et d’un diamètre maximum de 27,2 cm et 30 cm, respectivement situés à 29, 2 cm et 24,5 cm de hauteur, (fig. 8 no 2) pour une contenance de l’ordre de 13 litres. Le diamètre de la lèvre est de 12,7 cm. L’un de ces conteneurs se distingue de l’aspect général du type G.5 par la hauteur de son diamètre maximum,
situé aux deux tiers de l’amphore. Les dimensions du fond ne semblent pas être un critère discriminant pour la définition d’un module. En effet, le diamètre d’une amphore, de module standard est équivalent à celui des demi-modules.
Enfin, c’est vraisemblablement à un quart de mo-dule de G.5 qu’il faut attribuer une amphore, d’un diamètre maximum de 26,4 cm, qui ne mesure que 36,3 cm (fig. 8 no 3). En effet, son volume est de 7,88 litres. En revanche, l’embouchure, de 13,8 cm, est supérieure à celles des autres G.5 demi-module. La pâte de cette amphore, calcaire de couleur beige foncé avec un abondant dégraissant composé de grosses particules de mica, d’inclusions blanches et noires est également caractéristique.
Sur les 70 amphores conservées et donc observées dans le détail, 15 ont une pâte dont la couleur est dénaturée par leur séjour dans les eaux du Rhône. Ce chiffre est proportionnellement important par rapport aux autres types d’amphores gauloises7. Cela semble attester l’exis-tence d’un atelier utilisant une argile calcaire plus fine.
4.2.3 Les amphores Gauloise 2La G.2 est abondamment représentée, avec 160 am-phores. Ce conteneur, qualifié d’amphore à lèvre à
double inflexion externe, se caractérise par un fond plat annulaire, des anses plates à un, deux ou trois sillons et un col bitronconique avec un anneau en relief au niveau de l’attache supérieure (Laubenhei-mer 1989b, 123-124). Celle-ci est située aux deux tiers du col. Ajoutons à ces détails morphologiques la présence d’une gorge interne prononcée et d’un col généralement haut, terminé par une lèvre en ban-deau à face externe concave. Comme l’a observé F. Laubenheimer, ce modèle s’inspire des productions marseillaises de la période augustéenne, dénommées Bertucchi 6a (ibid, 125 ; Bertucchi 1992, 101). Ce-pendant, la morphologie des G.2 est variée ce qui semble lié à une évolution résultant d’une produc-tion à grande échelle durant toute la période julio-claudienne. Ainsi, elles se distinguent effectivement par le nombre de sillons sur leurs anses, la forme de leur bord ou encore la hauteur de leur col. La face ex-terne de la lèvre peut être verticale ou déversée et son extrémité peut être en bourrelet ou davantage pincée. Qui plus est, certains objets ne possèdent pas d’anneau
en relief sur le col.
Six exemplaires complets8 permettent d’identifier trois modules (fig. 9). Le volume standard est documenté par quatre amphores (fig. 10 no 1) dont la hauteur est comprise entre 56,9 et 63,3 cm et le diamètre maxi-mum entre 37 et 40,2 cm. Ce dernier se situe environ à la moitié de la hauteur de l’amphore ou quelques centi-mètres au-dessus. Le diamètre de la lèvre oscille entre 13,3 cm et 13, 9 cm et celui du fond entre 13,5 cm et 14,3 cm. La contenance est également variable avec un écart de moins de huit litres (entre 25,78 et 33,65 litres).
Le demi-module (fig. 10 no 2) est représenté par une amphore de 45,8 cm de haut. Son diamètre mesure 31 cm. Il est situé 2 cm au dessus du milieu de l’am-phore. En outre, cette G.2 se caractérise par un grand écart entre les diamètres du fond et de la lèvre dont les dimensions sont respectivement de 10,5 cm et de 14,9 cm. Son volume est de 13,51 litres.
Enfin, une amphore (fig. 10 no 3), de 37,5 cm de haut, possède un diamètre maximum de 25,5 cm. Il s’agit d’un quart de module d’une capacité de 7,45 litres. Notons, en revanche, que le diamètre du bord, de 14 cm, est aussi équivalent à celui des exemplaires de grand module. Par ailleurs, ses
Numéro d’inventaireDiamètre maximum(en cm)
Hauteur du dia-mètre maximum
(en cm)
Hauteur (en cm)
Volume (en litres)
AR3-3002-13 39 32 60,8 35,64AR3-2018-5 37 37 66,5 28,27AR3-2029-50 27,2 29,2 47,4 12,65AR3-2001-33 30 24,5 45,8 13,57AR3-3019-75 26,4 17,5 36,3 7,88
Figure 7 :Volumes et dimensions des
amphores G.5.
fichier ÉDITEUR destiné à un usage privé
383étude préliMinaire des aMphores gauloises des fouilles de l’épave ArLeS-rhôNe 3 (arles, B.-du-rh.) (2e Moitié du ier s. – 1ère Moitié du iie s. ap. J.-C
RAN 46 – pp. 375-394
Figure 8 :Amphores G.5 (Ech. 1/5 – Dessins et DAO : F. Bigot).
Figure 9 :Volumes et dimensions des amphores G.2.
Numéro d’inventaireDiamètre maxi-
mum(en cm)
Hauteur du dia-mètre maximum
(en cm)
Hauteur (en cm)
Volume (en litres)
AR3-2032-4 39,1 31 63,3 33,65AR3-2011-1 38 37 63 29,83AR3-1011-1 40,2 Indéterminée Indéterminée IndéterminéAR3-1020-3 37 31,5 56,9 25,78
AR3-4001-16 31 25,5 45,8 13,51AR3-2001-127 25,8 26,5 37,5 7,45
fichier ÉDITEUR destiné à un usage privé
384 – faBriCe Bigot – david dJaoui
revue arChéologique de narBonnaise, tome 46, 2013
anses sont fixées juste sous la lèvre et deux sillons sont tracés sur leur face supérieure.
Bien que le volume de l’amphore ne semble pas lié au diamètre de la lèvre, des cols se caractérisent par une embouchure étroite, de l’ordre de 9 ou 10 cm (fig. 10 no 4). Elle paraît trop faible pour une amphore gau-
Figure 10 :Amphores G.2 (Ech. 1/5 – Dessins et DAO : F. Bigot).
fichier ÉDITEUR destiné à un usage privé
385étude préliMinaire des aMphores gauloises des fouilles de l’épave ArLeS-rhôNe 3 (arles, B.-du-rh.) (2e Moitié du ier s. – 1ère Moitié du iie s. ap. J.-C
RAN 46 – pp. 375-394
loise d’une soixantaine de centimètres. Il semble s’agir d’autres exemplaires de demi ou de quart de module.
Un objet (fig. 10 no 5) est caractérisé par une pâte de couleur rouge et un pseudo-engobe blanc. Il contient un dégraissant moyennement abondant constitué de fines paillettes de mica et de grains blancs et noirs de taille moyenne. Il pourrait être originaire de la région de Fréjus.
4.2.4 Les amphores Gauloise 3La G.3, documentée par 85 amphores, possède une lèvre à double inflexion externe et, généralement, un anneau en relief au niveau de l’attache supérieure des anses. Son fond est plat, annulaire et large. Par ailleurs, les anses sont également plates avec deux ou trois sillons. La G.3 se distingue cependant de la G.2 par l’absence de gorge interne et par un col plus court. Il semble également que les anses soient fixées plus haut, juste sous la lèvre. De plus, le diamètre maximum se situe quelques centimètres au-dessus de la moitié de l’amphore.
Deux amphores complètes attestent l’existence de deux modules de G.3. L’amphore de contenance stan-dard, soit 32,61 litres, (fig. 11 no 1) possède un dia-mètre maximum de 38 cm, situé à 36 cm, et une hau-teur de 65,2 cm. Pour le demi-module (fig. 11 no 2), le diamètre maximum, sa hauteur et la hauteur totale sont respectivement de 33 cm, 24 cm et 44,5 cm. La contenance de cette amphore est de 15,57 litres. Pour-tant, le diamètre de la lèvre mesure 14,7 cm, pour une de ces amphores, et 14,9 cm pour l’autre. Cela montre que ce critère morphologique ne permet pas de dé-finir le module d’une G.3. La même remarque s’ap-plique également au diamètre du fond, dont l’écart est inférieur à un centimètre entre les deux modules.
4.2.5 Les amphores Gauloise 1La morphologie de 36 amphores est caractéristique de la G.1 standardisée produite à partir du milieu du Ier s. ap. J.-C. (Laubenheimer 1985, 243 ; Laubenhei-mer 1989b, 132). Elles possèdent une lèvre de section triangulaire sous laquelle l’attache supérieure des anses est fixée. Celles-ci sont plates et portent deux sillons. Le col est court et le diamètre maximum se situe à mi-panse. Par ailleurs, plusieurs fonds plats à pied annulaire sont rattachés à ce modèle. Ils se caractérisent par la largeur de leur pied qui est bien supérieure à celle des autres formes d’amphores gau-loises à fond plat.
Deux modules ont été identifiés. L’exemplaire de contenance standard le mieux conservé est un col (fig. 11 no 3). Le diamètre maximum de la panse de ce dernier est de 42 cm et celui de la lèvre de 14,8 cm. Par ailleurs, sa hauteur totale devait être de 50 cm environ, taille de l’amphore standard (Laubenhei-
mer 1985, 244). Le demi-module est documenté par une amphore complète (fig. 11 no 4). Sa hauteur et son diamètre maximum sont respectivement de 32 cm et 40 cm. Son volume est de 15,82 litres. De plus, le dia-mètre de la lèvre est de 14,6 cm. Ainsi, comme pour les G.3, il ne semble pas s’agir d’un critère discrimi-nant pour définir le module d’une G.1.
Deux groupes de pâtes bien distincts sont identi-fiables. Le premier regroupe 31 individus à pâte cal-caire. Ils sont produits dans toute la Narbonnaise de-puis la Provence jusqu’aux vallées de l’Aude, de l’Orb et de l’Hérault en passant par la vallée du Rhône (Laubenheimer, Schmitt 2009, 22 ; Mauné 2009, 38-41). Six G.1 présentent une pâte kaolinitique sableuse de couleur blanchâtre, rosée ou orangée. Elles sont originaires de la partie rhodanienne du département du Gard (Laubenheimer, Schmitt 2009, 20).
Une estampille EPPI sur col de G.1 à pâte sableuse kaolinitique a été mise au jour (fig. 11 no 5). Les lettres de celle-ci sont en relief dans un cartouche rectan-gulaire. Notons, par ailleurs, qu’un seul timbre de ce type, retrouvé à Nîmes sur une G.1 gardoise, était jusqu’à présent répertorié (Laubenheimer 1985, 423).
4.2.6 Les amphores Dressel 2/4Trente Dr.2/4 se caractérisent par leur variabilité morphologique. Le bord peut former un bourrelet plus ou moins massif ou triangulaire. Le col est géné-ralement bitronconique et plus rarement tronconique ou cylindrique. Quant aux anses, elles peuvent être coudées ou non avec parfois une protubérance sur la partie sommitale. Elles sont bifides ou simplement incisées par un sillon sur la face externe. Le diamètre des lèvres est également très variable avec des me-sures qui oscillent entre 12,2 cm et 18,4 cm.
Cette variété morphologique est illustrée par trois amphores presque entières. La première (fig. 12 no 1) possède un diamètre maximum de 31 cm situé à mi-panse. La distinction entre sa panse et son épaule est peu marquée. L’attache inférieure des anses se fixe à ce niveau. Le diamètre maximum des deux autres se situe au niveau d’une carène très marquée formant la séparation entre l’épaule et la panse. Elles se distin-guent néanmoins par l’aspect massif, l’épaule courte et le col cylindrique de la première (fig. 12 no 2) qui s’oppose à l’aspect plus fuselé, l’épaule longue et au col tronconique de la seconde (fig. 13 no 1). Notons, par ailleurs, que la forme de cette dernière est très proche de celle des Dr.2/4 produites dans l’atelier de Saint-Cassien à Cannes (Laubenheimer 1989b, 121).
4.2.7 L’amphore Fréjus-LenzbourgTrois cols de type Fréjus-Lenzbourg (fig. 13 no 2) pos-sèdent une lèvre plate inclinée vers l’extérieur avec un ressaut sur la face inférieure pour l’un d’entre
fichier ÉDITEUR destiné à un usage privé
386 – faBriCe Bigot – david dJaoui
revue arChéologique de narBonnaise, tome 46, 2013
Figure 11 :Amphores G.3 : 1-2 ; G.1 : 3-5 (Ech. 1/5 – Estampilles Ech. 1 –
Dessins et DAO : F. Bigot).
fichier ÉDITEUR destiné à un usage privé
387étude préliMinaire des aMphores gauloises des fouilles de l’épave ArLeS-rhôNe 3 (arles, B.-du-rh.) (2e Moitié du ier s. – 1ère Moitié du iie s. ap. J.-C
RAN 46 – pp. 375-394
eux. Les anses sont plates avec un ou deux sillons. Elles sont fixées à mi-col et sur la partie supérieure de l’épaulement. Ce dernier est très évasé. Le dia-mètre de sa lèvre mesure 13 cm, ce qui est faible pour ce modèle.
Ces amphores sont probablement originaires de l’of-ficine de Sainte-Croix à Fréjus, qui produit ce type à partir de la période flavienne. La description de la pâte, beige clair en surface, rose brun/rouge au cœur avec un dégraissant de sable fin plus ou moins abon-dant, est comparable à celle des exemplaires foroju-
liens (Brentchaloff 1988, 181-182, Laubenheimer et al. 1992, 19).
4.2.8 Les amphores Gauloise 11Deux G.11 semblent avoir été découpées au niveau du fond pour l’une et du col pour l’autre. Ce sont des amphores fuselées dont la taille est proche de 60 cm (Laubenheimer 1989b, 131). Leur diamètre maximum, de 16,5 cm (fig. 13 no 3) et 13,7 cm (fig. 13 no 4), se situe au niveau de l’attache infé-rieure des anses juste au dessus d’une carène, plus ou moins marquée, formée par l’épaulement. Le
Figure 12 :Amphores Dr.2/4 (Ech. 1/5 – Dessins et DAO : F. Bigot, A. Véléva).
fichier ÉDITEUR destiné à un usage privé
388 – faBriCe Bigot – david dJaoui
revue arChéologique de narBonnaise, tome 46, 2013
col est bitronconique avec un diamètre minimum situé au niveau de l’attache supérieure des anses. Celles-ci sont coudées, de section plate avec un sillon médian. L’embouchure, évasée, se termine par une lèvre moulurée. La seule originalité est
liée à la présence d’un fond creux pour l’un des individus. Au reste, l’aspect général des deux G.11 est différent puisque l’une possède un fond pointu tandis que l’autre est davantage fuselée.
Figure 13 :Amphores Dr.2/4 : 1 ; Fréjus-Lenzbourg : 2 ; G.11 : 3-4 ;
Dr.7/11 : 5 (Ech. 1/5 – Dessins et DAO : F. Bigot, A. Véléva).
fichier ÉDITEUR destiné à un usage privé
389étude préliMinaire des aMphores gauloises des fouilles de l’épave ArLeS-rhôNe 3 (arles, B.-du-rh.) (2e Moitié du ier s. – 1ère Moitié du iie s. ap. J.-C
RAN 46 – pp. 375-394
Ces G.11 se distinguent également par leur pâte. La pre-mière est calcaire de couleur beige et contient un dégrais-sant abondant composé de fines inclusions blanches, de particules de mica et de gros grains rouges et noirs. La seconde est également calcaire mais sa pâte est dénatu-rée en surface et jaunâtre au cœur. Elle est plus fine que la précédente. De plus, elle possède de petites inclusions rouges, de mica et des grains blancs petits ou moyens. Ces différences mettent en évidence l’existence d’au moins deux ateliers produisant ce modèle alors que seule l’officine de Mandelieu est actuellement connue (ibid).
4-2-9 Les amphores Dr.7/11 - Lyon 3BLes amphores de type Dr.7/11, documentées par deux individus (fig. 13 no 5), possèdent un col bitronconique à embouchure évasée et lèvre saillante horizontale et lé-gèrement pendante. Les anses sont fixées aux deux tiers du col et sur la partie supérieure de l’épaule. Elles sont plates et comportent deux sillons. Ces formes se rappro-chent du type Lyon 3B produit à partir de la période fla-vienne (Desbat, Dangréaux 1997, 77).
Elles possèdent toutes deux une pâte calcaire. L’une d’elle est dénaturée. Néanmoins, un abondant dégrais-sant composé de grosses inclusions blanches, noires et de particules de mica a été observé. Cette amphore semble être lyonnaise puisque sa pâte possède le même aspect que celles des amphores produites dans la capi-tale des Gaules (Maza et al. 2002, 280).
5. CONCLUSION
Le lot de 1679 amphores gauloises, le plus important connu à ce jour dans un dépotoir portuaire de Gaule Narbonnaise, apporte des données concrètes sur le com-merce des denrées transportées en amphores gauloises entre le milieu du Ier s. et le milieu du IIe s. Par ailleurs il renseigne sur le rôle d’Arles dans leur distribution.
Les G.4, destinées au grand commerce (Laubenheimer 2001, 55), sont prédominantes comme dans d’autres dé-potoirs flaviens de l’axe rhodanien tels ceux du Bas-de-Loyasse à Lyon (Dangréaux, Desbat 1987, 117) ou de l’Estagnon à Fos-sur-Mer (Marty, Zaaraoui 2009). De la même manière les G.1, destinées au commerce ré-gional, sont rares sur tous ces sites (Dangréaux, Desbat 1987, 123 ; Liou, Sciallano 1989, 158). Cela confirme la place d’Arles dans le grand commerce vers la Méditer-ranée et le limes germanique.
Les sept amphores à salaisons et sauces de poissons, Dr.7/11 lyonnaises ou encore Fréjus-Lenzbourg té-moignent également de ce fait, même si leur nombre est anecdotique. En effet, ces modèles sont destinés à la commercialisation de dérivés de poissons vers les « camps » du limes, où ils sont représentés par quelques exemplaires (Laubenheimer 2004, 155 ; Brentchaloff 1989, 183, Baudoux 1992, 166).
Le port d’Arles est une plaque tournante du trafic des denrées commercialisées en amphores depuis les provinces de Méditerranée et destinées au nord-est de la Gaule et à la Bretagne (Christol, Fiches 1999, 154 ; Long et al. 2006 ; en dernier lieu Long, Duper-ron 2013). Notre lot d’amphores gauloises prouve que le vin de Narbonnaise est également en partie ras-semblé à Arles pour être expédié. Pour ce dernier, il existe plusieurs courants ; les amphores de basse Provence, dont la présence est attestée par les G.5, sont très certainement distribuées vers Lyon et les limes germaniques et britanniques. Les amphores du Languedoc occidental ont probablement la même di-rection septentrionale. Les amphores de la moyenne et de la basse vallée du Rhône peuvent être com-mercialisées vers la Méditerranée et Rome ou bien vers Lyon et les limes. À la marge, il y a bien évi-demment des choses plus complexes, comme la part des amphores destinées à la consommation urbaine. Les G.1 à pâte kaolinitique, du nord-est de la cité de Nîmes, peuvent être un des témoins de ce phéno-mène puisqu’elles sont destinées au commerce régio-nal (Laubenheimer 2001, 55).
La présence anecdotique d’amphores à dérivés de pois-sons de la région de Fréjus se justifie par la localisation de cette colonie sur un axe du grand commerce. En effet, loin d’égaler l’importance économique des ateliers de sa-laisons de la péninsule ibérique9 , les produits à base de poissons forojuliens devaient être embarqués comme compléments de cargaisons dans les navires qui distri-buaient les amphores de cette cité ou dans ceux qui fai-saient escale par Fréjus avant de rejoindre Arles.
La concentration des estampilles A.P.M montrent peut-être aussi qu’Arles était un centre de production d’amphores. Bien que l’absence de surcuit semble in-diquer que l’atelier n’était pas situé sur les rives du Rhône, il se situait probablement à proximité. L’em-placement du dépotoir pourrait alors correspondre à la zone de conditionnement du vin local ou, du moins, de chargement des amphores arlésiennes. L’existence d’une seconde officine locale est peut-être attestée par la marque T.CRVIT (Corbeel, Duperron et coll., dans ce volume). On ignore également l’origine des autres timbres. De récentes analyses physico-chi-miques ont démontré que les timbres C.M.S et Q.C.H étaient rhodaniens (Laubenheimer, Schmitt 2009, 154). En Narbonnaise, M.I.P est documenté seule-ment à Arles (Corbeel, Duperron et coll, dans cet ou-vrage). T.V.P est attesté à Arles (Laubenheimer 1985, 433), dans le golfe de Fos (Amar, Liou 1984, 195) et à Toulon (Brun et al. 1992, 129 ; Brun 1999, 793), mais la localisation des officines qui les ont produites est inconnue. C’est aussi le cas pour S.P.S, dont une autre occurrence est connue à Arles (Corbeel, Du-perron et coll., dans ce volume), et MFM qui n’est pas attesté ailleurs.
fichier ÉDITEUR destiné à un usage privé
390 – faBriCe Bigot – david dJaoui
revue arChéologique de narBonnaise, tome 46, 2013
L’existence d’officines arlésiennes pourrait justifier la part importante des G.2 (10 %) au sein du dépotoir. La diffusion de ce modèle ralentit au moment où les G.4 commencent à être commercialisées. Dans le dépotoir flavien du Bas-de-Loyasse à Lyon, par exemple, une seule lèvre peut être assimilée à ce type (Dangréaux, Desbat 1987, fig.11 no 9). Aucune n’est dénombrée dans le vide sanitaire flavien de la place Bellecour à Lyon (Burnouf, Laubenheimer 1998, 180 ; 186) ou dans ce-lui de la bonification de l’Estagnon à Fos-sur-Mer daté des années 65-85 ap. J.-C. (Marty, Zaaraoui 2009, 399). Elles sont également inconnues à Rome sur les sites de la Meta Sudans (130-150 ap. J.-C.), Via Nova-Cli-vo Palatino (64-68 ap. J.-C.), Crypta Balbi (80-90 ap. J.-C.), Curia-Forum Iulium – Foro Transitorio (80-98 ap. J.-C) et Via Sacra-Via Nova (90-110 ap. J.-C) (Panella 1992, 190-199). Cette spécificité arlésienne pourrait donc témoigner du fait que la production des G.2. se poursuit durant la période flavienne pour un commerce régional. On ne peut pas non plus exclure un effet de source. En effet, la mise en place du dépo-toir débutant dans les années 60 ap. J.-C, ces G.2 pour-raient être les témoins du commerce du vin avant la création du modèle G.4. Le dépotoir montrerait alors la phase de transition G2/G4.
Les G.2 ont également pu être destinées à la com-mercialisation de vin de meilleure qualité complé-tant en cela celui conditionné dans les G.4. La G.2. dérive en effet de l’amphore de Marseille qui produit, d’après Pline, le meilleur vin « entre les Pyrénées et les Alpes » (N.H.XIV, 68). La morphologie de cette am-phore pouvait donc être, pour le consommateur, l’indi-cation d’un vin de qualité. Cette hypothèse est étayée par l’existence de demi et de quart de module de G.2. Ces derniers représentent 33 % des amphores com-plètes de ce type contre seulement 9 % pour les G.4. En Méditerranée, peu de modèles possèdent un tel pa-nel de modules. Il s’agit dans la plupart des cas d’am-phores orientales comme les Crétoises (Marangou 1995, 71 ; 78 ; 93-94). Or ces dernières transportent du vin de qualité supérieure, en particulier celles de pe-tit module (ibid, Lemaître 1995, 203-205). Ces obser-vations s’appliquent également aux G.5, pour lesquels 60 % des amphores complètes sont des demis ou des quarts de module. Le conditionnement de « crus su-périeurs » dans ce type peut expliquer pourquoi il est systématiquement présent sur les sites de consomma-tions du limes ou à Rome, mais dans de faibles pro-portions (Panella 1992, 197-199). Elles ne représentent que 19,5 % des amphores vinaires gauloises du dépo-toir du Bas-de-Loyasse à Lyon contre 72,2 % pour les G.4 (Dangréaux, Desbat 1987, 148). Dans le nord-est de la Gaule les pourcentages sont respectivement de 2,6 % et 84,2 % (Baudoux 1992, 164)
Au reste, les G.1 et les G.3 possèdent également un de-mi-module. Etait-il destiné au conditionnement de vin
de qualité supérieure ? Pour l’ensemble des types les différents modules ont sensiblement la même conte-nance. Ainsi le module standard est en moyenne de 31,87 litres avec une étendue des volumes comprise entre 25,52 litres et 37,6 litres. Le demi-module à une contenance moyenne 14,91 litres avec un écart compris entre 12,65 litres et 18,35 litres. Enfin, le quart de mo-dule contient 7,67 litres ± 0,20 litres. Ils ont donc respec-tivement une contenance moyenne de 58 setiers, 27 setiers et 14 setiers en prenant en compte les chiffres de 4 modii pour 64 setiers pour 35 litres (Brentchaloff 1988, 185).
L’étude des mobiliers en stratigraphie permettra de pré-ciser la chronologie de chaque type. Cela permettra de définir si les modèles julio-claudiens, en particulier les G.2, sont diffusés à Arles dans des niveaux contempo-rains ou postérieurs à la période flavienne ou s’ils sont les témoins d’un commerce antérieur. Par ailleurs, les ana-lyses de pâtes en cours permettront de préciser la pro-venance des amphores. La part des productions locales, des amphores destinées aux centres de consommation méditerranéens ou à ceux de la vallée rhodanienne (au nord d’Arles) et aux camps des limes germanique et bri-tannique sera établie.
Il conviendra de compléter ces données en y ajoutant celles recueillies sur le gisement A, lors des fouilles des années précédentes (Long 1998, Long et al. 2006). Cette partie du dépotoir sera ensuite mise en perspec-tive avec les autres contextes, datés de la seconde moitié de IIe s. au IVe s. ap. J.-C. (Long, Duperron 2011, 2013) et avec les contextes urbains (Valente 2009, étude iné-dite G. Duperron, F. Bigot). Grâce à ces travaux, la place d’Arles dans la production et la diffusion des amphores gauloises sera plus précisément établie. Nous serons en mesure de déterminer l’évolution du flux de celles-ci du-rant leur période de commercialisation mais aussi, grâce aux analyses de pâtes, la part de chaque région de Nar-bonnaise dans ce commerce.
Au terme de cet article, il nous est agréable de remercier pour leurs avis et relectures M.-B. Carre, F. Laubenheimer et S. Mauné
Fabrice Bigot ASM-Archéologie des Sociétés Méditerranéennes, UMR5140, Univ Montpellier 3, CNRS, MCC, F-34000, Montpellier, France
Doctorant à l’Université Paul Valéry – Montpellier 3
David Djaoui, Archéologue territorial au musée départemental de
l’Arles antique, Conseil général des Bouches-du-Rhône.
fichier ÉDITEUR destiné à un usage privé
391étude préliMinaire des aMphores gauloises des fouilles de l’épave ArLeS-rhôNe 3 (arles, B.-du-rh.) (2e Moitié du ier s. – 1ère Moitié du iie s. ap. J.-C
RAN 46 – pp. 375-394
◤ Notes de commentaire
1. Cette recherche est menée dans le cadre d’une thèse en cours à l’Université Montpellier III, intitulée « Nouvelles données, nouvelles réflexions sur les am-phores gauloises à partir de contextes portuaires de Gaule Narbonnaise (Ier s. av.
– IVe s. ap.) » , et dirigée par S. Mauné et F. Laubenheimer (co-dir, Université Paris X-Nanterre-ARSCAN).
2. Parmi les formes les plus fréquentes, le bol Drag. 37 est omniprésent, notam-ment pour les décorateurs flaviens Mercator, Biragillus et Germanus. Les assiettes Drag. 18, associées aux types Drag. 27, 29 et 33, complètent le service flavien. Concernant les parois fines de Bétique, les formes les plus récurrentes sont les types Mayet 37, 38 et 42.
3. Le diagramme stratigraphique, établi par Mourad El Amouri (Ipso Facto), repose sur un zonage artificiel, aussi bien horizontal, entre l’amont et l’aval du chaland, ou encore la berge et le chenal, que vertical, comme les tranchées latérales pour installer le berceau métallique du levage.
4. Analyses rélaisées par A. Schmitt, Directrice de la Maison de l’Orient Méditer-ranéen, CNRS, Université Lyon Lumière 2.
5. certaines Dr.2/4, produites à Fréjus, ont pu conditionner des sauces de poissons (Laubenheimer et al. 1992, 19).
6. Le volume des amphores a été calculé à l’aide du logiciel Archéo 4 disponible sur http:/sfecag.free.fr/. La contenance indiquée correspond à une amphore pleine à ras bord, afin de faciliter les comparaisons.
7. Il est de 21 % pour les G.5 contre 5 % pour les G.4 ;
8. Le fond d’une de ces amphores n’est pas conservé. Cela empêche de calculer sa contenance, mais pas de déterminer qu’il s’agit d’un module standard.
9. Au sein du dépotoir, 332 amphores à sauces et salaisons de poissons en prove-nance de Bétique ont été comptabilisées contre 2 de Fréjus.
fichier ÉDITEUR destiné à un usage privé
392 – faBriCe Bigot – david dJaoui
revue arChéologique de narBonnaise, tome 46, 2013
◤ Références bibliographiques
sources anciennes et travaux universitaires
Pline l’Ancien : PLINE L’ANCIEN, Histoire Naturelle. Livre XIV, traduit et commenté par ANDRE (J.), Belles Lettres, Paris, 1958.
Corbeel 2012 : CORBEEL (S.) – Inventaire des timbres sur terres cuites architecturales et sur amphores gauloises du Midi de la France (Ier s. av.-Ve s. ap. J.-C.). Etude préliminaire. Mémoire de Master 2 d’Archéologie de l’Université de Montpellier III, Montpellier-Lattes, juin 2012, 607p. Inédit.
Articles et monographies publiés
Amar, Liou 1984 : AMAR (G.), LIOU (B.) – Les estampilles sur amphores du golfe de Fos. Ar-chaeonautica, 4, 1984, p. 145-211.
Baudoux 1992 : BAUDOUX (J.) – La circulation des amphores dans le Nord-Est de la France. In : LAUBENHEIMER (F.) dir. – Les amphores en Gaule, production et circulation. Vol.1, PUFC, Paris, 1992, p. 163-196.
Barberan 2013 : BARBERAN (S.) – Mutations économiques et culturelles à Nîmes au début du Haut-Empire. L’apport du mobilier céramique. MAM, 33, Lattes, 2013.
Bertucchi 1992 : BERTUCCHI (G.) – Les amphores et le vin de Marseille (VIème s. av. J.-C.-IIème s. ap. J.-C.). RAN Suppl. 25, CNRS Edi-tions, Paris, 1992.
Brentchaloff 1988 : BRENTCHALOFF (D.) – L’am-phore à saumure de type Fréjus-Lenzbourg. SFE-CAG, Actes du Congrès d’Orange, 1988, p. 179-186.
Brun 1999 : BRUN (J.-P.) – Carte archéologique de la Gaule. Le Var. 2 vol., Académie des inscrip-tions et Belles-lettres, Paris, 1999.
Brun 2005 : BRUN (J.-P.) – Archéologie du vin et de l’huile en Gaule romaine, Errance, Paris, 2005.
Brun et◤al. 1992 : BRUN (J.-P.), LECACHEUR (P.), PASQUALINI (M.) – Les amphores du port antique de Toulon (Telo Martius). In : LAUBENHEIMER (F.) dir. – Les amphores en Gaule. Production et circulation. Vol.1, PUFC, Paris, 1992, p. 123-131.
Brun, Laubenheimer 2001 : BRUN (J.-C.), LAU-BENHEIMER (F.) – Conclusions. Gallia, 28, 2001, p. 203-219.
Burnouf, Laubenheimer 1998 : BURNOUF (J.), LAUBENHEIMER (F.) – Des vides sanitaires, Place Bellecour à Lyon. In : LAUBENHEIMER (F.) dir. – Les amphores en Gaule. Production et circulation. Vol.2, PUFC, Paris, 1998, p. 175-192.
Christol, Fiches 1999 : CHRISTOL (M.), FICHES (J.-L.) – Le Rhône : batellerie et commerce dans l’Antiquité. Gallia, 56, 1999, p. 141-155.
Dangréaux, Desbat 1987 : DANGREAUX (B.), DESBAT (A.) – Les amphores du dépotoir fla-vien du Bas-de-Loyasse à Lyon. Gallia, 45, 1987, p. 115-153.
Desbat, Dangréaux 1997 : DESBAT (A.), DAN-GREAUX (B.) – La production d’amphores à Lyon. Gallia, 54, 1997, p. 73-104.
Djaoui et◤al.◤2011 : DJAOUI (D.), GRECK (S.), MARLIER (S.) – Arles Rhône 3. Le naufrage d’un chaland antique dans le Rhône, enquête pluridisciplinaire. Actes Sud – Musée Départe-mental Arles Antique, Arles, 2011.
Djaoui, Martin, à paraître : DJAOUI (D.), MAR-TIN (Th.) – Mobilier de bord et cargaison du chaland gallo-romain Arles Rhône 3. In : Marlier (S.) dir. – Arles-Rhône 3. Un chaland gallo-romain du Ier s. apr. J.-C. (Archaeonautica 18). CNRS Editions – Musée départemental Arles antique, Arles, à paraître.
Laubenheimer 1985 : LAUBENHEIMER (F.) – La production des amphores en Gaule Narbonnaise. Les Belles Lettres, Paris, 1985.
Laubenheimer 1989a : LAUBENHEIMER (F.) – Les amphores. In : FICHES (J.-L.) dir. – L’Op-pidum d’Ambrussum et son territoire : fouilles au quartier du Sablas, Villetelle, Hérault 1975-1985, CNRS, Paris, 1989, p.121-128.
Laubenheimer 1989b : LAUBENHEIMER (F.) – Les amphores gauloises sous l’Empire : re-cherches nouvelles sur leur production et leur chronologie. In : Amphores romaines et Histoire économique : dix ans de recherche, Actes du colloque de Sienne (22-24 mai 1986), Ecole fran-çaise de Rome, Rome, 1989, p. 105-138.
Laubenheimer 2001 : LAUBENHEIMER (F.) – Le vin gaulois de Narbonnaise exporté dans le monde romain sous le Haut-Empire. In : LAU-BENHEIMER (F.) dir. – 20 ans de recherches à Sallèles d’Aude. PUFC, Besançon, 2001, p. 51-66.
Laubenheimer et◤al.◤1992 : LAUBENHEIMER (F.), avec la coll. de GEBARA (Ch.), BERAUD (I.) – Production d’amphores à Fréjus. In : LAU-BENHEIMER (F.) dir. – Les amphores en Gaule. Production et circulation. Vol.1, PUFC, Paris, 1992, p. 15-24.
Laubenheimer, schwaller, Vidal 1992 : LAU-BENHEIMER (F.), SCHWALLER (M.), VIDAL (L.) – Nîmes les amphores de la rue des Condé. In : LAUBENHEIMER (F.) dir. – Les amphores en Gaule, production et circulation. Vol.1, PUFC, Paris, 1992, p. 133-150.
Laubenheimer, Gisbert santonja 2001 : LAU-BENHEIMER (F.), GISBERT SANTONJA (J.-A) – La standardisation des amphores Gauloise 4, des ateliers de Narbonnaise à la production de
Denia (Espagne). In : LAUBENHEIMER (F.) dir. – 20 ans de recherches à Sallèles d’Aude, PUFC, Besançon, 2001, p. 33-50.
Laubenheimer, schmitt 2009 : LAUBENHEIMER (F.), SCHMITT (A.) – Amphores vinaires de Narbonnaise, Production et grand commerce. Création d’une base de données géochimiques des ateliers. Maison de l’Orient et de la Méditer-ranée, Lyon, 2009.
Lemaître 1995 : LEMAITRE (S.) – Les importa-tions d’amphores orientales à Lyon de l’époque d’Auguste au début du IIIe siècle après J.-C. : étude préliminaire. SFECAG, Actes du congrès de Marseille, 1995, p. 195-205.
Lequément 1975 : LEQUEMENT (R.) – Une épave du Bas-Empire dans la baie de Pampelonne. RAN, 1975, p. 177-188.
Liou, sciallano 1989 : LIOU (B.), SCIALLIANO (M.) – Le trafic du port antique de Fos dans l’Antiquité : essai d’évaluation à partir des am-phores. SFECAG, Actes du Congrès de Lezoux, 1989, p. 153-167.
Long 1998 : LONG (L.) – Inventaire des amphores du Rhône à Arles (Bouches-du-Rhône), un aspect des échanges à l’époque impériale. SFE-CAG, Actes du congrès d’Istres, 1998, p. 85-95.
Long 2009 : LONG (L.) – De la mer au fleuve : les ports antiques d’Arles. In : LONG (L.), PICARD (P.) dir. – César. Le Rhône pour mémoire. Actes Sud-Musée départementale Arles Antique, Arles, 2009, p. 30-43.
Long, Duperron 2011 : LONG (L.), DUPERRON (G.) – Le mobilier de la fouille de l’épave romaine Arles-Rhône 7. Un navire fluvio-mari-time du IIIe s. de notre ère. SFECAG, Actes du congrès d’Arles, 2011, p. 37-56.
Long, Duperron 2013 : LONG (L.), DUPERRON (G.), avec la coll. de BONIFAY (M.), CAPELLI (C.), DESBAT (A.), LEGER (C.) – Navigation et commerce dans le delta du Rhône : l’épave Arles-Rhône 14 (IIIe s. ap. J.-C.). In : MAUNE (S.), DUPERRON (G.) dir. – Aspects de la Vie Matérielle en Gaule Narbonnaise, II. Editions Monique Mergoil, Montagnac, p. 125-167
Long et◤al. 2006 : LONG (L.), PITON (J.), DJAOUI (D.) – Le dépotoir portuaire d’Arles sous le Haut-Empire. Fouilles subaquatiques du Rhône, Gisement A (Ier-IIe s. apr. J.-C.). SFECAG, Actes du Congrès de Pézenas, 2006, p. 579-588.
Marangou 1995 : MARANGOU (A.) – Le vin et les amphores de Crète de l’époque classique à l’époque impériale. Ecole française d’Athènes, Athènes, 1995.
Mauné 2009 : MAUNE (S.) – Recherches récentes sur les ateliers de potiers de Gaule Narbonnaise.
fichier ÉDITEUR destiné à un usage privé
393étude préliMinaire des aMphores gauloises des fouilles de l’épave ArLeS-rhôNe 3 (arles, B.-du-rh.) (2e Moitié du ier s. – 1ère Moitié du iie s. ap. J.-C
RAN 46 – pp. 375-394
◤ Références bibliographiques
Contribution à l’histoire socio-économique d’une province romaine. Ier s. av.-IIIe s. ap. J.-C. Texte original d’Habilitation à Diriger des Recherches, octobre 2009, Université de Mont-pellier III, Inédit.
Mauné, silvéréano 2011 : MAUNE (S.), SILVE-REANO (S.), avec la coll. de NEWMAN (Ch.)
– Productions augusto-tibériennes de l’atelier de Bastide-Neuve (Bouches-du-Rhône). SFECAG, Actes du congrès d’Arles, 2011, p. 667-690.
Marty, Zaaraoui 2009 : MARTY (F.), ZAARAOUI (Y.) – Contextes céramiques du Haut Empire de la bonification de l’Estagnon, à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône). SFECAG, Actes du congrès de Colmar, 2009, p. 397-426.
Maza et◤ al. 2002 : MAZA (G.), SAISON (A.), VALLET (C.), BECKER (Chr.) – Un dépotoir d’atelier de potiers du Ier siècle de notre ère dans la cour des Subsistances à Lyon. SFECAG, Actes du congrès de Bayeux, 2002, p. 275-330.
Panella 1992 : PANELLA (C.) – Mercato di Roma e anfore galliche nella primà età imperiale. In : LAUBENHEIMER (F.) dir. – Les amphores en Gaule, production et circulation. Vol.1, PUFC, Paris, 1992, p.185-206.
Valente 2009 : Valente (M.) – Arles, l’esplanade. Faciès céramique d’un niveau de destruction de la fin du IIIe s. apr. J.-C. SFECAG, Actes du congrès de Colmar, 2009, p. 803-821.
fichier ÉDITEUR destiné à un usage privé
430 – séverine CorBeel – guillauMe duperron
revue arChéologique de narBonnaise, tome 46, 2013
◤ Références bibliographiques
solin 1971 : SOLIN (H.) – Beiträge zur Geschichte der griechischen Personennamen in Rom. In : Commentationes Humanarum Latinarum, 48, Helsinki, 1971, 165 p.
solin 1982 : SOLIN (H.) – Die griechischen Per-sonennamen in Rom. Ein Namenbuch, Berlin-New York, 1982, 1584 p.
solin, salomies 1994 : SOLIN (H.) et SALOMIES (O.), Repertorium nominum et cognominum Latinorum, Hildescheim-Zurich-New York, 1994.
Tallah 2004 : TALLAH (L.) – Carte Archéologique de la Gaule, 84/2, Le Luberon et le Pays d’Apt, Académie des Inscriptions et Belles Lettres, Pa-ris, 2003, 432 p.
Thylander 1952 : THYLANDER (H.) – Etude sur l’épigraphie latine : date des inscriptions, noms et dénomination latine, noms et origine des personnes. In : Skanska Centraltryckeriet, 1952.
Vial 2003 : VIAL (J.) – Carte Archéologique de la Gaule, 34/3, Le Montpelliérais, Académie des Inscriptions et Belles Lettres, Paris, 2003, 479 p.
fichier ÉDITEUR destiné à un usage privé





































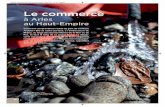



![Le Bas Danube dans la seconde moitié du XI-ème siècle: nouveaux États ou nouveaux peuples?, [w:] Byzantina et Slavica Cracoviensia, V: Byzantium, New Peoples, New Powers: The Byzantino-Slav](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6324f3e485efe380f30672ea/le-bas-danube-dans-la-seconde-moitie-du-xi-eme-siecle-nouveaux-etats-ou-nouveaux.jpg)








