Le Bas Danube dans la seconde moitié du XI-ème siècle: nouveaux États ou nouveaux peuples?, [w:]...
Transcript of Le Bas Danube dans la seconde moitié du XI-ème siècle: nouveaux États ou nouveaux peuples?, [w:]...
Byzantina et Slavica Cracoviensia, VByzantium, New Peoples, New Powers:
The Byzantino-Slav Contact Zone,from the Ninth to the Fifteenth Century
Cracow 2007
Jacek Bonarek
(Piotrków Trybunalski)
LE BAS DANUBE DANS LA SECONDE MOITlE DU XI-EME SIECLE:NOUVEAUX ETATS OU NOUVEAUX PEUPLES?
Dans l'histoire byzantine Je XI siecle est l'epoque de la crise generale de l'Etatl,laquelle a ete aggravee aussi bien par les invasions des nouveaux ennemis (Normands,Petchenegues, Turcs), que par les tendances sćparatistes dans l'Etat byzantin, surtoutdans les territoires frontaliers'', Ce separatisme etait renforce par la faiblesse du pouvoircentral qui ne pouvait proteg er ni les frontieres ni les ethnies qui y habitaient. Ainsi, enAsie Mineure les Turcs envahissaient surtout les territoires habitćs par les Armeniens,en Italie, les Normands s'emparaient des territoires appartenant au peuple roman, dansles Balkans, le but de l'expansion des Petchenegues etait les Slaves.
Ces tendances sćparatistes sont apparues tres nettement dans le Bas-Danube quifaisait partie de l'Etat byzantin depuis Jean Tzimiskes ' et qui etait appele Paristrion ouParadounavon par les Byzantins". D'apres les sources concernant 971, Jean ler mit les
I G. OSTROGORSKI, Geschichte des Byzantinischen Staates, Munchen 1963, p. 265-283; E. STANESCU, Lacrise du Bas-Danube byzantine au cours de la seconde moitle du XI' siecle, ZRVI 9, 1966, p. 49-73; M. ANGOLD,The Byzantine Empire 1025-1204. A political history, London-New York 1984, p. 12-102; W. TREADGOLD,A History oj the Byzantine Stale and Society, Stanford 1997, p. 583-611.
2 STANESCU, La crise, p. 49-51; J.-CI. CHEYNET, Pouvoir et contestations ił Bytance. Paris 1996, p. 379-412;TREADGOLD, A History, p. 607-610, 614; A. MADGEARU, The Periphery against the Center: the Case oj Para-dunavon, ZRVI 40,2003, p. 49-56.
3 V. TApKOWA-ZAIMOWA, Dolni Dunav - granicna zona na vizantijskia zapad, Sofia 1976, p. 34-36; M.WHITTOW, The Making oj Orthodox Byzantium, 600-1025, London 1996, p. 295-296; Istoria na srednovekovnaBćlgariu VI/-XIV vek, vol. l, Sofia 1999, p. 299-300; P. STEPHENSON, Byzantine Policy towards Paristrion in themid-eleventli celi tury: another interpretation, BMGS 23, 1999, s. 43-66; IDEM, Byzantium's Ba/kan Frontier. APolitical Study oj/he Nonhem Balkans, 900-1204, Cambridge 2000, p. 47-55; F. CURTA, Southeastern Europe inthe Middle Ages 500-1250, Cambridge 2006, s. 240-241.
4 N. BANESCU, Le theme de Paristrion-Paradounavon (Paradounavis), Les origines. Le nom, Bulletin de laSection Historique de l'Acadernie Roumaine 25, 1944, p. 139-151; T. WASILEWSKI, Le katepanikion et te duchede Paristrion au Xl" s., (dans:) Actes du XIV' Congres International des Etudes Byzantines, vol. II, Bucarest 1975,p. 641-645; IDEM, L'administration byzantine dans la vallće du Bas Dallube au X' e/ XI' siecles selon la sigil-lographie, Dobrudja 12, 1995, s. 190-203; TApKOWA-ZAIMOWA, Dolni Dunav, p. 36-39; EADEM, L'administra-tion byzantine au Bas-Dallube (fin du X'-XI' siecle), BsI, 45, 1993, p. 96; I. IORDANOV, Pećatite ot strategiata v
Jacek Bonarek
garnisons byzantines dans les forteresses danubiennes, en incorporant en merne tempsla Bulgarie danubienne a l'Empire5. Les evenements eonfus qui se sont passes dans leBas-Danube a la fin du Xveme siecle", peuvent supposer que les garnisons byzantines-au moins, dans les plus grandes fortresses, ont endurć les turbulences de la guerre avecle tsar Samuel et y ont stationne jusqu'a la crise de la seconde moitie du xr= siecle '.
La situation du Bas-Danube a cornmence a changer au desavantage du pouvoircentral vers la moitie du Xl-ćme siecle, quand, avec le consentement de I'empereurConstantin IX Monomaque, un des chcfs des tribus des Petchćnegues, Kegen, a eteadmis parmi les allies et les amis de l'Empire et a obtenu trois forteresses danu-biennes'', Cette decision a entarne le processus de colonisation des Petchenegues auParistrion et dans les territoires bulgares en particulier", ce qui a entrainć, commetoujours, une emanciparion lente des terres danubiennes et l' effondrement des struc-tures du pouvoir de I'EtaeO, d'autant plus que les anciens habitants du Paristrion, lequeloccupait une partie de l' ancienne Bulgarie, se mefiaient du pouvoir central, en cher-chant probablement de l'aide aupres des nomades!'.
Preslav, Sofia 1993, p. 1l7, 134-137; A. MADGEARU, The military Organization oj Paradounavon, Bsl. 60, 1999,p. 421; STEPHENSON, Byzantium 's Ba/kan, p. 55-58.
5 IOANNES SCYLlTZES Synopsis historion, ed. I. Thurn (CFHB, Y), Berlin-New York 1973, p. 310; N.Oixo OMIDES, II propos de la premiere occupation byzantine de la Bulgarie (971-ca. 986), (dans:) EYtjJYXIA,Melanges offerts 11 Helenę Ahrweiler, II, Paris 1998, p. 581-589; STEPHENSON, Byzantium's Balkan. p. 55-58.
6 Y. TApKOWA-ZAIMOWA, DO/IIi Dunav, p. 51-54; S. PIRIVATRIL:, Samuilovata ddrźava. Obchvat i charakter,Sophia 2000, p. 113-116; STEPHENSON, Byzantium's Balkan, p. 59-60, 63-65; IDEM, The Legend oj Basil/he Bul-gar-Slayer, Cambridge 2003, p. 14, 18-21; C. HOLMES, Basil fI and the governance oj Empire (976-1025), Oxford2005, p. 401-402.
7 N. BA ESCU, Le theme, p. 140-144; MADGEARU, The Mili/ary Organization, p. 421-422; PIRIVATRIL:, Sa-muilovata ddrźava, p. 113; P. Doimi De FRANKOPAN, The workings oj the Byzantine provincial administration inthe 1(j"_12,h centuries: the example oj Pres/av, Byz. 71, 200 l, p. 73-97.
8 IOANNES SCYLlTZES, p. 456-457; STANESCU, La crise, p. 51; P. DIACONU, Les Petchenegues au Bas-Danube, Bucarest 1970, p. 56-61; 1. SHEPARD, John Mauropous, Leo Tornicius and an alleged Russian army: thechronology oj/he Pecheneg crisis oj 1048-1049, JOB, 24, 1975, p. 61-89; TApKOWA-ZAIMOWA, Dolni Dunav, p.75-76; EADEM, La population du Bas-Danube et le pouvoir byzantin (XI'-XlJ' s.), (dans:) Actes du XY' CongresInternational d'Etudes Byzantines, Athenes-Septernbre 1976, vol. IY, Athenes 1980, p. 331-332; EADEM, Migra-tions [rontalieres en Bulgarie medievale, (dans:) Migrations et diaspora mediterranćennes (X'-XYI' siecles), ed.M. BALARD, A. DUCELLlER, Paris 2002, p. 127-128; ANGOLO, The Byzantine Empire, p. 15-16; E. MALAMUT,L 'image byzantin des Petchenegues, BZ 88, 1995, p. 118-119; STEPHENSON, Byzantium 's Balkan, p. 89-91: 1.0.KNIAZ' KIJ, Vizantia i koćevniki iuźnorusskich stepei, Sankt-Peterburg 2003, s. 38-39; CURTA, SoutheasternEurope, p. 296.
9 STANESCU, La crise, p. 51-52; DIACONU, Les Petchćnegues. p. 62-69; Y. TApKOWA-ZAIMOWA, LesjJ1ĘojJapfJapol el/a situation politique et ethnique au Bas-Danube pendant la seconde moitle du XI' S., (dans:)Actes du XI Y' Congres International des Etudes Byzantines, vol. II, Bucarest 1974, p. 616; EADEM, Dolni Dunav,p. 78-79; EADEM, Tiurskie koćevniki, vizantiskaia administracia i mestnoe nase/ene na Niźnym Dunae (XI-XfIvv.), (dans:) Vostoćnaia Evropa v drevnosti i srednevekov'e, Moskva 1978, p. 69; G.G. LITAVRIN, Vizantijskoeobśćestvo i gosudarstvo v XXI \IV., Moskva 1977, p. 238; ANGOLO, The Byzantine Empire, p. 16; MALAMUT,L 'image, p. 118-132; ANGOLO, The Byzantine Empire, p. 39; STEPHENSON, Byzantium's Ba/kan, p. 89-98;KNIAZ'KIJ, Vizantia i koćevniki, s. 43-44; CURTA, Southeastern Europe, p. 296-297.
10 F. CHALANDON, Essai sur le regne d'Alexis Comnene (108/-1118), Paris 1900, p. 3-5; TApKOVA-ZAIMO-WA, Tiurskie koćevniki, p. 69-70; STEPHENSON, Byzantine Policy, p. 52-53; IDEM, Byeantium's Balkan, p. 91-98;CURTA, Southeastern Europe, p. 297-298.
II TApKOWA-ZAIMOWA, La population, p. 336; EADEM, Dolni Dunav, p. 92-93, 97; EADEM, Tiurskie koćev-niki, p. 70-71.
194
Le Bas Dam/be dans la seconde moitie du Xl-eme siec/e: nouveaux Etats ou nouveaux peuples?
L'apogee du sćparatisme se manifestera dans la region danubienne apres les eve-nements des annees 1072-107312
. C'est alors qu'il s'est degage une vraie revoltedirigee par le vestarque Nestor, envoye par le pouvoir central pour gouverner la regiondanubienne+'. La cause de cette rebellion etait l'opposition envers la politique fiscaledu ministre Nicephoritzes, qui reduisit les subsides annuels que le treser imperialpayait aux villes danubiennes'". II faut bien souligner qu'on n'avait sńrernent pasl'intention de creer un Etat independant ni de changer I'empereur". Cependant, larevolte a prćcipite le proces sus de liquidation des structures du pouvoir central sur Jeterritoire soumis au duc ou catepan du Paristrion 16. Ainsi, cette manifestation d'hosti-lite envers Constantinople a desorganise la situation au nord de la montagne Haimos eny creant le vide politique. On suppose qu'on a commence a creer alors les centreslocaux du pouvoir avec l'aide des Petchenegues'", Quelques'uns, comme Dristra, dejaentre les mains des Petchenegues, jouissaient d'une indćpendance totale"; d'autres,surtout a Dobroudja qui avait sa monnaie locale a Isacce, se consideraient toujours unepartie de l'EmpireI9
. II se pose alors une question: peut-on lier ce processus a laformation du Paristrion independant, meme si cela signifierait seulement l'union decertains centres"? Cela semble peu vraisemblable ", mais on ne peut pas ecxlurequ'une longue absence du pouvoir byzantin ait pu aboutir a une telle situation (par
12 MICHAEL ATTALlOTA: Miguel Ataliates, Historia, ed. l.P. MARTIN, Madrid 2002, p. 150-153; G.G. LlTA-
VRIN, Bolgaria i Yizantia v XI-XIJ VV., Moskva 1960, p. 411-414; STANESCU, La crise, p. 56-61; DIACONU, LesPetchenegues, p. 100-106; N.-S. TANASOCA, Les mixobarbares et les formations politiques paristriennes du XIsiec/e, RRH, 12, 1973, p. 61-62; TApKOWA-ZAIMOWA, Dolni Dunav, p. 89-92; EADEM, Tiurskie koćevniki, p. 70;ANGOLO, The Byzantine, p. 121-122; MALAMUT, L'image, p. 130-132; CHEYNET, Pouvoir, p. 81, 390-391;TREADGOLO, A History. p. 607; STEPHENSON, Byzantine Policy, p. 58-60; IDEM, Byzantium 's Ba/kan, p. 98;MADGEARU, The Periphery, p. 50-52; CURTA, Southeastern Europe, p. 299.
13 MICHAEL ATTALlOTA, p. 151; TANASOCA, Les mixobarbares et les formations, p. 61; TApKOWA-ZAIMO-
WA, Dolni Dunav, p. 91-92; MALAMUT, L'image, p. 131; CHEYNET, Pouvoir, p. 390; ANGOLO, The Byzantine, p.
98; STEPHENSON, Byzantine Policy, p. 58-60; IDEM, Byzantium's Ba/kan, p. 98. II faut dire, que M. Angold et W.Treadgold datent la revolte a l'an 1076.
14 MICHAEL ATTALlOTA, p. 150; LlTAVRIN, Bolgaria i Vizantia, p. 412-413; TANASOCA, Les mixobarbares erlesformati~ns, p. 61; MALAMUT, L'image, p. 131; ANGOLO, The Byzantine, p. 98; CHEYNET, Pouvoir, p. 81, 390;TREADGOLO, AHistory, p. 607; STEPHENSON, Byrantine Policy, p. 58; IDEM, Byzantium's Balkan, p. 98;MADGEARU, The Periphery, p. 49.
15 On peut dire que ee serait plutót le eas d'une desobeissance eivique; voir aussi: TANASOCA, Les mixobar-bares et les formations, p. 80; ANGOLO, The Byzantine Empire, p. 98; ef.: CHEYNET, Pouvoir, p. 81; STEPHENSON,Byzanril1ePolicy, p. 58; IDEM, Byzantium's Balkan, p. 98.
16 E. STANESCU, Les "rnixobarbares" du Bas-Danube au XI' siec/e (Quelques problemes de la terminologiedes textes) NEH 3, 1965, p. 45; CHEYNET, Pouvoir, p. 390-391; MADGEARU, The Military. p. 429.
17 STANESCU, Les "rnixobarbares", p. 48; TANASOCA, Les rnixobarbares et les formations, p. 65.
18TApKOWA-ZAIMOWA, La population, p. 332; EADEM, Tiurskie koćevniki ... , p. 69-70; CHEYNET, Pouvoir, p.390; CURTA, Southeastern Europe, p. 299.
19 MADGEARU, The Military. p. 429; IDEM, The Periphery, p. 51; STEPHENSON, Byzantine policy, p. 43-66.
20 STANESCU, Les .rnixoborbares", p. 48; IDEM, La crise, p. 61; ANGOLO, The Byzantine, p. 39.
21 TApKOWA-ZAIMOWA, Dolni Dunav, p. 94.
195
Jacek Bonarek
analo~ie au VII-e me S?2) et a la naissance d'un nouvel etat - le Paristrion ou la Patzi-nakia 3.
Un autre probleme, lie directement a la situation politique du Bas-Danube dans laseconde moitie du Xl-eme S., est l'apparition dans les sources du nom "rllixobarbares"pour designer le reuple des villes et forteresses danubiennes'". Ce nom etait deja eon nudans I'antiquite/ et utilise par l'historiographie byzantine. Ainsi, par exemple, Theo-phylacte Simocatta nornme ainsi Phocas26, par contre, pour Jose~h Gćnesios, c'estConstantios, adopte par le reb elle et usurpateur Thomas le Slave2
. Ce n'est tout deme me qu'un emploi de ce terme archaique ad personam.
II faut bien souligner ici que les historiens byzantins des Xl-erne et Xll-erne sieclesemployaient souvent les ethnonymes archaiques'", A cóte des Scythes et Sauromates'",on trouve aussi des Tryballes, des Daques et des Getes, Ces ethnonymes concernentsurernent des peuples concrets, quoique leur identification soit difficile. On sait quepour Jean Skylitzes, les Tryballes etaient les Serbes"; il en est de merne pour JeanZonaras qui assimilait ces noms". Cependant, l'identification des Daces est beucoupplus compliquee, on essaie de les affilier aux Roumains ou aux Hongrois".
Le terme mixobarbaroi est, en generał, difficile a comprendre; il apparait chez Mi-chel Attaliates (en qualite generale) pour designer tous les habitants du Danube33. C'estjustement cette population, surtout les residents polyglottes des villes riches, qui a prć-
22TApKOWA-ZAIMOWA, Les fl.lĘoj3ćtpf3aPOI, p. 617; EADEM, Tiurskie koćevniki, p. 70.
23 Ce seeond nom apparait aussi sur les seeaux; I. IORDANOV, Sceau d'archonte de Iloiiivaxia du XI' s., EB28,2, 1992, p. 79-82; STEPHENSON, Byzantine policy, p. 45; IDEM, Byzantium's Balkan. p. 91, 96; MADGEARU,The Periphery, p. 51, 53; IDEM, Despre "Noua Anglie" de la Marea Neagrii (secolul al Xl-leo), Revista Istoricś14,5-6,2003, p. 140.
24 STANESCU, Les .irnixobarbares", p. 45-53; TANASOCA, Les mixobarbares et les formations, p. 61-82;TApKOWA-ZAIMOWA, Les fJtJ;ofkipf3apol, p. 615-619; EADEM, Dolni Dunav, p. 126-131; MALAMUT, L'imagebyzantine, p. 129-131; STEPHENSON, Byzantiuni's Balkan, p. 110.
25 TANASOCA, Les mixobarbares et les formations, p. 67-68; TApKOWA-ZAIMOWA, Les fJlĘofJ6pf3aPOI, p. 615;STEPHENSON, Byzamium's Balkan. p. 110.
26 THEOPHYLACTI SIMOCATTAE Historiae, ed. C. DE BOOR, Leipzig 1887, p. 302-303.
27 IOSEPHI GENESI Regum Libri Quattuor, ed. A. LESMUELLER-WERNER, I. THURN (CFHB, XIV), Berlin-New York 1978, p. 26.
28TApKOWA-ZAIMOWA, Dolni Dunav, p. 118-124; EADEM, Byzance, l'Europe Occidentale et les peuples bal-kaniques (quelques traites de leur optique reciproques), EB 3, 1993, p. 26; M.V. BIBIKOV, Archaizacia v vizanti-jskoi etnonimii, (dans:) Etnogenez narodov Balkan i Sevemogo Prićernomor'ia, Moskva 1984, p. 30-36; 1.0.KNIAZ'KIJ, Vizantia ikoćevniki, p. 60-61.
29 Aux XI' et XII" siecles les Seythes et les Sauromates ee sont principalment des nornades: les Petchćnegues,les Ouzes, les Coumans; voir p. ex.: TApKOWA-ZAlMOWA, Dolni Dunaj, p. 118-119, 123-124; EADEM, Tiurskiekoćevniki, p. 70; STEPHENSON, Byzantine Policy, p. 56-57; IDEM, Byzaniium's Balkan, p. 93, 97, 106, 107-110,153-154: J.W. BIRKENMEIER, The Development of the Komnenian Anny 1081-1180, Leiden-Boston-Koln 2002,p.72.
30 IOANNES SCYLlTZES, p. 424.
31 IOANNIS ZONARAE, Epitomae historiarum libri Xlll-XVlll, ed. TH. BOTTNER-WOBST, vol. III, Bonn 1897,p. 751.
32STANESCU, Les .onixobarbares", p. 50; BIRKENMEIER, The Development, p. 72; STEPHENSON, Byzantium'sBalkan, p. 109; CURTA, Southeastern Europe, p. 281; ef. TApKOWA-ZAIMOWA, Dolni Dunav, p. 119, 120-124.
33 MICHAEL ATTALlOTA, p. 150: 'J::epuAAE"lTo 8ic Kal TO TTEpl TOV "lo rpov KaTOlOUV >Ll~O~ap~apov.TTapaKElvTOl ycip rij aXel] T01JTO TToHal Kal >LEyaAOl TTóAEl EK TTao~ yAWOOT]<; OUVT]Y>LEVOV ExouamTTA~eO<;,Kal aTTAlTlKOV OU >LlKpOV dnorpśćooom.
196
Le Bas Da17Ubedans la seconde moitle du Xl-ćme siec/e: nouveaux Etats au nouveaux peuples?
pare la revolte par suite des actions impopulaires de Nicephoritzes. A cóte de la popu-lation indigene du Paristrion, appelee mixobarbaroi, apparaissent les Petchenegues(pour les chroniqueurs - les Scythesr". Ce qui est interessant, c'est qu' Attaliates n'apas employe l'ethnonyme Bulgares bien qu'il ait decrit auparavant les luttes entre lesBulgares et les Ouzes ". Par contre, on trouve frequemment ce terme dans les sourcesbyzantines ou il designe les habitants du therne Bulgarie, qui, peu apres, se sont rćvol-tes, diriges par Constantin Bodin36
. C'est chez Skylitzes Continue qu'on trouve beau-coup d'informations sur ces evenements". II est interessant qu'aucune de ces sourcesn'emploie l'ethnonime Bulgares pour dćsigner les habitants du Danube. Pour SkylitzesContinuć ainsi que Jean Zonaras, ce sont les Paristriens38. Meme pour Michel Atal-liates, les Bulgares etalent surtout les habitants des Balkans Occidentaux39.
II se pose alors une question - pourquoi les historiens byzantins, en dćcrivant lesevenernents des annees 1072-1073, ri'employaien-ils pas le terme Bulgares pour de-signer la population de la Bulgarie danubienne? En revenche, ils parIent de la popula-tion appelee par Attaliates mixobarbares, et par les autres, les Paristriens (Paristrioi).Le ternoignage le plus important est celui d' Attaliates qui vivait a cette epoque - la etpresantait les evenements avec beaucoup se precision. II semble que I'ethnonyme Bul-gares n'a pas ete employe car les revoltes, guides par Nestor, constituait pour l'Etatbyzantin une nouvelle qualitć, totalement diffćrente des Bulgares qui luttaient contreles Byzantins en occident. Comme on l'a deja rernarque, la revolte de Nestor avaitd'autres buts que celle de Bodin.
Michel Attaliates s'est servi de I'ancien nom archarque mixobarbaron, bien qu'iln'ait pas bien precisć sa signification. II semble tout de me me improbable qu'il com-prend sous ce terme les Petchenegues qui se civilisaient ou les Vlaques ou encore lesBulgares qui avaient adopte le style de vie des barbares, c'est-a-dire des nomades'". Onpourrait demander - pourquoi? Dans le premier cas, parce que les Petchenegues appa-raissent dans les sources sous leur vrai nom, ou comme les Scythes. En plus, Attaliatessouligne que ces Scythes gardaient leurs propres moeurs'". II Y a aussi une autredifficulte - comment les nomades pouvaient-ils se civiliser si la population de la-bas,
34 Parexernple: MICHAELATTALlOTA. p. 150,215,216.
35 MICHAEL ATTALlOTA, p. 63: ... TTayyEVEt TO TWV Ou(WV ifevou<; [.lnu T~<; (ola<; dTTOOKEU~<; T(lV"lo rpov oWTTEpmw8Ev ĘVAOl<; IWKPOL<; Kat AE[.l~OlS a\JTOTTpE[.lVOl<; Kal ~vpam<; TOUS OWKWAVOVTaS T~V
TOVTWV TTEpalwOlv BouAyapous ...
36 LITAVRIN, Bolgaria i Yimntia, p. 402-410; CHEYNET, Pouvoir, p. 79, 389, 390; lstoria na srednovekovnaBtugaria, p. 403-407.
37 SCYLlTZES CONTINUATUS: ' H LUVEXEla T~<; Xpovoypacpla<; TOi!' Iwavvou LKUAlT(Tj, ed. E.T. TSOLA-KES, Thessalonique 1968, p. 162-166.
38 IOANNES ZONA RAS, p. 744; SCYLlTZES CONTINUATUS, p. 166.
39MICHAEL ATTALlOTA. p. 7, 23, 29, 30,167,168,213.
40 STANESCU, Les .anixobarbares", p. 49-51; DIACONU, Les Petchenegues, p. 100-101, 103; TANASOCA, Lesinixobarbares et les formations, p. 64, 66; TApKOWA-ZAIMOWA, Les j1.1/;ojJapf3apOl, p. 618; H. AHRWEILER, Byz-antine Concepts of the Foreigner: The Case of the Nomads, (dans:) Studies on the Internal Diaspora of the Byzan-
tine Empire, ed. H. AHRWEILER, A.E. LAIOU, Washington DC 1998, p. 10-11, 13; STEPHENSON, Byzantium'sBalkan. p. 110.
41 MICHAEL ATTALlOTA, p. 150: ... ol TTEpmWeEVTE<; LKVem TO TTpÓTEpOV, TOV OKUelKOV ETTlcpEpOUOl~[OV ...
197
Jacek Bonarek
legalement appartenant a Byzance, ćtait souvent peręue comme etrangere, presquebarbare'f? Ce fait explique pourquoi la deuxieme possibilite est plutót a exclure.
On peut admettre alors que ces mixobarbares etaient une sorte de population me-langee du point de vue ethnique't'. Les Bulgares pouvaient en consrituer une partieimportante ou dominante, enrichie par d'autres elćrnents, ce qui n'est toutesfois quandrneme perceptible dans les sources". On suppose que c'etaient les Vlaques, dont lapresence dans les Balkans est certaine a cette epoque-la". II reste une question: trou-vait-on chez eux les Petchenegues et les Ouzes? C'est peu probable, comme on l'a dejadit, ils'etaient appeles les Scythes ou sous leurs propres noms. Les memes doutes eon-cement d'ailleurs les Vlaques - leur nom etait aussi connu aux Byzantins'". Peut-etrealors, il faudrait prendre l'information d' Attaliates a la lettre et traduire le termemixobarbaroi comme population heterogene du Bas-Danube: Bulgares, Petchenegues,Ouzes, Vlaques, Hongrois, Russes'". On peut admettre que ce nom signifiait pour Atta-liates une nouvelle entite.
On peut peut-etre avoire recours a l'information que les villes danubiennes etaientcapables de creer des forces militaires assez importantes'". Par exemple, Nestor nommecatepan de Dristra par le pouvoir central, est devenu chef des revoltes qui ont menaceConstantinople. Ces forces se composaient des autochtones et representaient leursinterćts'". Attaliates souligne que ces villes danubiennes pouvaient rassembler destroupes considerables'", mais ił n'ajoute merne pas que c'etait une partie de l'armeebyzantine qui accueillait deja les tagmata etrangers stationnant dans les themes". Lesforces du Paristrion pouvaient etre alors quelques chose de separe, hors des structuresmilitaires de I'Empire52
. Dans cette situation, on est tente d'ernettre une hypothese surl' origine de ces troupes. Peut-ćtre que les soldats des villes danubiennes etaient lesdescendants de ceux de l'ćpoque de Jean Tzimiskes. Les garnisons qu'avait laissees cetempereur victorieux, se composaient de soldats byzantins, de Romains (Romaioir '. II
42 MICHEL PSELLOS, Chronographie, ed. E. RENAULT, t. l, Paris 1926, p. 78-79, 81; A. DUCELLlER, La notiond'Europe ii Byzance des origines au XJJl'"'' siec/e, Bsl. 55,1994, p. 1-7.
43 DIACONU, Les Petchenegues, p. 101; TANASOCA, Les mixobarbares et les formations, p. 77-78.44 TApKOWA-ZAIMOWA, Les J1.lqof3lipfJapOl,p. 618; EADEM, Dolni Dunav, p. l30-l31.
45 STANESCU, Les "mixobarbares", p. 49; IDEM, Byzantinovlachica. I: Les Vlaques a la fin du X' siecie-debutdu XI' et la restauration de la dominatlon byzantine dans la Peninsule Balkanique, RESEE 6, 1968, p. 407-438;IDEM, Quelques propos sur l'image byzantine de la Romanite balkanique, RESEE 24, 1986, p. 133-144;TApKOWA-ZAIMOWA, La population, p. 334; TREADGOLD, A History, p. 539.
46 Un de plus anciens mentions des Vlaques 11 la Peninsule Balkanique est celu i de Jean Skylitzes: ... TOUTWVOE TWV reccdpov ciOEA<PWV Lla~lo IlEV Ev8vS' ciTTE~(W civmpE8ElS' IlEaOV KaaTop(aS' KaL TIpEaTTaS' ElS'TO., AEyollEvaS' KaAO., opuS' TTapci TlVWV BXcixwv ÓOlTWV ... (IOANNES SCYLlTZES, p. 329).
47 TA PKOWA-ZA IMOWA, Les J1.lqofJapjJapol,p. 618; TANASOCA, Les mixobarbares et les formations, p. 78.48 MICHAEL ATT ALlOTA, p. 150.
49 MADGEARU, The Military. p. 440; TApKOWA-ZAIMOWA, Dolni Dunav, p. 86-90.
50 MICHAEL ATTALlOTA, p. 150.
51 H. GLYKATZI-AHRWEILER, Recherches sur l'administration de l'Empire byzantin au IX'·XI' s., Bulletin decorrespondance hellenique 84, 1960, p. 23-24; LITA VRIN, Vizantijskoe obsćestvo, p. 242, 251-252, 253-255; J.-CI.CHEYNET, Les effectifs de l'armee byzantine aux X'-XII' S., Cahiers de civilisation rnedievale 38, 1995, p. 322-328; W. TREADGOLD, Byzantium and Its Army, Stanford 1995, p. 115-117.
52 MADGEARU, The Military, p. 440.
53 IOANNES SCYLlTZES, p. 310.
198
Le Bas Danube dans la seconde moitie du Xl-ćme siecle: nouveaux Etats ou l10uveaux peuples?
semble aussi qu'il existait toujours le contróle byzantin aux les terres qu'on avait prisesauparavant au prince russe Sviatoslav. Ce contróle n'a disparu ni pendant les guerresavec Samuel ni, d'autant plus, pendant les invasions des Petchenegues". D'autre part,cette surveillance n'etait pas tres continue et certaines fortresses pouvaient etre plus oumoins coupees du centre. Cela a facilite la transformation des garnisons en commu-nautes locales, mai s cultivant d'anciennes traditions. Ce n'etait pas des cas isoles, carau Vl-eme s., Procope de Cesaree decrivait ainsi les descendants des soldats romains,en soulignant qu' ils servaient les maitres barbares, en gardant les signes et la disciplinede leurs ancćtres ". Ainsi, on pourrait identifier les mixobarbaroi du Bas-Danubecomme un melange byzantino-barbare. Par contre, il n'est pas juste dattribuer ce termea la population locale, c'est-a-dire aux Bulgares (melanges avec les nomades) et auxVlaques, car pour les Byzantins cultivćs, ils etalent toujours des barbares. On a donctrouve un archarsrne bien pratique et on l'a employe pour designer une nouvelle qualitequi est apparue assez subitement a cause de la crise de l'Etat byzantin. Ce terme appa-rait aussi dans Alexiade d' Anne Cornnene, dans la description de l'expedition d' A!exisComnene contre !es Petchenegues". On y depeint un homme qui ćtait d'orię;ine mixte,ce qui est particulierment important - on souligne ses racines petchenegues'' .
Peut-etre qu'il faudrait alors traduire ce terme du point de vue ethnique - commel'appellation d'un nouveau groupe de population different des Bulgares (deja installes)et des Petchenegues (nouvellement venus) mais avec un tres net element romain, etprovenant surtout de tous les soldats byzantins, Iaisses dans !es garnisons danubiennes.Bien sur, a cause de la modicitć des sources, ce n'est qu'une des hypotheses. Ce pro-ces sus a pu commencer vers la fin du Xeme s. et s'est intensifie vers la moitie du Xleme
_
quand Byzance a perdu le contróle rćel sur les terres entre l'Hairnos et la Danube. Levide a ete cornble alors par les ćlites locales qui se sont mises a creer les organisrneslocaux en s' appuyant sur les grandes forteresses et collaborant avec les nomadescolonisant ces terres'". Le fait queces elites etalent d'une certaine faęon liees au milieuet a la raisen d'Etat byzantins peut etre confirme par l'indifference des riches villesdanubiennes vis-a-vis des evenements dans le therne de Bulgarie, dont les habitantscherchaient a creer un etat bulgare", Comme exemple, on peut ci ter aussi les appelsenvoyes par les revoltes du Paristrion a Constantinople dans les annees 1072-1073,pendant la rebellion de Nestor. C'etaient surtout des souhaits de destitution de l'impo-pulaire Nicephoritzes'".
54 BANESCU, Le theme, p. 140-144; MADGEARU, The Miluary. p. 421-2, 429; IDEM. The Periphery, p. 51;PIRIVATRIC, Samuilovata dćrźava, p. 113; P. DE FRANKOPAN, The workings, p. 73-97.
55 PROCOPIUS CAESARIENSIS, Opera omnia, rec. J. HAVRY, vol. II, Lipsiae 1963, p. 64-65.
56 ANNA COMNENA, Alexias, ed. D.R. REINSCH et A. KAMBYLIS (CFHB, XL), Berlin et New York 2001, p.209-222.
57 STANESCU. Les .Jnixobarbares ", p. 46; TANASOCA. Les mixobarbares et les formations, p. 71; B. SKOULA-
TOS, Les persennages byzantins de l'Alexiade. Analyse prosopographique et synthese, Louvain 1980, p. 213-215.
58 STANESCU, La crise, p. 56-61; MADGEARU, The Periphery, p. 49-56.
59 TANASOCA, Les mixobarbares er les jormations, p. 76; CHEYNET, Pouvoir, p. 389, 391; STEPHENSON,Byzantium's Ba/kan, p. 142.
60 TANASOCA, Les mixobarbares et les formations, p. 80; CHEYNET, Pouvoir, p. 81, 390-391; CURTA, South-eastern Europe, p. 299.
199
Jacek Bonarek
Ainsi, dans la seconde moitie du XI-e S., dans le Bas-Danube on n'observe pastellement l'apparition de nouveaux etat s que la naissance de communautes ethniques:des Petchenegues devenant agriculteurs'" et formant peut-etre alors la Patzinakia, etdes mixobarbaroi, appelćs ainsi provisoirement par les historiens byzantins, peut-etreidentiques aux Paristriens (Paristrioi) de certaines chroniques, par exemple de SkylitzesContinue ou Jean Zonaras62
. On ne peut pas non plus exclure leur ćvolution lente versl'Etat et le peuple des Paristriens (Paristrioi). Les actions resolues d' Alexis Comnenel'ont arrettee63; elle s ont ete forcees surtout par les avancements hostiles des mćmesPetchenegues. Ceux-ci aiderent les prćtendants au thróne: Nicćphore Bryennios etNicephore Basilakios64
, ensuite ils lutterent aux cótes des rebelles Lekas puis Traulos65.
On peut dire que de 1087 a 1091, les nomades etalent meme devenus un danger mortelpour Byzance, en dominant le Paristrion et pillant la Thrace66
. L'apogee de la menaceeut lieu quand les Petchenegues ont conclut une alliance avec Tzachas, l'emir deSmyrne, et ont mis le siege devant Constantinople'". A son tour, Alexis Ier Cornnenes'est allie aux Coumans et a ecrase les Petchenegues le 29 avril 1091 a la bataille deLebounion. Elle se termin a en massacre des Petchenegues survivants'". C'est cettevictoire qui a decide qu' Alexis Cornnene allait liberer les les Balkans de leur prćsenceet qui lui a permis de restaurer le pouvoir byzantin au Bas-Danube'", par cela mćme,enrayant la possibilite de la naissance d'un nouveau peuple.
61 TANA$OCA, Les mixobarbares et les [ormations, p. 80; TApKOWA-ZAIMOWA, Les f.llĘOjJapjJaPOI, p. 618;
MALAMUT, L'image, p. 132.
62 IOANNES ZONARAS, p. 713: SCYLlTZES CONTINUATUS, p. 166.
63 CHALANDON, Essai, p. 109-125, 128, 132-134; LITAVRIN, Bo/garia i Yizantia, p. 421; DIACONU, LesPetchćnegues, p. 130-134; TANA$OCA, Les mixobarbares et les formations, p. 81-82; ANGOLO, The ByzantineEmpire, p. 109-111; MALAMUT, L'image, p. 135-142; CHEYNET, Pouvoir, p. 391; A.G.K. SAVVIDES, Oi Tourkoikai to vizantio, Athens 1996, p. 79-80; MADGEARU, The Periphery, p. 54; BIRKENMEIER, The Development, p. 71-
77; STEPHENSON, Byzantium's Ba/kan Frontier, p. 100-105; CURTA, Southeastern Europe, p. 300-302.
64 DIACONU, Les Petchenegues, p. 110; TApKOWA-ZAIMOWA, Do/ni Dunav, p. 93; MALAMUT, L 'image, p.132-134; CHEYNET, Pouvoir, p. 83-84, 86-87; SAVVIDES, Oi Tourkoi, p. 79; STEPHENSON, Byzantium's Balkan, p.100-101; CURTA, Southeastern Europe, p. 301.
65 DIACONU, Les Petchenegues, p. 111; TApKOWA-ZAIMOWA, Dolni Dunav, p. 93; SKOULATOS, Les person-nages, p. 298-299; MALAMUT, L'image, p. 134-135; CHEYNET, Pouvoir, p. 85, 94; STEPHENSON, Byzantium'sBa/kan, p. 101; CURTA, Southeastern Europe, p. 289-290, 301.
66 CHALANDON, Essai, p. 109-125; TApKOWA-ZAIMOWA, Dolni Dw1C/v, p. 97-100; MALAMUT, L'image, p.135; KNIAZ'KIJ, Vizantia i koćevniki, p. 52-54; 96.
67 CHALANDON, Essai, p. 127; CL. CAHEN, Pre-Ottoman Turkey, London 1968, p. 81; ANGOLD, The Byzan-tine Empire, p. 110; SAVVIDES, Oi Tourkoi. p. 80; KNIAZ'KIJ, Vizantia i koćevniki, p. 53-54; CURTA, SoutheasternEurope, p. 301.
68 CHALANDON, Essai, p. 133-134; DIACONU, Les Petchenegues, p. 132-133; IDEM, Les Coumans au Bas-Danube aux Xl" et Xll" siec/es, Bucuresti 1978, p. 40; TApKOWA-ZAIMOWA, Dolni Dunav, p. 100; ANGOLO, TheByzantine Empire, p. 110-111; MALAMUT, L'image, p. 141-142; SAVVIDES, Oi Tourkoi, p. 80; BIRKENMEIER, TheDeve/opment, p. 76-77; STEPHENSON, Byzantium's Balkan, p. 103; KNIAZ'KIJ, Vizantia i koćevniki, p. 96-100;CURTA, Southeastern Europe, p. 301.
69 CHALANDON, Essai, p. 133-134; STANESCU, La crise, p. 61-65; TApKOWA-ZAIMOWA, Do/ni Dunav, p. 101;
ANGOLO, The Byzantine Empire, p. 111; STEPHENSON, Byzantium's Ba/kall, p. 103-105; CURTA, SoutheasternEurope, p. 302.
200
![Page 1: Le Bas Danube dans la seconde moitié du XI-ème siècle: nouveaux États ou nouveaux peuples?, [w:] Byzantina et Slavica Cracoviensia, V: Byzantium, New Peoples, New Powers: The Byzantino-Slav](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030900/6324f3e485efe380f30672ea/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Le Bas Danube dans la seconde moitié du XI-ème siècle: nouveaux États ou nouveaux peuples?, [w:] Byzantina et Slavica Cracoviensia, V: Byzantium, New Peoples, New Powers: The Byzantino-Slav](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030900/6324f3e485efe380f30672ea/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: Le Bas Danube dans la seconde moitié du XI-ème siècle: nouveaux États ou nouveaux peuples?, [w:] Byzantina et Slavica Cracoviensia, V: Byzantium, New Peoples, New Powers: The Byzantino-Slav](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030900/6324f3e485efe380f30672ea/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Le Bas Danube dans la seconde moitié du XI-ème siècle: nouveaux États ou nouveaux peuples?, [w:] Byzantina et Slavica Cracoviensia, V: Byzantium, New Peoples, New Powers: The Byzantino-Slav](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030900/6324f3e485efe380f30672ea/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Le Bas Danube dans la seconde moitié du XI-ème siècle: nouveaux États ou nouveaux peuples?, [w:] Byzantina et Slavica Cracoviensia, V: Byzantium, New Peoples, New Powers: The Byzantino-Slav](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030900/6324f3e485efe380f30672ea/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: Le Bas Danube dans la seconde moitié du XI-ème siècle: nouveaux États ou nouveaux peuples?, [w:] Byzantina et Slavica Cracoviensia, V: Byzantium, New Peoples, New Powers: The Byzantino-Slav](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030900/6324f3e485efe380f30672ea/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: Le Bas Danube dans la seconde moitié du XI-ème siècle: nouveaux États ou nouveaux peuples?, [w:] Byzantina et Slavica Cracoviensia, V: Byzantium, New Peoples, New Powers: The Byzantino-Slav](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030900/6324f3e485efe380f30672ea/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Le Bas Danube dans la seconde moitié du XI-ème siècle: nouveaux États ou nouveaux peuples?, [w:] Byzantina et Slavica Cracoviensia, V: Byzantium, New Peoples, New Powers: The Byzantino-Slav](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030900/6324f3e485efe380f30672ea/html5/thumbnails/8.jpg)



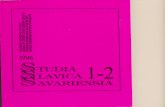






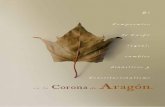



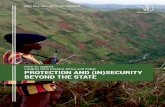


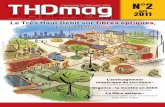
![Giger_Menzel_Wiemer Lexikologie und Sprachveränderung in der Slavia [= Studia Slavica Oldenburgensia 2]. Oldenburg 1998](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63225cfc61d7e169b00c98c0/gigermenzelwiemer-lexikologie-und-sprachveraenderung-in-der-slavia-studia-slavica.jpg)


