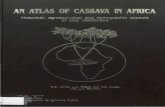Révolution culturelle et production d'un intellectuel de proposition (Pierre Rosanvallon)
(draft) "ANONYMUS MAGISTER ARTIUM. Le portrait intellectuel d’un maître ès arts anonyme de la...
Transcript of (draft) "ANONYMUS MAGISTER ARTIUM. Le portrait intellectuel d’un maître ès arts anonyme de la...
Fédération Internationale des Instituts d’Études MédiévalesTEXTES ET ÉTUDES DU MOYEN ÂGE, NUMERO 65
PORTRAITS DE MAÎTRESOFFERTS À OLGA WEIJERS
Fédération Internationale des Instituts d’Études Médiévales
Présidents honoraires :
L.E. BOYLE (†) (Biblioteca Apostolica Vaticana e Commissio Leonina, 1987-1999)L. HOLTZ (Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, Paris, 1999-2003)
Président :J. HAMESSE (Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve)
Vice-Président :
O. MERISALO (University of Jyväskylä)
Secrétaire :
J. MEIRINHOS (Universidade do Porto)
Membres du Comité :
O. R. CONSTABLE (University of Notre Dame)G. DINKOVA BRUUN (Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto)M. J. MUÑOZ JIMÉNEZ (Universidad Complutense de Madrid)A. OLIVA (Commissio Leonina, Paris)O. PECERE (Università degli Studi di Cassino)P. E. SZARMACH (Medieval Academy of America)
Fédération Internationale des Instituts d’Études MédiévalesTEXTES ET ÉTUDES DU MOYEN ÂGE, NUMERO 65
PORTRAITS DE MAÎTRES OFFERTS ÀOLGA WEIJERS
Édité par
Claire Angotti, Monica Brînzei, Mariken Teeuwen
PORTO2012
Mis en page parPaul Brînzei
ISBN: 978-2-503-54801-2
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in aretrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical,photocopying, recording or otherwhise, without the prior permission of the publisher.
©2012 Fédération Internationale des Instituts d’Études Médiévales.
Gabinete de Filosofia Medieval / Faculdade de Letras / P-4150-564 Porto.
ANONYMUS MAGISTER ARTIUM.Le portrait intellectuel de l’auteur du Commentaire de Paris (1235-40)
sur l’Ethica nova et vetus∗
Irene Zavattero
Faire le portrait d’un auteur anonyme semble relever de la contradiction. Ne pasconnaître l’identité d’un auteur devrait empêcher la rédaction d’une notice biographique.Toutefois, au moyen de l’étude de ses œuvres, on peut tenter d’en esquisser le profilintellectuel, bien que de manière conjecturale et approximative. L’objectif se révèleencore plus difficile et, voire illégitime, si l’on ne dispose que d’une seule œuvre de cetauteur. Néanmoins cette démarche ne nous semble pas totalement dépourvue d’intérêtpour le cas que nous nous proposons de traiter, à savoir pour un maître ès arts quidonna un cours sur l’Ethica nova et vetus entre 1235-40 à la Faculté des arts de Paris.Cette tentative de portait mettra en effet à jour un profil inattendu de commentateuraristotélicien.
Dénommé par les spécialistes « Commentaire de Paris », ce cours est l’un des sixcommentaires1 qui nous sont parvenus, complets ou fragmentaires, portant sur les troispremiers livres de l’Éthique à Nicomaque (EN), c’est-à-dire sur la seule partie de lapremière traduction du livre aristotélicien, achevée par Burgundio de Pise autour de1150, qui circulait à Paris dans la première moitié du XIIIe siècle2.
∗Cette étude s’insère dans le cadre du projet de recherche « Filosofia e teologia nel Medioevo latino.Edizioni di testi e studi critici » (Prin 2009) coordonné par Loris Sturlese à l’Università del Salento. Jeremercie Catherine König-Pralong pour sa relecture attentive de mon texte et ses remarques critiques.
1Le Commentaire de Paris est transmis dans les mss. Paris, Bibliothèque Nationale de France, lat. 3804A(f. 140ra-143va ; 152ra-159vb, 241ra-247vb) et lat. 3572 (f. 226ra-235ra). Le fragment de la partie concernantl’Ethica nova a été édité par R.-A. Gauthier, « Le cours sur l’Ethica nova d’un maître ès arts de Paris(1235-1240) », Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge 50 (1975), p. 71-141. La Lectura inEthicam veterem, elle aussi incomplète, est démembrée en trois tronçons, lesquels, considérés l’un à la suitede l’autre, constituent un commentaire unitaire. Pour l’édition du prologue de cette Lectura cf. I. Zavattero,« Le prologue de la Lectura in Ethicam veterem du “Commentaire de Paris” (1235-1240). Introduction ettexte critique », Recherches de Théologie et Philosophie Médiévales 77,1 (2010), p. 1-33. Les cinq autrescommentaires sont le Commentaire d’Avranches sur l’Ethica vetus (ms. Avranches, Bibliothèque Municipale232, f. 90r-123r), le Commentaire du Ps.-Peckham sur la noua et la vetus (le texte complet : mss. Firenze,Biblioteca nazionale, Conventi soppressi G4 853, f. 1 ra-77va ; Oxford, Bodleian Library, lat. misc. c. 71,f. 2ra-52rb ; fragments : mss. Praga, Národní knihovna III F 10, f. 12ra-23va ; Avranches, BibliothèqueMunicipale 232, f. 123r-125v ; éd. du prologue par V.A. Buffon, « Anonyme [Pseudo-Peckham], Lecturacum quaestionibus in Ethicam novam et veterem [vers 1240-44], Prologue », Recherches de Théologieet Philosophie Médiévales 78,2 [2011], p. 297-382), le Commentaire de Robert Kilwardby sur la nova etla vetus (texte complet : ms. Cambridge, Peterhouse 206, f. 285ra-307vb, fragment : ms. Praga, Národníknihovna III F 10, ff. 1ra-11vb), le Commentaire de Naples (édité par M.J. Tracey, « An Early 13th-CenturyCommentary on the Nicomachean Ethics I, 4-10 : The Lectio cum Questionibus of an Arts-Master at Parisin MS Napoli, Biblioteca Nazionale VIII G 8, f. 4ra-9vb », Documenti e studi sulla tradizione filosoficamedievale 17 [2006], p. 28-69) et un fragment sur le début de l’Ethica vetus II,1-3 (ms. Paris, BibliothèqueNationale de France, lat. 3572, f. 186ra-187ra).
2L’Ethica vetus (livres II et III de l’EN) et l’Ethica nova (livre I) ont été traduites, dans cet ordre eten deux phases successives, par Burgundio de Pise « en 1150 ou avant », comme l’a démontré F. Bossier,« L’élaboration du vocabulaire philosophique chez Burgundio de Pise », in J. Hamesse (ed.), Aux originesdu lexique philosophique européen : l’influence de la Latinitas, Brepols, Louvain-la-Neuve 1997, p. 81-116.
8 IRENE ZAVATTERO
À l’exception de celui qui semble devoir être attribué à Robert Kilwardby3, tousces commentaires sont anonymes. L’anonymat est très fréquent dans la productionphilosophique de la Faculté des arts, surtout dans la première moitié du XIIIe siècle àParis4. Souvent, nous ne disposons que de reportationes de cours, à savoir de notesprises au vol par les étudiants ou par un assistant dumaître5. Ces notes étaient en généralrévisées par le maître ou par l’élève avant d’être diffusées dans leur forme définitive.Tel est le cas, selon l’avis de René-Antoine Gauthier, du Commentaire de Paris : ils’agit d’une reportatio copiée par le « magister Johannes Le Lemosini » — comme lerévèlent deux ex-libris lisibles dans les marges de ses reportationes6 — qui ne nouslivre pas des notes à l’état brut, mais plutôt une mise au net de celles-ci7.
L’identification du reportator—quime semble convaincante en la personne de Jeande Limoges, maître séculier de l’Université de Paris puis cistercien à Clairvaux8 — nerévèle en rien l’identité de l’auteur du commentaire, qui demeure inconnu. Toutefois,en analysant la doctrine transmise par le seul fragment de la Lectura in Ethicam novamque nous possédions, dont il a par ailleurs établi l’édition critique, Gauthier a esquisséle portrait intellectuel de son auteur : ce « maître ès arts se veut philosophe, il expliqueAristote, il le connaît bien, mais il reste, quoi qu’il en ait (sic), un théologien », car sesdoctrines sont très proches de celles des théologiens de son temps, « en particulier duchancelier Philippe et de la première école franciscaine »9.
Je me propose ici de vérifier le bien-fondé du jugement de Gauthier en élargissantl’analyse au commentaire de la vetus ; j’étudierai brièvement l’interprétationqu’élabore le maître anonyme au sujet de quelques doctrines de l’Éthique à Nicomaqued’Aristote — notamment la doctrine du bonheur et de la vie contemplative, ainsi quela description des activités des facultés à l’œuvre dans la contemplation. Le maîtrecommente-t-il l’EN en philosophe ou se révèle-t-il débiteur de la pensée théologique ?Cette démarche a pour but de mesurer le degré d’adhésion du maître à l’éthiquephilosophique d’Aristote, non pas pour estimer la valeur du commentaire sur la basede sa conformité à la pensée aristotélicienne, mais pour saisir la spécificité des choixinterprétatifs du maître. Puisqu’il témoigne d’une bonne connaissance de l’Ethica
3L’attribution a été proposé par P.O. Lewry, « Robert Kilwardby’s Commentary on the Ethica novaand vetus », in C. Wenin (ed.), L’homme et son univers au Moyen Âge, Peeters, Louvain-la-Neuve/Leuven1986, p. 799-807.
4Pour les maîtres ès arts dont nous possédons des œuvres issues de l’enseignement à Paris, à l’exceptiondes anonymes, voir le remarquable répertoire en neuf volumes achevé par OlgaWeijers, Le travail intellectuelà la Faculté des arts de Paris : textes et maîtres (ca. 1200-1500), Brepols, Turnhout 1994-2012. Quelquesnoms de maîtres ès arts actifs à Paris après 1215 sont répertoriés par N.Gorochov, Naissance de l’université.Les écoles de Paris d’Innocent III à Thomas d’Aquin (v. 1200-v.1245), Honoré Champion, Paris 2012,p. 328-330, 404-405.
5J. Hamesse, « La technique de la reportatio », in O. Weijers, L. Holtz (eds), L’enseignement desdisciplines à la Faculté des arts (Paris et Oxford, XIIIe-XVe siècles), Brepols, Turnhout 1997, p. 405-421.
6Cf. J. Sclafer, « Remarques concernant quelques manuscrits universitaires de l’abbaye de St-Martialde Limoges copié par Jean le Limousin », Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge 50 (1975),p. 143-146. Sclafer et Gauthier (« Le cours », p. 72) s’accordent sur le fait que Jean n’est pas l’auteur ducommentaire, mais seulement le reportateur.
7Gauthier, « Le cours », p. 72-73.8Zavattero, « Le prologue », p. 7-9.9Gauthier, « Le cours », p. 92 ajoute l’hypothèse — sans point d’appui dans le texte, jusqu’à nouvel
avis — que le maître aurait pu s’inspirer de la doctrine d’Alexandre de Halès. Gauthier formule cettehypothèse sur la base de la mention d’une Sentencia super nouam et ueterem ethicam secundum Alexandrum,malheureusement perdue, contenue dans le catalogue du ms. 1338 de la bibliothèque de la Sorbonne(Cf. L. Delisle, Le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale, Paris 1881, III, 64). Même s’il estimpossible d’affirmer qu’il s’agit du Commentaire de Paris, l’intitulé mystérieux de la Sentencia (« d’aprèsl’enseignement d’Alexandre ») paraît renvoyer à notre commentaire plutôt qu’aux autres commentaires surla nova et la vetus qui nous sont parvenus.
ANONYMUS MAGISTER ARTIUM 9
nova et vetus — compte-tenu de l’état corrompu et mutilé de la copie qui était en sapossession10 —, une enquête sur son herméneutique peut contribuer à reconstruire sonhorizon culturel, voire à dessiner son profil intellectuel.
Le bonheur est DieuNous ne possédons qu’un texte fragmentaire de la Lectura in Ethicam novamdu Commentaire de Paris, limité aux chapitres 2-4 du premier livre de l’EN(1095a2-1097a14). Par conséquent, l’exposition de la définition aristotéliciennedu bonheur comme opération propre de l’homme (EN I 6, 1097b24-1098a20) estmalheureusement perdue. À la suite d’Aristote, le maître anonyme considère que lebonheur est « le plus grand bien désiré par toutes choses »11, pourtant il identifie cebien suprême au Premier Principe ou à la Première Cause du néoplatonisme, ainsiqu’à la lux de la doctrine de l’illumination d’Augustin12. Bien que le maître attribueau bien suprême certains attributs du Premier Principe néoplatonicien, il se réfèreau Dieu de la doctrine chrétienne ; il souligne en effet explicitement cette référencechrétienne à plusieurs reprises13. L’auteur du Commentaire de Paris désigne doncmanifestement Dieu par le terme « Primum ». En identifiant le bien suprême auPrimum, il fait coïncider le bonheur, qui réside dans le bien suprême, avec Dieu. Ainsinotre commentateur adopte la théorie du bonheur formulée par Augustin dans le Decivitate Dei (VIII, 8), où ce dernier identifie le summum bonum des platoniciens avecle Dieu du christianisme. À cet égard, il est significatif que l’auteur du Commentairen’hésite pas à remplacer ‘Deus’ par ‘felicitas’ dans la formule de saint Augustin : « lavie de l’âme est Dieu » devient « la vie de l’âme est le bonheur »14. « Bonheur » estpour notre maître un nom de Dieu. Il peut ainsi dire : « le bonheur donne la vie » et« l’âme reçoit la vie par le bonheur »15.
L’identification de Dieu et du Primum résulte d’influences néoplatoniciennessur la théologie chrétienne. Elle est attestée dans les traductions latines des œuvresmétaphysiques d’Avicenne et d’Algazel, où l’on rencontre souvent le terme Primumpour signifier Dieu16. Philippe le Chancelier, dans sa Summa de bono, et Alexandrede Hales, dans sa Glossa sur les Sentences, se réfèrent eux aussi à Dieu en l’appelantPrimum17. Dans le cas de notre commentaire, cette identification est digne d’intérêtet particulièrement instructive : elle montre le maître incliné par son approche
10Cf. Gauthier, « Le cours », p. 73-75.11Gauthier, « Le cours », p. 96, 18-20.12Cf. I.Zavattero, « Le bonheur parfait dans les premiers commentaires latins à l’Éthique à Nicomaque »,
Revue de théologie et de philosophie 139 (2007), p. 311-327, ici 314-317.13Gauthier, « Le cours », p. 121,22-24. En outre, le maître place également dans le premier principe la
bonté, la sagesse et la puissance (in primo est bonitas, sapiencia et potencia) attributs de la Trinite. Cf. infra,nn. 56 et 57.
14Cf. Augustinus Hipponensis, Sermones de Scripturis de Novo Testamento, CLXI 6 6 (PL 38, 881) :« Vita corporis anima est, vita animae Deus est ». Gauthier, p. 107 : « Felicitas est vita anime ».
15Cf. Gauthier, « Le cours », p. 116,35-36 : « felicitas [. . .] dat uitam » et « anima [. . .] recipit uitam afelicitate ».
16Cf. Avicenna, Liber de philosophia prima siue scientia diuina I-X. Lexiques, S. Van Riet (ed).,Peeters/Brill, Louvain/Leiden 1983, III, p. 292 ; Algazel,Metaphysica, J.T.Muckle (ed.), St. Michael’sCollege, Toronto 1933. Cf.C. Lafleur, « Dieu et l’idéal théologico-métaphysique de la première philosophieuniversitaire parisienne : le cas de la Divisio scientiarum (vers 1250) de maître Arnoul de Provence », inL. Langlois, Y.-Ch. Zarka (eds), Les philosophes et la question de Dieu, P.U.F., Paris 2006, p. 73-86, icip. 77, n. 5.
17Philippus Cancellarius, Summa de bono, N. Wicki (ed.), Francke, Bern 1985, I, p. 68, 100-70,152 ;Alexander Halensis, Glossa in IV libros Sententiarum, PP. Collegii S. Bonaventurae ad ClarasAquas (eds), Firenze 1952-1954, I, p. 64, 19-20 ; II, p. 27, 16-18.
10 IRENE ZAVATTERO
métaphysique à gagner le domaine de la théologie, même s’il paraît vouloir demeurerdans le champ philosophique18. En outre, la conséquente identification du bonheur et deDieu pose le problème de la réalisation du bonheur et de son accessibilité pour l’homme :dans quelle mesure l’homme peut-il œuvrer pour atteindre le bonheur transcendant ?Au bonheur qui, comme le dit Gauthier, « n’est pas à faire » mais « existe »19, l’hommene peut que s’unir ; ou mieux, comme l’explique le commentateur, c’est le bonheurqui s’unit à nous (« de felicitate, que unitur nobis »20), car seul le Premier Principepeut décider de réaliser cette union. Cette doctrine présuppose de fait l’incapacité etl’inaptitude de l’homme à parvenir par soi-même au souverain bien.
Pourtant, le maître semble envisager, d’un point de vue philosophique (secundumphilosophos), la possibilité pour l’homme d’acquérir le bonheur par la viecontemplative :
uita que est idem felicitati predicatur de uita contemplatiua in quantum uitacontemplatiua est circa cognitionem sine fantasmate et uirtutem que est circapartem superiorem intellectus practici siue uirtutis desideratiue21
La vie contemplative consiste en l’activité conjointe de la cognitio sinefantasmate — qui, on le verra, est opérée par l’intellect agent — et de la vertu — quel’on découvrira être la vertu intellectuelle, l’habitus de la partie supérieure del’intellect pratique.
Pour comprendre cette définition de la vie contemplative et pour évaluer le rôle jouépar l’homme dans la réalisation du bonheur, il faut d’abord analyser la classificationdes puissances de l’âme proposée par le commentateur parisien.
La classification des puissances de l’âme
La division des facultés de l’âme est établie dans le passage suivant, tiré du prologueau commentaire de la vetus22 :
sicut anima secundum partem speculatiuam habet duplicem naturam, ăunamą
secundum quam comparatur ad superiora et hec uocatur intellectus agens, aliamhabet secundum quam comparatur ad inferiora et hec uocatur intellectus possibiliset secundum intellectum agentem semper est in anima ueritas, secundumpossibilem non, similiter ex parte intellectus practici sunt iste diuerse nature : unaque respondet intellectui agenti et hec uocatur superior pars intellectus practici,alia respondet intellectui possibili et uocatur inferior pars intellectus practici, etpars superior semper est ad bonum, inferior non23.
18Pour la discussion de ce sujet dans les textes didascaliques cf. C. Lafleur, « Dieu, la théologie et lamétaphysique au milieu du XIIIe siècle selon des textes épistémologiques artiens et thomasiens », Revue dessciences philosophiques et théologiques 89 (2005), p. 261-294.
19Gauthier, « Le cours », p. 78.20Gauthier, « Le cours », p. 99, 14-15. L’idée de bonheur qui s’unit à l’homme se trouve aussi chez
Arnulfus Provincialis, Divisio Scientiarum, in C. Lafleur (ed), Quatre introductions à la philosophieau XIIIe siècle. Textes critiques et étude historique, Montréal-Paris, Institut d’Études Médiévales-Vrin 1988,p. 335, 536-540.
21Gauthier, « Le cours », p. 116, 23-26, voir aussi le texte de la note 63.22La structure de l’âme rationnelle est le leitmotiv du commentaire ; cela démontre l’intérêt du maître
pour les problématiques psychologiques et aussi la cohésion du commentaire, car la même classification despuissances de l’âme se trouve dans l’exposition de la nova, ainsi que dans le prologue et dans l’expositionde la vetus.
23Zavattero, « Le prologue », p. 24, 169-25,179.
ANONYMUS MAGISTER ARTIUM 11
La double orientation des deux facultés vers le haut et vers le bas, exprimée par leslocutions comparatur ad superiora et comparatur ad inferiora, évoque la « théoriedes deux faces de l’âme » du Traité de l’âme d’Avicenne24. Cette doctrine jouissaitd’une certaine popularité chez les théologiens de la première moitié du XIIIe siècle25.Jean de la Rochelle l’utilise en la conjuguant aux notions pseudo-augustiniennes deratio superior et de ratio inferior empruntées au De spiritu et anima26. Philippe leChancelier, par contre, octroie à chaque face de l’âme une partie cognitive et une partiemotrice27. Notre maître ès arts tire probablement de cette tradition sa classificationdes puissances de l’âme : il applique le dédoublement opéré par Philippe aux deuxmembres de la division aristotélicienne en intellect théorétique et intellect pratique.Non seulement le premier intellect comporte deux parties, comme l’enseigne Aristote,mais aussi le second : l’intellect pratique— appelé souvent pars desiderativa oumotivaselon la terminologie avicennienne28 —, possède une partie supérieure et une partieinférieure qui correspondent respectivement à l’intellect agent et à l’intellect possible.
Au niveau cognitif, notre commentateur confère à l’intellect agent uneconnaissance indistincte (cognitio in summa ou sine fantasmate) et à l’intellectpossible la connaissance distincte (mediante fantasmate). Au niveau pratique, lapartie supérieure correspond à la volonté indistincte (in summa ou sine deliberatione)et possède une connaissance affective (cognitio cum affectu), tandis que la partieinférieure correspond au libre arbitre, voire à la volonté avec délibération (cumdeliberatione). Les deux parties de l’intellect impliquées dans la vie contemplativesont les deux facultés supérieures, qui sont toujours droites (rectae), à la différencedes facultés inférieures qui peuvent être droites ou non droites (rectae et non rectae),du fait qu’elles sont tournées ad inferiora, qu’elles sont en contact avec les êtresinférieurs.
Dans la section qui suit, nous analysons en détail les caractéristiques des deuxfacultés supérieures et de leurs activités, la cognitio in summa et la cognitio cum affectu,pour saisir quel type d’opération produit la vie contemplative.
L’intellect agent et la connaissance in summa
La classification des puissances établie par le maître montre qu’il conçoit l’intellectagent comme une puissance de l’âme. L’adhésion à cette doctrine range leCommentairede Paris parmi les témoins du « premier averroïsme » à Paris, à savoir dans la traditionissue des traités anonymes De anima et potenciis eius (ca. 1225) et De potentiis animaeet obiectis (ca. 1230), qui fut continuée par Philippe le Chancelier29.
24Avicenna, Liber de anima, S. Van Riet (ed.), Peeters/Brill, Louvain/Leiden 1972, I, 5, p. 93, 99-94,14.
25Sur l’origine et les voies de transmission de cette théorie de l’Antiquité au Moyen Âge, cf. V.A. Buffon,L’idéal éthique des maîtres ès arts de Paris vers 1250, avec édition critique et traduction sélectivesdu Commentaire sur la Nouvelle et la vieille Éthique du Ps.-Peckham, Thèse de doctorat, UniversitéLaval, Québec 2007, p. 84-134 (sur la doctrine chez le Commentaire de Paris, p. 122-125). Cf. aussiV.A. Buffon, « The Structure of the Soul, Intellectual Virtues, and the Ethical Ideal of Masters of Arts inEarly Commentaries on the Nichomachean Ethics », in I.P. Bejczy (ed.), Virtue Ethics in the Middle Ages :Commentaries on Aristotle’s Nicomachean Ethics, 1200-1500, Brill, Leiden-Boston 2007, p. 13-30.
26Pour l’explication de ratio superior/inferior (tirée de Ps-Augustin,De spiritu et anima, 11, PL 40, 787),cf. Iohannes de Rupella, Summa de anima, J.-G. Bougerol (ed.), Vrin, Paris 1995, II, 3, 73, p. 205-206.Pour la théorie des duae facies, cf. Ibid., I, 7, 45, p. 146-147.
27Philippus Cancellarius, Summa de bono, p. 104, 21-28.28Cf. Avicenna, De anima, I 5, p. 82, 40-41 ; Liber de causis primis et secundis, R. de Vaux (ed.), Notes
et textes sur l’avicennisme latin aux confins des XIIe-XIIIe siècles, Vrin, Paris 1934, p. 119-120.29Cf. R.-A.Gauthier, « Notes sur les débuts (1225-1240) du premier “averroïsme” », Revue des sciences
philosophiques et théologiques 66 (1982), p. 321-374. Pour l’édition du premier traité, cf. R.-A. Gauthier,
12 IRENE ZAVATTERO
Selon notre maître, l’intellect agent a « une connaissance générale et indistincte detoutes les choses », par conséquent il est toujours droit, sa connaissance ne commetpas d’erreur.
Illa enim pars speculatiui intellectus que est superior semper est recta, et illa parsuocatur intellectus agens, qui habet cognitionem omnium rerum in summa etindistincte ; unde dicit Boetius [Cons. Phil. V, m. 3] : « Summam retinet singulaperdit » ; et in cognitione huiusmodi intellectus non potest esse error30.
L’auteur décrit la cognitio in summa à l’aide d’une citation tirée de la Consolatiophilosophiae31 — summamque tenet singula perdens — au moyen de laquelle Boècedécrit le statut de la connaissance de l’âme qui, une fois la pureté originaire perdue, setrouve mêlée au corps. Cependant, cette âme unie au corps n’oublie pas totalement sonancienne condition et conserve l’idée de la totalité, à savoir une connaissance générale,alors même qu’elle n’a plus accès à la connaissance des singuliers, des choses prisesdans leur singularité.
Comme l’a démontré Gauthier, la source de cette doctrine est un passage de laSumma de bono portant sur la distinction de la connaissance chez l’homme et chezl’ange32 : au niveau le plus haut de la connaissance intellectuelle, qui concerne lesêtres supérieurs, l’opération de l’intellect agent humain est une connaissance innée,comme l’est celle des anges. À la différence de la connaissance angélique, elle demeurecependant globale et confuse. Toutefois, l’expression « in summa », que Philippe utilisepour parler de l’ange, reçoit chez le commentateur parisien une acception techniquequi signifie la connaissance « en bloc », indistincte et globale de l’intellect agent chezl’homme.
Par rapport à Philippe, le maître introduit une autre idée nouvelle : la connaissancein summa est un habitus inné de l’intellect agent, car « elle naît avec l’âme, laquellenaît avec l’amour du Premier Principe » :
humana anima secundum partem que uocatur agens habet cognitionem rerum insumma, et ista cognitio siue habitus innascitur cum ipsa anima. Item anima nasciturcum amore Primi, et iste habitus seu istud desiderium est innatum ; et secundumhuiusmodi habitus accipiendo intellectum, intellectus semper est rectus33.
Cette doctrine de l’intellect agent habitus, qui sera sévèrement critiquée dans lesdécennies suivants34, est formulée en termes augustiniens par Richard Fishacre. Endistinguant la mémoire propre à l’intellect possible, qui conserve les idées reçues parl’intelligence, de la mémoire propre à l’intellect agent, Richard définit cette dernière
« Le traitéDe anima et de potenciis eius d’un maître ès arts (vers 1225) », Revue des Sciences Philosophiqueset Théologiques 66 (1982), p. 3-55, 48. Pour l’édition du deuxième, cf. D.A. Callus, « The Powers of theSoul. An Early Unpublished Text », Recherches de théologie ancienne et médiévale 19 (1952), p. 131-179.
30Gauthier, « Le cours », p. 102,8-12.31Cf. Boetius, Philosophiae consolatio, L. Bieler (ed.), Brepols, Turnhout 1957, p. 96, 25.32Philippus Cancellarius, Summa de bono, p. 85, 81-93 L’idée d’une connaissance innée en l’intellect
se trouve aussi dans les premiers commentaires du De anima, bien qu’elle concerne l’intellect conçu commesubstance séparée, cf. P. Bernardini, « La dottrina dell’anima separata nella prima metà del XIII secolo e isuoi influssi sulla teoria della conoscenza (1240-60 ca.) », in I. Zavattero (ed.), Etica e conoscenza nelXIII e XIV secolo, Dip. di Studi storico-sociali e filosofici, Arezzo 2006, p. 27-37, notamment 31-33.
33Zavattero, « Le prologue », p. 24, 162-166.34Notamment par Albert le Grand, Bonaventure et Sigier de Brabant, cf. Gauthier, « Le cours »,
p. 89-92.
ANONYMUS MAGISTER ARTIUM 13
comme un habitus de toutes les formes intelligibles qui est inné à l’intellect dès sacréation35.
Ainsi décrit, l’intellect agent opère toujours droitement et possède une connaissanceinnée caractérisée par l’absence de contact avec les images36.
En définissant la vie contemplative, le maître ne mentionne pas la cognitio insumma, mais il attribue à l’intellect agent une cognitio sine fantasmate dont il nedécrit pourtant pas le procès cognitif ; il se contente de distinguer cette connaissancede la cognitio mediante phantasmate37. Selon Gauthier38, la source utilisée ici parnotre maître doit être recherchée dans la tradition des traités anonymes De animaet potenciis eius et De potentiis animae et obiectis, qui envisagent deux types deconnaissance de l’âme rationnelle, l’un coïncidant avec l’abstraction aristotélicienneet l’autre avec l’illumination augustinienne. Le premier type de connaissance abstraitles espèces des phantasmes, l’autre connaît les formes spirituelles au moyen d’uneillumination supérieure39. Philippe le Chancelier reprend aussi cette distinction. Ilutilise l’expression sine fantasmate pour désigner la connaissance des essences simplespar opposition à la connaissance des substances composées qui se réalise mediantephantasmate40.
La comparaison de notre commentaire avec ces textes semble suggérer que lacognitio sine fantasmate correspond à une connaissance des espèces par illuminationsupérieure, sans aucun contact avec les images des objets particuliers perçus par lessens41.
Ainsi, la cognitio sine fantasmate semble correspondre à la cognitio in summa :toutes les deux sont produites par l’intellect agent et ont en commun la même exclusiondu concours des données sensibles. Elles sont peut-être — comme le suggère OdonLottin — une transposition en termes abstraits de la théorie de l’illumination selonlaquelle l’intellect supérieur voit les choses en Dieu42.
35Richardus Fishacre, In Sent. I, Paris, Bibliothèque Nationale de France, lat. 15754, f. 10vb ; Città delVaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ottob. lat. 294, f. 8rb : « Duplex est in nobis memoria : Una quefit ex speciebus primo receptis in intelligencia et deinde in memoria repositis ; et hec est memoria intellectuspossibilis ; et hec sequitur intelligenciam et uoluntatem, quia quod primo intelligo et deinde amo, memoriterteneo. Alia est habitus omnium formarum intelligibilium in mente, saltem angelica, ex conditione sua ; ethec est memoria intellectus agentis in nobis, et de hac dicit Augustinus De Trinitate (XIV,5) : ipsa mensinfantis nosse se credenda est »
36Lectura in Ethicam veterem, f. 154rb : « sine dubio intellectus agens habet cognitionem rerum insumma et non habet cognitionem singulorum ; unde dicimus quod habitus sunt in ipso innati secundumquod habet cognitionem rerum in summa ».
37Gauthier, « Le cours », p. 116, 16-20 : « duplex est cognitio : est enim quedam cognitio sine fantasmateet est quedam cognitio mediante fantasmate ; et illa uita contemplatiua que attenditur penes scienciam etcognitionem que est sine fantasmate est de qua predicatur uita quam ponendo esse felicitatem non errabantphilosophi ».
38Gauthier, « Le cours », p. 81.39Cf. Gauthier, « Le traité », p. 53, 482-54, 487 ; Callus, « The Powers », p. 148, 19-21 ; p. 157, 12-14.40Philippus Cancellarius, Summa de bono, p. 271, 238-242.41D’ailleurs, le maître fait souvent référence à une illumination que l’intellect agent reçoit du Premier
Principe sans toutefois en expliquer précisément le rôle cognitif : Lectura in Ethicam veterem, f. 155rb :« bonitas datur nobis a Primo qui illuminat intellectum nostrum » ; cf. Zavattero, « Le prologue »,p. 29, 325-6. La même illumination est envisagée aussi pour la partie supérieure de l’intellect pratique,cf. Zavattero, « Le prologue », p. 29, 328-9.
42Cf. O. Lottin, « Psychologie et morale à la faculté des arts de Paris aux approches de 1250 », in Id.Psychologie et morale aux XIIe et XIIIe siècles, J. Duculot, Gembloux 1957, I, p. 505-534, ici 515.
14 IRENE ZAVATTERO
La partie supérieure de l’intellect pratique et la connaissance cumaffectu
Dans le commentaire de l’Ethica nova, le maître décrit les activités de la partiesupérieure de l’intellect pratique :
intellectus practici superior desiderat et appetit et cognoscit, set ista cognitio estcum affectu, et istud desiderium et ista uoluntas semper sunt recta ; ista enimuoluntas indistincta est, et hoc modo intelligit auctor cum dicit quod omnessummum bonum uolunt43.
L’auteur explique que « tous veulent le souverain bien » (EN I 1, 1094a2-3), commele dit Aristote, car ils le désirent selon la partie supérieure de l’intellect pratiquecaractérisée par un désir et une volonté toujours droits. Bien que cette volonté soitindistincte, les hommes ne peuvent se tromper en désirant le bien suprême, car ilsdésirent ainsi la fin ultime44.
Quelques lignes avant le passage cité, le maître avait distingué deux typesde volonté : la voluntas sine deliberatione, toujours droite, de la voluntas cumdeliberatione, responsable des actions bonnes ou mauvaises45. Cette distinctionremonte à celle de Jean Damascène46 entre une volonté naturelle (thelesis) et unevolonté rationnelle (bulesis), mais le maître puise plutôt aux reformulations que lesthéologiens contemporaines avaient données de la division du Damascène. Alexandrede Halès distingue entre volonté indefinita et definita47 et Philippe le Chancelier entrevoluntas naturalis et voluntas deliberativa48. Dans la Summa halensis—compilation del’école franciscaine parisienne datée de 1238-1255— la thelesis est appelée voluntas utnatura, à savoir appetitus generalis et indeterminatus, tandis que la bulesis est nomméevoluntas ut voluntas, à savoir volonté specialis et definita49. Au-delà des dénominationsquelque peu différentes, il nous semble que le concept de volonté indistincta ou sinedeliberatione dont parle notre maître ès arts coïncide avec la volition naturelle décritecomme appétit général et indéterminé par les théologiens de l’époque50.
En outre, à l’instar d’Alexandre de Halès, Philippe le Chancelier et les compilateursde la Summa halensis51 font correspondre la volition naturelle à la syndérèse.Pareillement, dans le commentaire de l’Ethica vetus, notre maître nomme sinderesis lapartie supérieure de l’intellect pratique52.
43Gauthier, « Le cours », p. 102, 14-18.44Gauthier, « Le cours », p. 102, 21-23 : « Et quamuis omnes uolunt summum bonum primo dicta
uoluntate, hoc est, etsi desiderent ipsum indistincte, sic non errant, quia finem appetunt ».45Gauthier, « Le cours », p. 101, 24-32.46Ioannes Damascenus, De fide orthodoxa : Version of Burgundio and Cerbanus, E.M. Buytaert (ed.),
St. Bonaventure, N.Y. 1955, p. 135, 67-136, 70.47Alexander Halensis, Quaestiones disputate antequam esset frater, PP. Collegii S. Bonaventurae
ad Claras Aquas (eds), Firenze 1960, I, p. 58, 16-18.48Philippus Cancellarius, Summa de bono, p. 162, 91-107.49Alexander Halensis, Summa theologica, PP. Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas (eds),
Firenze 1924, I, p. 479-480.50Bien que la thelesis de Damascène et la voluntas ut natura des théologiens semblent correspondre à
la « volonté de la fin » d’Aristote (cf. A. Robiglio, L’impossibile volere. Tommaso d’Aquino, i tomisti e lavolontà, Vita e Pensiero, Milano 2002, p. 21, 157, n. 10), il me semble que la notion de « volonté indistincte »ne vienne pas d’Aristote mais de la pensée théologique.
51Respectivement Alexander Halensis, Quaestiones disputate antequam esset frater, I, p. 592 ;Philippus Cancellarius, Summa de bono, p. 194, 50-54 ; Alexander Halensis, Summa theologica,II, p. 493a.
52Lectura in Ethicam veterem, f. 247rb : « Sinderesis dicit superiorem partem intellectus practici,proheresis autem dicit inferiorem partem intellectus ». Alexander Halensis, Glossa, II, p. 217, 11-16 ;
ANONYMUS MAGISTER ARTIUM 15
Cette faculté possède aussi une connaissance affective (cognitio est cum affectu)que le maître définit dans le commentaire de l’Ethica vetus :
pars desideratiua quantum ad superiorem partem habet dilectionem et affectumsibi innata, set hoc est in summa ; unde in summa habet predilectionem etcontemplationem53.
L’activité contemplative de la partie supérieure de l’intellect pratique est, commeson appétit, indistincte (in summa) et elle est caractérisée par l’amour et l’innéité. Ils’agit donc d’une contemplation de type affectif qui est innée en la partie supérieurede l’intellect pratique. Il ressort de l’analyse conduite jusqu’ici que les deux facultéssupérieures de l’intellect impliquées dans la définition de la vie contemplative secorrespondent et partagent les mêmes caractéristiques d’indistinction et d’innéité.
À propos de la partie supérieure de l’intellect pratique, le maître explique encoreque sa dilection et sa contemplation indistinctes et innées ne produisent pas les vertusintellectuelles. Toutefois, cette faculté possède aussi une connaissance distincte : elleconnaît séparément (discrete) les attributs du Premier Principe (potentia, sapientia,bonitas) et elle produit ainsi des habitus acquisiti qui sont les vertus intellectuelles54 :
Tamen ex doctrina, sicut prius dictum est, cognoscit bonitatem et potentiam etsapientiam discrete, et quia cognoscit bonitatem discrete, ideo diligit, et sic afficitur,et sic fit consummatio uirtutis intellectualis ; et hoc modo est uirtus intellectualishabitus acquisitus et non innatus55.
Auparavant (« sicut prius dictum est »), dans la sentencia de la leçon, lorsqu’il exposele sens des mots d’Aristote concernant la formation de la vertu intellectuelle (« eaquidem que intellectualis, multum ex doctrina habet, et generationem et augmentum »,EN II,1,1103a15-16), le maître explique que l’homme est instruit de la grandeur, de lavariété et de l’ordre des êtres par l’étude de la production du réel. Au moyen de cetenseignement (ex doctrina), l’homme contemple la puissance, la sagesse et la bonté deDieu. Étant donné que ce dernier attribut est la fin ultime de toute bonté, il aime Dieu.Ainsi se produit l’achèvement de la vertu intellectuelle qui consiste en la contemplationdu Premier Principe et en son amour56.
Dans ce passage, le commentateur fait un usage remarquable d’une doctrine typiquede la théologie du XIIe siècle, celle de la triade potentia-sapientia-bonitas. À la suited’Hugues de Saint Victor et de Pierre Abélard, les théologiens corrélaient ces trois
381, 5-8 ; 383, 16-19 situe la syndérèse dans la partie supérieure de la faculté motiva ; son enseignementest repris par le traité De anima et potenciis eius (Gauthier, « Le traité » p. 54, 491) et par le De potentiisanimae et obiectis (Callus, « The Powers », p. 159, 18-22).
53 Lectura in Ethicam veterem, f. 154rb.54Le maître s’éloigne d’Aristote, qui considère les vertus intellectuelles comme produites par l’intellect
spéculatif. Voir aussi Lectura in Ethicam veterem, f. 154va : « operationes que sunt partis desideratiue incomparatione ad superiora [. . .] in hoc consistit uirtus intellectualis ».
55Lectura in Ethicam veterem, f. 154va.56Lectura in Ethicam veterem, f. 154ra : « Per exitum rerum in esse, potest nobis doceri Dei substantia ;
item per multitudinem rerum et magnitudinem possumus doceri de cognitione Primi et per ordinem. Undecum uidemus res exire in esse et magnitudinem et multitudinem rerum et ordinem possumus ex doctrinacognoscere, hic est contemplari dei essentiam et sapientiam per ordinem et bonitatem et quia contemplamussuam bonitatem. Bonitas autem sua est bonitas in fine bonitatis, ideo diligimus ipsum et sic fit consummatiouirtutis intellectualis. Et sic patet quod uirtus intellectualis consistit in contemplatione primi boni et dilectioneeius uel affectum ».
16 IRENE ZAVATTERO
attributs aux trois personnes de la Trinité57. Quant à notre maître, il utilise cette triadepour expliquer le statut des vertus intellectuelles : celles-ci sont des habitus acquis parceque l’intellect connaît discrete les trois attributs. Il souligne surtout la tâche des vertusintellectuelles : elles contemplent les attributs de Dieu et leur connaissance est affective.Durant tout le commentaire, le maître répète que la vertu intellectuelle consiste « incontemplatione Primi et dilectione eiusdem »58 et il souligne son but spécifique, quiest d’aimer le Premier Principe : « dilectio Primi est obiectum intellectualis et finis »59.
En ce qui concerne l’attribution d’une connaissance affective aux vertusintellectuelles, il semble que le maître se soit encore une fois inspiré du traitéthéologique De potentiis animae et obiectis60. Il est toutefois indéniable que ladilection et l’amour, si souvent mis en exergue par le maître, renvoient à la moralechrétienne, dont le premier et le plus fondamental des préceptes est d’aimer Dieu poursa propre bonté intrinsèque et infinie61.
La vie contemplative produit une connaissance affectiveLa définition de la vie contemplative à laquelle nous avons fait allusion tout au long denotre étude est contenue dans le commentaire du passage de l’Ethica nova concernantles trois types de vie (EN I 3, 1095b17-19). Le maître décrit la vie contemplative selonle point de vue des philosophes et des théologiens. Penes theologos la vie contemplativeest imparfaite à l’instar des vies de jouissance et politique : seule la vie future de l’âmeséparée est bienheureuse62. Par contre, selon les philosophes — qui ne s’y trompèrentpas, précise le maître, lorsqu’ils identifièrent le bonheur à la vie contemplative —, elleest une synthèse de vertu et de connaissance :
Est autem alia respontio secundum philosophos et hec est respontio. Dicendum estquod uita in quam ponendo felicitatem non errabant philosophi predicatur de uitacontemplatiua ; set dicendum est quod uita contemplatiua est secundum uirtutemet scienciam siue cognitionem63.
Il ne s’agit pourtant pas de la vertu et de la science au sens courant, mais de la vertude la partie supérieure de l’intellect pratique et de la connaissance « sans images »(cognitio sine fantasmate) produite par la partie supérieure de l’intellect spéculatif64.
57Cf. D. Poirel, Livre de la nature et débat trinitaire au XIIe siècle. Le ‘De tribus diebus’ de Hugues deSaint-Victor, Brepols, Turnhout 2002, p. 261-420 a attribué à Hugues la paternité de la triade qu’on attribuaitauparavant à Abélard. Les thèses de Poirel sont discutées par M. Perkams, « The Origins of the TrinitarianAttributes potentia, sapientia, benignitas », Archa verbi 1, 2004, p. 25-41 ; G. Allegro, Teologia e metodoin Pietro Abelardo, Officina di Studi Medievali, Palermo 2010, p. 103-147 et 214-231.
58Lectura in Ethicam veterem, f. 153vb et encore f. 154ra : « complementum ipsius [uirtutis intellectualis]est contemplatio Primi cum dilectione et affectu eiusdem ».
59Lectura in Ethicam veterem, f. 154rb.60Cf. Callus, « The Powers », p. 161, 10-14. D’ailleurs cette idée était répandue chez les maîtres ès
arts de l’époque, notamment chez le compilateur du Guide de l’étudiant (1230-1240), chez le Ps.-Peckhamdans son commentaire sur l’Ethica nova et vetus (1240-44) et chez Arnoul de Provence dans la Divisioscientiarum (~ 1250) ; cf. V.A. Buffon, « Philosophers and Theologians on Happiness. An Analysis ofEarly Latin Commentaries on the Nicomachean Ethics », Laval théologique et philosophique, 60,3 (2004),p. 449-476 ; I. Zavattero, « Felicità e Principio Primo. Teologia e filosofia nei primi commenti latiniall’Ethica Nicomachea », Rivista di storia della filosofia 61 (2006), p. 109-136.
61J. Rohmer, La finalité morale chez les théologiens de saint Augustin à Duns Scot, Paris, Vrin 1939,p. 7.
62Gauthier, « Le cours », p. 116, 9-11 : « [. . .] de illa uita que est cum anima separata potest praedicarifelicitas et sic patet quod non sumit hic sufficienter modos ipsius uite. Et ista respontio est penes theologos ».
63Gauthier, « Le cours », p. 116, 12-15.64Cf. texte de la note 21.
ANONYMUS MAGISTER ARTIUM 17
Compte tenu des passages analysés dans les paragraphes précédents, on peutidentifier la uirtus mentionnée sans autre spécification dans la définition de la viecontemplative à la vertu intellectuelle chargée de la contemplation affective du PremierPrincipe, tandis que la scientia ou cognitio sine fantasmate correspond à la connaissanceglobale et indistincte, à la cognitio in summa.
Étant donné que ces deux connaissances sont innées en l’âme, la vie contemplativeproduite par leur action conjointe est une forme de vie à la quelle l’homme est prédisposépar nature. En outre, puisque le bonheur réside dans la vie contemplative, l’homme estprédisposé au bonheur par son inclination naturelle à connaître et aimer Dieu.
Ces conclusions semblent contredire l’inaptitude de l’homme à parvenir parsoi-même au souverain bien, inaptitude que nous avons mise en évidence au début decette contribution. D’autres passages du commentaire attestent pourtant de la cohérencede la doctrine du maître.
Dans l’exposition de la nova on lit : « uirtus secundum quam attenditur uitacontemplatiua est medium quo nobis unitur felicitas »65. La vertu selon laquellel’homme réalise la vie contemplative n’est que le moyen par lequel le bonheur s’unit àlui.
Dans l’exposition de la vetus, en commentant le passage où Aristote souligne queson traité sur les vertus n’a pas une fin spéculative, mais pratique (EN II 2, 1103b26-30),le maître insiste sur l’idée que la contemplation produite par les vertus intellectuelles ala fonction d’unir l’homme à Dieu :
Duplex est contemplatio, quedam enim est contemplatio que est finis rerumnaturalium vel rationalium et quedam est contemplatio que est finis uirtutumintellectualium. Et contemplatio quod est finis rationalis philosophie uel naturalisnon est nobilior quam uirtus siue bonum fieri, quia secundum uirtutem unimurPrimo, secundum autem illam speculationem non. Set illa speculatio que est finisintellectualium uirtutum est nobilior uirtute quia magis fit unio ad Primum peripsam quam per uirtutem consuetudinalem66.
La contemplation qui est la fin de la philosophie rationnelle est non seulement moinsnoble que la contemplation qui est la fin des vertus intellectuelles, mais elle est aussiinférieure à l’opération de la vertu morale qui rend l’homme bon (uirtus siue bonumfieri), car la contemplation rationnelle n’unit pas l’homme à Dieu.
De ce passage on déduit que la contemplation produite par les vertus intellectuellesne coïncide pas avec la spéculation rationnelle et qu’elle est le moyen de l’unionà Dieu. Par conséquent, l’inclination naturelle à la connaissance affective de Dieupeut s’exprimer dans la vie contemplative, mais celle-ci ne réalise pas le bonheur enl’homme ; elle constitue seulement le moyen de l’accès au bonheur, la condition idéalede l’union à Dieu.
En distinguant deux types de contemplation, le maître force le sens du passage de lavetus, car Aristote y dit explicitement de ne pas étudier la vertu en son essence, à savoird’un point de vue spéculatif, mais d’un point de vue pratique, en tant qu’activité quirend l’homme vertueux (ut boni fiamus). Par contre, le maître élève le rôle des vertusmorales ; il en fait des moyens en vue de l’union à Dieu et il insère une référence auxvertus intellectuelles, responsables du deuxième type de contemplation, en soulignantqu’elles réalisent l’union à Dieu plus que ne le font les vertus morales. Le maître utilisedonc les mots d’Aristote pour faire place à la connaissance affective, en soulignantqu’elle n’est pas une connaissance rationnelle et qu’elle est la contemplation la plusnoble en raison de son but : l’union à Dieu.
65Gauthier, « Le cours », p. 115, 17-18.66Lectura in Ethicam veterem, f. 157rb.
18 IRENE ZAVATTERO
Ce passage confirme donc que la vie contemplative, synthèse de la cognitio insumma et de la cognitio cum affectu, ne conduit pas à une connaissance rationnelle deDieu, mais à l’union avec lui. En cette union, réalisée par Dieu (unimur Primo), résidele bonheur qui s’unit à nous (« de felicitate, que unitur nobis ») et qui est Dieu-même,comme nous l’avons expliqué au début67.
Philosophe ou théologien ?Cette analyse permet enfin d’évaluer la conformité ou la distance du commentaire dumaître anonyme par rapport à la pensée aristotélicienne et de revenir à la questionposée au début : interprète-t-il la littera d’Aristote en philosophe ou en théologien ?
Les doctrines étudiées montrent que le maître se démarque significativementd’Aristote. L’idée d’un bonheur transcendant qui n’est pas à faire mais qui existe estdiamétralement opposée à la doctrine aristotélicienne du bonheur comme opérationde l’homme (EN I 6, 1097b24-1098a20). La connaissance sans phantasmes est auxantipodes de la pensée d’Aristote, qui affirme la nécessité du phantasme pour touteconnaissance possible de l’âme (De anima III 7, 431a16-17). La contemplation affectiven’est pas moins étrangère à Aristote et à sa théorie des vertus intellectuelles, habitusde l’intellect spéculatif perfectionnant la raison et visant à la connaissance du vrai (ENVI 12). De fait, la vie contemplative caractérisée par l’amour de Dieu que théorisenotre maître est contraire à la vie contemplative d’Aristote, qui est une connaissancestrictement intellectuelle et qui a l’ambition d’achever le sujet qu’est l’intellect, nonde le dépasser pour atteindre un objet transcendant (EN X 7, 1177a12-17). Ainsi,l’idée que le bonheur consiste dans l’union de l’homme à Dieu, doctrine typique de lamorale chrétienne, est opposée à la morale d’Aristote centrée sur le perfectionnementde l’homme dans sa dimension terrestre.
Ces idées anti-aristotéliciennes ne sont que les conséquences du principefondamental de l’herméneutique du maître : l’identification du bien suprême à Dieu,alors que l’enseignement d’Aristote concevait ce bien comme l’activité de l’âmeselon la vertu, à savoir la meilleure et la plus achevée des activités humaines (EN I 6,1098a17-18). Le commentateur adhère au paradigme chrétien élaboré par Augustin etdominant durant les siècles précédents, qui avait finalisé la réflexion éthique par lathéologie.
Comme nous l’avons souligné, notre commentateur tire toutes ces doctrinesanti-aristotéliciennes de la pensée théologique : il les développe en des termesnouveaux. Souvent, il les réélabore de manière plus technique.
Bien que plusieurs aspects du commentaire doivent encore être étudiés68, sur labase des passages analysés il est possible de conclure que le profil intellectuel du maîtrecorrespond à celui tracé par Gauthier : « notre maître ès arts se veut philosophe, ilexplique Aristote, il le connaît bien, mais il reste, quoi qu’il en ait (sic), un théologien ».Toutefois, le jugement que formule Gauthier à la suite de son analyse minutieuse etremarquable adopte une forme rhétorique, qui nécessite quelques mises au point.
« Le maître se veut philosophe » ne signifie pas qu’il revendique le rôle dephilosophe et qu’il défende le point de vue philosophique. Quand il traite de thèmeséthiques délicats, comme de la définition de la vie contemplative, il présente les pointsde vue des philosophes et des théologiens, sans établir cependant d’opposition et sans
67Cf. supra n. 20.68Notamment l’influence des Arabes, en particulier d’Avicenne, sur la pensée du maître, dans le but
d’examiner si les allusions aux doctrines arabes (par ex. l’illumination du Premier Principe) sont un empruntdirect ou médiatisé par les théologiens de l’époque. Finalement, il convient d’évaluer la doctrine du maîtredans le contexte doctrinal parisien de la première moitié du XIIIe siècle, à savoir par rapport aux « courants »que l’historiographie a décrits en termes de « premier averroïsme » et d’« avicennisme augustinisant ».
ANONYMUS MAGISTER ARTIUM 19
exprimer une prise de position personnelle69. La seule fois qu’il se range parmi lesphilosophes, c’est en discutant de la responsabilité du mal ; il affirme alors qu’il n’ya pas de positions différentes : « apud nos et apud theologos nos omnino sumumprincipium mali »70.
Ainsi, cette distinction entre théories philosophique et théologique ne se présentepas comme une démarcation méthodologique, mais bien comme l’exposition de deuxpoints de vue que le maître prend soin de présenter pour s’acquitter de sa missionpédagogique : informer les élèves sur les différentes positions au sujet des grandsthèmes éthiques et montrer la divergence essentielle des deux approches. Partant, sonrôle de ‘philosophe’ ne consiste que dans cette compétence que relève Gauthier : « ilexplique Aristote, il le connaît bien », c’est-à-dire dans son métier de maître ès arts.
Le commentateur est conscient de sa mission, qu’il énonce explicitement : « icinous ne devons pas résoudre les questions selon le point de vue des théologiens,mais plutôt selon l’intention du Philosophe »71. Cette mise au point semble exprimerl’intention du maître : il veut suivre de près l’EN et l’interpréter au mieux. Cela nel’empêche cependant pas d’user de concepts étrangers à la pensée d’Aristote, tirés destextes des théologiens de l’époque. La définition de la vie contemplative en est unexemple emblématique : le maître expose le point de vue philosophique, il le partage etl’adopte dans tout son commentaire ; il construit une théorie de la contemplation qui soitcohérente et unitaire, mais qui est bâtie sur des doctrines empruntées aux théologiens.On se demande donc si le point de vue exposé est vraiment philosophique et quelsétaient ces philosophi qui « ne se trompèrent pas lorsqu’ils attribuèrent le bonheur àla vie contemplative ». En général, les médiévaux désignent par « philosophi » lesphilosophes de l’antiquité, mais, dans notre cas, il paraît bien difficile d’identifier lesauteurs de l’antiquité visés par le maître. Une explication possible serait que le maîtres’inspire de l’éloge des platoniciens par Augustin dans le chapitre du De civitate Dei(VIII, 8) dédié à la philosophie morale. Selon Augustin, Platon et ses disciples ontcompris que le souverain bien transcende les biens corruptibles du corps et de l’âme,et qu’il consiste en l’union à Dieu au moyen de la connaissance et de l’amour. On peutsupposer que le commentateur reprend cette idée augustinienne et qu’il l’élabore à l’aidede doctrines qui circulaient à Paris et qui étaient conformes au principe herméneutiquede l’identification du bien suprême à Dieu. Si cette hypothèse est fondée, le point devue ‘philosophique’ renverrait à la lecture théologique de la pensée antique proposéepar Augustin.
L’affirmation de Gauthier, « il reste un théologien », est donc tout à faitconvaincante : le maître emprunte les outils qui lui servent à interpréter l’EN dans laculture de son temps, profondément marquée par des motifs augustiniens.
En conclusion, le profil intellectuel de ce maître anonyme nous semble digned’intérêt ; alors qu’on s’attendrait à rencontrer la philosophie d’Aristote chez uncommentateur de l’EN, chez notre maître ès arts on découvre en effet une doctrinecohérente et non dépourvue de profondeur, qui est imprégnée de théologie. En outre,son portrait est intéressant dans la mesure où il contribue à la reconstruction de lafigure du maître ès arts de la première moitié du XIIIe siècle et dans la mesure où ilfournit des informations sur l’enseignement à la Faculté des arts.
69Le même procédé se rencontre dans la discussion de la priorité de l’habitus dans l’agir morale,cf. I. Zavattero, « L’acquisition de la vertu morale dans les premiers commentaires latins de l’Éthique àNicomaque », in A.Musco, C. Compagno, S. D’Agostino, G. Musotto (eds) Universalità della ragione.Pluralità delle Filosofie nel Medioevo. XII Congresso Internazionale di Filosofia Medievale, Palermo 17-22settembre 2007, Officina di Studi Medievali, Palermo 2012, II.1, p. 235-243.
70Lectura in Ethicam veterem, f. 155rb.71Lectura in Ethicam veterem, f. 243ra : « hic non debemus soluere quemadmodum theologi, sed
secundum intentionem philosophi », il l’affirme dans un passage concernant l’habitus des vertus morales,après avoir présenté la position théologique qui conçoit l’habitus comme infus.
20 IRENE ZAVATTERO
Comme le rappelle Olga Weijers, il ne faut pas se limiter « à considérer les textesmédiévaux comme autant de sources d’information directe, sans se soucier du faitque ces textes ont eux-mêmes une histoire et un contexte. En les utilisant, il faut tenircompte de plusieurs aspects : les conditions de leurs transmission matérielle (dictée,reportation, copie, etc.), les modalités de transmission de leur contenu (emprunts,circulation des idées) et, finalement, le fait que ces textes étaient destinés à un publicet qu’ils appartenaient à un genre littéraire »72. Conformément à cette exhortationméthodologique, il est possible de réunir plusieurs données utiles à la réalisation duportrait de notre maître.
En effet, on ne peut apprécier la particularité de la doctrine de notre maître eten découvrir les motivations plausibles qu’en considérant le Commentaire de Parisdans le contexte de la Faculté des arts parisienne de la première moitié du XIIIesiècle. La réception de la pensée d’Aristote est dans sa première phase et l’assimilationgraduelle de l’éthique procède dans un premier temps à un détournement par rapportaux idées foncières d’Aristote. On peut supposer que le maître a de la peine à se libérerde la morale augustinienne dominante ou alors qu’il essaie de christianiser l’éthiquearistotélicienne afin de la réconcilier avec la théologie augustinienne73. D’ailleurs, sescollègues commentateurs de l’Ethica nova et vetus rencontrent les mêmes difficultésthéoriques à l’endroit de la coïncidence entre bonheur et summum bonum : ils adoptentune approchemétaphysique qui identifie le bien suprême, et par conséquence le bonheur,au Premier Principe. Le seul qui se démarque alors de cette approche, en soulignant ladimension pratique de l’éthique d’Aristote, est Robert Kilwardby74.
Si l’on tient compte de la transmission fragmentaire du texte de l’EN, on doitaussi remarquer qu’elle ne permet pas au maître anonyme de connaître la définitionaristotélique de la vie contemplative contenue dans le dixième livre et laissée ensuspens dans le premier. Cette lacune pourrait expliquer la définition du maître commeune tentative de combler le vide laissé par Aristote au moyen de la doctrine de lacontemplation courante à Paris, la théorie augustinienne.
En outre, le genre littéraire utilisé, à savoir le commentaire sous forme de lectiones,courant à Paris durant la période 1230-126075, répond aux exigences d’enseignement dumaître qui, après la présentation de la structure et du sens littérale de l’EN dans la divisiotextus et dans l’expositio litterae, profite des quaestiones pour aborder des problèmesqui ne sont pas toujours strictement liés au texte, et pour construire ainsi une doctrinehétérogène à Aristote. Le choix d’un autre genre littéraire comme l’expositio, choisiepar Kilwardby, aurait relégué à de simples notanda l’approfondissement doctrinal etpeut-être défavorisé l’élaboration d’une doctrine unitaire.
Enfin, il ne faut surtout pas oublier que notre maître s’adresse aux étudiants ès arts :c’est d’abord pour ces destinataires-là qu’il forge son interprétation christianisante del’EN et qu’il fait preuve d’un certain souci pédagogique : présenter les différents points
72O. Weijers, « Les genres littéraires à la Faculté des arts », Revue des sciences philosophiques etthéologiques 82,4 (1998), p. 631-641, ici 631 [réimpr. dans Ead., Études sur la Faculté des arts dans lesuniversités médiévales. Recueil d’articles, Brepols, Turnhout 2011, p. 146-155, ici p. 146].
73La même démarche christianisant est suivie par le maître ès arts anonyme qui commente, dansles même années, le De anima, cf. Anonymi magistri artium, Lectura in librum de anima a quodamdiscipulo reportata (Ms. Roma Naz. V. E. 828), R.A Gauthier (ed.), Collegii S. Bonaventurae ad ClarasAquas, Grottaferrata 1985. L’affirmation de Gauthier (p. 22*) « l’Aristote des Artistes n’était pas seulementun Aristote chrétien, c’était un Aristote platonicien » est applicable aussi à l’herméneutique de notrecommentateur.
74Cf. Zavattero,« Le bonheur parfait ». L’approche métaphysique est utilisée surtout par le Ps.-Peckham.75Cf. O. Weijers, La structure des commentaires philosophiques à la Faculté des Arts : quelques
observations, in G. Fioravanti, C. Leonardi, S. Perfetti (eds), Il commento filosofico nell’Occidentelatino (secoli XIII-XV), Brepols, Turnhout 2002, p. 17-41, notamment 17-19 [réimpr. dans Weijers, Étudessur la Faculté des arts, p. 193-217, ici 193-195].
ANONYMUS MAGISTER ARTIUM 21
de vue philosophique et théologique. Ainsi, plutôt que d’interpréter la conciliation entrethéologie augustinienne et philosophie aristotélicienne établie par le commentateurcomme une stratégie politique — c’est-à-dire comme un indice du fait que les maîtresd’alors « ont à cœur de vivre en parfaite intelligence avec leurs puissant voisins, gardiensattitrés de l’orthodoxie »76 — il nous semble que l’on doive simplement considérer cetteharmonisation comme le résultat des objectifs de l’enseignement. Le maître s’attacheà expliquer l’Ethica nova et vetus et à persuader de certaines vérités, en puisant dansson bagage intellectuel et en mettant en œuvre les dispositifs culturels de son temps.
76Lottin, « Psychologie et morale », p. 534.
INDEX DES MANUSCRITS 25
INDEX DES MANUSCRITS
Avranches,Bibliothèque Municipale,MS. 232, 7
Cambridge,Peterhouse College,MS. 206, 7
Città del Vaticano,Bibl. Apostolica Vaticana,Ottob. Lat. 294, 13
Firenze,Biblioteca Nazionale,MS. Conv. Soppr. G. 4 853, 7
Napoli,Biblioteca Nazionale,MS. VIII G 8, 7
Oxford,Bodleian Library,MS. Lat. Misc. C. 71, 7
Paris,Bibl. nationale de France,lat. 3572, 7lat. 3804 A, 7lat. 15754, 13
Bibliothèque de la Sorbonne,MS. 1338, 8
Prague,Národní knihovna,MS. VIII. F.10, 7
Roma,Biblioteca Nazionale,MS. V.E. 828, 20
26 INDEX
INDEX DES AUTEURS ANCIENS ET MÉDIÉVAUX
Albertus Magnus, 12Alexander Halensis, 8, 9, 14Anonymi magistri artium, 20Aristoteles, 8, 9, 11, 14, 15, 17–20Arnulfus Provincialis, 9, 10, 16Augustinus Hipponensis, 9, 13, 16, 18,
19Avicenna (Abu ãAlı l-H. usayn ibn Sına),
9, 11, 18Boethius (Anicius Manlius Severinus),
12Bonaventura de Balneoregio, 12Burgundius Pisanus, 7, 14Cerbanus Monahus Hungarus, 14al-Gazali (Abu H. amid ibn Muh. ammad
al-Ghazalı), 9Hugo de Sancto Victore, 16Iohannes Damascenus, 14Iohannes de Rupella, 11Iohannes Duns Scotus, 16Johannes Lemovicensis, 8Petrus Abaelardus, 15, 16Philippus Cancellarius, 8, 9, 11–14Ps. Augustinus Hipponensis, 11Ps. Peckham, 7, 11, 16, 20Richardus Fishacre, 12, 13Robertus Kilwardby, 7, 8, 20Sigerus de Brabantia, 12Thomas de Aquino, 8, 14
INDEX DES AUTEURS MODERNES 27
INDEX DES AUTEURS MODERNES
Allegro, G., 16Bejczy, I.P., 11Bernardini, P., 12Bieler, L., 12Bossier, F., 7Bougerol, J.-G., 11Buffon, V.A., 7, 11, 16Buytaert, E.M., 14Callus, D.A., 12, 13, 15, 16Compagno, C., 19D’Agostino, S., 19de Vaux, R., 11Delisle, L., 8Fioravanti, G., 20Gauthier, R.-A., 7–20Gorochov, N., 8Hamesse, J., 7, 8Holtz, L., 8König-Pralong, C., 7Lafleur, C., 9, 10Langlois, L., 9Leonardi, C., 20Lewry, P.O., 8Lottin, O., 13, 21Muckle, J.T., 9Musco, A., 19Musotto, G., 19Perfetti, S., 20Perkams, M., 16Poirel, D., 16Robiglio, A., 14Rohmer, J., 16Sclafer, J., 8Sturlese, L., 7Tracey, M.J., 7Van Riet, S., 9, 11Weijers, O., 8, 20Wenin, C., 8Wicki, N., 9Zarka, Y.-Ch., 9Zavattero, I., 7–10, 12, 13, 16, 19, 20
Collection « Textes et Études du Moyen Âge »
publiée par la Fédération Internationale des Instituts d’Études Médiévales
Volumes parus :
Orders must be sent to // Les commandes sont à adresser à :
Brepols PublishersBegijnhof 67B-2300 Turnhout (Belgium)
Phone +32 14 44 80 30 Fax +32 14 42 89 19
http ://www.brepols.net E-mail : [email protected]