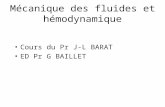Profil intellectuel et relations interpersonnelles chez des enfants et des adolescents surdoués
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Profil intellectuel et relations interpersonnelles chez des enfants et des adolescents surdoués
R
pMdvppRupgCdpa©
M
A
sMaVa(Rais
0d
Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence 57 (2009) 379–384
Article original
Profil intellectuel et relations interpersonnelles chez des enfantset des adolescents surdoués
Intellectual profile and interpersonal relationships in gifted children and adolescents
N. Kostogianni a,∗, A. Daoudi b, A. Andronikof a
a Département de psychologie, laboratoire IPSé, université Paris-Ouest Nanterre La Défense, 200, avenue de la République, 92001 Nanterre, Franceb Eurotalent, comité européen pour l’éducation des enfants et adolescents précoces, surdoués, talentueux, 13, rue Antoine-Chantin, 75014 Paris, France
ésumé
Le but de l’étude est de repérer les liens entre le profil intellectuel (homogène versus hétérogène en faveur des aptitudes verbales), les troublessychopathologiques et la perception de soi et des relations interpersonnelles chez des enfants et des adolescents surdoués.éthode. – Nous avons recruté des surdoués (QIT ≥ 130 au WISC-III) âgés entre neuf et 15 ans et ayant un profil homogène (QIV-QIP ≤ 12, groupe
es surdoués globaux, n = 52) et des surdoués ayant un profil hétérogène en faveur des aptitudes verbales (QIV-QIP > 20, groupe des surdouéserbaux, n = 46). Ils sont tous scolarisés dans des établissements scolaires classiques. Nous avons utilisé le Rorschach en système intégré (RSI)our étudier la perception de soi et des relations interpersonnelles et la liste de comportements pour enfants (CBCL) pour évaluer la présence deroblèmes émotionnels et comportementaux.ésultats. – Les deux groupes de surdoués ne se différencient pas à la CBCL. Le RSI met en évidence dans le groupe de surdoués verbauxne dévalorisation de soi (indice EGO) qu’ils abordent de facon très intellectualisée (Hx > 0). Les surdoués verbaux montrent moins d’intérêtour les autres (H < 2 ; COP < 2 et AG < 2) et éprouvent plus de difficultés dans les relations interpersonnelles (CDI > 3) que les surdouéslobaux.onclusion. – Nous n’avons pas trouvé de lien entre le profil intellectuel et les troubles émotionnels et comportementaux dans ces groupes’enfants et d’adolescents surdoués. Un écart important entre les QIV-QIP ne devrait pas être interprété comme étant indicatif d’une organisationsychopathologique. Cependant, les surdoués verbaux présentent un investissement de soi plus faible et des difficultés plus importantes à se lierux autres.
2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
ots clés : Surdoués verbaux; Relations interpersonnelles; Profil intellectuel; Rorschach système intégré; Psychopathologie
bstract
We study the relationship between intellectual profile (even versus uneven profile in favor of verbal abilities), emotional/behavioral problems,elf-perception and interpersonal perception in gifted children and adolescents.ethod. – Ninety-eight non patient gifted children and adolescents (age range 9 to 15; Full Scale IQ ≥ 130 on the WISC-III) were recruited through
n association for gifted children. Two subgroups were compared: the globally gifted (n = 52) presenting no more than a 12 points difference betweenIQ and PIQ and the verbally gifted (n = 46), with a minimum of 20 points difference between VIQ and PIQ and VIQ greater than PIQ. All subjects
re attending regular educational program. Self-perception and interpersonal perception is examined with the Rorschach Comprehensive SystemRCS). The Child Behavior Checklist (CBCL) is also administered to measure emotional and behavioral problems.esults. – No significant difference on the CBCL is found between the two groups. The RCS distinguished verbally from globally gifted children
h (EGO) and they attempt to deal with issues of self-image in an overly
nd adolescents. Verbally gifted have a more negative personal wort ntellectualized manner (Hx > 0). They are less interested in others (H < 2; COP < 2 et AG < 2) and tend to feel less comfortable in interpersonalituations (CDI > 3) than globally gifted.∗ Auteur correspondant. Laboratoire IPSé, université Paris-Ouest-Nanterre-La-Défense, 200 avenue de la République, 92001 Nanterre, France.Adresse e-mail : [email protected] (N. Kostogianni).
222-9617/$ – see front matter © 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.oi:10.1016/j.neurenf.2009.05.002
3
CSs©
K
1
tcvWshslbgc
f[rfevmvàpQlsdad
iddCctLaaced(clstf
80 N. Kostogianni et al. / Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence 57 (2009) 379–384
onclusion. – We found no relation between intellectual profiles and emotional and behavioral problems in gifted children and adolescents.ignificant VIQ greater than PIQ discrepancies shouldn’t be interpreted as related to psychopathology. However, verbally gifted lack of sufficientelf-concern and have more difficulties relating with others than globally gifted.
2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
schac
asd
rpDlfta
missddWpd
mvmratanvd
dfiltrtpi
2
2
eywords: Verbally gifted; Interpersonal relationships; Intellectual profile; Ror
. Introduction
Les sujets surdoués sont définis par un quotient intellectuelotal (QIT) d’au moins deux écart-types supérieur à la moyenne,e qui correspond à un QIT supérieur ou égal à 130 à la troisièmeersion de l’échelle d’intelligence de Wechsler pour enfants, leISC-III [1]. Le WISC-III et depuis récemment le WISC-IV [2]
ont les outils les plus fréquemment utilisés pour l’évaluation duaut potentiel intellectuel [3,4]. L’utilisation d’un score globaluggère la présence d’aptitudes hautement supérieures dans touses domaines évalués par les tests d’intelligence (surdoués glo-aux). Cette conception polyvalente des surdoués méconnaît larande disparité des profils intellectuels retrouvés au sein deette population [3].
Plusieurs recherches ont établi que plus le QIT est élevé, plusaible est la corrélation entre les sous-tests du test d’intelligence5–8]. Le fonctionnement cognitif tend à être d’autant plus hété-ogène que le QI est élevé. Chez les enfants surdoués, l’écartréquemment observé entre le quotient intellectuel verbal (QIV)t le quotient intellectuel de performance (QIP) est la forme deariabilité intra-individuelle la plus souvent évoquée. Le QIVesure la conceptualisation, la connaissance et l’expression
erbale ; le QIP mesure l’intelligence non verbale, l’aptitudetraiter des stimuli visuospatiaux et à résoudre des nouveaux
roblèmes [9]. Le plus souvent, l’écart est observé en faveur duIV [10–13]. Dans le manuel du WISC-III [1], une étude réa-
isée sur 81 sujets à très haut QIT conclut que lorsqu’un écartignificatif entre les deux échelles est observé, il est en faveuru QIV dans 76 % des cas. Bessou et al. [14] analysent le profilu WISC-III de 245 enfants surdoués. Le QIV y est dans 82 %es cas supérieurs au QIP de 14 points en moyenne.
D’après les psychométriciens, l’écart entre le QIV et le QIPndique que le surdouement peut être spécifique à des domaines’aptitudes comme par exemple le surdouement verbal. Cepen-ant, d’autres interprétations sont proposées dans la littérature.ertains praticiens considèrent cette hétérogénéité des aptitudesomme étant le signe d’une « dyssynchronie » développemen-ale qui serait vécue comme une source de stress et de frustration.es surdoués verbaux doivent faire face plus que les surdouésyant un profil homogène au décalage qui existe entre lesptitudes verbales et le développement staturopondéral, psy-homoteur et affectif. Même si ces enfants conceptualisent trèsfficacement ce qu’ils veulent accomplir, leur développementans les autres secteurs reste conforme à leur âge physiologiquepar exemple, le manque de dextérité manuelle) en les empê-hant de concrétiser leurs aspirations [15]. Selon Kaufman [9]
es surdoués ayant un profil inégal en faveur du QIV utilisent destratégies plus réfléchies, ont parfois de légers déficits visuomo-eurs et tendent à être incertains ou compulsifs. Par ailleurs, laaible résistance au stress peut se traduire par un QIP inférieurro
h; Psychopathology
u QIV puisque plusieurs épreuves de l’échelle de Performanceont chronométrées et demandent au sujet d’agir sous la pressionu temps [4].
Dans le cadre de la psychologie développementale, cette hété-ogénéité des aptitudes constatée vers l’âge scolaire n’apparaîtas comme un fait primaire de développement [16]. Vaivre-ouret [16] considère le décalage QIV supérieur à QIP chez
es enfants surdoués comme le résultat d’une détérioration deonctions non exercées ou bien comme une focalisation de fonc-ionnement sur le seul domaine purement intellectuel et scolaireu détriment du domaine moteur exercant le corps.
Pour certains cliniciens, un QIT homogène reflète non seule-ent un fonctionnement intellectuel mais aussi une bonne
ntégration de la personnalité [17]. En revanche, un QIV impres-ionnant face à un QIP moyen ou à la limite de la normaleerait le résultat d’un surinvestissement de la pensée dans le bute se défendre contre des angoisses archaïques avec le risquee décompensations pathologiques à l’adolescence [18,19].eismann-Archache [20] considère que l’accès précoce à la
ensée formelle équivaut à un investissement contra-phobiquee la pensée destiné à maintenir à distance la relation à l’autre.
Il existe peu de recherches concernant le lien entre le surdoue-ent verbal et le fonctionnement socio-affectif. Les surdoués
erbaux par rapport aux surdoués non verbaux rapportent unanque de popularité auprès de leurs pairs [21], un sentiment de
ejet plus important et une dévalorisation de soi [22] par rapportux surdoués non verbaux. Les surdoués verbaux présentent uneendance plus accentuée à se considérer comme différents desutres et adoptent comme stratégie privilégiée pour faire face laégation de leurs aptitudes intellectuelles supérieures pour pou-oir être intégrés [23]. Ils sont par conséquent moins impliquésans les relations sociales [24].
La littérature ne permet donc pas de savoir si une grandeifférence QIV-QIP serait simplement représentative d’un pro-l intellectuel typique chez les sujets surdoués, une entrave à
’adaptation sociale voire même l’expression d’une organisa-ion psychopathologique. L’objectif de notre recherche est deepérer les liens entre le profil intellectuel (homogène versusrès hétérogène en faveur des aptitudes verbales), les troublessychopathologiques et la perception de soi et des relationsnterpersonnelles chez des enfants et des adolescents surdoués.
. Méthodes
.1. Participants et procédure
Nous avons formé deux groupes de surdoués contrastés enegard du profil intellectuel. Pour définir le caractère homogèneu hétérogène du profil intellectuel au WISC-III, nous faisons
’enfa
rclrQuépedd
•
•
loptnRé
3
3C
lopnamàd
3
eq
•
•
•
•
•
•
•
•
•
dPc
4
mUn
5
d5sgN
N. Kostogianni et al. / Neuropsychiatrie de l
éférence aux travaux de Kaufman [9] et de Grégoire [4]. Selones auteurs, la différence entre le QIV et le QIP est significativeorsqu’elle est égale ou supérieure à 12 points. Plus la diffé-ence dépasse cette valeur de 12 points, plus l’interprétation desIV et QIP doit retenir l’attention au détriment du QIT. Ainsi,ne différence égale ou supérieure à 20 points entre les deuxchelles (QIV-QIP) est considérée comme témoignant d’une dis-ersion très élevée révélatrice d’un décalage notable d’efficiencentre les aptitudes verbales et visuospatiales. La probabilité’apparition d’une telle différence est de 16 % dans l’échantillon’étalonnage du WISC-III [1].
Nos critères de sélection étaient alors les suivants :
des enfants et des adolescents âgés de neuf à 15 ans ayantun QIT supérieur ou égal à 130 au WISC-III, présentant unprofil soit homogène (différence entre QIV et QIP ≤ 12) pourle groupe des surdoués globaux soit très hétérogène en faveurdu QIV (QIV-QIP > 20 points) pour le groupe des surdouésverbaux ;ne participant à aucun programme éducatif particuliers’adressant à des enfants surdoués afin de contrôler lesvariables associées au contexte scolaire.
Le recrutement des sujets s’est fait par le psychologue de’association Eurotalent à Paris. Les enfants et les adolescentsnt été déjà identifiés comme étant surdoués au WISC-III et lesychologue de l’association avait connaissance de leurs résul-ats. En revanche, le psychologue investigateur de cette étude’avait accès aux résultats du WISC-III qu’après la passation duSI. Parents et enfants étaient volontaires pour participer à cettetude et ont donné leur consentement éclairé.
. Instruments
.1. Liste de comportements pour enfants (Child Behaviorheck List [CBCL])
La CBCL [25,26] est remplie par les parents. Elle éva-ue la présence de problèmes émotionnels et comportementauxbservés chez des enfants âgés de quatre à 16 ans. La CBCLermet de calculer une note globale de psychopathologie, uneote d’internalisation (retrait-isolement, plaintes somatiques etnxiété-dépression) et une note d’externalisation (comporte-ent déviant et comportement agressif). Le seuil clinique est fixé63, à partir de cette note les manifestations comportementalese psychopathologie sont considérées comme notables.
.2. Rorschach système intégré (RSI)
Le RSI [27,28] est choisi pour étudier la perception de soit des relations interpersonnelles. Cet outil présente de bonnes
ualités psychométriques.Nous avons sélectionné les variables suivantes :
la variable Vista (V > 0) signale la préoccupation relative auxtraits négatifs de soi ;
pemld
nce et de l’adolescence 57 (2009) 379–384 381
les réponses morbides (MOR > 1) signifient que la représen-tation de soi comporte des caractéristiques plus négatives etplus atteintes que la moyenne ;l’indice d’égocentrisme (indice EGO) est un indicateur del’attention portée à soi (investissement de soi) ;la faible présence de contenus humains (H < 2) témoigne d’unmanque d’intérêt pour les autres ou d’une mauvaise interpré-tations des signes sociaux ;les formes de contenu humain autres que le contenu humainentier (H < [H] + Hd + [Hd]) sont sélectionnées de manièreplus fréquente par ceux dont la représentation de soi est fon-dée moins sur des interactions réelles que sur l’imaginationou sur des représentations internes qui coïncident moins avecla réalité ;la réponse expérience humaine (Hx > 0) signifie que la repré-sentation de soi est abordée d’une manière excessivementintellectuelle qui tend à ignorer la réalité ;les réponses de coopération (COP) et d’agression (AG)témoignent d’une conception soit positive soit agressive desinteractions interpersonnelles. Une valeur inférieure à deux(COP < 2 et AG < 2) témoigne d’une baisse de la vitalité rela-tionnelle ;les représentations humaines (HR) reflètent l’efficience descomportements interpersonnels. Elles se distinguent en deuxcatégories : GHR pour les bonnes (G pour good) et PHR pourles faibles (P pour poor). Si la valeur du GHR est supérieureà celle du PHR (GHR > PHR), nous pouvons en déduire queles comportements interpersonnels sont adaptés ;l’indice de déficit en coping quand il est positif (CDI > 3)témoigne d’une difficulté à établir et/ou à maintenir des rela-tions proches et matures.
Un tiers des protocoles a été tiré au hasard et fait l’objet d’uneouble cotation en insu afin d’évaluer la fidélité intercotateurs.our évaluer la fidélité intercotateurs au RSI, le coefficient deorrélation interclasse ICC a été calculé.
. Analyses
Les pourcentages ont été comparés par le test du x2. Lesoyennes ont été comparées par le test-t de Student ou le testde Mann-Whitney en fonction de la distribution normale ou
on des données. Le seuil de significativité est fixé à p < 0,05.
. Résultats
Le Tableau 1 fournit une description des caractéristiques deseux groupes. Le groupe des surdoués globaux est composé de2 sujets et le groupe des surdoués verbaux de 46. Les variablesexe, âge et parcours scolaire ne se distinguent pas dans les deuxroupes. Les garcons sont surreprésentés dans les deux groupes.ous avons également vérifié que le milieu social ne différencieas les deux groupes de surdoués. La grande majorité des sujets
st issue d’un milieu social favorisé. Les deux groupes ont leême niveau intellectuel si on se limite au QIT. En revanche,a différence QIV-QIP distingue de facon très significative leseux groupes. Le groupe des surdoués globaux a une moyenne de
382 N. Kostogianni et al. / Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence 57 (2009) 379–384
Tableau 1Caractéristiques de deux groupes des surdoués.
Surdoués globaux (n = 52) Surdoués verbaux (n = 46) x2 (1)/U
Moyenne (E.T.) Fréquence Moyenne (E.T.) Fréquence p
Sexe, M:F 36:16 35:11 0,44Âge (ans) 12,15(1,99) 11,54(2,2) 0,12Scolarité (ans) 7,08 (1,79) 6,41(2,05) 0,07Avancement 6 7 0,31Redoublement 5 3 0,57QIT 137,01(5,83) 137,63(6,21) 0,73QIV 133,13(6,37) 144,5 (4,78) < 0,001QIP 129,73(5,40) 116,3 (6,67) < 0,001QIV-QIP 3,40 (6,81) 28,19 (6,28) < 0,001
E.T. : écart-type.En gras : les résultats significatifs au seuil p < 0,05.
Tableau 2Résultats à la CBCL.
Surdoués globaux (n = 52) Surdoués verbaux (n = 46) t(96)/U
Moyenne (E.T.) Note clinique (%) Moyenne (E.T.) Note clinique (%) p
Internalisation 63,01(14,89) 44 71,35(20,58) 56 0,09Externalisation 56,70(12,11) 34 58,50(12,87) 34 0,51P
E
QQdtn
st(és
cv
idéinlscpr
TR
VMEHHHCGC
EHcE
sychopathologie 58,34(11,42) 41
.T. : écart-type.
IV de 133,13 ± 6,37 (niveau très supérieur) et une moyenne deIP de 129,73 ± 5,4 (niveau très supérieur). Le groupe des sur-oués verbaux a une moyenne de QIV de 144,5 ± 4,78 (niveaurès supérieur) et une moyenne de QIP de 116,3 ± 6,67 (niveauormal fort).
La comparaison des moyennes ne différencie pas de faconignificative les deux groupes en ce qui concerne la manifesta-ion des problèmes psychopathologiques repérés par les parentsTableau 2). Dans les deux groupes, il existe un pourcentagelevé de sujets présentant des troubles internalisés (44 % des
urdoués globaux et 56 % des surdoués verbaux).Au RSI, l’accord interjuges est excellent puisque le coeffi-ient de corrélation intraclasse (ICC) pour les variables étudiéesarie de 0,81 à 0,97. Concernant le RSI (Tableau 3), les variables
drdl
ableau 3ésultats au Rorschach système intégré (RSI).
Surdoués globaux(n = 52)
Moyenne (E.T.) Fréquence (%)
> 0 59,6OR > 1 44,23
GO 0,34 (0,16)<2 26,9< (H) + Hd + (Hd) 61,53x > 0 19,23OP < 2 et AG < 2 44,23HR > PHR 25DI > 3 21,2
.T. : écart-type ; V > 0 : introspection négative douloureuse ; MOR > 1 : idéation nég< (H) + Hd + (Hd) : image de soi peu réaliste ; Hx > 0 : représentation de soi exces
omportements relationnels efficients ; CDI > 3 : indice d’incompétence sociale.n gras : les résultats significatifs au seuil p < 0,05.
63,13(14,80) 53 0,13
ndiquant une perception négative de soi (V > 0, MOR > 1) neifférencient pas les deux groupes. Cependant, un pourcentagelevé de sujets dans les deux groupes semble s’adonner à unentrospection douloureuse de soi (59 %) et à s’attribuer des traitségatifs (43 %). La différence des moyennes à l’indice EGO poures deux groupes est significative (p = 0,01). L’investissement deoi tend à être plus négatif chez les surdoués verbaux. Le pour-entage de sujets donnant moins de deux réponses H « pure » estlus élevé (p = 0,01) dans le groupe des surdoués verbaux. Leapport H : (H) + Hd + (Hd) ne différencie pas les deux groupes
e surdoués. Les deux groupes de surdoués donnent moins deéponses H « pure » que d’autres contenus humains. Les sur-oués verbaux donnent plus de réponses Hx (vécu humain) quees surdoués globaux (p = 0,04). Concernant la perception desSurdoués verbaux(n = 46) x2 (1)/t(96)
Moyenne (E.T.) Fréquence (%) p
58,7 0,9241,30 0,77
0,26(0,16) 0,0152,2 0,0169,56 0,4026,08 0,0471,79 0,00621,7 0,7041,3 0,03
ative sur soi ; EGO : indice d’égocentrisme ; H < 2 : méconnaissance d’autrui ;sivement intellectualisée ; COP > 2 ; AG < 2 : retrait relationnel ; GHR > PHR :
’enfa
r(dqtlhcppssh
6
(ppfipqpuesNec
dptleisEcpsaatuldlcbpcc
rv
atdrcCpLétqprdtasdaelltapr
càlppddeddladmTc
ddm
lvIQc
N. Kostogianni et al. / Neuropsychiatrie de l
elations interpersonnelles, la majorité des surdoués verbaux72 %) donnent moins de réponses contenant des mouvementse coopération ou d’agression (COP < 2 et AG < 2, p = 0,006)ue les surdoués globaux (44 %). Le désinvestissement des rela-ions est plus important chez les surdoués verbaux que chezes surdoués globaux. La dominance des bonnes représentationsumaines par rapport aux faibles (GHR > PHR) n’est pas signifi-ative entre les deux groupes. Les surdoués verbaux présententlus souvent un indice de déficit en coping positif (CDI > 3,= 0,03) que les surdoués globaux (41 % vs 21 %). Ce résultat
ouligne la présence de plus de difficultés relationnelles chez lesurdoués verbaux par rapport aux surdoués ayant un profil plusomogène.
. Discussion
Nous n’avons trouvé aucun lien entre le profil intellectuelharmonieux vs dysharmonieux) et les manifestations psycho-athologiques telles que repérées par la CBCL. Toutefois, unourcentage élevé de notre population (indépendamment du pro-l intellectuel) présente des troubles internalisés (CBCL) et uneerception négative de soi (V > 0, MOR > 1 au RSI). Étant donnéu’il s’agit ici d’une population non clinique, ce résultat peutaraître surprenant. Cependant, l’inventaire de comportementstilisé ici est rempli par les parents. Ceux-ci peuvent parfoisxagérer les difficultés rencontrées chez leurs enfants surdoués’ils les considèrent comme vulnérables du fait de leur surdon.ous pouvons également nous demander si une partie de ces
nfants n’a pas présenté de signes anxiodépressifs ayant motivéette suspicion d’un très haut QI.
En revanche, les résultats au RSI mettent en évidence desifférences entre nos deux sous-groupes dans la sphère de laerception que ces enfants ont d’eux-mêmes et de leurs rela-ions aux autres. Ce sont les surdoués verbaux qui présentente plus de difficulté dans ce domaine. En effet, le RSI metn évidence un désinvestissement de soi et des autres plusmportant chez les surdoués verbaux. Sur le plan de la repré-entation de soi, les surdoués verbaux se dévalorisent (indiceGO) davantage que les surdoués globaux. Cette fragilité nar-issique pourrait être due à leur difficulté à rencontrer desersonnages supports d’identification dans leur entourage. Lesurdoués verbaux semblent manquer d’intérêt pour les autres ouu moins avoir plus de difficultés à les comprendre (H < 2). Ilsdoptent une approche excessivement intellectuelle des ques-ions concernant la représentation de soi (Hx > 0), ce qui signene défense active contre la souffrance induite par cette déva-orisation. Les surdoués verbaux ont des difficultés de contrôleans l’interaction avec l’environnement, particulièrement dansa sphère interpersonnelle (CDI > 3). La précarité des assises nar-issiques retrouvée chez les surdoués verbaux (indice EGO trèsas) et la méconnaissance de soi et des autres (H < 2) ne permetas l’abord des conflits relationnels (COP < 2 et AG < 2). Cetteonfiguration est retrouvée chez des personnes qui peuvent être
onsidérées par les autres comme distantes ou retirées [27,28].Dauder et Benbow [22] attribuent les difficultés relationnellesetrouvées chez les surdoués verbaux au fait que les aptitudeserbales sont plus visibles dans les situations sociales que les
mela
nce et de l’adolescence 57 (2009) 379–384 383
ptitudes mathématiques ou spatiales. Le langage nous dis-ingue mais nous sépare aussi, il constitue un puissant vecteur’appartenance au groupe. Ces enfants emploient un langageecherché peu accessible pour les pairs et peuvent être percusomme des enfants atypiques et mis à l’écart par leurs pairs.ertaines compétences (sociales en l’occurrence) ne peuventarfois pas s’exprimer, en raison d’un contexte défavorable.es sujets de notre échantillon sont tous scolarisés dans destablissements standard sans que les particularités de leur fonc-ionnement intellectuel soient prises en compte. Il est probableu’ils manquent de camarades prêts à partager leurs préoccu-ations et intérêts. Il serait intéressant de comparer le vécuelationnel des enfants et des adolescents surdoués en fonctiones différents contextes éducatifs. Les garcons sont majori-aires dans notre échantillon. Nous pouvons supposer que lesptitudes verbales très supérieures sont encore moins valori-ées chez les garcons que chez les filles. Il serait important’étudier les différents types de surdouement intellectuel à l’âgedulte. Nous nous demandons si le désinvestissement de soit des autres que nous constatons chez les enfants et ado-escents surdoués verbaux perdurent à l’âge adulte ou bien’expérience de vie permet-elle d’utiliser ces facilités intellec-uelles pour mieux se lier aux autres. Une fois parvenus à l’âgedulte ces sujets choisiront leur propre environnement et auronteut-être la possibilité de fréquenter des personnes qui leuressemblent.
Une autre piste de recherche qui mérite d’être exploitée estelle avancée par Vaivre-Douret [16] : le décalage QIV supérieurQIP ne serait pas un fait développemental mais le résultat de
a dégradation de fonctions non exercées, probablement en rap-ort avec leur non-valorisation. Selon cet auteur, les aspirationsarentales privilégient les sollicitations cognitives aux dépenses sollicitations corporelles, ce qui suscite chez l’enfant sur-oué un sentiment d’incompréhension. L’enfant renonce au jeut à la créativité. Il s’isole des autres enfants, il est mal à l’aiseans son corps et dans l’expression émotionnelle et la confiancee soi diminue en conséquence. Selon le même auteur, le déca-age QIV supérieur à QIP peut être le signe d’une dyspraxievec des troubles visuospatiaux. Dans notre étude, le groupees surdoués verbaux avait un QIP d’un niveau supérieur à laoyenne (116,3 ± 6,67), il est donc difficile de parler de trouble.outefois, en l’absence d’un bilan neuropsychologique ou psy-homoteur nous ne pouvons pas exclure cette probabilité.
Nous constatons tout l’intérêt d’une étude longitudinale’une assez grande ampleur qui identifierait le surdouement danses domaines variés et qui tracerait des trajectoires développe-entales en intégrant des aspects socio-affectifs.Notons que, conformément à la littérature, nous avons utilisé
es QIV et QIP du WISC pour définir les groupes de surdouéserbaux et globaux. La nouvelle version de ce test (WISC-V) fait disparaître la distinction entre QIV et QIP. Outre leIT, le WISC-IV permet le calcul de quatre indices factoriels :
ompréhension verbale (ICV), raisonnement perceptif (IRP),
émoire de travail (IMT), vitesse de traitement (IVT). Les ICVt IRP sont considérés comme des mesures encore plus pures de’intelligence verbale et visuospatiale. Notre recherche pourraitlors être reproduite à partir du WISC-IV.
3 l’enfa
7
letodrapcus
R
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[[
[
[
[
[
[
[
84 N. Kostogianni et al. / Neuropsychiatrie de
. Conclusion
Nous n’avons pas trouvé de lien entre le profil intellectuel etes problèmes comportementaux et émotionnels chez des enfantst des adolescents surdoués. Il ne faudrait donc pas interpré-er l’hétérogénéité du profil intellectuel comme étant le signe,u l’expression d’une organisation psychopathologique. Cepen-ant, les surdoués verbaux sont plus en difficulté dans le domaineelationnel. Ils présentent un faible investissement de soi et desutres qui pourrait s’expliquer par la difficulté de rencontrer desersonnages supports d’identification dans leur entourage. Ilsherchent à se défendre par l’intellectualisation qui aboutit àne méconnaissance de soi et une mauvaise interprétation designes sociaux.
éférences
[1] Wechsler D. Manuel de l’échelle d’intelligence de Wechsler pour enfants(WISC-III). Paris: ECPA; 1996.
[2] Wechsler D. Manuel de l’échelle d’intelligence de Wechsler pour enfants(WISC-IV). Paris: ECPA; 2005.
[3] Winner E. The origins and ends of giftedness. Am Psychol 2000;55:159–69.[4] Grégoire J. L’évaluation clinique de l’intelligence de l’enfant. Bruxelles:
Mardaga; 2000.[5] Detterman DK, Daniel MH. Correlations of mental tests with each other
and with cognitive variables are highest for low IQ groups. Intelligence1989;13:349–59.
[6] Facon B. L’organisation des aptitudes cognitives est-elle hiérarchique ? RevEur Psychol Appl 2003;53:189–98.
[7] Legree PJ, Pifer ME, Grafton FC. Correlations among cognitive abilitiesare lower for higher ability groups. Intelligence 1996;23:45–57.
[8] Lynn R. Does Spearman’s g decline at high IQ levels? Some evidence fromScotland. J Genet Psychol 1992;153:229–30.
[9] Kaufman AS. Intelligent testing with the WISC-III. New York: Wiley;1994.
10] Saccuzzo DP, Johnson NE, Russell G. Verbal versus performance IQ for gif-ted African-American, caucasian, Filipino, and Hispanic children. PsycholAssess 1992;4:239–44.
[
[
nce et de l’adolescence 57 (2009) 379–384
11] Silver SJ, Clampit MK. WISC-R profiles of high ability children: interpre-tation of verbal-performance discrepancies. Gifted Child Q 1990;34:76–9.
12] Sweetland DJ, Reina MJ, Tatti FA. WISC-III verbal/performance dis-crepancies among a sample of gifted children. Gifted Child Q 2006;50:7–10.
13] Wilkinson SC. WISC-R profiles of children with superior intellectual abi-lity. Gifted Child Q 1993;37:84–91.
14] Bessou A, Montlahuc C, Louis J, Fourneret P, Revol O. Profil psy-chométrique de 245 enfants intellectuellement précoces au WISC-III.ANAE Approche neuropsychologique des apprentissages chez l’enfant2005;17:23–8.
15] Terrassier JC. Le développement psychologique des enfants intellectuelle-ment précoces. J Pediatr Pueric 1996;9:221–6.
16] Vaivre-Douret L. Les caractéristiques développementales d’un échantillond’enfants tout venant « à hautes potentialités » (surdoués) : suivi prophy-lactique. Neuropsychiatr Enfance Adolesc 2004;52:129–41.
17] Bléandonu G, Revol O. Approche psychopathologique et psychanalytiquedes enfants surdoués. EMC Psychiatr 2006;127:1–6.
18] Bléandonu G. Les enfants intellectuellement précoces. Paris: PUF; 2004.Que sais-je ?
19] Siaud-Facchin J. L’enfant surdoué. Paris: Odile Jacob; 2002.20] Weissman-Arcache C. Hétérogéné ou dysharmonie ? Clinique du fonction-
nement mental des enfants à haut potentiel. Bull Psychol 2006;59:481–9.21] Brody LE, Benbow CP. Social and emotional adjustment of adolescents
extremely talented in verbal or mathematical reasoning. J Youth Adolesc1986;15:1–18.
22] Dauber SL, Benbow CP. Aspects of personality and peer relations of extre-mely talented adolescents. Gifted Child Q 1990;34:10–5.
23] Swiatek MA. An empirical investigation of the social coping strategiesused by gifted adolescents. Gifted Child Q 1995;39:154–61.
24] Ablard KE. Self-perceptions and needs as a function of type of academicability and gender. Roeper Rev 1997;20:110–5.
25] Achenbach TM, Rescorla LM. Manual for the ASEBA school-age formand profiles. Burlington, VT: University of Vermont; 2001.
26] Fombonne E, Chendan AM, Carradec S, Achard S, Navarro N, Reis S. LeChild Behaviour Checklist: un instrument pour la recherche en psychiatrie
de l’enfant. Psychiatr Psychobiol 1988;3:409–18.27] Exner JE. A Primer for Rorschach Interpretation. Asheville, N.C: Ror-schach Workshops; 2000.
28] Exner JE. Rorschach workbook for the comprehensive system. Asheville,N.C: Rorschach Workshops; 2001.