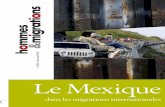HAMON Étienne, « Le naturalisme dans l’architecture française autour de 1500 », dans Le...
-
Upload
univ-lille -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of HAMON Étienne, « Le naturalisme dans l’architecture française autour de 1500 », dans Le...
T naturalisme dans l'architecture française autour de 1500'
Etienne Hamon
Introduction
« Nature et imagination ». C'est sous ce titre que Jan Bialostocki, dans son ouvrage sur l'art du xv" siècle traduit en Français en 1993, abordait l 'un des aspects les plus singuliers de l'architecture européenne de cette période une tendance organique et concrète de l'imagination décorative qui se traduit par la métamorphose des éléments qui composent et structurent les surfaces, les supports ou les dispositifs décoratifs en formes naturelles, végétales notamment. Le phénomène est bien connu à travers les fantaisies qui virent le jour au cours des années 1490-1510 dans la péninsule Ibérique et, surtout, dans le monde germanique, domaine oii elles apparaissent en rapport étroit avec les modèles diffusés par la gravure à l'exemple, souvent commenté, du portail nord de l'église du château de Chemnitz en Saxe (vers 1503-1525)'.
La France ne semble jamais avoir été sérieusement envisagée comme une terre d'élection pour ce courant esthétique. Les rares témoignages cités dans la littérature ancienne ou récente forment un maigre corpus disparate auquel les auteurs, cantonnés à une approche anecdo-tique, n'ont jamais cherché à trouver une cohérence"*. Camille Enlart en avait reconnu dans l'architecture civile uniquement (tour Jean-sans-Peur à Paris, portail du palais du Roure à Avignon, château Perricard, maison à Cahors) \s près de nous, Jan Bialostocki a signalé le portail nord de la cathédrale de Beauvais et le palais du Roure (fig. 7) tandis que Roland Recht présentait pour seul exemple le portail sud de la cathédrale de Sens'\a recherche allemande et anglo-saxonne récente s'est généralement contentée de ces exemples '. Si, de fait, aucun monument français connu ne présente de développements aussi monumentaux qu'ailleurs en Europe, les occurrences ne manquent pas et leur recensement réserve encore, à n'en pas douter, de belles surprises. Ce décalage entre la réalité du terrain et le mutisme de la critique trahit l'embarras des archéologues quant au statut de ce décor au sein d'une production dont on peine encore, de manière plus globale, à saisir la diversité. L'existence
1. Je remercie tout particulièrement Jean Guillaume et Florian Meunier pour l'aide qu'ils m'ont apportée dans la préparation de cet article grâce aux exemples qu'ils ont porté à mon attention.
2. BIALOSTOCKI 1993, p. 3 1 9 - 3 2 9 .
3. Le monde germanique est au cœur des principales études récentes sur le sujet, parmi lesquelles ont citera Korner 1990, Crossley 1993, Giinther 2 0 0 1 , Hubach 2 0 0 5 et Kavaler 2005 .
4 . LESUEUR 1904, p. 2 4 7 - 2 5 8 .
5. Camille Enlart, Manuel d'archéologie française. Deuxième partie. Architecture civile et militaire, 1.1, Paris, 1929, p. 188. 6. Roland Recht, « L'architecture », dans Le Monde gothique. Autimne et renouveau. 1380-1500 , Paris (coll. L'Univers des
formes), 1988, p. 14. 7. KÔRNER 1990, CROSSLEY 1993 et O Û N T H E R 2 0 0 1 invoquent la tour Jean-sans-Peur et le palais du Roure.
3 3 0 / Etienne Hamon
d'un courant bien constitué (plus d'une centaine de monuments !) justifie que l'on s'interroge sur la place de celui-ci dans l'art monumental français de la f in de la période gothique.
O n tentera ici une approche multidirectionnelle du phénomène, sans prétendre apporter des réponses définitives aux interrogations soulevées. O n essaiera de comprendre pourquoi les architectes et les décorateurs français ont privilégié la forme de naturalisme la plus intimement liée à l'architecture, la branche écotée, et de mettre ce constat en rapport avec celui qui ressort de l'examen du décor architectural des livres illustrés et des estampes où c'est également cette forme qui domine dans les processus de métamorphose. A cet égard, architecture et arts graphiques paraissent, en France plus qu'ailleurs, s'être mutuellement influencés. I l faudra aussi se poser la question des motivations de l'emploi de ce décor au-delà de son usage comme véhicule d'un symbolisme complexe. O n se penchera ainsi sur le profil des artistes et des commanditaires qui l 'ont promu. O n verra à cette occasion qu'i l apparaît nécessaire d'étudier ses manifestations en parallèle à celles qui, dans le même contexte, témoignent de l'émergence d'un autre répertoire nouveau, celui de l'italianisme. I l sera utile de mesurer le degré de connivence entre ces langages pour comprendre leur valeur respective dans l'architecture française des années 1500. O n verra enfin s'il est possible d'apporter une réponse à une question qui touche à la problématique même du « Gothique de la Renaissance » : ce naturalisme français des années 1490-1510 relève-t-il de l'art gothique ou de celui de la Renaissance, ou encore, pourquoi pas, d'une troisième voie dont les historiens d'art ont déjà évoqué l'existence 1
Les branches écotées dans l'illustration des manuscrits et des ouvrages imprimés
Le détour préalable par les livres illustrés est indispensable dans l'étude du phénomène puisqu'ils fournissent des repères souvent bien datés et bien localisés. Les récents travaux des spécialistes ont montré que la branche écotée était un motif récurrent autour de 1500 dans l 'illustration des livres en France et dans les pays voisins oii elle est utilisée pour peindre les encadrements avec une grande variété de compositions, de tracés et de traitements plastiques. L'un des exemples de ce type de décor les plus étonnants par son caractère monumental est l'encadrement de l'Adoration des mages des Heures de Jean de Chasteauneuf, peintes vers 1493 pour Jean de Chasteauneuf, secrétaire de René I I de Lorraine, par l'historieur Georges T r u -bert''* (fig. l a ) . Ce manuscrit témoigne d'une rare imagination décorative dans le traitement des bordures, dans lesquelles transparaissent les emprunts à l'enluminure « ganto-brugeoise » .̂
De fait, à Gand dans les années 1470, le Maître de Marie de Bourgogne et son entourage dessinent avec des branches écotées des encadrements (registre de la Guilde de Saint-Anne). Mais, comme l'a montré Nicole Reynaud, le répertoire de Georges Trubert n'est pas réductible aux modèles flamands. L'usage qu' i l fait de la branche écotée, en association étroite avec l'héraldique, prend un tour plus monumental en se détachant du répertoire feuillage et fleuri des Pays-Bas. Plus lisibles, ces motifs sont donc beaucoup plus à même d'offrir des modèles aux tailleurs de pierre. D'autre part, la formule du cadre fait de branchages n'est pas, avant 1490, l'apanage des Flandres. Vers 1450-1470, on la trouve dans plusieurs grands centres de l'enluminure française : à Paris sous le pinceau des prolifiques Maître de Jean Rolin et Maître François ; dans les manuscrits champenois tels ïAnnonciation d'un livre d'heures à l'usage de Troyes puis, dans les années 1480, chez le Maître de Guyot Le Peley (alias Maître du
8. Paris, BnF, N . a. lat. 3210, fol. 34 v. Notice dans A V R I L et REYNAUt) 1993, cat. n" 217. 9. lUuminuting the Renaissance, Los Angeles, 2003, cat. n" 20, 23 et 32.
10. A V R I L et REYNAUD 1993, p. 43-44. Charles Sterling, la peinture médiévale à Paris, 1300-1500, 1.11, Paris, 1990, p. 206.
Le naturalisme dans l'architecture française autour de 1500 / 331
Michault de Le Peley) Est-ce un hasard si Georges Trubert a été formé à Troyes avant d'entrer au service du roi René et de s'installer en Provence vers 1470 ?
Ce traitement plastique des encadrements de branchages se retrouve dans un autre contexte français en contact avec le milieu troyen. A Bourges vers 1490-1510, Jean Colombe puis Jean et Jacquelin de Montluçon et leur entourage, notamment le Maître de Spencer 6, affectionnent les encadrements de branches écotées, celles notamment dont la forte section et la couleur dorée renforcent la monumentalité C'est le cas des illustrations des Heures de Boisrouvray (vers 1500) dans lesquelles deux types de branches écotées coexistent, un type « à la moderne », et un autre « à l'antique » selon une formule attestée dans l'architecture gréco-romaine des premiers siècles de notre ère.
Assurément, la diffusion de ce moti f dans la peinture a été facilitée, à partir des années 1490, par la gravure tant dans le monde germanique qu'en France comme le montre l'encadrement de l'Arbre de Jessé des Heures à l'usage de Rome imprimées par Pigouchet pour Simon Vostre à Paris en 1498. Mais si les influences réciproques de l'enluminure et de l'estampe sont bien établies, i l est plus difficile d'élucider les rapports qui unissent les arts figurés et les arts plus monumentaux, notamment le sens de la diffusion. Comment expliquer ainsi la curieuse similitude de composition entre les encadrements de baies de la maison des Coquilles de Salamanque et le couronnement de certains encadrements du Compost et kalendrier des bergers édité par Jean Belot à Genève en 1497 / Comme pour les ornements à l 'Antique, l'absence de composition rigoureusement identique ajoutée à la chronologie relative trop incertaine de ces différentes manifestations, pour ce qui est de sa phase la plus active autour de 1500, rend difficile l ' identification de filiations indiscutables.
Les branches écotées dans l'architecture flamboyante française
Toujours est-il qu'i l existe, en France aussi, une grande variété de manifestations monumentales qui reflète assez bien celle qui existe dans les arts graphiques. Les exemples y sont contemporains de ceux du monde germanique, et les développements ultimes y sont au moins aussi nombreux à défaut d'être aussi spectaculaires, et ils sont plus originaux pour nombre d'entre eux.
Tel est le cas du pavillon que Louis X l l fit élever entre 1500 et 1506 sur le long côté du grand jardin du château de Blois " . Ce petit édifice appelé parfois « pavillon d'Anne de Bretagne » a été très restauré par Anatole de Baudot en 1889 avant de servir, jusqu'à une date récente, de local pour l'office de tourisme puis d'être désaffecté La partie centrale octogonale (et non carrée comme le laisse croire le plan de D u Cerceau), couverte d'une haute toiture, est cantonnée de trois petits pavillons carrés couverts en terrasse et d'une chapelle à abside polygonale désaxée. Ce qui surprend au premier abord (car i l faudra revenir sur son plan inhabituel), c'est le décor associé à cette architecture : i l est en grande partie constitué de motifs naturalistes (animaux, petits rochers...) dont les plus insistants sont les branches écotées qui jaillissent de souches au sommet des contreforts extérieurs de la chapelle (fig. 2) ou prennent naissance, à l'intérieur, dans les angles du pavillon central en guise de support à la coupole d'arête de la salle inférieure.
Pierre Lesueur s'était interrogé sur le sens de ce décor, émettant l'hypothèse qu'i l s'agissait
1 1 . AVRIL , H E R M A N T et BIBOLET 2007 , cat. n" 3 2 et fig. n" 37.
12. AVRIL , H E R M A N T et BIBOLET 2007 , fig. n" 154.
13. LESUEUR 1904, p. 2 4 7 - 2 5 8 .
14. Voir le dessin d ' A . Félibien dans son « Mémoire pour servir à l'histoire des maisons royalles... » (château de Cheverny).
3 3 2 / Etienne Hamon
des attributs symboliques du couple royal, au même titre que la cordelière également bien en vue, ou d'une marque de l'architecte dont le nom nous échappe. Dans cet environnement bucolique où le couple royal semble avoir aimé à se retirer du monde (c'est là que le roi assiste le plus souvent aux offices religieux lors de ses séjours à Blois en 1506-1507), ces formes participent en tout cas à l 'affirmation du caractère rustique de l'édifice. Son architecture générale délibérément composite (brique et pierre dans le style de l'aile Louis X l l du château, associée au pan de bois) a pu être enrichie dans ce sens en s'inspirant des représentations enluminées de la Nativité où la scène se déroule sous une cabane aux montants faits de branches écotées '\i l 'on en croit Félibien pour qui la reine y venait en « retraite quand elle fist un vœu pour avoir des enfants » la construction procéderait d'une démarche apotropaïque du couple royal qui se serait appliqué à recréer sur ce mythique modèle les conditions de la naissance tant désirée d'un héritier mâle.
L'ambiguïté est inhérente à l'ornementation naturaliste dans l'architecture gothique française tout au long de sa riche tradition. Le principe de métamorphose des éléments structurants de l'architecture et de son décor, qui remonte à l'Antiquité, a déjà connu une certaine faveur dans les années 1200. La transformation en formes naturelles qui affecta la plupart des chapiteaux de cette période en vint parfois à contaminer le fût de certaines colonnettes comme dans l'église Notre-Dame de Vermenton (Yonne) (fig. 3). Cette métamorphose est encore à l'œuvre, vers 1220, dans certains détails des dessins d'architecture du carnet de Vil lard de Honnecourt.
Après deux siècles de relégation, le moti f de la branche écotée ressurgit à la f in de l'époque gothique dans un mouvement qu'encouragea l'essor du symbolisme et de l'héraldique. Les allusions sont en effet multiples : au bois de la Croix, comme le montre le grand nombre de crucifix formés de branches écotées dans la peinture, l'orfèvrerie ou l'architecture depuis le XlV siècle ; à la Vierge dont l'emblématique se nourrit de la diffusion, vers 1500, du culte de l'Immaculée Conception que relaie la gravure (par exemple r« exaltata cedrus » et l'olivier des Heures à l'usage de Rome de Thielman Kerver, Paris, 1505), comme cela est confirmé par l'association de ces motifs avec d'autres attributs mariaux dans la peinture (heures de Troyes, V . 1470) et l'architecture ; allusions à l'arbre généalogique également, symbole dont le succès à l'époque médiévale doit beaucoup à la vision biblique de l 'Arbre de Jessé. La période qui nous occupe est celle qui a vu naître les plus belles interprétations monumentales de ce thème comme au tympan du portail nord de la cathédrale de Beauvais conçu vers 1510. Et cette image est aussi pour beaucoup dans l'association fréquente des branches écotées et de l'héraldique ou de l'emblématique profane dans la peinture, dans l'ornement des chartes et dans l'architecture à l'image de l'église de Cézac (Lot) ' ' (fig. 4).
Toutes ces interprétations sont cependant mal assurées et, dans bien des cas, elles restent insuffisantes. Car la branche écotée paraît le plus souvent dénuée de signification à l'image des créations de M a r t i n Chambiges. A u portail nord de Beauvais en effet, les branches de l 'Arbre de Jessé contaminent les gables décoratifs selon un processus déjà engagé dix ans plus tôt au portail sud où le gable fait de branches écotées était apparu dans le tympan et les ébrasements, hors de tout contexte généalogique. Pour Chambiges, qui avait inauguré le motif à Sens dans les années 1490, l'emploi pourrait avoir eu des motivations beaucoup plus personnelles sur lesquelles on reviendra. L'interprétation symbolique est également peu satisfaisante pour expliquer ce qui est à la fois l 'un des plus anciens et des plus extraordinaires
15. Voir par exemple AvRlL, HERMANT et BiBOLET 2007 , cat. n" 1 6 et 4 6 .
16. Cité par LESUEUR 1904, p. 2 5 0 - 2 5 1 .
17. On trouve d'autres exemples de cette association au château de la Coste à Mayran (Aveyron) en 1463 et dans la fontaine publique de Saint-Saturnin (Puy-de-Dôme) au début du xvr' siècle.
Le naturalisme dans l'architeclure française autour de 1500 / 3 3 3
exemples dans l'architecture flamboyante française : le couronnement de l'escalier de la tour Jean-sans'Peur à Paris (vers 1409-1411).
C'est le caractère gratuit qui l'emporte dans la plupart des exemples monumentaux connus de branches écotées. C'est du moins l'explication la plus prudente que l 'on peut donner pour définir son usage le plus répandu qui consiste à substituer la branche aux rinceaux feuillages décorant les parties concaves des piédroits et des archivoltes des ouvertures. O n le note dès avant le milieu du XV" siècle dans les grands chantiers ligériens comme à la cathédrale de Nantes (portails ouest) et à Notre-Dame de Cléry (portails du bras sud du transept, fig. 5, et de la chapelle de Villequier) . Cet emploi gagne les régions voisines dans les années 1470. O n le trouve dans les montants de la cheminée de « Grande chambre » du château de Tancarville bâtie vers 1473 (fig. 6). Comme la structure en brique et pierre auquel i l est ici associé, inhabituelle dans l'architecture de prestige de la région au XV" siècle, le décor de Tancarville a sans doute ses références en Val-de-Loire oii vivait le commanditaire Guillaume d'Harcourt. U n peu plus tard sans doute, on a mis en scène de cette manière le portail du quartier canonial de Notre-Dame-en-Vaux à Châlons-en-Champagne.
Les exemples les plus remarquables de portails soulignés de branches écotées sont cependant à rechercher à la périphérie du royaume. A u palais du Roure d'Avignon, construit vers 1490 pour le marchand Pierre Baroncelli, les branches écotées offrent une traduction végétale des formes entrecroisées qu'affectionnent les architectes du monde germanique et des provinces françaises de l'est, de la Lorraine à la Provence (fig. 7).
O n peut expliquer la présence de ce motif à Avignon par le cosmopolitisme des artistes qui ont travaillé dans cette ville après le retour de la cour pontificale en Italie. A l'époque de la construction du palais du Roure, s'y côtoyaient beaucoup de Lyonnais, des Lorrains, des Berrichons. Et l 'enlumineur Georges Trubert, dont les œuvres attestent de l'emploi d'une formule peinte assez proche, était encore actif dans cette ville. Son départ d'Avignon vers 1491 pour la Lorraine méridionale semble avoir eu des répercussions sur l'activité monumentale de la principauté dirigée par René I I . La région offre en effet, sous réserve d'authenticité, un exemple étonnant d'usage de la branche écotée dans l'architecture : on l'a utilisée pour dessiner les arcs du dispositif de contrebutement qui s'appuie aux angles du dernier étage octogonal de la tour nord de la collégiale Saint-Gengoult à T o u l (fig. 8), selon un procédé qui pourrait avoir été inspiré par les amortissements des contreforts de la chapelle du pavillon de Blois.
Vers 1500, la diffusion de la branche écotée a atteint l'apogée de son extension géographique en France. Le pavillon de Blois témoigne alors d'un engouement qui touche d'autres résidences royales comme l'oratoire d'Anne de Bretagne au château de Loches, en association avec des motifs naturalistes plus communs (cordelières...). A Blois même, certaines parties de l'aile Louis X I I ont été contaminées par ces écots telle la claire-voie qui borde le dernier pallier du grand escalier. Et ces mouchettes métamorphosées en treillis de branchages pourraient avoir servi de modèle à l'architecte qui dessina le tr i forium de la nef de Saint-Ger-main-d'Argentan, ce qui serait un argument supplémentaire pour rajeunir ce vaisseau généralement daté du milieu du X V siècle, tandis que des motifs d'un naturalisme plus abstrait naissaient à la façade nord du transept de la cathédrale d'Evreux.
La position qu'occupent Avignon et la Lorraine dans la circulation des artistes autour de 1500 permet d'expliquer ces développements quasi simultanés dans plusieurs domaines de la création artistique. Les choses sont plus énigmatiques pour la région française qui concentre le plus grand nombre d'œuvres monumentales incorporant des branches écotées, le Quercy
18. Jean Mesqui, Le château de Tancarvdle. Histoire et architecture (supplément au Bulletin monumental, n" 1), Paris, 2007, p. 54 -55 .
3 3 4 / Etienne Hamon
et ses marges. Considérée comme marginale par rapport aux grands courants artistiques de cette époque, cette zone a été oubliée des historiens de l'art flamboyant qui sont longtemps passés à côté de l'inventaire édifiant dressé par l'abbé Depeyre en 1932 Selon cet auteur qui a recensé une soixantaine de monuments présentant ce motif dans toute la province, dont une vingtaine à Cahors, surtout des maisons, le plus ancien témoignage serait la chapelle de la cathédrale dédiée à la Vierge Immaculée. I l serait antérieur à 1484, date de la consécration par l'évêque Antoine d'Alamand. Dans le Quercy, cette mode a duré près d'un demi-siècle puisque ses derniers témoignages sont assurément postérieurs à 1531 (église de Bagat).
D'abord discret, le moti f a pris des proportions envahissantes au début du Xvr siècle tout en restant, comme dans le prototype supposé, associé à d'autres symboles de la Vierge : roses, soleils, croissants, lys. Les occurrences les plus spectaculaires concernent de petites églises du diocèse de Cahors et de ses alentours, comme Cézac (fig. 4) et Boisse, O L I des piles entières, souvent à l'entrée de chapelles, sont traitées de cette manière. L'architecture civile de la même région offre plusieurs exemples de généralisation du procédé à toutes les parties moulurées d'un édifice, comme au château Perricard à Montayral (Lot-et-Garonne, près de Fumel) où les branches qui encadrent les portes sont amorties en tourelle coiffée d'une poivrière.
N o n loin de là, en Rouergue, les branches écotées apparaissent selon des principes plus proches des manifestations du reste de la France. C'est aussi un monument majeur de la province, l'abbaye de Conques, qui abrite l'une des applications les plus séduisantes de ce décor. La porte du trésor au sud-ouest de l'ancien cloître, peut-être issue d'un remontage, montre en effet un système très différent des réalisations du groupe quercynois par la longueur des écots et la sinuosité de la ramure (fig. I b ) .
I l est difficile, pour l'heure, de saisir les circonstances dans lesquelles les nombreuses oeuvres du groupe Quercy-Rouergue ont vu le jour en raison de leur anonymat et de leur chronologie flottante. Les choses sont plus claires en Ile-de-France qui présente l'intérêt d'offrir un groupe de monuments flamboyants homogènes, assez bien datés et attribués, où le moti f apparaît de manière plus discrète mais aussi plus systématique. I l s'agit d'édifices où la branche écotée sert à tracer de petites accolades dont les rampants se prolongent en boucle. Tous les indices concordent pour désigner M a r t i n Chambiges comme le chef de file de ce courant. Quelques années avant l'exemple déjà cité de la cathédrale de Beauvais, commencée en 1500, M a r t i n Chambiges avait utilisé ce moti f aux portails de la cathédrale de Sens, et i l en usera encore à la façade occidentale de la cathédrale de Troyes dont i l donna les plans vers 1505.
Déjà significatif en soi d'un usage personnalisé de la branche écotée, ce corpus l'est plus ' encore si on l'étoffe des chantiers soumis, preuves à l'appui, au rayonnement de ceux du maître. La branche écotée en accolade est attestée en Champagne méridionale (jubé de l'église de la Madeleine de Troyes ; portail de celle des Riceys...), à Beauvais (hôtel d'Argillière, ^ disparu en 1940) et dans ses environs (portail nord de Gisors où M a r t i n Chambiges se rendit en 1516 '̂̂ ) ainsi qu'à Sens (porte du palais de l'archevêque Etienne Poncher) et dans son diocèse où l'architecte du chevet de Saint-Aspais de Melun en 1517 (fig. 9), le parisien Jean de Félin, originaire de Lorraine, avait côtoyé M a r t i n Chambiges à Paris avant le départ de ce dernier pour Beauvais. Enfin c'est à Paris même que l 'on rencontre la série la plus homogène de témoignages de cet emploi, dans des monuments anonymes mais assurément conçus dans l'entourage de Chambiges ou de ses proches : le bras nord du transept de Saint-Gervais
19. DEPEYRE 1952.
20. H A M O N 2008, p. 383-384.
Le naturalisme dans l'architecture française autour de 1500 / 3 3 5
commencé vers 1494 (fig. 10) et les deux tourelles, probablement plus récentes de quelques années, de l'hôtel Hérouet et de l'hôtel disparu vers 1860 dans l'aménagement des abords de l'hôtel de ville. Ains i ce moti f semble être devenu sinon une « signature », du moins une sorte de « label » pour certains architectes du bassin parisien, et ce jusqu'à la disparition de M a r t i n Chambiges au début des années 1530.
Statut du décor naturaliste
Faute de discours critique contemporain du phénomène, faute aussi de repérage du lexique accordé à ce répertoire dans les sources contemporaines, l'interprétation du statut de ce décor architectural reste délicate. Si la symbolique liée à l'artiste, au commanditaire ou à certaines dévotions explique en partie le foisonnement des années 1500, elle ne suffit pas à définir le statut de ce décor au regard de l'esthétique des monuments.
Les arts figurés offrent quelques clés pour l'évaluation du phénomène sous cet angle. Dans le milieu berruyer comme dans l'œuvre de Georges Trubert, l'emploi de branches écotées voisine avec l 'utilisation d'architectures à l 'Antique de fort bonne facture. Les artistes qui maîtrisaient les deux registres les mettaient-ils sur le même plan ; les considéraient-ils comme deux aspects d'un même univers antiquisant ? L'explication est plausible comme le suggèrent les encadrements d'un manuscrit berruyer démembré de la même époque dont quatre feuillets sont conservés (Louvre, département des arts graphiques) : les pilastres et l'entablement qu'ils soutiennent, dans deux tableaux, sont remplacés, dans les deux autres, par des branches écotées qui épousent le même tracé, jusqu'à reproduire le profil de la corniche, et qui, sur les montants verticaux, conservent les bases et les chapiteaux à l 'Antique.
O n est porté à formuler les mêmes conclusions pour les encadrements peints ou gravés oij la branche écotée n'occupe que la partie supérieure du cadre. Dans les exemples de ce type, les supports restent soit neutres et intemporels, soit composés de colonnes, presque toujours à l 'Antique. Le cadre est également fréquemment peuplé de put t i . Cette association laisse donc penser que la branche écotée était, au sein du nouveau répertoire, une alternative à l'entablement et au fronton classique cintré ou triangulaire. Mais une autre interprétation de cette cohabitation est possible. Elle procéderait d'une volonté de jouer sur l'opposition des formes de manière plus poussée encore que celle que permet l 'hybridation du gothique et de l 'Antique : en opposant cette fois deux natures, le minéral et le végétal.
Dans l'architecture oii les contraintes techniques posées aux artistes étaient plus fortes, les motivations de la production de ce décor et les conséquences de sa réception sont plus difficiles à établir. I l faut envisager ces deux phénomènes dans un système complexe par sa dimension spatiale de rapports morphologiques avec la modénature et la structure des monuments dans lesquels l'ornement naturaliste prend place.
A u regard de la modénature, les branches écotées s'inscrivent généralement dans un contexte gothique. Mais celui-ci est plus ou moins affirmé. A Cléry, Tancarville, Châlons et Blois, le tronc est issu d'une souche, mais le tout forme un décor intégré à une modénature traditionnelle. Dans le pavillon de Blois, les références au gothique sont dominantes, du moins à l'extérieur oii les baies de la chapelle, les croisées à larmier et les garde-corps relèvent du répertoire flamboyant qui règne dans les campagnes des années 1500 du château. En Quercy, les branches se substituent à la modénature traditionnelle mais elles restent issues d'une base d'architecture gothique. O n va en revanche plus loin à Conques oii la base relève d'un style plus indéterminé, et oii toute autre référence à la modénature traditionnelle a disparu du dessin de la porte.
Sur un plan structurel, on constate qu'un peu partout la branche écotée apparaît dans un contexte de recherche de virtuosité qui se traduit par le voisinage de celle-ci, au sein d'un
3 3 6 / Etienne Hamon
même édifice, avec d'autres interprétations organiques ou fantaisistes des structures. Elle est ainsi associée à un appareil polychrome décoratif (Tancarville, Blois) ou à des chef-d'œuvre de stéréotomie que sont les supports en spirale (bassin parisien. Lorraine méridionale, oratoire de Loches...). O n rencontre même, dans le Quercy notamment, des combinaisons de supports torsadés et d'écots (Cézac, fig. 4, Cabrerets).
Ces derniers participent donc manifestement à la recherche des effets qui caractérise l 'un des courants, dominant vers 1500, du gothique flamboyant, d'autant plus activement que ces motifs peuvent être réalisés à moindre frais. O n comprend, dans ces circonstances, que l'emploi de la branche écotée sur une grande échelle ait pu ne pas être l'apanage des maîtres d'œuvre de premier plan. C'est même le contraire qui semble s'être produit au vu des exemples quercynois dont la rusticité de la mise en œuvre contraste avec le raffinement des grandes créations flamboyantes contemporaines comme le cloître de Cahors (vers 1504-1520), imperméables pour leur part à ce type de décor. Les premiers seraient-ils le fruit de l'activité d'ateliers locaux de second ordre, qui, faute de pouvoir rivaliser avec les tailleurs de pierre appelés de l'extérieur, ont développé de nouveaux procédés décoratifs à leur portée, jusqu'à la répétition routinière ?
Que l 'on retienne ou non l'explication par la technique, i l est du moins notoire que les utilisations les plus ostentatoires de ce répertoire procèdent d'une démarche délibérée qui tend à opposer des styles sur un plan interne (au sein d'un même édifice) ou externe (par rapport à un autre monument) . Comme si ces architectes avaient voulu explorer une alternative à la fois au répertoire antiquisant et aux derniers raffinements du gothique flamboyant. Une troisième voie que les fantaisies de la stéréotomie ne satisfaisaient pas à elles seules.
Cette motivation pourrait avoir été au cœur du projet du pavillon de Blois. Sans le médaillon en terre cuite à profil d'empereur romain au-dessus de la porte pour annoncer la couleur, le visiteur n'aurait vu là qu'une composition dans le goût français sans prêter attention au caractère inédit de la fonction d'agrément et au parti résolument nouveau en France du plan centré, rendu imparfait par l ' inflexion donnée à l'axe de la chapelle pour assurer son orientation.
A en juger par ce dernier exemple, l'opposition gothique/antique paraît le plus souvent inopérante. La branche écotée s'intègre en effet volontiers à un flamboyant raffiné ou à un environnement monumental plutôt assez réceptif au répertoire décoratif italianisant, les deux allant souvent de pair. Dans ces grands monuments des alentours de 1500 (jubé et décor architectural de la Madeleine de Troyes), i l ne fait guère de doute que les architectes qui emploient la branche écotée maîtrisent les deux répertoires gothique et antiquisant quand bien même ce dernier resterait discret. Ains i dans le cas d'une production individuelle bien identifiée comme celle de M a r t i n Chambiges (la cathédrale de Troyes en particulier), on constate que la discrétion du motif de la branche écotée n'a d'égal que celle des fantaisies du répertoire italianisant. Mais le rapport est plus favorable au second chez les émules de Chambiges comme chez Hugues Cuvelier (palais archiépiscopal de Sens, vers 1520). A la lumière de ces exemples, on est en droit de se demander si, a rebours de l'explication dualiste proposée plus haut, la métamorphose du minéral et le naturalisme des ornements n'étaient pas considérés par ceux qui en usaient comme des processus ou des procédés faisant partie intégrante du renouvellement de l'architecture dans le sens de l 'Antique.
Le naturalisme dans l'architecture française autour de 1500 / 3 3 7
Conclusion
I l n'y a donc pas d'explication simple du phénomène dans l'architecture française. Tous les indices tendent cependant à montrer que la branche écotée est tenue, à partir des années 1470 soit en même temps que les plus anciens exemples outre-Rhin ' ' , comme l'expression d'une nouveauté, voire d'une rupture que certains artistes, tels M a r t i n Chambiges et son entourage qui n'avaient rien des « gothiques intraitables » qu'ont voulu reconnaître les historiens d'art du XIX" siècle plaçaient sur le même plan que l'italianisme qu'ils connaissaient mais boudaient ostensiblement dans leurs créations les plus monumentales.
Ce naturalisme s'ancre dans une tradition très ancienne de métamorphose des éléments structurants de la modénature et de naturalisme. Mais le phénomène forme surtout l 'un des aspects les plus stables du gothique français des années 1400-1520 qui, dans ce sens, mérite pleinement son qualificatif imagé de flamboyant. Les architectes ont autant joué avec les éléments (les linéarités suggérant les flammes) qu'avec les règnes de la nature, fusionnant le minéral avec le végétal et l 'animal.
L'accélération du mouvement vers 1490-1510 s'est faite en parallèle à la diffusion des motifs de la première Renaissance et a coïncidé avec le renouveau des études vitruviennes susceptible de promouvoir leur diffusion, en référence aux origines végétales de l'architecture invoquées dans le traité antique Elle témoigne avant tout de la rapidité des échanges et de la circulation des modèles graphiques. Quand on peut identifier les artistes (à Avignon, à Paris, à Sens), on sent que ce décor procède d'une synthèse complexe d'influences culturelles. Ains i le parcours du peintre Georges Trubert, originaire de Champagne, employé par le roi René en val de Loire et en Provence, qui termina sa carrière en Lorraine sans jamais avoir perdu le contact avec sa famille installée à Paris, dessine la géographie des principales œuvres de ce type. Celui de l'architecte M a r t i n Chambiges forme les contours d'une zone de diffusion d'un moti f similaire, dans des manifestations plus discrètes mais plus personnalisées.
Si le répertoire naturaliste disparaît en même temps que le vocabulaire gothique, i l ne lu i est pas assimilable. Son rapport avec les deux répertoires conventionnels gothique et antique reste par conséquent ambigu selon un principe cher aux hommes des alentours de 1500. Faut-il alors le considérer comme une troisième voie, dans laquelle ont pourrait aussi ranger les voûtes à arêtes multiples du monde germanique qui semblent vouloir renier leur statut d'artefact ? Ce serait prêter des intentions encore trop claires à ces hommes, artistes et commanditaires, pour qui la notion de style était pratiquement indicible vers 1500 en France. C'est semble-t-il (mais i l faudrait pour l'affirmer un relevé plus attentif) autour de 1510 seulement que le terme d'« antique » apparaît dans les textes pour désigner quelque chose de nouveau dans l'architecture, apparu pourtant dès les années 1490^''. C'est bien, en tout cas, ce détachement des architectes quant à la nature de leur art qui va être mis à rude épreuve au cours du règne de François l" à mesure que l'italianisme s'affirmera.
L I S T E DES O U V R A G E S FRÉQUEMMENT CITÉS
A V R I L , H E R M A N T E T B I B O L E T 2007 - François Avri l , Maxence Hermant, Françoise Bibolet, Très riches heures de Champagne. L'enluminure en Champagne à la fin du Moyen Age, Paris - Châlons-en-Champagne, 2007.
A V R I L E T R E Y N A U D 1993 - François Avri l et Nicole Reynaud, Les manuscrits à peinture en France, 1440-1520, Paris, 1993.
B I A L O S T O C K I 1993 - ]an Bialostocki, L'Art du xV siècle. Des Parler à Durer, Paris, le Livre de Poche, 1993.
21. CROSSLEY 1993, p. 74.
22. Louis Gonse, L'art gothique, Paris, s.d. (1890), p. 280. 23. Sur l'impact architectural, datis ce sens, de l'humanisme voir notamment Crossley 1993 pour le cas allemand. 24. A Gaillon en 1509, on passa commande à un maçon de consoles à la fois « a l'antique et a la mode françoise » : Achille
Deville, Comptes et dépenses de la construction du château de Gaillon, Paris, 1850, p. 405.
3 3 8 / Etienne Hamon
C R O S S L E Y 1993 - Paul Crossley, « The Return to the Forest. Natural Architecture and the German Past in the Age of Durer », dans T. W. Gaethgens (éd.), Kûnstlerischer Austausch - Artistic Exchange. Akten des XXVIII . Intemationalen Kongresses fiir Kunstges-chichte, Berhn 15.-20. ]uli 1992, Bd. Il, Berlin 1993, p. 71-80.
D E P E Y R E 1932 - Abhé J. Depeyre, Essai sur une école de sculpture ornementale quercynoise autour de 1500, Cahors, 1932.
G Û N T H E R 2001 - Hubertus Gûnther, « Das Astwerk und die Théorie der Renaissance von der Entste-hung der Architektur », dans M.-C. Heck, F. Lemerle et Y. Pauwels (éd.), Théorie des arts et création artistique dans l'Europe du nord du XVf au début du XViif siècle, Lille, 2001, p. 13-32.
H A M O N 2008 - Etienne Hamon, Un chantier flamboyant et son rayonnement : Gisors et les églises du Vexin frattçais, Besançon, 2008.
Fig. la. Georges Trubert, Heures de Jean de Chasteauneuf. Paris, BnF, N . a. lat. 3210, fol. 34 v. (d'après Avr i l et Reynaud 1993, cat. n" 217).
H U B A C H 2005 - Hanns Hubach, « Johann von Dalberg und das naturalistische Astwerk in der zeitgenôs-sischen Skulptur in Worms, Heidelberg und Laden-burg », dans G . Bônneti et B. Keilmann (éd.), Der Wormser Bischof Johann von Dalberg (1482-1503) und seine Zeit (Quellen und Ahhandlungen zur mittel-rheinischen Kirchengeschichte, n" 117), Mayence, 2005, p. 207-232.
K Ô R N E R 1990 - Hans Korner, « Die "gestorte Form" in der Architektur des spâten Mittelalters », dans C. Andréas, M . Biickling et R. Dorn (éd.), Festschrift fiir Hartmut Biermann, Weinheim, 1990, p. 65-80.
L E S U E U R 1904 - Pierre Lesueur, « Les jardins du château de Blois », Mémoires de la Société des Sciences et lettres du Loir-et-Cher, t. 18, 1904, p. 223-426.
K A V A L E R 2005 - Ethan Matt Kavaler, « Nature and the Chapel Vaults at Ingolstadt. Structuralist and Other Perspectives », The Art Bulletin, n" 87, 2005, p. 230-248.
Fig. Ib. Abbaye de Conques, porte du trésor, cl. É. Hamon.
Le naturalisme dans l'architecture française autour de 1500 / 339
Fig. 2. Blois, pavillon des anciens jardins du château, cl. É. Hamon. Fig. 3. Église de Vermenton, pile de la nef, cl. É. Hamon.
3 4 0 / Etienne Hamon
Fig. 4. Église de Boisse, supports à écots, cl. M . Scellés et G. Séraphin. Fig. 5. Église Notre-Dame de Cléry-Saint-André, Inventaire général région Midi-Pyrrénées, Conseil général du Lot. ébrasements du portail sud du transept, cl .È. Hamon.