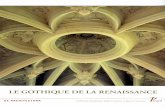HAMON Étienne, « Un Lorrain à Paris ? L’architecte Jean de Felin (actif 1488-1520) et le...
-
Upload
univ-lille -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of HAMON Étienne, « Un Lorrain à Paris ? L’architecte Jean de Felin (actif 1488-1520) et le...
Actes dm adémie de Stanislasi vendredi 17 et samedi 18 mai 2013 Grand Salon de l'Hôtel de Ville - Place Stanislas, 54000 Nancy
SOUS la direction de Bernard GUIDOT
Annales de PEst n°l -2014
ANNALES DE L'EST -2014-1 271
Etienne HAMON Professeur d'histoire de l'art médiéval Université de Picardie, Trame
Un Lorrain à Paris ? L'architecte Jean de Félin
(actif 1488-1520) et le dynamisme architectural
des années 1500
Le renouveau de la création architecturale est l'une des manifestations les plus spectaculaires du dynamisme artistique qui anime l'Europe du nord à partir de 1430, si bien qu'on ne peut pas ne pas l'assimiler à une forme de « renaissance ». Mais c'est aussi l'une des plus délicates à analyser en raison des multiples facteurs qui la déterminent. La Lorraine est, en la matière, un terrain d'étude de premier ordre. La région a tenu un rang important dans ce courant monumental marqué par des échanges accrus avec les grandes aires culturelles environnantes, et, grâce au travail de plusieurs générations de chercheurs particulièrement attentifs à cette dimension de l'art régional, elle a pleinement participé au récent renouvellement de nos connaissances sur l'architecture gothique tardive'. Ma contribution à ce dossier sera donc modeste et limitée au seul point de vue pour lequel j ' a i légitimité à intervenir ici, celui des relations entre Paris et la Lorraine à l'aube de la Renaissance. Les recherches que j ' a i consacrées ces dernières années à la capitale m'ont en effet amené plus d'une fois à constater ou à supposer l'existence d'échanges artistiques nourris entre ces deux pôles de l'art flamboyant^.
1 - Je suis en effet largement redevable, entre autres, à Pierre Marot, Alain Villes, Sylvain Bertoldi, Georges Fréchet, Michel Hérold et Pierre Sesmat, des données historiques et des analyses qui ont nourri cet article. 2 - E. HAMON, « Une famille d'artistes d'origine troyenne à Paris à la fin du XV^ siècle : les Trubert », Des sources à l'œuvre. Etudes réunies par Dany Sandron. Bibliothèque de l'École des chartes, t. 162, 2004-1, p. 163-189 ; É. HAMON, Une capitale flamboyante : la création monumentale à Paris autour de 1500, Paris, 2011.
272 ETIENNE HAMON
Plus particulièrement, c'est la découverte du fait que le plus courtisé des architectes parisiens des années 1500, Jean de Félin, était probablement d'origine lorraine qui a motivé cette intervention. Celle-ci visera donc à identifier les jalons monumentaux qui, de part et d'autre, pourraient témoigner des pérégrinations de cet architecte ou refléter la double culture que lui et certains de ses contemporains ont pu imprimer à des réalisations qui comptent parmi les plus emblématiques de l'art flamboyant.
7. Le dynamisme du gothique tardif en Lorraine. Pour bien mesurer l'enjeu de ces investigations, i l est nécessaire de
rappeler la richesse, l 'originalité et la vitalité durable du gothique tardif en Lorraine. L'art rayonnant y a, en effet, connu d'importantes mutations dans les années 1300 en participant notamment aux recherches spatiales et plastiques de l'Empire : églises halles, modénature simplifiées, etc. Puis de nouvelles formes et des graphismes curvilinéaires y ont été expérimentés dès les alentours de 1400 lorsque les circonstances étaient favorables comme pour l'église de pèlerinage d'Avioth. Enfin, les chantiers religieux de toute nature y ont connu un redémarrage précoce après les troubles du second quart du XV^ siècle. Ainsi dès les années 1460, l'église Saint-Martin de Pont-à-Mousson fut terminée grâce au soutien du roi René qui permit aussi au chantier de Saint-Étienne de Bar-le-Duc de prendre un nouveau souffle avec la construction du chevet. Mais le projet le plus ambitieux de cette décennie fut assurément celui de la façade de la cathédrale de Toul lancé le 9 mai 1460, un chantier flamboyant exceptionnel en France par sa précocité, par la détermination avec laquelle i l a été mené à bien et surtout pas ses qualités plastiques, comme l'a montré Alain Villes^ Et l'on a vu avec Yves Gallet que, plus à l'est, les innovations de l'Empire avaient suscité dans les mêmes années (1467-1475) des applications originales à l'image du chœur à voûtes réticulées de l'église de Fénétrange. On comprend donc que la Lorraine ait, dès lors, exporté au loin son savoir-faire, comme le laisse imaginer la présence de l'architecte Nicolas de Bar à Oviedo dans les années 1440"*.
Dans l'aire française de la Lorraine, un double mouvement s'est esquissé sous le règne de René I I et s'est accentué sous celui de son successeur. Sa première manifestation, à laquelle les contemporains furent sensibles^ fut une accélération et une amplification des entreprises en cours bientôt relayée par l'ouverture de nouveaux chantiers : Saint-Nicolas-de-Port, Saint-Étienne de Saint-Mihiel, Blénod-lès-Toul, etc. La seconde est une transformation sensible de l'esthétique des monuments. L'italianisme en est la forme la plus visible, mais je laisse à Pierre Sesmat le soin de l'évoquer bien mieux que moi dans ce recueil d'actes. L'évolution
3 - A. VILLES, La cathédrale de Toul, Toul, 1983, t. 2, p. 29. A - La architectura tardogothica castellana entre Europay America, sous la dir. de Begoiia Alonso Ruiz, Madrid, 2011, p. 22. 5 - Philippe de Vigneulles s'en fait régulièrement l'écho dans sa chronique : La chronique de Philippe de Vigneulles, éd. par Ch. Bruneau, t. IV, Metz, 1933, p. 192 et passim.
UN LORRAIN À PARIS? L'ARCHITECTE JEAN DE FELIN (ACTIF 1488-1520).. 273
qui m'intéresse ici touche aux orientations du gothique flamboyant et ce dans ce qu'elles ont d 'éminemment révélateur, selon nous, de l'expression individuelle de créateurs à la cuUure élargie : la virtuosité accrue de la stéréotomie, le maniérisme des formes et des graphismes et le naturalisme du décor architectural.
Ces tendances, parfois très poussées dans certaines réalisations de taille réduite comme dans le cas des ogives suspendues à clés pendantes de la chapelle de l'orfèvre du duc Pierre Wiriot à Saint-Christophe de Neufchâ t eau vers 1505'', se sont affirmées simuhanément dans les grands centres de Saint-Nicolas-de-Port, Toul et Nancy. Les piles torses du transept de Saint-Nicolas-de-Port, conçues avant 1511, sont l'exemple le plus spectaculaire du renouveau des recherches sur la stéréotomie (fig. 1) ; mais elles font figure d'hapax régional. Plus répandus sont les graphismes aux lignes brisées, apparus dans la France moyenne au m i l i e u d u X V % a f f e c t a n t des proportions colossales comme au cloître de Saint-Gengoult de Toul et
à la porterie du palais ducal Nancy, construite en 1511-1512, qui emprunte au logis de Louis X I I à Blois pour la structure et aux palais flamboyants du Berry pour les bustes de personnages sculptés dans de fausses fenêtres (palais Jacques Cœur et hôtel de ville de Bourges ; château de Meillan). C'est à Saint-Gengoult aussi que l'on rencontre alors des ébrasements à anamorphose combinant les recherches optiques locales (le traité de Jean Pèlerin) et les modèles flamboyants fournis par les grands chantiers du bassin parisien du premier tiers du X V P siècle où souffle l'esprit de l'architecte Martin Chambiges : Beauvais, Senlis, Clermont-en-Beauvaisis ou Troyes. Et c'est encore dans cette collégiale que l'on trouve l'une des applications
I : Saint-Nicolas-de-Port, intérieur du transept (photo E. Hamon)
6 - A. YBERT, É. LEFEBVRE, « Construire une voûte au XVP siècle. L'exemple de la chapelle Wiriot de Saint-Christophe de Neufchâteau », Célèbres ou obscurs. Hommes et femmes dans leurs territoires et leur histoire. 134e Congrès des sociétés historiques et scientifiques, Bordeaux 2009, p. 291-305.
274 ETIENNE HAMON
les plus singulières du travail de métamorphose opéré par les artistes travaillant la pierre. Les arcs-boutants de l'étage octogone de la tour nord, encore inspirée par les clochers de Pont-à-Mousson, prennent vie sous forme de branches écotées (fig. 2). Plusieurs dalles funéraires de l'église témoignent, plus discrètement, de ce principe organique au travers de leurs encadrements gravés d'architectures. I l nous faudra revenir sur ces marqueurs puissants de l'individualisme des bâtisseurs.
r
Fig. 2 : Toul, collégiale Saint-Gengoult, détail du couronnement de la tour nord (photo E. Hamon)
UN LORRAIN À PARIS? L'ARCHITECTE JEAN DE FELIN (ACTIF 1488-1520)... 275
2. Le renforcement de l'axe Paris-Lorraine autour de 1500. Les sources de ce renouveau sont assurément à chercher dans le contexte
de recomposition des échanges culturels entre la Lorraine et les régions environnantes sous René I I . Celle impliquant la région parisienne va nous intéresser tout particulièrement.
Au sortir de la guerre de Cent Ans, la capitale du royaume délaissée par les rois n'était pas une pièce essentielle du jeu d'influences politiques de la maison de Lorraine, laquelle n'y entretenait pas de résidence fixe^. Cela n'empêcha pas les princes lorrains, dès le début du règne de René I I , d'y séjourner régulièrement, notamment lorsque la cour de France elle-même s'y rendait. Les ducs entraînèrent alors dans leur sillage des clercs et des marchands qui contribuèrent à la connaissance croisée des grandes créations artistiques des deux milieux. Dès 1475, le duc avait choisi comme secrétaire un clerc parisien, Pierre de Blaru (tl510), qui s'illustra en composant laNancéide pour chanter la victoire de 1477. Familier de Paris était aussi l'un des plus fameux conseillers de René I I , Jean Pèlerin, auparavant au service de Louis X I et de Commynes. Le Viator accompagna plusieurs fois le duc à Paris, étudiant les monuments gothiques dont i l illustra son De artificiali perspectiva paru à Toul en 1505. De là aussi, peut-être, lui vint sa connaissance des œuvres de Colin d'Amiens, peintre parisien à la solide renommée, disparu entre 1497 et 1500, dont i l invoque la mémoire au fol. 1 de la 3*̂ édition du même traité en 1521. Enfin un autre homme de lettres lorrain sut faire connaître à ses compatriotes les créations parisiennes les plus marquantes de son temps, le messin Philippe de Vigneulles, qui dans ses mémoires ne tarit pas d'éloges pour le nouveau pont Notre-Dame dont i l fut un témoin attentif de la reconstruction entre 1500 et 1512^
L'exposition qui s'est tenue au printemps 2013 au Musée national du Moyen Age nous a rappelé combien la circulation d'artistes opérant dans les arts précieux et figurés depuis les terres germaniques en direction du cœur du royaume de France était un phénomène bien ancré dans l'histoire artistique de l'Europe. Ce courant s'est maintenu aux X I V et X V siècle comme le suggère l'anthroponymie artistique
7 - L'hôtel des ducs de Bar avait été confisqué par Louis XI . L'hôtel d'Harcourt, passé par mariage à la famille de Lorraine, était en déshérence depuis longtemps au moment de sa vente en 1543 par Claude de Lorraine, duc de Guise (voir les notices à ces lieux dans La demeure médiévale à Paris : répertoire sélectif des principaux hôtels, Paris, 2012). En 1498, René II logea chez les Albret à l'hôtel de Clisson, qui passera plus tard aux Guise (Dom A. CALMET, Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine, t. I I , Nancy, 1728, col. 1107-1108). 8 - « En celle meisme année [1512] fut du tout reffait et achevis le pont Nostre Damme de Paris, lequelle avoit esté cheus et fondus en la ripvière de Senne en l'an mil IIlIc Illlxx et XIX, comme cy devent ait estes dit. Et est cest piesse d'euvre la plus belle et la plus riche, pour ung pont, qui soit au monde comme je croy » : Philippe de Vigneulles, La chronique de Philippe de Vigneulles, éd. par Ch. Bruneau, t. IV, Metz, 1933, p. 128.
276 ETIENNE HAMON
parisienne^ et l'archéologie a apporté récemment un émouvant témoignage sur ces échanges à l'époque qui nous occupe. Les plus anciennes pièces du trésor de vaisselle d'argent de Pouilly-sur-Meuse (Meuse), découvert en 2006, sont en effet sorties d'ateliers parisiens d'où elles ont pu être exportées en Lorraine dès les années 1500'°. Pour les Lorrains comme pour toute la clientèle française, la production parisienne d'orfèvrerie était la plus appréciée.
Dans le domaine de la peinture où la Lorraine ne disposait pas d'une forte tradition artistique, les ressources extérieures furent également abondamment sol l ic i tées . Des Allemands furent engagés aux Cordeliers de Nancy mais c'est aux artistes français que la famille ducale accorda ses plus grandes faveurs en matière de production de luxe. Je me contenterai d'illustrer cet aspect du mécénat de René I I par le cas des frères Trubert. Georges Trubert fut l'un des artistes les plus brillants de la cour de Lorraine. Enlumineur originaire du diocèse de Troyes, actif pour le roi René dès 1467 en Val-de-Loire, i l voyagea en Italie en 1476 et s'établit en Provence où i l devint vers 1486 enlumineur en titre de René 11. I l s'installa vers 1490 en Lorraine où i l demeura jusqu'à sa mort en 1508. Parmi ses missions officielles lointaines, deux au moins l'amenèrent à Paris en 1496 et 1499. C'est là aussi qu'en 1492 le duc commanda pour sa chapelle au frère de Georges des « orgues de paille », une sorte de xylophone. Guyot Trubert était en effet établi comme facteur d'orgues dans la capitale où résidaient deux autres frères Trubert, les sculpteurs Oudart et François".
On pourrait multiplier les exemples montrant que René I I appréciait la manière parisienne et que, pour les artistes dont i l s'entourait, l'horizon parisien offrait une promesse de perfectionnement autant que de débouchés'^ I l serait donc étonnant que le dynamisme architectural de la Lorraine sous son gouvernement ne fiit pas lui aussi, partiellement au moins, tributaire de ces échanges avec l'Île-de-France. Je me propose d'explorer ces derniers à la lumière du parcours d'un architecte de premier plan, Jean de Félin.
9 - Au hasard des sources parisiennes, on rencontre un Jean Le Lorrain, tapissier (1376), un Ymbelot Le Lorrain, peintre (1396-1418), un Jean Le Lorrain, fondeur (1467-1470), et bien d'autres artistes au nom formé sur une ville lorraine. 10 - Elles portent notamment le poinçon de Pierre Ensoult, actif après 1466 et mort avant 1500 (voir à ce sujet la contribution de M. Bimbenet-Privat au catalogue Trésors enfouis de la Renaissance : autour de Pouilly-sur-Meuse, Paris, 2011, et E. HAMON, Documents du Minutier central des notaires de Paris. Art et architecture avant 1515, Paris, 2008, n° 1035). Des contacts existent aussi entre orfèvres lorrains et Paris (É. HAMON, ibid., n° 1182). 11 - Sur cet artiste révélé par Nicole Reynaud et sur sa famille, voir en dernier lieu É. HAMON, op. cit., 2004, à la note 2. 12 - Citons aussi, à la suite de Nicole Reynaud, le cas de Pierre Gamier, enlumineur originaire de Bourges, actif pour René II (1476-1493) qui l'envoya en 1486 à Paris rapporter une bible enluminée, et celui de François Bourcier, envoyé en 1506-1508 par le duc à Paris « pour aller apprendre l'art d'enlumineur ». N. REYNAUD, « Georges Trubert, enlumineur du roi René et de René II de Lorraine », Revue de l'art, t. 35, 1977, p. 58 et p. 63, note 48.
UN LORRAIN À PARIS? L'ARCHITECTE JEAN DE FELIN (ACTIF 1488-1520).. 277
3. Un médiateur ? L'architecte Jean de Félin. Jean de Félin fut l'architecte le plus en vue à Paris au cours des deux premières
décennies du X V P siècle. À ses fonctions de maître des œuvres de maçonnerie de la ville et de juré du roi, qui lui conféraient une position dominante et un statut d'expert dont témoigne des dizaines de rapports techniques (fig. 3), i l ajouta celle d'architecte et d'entrepreneur de réalisations qui comptèrent parmi les plus fameuses dans la capitale et sa région : la tour de l'église Saint-Jacques-de-la-Boucherie, le plus haut clocher de Paris après ceux de la cathédrale (fig. 4) ; le pont Notre-Dame, tant
admiré par Philippe de Vigneulles (est-ce un hasard ?), etc.'^ Informé de tous les chantiers d'envergure, Jean de F é l i n ba igna i t dans un milieu artistique cosmopolite dont faisaient partie les frères Trubert qui tenaient rés idence à deux pas de la sienne.
Mais si la deuxième partie de sa ca r r i è r e est l impide, tel n'est pas le cas de la première , ce qui nous renvoie à la question de ses origines. Ses premières années d'activité furent en effet marquées par une longue éclipse, surprenante pour un artiste de l'envergure qui sera la sienne par la suite.
Fig. 4: Paris, tour de l'ancienne église Saint-Jacques-de-la-Boucherie, commencée en 1509 par Jean de Félin (photo E. Hamon)
Fig. 3 : Signature autographe de Jean de Félin sur un rapport d'expertise de 1506 : Arch.
nat. S 2026A (photo. E. Hamon)
13 - É. HAMON, op. cit., 2008, à la note 10, n° 149, et É. HAMON, op cit., 2011, à la note 2, p. 243-246.
278 ÉTTENNE HAMON
Après une première apparition comme sous-traitant pour la taille de claveaux d'ogives sur le chantier de l'église à Saint-Paul en 1488, i l disparaît des sources pour ne réapparaître qu'au printemps 1500 sous le nom de « Jean de Félin dit de Lorraine ». Ce sobriquet soulève nombre d'interrogations. L'architecte le tenait-il de sa province d'origine d'où i l serait arrivé à Paris avant 1488, ou d'un séjour temporaire dans cette province entre 1488 et 1500, deux hypothèses au demeurant parfaitement compatibles ? La rareté des occurrences de ce surnom dans la documentation qui le concerne autant que leur date (deux immédiatement après 1500, puis une en 1514) peuvent faire pencher pour la seconde hypothèse . Mais celle-ci doit tenir compte d'un possible effet de source. Jean de Félin avait toutes les raisons de ne pas quitter Paris autour de 1490, période faste pour l'activité artistique dans la capitale où plusieurs grands chantiers annonciateurs de ses futures créations restent toujours anonymes : les chevets de Saint-Séverin et de Saint-Gervais ; la rose de la Sainte-Chapelle, etc.
D'ailleurs l'anthroponymie milite plutôt en faveur de la première hypothèse, à savoir que Jean de Félin serait un Lorrain d'origine. I l existe en effet dans la Meurthe-et-Moselle, à 16 km à l'est de Pont-à-Mousson, une petite commune du nom de Phlin, dont les graphies les plus courantes du X I I F au XVL" siècle sont « Félin », « Flin » ou « Felain »"*. Cette bourgade avait donné son nom à une famille noble dont sortit un évêque de Metz au XI IP siècle'^ Elle perdit son fief éponyme vers 1400 mais le patronyme perdura : un certain Bertrand de Félin figurait parmi les fidèles du duc assemblés à Nancy en septembre 1435"". À l'appui d'une telle origine familiale, on soulignera que le frère de Jean de Félin, Didier, également maître d 'œuvre de renom à Paris (attesté 1497-tl500) et lui aussi surnommé « de Lorraine », portait un prénom plutôt rare à Paris (6 « artistes » le portent sur les quelque 3000 repérés vers 1500) alors qu'il est courant dans l'est de la France'̂
4. Jean de Félin et la Lorraine : hypothèses monumentales. Les œuvres parisiennes connues de Jean de Félin, toutes postérieures à 1500,
offrent-elles les accents « lorrains » de la fin du XV^ siècle que l'on serait fondé à y trouver dans les deux scénarios envisagés plus haut ? Certaines pistes tournent court comme son goût prononcé pour les branches écotées si manifeste dans l'église
14 - Même si notre architecte signe « de Félin », son nom est occasionnellement orthographié « Phelin » par les scribes parisiens: E. HAMON, op. cit., 2008, à la note 10, n° 154. 15 - H. LEPAGE, Les communes de la Meurthe, vol. 2, Nancy, 1853, p. 287-290. 16 - Dom A. CALMET, Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine, t. I I I , Nancy, 1728, col. c c x x i - c c x x n . 17 - Sur Didier de Félin, voir É. HAMON, op. c/7., 2008, à la note 10, n° 148. On croise un autre maçon nommé Didier Le Lorrain sur le chantier de la cathédrale de Bourges en 1516 !
UN LORRAIN À PARIS? L'ARCHITECTE JEAN DE FELIN (ACTIF 1488-1520).. 279
Saint-Aspais de Melun dont i l donna les plans en 1517 (fig. 5). Plus que ses contacts avec des artistes du milieu lorrain comme Georges Trubert, dont les enluminures attestent une même sensibilité au naturalisme autour de 1490, cette tendance est redevable des créations de son mentor parisien Martin Chambiges'*^.
Fig. 5 : Melun, portail sud du chevet de leglisc Sauii-Aspais par Jean de Félin, 1517-1520 (photo E. Hamon)
18 - É. HAMON, « Le naturalisme dans l'architecture française autour de 1500 », Le gothique de la Renaissance. Actes des 4e rencontres d'architecture européenne, Paris, 2011, p. 329-343.
280 ETIENNE HAMON
L'absence de Jean de Félin des sources parisiennes entre 1488 et 1500, en dépit des réserves invoquées plus haut sur l'interprétation à lui donner, et le surnom qu'il reçoit à cette dernière date nous obligent à envisager qu'il ait pu entreprendre dans cet intervalle une mission dans le duché, laquelle aurait d'ailleurs pu lui valoir la renommée qui s'attache à lui à Paris dès 1500. Tâchons donc d'en comprendre les circonstances et, surtout, les motivations.
L'activité des réseaux politiques, commerciaux et artistiques lorrains à Paris, précédemment entrevus, lui offrait toutes les opportunités d'entrer en contact avec des commanditaires lorrains. Restait le principal, la motivation, qui ne pouvait être que la perspective d'occuper sur un chantier de grande envergure une place à la mesure de ses talents de tailleur de pierre. On l'a suggéré en introduction, ce ne sont pas les grands chantiers qui manquaient alors en Lorraine. Reste à identifier ceux d'entre eux qui témoignent d'influences reçues de la capitale ou léguées à celle-ci.
J'écarterais d'emblée Metz et Nancy. À Metz commença bien un important chantier en 1487 avec le bras nord de la cathédrale. Mais les chercheurs ont suffisamment montré que l'on s'y est montré d'une intraitable fidélité à l'art rayonnant et que l'on y a privilégié la filière germanique pour les recrutements d'artistes é t r a n g e r s à la v i l l e . Cependant, les commandes de l'évêque Henri de Lorraine (1484-1505), oncle de René I I , ont davantage sollicité des artistes du bassin parisien, à l'image de Jacques Bachot recruté à Troyes en 1495-1504 pour sculpter des tombeaux dans la cathédrale et dans la collégiale Saint-Laurent de Joinville. La participation de Jean de Félin à ces entreprises disparues n'est pas à exclure. Nancy ne fournit pas une hypothèse plus séduisante. Les grands travaux d'architecture y commencèrent surtout après 1500, si l'on excepte les Cordeliers fondés en 1482 mais dont le chantier ne décolla que sous le règne d'Antoine après avoir fait appel à des artistes locaux ou impériaux'^.
C'est plutôt du côté de Toul qu ' i l semble falloir rechercher les signes les plus tangibles de l'intervention de maîtres d'œuvre sensibilisés aux formules f rançaises . La ca thédra le en cours d 'achèvement ne saurait retenir notre attention. Les lacunes de sa documentation laissent, certes, ouverte l'hypothèse d'un maître d'œuvre étranger dans la dizaine d'années qui suit la mort en 1491 ou 1492 du maître d 'œuvre Jacquemin de Lenoncourt, et le profil de Jean de Félin, à la fois sculpteur et architecte, en fait un bon candidat à cette succession. Mais les styles des créations du maître parisien et des superstructures de la cathédrale lorraine n'offrent pas de rapprochement convaincant, pas plus que les singularités de Saint-Gengoult (fig. 2), même si l'esprit n'est pas très éloigné.
19 - On y fait venir en 1484 un verrier de Strasbourg, en 1490 un imagier de Toul et en 1500-1501 un peintre allemand, Bartholomeus Vest. S. BERTOLDI, « Nancy église des Cordeliers », Congrès archéologique de France, 164e session, Nancy et Lorraine méridionale, 2006, p. 99-107.
UN LORRAIN À PARIS? L'ARCHITECTE JEAN DE FELIN (ACTIF 1488-1520).. 281
Reste alors le plus ambitieux et cosmopolite des chantiers du moment en Lorraine: Saint-Nicolas-de-Port^°. Le programme initial qu'il convient sans doute de placer vers 1490, largement tributaire du modèle de la cathédrale de Toul, ne milite pas en faveur d'un architecte recruté sur la base de son expérience parisienne, sinon pour les voûtes complexes sans ogives prévues dès l'origine ; encore qu'un modèle germanique soit ici envisageable. En revanche les nouvelles inflexions prises en cours de chantier, à partir des années 1500, vont dans un sens qui nous intéresse. Les historiens ont montré qu'elles participaient à une reprise en main du chantier par une équipe plus expérimentée que celle à qui l'on doit les imperfections techniques des parties les plus anciennes du chevet. La mise en chantier du transept double, authentique morceau de bravoure de l'église pour reprendre l'expression de Pierre Sesmat^', pouvait à elle seule motiver un tel renouvellement des cadres (fig. 1).
L'analyse de ce jaillissement de colonnes de formes variées ne laisse guère de doute sur le fait que l'équipe chargée vers 1505 de sa mise en œuvre était, en partie du moins, parisienne de formation. Quelle que fût sa composition, celle-ci a en tout cas fait preuve de son aptitude à acclimater, dans l'espace intérieur de l'église non encore totalement défini, les accents nouveaux de l'art parisien vers 1490 dont les colonnes à torsion alternée (déambulatoire de Saint-Séverin) sont l'une des manifestations les plus saisissantes (fig. 6)^^ Jean de Félin serait tout désigné pour assumer la paternité du chef-d'œuvre portois si sa présence assidue à Paris à partir de 1500 au plus tard ne contrariait cette hypothèse. À moins que l'on ne retienne la chronologie haute d'Andréas Fôrderer qui permet d'imaginer que cette inflexion décisive du chantier de Saint-Nicolas intervint dans les années 1490^1 Et si Jean de Félin a fort bien pu laisser à Saint-Nicolas-de-Port des instructions nécessaires à la mise en application de se projets, c'est un scénario différent qui se dessine dans lequel notre architecte pourrait n'avoir eu qu'un rôle partiel voire aucun rôle.
20 - On y croise, mais plus tard, des peintres-verriers lyonnais dont Nicolas Droguet (1508-1510) et un sculpteur champenois Jacques Bachot qui y réalisa une Mise au tombeau vers 1520. 21 - P. SESMAT, « Saint-Nicolas-de-Port, l'église de pèlerinage de saint Nicolas », Congrès archéologique de France, 164e session, Nancy et Lorraine méridionale, 2006, p. 189-198, à la p. 196. 22 - É. HAMON, op. cit., 2011, à la note 2, en particulier p. 170-172. On pourrait également mettre le décor de remplages aveugles des écoinçons des grandes arcades de la seconde campagne au crédit de ces influences du bassin parisien. Ces demières ne doivent pas être surestimées : les piles ornées de bagues, qui contribuent à rapprocher le transept de Saint-Nicolas des églises parisiennes, existent dans l'art lorrain du XV^ siècle à l'image de certains supports de la nef de Saint-Étienne de Bar-le-Duc. 23 - A. FÔRDERER, Saint-Nicolas-de-Port : eine spàtgotische Wallfahrtskirche in Lothringen, Karlsruhe, 2007.
282 ETIENNE HAMON
Fig. 7 : Paris, hôtel de Sens, aile sud commencée en 1498 par Michault Robin et associés (photo Céline Gumiel, centre André Chastel)
UN LORRAIN À PARIS? L'ARCHITECTE JEAN DE FELIN (ACTIF 1488-1520).. 283
On sait aujourd'hui que la reprise en main du chantier évoquée plus haut s'est déroulée, à partir de 1505 du moins, sous la conduite d'un nommé Michel Robin qui apparaît cette année-là comme « maistre maçon de l'église Sainct Nicolas de Port » et qui est appelé à la même époque avec « un autre maître maçon du duc de Lorraine » comme expert sur le chantier de la façade de la cathédrale de Troyes, occasion pour ces hommes de prendre connaissance des projets du parisien Martin Chambiges^"*. La date exacte de l'entrée de Michel Robin sur la scène lorraine est malheureusement inconnue mais elle ne saurait être de beaucoup antérieure à 1505. Toujours à cette date, le maître maçon fit en effet l'acquisition d'une maison à Port, ce qui suggère qu'il n'était pas assidûment à l'œuvre à la grande église auparavant.
L'origine de ce Michel Robin n'a, à ma connaissance, jamais été établie avec précision. J'oserais donc, pour finir, une dernière hypothèse : n'était-il pas parisien et, dans ce cas, ne peut-on l'identifier au nommé Michault Robin qui figure parmi les maçons engagés pour construire l'hôtel des archevêques de Sens à Paris en 1498 (fig. 7) et qui se trouve être le seul dont la trace se perde dans la capitale après cette date ? De la part d'un tailleur de pierre ayant participé à une réalisation aussi prestigieuse - dont l'étude architecturale est aujourd'hui compromise par les très lourdes restaurations qu'elle a subies - cette disparition est suffisamment inattendue pour autoriser ce type d'explication, comme nous l'avons fait précédemment pour Jean de Félin.
Avouons-le, i l ne s'agit là que de conjectures dont l'accumulation ne saurait tenir lieu de preuves. En attendant que celles-ci nous soient fournies pour l'architecture, on peut se fier à des témoignages historiques nombreux et concordants du fait que le renouveau du gothique flamboyant en Lorraine autour de 1500 fut le fruit d'échanges nourris avec, notamment, l'espace français. L'examen des œuvres appartenant à ce courant d'une extraordinaire fécondité rend difficile de préciser dans quel sens ces liens se sont le plus affirmés, d'autant que d'autres influences se sont fait sentir
24 - P. MAROT, Saint-Nicolas-de-Port, la Grande église et le pèlerinage, s. 1., 1963, p. 101-102. S. MURRAY, Building Troyes Cathedral. The Late Gothic Campaigns, Bloomington-Indianapolis, 1987, p. 178.
284 ETIENNE HAMON
dans l'architecture lorraine, particulièrement celles venant de Champagne. Par son dynamisme et sa position géographique, cette province offrit une porte d'entrée privilégiée à l'art français en Lorraine autant qu'un relai pour des influences en retour en direction du milieu parisien alors si perméable aux apports extérieurs^'. Jacques Bachot en donne l'exemple : imagier de Troyes, i l réalisa vers 1500 deux tombeaux pour Henri de Lorraine, évêque de Metz, puis reçut une commande de statues pour Saint-Germain-l'Auxerrois de Paris en 1506 avant de sculpter vers 1515 un sépulcre à Saint-Nicolas-de-Port. Ce qui est acquis pour ce sculpteur, en qui les spécialistes tendent raisonnablement à voir le Maître de Chaource, a dià se produire dans le domaine de l'architecture à propos de laquelle, malheureusement, les travaux historiques anciens se montrent rarement aussi loquaces sur l'identité des créateurs qu'ils le sont à propos des beaux-arts, alors même que les monuments sont toujours restés présents de manière bien plus insistante dans le paysage actuel que les œuvres mobilières ou funéraires à qui ils servaient d'écrins.
25 - É. HAMON « Les échanges artistiques entre Paris et Troyes à la fin de l'époque gothique d'après les sources d'archives », La vie en Champagne, nouvelle série, n° 43, juillet-septembre 2005, p. 44-54.