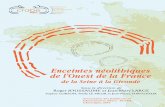Haches alpines Néolithique moyen pyrénéen-2011
Transcript of Haches alpines Néolithique moyen pyrénéen-2011
Résumé :Dans l’optique du programme JADE, notre enquête sur les ensembles funéraires de Catalogne a permis de montrer que l’arrivée des haches en jades alpins (sur-tout du massif du Mont Viso) n’était probablement pas antérieure à la fin du Ve millénaire. Quant au maximum des importations, il intervient certainement durant le premier quart du IVe. À cette époque, la corrélation sem-ble forte entre l’arrivée des nucléus en silex bédoulien chauffé et la présence de ces haches alpines, souvent dans les ensembles funéraires les plus riches. Ce se-rait donc par le biais des influences chasséennes et des réseaux de circulation du silex du Vaucluse que la cir-culation de certains jades alpins aurait été tardivement réorientée au-delà des Pyrénées, en direction des ex-ploitants de variscite.
La hache de type carnacéen trouvée isolément à Collbatò témoigne de l’intrusion d’une hache en jade alpin d’abord importée en Bretagne, puis repolie en Morbihan, avant d’être exportée à nouveau en direction du sud-ouest de la France et jusqu’en Catalogne ; elle pourrait avoir constitué une contre-partie à l’exportation de la variscite de Gavà vers l’Armorique à cette époque.
On doit également constater que, parmi les dotations fu-néraires, les lames polies en jades alpins accompagnent préférentiellement les inhumations les mieux dotées. Bien qu’aucune de ces haches n’atteigne des dimensions exceptionnelles, ni un niveau de polissage vraiment re-marquable, elles pourraient bien matérialiser la richesse de quelques défunts particuliers, sans atteindre pour autant le statut extraordinaire des hommes inhumés, vers le milieu du Ve millénaire, autour du golfe du Mor-bihan ou à Varna sur les rives de la Mer Noire. Seule la sépulture de La Bisbal d’Empordà semble devoir être re-marquée plus particulièrement, avec son unique viatique : une magnifique longue hache (28,5 cm) de type Puy, au polissage très soigné ; se pose ici la question du statut très éminent de l’inhumé.
L’étude des tombes catalanes permet également de da-ter plus précisément, au moins dans cette région, les haches en jades de type Puy. L’exemplaire de Bòbila Madurel M5, placé dans une tombe à fosse circulaire, est attribué au tout début des « Sepulcres de fossa », c’est-à-dire à la transition Ve-IVe millénaires. Celui de Bòbila Padró est à peine plus tardif ; il est contempo-rain du faciès Auriac du Chasséen, entre 4000 et 3850 av. J.-C. Ce serait donc bien à l’expansion du Chas-séen (contemporain de la première métallurgie du cui-vre en Italie du Nord) vers la fin du Ve millénaire, que l’on devrait la première diffusion du type Puy, dont les exemplaires tardifs sont encore attestés au cours
du 36e siècle dans les villages littoraux de Suisse oc-cidentale. Les séries catalanes comportent aussi des grandes haches en jade-néphrite et autres roches tenaces dont l’origine valaisanne ou pyrénéenne de-vra être précisée lorsque les référentiels des divers affleurements de roches ultrabasiques nord-pyrénéen-nes seront établis. Les morphotypes de ces haches ne sont pas différents de ceux des Alpes ; ils adoptent les standards des types Chelles et Puy ou celui de longs ciseaux, ces derniers pouvant avoir des formes spéci-fiquement pyrénéennes (type Lagor).
Mots clés : Néolithique, Sepulcres de fossa, Chasséen, Catalogne, Pyrénées, Languedoc, sépulture, haches polies, jadéitite, omphacitite, éclogite, néphrite, cinérite, variscite, silex, obsidienne.
Chapitre 15
Les haches alpines dans les sépultures du Néolithiquemoyen pyrénéen : importations et influences
Alpine axeheads in the Middle Neolithic graves of the Pyrenees : importations and influences
Jean Vaquer, Araceli Martín, Pierre Pétrequin, Anne-Marie Pétrequin et Michel Errera
872 Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influencesDEUXIÈME PARTIE
873Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
Jade Grandes haches alpines du Néolithique européen Ve et IVe millénaires av. J.-C.
Abstract :Thanks to programme JADE, our research into the fu-nerary assemblages of Catalonia has allowed us to de-monstrate that the arrival of Alpine jade axeheads (co-ming mostly from the Mont Viso massif) was probably no earlier than the end of the 5th millennium BC. The peak period of importation was during the first quarter of the 4th millennium BC. At this time, there seems to have been a strong correlation between the presence of these Alpine axeheads and the arrival of cores of heat-treated Bedoulian flint ; both have often been found in the assemblages from the richest graves. It therefore appears that influence from the Chassey culture, and the operation of the network of contacts around which Vaucluse flint circulated, were responsible for the late re-orientation of the circulation pattern of certain Alpine jades across the Pyrenees, in the direction of the people who were mining variscite.
The single Carnac-type axehead found at Collbatò attests to the intrusion of an Alpine jade axehead that had initially been imported to Brittany, and subsequently repolished in the Morbihan, before being exported once again, to-wards south-west France and as far as Catalonia. It may have constituted an item that had been exchanged for the variscite from Gavà that was being exported northwards to Armorica at this time.
It should also be noted that, among the range of grave goods, polished axeheads of Alpine jade are preferen-tially found in the richest graves. Even though none of these axeheads is exceptionally large, nor has a remar-kable degree of polish, nevertheless they may well have been a material expression of the wealth and importan-ce of certain special individuals (albeit none occupying the extraordinary status of the men who were buried, around the middle of the 5th millennium, around the Gulf of Morbihan or at Varna on the shores of the Black Sea). Only the grave of La Bisbal d’Empordà seems to have been of especial significance, with its unique set of gra-ve goods : a magnificent long axehead (28.5 cm long) of Puy type, very carefully polished. This raises the ques-tion of the eminent status of the individual with whom they were buried.
The study of Catalan tombs also permits us to arrive at a more precise date for the use of Puy-type jade axeheads, at least in this region. The example of Bòbila Madurel M5, placed in a circular pit, is attributed to the very beginning of the « Sepulcres de fossa » culture, at the transition of the 5th to the 4th millennia BC. The example from Bò-bila Padró is slightly later : it is contemporary with the Auriac phase of the Chassey culture, between 4000 and 3850 BC. The initial diffusion of Puy-type axeheads would
therefore seem to be linked with the expansion of the Chasséen (which was contemporary with the earliest copper metallurgy in northern Italy), around the end of the 5th millennium ; the latest examples of Puy-type axe-heads date to the 36th century BC in the lakeside villages of western Switzerland. The Catalan series of Alpine axe-heads includes large specimens in nephrite jade, along with others made from other tough rocks which could come from either the Valais or the Pyrenees; determining which is the case awaits the establishment of a reference collection of ultrabasic rocks in the north Pyrenees. The shapes of these axeheads are the same as those of Al-pine jade axeheads ; they are of Chelles and Puy type. There are also long chisels, which seem to be of specifi-cally Pyrenean type (‘type Lagor’).
(translation : Alison Sheridan)
Key words : Neolithic, Sepulcres de fossa, Chassey, Chasséen, Catalonia, Pyrenees, Languedoc, grave, po-lished axeheads, jadeitite, omphacitite, eclogite, nephrite, cinerite, variscite, flint, obsidian
DEUXIÈME PARTIE
874 Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
Quelques grandes haches en roches alpines, des types alpins ou carnacéens, ont été découvertes
dans le domaine pyrénéen. La situation est cependant très différente entre le versant nord pyrénéen, qui a li-vré d’assez nombreux exemplaires en trouvailles isolées, et le versant sud où quelques-unes ont été signalées en contexte funéraire. Cette zone méritait donc une enquête portant sur toutes les haches des dotations funéraires, de façon à contrôler leur appartenance au phénomène des haches alpines et à traquer des informations contextuel-les précises. De prime abord, la situation est apparue très différente entre le nord et le sud de la chaîne pyrénéenne. Tandis que le Chasséen nord pyrénéen ne comporte que 156 tombes, dont 13 seulement avec des dépôts de ha-ches polies, la culture catalane des « Sepulcres de fossa » compte plus de 500 tombes, dont 107 ont livré des haches polies au nombre de 1 à 9. La Catalogne constitue donc un ensemble de référence remarquable pour les diverses problématiques concernant cette catégorie d’outillage.
En Languedoc, les caractérisations pétrographiques des roches utilisées pour les haches polies sont principalement dues à M. Ricq -de Bouard (1996), qui n’a étudié pratique-ment que des séries provenant d’habitats. En Catalogne, les études de haches polies n’ont pas été systématisées. Dans les monographies anciennes, les roches utilisées pour les haches polies des sépultures ont été identifiées à vue par des préhistoriens naturalistes, sans aucun recours à des analyses pétrographiques (Serra Vilaro 1927, Serra Rafols 1947). Ces déterminations sont pour la plupart im-précises et empiriques (serpentine, jadéite, diorite, ophite, etc.) ; elles ont ensuite été reprises telles quelles dans les principales synthèses (Ripoll Perelló et Llongueras Cam-paña 1963, Muñoz Amilibia 1965, Esteve 1999, Castany 2009). L’application de méthodes pétrographiques est ré-cente ; lorsqu’elle est fondée sur des lectures minéralogi-ques de lames minces par des géologues, les caractérisa-tions ont un caractère destructif gênant et cela explique qu’elles ont surtout porté sur des haches provenant de prospections ou d’habitats, qui ne présentaient pas un intérêt muséographique important (Bosch 1984, Alvarez Perez 1993, Risch et Martinez Fernandez 2008). Dans ces conditions, les résultats ont documenté principalement les outils communs obtenus sur des roches métamorphiques banales provenant d’alluvions. En Catalogne, le mythe d’une utilisation importante du basalte a dû être aban-donné au profit du constat d’une utilisation massive des cornéennes. Il n’y a guère que la série de la sépulture de Bòbila d’en Joca qui a fait l’objet d’une enquête archéo-pé-trographique poussée, avec plusieurs méthodes en partie destructives et non destructives, mais ces analyses sont restées inédites (Casas i Pérez 2000). Cette étude a révélé que la dotation de cette sépulture contient des haches en roches différentes, pas faciles à caractériser et vraisembla-blement de provenance lointaine (Alpes italiennes et Midi de la France), comme d’autres éléments déposés dans la tombe.
Dans le cadre du projet JADE, il a paru très intéressant de pouvoir appliquer une méthode de caractérisation non destructive -telle que l’analyse spectroradiométrique- à des pièces qui font partie pour certaines des mobiliers les plus emblématiques du Néolithique pyrénéen. Le choix a donc porté sur les registres funéraires qui ont récemment été inventoriés des deux côtés de la frontière, dans le cadre d’une ACR sur « Les espaces et les pratiques funéraires du domaine pyrénéen au Néolithique moyen ». L’axe majeur
de cette enquête repose sur une mission du programme JADE effectuée en avril 2008 au Musée archéologique de Catalogne à Barcelone (M. Errera, A.-M. et P. Pétrequin, J. Vaquer) ; il est complété par les apports de quelques mis-sions complémentaires effectuées par la suite dans d’autres établissements catalans, afin de réaliser les examens de pièces supposées alpines repérées dans les publications (A. Martin et J. Vaquer). C’est afin de mieux comprendre les ramifications de la problématique des grandes haches alpines que l’enquête a été élargie au cas par cas, d’une part à quelques trouvailles fortuites en Catalogne ou à des pièces en roches alpines de longueur inférieure à 14 cm lorsqu’elles étaient présentes dans les séries. La problé-matique des possibles imitations concernant des haches de morphologie alpine réalisées en roches pyrénéennes n’a pas été éludée. Dans cet article, elle est évoquée seule-ment à propos de certaines pièces de la zone méridionale des Pyrénées. Une étude spécifique au versant nord a été réalisée pour le programme JADE et est disponible dans cet ouvrage (tome 2, chapitre 20, p. 1088).
• 1. Les haches polies d’origine alpine dans les dotations funéraires chasséennes de la zone nord-pyrénéenne
Dans la zone nord-pyrénéenne, les haches polies sont at-testées dans près de 8% des sépultures connues. Parmi celles-ci, plusieurs sont des mentions anciennes difficile-ment vérifiables dont les pièces sont perdues, ce qui ne permet pas de connaître la nature des roches utilisées et leur origine possible. Tel est le cas des sépultures dites de Chambre Verte à Béziers (Hérault) (deux haches) et, dans l’Aude, des tombes de la nécropole de Bordasse à Conilhac-de-la-Montagne (deux haches) ou de la ciste de Lapierre à Castelnaudary (trois haches) (Guilaine et Muñoz 1964, Va-quer 2007). Les mentions de découvertes de grandes ha-ches en roches alpines dans des ambiances funéraires sont anciennes et douteuses. Le cas du Doul à Peyriac-de-Mer (Aude), où de grandes haches en jade auraient été extraites d’un tumulus, est invérifiable (Héléna 1937). La trouvaille de la grotte du Figuier à Dourgne (Tarn), où une belle hache de type Durrington aurait été associée à des ossements humains souffre d’imprécision (Vaquer, Pétrequin et Remi-court 2008). La très fameuse « tombe de Pauilhac » (Gers) est extraordinaire, mais aussi problématique. Si des argu-ments ont été apportés récemment pour considérer que tout le mobilier de Bischoff et celui de du comte de Chas-teigner pouvait constituer une dotation particulièrement ri-che à situer à la charnière des Ve et IVe millénaires (Roussot-Larroque 2008), il subsiste des incertitudes sur la véracité de l’association des deux haches de jade, des lames en silex de Forcalquier débitées au levier et des parures en or. En effet, d’après les mentions de Bischoff (1865), une des haches aurait été trouvée à 15 m des autres trouvailles, tout à fait isolée au milieu d’une couche de gravier, ce qui ne plaide pas vraiment pour une association stricte dans une unique tombe. Dans ces trois cas, les ambiances funé-raires des trouvailles de « haches d’apparat » nous semblent plutôt supputées que prouvées.
En Languedoc et en Midi-Pyrénées, il n’est donc pas possible de raccorder sûrement les trouvailles de gran-des haches en roches alpines avec des dotations funérai-res. Lorsque des haches trouvées en contexte funéraire peuvent être examinées, elles sont en roches locales et banales, comme c’est le cas à Villeneuve-Tolosane et à Cugnaux (Haute-Garonne) (Vaquer, Gandelin et al. 2008).
DEUXIÈME PARTIE
875Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
Jade Grandes haches alpines du Néolithique européen Ve et IVe millénaires av. J.-C.
En fin de compte, on ne peut citer que deux cas de haches en roches alpines en contexte chasséen, pro-bablement funéraire. La première est une lame de ha-che de forme trapézoïdale, à section elliptique mince, qui mesure 7 cm de long, sur 4,1 cm de large, trouvée dans la fosse 22 du site de Jacques Cœur II à Mont-pellier (Hérault) ; elle serait en jadéitite d’après M. Ricq -de Bouard. Elle se trouvait dans une fosse à mobilier abondant de style Chasséen ancien, située à une dizai-ne de mètres d’une sépulture à inhumation d’un sujet adulte placée dans une fosse circulaire, sans dotation conservée (Jallot et al. 2000). Il a été admis implicite-ment qu’il y aurait un lien entre les deux fosses, com-me dans le cas du dépôt des fosses 35-36 du site des Plots de Berriac (Aude), mais cela n’est pas prouvé, faute de raccord de mobilier fragmenté. L’autre est une trouvaille fortuite faite sur le site des Pluméjals à Pui-chéric (Aude). Il s’agit d’un petit lot de pièces remar-quables trouvées au même endroit à l’occasion d’une plantation de vigne dans la propriété de G. Carbou. Ce mobilier qui comporte un nucléus à lamelles en silex bédoulien chauffé et deux haches polies entières évo-que fortement une dotation funéraire d’une sépulture détruite par le défonçage de la parcelle.
La première lame de hache polie, à tranchant convexe légèrement oblique, section elliptique et talon conique, est en roche tenace vert foncé et de haute densité. La zone du tranchant est entièrement polie, tandis que le corps et le talon ont gardé des traces du piquetage de mise en forme (fig. 1, n° 1). Cette lame mesure 12,7 cm de long, 5,3 cm de large et 2,6 cm d’épaisseur. L’ana-lyse spectroradiométrique montre qu’il s’agit d’une
éclogite, probablement du Mont Viso selon une déter-mination à l’œil nu (voir fichier général en fin d’ouvrage, hache n° JADE 2008_862).
La seconde lame de hache, elle aussi entière et bien conservée, est en roche tenace, de couleur vert som-bre. Elle est à tranchant légèrement oblique et conve-xe, avec un talon conique. Sa section est elliptique avec un flanc légèrement équarri. Le polissage devait s’étendre sur la majeure partie de la pièce, mais des enlèvements liés à des altérations ne permettent pas de s’en rendre compte correctement. Des zones à bouchardage résiduel existent dans la partie proxi-male (fig. 1, n° 2). Elle est très semblable à la précé-dente quoique légèrement moins longue : longueur 11,4 cm, largeur 5,2 cm, épaisseur 2,3 cm. Si l’ana-lyse spectroradiométrique ne permet pas de préci-ser l’origine de la roche, une détermination à l’œil nu permet de suggérer une origine alpine possible, dans le massif du Mont Viso (voir listing général, hache n° JADE 2008_861).
Ce type de hache est typique du Néolithique moyen, mais ne se rencontre que rarement dans les habitats. On en connaît quelques débris sur certaines stations chasséennes comme les Picarts à Montlaur ou le Coustou à Cavanac (Aude), où leur provenance alpine a été déterminée par M. Ricq -de Bouard (1996). Géné-ralement ces haches de format moyen se rencontrent plutôt dans les sépultures de l’aire orientale des Pyré-nées, notamment dans le sud de la Catalogne, où elles sont bien documentées dans les sépultures les plus riches du complexe des « Sepulcres de fossa ».
FIG. 1Haches polies en éclogite du site de Pluméjals (possible tombe bouleversée), Puichéric (Aude, Languedoc, France).
Collection Carbou, photo M. Remicourt, DAO J. Vaquer.
DEUXIÈME PARTIE
876 Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
Les trois objets lithiques trouvés par G. Carbou sur le site des Pluméjals sont typiques du Néolithique moyen et plus particulièrement du Chasséen méridional dans son étape classique (circa 4000-3850 av. J.-C.). Il s’agit d’un mobilier de choix ne comportant que des éléments d’importation lointaine, sans dégâts liés à l’usage ou à une utilisation li-mitée. Le nucléus en silex bédoulien chauffé de type sub-conique à plan de pression incliné (type mixte de V. Léa) est prêt à l’emploi et aurait pu donner d’autres lamelles ; les deux haches polies sont à tranchant vif, encore utilisable. Il ne saurait s’agir de rejets domestiques qui ne comportent jamais de telles pièces de valeur, intactes. Il semble peu pro-bable qu’il s’agisse d’un dépôt, car ces derniers ne mêlent pas les haches polies et les silex qui circulaient sans doute dans le cadre de réseaux distincts. L’hypothèse d’un mobi-lier funéraire d’une ou de plusieurs tombes remaniées par les défonçages de vigne semble la plus probable.
• 2. Une grande hache polie d’origine alpine dans une dotation funéraire du Néolithique moyen de la province de Gérone
Le Néolithique moyen de cette zone au nord-est de la Catalogne est documenté principalement par des séries qui appartiennent au groupe de Montbolo -parfois mâtiné d’aspects du Chasséen ancien (mobilier de la tombe Fon-teta à la Bisbal) pour la seconde moitié du Ve millénaire- et d’autre part à la culture des « Sepulcres de fossa » dans son faciès empordanien pour la première moitié du IVe millénaire. Celui-ci se manifeste principalement par un polymorphisme des types de tombes incluant des tom-bes en fosse, des tombes en cistes et quelques dolmens à couloir anciens (Martin et Villalba 1999 ; Tarrus 2002). Une seule hache alpine a été signalée dans cette région.
2. 1. La tombe de la Bisbal d’Empordà, Baix Empordà (Girona)
Cette trouvaille a été maintes fois citée comme exemple de « hache d’apparat » trouvée en contexte funéraire. La pièce est conservée au Musée d’Archéologie de Catalogne à Barcelone sous le n° 16381. Elle a été trouvée en 1910 dans une tombe à dalles située dans la vallée du Daró. Dé-couverte fortuitement, elle était associée à des ossements humains, mais on ne sait pas si elle était accompagnée d’autres éléments de mobilier. Il s’agit d’une grande hache de forme triangulaire à tranchant convexe symétrique et à talon pointu de section sub-quadrangulaire (fig. 2). Les bords dressés sont plats d’un bout à l’autre de la pièce avec des arêtes très nettes, les faces sont bombées par-faitement polies, sauf près du talon où subsistent quelques traces de piquetage. Il s’agit d’une hache de type Puy par-faitement typique et de grandes dimensions : 28,4 cm de long, 6,3 cm de large et 2,7 cm d’épaisseur. Elle a été réa-lisée dans une roche qualifiée de serpentine par E. Ripoll et M. Llongueras (1963) ainsi que par A.-M. Muñoz (1965). Il s’agit en fait d’une roche à grain fin, étirée complexe, de couleur vert très sombre presque noir qui contient de ra-res grenats minuscules. Elle correspond à une omphacitite alpine, très vraisemblablement du Mont Viso (voir listing général n° JADE 2008_1593). Un des côtés présente une fissure d’origine probablement thermique qui indique un mode débitage du bloc support par le feu, selon un pro-cédé bien connu dans le domaine alpin (Pétrequin et al. 2008). Il n’est pas possible de retenir ce contexte pour une datation fine ; en effet en Catalogne, les tombes à dalles (cistes ou chambres) sont connues à la fois au Néolithique
moyen I ou initial (par exemple tombe de Ségudet en An-dorre) et au Néolithique moyen II ou classique (complexe solsonien et empordanien).
• 3. Les haches en roches alpines dans les contextes néolithiques de la province de Barcelone
Le territoire de Barcelone ne constitue pas un ensemble géographiquement homogène. Le Néolithique moyen I est représenté par les cultures de Montbolo plutôt dans les zones montagneuses du nord-ouest et de Molinot plutôt vers le sud. Dans de nombreux sites, les deux faciès se présentent sous des aspects mixtes. La culture des « Se-pulcres de fossa » est quant à elle représentée dans son faciès du Vallèsien, très richement documenté dans la dé-pression pré-littorale et au sein duquel une périodisation des types de tombes en fosse, des pratiques funéraires et des assemblages de mobilier commence à être possible. Plusieurs ensembles d’ampleur inégale ont été étudiés.
3. 1. La Cova del Frare de, Matadepera (Vallès occidental, Barcelona)
La Cova del Frare à Matadepera est un gisement de la chaî-ne pré-littorale, qui présente une stratigraphie de référence du Néolithique de Catalogne. Elle recèle des témoins bien documentés d’occupations du Néolithique ancien cardial et épicardial, du Néolithique moyen I (styles Montbolo et Molinot) et du Néolithique final (Martin et al. 1981 et 1985). L’outillage en pierre polie est peu abondant dans les séries de ce site. Nous avons pu examiner deux pièces.
FIG. 2Grande hache polie de type Puy en omphacitite alpine, trouvée dans la tombe
en ciste de La Bisbal d’Empurdà (Girona, Catalunya, Espagne).Musée d’Archéologie de Catalogne, Barcelone, photo P. Pétrequin, DAO : J. Vaquer.
DEUXIÈME PARTIE
877Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
Jade Grandes haches alpines du Néolithique européen Ve et IVe millénaires av. J.-C.
La première provient des niveaux du Cardial. C’est un petit tranchet à tranchant peu convexe de forme trapézoïdale, à section peu rectangulaire mince (fig. 3, n° 5). Il mesure 4,4 cm de long, 3,1 cm de large et 0,8 cm d’épaisseur. Il a été réalisé
sur un éclat débité sur enclume. Seul le tranchant et les côtés sont polis. La roche est à grain fin de couleur vert sombre. L’analyse spectroradiométrique (voir annexe 1) ne renvoie pas à un type alpin connu et suggère un gabbro vraisemblable.
FIG. 3Outils polis d’origines diverses : n° 1, 6 et 7 : Bòbila Madurell, Sant Quirze del Vallès, Vallès occidental (Barcelone, Catalogne, Espagne), n° 1 : tombe M5, ciseau en
néphrite, n° 6 : tombe M5, hache en jadéitite, n° 7 : tombe G10-7, hache en serpentinite. N° 2 et n° 3 : petites lames polies du site de la Caserne de Sant Pau del Camp, Barcelone, Barcelonès (Barcelone, Catalogne, Espagne), n° 2 ciseau en jadéitite de la sépulture 17, n° 3 petite hache en amphibolite calcique d’un niveau d’habitat du Néolithique ancien. N° 4 et 5 Cova del Frare, Matadepera, Vallès occidental (Barcelone, Catalogne, Espagne), n° 4 petit ciseau en gabbro du Néolithique
ancien, n° 5 hache en amphibolite calcique du Néolithique final. N° 8 lame d’herminette partiellement polie sur éclat de quartzite, provenant du niveau du Néolithique moyen type Molinot remanié, de la Grotte de Can Sadurní, Begues, Garraf (Barcelone, Catalogne, Espagne).Lieux de conservation divers dont le Museu d’Història de Sabadell pour les n° 1, 6, 7, photos P. Pétrequin et DAO J. Vaquer.
DEUXIÈME PARTIE
878 Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
La seconde vient des niveaux du Néolithique final. C’est une lame de forme trapézoïdale à tranchant convexe sy-métrique, à bords arqués et à talon tronqué. Ses bords sont équarris par polissage, donnant une section sub-qua-drangulaire (fig. 3, n° 4). Cette forme évoque le type Puy, mais la pièce est trop petite pour être classée dans ce type : elle mesure 8,5 cm de long, 4,9 cm de large et 2,2 cm. La roche est de couleur brun olivâtre, à grain très fin évoquant l’amphibolite calcique des outils de nombreux sites néolithiques de la partie nord-orientale des Pyré-nées. L’analyse spectroradiométrique (voir annexe 1) per-met de proposer une néphrite ou une amphibolite.
Les deux pièces polies de la Cova del Frare en roches fines probablement exogènes ne semblent pas être en roche d’origine alpine.
3. 2. La hache de Collbató (Baix Llobregat, Barcelona)
Cette hache conservée au Musée d’Archéologie de Cata-logne à Barcelone sous le n° 16376 a été publiée d’abord comme provenant de Collbató selon E. Ripoll et M. Llon-gueras (1963 : 23 et 26), puis comme provenant d’une sépulture de la Vinya del Castell à El Bruc (Barcelona) par A.-M. Muñoz (1965 : 132). Si l’on se fie à la publication plus ancienne de J. Colomines i Roca et Beda Ma Espona dans laquelle elle est figurée (1925 : 116 et pl. XLVI,9), c’est en fait la mention Collbató qu’il faut retenir ; il s’agirait donc d’une trouvaille isolée (fig. 4, n° 3). C’est une lame de hache de forme triangulaire à tranchant convexe, flancs légèrement arqués, avec un talon conique un peu cassé. La forme générale évoque le type Tumiac non perforé, toutefois elle n’a pas de section lenticulaire ; elle est peu épaisse avec une section elliptique aplatie et des bords arrondis, ce qui la rapproche plutôt du morphotype Green-law repoli en Morbihan. La roche de couleur vert moyen est marbrée avec des cristaux blancs et des grenats. Les analyses montrent qu’il s’agit d’une jadéitite, très vraisem-blablement du Mont Viso (voir listing des grandes haches n° JADE 2008_1594). Le polissage est poussé, de type 5, avec un résidu de piquetage fin sur une face. Même si la pièce a perdu sa luisance par altération, il s’agit bien d’une lame carnacéenne, c'est-à-dire d’une pièce alpine modi-fiée en Bretagne et rediffusée vers la Catalogne à partir de cette région.
3. 3. Grotte de Can Sadurní Begues (Garraf Barcelona)
La grotte de Can Sadurní à Begues est l’un des princi-paux gisements stratifiés de Catalogne pour l’Holocène (Blasco, Edo et Villalba 2003). Elle recèle des niveaux de l’Epipaléolithique et du Néolithique ancien cardial et épi-cardial. La séquence de la fin du Néolithique ancien (Post-cardial) et du Néolithique moyen I (Molinot et Montbolo) y est particulièrement développée. Le Néolithique moyen II (« Sepulcres de fossa ») est lacunaire ; l’occupation du site a repris au Néolithique final/Chalcolithique sous la for-me d’une sépulture collective et à l’Age du Bronze ancien sous la forme d’une grotte bergerie.
La grotte a livré beaucoup de mobilier, mais peu d’outillage en pierre polie. C’est d’un secteur remanié livrant essentiel-lement du matériel de style Molinot qu’une grande hache polie a été découverte. Elle mesure 20,7 cm de long, 7,7 cm de large et 2,7 cm d’épaisseur, ce qui la place dans le groupe des grandes haches ; toutefois son façonnage étant sommaire, on ne peut pas vraiment la considérer comme une pièce surdéterminée, mais plutôt comme un gros outil.
Il s’agit d’une grande lame à tranchant en double bi-seau dissymétrique (herminette) probablement réali-sée sur un gros éclat, ce qui lui a donné une section en D (fig. 3, n° 8). La face inférieure est en effet une face d’éclatement très partiellement polie, tandis que la face supérieure mieux polie (niveau 2) laisse voir de nombreux négatifs d’enlèvements, voire d’esquilles thermiques. La forme générale est sub-trapézoïdale avec un tranchant légèrement convexe, des bords ar-qués et un talon tronqué convexe ; elle ne correspond pas aux morphotypes alpins qui présentent tous des talons coniques. La roche est à grain fin de couleur vert très sombre, pratiquement noire. Le spectre obtenu en analyse spectroradiométrique (voir annexe 1) pourrait correspondre à un quartzite, gneiss ou schiste, dans tous les cas une roche non alpine.
3. 4. Une petite hache en jadéitite ( ?) à Cardona (Bages, Barcelona)
La localité de Cardona dans la contrée du Bages, au nord-est de la Catalogne, est bien connue grâce à son immense gisement de sel gemme dit « La Muntanya de Sal » (Weller et Fíguls 2005). Les prospections réalisées dans la Val Salina, au pied de l’affleurement de halite, ont livré de nombreux outils de type haches et mas-ses ou broyeurs, qui sont en majorité en cornéenne. Ils correspondent dans de nombreux cas à d’anciennes haches polies récupérées ou modifiées pour l’extrac-tion et le broyage du sel gemme. C’est l’exploitation de cette ressource qui serait à l’origine de la richesse des sépultures à dalles de cette contrée, qui fait partie précisément du groupe Solsonien. Les sépultures de ce groupe peuvent contenir des biens précieux, comme des parures en variscite ou en coquillages marins, ainsi que des pièces lithiques importées en silex blond bé-doulien du Vaucluse ou en silex calcédonieux du Priorat. Cardona faisant figure de point focal de la redistribution des richesses dans cette région, il nous a paru intéres-sant d’y rechercher des pièces en roches étrangères à la région. Grâce à l’amabilité d’A. Fíguls, nous avons pu examiner de nombreuses pièces trouvées aux abords immédiats du gisement de sel gemme, qui sont en cor-néenne ou en schiste tacheté. Au sein de ces collec-tions, nous avons pu remarquer et photographier une seule pièce en roche verte trouvée fortuitement dans la commune (fig. 4, n° 1). Il s’agit d’une petite lame polie de forme sub-trapézoïdale à tranchant convexe, bords arqués et talon arrondi, qui mesure 6,55 cm de long, 3,4 cm de large et 1,25 cm d’épaisseur ; sa section est biconvexe avec de légers méplats sur les côtés. Elle a été réalisée dans une roche à grain fin d’aspect marbré, de couleur vert clair avec des veines blanches. Cette hache n’a pas été analysée, mais elle ressemble à une jadéitite d’après J. Vaquer.
3. 5. La sépulture de Sant Joan Despi (Baix Llobregat, Barcelona)
Cette sépulture avec une dalle en place, établie dans des marnes près de l’estuaire du Llobregat, était probable-ment une tombe en fosse de type 1b ou 3 du groupe vallèsien (Martín 2009). Elle a livré quatre outils polis : un long ciseau en cours de polissage, une hache en « amphi-bolite » perdue et deux petits outils qui ont pu être exami-nés au musée d’Archéologie de Catalogne à Barcelone (n° 16365 et 16366).
DEUXIÈME PARTIE
879Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
Jade Grandes haches alpines du Néolithique européen Ve et IVe millénaires av. J.-C.
FIG. 4N° 1 : petite hache en jadéitite alpine ( ?) trouvée dans la commune de Cardona, Bages (Barcelona, Catalunya, Espagne), n° 2 : petite hache en cinérite
de Réquista provenant des environs de Solsona, Solsonès (Lleida, Catalunya, Espagne), n° 3 : hache carnacéenne de type Tumiac en jadéitite alpine trouvée à Collbató, Baix Llobregat (Barcelona, Catalunya, Espagne), n° 4 : grande hache de type Chelles en roche noire provenant des environs de
Solsona, Solsonès (Lleida, Catalunya, Espagne).N° 1 collection privée à Cardona, n° 2 et 4 Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, n° 3, Musée d’Archéologie de Catalogne, Barcelone ;
photos P. Pétrequin, DAO : J. Vaquer.
Le premier est une hache trapézoïdale à section min-ce biconvexe et bords équarris qui mesure 5,2 cm de long, 3,8 cm de large et 1 cm d’épaisseur, en roche fine de couleur vert foncé. Deux analyses spectrora-
diométriques montrent qu’il s’agit d’une amphibolite calcique (voir annexe 1) ; un examen à l’œil nu permet de pencher plutôt en faveur d’une origine pyrénéenne plutôt qu’alpine.
DEUXIÈME PARTIE
880 Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
FIG. 5Hache de type Puy en amphibolite calcique rétromorphosée trouvée dans la tombe en fosse de Bòbila de Bellsolà, Santa Perpétua de la Mogoda, Vallès
occidental (Barcelona, Catalunya, Espagne).Musée d’Archéologie de Catalogne, Barcelone, photo P. Pétrequin , DAO : J. Vaquer.
La seconde, de morphologie similaire, mesure 4,2 cm de long, 3,4 cm de large et 1,1 cm d’épaisseur. Elle est en roche fine vert moyen à inclusions blanches. L’analyse spectroradiométrique permet de déterminer une pyroxé-nite calcique et de suggérer une origine alpine possible, peut-être dans le massif du Mont Viso (voir annexe 1).
Le mobilier de cette tombe comportait aussi un nucléus à lamelles en silex bédoulien de type mixte et une canine de sanglier polie. Le type de nucléus permet de placer cet ensemble au cours de l’étape classique de la culture des « Sepulcres de fossa ».
3. 6. La tombe en fosse de Bòbila de Bellsolà, Santa Perpetua de Mogoda (Vallès occidental, Barcelona)
Ce sont des exploitations d’argile pour une briqueterie qui ont révélé sept sépultures. La sépulture 1, découverte en 1922, se distingue par un mobilier de choix conservé au Musée d’Archéologie de Catalogne à Barcelone. Il com-porte deux nucléus en silex blond et une grande hache polie considérée comme amphibolite dans les premières publications (Colominas Roca 1927-31, Ripoll et Llongue-ras 1963, Muñoz 1965). Cette sépulture ne contenait qu’un squelette en position repliée.
La hache polie qui mesure 14,6 cm de long, 4,9 cm de large et 2 cm d’épaisseur rentre dans la catégorie des grandes haches (fig. 5). Elle a une forme trapézoïdale, avec un tranchant convexe à double biseau symétrique qui est perpendiculaire à l’axe longitudinal de la pièce. Son talon est tronqué convexe et ses flancs convexes convergents présentent des rainures de sciage bilatéral alterne, qui lui confèrent une section sub-rectangulaire moyenne. Les faces sont légèrement bombées et bien polies, hormis une petite plage résiduelle d’éclatement sur une d’elles (polissage de niveau 3). Une fissure est visible et pourrait témoigner d’une extraction au feu du bloc débité ensuite par sciage. La roche est à grain fin, de couleur vert foncé cru translucide, avec quelques points blancs et pourrait correspondre à une roche alpine. L’ana-lyse spectroradiométrique indique une amphibolite calci-que rétromorphosée ; une origine alpine ne peut pas être exclue, selon des critères visuels (Les Haudères, Valais ?) (voir annexe 1).
Les deux nucléus sont en silex blond bédoulien du Vau-cluse. Le premier présente à l’arrière les stigmates d’une crête antéro-postérieure, témoignant d’une mise en for-me initiale en mitre. Le plan de pression est lisse et ortho-gonal par rapport à la surface d’exploitation. Celle-ci est convexe comportant sept négatifs d’extraction lamellai-res à terminaisons aiguës, d’après ce qui est observable de la base du nucléus qui est cassée. Le second nucléus de morphologie quadrangulaire à plan de pression très incliné (du type Trets) présente des négatifs d’enlève-ments lamellaires recoupés par des enlèvements irré-guliers d’éclats, dont un rebroussé. La morphologie de ces nucléus en silex bédoulien chauffé présente des cor-respondances avec le Chasséen méridional classique et récent pour les conceptions volumétriques en mitre et en module quadrangulaire plat. Ces types de nucléus sont attestés au cours de la première moitié du IVe millénaire dans le midi de la France.
3. 7. La tombe 1 de Bòbila d’en Sallent, Cerdanyola (Vallès occidental, Barcelona)
La tombe 1 de Bòbila d’en Sallent a été découverte en
1946. Elle faisait partie d’un groupe de tombes qui a été détruit (Colominas Roca 1952). Il s’agissait d’une tombe en fosse, creusée dans les argiles quaternaires et recouverte d’une grande dalle de schiste mesurant 1,40 m de long, ce qui tend à indiquer une tombe de type 3a (Martín 2009).
Le mobilier comporte deux haches polies. La plus grande, à tranchant peu convexe et côtés arqués convergents vers un talon arrondi, mesure 7,5 cm de long, 4,1 cm de large et 2,5 cm d’épaisseur (Musée d’Archéologie de Catalo-gne à Barcelone, n° 16424). Elle a une section biconvexe à elliptique et des côtés piquetés. Elle a été réalisée dans une roche noire à grain fin. L’analyse spectroradiométri-que permet de l’attribuer aux jadéitites rétromorphosées, très probablement d’origine alpine, mais sans pouvoir en préciser le gîte exact (voir annexe 1).
La seconde hache est de forme trapézoïdale à section sub-quadrangulaire plate ; elle mesure 5,5 cm de long, 4,2 cm de large. Elle a été réalisée dans une roche fine de couleur vert foncé à points noirs et blancs. L’analyse spectrora-diométrique permet de la caractériser comme un chlori-toschiste à épidote dont l’origine est indéterminée, cette roche existant dans de nombreux massifs anciens.
Le mobilier de cette tombe comportait aussi une parure faite de sept perles en variscite (6 discoïdes et une en tonnelet). Le silex bédoulien est représenté par une la-melle et par deux nucléus à lamelles de morphologie co-nique à plan de pression incliné ou très incliné (type mixte de V. Léa) (Ripoll et Llongueras 1963). Le type de tombe (probablement type 3), comme les pièces en silex bédou-lien, indiquent une appartenance à l’étape classique de la culture des tombes en fosse dans son faciès vallèsien.
3. 8. La sépulture rectangulaire de Bòbila Padró, Ripollet (Vallès occidental, Barcelona)
Le site de la Bòbila Padró a livré, entre 1929 et 1935, des fosses remplies de pierres et de vestiges (silos) et plusieurs sépultures en fosse qui ont été détruites par
DEUXIÈME PARTIE
881Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
Jade Grandes haches alpines du Néolithique européen Ve et IVe millénaires av. J.-C.
FIG. 6Haches polies en roches alpines de la sépulture rectangulaire de Bòbila Padró, Ripollet, Vallès occidental, (Barcelona, Catalunya, Espagne). N° 1 fragment de hache en éclogite, n° 2 dessin de la grande hache alpine de type Chelles publié par Ripoll et Llongueras 1967 (d’après A. Bregante), n° 3 grande hache de type Puy en jadéitite.
Museu d’Història de Sabadell, n° 1 et 3 photo P. Pétrequin et DAO J. Vaquer, n° 2 dessin J. Vaquer d’après A. Bregante.
des extractions d’argile pour une briqueterie. C’est grâce aux visites régulières de V. Renom que l’on possède des informations sur ces tombes, notamment la tombe 1 dite rectangulaire, qui a livré le mobilier le plus riche de tout le Néolithique moyen catalan. Celui-ci constitue le fleuron du musée de Sabadell et a été décrit à diverses repri-ses (Renom i Costa 1934, Muñoz 1965, Ripoll et Llon-gueras 1967). C’est en utilisant la publication et le cahier de fouilles de Renom que des informations concrètes sur la forme de la tombe ont été consignées par A.-M. Muñoz. Selon cet auteur, c’était une fosse rectangulaire de 3 m de profondeur, recouverte de trois grandes dalles de conglomérat ; elle ne contenait qu’un seul individu. On peut supposer qu’il s’agissait probablement d’une tombe de type 3a ou 3c (Martín 2009), si l’on tient compte des enseignements récents de la nécropole de Can Gambús-1 dans laquelle les tombes à fosse funéraire centrale (type A1 de Roig et al. 2010 ou type 3a avec dalles de Martín 2009) sont couvertes de plusieurs dalles de conglomérat.
Les mêmes termes de V. Renom « protégée par des dal-les de conglomérat » ont été interprétés différemment par E. Ripoll et M. Llongueras (1967), qui en s’appuyant sur les notes manuscrites signalant quatre dalles, propo-sent de considérer la tombe comme une ciste dont les parois auraient été revêtues de dalles. Il est évidemment impossible de trancher pour l’une ou l’autre de ces inter-prétations sans document graphique ou photographique.
La sépulture 1 de Bòbila Padró aurait livré huit outils po-lis selon A.-M. Muñoz (1965) et neuf selon E. Ripoll et M. Llongueras (1967) qui en présentent d’excellents dessins dus à A. Bregante. Nous avons pu examiner et analyser huit pièces exposées au Musée de Sabadell ; toutefois si huit d’entre elles correspondent bien aux pièces figurées, l’une d’elles manque (Muñoz, fig. 13, n° 2 ou E. Ripoll et M. Llongueras 1967, fig. 6, n° 3). Le fragment non cité par A.-M. Muñoz a été figuré par E. Ripoll et M. Llongueras. Sur les neuf pièces citées, quatre seraient d’origine alpine.
DEUXIÈME PARTIE
882 Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
La première, inventoriée 2736, est une hache de forme triangulaire symétrique à tranchant peu convexe et à bords arqués convergents vers un talon pointu et bou-chardé (fig. 6, n° 3). Les bords sont dressés conférant à la pièce une section rectangulaire caractéristique du type Puy. Cette pièce qui mesure 16,7 x 6,5 x 2 cm rentre dans la classe des grandes haches ; c’est un type alpin à talon initialement bouchardé qui a sans doute été repris (polissage de niveau 4). Elle a été réa-lisée à partir d’un bloc débité au feu comme le sug-gère des fissures thermiques. La roche à grain fin est vert moyen, à points plus foncés, d’aspect marbré ; à l’œil nu, elle ressemble à une jadéitite du Mont Viso. L’analyse spectroradiométrique et la mesure de densi-té confirment une jadéitite typique (annexe 1 et listing des grandes haches n° JADE 2008_1610).
La seconde est la hache perdue, qui a été considé-rée comme en « roche verte » par A.-M. Muñoz et en « serpentine » par E. Ripoll et M. Llongueras. Ces deux qualificatifs ont été utilisés par ces auteurs pour d’autres grandes haches qui sont toutes en éclogite ou en jadéitite. Le dessin de A. Bregante révèle qu’il s’agit d’une hache de forme trapézoïdale à tranchant peu convexe et talon arrondi, avec une section ellipti-que peu épaisse. Les bords présentent une amorce de méplat dans la zone sous le tranchant. Les faces sont polies sur les deux tiers distaux et piquetées dans le tiers proximal. Les mesures permettent de la placer dans le groupe des grandes haches (14,7 x 6,1 x 2,7 cm). Sa forme générale et sa section correspondent au type Chelles court.
La troisième pièce, inventorié 2734, est un talon de petite hache probablement trapézoïdale, bien polie (polissage de niveau 4). Ce talon est à section lenticulaire mince (fig. 6, n° 1). La couleur de la roche est vert moyen, la structure de la roche étant grenue et complexe. L’analyse spectroradiométrique permet de déterminer une éclogite d’origine alpine possible (annexe 1 et listing des grandes haches n° JADE 2008_1607).
La quatrième inventoriée 2726 est sub-trapézoïdale à tranchant convexe, avec les flancs arqués et un talon tronqué oblique (fig. 7, n° 1). Elle présente une sec-tion elliptique moyenne. Son polissage est de niveau 3, laissant voir des facettes ; il n’a pas totalement ef-facé les enlèvements de taille et quelques traces de bouchardage. Elle mesure 11,6 cm de long, 6 cm de large et 2,1 cm d’épaisseur. La roche est vert foncé à bleuâtre, étirée. L’analyse spectroradiométrique per-met de reconnaître une amphibolite calcique rétro-morphosée, peut-être d’origine alpine (Les Haudères, Valais ?). La densité de 2,97 est compatible avec cette proposition (annexe 1 et listing des grandes haches n° JADE 2008_1612).
Les autres haches sont en roches métamorphiques d’ori-gine locale ou régionale et comportent trois pièces de grand format.
La pièce inventoriée 2732 est un long ciseau ou pic à tranchant convexe, corps sub-cylindrique et talon pointu (fig. 7, n° 6). Elle mesure 22,2 x 3,2 x 2,3 cm et présente une section elliptique épaisse. Le polissage est assez poussé en partie distale (niveau 4), des tra-ces de bouchardage étant visibles en partie proximale. La roche de couleur gris foncé contient de nombreux
cristaux noirs ; elle a été considérée comme en basalte par E. Ripoll et M. Llongueras, mais ressemble plutôt à une cornéenne. L’analyse spectroradiométrique donne un spectre peu caractéristique ; la densité est de 2,88, ce qui paraît compatible avec une attribution au groupe des cornéennes (annexe 1 et listing des grandes ha-ches n° JADE 2008_1608).
La pièce inventoriée 2733 est un autre long ciseau ou pic, plus ou moins fusiforme, à tranchant pratiquement droit et à section transversale presque circulaire (fig. 7, n° 5). Il mesure 17,8 cm de long, 2,3 cm de large et 2,1 cm d’épaisseur. Son polissage est imparfait (niveau 3, lais-sant voir des plages bouchardées sur le corps et le talon). Il est constitué d’une roche litée gris verdâtre à taches noires, qui a été considérée comme un schiste tacheté par E. Ripoll et M. Llongueras (1967). L’analyse spectro-radiométrique n’a pas permis de détermination, mais la densité de 2,76 est compatible avec une cornéenne ou un schiste tacheté (annexe 1 et listing des grandes ha-ches n° JADE 2008_1613).
La pièce inventoriée 2735 est une lame allongée à tran-chant convexe symétrique et talon arrondi, avec une section elliptique épaisse (fig. 7, n° 4). Elle mesure 17,3 cm de long, 4 ,9 cm de large et 3,4 cm d’épaisseur. Son polissage est assez poussé à facettes sur les faces, mais plus grossier et strié au tranchant qui pourrait avoir été repris par affûtage. La roche est grenue, noire, de faible résistance mécanique. Elle a été considérée comme un basalte par E. Ripoll et M. Llongueras (1967), mais pour-rait correspondre à une roche métamorphique. L’analyse spectroradiométrique n’a pas permis de détermination, mais la densité de 2,90 est compatible avec une cor-néenne (annexe 1 et listing des grandes haches n° JADE 2008_1611).
Les deux autres lames plus petites sont assez sembla-bles d’aspect et sont des lames de haches de travail.
La première inventoriée 2724 est sub-trapézoïdale, avec un tranchant convexe des bords arqués et un talon tronqué (fig. 7, n° 3). Elle présente une section elliptique moyenne ; son polissage est peu soigné, de niveau 3 avec des restes d’enlèvements par taille. Elle mesure 8,1 cm de long, 4,7 cm de large et 2 cm d’épaisseur. La partie proximale de cette lame porte un lustré qui est caractéristique d’un emmanche-ment direct. La hache est en une roche à grain fin, vert bleuté et veinée. Elle a été considérée comme une amphibolite par E. Ripoll et M. Llongueras (1967). L’analyse spectroradiométrique permet de reconnaî-tre un schiste à glaucophane. La densité de 2,97 est compatible avec cette proposition (annexe 1 et listing des grandes haches n° JADE 2008_1606).
Le seconde inventoriée 2725 est sub-trapézoïdale, avec un tranchant convexe légèrement déjeté des bords ar-qués et un talon tronqué (fig. 7, n° 2). Sa section est elliptique moyenne avec des bords bouchardés. Le po-lissage est de niveau 3, avec quelques résidus de plages taillées ou piquetées. Elle mesure 9,7 cm de long, 4,7 cm de large et 1,7 cm d’épaisseur. La roche est sembla-ble à celle de la hache précédente. L’analyse spectrora-diométrique permet de montrer qu’il s’agit également d’un schiste à glaucophane. La densité de 2,89 est com-patible avec cette proposition (annexe 1 et listing des grandes haches n° JADE 2008_1609).
DEUXIÈME PARTIE
883Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
Jade Grandes haches alpines du Néolithique européen Ve et IVe millénaires av. J.-C.
FIG. 7Outils polis en roches alpines de la sépulture rectangulaire de Bòbila Padró, Ripollet, Vallès occidental, (Barcelona, Catalunya, Espagne).
N° 1 : grande hache de type Puy en amphibolite calcique, n° 2 et 3 : petites haches en schiste à glaucophane, n° 4 ciseau massif en cornéenne, n° 5 et 6 : ciseaux-pics étroits de type Lagor en cornéenne.
Museu d’Història de Sabadell, photos P. Pétrequin et DAO J. Vaquer.
Ce lot d’outils polis était accompagné d’autres piè-ces lithiques taillées. Les nucléus à lamelles sont au nombre de six : un en obsidienne (le seul connu en
Catalogne) et 5 en silex blond bédoulien du Vaucluse ayant subi un traitement thermique.
DEUXIÈME PARTIE
884 Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
Le nucléus d’obsidienne est sur éclat, avec plan de pres-sion lisse. Il a une forme sub-cylindrique « en tambour » et une surface de débitage oblongue se développant sur les trois quart de la périphérie (débitage tournant probable), le dos du nucléus étant formé d’un enlèvement d’éclat inver-se (postérieur à la cassure de la base ?). La forme en tam-bour de ce nucléus est originale et pourrait résulter du bris d’un nucléus initialement conique. Il présente des négatifs d’enlèvements d’une quinzaine de lamelles, certaines ob-tenues avant cassure de la base du nucléus, d’autres après cassure que l’on reconnaît à leur extrémité outrepassée et qui ne dépassaient pas 2,6 cm de long.
Le plus petit des nucléus en silex blond, inventorié 5, est un nucléus sur éclat ; il présente sur son côté gauche la face d’éclatement de l’éclat support et sur le flanc droit des négatifs d’enlèvement d’éclats d’une probable mise en forme en mitre. La base est plate, mais elle pourrait être cassée. Le plan de pression est lisse et incliné vers l’arrière du nucléus, ce qui permet de la qualifier de nu-cléus mixte. Le front de débitage aménagé sur la tranche de l’éclat est étroit ; il présente les négatifs de 5 extrac-tions lamellaires à tendance convergente vers la base.
Le nucléus 8 est de forme sub-conique à plan de pression lisse incliné vers l’arrière du nucléus. Il résulte d’une mise en forme en mitre par crête antéro-postérieure et présente un large front convexe à 10 enlèvements lamellaires nettement convergents. Il s’agit donc d’un nucléus de type mixte.
Le nucléus 6 est lui aussi de forme sub-conique à plan de pression lisse incliné vers l’arrière. Il résulte d’une mise en forme en mitre par crête antéro-postérieure partielle, puisque sa base et son côté droit présentent une réserve corticale. Son front d’exploitation est très convexe, avec une dizaine de négatifs d’extraction lamellaires, compor-tant des lamelles longues et aiguës au centre et des la-melles courtes et irrégulières sur les flancs. Sa corniche présente quelques négatifs de petits éclats rebroussés.
Le nucléus 9 est plus volumineux (10,5 cm de haut) et re-lativement large. Il avait probablement une mise en forme par deux crêtes antéro-latérales, qui ménageaient une im-portante réserve corticale formant toute la base et une par-tie du dos du nucléus. Son front était peu convexe, avec des négatifs d’extractions de lames et lamelles à tendance obtuses, dont on ne perçoit pas bien les parties proximales en raison de la destruction de toute la zone de la corniche et d’une partie du plan de pression. Cette destruction ré-sulte d’enlèvements en percussion perpendiculaires à la table, que nous considérons comme une tentative ratée d’extraction d’une tablette d’avivage, suite à un accident de rebroussé d’une lame dont il subsiste le négatif de la partie distale sur la table. Ces enlèvements n’ont pas totalement ôté le plan de pression initial, qui était lisse et très incliné. Ce nucléus pourrait avoir eu une mise en forme quadrangulaire due à la grande réserve corticale de la base et du dos. Dans son état, il était évidemment inutilisable et montre la faible maîtrise technique de son dernier manipulateur.
Le nucléus 13 est lui aussi de grande dimension (9,8 cm de haut) et ressemble au précédent en raison d’une large réserve corticale à la base et sur le dos. Sa table est peu convexe, avec les négatifs de 7 extractions laminaires et lamellaires à extrémité oblique en raison de la convexité de la base corticale. Il pourrait avoir été à mise en forme quadrangulaire et avec un plan très oblique, mais celui-ci n’est pas observable dans son état initial. Il a fait l’ob-
jet d’une réfection par une série d’enlèvement d’éclats partant du pourtour, notamment de la table qui présente une corniche fortement esquillée avec quelques petits enlèvements rebroussés. Le nouveau plan de pression est pratiquement orthogonal par rapport à la table et fa-cetté ; la corniche est très irrégulière. Cette remise en forme est donc maladroite et n’a pas permis de nouvelles extractions réussies. On note en plus des impacts sur deux arêtes guide, qui peuvent témoigner d’une réforme volontaire du nucléus.
Les pièces taillées déposées dans la tombe sont : une lamelle en silex blond bédoulien, complète à section tra-pézoïdale et terminaison aiguë de 9,9 cm de long ; trois fragment d’une lame en silex bédoulien blond cassée incomplète, à section trapézoïdale de 1,7 cm de large ; un fragment médial de lame en silex gris présentant des retouches semi-abruptes bilatérales.
L’élément le plus spectaculaire trouvé dans cette tombe est un ensemble de perles en variscite qui comportait plus de 272 éléments (300 trouvés selon V. Renom), dont 115 per-les en tonnelet, 84 cylindriques, 70 discoïdales et trois frag-ments. Ces perles forment un probable collier à plusieurs rangs, qui est le plus important connu à ce jour en Catalogne.
La dotation comportait aussi un fragment de poinçon sur diaphyse de métapode de capriné.
La céramique est représentée par les restes d’un vase et des tessons. Il s’agit d’une petite écuelle carénée à paroi concave, munie d’un mamelon non perforé sur la carène. Les tessons recueillis permettent d’identifier un bord ren-trant de vase globuleux à lèvre épaissie en filet en relief et un tesson portant une anse en ruban.
Les informations disponibles, tant sur le type de tombe (type 3, probablement) que sur le mobilier (céramique carénée à bouton), permettent d’attribuer cette riche sépulture à l’étape classique de la culture catalane des tombes en fosse dans son faciès du Vallès. Les pièces en silex bédoulien du Vaucluse recueillies, notamment les nucléus en silex blond ayant tous subi un traitement thermique, indiquent des connexions avec le Chasséen méridional dans ses étapes postérieures à 4100 av J.-C. Les formes des nucléus, qu’elles soient de type mixte ou quadrangulaire plates pour deux exemplaires à large réserve corticale inférieure et dorsale, renvoient à l’éta-pe classique du Chasséen méridional, soit au début du quatrième millénaire, en correspondance avec les faciès d’Auriac ou Terres Longues, soit dans une fourchette comprise entre 4000-3850 av. J.-C.
3. 9. La tombe en fosse de Bòbila d’en Joca à Montornés del Vallès (Vallès oriental, Barcelona)
La tombe en fosse de Bòbila d’en Joca a été découverte en 1955 par des ouvriers qui emportèrent et dispersè-rent le mobilier. Une partie de ce matériel fut récupérée postérieurement grâce à Josep Estrada, conservateur du musée de Granollers et à Ramon Puig, curé de la pa-roisse. Les objets, publiés par J. Estrada, furent donnés au Musée de Granollers par le propriétaire des terrains (Estrada Garriga 1956, Casas i Pérez 2000). Aucune autre sépulture n’a été signalée à proximité immédiate de cette tombe, mais ce lieu est proche d’une nécropole qui se trouvait dans les terres voisines de la Bòbila de Can Torrent, où trois tombes néolithiques avaient été découvertes antérieurement.
DEUXIÈME PARTIE
885Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
Jade Grandes haches alpines du Néolithique européen Ve et IVe millénaires av. J.-C.
Il s’agissait d’une tombe en fosse de forme indétermina-ble, creusée dans de l’argile jusqu’à 1,20 m de profondeur. Les travaux des ouvriers de la briqueterie détruisirent en partie la sépulture. Quand le mobilier apparut, il restait seulement la partie supérieure du squelette orientée au nord-nord-est. D’après une photographie, le torse repo-sait sur le dos avec la tête placée au nord-nord-est tour-née vers la droite et la face orientée vers l’ouest. Les bras étaient plaqués au thorax de chaque côté, mais les avant bras avaient été détruits. Bien que les restes humains aient été perdus, l’anthropologue D. Campillo considère qu’ils appartenaient à un adulte, d’après ce qui est visible sur la photographie (Casas i Pérez 2000 : 34).
La tombe a livré un mobilier funéraire très riche : 2 grands ciseaux, 5 haches, 22 perles en variscite, 4 nu-cléus, 10 fragments de lamelles, 3 armatures de flèche, 2 éclats en silex et 10 fragments d’un petit vase muni d’une anse (Muñoz 1965, Casas i Pérez 2000). Ce mobi-lier est le quatrième en richesse après ceux de la Bòbila Padró de Ripollet, de la mine 83 de Can Badosa à Gavà ou de la tombe 167 de la nécropole de Can Gambús-1 à Sabadell. Cet ensemble, conservé au musée de Granol-lers, a été décrit et étudié à plusieurs reprises (Estrada Garriga 1956, Serra Ràfols 1956, Ripoll et Llongueras 1963, Muñoz 1965). Il s’y s’ajoute quelques autres piè-ces inédites qui avaient été récupérées au moment de la découverte et détenues jusqu’à ce jour par la famille de l’exploitant de la Bòbila d’en Joca, M. Josep Gurri. Celles-ci ont été retrouvées et analysées plus récem-ment dans le cadre d’un mémoire universitaire. Dans celui-ci, on trouve aussi le témoignage inédit apporté par Jaume Gurri, qui a assisté à la découverte, sur la dispo-sition du mobilier qui apparut en dessous du bras droit formant un tas, sans ordre, comme s’il avait été déposé dans une bourse (Casas i Pérez 2000 : 17).
Les outils en pierre polie :
Il s’agit d’un des lots les plus importants de la Catalogne que nous avons pu en partie analyser, grâce à l’amabi-lité du conservateur actuel du Musée de Granollers, qui a apporté cinq des sept pièces au musée archéologique de Catalogne. Les deux pièces non examinées sont de grands ciseaux qui sont décrits ici d’après les publica-tions de J. Serra Ràfols, E. Ripoll et M. Llongueras, A. M. Muñoz et surtout d’après le mémoire de recherche de troisième cycle de J. Casas i Pérez, qui a réalisé des analyses pétrographiques en microscopie optique sous le contrôle de A. Alvarez, des analyses par DRX sous le contrôle de X. Alcobé Ollé et par microsonde électroni-que sous le contrôle de J. Melgarejo.
La pièce la plus remarquable (BJ-535) est un ciseau de forme trapézoïdale très allongée à tranchant convexe, à double biseau symétrique et base arrondie, qui a été qua-lifié de « soc » ou de « pique ». Sa section transversale est peu épaisse, biconvexe à méplats latéraux. Ce ciseau mesure 34,2 cm de long, 4,7 cm de largeur maximale et 1,9 cm d’épaisseur. Il serait en microdiorite de couleur gris d’après les analyses pétrographiques réalisées par J. Casas i Pérez (2000 : 90).
Un autre ciseau très allongé (BJ-541) est de forme sub-cylindrique. Il mesure 27 cm de long, 3,2 cm de large et 2 cm d’épaisseur. Il diffère du précédent par un tranchant étroit peu convexe et par la technique de fabrication, qui a laissé visibles de profondes rainures
de sciage longitudinal. C’est en raison de la présence de ces rainures ou méplats qu’il a été qualifié de « lis-soir ou d’aiguisoir », mais il ne s’agit pas de marques d’usage, mais plutôt de fabrication. Les examens pé-trographiques de lames minces de J. Casas i Pérez ont permis de caractériser le matériau comme une micro-diorite de couleur gris cendre (Casas 2000 : 90).
Les cinq autres pièces que nous avons pu examiner et analyser ne rentrent pas dans la catégorie des grandes haches :
La première (BJ-537) est une lame de hache de forme sub-triangulaire, à tranchant convexe symétrique et à bords dressés et convergents de façon convexe vers un talon anguleux (fig. 8, n° 5). Cette lame qui mesure 12,2 cm de long, 5,2 cm de large et 2 cm d’épaisseur est en roche siliceuse gris verdâtre à grain très fin avec un lit d’éléments grossiers (feldspath) ; elle a été in-terprétée comme un microquartz-monzonite par J. Ca-sas i Pérez (2000 : 90). La roche correspond en fait à la cinérite du bassin carbonifère de Brousse Broquiès près de Réquista (Aveyron, France) (annexe 1 et lis-ting des grandes haches n° JADE 2008_1602). Cette lame qui montre un lit de sable anguleux encadré de deux lamines très fines présente toutes les caracté-ristiques d’une strate déjà connue pour avoir été ex-ploitée au Néolithique dans les carrières (Servelle et Vaquer 2000). Les caractéristiques techniques de cette pièce, notamment les négatifs résiduels de taille avant polissage et les bords verticaux, sont eux aussi typi-ques des ateliers des environs de Réquista. Le polis-sage très poussé jusqu’au lustre sur une des faces est par contre moins fréquent dans les séries françaises et pourrait correspondre à une volonté de valorisation de la pièce, qui est peut-être une imitation des pièces d’origine alpine auxquelles elle est associée.
Une autre lame de forme ogivale mais à tranchant peu convexe, présente un talon conique finement piqueté (BJ-536) ; sa section transversale est avec de légers mé-plats latéraux eux aussi piquetés, tandis que la section longitudinale est asymétrique (fig. 8, n° 3). Elle mesure 13,2 cm de long, 5,4 cm de large et 2,3 cm d’épaisseur. Déterminée comme diorite par Serra Rafols, elle corres-pondrait à un skarn calcosilicaté (plagioclases, diopsides, clinozoïsite) d’après J. Casas (2000 : 92). L’analyse spec-troradiométrique permet de montrer qu’il s’agit d’une ja-déitite, qu’un examen à l’œil nu tend à attribuer au Mont Viso, plus particulièrement Oncino/Porco (annexe 1 et listing des grandes haches n° JADE 2008_1598).
La lame BJ-539, de forme triangulaire à tranchant convexe symétrique et bords dressés convexes, mesure 9,1 cm de long, 4,2 cm de large et 1,7 cm d’épaisseur (fig. 8, n° 1). De couleur vert pâle cru et translucide, elle a été déterminée à vue comme une jadéitite par tous les chercheurs depuis Serra Raffols, ce qui a été confirmé par les examens microscopiques de lames minces de J. Casas i Pérez. Les analyses en DRX et microsonde ont confirmé la composition mo-nominérale de la pièce en jadéite. L’analyse spectrora-diométrique montre une jadéitite faiblement micacée, rétromorphosée dans le faciès des schistes verts, qui provient probablement du Mont Viso dans sa partie méridionale (Porco ou Rasciassa) (annexe 1 et listing des grandes haches n° JADE 2008-1601).
DEUXIÈME PARTIE
886 Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
FIG. 8Outils polis en roches diverses de la sépulture 2 de Bòbila d’en Joca, Montornès de Vallès, Vallès oriental, (Barcelona, Catalunya, Espagne). N° 1 à 3 petites haches en jadéitite du Mont Viso, n° 4 hachette en néphrite (pyrénéenne) et n° 5 hache en cinérite de Réquista.Musée de Granollers, photo P. Pétrequin, DAO : J. Vaquer.
La lame BJ-538, de forme sub-triangulaire à tranchant convexe et talon conique, possède une section transver-sale elliptique (fig. 8, n° 2). Elle mesure 9,7 cm de long, 4,6 cm de large et 1,8 cm d’épaisseur. Elle présente vers
la crosse une plage lustré qui indique le négatif de l’em-manchement. La roche parfaitement polie est de couleur vert moyen, avec une structure étirée. Elle correspon-drait à un diopsidite d’après Casas i Pérez (2000 : 92).
DEUXIÈME PARTIE
887Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
Jade Grandes haches alpines du Néolithique européen Ve et IVe millénaires av. J.-C.
L’examen de la lame mince et l’analyse en DRX ont révé-lé que le minéral principal est la jadéite. D’après l’analyse spectroradiométrique, il s’agit d’une omphacitite, d’une omphacitite jadéitique ou d’une omphacitite légèrement rétromorphosée d’origine alpine - il faut rappeler (dans cet ouvrage, tome 1, chapitre 8, p. 440) que la distinction entre jadéite et omphacite est très délicate tant en lame mince qu’aux rayons X pour ces deux minéraux très proches du point de vue minéralogique. L’examen à l’œil nu montre une bonne correspondance avec des échantillons du Mont Viso, en particulier d’Oncino/Bulé (annexe 1 et listing des grandes haches n° JADE 2008_1600).
La lame BJ-540 a une forme ogivale à tranchant peu convexe et légèrement asymétrique en plan (fig. 8, n° 4). Sa section est biconvexe à méplats latéraux et son talon arrondi irrégulier à négatif de cassures du bloc utilisé. C’est la plus petite des lames qui mesure 8,7 cm de long, 3,3 cm de large et 1,8 cm d’épaisseur. La roche qui la constitue est très homogène, de texture fibreuse et de couleur vert moyen. A l’œil nu, c’est une roche qui est semblable à cel-le de plusieurs belles pièces du Languedoc déterminées comme trémolitite monominérale (jade-néphrite) : grands ciseaux du Musée de Narbonne, imitation de type Dur-rington du Musée de Carcassonne et petites pièces dans plusieurs sites du Chasséen classique comme Auriac à Carcassonne (Aude). L’examen de la lame mince de cette pièce a révélé la présence dominante de trémolite d’après Casas i Pérez, détermination confirmée par l’analyse par DRX. Une origine de la partie orientale des Pyrénées du nord est envisageable pour cette pièce. L’analyse spectro-radiométrique confirme la détermination comme amphibo-lite calcique (la trémolite étant une amphibole calcique) ; une origine possible dans les Alpes valaisannes ne peut pas être exclue (annexe 1 et listing des grandes haches n° JADE 2008_1599).
Les autres éléments de mobilier associés et la datation :
Les éléments d’industrie lithique taillée comportent plu-sieurs catégories de pièces. Il s’agit tout d’abord de trois nucléus (BJ-532) mentionnés dans les premières publica-tions. Ils sont en silex blond bédoulien chauffé d’origine provençale et présentent des réserves corticales impor-tantes prouvant leur mise en forme dans le secteur des affleurements du Vaucluse. Il s’agit de nucléus qualifiés par les archéologues catalans comme « en patte de chè-vre », mais en fait ce sont des nucléus présentant des modes de conception volumétrique particuliers.
Le plus gros (105 mm de haut et 905 g) présente un plan de pression lisse et incliné par rapport à la surface de débitage, de façon à former un angle aigu. Son front d’exploitation est convexe à huit négatifs d’extractions de lamelles, qui présentent des extrémités distales obtuses en raison de la largeur et de la convexité de la base corticale. Les flancs parallèles ont été façonnés par enlèvements d’éclats. Toute la base et la face arrière sont corticales. Il s’agit d’un nu-cléus de conception quadrangulaire, dont le front est de-venu convexe par l’amorce du débitage. Ce nucléus a été à peine exploité, puis il a été sacrifié car ces nervures ont été martelées et la corniche a été écaillée de façon à empêcher toute possibilité de reprise du débitage par pression.
Le second nucléus, plus large, devait être à mise en forme quadrangulaire par deux crêtes antéro-latérales. Il mesure 78 mm de haut et pèse 766 g. Son front est légè-rement convexe, mordant sur les flancs à grands enlève-
ments lisses et mats, témoignant de cette mise en forme avant traitement thermique. Son plan de pression est pratiquement orthogonal par rapport à la surface de débi-tage, mais c’est un état secondaire. En effet, il présente à l’arrière une plage mate rubéfiée, tandis que la partie avant présente des négatifs d’enlèvements luisants réali-sés après chauffe, ce qui indique une probable réfection du plan de pression. Sa surface de débitage présente six négatifs d’enlèvements de lamelles, dont la terminaison sur la base plate du nucléus était obtuse et légèrement outrepassée. Il diffère du précédent par sa base plate (constitué par un négatif d’éclatement), mais il présente lui aussi un dos cortical. Comme le précédent, ce nucléus a été sacrifié alors qu’il était encore très exploitable, ses nervures et sa corniche ont été martelées.
Le troisième est à plan de pression lisse très incliné par rap-port à la surface de débitage, dont il est séparé par un angle très aigu. Il mesure 88 mm de haut et pèse 480 g. Son front est convexe, présentant les négatifs de cinq lamelles, dont les terminaisons sur la base corticale du nucléus sont convergen-tes ou obtuses et outrepassées. Les deux flancs du nucléus ont été façonnés par enlèvements d’éclats et sont parallè-les, tandis que la base et le dos du nucléus sont corticaux. Il s’agit d’un nucléus assimilable au type mixte de V. Léa.
Il s’y ajoute un quatrième nucléus récupéré récemment par J. Casas i Pérez auprès de la famille Gurri, qui avait conservé un certain nombre de pièces provenant de cette tombe. Il s’agit d’un nucléus en silex bédoulien blond manifestement chauffé et plus volumineux que les précédents (102 mm de hauteur et poids : 1 225 g). Il est à plan de pression incliné à 45° par rapport à la surface de débitage ; sa base et son dos sont corticaux. Les deux flancs façonnés par enlèvements de grands éclats extraits à partir de la face supérieure sont absolument parallèles. Son front de débitage, légèrement convexe, comporte huit négatifs d’enlèvements lamellaires à terminaison convergente ou obtuse, légèrement outre-passés sur la convexité corticale de la base. Il s’agit d’un nucléus rectangulaire plat, à plan de pression très incliné, dont la conception évoque le type Trets.
Les quatre nucléus de la tombe de Bòbila d’en Joca sont des pièces dont l’état est rarement observable hors de la zone des ateliers chasséens du Vaucluse. Cela est dû au fait qu’ils ont dû parvenir dans le Vallès dans cet état de nucléus amorcés et prêts pour le débitage par pression. Toutefois, ils n’ont pratiquement pas été exploités, mais probablement thésaurisés pour leur valeur d’échange avant d’être sacrifiés pour le « trousseau funéraire ». Ils témoignent d’une conception de mise en forme minima-liste, qui consiste en l’ouverture d’un plan de pression lisse et au façonnage de deux flancs parallèles par enlè-vements d’éclats à partir de ce plan de pression, détermi-nant une morphologie plus ou moins quadrangulaire en raison de la largeur de la base laissée brute. On ne peut pas savoir comment était façonné le front de débitage au départ, mais, vu la largeur des pièces, ce pouvait être par deux crêtes antéro-latérales. Ce mode diffère de celui qui consistait à tailler des préformes en mitre à crête unique antéro-postérieure, dont l’exploitation conduisait à des nucléus semi-coniques. Dans le domaine du Chasséen méridional, des nucléus de conception volumétrique semblable (mixte ou quadrangulaire) et à plan de pres-sion très incliné par rapport à la surface de débitage, sont attestés sur des sites des étapes classiques et récentes, dans la première moitié du IVe millénaire.
DEUXIÈME PARTIE
888 Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
Les types à plan de pression très incliné, de conception quadrangulaire ou mixte, sont fréquents dans les étapes évoluées et récentes du Chasséen méridional (second quart du IVe millénaire).
Les autres pièces taillées sont dix fragments de lamel-les (dont deux récupérés auprès de la famille Gurri) en silex blond bédoulien chauffé. On compte trois parties proximales de lamelles à section trapézoïdale et une à section polygonale, dont les largeurs oscillent entre 0,9 et 1,1 cm. Parmi les fragments mésiaux, un est à section triangulaire et les autres, à section trapézoïdale, sont de plein débitage. Ces lamelles sur silex bédoulien chauffé sont très fréquentes dans les ensembles de l’étape clas-sique de la culture catalane des tombes en fosse. Vers la fin de cette culture, le silex blond d’origine provençale a été remplacé par d’autres silex venant du sud de la Ca-talogne, comme l’indiquent les séries de la nécropole de Cami de Can Grau à la Roca-del Vallès (Martí et al. 1997).
Le dépôt contenait aussi trois armatures de flèches : un trapèze réalisé par troncatures obliques directes et deux pointes à pédoncule et ailerons, dont le limbe est de forme triangulaire isocèle, déterminant des ailerons pointus par raccord à angle droit avec le pédoncule. Ces deux pointes semblent été façonnées sur des fragments de lames par retouches bifaciales à la pression. Ce type d’armature est connu dans le Vallès, à la Bòbila Madurell et dans la nécropole de Cami de Can Grau, La Roca del Vallès. Dans cette nécropole, elles sont attestées à la fois dans les tombes de type 4b de Martín 2009 (à fosse sépulcrale rectangulaire et avant-fosse décalées) et dans les tombes de type 5 de Martín 2009 (à niche absidiale et avant-fosse tangentes ou proto-hypogées). Un exem-plaire de forme identique à celles de Bòbila d’en Joca est connu dans la tombe CCG 42 qui appartient au type 5, c’est à dire probablement le type architectural le plus récent des « Sepulcres de fossa » du Vallèsien (second quart du IVe millénaire). En Provence, de telles armatu-res sont présentes dans le Chasséen récent, notam-ment dans les couches C6 et C5 de la grotte de l’Eglise à Baudinard, Alpes-de-Haute-Provence (Gassin 1996). En Languedoc, on connaît des armatures identiques dans quelques ensembles funéraires de l’étape finale du Néolithique moyen, notamment dans l’ossuaire 4 de las Clauzos à Auriac, Aude (Chantret et al. 1990) et surtout dans la tombe en chambre souterraine de Coste-Rouge à Beaufort, Hérault qui est datée : ERL 9626 4743 ± 46 BP, soit entre 3638-3377 av. J.-C. avec probabilité à 68,9 % (Vaquer et al. 2007). Cette datation chevauche en par-tie celle obtenue pour la tombe de Bòbila d’en Joca à partir de résidus d’os humains collés par des concrétions calcaires au long ciseau (Oxa-8776 : 4600 ±70 BP soit : 3650-3050 av. J.-C. à deux sigmas). Toutefois cette data-tion paraît légèrement trop récente au regard du type de tombe de Bòbila d’en Joca (probablement une tombe de type 3 ou 4 d’après la position et l’orientation du squelette) et à certains aspects du mobilier, notam-ment la présence de nucléus chauffés en silex blond bédoulien qui n’apparaissent régulièrement que dans les tombes des types 3 et 4 de la typologie des tombes révisée par A. Martín (2009). C’est donc probablement vers la fin de l’étape classique de la culture des « Se-pulcres de fossa » qu’il faut placer la tombe de Bòbila d’en Joca soit probablement à la charnière du premier et du second quart du IVe millénaire.
La parure est représentée par un collier de 22 perles en variscite (une cylindrique de la collection de la famille Gurri), pour la plupart en forme de tonnelet et plus rare-ment sub-cylindrique, voire irrégulières. La plus grosse perle, de 45 mm de long pèse 62 g, tandis que les plus petites mesurent une dizaine de millimètres de long pour un poids à peine supérieur au gramme. Ce type de pa-rure est fréquent dans les mobiliers funéraires de l’étape classique de la culture des tombes en fosse, notamment dans les tombes de type 4 ; il est toutefois absent dans les tombes de type 5 de la nécropole de Cami de Can Grau, placées dans le deuxième quart du IVe millénaire.
Les travaux récents et systématiques sur le rituel funé-raire du Vallèsien sont dus à Roser Pou et Miquel Martí (1995), à partir desquels l’une d’entre nous a établi une typologie synthétique (Martín 2009). En résumant, on peut retenir que la callaïs est présente dans tous les types de tombes, à l’exception du type 5 à chambre funéraire tangente et souvent plus profonde que l’avant-fosse. Les nucléus sont attestés principalement dans les types 1 et 3 et on en connaît quelques uns dans le type 4, dans la nécropole de Can Gambús-1 (Roig et al. 2008, vol. 1).
Les haches en roches importées se trouvent dans les tombes de type 1, 3 et 4. Les pointes de flèches à pé-doncule et ailerons sont fréquentes dans les tombes de type 4 et 5 et il y en a aussi quelques unes dans les tom-bes de type 3a à Can Gambús 1. En définitive, si l’on considère que le type 5 jusqu’à présent n’a jamais livré de nucléus en silex bédoulien, ni de perles en callaïs, et que dans ces tombes l’orientation dominante des sque-lettes est SE-NW (Martí et al. 1997), on peut exclure que la tombe d’en Joca ait été de ce type. Si on se réfère à la standardisation de l’architecture des tombes, aux règles d’orientation des inhumés et aux règles de constitution des dotations funéraires du Vallèsien, on peut proposer que la sépulture de Bòbila d’en Joca était probablement du type 3a ou 4a, voire du type 1, mais on sait que ce der-nier correspond dans de nombreux cas au type 3 arasé (Martín 2009).
3. 10. Caserna de Sant Pau del Camp, Barcelona (Barcelonès Barcelona)
Le site de la Caserne de Sant Pau del Camp se trouve dans le centre historique de la ville de Barcelone. Il a fait l’objet de fouilles préventives entre 1988 et 1992, qui ont révélé, à la base d’un complexe stratifié, des témoins de plusieurs occupations néolithiques (Molist et al. 2008). Il s’agissait notamment de vestiges d’habitats du Néolithi-que ancien cardial et post-cardial à structures de com-bustion empierrées et à silos, qui était recoupé par une nécropole de tombes en fosse du Néolithique moyen I, livrant des céramiques de style mixte Molinot et Mont-bolo ancien, attribués par les auteurs à l’horizon post-car-dial (Gómez et al. 2008). Les 24 sépultures individuelles fouillées forment deux groupes d’inhumations de sujets généralement en position repliée sur le côté ; elles com-portent des dotations sous forme de poteries, de parures et d’outils lithiques. L’industrie lithique de ce site a fait l’objet d’une publication préliminaire globale, qui révèle la présence de 57 pièces polies, pour la plupart en roches métamorphiques locales telles que des cornéennes, des schistes, etc., ainsi que deux pièces en roches vertes (Bofill et al. 2008). Nous avons pu examiner ces deux piè-ces grâce à l’amabilité de M. Molist.
DEUXIÈME PARTIE
889Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
Jade Grandes haches alpines du Néolithique européen Ve et IVe millénaires av. J.-C.
La première est un fragment distal de petit ciseau, à tran-chant en double biseau de forme convexe (SP 90, sect. B, N2, T. XIII-1), qui a fait l’objet d’un polissage total à facet-tes. Il mesure 2,3 cm de long (cassé), 2 cm de large et 0,8 cm d’épaisseur (fig. 3 n° 3). L’analyse spectroradiométri-que permet de déterminer une amphibolite calcique ré-tromorphosée ; à l’œil nu, la roche pourrait être d’origine pyrénéenne plutôt qu’alpine (voir annexe 1). Cette pièce provient d’un niveau d’habitat du Néolithique ancien.
La seconde pièce provient du secteur B AD 7, T. XXV enter. XVII, n°1, c'est-à-dire de la sépulture 17, qui conte-nait les restes d’un adolescent d’une dizaine d’années, accompagné d’une riche dotation comportant les sque-lettes de deux chèvres en connexion, un collier de perles discoïdes en variscite avec un pendentif en même mi-néral, une lamelle de silex et une petite lame en pierre polie. Cette petite hache ou ciseau est de forme sub-rec-tangulaire, à côtés convexes et à section en D, avec un tranchant à double biseau symétrique et convexe en plan (fig. 3, n° 2). L’analyse spectroradiométrique permet de déterminer une jadéitite atypique d’origine alpine ; à l’œil nu, cette jadéitite rappelle des échantillons équivalents du Mont Viso (voir annexe 1).
Bien que très limitées, les observations sur ces pièces indiquent que la seconde est incontestablement d’origine alpine. Malgré sa petite taille, il s’agit d’un jalon intéres-sant pour la diffusion d’outillages alpins. En effet ce type d’élément était jusqu’à présent inédit dans des contextes du Néolithique moyen 1 catalan mais bien connus dans le complexe des « Sepulcres de fossa » du Néolithique moyen 2. S’il se confirme que cette tombe date bien de la seconde moitié du Ve millénaire cette pièce suggère que les importants réseaux existant dans le Midi français au cours du Chasséen ancien et du Montbolo se prolon-geaient en Catalogne au moins jusqu’au Llobregat. Les datations radiométriques obtenues sur le site ont été li-mitées par le manque de collagène et en raison d’écarts types importants. Le résultat mentionné pour la sépul-ture 18 : UBAR 263 : 5160 ± 130 soit 4250-3700 av. J.-C. ne couvre que partiellement la fourchette envisageable à partir de la typologie du matériel, qui devrait se placer dans le dernier quart du Ve millénaire.
3. 11. La nécropole de Bóbila Madurell à Sant Quirze del Vallès (Vallès occidental, Barcelona)
Le site de la Bóbila Madurell est un vaste complexe d’habitats et de nécropoles du Néolithique moyen, qui s’étend sur une trentaine d’hectares et qui a fait l’objet de nombreuses découvertes et de fouilles préventives. Les premières étaient liées à la construction du chemin de fer (1921), puis à des exploitations d’argile pour des briqueteries dès 1931 (Serra Ràfols 1947, Ripoll et Llon-gueras 1963, Muñoz 1965), à des travaux d’autoroutes dans les années 70 (Llongueras et al. 1981, 1986) et d’ur-banisation à la fin des années 80 à Can Feu-Mas Duran (Martín et al. 1988). Ils se sont poursuivis au début des années 90 à Poble Sec-Ferrocarrils (Blanch et al. 1991, 1992) et peu après à Mas Duran (Martín et Mora 1992, 1993, Bordas et al. 1994, Martín et al.1996). Il doit aussi être mis en relation avec les trouvailles plus récentes à Can Gambús-1 (Roig et al. 2006, 2008, Roig et al. 2010) et Can Gambús-2 (Artigues et al. 2006, 2007) dans la commune de Sabadell. Ce site est emblématique du fa-ciès vallèsien de la culture catalane des « Sepulcres de fossa » aussi bien pour les aspects de l’habitat (presque
une centaine de fosses ou de structures domestiques) que pour les aspects funéraires (170 tombes de divers types inventoriées au total) (Martín 2009). Plusieurs de ces tombes ont livré de l’outillage en pierre polie. Nous en avons sélectionné deux qui contenaient des pièces en roches vertes.
La tombe M5 : C’est une structure à tombe en fosse centrale circulaire, fouillée en 1991 dans le secteur de Mas Duran. Il s’agit du type 3 de Pou et Martí (1995) et 3b de Martín (2009). Elle avait une avant fosse sub-circulaire (2,65 x 2,28 m.), conservée sur 30 cm, et une chambre funéraire sub-cir-culaire (1,65 x 1,55 m) d’un mètre de profondeur. Cette tombe contenait les restes osseux de deux sujets (un enfant et un adulte de sexe indéterminé), mal conservés et remaniés (tombe pillée anciennement). Elle a livré des éléments mobiliers assez abondants au sein desquels on note trois lames de haches polies (Pou et Martí 1995 : vol. II, 74-78, et vol. I, planches VI, IX et X).
La première marquée M5, n°129 13 est une lame sub-triangulaire à tranchant convexe symétrique, à bords ar-qués convergents vers un talon conique (fig. 3, n° 6). Elle mesure 13,7 cm x 4,6 cm x 2,5 cm et se trouve donc au seuil inférieur du groupe des grandes haches. Sur les deux tiers distaux, elle présente des bords aplanis avec arêtes marquées qui permettent de la rapprocher du type Puy sp. En partie proximale, la section devient elliptique, ce qui est dû au fait que tout le talon est bouchardé. Le polissage des faces et des bords est très régulier (niveau 4), légèrement brillant ; il ne laisse voir que deux stigma-tes de taille sur la même face et une fissure d’extraction thermique sur un côté. A l’œil nu, la roche vert pâle mat évoque une jadéitite saccharoïde à nombreux petits points vert moyen de type Mont Viso/Porco. Cette impression est confirmée à la fois par l’analyse spectroradiométrique et par la mesure de densité : 3,36. Une origine Mont Viso (Porco, Bulè) est hautement probable (annexe 1 et listing des grandes haches n° JADE 2008_1618).
La seconde pièce marquée M 5. n°78 .14 est de forme tra-pézoïdale, à tranchant légèrement et section sub-rectangu-laire (fig. 3, n° 1). Elle mesure 3,9 cm x 3,9 cm x 1 cm et est entièrement polie avec facettes visibles, soit un polissage de niveau 3. La roche est fine et de couleur brun olivâ-tre avec des cristaux blanchâtres ; à l’œil nu, elle évoque des pièces semblables en amphibolite calcique (néphrite) trouvées dans plusieurs sites du Chasséen classique nord pyrénéen, tels que Auriac, Carcassonne. L’analyse spec-troradiométrique permet de reconnaître une néphrite ré-tromorphosée (annexe 1 et listing des grandes haches n° JADE 2008-1619).
Une troisième lame en pierre polie, de forme allongée, est à tranchant convexe avec un corps dissymétrique, un talon arrondi et une section elliptique mince. Elle n’a pas pu être examinée.
Ce lot de haches était accompagné de pièces lithiques en silex taillé qui comportent deux nucléus en silex blond bédoulien chauffé, un conique avec une réfection proba-ble du plan de pression et un autre mixte à plan de pres-sion très incliné. Il y a aussi 3 lamelles et 4 fragments de lamelles en silex blond. Les pièces retouchées sont 8 armatures de flèches géométriques : 1 segment, 1 trian-gle isocèle, 6 trapèzes, dont trois de type Trets. Il y avait aussi une meule plate en pierre métamorphique.
DEUXIÈME PARTIE
890 Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
La parure se réduit à une seule perle en variscite et à des éléments de parure en coquilles de mollusques marins, un Glycimeris entier et 3 fragments. Il est possible que ces éléments précieux aient été plus nombreux à l’origine, puisque la tombe a été pillée anciennement. La céramique n’était représentée que par des tessons dispersés.
La forme circulaire de la tombe suggère une attribution au tout début de la culture catalane des tombes en fos-se, dans son faciès vallèsien. Il n’y a pas de datation pour les tombes de type 3b, mais celles pour le type 3a à Can Gambús 1 (type A de Roig et Coll) de 4850 ± 80 BP, 4980 ± 40 BP et 4865 ± 40 BP (Roig et al. 2010). Ces résultats nous indiquent une tranche entre 3812 et 3495 av. J.-C. à 2 s. Ces résultats nous semblent trop récents par rapport à ce qui était attendu en fonction de la typologie des mobiliers, qui devraient correspondre à une datation à la charnière des Ve et IVe millénaires. La présence d’une hache alpine de type Puy dans un tel contexte constitue un précieux jalon chronologique pour ce type, avec la particularité remarquable d’un bouchar-dage de la zone du talon, correspondant probablement à un réaménagement secondaire.
La tombe G10-7 :
Cette tombe a été fouillée en 1991 dans le secteur Mas Duran. C’était une tombe à fosse sépulcrale rectangulaire (1,61 x 1,30 m), conservée sur 60 cm de profondeur. Elle a été attribuée au type 1a de Martí et Pou (1995) et de Martín (2009), celui-ci pouvant correspondre à des tom-bes de type 3 ou 4 ayant subi une forte érosion. Comme il est de règle dans ce genre de fosse, il n’y avait qu’un seul squelette d’un individu adulte masculin avec la tête placée à l’est, le corps couché sur le dos et les membres inférieurs repliés vers la gauche (Pou et Martí, 1995 : vol. II, 21-25 et vol. I, planches IV-IX ).
Ce sujet disposait d’une riche dotation qui comportait deux haches polies, dont une posée à droite du crâne (Gibaja 2003 : 240). C’est une lame marquée G 10. n°7 .15, de forme sub-triangulaire à tranchant convexe sy-métrique et à bords dressés, avec un polissage total de niveau 4 (fig. 3, n° 7). Utilisée comme outil, elle me-sure 8,6 x 5,5 x 2,2 cm. Elle a été faite dans une roche d’aspect proche de la serpentinite, de couleur vert foncé bleuté avec quelques rectangles blancs. L’analyse spec-troradiométrique a confirmé la caractérisation comme serpentinite (antigorite), ce que ne dément pas la mesu-re de densité : 2,67. Il est délicat de déterminer l’origine de cette roche ; toutefois la rareté de ce matériau dans les séries catalanes suggère de la considérer comme exogène et probablement alpine (voir annexe 1). Dans le midi de la France, les haches en serpentinite ne sont pas fréquentes et sont surtout localisées près des af-fleurements ophiolitiques dans les Pyrénées nord-orien-tales et en Provence orientale (Ricq -de Bouard 1996), mais elles ne sont réellement abondantes que dans les séries du domaine nord-occidental des Alpes (Thirault 2004). L’autre pièce polie, à tranchant convexe symétri-que, est fragmentée.
Le reste du mobilier funéraire comporte des pièces taillées en silex blond bédoulien importé du Vaucluse. Trois nucléus, traités thermiquement (plages mates rougies antérieures au débitage de lamelles), formaient un dépôt localisé à hauteur du thorax sur le côté gau-che du sujet. Un de ces nucléus figuré par J.-F. Gibaja
(2003, fig. III-2) est de type mixte, avec extractions la-mellaires frontales sur un plan de pression très incliné et avec une table convergente. Un autre est de type mixte double ; le dernier paraît avoir une table quadran-gulaire, mais sa base est cassée et son plan de pres-sion pratiquement orthogonal.
Le même silex est représenté par une lame et 4 frag-ments de lame et de lamelle. Une lame est à section pris-matique et un fragment de lamelle à section triangulaire sans partie distale. La seule pièce retouchée est une ar-mature trapézoïdale, obtenue par double troncature d’un fragment de lame.
L’outillage en os est représenté par sept poinçons sur métapodes de caprinés refendus avec poulie articulaire conservée. Ils étaient disposés à droite de la tête et le long du bras droit.
Il y avait aussi les fragments de deux vases, dont un à ouverture déformée, muni d’une anse. Le sujet portait un collier de perles en variscite comportant onze perles, dont deux en tonnelet et les autres discoïdes.
L’analyse radiocarbone sur un échantillon d’os a donné une datation de 5540 ± 450 BP, évidemment peu utile à cause de son très grand écart-type. Mais ce type de do-tation relativement riche associée à un individu masculin ressemble à plusieurs autres de la nécropole voisine de Can Gambús-1 à Sabadell (Roig et Coll, 2006 et 2008, Roig et al. 2010), dans des sépultures de type 3a ou 4 a et b qui correspondent à l’étape classique du Vallèsien, datable dans le premier quart du IVe millénaire. C’est dans ce contexte que se trouve une lame de hache en serpen-tinite probablement importé de France.
3. 12. Nécropole de Can Gambús-1 à Sabadell (Vallès occidental, Barcelona)
La nécropole néolithique de Can Gambús-1 à Sabadell (Barcelona) a fait l’objet d’une opération de fouilles pré-ventives entre 2003 et 2006 sous la direction de J. Roig ; la fouille a permis de préciser la connaissance des archi-tectures et des pratiques funéraires du faciès vallèsien de la culture catalane des tombes en fosses (Roig Buxó et Coll Riera 2006, Roig et al. 2010). Il s’agit d’un groupe de 47 tombes en fosses situé au sommet d’une colline allon-gée (Serrat de Can Feu), constituée d’argiles du Miocène plus ou moins indurées par des encroûtements calcaires. La nécropole s’étend sur 0,54 hectare et forme une aire ovalaire qui a été amputée par des terrassements vers le sud-est. Les structures sont inégalement conservées selon leur type architectural et aussi selon leur localisa-tion par rapport au sommet de l’interfluve. On peut tout de même constater la juxtaposition de types différents, ce qui pourrait indiquer que la nécropole a été utilisée pendant une assez longue période. Aucun recoupement de tombe n’a été toutefois observé, ce qui suggère l’exis-tence de dispositifs de signalisation au niveau du sol de l’époque. Les fouilleurs ont constaté seulement des re-coupements avec des structures d’habitat de périodes historiques, dont l’état de conservation permet de sus-pecter une érosion des paléosols sur une épaisseur de l’ordre de 0,8 à 1,50 m.
Les 47 structures funéraires en creux correspondent pour la plupart à des sépultures individuelles (43) et à quatre sépultures doubles. Les architectures des tombes per-mettent de reconnaître plusieurs types.
DEUXIÈME PARTIE
891Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
Jade Grandes haches alpines du Néolithique européen Ve et IVe millénaires av. J.-C.
- Tombes à avant-fosse quadrangulaire et fosse funéraire quadrangulaire centrale. Il s’agit du type 3a de Martín (2009) ou du type A de Roig et al. (2010). Ces 11 tom-bes sont caractérisées par une avant-fosse plus grande, créant une banquette tout autour de la fosse funéraire creusée plus profondément, de 0,90 à 1,85 m de pro-fondeur. Cela permettait de disposer et de maintenir un dispositif de couverture de la loge sépulcrale de façon à ce qu’elle reste vide. Les apports novateurs de la nécro-pole de Can Gambus-1 concernent ces fermetures qui pouvaient être des dalles de conglomérat local (type A1 de Roig et al. 2010) ou des éléments en bois recouverts de pierres (type A2 de Roig et al. 2010). Ces tombes sont orientées pour certaines est-ouest et pour la majorité nord-est-sud-ouest.
- Tombes à avant-fosse quadrangulaire et fosse funéraire quadrangulaire partiellement sous-cavée au nord-est. Il s’agit du type 4a de Martín (2009) ou du type C de Roig et al. (2010). Dans ces trois tombes, la loge sépulcrale est décalée vers le nord-est, de sorte que la partie su-périeure du corps du défunt est engagée sous la paroi de l’avant-fosse, le reste étant couvert d’un dispositif de couverture en matériaux organiques qui prenait appui sur la banquette de l’avant-fosse.
- Tombes à avant-fosse quadrangulaire et loge funéraire sous-cavée, avec accès en puits au nord-est. Attesté par quatre exemplaires, ce type correspond au type 4b de Martín (2009) ou au type B de Roig et al. (2010). Il diffère peu du précédent, si ce n’est par le fait que la loge sépul-crale est totalement sous-cavée sous la paroi de l’avant-fosse, celle ci ne comportant que la bouche du puits d’ac-cès vertical, qui était obturée par une dalle posée à plat sur le rebord de la banquette.
- Tombes à avant-fosse quadrangulaire et chambre absi-diale à accès frontal. Il s’agit du type 5 de Martín (2009) ou du type D de Roig et al. (2010). Dans ce type, l’avant-fosse et la chambre funéraire sont séparées par un accès frontal obturé par une ou plusieurs dalles verticales. Ce type est attesté par six exemplaires plus ou moins bien conservés. Il s’agit de proto-hypogées, dans lesquels les défunts étaient placés orthogonalement par rapport à l’axe du monument, généralement orienté vers le nord-nord-est. Ces sépultures marquent donc un retour à une orientation antipolaire des défunts.
- Le dernier type de tombe correspond à des fosses sim-ples de forme quadrangulaire, qui sont surtout localisées au centre de la nécropole, donc dans la zone la plus éro-dée. Ce type correspond au type 1a de Martín (2010) ou du type E de Roig et al. (2010). Il est impossible de sa-voir si ce type existait vraiment ou si ce sont des tombes érodées. S’il s’agit de tombes dont l’avant-fosse n’est pas conservée, elles pourraient correspondre à la partie la plus profonde de tombes des types 3 ou 4 de Martín (2009) ou des types A, C et B de Roig et al. (2010).
Le plan de la nécropole de Can Gambús-1, tout comme celui de la nécropole de Cami de Can Grau à la Roca del Vallès (Martí, Pou et Carlus 1997), révèle un développe-ment topographique corrélé à la typologie des tombes. Les tombes les plus anciennes, au sommet de l’inter-fluve, sont des types 1a et 3a de Martín (2009), avec des orientations qui semblent est-ouest sur la ligne sommi-tale et qui paraissent ensuite dériver vers le nord-est pour l’ensemble des autres tombes. Les tombes des types
4a et 4b se trouvent en périphérie sud-ouest du premier groupe, tandis que les tombes du type 5 de Martín 2009 se trouvent sur la périphérie nord-occidentale de la nécro-pole. Les datations radiométriques obtenues confirment la succession des tombes de type 3a de Martín ou A2 de Roig et du type 5 de Martín ou D de Roig, ce qui est conforme aux indications chronologiques de la nécropole de Cami de Can Grau, qui a déjà révélé la succession des tombes de type 4 et 5 (Martí, Pou et Carlus 1997). Tou-tefois les jalons de chronologie absolue obtenus à Can Gambús-1 pour le type 3a sans dalles (E 110 : UBAR 900 : 4850 ± 80 soit 3800-3496 av. J.-C. ; E 167 : UBAR 901 : 4980 ± 40 soit 3812-3656 av. J.-C. ; E246 : UBAR 902 soit 3714-3628 av. J.-C.) ou pour le type 5 (E 515 : UBAR 903 : 4570 ± 60 soit 3385-3090 av. J.-C.) parais-sent tous légèrement trop récents.
Les dotations funéraires de la nécropole de Can Gam-bús-1 constituent un ensemble de référence particulière-ment significatif en raison de leur richesse et des multi-ples corrélations qui peuvent être établies. L’outillage en pierre polie est représenté par 14 pièces provenant de 12 sépultures, 10 avec une seule hache et 2 avec deux haches. Les lithotypes représentés sont diversifiés : une éclogite, une jadéitite, une omphacitite jadéitique, quatre néphrites, quatre chloritoschistes et trois pièces en cal-caire ou marbre (haches simulacres ?). Dans cette série, quatre pièces ont une origine alpine très probable.
Can Gambús-1-E162 196 7 : petite hache trapézoïdale à bords droits faite dans une roche grise d’aspect rubanée (fig. 9, n° 3). L’analyse spectroradiométrique permet de déterminer une jadéitite d’origine alpine, probablement du Mont Viso (Oncino/Bulè) (voir annexe 1). Cette hache a été trouvée dans une tombe à fosse rectangulaire sim-ple du type 1a de Martín (2009) ou du type E de Roig, très probablement de type 3 ou 4 dont l’avant-fosse n’était pas conservée. La tombe contenait la sépulture d’un adulte de sexe indéterminé.
Can Gambús-1 E167 268 16 : Hache de forme sub-trapé-zoïdale, à tranchant légèrement convexe, flancs arqués et talon arrondi. Elle a une section elliptique et présente quel-ques stigmates de mise en forme par taille, avant un po-lissage peu soigné de niveau 3. Cette hache mesure 13,8 cm de long, 7,2 cm de large et 3,2 cm d’épaisseur, près de la limite inférieure du groupe des grandes haches ; sa morphologie la rapproche du type Chelles court. Elle est dans une roche fine, vert foncé noirâtre avec de grands cristaux de même couleur (fig. 9, nº 4). L’analyse spectro-radiométrique permet de déterminer une éclogite, ce que confirme une mesure de densité de 3,56. Il pourrait s’agir d’une hache d’origine alpine, mais dont on ne connaît pas d’équivalent exact à l’œil nu (annexe 1 et listing des gran-des haches n° JADE 2008_1615). Son contexte est celui d’une tombe de type A2 de Roig, contenant les restes d’un homme adulte avec une dotation riche. La hache était inti-mement associée au dépôt de trois nucléus en silex bédou-lien du Vaucluse. Le sujet portait un collier de 155 perles en variscite (146 discoïdales, 8 cylindriques, une grosse en tonnelet) ; une autre perle était isolée. Il était environné de trois lames en silex bédoulien chauffé et de cinq trapèzes, ainsi que d’outils en os (trois poinçons et des fragments). La céramique n’était représentée que par un fragment de bord. La morphologie des nucléus -un en mitre et deux de morphologie mixte- révèle des concordances avec le Chas-séen méridional classique (premier quart du IVe millénaire).
DEUXIÈME PARTIE
892 Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
FIG. 9Outils polis en roches alpines provenant de la nécropole de tombes en fosse de Can Gambús-1, Sabadell, Vallès occidental (Barcelone, Catalogne, Espagne). N° 1 : tombe 70, hache en omphacitite à gros grenats, n° 2 : tombe 166, hache du type Puy en néphrite , n° 3 : tombe 162, petite hache en jadéitite. N° 4 : tombe 167, hache de type Chelles en éclogite.Museu d’Història de Sabadell, photos P. Pétrequin, DAO J. Vaquer.
Can Gambús-1-E70 310 7 : une petite hache trapézoïdale à tranchant convexe, bords légèrement arqués et dres-sés avec un talon tronqué convexe ; celui-ci est martelé au point qu’on peut se demander si cette partie de la ha-
che n’a pas été reprise après cassure. La hache présente une section sub-rectangulaire et mesure 5,3 cm de long, 3,7 cm de large et 1,6 cm d’épaisseur. C’est une hache de travail à polissage de niveau 3. Elle est en roche à grain
DEUXIÈME PARTIE
893Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
Jade Grandes haches alpines du Néolithique européen Ve et IVe millénaires av. J.-C.
fin vert foncé avec de grands grenats et d’autres cristaux gris bleutés ; à l’œil nu, il pourrait s’agir d’une éclogite (fig. 9, nº 1). L’analyse spectroradiométrique permet de déter-miner une omphacitite, une omphacitite jadéitique ou une omphacitite légèrement rétromorphosée ; cette caractéri-sation est confirmée par une densité de 3,42. Il s’agit pro-bablement d’une roche alpine (voir annexe 1). Cette hache faisait partie de la riche dotation d’une tombe du type E de Roig, qui contenait les restes d’un homme adulte. La hache était associée à deux nucléus en silex bédoulien de type sub-conique ou en mitre. Le mobilier comportait aussi une parure en perles discoïdes de variscite, plusieurs lamelles, des trapèzes et une pointe à pédoncule et ailerons en silex blond, des poinçons en os et les restes de cinq vases. Ce mobilier correspond à l’étape classique de la culture cata-lane des tombes en fosse (premier quart du IVe millénaire).
Can Gambús-1- E166 253 5 : c’est une hache de forme trapézoïdale allongée, à tranchant convexe bords arqués et équarris et talon tronqué droit équarri lui aussi. Avec une longueur de 13,5 cm, une largeur de 4,4 cm et une épais-seur de 1,8 cm, elle est au seuil de la classe des grandes haches et correspond parfaitement au type Puy, en raison de ses bords à méplats et leur raccord au tranchant obtus. La finition est assez poussée avec un polissage de niveau 4. La roche est très fine de couleur vert foncé bleuté, avec quelques cristaux rectangulaires blancs ; elle évoque une amphibolite calcique (fig. 9, nº 2). L’analyse spectroradiomé-trique permet de déterminer une néphrite rétromorphosée, ce que confirme une mesure de densité de 2,96. Il s’agirait peut-être d’une importation alpine, mais non démontrée (an-nexe 1 et listing des grandes haches n° JADE 2008_1614). Cette lame de hache fait partie de la dotation d’un individu adulte de sexe indéterminé, placé dans une tombe du type B de Roig, c'est-à-dire une tombe à fosse funéraire déca-lée par rapport à l’avant-fosse, avec puits d’accès couvert par une dalle qui forme un type transitionnel vers les vraies tombes à niche absidiale de l’étape récente de la culture des « Sepulcres de fossa ». On peut donc la dater vers la fin de l’étape classique de cette culture, soit vers la fin du premier quart du IVe millénaire. Les éléments du mobilier associé sont semblables à ceux des tombes riches de type A, à savoir deux nucléus en silex bédoulien chauffé de mor-phologie mixte et trois lames en silex blond bédoulien, une pointe de flèche à pédoncule et ailerons et un bracelet de huit perles en variscite. La morphologie des nucléus en silex bédoulien révèle des connexions avec le Chasséen méridio-nal classique.
Grâce à l’excellente qualité des observations de fouilles, la nécropole de Can Gambús-1 permet d’établir plusieurs types de corrélations. Les trois haches alpines ont été dé-posées dans des tombes à fosse funéraire rectangulaire, qui peuvent être en position centrale ou décalée dans l’avant-fosse. Comme d’autres haches polies, elles sont associées de façon stricte à des dépôts de nucléus en silex blond bédoulien, figurant comme des objets de va-leur et probablement placés dans des contenants à côté du corps. Leur disposition semble en effet révéler que la plupart des haches n’étaient pas emmanchées. Lorsque la diagnose sexuelle du défunt a pu être établie, ces outils sont associés à des sujets masculins et, dans les trois cas, ils figurent dans des tombes avec armatures de flèche.
3. 13. Sépulture de la mine de variscite 9 de Can Tintorer, Gavà (Baix Llobregat, Barcelona)
Lors des premières fouilles de sauvetage du complexe mi-nier de Can Tintorer à Gavà, des restes humains ont été trouvés dans le remplissage de l’entrée de cette mine rem-blayée (Villalba et al. 1986). Le dépôt funéraire comportait les restes de plusieurs individus : cinq ou six ? Seuls deux d’entre eux étaient bien représentés, mais leur disposition avait été perturbée ; il s’agirait d’une sépulture collective. Les éléments de mobilier trouvés à proximité ont été interprétés comme du mobilier funéraire : ils comportaient un petit ci-seau en pierre polie qui mesure 3,9 cm de long, 1,6 cm de large et 0,8 cm d’épaisseur. Il a été réalisé dans une roche de couleur vert moyen à traînées noires. L’analyse spectrora-diométrique permet de déterminer une amphibolite calcique rétromorphosée ; à l’œil nu, une origine alpine semble très douteuse (voir annexe 1). Le reste du mobilier se compo-sait de poinçons sur métapodes d’ovicaprinés, un gobelet caréné, un escargot marin biforé et une masse. Le vase, avec sa carène très vive et son col rentrant, est typique de l’étape classique ou récente de la culture des « Sepulcres de fossa » ; des vases semblables à paroi très concave ont été trouvés dans des tombes de type 4 à Cami de Can Grau.
3. 14. La sépulture de la mine de variscite 83 de Can Badosa, Gavà (Baix Llobregat, Barcelona) Cette sépulture a été détectée lors d’une opération d’ar-chéologie de sauvetage réalisée en 2000 sur la zone des mines préhistoriques de variscite de Gavà, dans le sec-teur de la Serra de les Ferreres ou de Can Badosa (Borrell et al. 2005, Bosch et Borrell 2009).
Le puits de cette mine était obturé par un gros bloc calcai-re condamnant l’accès à une galerie réutilisée en chambre funéraire souterraine. La sépulture individuelle était établie dans une petite rotonde de 1,90 m/1,50 m, fermée par des dalles disposées de chant. Elle était mal conservée, les restes humains étant déconnectés et incomplets, sans doute en raison d’une décomposition, puis d’une altération en milieu non colmaté. L’analyse anthropologique des res-tes a permis de déterminer un sujet adulte, dont le sexe n’a pas pu être précisé. Ce sujet était accompagné d’une très riche dotation comportant plusieurs sortes d’objets.
Industrie en pierre polie :
Les lames de haches en pierre polies sont au nombre de quatre :
La plus grande (M83 18) peut rentrer dans la catégorie des grandes haches, étant donné ses dimensions impor-tantes (L : 16,1 cm, l. max. : 7,2 cm et e : 3,1 cm). Tou-tefois, elle n’est pas d’une finition aboutie, puisqu’une face présente un grand négatif d’éclatement antérieur au polissage et l’autre face des négatifs d’enlèvements multiples. Le tranchant est convexe en plan et à double biseau symétrique en profil ; il est perpendiculaire à l’axe longitudinal de la pièce et plus étroit que la largeur maxi-male du corps. Le talon est cassé ; il pouvait être tronqué oblique. Les flancs sont convexes et renflés avec la lar-geur maximale au tiers supérieur. La section est elliptique avec amorces d’arêtes uniquement dans la partie distale. Cette hache présente quelques ressemblances avec le type alpin Durrington en raison de sa forme en goutte, plus renflée sur le corps que vers le tranchant ; mais elle n’est absolument pas typique en raison de l’absence de talon pointu et de sa finition imparfaite qui la ferait clas-ser plutôt dans les haches de travail. La roche est à grain fin, vert moyen à noir, sans grenats visibles à l’œil nu ;
DEUXIÈME PARTIE
894 Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
FIG. 10Haches polies de la sépulture de la mine de Can Badosa 83 à Gavà, Baix Llobregat (Barcelone, Catalogne, Espagne). N° 1 : Hache en jadéitite, n° 2 : hache en éclogite, n° 3 : petite hache en fibrolite, n° 4 grande hache de travail en éclogite.Musée de Gavà, photo P. Pétrequin, DAO : J. Vaquer.
elle présente ponctuellement en surface des traces d’un enduit d’hématite (fig. 10, n° 4). L’analyse spectroradiomé-trique montre qu’il s’agit d’une éclogite ; les comparaisons à l’œil nu suggèrent une origine dans le massif du Mont Viso, peut-être Oncino/Bulè (annexe 1 et listing des grandes haches n° JADE 2008_1597).
La seconde hache (M83 19) est très bien polie, mais de di-mensions plus réduites (L : 8,6 cm, l : 5,8 cm, e : 2,4 cm).
Elle présente en plan un tranchant peu convexe et en profil axial un double biseau symétrique. Le corps est tra-pézoïdal à flancs convexes avec un léger renflement au tiers distal (5,8 cm de large contre 5,7 cm au tranchant). Le talon est cassé sur une face ; il pouvait être tronqué ar-rondi. La section est elliptique moyenne. Cette lame est donc morphologiquement très proche de la précédente. Elle est bien polie sur les deux faces, qui ne présentent
DEUXIÈME PARTIE
895Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
Jade Grandes haches alpines du Néolithique européen Ve et IVe millénaires av. J.-C.
que des plages résiduelles piquetées vers le talon. En surface sont visibles des traces d’oxyde de fer et peut-être d’hématite. Les flancs sont convexes avec amorces d’arêtes distales ; ils sont piquetés. La roche est à grain fin de couleur vert foncé à noir (fig. 10, n° 1). L’analyse spectroradiométrique permet de déterminer une jadéitite faiblement micacée ; l’origine pourrait en être le Mont Viso et plus particulièrement Oncino/Porco (voir annexe 1). Toutefois, la mesure de la densité (2,98 ?) pourrait contredire cette détermination, très inhabituelle dans le cas des jadéitites, improbable dans celui des éclogites.
La troisième lame (M83 29) est une lame étroite (L : 7,1 cm, l : 3 cm, e : 1,4 cm), à tranchant convexe en plan et à double biseau symétrique en vue de profil. Le corps est étroit à flancs légèrement convexes ; le talon est tronqué oblique avec une légère cassure. La section est elliptique moyenne. La roche est à grain fin, de couleur vert moyen avec des passées de couleur vert foncé, elle contient aus-si des cristaux gris blanchâtres groupés vers le tranchant (fig. 10, n° 2). L’analyse spectroradiométrique permet de déterminer une éclogite légèrement rétromorphosée ; une origine alpine est possible, mais cette éclogite n’est pas caractéristique à l’œil nu (voir annexe 1). Toutefois, la mesure de la densité (3,10 ?) pourrait contredire cette dé-termination, très inhabituelle dans le cas des éclogites.
La quatrième lame polie (M83 28) est de forme trapé-zoïdale, à tranchant convexe légèrement dissymétrique quoique perpendiculaire à l’axe longitudinal (L : 7,2 cm, l : 4,7 cm, e : 1,3 cm). En vue de profil la pièce est mince, fusiforme avec un tranchant à double biseau symétrique. La section transversale est sub-quadran-gulaire peu épaisse. Les flancs sont dressés et légère-ment convexes et le talon est tronqué oblique (fig. 10, n° 3). La roche est une fibrolite ou sillimanite à struc-ture tourmentée de couleur blanche à passées jaunes. La détermination à l’œil nu est confirmée par l’analyse spectroradiométrique (voir annexe 1).
Le lot de haches polies de la tombe 83 comporterait donc trois pièces en « roches alpines » (deux en éclogite et une en jadéitite), dont une de grand format, qui présente une forme évoquant peut-être le type Durrington, mais qui est difficilement classable dans les types socialement valorisés en raison de sa finition sommaire. Une autre pièce est en sillimanite d’origine probablement ibérique.
Autres éléments et arguments de datation
Les éléments d’industrie lithique taillée sont au nombre de 14 et sont tous en matériaux exogènes.
La pièce d’origine la plus lointaine est une lamelle d’obsi-dienne entière de 78 mm de long, obtenue par pression ; l’analyse géochimique a permis de situer l’origine en Sar-daigne au Monte Arci et plus particulièrement à la source A de Conca Cannas (Bosch, Gibaja et Gratuze 2009).
Les 13 autres pièces sont en silex bédoulien blond origi-naire du Vaucluse, comme le suggère la présence de spi-cules d’éponge, de grains de quartz détritiques et d’oxy-des de fer, visibles à la loupe binoculaire. L’aspect luisant ou satiné de ces pièces indique un traitement thermique en vue de rentabiliser le débitage de fines lamelles par pression (Borrell 2009).
La dotation comporte trois nucléus déposés dans un état encore largement exploitable, qui permet de caractériser leur mode de façonnage et leur mode d’exploitation.
Le nucléus M83 8 peut-être qualifié de sub-conique. A la base et à l’arrière, il présente les restes d’une crête antéro-postérieure axiale, témoignant d’une mise en forme initiale en mitre. Son plan de pression horizontal semble avoir été repris, car il est facetté par des enlève-ments d’éclats centripètes (post-traitement thermique). Le front d’exploitation est hémicirculaire, comportant 11 négatifs d’extraction de lamelles à extrémité dis-tale aiguë ou oblique. Ce nucléus présente un défaut sous forme d’une fissure, résultant probablement d’un « crack » lors du traitement thermique. Il s’agirait d’un nucléus en mitre ou carénoïde devenu semi-conique, en cours d’exploitation semi-tournante.
Le nucléus M83 27 peut être qualifié de type sub-coni-que. Il présente lui aussi un plan de pression peu incliné et circulaire, mais qui résulte d’une reprise puisque les enlèvements d’éclats sont luisants et ont donc été réa-lisés après chauffe. Son dos est cortical et sa base incli-née. Le front d’exploitation supérieur est très convexe ; il présente sur le flanc droit des négatifs d’enlèvements lamellaires rebroussés. C’est sans doute pour cette rai-son que la surface d’exploitation a été reprise à l’envers sur le flanc gauche, où l’on note 7 négatifs d’enlève-ments partant de la base, qui forme un plan de pression très incliné. Ce nucléus porte donc à la fois le témoi-gnage de la maladresse et des facultés d’adaptation et de récupération de deux tailleurs sans doute différents.
Le troisième nucléus (M83 7) semi-conique est à plan de pression lisse et incliné du type mixte de V. Léa (2003). Le plan de pression était sans doute plus incliné à l’origine, puisqu’il a été repris par enlèvement d’une tablette après traitement thermique et qu’il reste un lambeau du plan initial mat et rougi à l’arrière du nucléus. Le front d’exploi-tation est convexe, gagnant sur les deux flancs ; la base est plus étroite que le plan supérieur. La table présente les négatifs de lamelles réussies à extrémité distale plu-tôt aigues et les négatifs de deux lamelles rebroussées sur le coté droit. Sur le flanc gauche, une lamelle trouvée dans la tombe a pu être raccordée ; elle correspond à la dernière lamelle tirée de ce nucléus.
Les autres éléments en silex bédoulien de cet ensemble sont neuf lamelles de plein débitage, dont sept brutes plus ou moins complètes, une longue retouchée et un pe-tit fragment proximal. Il est intéressant de noter que trois des lamelles brutes se raccordent entre elles et sont pro-bablement issues du nucléus M83 7. La série comporte aussi deux armatures de projectile, qui sont des trapèzes obtenus par troncatures à retouches abruptes directes.
L’outillage en os figurant dans cette dotation comporte quatre poinçons sur hémi-métapodes de caprinés et les fragments de deux ciseaux sur métapodes de bovins.
Les éléments de parure sont des perles de colliers. Celles en variscite sont au nombre de 64 et regroupent divers types en tonnelet, cylindriques ou discoïdes, qui sont interprétées comme formant un seul élément. Le second collier comportait 241 perles cylindriques en corail rouge. La dotation funéraire comportait aussi 61 fragments de variscite irréguliers, mais pouvant pré-senter des facettes polies qui forment une probable provision de matériau pour la fabrication de perles dis-coïdes ou de plaquettes. Ce dépôt indique que le sujet inhumé avait dû prendre part à l’exploitation minière et à la fabrication de parures.
DEUXIÈME PARTIE
896 Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
Le mobilier céramique était représenté par un vase à bou-che quadrangulaire, muni d’une petite anse tubulaire sur le haut d’une des parois. Parmi les tessons trouvés dans les remblais de la mine se trouve un bord de coupe à deux sillons internes, de style Chasséen méridional classique.
Le mobilier funéraire de la mine 83 de Gavà est tout à fait typique de la culture des « Sepulcres de fossa » dans son faciès du Vallès ou Vallèsien. Il présente des similitudes notamment avec le mobilier de plusieurs tombes de la né-cropole de Can Gambús-1 à Sabadell. Dans cette nécropole, des dotations semblables (avec plusieurs nucléus et des lamelles de silex bédoulien chauffé, des colliers de varis-cite, des vases à bouche quadrangulaire, des trapèzes et des outils en os et même quelques pièces d’obsidienne) sont attestées dans les mobiliers des tombes de type 3a à fosse sépulcrale centrée dans l’avant-fosse ou de type 4a à fosse polaire ou légèrement décalée et en partie sous-cavée par rapport à l’avant-fosse. Ces types sont attribués à l’étape classique de la culture des tombes en fosse et présentent des éléments importés en provenance du com-plexe chasséen méridional dans son étape classique, placée au premier quart du IVe millénaire. Dans le cas présent, la typologie des nucléus en silex bédoulien et leur traitement thermique systématique, la présence d’obsidienne sarde et la présence d’un fragment de coupe en calotte à deux sillons internes sont des indicateurs qui montrent un paral-lélisme avec le style audois d’Auriac ou avec le style hé-raultais de Lattes, qui sont les plus représentatifs de cette étape dans le Midi de la France.
La datation radiométrique obtenue à partir de charbons de bois de la mine 83 est difficilement utilisable en raison de son très grand écart-type, qui couvre pratiquement tout le Néolithique moyen : Beta 155686 : 5222 ± 110, soit 4320-3780 av. J.-C. à 2 sigmas ; toutefois la fourchette de probabilité maximale à un sigma 4220-3950 av. J.-C. se positionne en partie dans le créneau envisagé. Dans la mesure où elle concerne un charbon pris dans le remblai de la mine dont l’exploitation est antérieure à l’utilisation funéraire, ce décalage n’est pas surprenant.
3. 15. Le dépôt d’objets de la Mine de variscite 85 de Can Badosa, Gavà (Baix Llobregat, Barcelona)
C’est à l’extrémité d’une galerie d’exploitation que ce dé-pôt de matériel a été découvert, posé sur le sol. Il s’agit d’une concentration d’objets intacts, de nature diverse. La céramique est représentée par deux gobelets à col rentrant concave, un muni d’anses en ruban, l’autre de deux lan-guettes à trois perforations verticales. L’industrie osseuse est représentée par 84 outils et fragments, soit environ 69 poinçons, 5 spatules et des fragments ou pièces en cours de fabrication. La parure en matières dures animales est représentée par 79 dentales et un fragment de canine infé-rieure de suidé. La parure minérale comprend 21 éléments perforés (perles, pendentifs, appliques) et 67 éléments non perforés, plaquettes polies et fragments divers. L’industrie lithique taillée est représentée par une lame et trois lamel-les en silex bédoulien chauffé, dont une retouchée, et par trois armatures perçantes pédonculées, dont deux en silex bédoulien et une en silex rubané de type Los Monegros. L’outillage en pierre polie comporte deux pièces, une lame sub-triangulaire allongée en schiste (cassée et repolie de façon sommaire) et une petite lame trapézoïdale à section sub-rectangulaire. Cette dernière mesure 5,1cm de long, 4 cm de large et 0,9 cm d’épaisseur et a été réalisée dans une roche saccharoïde de couleur vert moyen, à structure étirée.
L’analyse spectroradiométrique à permis de montrer qu’il s’agissait d’une éclogite rétromorphosée, ce que confirme une densité de 3,46. Il s’agit très probablement d’une roche d’origine alpine (voir annexe 1).
Ce lot de matériel hétéroclite évoque évidemment une riche dotation funéraire d’une sépulture qui aurait pu se trouver dans la partie détruite de la galerie, mais aucune trace d’os humain n’a été détectée dans la partie conser-vée. Il pourrait s’agir d’une cachette de matériel ou d’un dépôt votif (Bosch et Borrell 2009). Le style de l’industrie lithique en silex bédoulien chauffé et les céramiques per-mettent d’attribuer cet ensemble à l’étape classique de la culture des « Sepulcres de fosa », soit au premier quart du IVe millénaire.
• 4. Les haches polies alpines dans les dotations funéraires de Lleida (haut bassin du Sègre et Andorre)
Cette région située au nord-ouest de la Catalogne est bien connue pour sa haute concentration de tombes à dalles du Néolithique moyen, qui appartiennent au groupe Solsonien. Ces tombes à dalles ne forment pas un groupe homogène sur le plan architectural, puisque certaines sont des cistes (fermeture par le haut), alors que d’autres sont des « cam-bras » à ouverture frontale et utilisation parfois plurielle (Cas-tany 1992). Les mobiliers trouvés dans ces tombes relèvent pour la plupart de la culture des « Sepulcres de fossa », mais il se pourrait que la tradition de ces tombes à dalles dé-bute plus tôt, si l’on se fie à la ciste de Segudet en Andorre (Yáñez et al. 2002), qui a livré un vase de style Néolithique moyen I, ou aux grands tumulus de la zone de Tavertet en Osona (Barcelona) qui ont livré du mobilier Montbolo (Cruel-ls et al. 1992). Les examens de haches que nous avons pu faire dans cette région ont été assez limités.
4. 1. Les haches polies du Musée de Solsona (Solsonés, Lleida)
Le musée diocésain de Solsona est celui qui recèle la majorité des collections de mobilier provenant des tom-bes à dalles du groupe Solsonien. Nous avons examiné ces séries qui ne comportent que des haches en roches pyrénéennes (cornéennes et amphibolites calciques). C’est dans les collections anciennes, qui regroupent de nombreuses trouvailles isolées de la région, que l’on a pu reconnaître deux pièces en roches importées.
La première est une petite lame de forme trapézoïdale, à tran-chant rectiligne oblique avec les bords dressés. Elle présente sur un coté des traces de taille à partir d’une arête. Elle a été façonnée par polissage dans une roche siliceuse de couleur gris-vert que nous reconnaissons, à l’œil nu, comme une ci-nérite provenant de Réquista en Aveyron (France) (fig. 4, n° 2).
La seconde hache est de grand format. Elle est allongée et massive avec un tranchant peu convexe et des bords arqués convergent vers un talon qui n’est pas conservé, mais qui a pu être pointu. Elle mesure « 19,6 cm » de long (en fait autour de 21,5 cm avant cassure du talon), 6,8 cm de large et 4,4 cm d’épaisseur. Sa section est elliptique épaisse avec les bords légèrement aplanis ne formant pas d’arêtes longitudinales bien nettes (fig. 4, n° 4), ce qui la rapproche du type Chelles court. Elle a été réalisée dans une roche à grain fin pratiquement noire sans grenats visi-bles. Elle présente un poli poussé de niveau 4 sur les faces, qui sont luisantes, et moins accentué sur les côtés. Sans analyse, il n’est pas possible de dire si la roche est d’ori-gine alpine, mais c’est une possibilité à prendre en compte.
DEUXIÈME PARTIE
897Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
Jade Grandes haches alpines du Néolithique européen Ve et IVe millénaires av. J.-C.
4. 2. Les sépultures de la Feixa del Moro, Juberri (Andorre)
Ce petit groupe funéraire néolithique a été découvert for-tuitement ; il a fait l’objet d’une fouille préventive entre 1983 et 1985, qui a révélé la présence de trois tombes en ciste et d’un niveau d’habitat caractérisé par des cu-vettes de combustion empierrées et des épandages de mobilier (Llovera 1986, Llovera 1992, Llovera et Canturri 1985, Llovera et Colomer 1989). Dans les diverses uni-tés stratigraphiques, le matériel ne paraît pas homogène. Les témoins recueillis dans le sol d’habitat, notamment les céramiques munies de grosses anses et de cordons ou de crêtes en relief, sont caractéristiques du début du Néolithique moyen, tandis que les tombes ont livré des éléments typiques de l’étape classique de la culture des « Sepulcres de fossa ». Les datations au radiocarbone confirment un décalage de l’ordre de trois siècles entre les deux occupations des lieux.
Les trois tombes en ciste de la Feixa del Moro ont livré des haches polies qui constituent cependant des lots inégaux. La ciste 3, qui contenait les restes d’une femme et d’un enfant, n’a livré qu’une petite lame de hache, tandis que les cistes 1 et 2, qui contenaient des hommes adultes, ont livré respectivement 8 et 5 lames de pierre polie. Les photographies publiées de ces mobiliers funéraires comportent des lames en roches de couleur vert foncé et de texture grenue qui nous ont paru pouvoir être en roches alpines. Ces tombes comportent aussi des exemplaires de grande taille, de morphologie semblable à des modèles ty-piquement alpins, ce qui nous a incité à demander à les examiner. Lors de la mission au Service « del Patrimoni arqueologic d’Andorra », il est apparu qu’on ne pouvait accéder qu’à quelques-unes de ces piè-ces, certaines étant toujours chez les inventeurs du site qui ont fouillé la ciste 1, et d’autres immobilisées dans une exposition.
En fin de compte grâce à l’amabilité de X. Maese, nous avons pu examiner et photographier deux lames en pierre polie de la ciste 1, trois lames polies de la ciste 2 et la seule lame polie de la ciste 3.
Les pièces de la ciste 1 ne correspondent pas aux la-mes en roches de couleur vert foncé des publications (Llovera et Colomer 1989). La première est de facture assez grossière et de forme trapézoïdale, avec des pla-ges et bords bruts de cassure. Elle est en roche noire légèrement litée à cassure conchoïdale, avec des tra-ces de cristaux blancs altérés et pourrait correspondre à une phtanite locale (fig. 11, n° 1). La seconde est plus intéressante en raison de sa grande taille et de sa forme. Il s’agit d’une lame de forme allongée à tranchant peu convexe et bords arqués, qui convergent vers un talon arrondi. Elle fait partie du groupe des grandes haches, puisqu’elle mesure 16,2 cm de long, 4,8 cm de large et 3,1 cm d’épaisseur. Sa section est elliptique moyenne et son polissage est poussé en partie médio-distale, la zone du talon étant entièrement bouchardée. Il s’agit d’une hache qui peut être classée dans le type Chelles (fig. 11, n° 5). La roche est vert pâle opaque ; en surfa-ce, on note des vacuoles dues à la dissolution de cris-taux blancs qui sont partiellement conservés. A l’œil nu, cette roche paraît différente des roches alpines ha-bituelles ; il pourrait s’agir d’une imitation de type alpin
dans une roche dont la nature (pyroxénite ?) et l’origine restent à déterminer.
Les pièces provenant de la ciste 2 comportent deux pe-tites lames trapézoïdales peu épaisses en roches fines à poli luisant. La première, blanche et nacrée à passées vertes et rouille, est une fibrolite (gneiss à sillimanite) (fig. 11, n° 2). La seconde, d’aspect cireux et de couleur brun verdâtre (olivâtre), est probablement une néphrite, d’un type fréquent dans les assemblages chasséens du bassin de l’Aude (fig. 11, n° 3). La troisième pièce de cette tombe est une grande lame de hache de forme triangulaire allongée, à tranchant peu convexe et bords arqués qui convergent vers un talon conique. Elle est à section elliptique moyenne et présente un polissage total de niveau 4. Sa forme correspond au type alpin Chelles long. Elle mesure 20,6 cm de long, 5,1 cm de large au tranchant et 3,25 cm d’épaisseur (fig. 11, n° 6). La roche est de couleur vert pâle opaque, avec des tra-ces de cristaux blancs altérés ayant laissé des trous par dissolution. Cette roche est identique à celle de la hache de la ciste 1. Il s’agit probablement d’une imitation d’un type alpin, dans une roche dont la nature (pyroxénite ?) et l’origine restent à déterminer.
La seule lame polie trouvée dans la ciste 3 est une pe-tite lame trapézoïdale peu épaisse à bords droit (fig. 11, n° 4). Elle est en roche à grain fin de couleur vert pâle translucide.
Les trois tombes du groupe de Feixa del Moro corres-pondent à des structures en creux contenant des tombes construites en dalles parfaitement agencées, puisqu’elles n’étaient pas totalement colmatées. La forme des fosses n’a pas été indiquée sur les plans publiés, mais les plans des appareillages de dalles suggèrent qu’il s’agissait plu-tôt de cistes que de chambres.
Dans la ciste 1, la datation obtenue sur os humain est difficilement utilisable vu son grand écart type (Télédyne Westwood 4930 ± 170, soit 3940 à 3375 av. J.-C.), même si elle indique un positionnement au IVe millénaire. Le mo-bilier associé aux haches est plus significatif. La tombe 1, ouverte depuis longtemps, contenait outre les huit lames de haches polies, une perle cylindrique en variscite et qua-tre pièces en silex blond bédoulien chauffé, soit un frag-ment mésio-distal de lame et trois fragments de lamelles brutes. La tombe 2, outre les cinq lames en pierre polie, a livré un collier de 58 perles cylindriques et discoïdes en variscite, ainsi qu’une parure de genou de 19 perles en va-riscite, un lot de trente poinçons sur métapodes et deux lamelles en silex blond bédoulien, une brute et l’autre re-touchée. La tombe 3 a livré, en plus de la hache, une quin-zaine de poinçons sur métapodes, une aiguille en os, deux pendentifs sur lamelles d’os et un autre sur dent de suidé, un bracelet de 13 perles en variscite, ainsi que deux pièces en silex blond bédoulien chauffé (une lamelle de plein débi-tage brute et une autre lamelle transformée en mèche par retouches abruptes bilatérales).
Il s’agit d’éléments qu’on trouve surtout dans l’étape classique du Chasséen méridional ou dans l’étape clas-sique de la culture des « Sepulcres de fossa », soit dans le premier quart du IVe millénaire. Dans les éta-pes plus récentes de ces deux complexes culturels, les perles en variscite sont plus rares ou absentes et en Catalogne, le silex bédoulien fait place alors à d’autres variétés provenant du sud (bassin de l’Ebre et Priorat).
DEUXIÈME PARTIE
898 Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
FIG. 11Haches polies des cistes de la nécropole de Feixa del Moro, Juberri (Principauté d’Andorre). N° 1 : hache en phtanite de la ciste 1, n° 2 : petite hache en fibrolite de la ciste 2, n° 3 : petite hache en amphibolite calcique de la ciste 2, n° 4 : petite hache en roche verte indéterminée de la ciste 3, n° 5 : grande hache de type Chelles en roche verte (pyroxénite ?) de la ciste 1, n° 6 : grande hache de type Chelles en roche verte (pyroxénite ?) de la ciste 2.Service du patrimoine d’Andorre, photos et DAO J. Vaquer.
DEUXIÈME PARTIE
899Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
Jade Grandes haches alpines du Néolithique européen Ve et IVe millénaires av. J.-C.
• 5. Les haches polies alpines dans les dotations funéraires de la province de Tarragona (Baix Camp)
Pour cette zone du sud de la Catalogne, ce sont des photographies publiées en noir et blanc dans l’ouvrage « Reus y su entorno en la Prehistoria » de S. Vilaseca (1973 : pl. 50) qui avaient attiré notre attention et nous ont incité à réaliser une mission (A. Martín et J. Vaquer). Grâce à l’amabilité de M. Jaume Massó, directeur du musée Salvador Vilaseca de Reus, nous avons pu voir près d’une centaine de haches polies trouvées ancien-nement dans la région. La très grande majorité des pièces examinées sont en cornéenne et plusieurs sont des ébauches sur galets, ce qui indique sûrement une production locale de cette composante. Les haches en roches exogènes forment plusieurs groupes, dont un en fibrolite/sillimanite, comporte une hache perforée de type Cangas provenant de la commune de Colldejou. Parmi les autres, on note une petite lame de forme trapézoïdale à tranchant convexe et section elliptique peu épaisse, qui a été réalisée dans une roche grenue de couleur vert foncé paraissant être une éclogite. Elle porte le n° 4816 et provient de la commune de Capafonts (fig. 12, n° 1) ; il pourrait s’agir de l’exportation alpine située la plus au sud outre Pyrénées. La grande hache à bords équarris qui avait attiré notre attention en raison de son apparte-nance au type Puy, n’est pas en roche éclogitique. Elle porte le n° 4858 et provient de Mas del Poldo à El Molar (Tarragona, Catalunya, Espagne). Il s’agit d’une grande lame à tranchant peu convexe et à bords dressés, avec arêtes vives arquées qui convergent vers un talon poin-tu. Elle mesure 21,9 cm de long, 6,8 cm au tranchant et 4,1 cm d’épaisseur. Sur une des faces près du talon, subsiste une surface d’éclatement du bloc support qui est en roche fibreuse très fine de couleur brun olivâtre (fig. 12, nº 3). Cette roche est semblable aux grands ci-seaux provenant des Corbières, conservés au Musée de Narbonne et déterminés par M. Ricq -de Bouard comme étant en amphibolite calcique (néphrite). Cette pièce se-rait donc une imitation de type alpin, probablement réa-lisée dans un atelier nord-pyrénéen. Une autre lame de hache, bien qu’abîmée par des cassures au tranchant et au talon, mérite d’être mentionnée car elle présente sur un bord une nette rainure de sciage. Elle porte le n° 4860 et est marqué Sorteta, ce qui correspond au nom d’une ferme dans la commune de Reus. Dans son état actuel, la pièce mesure 11,3 cm de long, 5,7 cm de large et 2,9 cm d’épaisseur, mais elle a pu mesurer près de 14 cm à l’origine, ce qui permet de la classer dans le groupe des grandes haches (fig. 12, n° 2). D’après ce qu’il en reste, on peut affirmer qu’elle avait probablement une forme trapézoïdale et des bords dressés à arêtes marquées, ré-sultant d’un polissage n’ayant pas totalement effacé les traces de sciage. Ce serait donc une autre hache de type Puy. La roche utilisée est de couleur gris bleuté à texture fibreuse ; c’est probablement une amphibolite calcique. Cette hache serait donc, elle aussi, une imitation du type alpin Puy réalisée dans une roche pyrénéenne.
• 6. Discussion
En l’état actuel des connaissances (fig. 13), il demeure difficile de comparer les rôles joués par les haches en roches alpines sur les deux versants de la chaîne pyré-néenne tout au long du Néolithique. Les examens réali-sés dans le cadre de cette étude apportent tout de même quelques éléments de discussion.
Au sujet des petites haches dans les tombes
En ce qui concerne la diffusion vers le sud-ouest des haches de travail en roches alpines (L inférieure à 13,5 cm), on sait, grâce à M. Ricq -de Bouard (1996), que les productions des Alpes internes (éclogites, omphacitites et jadéitites) sont rares à l’ouest du Rhône au Néolithique ancien, fréquentes au Néolithique moyen I, puis soumises à des concurren-ces de roches siliceuses (cinérite et silex du Bergeracois) au Néolithique moyen II et au Néolithique final. Dans tout le Languedoc méditerranéen occidental, les productions de haches sont dominées par les amphibolites calciques d’origine pyrénéenne (hauts bassins de l’Aude et de l’Ariè-ge) tout au long du Néolithique. La situation est différente dans le bassin de la Garonne, où la composante lourde en outillages taillés et polis est très largement dominée par les outillages sur galets de cornéennes, schistes tachetés, quartzites et métagrauwacke. Les pièces de provenance exogène (sillimanite, amphibolite calcique et roches alpines) sont attestées au Chasséen ancien, mais elles y sont rares. Ce n’est qu’à partir du Chasséen classique et récent que l’on rencontre des importations limitées en silex du Berge-racois, en cinérite de Réquista et en métabasite tarnaise. En Catalogne, les informations disponibles indiquent une utili-sation notable de chloritoschistes, schistes amphibolitiques et amphibolites dès le Néolithique ancien, notamment à la Draga (Banyoles, Pla de l’Estany, Girona) d’après les déter-minations de Clop, Alvarez et Reche (2000), ce que confir-ment les rares pièces de cette période que nous avons pu analyser (Cova del Frare, caserna Sant Pau del Camp). Cette utilisation des amphibolites calciques s’est poursuivie en-suite jusqu’à la fin du Néolithique. En Catalogne, les roches les plus utilisées pour les outillages polis communs sont les cornéennes et les schistes tachetés durant tout le Néolithi-que. Ils représentent l’essentiel de la production régionale bien documentée par plusieurs ateliers situés en Andorre et en aval dans la vallée du Segre. Quelques éléments exogè-nes ont été signalés, notamment des pièces en sillimanite provenant probablement d’autres régions de la péninsule Ibérique et de rares pièces en jadéitite alpine qui figurent notamment dans des dotations funéraires particulièrement riches des « Sepulcres de fossa ».
Notre enquête peut difficilement retenir des indications quantitatives, dans la mesure où elle n’a pas été régie par une procédure d’échantillonnage systématique, mais a porté sur des séries sélectionnées dans lesquelles nous suspections la présence de productions alpines. Elle ré-vèle pourtant que les dotations funéraires du Midi de la France, comme celles de la Catalogne, recèlent des piè-ces d’outillage en pierre polie de petite dimension, qui ne diffèrent pas typologiquement des outils de travail trou-vés sur les habitats.
Dans le Midi de la France, les pièces disponibles - qu’elles soient d’origine alpine ou d’origine locale - ne nous sem-blent pas différer des outils polis trouvées en contexte d’habitat. En Catalogne par contre, les séries que nous avons étudiées semblent comporter des éléments dis-tincts de ceux trouvés habituellement sur les habitats. Comme l’ont montré plusieurs auteurs (Bosch 1984, Al-varez Perez 1993, Risch et Martinez Fernandez 2008), les séries provenant des habitats sont largement dominées par les outils polis sur cornéenne et schistes tachetés, alors que les séries des tombes et des nécropoles catala-nes que nous avons examinées donnent une image tout à fait différente.
DEUXIÈME PARTIE
900 Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
FIG. 12Haches polies en roches tenaces du musée S. Vilaseca de Reus, Tarragona (Catalogne, Espagne). N° 1 : hache en éclogite de Capafonts (Tarragona), n° 2 : grande hache à bord scié de Sorteta, Reus (Tarragona), n° 3 : grande hache de type Puy en amphibolite calcique (néphrite) de Mas del Poldo, El Molar (Tarragona).Museu Salvador Vilaseca de Reus, photo et DAO J. Vaquer.
A la Caserna Sant Pau del Camp, seule série funéraire dis-ponible qui soit attribuable au Néolithique moyen I, une pièce sur les trois attestées est en jadéitite. Elle semble indiquer que le choix de pièces de provenance lointaine était déjà en vigueur pour honorer certains défunts à la fin du Ve millénaire avant notre ère.
Si l’on cumule les pièces des séries du Néolithique moyen II, il apparaît que les petites haches polies (de longueur in-férieure à 13,5 cm) déposées dans les sépultures ne sont pas en cornéenne. Les pièces déposées dans ces do-tations funéraires étaient donc sélectionnées selon des critères qui excluaient les exemplaires le plus communs dans l’usage fonctionnel. Le classement par matériaux (fig. 14) fait apparaître d’autres roches.
Certaines de ces roches sont rarement attestées dans l’outillage poli. Il s’agit de trois pièces en calcaire ou en
marbre de deux tombes de la nécropole de Can Gambus-1. C’est une roche peu résistante aux chocs mais qui présente un beau poli ; les trois exemplaires ont un aspect semblable, blanc légèrement rosé et pourraient avoir la même origine. Les éléments de comparaison pour ce genre de production sont rares, on peut citer tout de même un exemplaire consi-déré comme « votif » de la grotte du Poteau à Saint-Pons (Hérault). Une origine pyrénéenne au sens large ou langue-docienne est envisageable pour ces pièces.
Les haches en schiste (chloritoschiste, schiste à glauco-phane) ou en phtanite sont relativement banales et peuvent correspondre aux productions d’outils courants de la zone pyrénéenne au sens large. Une origine plus lointaine des ro-ches à glaucophane a été envisagée par M. Ricq -de Bouard (1996) pour les outils en glaucophanite du Languedoc qui proviendraient toutes du bassin alluvial de la Durance.
DEUXIÈME PARTIE
901Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
Jade Grandes haches alpines du Néolithique européen Ve et IVe millénaires av. J.-C.
FIG. 13Carte de répartition des trouvailles de haches en roches d’origine alpine sur le versant méridional des Pyrénées.
Grandes haches en roches alpines déterminées : N° 1 : ciste de La Bisbal d’Empordà, une de type Puy long en omphacitite, n° 2 : Bòbila Bellsolà, Santa Perpètua de la Mogoda, une de type Puy court en amphibolite
calcique valaisanne, n° 3 : Bòbila Padró, Ripollet, une de type Puy court en jadéitite, n° 4 : tombe M5 de Bòbila Madurell, Sant Quirze del Vallès, une de type Puy court en jadéitite, n° 5 : nécropole de Can Gambús-1, Sabadell, une de type Puy en néphrite et une de type Chelles en éclogite, n° 6 : Collbató (une de
type Tumiac en jadéitite), n° 7 : Mine 83 de Can Badosa, Gavà, une hors typologie en éclogite, n° 8 : Sadaba (Aragón) : une de type Pauilhac en éclogite.
Grandes haches de types alpins en roches indéterminées (importations possibles ou imitations) : N° 3 : Bòbila Padró, Ripollet, une de type Chelles en roche indéterminée, n° 9 : tombe en fosse de Bòbila d’en Joca, Montornès del Vallès : deux longs ciseaux
de type Chamoson en micro-diorite ( ?), n° 10 : musée de Solsona, une de type Chelles en roche indéterminée, n° 11 : cistes de Feixa del Moro, Juberri Andorre, deux haches de type Chelles en pyroxénite ?, n° 12 : Sorteta, Reus : hache de type Puy en amphibolite calcique, n° 13 : Mas del Poldo, El Molar hache de type
Puy long en néphrite.
Petites haches en roches alpines :N° 3 : Bòbila Padró, Ripollet, un talon de petite hache en éclogite, n° 4 : tombe G10.7 de Bòbila Madurell, Sant Quirze del Vallès, une petite en serpentinite, n° 5 : nécropole de Can Gambús-1, Sabadell, tombe E162 : une petite en jadéitite et tombe E 70 : une petite en omphacitite, n° 7 : Mine 83 de Can Badosa,
Gavà, trois petites, deux en éclogite et une en jadéitite, et mine 85 : une petite en éclogite, n° 9 : tombe en fosse de Bòbila d’en Joca, Montornès del Vallès : trois petites haches (une omphacitite et deux en jadéitite), n° 14 : Cardona : une petite en jadéitite, n° 15 : Santa Eulàlia de Ronçana, un fragment de tranchant
en éclogite, n° 16 : Sant Pau del Camp, Barcelona : une petite en jadéitite, n° 17 : Bòbila d’en Sallent, Cerdanyola : une petite en jadéitite, Sant Joan Despí : une petite en pyroxénite calcique, n° 18 : Capafonts : une petite en éclogite.
Cartographie J. Vaquer.
La présence d’outils polis en fibrolite (gneiss à sillimanite) en faible nombre correspond à la réalité de nombreuses collections du nord et du sud des Pyrénées. Des outils en fibrolite de production locale sont connus aussi bien en France, notamment en Bretagne et en Auvergne qu’en Es-pagne où existent des affleurements présentant de gros nodules de sillimanite (Centre et Sud). Les référentiels ne sont pas suffisamment détaillés pour établir des liaisons entre les affleurements connus et les séries d’outils. C’est donc la règle de l’approvisionnement aux gisements les plus proches qu’il faut retenir pour ce matériau.
La présence d’une hache en cinérite siliceuse de Réquista dans la dotation funéraire de la sépulture de Bòbila d’en Joca offre un cas de relation sûre entre un gisement de matière première bien déterminée et un contexte de dé-pôt précis (Servelle et Vaquer 2000). La distance d’ache-minement de cette pièce est de l’ordre de 300 km à vol d’oiseau. On peut envisager que la pièce a été transmise par l’intermédiaire des Chasséens du Languedoc occidental
(style d’Auriac) qui faisaient usage à la fois de haches en cinérite rouergate et de variscite de Gavà.
L’exemplaire en serpentinite de la Bòbila Madurell et celui en pyroxénite de Sant Joan Despí sont plus délicats à in-terpréter. Il s’agit de roches métamorphiques qui existent dans plusieurs massifs en affleurements réduits, mais qui n’ont pas donné lieu partout à des exploitations importan-tes pour les outillages polis. Leur rôle est notable dans le domaine alpin occidental qui pourrait être la zone source des rares exemplaires diffusés vers les Pyrénées.
Le rôle de l’amphibolite calcique et notamment de la néphrite (trémolitite) est important dans les séries exa-minées. Ce n’est pas étonnant puisque cette roche existe en affleurements dans le domaine pyrénéen nord-occidental (Aude-Ariège) et qu’elle a été intensément exploitée et diffusée tout au long du Néolithique. Une origine nord-pyrénéenne doit être envisagée pour la ma-jorité des pièces en amphibolite calcique. Ce qui ferait des distances d’acheminement de l’ordre de 150 km.
DEUXIÈME PARTIE
902 Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
Toutefois dans la mesure où quelques importations de gran-des haches en néphrite du Valais (cf. Les Haudères) sont attestées, on ne peut pas exclure que quelques haches en néphrite alpine aient circulé aussi jusqu’en Catalogne (soit une distance d’acheminement de l’ordre de 920 km).
Le rôle de l’amphibolite calcique et notamment de la néphrite (trémolitite) est important dans les séries exami-nées. Ce n’est pas étonnant puisque cette roche existe en affleurements dans le domaine pyrénéen nord-occidental (Aude-Ariège) et qu’elle a été intensément exploitée et diffusée tout au long du Néolithique. Une origine nord-pyrénéenne doit être envisagée pour la majorité des piè-ces en amphibolite calcique. Ce qui ferait des distances d’acheminement de l’ordre de 150 km. Toutefois dans la mesure où quelques importations de grandes haches en néphrite du Valais (cf. Les Haudères) sont attestées, on ne peut pas exclure que quelques haches en néphrite alpine aient circulé aussi jusqu’en Catalogne (soit une dis-tance d’acheminement de l’ordre de 920 km).
Si l’on cumule les attestations de roches alpines, celles-ci viennent au premier rang avec 20,4 %, une situation qui ne reflète pas véritablement la proportion des roches alpines de l’ensemble des haches polies déposées dans les tombes de la culture des «Sepulcres de fossa », mais seulement de celles déposées dans les plus riches où elles peuvent figurer à plusieurs exemplaires. Il s’agit à l’évidence de biens précieux sacrifiés en l’honneur de dé-funts particulièrement distingués. La proportion notable de jadéitite au sein de ces roches alpines renforce cette impression, puisque cette roche est beaucoup plus rare que les éclogites dans les affleurements du Mont Viso. Pour toutes ces haches, les distances d’acheminement sont de l’ordre de 630 km à vol d’oiseau.
A propos des grandes haches en Catalogne
La concentration de grandes haches liée aux ensembles funéraires de la culture des « sepulcres de fosa » catalans
est originale à plus d’un titre (fig. 15). Elle présente une diversité typologique beaucoup plus faible que celle du Midi de la France où l’on rencontre à la fois les types du Néolithique ancien et du Néolithique moyen I et II (dans cet ouvrage, p. 574).
Si l’on se réfère aux données chrono-typologiques euro-péennes du programme Jade (Pétrequin et al. 2002), une seule grande hache appartiendrait soit à l’étape B, soit à l’étape C (4300-4100). Il s’agit de la hache de Collbató qui peut-être classée soit dans le type Greenlaw repolie, soit dans le type Tumiac non perforé et qui appartient en tout cas au groupe carnacéen. Malheureusement elle est privée de contexte. Elle pourrait être le seul témoin d’un contact nord sud avec l’Armorique, en réciprocité possi-ble à la diffusion de la variscite de Gavà vers la Bretagne au Néolithique moyen I (Herbaut et Querré 2004).
Cinq grandes haches catalanes appartiennent au type Chelles (trois au sous-type court et deux au sous-type long). L’emploi d’une éclogite alpine est avéré dans un cas (Can Gambús-1 E167). Dans d’autres cas, les roches sont indéterminées et des imitations en autres roches sont plausibles. La chronologie de ce type est considérée comme assez longue, ce que confirme le cas de la Bòbila Padró où la contemporanéité stricte est attestée avec le type Puy. Les autres contextes disponibles indiquent une datation dans le premier quart du IVe millénaire.
Le type Puy à bords bien équarris est attesté par sept exemplaires (dont deux d’une longueur supérieure à 20 cm). Trois sont en jadéitite ou omphacitite du Viso, deux en néphrite possiblement alpine (Valais ?). Une autre est en néphrite olivâtre probablement des Pyrénées et une en amphibolite calcique des Pyrénées. Le morphotype alpin sans doute dérivé des productions de haches en cuivre du Chalcolithique ancien a fortement influencé non seule-ment les ateliers alpins du Viso, mais aussi les autres ate-liers qui imitaient les modèles alpins pour des productions
FIG. 14Types de roches des haches « de travail » analysées faisant partie des dotations funéraires du Néolithique moyen II de Catalogne (« Sepulcres de fosa » étape classique : 4000-3850 av. J.-C.).
DEUXIÈME PARTIE
903Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
Jade Grandes haches alpines du Néolithique européen Ve et IVe millénaires av. J.-C.
en roches tenaces sciées. Le type Pauilhac qui ex-prime lui aussi des relations avec le Chalcolithique ancien n’est pas attesté en Catalogne, alors qu’il est bien représenté dans la zone nord pyrénéenne. Sa présence au sud de la chaîne pyrénéenne ne saurait être tenue pour impossible, puisqu’un exemplaire est connu en Aragon à Sadaba (listing général des gran-des haches, JADE 2008_1616)
De longs ciseaux étroits sont connus dans les dotations de plusieurs sépultures appartenant au faciès du Vallès ou au faciès solsonien. Ces pièces ne semblent pas former un groupe homogène. Les deux très longs exemplaires de Bòbila d’en Joca qui seraient en « micro-diorite » pré-sentent de très nettes rainures de sciage qui ont été lais-sées brutes. Cet aspect les rapproche de plusieurs autres longs ciseaux connus en Europe occidentale qui sont en amphibolite calcique ou en néphrite. Parmi ceux-ci figure l’exemplaire de Chamoson (Valais, Suisse) ou les deux longs ciseaux des Corbières conservés au Musée de Nar-bonne. Si l’on classe ces spécimens dans le type Bernon, il faut admettre que ce type a eu une grande longévité, au moins jusqu’au premier quart du IVe millénaire. D’autres ciseaux, parfois qualifiés « de piques », sont très étroits et totalement façonnés, à section elliptique ou sub-circu-laire. Ils sont en roches pyrénéennes (cornéennes et schis-tes tachetés) et correspondent à des productions locales qui ne sont pas obligatoirement des imitations de types alpins. On peut les rattacher au type Lagor qui forme un groupe pyrénéen et ibérique et qui pourrait avoir eu une grande longévité dans cette zone du sud-ouest européen, puisqu’il débute au Néolithique moyen I (habitat de Juberri en Andorre) et existe encore dans les tombes du premier quart du IVe millénaire (Pétrequin et al. 2007b).
Des manipulateurs de richesses
L’intérêt principal de la documentation catalane est de
livrer plusieurs ensembles funéraires bien documentés, comportant des grandes haches alpines ou leurs imita-tions. Cette région offre l’opportunité, rare à l’échelle européenne, de pouvoir cerner le statut des personnes qui ont possédé de tels biens et qui ont pu les emporter dans leur tombe (fig. 16).
L’identification biologique des défunts qui possédaient des grandes haches dans leur équipement funéraire n’a pas toujours pu être établie pour diverses raisons, tenant à l’état de conservation ou aux méthodes de fouilles. Sur les dix tombes retenues, trois n’ont pas livré de restes déterminables et les autres ont livré des ossements d’adultes. Dans un cas, malheureusement remanié anciennement, un adulte était accompagné d’un enfant (Bòbilà Madurell M5). Dans les trois cas où la diagnose sexuelle a pu être établie, il s’agit de sujets masculins. On peut donc considérer que les grandes haches étaient essentiellement l’apanage d’adultes masculins. Cette impression est renforcée par la pré-sence d’armatures de flèches dans la moitié des tom-bes. En effet dans les contextes culturels concernés (Vallèsien du complexe catalan des « Sepulcres de fossa » ou Chasséen languedocien), les armatures de flèches ne se trouvent que dans les tombes masculines des types 1 à 4 ce qui ne serait pas toujours le cas pour les haches polies (Gibaja 2003).
L’autre constat important est que les dotations com-portant des grandes haches alpines ou leurs imitations sont parmi les plus riches connues à l’échelle de toute la Catalogne. En effet, hormis les cas de La Bisbal et de la Bòbila Bellsolà qui sont des découvertes fortuites faites par des ouvriers, et qui pourraient de ce fait ne comporter qu’une partie seulement du mobilier initial, les dotations concernées sont exceptionnelles à la fois par la qualité et par la quantité des pièces.
FIG. 15Haches de plus de 13,5 cm de long du Néolithique moyen de la Catalogne, classement par type morphologique et par roche.
DEUXIÈME PARTIE
904 Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
Le critère le plus évident de la richesse de ces dotations concerne la présence d’éléments de parure en variscite, parfois associés à d’autres ornements en matériaux di-vers (corail, coquillage), qui sont attestés dans toutes les tombes bien documentées. Il s’agit évidemment d’objets d’affichage dont la valeur pouvait se mesurer soit au nom-bre de perles, soit à leur forme ou à leur grosseur. Dans ce registre, le collier à plusieurs rangs de grosses perles en variscite de Bòbila Padró est inégalé, tout comme le collier de 241 perles en corail rouge de la mine 83 de Can Badosa à Gavà. Dans cette dotation, le collier de corail représente sans doute la part la plus prisée, puisque les éléments en variscite étaient produits sur place. Ce sont pour moitié des perles finies d’un collier, le reste étant composé de perles en cours de fabrication. Deux sépul-tures se démarquent des autres, car elles n’ont chacune qu’une seule perle en variscite. Toutefois dans le cas de la tombe M5 de Bòbila Madurell, il est manifeste qu’il s’agit d’une tombe remaniée dont la majeure partie du contenu de la fosse a été dispersé dans l’avant fosse, ce qui indique un probable pillage. La ciste 1 de Feixa del Moro était une tombe ouverte dans un talus avant que les inventeurs n’en vident le contenu ; il n’est pas impossible qu’elle ait fait, elle aussi, l’objet de spoliation.
Dans le registre des parures, c’est le collier de corail de Gavà qui peut être considéré comme un bien exotique, même s’il est impossible de préciser son origine. Le corail rouge est ubiquiste dans les zones côtières de la Méditerranée occidentale pourvu qu’il y ait des biotopes favorables (cô-tes rocheuses ou falaises sous-marines). Il peut se trouver à faible profondeur dans les zones nord méditerranéennes avec grottes et surplombs sous-marins. Il est parfois rejeté en petits bouts sur les plages dans ces zones et a pu servir pour quelques parures simples comme des pendeloques. La réalisation de parures à éléments multiples calibrés im-plique une récolte plus systématique, voire une pêche sous-marine. Son utilisation préhistorique est toutefois assez mal documentée, avec des occurrences dès le Néolithique ancien en Ligurie et les débuts du Néolithique moyen en Italie péninsulaire et en Sardaigne, d’où proviennent sans doute les éléments trouvés dans les tombes de type Cham-blandes du domaine nord-alpin (Borrello 2001, Bosch 2009). De ce fait, nous pensons que même si du corail rouge de grande qualité existe sur les côtes provençales et catalanes, on ne peut totalement exclure que le collier de Gavà ne soit pas une importation de l’aire tyrrhénienne.
L’obsidienne présente dans les deux dotations de Bóbila Padró et de la mine 83 de Gavà est un bien dont la pro-venance lointaine ne fait guère de doute. La lamelle de Can Badosa 83 a été analysée et provient de la Source A de Conca Cannas en Sardaigne (Bosch, Gibaja et Gratuze 2009). Le petit nucléus de Bòbila Padró n’est pas analysé, mais il est dans une obsidienne translucide à passées noi-res, qui présente les caractéristiques visuelles de cette source. Ces deux éléments trouvés à près de 1 100 km du gîte de matière première constituent certainement des biens très rares qui étaient sans doute très prisés, bien que leur valeur d’usage soit peu différente de celle du si-lex. En Catalogne, les occurrences d’obsidienne sont peu nombreuses, outre les deux cas déjà cités on connaît aussi deux fragments de lamelles qui proviennent de la sépul-ture MS 17 de La Bòbila Madurell et une lamelle d’une sépulture de la nécropole de Can Gambús-1 (Gibaja et Ter-radas 2008). Il est significatif de constater que toutes les pièces en obsidienne trouvées en Catalogne proviennent de sépultures, ce qui n’est pas le cas dans le Midi de la France où toutes les obsidiennes trouvées proviennent d’habitat. La présence d’un nucléus à Bòbila Padró est tout à fait exceptionnelle, puisque les nucléus sont très rares en dehors des zones où l’obsidienne était une matière pre-mière d’usage courant comme la Sardaigne, la Corse et quelques sites du littoral toscan (Vaquer 2006). Dans tout le Midi de la France, on ne connaît que 32 nucléus, dont 26 sur le seul site des Terres Longues à Trets dans les Bou-ches-du-Rhône qui apparaît comme une place centrale de redistribution de l’obsidienne sarde et probablement aussi du silex bédoulien en Basse Provence (Léa et al. 2010). La forme en tambour, probablement conique à l’origine, du petit nucléus de Bòbila Padró n’est pas sans rappeler celle des petits nucléus de ce site des Terres Longues. De ce fait, il est permis de se demander si les sites provençaux de ce type n’auraient pas servi de relais pour diffuser à la fois de l’obsidienne sarde et du silex blond bédoulien en direction du Languedoc et de la Catalogne.
Le silex blond présent sous forme de nucléus ou de la-melles et d’outils dans les tombes de la culture catalane des « sepulcres de fosa » a été supposé de provenance locale ou régionale par A.-M. Muñoz (1965), ce qui n’a jamais été vérifié par la suite. Les similitudes d’aspect et surtout des paramètres techniques (traitement thermi-que et mise en forme par crête antéro-postérieure pour des nucléus semi-coniques) sont les critères que nous
FIG. 16Classement de quelques tombes catalanes de « la cultura des Sepulcres de fosa » en fonction de la richesse des dotations.
DEUXIÈME PARTIE
905Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
Jade Grandes haches alpines du Néolithique européen Ve et IVe millénaires av. J.-C.
avions retenus pour proposer une origine provençale à ce silex (Martín et Vaquer 1995). Depuis, quelques expertises réalisées J.-F. Gibaja (2003) et quelques examens à la loupe binoculaire réalisés par V. Léa et J. Vaquer sur les séries de Bòbila Madurell, Bòbila d’en Joca et Can Badosa 83 ou sur les séries du musée de Solsona, ont permis de reconnaître les caractères typiques des silex bédouliens du Vaucluse (cortex grenu, silex à grain très fin, cristaux de quartz scin-tillants, présence d’oxydes minéraux noirs et rouges, rares spicules d’éponges). Désormais l’origine provençale du silex blond des « Sepulcres des fossa » est considérée comme évidente pour une majorité de spécialistes (Gibaja et Terra-das 2010). La prétendue spécificité catalane des mises en forme de nucléus « en patte de chèvre » soulignée par cer-tains auteurs (Muñoz 1965, Briois 2005 : 299) n’était fondée que sur une connaissance partielle des formes des nucléus chasséens du Midi ; en effet, ils étaient surtout documen-tés à travers des exemplaires quasiment épuisés trouvés sur les habitats. Depuis que l’on connaît les standards de production des préformes sur les ateliers du Vaucluse (Léa et al. 2007), leur morphologie en quart de sphère ou navi-forme à crête antéro-postérieure paraît moins originale.
On retrouve en fait dans les tombes catalanes des nucléus qui ont été entamés, mais très peu débités. Ils constituent évidemment des biens que l’on ne trouve que très rare-ment sur les sites consommateurs chasséens du midi de la France. Les exemplaires des tombes catalanes que nous avons pu examiner sont beaucoup plus nombreux ; ils correspondent pour la plupart au type « mixte », c’est-à-dire à mise en forme en mitre ou semi-conique avec ouverture d’un plan de pression incliné vers l’arrière (Léa 2003). C’est le principal module volumétrique mis en forme sur les ateliers du Vaucluse ; il n’est donc pas étonnant de le retrouver dans les dotations funéraires catalanes, qui contiennent des éléments d’importation non utilisés ou très peu exploités. Ces nucléus, prépa-rés pour le débitage de lamelles par pression et testés après traitement thermique, devaient avoir une très haute valeur d’échange, tout comme les quelques lames non chauffées qui circulaient en même temps. Dans le Midi méditerranéen de la France entre les Alpes et les Pyrénées et jusqu’à la hauteur de Valence dans le couloir rhodanien, le silex bédoulien blond du Vaucluse, sous ces deux formes, couvrait l’essentiel des besoins en outils tranchants et en en supports d’outils. Il représente souvent plus de 90 % des pièces dans les séries des grands sites d’habitat. Le réseau de diffusion était suffisamment bien organisé pour assurer un approvisionnement quasi exclusif et ca-pillaire dans un rayon d’environ 300 km autour de la zone source (Vaquer et Remicourt 2010). Ce système a fonc-tionné de façon régulière pratiquement pendant toute la première moitié du IVe millénaire sans connaître de crise à l’échelle du Midi de la France. Cette matière première lithique avait assurément un rôle économique fondamen-tal et a dû constituer un facteur de cohésion de la culture chasséenne à cette échelle (Briois et al.1998). Dans les contextes chasséens, ce n’est qu’à partir de 300 km et au-delà que le silex blond bédoulien a été concurrencé par d’autres silex et qu’il a acquis, en plus de sa valeur d’usage technique, le statut de bien précieux figurant en bonne place dans les dotations funéraires les plus riches. En Midi-Pyrénées, des lames sont attestées, notamment dans la riche sépulture A 185 de Saint-Michel-du-Touch et deux lames non chauffées associées à deux nucléus mixtes figurent dans le dépôt (funéraire ?) de la maison
Vignaud à Tournefeuille, Haute-Garonne (Jédikian 2008, Vaquer et al. 2008). Cette utilisation du silex bédoulien comme bien de valeur sacrifié en l’honneur d’un défunt n’est que rarement documentée dans le midi de la France (cas probable de la trouvaille des Pluméjals à Puichéric, Aude), alors qu’elle est relativement courante en Cata-logne où l’on connaît 71 nucléus en silex blond déposés dans une quarantaine de tombes. Leur valeur d’échange devait être très forte dans cette région où la proportion de silex blond par rapport aux autres matériaux utilisés sur les habitats varie entre 9,5 % sur le site de Can Isach, Palau Savardera, Girona et 67,7 % dans les fosses de Bòbila Madurell à Sant Quirze del Vallès, Barcelona (Gi-baja 2003). Cette valeur devait se décliner en fonction de paramètres, tels que la dimension du nucléus ou le nom-bre de ceux-ci. L’unité d’appréciation la plus concrète de ces échanges devait être sans doute la lamelle débitée ou potentiellement débitable. On sait que des lamelles figurent systématiquement en nombre variable dans les sépultures catalanes ; parfois, elles étaient même pro-duites spécialement en petites séries au moment des funérailles, comme le prouvent les remontages de trois à six lamelles obtenus par exemple dans la tombe B6 de la Bòbila Madurell ou dans la tombe de la mine 83 de Can Badosa à Gavà. Lorsque ce sont des nucléus à lamelles qui sont déposés, on peut considérer qu’il s’agit de lots potentiels de lamelles que l’on peut estimer selon les cas à quelques dizaines pour les plus petits, voire à plus d’une centaine pour les plus gros tels ceux de Bòbila d’en Joca ou de Bòbila Padró. Ces dépôts de nucléus en tant que biens patrimoniaux thésaurisés varient aussi en nombre sur une échelle de un à cinq, ce qui augmente considéra-blement la gamme des valeurs de ces dotations. Il paraît très significatif de constater que les tombes qui contien-nent les grandes haches sont aussi celles qui contiennent les plus grands nombre de nucléus en silex bédoulien (fig. 16). La relation entre ces deux catégories de biens précieux est indéniable, au point que ces objets sont très intimement associés dans la plupart des dépôts. A Can Gambús-1, les observations rigoureuses faites sur la dis-position du mobilier dans les tombes indiquent que les nucléus, lorsqu’ils sont par deux ou par trois, sont le plus souvent groupés et intimement associés aux haches, au point qu’il est douteux que celles-ci aient été déposées avec leur manche (cf. tombe 166 où le talon de la grande hache est entouré par trois nucléus, ne laissant aucune place pour le négatif d’un éventuel manche). Il semble donc évident que ces nucléus associés aux grandes ha-ches formaient des dépôts de biens patrimoniaux thésau-risés, qui pouvaient être disposés sur des tablettes ou rangés dans des étuis ou coffrets comme le supposent les fouilleurs de la nécropole (Roig et al. 2010).
Cette revue des diverses catégories de mobilier asso-ciées aux grandes haches alpines ou à leurs imitations révèle qu’elles étaient l’apanage des personnages mas-culins les plus riches et sans doute les plus influents. Ce sont eux qui avaient le pouvoir non seulement d’accumu-ler le plus grand nombre d’objets précieux, mais aussi ceux qui avaient l’origine la plus lointaine. Le caractère exotique de la plupart des biens déposés dans les sé-pultures les plus riches augmente leur rareté et leur confère le statut de bien de prestige dans le contexte catalan. C’est aussi la diversité des biens exotiques qui caractérise les personnages des tombes les plus riches.
DEUXIÈME PARTIE
906 Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
FIG. 17Provenance des éléments exogènes faisant partie de la dotation funéraire de la tombe de Bòbila d’en Joca, Montornès del Vallès, Barcelone (Catalogne, Espagne).DAO J. Vaquer.
FIG. 18Provenance des éléments exogènes faisant partie de la dotation funéraire de la tombe de la mine 83 de Can Badosa à Gavà, Barcelone (Catalogne, Espagne).DAO J. Vaquer.
DEUXIÈME PARTIE
907Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
Jade Grandes haches alpines du Néolithique européen Ve et IVe millénaires av. J.-C.
FIG. 19Provenance des éléments exogènes faisant partie de la dotation funéraire de la tombe rectangulaire de Bòbila Padró à Ripollet, Barcelone (Catalogne, Espagne).
DAO J. Vaquer.
Dans le cas de Bòbila d’en Joca, ce sont les trois haches en jadéitite du Mont Viso qui sont les biens dont l’origine est la plus lointaine (≈ 625 km) ; ils sont suivis par les nucléus en silex bédoulien du Vaucluse (≈ 500 km), puis par la hache en cinérite de Réquista, Aveyron (300 km) et par les pièces en amphibolite calcique ou en micro-diorite, dont nous si-tuons l’origine dans la zone axiale pyrénéenne (≈ 160 km). Le collier de perles en variscite provient sûrement de Gavà à une trentaine de kilomètres. Si l’on cumule les distan-ces d’acheminement en ligne directe de tous ces biens, on obtient une distance cumulée de 4 685 km, ce qui nous paraît remarquable dans le contexte européen occidental (fig. 17). La même estimation réalisée avec la dotation de la mine 83 de Can Badosa à Gavà est encore plus élevée (fig. 18) Outre les haches polies en provenance du Mont Viso (≈ 660 km) et les nucléus en silex blond bédoulien du Vaucluse (530 km), on y trouve en effet de l’obsidienne sarde (≈ 1 130 km), du corail rouge (entre 200 et 1 130 km) et de la fibrolite massive provenant au plus près du centre ou du sud de la péninsule Ibérique (≈ 500 km). Dans ce cas, la distance d’acheminement cumulée de ces divers biens se situe autour de 6 000 km. Dans ce domaine, la palme revient en fait à la dotation de la Bòbila Padró (fig. 19). Elle réunit une pièce en obsidienne (≈ 1 100 km), une pièce en amphibolite calcique ou en néphrite pouvant pro-venir des Pyrénées ou du Valais (160 à 920 km), 3 haches en roches jadéitiques du Mont Viso (≈ 625 km), cinq nu-cléus et deux lames en silex blond bédoulien du Vaucluse (500 km chacun), 3 longs ciseaux en cornéenne ou schiste tacheté qui proviennent probablement des ateliers de la haute vallée du Sègre (110 km), deux haches en schiste à glaucophane de la zone métamorphique pyrénéenne voire
du bassin inférieur de la Durance (≈ 100 km à 500 km ?) et une extraordinaire parure en variscite provenant sans doute de Gavà (30 km). Dans ce cas, la distance cumulée d’acheminement de ces diverses pièces pourrait se situer entre 7 000 et 8 000 km, ce qui paraît tout à fait extraordi-naire dans le contexte méditerranéen de l’époque.
Un autre moyen d’estimer la richesse des dotations fu-néraires consiste à attribuer des points aux diverses ca-tégories d’objets en fonction de divers paramètres, tels que le matériau utilisé et sa provenance, mais aussi de sa complexité de fabrication, de son degré de finition. Ce procédé, parfois considéré comme trop subjectif pour être pertinent, est certes discutable (Manolakakis 2007), mais il présente au moins l’avantage de fournir une grille de lecture homogène pour pouvoir faire des comparai-sons et classer les dotations. Nous proposons un es-sai de classement des sépultures qui contiennent des grandes haches alpines ou des imitations de celles-ci.
Dans ce tableau (fig. 16), nous avons attribué une valeur de 30 points à chaque grande hache, en multipliant par quatre cette valeur si la pièce est en roche alpine et en multipliant par 10 cette valeur si la lame polie dépasse 25 cm de lon-gueur. Pour les petites haches, nous attribuons une valeur de 20 points à chaque pièce et de 80 points si elle est en roche alpine. L’obsidienne sarde est créditée de 70 points par pièce. Les nucléus en silex blond bédoulien de 50 points chacun, les lames et lamelles en silex bédoulien chauffé (probablement débitées en Catalogne) de deux points, les armatures de flèche de 3 points. La variscite, qui représente au mieux la richesse spécifiquement catalane, représente 10 points par élément (perle, chaton, pendeloque, etc.).
DEUXIÈME PARTIE
908 Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
Les éléments de parure en organisme marin (coquillages percés, perle en corail, etc.) représentent 5 points par pièce. Chaque outil en os représente un point et chaque céramique 2 points. Avec ce système d’évaluation, la va-leur relative des dotations se répartit selon une échelle de 1 à 19 ; la moins notée est la sépulture Feixa del Moro 1 avec 188 points et la mieux notée Bòbila Padró avec 3 577 points. La dotation de la sépulture de la mine 83 de Can Badosa à Gavà (3 007 points) apparaît en second rang, tandis que Can Gambús-1 E167 avec 1856 points devance Bòbila d’en Joca (1 331 points). La Bisbal, avec sa seule grande hache, serait au cinquième rang avec 1 200 points et ferait partie du groupe des tombes au mobilier le plus riche, tout comme la sépulture en ciste de Feixa del Moro 2 (884 points), soit 4,7 fois plus que la dernière tombe classée. Toutes les autres dotations : Bòbila Madurell M5 (328 points), Can Gambús- E166 (307 points), Bòbila Bellsolà (220 points) et Feixa del Moro 1 (188 points) semblent former un second groupe bien dé-marqué du premier. Il faut relever cependant que deux des tombes de ce second groupe sont suspectées d’avoir été violées et pillées, ce qui réduit la portée de cette dis-tinction. De plus la dotation de Can Gambús-1 166 doit sa note à la supposition que la grande hache est d’origine alpine ; or celle-ci est d’une part au seuil de la catégorie avec une longueur de 13,5 cm et d’autre part elle est en néphrite rétromorphosée, une roche supposée alpine, mais dont tous les référentiels géologiques ne sont pas encore connus. Si l’on prend le parti de la prudence en ne tenant pas compte de ces tombes du second groupe, on peut à partir de nos systèmes de notation distinguer dans le corpus catalan six tombes à mobilier très riche, com-portant soit des grandes haches alpines soit des lots de petites haches alpines associées à des grandes haches de production locale. Il s’agirait de sépultures d’individus masculins capables d’accumuler d’une part la richesse lo-cale représentée par la variscite et d’autre part de détenir des biens de prestige, pour la plupart d’origine lointaine, sous forme de réserve ou de biens patrimoniaux retirés du circuit techno-économique. Ces hommes de pouvoir représenteraient environ 1% de la population inhumée dans des tombes normalisées, probablement moins par rapport à la population totale, puisque l’on sait qu’il existe aussi des sépultures non normalisées en nombre apparemment minoritaire (en grottes ou en structures d’habitat). Les grandes haches de jade (ou parfois leurs imitations) sont le marqueur le plus fort de ce groupe, puisqu’elles participent exclusivement à sa distinction, ce qui n’est pas le cas des autres biens précieux tels que les parures en variscite, les pièces en obsidienne ou les nucléus et outils en silex bédoulien du Vaucluse, que l’on trouve dans d’autres catégories de dotations funéraires.
BibliographieALVAREZ A., 1993.- Tipologia petrogràfica de les destrals polides a Catalunya, Empuries, 48-50, t. I : 18-25
ARTIGUES P.Ll., BRAVO P. et HINOJO E., 2007.- Memòria de la intervenció arqueològica al jaciment de Can Gambús-2 (Sabadell, Vallès Occidental). Octubre 2003-desembre 2004, Arxiu Servei d’Arqueologia i Pa-leontologia, mémoire num. 6421, multigraphié.
BISCHOFF E., 1865.- Monuments de l’Age de Pierre et de la période gallo-romaine dans la vallée du Gers, Revue de Gascogne, 6 : 389-396.
BLANCH R.M., 1992.- Restes d’ocupació : l’exponent de la Bòbila Madurell, in : Estat de la investigació sobre el neolític a Catalunya. 9è Col.loqui Internacional d’arqueolo-gia de Puigcerdà, Puigcerdà et Andorra, 1991 : 179- 180.
BLANCH R.M., LAZARO P. et ALAMINOS M.A., 1991.- Bòbila Madurell. Memòria de l’excavació d’urgència en el sector de Madurell sud i ferrocarrils. Setembre 1989-ge-ner 1990. Arxiu Servei d’Arquelogia i Paleontologia, me-moire núm. 1965, 2 vol., multigraphié.
BLASCÓ A., VILLALBA et P. y EDO M., 1996.- Intercam-bio de bienes de prestigio en catalunya durante el neolí-tico. El desarrollo de la desigualdad social, in : I Congrés del Neolític a la Península Ibèrica. Formació i implantació de les comunitats agrícoles. Gavà-Bellaterra, març 1995. Rubricatum (Gavà). 1, vol. II : 549-556.
BLASCÓ A., EDO M. et VILLALBA M.-J., 2003.- Cardial, epicardial y Postcardial en Can Sadurní (Begues, Baix Llo-bregat). El largo fin del Néolítico antiguo en Cataluña, in : III Congreso Neolítico en la Península Ibérica. Universidad de Cantabria, Santander : 867-877.
BOFILL M., CLOP X. et MOLIST M., 2008.- Utillage macrolitic en els nivells neoliics de l’assentatment de la Caserna Sant Pau, Quaderns d’Arqueologia i historia de la ciutat de Barcelona, Quarhis, epoca II, 4 : 25-35.
BORDAS A., DIAZ J., POU R., PARPAL A. et MARTIN A., 1994.- Excavacions arqueològiques 1992-1993 a la Bòbila Madurell-Mas Duran (Sant Quirze del Vallès, Vallès Occidental), Tribuna d’Arqueologia, 1992-1993, Departa-ment de Cultura de la Generalitat de Catalunya : 31-47.
BORRELL F., 2009.- La indústria litica tallada en silex de les mines 83, 84, 85 i 90 (Gavà Baix Llobregat), morpho-logia i tecnología, in : J. Bosch et F. Borrell (ed.), Interven-cions arqueològiques a las mines de Gavà (sector Serra de les Ferreres) anys 1998-2009. Rubricatum, revista del museo de Gavà, 4 : 109-124.
BORRELL F., ESTRADA A., BOSCH J. et ORRI E., 2005.- Excavaciones recientes en las minas neolíticas de Gavà –sector Sierra de las Ferreres- (Baix Llobregat, Barcelona) nuevos datos para el conocimiento de los rituales funerarios, in : Arias Cabal, Ontañon Peredo et Garcia-Monco Pineiro (ed.), Actas del IIIer Congreso del neolítico en la Península Ibérica. Universidad de Cantabria, Santander : 635-642.
BORRELLO M.A., 2001.- Vous avez dit corail ?, Annuai-re de la Société suisse de Préhistoire et d’Archéologie, 84 : 191-196.
BOSCH A., 1984.- Les destrals polides del Nord de Cata-lunya : tipologia i petrologia, Fonaments, 4 : 221-245.
BOSCH J., 2009.- Peces de collaret de corall de l’epoca neolítica procedents de la mina 83 de Gavà, in : J. Bosch et F. Borrell (ed.), Intervencions arqueològiques a las mines de Gavà (sector Serra de les Ferreres) anys 1998-2009, Rubricatum, revista del museo de Gavà, 4 : 181-184.
BOSCH J. et BORRELL F. (ed.), 2009.- Intervencions arqueolò-giques a las mines de Gavà (sector Serra de les Ferreres) anys 1998-2009. Rubricatum, revista del museo de Gavà, 4, 269 p.
BOSCH J., GIBAJA F. et GRATUZE B., 2009.- Estudi d’una peça d’obsidiana procedent de la mina 83 de Gavà : tipolo-gía, funcionalitat i petrografía, in : J. Bosch et F. Borrell (ed.), Intervencions arqueològiques a las mines de Gavà (sector Serra de les Ferreres) anys 1998-2009. Rubricatum, revista del museo de Gavà, 4 : 133-137.
DEUXIÈME PARTIE
909Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
Jade Grandes haches alpines du Néolithique européen Ve et IVe millénaires av. J.-C.
BRIOIS F., 2005.- Les industries de pierre taillée néo-lithiques en Languedoc occidental. Lattes, MAM, 20, ADAL, 341 p.
BRIOIS F., BROSSIER S., GERNIGON K. et VAQUER J., 1998.- Polymorphisme des industries en silex chasséen-nes entre le Rhône et l'Aquitaine, in : A. d’Anna et D. Bin-der (ed.), Production et Identité culturelle, actualité de la recherche. Actes de la deuxième session des Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente, Arles, 8-9 novem-bre 1996, Antibes, édition APDCA : 129-144.
CAP JEDIKIAN G., PERRIN T., EMICOURT M. et SER-VELLE C., 2008.- Révision des données disponibles sur les aménagements funéraires du site de Saint-Michel du Touch, Toulouse (Haute-Garonne), in : J. Vaquer et al. (ed.), 2008.- Défunts néolithiques en Toulousain. Toulou-se, EHESS, éditions AEP : 179-196.
CASAS I PEREZ J., 2000.- Anàlisi de primeres matèries del Neolitic Mig de Catalunya: el silex melat. Treball de recerca de tercer cicle, Universitat de Barcelona, Facultat de Geografia i historia, Departament de Prehistoria, His-tòria Antiga i Arqueologia, multigraphié.
CASTANY I LLUSSÀ J., 1992.- Estructures funera-ries dels megalits neolitics del Solsonès, in : Estat de la investigació sobre el neolític a Catalunya. Actes del 9e col.loqui internacional de Puigcerdà 1991, Andorra Institut d'Estudi Ceretans - Servei d'Arquelogia d'An-dorra : 249-253.
CASTANY I LLUSSÀ J., 2008.- Els megàlits neolítics del “Solsonià “. Tesi doctoral, departamento d’história, Uni-versitat de Lleida, multigraphié.
CHANTRET F., GUILAINE J. et GUILLEMAUT A., 1970.- Analyses de quelques perles méridionales en callaïs, Bulletin de la Société Préhistorique française, 67 (7) : 216-219.
CLOP X., ÀLVAREZ A. et RECHE J., 2000.- Els Recursos minerales, in : Bosch, Chinchilla et Tarrús (ed.).- El poblat lacustre neolític de la Draga (excavacions 1990-1998). Monografies del CASC, 2, Girona, Museu d’Arqueologia de Catalunya : 123-128.
COLOMINES I ROCA J. et DOM BEDA M.a ESPONA, 1925.- Prehistoria de Montserrat, Analecta Montserraten-sia, VI, Monastir de Monteserrat : 225-352.
CRUELS W., CASTELLS J. et MOLIST M., 1992.- Una necropolis de cambres amb tumul complex del IV Mil.leni a la Catalunya interior, in : Estat de la investigació sobre el neolític a Catalunya. Actes del 9e col.loqui internacional de Puigcerdà 1991, Andorra, Institut d'Estudi Ceretans - Servei d'Arquelogia d'Andorra : 262-264.
EDO M. ,VILLALBA M.J. et BLASCO A., 1995.- La calaíta en la Península Ibérica, in : 1º Congresso de Arqueologia Peninsular. Porto, octubre de 1993, Actas VI, Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 35 (2), Porto : 127 a 155.
ESTEVE GÀLVEZ F. 1999.- Recerques arqueològiques a la Ribera Baixa de l’Ebre. I. Prehistòria. Museu del Mont-sià, Ajuntament d’Amposta.
ESTRADA GARRIGA J., 1956.- Sepulcro neolítico en fosa de la Bòbila d’en Joca, in : VIII Reunión de la Co-misaría Provincial de Excavaciones Arqueológicas de Barcelona. Informes y Memorias. 32, Madrid : 113-115, láminas 22-29.
GASSIN B., 1996.- Évolution socio-économique dans le Chasséen de la grotte de l’Eglise supérieure (Var). Mono-graphies du CRA, 17, Paris, CNRS éditions, 326 p.
GIBAJA BAO J.F., 2003.- Comunidades Neolíticas del Noroeste de la Península Ibérica. Una aproximación socio-económica a partir del estudio de la función de los útiles líticos. Oxford, BAR Internacional Series, 1140, 318 p.
GIBAJA BAO J.F. et TERRADAS X., 2008.- Los restos lí-ticos tallados de la necrópolis de Can Gambús 1 (Sabadell, Barcelona) : primeros resultados del análisis tecnologico y funcional, in : Hernandez Perez, Soler Diaz et Lopez Pa-dilla (ed.), IV Congresso del Neolitico peninsular. Alicante noviembre 2006, Alicante, MARQ, II : 178-183.
GOMEZ A., GUERRERO E., CLOP X., BOSCH J. et MO-LIST M., 2008.- Estudi de la cerámica neolítica del jaci-ment de la Caserna Sant Pau, Quaderns d’Arqueologia i historia de la ciutat de Barcelona, Quarhis, II (4) : 25-35.
GUILAINE J., 1962.- Sépultures néolithiques du Sud de la France, Zephyrus, XIII : 17-29.
GUILAINE J., 1996.- Proto-mégalithisme, rites funéraires et mobiliers de prestige néolithiques en Méditerranée oc-cidentale, in : Homenaje al Profesor Manuel Fernández Miranda. Complutum. Extra 6, t. 1 : 123-140.
GUILAINE J. et MUÑOZ A.M., 1964.- La civilisation catalane des "sepulcros de fosa" et les sépultures néo-lithiques du Sud de la France, Revue d'Études Ligures, 1-4 : 6-30.
HELENA P., 1937.- Les origines de Narbonne. Toulouse, Ed. Privat, 491 p.
HERBAUT F. et QUERRE G., 2004.- La parure néolithi-que en variscite dans le sud de l’Armorique, Bulletin de la Société Préhistorique Française, 101 (3) : 497-520.
JALLOT L., GEORJON C., WATTEZ J., BLAIZOT F., LEA V. et BEUGNIER V., 2000.- Principaux résultats de l’étude du site chasséen ancien de Jacques Coeur II (Port Marianne, Montpellier, Hérault), in : Leduc, Valdeyron et Vaquer (ed.), 2000.- Sociétés et espaces. Actes des Ren-contres méridionales de Préhistoire récente, troisième session, Toulouse 1998, Toulouse, Archives d’Ecologie Préhistorique : 281-303.
LEA V., 2003.- Les industries lithiques du Chasséen en Languedoc oriental : caractérisation par l'analyse techno-logique. Oxford, British Archaelogical Reports Internatio-nal Series, 1232.
LEA V., BINDER D., VAQUER J. et BRIOIS F., 2007.- Le Chasséen méridional à lamelles d'Arnal : évolution de notre perception des industries lithiques, in : J. Evin (ed.), Un siècle de construction du discours scientifique en Préhistoire. XXVIème Congrès Préhistorique de France, Avignon 2004, supplément BSPF, Paris, Société Préhisto-rique Française, vol. 3 : 263-276.
LEA V., PELISSIER M., GRATUZE B., BOUCETTA S. et LEPERE C., 2010.- Renouvellement des données sur la diffusion de l’obsidienne sarde en contexte chasséen (midi de la France) : la découverte du site des Terres Longues (Trets, Bouches-du-Rhône), in : C. Luglie (ed.), L’ossidiana del Monte Arci nel Mediterraneo. Atti del 5° Convegno internazionale di Pau (Italie), 2008, Pau : 157-186.
DEUXIÈME PARTIE
910 Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
LLONGUERAS M., MARCET R. et PETIT M.A., 1981.- Excavacions de jaciments neolítics a la Bòbila Madurell (Sant Quirze del Vallès), in : El Neolític a Catalunya. Taula rodona de Montserrat, 1980, Publicacions de l’Abadia de Montserrat : 173-183.
LLONGUERAS M., MARCET R. et PETIT M.A., 1986.- Darrers treballs a la Bòbila Madurell (Sant Quirze del Vallès, Vallès Occidental), Tribuna d’Arqueologia, 1984-1985, De-partament de Cultura de la Generalitat de Catalunya : 25-34.
LLOVERA X., 1986.- La Feixa del Moro i el Neolitic Mig-re-cent a Andorra, Tribuna d’Arqueologia, 1985-1986, Depar-tament de Cultura de la Generalitat de Catalunya :15-24.
LLOVERA I MASSANA X., 1992.- Visita i discussions so-bre la Feixa del Moro (Juberri, Andorra), in : Actes du 9e col-loqui internacional d’Arqueologia de Puigcerda : Estat de la investigació sobre el Neolític a Catalunya. Puigcer-da-Andorra, 1991, Puigcerda, Institut d’Estudis ceretans : 265-267.
LLOVERA X. et CANTURRI P., 1988.- La Feixa del Moro (Juberri, Andorra) et le Néolithique Moyen à An-dorra. in : Du Néolithique moyen II au Néolithique final au Nord-Ouest des Alpes. Actes du 12e Colloque Interré-gional sur le Néolithique, Lons-Le-Saunier, 1985, Lons-le-Saunier, Edition du Musée d’Archéologie de Lons-Le-Saunier et du Cercle Girardot : 243-250.
LLOVERA X. et COLOMER A., 1989.- La cultura de les Se-pulcres de Fossa, in : Andorra Arqueologica Exposició. An-dorra Govern, Conselleria d’educació i de cultura : 34-39.
MANOLAKAKIS L., 2007.- Varna et le Chalcolithique de Bul-garie, in : J. Guilaine (ed.), Le Chalcolithique et la construc-tion des inégalités. t. 1, Le continent européen. Séminai-res du Collège de France, Paris, Edition Errance : 25-46.
MARTÍ M., POU R. et CARLUS X., 1997.- Excavacions ar-queològiques a la ronda sud de Granollers, 1994. La necrò-polis del neolític mitjà i les restes romanes del camí de Can Grau (La Roca del Vallès, Vallès Oriental). Els jaciments de Cal Jardiner (Granollers, Vallès Oriental), Excavacions ar-queològiques a Catalunya (Barcelona), 14, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya : 37-197.
MARTÍN COLLIGA A., 2009.- Les sociétés du Néolithique moyen en Catalogne et leur gestion du funéraire, in : J. Guilaine (ed.), Du Néolithique à l’Histoire : sépultures et sociétés. Sémi-naires du Collège de France, Paris, Editions Errance : 45-67.
MARTÍN COLLIGA A., BIOSCA A. et ALBAREDA M.J., 1985.- Excavacions à la Cova del Frare (Matapedera, Vallès Occidental). Dinamica ecológica, sequencia cultural i crono-logia absoluta, Tribuna d’arqueologia, 1983-1984 : 91-104.
MARTÍN COLLIGA A., GUILAINE J. et THOMMERET J. et Y., 1981.- Estratigrafia y dataciones C14 de la “Cova del Frare” de St. Llorenc del Munt (Matadepera, Barcelona), Zephirus (Salamanca), XXXII-XXXIII : 101-111.
MARTÍN COLLIGA A., MIRET J., BLANCH R.M., ALIAGA S., ENRICH R., COLOMER S., ALBIZURI S. et BOSCH J.,1988.- Campanya d’excavacions arqueologiques 1987-1988 al jaciment de la Bòbila Madurell-Can Feu (Sant Qui-rze del Vallès, Vallès Occidental), Arrahona, 3 : 9-23.
MARTÍN A. et MORA R. (ed.)., 1992.- Bòbila Madurell-Mas Duran (Sant Quirze del Vallès, Vallès Occidental). Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia, memoire núm. 865, 2 vol., multigraphié.
MARTÍN A. et MORA R. (ed.)., 1993.- Bòbila Madurell-Mas Duran (Sant Quirze del Vallès, Vallès Occidental). Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia, memoire núm. 1007, 5 vol., multigraphié.
MARTÍN COLLIGA A. et VAQUER J., 1995.- El pobla-ment dels pirineus a l'Holoce del Mesolitic a l'Etad del Bronze, in : J. Bertanpetit et E. Vives (ed.), Montanyes i Poblacio. Primer congres del Centre de Trobada de les Cultures Pirenenques, Andorra La Vella, 1993 : 35-73.
MARTÍN A., BORDAS A. et MARTÍ M., 1996.- Bòbila Madurell (Sant Quirze del Vallès, Barcelona). Estrategia económica y organización social en el neolítico medio, in : Formació i implantació de les comunitats agrícoles. I Congrés del Neolític a la Península Ibèrica, Gavà-Bella-terra, març 1995, Rubricatum, 1, vol. I : 423-428.
MARTÍN A. et VILLALBA M.J., 1999.- Le Néolithique moyen de la Catalogne, in : Le Néolithique du Nord-Ouest méditerranéen. XXVe Congrès Préhistorique de France, Carcassonne, 1994, Paris, Société Préhistorique Fran-çaise : 211-224.
MESTRES J., 1989.- Les sepultures neolítiques de l’Hort d’en Grimau (Castellví de la Marca, Alt Penedès), Olerdulae, XIII-XIV (1-4) : 97-109.
MOLIST M., VICENTE O. et FARRE R., 2008.- El jaci-ment de la caserna Sant Pau del Camp : appoximació la caracterisació d’un assentament del Neolitic antic, Qua-derns d’Arqueologia i historia de la ciutat de Barcelona, Quarhis, II (4) : 15-24.
MUÑOZ A.-M., 1965.- La cultura neolítica catalana de los sepulcros de fosa. Universidad de Barcelona, publica-cions eventuales de Pyrenae.
PETREQUIN P., CASSEN S., CROUTSCH C. et ERRERA M., 2002.- La valorisation sociale des longues haches de l'Europe néolithique, in : J. Guilaine (ed.), Matériaux, pro-ductions, circulations du Néolithique à l'Age du Bronze. Paris, Editions Errance : 67-98.
PETREQUIN P., PETREQUIN A.M., ERRERA M., CAS-SEN S., CROUTSCH C., KLASSEN L., ROSSY M., GA-RIBALDI P., ISETTI E., ROSSI G. et DELCARO D., 2005.- Beigua, Monviso e Valais. All'origine delle grandi asce levigate di origine alpina in Europa occidentale durante il V millennio, Rivista di Scienze Preistoriche, LV : 265-322.
PETREQUIN P., PETREQUIN A.M., ERRERA M., CROUTSCH C., CASSEN S. et ROSSY M., 2007a.- Les carrières néolithiques du Mont Viso (Piémont, Italie) : un premier survol, in : M. Besse (ed.), Sociétés néolithiques. Des faits archéologiques aux fonctionnements socio-économiques. Actes du 27e Colloque interrégional sur le Néolithique, Neuchâtel, 1 et 2 octobre 2005, Lausanne, Cahiers d’Archéologie Romande, 108 : 51-68.
PETREQUIN P., CASSEN S., ERRERA M., PAILLER Y. et GAUTHIER E., 2007b.- La hache polie de Lagor (Pyrénées-Atlantiques) : une production du Ve millénaire, Archéologie des Pyrénées occidentales et des Landes, 26 : 7-20.
PETREQUIN P., PETREQUIN A.M., ERRERA M., JAIME RIVERON O., BAILLY M., GAUTHIER E. et ROSSI G., 2008.- Premiers épisodes de la fabrication des longues haches alpines : ramassage de galets ou choc thermique sur des blocs, Bulletin de la Société Préhistorique Française, 105 (2) : 309-334.
DEUXIÈME PARTIE
911Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
Jade Grandes haches alpines du Néolithique européen Ve et IVe millénaires av. J.-C.
POU R. et MARTI M., 1995.- Els Sepulcres de Fossa al Vallès. Estudi de les necrópolis de la Bòbila Madurell i del Camí de Can Grau. Travail de recherche, Facultat de Lletres, Universitat autònoma de Barcelona, 3 vol., multigraphié.
POU R., MARTI M., DIAZ J. et BORDAS A., 1994.- Estudio de la necrópolis del grupo de Sepulcros de Fosa del yacimien-to de “Bòbila Madurell” (Sant Quirze del Vallés, Barcelona) en el contexto del neolítico medio reciente en Catalunya, in : 1º Congresso de Arqueologia Peninsular. Porto, 1993, Actas dos Trabalhos de Antropologia e Etnologia, XXXIV (3-4) : 61-80.
POU R., MARTI M., BORDAS A., DIAZ J. et MARTIN A., 1996.- La cultura de los Sepulcros de Fosa en el Vallés. Los yacimientos de “Bòbila Madurell i Camí de Can Grau” (St. Quirze del Vallès y La Roca del Vallès -Barcelona), in : Ier Congrés del Neolític a la Península Ibèrica. Formació i implantació de les comunitats agrícoles. Gavà-Bellaterra, març 1995, Rubricatum (Gavà), 1, vol. II : 519-526.
RENOM I COSTA V., 1934a.- La secció de prehistòria. Anuari del Museu de Sabadell : 19.
RENOM I COSTA V., 1934b.- Prehistòria. Museo de la ciudad de Sabadell : 25-29.
RICQ -DE BOUARD M., 1996.- Pétrographie et sociétés néolithiques en France méditerranéenne. L’outillage en pierre polie. Monographie du C.R.A, 16, Paris, Ed. du CNRS.
RIPOLL E. et LLONGUERAS M., 1963.- La cultura neo-lítica de los Sepulcros de Fosa en Cataluña, Ampurias, XXV, Barcelona : 1-90.
RIPOLL PERELLO E. et LLONGUERAS CAMPAÑA M., 1967.- Notas sobre sepulcros de fosa catalanes, Ampurias, XXIX, Barcelona : 240-257.
RISCH R. et MARTÍNEZ FERNANDEZ F., 2008.- Dimen-siones naturales y sociales de la producción de hachas de piedra en el noreste de la Península Ibérica, Trabajos de Prehistoria, 65 : 47-71
ROIG BUXO J. et COLL RIERA J.M., 2006.- El paratge arqueològic de Can Gambus 1 (Sabadell, Vallès occi-dental), Tribuna d’arqueologia, Barcelona, Generalitat de Catalunya : 85-109.
ROIG J. et COLL J.M., 2008.- Memòria de la intervenció arqueològica a Can Gambús 1 (Sabadell, Vallès Occiden-tal). Abril 2003-desembre 2004 i agost 2006. Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia, núm 7416, 22 vol., multigraphié.
ROIG J., COLL J.M., GIBAJA J.-F., CHAMBON P., VIL-LAR V., RUIZ J., TERRADAS X. et SUBIRA M.E., 2010.- La necrópolis de Can Gambús (Sabadell, Barcelona). Nue-vos conocimientos sobre las practicas funerarias durante el neolítico medio en el noreste de la Peninsula Ibérica, Trabajos de prehistoria, 67 (1) : 59-84.
ROUSSOT-LARROQUE J., 2008.- La « sépulture de chef » de Pauilhac (Gers), Préhistoire du Sud-Ouest, 16 (1) : 91-142.
SERRA RAFOLS J. de C., 1947.- La exploración de la necrópolis neolítica de la Bòbila Madurell en Sant Quirze de Galliners, Revista del Museo de la Ciudad de Sabadell, III : 57-75.
SERRA RAFOLS J. de C., 1956.- El sepulcro de fosa de la Bòbila d’En Joca (Montornès). VIII reunión de la Comi-saria Provincial de Excavaciones Arqueológicas de Barce-lona, Informes y memorias, 32, Madrid : 115-120.
SERVELLE C. et VAQUER J., 2000.- Les haches polies en cinérite du Rouergue, des producteurs aux consom-mateurs, in : M. Leduc, N. Valdeyron et J. Vaquer (ed.), Sociétés et espaces. Actes des Rencontres méridionales de Préhistoire récente, 3ème session, Toulouse, 1998, Tou-louse, éd. AEP, Toulouse : 81-100.
TARRUS I GALTER J., 2002.- Poblats, dolmens i menhirs : els grups mzegalitics de l’Albera, serra de Rodes I cap de Creus : Alt emporda, Roselló i Vallespir Oriental. Unitat de publicacions de la Diputació de Girona, 950 p.
VAQUER J., 2006.- La diffusion de l’obsidienne dans le Néolithique de Corse du Midi de la France et de la Catalogne, in : Materie prime e scambi nella prehistoria italiana. Atti de la XXXIXe Riunione Scientifica nel Istituto Italiano di Preis-toria e Protostoria, Firenze, 2004, Firenze, IIPP : 483-498.
VAQUER J., 2007.- Les tombes à dalles du Néolithique moyen dans la zone nord pyrénéenne, in : P. Moinat et P. Chambon (ed.), Les cistes de Chamblandes et la place des coffres dans les pratiques funéraires du Néolithique moyen occidental. Colloque, 12-13 mai 2006, Lausanne, Cahiers d'archéolo-gie romande, Paris, Société Préhistorique Française : 13-25.
VAQUER J., DUDAY H., GANDELIN M., TRESSET A. et HEROUIN S., 2007.- La tombe néolithique de Coste Rouge, Beaufort (Hérault) et la question des tombes à dalles néolithiques dans le nord-est des Pyrénées, Gallia Préhistoire, 49 : 127-159.
VAQUER J., GANDELIN M., REMICOURT M. et TCHE-REMISSINOFF Y., (ed.), 2008.- Défunts néolithiques en Toulousain. Toulouse, EHESS, Archives d’Ecologie Pré-historique, série monographie.
VAQUER J., PETREQUIN P. et REMICOURT M., 2008.- Quelques éléments mobiliers remarquables du Néoli-thique en pays toulousain ; offrandes funéraires ou dé-pôts ? , in : J. Vaquer et al. (ed.), Défunts néolithiques en Toulousain. Toulouse, EHESS, Archives d’écologie préhistorique, série monographie : 13-29.
VAQUER J. et REMICOURT M., 2010.- Rythmes et mo-dalités d’approvisionnement en silex blond bédoulien dans le Chasséen du bassin de l’Aude : le cas d’Auriac, Carcassonne (Aude), in : A. Beeching, E. Thirault et J. Vi-tal (ed.), Économie et Société à la fin de la Préhistoire - Actualité de la recherche. DARA, 34, ALPARA, Lyon, Maison de l’Orient et de la Méditerranée : 39-56.
VILLALBA M.-J., BAÑOLAS L., ARENAS J. et ALONSO M., 1986.- Les mines neolítiques de Can Tintorer, Gavà, Excavacions 1978-1980. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Servei d’Arqueologia, Excava-cions arqueologiques a Catalunya, 6.,,VILASECA S., 1973.- Reus y su entorno en la prehistoria. Reus, Associacion de estudios Reusenses, 2 vol.
WELLER O. et FIGULS A., 2005.- Première exploitation de sel gemme en Europe : organisation et enjeux socio-économiques au Néolithique moyen autour de La Mon-tanya de Sal de Cardona (Catalogne), in : A. Fíguls et O. Weller (ed.), Sal O3. Trobada internacional d’Arqueologia, Cardona, 2003, Edition Archaeaeologia Cardonensis, 1, IREC Cardona : 219-239.
YAÑEZ C., MALGOSA A., BURJACHS F., DIAZ N., GARCIA C., ISIDRO A., JUAN J. et MATAMALA J., 2002.- El Món funerari al final del V mil.leni a Andorra : la tomba de Segudet (Ordino), Cypsela, 14 : 175-194.
DEUXIÈME PARTIE
912 Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
Annexe 1 Analyses des haches de Catalogne (Michel Errera, Pierre Pétrequin et J. Vaquer)
En vert : les haches d’origine alpine très probable En orange : les haches d’origine alpine possible
BARCELONA (Barcelona), Sant Pau del Camp, Sect. B N2 T. XIII 1. Extrémité (tranchant) petite lame polie. 2,3 cassé x 2 x 0,8 cm. Roche vert pâle type fibrolite ?Analyse spectroradiométrique : Barc_015 et Barc_016, Amphibolite_Ca rétromorphosée (+ clinochlore) (End-member_235, Spectrofaciès_141). Origine la plus proba-ble : non alpin (œil nu) ; le spectrofaciès paraît clairement être associé à la localité des Haudères, en Suisse ; néan-moins, il y a lieu d’être prudent, car le référentiel utilisé pourrait être inadéquat ou incomplet pour le type de ro-che analysée (spectro).
BARCELONA (Barcelona), Sant Pau del Camp, tombe XXV, ent XVII, n° 1, Sect. B, AD 7. Petite hache. Section en D. 3 x 1,9 x 0,8 cm. Roche vert moyen tachetée ; si jadéitite, probablement Mont Viso.Analyse spectroradiométrique : Barc_017 et Barc_018, Jadéitite atypique (Endmember_170, Spectrofaciès_104). Origine la plus probable : Viso probable (œil nu) ; il semble imprudent d’assigner une origine Viso ou Groupe de Voltri tant les spectres paraissent voisins (spectro).
BEGUES (Barcelona), Grotte Can Sandurni (fouille M. Edo). Très grande herminette plate. Section en D. Polissage 2. Cupules thermiques profondes sur le dos de l’outil. 20,7 x 7,7 x 2,7 cm. Roche noire avec petits cristaux ? Inconnue ?Analyse spectroradiométrique : Barc_079, quartzite, gneiss ou schiste (Endmember_239, Spectrofaciès_110). Densité : 2,9. Origine la plus probable : non alpin (œil nu) ; les spectres sont trop peu contrastés pour donner lieu à des comparaisons pertinentes (spectro).
CERDANYOLA (Barcelona), Bòbila d’en Sallent, tombe 1. Musée d’Archéologie de Catalogne à Barcelone, n° 16424. Petite hache de travail. Type Chelles. Section ova-laire épaisse. Côtés piquetés. Polissage 3. 7,5 x 4,1 x 2,5 cm. Roche fine noire. Amphibolite ?Analyse spectroradiométrique : Barc_029, Jadéitite rétromor-phosée dans le faciès des schistes bleus, peut-être à la limite avec les schistes verts (apparition d’un minéral du groupe des chlorites ou de l’épidote ?) (Endmember_058, Spectro-faciès_510). Origine la plus probable : non déterminée (œil nu) ; alpin, mais en l’absence de comparaison convaincante, aucune origine plausible ne peut être proposée (spectro).
CERDANYOLA (Barcelona), Bòbila d’en Sallent, tombe 1. Musée d’Archéologie de Catalogne à Barcelone, n° 16423. Petite hache de travail, trapézoïdale. Polissage 4. 5,5 x 4,2 x 1,4 cm. Roche fine vert foncé à points noirs. Quelques points blancs. Inconnu ?Analyse spectroradiométrique : Barc_030, Chloritoschiste à épidote (Endmember_044, Spectrofaciès_156). Origine la plus probable : non déterminée (œil nu) ; pas de référentiel adéquat ; les chloritoschistes sont abondants dans tout le domaine alpin et peuvent se trouver aussi ailleurs (spectro).
COLLBATÓ (Barcelona) (anciennement El Bruc) Vinya del Castell), découverte isolée. Musée d’Archéologie de Catalo-gne à Barcelone, N°16376. Hache. Type Tumiac non perfo-rée très vraisemblable (ou Greenlaw sp. repolie ?). Section ovalaire moyenne. Polissage 5 (stigmates de piquetage sur
une face). 19,6 x 6,5 x 2,3 cm. Roche légèrement saccha-roïde étirée, vert moyen cru, quelques petites passées noirâtres type Viso. Jadéitite ? (fichier JADE 2008_1594).Analyse spectroradiométrique : Barc_002, Barc_003 et Barc_004, Jadéitite atypique faiblement rétromorphosée (schistes verts) (Endmember_185, Spectrofaciès_113). Den-sité : 3,34. Origine la plus probable : Viso (œil nu) ; la source est sans doute le Viso, probablement un bloc épuisé (Oncino/Bulé) ayant fourni de très nombreux éclats de débitage ; néanmoins Voltri ne peut être définitivement écarté (spectro).
EL BRUC (Barcelona), Can Vallés, tombe 2. Musée d’Archéo-logie de Catalogne à Barcelone, n° 16378. Hache de travail. Type Chelles court. Section ovalaire épaisse. Corps et talon piqueté. 7,8 x 4,4 x 2,5 cm. Roche vert foncé à noir. Inconnu ?Analyse spectroradiométrique : Barc_028 : non détermi-né (nd_4). Origine la plus probable : non alpin (œil nu) ; non précisée (spectro).
GAVÀ (Barcelona), Can Badosa 2001, mine 85 (1). Mu-sée municipal de Gavà, n° 1085. Petite hache trapézoï-dale plate. Côtés bouchardés. 5,1 x 4 x 0,9 cm. Roche saccharoïde vert moyen, étirée. Inconnu ou alpin ?Analyse spectroradiométrique : Barc_005 et Barc_006, Éclo-gite rétromorphosée dans le faciès des schistes verts (chlo-ritoschistes), parfois micacée (Endmember_238, Spectro-faciès_253). Densité : 3,46. Origine la plus probable : alpin possible (œil nu) ; en l’absence de comparaison convaincan-te, aucune origine plausible ne peut être proposée (spectro).
GAVÀ (Barcelona), Can Badosa, mine 83 (2). Musée de Gavà. Hache de travail. Section ovalaire moyenne. 8,6 x 5 x 2,4 cm. Roche vert foncé à noir, inconnue ?Analyse spectroradiométrique : Barc_011 et Barc_012, Jadéitite faiblement micacée, rétromorphosée dans le faciès des schistes verts (Endmember_051, Spectrofa-ciès_430). Densité : 2,98. Origine la plus probable : non déterminée (œil nu) ; l’origine pourrait être le Viso et parti-culièrement Oncino (Porco, Rasciassa) ; toutefois, vu une mauvaise concordance avec l’absorption diagnostique de la jadéite, le doute subsiste d’autant plus qu’une origine Voltri reste plausible (spectro).
GAVÀ (Barcelona), Can Badosa, mine 83 (3). Musée de Gavà, n° 1085. Petite hache ciseau. Section ovalaire moyenne. 7,1 x 3 x 1,4 cm. Roche vert foncé, inconnue ?Analyse spectroradiométrique : Barc_007 et Barc_008, Éclogite légèrement rétromorphosée (Endmember_239, Spectrofaciès_110). Densité : 3,10. Origine la plus pro-bable : non déterminée, mais alpin possible (œil nu) ; les spectres des éclogites sont trop peu contrastés pour donner lieu à des comparaisons pertinentes (spectro).
GAVÀ (Barcelona), Can Badosa, mine 83 (4). Sépulture avec lamelle en obsidienne, variscite, perles en corail, etc. Musée de Gavà. Hache de travail. Section ovalaire moyenne. Polis-sage 3. 16,1 x 7,2 x 3,1 cm. Roche à grain fin, vert moyen à noir, éclogite fine type Viso ? (fichier JADE 2008_1597).Analyse spectroradiométrique : Barc_013 et Barc_014, Éclogite (quartzite, gneiss ou schiste si la densité est comprise entre 2,60 et 2,80) (Endmember_239, Spec-trofaciès_110). Origine la plus probable : Viso (œil nu) ; les spectres des éclogites sont trop peu contrastés pour donner lieu à des comparaisons pertinentes (spectro).
DEUXIÈME PARTIE
913Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
Jade Grandes haches alpines du Néolithique européen Ve et IVe millénaires av. J.-C.
GAVÀ (Barcelona), Can Badosa, mine 83 (5). Musée de Gavà. Petite hache. Section intermédiaire à côtés abat-tus, type Puy. 7,2 x 4,7 x 1,3 cm. Fibrolite blanche à struc-ture très tourmentée.Analyse spectroradiométrique : Barc_009 et Barc_010, Fibrolite (gneiss à sillimanite) (Endmember_001, Spectro-faciès_132). Origine la plus probable : non alpin (œil nu) ; pas de référentiel adéquat (spectro).
GAVÀ (Barcelona), sépulture de la mine 9. Musée de Gavà. Petit ciseau poli. Section ovalaire moyenne. 3,9 x 1,6 x 0,8 cm. Roche vert moyen, étirée avec quelques traînées noirâtres, inconnue ?Analyse spectroradiométrique : Barc_034 , Amphibolite_Ca rétromorphosée (+ clinochlore) (Endmember_235, Spec-trofaciès_141). Origine la plus probable : non déterminée (œil nu) ; le spectrofaciès paraît clairement être associé à la localité des Haudères, en Suisse ; néanmoins il y a lieu d’être prudent, car le référentiel utilisé pourrait être inadé-quat ou incomplet pour le type de roche analysée (spectro).
LA BISBAL (Girona), tombe. Musée d’Archéologie de Ca-talogne à Barcelone, N°16381. Hache. Type Puy. Fissure de débitage au feu. Section quadrangulaire moyenne. Ré-sidu de piquetage au talon. Polissage par facettes en par-tie lisible, polissage 6. 28,4 x 6,4 x 2,7 cm. Roche à grain fin, étirée complexe, vert foncé. Rares grenats, minuscu-les ? Omphacitite type Viso ? (fichier JADE 2008_1593).Analyse spectroradiométrique : Barc_000 et Barc_001, Om-phacitite, omphacitite jadéitique, omphacitite légèrement rétromorphosée (Endmember_234, Spectrofaciès_111). Densité : 3,34. Origine la plus probable : Viso (œil nu) ; les spectres des omphacitites sont trop peu contrastés pour donner lieu à des comparaisons pertinentes (spectro).
MATADEPERA (Barcelona), Matadepera, Cova del Frare, CF U 24 317. 12, Cardial ou Epicardial. Tranchet sur éclat taillé à l’enclume. Seul le tranchant est poli. Polissage 2. 4,4 x 3,1 x 0,8 cm. Roche fine vert foncé, type éclogite ?Analyse spectroradiométrique : Barc_076, Gabbro vrai-semblable, mais les roches effusives du type basalte ne sont pas à exclure ; la présence d’olivine semble cepen-dant moins marquée que dans ces derniers (Endmem-ber_181, Spectrofaciès_004). Origine la plus probable : non déterminée (œil nu) ; non alpin (spectro).
MATADEPERA (Barcelona), Matadepera, Cova del Frare, CF X 25 C4 147. 11), Néolithique final. Petite hache. Type Puy. Section épaisse. 8,5 x 4,9 x 2,2 cm. Amphibolite cal-cique verdâtre de la vallée de l’Aude ?Analyse spectroradiométrique : Barc_077 et Barc_078, Néphrite rétromorphosée (+ clinochlore) (Endmem-ber_015, Spectrofaciès_142). Densité : 2,94, amphibolite probable. Origine la plus probable : vallée de l’Aude possi-ble (œil nu) ; la meilleure comparaison avec le référentiel utilisé se fait avec un échantillon de la mine d’Ur, à Pos-chiavo, dans les Grisons (Suisse) ; mais il y a lieu d’être prudent, car le référentiel pourrait être inadéquat ou in-complet pour le type de roche analysée (spectro).
MONTORNÈS DEL VALLÈS, tombe de Bòbila d’en Joca , n° 536. Musée de Granollers. Hache de travail. Type Chelles. Section ovalaire moyenne. Talon et côtés piquetés. Stigmates de taille. Polissage 3. 13,2 x 5,6 x 2,3 cm. Roche vert saccha-roïde, jadéitite type Viso Porco ? (fichier JADE 2008_1598).Analyse spectroradiométrique : Barc_025 et Barc_026, Jadéi-tite typique légèrement rétromorphosée (Endmember_056, Spectrofaciès_335). Origine la plus probable : Viso Porco
(œil nu) ; les meilleures comparaisons ne permettent pas de préciser l’origine avec une probabilité suffisante (spectro).
MONTORNÈS DEL VALLÈS, tombe de Bòbila d’en Joca, n° 537. Musée de Granollers. Hache. Type Puy. Section moyenne. 13,2 x 5,6 x 2,3 cm. Roche fine gris clair à lits sableux, patine brun rouge. Cinérite siliceuse typique du Bassin carbonifère de Réquista en Aveyron, France (fichier JADE 2008_1602).Analyse spectroradiométrique (M. Errera) : Barc_027, Métagranite (ou métadiorite) (Endmember_023, Spectro-faciès_133). Origine la plus probable : Requista (œil nu) ; la comparaison spectrale avec des échantillons de la ciné-rite de Requista est très positive, sans être concluante en l’absence d’un référentiel représentatif (spectro).
MONTORNÈS DEL VALLÈS, tombe de Bòbila d’en Joca, n° 538. Musée de Granollers. Petite hache de travail. Type Chelles. Section ovalaire moyenne. Traces brillantes d’emmanchement au talon. Polissage 4. 9,9 x 4,7 x 2,0 cm. Jadéitite ou omphacitite fine étirée vert moyen, type Viso Bulè (fichier JADE 2008_1600).Analyse spectroradiométrique : Barc_023 et Barc_024, Omphacitite, omphacitite jadéitique, omphacitite légè-rement rétromorphosée (Endmember_208, Spectrofa-ciès_111). Origine la plus probable : Viso Bulè (œil nu) ; les spectres des omphacitites sont trop peu contrastés pour donner lieu à des comparaisons pertinentes (spectro).
MONTORNÈS DEL VALLÈS, tombe de Bòbila d’en Joca, n° 539. Musée de Granollers. Petite hache. Type Puy. Sec-tion intermédiaire moyenne. Polissage 4. 9,2 x 4,2 x 1,7 cm. Jadéitite fine étirée, quelques rectangles de lawsonite. Vert pâle cru translucide, type Viso Bulè (fichier JADE 2008_1601).Analyse spectroradiométrique : Barc_019 et Barc_020, Ja-déitite faiblement micacée, rétromorphosée dans le faciès des schistes verts (Endmember_051, Spectrofaciès_430). Origine la plus probable : Viso Bulè (œil nu) ; l’origine pourrait être le Viso et particulièrement Oncino (Porco, Rasciassa) ; toutefois, vu une mauvaise concordance avec l’absorption diagnostique de la jadéite, le doute subsiste, d’autant plus qu’une origine Voltri reste plausible (spectro).
MONTORNÈS DEL VALLÈS, tombe de Bòbila d’en Joca, n° 540. Musée de Granollers. Petite hache de travail. Type Puy. Section moyenne. Polissage 3. 8,8 x 3,4 x 1, 8 cm. Jadéitite fine étirée vert moyen, type Viso ? (fichier JADE 2008_1599).Analyse spectroradiométrique : Barc_021 et Barc_022, Amphibolite_Ca rétromorphosée (+ clinochlore) (Endmem-ber_235, Spectrofaciès_141). Origine la plus probable : alpin probable (œil nu) ; le spectrofaciès paraît clairement être as-socié à la localité des Haudères, en Suisse ; néanmoins, il y a lieu d’être prudent, car le référentiel utilisé pourrait être inadé-quat ou incomplet pour le type de roche analysée (spectro).
RIPOLLET (Barcelona), sépulture de Bòbila Padró (7). Musée d’Histoire de Sabadell, n° 2726. Hache. Section ovalaire moyenne. Polissage 3 avec stigmates de taille. 11,6 x 6 x 2,1 cm. Roche vert foncé à bleuâtre, étirée ? Inconnue ? (fichier JADE 2008_1612).Analyse spectroradiométrique : Barc_054, Amphibolite_Ca rétromorphosée (+ clinochlore) (Endmember_235, Spectrofa-ciès_141). Densité : 2,9. Origine la plus probable : non déter-minée (œil nu) ; le spectrofaciès paraît clairement être associé à la localité des Haudères, en Suisse ; néanmoins, il y a lieu d’être prudent, car le référentiel utilisé pourrait être inadé-quat ou incomplet pour le type de roche analysée (spectro).
DEUXIÈME PARTIE
914 Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
RIPOLLET (Barcelona), sépulture de Bòbila Padró (8). Musée d’Histoire de Sabadell, n° 2733. Long ciseau. Section circu-laire. Polissage 3. Traces de bouchardage sur le corps et le talon. 17,8 x 2,3 x 2,1 cm. Roche à gros grain, étirée aspect lité et tacheté ? Schiste tacheté ? (fichier JADE 2008_1613).Analyse spectroradiométrique : Barc_055 , non détermi-né (nd_4). Densité : 2,76. Origine la plus probable : non alpin (œil nu) ; non déterminée (spectro).
RIPOLLET (Barcelona), Sépulture 1 de Bòbila Padró (1). Musée d’Histoire de Sabadell n° 2724, Hache. Section ovalaire moyenne. Polissage 3, stigmates de taille. 8,1 x 4,7 x 2 cm. Roche fine vert bleutée très étirée. Amphibo-lite ? (fichier JADE 2008_1606).Analyse spectroradiométrique : Barc_045 et Barc_046, Schiste à glaucophane (Endmember_020, Spectrofa-ciès_145). Densité : 2,97. Origine la plus probable : non déterminée (œil nu et spectro).
RIPOLLET (Barcelona), sépulture 1 de Bòbila Padró (2). Musée d’Histoire de Sabadell, n° 2734 (2). Talon brisé d’une petite hache trapézoïdale. Section lenticulaire min-ce. Polissage 4. 2,3 cassé x 3,4 x 1 cm. Roche vert moyen, étirée, à structure complexe ? (fichier JADE 2008_1607).Analyse spectroradiométrique : Barc_047 et Barc_048, Éclogite (quartzite, gneiss ou schiste si la densité est comprise entre 2,60 et 2,80) (Endmember_239, Spectro-faciès_110). Origine la plus probable : non déterminée, mais alpin possible (œil nu) ; les spectres des éclogites sont trop peu contrastés pour donner lieu à des compa-raisons pertinentes (spectro).
RIPOLLET (Barcelona), sépulture 1 de Bòbila Padró (4). Musée d’Histoire de Sabadell, n° 2725. Hache. Type Chelles. Section ovalaire moyenne. Polissage 3. Quel-ques stigmates de taille. Bouchardage sur les deux côtés. 9,7 x 4,7 x 1,7 cm. Roche grenue, veinée de vert sombre, inconnue (fichier JADE 2008_1609).Analyse spectroradiométrique : Barc_050, Schiste à glauco-phane (Endmember_020, Spectrofaciès_145). Densité : 2,89. Origine la plus probable : non déterminée (œil nu et spectro).
RIPOLLET (Barcelona), sépulture 1 de Bòbila Padró (5). Musée d’Histoire de Sabadell, n° 2736. Grande hache. Type Puy. Section rectangulaire moyenne. Fissures d’ex-ploitation par le feu. Piquetage sur les deux côtés du ta-lon, traces de la hache alpine originelle. Polissage 4. 16,7 x 6,5 x 2 cm. Roche vert moyen avec points et marbrures vert foncé (fichier JADE 2008_1610).Analyse spectroradiométrique : Barc_051 et Barc_052, Jadéitite typique légèrement rétromorphosée (Endmem-ber_072, Spectrofaciès_500). Densité : 3,29. Origine la plus probable : Viso Porco possible (œil nu) ; les nombreu-ses comparaisons ne permettent pas de préciser l’origine ; même si certaines sont particulièrement convaincantes et semblent indiquer le Viso, d’autres tout aussi convaincan-tes paraissent plutôt indiquer Voltri (spectro).
RIPOLLET (Barcelona), sépulture 1 de Bòbila Padró (6). Mu-sée d’Histoire de Sabadell, n° 2735. Peut-être un long ciseau qui aurait été repris par polissage après cassure, car facettes de polissage grossier sur les côtés et polissage très fin sur les faces. Section ovalaire épaisse. Polissage 3. 17,3 x 4,9 x 3,4 cm. Roche grenue de faible résistance mécanique, noi-râtre ? Amphibolite ? (fichier JADE 2008_1611).Analyse spectroradiométrique : Barc_053, cornéenne très plausible vu la densité et l’absence de caractéristiques spectrales (Endmember_239, Spectrofaciès_110). Densité :
2,90. Origine la plus probable : non alpin (œil nu) ; non déter-minée (spectro).
RIPOLLET (Barcelona), sépulture 1 de Bòbila Padró 1 (3). Musée d’Histoire de Sabadell, n° 2732. Longue hache ci-seau. Section ovalaire épaisse. Polissage 4. 22,2 x 3,2 x 2,3 cm. Roche grenue, verdâtre. Inconnue ? Aspect lité et tacheté ? (fichier JADE 2008_1608).Analyse spectroradiométrique : Barc_049, Cornéenne très plausible vu la densité et l’absence de caractéristi-ques spectrales. Densité : 2,88. Origine la plus probable : non alpin (œil nu) ; non déterminée (spectro).
SABADELL (Barcelona), nécropole de Can Gambús-1. 111. 214. 2. Hache de travail. Forme trapézoïdale. Sec-tion ovalaire irrégulière. Polissage 2. Stigmates de taille visibles. Le support était probablement un galet éclaté. 9,1 x 7,7 x 1,8 cm. Roche grise foliée. Amphibolite ?Analyse spectroradiométrique : Barc_093 et Barc_094, As-semblage quartz-albite-muscovite-chlorite caractéristique du faciès des schistes verts (chloritoschistes, chloritoschis-tes légèrement micacés ou micacés) (Endmember_112, Spectrofaciès_115). Origine la plus probable : non alpin (œil nu) ; le faciès métamorphique des schistes verts (chlo-ritoschistes) est assez répandu dans les zones externes de l’arc alpin ou dans d’autres domaines (spectro).
SABADELL (Barcelona), nécropole de Can Gambús-1. 122. 211. 11. Tombe à chambre latérale. Un collier de callaïs, un nucleus, 3 lames de silex, plusieurs pointes en os. Petite hache de travail. Forme trapézoïdale. Section ovalaire moyenne. Polissage 3. Traces de l’emmanche-ment visible au talon. 4,2 x 3,9 x 1,2 cm. Roche grise avec quelques cristaux blancs. Amphibolite ?Analyse spectroradiométrique : Barc_097 et Barc_098, Chloritoschiste à épidote (Endmember_129, Spectrofa-ciès_156). Origine la plus probable : non alpin (œil nu) ; pas de référentiel adéquat (spectro).
SABADELL (Barcelona), nécropole de Can Gambús-1. 122. 211. 13. Hache de travail. Type Puy. Section moyen-ne. Polissage 4. 8,4 x 5,2 x 2 cm. Roche grise avec des interlits réguliers blanchâtres. Amphibolite ?Analyse spectroradiométrique : Barc_099 et_100, Néphrite rétromorphosée (+ clinochlore) (Endmember_015, Spec-trofaciès_142). Densité : 2,98. Origine la plus probable : non alpin (œil nu) ; la meilleure comparaison avec le réfé-rentiel utilisé se fait avec un échantillon de la mine d’Ur, à Poschiavo, dans les Grisons (Suisse) ; mais il y a lieu d’être prudent, car le référentiel pourrait être inadéquat ou incomplet pour le type de roche analysée (spectro).
SABADELL (Barcelona), nécropole de Can Gambús-1. 130. 262. 3. Hache de travail. Petite hache à bords droits. Type Puy. Section moyenne. 8 x 4,1 x 1,7 cm. Roche type calcaire très corrodé, blanchâtre. Calcaire ?Analyse spectroradiométrique : Barc_103 et Barc_104, non déterminé {nd_3 (Roche carbonatée)}. Origine la plus probable : non alpin (œil nu) ; non déterminée (spectro).
SABADELL (Barcelona), nécropole de Can Gambús-1. 175. 662. 8. Deux poteries, un bracelet et un collier de callaïs et un nucleus en silex. Hache de travail. Petite hache trapézoïdale. Polissage 4. Section ovalaire moyenne. 3,2 x 3 x 0,9 cm. Ro-che vert foncé à bleuté avec aiguilles noirâtres. Amphibolite ?Analyse spectroradiométrique : Barc_101 et Barc_102, Chloritoschiste à épidote (Endmember_129, Spectrofa-ciès_156). Origine la plus probable : non alpin (œil nu) ; pas de référentiel adéquat (spectro).
DEUXIÈME PARTIE
915Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
Jade Grandes haches alpines du Néolithique européen Ve et IVe millénaires av. J.-C.
SABADELL (Barcelona), nécropole de Can Gambús-1. 176. 257. 11. Tombe à chambre latérale. Associé à des trapèzes, un nucléus et 3 flèches à pédoncule et 2 lames en silex et un collier en callaïs. Hache de travail. Type Puy. Section ovalaire épaisse. Côtés bouchardés. Polissage 3. 11,8 x 4,9 x 3,1 cm. Roche sombre bleutée, étirée avec quelques filets blanchâtres. Amphibolite ?Analyse spectroradiométrique : Barc_091 et Barc_092, Chloritoschiste à épidote (Endmember_129, Spectrofa-ciès_156). Origine la plus probable : non alpin (œil nu) ; pas de référentiel adéquat (spectro).
SABADELL (Barcelona), nécropole de Can Gambús-1. 2003. 130. 262. 4. Petite hache. Section ovalaire moyenne, avec amorces de bords droits. Dimensions : 10 x 4,1 x 2,1 cm. Roche blanchâtre complètement corrodée. Calcaire ?Analyse spectroradiométrique : Barc_083 et Barc_084, non déterminé {nd_3 (Roche carbonatée)}. Densité : 2,70. Origine la plus probable : non déterminée (œil nu et spectro).
SABADELL (Barcelona), nécropole de Can Gambús-1. 2003. 166. 253. 5. Tombe en fosse. Deux nucleus, 2 la-mes et une pointe de flèche à pédoncule et ailerons, un bracelet en callaïs. Hache type Puy. Section quadrangu-laire moyenne. Polissage 4. Talon équarri. 13,5 x 4,4 x 1,8 cm. Roche proche serpentine vert foncé bleuté avec quelques rectangles blancs. Serpentinite ? (fichier JADE 2008_1614).Analyse spectroradiométrique : Barc_080 et Barc_081, Néphrite rétromorphosée (+ clinochlore) (Endmem-ber_015, Spectrofaciès_142). Densité : 2,96. Origine la plus probable : non déterminée (œil nu) ; la meilleure comparaison se fait avec un échantillon de la mine d’Ur, à Poschiavo, dans les Grisons (Suisse) ; mais il y a lieu d’être prudent, car le référentiel pourrait être inadéquat ou incomplet pour le type de roche analysée (spectro).
SABADELL (Barcelona), nécropole de Can Gambús-1. 2003. 184. 720.22. Tombe en fosse. Un nucléus en silex, une lame et 2 trapèzes en silex et 2 pointes en os. Petite hache allongée. Section lenticulaire moyenne. Polissage 3. 11,4 x 4,1 x 1,6 cm. Roche très altérée. Structure com-plexe. Amphibolite ?Analyse spectroradiométrique : Barc_085 et Barc_086, Jade-néphrite (+ Cr3+) (Endmember_053, Spectrofa-ciès_143). Densité : 2,88. Origine la plus probable : non déterminée (œil nu) ; les comparaisons sont assez dé-monstratives et indiquent presque toutes Mulegns, dans les Grisons (Suisse) ; mais il y a lieu d’être prudent, car le référentiel utilisé pourrait être inadéquat ou incomplet pour le type de roche analysée (spectro).
SABADELL (Barcelona), nécropole de Can Gambús-1. 2003. 497. 1536. 11. Tombe en fosse. Une spatule en os et 2 pointes de flèche à pédoncule et ailerons. Petite hache triangulaire. Section intermédiaire moyenne. Polis-sage 3. 4,7 x 3,7 x 1,3 cm. Roche fine noirâtre étirée. Amphibolite ?Analyse spectroradiométrique : Barc__089 et Barc_090, Amphibolite_Ca rétromorphosée (+ clinochlore) (End-member_235, Spectrofaciès_141). Origine la plus proba-ble : non alpin (œil nu) ; le spectrofaciès paraît clairement être associé à la localité des Haudères, en Suisse ; néan-moins, il y a lieu d’être prudent, car le référentiel utilisé pourrait être inadéquat ou incomplet pour le type de ro-che analysée (spectro).
SABADELL (Barcelona), nécropole de Can Gambús-1. Tombe en fosse sépulture 167. 268. 16. Associée à 3 nu-cleus en silex + une lame et 2 trapèzes en silex et un col-lier de callaïs. Hache lourde. Section ovalaire moyenne. Polissage 3. Quelques stigmates de taille encore visibles. 13,8 x 7,2 x 3,2 cm. Roche fine noirâtre avec grands cris-taux de même couleur. (fichier JADE 2008_1615).Analyse spectroradiométrique : Barc_082, Éclogite (End-member_239, Spectrofaciès_110). Densité : 3,56. Origine la plus probable : non déterminée (œil nu) ; les spectres des éclogites sont trop peu contrastés pour donner lieu à des comparaisons pertinentes (spectro).
SABADELL (Barcelona), nécropole de Can Gambús-1. 668. 1844. 2. Tombe en fosse. Deux poteries, plusieurs lames de silex et un collier de callaïs. Hache de travail. Proche type Bégude. Section ovalaire épaisse. Polissage 4. 11,6 x 4,5 x 3 cm. Roche type calcaire très corrodé, blanchâtre.Analyse spectroradiométrique : Barc_105 et Barc_106, non déterminé {nd_3 (Roche carbonatée)}. Origine la plus probable : non alpin (œil nu) ; non déterminée (spectro).
SABADELL (Barcelona), nécropole de Can Gambús-1. Tombe en fosse. 2003. 162. 196. 7. Petite hache trapézoïdale à bords droits. Section intermédiaire moyenne. Polissage 4. 4 x 3,4 x 1,1 cm. Roche grise avec lits minces et réguliers. Amphibolite ?Analyse spectroradiométrique : Barc_095 et Barc_096, Ja-déitite parfois quartzo-feldspathique, rétromorphosée dans le faciès des schistes bleus, moins probablement dans celui des schistes verts (Endmember_107, Spectrofaciès_444). Origine la plus probable : non déterminée (œil nu) ; les meilleures comparaisons pourraient indiquer le Viso et plus particulièrement Oncino (Bulè) ; toutefois ces comparaisons sont trop peu nombreuses pour être affirmatif (spectro).
SABADELL (Barcelona), nécropole de Can Gambús-1. 70. 310. 7. Petite hache. Section intermédiaire moyenne. Côtés légèrement dressés. Polissage 3. 5,7 x 3,7 x 1,6 cm. Roche à grain fin noire avec grands cristaux sombres (grenats ?) et d’autres gris bleuté. Eclogite ?Analyse spectroradiométrique (M. Errera) : Barc_087 et Barc_088, Omphacitite, omphacitite jadéitique, ompha-citite légèrement rétromorphosée (Endmember_234, Spectrofaciès_111). Densité : 3,42. Origine la plus pro-bable : non déterminée, mais alpin possible (œil nu) ; les spectres des omphacitites sont trop peu contrastés pour donner lieu à des comparaisons pertinentes (spectro).
SABADELL (Barcelona), environs de Sabadell. Musée d’Histoire de Sabadell, n° 2664.9. Petite hache. Section intermédiaire moyenne. Polissage 3. 6,2 x 3,7 x 1,3 cm. Roche fibreuse blanc gris ? Fibrolite probable ?Analyse spectroradiométrique : Barc_056 et Barc_057, Fi-brolite (gneiss à sillimanite) (Endmember_001, Spectrofa-ciès_132). Densité : 3,18, sillimanite. Origine la plus probable : non alpin (œil nu) ; pas de référentiel adéquat (spectro).
SANT JOAN DESPÍ (Barcelona), Sant Joan Despí, sé-pulture en fosse rectangulaire. Musée d’Archéologie de Catalogne à Barcelone, n° 16365. Petite hache trapézoï-dale à section intermédiaire moyenne. 5,2 x 3,8 x 1,0 cm. Roche vert foncé, étirée. Inconnu ?Analyse spectroradiométrique : Barc_031 et Barc_032, Amphibolite_Ca rétromorphosée (+ clinochlore) (Endmem-ber_235, Spectrofaciès_141). Origine la plus probable : non alpin (œil nu) ; le spectrofaciès paraît clairement être associé à la localité des Haudères, en Suisse ; néanmoins, il y a lieu d’être prudent, car le référentiel utilisé pourrait être inadé-quat ou incomplet pour le type de roche analysée (spectro).
DEUXIÈME PARTIE
916 Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
SANT JOAN DESPÍ (Barcelona), Sant Joan Despí, sé-pulture en fosse rectangulaire. Musée d’Archéologie de Catalogne à Barcelone, n° 16366. Petite hache trapézoï-dale. Section intermédiaire moyenne. 4,2 x 3,4 x 1,1 cm. Roche vert moyen à inclusions blanches. Inconnu ?Analyse spectroradiométrique : Barc_033, Pyroxénite (calcique ?) micacée faiblement rétromorphosée (épi-dote) (Endmember_190, Spectrofaciès_002). Origine la plus probable : non déterminée (œil nu) ; si la source est très probablement le Viso (Crissolo, Oncino, etc.), les caractères particuliers éventuels du spectrofaciès sont sans doute masqués par la dominance d’un miné-ral du groupe des épidotes ; les spectrofaciès similai-res provenant du Val d’Aoste ou du Val de Bagnes sou-lignent un spectrofaciès probablement relativement ubiquiste dans le domaine alpin, mais peut-être aussi en dehors (spectro).
SANTA EULALIA DE RONÇANA (Vallès oriental, Barcelona), découverte de surface. Dpt de Pehisto-ria, Université Autonome de Barcelona, N° SEAV-35. Fragment de tranchant de hache. Type Puy. Section quadrangulaire. 3,1 cassé x 1,5 cassé x 1,3 cm cassé. Roche à grain fin un peu hétérogène, vert moyen avec points verts foncés, minéraux rougeâtres (grenats ?), éclogite ou jadéitite à grenats, type Viso Bulè (fichier JADE 2008-1617).Analyse spectroradiométrique : Barc_107, Éclogite (quart-zite, gneiss ou schiste si la densité est comprise entre 2,60 et 2,80) (Endmember_239, Spectrofaciès_110). Ori-gine la plus probable : Viso (œil nu) ; les spectres des éclogites sont trop peu contrastés pour donner lieu à des comparaisons pertinentes (spectro).
SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Barcelona), Bòbila Ma-durell, sépulture M 5. n°129 .13. Musée d’Histoire de Sabadell. Hache. Type Chelles avec côtés droits vers le tranchant qui suggèrent plutôt un type Puy repris par pi-quetage au talon. Talon bouchardé post polissage. Polis-sage 4, légèrement brillant. Deux stigmates de taille sur la même face. Une fissure d’extraction thermique. 13,7 x 4,6 x 2,5 cm. Jadéitite saccharoïde vert pâle mat à nom-breux petits points vert moyen, type Viso Porco (fichier JADE 2008_1618).Analyse spectroradiométrique : Barc_074 et Barc_075, Jadéitite typique légèrement rétromorphosée (Endmem-ber_224, Spectrofaciès_340). Densité : 3,36. Origine la plus probable : Viso Porco (œil nu) ; les comparaisons les plus convaincantes indiquent toutes que le Viso et plus particulièrement Oncino (Porco, Bulè, etc.) ; mais d'autres sources doivent être considérées (spectro).
SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Barcelona), Bòbila Madu-rell, sépulture M 5. n° 78 .14. Musée d’Histoire de Saba-dell. Tranchet trapézoïdal entièrement poli . Section ova-laire mince. Polissage 3. 3,9 x 3,9 x 1 cm. Roche verdâtre à grain fin. Proche amphibolite de la vallée de l’Aude ? (fichier JADE 2008_1619).Analyse spectroradiométrique : Barc_072 et Barc_073, Néphrite rétromorphosée (+ clinochlore) (Endmember_015, Spectrofaciès_142). Origine la plus probable : non alpin, vallée de l’Aude ? (œil nu) ; la meilleure comparaison avec le référentiel utilisé se fait avec un échantillon de la mine d’Ur, à Poschiavo, dans les Grisons (Suisse) ; mais il y a lieu d’être prudent, car le référentiel pourrait être inadé-quat ou incomplet pour le type de roche analysée (spectro).
SANT QUIRZE DEL VALLÈS (Barcelona), Bòbila Ma-durell, sépulture M 5. n° 78 .14. Musée d’Histoire de Sabadell. Hache de travail. Bords droits. Type Puy sp. Section épaisse. Polissage 4. 8,6 x 5,5 x 2,2 cm. Ro-che proche serpentine vert foncé bleuté avec quelques rectangles blancs.Analyse spectroradiométrique : Barc_071, Serpentinite (antigorite) (Endmember_142, Spectrofaciès_150). Den-sité : 2,67. Origine la plus probable : alpin possible (œil nu) ; pas de référentiel adéquat (spectro).
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA (Barcelona), Bòbila de Bellsolà, sépulture 1. Musée d’Archéologie de Catalogne à Barcelone, n° 16410. Grande hache sciée. Type Puy. Section quadrangulaire moyenne. Polissage 3, stigmates de taille, sciage, trait régulier à fond rond, sciage bilatéral alterne, traces d’éclatement avant polissage.14 ,7 x 4, 8 x 2 cm. Roche fine vert foncé cru translucide, quelques points blancs, type Viso ? (fichier JADE 2008_1620).Analyse spectroradiométrique : Barc_070, Amphi-bolite_Ca rétromorphosée (+ clinochlore) (Endmem-ber_235, Spectrofaciès_141). Origine la plus probable : Alpes (œil nu) ; le spectrofaciès paraît clairement être associé à la localité des Haudères, en Suisse ; néan-moins, il y a lieu d’être prudent, car le référentiel utilisé pourrait être inadéquat ou incomplet pour le type de roche analysée (spectro).
DEUXIÈME PARTIE
917Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique - Chapitre 15 - Les haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
Jade Grandes haches alpines du Néolithique européen Ve et IVe millénaires av. J.-C.
Photo : P. Pétrequin.
La Bisbal de Ampurdàn, Espagne
Collbato, Espagne
DEUXIÈME PARTIE
JADEGrandes haches alpinesdu Néolithique européen. Ve et IVe millénaires av. J.-C.
© Presses Universitaires de Franche-Comté n°1224Collection Les cahiers de la MSHE Ledoux n°17Série Dynamiques territoriales n°6
UFR des Sciences du Langage, de l'Homme et de la Société47, rue Mégevand - 25030 Besançon cedex
© Centre de Recherche Archéologique de la Vallée de l'Ain - 201269, Grande Rue - 70100 Gray
DiffusionCID : 18-20, rue Robert Schuman - 94220 Charenton-le-Pont
ISBN : 978-2-84867-412-4ISSN : 1772-6220
2012
sous la direction de Pierre Pétrequin, Serge Cassen, Michel Errera, Lutz Klassen, Alison Sheridan et Anne-Marie Pétrequin
Tome 2
PAO, conception et réalisation : Claude Schmitt - Arcom
748 Sommaire tome 1 et 2
Sommaire
tome 18
16
25
26
27
46
184
214
258
292
420
440
Remerciements
ProblématiquePierre PétrequinJADE : Inégalités sociales et espace européen au Néolithique : la circulation des grandes haches en jades alpins
A propos des archives et des bases de données
PREMIERE PARTIE : Sources de matières premières
Chapitre 1Anne-Marie Pétrequin et Pierre PétrequinLes modèles ethnoarchéologiques de Nouvelle-Guinée
Chapitre 2Pierre Pétrequin, Anne-Marie Pétrequin, Michel Errera et Frédéric ProdéoProspections alpines et sources de matières premières. Historique et résultats
Chapitre 3Pierre Pétrequin, Christophe Croutsch, Michel Errera, Matthieu Honegger, Luc Jaccottey, François Mariétoz et Pierre-Jérôme ReyApproche des productions valaisannes en amphibolite calcique (néphrite)
Chapitre 4Pierre Pétrequin et Anne-Marie PétrequinChronologie et organisation de la production dans le massif du Mont Viso
Chapitre 5Pierre Pétrequin, Christophe Bontemps, Daniel Buthod-Ruffier et Nicolas Le MauxApproche expérimentale de la production des haches alpines
Chapitre 6 Pierre Pétrequin, Michel Errera et Michel Rossy avec la collaboration de Claudio D'Amico et Massimo GhediniViso ou Beigua : approche pétrographique du référentiel des "jades alpins"
Chapitre 7Claudio D'AmicoJades and other greenstones from the Western Alps. A petrographic study of the geological sampling Jade
Chapitre 8Michel Errera, Pierre Pétrequin et Anne-Marie PétrequinSpectroradiométrie, référentiel naturel et étude de la diffusion des haches alpines
534
535
544
574
728
750
822
872
918
996
DEUXIEME PARTIE : Les haches en jades, de l'Italie à l'Atlantique
Chapitre 9Pierre PétrequinUne source de confusion : les haches ethnographiques et les réutilisations tardives dans les séries néolithiques européennes
Chapitre 10Pierre Pétrequin, Estelle Gauthier, Luc Jaccottey,Françoise Jeudy, Alain Maitre et Jean VaquerLes exploitations de Réquista (Aveyron) et de Plancher-les-Mines (Haute-Saône, France).Exemples de diffusion de haches à moyenne distance
Chapitre 11Pierre Pétrequin, Serge Cassen, Estelle Gauthier, Lutz Klassen, Yvan Pailler et Alison Sheridan avec la collaboration de Jonathan Desmeulles, Pierre-Alain Gillioz, Nicolas Le Maux, Annabelle Milleville, Anne-Marie Pétrequin, Frédéric Prodéo, Anaïck Samzun et Ramon Fabregas ValcarceTypologie, chronologie et répartition des grandes haches alpines en Europe occidentale
Chapitre 12Claudio D'Amico and Elisabetta StarniniCirculation and provenance of the Neolithic "greenstone" in Italy
tome 2Chapitre 13Michel Errera, Pierre Pétrequin et Anne-Marie PétrequinOrigine des jades alpins entre Provence et Adriatique
Chapitre 14Maria Bernabò Brea, Michel Errera, Paola Mazzieri, Simone Occhi et Pierre PétrequinLes haches alpines dans la culture des VBQ en Emilie occidentale : contexte, typologie, chronologie et origine des matières premières
Chapitre 15Jean Vaquer, Araceli Martín, Pierre Pétrequin, Anne-Marie Pétrequin et Michel ErreraLes haches alpines dans les sépultures du Néolithique moyen pyrénéen : importations et influences
Chapitre 16Serge Cassen, Christine Boujot, Salvador Dominguez Bella, Mikaël Guiavarc'h, Christophe Le Pennec, Maria Pilar Prieto Martinez, Guirec Querré, Marie-Hélène Santrot et Emmanuelle VigierDépôts bretons, tumulus carnacéens et circulations à longue distance
Chapitre 17Peter A.C. Schut and Henk KarsJade axes in the Netherlands : some observations concerning distribution, date and typology
749Sommaire tome 1 et 2
1014
1015
1046
1088
1108
1136
1168
1194
1208
TROISIEME PARTIE : Les signes en jades alpins et leurs imitations
Chapitre 18Pierre Pétrequin, Serge Cassen, Lutz Klassenet Ramon Fábregas ValcarceLa circulation des haches carnacéennes en Europe
Chapitre 19Alison Sheridan et Yvan PaillerLes haches alpines et leurs imitations en Grande-Bretagne, dans l'île de Man, en Irlande et dans les îles Anglo-Normandes
Chapitre 20Christian Servelle et Jean VaquerImitations et contrefaçons de longues haches polies d’origine alpine dans le Néolithique du sud-ouest de la France et de l’Andorre
Chapitre 21Ramón Fábregas Valcarce, Arturo de Lombera Hermida and Carlos Rodríguez RellánSpain and Portugal : long chisels and perforated axes. Their context and distribution
Chapitre 22François Giligny, Françoise Bostyn et Nicolas Le MauxProduction et importation de haches polies dans le Bassin parisien : typologie, chronologie et influences
Chapitre 23Yvan PaillerL’exploitation des fibrolites en Bretagne et ses liens avec les productions alpines
Chapitre 24Mark EdmondsAxes and Mountains : a view from the West
Chapitre 25Florian Klimscha« Des goûts et des couleurs, on ne discute pas ». Datation, répartition et valeur sociale des haches en silex de la culture Gumelniţ a
1230
1231
1280
1310
1354
1424
1425
1438
1462
1504
QUATRIÈME PARTIE : Valorisation sociale des haches alpines
Chapitre 26Pierre Pétrequin, Serge Cassen, Michel Errera, Tsoni Tsonev, Kalin Dimitrov, Lutz Klassen et Rositsa MitkovaLes haches en « jades alpins » en Bulgarie
Chapitre 27Lutz Klassen, Serge Cassen and Pierre PétrequinAlpine axes and early metallurgy
Chapitre 28Serge CassenL’objet possédé, sa représentation : mise en contexte général avec stèles et gravures.
Chapitre 29Pierre Pétrequin, Serge Cassen, Michel Errera, Lutz Klassen et Alison SheridanDes choses sacrées… fonctions idéelles des jades alpins en Europe occidentale
CINQUIÈME PARTIE : Résumé général et bases de données
Résumé / AbstractPierre Pétrequin, Serge Cassen, Michel Errera, Lutz Klassen, Anne-Marie Pétrequin et Alison Sheridan
Inventaire 2008 des associations de grandes haches en jades en Europe occidentalePierre Pétrequin, Serge Cassen, Michel Errera, Lutz Klassen, Yvan Pailler, Anne-Marie Pétrequin et Alison Sheridan
Planches dessin des grandes haches trouvéesen dépôtPierre Pétrequin, Annabelle Milleville et Anne-Marie Pétrequin
A propos des auteurs et des collaborateurs
tome 2