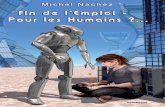62 Dépots humains en fosse circulaire Néolithique récent
Transcript of 62 Dépots humains en fosse circulaire Néolithique récent
Morts anormaux et sépultures bizarresLes dépôts humains en fosses circulaires ou en silos
du Néolithique à l’âge du FerActes de la IIe table ronde interdisciplinaire « Morts anormaux et sépultures bizarres :
questions d’interprétation en archéologie funéraire »29 mars - 1er avril 2006, Sens
Sous la direction deLuc Baray et Bruno Boulestin
Préfaced’Alain Gallay
Éditions Universitaires de DijonCollection Art, Archéologie & Patrimoine
Dijon, 2010
Ouvrage publié avec le soutien du Centre de Recherche et d’Étude du Patrimoine-Musées de Sens, de l’Agence Nationale de la Recherche et de l’UMR-CNRS 5594 ARTeHIS
IntroductionDans une vaste zone qui dessine un croissant reliant le Midi de la France à laPologne, l’horizon 4500 – 35001 voit l’épanouissement d’une nouvelle manièrede traiter les morts. En témoignent des restes humains déposés dans des fossescirculaires souvent assimilées à des silos. Ces restes – squelettes complets, partiesde squelettes ou ossements isolés – se trouvent sur le fond de la structure ou dansson remplissage. Ils appartiennent à un ou plusieurs individus. Dans le secondcas, on observe des configurations variées, mais qui présentent malgré toutquelques constantes. L’examen de ces dernières est l’un des objectifs prioritairesde cet article. (Fig. 1).La période traitée correspond à une division appelée, selon les systèmeschronologiques, Néolithique récent, Néolithique moyen II (NM II) ouChalcolithique ancien. La distinction entre NM I et NM II n’est pas pertinentepour l’Europe centrale, où se situent la majorité des cultures concernées. Lanotion de Chalcolithique présente des contenus très variables selon les milieuxde recherche ; elle est, en outre, chargée de connotations sociales et historiquestrop lourdes dès lors que l’objectif est simplement de disposer d’une expressionla plus neutre possible pour désigner un horizon chronologique, et rien de plus.J’ai donc choisi, m’alignant sur le système chronologique de l’Allemagne du Sud,de parler de « Néolithique récent » pour désigner la période couverte par cetteétude. (Fig. 2).Les principales entités concernées sont, d’ouest en est, le Chasséen, les culturesde Michelsberg, de Munzingen, de Münchshöfen et d’Altheim, le groupe deLudanice (Lengyel tardif) et l’étape ancienne du complexe culturel dit « desvases à col en entonnoir » (TRBK)2, représentée principalement par la culture deBaalberge. L’extension géographique du phénomène est présentée sur la carte dela figure 2.
Les sépultures en fosses circulaires del’horizon 4500 – 3500 : contribution àl’étude comparée des systèmes funéraires duNéolithique européen
Les spécialistes ont proposé différentes interprétations du phénomène. Pour sefaire une idée des péripéties de ce débat, on consultera avec profit le travail deC. Nickel (1997). Pour certains, par exemple C. Nickel, il ne saurait être questionde véritables sépultures. Les restes humains déposés dans des fosses circulairesconsidérées comme des fosses de stockage désaffectées constituent pour eux lereflet de pratiques marginales qui, de par leur diversité, échappent à toutetentative de synthèse. À l’opposé, J. Lichardus considère les documents recueillispour la culture de Michelsberg comme de véritables sépultures implantées dansdes fosses creusées spécialement pour accueillir les dépôts humains (Lichardus,1986). Pour le site éponyme de la culture de Michelsberg, il s’appuie sur larépartition des fosses à dépôts humains pour suggérer l’existence de véritablesnécropoles étroitement associées aux habitats. Son analyse sommaire, appuyéele plus souvent sur des descriptions peu fiables, est cependant loin d’emporter laconviction. Le renouveau viendra du sud, avec les études impulsées parA. Beeching (Crubézy, 1991 ; Beeching, Crubézy, 1998 ; Beeching, 2003) sur labase de ses fouilles dans la vallée du Rhône. On y découvre que lesconfigurations observées en Europe centrale existent également dans leChasséen méridional et, grâce à la finesse des observations de terrain, quecertains des dépôts observés ne doivent manifestement rien au hasard. L’idéequ’une partie au moins de ces fosses circulaires ont accueilli de véritablessépultures s’en trouve naturellement renforcée. Mon objectif ici n’est ni de passer en revue tous les travaux sur la question, nide livrer un catalogue exhaustif des dépôts humains en fosse circulaire de la zoned’étude. Plus modestement, je me propose premièrement de passer en revuequelques exemples significatifs dans le but de délimiter le plus précisémentpossible les limites du phénomène et, deuxièmement, de mener une brèveréflexion sur la manière dont il s’insère dans le « paysage funéraire » de l’Europecentrale et occidentale entre 4500 et 3500.
38
Fig. 2 – Extension de la zone d’étude avec indication des principaux groupes culturels.
Caractérisation du phénomène
Lorsque la fosse livre un individu unique, il est le plus souvent en position fléchie(fig. 3, n° 1 à 3), membres inférieurs et supérieurs repliés. Cette positioncorrespond à celle de la grande majorité des sépultures « régulières »3 connuespour les cultures de notre domaine, et nous utiliserons dorénavant l’adjectif« conventionnelle » pour la désigner. Pour ce qui est de la culture de Michelsberg,où les « vraies » sépultures sont plus rares que, par exemple, en contexteBaalberge ou Chasséen, on citera une tombe découverte récemment en Alsace(Tristan, 2003) et la tombe de Velka Ves (Bohême ; Nickel, 1997, pl. 23 n° 2).
39
Fig. 3 – Exemples de dépôts individuels. 1, Holtzheim « Altmatt »(Michelsberg ou Munzingen) ; 2, Oberderdingen (Michelsberg) ;3 et 4, Mundolsheim (Munzingen). 1, d’après Lefranc, 2001 ; 2, d’après Stauch, Banghard, 2002 ; 3 et 4, d’après Blaizot, 2001.
Le site Munzingen récemment fouillé à Didenheim-Morschwiller (Haut-Rhin) alivré trois cas de dépôts multiples (Denaire, à paraître). La fosse 1 de la zone 1(fig. 4) contenait un adulte en position conventionnelle qui reposait sur les restesmal conservés d’un enfant en bas âge. Notons au passage que la déconnexionqui a éloigné le crâne et la mandibule de l’adulte du reste du squelette a étéprovoquée par le creusement d’un terrier. Des tessons de deux vases setrouvaient au même niveau que les squelettes.
40
Fig. 4 – Didenheim-Morschwiller, structure 1 (zone 1) ; plan et profil schématique (doc. Antea Sarl).
La fosse 8 de la zone 2 (fig. 5) présente une configuration plus complexe. Sur lefond de la structure reposaient les squelettes de deux individus, l’un en positionconventionnelle et privé de son crâne (ind. 1), l’autre en position désordonnée(ind. 2) montrant des déplacements d’os qui suggèrent une interventionpostérieure à la décomposition du corps. Comme le montre bien la présence dedeux crânes, les restes éparpillés au-dessus des individus 1 et 2 proviennent dedeux individus supplémentaires, un adulte et un troisième enfant. Il peutnaturellement s’agir de dépôts secondaires, mais rien ne permet, là encore,d’exclure l’éventualité de manipulations in situ.
41
Fig. 5 – Didenheim-Morschwiller, structure 8 (zone 2) ; plan général et détail des quatre individus (doc. Antea Sarl).
42
Fig. 6 – Didenheim-Morschwiller, structure 28 (zone 3) ; plan et profil schématique (doc. Antea Sarl).
Fig. 7 – Didenheim-Morschwiller, structure 28 (zone 3) ; détail des quatre individus (doc. Antea Sarl).
La fosse 28 de la zone 3 a livré les restes de quatre individus (fig. 6 et 7). Lesindividus 1, 2 et 3 ont été empilés les uns sur les autres dans l’ordre suivant : unadulte en position désordonnée (ind. 1) qui reposait une dizaine de cm au-dessusdu fond de la structure était recouvert par le squelette d’un second adulte enposition repliée (ind. 2), lui-même étant recouvert par le squelette partiellementdisloqué d’un enfant (ind. 3). À côté de ce paquet compact, au même niveau,reposaient les restes déstructurés d’un second enfant (ind. 4) qui correspond soità un dépôt secondaire, soit à une manipulation sur place de type « rangement ».Près du bord sud de la fosse, devant le visage de l’individu 2, se trouvaient ungobelet en bois de cerf et un grand fragment de vase.Le dénominateur commun de ces trois ensembles est qu’ils contiennent chacunun individu en position conventionnelle associé à un nombre variable d’individusen position désordonnée. Cette configuration est manifestement récurrente dansnotre domaine d’étude. Parmi les exemples les plus parlant figurent les « tombes »1 et 5 du site fossoyé Michelsberg de Bruchsal (Nickel, 1997) et la structure 2d’Inningen (Bavière, culture d’Altheim). La structure 1 de Bruchsal a livré lesrestes de neufs individus. La partie supérieure du dépôt a malheureusement étéperturbée par des fouilles clandestines, ce qui explique pourquoi la position del’enfant d’environ 5 ans dont elle a livré les restes n’est pas connue.Immédiatement en dessous étaient regroupés les restes d’un homme, de cinqenfants et d’un nouveau-né. Les descriptions disponibles sont peu précises, maison sait que l’un au moins de ces squelettes (celui de l’adulte) était disloqué. Souscet ensemble, apparemment isolé par une couche de sédiments peu épaisse,reposait le squelette d’un homme adulte en position conventionnelle. Dans la« tombe 5 » du même site, un enfant de 5 à 6 ans en position conventionnellevoisinait (au même niveau), avec une femme adulte déposée sur le ventre enposition désordonnée. La fosse 2 d’Inningen ( Nickel, 1997, pl. 23) a livré undépôt compact contenant six squelettes « complets », des os isolés de plusieursautres individus et de la faune. Un squelette d’adulte en position repliée étaitcomme posé sur les autres squelettes, tous en position désordonnée. Le modèle qui ressort de ce rapide examen peut se décliner comme suit :- position fléchie comme norme dans toute la zone d’étude ; cette norme estappliquée aussi bien dans les sépultures « régulières » que dans les dépôtshumains en fosses circulaires ;- dans le cas des dépôts multiples en fosses circulaires, la configuration la pluscourante voit l’association d’un individu en position conventionnelle et d’unnombre variable d’individus en position désordonnée4 ;- les trois cas de figures les plus courants sont les suivants : A, individu seulen position conventionnelle ; B, individu seul en position nonconventionnelle ; C, dépôt multiple avec un individu en position repliée, lesautres en position désordonnée ;- un décompte précis des proportions relatives de ces trois configurationsreste à faire. Pour s’en tenir à deux complexes comprenant chacun plusieursstructures et fouillés récemment, on remarquera pour le site Michelsberg deBruchsal un ensemble équilibré comportant deux dépôts de type A, deux detype B et deux de type C et pour le site de Didenheim-Morschwiller uncomplexe à trois ensembles de type C ;- l’existence d’une norme et le caractère récurrent des configurationsidentifiées nous autorisent à qualifier de « sépulcrales » les pratiquescorrespondantes et à assimiler à des sépultures les dépôts humains en fossecirculaire du Néolithique récent ;- les dépôts multiples décrits montrent tous une asymétrie entre l’individu enposition conventionnelle et les autres. Cette différence de traitement pourraitrefléter une situation de type « mort(s) d’accompagnement » (Testart, 2004).
43
Lorsque la structure comporte plusieurs squelettes, ils sont le plus souventgroupés sur un seul niveau. Mais on connaît également des cas de dépôtssuccessifs. Cette configuration est illustrée par la fosse Lengyel tardif de BajcRagona (fig. 8), par une fosse Munzingen de Riedisheim Violettes » (Haut-Rhin ;Schweitzer, Fulleringer, 1973), par la fosse chasséenne « EDF6 » du site deMontélimar « Le Gournier » (Crubézy, 1991) et par au moins une structurechasséenne du site du Crès à Béziers (Hérault ; Loison et al., 2003). Dans lesquatre cas, les différents épisodes de dépôt sont clairement séparés par dessédiments.
Il existe également des fosses dans lesquelles des parties de squelettes ou des osisolés voisinent avec des squelettes complets. Outre l’exemple de Didenheim-Morschwiller (fosse 8 de la zone 2) décrit plus haut, c’est le cas par exemple àHoltzheim « am Schluesselberg » (Bas-Rhin ; culture de Michelsberg ou deMunzingen), où les deux individus d’un dépôt de type C étaient accompagnés
44
Fig. 8 – Bajc-Ragona (Slovaquie) ; groupe de Ludanice (vers 4400 – 4200 av. J.-C.) (d’après Tocik, 1991).
du crâne d’un troisième individu (Kuhnle et al., 2000). Une fosse de la culturede Münchshöfen découverte sur le site bavarois de Grossmehring nous montreque ce type de situation peut se révéler encore beaucoup plus complexe (fig. 9).Ces configurations peuvent résulter du dépôt de corps ou de squelettesincomplets ou d’ossements isolés, mais également d’interventions dans la fossepostérieures à la décomposition des corps. Des remaniements qui auraient alorsété facilités par des dispositifs de protection dont l’existence est démontréeindirectement par des indices de décomposition en espace non colmaté. De telsindices sont attestés sur le site Michelsberg de Rosheim (Boës, ce volume) ainsique pour les sites chasséens de Montélimar « Le Gournier » (Crubézy, 1991),Saint-Paul-Trois-Châteaux « Les Moulins » (Beeching, Crubézy, 1998) et Béziers« Le Crès » (Loison et al., 2003). Ils pourraient expliquer aussi certaines descaractéristiques des structures 8 (zone 2) et 28 (zone 3) de Didenheim-Morschwiller.
45
Fig. 9 – Grossmehring (Bavière) ; culture de Münchshöfen (4500 – 3800) (d’après Schröter, 1997)
La présence de mobilier funéraire est facultative, mais, en cela, notre corpus nese distingue en rien de la plupart des nécropoles du Néolithique européen. Onrelèvera, par exemple, la présence de mobilier dans les sépultures simples enfosse circulaire de Mundolsheim (Munzingen ; Blaizot, 2001) etd’Oberderdingen (Michelsberg ; Stauch, Banghard, 2002) ainsi que dans l’uneau moins des sépultures multiples de Didenheim-Morschwiller (Munzingen). Onmentionnera également une sépulture du site de Rosheim (Michelsberg ; voirdans Boës, ce volume) et la sépulture de la structure 69 de Saint-Paul-Trois-Châteaux (Crubézy, 1991 ; Beeching, Crubézy, 1998).Même si les quelques études dignes de ce nom effectuées sur des ensembles àplusieurs individus ont conduit à les interpréter comme des sépultures multiples,les indices de manipulation postérieure à la décomposition des corps et les cas dedécomposition en espace non colmaté laissent la porte ouverte à d’éventuellespratiques de type « sépulture collective », autrement dit à la possibilité qu’unesépulture demeurée accessible ait pu connaître plusieurs épisodes de dépôt. Parailleurs, la possibilité de « dépôts simultanés d’individus décédéssuccessivement », évoquée à propos de la fosse chasséenne « EDF6 » deMontélimar (Crubézy, 1991) est illustrée également par le dépôt secondaire dela structure 28/3 de Didenheim-Morschwiller. Bien qu’il ne présente aucun pointde contact avec les autres squelettes, ce dépôt se situe clairement au même niveauque ces derniers. Tout porte donc à croire qu’il a été mis en terre en même temps.La présence d’un individu dont l’état indique qu’il est décédé avant l’individu« central » (celui qui présente une position conventionnelle) n’est pas compatibleavec le modèle du (ou des) mort(s) d’accompagnement mentionné plus haut. Àmoins, bien sûr, d’admettre que le groupe des « accompagnants » puisse secomposer au moins en partie d’individus dont la mort n’est pas une conséquencedirecte de celle du personnage central.La présence occasionnelle de restes animaux doit également être mentionnée.Dans les principales cultures de notre aire d’étude, les fosses circulaires livrentaussi des squelettes d’animaux en connexion, seuls ou associés à des humains,avec au sans mobilier « funéraire ». La recension exhaustive des squelettesanimaux et des assemblages humain(s) – animal(aux) reste à faire. On secontentera ici de souligner que les espèces qui apparaissent le plus régulièrementsont le chien, le cochon et le bœuf (fig. 10). L’exemple le plus spectaculaireappartient à la culture de Baalberge. Il s’agit d’une fosse du site de Weissenfels(Saxe-Anhalt ; Preuss, 1966) dans laquelle quatre humains cohabitaient avec lesrestes de 24 bovins et de 20 chiens, certains de ces animaux se présentant sousla forme de squelettes complets.La cohérence de l’ensemble ne fait pour moi aucun doute, les mêmesconfigurations se répétant d’un bout à l’autre du domaine d’étude. Voicicomment on peut résumer les principales caractéristiques de cette pratiquefunéraire originale :1. les morts sont inhumés dans des fosses circulaires dont certaines peuventêtre des fosses d’habitat recyclées ;2. ces fosses sont manifestement implantées au sein des habitats, où ellesvoisinent toujours avec d’autres fosses circulaires dépourvues de dépôtshumains ;3. nous avons donc, selon toute vraisemblance, affaire à une variante de lapratique consistant à enterrer les morts dans la maison ou a proximitéimmédiate de la maison, dans un périmètre que l’on peut qualifier d’espacedomestique ;4. ces ensembles funéraires sont composés d’un ou plusieurs individus etrésultent d’un ou plusieurs épisodes de dépôt. Sauf erreur de ma part, la
46
47
Fig. 10 – Exemples d’associations homme – animal dans la TRBK de Moravie (Culture de Baalberge, vers 4000-3600 av. J.-C.) (d’après Smid, 2002).
structure la plus prolifique est la fosses 118 du site éponyme de la culture deMichelsberg (dans le Bade-Wurtemberg), qui a livré les restes de18 individus5 ;5. les structures à plusieurs dépôts espacés dans le temps, et, dans une moindremesure, les manipulations observées sur des squelettes dont certains se sontmanifestement décomposés en espace non colmaté, suggèrent l’idée d’unfonctionnement assimilable, par certains côtés, à celui des sépulturescollectives6 ;6. dans le cas des dépôts multiples, la configuration la plus courante est cellequi rassemble un individu en position conventionnelle et un ou plusieurssquelettes en position désordonnée ;7. la présence de corps incomplets, de segments corporels, d’ossements isoléset de dépôt secondaire ajoute à la complexité d’ensemble. La manipulationdes corps, qu’elle se passe en amont, avant l’enfouissement des restes, oudans la fosse sépulcrale, constitue manifestement un élément important dusystème funéraire dont nous cherchons à cerner les contours ;8. le dépôt de corps, de parties de corps ou de restes isolés d’animaux aprobablement partie liée à ce même système. Les dépouilles animales sontdéposées dans le même type de structures, associées ou non à des resteshumains, selon une dialectique qui nous échappe encore ;9. le dépôt en fosse circulaire ne concerne manifestement pas l’ensemble dela population. Mais les grands décapages de l’archéologie préventive, enmultipliant le nombre de cas, nous montrent que l’écart entre la populationtotale et la fraction enfouie n’est peut-être pas significativement différent dece qu’il est dans des cultures néolithiques « à nécropoles » extérieures à notrecomplexe ;10. la population inhumée en fosse circulaire peut être répartie en cinq sousgroupes : A, les individus enterrés seuls en position conventionnelle ; B, lesindividus enterrés seuls en position non conventionnelle ; C, les individus« centraux » des sépultures multiples ; D, les « accompagnants » des sépulturesmultiples ; E, les individus dont seule une partie du squelette est présente dansla fosse. Les groupes B et D partagent le caractère « position désordonnée ».
On peut voir à travers cette énumération que de nombreuses incertitudessubsistent. Rares demeurent en effet les structures qui ont bénéficié desméthodes de fouille et d’enregistrement actuellement préconisées, et il faudraattendre de disposer d’un plus grand nombre de cas « sûrs » pour espéreratteindre une compréhension plus fine du phénomène.
Fosses circulaires et chambres sépulcralesL’existence de cas de décomposition en espace non colmaté et de manipulationspostérieures au décharnement des corps figurent parmi les résultats les plusintéressants des fouilles récentes réalisées « dans les règles de l’art ». Si l’on songe,par ailleurs, que l’une des grandes nouveautés du système funéraire duNéolithique récent par rapport à ceux qui l’ont précédé est cette manière d’enterrerplusieurs corps dans une structure de forme circulaire, le cas échéant en plusieursdépôts espacés dans le temps, on ne peut s’empêcher de faire le rapprochementavec le fonctionnement d’un autre type de structure appartenant au même horizonchronologique, à savoir les chambres funéraires de plan circulaire caractéristiquesdes tombes à couloir de l’ouest de la France. De fait, la liste des caractéristiquesénumérées plus haut à propos des fosses circulaires recoupe en grande partie cellequ’a établie récemment P. Chambon à propos des tombes à couloir appartenantau millénaire qui nous intéresse ici (Chambon, 2003).
48
La première analogie concerne la forme du contenant. Alors que les tombes oules chambres sépulcrales des périodes antérieures et postérieures sont toujours deplan ovale ou quadrangulaire, l’horizon 4500 – 3500 est le seul à user destructures circulaires, et ce trait est partagé par les cultures de notre zone d’étudeet les constructeurs de tombes à couloir de l’ouest de la France. Dans leschambres sépulcrales de cette région, les individus sont déposés en positionfléchie ; on y trouve des squelettes partiels, des squelettes disloqués, des indicesde manipulation postérieure au décharnement des corps, de déplacement, deprélèvement à l’occasion d’une réouverture de la sépulture ; certains indiceslaissent supposer l’existence de dépôts successifs de groupes d’individus, ouencore de dépôts simultanés d’individus qui ne sont pas morts en même temps ;les mobiliers y sont pauvres et de composition très variée. Inutile, je l’espère,d’insister sur les ressemblances entre cette liste de caractéristiques tirée du travailde P. Chambon et ce que nous avons écrit plus haut à propos des dépôts enfosses circulaires.Il ne faut cependant pas oublier que, dans les deux complexes, nombreux sontles faits ambigus, et cela y compris dans les structures ayant bénéficié de
49
Fig. 11 – Exemples de chambres funéraires de tombes à couloir de l’ouest de la France. 1. Fontenay-le-Marmion « La Hoguette » (Calvados), chambre I ;2 et 3. Condé-sur-Ifs « La Bruyère du Hamel », chambres B et C(d’après Dron et al., 2003).
méthodes de fouille « modernes ». Cependant, loin d’affaiblir le raisonnement,cette ambiguïté partagée vient enrichir la liste déjà longue des traits communs.Les interrogations que formulent Chambon à propos des chambres du tertre deLa Hoguette ou de l’une des chambres des tumulus de Bougon se posent dansles mêmes termes pour certaines de nos tombes en fosse circulaire. Il s’agit, dansle premier cas, de savoir si les sépultures sont collectives ou multiples et, dans lesecond, si on a affaire à une sépulture multiple suivie d’interventions sur lessquelettes, à une sépulture collective ou au « dépôt simultané d’individus décédéssuccessivement » (Chambon, 2003, p. 68 et 78)7. L’objection de la rareté destombes en fosses relativement aux sépultures en chambres circulaires de l’ouestn’est aujourd’hui plus de mise. On assiste, grâce au développement del’archéologie préventive, à une multiplication des sépultures en fosse. Et, si cetaccroissement du corpus nous a permis de montrer que nous n’étions pas enprésence d’une pratique marginale et aléatoire, elle nous révèle aussi qu’il n’y aplus aucune raison de penser qu’elle concernait un pourcentage de la populationinférieur à celui que représentent, dans leur aire, les individus inhumés dans leschambres circulaires des tombes à couloir.Le caractère souterrain du premier et subaérien du second constitue la différencela plus frappante entre nos deux types de structures funéraires. Mais il ne fautpas perdre de vue que, la masse des tertres de l’ouest aidant, les deux sont, aufond, « enterrées ». L’absence apparente, dans les chambres de l’ouest, d’indicesde subordination8 entre les individus doit également être soulignée, de même quele fait que les utilisateurs des mêmes structures prenaient soin, le plus souvent,de réserver un espace à chacun des corps déposés. Mais ces petites différencesme semblent de peu de poids face à la longue liste des analogies. Après tout,l’absence d’indices ne constitue pas une preuve et la promiscuité apparente quirègne dans les fosses circulaires n’est peut-être rien d’autre que la conséquenced’un problème technique, celui de la fermeture, qui interdit de creuser desstructures de grand diamètre. Par ailleurs, le modèle proposé ici supporteraitsans difficulté l’existence de disparités secondaires. Il suffit en effet de prendre unpeu de recul pour voir que notre zone d’étude et les régions plus occidentalessont réunies premièrement par un même rejet du système précédent, celui destombes individuelles en fosses ovales, et, deuxièmement, par un « noyau dur »de pratiques nouvelles que l’on peut résumer ainsi : structures sépulcralescirculaires ; habitude d’associer plusieurs individus dans une même structure quidemeure accessible après sa première utilisation sans pour autant, en l’absencede réduction de corps et de rangement, se transformer en ossuaire. Il y a làrupture avec le système funéraire antérieur, mais aussi, comme l’ont soulignéavec force U. Veit (1993) et P. Chambon (2003), contraste marqué avec lesusages en vigueur dans les mêmes régions après 3500.
Changeons d’échelleComme chacun sait, la question des tombes à couloir de l’ouest de la France entre4500 et 3500 ne peut pas être traitée isolément. Les pratiques qu’on y observe sonten effet, même s’il existe des nuances régionales, partagées par une vaste régionqui forme un arc englobant l’Europe atlantique et une partie de l’Europe du Nord.Les analogies entre ces deux grands domaines ont été listées il y a une douzained’année par U. Veit, qui a bien noté, parmi les analogies les plus saillantes, lecaractère subaérien des chambres sépulcrales recouvertes de tertres, les modesde traitement des défunts rappelés plus haut à propos des tombes à couloir del’ouest de la France, ainsi que la manière dont ils se distinguent des pratiques
50
véritablement « collectives » en vigueur après 3500 (Veit, 1993). La provincefunéraire correspondante dessine une auréole concentrique à celle des tombes enfosse circulaire (fig. 12). Nous l’appellerons, par commodité, « auréole externe ».Dans ce dispositif, l’auréole « interne » est formée par la zone à cimetières qui reliel’Italie du Nord et le Plateau suisse à la Plaine hongroise. Cette dernière secaractérise par la présence de nécropoles à tombes plates, en pleine terre ou encistes, qui, au moins pour la partie orientale9, s’inscrit clairement dans la vieilletradition des nécropoles du Néolithique danubien. Les nécropoles de typeChamblandes, avec leurs sépultures collectives qui cohabitent avec des tombesindividuelles, forment un ensemble à part au sein de ce complexe. Il n’est peut-êtrepas indifférent de noter ici que, dans le groupe des nécropoles à cistes au seinduquel on a pris l’habitude de les classer, elles sont les seules à présenter cetteparticularité, les sépultures collectives n’étant, sauf erreur de ma part, pasreprésentées dans les nécropoles italiennes de la culture des vases à bouche carrée(VBQ). Faut-il en conclure que les cimetières Chamblandes représentent un typeintermédiaire entre l’auréole centrale et l’auréole interne, cette particularité étantdue à sa situation « frontalière » ? Il est évidemment trop tôt pour se permettre detelles généralisations, mais il ne fait pas de doute que cette piste sera l’une de cellesque devra suivre l’étude comparée des systèmes funéraires à l’échelle du continenteuropéen, qui n’en est après tout qu’à ses débuts.Le schématisme de cette carte de l’Europe dissimule naturellement une réalitéplus complexe et plus diverse. Nous y avons privilégié à dessein les pratiques à
51
Fig. 12 – Extension des grandes provinces funéraires durant l’horizon 4500 – 3500.
la fois dominantes et, dans la plupart des cas, innovantes, des trois airesconcernées. Et nous assumons le caractère réducteur de ce qui ne doit pas êtrecompris comme autre chose qu’un modèle provisoire, un repère dans unediscussion qui ne peut pas être relancée autrement qu’à partir de tellesgénéralisations.L’exploration exhaustive des potentialités de ce modèle est évidemmentimpossible dans le cadre de cet article. Je me contenterai donc de quelquesremarques très générales dont le but sera davantage de mieux en cerner lescontours :1. comme on peut le constater à propos du Baalberge et du Chasséen, dontles aires d’extension respectives sont à cheval sur deux provinces funéraires,ce découpage n’épouse pas obligatoirement celui des limites culturelles. Cetteautonomie du funéraire vis-à-vis des styles céramiques a déjà été observéepour les périodes antérieures. Elle fait évidemment partie des constats quialimentent la discussion sur la pertinence du concept de culturearchéologique (Jeunesse, 2006) ;2. il existe naturellement des exceptions au système tripartite proposé. Maisun examen approfondi montre qu’elles présentent toujours un caractèreponctuel ou marginal. On peut penser aux sépultures en ciste – et collectivespour certaines – de Saint-Martin-La-Rivière, dans le centre-ouest de la France(Patte, 1971 ; Airvaux, 1996), qui ont été comparées avec raison aux tombesde type Chamblandes, mais les dernières datations radiocarbones réaliséeslaissent supposer qu’elles pourraient être en grande partie antérieures à notrefourchette chronologique de référence (marginalité chronologique). Lanécropole chasséenne à tombes plates de Monéteau, dans l’Yonne (Chambonet al., 2004) pourrait, de son côté, témoigner d’une certaine inertie dusystème funéraire danubien, dans un entre-deux encore difficilementcernable entre l’auréole centrale et l’auréole externe (marginalitégéographique). Le site du Crès à Béziers, où cohabitent tombes en fossescirculaires et sépultures « ordinaires » (Loison et al., 2003), témoigne lui ausside cette indétermination qui semble régner dans une partie au moins dudomaine chasséen10. Une même mixité a d’ailleurs été observée parA. Beeching (ce volume) sur le site du Gournier à Montélimar. Aux Pays-Baset dans le sud de la Scandinavie, c’est-à-dire aux confins extérieurs del’auréole externe (marginalité géographique), des communautés restéesprofondément ancrées dans la tradition mésolithique, par exemple lesporteurs des cultures des Swifterbant et d’Ertebölle, continuent à utiliser descimetières à tombes plates jusque vers 4000 et au-delà, échappant en grandepartie au premier mouvement de diffusion des sépultures multiples et/oucollectives sous tertre. Là encore, l’examen des séquences locales permetaisément de remonter aux origines de ces situations qui ne font guère plusqu’égratigner le modèle général. Et puis, dernier exemple, il y a le cas descultures les plus orientales de l’aire des sépultures en fosses circulaires (enpremier lieu Baalberge et Ludanice), où ces dernières cohabitent avecd’autres modes d’enfouissement des défunts, comme si l’élan qui porte lanouvelle pratique avait connu un certain essoufflement à l’extrémité est ducroissant que forme l’auréole centrale.
ConclusionLes dépôts humains en fosse circulaire du Néolithique récent ont longtemps étévus comme un phénomène marginal, une pratique secondaire, souventprésentée comme aléatoire, et subordonnée à une norme inconnue faute de
52
documents conservés. J’espère avoir réussi à prouver ici qu’il n’en est rien et qu’ily a là l’expression d’un système funéraire bien structuré, et cela même si nous n’enavons encore qu’une connaissance lacunaire. Parmi ses caractéristiques les plussaillantes, on retiendra, en particulier, le traitement différentiel qui transparaît àtravers l’opposition entre la position standard et les positions désordonnées. C’estdans le cas des tombes à dépôts multiples que le contraste est le plus net. L’idéed’une relation de dépendance entre un individu privilégié et ceux qui l’ont suividans la tombe s’impose d’elle-même. Quelques rares analyses laissent supposerl’existence de liens génétiques entre l’individu « central » et au moins une partiedes autres. Mais il faudra attendre de disposer d’un nombre d’études plusimportant pour évaluer le degré de généralité de cette observation. Le choix d’une structure circulaire et, plus encore, la nouveauté consistant à yinstaller plusieurs corps susceptibles ensuite de connaître des remaniements,permet de relier le système des tombes en fosse avec celui des chambressépulcrales des tombes à couloir de l’Ouest de la France et, de manière plusgénérale, à l’ensemble des sépultures sous tertre de l’horizon 4500 – 3500 quiforment notre « auréole externe ». Là aussi, le chemin est encore long jusqu’aumoment où l’on pourra déterminer jusqu’à quel point les analogies formellesrecouvrent des pratiques funéraires et des formes d’organisation socialescomparables. Le fait qu’aucun individu « central » ne soit identifiable dans lestombes à couloir ne doit pas dissuader les chercheurs de suivre cette piste, pourmoi fondamentale, tant il est vrai que l’absence de preuve ne saurait êtreconsidéré comme une preuve11.Reste la question, laissée en suspens, de la genèse du système des sépultures enfosses circulaires. L’idée qu’il pourrait relever d’une pure convergence est renduepeu vraisemblable par la cohérence à la fois chronologique et géographique duphénomène. La continuité géographique entre les cultures concernées plaide plutôtpour un processus de diffusion. Même si une analyse détaillée des contexteschronologiques reste à faire, il semblerait que les cas les plus anciens soient àchercher du côté du Chasséen du sud de la France12. Si l’on se place dans cetteperspective, on peut imaginer une émergence du phénomène dans cette régionsuivi d’une diffusion qui aurait gagné successivement les régions rhénanes, laBavière et l’est de l’Europe centrale. La culture de Michelsberg semble avoir jouéun rôle central dans cette diffusion. Les dernières recherches ont permis dedéterminer que son berceau se trouve dans le Bassin parisien, confirmant l’idéedéjà ancienne que des influx chasséens auraient largement contribué à sa genèse(Jeunesse, 1998). De là, le Michelsberg s’est installé dans la vallée du Rhin(Jeunesse et al., 2004) avant de continuer son expansion vers l’est jusqu’en Bavière(Matuschik, 1992) et d’exercer une influence marquée sur l’Énéolithique ancien deBohême (Zapotocky, 1996 ; Zapotocky et al., 1989) ; dans ces deux dernièresrégions, il entre en contact avec, respectivement, la culture de Münschshöfen et lesgroupes épilengyeliens. Parallèlement, les recherches les plus récentes insistent surle rôle du Michelsberg dans la formation de la TRBK aussi bien dans le Nord del’Allemagne (Hartz et al., 2000) que dans le centre de la Pologne (Rzepecki, 2004).L’idée n’est pas forcément que la nouvelle pratique funéraire aurait accompagné ladiffusion du Michelsberg mais plutôt que celle-ci a eu pour conséquence la miseen place d’un réseau englobant l’ensemble des cultures de notre zone d’étude qui,à un moment qui reste à situer précisément dans le temps, aurait favorisé ladiffusion du nouveau système funéraire.
Christian JEUNESSEUniversité de Strasbourg, UMR 7044,
Étude des civilisations de l’Antiquité de la Préhistoire à Byzance
53
NOTES
1. Toutes les dates utilisées sont en cal BC.2. L’habitude s’est installée d’utiliser l’abréviation crée par nos collègues allemands pour le
terme de Trichterbecherkultur.3. Par sépulture « régulières », nous entendons des tombes intégrées à des cimetières ou des
sépultures isolées aux caractéristiques analogues.4. Dans toutes les cultures concernées, la position conventionnelle correspond à la position
fléchie. Deux découvertes laissent cependant supposer l’existence d’une normesecondaire dans le Néolithique récent alsacien. Il s’agit des squelettes en positionallongée, membres supérieurs et inférieurs en extension, de Holtzheim « Altmatt »(Lefranc, 2001) et de Holtzheim « Am Schluesselberg » (Kuhnle et al., 2000). Le premierétait seul dans une fosse sépulcrale « ordinaire » (de forme quadrangulaire), le secondpeut être considéré comme l’individu central d’une structure circulaire qui a livré parailleurs les restes de deux autres individus.
5. Manifestement répartis entre plusieurs épisodes de dépôt (Nickel, 1997, p. 149-150).6. L’existence de couches de sédiments séparant les différents dépôts n’est évidemment pas
de nature à fragiliser cette hypothèse. Comme on sait, on en connaît aussi dans desstructures dont personne ne songerait à contester le caractère collectif (en premier lieu lasépulture de La Chaussée-Tirancourt ; voir, en dernier lieu, Leclerc, Masset 2006).
7. Dans le résumé de son ouvrage, P. Chambon s’exprime ainsi à propos des tombes àcouloir : « Il existe des sépultures traditionnellement classées au sein des sépulturescollectives, mais qui résistent finalement au diagnostic : entre dépôts simultanés ousuccessifs, il est impossible de trancher » (Chambon, 2003). Moyennant le remplacement,dans la première proposition, de « collectives » par « multiples », on pourrait parlerexactement dans les mêmes termes de certaines de nos sépultures en fosse circulaire.
8. Judicieusement soulignée par Jean Leclerc et Isabelle Le Goff dans la discussion qui asuivi ma communication.
9. Représentée, pour se limiter aux sites les plus célèbres, par les cimetières de Tiszapolgaret Bodrogkeresztur.
10. Sachant cependant que, dans la mesure où nous ne connaissons pas encore l’histoire decet habitat (en particulier sa durée d’occupation et sa périodisation interne), cette« cohabitation » pourrait n’être qu’illusoire.
11. Une des possibilités seraient que les chambres sépulcrales étaient destinées à accueillirsuccessivement des dépôts correspondant aux trois configurations rencontrées dans lesfosses circulaires (individu seul en position conventionnelle ; individu seul en positionnon conventionnelle ; dépôt multiple avec un individu en position repliée, les autres enposition désordonnée). Dans la mesure où nous n’avons presque jamais les moyens dereconstituer l’historique des dépôts dans les chambres rondes de l’ouest, il en résulteraitun palimpseste qui, par la force des choses, ne peut que différer des configurationsrencontrées ordinairement dans les fosses circulaires.
12. Je pense notamment au site de Berriac « les Plots », que Jean Vaquer (1990) place audébut de sa périodisation interne du Chasséen régional.
BIBLIOGRAPHIE
Airvaux 1996 : AIRVAUX (J.) – Découverte d’une nouvelle sépulture néolithiqueen ciste à la Goumoizière de Saint-Martin-La-Rivière (Valdivienne) : premiersrésultats. Le Pays Chauvinois, 34, 1996, p. 64-106.
Beeching 2003 : BEECHING (A.) – Organisation spatiale et symbolique du rituelfunéraire chasséen en moyenne vallée du Rhône : première approche. In :CHAMBON (P.), LECLERC (J.), dir. – Les Pratiques funéraires néolithiques avant3500 av. J.-C. en France et dans les régions limitrophes. Paris : Société PréhistoriqueFrançaise, 2003, p. 231-249. (Mémoire ; XXXIII).
Beeching, Crubézy 1998 : BEECHING (A.), CRUBÉZY (E.) – Les Sépultureschasséennes de la vallée du Rhône. In : GUILAINE (J.), éd. – Sépultures d’occidentet genèses des mégalithismes. Paris : Errance, 1998, p.147-164.
Blaizot 2001 : BLAIZOT (F.) – Premières données sur le traitement des corpshumains à la transition du Néolithique récent et du Néolithique final dans leBas-Rhin. Gallia Préhistoire, 43, 2001, p. 175-235.
54
Chambon 2003 : CHAMBON (P.) – Les Morts dans les sépultures collectives néolithiquesen France : du cadavre aux restes ultimes. Paris : CNRS, 2003. 395 p. (Supplémentà Gallia Préhistoire ; 35).
Chambon et al. 2004 : CHAMBON (P.), THIOL (S.), TRISTAN (C.) – Une Nouvelleopération sur le secteur de Macherin à Monéteau (Yonne), la « Rue de Bonn » :suite du village et de l’enceinte, nouvelle nécropole… Internéo, 5, 2004, p. 73-79.
Crubézy 1991 : CRUBÉZY (E.) – Les Pratiques funéraires du Chasséen dans lamoyenne vallée du Rhône. In : Identité du Chasséen : actes du colloque internationalde Nemours 1989. Nemours : APRAIF, 1991, p. 393-398. (Mémoires duMusée de Préhistoire d’Ile-de-France ; 4).
Denaire à paraître : DENAIRE (A.) – Les Sépultures multiples du Néolithiquerécent de Didenheim/Morschwiller-le-Bas (Haut-Rhin). In : Relationsinterrégionales au Néolithique entre Bassin parisien et Bassin rhénan : actes du26e colloque interrégional sur le Néolithique, Luxembourg, 8-9 nov. 2003.(Supplément à Archeologia Mosellana).
Dron et al. 2003 : DRON (J.-L.), LE GOFF (I.), LEPAUMIER (H.) – LeFonctionnement des tombes à couloir en Basse-Normandie. In : CHAMBON(P.), LECLERC (J.), dir. – Les Pratiques funéraires néolithiques avant 3500 av. J.-C.en France et dans les régions limitrophes. Paris : Société Préhistorique Française,2003, p. 259-286. (Mémoire ; XXXIII).
Hartz et al. 2000 : HARTZ (S.), HEINRICH (D.), LÜBKE (H.) – Frühe Bauern an derKüste. Neue 14C Daten und aktuelle Aspekte zum Neolithisierungsprozess imnorddeutschen Ostseeküstengebiet. Prähistorische Zeitschrift, 75, 2000, p. 129-152.
Jeunesse 1998 : JEUNESSE (C.) – Pour une origine occidentale de la culture deMichelsberg ? In : BIEL (J.), SCHLICHTHERLE (H.), STROBEL (M.), ZEEB (A.),éd. – Die Michelsberger Kultur und ihre Randgebiete : Probleme der Entstehung,Chronologie und des Siedlungswesens : Kolloquium Hemmenhofen, 21-23 fév.1997. Stuttgart : Komissionsverlag K. Theiss, 1998, p.29-45.
Jeunesse 2006 : JEUNESSE (C.) – Les Traditions funéraires du Néolithique moyenen Europe centrale dans le cadre du système funéraire danubien. In : ALT (K.),ARBOGAST (R.-M.), JEUNESSE (C.), VAN WILLIGEN (S.), dir. – Archéologiefunéraire du Néolithique danubien, Zimmersheim : Association pour la Promotionde la Recherche Archéologique en Alsace, 2004, p. 3-26. (Cahiers ; 20).
Jeunesse et al. 2004 : JEUNESSE (C.), LEFRANC (P.), DENAIRE (A.) – Groupe deBischheim, origine du Michelsberg, genèse du groupe d’Entzheim. La transition entre leNéolithique moyen et le Néolithique récent dans les régions rhénanes. Zimmersheim :Association pour la Promotion de la Recherche Archéologique en Alsace,2004. 280 p. (Cahiers ; 18/19, 2002/2003).
Kuhnle et al. 2001 : KUNHLE (G.), WIECHMANN (A.), ARBOGAST (R.-M.), BOËS(E.), CROUTSCH (C.) – Le Site Michelsberg et Munzingen de Holtzheim (Bas-Rhin). Revue Archéologique de l’Est, 50, 2001, p. 3-51.
Leclerc, Masset 2006 : LECLERC (J.), MASSET (C.) – L’Évolution de la pratiquefunéraire dans la sépulture collective néolithique de La Chaussée-Tirancourt(Somme). Bulletin de la Société Préhistorique Française, 103, 2006, p. 87-116.
Lefranc 2001 : LEFRANC (P.) – L’Habitat Néolithique moyen et récent deHoltzheim « Altmatt » : fouilles 2000 et 2001. Cahiers de l’Association pour laPromotion de la Recherche Archéologique en Alsace, 17, 2001, p. 107-134.
Lichardus 1986 : LICHARDUS (J) – Le Rrituel funéraire de la culture deMichelsberg dans la région du Rhin supérieur et moyen. In : DEMOULE (J.-P.), GUILAINE (J.), éd. – Le Néolithique de la France : hommage à G. Bailloud.Paris : Picard, 1986, p. 343-358.
55
Loison et al. 2003 : LOISON (G.), FABRE (V.), VILLEMEUR (I.) – Structuresdomestiques et aménagements funéraires sur le site Chasséen du Crès àBéziers (Hérault). Archéopages, 10, 2003, p. 32-39.
Matuschik 1992 : MATUSCHIK (I.) – Sengkofen « Pfatterbreite », eine Fundstelleder Michelsberger Kultur im bayerischen Donautal, und die MichelsbergerKultur im östlichen Alpenvorland. Bayerische Vorgeschichtsblätter, 57, 1992, p. 1-31.
Nickel 1997 : NICKEL (C.) – Menschliche Skelettreste aus MichelsbergerFundzusammenhängen. Zur Interpretation einer Fundgattung. Bericht derRömisch-Germanischen Kommission, 78, 1997, p. 29-195 et pl. 1-38.
Patte 1971 : PATTE (E.) – Quelques sépultures du Poitou, du Mésolithique auBronze moyen. Gallia Préhistoire, 14, 1971.1, p. 139-244.
Preuss 1966 : PREUSS (J.) – Die Baalberger Gruppe in Mitteldeutschland. Berlin : VEBDeutscher Verlag der Wissenschaften, 1966. VI-253 p.-66 p. de pl.(Veröffentlichungen des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle ; 21).
Rzepecki 2004 : RZEPECKI (S.) – Spolecznosci srodkowoneolitycznej kultury PucharowLejkowatych na Kujawach = Middle Neolithic societies of the Funnel BeakerCulture in Kuyavia. Poznan : Unywersitet im. Adame Mickiewicza wPoznaniu, 2004. 235 p.
Schweitzer, Fulleringer 1973 : SCHWEITZER (R.), FULLERINGER (B.) –Découvertes de fosses du Michelsberg à Riedisheim. Bulletin du MuséeHistorique de Mulhouse, 81, 1973, p.23-38.
Smid 2002 : SMID (M.) – Prispevek k poznani pohre bniho ritu kulturynalevkovitych poharu na Morave (rés. all. : Zum Bestattungsritus derTrichterbecherkultur in Mähren). In : CHEBEN (I.), KUZMA (I.), éd. – Otazkyneolitu a eneolitu nasich krajin : actes du colloque de Liptovska Sielnica, oct.2001. Nitra : Archeologick? ústav SAV, 2002, p. 375-391.
Stauch, Banghard 2002 : STAUCH (E.), BANGHARD (K.) – Das ganz normaleMichelsberg. Neues zur jungneolithischen Siedlungsgeschichte zwischenRhein und Nekar. In : ETTEL (P.), FRIEDRICH (R.), SCHIER (W.), éd. –Interdisziplinäre Beiträge zur Siedlungsarchäologie. Gedenkschrift für Walter Janssen.Rahden : Leidorf, 2002, p. 369-390.
Testard 2004 : TESTARD (A.) – Les Morts d’accompagnement. Paris : Errance, 2004,261 p. (tome 1) et 137 p. (tome 2).
Tocik 1991 : TOCIK (A.) – Erforschungsstand der Lengyel-Kultur in derSlovakei. Rückblick und Ausblick. In : LICHARDUS (J.), éd. – Die Kupferzeit alshistorische Epoche. Bonn : R. Habelt, 1991, p. 301-317. (Saarbrücker Beiträgezur Altertumskunde ; 55).
Tristan 2003 : TRISTAN (C.) – Marlenheim (Bas-Rhin), contournement routier : deuxhabitats rubanés et une occupation Hallstatt : document final de synthèse desauvetage urgent. Strasbourg : INRAP, SRA d’Alsace, 2003. 279 p.
Vaquer 1990 : VAQUER (J.) – L’Évolution du Chasséen méridional : ‘essai dansle Bassin de l’Aude. In : GUILAINE (J.), GUTHERZ (X.), dir. – Autour de JeanArnal. Montpellier : Université des sciences et techniques, 1990, p. 177-189.
Veit 1993 : VEIT (U.) – Kollektiv Bestattungen im nord- und WesteuropäischenNeolithikum. Bonner Jahrbücher, 193, 1993, p. 1-44.
Zapotocky 1996 : ZAPOTOCKY (M.) – Das frühe Äneolithikum imnordböhmischen Elbegebiet. Archeologické. Rozhledy, 1996.3; 1996, p. 404-459.
Zapotocky et al. 1989 : ZAPOTOCKY (M.), CERNA (E.), DOBES (M.) –Michelsberger Funde aus Nordwestböhmen. Pamatky Archeologické, 80, 1989,p. 30-58.
56