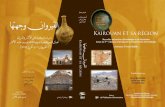Les restes humains des dolmens de Puyraveau (Saint-Léger de Montbrun, Deux-Sèvres, France)
-
Upload
u-bordeaux1 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Les restes humains des dolmens de Puyraveau (Saint-Léger de Montbrun, Deux-Sèvres, France)
PUYRAVEAU À SAINT-LÉGER-
DE-MONTBRUN (DEUX-SÈVRES),
LE DOLMEN II
Sous la direction de
Vincent ARD
Un monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique
dans le Centre-Ouest de la France
Collections particulières,et collections des musées de Poitiers
et des Tumulus de Bougon
5
Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France
SOMMAIRE
– p. 9 –AVANT-PROPOS
Jacques BUISSON-CATIL
– p. 11 –PRÉFACE
Jean VAQUER
– p. 15 –LES PARTENAIRES
Éric GAUTIERAlain CLAEYS
– p. 19 –
REMERCIEMENTS
– p. 21 –INTRODUCTION
Vincent ARD
– p. 25 –CHAPITRE 1 :
Les dolmens de Puyraveau : présentation générale
I. Cadre naturel D. PoncetA. Localisation géographiqueB. Contexte géologique
p. 27
p. 27
p. 28
6
Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France
II. Historique de l’exploration des monuments V. ArdA. Les premières mentions au XIXe siècle B. Les années soixante : des fouilles clandestines à la dispersion des collections C. Les années soixante-dix : les premières publications scientifiques D. En 1997, les premières fouilles, mais trop tard …
III. Les données architecturales : les fouilles 1997 F. BouinA. Le dolmen I B. Le dolmen II C. Datation
IV. Nature pétrographique et origine géographique des matériauxde construction des monuments D. Poncet
– p. 83 –CHAPITRE 2 : Un mobilier exceptionnel
déposé dans le dolmen II
Préambule
I. De 1964 à 2009, l’histoire mouvementée du mobilier V. Ard
II. Le mobilier du NéolithiqueA. La céramique V. Ard B. Les industries lithiques P. Fouéré, E. Ihuel, J. Pelegrin, C. Buret,J. Linton, P. Pétrequin, D. Poncet, J. Primault, J. Vosgesavec la collaboration de F. Blanchet et N. Mallet
Observations techniques sur les poignards de Puyraveau II J. Pelegrin
C. L’industrie en matières dures d’origine animale A. MaingaudD. Les éléments de parure non métalliques A. Garin Carmagnani et J. VosgesE. Les perles en cuivre de Puyraveau dans le contexte de la fin du Néolithique du Centre-Ouest B. Mille et V. Ard
III. Le mobilier du CampaniformeA. La céramique L. SalanovaB. Le poignard à languette en cuivre de Puyraveau B. Mille et V. Ard
IV. Un indice d’une visite plus récente du monument E. Bouchet
p. 32
p. 32
p. 33
p. 49
p. 50
p. 51
p. 55
p. 62
p. 79
p. 80
p. 85
p. 87
p. 92
p. 92
p. 141
p. 168
p. 354
p. 363
p. 406
p. 419
p. 419
p. 423
p. 430
7
Sommaire
p. 437
p. 438
p. 440
p. 442
p. 444
p. 446
p. 449
p. 452
p. 454
p. 461
p. 462
p. 466
p. 478
p. 478
p. 480
p. 488
– p. 435 –CHAPITRE 3 :
Les restes humains Ludovic Soler
Introduction
I. Collections étudiées, représentativité du matériel et approche générale
II. Répartition des restes humains
III. Dénombrement des individus du dolmen II
IV. Sexe et âge au décès
V. Ostéologie quantitative
VI. Caractères morphologiques
VII. Les restes de faune
Temporalité du fonctionnement des monuments et conclusions
– p. 459 –CHAPITRE 4 :
Puyraveau dans son contexte régional
I. Le mégalithisme du Thouarsais A. Matériaux utilisés pour l’érection des mégalithes du Thouarsais D. PoncetB. Le mégalithisme du Thouarsais dans son contexte régional F. Bouin et R. Joussaume
II. La fin du Néolithique dans le Thouarsais : le groupe de Taizé V. Ard et E. IhuelA. Une documentation quasi exclusivement funéraireB. Aire d’influence et proposition de phasage du TaizéC. Un secteur clé dans la circulation des premiers poignards en silexde la région du Grand-Pressigny
Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France
III. Un nouveau témoin campaniforme dans le Centre-Ouest L. Salanova, A. Cormenier et V. ArdA. Inventaire et répartition de la céramique campaniforme dans le Centre-OuestB. Le cadre chronologique du Campaniforme dans le Centre-OuestC. Les rapports des groupes du Néolithique final avec le Campaniforme
– p. 513 –CONCLUSIONS
Vincent ARD
– p. 517 –BIBLIOGRAPHIE
– p. 549 –ANNEXES
p. 491
p. 491
p. 498
p. 502
8
435
Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France
Ludovic Soler
437
Les restes humains
INTRODUCTION
Les dolmens de Puyraveau font partie de ces ensembles trop anciennementfouillés et remaniés pour que l’on puisse en retirer des informations sur les gestesfunéraires faute de données sur la répartition des os humains, tant en plan qu’enstratigraphie. Lors de la reprise de la fouille de tels monuments, on peut espérerretrouver des lambeaux de niveaux en place, encore faut-il que la méthodologieait été adaptée.
Les travaux les plus récents menés par Frédéric Bouin sur les dolmens dePuyraveau auraient pu porter leurs fruits de ce point de vue-là, mais les niveauxarchéologiques avaient été trop largement remaniés par les fouilles clandestines.
Quant aux études des ossements eux-mêmes, les conséquences d’une interven-tion non adaptée sur le terrain sont directes, car elles en limitent la portée. Dansnombre des travaux anciens, les publications abordent, la plupart du temps, deux aspects. Les éléments morphologiques, métriques et pathologiques les plusremarquables sont décrits et un dénombrement des individus est effectué à partirdes éléments considérés comme les plus importants (crâne, os longs, dents) ou lesmoins fragmentés. Certaines parties anatomiques, pourtant témoins d’individussupplémentaires ou de classes d’âges différentes (enfants périnataux par exempleou fragments d’os significatifs), sont ainsi ignorées. Le cas des ossements humainsde Puyraveau étudiés par É. Patte ne fait pas exception en la matière (Patte 1971 ;1976).
La prise en compte de l’ensemble des os aujourd’hui connus, issus desdifférentes collections réunies, permet d’avoir une vision plus complète du nombred’individus déposés dans ces monuments. Au-delà du simple décompte, nousproposons également de discuter la représentativité de ces ossements et ce qu’ilsrévèlent sur le fonctionnement des espaces sépulcraux.
438
Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France
I. COLLECTIONS ÉTUDIÉES,REPRÉSENTATIVITÉ DU MATÉRIEL ETAPPROCHE GÉNÉRALE
Sans doute plus que pour le reste du mobilier archéologique en raison d’une
moindre considération portée aux ossements, on ignore la fraction des os humains
disparue, en particulier ceux remis en terre ou rejetés dans une carrière par les
premiers fouilleurs du dolmen dans les années soixante et tous ceux récoltés et/ou
jetés par d’autres “intervenants” non identifiés à ce jour.
Les ossements conservés sont aujourd’hui répartis entre trois collections
particulières et les collections publiques des musées de Poitiers et Bougon. Nous
avons réalisé un inventaire définissant l’état de la collection pour chaque musée
ou lot privé. Un dénombrement des individus a ensuite été réalisé en prenant en
compte simultanément l’ensemble de ces os.
1. Description des séries
Les collections contenant des os humains et auxquelles nous avons eu accèssont les suivantes :
La collection Patte (musées de Poitiers)
La collection É. Patte livre la plus grande partie des ossements connus. Il s’agitde ceux récupérés par É. Patte lors de son premier passage sur le site en 1965, aprèsles déprédations des premiers fouilleurs, ainsi que des quelques os ramassés parÉ. Patte lui-même lors de la petite opération de sauvetage qu’il a effectuée en 1966.Les os ont été relativement bien nettoyés et leur état de conservation est trèsvariable : du crâne complet (dépôt médiéval) à un ensemble de trois caissesd’esquilles. La plupart des os sont malgré tout très fragmentés. Les plus completsont été pris en compte dans l’inventaire réalisé par É. Patte : “Les restes humains,sauf les petits os, sont dans un état lamentable. […]. Il y avait certainement aumoins 30 individus, d’après le nombre d’astragales droits ; les autres os utilisablesfournissent des nombres inférieurs mais de même ordre. L’os long le moins briséest un tibia gauche fracturé à 50 mm au-dessus du trou nourricier” (Patte 1971, p. 215-216). Il s’agit des seuls éléments publiés relatifs au dénombrement des osde Puyraveau. Une partie était rangée dans les tiroirs du musée Sainte-Croix dePoitiers par élément anatomique et porte le numéro “916”, correspondant au sitede Puyraveau II dans l’inventaire réalisé par É. Patte des sites qu’il a étudiés.
439
Les restes humains
Les collections conservées au musée des Tumulus de Bougon
Des ossements issus des dolmens de Puyraveau existent parmi plusieurscollections du musée de Bougon. La collection Labitte comprend une mandibule.
Le musée conserve également les vestiges osseux résultant des fouilles de 1997
dirigées par F. Bouin. Provenant la plupart du temps de niveaux remaniés, c’est deloin la collection présentant la plus grande fragmentation des ossements. Cesderniers n’ont pas été lavés avant notre étude, mais étaient rangés par provenancearchéologique (cf. infra) et les trois monuments sont distingués (avec une très largemajorité issue du dolmen II ; 4 lots proviennent du dolmen I dont l’intérieur nefut pas fouillé, car la chambre avait déjà été vidée anciennement).
Les collections particulières
La collection particulière Gérard M. est d’un point de vue qualitatif identiqueà celle de Patte. Il s’agit d’une fraction des ossements qui n’avait pas été remise àÉ. Patte par les jeunes fouilleurs en 1965.
Deux autres collections particulières présentent des restes humains : celles deJean-Pierre N. (une mandibule) et d’Henri C. (une mandibule, un lot de dents etdeux axis).
Afin de déterminer le nombre d’individus représentés par l’ensemble des ossements issus des dolmensde Puyraveau, chaque os fut identifié, puis comptabilisé par partie anatomique. Ici est figuré un exempledu premier tri et du conditionnement effectué par É. Patte par type d’os dans les années 1960 (collectionPatte, musées de Poitiers ; Cliché : L. Soler).
440
Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France
II. RÉPARTITION DES RESTES HUMAINS
L’exploitation des archives de fouille, même plusieurs décennies après lestravaux, peut s’avérer fort enrichissante pour peu que les données soient préciseset objectives (cf. pour la région, les travaux sur le gisement éponyme d’Artenac à Saint-Mary, en Charente ; Duday, Soler 2008 ; ou encore les travaux collectifs encours sur la nécropole de Champ-Châlon à Benon en Charente-Maritime par L. Soler, J.-P. Cros, J.-M. Gilbert, R. Joussaume et R. Cadot). Ce n’est malheu-reusement pas le cas pour le site de Puyraveau.
1. Ossements mis au jour avant 1997
L’absence totale d’archives, ou même d’une description sommaire de larépartition des ossements, interdit toute tentative de discussion relative à la gestiondes espaces funéraires.
2. Ossements mis au jour en 1997
Considérant, à juste titre, que les remaniements à l’intérieur et aux abords desmonuments furent importants, le prélèvement du mobilier fut réalisé par lots etenregistré par rapport aux éléments architecturaux. Les ossements que nous avonsétudiés se répartissent en deux groupes : ceux issus des niveaux remaniés situésen fonction de leur position relative aux orthostates (e. g. à l’ouest de la dalle K,au sud du A, etc.) et ceux retrouvés dans des fosses (de calage ou non) ou sous deséléments effondrés du dolmen.
Lorsque des os ont pu être retrouvés dans une fosse de calage d’orthostate ousous un de ces piliers affaissés, il fut logique de supposer qu’ils pouvaient être “enplace”. Nous avons tenté d’identifier des répartitions préférentielles d’ossementsen recherchant des regroupements cohérents liés à l’âge ou aux parties anato-miques du squelette. Les rares cas observés de ces liaisons secondaires ne noussemblent pas significatifs de gestes funéraires particuliers, de la gestion des espacesinternes ou encore de remaniements postérieurs aux dépôts, qu’ils soientanthropiques ou non. Ainsi, un lot d’os longs (humérus, radius, tibia), une scapula,deux dents déciduales, des métatarsiens et une scapula compatibles avec un mêmeenfant furent retrouvés et enregistrés comme provenant du même secteur (“n° 64,au nord-est de la dalle C, dolmen II”) mais dans le niveau de déblais. Unappariement talus-calcanéus droit provenant également d’une même zone (n° 52)a été observé, mais un tel rapprochement au sein d’une sépulture collective n’estguère étonnant et peu significatif à lui seul. D’autres os compatibles en fonctionde l’âge furent retrouvés groupés dans des fosses, qu’il s’agisse de fosse de calage
441
Les restes humains
(“fosse de calage dalle G, n°143”) ou non (“fosse entrée Dolmen II”), mais ils nereprésentent jamais de squelettes complets et sont toujours accompagnés aucontraire d’os d’autres individus. Il peut donc s’agir de regroupements postérieursaux dépôts des corps dans le cadre d’une réutilisation des lieux par exemple outout simplement de remaniements fortuits anthropiques (fouilles clandestines)ou animales (cf. infra). D’ailleurs, dans la “fosse creusée à l’est de la dalle D” furentrécoltés de nombreux os humains mais aussi un squelette presque complet deblaireau. L’altération des os humains est la même dans la fosse qu’ailleurs dans lemonument alors que les os de blaireau sont très différemment conservés, au vude leur coloration et des nombreuses empreintes de radicelles.
État de conservation des ossements de Puyraveau : l’altération de la matière osseuse est en généralfaible. Ainsi, malgré la forte fragmentation liée aux nombreux remaniements de la plupart des os, leuridentification reste correcte (Collection Patte, musées de Poitiers ; Cliché : L. Soler).
442
Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France
III. DÉNOMBREMENT DES INDIVIDUS DU DOLMEN II
Nous avons insisté sur le fait que les conditions de découverte ne permettentpas de distinguer les défunts se rapportant à telle ou telle période d’occupationdu monument et que les ossements parvenus jusqu’à nous ne représentent qu’unepartie indéterminable de l’ensemble des individus déposés. Il nous a cependantparu important d’en évaluer le nombre minimal (NMI, nombre minimumd’individus) identifiable sur l’ensemble des collections (fig. 292). Nous n’avonspas tenu compte du squelette médiéval de la collection É. Patte qui se distinguedes ossements néolithiques par une altération différente des ossements, ni d’unesérie de mandibules et d’os longs qui pour les mêmes raisons proviennentclairement d’un autre site (les os ne sont d’ailleurs pas marqués du n° d’inventaire“916” de Patte).
Le principe du dénombrement consiste à décompter l’os (ou la partieanatomique) le mieux représenté, qui constitue alors un NMI de fréquence. Cetteestimation peut être améliorée en tenant compte du degré de maturation des os(âge au décès) et éventuellement du sexe des individus (ce qui n’est pas réalisableici à cause de la trop grande fragmentation des os coxaux). On parle alors de NMIpar exclusion (Bökönyi 1970). L’effectif le plus grand est obtenu par la caninesupérieure gauche présente 88 fois. Elle témoigne au total de 85 individus de plusde 15 ans (maturation de la dent et mise en place achevée avec usure avérée)auxquels il faut ajouter 14 sujets immatures de moins de 15 ans. Le NMI dePuyraveau est donc de 99 individus. Il est possible de compléter cette analyse enintégrant les résultats des appariements (Krantz 1968 ; Chaplin 1971 ; Masset1984). Cette opération impose cependant que l’on soit certain des relationsd’exclusion entre les os potentiellement appariables. Or, la forte fragmentation,l’origine indéterminée des ossements et l’échelle chronologique concernée neréunissent pas ces conditions de fiabilité. À titre indicatif seulement, nous avonstenté cette estimation à partir de quelques os relativement bien conservés (talus,calcaneus, patella). Les exclusions ne sont pas significatives et le NMI restesimilaire.
Nous retiendrons donc l’effectif minimal de 99 individus, plus de trois foissupérieur au chiffre de 30 sujets avancé par É. Patte à la suite de l’examenanthropologique de l’échantillon qui lui avait été remis à l’époque (Patte 1971).
Les restes humains
443
Fig. 292 : Saint-Léger-de-Montbrun, dolmen II de Puyraveau (Deux-Sèvres) : NMI de fréquence (tousâges et toutes collections confondus) déterminé pour les dents et pièces osseuses. Les incompatibilitésd’âge ne sont pas considérées dans ce tableau. Les effectifs donnés pour les dents tiennent comptedes alvéoles vides. Le meilleur effectif est fourni par la canine supérieure gauche. Si le déficit de laplupart des petits os est à mettre sur le compte de leur non-reconnaissance sur le site, c’est le forttaux de fragmentation qui explique facilement la mauvaise représentation des grands os longs desmembres. Ils sont par ailleurs très bien représentés par leurs données pondérales. L’hypothèse duretrait d’un certain nombre de crânes est avancée pour expliquer le déficit en blocs cranio-faciaux eten mandibules.
444
Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France
IV. SEXE ET ÂGE AU DÉCÈS
La diagnose sexuelle est basée sur l’os coxal. Malheureusement, l’état deconservation de la série est tel que même la méthode utilisant uniquement l’aspectde la surface auriculaire n’est pas applicable (Bruzek et al. 1996). Nos observationsse limitent alors à noter la présence de caractères très variés tels que deséchancrures ischiatiques très ouvertes ou bien fermées, des tubercules de Buissontotalement absents ou bien marqués, des surfaces auriculaires peu élevées ou pasdu tout et la présence ou non de sillons pré-auriculaires. Il s’agit de caractèresmasculins et féminins marqués mais qui observés isolés des autres caractèresanatomiques n’ont que peu de valeur. On ne peut donc que supposer la présencedes deux sexes dans ces sépultures.
Les données relatives à l’âge au décès des adultes sont tout aussi lacunaires.Les méthodes sont basées sur les phénomènes de sénescence des articulations. Or, en plus des problèmes simplement méthodologiques, liés notamment à la variabilité intra et inter populationnelle et à la vitesse de sénescence, lafragmentation des os est là encore le principal élément nous empêchant touteconsidération sur l’âge au décès des individus adultes déposés à Puyraveau. L’aspectde la surface auriculaire (Lovejoy et al. 1985) suggère la présence d’adultes jeunesmais aussi de sujets plus âgés, dont témoignent les différents degrés de synostosedes sutures crâniennes rencontrés sur les fragments de voûtes (Masset 1984).
Pour estimer l’âge au décès des sujets immatures, nous n’avons pu utiliser lesdonnées métriques que pour les individus morts en bas âge (Fazekas, Kósa 1978 ;Sellier et al. 1997). La maturation dentaire (Ubelaker 1984 ; Moorrees et al. 1963)et les degrés de synostose des points secondaires d’ossification (Birkner 1980) ontété utilisés pour les enfants plus âgés. Très peu de dents étaient conservées surarcade, ce qui limite là aussi la précision des estimations. Les 14 individusimmatures identifiés se répartissent selon les classes d’âge suivantes : 3 individusde 15-19 ans, 4 à 5 de 10-14 ans, 4 à 5 de 5 et 9 ans (un des individus pouvant êtredans l’une ou l’autre des catégories), 3 entre 1 et 4 ans, et 2 à 3 périnatals. Un trèsnet déficit (25 à 30 % de l’effectif total) du nombre d’individus apparaît pour lesclasses d’âge les plus jeunes (moins de 5 ans) par rapport au nombre attendu pource type de population (selon les calculs théoriques obtenus à partir des tables deLedermann (1969) et en considérant une espérance de vie à la naissance entre 25 et 35 ans). Il n’y a pas de raison que les os des plus jeunes enfants aient été plus affectés par la taphonomie que les autres, de manière continue sur près de 5 000 ans. L’ensemble des espaces funéraires ayant été totalement exploré, on nepeut suggérer que les individus les plus jeunes furent déposés dans une zoneparticulière des chambres. Enfin, certains os des jeunes individus (mais pas tous)sont de petites dimensions et auraient pu échapper aux premiers explorateurs des
445
Les restes humains
monuments. Cependant, de nombreuses pièces de petite taille furent récoltées àcette occasion comme des ossements (phalanges, dents isolées, etc.) et du mobilier,à l’instar des perles, dont les dimensions sont nettement inférieures à celles d’unfémur par exemple, même de périnatal. En outre, il faut souligner que les terresont été tamisées, ce qui a permis de récupérer de telles pièces au cours des années1960, puis en 1997 lors des fouilles Bouin. Tout cela nous conduit à penser queles déficits en ossements d’individus des classes d’âge les plus jeunes ont uneorigine culturelle plutôt que taphonomique ou liée aux méthodes de fouille.
L’absence de données précises quant au sexe et à l’âge au décès des individusdu site est d’autant plus décevante que le caractère exceptionnel du mobilierretrouvé dans le monument aurait pu trouver une explication dans le recrutementdes individus déposés. La mise en évidence, par les travaux de F. Bouin, du passaged’un monument de type angevin à un monument à couloir aurait également été l’occasion de voir si des changements étaient également perceptibles à traversles gestes funéraires et les individus ayant eu accès à ces tombes. Ce n’est malheu-reusement pas le cas, mais on notera tout de même que les deux sexes et toutes lesclasses d’âge semblent représentés parmi les os conservés, à l’exception des enfantsde moins de 5 ans presque totalement absents sur toute la durée de fonctionne-ment des monuments.
446
Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France
V. OSTÉOLOGIE QUANTITATIVE
Le cas des sépultures collectives présentant une longue durée de fonction-nement et un grand nombre d’inhumés implique souvent une accumulation, undéplacement, un enchevêtrement, voire un retrait des os de l’espace funéraire.Quantifier le nombre des os retrouvés par catégorie anatomique dans un assem-blage archéologique par rapport au nombre d’os attendu dans une population, enfonction du nombre total d’individus défini, apparaît comme un moyen efficacepermettant de discuter du fonctionnement de l’espace funéraire. Le problèmeprincipal est le taux de fragmentation (très important ici) limitant l’identificationdes os incomplets. Pour pallier cela, l’enregistrement des données pondérales desdifférentes parties du squelette est une solution souvent utilisée, car moinsinfluencée par le taux de fragmentation. Il s’agit de la méthodologie appliquée àl’étude des sépultures à incinération (Duday 1987b ; Duday et al. 2000). Elleconsiste à déterminer les proportions relatives des différentes parties anatomiquesconservées (pourcentage d’os du crâne, de la cuisse, de la jambe, etc.), puis de lesconfronter à un référentiel (Krogman 1978). Nous discutons donc ci-dessous laconservation des os à partir de ces deux types de données.
On notera tout d’abord que le nombre (fig. 292) et le poids de fragmentsindéterminés sont importants (12,42 % sur 30,453 kg ; fig. 293). Le déficit en bloccrânio-facial et mandibule est flagrant, quel que soit le mode d’enregistrement.Pourtant, le nombre des différentes dents (majoritairement isolées) reste globale-ment correct, malgré quelques disparités (liées parfois à l’identification de certainespièces : symétrie des incisives inférieures par exemple). Ces dents témoignent dela présence des crânes ayant par la suite disparus. Le crâne est la pièce du squelettela plus visible, la plus volumineuse et souvent la plus porteuse de sens quant à lareprésentation de l’individu. Il ne serait pas étonnant qu’ils aient préférentielle-ment fait l’objet de retraits des espaces funéraires. Alors que de rares crânescomplets sont mentionnés dans les témoignages oraux des fouilleurs de l’époque,seules des portions de voûtes, parfois importantes, et quelques mandibulescomplètes sont parvenues jusqu’à nous. Des pertes sont indiscutablementimputables aux “méthodes de fouille” des premiers intervenants, mais on nesaurait exclure totalement que le temps de fonctionnement des sépultures et lenombre d’individus cumulés aient incité au retrait de quelques-unes de ces piècesvolumineuses au cours du Néolithique.
Les éléments du tronc très fragmentés sont très faiblement représentés dansles décomptes (ici seuls les atlas et axis ont pu être enregistrés). En revanche, enconsidérant les marges d’erreur, le rachis et les côtes sont correctement conservésdu point de vue de leur poids. Ces pièces se conservant souvent mal (notammentla partie spongieuse des vertèbres), leur bonne représentativité indique la faiblepart des phénomènes d’altération des os dans le sol. On s’étonnera alors de la
447
Les restes humains
mauvaise conservation, même pondérale, des os plats des ceintures (os coxal,scapula) qui pourtant s’identifient relativement bien.
À l’inverse, si la fragmentation de certains os longs des membres supérieurs etinférieurs biaise les décomptes, les données pondérales nous donnent à voir unautre tableau. Ainsi l’humérus est sur-représenté par rapport au taux attendu (plusde 8 % au lieu d’un peu plus de 6). En revanche, radius et ulna restent largementdéficitaires, quel que soit le mode d’enregistrement. En termes de poids, cela peuts’expliquer par le fait que la fragmentation est telle qu’il n’a pas toujours étépossible de distinguer les deux os qui ne sont donc pas inclus dans le décompte.Or, lorsqu’on ajoute le poids des fragments enregistrés simplement sousl’appellation avant-bras, le taux remonte à 3,34 %, ce qui se rapproche des 4 %environ attendus. En outre, ne sont pas pris en compte les fragments de diaphysed’avant-bras qui n’ont pu être distingués des fragments de diaphyse de la fibula(922 g). Cette dernière ainsi que les restes de tibia et de fémur sont égalementbien représentés par leur poids. Ainsi, malgré leur importante fragmentation, lesgrands os longs sont parmi les parties anatomiques les mieux conservées de lasérie. De fait, ils paraissent même presque sur-représentés.
Fig. 293 : Saint-Léger-de-Montbrun, dolmen II de Puyraveau (Deux-Sèvres) : représentation pondérale des diversesrégions du squelette, en poids absolu et en poids relatif par rapport au poids total des os humains retrouvés sur lesite. Les deux colonnes de droite indiquent les valeurs théoriques du poids relatif et leur écart-type (SD, standarddeviation), d’après les données de Lowrance et Latimer in Krogman 1978.
448
Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France
Enfin, les os des mains et pieds montrent dans le détail une disparitéquantitative entre les différents os concernés, malgré une bonne représentativitégénérale. Les plus petits os ont dû sans aucun doute échapper aux premièresinvestigations dans les monuments, facilement confondus avec de petits cailloux(tarse antérieur et carpe notamment). Les os longs du métatarse et du métacarpesont bien représentés en nombre (avec parfois des scores proches du NMI global)et les différences entre certains sont à mettre parfois en relation avec l’impossibilitéd’une identification précise (latéralisation, détermination du rang), à cause del’altération de l’extrémité proximale comme c’est le cas pour 77 métacarpiens. Cecipeut expliquer que leur poids soit artificiellement gonflé lorsque chaque os desmains et des pieds est individualisé dans les données pondérales (plus de la moitiédu pourcentage attendu).
Ainsi, le nombre des fragments indéterminés limite la pertinence des inter-prétations en général et il en ressort des disparités qui ne sont pas toujoursexplicables : bonne conservation générale avec présence de petits os et des osfragiles (corps vertébraux), mais faible représentativité d’autres os habituellementbien représentés (calcaneus) ou bien identifiables (os coxal). Malgré tout, plusieurstendances nettes se dessinent. Le déficit en crânes associé à une bonne repré-sentation des dents (qui auraient été perdues sur place) permet d’émettrel’hypothèse de retraits de cette partie du squelette, peut-être pour gérer les espacesfunéraires au cours des différents épisodes de fonctionnement des monuments.Les grands os longs des membres sont très fragmentés mais très bien représentéspar les données pondérales. Ils ont pu eux aussi, de par leur volume, faire l’objetde piétinements expliquant une partie de la fragmentation (sur os sec) et desretraits, dans ce cas-là de moindre importance. On peut également envisager, pourexpliquer leur sur-représentation par rapport aux autres parties anatomiques (oudu moins leur relative abondance), qu’au lieu d’être retirés, la plupart des grandsos longs furent regroupés en différents points de l’espace funéraire. On peut aussienvisager que l’on ait amené et déposé des os déjà décharnés, ce qui ne va pas dans le sens du reste du mobilier osseux (présence des os issus des articulationsles plus labiles). Ce phénomène de rangement est observé notamment dans lesniveaux supérieurs de la grotte sépulcrale d’Artenac (Duday, Soler 2008, p. 85).Malheureusement, l’absence de données relatives à la répartition des os dePuyraveau montre toute la limite du raisonnement que l’on peut avoir sur cesossements. La très importante quantité de mobilier découvert a pu, elle aussi, àun moment donné, inciter à des rangements au sein de l’espace sépulcral. D’aprèsl’un des jeunes fouilleurs de l’époque, les vases, pour beaucoup intacts, étaientempilés les uns dans les autres le long des parois (le corpus céramique rassemblépermet d’estimer une densité de 7 vases par mètres carrés dans la chambre dudolmen II !). De la même manière, on peut envisager légitimement des rangementsd’une partie des os les plus encombrants au cours de l’utilisation des espacessépulcraux.
449
Les restes humains
VI. CARACTÈRES MORPHOLOGIQUES
1. Variations métriques et morphologiques
L’absence de positionnement stratigraphique des os, leur forte fragmentationet la durée de fonctionnement importante des espaces funéraires nous ont conduità ne pas développer d’étude morphologique et métrique. Rappelons un cas despina bifida sur un sacrum et la présence d’un os inter pariétal décrits par É. Patte(1976, p. 304), et un second os inter pariétal non indiqué dans la publication.
2. Pathologies
Dans les deux publications consacrées aux ossements humains de Puyraveau(Patte 1971 ; 1976), on retrouve quelques considérations sur l’état de santé etl’hygiène des populations inhumées dans ces dolmens. Nous reprenons ceséléments et ajoutons un cas de fracture observé dans la collection particulièreGérard M. Ces éléments ne sont pas suffisamment pertinents pour en retirer unesynthèse épidémiologique.
Le doyen Patte évoque le port de sandales lorsqu’il observe la courbure trèsmarquée de certains cinquièmes métatarsiens (Patte 1971, p. 215 ; 1976, p. 303).Deux exemplaires ont été mis à part au sein de la collection, mais il n’est paspossible, à notre sens, de pouvoir considérer qu’ils sont le résultat d’une tellecontrainte, vestimentaire ou autre.
É. Patte signale également un fragment decrâne possédant des traces d’origine anthro-pique : “Un fragment triangulaire de pariétal(?) (de côtés égaux à 43, 40 et 46 mm) a sa faceconcave décortiquée (sauf un fragment infimede table interne de 6 x 12 mm près des angles).Le diploé y apparaît usé, la face convexeprésente des stries de raclage parallèles au plusgrand côté et s’étendant sur environ la moitiéde la pièce ; il s’agit d’une amulette crânienne[…] . Les 3 fractures n’ont pas l’aspect de cellesproduites sur un crâne frais, mais les saillies en sont mousses comme lorsque la pièce a étéportée” (Patte 1971, p. 212). Nous ne sommespas en mesure de confirmer cette observation.Pour nous en effet, les traces observables surle fragment de voûte crânienne proviennentplutôt d’un outil utilisé lors de l’explorationdu dolmen concerné (fig. 294).
Fig. 294 : Saint-Léger-de-Montbrun, dolmen II dePuyraveau (Deux-Sèvres) : fragment de voûte crâniennepublié par É. Patte (1971, p. 212 et 213) comme portantdes traces de raclage d’origine anthropique. À notreavis, la morphologie de ces traces incite plutôt àprivilégier une altération liée à l’action des outilsutilisés lors de la mise au jour du fragment (Cliché : L. Soler).
450
Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France
Atteintes dentaires
Six cas de résorptions alvéolaires ont été repérés sur des mandibules et un cassur maxillaire. Elles sont parfois associées à de vastes niches formées aux dépensdu corps de l’os et correspondant à des infections de type abcès. É. Patte note aussila présence d’une molaire isolée avec une fusion à la cuspide postérieure, d’unedent en cheville ayant sa propre racine ainsi qu’une autre molaire avec l’adjonctiond’une dent en cheville à couronne très distincte, mais à racine à demi fusionnéesur toute sa longueur. Nous avons également enregistré 27 caries, préféren-tiellement situées au niveau du collet des molaires avec des cas envahissants.
Pathologies dégénératives
Quelques rares cas d’arthrose affectent les champsarticulaires observables sur des fragments de vertèbres.Le seul autre cas digne d’intérêt pour ce type depathologie est une atteinte sur l’articulation proximaled’une phalange proximale de pied gauche. Le champarticulaire présente, le long des bords dorsal etmédial, une plage lisse et brillante ponctuée de trous vasculaires ; sa largeur varie entre 40 et 60 mm.L’articulation est bordée par un léger bourreletostéophytique avec une extension du champ articu-laire le long du bord dorsal et à l’angle médio-plantaire. Il s’agit vraisemblablement d’une arthroseayant évolué jusqu’au poli articulaire (fig. 295).
Pathologies traumatiques
Un fragment diaphysaire d’os de l’avant-bras (radius gauche, identifié commeun “cubitus droit” dans la première publication) présente un cal osseux consécutifà une fracture consolidée avec un faible déplacement de l’os (fig. 296).
Fig. 295 : Saint-Léger-de-Montbrun, dolmen II dePuyraveau (Deux-Sèvres) : poli articulaire sur l’extré-mité proximale d’une phalange proximale de pied(Cliché : L. Soler).
Fig. 296 : Saint-Léger-de-Montbrun, dolmen II de Puyraveau (Deux-Sèvres) : fragment diaphysaireprésentant un cal osseux consécutif à une fracture sur l’avant-bras ayant peu entraîné de déplace-ment de l’os (Cliché : L. Soler).
451
Les restes humains
Fig. 297 : Saint-Léger-de-Montbrun, dolmen II de Puyraveau (Deux-Sèvres) :extrémité distale d’un radius droit d’adulte décalée vers l’arrière par rapport à l’axe diaphysaire au-dessus de l’articulation radio-carpienne. Il s’agit trèsprobablement des suites d’une fracture que l’on rencontre classiquement lorsd’une chute où l’on tente de se rattraper sur les mains au prix d’une hyperextension du poignet (fracture de Pouteau-Colles). 1 : face postérieure ; 2 : facemédiale (Clichés : L. Soler).
L’extrémité distale d’un radius droit d’adulte (collection Gérard M.) est décaléede 7 degrés vers l’arrière par rapport à l’axe diaphysaire au-dessus de l’articulationradio-carpienne. Il s’agit très probablement des suites d’une fracture observéeclassiquement lors d’une chute où l’on tente de se rattraper sur les mains au prixd’une hyper extension du poignet, dite fracture de Pouteau-Colles (fig. 297).
1 2
Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France
VII. LES RESTES DE FAUNE
Les collections É. Patte, Gérard M. et celle issue des fouilles de F. Bouin
contenaient quelques os de faune mélangés aux restes humains (232 restes,
cf. fig. 298 ; détermination Lisandre Bedault, UMR 7041). À l’instar des restes
humains, ces os sont en général bien conservés mais très fragmentés, d’où une
détermination parfois imprécise et un inventaire par grands types.
Le corpus indique une forte présence de faune sauvage probablement intrusive :
blaireau et petits carnivores de type martre, rongeurs et taupe. Parmi les quelques
éléments de faune domestique, certains sont probablement un apport récent
(dents de cheval). Ils se distinguent en effet d’un point de vue taphonomique et
furent retrouvés aux abords du dolmen II au cours des fouilles de F. Bouin. On ne
peut donc pas les attribuer avec certitude aux époques de fonctionnement des
monuments. Les autres espèces s’apparentent davantage à ce que l’on retrouve
classiquement en contexte néolithique : bœuf (NMI : 1), capriné et porc (NMI : 2)
et le chien avec le plus grand nombre de restes (39 de chaque grande partie anato-
mique pour un NMI de 3).
452Fig. 298 : Saint-Léger-de-Montbrun, dolmens de Puyraveau (Deux-Sèvres) : inventaire des restes defaune répertoriés parmi les ossements (Détermination : L. Bedault).
453
Les restes humains
Il n’existe qu’une seule association directe de faune avec des restes humains.Elle a été rencontrée lors des fouilles de F. Bouin dans une fosse creusée dans lachambre du dolmen II, qui pourrait se rapporter, comme la plupart des autresfosses mises au jour, aux diverses explorations clandestines du site. Il s’agit dusquelette incomplet d’un blaireau avec des os humains très variés.
Les os de faune se distinguent par une altération de surface très nette : présenceabondante d’empreintes de radicelles totalement absentes sur les os humains. Lamise en place de ces deux ensembles n’a vraisemblablement pas eu lieu en mêmetemps.
Étant donné le contexte des interventions sur ces monuments et les élémentsconservés, la faune n’apporte pas d’informations pertinentes sur le fonctionnementde ces sépultures.
454
Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France
TEMPORALITÉ DU FONCTIONNEMENT DESMONUMENTS ET CONCLUSIONS
L’ensemble du mobilier déposé dans le dolmen II de Puyraveau témoigne de plusieurs épisodes de fonctionnement, du Néolithique moyen (période deconstruction probable au moins du premier monument) jusqu’à la fin du IIIe millénaire avant J.-C. Malheureusement, l’étude des ossements et l’absence dedonnées stratigraphiques ne permettent pas de discuter du caractère continu ounon de l’utilisation du monument II.
L’étude architecturale fait état d’au moins trois phases comme on l’a vu. Lemonument le plus anciennement construit est le dolmen II avant que la mise enplace du tumulus du dolmen I vienne en condamner l’accès. Cette seconde phasea probablement marqué un temps d’arrêt dans le fonctionnement du dolmen II.Cette interruption peut être située au Néolithique moyen si l’on s’accorde àattribuer la construction du monument I à cette période (seule période de cons-truction avérée pour ce type de monument). Ce temps d’arrêt n’est pas perceptibleà travers l’étude des ossements ; ces derniers proviennent en effet principalementdu dolmen II alors qu’on ignore tout de la chambre I. Enfin, nous ne connaissonspas les conséquences sur les dépôts du dolmen II de l’adjonction d’un autre espaceà ses dépens (dolmen III). S’ajoutent bien sûr à cela les biais liés aux interventionsrécentes que nous avons déjà discutées.
Il ressort tout de même de l’étude des ossements humains plusieurs infor-mations intéressantes liées notamment à la durée d’utilisation du monument. Eneffet, l’accumulation, dans le temps et dans le petit espace du dolmen II, d’au moinsune centaine de corps et le profil ostéologique de la série conservée permettentd’envisager une gestion de l’espace sépulcral via le retrait (crânes) et/ou leregroupement des os les plus volumineux (grands os longs des membres). Àquel(s) moment(s) ces déplacements ont-ils commencé dans l’histoire du site ?Nous l’ignorons. De telles manipulations ont pu être mises en évidence régionale-ment dans des contextes très divers et pour différentes périodes du Néolithique :regroupement d’os à la Goumoizière à Valdivienne (Vienne ; Soler 2007), dans la grotte du Quéroy à Chazelles (Charente ; Detante 2002) ou La Pierre-Virante àXanton-Chassenon (Vendée ; Chambon 2003), des rangements de crânes à Bougon B (Deux-Sèvres ; Chambon in Mohen, Scarre 2002 ; Soler in Mohen,Scarre 2002), des retraits de crânes au Trou Amiault à la Rochette (Charente ;Souris de 2007), des regroupements d’os longs dans les niveaux supérieurs sur lesite éponyme d’Artenac (Duday, Soler 2008) ou leur sur-représentation dans lesdépôts du couloir du dolmen B de la Boixe, également en Charente (Souris de2000).
455
Les restes humains
Fig. 299 : Saint-Léger-de-Montbrun, dolmen II de Puyraveau (Deux-Sèvres) : datations radiocarbonesobtenues à partir du même os (talus gauche) de quatre sujets distincts (calibration Reimer et al.2004 ; Oxcal v. 3.10). Ces dates illustrent et précisent le calage chronologique de l’une des phases defonctionnement du monument au cours du Néolithique final, à laquelle peut être attribuée unepartie du mobilier qui accompagnait les ossements. D’autres phases de fonctionnement, avérées aussibien par le mobilier que par les évolutions architecturales, ne sont pas illustrées compte tenu dufaible nombre de datations effectué par rapport au nombre total d’individus déposés.
L’observation la plus marquante est le maintien dans le temps du déficit en
individus de moins de 5 ans. Il existe bien d’autres sites funéraires néolithiques
à occupation longue dans le Centre-Ouest, utilisés dès le Néolithique moyen,
puis réutilisés au cours des périodes récente et finale, que ce soit en contexte
mégalithique ou en grotte (Bellefonds, Artenac, le Trou Amiault, cf. également
la série de datations réalisées dans le cadre d’un PCR dirigé par B. Boulestin ;
Boulestin 2010), mais rares sont ceux qui ont pu faire l’objet d’une étude détaillée.
Lorsqu’elles ont été réalisées, il ressort toujours des décomptes un déficit en jeunes
individus. Avec les précautions de rigueur quant à la reprise de travaux anciens,
on peut considérer cette pratique comme un fait récurrent, au moins entre le
Néolithique moyen et le Néolithique final, dans la région comme cela se dessine
par ailleurs dans d’autres régions.
Enfin, nous avons tenté de préciser chronologiquement les différentes phases
de fonctionnement du dolmen II en faisant dater certains ossements. Pour cela, il
fallait s’assurer préalablement que les sujets échantillonnés étaient clairement
individualisés. C’est pourquoi nous avons sélectionné à chaque fois le même os
évitant ainsi tous doublons (le talus gauche), sans qu’il soit bien entendu possible
de savoir, à partir de la morphologie des os, si les échantillons choisis appartenaient
à une même période d’utilisation du monument. Rappelons enfin que malgré les
456
Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France
travaux de F. Bouin, il n’a pas été possible de retrouver d’ossements humains avecune provenance stratigraphique claire qui auraient pu être datés préférentiellement.Quatre individus ont été finalement datés dans le cadre du programme “Artémis”(CDRC Lyon) via le Service Régional de l’Archéologie de la DRAC de Poitou-Charentes (fig. 299). Les résultats s’inscrivent tous dans la même tranche chrono-logique du Néolithique final, entre 2860 et 2460 avant J.-C. Aucune corrélationdirecte avec le mobilier n’est possible mais ces résultats correspondent bien à unedes phases de fonctionnement avérées par celui-ci.
Pour ce qui est des autres phases d’occupation, il est bien sûr regrettable qu’onne puisse les appréhender d’un point de vue radiométrique. Le faible nombre dedatations effectuées au regard de la centaine de sujets individualisés en est sansdoute une des raisons principales. En effet, pour le Néolithique moyen, lorsqueles données permettent de le constater, le nombre d’individus est limité à unepetite dizaine par chambre (F0 de Bougon, Champ-Châlon à Benon, Péré à Prissé-la-Charrière). Ce nombre limité réduit les chances de les repérer parmi la centained’individus reconnue dans le dolmen II de Puyraveau. Le mobilier accompagnantces morts est généralement lui aussi limité en nombre, ce qui explique sa faiblereprésentativité dans le corpus de Puyraveau (deux armatures tranchantes unique-ment).
Quant au Néolithique récent, les études de la parure, du mobilier osseux etlithique, ne permettent pas d’identifier clairement des éléments caractéristiquesde cette période. Est-ce lié à la nature peu diagnostique et ubiquiste des objets ou à leur absence ? Seule la céramique fait état de cette période de manièreindubitable et très marquée (phase Taizé ancien ; Ard, Ihuel, ce volume, p. 478).Deux possibilités s’offrent alors à nous : soit l’apport considérable de vases est enrapport avec le dépôt de corps et pourrait par exemple refléter la volonté demagnifier tout ou partie des individus, soit la fonction funéraire disparaîtmomentanément au profit d’un lieu de dépôt pour ces vases (à mettre en rapportavec la position et le rôle clé du groupe de Taizé dans la région), avant de reprendreau Néolithique final. Nous n’avons bien sûr pas la réponse. L’abondance demobilier, surtout lithique, et la datation des os mettent de fait en évidence unfonctionnement funéraire essentiellement au cours du Néolithique final (phaseTaizé récent), ce qui indique soit une reprise des dépôts de corps au cours de cettepériode, après un hiatus au Néolithique récent, soit plus vraisemblablement unecontinuité de dépôts depuis le Néolithique moyen. La question n’est en tout caspas anodine. En effet, si l’introduction de corps humains au cours du Néolithiquerécent est clairement attestée dans d’autres monuments construits au Néolithiquemoyen, la présence d’ossements humains est également rencontrée dans lesniveaux du Néolithique récent des fossés de nombreuses enceintes. Dans la régionde Puyraveau, très peu d’enceintes ont fait l’objet d’intervention archéologique.Le tri du matériel osseux issu des sondages réalisés dans les fossés de l’enceinte de
457
Les restes humains
Fertevault (Thouars) nous a permis d’identifier un fragment de voûte crânienneprovenant des niveaux contenant du mobilier céramique du Néolithique récentsimilaire à celui de Puyraveau. Or, la signification des dépôts humains dans lesfossés d’enceintes est encore largement discutée (Pariat 2007 ; Semelier 2007). Leurprésence est de plus en plus souvent mise en évidence dans les fossés du Centre-Ouest : squelettes complets ou os épars, associés ou non à de la faune, déposésparfois dans des structures aménagées et présentant dans certains cas un traitementparticulier du corps comme des blessures mortelles. On ignore encore malheu-reusement ce qu’ils représentent au Néolithique récent par rapport aux corpsdéposés dans les monuments mégalithiques.
Les os courts sont généralement mieux conservés que les autres. Des appariements par symétrie ontété tentés sur certains d’entre eux afin d’améliorer l’estimation du nombre minimum d’individus. Quel’on prenne en compte ou non ces données, le résultat global reste inchangé avec un nombre d’individusautour de 100 (Ensemble des talus gauches, les datations C14 effectuées ont été obtenues sur 4 de cesos) (Cliché : L. Soler).
517
Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France
Airvaux, Primault 2002 : AIRVAUX (J.), PRIMAULT (J.), Considérations surl’extension géographique du Néolithique final à “livre-de-beurre” en Touraine etPoitou, L’Anthropologie, t. 106, 2002, p. 269-294.
Alcaydé et al. 1970 : ALCAYDÉ (G.), BIGOT (A.), FEYS (R.), Carte géologique à1/50 000, feuille Saumur (485). Éd. BRGM, Orléans 1970, avec notice explicativede 15 p.
Anderson et al. 1992 : ANDERSON (P. C.), PLISSON (H.), RAMSEYER (D.), La moisson au Néolithique final : approche tracéologique d’outils en silex deMontilier et de Portalban, Archéologie suisse, t. 15, 1992, p. 60-67.
André 1998 : ANDRÉ (M.), La sépulture campaniforme des Boulloires à Saint-Martin-de-Fraigneau. In : JOUSSAUME (R.) dir., Les premiers paysans du Golfe.Le Néolithique dans le Marais poitevin. Éd. Patrimoines et médias, Chauray 1998,p. 120-122.
Arbogast et al. 2002 : ARBOGAST (R.-M.), DESLOGES (J.), CHANCEREL (A.),Sauvages et domestiques : les restes animaux dans les sépultures monumentalesnormandes du Néolithique, Anthropozoologica, t. 35, 2002, p. 17-27.
Ard 2008 : ARD (V.), Traditions techniques et savoir-faire céramiques auNéolithique récent dans le Centre-Ouest de la France : le cas des sites d’habitatattribués au Vienne-Charente, Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 105,n° 2, 2008, p. 345-369.
Ard 2011a : ARD (V.), Apport de la technologie céramique à la caractérisation descultures néolithiques : l’exemple du Néolithique récent du Centre-Ouest de laFrance (3600-2900 avant J.-C.). In : SÉNÉPART (I.), PERRIN (T.), THIRAULT (E.),BONNARDIN (S.) dir., Marges, frontières et transgressions. Actualité de larecherche, 8e Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente, Marseille, 7-8 novembre 2008, Archives d’Écologie Préhistorique, Toulouse 2011, p. 41-59.
Ard 2011b : ARD (V.), Traditions céramiques au Néolithique récent et final dansle Centre-Ouest de la France (3700-2200 avant J.-C.) : filiations et interactions entregroupes culturels. Thèse de doctorat, Université Paris Ouest/Nanterre/La Défense,2011, 2 vol., 641 p., dactylographiée.
BIBLIOGRAPHIE
518
Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France
Ard, Lacroix 2009 : ARD (V.), LACROIX (E.) dir., Puyraveau, le secret du dolmen.Catalogue de l’exposition du musée des Tumulus de Bougon, 10 juillet 2009 au
3 janvier 2010, Conseil général des Deux-Sèvres, Bougon 2009, 33 p.
Arnauld 1843 : ARNAULD (C.), Les monuments des Deux-Sèvres, Nouhet, LaDécouvrance. Réédition de Monuments religieux, militaires et civils du Poitou.
Deux-Sèvres, 1843, Niort 2005, 328 p.
Aubry 1991 : AUBRY (T.), L’exploitation des ressources en matières premièreslithiques dans les gisements solutréens et badegouliens du bassin versant de laCreuse (France). Thèse de doctorat, Université Bordeaux I, 1991, 327 p., 78 fig.,
17 tab., dactylographiée.
Augereau et al. 2007 : AUGEREAU (A.), BRUNET (P.), COSTA (L.), COTTIAUX
(R.), HAMON (T.), IHUEL (E.), LANGRY-FRANÇOIS (F.), MAGNE (P.),
MAINGAUD (A.), MALLET (N.), MARTINEAU (R.), MILLE (B.), MILLET-
RICHARD (L.-A.), POLLONI (A.), RENARD (C.), RICHARD (G.), SALANOVA
(L.), SAMZUN (A.), SIDÉRA (I.), SOHN (M.), Le Néolithique récent dans le
Centre-Nord de la France (3400/3300-2800/2700 av. J.-C.) : l’avenir du Seine-Oise-
Marne en question. In : EVIN (J.) dir., Un siècle de construction du discoursscientifique en Préhistoire. Actes du XXVIe Congrès préhistorique de France,
Congrès du Centenaire de la Société Préhistorique Française, Avignon-Bonnieux,
21-25 septembre 2004. Éd. SPF, Paris 2007, Vol. III, p. 165-184.
Auxiette 1989 : AUXIETTE (G.), Les bracelets néolithiques dans le nord de la
France, la Belgique et l’Allemagne rhénane, Revue archéologique de Picardie, t. 1,
n° 1-2, 1989, p. 13-65.
Bailloud 1975 : BAILLOUD (G.), Les céramiques “cannelées” du Néolithique
morbihannais, Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 72, n° 1, 1975,
p. 343-367.
Bailloud et al. 2008 : BAILLOUD (G.), BURNEZ (C.), DUDAY (H.),
LOUBOUTIN (C.) dir., La grotte d’Artenac à Saint-Mary (Charente) : révision dugisement éponyme. Éd. SPF (Travaux ; 8), Paris 2008, 126 p.
Barge 1982 : BARGE (H.), Les perles-pendeloques à coches en os. In : CAMPS-
FABRER (H.) dir., Industrie de l’os néolithique et de l’Âge des métaux. Deuxième
réunion du groupe de travail n° 3 sur l’industrie de l’os préhistorique. Saint-
Germain-en-Laye, 1980, Éd. CNRS, Paris 1982, p. 113-123.
Barge, Carry 1986 : BARGE (H.), CARRY (A.), Les parures en quartz hyalin du
Midi de la France, Bulletin du Musée d’Anthropologie préhistorique de Monaco,
t. 29, 1986, p. 65-80.
Barge-Mahieu et al. 1991 : BARGE-MAHIEU (H.), BELLIER (C.), CAMPS-FABRER
(H.), CATTELAIN (P.), MONS (L.), PROVENZANO (L.), TABORIN (Y.), Objets
519
Bibliographie
de parure, Cahier IV, Fiches typologiques de l’industrie osseuse préhistorique.Publications de l’Université de Provence, Aix-en-Provence 1991.
Baudouin 1935 : BAUDOUIN (M.), Les haches en serpentine de la Vendée,Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 32, n° 4, 1935, p. 245-247.
Besse 1996 : BESSE (M.), Le Campaniforme en France, Analyse de la céramiqued’accompagnement. BAR International Series 635, Oxford 1996, 56 p., 115 fig., 26 pl.
Beugnier, Crombé 2007 : BEUGNIER (V.), CROMBÉ (P.), L’outillage commun du premier site d’habitat néolithique découvert en Flandre (Belgique). Étudefonctionnelle de l’industrie lithique taillée du site de Waardamme (3e millénaireav. J.-C.), Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 104, n° 3, 2007, p. 525-542.
Beugnier, Plisson 2004 : BEUGNIER (V.), PLISSON (P.), Les poignards en silexdu Grand-Pressigny : fonction de signe et fonctions d’usage. In : BODU (P.),CONSTANTIN (C.) dir., Approches fonctionnelles en préhistoire. Actes du XXVe Congrès préhistorique de France, Nanterre, 24-26 novembre 2000, Éd. SPF,Paris 2004, p. 139-154.
Billard et al. 1996 : BILLARD (C.), CARRÉ (F.), GUILLON (M.), TREFFORT (C.),JAGU (D.), VERRON (G.), L’occupation funéraire des monuments mégalithiquespendant le haut Moyen Âge. Modalités et essai d’interprétation, Bulletin de laSociété Préhistorique Française, t. 93, n° 3, 1996, p. 279-286.
Billard et al. 2010 : BILLARD (C.), GUILLON (M.), VERRON (G.), Les sépulturescollectives du Néolithique récent-final de Val-de-Reuil et Porte-Joie (Eure - France).Université de Liège (ERAUL ; 123), Liège 2010, 409 p.
Birkner 1980 : BIRKNER (H.), L’image radiologique typique du squelette.Maloine, Paris 1980, 564 p.
Bökönyi 1970 : BÖKÖNYI (S.), A new method for the determination of thenumber of the individuals in animal bones material, American Journal ofArchaeology, t. 74, 1970, p. 291-292.
Bonnardin 2009 : BONNARDIN (S.), La parure funéraire au Néolithique anciendans les Bassins parisien et rhénan : Rubané, Hinkelstein et Villeneuve-Saint-Germain. Éd. SPF (Mémoire ; 49), Paris 2009, 322 p.
Bonnissent 1999 : BONNISSENT (D.), L’industrie sur matières dures animales.In : BURNEZ (C.), FOUÉRÉ (P.) dir., Les enceintes néolithiques de Diconche àSaintes (Charente-Maritime), une périodisation de l’Artenac. Société PréhistoriqueFrançaise (Mémoire ; XXV) et Éd. Association des Publications Chauvinoises(Mémoire ; XV), Chauvigny 1999, 1er vol., p. 131-137.
Bordes 1969 : BORDES (F.), Traitement thermique du silex au Solutréen, Bulletinde la Société Préhistorique Française, t. 66, n° 7, 1969, p. 197.
520
Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France
Bottet 1965 : BOTTET (R.), Complément à l’inventaire du mobilier de la “PierrePlate”, Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 62, n° 4, 1965, p. 154-156.
Bouchet et al. 1990a : BOUCHET (J.-M.), BURNEZ (C.), ROUSSOT-LARROQUE(J.), VILLES (A.), Le Bronze ancien dans la vallée de la Seugne : La Palut à Saint-Léger (Charente-Maritime), Gallia Préhistoire, t. 32, 1990, p. 237-275.
Bouchet et al. 1990b : BOUCHET (J.-M.), BURNEZ (C.), FOUÉRÉ (P.), La Grande-Pigouille à Belluire (Charente-Maritime), Bulletin de la Société PréhistoriqueFrançaise, t. 87, n° 5, 1990, p. 153-160.
Bouchet et al. 1993 : BOUCHET (J.-M.), BURNEZ (C.), FOUÉRÉ (P.), La Grande-Pigouille à Belluire (Charente-Maritime), Bulletin de la Société PréhistoriqueFrançaise, t. 90, n° 6, 1993, p. 436-442.
Bouchet et al. 1995 : BOUCHET (J.-M.), BURNEZ (C.), FOUÉRÉ (P.), Un site detransition du Néolithique récent-final : la fosse du Peuchin à Pérignac (Charente-Maritime), Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 92, n° 3, 1995, p. 332-345.
Bougeant 2009 : BOUGEANT (P.), L’habitat campaniforme de la plage del’Écuissière à Dolus-d’Oléron (Charente-Maritime). In : LAPORTE (L.) dir., Despremiers paysans aux premiers métallurgistes sur la façade atlantique de la France(3500-2000 av. J.-C.). Éd. Association des Publications Chauvinoises (Mémoire ;XXXIII), Chauvigny 2009, p. 163-166.
Bouin 1996a : BOUIN (F.), Le dolmen E134 de Taizé (Deux-Sèvres). Premiersrésultats. In : Internéo 1. Journée d’information du 23 novembre 1996, Éd.INTERNEO et SPF, Paris 1996, p. 121-126.
Bouin 1996b : BOUIN (F.), La sépulture sous dalle de la Grosse Pierre à Luzay,Bulletin de la Société Historique et Scientifique des Deux-Sèvres, t. 4, n° 1-2, 1996,p. 333-349.
Bouin 2002 : BOUIN (F.), 7.2.1. Étude spécialisée 14 : Le dolmen des Sept-Cheminsà Bougon. In : MOHEN (J.-P.), SCARRE (C.) dir., Les tumulus de Bougon (Deux-Sèvres). Complexe mégalithique du Ve au IIIe millénaire. Éd. Errance, Paris 2002,p. 170-175.
Bouin, Joussaume 1998 : BOUIN (F.), JOUSSAUME (R.), Le tumulus du Planti àAvailles-sur-Chizé (Deux-Sèvres). In : GUTHERZ (X.), JOUSSAUME (R.) dir., LeNéolithique du Centre-Ouest de la France. Actes du XXIe Colloque inter-régionalsur le Néolithique, Poitiers, 14-16 octobre 1994, Éd. Association des PublicationsChauvinoises (Mémoire ; XIV), Chauvigny 1998, p. 169-182.
Bouin, Legriel 1997 : BOUIN (F.), LEGRIEL (J.), Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres). Dolmens de Puyraveau. Fouilles programmées. 15 juillet - 17 novembre1997. DRAC - SRA Poitou-Charentes, 1997, 13 p., 7 fig., 4 pl., dactylographié.
521
Bibliographie
Boujot, L’Helgouach 1987 : BOUJOT (C.), L’HELGOUACH (J.), Le site
néolithique à fossés interrompus des Prises à Machecoul (Loire-Atlantique). Études
sur le secteur oriental. In : Préhistoire de Poitou-Charentes, problèmes actuels.Actes du 111e Congrès national des Sociétés savantes, Poitiers, 1986, Éd. CTHS,
Paris 1987, p. 255-269.
Boulestin 2010 : BOULESTIN (B.), Face aux mégalithes. Sépultures en grotte du
Néolithique moyen en Charente, Archéo-Théma, n° 10, sept-oct. 2010, p. 24.
Bourgarit, Mille 2003 : BOURGARIT (D.), MILLE (B.), The elemental analysis of
ancient copper-based artefacts by Inductively-Coupled-Plasma Atomic-Emission-
Spectrometry (ICP-AES): an optimized methodology reveals some secrets of the
Vix Crater, Measurement Science and Technology, t. 14, 2003, p. 1 538-1 555.
Bourhis, Briard 1979 : BOURHIS (J.-R.), BRIARD (J.), Analyses spectrographiquesd’objets préhistoriques et antiques. Quatrième série. Université de Rennes I
(Travaux du laboratoire “Anthropologie - Préhistoire - Protohistoire - Quaternaire
armoricains”), Rennes 1979, 133 p.
Briard, L’Helgouach 1958 : BRIARD (J.), L'HELGOUACH (J.), Chalcolithique,Néolithique secondaire, survivances néolithiques à l'Âge du Bronze ancien enArmorique. Travaux du laboratoire d'anthropologie préhistorique, Rennes 1957,
72 p.
Briard, Maréchal 1958 : BRIARD (J.), MARÉCHAL (J.-R.), Étude technique
d’objets métalliques du Chalcolithique et de l’Âge du Bronze de Bretagne, Bulletinde la Société Préhistorique Française, t. 55, n° 7-8, 1958, p. 422-430.
Briard, Roussot-Larroque 2002 : BRIARD (J.), ROUSSOT-LARROQUE (J.), Les
débuts de la métallurgie de la France atlantique. In : BARTELHEIM (M.),
PERNICKA (E.), KRAUSE (R.) dir., Die Anfänge der Metallurgie in der Alten Welt / The beginnings of Metallurgy in the Old World, 1997, M. Leidorf,
Rahden/Westf. 2002, p. 135-160.
Bruzek et al. 1996 : BRUZEK (J.), CASTEX (D.), MAJO (T.), Évaluation des
caractères morphologiques de la face sacro-pelvienne de l’os coxal. Proposition
d’une nouvelle méthode de diagnose sexuelle, Bulletins et mémoires de la Sociétéd’Anthropologie de Paris, t. 8, n° 3-4, 1996, p. 481-490.
Buret 1983 : BURET (C.), L’industrie de la pierre polie au Néolithique moyen etrécent à Auvernier, canton de Neuchâtel (Suisse). Thèse de doctorat, sous la
direction de J. Tixier, Université Paris X, 1983, 196 p., dactylographiée.
Buret, Ricq-de-Bouard 1982 : BURET (C.), RICQ-DE-BOUARD (M.), L’industriede la “pierre polie” du Néolithique moyen d’Auvernier (Neuchâtel, Suisse) : lesrelations entre la matière première et les objets. Éd. CNRS (Notes internes du
Centre de Recherches archéologiques ; 41), Sophia-Antipolis 1982, 27 p.
522
Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France
Burgaud 1941 : BURGAUD (P.), Fouille d’un petit dolmen à Trizay (Charente-Inférieure), Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 38, n° 1-2, 1941, p. 43-48.
Burnez 1976 : BURNEZ (C.), Le Néolithique et le Chalcolithique dans le Centre-Ouest de la France. Éd. SPF (Mémoire ; XII), Paris 1976, 374 p.
Burnez 1996 : BURNEZ (C.) dir., Le site des Loups à Échiré (Deux-Sèvres). Conseilgénéral des Deux-Sèvres, Éd. Musée des Tumulus de Bougon, 1996, 255 p., 159 fig., 19 ph.
Burnez 2010 : BURNEZ (C.), Le Camp à Challignac (Charente) au IIIe millénaireav. J.-C. Un établissement complexe de la culture d’Artenac dans le Centre-Ouestde la France. BAR International Series 2165, Oxford 2010, 494 p.
Burnez, Fouéré 1999 : BURNEZ (C.), FOUÉRÉ (P.) dir., Les enceintes néolithiquesde Diconche à Saintes (Charente-Maritime), une périodisation de l’Artenac. Éd. SPF (Mémoire ; XXV) et Éd. Association des Publications Chauvinoises(Mémoire ; XV), Chauvigny 1999, 2 vol., 829 p., 99 fig., 58 ph.
Burnez, Lagarde 1986 : BURNEZ (C.), LAGARDE (M.-C.), Campaniformes sur lesite des Loups à Échiré (Deux-Sèvres). In : JOUSSAUME (R.) dir., CulturesCampaniformes dans le Centre-Ouest de la France. Éd. GVEP, La Roche-sur-Yon1986, p. 97-100.
Burnez, Louboutin 2002 : BURNEZ (C.), LOUBOUTIN (C.), The causewayedenclosures of Western-Central France from the beginning of the fourth to the endof the third Millenium. In : VARNDELL (G.), TOPPING (P.) dir., Enclosures inNeolithic Europe, Essays on Causewayed and Non-Causewayed Sites. Actes duColloque Neolithic Enclosures in Europe, Londres, English Heritage, 1999, OxfordBooks, Oxford 2002, p. 11-27.
Burnez et al. 1962 : BURNEZ (C.), RIQUET (R.), POULAIN (T.), La grotte n° 2de la Trache, commune de Châteaubernard, canton de Cognac (Charente), Bulletinde la Société Préhistorique Française, t. 59, n° 7-8, 1962, p. 445-477.
Burnez et al. 1991 : BURNEZ (C.), FISCHER (F.), FOUÉRÉ (P.), Le Gros-Bost àSaint-Méard-de-Drône (Dordogne), Bulletin de la Société Préhistorique Française,t. 88, n° 10-12, 1991, p. 291-340.
Burnez et al. 1995 : BURNEZ (C.), DASSIÉ (J.), SICAUD (F.), L’enceinteartenacienne du “Camp” à Challignac (Charente), Bulletin de la SociétéPréhistorique Française, t. 92, n° 4, 1995, p. 463-478.
Burnez et al. 1998 : BURNEZ (C.), FOUÉRÉ (P.), LOUBOUTIN (C.), Artenac et Campaniforme dans le Centre-Ouest de la France, Bulletin de la SociétéPréhistorique Française, t. 95, n° 3, 1998, p. 303-304.
Burnez et al. 2001 : BURNEZ (C.), LOUBOUTIN (C.), BRAGUIER (S.), Leshabitats néolithiques ceinturés du Centre-Ouest de la France. In : GUILAINE (J.)
523
Bibliographie
dir., Communautés villageoises du Proche-Orient à l’Atlantique (8000-2000 avantnotre ère). Séminaire du Collège de France, Éd. Errance, Paris 2001, p. 205-220.
Burnez-Lanotte et al. 2008 : BURNEZ-LANOTTE (L.), ILETT (M.), ALLARD (P.),Avant-propos. In : BURNEZ-LANOTTE (L.), ILETT (M.), ALLARD (P.) dir., Findes traditions danubiennes dans le Néolithique ancien du Bassin parisien et de la Belgique (5100-4700 av. J.-C.). Autour des recherches de Claude Constantin.Éd. SPF (Mémoire ; XLIV), Paris 2008, p. 11-18.
Cadot, Touzeau 1999 : CADOT (R.), TOUZEAU (A.), Présence d’anneaux enschiste dans un contexte peu-richardien au Châtelet à Landrais (Charente-Maritime),Bulletin du Groupe vendéen d’études préhistoriques, t. 35, 1999, p. 29-45.
Caspar et al. 2005 : CASPAR (J.-P.), FÉRAY (P.), MARTIAL (E.), Identification etreconstitution des traces de teillage des fibres végétales au Néolithique, Bulletinde la Société Préhistorique Française, t. 102, n° 4, 2005, p. 867-880.
Cassen 1987 : CASSEN (S.), Le Centre-Ouest de la France au IVe millénaire av. J.-C.BAR International Series 342, Oxford 1987, 390 p., 112 fig., 7 ph.
Cassen 1989 : CASSEN (S.), Préhistoire récente du Choletais : une exploitationcartographique de la prospection désordonnée, Revue Archéologique de l’Ouest,t. 6, 1989, p. 71-92.
Cassen 1992 : CASSEN (S.), Le Néolithique récent sur la façade atlantique de laFrance. La différenciation stylistique des groupes céramiques, Zephyrus, t. XLIV-XLV, 1992, p. 167-182.
Cassen et al. 1998 : CASSEN (S.), AUDREN (C.), HINGUANT (S.), LANNUZEL(G.), MARCHAND (G.), L’habitat Villeneuve-Saint-Germain du Haut-Mée (Saint-Étienne-en-Coglès, Ille-et-Vilaine), Bulletin de la Société Préhistorique Française,t. 95, n° 1, 1998, p. 41-75.
Cassini de Thury 1760-1765 : CASSINI DE THURY (C.-F.), Carte générale de laFrance à 1/84 600, feuille Richelieu-Saumur (66). Dépôt de la Guerre, Paris 1760-1765.
Chambon 2002 : CHAMBON (P.), Analyse des dépôts sépulcraux des dolmens F0
et B2 de Bougon. In : MOHEN (J.-P.), SCARRE (C.), Les Tumulus de Bougon(Deux-Sèvres). Complexe mégalithique du Ve au IIIe millénaire. Éd. Errance, Paris2002, p. 132-143.
Chambon 2003 : CHAMBON (P.), Les morts dans les sépultures collectivesnéolithiques en France : du cadavre aux restes ultimes. Éd. CNRS, Paris 2003, 395 p.
Champême 1989 : CHAMPÊME (L.-M.), Sur les côteaux de Fertevault, communede Thouars (Deux-Sèvres). Éperon barré préhistorique. Sondage août 1989. DRAC - SRA Poitou-Charentes, 1989, 6 p., 15 fig., dactylographié.
524
Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France
Champême 1996 : CHAMPÊME (L.-M.), L’éperon barré du Clos du Logis à Saint-Généroux (Deux-Sèvres). Occupation du site et de ses abords. In : Internéo 1.Journée d’information du 23 novembre 1996. Éd. INTERNEO et SPF, Paris 1996,p. 169-183.
Champême 1998 : CHAMPÊME (L.-M.), Le bâtiment sur poteaux du FiefBaudouin, commune d’Airvault (Deux-Sèvres). In : GUTHERZ (X.), JOUSSAUME(R.) dir., Le Néolithique du Centre-Ouest de la France. Actes du XXIe Colloqueinter-régional sur le Néolithique, Poitiers, 14-16 octobre 1994, Éd. Association desPublications Chauvinoises (Mémoire ; XIV), Chauvigny 1998, p. 297-306.
Champême 1999 : CHAMPÊME (L.-M.), Enceintes à fossés de barrage dans lebassin du Thouet (Deux-Sèvres), Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 96, n° 3, 1999, p. 353-358.
Chantraine et al. 1986 : CHANTRAINE (J.), CHAURIS (L.), CABANIS (B.),CHAURIS (M.-M.), LARSONNEUR (C.), HERROUIN (Y.), RABU (D.), LULZAC(Y.), BOS (P.), Notice explicative de la feuille de Plestin-les-Grèves, cartegéologique de la France à 1/50�000. Éd. BRGM, Orléans 1986, 84 p.
Chaplin 1971 : CHAPLIN (R. E.), The study of animal bones from archaeologicalsites. Seminar Press, London/New-York 1971, 170 p.
Chauvet 1899 : CHAUVET (G.), Statistique et bibliographie des sépulturespréromaines du département de la Charente, Bulletin de la Société Archéologiqueet Historique de la Charente, 1899, p. 491-542.
Chevalier et al. 1982 : CHEVALIER (J.), TIXIER (J.), INIZAN (M.-L.), Unetechnique de perforation par percussion de perles en cornaline (Larsa, Iraq),Paléorient, t. 8, n° 2, 1982, p. 55-62.
Clottes, Costantini 1976 : CLOTTES (J.), COSTANTINI (G.), Les civilisationsnéolithiques dans les Causses. In : GUILAINE (J.) dir., La Préhistoire française. II. Les civilisations néolithiques et protohistoriques de la France. Éd. CNRS, Paris1976, p. 279-291.
Collin, Minier 1999 : COLLIN (M.), MINIER (J.-P.), Inventaire des paysages dePoitou-Charentes. CREN Poitou-Charentes, Poitiers 1999, 3 vol., 1 carte à 1/250 000
hors-texte.
Colmont 2006 : COLMONT (G.), Comment situer l’origine des élémentsarchitecturaux d’un mégalithe ? In : JOUSSAUME (R.), LAPORTE (L.), SCARRE(C.) dir., Origine et développement du mégalithisme de l’Ouest de l’Europe. Actesdu colloque international, Bougon, 26-30 octobre 2002, Conseil général des Deux-Sèvres, Niort 2006, p. 357-363.
Cordier 1986 : CORDIER (G.), Les dépôts de lames en silex en France, ÉtudesPréhistoriques, t. 17, 1986, p. 33-48.
525
Bibliographie
Cordier 1987 : CORDIER (G.), L’œuvre scientifique du doyen Patte. La Simarre,Joué-les-Tours 1987, 32 p.
Cordier, Riquet 1958 : CORDIER (G.), RIQUET (R.), L’ossuaire du Vigneau et ledolmen de la Roche, commune de Manthelan (Indre-et-Loire), L’Anthropologie,t. 62, n° 1-2, 1958, p. 2-29.
Cordier et al. 1972 : CORDIER (G.), RIQUET (R.), BRABANT (H.), POULAIN(T.), Le site archéologique du dolmen de Villaine à Sublaines (Indre-et-Loire),Gallia Préhistoire, t. 15, n° 1, 1972, p. 31-135.
Cormenier 2005 : CORMENIER (A.), Les interactions Artenac-Campaniforme dansle Centre-Ouest de la France : l’apport des décors céramiques. Mémoire deMaîtrise, Université Paris I, 2005, 2 vol., dactylographié.
Cormenier 2009 : CORMENIER (A.), V. Les interactions entre Artenacien etCampaniforme dans le Centre-Ouest de la France. L’apport des décors céramiques.In : LAPORTE (L.) dir., Des premiers paysans aux premiers métallurgistes sur lafaçade atlantique de la France (3500-2000 av. J.-C.). Éd. Association des PublicationsChauvinoises (Mémoire ; XXXIII), Chauvigny 2009, p. 314-328.
Cottiaux et al., à paraître : COTTIAUX (R.), SALANOVA (L.), BRUNET (P.),LANGRY-FRANÇOIS (F.), MAINGAUD (A.), MARTINEAU (R.), MILLE (B.),POLLONI (A.), RENARD (C.), SOHN (M.), Synthèse des connaissances sur leNéolithique récent dans le Bassin parisien (3600-2900 av. J.-C.) : périodisation etdéfinition de faciès régionaux. In : SALANOVA (L.), COTTIAUX (R.) dir., LeNéolithique récent du Bassin parisien. Revue Archéologique de l’Est (Suppl.), àparaître.
Crédot 2002 : CRÉDOT (R.) avec la collaboration de LINTZ (G.), Le dolmen deBagnol à Fromental (Haute-Vienne), Bulletin de la Société Préhistorique Française,t. 99, n° 1, 2002, p. 81-90.
Daleau, Maufras 1904 : DALEAU (F.), MAUFRAS (E.), Le dolmen sous tumulusdu Terrier de Cabut, commune d’Anglade (Gironde), Bulletin de la SociétéArchéologique de Bordeaux, t. XXV, 1904, p. 84-91 et 96-97.
Delibes de Castro 1977 : DELIBES DE CASTRO (G.), El Vaso Campaniforme enla Meseta Norte Española. Universidad de Valladolid (Studia Archeologica ; 46),Valladolid 1977, 174 p.
Detante 2002 : DETANTE (M.), Étude anthropologique des niveaux artenaciensde la grotte du Quéroy (Chazelles, Charente). Mémoire de Maîtrise, UniversitéParis I, 2002, 107 p., dactylographié.
Dhoste et al. 1987 : DHOSTE (M.), LEGENDRE (L.), COUBÈS (L.), Cartegéologique à 1/50 000, feuille Thouars (539). Éd. BRGM, Orléans 1987.
Duday 1987a : DUDAY (H.), Contribution des observations ostéologiques à lachronologie interne des sépultures collectives. In : DUDAY (H.), MASSET (C.)
526
Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France
dir., Anthropologie physique et Archéologie : Méthodes d’étude des sépultures.Actes du colloque de Toulouse, novembre 1982, Éd. CNRS, Paris 1987, p. 51-59.
Duday 1987b : DUDAY (H.), La quantification des restes humains. Application
aux sépultures à incinération, ou des différentiels autres que la conservation. In :
Actes de la table ronde : Méthode d’étude des sépultures. RCP 742 du CNRS, Saint-
Germain-en-Laye 1987, p. 1-12.
Duday, Soler 2008 : DUDAY (H.), SOLER (L.), Anthropologie de terrain,
anthropologie biologique : le fonctionnement funéraire de la cavité. In :
BAILLOUD (G.), BURNEZ (C.), DUDAY (H.), LOUBOUTIN (C.) dir., La grottesépulcrale d’Artenac à Saint-Mary (Charente) : révision du gisement éponyme.
Éd. SPF (Travaux ; 8), Paris 2008, p. 73-94.
Duday et al. 1995 : DUDAY (H.), LAUBENHEIMER (F.), TILLIER (A.-M.),
Sallèles-d’Aude : nouveau-nés et nourrissons chez les potiers gallo-romains.Université de Besançon (Annales littéraires de l’Université de Besançon ; 144) et
Les Belles Lettres (Centre de Recherches d’Histoire Ancienne ; 144), Besançon/Paris
1995, 146 p.
Duday et al. 2000 : DUDAY (H.), DEPIERRE (G.), JANIN (T.), Validation des
paramètres de quantification, protocoles et stratégies dans l’étude anthropologique
des sépultures secondaires à incinération. L’exemple des nécropoles protohisto-
riques du Midi de la France. In : DEDET (B.), GRUAT (P.), MARCHAND (G.),
PY (M.), SCHWALLER (M.) dir., Archéologie de la Mort, Archéologie de la tombeau premier Âge du Fer. Association pour la recherche archéologique en Languedoc
oriental (Monographie d’Archéologie Méditerranéenne ; 5), Lattes 2000, p. 7-
29.
Duhard 2002 : DUHARD (J.-P.), Quelques aspects techniques dans la confection
des “perles” néolithiques en pierre du Sahara, Bulletin de la Société PréhistoriqueFrançaise, t. 99, n° 2, 2002, p. 357-365.
Dupin 1804 : DUPIN (C.-F.-E.), Mémoire statistique du département des Deux-Sèvres, adressé au ministre de l’Intérieur d’après ses instructions. Imprimerie de
la République, Paris 1804, 304 p.
Duplessy 1999 : DUPLESSY (J.), Les monnaies françaises royales : de HuguesCapet à Louis XVI (987-1793). 2e édition, Maison Platt, Paris 1999, vol. 1, 377 p.
Durbet 1993 : DURBET (G.), Caractérisation technologique et interprétation
dynamique d’une concentration lithique moustérienne, Champ-Paillard (Deux-
Sèvres), Locus 1, Amas A, Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 90,
n° 6, 1993, p. 405-410.
Fasekas, Kósa 1978 : FASEKAS (I. G.), KÓSA (F.), Forensic Foetal Osteology.
Akademiai Kiado, Budapest 1978, 414 p.
527
Bibliographie
Figueroa-Larre 2005 : FIGUEROA-LARRE (V.), La métallurgie en contexte campa-niforme : Nord de la péninsule Ibérique et en France. Mémoire de Maîtrise,Université Paris 1, 2005, 123 p. + annexes, dactylographié.
Fouéré 1994 : FOUÉRÉ (P.), Les industries en silex entre Néolithique moyen etCampaniforme dans le nord du Bassin aquitain. Approche méthodologique,implications culturelles de l’économie des matières premières et du débitage.Thèse de doctorat, Université Bordeaux I, 1994, 547 p., 163 fig., 139 pl. hors-texte,dactylographiée.
Fouéré 1998 : FOUÉRÉ (P.), Variabilité des industries en silex entre le Néolithiquemoyen et le début du Néolithique récent en Centre-Ouest. In : GUTHERZ (X.),JOUSSAUME (R.) dir., Le Néolithique du Centre-Ouest de la France. Actes duXXIe colloque inter-régional sur le Néolithique, Poitiers, 14-16 octobre 1994, Éd. Association des Publications Chauvinoises (Mémoire ; XIV), Chauvigny 1998,p. 133-145.
Fouéré, Dias-Meirinho 2008 : FOUÉRÉ (P.), DIAS-MEIRINHO (M.-H.), Lesindustries lithiques taillées des IVe et IIIe millénaires dans le Centre-Ouest et leSud-Est de la France. In : DIAS-MEIRINHO (M.-H.), LÉA (V.), GERNIGON (K.),FOUÉRÉ (P.), BRIOIS (F.), BAILLY (M.) dir., Les industries lithiques taillées desIVe et IIIe millénaires en Europe occidentale. Colloque international, Toulouse, 7-9 avril 2005, BAR International Series 1884, Oxford 2008, p. 231-258.
Fromont 2005 : FROMONT (N.), Les anneaux en pierre dans le nord de la Franceet la Belgique au Néolithique ancien : structuration des productions et de lacirculation des matières premières. In : MARCHAND (G.), TRESSET (A.) dir.,Unité et diversité des processus de néolithisation sur la façade atlantique del’Europe (6e-4e millénaires avant J.-C.). Table ronde de Nantes, 26-27 avril 2002,Éd. SPF (Mémoire ; XXXVI), Paris 2005, p. 203-212.
Gabilly 1957 : GABILLY (J.), Les étapes de la transgression du Lias dans le norddes Deux-Sèvres. Travaux de l’Institut de Géologie et d’Anthropologie Préhisto-rique de la Faculté des Sciences de Poitiers, vol. I, 1957, p. 13-60.
Gabilly 1961 : GABILLY (J.), Observations sur l’extension des dépôts secondairesde part et d’autre de l’anticlinal de Parthenay, Comptes Rendus Hebdomadairesdes Séances de l’Académie des Sciences, t. 253, 1961, p. 2 723-2 725.
Gachina 1998 : GACHINA (J.), Le dolmen de “la Grosse Pierre” à Sainte-Radegonde (Charente-Maritime). In : GUTHERZ (X.), JOUSSAUME (R.) dir., LeNéolithique du Centre-Ouest de la France. Actes du XXIe Colloque inter-régionalsur le Néolithique, Poitiers, 14-16 octobre 1994, Éd. Association des PublicationsChauvinoises (Mémoire ; XIV), Chauvigny 1998, p. 193-202.
Gaillard, Gomez de Soto 1984 : GAILLARD (J.), GOMEZ DE SOTO (J.), III. Lesanneaux en pierre. Conclusion archéologique, Gallia Préhistoire, t. 27, n° 1, 1984,p. 108-115.
528
Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France
Galan et al. 1961 : GALAN (A.), CAVAILLÉ (A.), RIQUET (R.), La grotte de Marsa
(Beauregard, Lot), Gallia Préhistoire, t. 4, 1961, p. 91-142.
Gallay, Gallay 1968 : GALLAY (A.), GALLAY (G.), Le Jura et la séquence
Néolithique récent - Bronze ancien, Archives Suisses d’Anthropologie générale,Genève, t. 33, n° 1, 1968, p. 1-84.
Gandriau 2008 : GANDRIAU (O.), Le bois des Jarries à Saint-Mars-la-Réorthe
(Vendée), Bulletin du Groupe Vendéen d’Études Préhistoriques, t. 44, 2008, p. 1-
48.
Gardin 1998 : GARDIN (C. du), Le Campaniforme et l’ambre : mythe ou réalité ?,
Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 95, n° 3, 1998, p. 343-350.
Gardin 2002 : GARDIN (C. du), L’ambre et sa circulation dans l’Europe
protohistorique. In : GUILAINE (J.) dir., Matériaux, productions, circulations du Néolithique à l’Âge du Bronze. Séminaire du Collège de France, Éd. Errance
(coll. des Hespérides), Paris 2002, p. 213-238.
Gauron, Massaud 1983 : GAURON (E.), MASSAUD (J.), La nécropole de Chenon.Étude d’un ensemble dolménique charentais. Éd. CNRS (Suppl. à Gallia
Préhistoire ; XVIII), Paris 1983, 195 p., 47 fig.
Gauron, Massaud 1987 : GAURON (E.), MASSAUD (J.), Le dolmen de la Motte
de la Jacquille (commune de Fontenille, Charente). Un élément architectural
inédit, Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 84, n° 2, 1987, p. 60-64.
Gaussen 1995 : GAUSSEN (J.), Le poste de travail d’un fabricant de perles
néolithiques (Pays Ioullemedene - Région de Ménaka - République du Mali). In :
CHERNORKIAN (R.) dir., L’Homme méditerranéen : mélanges offerts à GabrielCamps. Université de Provence, Aix-en-Provence 1995, p. 87-92.
Germond 1980 : GERMOND (G.), Inventaire des mégalithes de la France. 6 - Deux-Sèvres. Éd. CNRS (Suppl. à Gallia Préhistoire ; I), Paris 1980, 286 p.
Germond 1998 : GERMOND (G.), La contribution thouarsaise à la connaissance
du Néolithique récent et final du Centre-Ouest. In : GUTHERZ (X.),
JOUSSAUME (R.) dir., Le Néolithique du Centre-Ouest de la France. Actes du
XXIe Colloque inter-régional sur le Néolithique, Poitiers, 14-16 octobre 1994,
Éd. Association des Publications Chauvinoises (Mémoire ; XIV), Chauvigny 1998,
p. 257-278.
Germond 2001 : GERMOND (G.), Les Deux-Sèvres préhistoriques. Geste Éditions,
La Crèche 2001, 299 p.
Germond 2010 : GERMOND (G.), Inventaire des mégalithes de la France. Deux-Sèvres. Réédition du Conseil général des Deux-Sèvres et du SRA Poitou-Charentes,
1980, Éd. CNRS (Suppl. à Gallia Préhistoire ; I), Paris 2010, 286 p.
529
Bibliographie
Germond, Joussaume 1983 : GERMOND (G.), JOUSSAUME (R.), avec la
participation de BIZARD (M.), Le tumulus du Montiou à Sainte-Soline (Deux-
Sèvres). Présentation, premier bilan des fouilles. In : Congrès préhistorique deFrance. XXIe Session, Montauban/Cahors, 1979, Éd. SPF, Paris 1983, vol. 2, p. 131-
138.
Germond et al. 1975 : GERMOND (G.), BILLY (G.), FAYE (S.), Le mégalithe de
la Pille-Verte à Mauzé-Thouarsais (Deux-Sèvres), L’Anthropologie, t. 79, n° 1, 1975,
p. 113-139.
Germond et al. 1994 : GERMOND (G.), CHAMPÊME (L.-M.), CHAMPÊME (M.),
FERNANDEZ (L.), Le tumulus de la Motte des Justices à Thouars (Deux-Sèvres).
Premiers sondages. Premiers résultats, Bulletin de la Société Préhistorique
Française, t. 91, n° 6, 1994, p. 394-406.
Geslin et al. 1975 : GESLIN (M.), BASTIEN (G.), MALLET (N.), Le dépôt de
grandes lames de La Creusette, Barrou (Indre-et-Loire), Gallia-Préhistoire, t. 18,
n° 2, 1975, p. 401-422.
Giot et al. 1979 : GIOT (P.-R.), L’HELGOUAC’H (J.), MONNIER (J.-L.),
Préhistoire de la Bretagne. Éd. Ouest-France, Rennes 1979, 445 p.
Giot et al. 1986 : GIOT (D.), MALLET (N.), MILLET (D.), Les silex de la région
du Grand-Pressigny (Indre-et-Loire), recherches géologiques et analyses pétrogra-
phiques, Revue Archéologique du Centre de la France, t. 25, 1986, p. 21-36.
Goër de Hervé, Surmely 2006 : GOËR DE HERVÉ (A. de), SURMELY (F.),
Nouvelles études sur la provenance géographique des blocs utilisés pour la
construction de monuments mégalithiques dans le département du Puy-de-Dôme.
In : JOUSSAUME (R.), LAPORTE (L.), SCARRE (C.) dir., Origine et développe-
ment du mégalithisme de l’Ouest de l’Europe. Actes du colloque international,
Bougon, 26-30 octobre 2002, Conseil général des Deux-Sèvres, Niort 2006, p. 249-
252.
Gomez de Soto 1980 : GOMEZ DE SOTO (J.), Les cultures de l’Âge du Bronze
dans le bassin de la Charente. Pierre Fanlac, Périgueux 1980, 119 p.
Gomez de Soto 1984 : GOMEZ DE SOTO (J.), Approche de la paléométallurgie
dans le bassin de la Charente d’après les résultats des analyses spectrographiques.
In : BRIARD (J.) dir., Paléométallurgie de la France atlantique. Université de
Rennes I (Travaux du laboratoire “Anthropologie - Préhistoire - Protohistoire -
Quaternaire armoricains”), Rennes 1984, p. 85-97.
Gomez de Soto, Laporte 1990 : GOMEZ DE SOTO (J.), LAPORTE (L.), Les niveaux
artenaciens de la grotte du Quéroy à Chazelles (Charente), Gallia Préhistoire,
t. 32, 1990, p. 179-235.
530
Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France
Gonzales, Ibanez 1994 : GONZALES URQIJO (J.-M.), IBANEZ ESTEVEZ (J.-J.),
Metodologia de analisis funcional de instrumentos tallados en silex. Universidad
de Deusto (Cuadernos de Arqueologia ; 14), Bilbao 1994, 301 p.
Gorelick, Gwinnett 1978 : GORELICK (L.), GWINNETT (E. J.), Ancient seals and
modern science, Expedition, t. 20, n° 2, 1978, p. 38-47.
Grébénart 1980 : GRÉBÉNART (D.), La grotte sépulcrale des Barbilloux (Saint-
Aquilin, Dordogne). I - Étude archéologique, Gallia Préhistoire, t. 23, n° 1, 1980,
p. 153-175.
Gruet 1967 : GRUET (M.), Inventaire des mégalithes de la France. 2. Maine-et-Loire. Éd. CNRS, Paris 1967, 345 p.
Gruet 1995 : GRUET (M.), L’enceinte néolithique de Matheflon à Seiches (Maine-
et-Loire). In : Journée d’information archéologique. Association d’Études préhisto-
riques et protohistoriques des Pays de la Loire, Angers, 28 janvier 1995, p. 13-18.
Gruet, Passini 1986 : GRUET (M.), PASSINI (B.), La Bajoulière en Saint-Rémy-la-
Varenne (Maine-et-Loire). Fouille et restauration d’un grand “dolmen angevin”,
Revue Archéologique de l’Ouest, t. 3, 1986, p. 29-46.
Gruet et al. 1973 : GRUET (M.), PASSINI (B.), SIRAUDEAU (J.), SIRAUDEAU
(M.-C.), CHALLET (P.), L’ossuaire semi-mégalithique de Chacé (Maine-et-Loire),
Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 70, n° 10, 1973, p. 385-400.
Guilaine et al. 2001 : GUILAINE (J.), CLAUSTRE (F.), LEMERCIER (O.),
SABATIER (P.), Campaniformes et environnement culturel en France méditer-
ranéenne. In : NICOLIS (F.) dir., Bell Beaker Today : pottery, people, culture,symbols in Prehistoric Europe. Proceeding of the International Colloquium, Riva
del Garda (Trento, Italy), 11-16 May 1998, Trento 2001, p. 229-275.
Gutherz 1998 : GUTHERZ (X.), Le mégalithisme en Poitou-Charentes. Acquis,
recherches, protection et mise en valeur. In : SOULIER (P.) dir., La France desdolmens et des sépultures collectives (4500-2000 avant J.-C.). Éd. Errance (coll.
Archéologie Aujourd’hui), Paris 1998, p. 282-290.
Guyodo 2001 : GUYODO (J.-N.), Les assemblages lithiques des groupes néo-lithiques sur le massif Armoricain et ses marges. Thèse de doctorat, Université de
Rennes I, 2001, 466 p., dactylographiée.
Hamon 1998 : HAMON (T.), L’enceinte néolithique du Montet, ses rapports avec
les ateliers du Grand-Pressigny, Bulletin des Amis du Musée du Grand-Pressigny,t. 49, 1998, p. 37-42.
Hébras 1960 : HÉBRAS (C.), Fouille d’un dolmen du groupe de Monpalais,
commune de Taizé (Deux-Sèvres), Bulletin de la Société Préhistorique Française,t. 57, n° 11-12, 1960, p. 666-671.
531
Bibliographie
Hébras 1965 : HÉBRAS (C.), Le dolmen E 136 du groupe de Monpalais, communede Taizé (Deux-Sèvres), Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 62, n° 1,1965, p. 139-158.
Hébras 1978 : HÉBRAS (C.), La station chalcolithique des Sablons à Saint-Jouin-de-Marnes (Deux-Sèvres), Bulletin de la Société des Antiquaires de l’Ouest, t. 14,1978, p. 613-624.
Hébras, Labitte 1969 : HÉBRAS (C.), LABITTE (J.), Une gaine en bois de cerf dansle Thouarsais (Deux-Sèvres), Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 66,n° 5, 1969, p. 147-148.
Hénaff 2003 : HÉNAFF (X.), La céramique décorée du site artenacien dePonthezières à Saint-Georges-d’Oléron (Charente-Maritime) dans son cadrerégional, Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 100, n° 4, 2003, p. 733-755.
Herrán-Martínez 1997 : HERRÁN-MARTÍNEZ (J.), Arqueometalurgia de la Edaddel Bronce en Castilla y León. Tesis doctoral, Universidad de Valladolid, 1997,dactylographiée.
Honegger 2001 : HONEGGER (M.), L’industrie lithique taillée du Néolithiquemoyen et final de Suisse. Éd. CNRS (Monographie du CRA ; 24), Paris 2001, 353 p.,197 fig.
Ihuel 2004 : IHUEL (E.), La diffusion du silex du Grand-Pressigny dans le massifArmoricain au Néolithique. Grand-Pressigny : BAMGP (suppl. 2) et Éd. CTHS(Documents préhistoriques ; 18), Paris 2004, 202 p., 32 fig., 68 pl.
Ihuel 2008 : IHUEL (E.), De la circulation des grandes lames à la circulation despoignards. Mutation des productions lithiques spécialisées dans l’Ouest de laFrance du Ve au IIIe millénaire. Thèse de doctorat, Université Paris X, 2008, 394 p., 206 pl., dactylographiée.
Ihuel, Pelegrin 2008 : IHUEL (E.), PELEGRIN (J.), Du Jura au Poitou en passantpar le Grand-Pressigny : une méthode de taille et des poignards particuliers vers3000 av. J.-C. In : DIAS-MEIRINHO (M.-H.), LÉA (V.), GERNIGON (K.),FOUÉRÉ (P.), BRIOIS (F.), BAILLY (M.) dir., Les industries lithiques taillées desIVe et IIIe millénaires en Europe occidentale. Colloque international, Toulouse, 7-9 avril 2005, BAR International Series 1884, Oxford 2008, p. 135-182.
Imbert 1862 : IMBERT (M.), Notice, Bulletin de la Société des Antiquaires del’Ouest, t. 9, 1859-1861, p. 422.
Inizan, Tixier 2000 : INIZAN (M.-L.), TIXIER (J.), L’émergence des arts du feu : letraitement thermique des roches siliceuses, Paléorient, t. 26, n° 2, 2000, p. 23-36.
Jeudy et al. 1997 : JEUDY (F.), MAITRE (A.), PRAUD (I.), PÉTREQUIN (A.-M.),PÉTREQUIN (P.), Les lames de pierre polie de Chalain 3. In : PÉTREQUIN (P.)
532
Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France
dir., Les sites littoraux néolithiques de Clairvaux-les-Lacs et de Chalain (Jura), III. Chalain station 3. 3200-2900 av. J.-C. Éd. Maison des Sciences de l’Homme,Paris 1997, vol. 2, p. 455-465.
Joubert et al. 2000a : JOUBERT (J.-M.), THIÉBLEMONT (D.), KARNAY (G.),WYNS (R.), Carte géologique à 1/50 000, feuille Montreuil-Bellay (512). Éd. BRGM, Orléans 2000.
Joubert et al. 2000b : JOUBERT (J.-M.), THIÉBLEMONT (D.), KARNAY (G.),WYNS (R.), PONCET (D.), Notice explicative de la carte géologique à 1/50 000,feuille Montreuil-Bellay (512). Éd. BRGM, Orléans 2000, 110 p.
Joussaume 1976a : JOUSSAUME (R.), Dolmen de Pierre-Levée à Nieul-sur-l’Autize(Vendée), Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 73, n° 1, 1976, p. 398-421.
Joussaume 1976b : JOUSSAUME (R.), Le dolmen angevin de la Pierre-Folle à Thiré(Vendée), Gallia Préhistoire, t. 19, n° 1, 1976, p. 1-67.
Joussaume 1977 : JOUSSAUME (R.), Le mégalithe de la Pierre-Virante à Xanton-Chassenon (Vendée), L’Anthropologie, t. 81, n° 1, 1977, p. 5-62.
Joussaume 1981 : JOUSSAUME (R.), Le Néolithique et le Chalcolithique del’Aunis et du Poitou occidental dans son cadre atlantique. Université Rennes I(Travaux du laboratoire “Anthropologie - Préhistoire - Protohistoire - Quaternairearmoricains”), Rennes 1981, 625 p.
Joussaume 1986 : JOUSSAUME (R.), Les sites campaniformes du littoral atlantiqueentre Loire et Gironde. In : JOUSSAUME (R.) dir., Cultures campaniformes dansle Centre-Ouest de la France. Éd. GVEP, La Roche-sur-Yon 1986, p. 135-156.
Joussaume 2003 : JOUSSAUME (R.), Du réaménagement des monumentsfunéraires néolithiques dans le Centre-Ouest de la France, Revue archéologiquede Picardie, numéro spécial, t. 21, 2003, p. 157-171.
Joussaume 2006 : JOUSSAUME (R.) avec la collaboration de CADOT (R.),GILBERT (J.-M.), Les tumulus de Champ-Châlon à Benon (Charente-Maritime),Bulletin du Groupe Vendéen d’Études Préhistoriques, t. 42, 2006, 90 p., 108 fig.
Joussaume, Pautreau 1990 : JOUSSAUME (R.), PAUTREAU (J.-P.), La Préhistoiredu Poitou. Éd. Ouest-France, Rennes 1990, 599 p.
Joussaume et al. 1994 : JOUSSAUME (R.), BARBIER (S.), GOMEZ (J.) avec lacollaboration de CADOT (R.), Dolmen des Pierres-Folles des Cous à Bazoges-en-Pareds (Vendée), Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 91, n° 1, 1994,p. 64-76.
Joussaume et al. 2008 : JOUSSAUME (R.), CRÉDOT (R.), GIRAUD (C.) avec lacollaboration de BERNARD (R.), CROS (J.-P.), FOUÉRÉ (P.), MENS (E.), Ledolmen des Goudours à Folles (Haute-Vienne) et les dolmens à chambre axiale
533
Bibliographie
allongée dans le Centre-Ouest de la France, Préhistoire du Sud-Ouest, t. 15, n° 1,2008, p. 3-54.
Joussaume et al. 1999 : JOUSSAUME (R.), FOUÉRÉ (P.), LE ROUX (C.-T.),LASNIER (B.), L’HELGOUAC’H (J.), CROS (J.-P.), GILBERT (J.-M.), PAUTREAU(J.-P.), BOURHIS (J.), Le tumulus du Pey de Fontaine au Bernard (Vendée), GalliaPréhistoire, t. 41, 1999, p. 167-222.
Joye 2008 : JOYE (C.), Hauterive-Champréveyres, 15. Le village du Cortaillodclassique : étude de l’outillage en roches polies. Office et musée cantonal d’archéo-logie (Archéologie neuchâteloise ; 40), Neuchâtel 2008, 208 p., 150 fig., 39 pl.
Keeley 1980 : KEELEY (L.-H.), Experimental determination of Stone Tool Uses, amicrowear analysis. University of Chicago press, Prehistoric Archaeology andEcology Series, Chicago 1980, 212 p.
Klassen et al. 2007 : KLASSEN (L.), PÉTREQUIN (P.), GRUT (H.), Haches platesen cuivre dans le Jura français. Transferts à longue distance de biens socialementvalorisés pendant les IVe et IIIe millénaires, Bulletin de la Société PréhistoriqueFrançaise, t. 104, n° 1, 2007, p. 101-124.
Klein 1961 : KLEIN (C.), À propos du “Sidérolithique” sous-vendéen, ComptesRendus Hebdomadaires des Séances de l’Académie des Sciences, t. 251, 1961, p. 151-153.
Krantz 1968 : KRANTZ (G. S.), New method of counting mammal bones,American Journal of Archaeology, t. 72, 1968, p. 286-288.
Krausz, Hamon 2007 : KRAUSZ (S.), HAMON (T.), Le site des Vaux à Moulins-sur-Céphons (Indre) : aspects préliminaires. In : AGOGUÉ (O.), LEROY (D.),VERJUX (C.) dir., Camps, enceintes et structures d’habitat néolithiques en Franceseptentrionale. Actes du 24e Colloque interrégional sur le Néolithique, Orléans,19-21 novembre 1999, Éd. FERACF (Suppl. Revue Archéologique du Centre de laFrance ; 27), Tours 2007, p. 241-256.
Krogman 1978 : KROGMAN (W. M.), The Human Skeleton in Forensic Medicine.3e édition, Charles C. Thomas, Springfield, Illinois 1978, 337 p.
Lachiver 1997 : LACHIVER (M.), Dictionnaire du monde rural. Les mots du passé.Éd. Fayard, Paris 1997, 1 766 p.
Laporte 1996 : LAPORTE (L.), Quelques réflexions sur le Néolithique final duCentre-Ouest de la France, Revue Archéologique de l’Ouest, t. 13, 1996, p. 51-74.
Laporte 2001 : LAPORTE (L.), Du Néolithique au Bronze ancien sur la façadeatlantique du Centre-Ouest de la France, Bulletin de la Société PréhistoriqueFrançaise, t. 98, n° 1, 2001, p. 83-101.
Laporte 2009a : LAPORTE (L.) dir., Des premiers paysans aux premiersmétallurgistes sur la façade atlantique de la France (3500-2000 av. J.-C.). Éd.
534
Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France
Association des Publications Chauvinoises (Mémoire ; XXXIII), Chauvigny 2009,810 p., 611 fig.
Laporte 2009b : LAPORTE (L.), La parure néolithique dans le Centre-Ouest de laFrance. In : LAPORTE (L.) dir., Des premiers paysans aux premiers métallurgistessur la façade atlantique de la France (3500-2000 av. J.-C.). Éd. Association desPublications Chauvinoises (Mémoire ; XXXIII), Chauvigny 2009, p. 454-469.
Laporte, Glausinger 1986 : LAPORTE (L.), GLAUSINGER (R.), Le site del’Écuissière à Dolus (Île d’Oléron, Charente-Maritime). In : JOUSSAUME (R.)dir., Cultures campaniformes du Centre-Ouest de la France. Éd. GVEP, La Roche-sur-Yon 1986, p. 77-88.
Laporte, Gomez de Soto 2008 : LAPORTE (L.), GOMEZ DE SOTO (J.), DuNéolithique final au tout premier Bronze ancien dans le Centre-Ouest de la Franceet plus généralement sur sa façade atlantique : des données encore très lacunairespour la seconde moitié du IIIe millénaire av. J.-C., Bulletin de la Société Préhisto-rique Française, t. 105, n° 3, 2008, p. 555-576.
Laporte et al. 2010 : LAPORTE (L.), SCARRE (C.), JOUSSAUME (R.), SOLER(L.), Nouvelles données sur le mégalithisme de l’Ouest de la France : Recherchesen cours autour du tumulus C de Péré à Prissé-la-Charrière (Deux-Sèvres), Archéo-Théma, sept. 2010, p. 4-14.
Leclerc 1995 : LECLERC (J.), Bazoches-sur-Vesle (Aisne). In : MASSET (C.),SOULIER (P.) dir., Allées couvertes et autres monuments funéraires duNéolithique dans la France du Nord-Ouest, Allées sans retour. Nemours : MPIF,Saint-Ouen-l’Aumône : SDAVO, Guiry-en-Vexin : MADVO, Éd. Errance, Paris1995, p. 137-138.
Lecointre et al. 1948 : LECOINTRE (G.), MATHIEU (G.), WATERLOT (G.), Cartegéologique à 1/80 000, feuille Saumur (119). 2e édition, Éd. BRGM, Orléans 1948,avec notice explicative de 6 p.
Lecornec 1996 : LECORNEC (J.), L’allée couverte de Bilgroix, Arzon, Morbihan,Bulletin de la Société polymathique du Morbihan, t. 122, 1996, p. 15-60.
Ledermann 1969 : LEDERMANN (S.), Nouvelles tables types de mortalité.Éd. PUF (Travaux et Documents de l’INED ; 3), Paris 1969, 260 p.
Legendre 1984 : LEGENDRE (L.), Les transgressions mésozoïques sur le promon-toire oriental du Massif vendéen. Thèse de doctorat, Université de Poitiers, 1984,222 p., 134 fig., 6 pl. + 1 pl. hors-texte, dactylographiée.
Legendre et al. 1989 : LEGENDRE (L.), DHOSTE (M.), COUBÈS (L.), Noticeexplicative de la carte géologique à 1/50 000, feuille Thouars (539). Éd. BRGM,Orléans 1989, 34 p.
Le Lan 2005 : LE LAN (J.-Y.), La pendeloque de Caudric, Cahiers du Pays dePloemeur, t. 15, 2005, p. 47.
535
Bibliographie
Le Roux 1999 : LE ROUX (C.-T.), L’outillage de pierre polie en métadolérite dutype A. Les ateliers de Plussulien (Côtes-d’Armor). Production et diffusion auNéolithique dans la France et au-delà. Université de Rennes I (Travaux dulaboratoire “Anthropologie - Préhistoire - Protohistoire - Quaternaire armoricains” ;43), Rennes 1999, 244 p., 69 fig.
Le Touzé de Longuemar 1865 : LE TOUZÉ DE LONGUEMAR (A.), Les dolmensdu Haut-Poitou, Mémoires de la Société des Antiquaires de l’Ouest, t. XXX, 1865,p. 5-37.
Letterlé 1986 : LETTERLÉ (F.), Le monument mégalithique des Erves à Sainte-Suzanne (Mayenne) et ses implications chronologiques. In : AUBIN (G.) dir., Actesdu Xe colloque interrégional sur le Néolithique, Caen, 1983, Association pour ladiffusion des recherches archéologiques (Revue Archéologique de l'Ouest ; Suppl.1), Rennes 1986, p. 149-164.
Letterlé 1987 : LETTERLÉ (F.), Le dolmen des Erves à Sainte-Suzanne ; le plus vieuxmonument de la Mayenne. In : Premiers agriculteurs de la Mayenne, recherchesrécentes sur le Néolithique (1978-1986). Association d’Études préhistoriques ethistoriques des Pays de la Loire, Nantes 1987, p. 15-21.
L’Helgouac’h 1965 : L’HELGOUAC’H (J.), Les sépultures mégalithiques enArmorique. Thèse de doctorat, Université de Rennes, 1965, 331 p., dactylographiée.
L’Helgouac’h 1998 : L’HELGOUAC’H (J.), Mégalithisme dans le pays de la Loire.In : SOULIER (P.) dir., La France des dolmens et des sépultures collectives (4500-2000 avant J.-C.). Éd. Errance (coll. Archéologie Aujourd’hui), Paris 1998, p. 256-266.
Lhote 1942 : LHOTE (H.), Découverte d’un atelier de perles néolithiques dans larégion de Gao (Soudan français) (1re partie), Bulletin de la Société PréhistoriqueFrançaise, t. 39, 1942, p. 277-292.
Lhote 1943 : LHOTE (H.), Découverte d’un atelier de perles néolithiques dans larégion de Gao (Soudan Français) (2e partie), Bulletin de la Société PréhistoriqueFrançaise, t. 40, 1943, p. 24-35.
Lichardus et al. 1985 : LICHARDUS (J.), LICHARDUS-ITTEN (M.), BAILLOUD(G.), CAUVIN (J.), La Protohistoire de l’Europe. Le Néolithique et le Chalcolithique.Éd. PUF (Nouvelle Clio), Paris 1985, 640 p.
Lièvre 1883 : LIÈVRE (A.-F.), Exploration archéologique du département de laCharente. III. Canton d’Aigre, Bulletin de la Société Archéologique et Historiquede la Charente, Série 5, t. 6, 1883, p. 91-137.
Linton 2009 : LINTON (J.), Consommer, stocker et exporter. Analyse tracéologiquede grandes lames livre-de-beurre de la région des ateliers du Grand-Pressigny(Indre-et-Loire, France) au Néolithique final. In : BONNARDIN (S.), HAMON
536
Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France
(C.), LAUWERS (M.), QUILLIEC (B.) dir., Du matériel au spirituel. Réalitésarchéologiques et historiques des “dépôts” de la Préhistoire à nos jours. Actes desXXIXe Rencontres Internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes, 2008,APDCA, Antibes 2009, p. 111-118.
Louboutin 2008 : LOUBOUTIN (C.), La parure. In : TARRÊTE (J.), LE ROUX (C.-T.) dir., Le Néolithique. Éd. Picard (coll. Archéologie de la France), Paris 2008, p. 364-373.
Louboutin, Ard 2006 : LOUBOUTIN (C.), ARD (V.) avec les contributions deBOURGUEIL (B.), BRAGUIER (S.), BURNEZ (C.), IHUEL (E.), MAINGAUD(A.), Le Chemin Saint-Jean, Le Grand Lopin à Authon-Ebéon (Charente-Maritime).Fouille programmée annuelle 2003 et triennale 2004-2006. Rapport de synthèse.DRAC - SRA Poitou-Charentes, 2006, 28 p., 59 fig., 2 tab., dactylographié.
Louboutin, Ard 2008 : LOUBOUTIN (C.), ARD (V.) avec la collaboration deIHUEL (E.), MAINGAUD (A.), Le Chemin Saint-Jean à Authon-Ebéon (Charente-Maritime) : un habitat du Néolithique récent, Bulletin de Liaison et d’Informationde l’Association des Archéologues de Poitou-Charentes, t. 37, 2008, p. 9-20.
Louboutin et al. 1997 : LOUBOUTIN (C.), BURNEZ (C.), CONSTANTIN (C.),SIDÉRA (I.), Beaumont-La Tricherie (Vienne) et Challignac (Charente) : deux sitesd’habitat de la fin du Néolithique, Antiquités Nationales, t. 29, 1997, p. 49-64.
Louboutin et al. 1998 : LOUBOUTIN (C.), OLLIVIER (A.), CONSTANTIN (C.),SIDÉRA (I.), TRESSET (A.), FARRUGIA (J.-P.), La Tricherie à Beaumont (Vienne) :un site d’habitat du Néolithique récent. In : GUTHERZ (X.), JOUSSAUME (R.)dir., Le Néolithique du Centre-Ouest de la France. Actes du XXIe Colloque inter-régional sur le Néolithique, Poitiers, 14-16 octobre 1994, Éd. Association desPublications Chauvinoises (Mémoire ; XIV), Chauvigny 1998, p. 307-325.
Lovejoy et al. 1985 : LOVEJOY (C. O.), MEINDL (R. S.), PRYZBECK (T. R.),MENSFORTH (R. P.), Chronological metamorphosis of the Auricular Surface ofthe Ilium: a new method for the determination of adult skeletal age at death,American Journal of Physical Anthropology, t. 68, n° 1, 1985, p. 15-28.
Maguer 2000 : MAGUER (P.) avec la collaboration de COFFINEAU (E.),DIETSCH-SELLAMI (M.-F.), GUITTON (V.), LEMAÎTRE (S.), NAULEAU (J.-F.),OPRITESCO (A.), Cholet : Les Natteries (Maine-et-Loire). Rapport de fouillepréventive sur l’autoroute A87 (tronçon 1), AFAN, DRAC - SRA Pays de la Loire,2000, 259 p., 66 pl., dactylographié.
Maingaud 2003 : MAINGAUD (A.), L’industrie en matières dures d’origineanimale de la fin du 4e et du 3e millénaires avant J.-C. de la collection de Baye,Antiquités Nationales, t. 35, 2003, p. 55-82.
Maingaud 2004 : MAINGAUD (A.), L’industrie en matières dures animales Seine-Oise-Marne en contexte domestique. Mémoire de DEA, Université Paris I, 2004,2 vol., 50 p., dactylographié.
537
Bibliographie
Mallet 1992 : MALLET (N.), Le Grand-Pressigny : ses relations avec la civilisationSaône-Rhône. Supplément au bulletin des Amis du Musée du Grand-Pressigny,1992, vol. 1 : 218 p., 100 fig. ; vol. 2 : 123 pl. hors texte.
Mallet et al. 1994 : MALLET (N.), PELEGRIN (J.), REDURON-BALLINGER (M.),Sur deux dépôts de lames pressigniennes : Moigny et Boutigny (Essonne), Bulletindes Amis du Musée du Grand-Pressigny, t. 45, 1994, p. 25-37.
Mallet et al. 2008 : MALLET (N.), IHUEL (E.), VERJUX (C.), La diffusion du silexdu Grand-Pressigny au sein des groupes culturels des IVe et IIIe millénaires. In :DIAS-MEIRINHO (M.-H.), LÉA (V.), GERNIGON (K.), FOUÉRÉ (P.), BRIOIS(F.), BAILLY (M.) dir., Les industries lithiques taillées des IVe et IIIe millénairesen Europe occidentale. Colloque international, Toulouse, 7-9 avril 2005, BARInternational Series 1884, Oxford 2008, p. 183-206.
Mantel 1991 : MANTEL (E.), Nouveaux sites campaniformes dans la basse valléede la Seine, III. Les sépultures des Petits Prés et du Chemin des Vignes à Léry(Eure), Étude archéologique, Gallia Préhistoire, t. 33, n° 1, 1991, p. 185-206.
Marcigny et al. 2007 : MARCIGNY (C.), GHESQUIÈRE (E.), RICHÉ (C.) avec lacollaboration de MALLET (N.), Analyse du mobilier funéraire du mégalithe du“Château” à Angers (Maine-et-Loire) : présence d’outils en silex du Grand-Pressigny,Bulletin des Amis du Musée de Préhistoire du Grand-Pressigny, t. 58, 2007, p. 19-30.
Massaud 1967 : MASSAUD (J.), Extension de la technique “Sublaines” dans leCentre-Ouest de la France, Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 64, n° 5, 1967, p. CXLIII-CXLV.
Masset 1982 : MASSET (C.), Estimation de l’âge au décès par les sutures crâniennes.Thèse de Sciences naturelles. Thèse d’État, Université Paris VII, 1982, 301 p.,dactylographiée.
Masset 1984 : MASSET (C.), Le dénombrement dans les sépultures collectives,Garcia de Orta, Seria antropobiologica, t. 3, n° 1-2, Lisbonne 1984, p. 149-152.
Mathieu, Waterlot 1958 : MATHIEU (G.), WATERLOT (G.), Carte géologique à1/80 000, feuille Bressuire (131). 2e édition, Éd. BRGM, Orléans 1958, avec noticeexplicative de 6 p.
Matuschik 2009 : MATUSCHIK (I.) en collaboration avec AFFOLTER (J.), KAISER(M.), KINSKY (M.), MÜLLER (A.), PÉTREQUIN (P.), Grabanlagen des frühenEndneolithikums und der späten Hallstattzeit in Jettingen-Unterjettingen, Hau, Lkr. Böblingen - ein Beitrag zur Megalithik im Flussgebiet des Neckars,Fundberichte aus Baden-Württemberg, t. 30, 2009, p. 65-94.
Mauduit et al. 1977 : MAUDUIT (J.), TARRÊTE (J.), TABORIN (Y.), GIRARD(C.), La sépulture collective mégalithique de l’usine Vivez à Argenteuil, Val-d’Oise,Gallia Préhistoire, t. 20, n° 1, 1977, p. 177-227.
538
Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France
Michel 2009 : MICHEL (M.), II. Mobilier céramique et rituel funéraire artenacien :la réoccupation des dolmens de la Boixe B (Vervant, Charente) et de Chenon B1
(Chenon, Charente). In : LAPORTE (L.) dir., Des premiers paysans aux premiersmétallurgistes sur la façade atlantique de la France (3500-2000 av. J.-C.). Éd.Association des Publications Chauvinoises (Mémoire ; XXXIII), Chauvigny 2009,p. 656-676.
Mille 2008 : MILLE (B.), Se parer de métal : étude du mobilier métallique de la grotte sépulcrale d’Artenac à Saint-Mary (Charente). In : BAILLOUD (G.),BURNEZ (C.), DUDAY (H.), LOUBOUTIN (C.) dir., La grotte sépulcrale d’Artenacà Saint-Mary (Charente). Révision du gisement éponyme. Éd. SPF (Travaux ; 8),Paris 2008, p. 56-70.
Mille, Bouquet 2004 : MILLE (B.), BOUQUET (L.), Le métal au troisièmemillénaire dans le Centre-Nord de la France. In : VANDER LINDEN (M.),SALANOVA (L.) dir., Le IIIe millénaire dans le nord de la France et en Belgique.Bruxelles : Société royale belge d’anthropologie (Praehistorica et Anthropologica ;115) et Éd. SPF (Mémoire ; XXXV), Paris 2004, p. 197-215.
Millet-Richard 1997 : MILLET-RICHARD (L.-A.), Habitats et ateliers de taille auNéolithique final dans la région du Grand-Pressigny (Indre-et-Loire). Technologielithique. Thèse de doctorat, Université Paris I, 1997, 2 vol., 315 p., dactylographiée.
Millet-Richard, Primault 1993 : MILLET-RICHARD (L.-A.), PRIMAULT (J.),Problèmes technologiques concernant deux lames à talon piqueté, Bulletin desAmis du Musée du Grand-Pressigny, t. 44, 1993, p. 43-45.
Mohen, Briard 1983 : MOHEN (J.-P.), BRIARD (J.), Typologie des objets de l’Âgedu Bronze en France. Fascicule II. Poignards, hallebardes, pointes de lance, pointesde flèche, armement défensif. Éd. SPF et CNRS, Paris 1983, 159 p.
Mohen, Scarre 2002 : MOHEN (J.-P.), SCARRE (C.), Les Tumulus de Bougon(Deux-Sèvres). Complexe mégalithique du Ve au IIIe millénaire. Éd. Errance, Paris2002, 256 p., 380 fig.
Moorrees et al. 1963 : MOORREES (C. F. A.), FANNING (E. A.), HUNT (E. E.),Age variation of formation stages for ten permanent teeth, Journal of DentalResearch, t. 42, 1963, p. 1 490-1 502.
Néraudeau 2010 : NÉRAUDEAU (D.), L’ambre crétacé des Charentes : unealternative à l’ambre balte ? In : Pré-actes du colloque international Roches etSociétés de la Préhistoire entre massifs cristallins et bassins sédimentaires. Rennes,28-30 avril 2010, Rennes 2010, p. 38.
Nouel et al. 1965 : NOUEL (A.), DAUVOIS (M.), BAILLOUD (G.), RIQUET (R.),POULAIN (T.), PLANCHAIS (N.), HOREMANS (P.), L’ossuaire néolithiqued’Éteauville, commune de Lutz-en-Dunois (Eure-et-Loir), Bulletin de la SociétéPréhistorique Française, t. 62, n° 3, 1965, p. 576-648.
539
Bibliographie
Oberlin 2003 : OBERLIN (C.), Calibration des datations radiocarbone : le pointsur la période 6e-2e millénaire avant J.-C. In : GASCO (J.), GUTHERZ (X.),LABRIFFE (P.-A. de) dir., Temps et espace culturel du 6e au 2e millénaire en Francedu sud. IVe Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente, Nîmes, 28-29 octobre2000, Monographie d’Archéologie méditerranéenne, Lattes 2003, p. 35-42.
Pariat 2007 : PARIAT (J.-G.), Des morts sans tombe ? Le cas des ossements humainsen contexte non sépulcral en Europe tempérée entre les 6e et 3e millénaires av. J.-C. BAR International Series 1683, Oxford 2007, 195 p.
Patte 1941 : PATTE (É.), Sur les affinités culturelles de la Charente au Chalco-lithique, Revue anthropologique, t. 51, n° 7-9, 1941, p. 67-121.
Patte 1960 : PATTE (É.), Les briquets dans les sépultures au Néolithique et auBronze, Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 57, n° 1-2, 1960, p. 51-55.
Patte 1971 : PATTE (É.), Quelques sépultures du Poitou, du Mésolithique auBronze moyen, Gallia Préhistoire, t. 14, n° 1, 1971, p. 139-244.
Patte 1976 : PATTE (É.), Restes humains des tumulus de Fleuré (Vienne) et dePuyraveau (Deux-Sèvres), Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie deParis, XIIIe Série, t. 3, n° 3, 1976, p. 281-305.
Pautreau 1974 : PAUTREAU (J.-P.), L’habitat Peu-Richardien de la Sauzaie,commune de Soubise (Charente-Maritime). Circonscription des AntiquitésPréhistoriques de Poitou-Charentes, Rochefort 1974, 101 p., 83 pl.
Pautreau 1975 : PAUTREAU (J.-P.), Datations radiocarbones de l’Artenac du CampAllaric à Aslonnes (Vienne), Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 72,n° 1, 1975, p. 24-25.
Pautreau 1979a : PAUTREAU (J.-P.), Les rapports entre Artenaciens et Campa-niformes et les débuts de la métallurgie du cuivre dans le Centre-Ouest de laFrance, Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 76, n° 4, 1979, p. 110-118.
Pautreau 1979b : PAUTREAU (J.-P.), Le Chalcolithique et l’Âge du Bronze enPoitou (Vendée, Deux-Sèvres, Vienne). Centre d’Archéologie et d’EthnologiePoitevine, Poitiers 1979, 2 vol., 425 p., 106 pl.
Pautreau 1984 : PAUTREAU (J.-P.), Quelques aspects de la métallurgie en Poitouaux Âges du Cuivre et du Bronze. In : BRIARD (J.) dir., Paléométallurgie de laFrance Atlantique. Université de Rennes I (Travaux du laboratoire “Anthropologie -Préhistoire - Protohistoire - Quaternaire armoricains”), Rennes 1984, p. 99-133.
Pautreau 1991 : PAUTREAU (J.-P.), Trois sépultures en fosse du Néolithiquemoyen à Antran (Vienne). In : DESPRIÉE (J.) et al., La région Centre, carrefourd’influences ? Actes du 14e colloque interrégional sur le Néolithique, Blois, 16-18 octobre 1987, Suppl. au bulletin de la Société Archéologique, Scientifique etLittéraire du Vendômois, Vendôme 1991, p. 131-142.
540
Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France
Pautreau, Hébras 1972 : PAUTREAU (J.-P.), HÉBRAS (C.), Quelques objets duDolmen de Puyraveau (Deux-Sèvres) dans une collection thouarsaise, Bulletin dela Société Préhistorique Française, t. 69, n° 2, 1972, p. 599-606.
Pautreau, Mataro I Pladelasala 1996 : PAUTREAU (J.-P.), MATARO I PLADELASALA(M.), Inventaire des mégalithes de France. La Vienne. Éd. Association des Publica-tions Chauvinoises (Mémoire ; XII), Chauvigny 1996, 319 p.
Pautreau, Robert 1980 : PAUTREAU (J.-P.), ROBERT (P.-P.), Le gisementcampaniforme des Deux Moulins au Bois-en-Ré (Charente-Maritime), Bulletin dela Société Préhistorique Française, t. 77, n° 9, 1980, p. 283-288.
Pautreau et al. 2006 : PAUTREAU (J.-P.), FARAGO-SZEKÈRES (B.), MORNAIS(P.), La nécropole néolithique de la Jardelle à Dissay (Vienne, France). In :JOUSSAUME (R.), LAPORTE (L.), SCARRE (C.) dir., Origine et développementdu mégalithisme de l’ouest de l’Europe. Actes du colloque international, Bougon,26-30 octobre 2002, Conseil général des Deux-Sèvres, Musée des Tumulus deBougon, Niort 2006, p. 375-379.
Peek 1975 : PEEK (J.), Inventaire des mégalithes de France, 4. Région parisienne :Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise. Éd. CNRS (Suppl. à Gallia Préhistoire ; 1), Paris 1975, 408 p., 16 pl.
Pelegrin 1997 : PELEGRIN (J.), Nouvelles observations sur le dépôt de la Creusette(Barrou, Indre-et-Loire), Bulletin des Amis du Musée du Grand-Pressigny, t. 48,1997, p. 19-34.
Pelegrin 2002 : PELEGRIN (J.), La production des grandes lames de silex du Grand-Pressigny. In : GUILAINE (J.) dir., Matériaux, productions, circulations duNéolithique à l’Âge du Bronze. Séminaire du Collège de France, Éd. Errance (coll.des Hespérides), Paris 2002, p. 131-148.
Pelegrin 2004 : PELEGRIN (J.), Sur les techniques de retouche des armatures de projectile. In : PIGEOT (N.) dir., Les derniers Magdaléniens d’Étiolles :perspectives culturelles et paléohistoriques (l’unité d’habitation Q31). Éd. CNRS(Suppl. à Gallia Préhistoire ; XXXVIIe), Paris 2004, p. 161-166.
Pelegrin 2005 : PELEGRIN (J.), L’extraction du silex au Grand-Pressigny pendantle Néolithique final : proposition d’un modèle, Bulletin des Amis du Musée duGrand-Pressigny, t. 56, 2005, p. 67-71.
Pelegrin, Ihuel 2005 : PELEGRIN (J.), IHUEL (E.), Les 306 nucléus de la ruine dela Claisière (Abilly, Indre-et-Loire), Bulletin des Amis du Musée du Grand-Pressigny, t. 56, 2005, p. 45-65.
Péridy 2005 : PÉRIDY (P.), Site d’enceintes néolithiques de La Chevêtelière,commune de L’Île-d’Olonne et de Saint-Mathurin (Vendée). Rapport d’activité,DRAC - SRA Pays de la Loire, 2005, 32 p., dactylographié.
541
Bibliographie
Péridy 2007 : PÉRIDY (P.), La Chevêtelière : 10 ans de recherche ... et tout unprogramme, Bulletin de l’Association de Recherche Archéologique dans le Nord-Ouest de la Vendée, t. 21, 2007, p. 2-29.
Perrin et al. 2007 : PERRIN (T.), IHUEL (E.), PLISSON (H.), Le Bois Pargas àPageas (Haute-Vienne) : un nouveau témoin du Néolithique final en Limousin,Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 104, n° 3, 2007, p. 543-563.
Pétorin et al. 1999 : PÉTORIN (N.), BAYEN (E.), FARAGO (B.), FOUÉRÉ (P.),GRÉGOIRE-DEBUSCHER (R.), PASCAL (J.), Saint-Georges-les-Baillargeaux, “LesVarennes” (Vienne). DFS de fouille de sauvetage urgent, DRAC - SRA Poitou-Charentes, 1999, 40 p., 24 fig., dactylographié.
Pétrequin et al. 1997 : PÉTREQUIN (P.), CASSEN (S.), CROUTSCH (C.),WELLER (O.), Haches alpines et haches carnacéennes dans l’Europe du Ve millé-naire, Notae Praehistoricae, t. 17, 1997, p. 135-150.
Pétrequin et al. 1998 : PÉTREQUIN (P.), CROUTSCH (C.), CASSEN (S.), Àpropos du dépôt de La Bégude (Drôme) : haches alpines et haches carnacéennespendant le Ve millénaire, Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 95, n° 2, 1998, p. 239-254.
Pétrequin et al. 2002 : PÉTREQUIN (P.), CASSEN (S.), CROUTSCH (C.),ERRERA (M.), La valorisation sociale des longues haches dans l’Europenéolithique. In : GUILAINE (J.) dir., Matériaux, productions, circulations duNéolithique à l’Âge du Bronze. Séminaire du Collège de France, Éd. Errance (coll.des Hespérides), Paris 2002, p. 67-98.
Pétrequin et al. 2011a : PÉTREQUIN (P.), CASSEN (S.), GAUTHIER (E.),KLASSEN (L.), PAILLER (Y.), SHERIDAN (A.) avec la collaboration deDESMEULLES (J.), GILLIOZ (P. A.), SAMZUN (A.), Typologie, chronologie etrépartition des haches alpines en Europe occidentale. In : PÉTREQUIN (P.),CASSEN (S.), ERRERA (M.), KLASSEN (L.), SHERIDAN (A.) dir., Jade. Grandeshaches alpines du Néolithique européen. Ve et IVe millénaires av. J.-C. PressesUniversitaires de Franche-Comté (Cahiers de la MSHE C.N. Ledoux), Besançon2011, t. 1 : p. 574-727.
Pétrequin et al. 2011b : PÉTREQUIN (P.), ERRERA (M.), ROSSY (M.) encollaboration avec D’AMICO (C.), GHEDINI (M.), Viso ou Beigua : approche duréférentiel des jades alpins. In : PÉTREQUIN (P.), CASSEN (S.), ERRERA (M.),KLASSEN (L.), SHERIDAN (A.) dir., Jade. Grandes haches alpines du Néolithiqueeuropéen. Ve et IVe millénaires av. J.-C. Presses Universitaires de Franche-Comté(Cahiers de la MSHE C.N. Ledoux), Besançon 2011, t. 1 : p. 292-419.
Plisson et al. 2002 : PLISSON (H.), MALLET (N.), BOCQUET (A.), RAMSEYER(D.), Utilisation et rôle des outils en silex du Grand-Pressigny dans les villages deCharavines et de Portalban (Néolithique final), Bulletin de la Société PréhistoriqueFrançaise, t. 99, n° 4, 2002, p. 793-811.
542
Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France
Pollès 1983 : POLLÈS (R.), Contribution à l’étude de la céramique du Néolithiquefinal de la Bretagne. Mémoire de Maîtrise, Université Paris I, 1983, 2 vol., 88 pl.,123 p., dactylographié.
Polloni 2008a : POLLONI (A.), La parure dans les sépultures collectives de la findu IVe au début du IIe millénaire en Bassin parisien. Thèse de doctorat, UniversitéParis I, 2008, 2 vol., dactylographiée.
Polloni 2008b : POLLONI (A.), Parures individuelles et sépultures collectives à lafin du Néolithique en Bassin parisien, Préhistoires Méditerranéennes, t. 14, 2008,p. 75-89.
Polloni 2010 : POLLONI (A.), Un cas de récupération au Néolithique récent. Lespendeloques arciformes du Bassin parisien, Archéopages, t. 29, 2010, p. 16-19.
Polloni et al. 2004 : POLLONI (A.), SOHN (M.), SIDÉRA (I.), Structure dumobilier funéraire en os, bois de cerf, dents et coquillages à la fin du 4e millénaireet au 3e millénaire en Bassin parisien, Anthropologica et Praehistorica, t. 115, 2004,p. 179-195.
Poncet et al. 2004 : PONCET (D.), COUNIL (R.), NOYER (G.), La pierre dansl’architecture traditionnelle en Pays Thouarsais. Syndicat Mixte du Pays Thouarsais,Thouars 2004, 52 p. (+ 1 Cédérom hors-texte).
Praud et al. 2003 : PRAUD (I.), LE GALL (J.), VACHARD (D.), Les bracelets enpierre du Néolithique ancien : provenance et diffusion des matériaux sur les sitesVilleneuve-Saint-Germain du Bassin parisien. In : DESBROSSE (R.), THÉVENIN(A.) dir., Préhistoire de l’Europe des origines à l’Âge du Bronze. Actes du 125e Congrès National des Sociétés Historiques et Scientifiques, Lille, 2000, Éd. CTHS, Paris 2003, p. 491-502.
Primault 2003 : PRIMAULT (J.), Exploitation et diffusion des silex de la région duGrand-Pressigny au Paléolithique. Thèse de doctorat, Université Paris X - Nanterre,2003, 358 p., 177 fig., dactylographiée.
Prudhomme, Villes 2000 : PRUDHOMME (P.), VILLES (A.), Une sépulture duNéolithique final à Saint-Pierre-de-Maillé (Vienne), Bulletin des Amis du Muséede Préhistoire du Grand-Pressigny, t. 51, 2000, p. 33-46.
Ramseyer 1987 : RAMSEYER (D.), Emmanchements de l’outillage lithiquenéolithique de quelques stations littorales du canton de Fribourg (Suisseoccidentale). In : STORDEUR (D.) dir., La main et l’outil : manches et emman-chements préhistoriques. Actes de la table ronde CNRS, Lyon, 26-29 novembre1984, Maison de l’Orient, Lyon 1987, p. 211-218.
Reimer et al. 2004 : REIMER (P. J.), BAILLIE (M. G. L.), BARD (E.), BAYLISS (A.),BECK (J. W.), BLACKWELL (P. G.), BUCK (C. E.), BURR (G. S.), CUTLER (K.B.), DAMON (P. E), EDWARDS (R. L.), FAIRBANKS (R. G.), FRIEDRICH (M.),
543
Bibliographie
GUILDERSON (T. P.), HERRING (C.), HUGHEN (K. A.), KROMER (B.),
MCCORMAC (F. G.), MANNING (S. W.), RAMSEY (C. B.), REIMER (P. J.),
REIMER (R. W.), REMMELE (S.), SOUTHON (J. R.), STUIVER (M.), TALAMO
(S.), TAYLOR (F. W.), VAN DER PLICHT (J.), WEYHENMEYER (C. E.), IntCal04
Terrestrial radiocarbon age calibration, 0-26 cal kyr BP, Radiocarbon, t. 46, n° 3,
2004, p. 1 029-1 058.
Renard 2004 : RENARD (C.), Première caractérisation des industries lithiques du3e millénaire en Centre-Nord de la France. Les armatures de flèches de la fin du4e et du 3e millénaire dans le bassin de la Seine. In : VANDER LINDEN (M.),SALANOVA (L.) dir., Le IIIe millénaire dans le nord de la France et en Belgique.Bruxelles : Société royale belge d’anthropologie (Praehistorica et Anthropologica ;115) et Éd. SPF (Mémoire ; XXXV), Paris 2004, p. 103-113.
Rey et al. 2010 : REY (P.-J.), PERRIN (T.), BRESSY (C.), LINTON (J.), La tombe ade la nécropole de Fontaine-le-Puits (Savoie), un dépôt funéraire exceptionnel dela transition Néolithique moyen/final. Actes du XIIe Colloque sur les Alpes dansl’Antiquité, Yenne (Savoie), 2-4 octobre 2009 (Bulletin d’Études préhistoriques et archéologiques alpines, Société Valdôtaine de Préhistoire et d’Archéologie, n° spécial XXI), Aoste 2010, p. 105-124.
Ricard 1980 : RICARD (J.-L.), Le Moustérien de tradition acheuléenne de la Croix-Guémard (Deux-Sèvres), Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 77, n° 10-12, 1980, p. 306-316.
Ricard 1989 : RICARD (J.-L.), Le Paléolithique ancien et moyen dans les Deux-Sèvres. Le gisement paléolithique de plein air de Champ-Paillard. Thèse de L’ÉcolePratique des Hautes Études Sciences de la Vie et de la Terre (IIIe Section),Laboratoire d’Anthropologie des hommes fossiles, Université Bordeaux I, 1989,420 p., 70 fig., 120 pl., dactylographiée.
Ricard, Delisle 1992 : RICARD (J.-L.), DELISLE (A.), Comportement opportunisteou comportement structuré des hommes du Paléolithique moyen ? Les premierséléments de réponse du site de Champ-Paillard (Deux-Sèvres), Bulletin de laSociété Préhistorique Française, t. 89, n° 7, p. 198-199.
Ricq-de-Bouard 1996 : RICQ-DE-BOUARD (M.), Pétrographie et sociétés néo-lithiques en France méditerranéenne. L’outillage en pierre polie. Éd. CNRS(Monographie du C.R.A. ; 16), Paris 1996, 272 p.
Riquet, Burnez 1956 : RIQUET (R.), BURNEZ (C.), Les cadres culturels duNéolithique des pays du Centre-Ouest. In : Congrès Préhistorique de France.Poitiers et Angoulême, 1956, p. 861-878.
Riquet, Cordier 1957 : RIQUET (R.), CORDIER (G.), L’ossuaire néolithique duBec-des-Deux-Eaux, commune de Ports (Indre-et-Loire), L’Anthropologie, t. 61, n° 1-2, p. 28-44.
544
Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France
Robert 1998 : ROBERT (P.-P.), Les tumulus de Peu-Poiroux à Bois-en-Ré (Charente-Maritime). In : JOUSSAUME (R.) dir., Les premiers paysans du Golfe. LeNéolithique dans le Marais poitevin. Éd. Patrimoines et médias, Chauray 1998, p. 62-63.
Rolin et al. 2004 : ROLIN (P.), AUDRU (J.-C.), PONCET (D.), PAPIN (H.),JOUSSEAUME (S.), MAILLARD (A.), Carte géologique à 1/50 000, feuilleBressuire (538). Éd. BRGM, Orléans 2004.
Roudil 1977 : ROUDIL (J.-L.), Les épingles en os du Sud-Est de la France, Bulletinde la Société Préhistorique Française, t. 74, n° 8, 1977, p. 237-242.
Roussot-Larroque 1990 : ROUSSOT-LARROQUE (J.), Paradigmes perdus, para-digmes retrouvés ... Le Campaniforme atlantique et les sociétés du Néolithiquefinal de l’Ouest, Revue Archéologique de l’Ouest, suppl. 2, 1990, p. 189-204.
Roussot-Larroque 1995 : ROUSSOT-LARROQUE (J.), Problèmes campaniformesdans la région centre-atlantique. In : Origens, Estruturas e Relaçoes das CulturasCalcoliticas da Peninsula Iberica. Actas das I Jornadas Arqueologicas de TorreVedras, 3-5 Abril 1987 (Trabalhos de Arqueologia ; 7), 1995, p. 306-327.
Roussot-Larroque 1998 : ROUSSOT-LARROQUE (J.), Premiers objets en cuivredans le Sud-Ouest de la France. In : FRÈRE-SANTOT (M.-C.) dir., Paléométallurgiedes cuivres. Actes du colloque de Bourg-en-Bresse et Beaune, 17-18 octobre 1997,Éd. Monique Mergoil (Monographies Instrumentum ; 5), Montagnac 1998, p. 131-150.
Roussot-Larroque et al. 1998 : ROUSSOT-LARROQUE (J.), MOREAU (J.),BOURHIS (J.-R.), Hache plate, poignard à languette et pointe de Palmela de laGlaneuse à Soulac-sur-Mer (Gironde), Préhistoire du Sud-Ouest, t. 5, n° 2, p. 163-175.
Roussot-Larroque et al. 2000 : ROUSSOT-LARROQUE (J.), MOREAU (J.),BOURHIS (J.-R.), Nouveau poignard campaniforme à Soulac-sur-Mer (Gironde),Préhistoire du Sud-Ouest, t. 7, n° 1, 2000, p. 75-81.
Roux 2000 : ROUX (V.), Contexte historique et ethnographique. In : ROUX (V.)dir., Cornalines de l’Inde. Des pratiques techniques de Cambay aux techno-systèmes de l’Indus. Éd. Maison des Sciences de l’Homme, Paris 2000, p. 21-50.
Rozoy 1976 : ROZOY (J.-G.), “Craches” ou “croches” de cerf ?, Bulletin de laSociété Préhistorique Française, t. 73, n° 8, 1976, p. 228.
Saintot 1998 : SAINTOT (S.), Les armatures de flèches en silex de Chalain et deClairvaux, Gallia préhistoire, t. 40, 1998, p. 204-241.
Salanova 1992 : SALANOVA (L.), La céramique campaniforme du Sud-Finistère,Antiquités Nationales, t. 24, 1992, p. 9-24.
545
Bibliographie
Salanova 1998 : SALANOVA (L.), Le statut des assemblages campaniformes
en contexte funéraire : la notion de “bien de prestige”, Bulletin de la Société
Préhistorique Française, t. 95, n° 3, 1998, p. 315-326.
Salanova 2000 : SALANOVA (L.), La question du Campaniforme en France et
dans les îles Anglo-Normandes : productions, chronologie et rôles d’un standard
céramique. Coédition SPT/CTHS, Paris 2000, 392 p.
Salanova 2007 : SALANOVA (L.), Les sépultures campaniformes : lecture sociale.
In : GUILAINE (J.) dir., Le Chalcolithique et la construction des inégalités, t. I : Le
continent européen. Séminaires du Collège de France, Éd. Errance, Paris 2007,
p. 213-228.
Salanova et al. 2011 : SALANOVA (L.), RENARD (C.), MILLE (B.), Chapitre 7 :
Réexamen du mobilier de la sépulture campaniforme d’Arenberg (Wallers, Nord).
In : SALANOVA (L.), TCHÉRÉMISSINOFF (Y.) dir., Les sépultures individuelles
campaniformes en France. Éd. CNRS (Suppl. à Gallia Préhistoire ; XLI), Paris 2011,
p. 79-95.
Sellier et al. 1997 : SELLIER (P.), TILLIER (A.-M.), BRUZEK (J.), À la recherche
d’une référence pour l’estimation de l’âge des fœtus, nouveau-nés et nourrissons
des populations archéologiques européennes, Anthropologie et Préhistoire, t. 108,
Bruxelles 1997, p. 75-87.
Semelier 2007 : SEMELIER (P.), Ossements humains et enceintes néolithiques :
l’exemple du Centre-Ouest de la France. Thèse de doctorat, Université Bordeaux 1,
2007, 207 p., dactylographiée.
Semenov 1964 : SEMENOV (S. A.), Prehistoric technology. An experimental study
of the oldest tools and artefacts from traces, manufacture and wears. Ed. Cory,
Adams and Mackay, Londres 1964, 211 p.
Sénépart, Sidéra 1991 : SÉNÉPART (I.), SIDÉRA (I.), Une culture chasséenne pour
les matières dures animales ? In : BEECHING (A.), BINDER (D.), BLANCHET
(J.-C.), CONSTANTIN (C.), DUBOULOZ (J.), MARTINEZ (R.), MORDANT
(D.), THEVENOT (J.-P.), VAQUER (J.) dir., Identité du Chasséen. Actes du
colloque international de Nemours, 17-19 mai 1989, APRAIF (Mémoires du Musée
de Préhistoire d’Île de France ; 4), Nemours 1991, p. 299-312.
Sidéra 1993 : SIDÉRA (I.), Les assemblages osseux en Bassins parisien et rhénan
du 6e au 4e millénaire B.C. Histoire, techno-économie et culture. Thèse de
doctorat, Université Paris I, 1993, 3 vol., dactylographiée.
Sidéra 2000 : SIDÉRA (I.), Animaux domestiques, bêtes sauvages et objets en
matières animales du Rubané au Michelsberg, Gallia Préhistoire, t. 42, 2000,
p. 108-194.
546
Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France
Sidéra 2002 : SIDÉRA (I.), Outils, armes et parures en os funéraires à la fin duNéolithique, d’après Val-de-Reuil et Porte-Joie (Eure), Gallia Préhistoire, t. 44,2002, p. 215-230.
Sidéra 2008 : SIDÉRA (I.), L’industrie osseuse : des poinçons pour unique mobilier.In : BAILLOUD (G.), BURNEZ (C.), DUDAY (H.), LOUBOUTIN (C.) dir., Lagrotte d’Artenac à Saint-Mary (Charente) : révision du gisement éponyme. Éd. SPF(Travaux ; 8), Paris 2008, p. 50-53.
Sigot 1999 : SIGOT (J.), La Dive et son canal. CMD, Montreuil-Bellay 1999, 112 p.
Simonin 1997 : SIMONIN (D.), La transition Villeneuve-Saint-Germain/Cernydans le Gâtinais et le Nord-Est de la Beauce. In : CONSTANTIN (C.), MORDANT(D.), SIMONIN (D.) dir., La culture de Cerny, nouvelle économie, nouvelle sociétéau Néolithique. Actes du 6e colloque interrégional sur le Néolithique, Nemours,9-11 mai 1994, Mémoire du Musée de la Préhistoire d’Île-de-France, 1997, p. 39-64.
Sohn 2006 : SOHN (M.), Du collectif à l’individuel : évolution des dépôtsmobiliers dans les sépultures collectives d’Europe occidentale de la fin du IVe à lafin du IIIe millénaire av. J.-C. Thèse de doctorat, Université Paris I, 2006, 2 vol.,642 p., dactylographiée.
Soler 2002 : SOLER (L.), Tumulus B2, les alignements de crânes : rituel funéraireou gestion de l’espace ? Complément d’analyse. In : MOHEN (J.-P.), SCARRE (C.),Les Tumulus de Bougon (Deux-Sèvres). Complexe mégalithique du Ve au IIIe millénaire. Éd. Errance, Paris 2002, p. 143-149.
Soler 2007 : SOLER (L.), Les gestes funéraires des sépultures en coffre duNéolithique moyen de La Goumoizière (Valdivienne, Vienne) dans leur contexteculturel. In : MOINAT (P.), CHAMBON (P.) dir., Les cistes de Chamblandes et laplace des coffres dans les pratiques funéraires du Néolithique moyen occidental.Actes du colloque de Lausanne, 2006, Lausanne : Cahiers d’archéologie romandeet Paris : SPF (Mémoire ; XLIII), 2007, p. 115-131.
Souris de 2000 : SOURIS (L. de), Étude de l’organisation du dépôt funéraire ducouloir du dolmen B de la Boixe (Charente). Mémoire de Maîtrise, Université dePoitiers, 2000, dactylographié.
Souris de 2007 : SOURIS (L. de), Occupations funéraires des grottes néolithiquesen Poitou-Charentes : l’exemple du Trou Amiault (La Rochette, Charente, France).In : BESSE (M.) dir., Sociétés néolithiques : des faits archéologiques aux fonctionne-ments socio-économiques. Actes du 27e colloque interrégional sur le Néolithique,Neuchâtel, 2005, Cahiers d’archéologie romande, Lausanne 2007, p. 285-294.
Strahm 1979 : STRAHM (C.), Les épingles de parure en os du Néolithique final.In : CAMPS-FABRER (H.) dir., L’industrie en os et bois de cervidé durant leNéolithique et l’Âge des Métaux. Première réunion du groupe de travail n° 3 surl’industrie de l’os préhistorique, Éd. CNRS, Paris 1979, p. 47-85.
547
Bibliographie
Surmely, Murat 2003 : SURMELY (F.), MURAT (R.), Mesures de la résistancemécanique de différents types de silex et roches siliceuses. In : VERGAIN (P.) et al., Les matières premières lithiques en Préhistoire. Actes de la table rondeinternationale d’Aurillac, 20-22 juin 2002, Cressensac (Suppl. Préhistoire du Sud-Ouest ; 5), 2003, p. 337-342.
Tartarin 1885 : TARTARIN (E.), L’Âge de la Pierre à Saint-Martin-la-Rivière etenvirons (Vienne). Description d’un cimetière et de stations préhistoriques. Éd. Octave Doin, Paris 1885, 43 p., 7 pl.
Tessier 1994 : TESSIER (M.), Dictionnaire archéologique du Pays de Retz. SociétéNantaise de Préhistoire, Nantes 1994, 68 p.
Thiéblemont et al. 2001 : THIÉBLEMONT (D.), GUERROT (C.), LE MÉTOUR(J.), JÉZEQUEL (P.), Le complexe de Cholet-Thouars : un ensemble volcano-plutonique cambrien moyen au sein du bloc précambrien des Mauges, Géologiede la France, n° 1-2, 2001, p. 7-17.
Thirault 2004 : THIRAULT (É.), Échanges néolithiques : les haches alpines. Éd.Monique Mergoil (Préhistoires ; 10), Montagnac 2004, 468 p., 148 fig., 42 tab., 50 pl.
Ubelaker 1984 : UBELAKER (D. H.), Human Skeletal remains. Excavation,Analysis, Interpretation (revised edition). Taraxacum (Manuals on Archaeology ;2), Washington 1984 ; 1re éd. 1978, Chicago, Aldine.
Vacher 2010 : VACHER (S.), Dolus d’Oléron (Charente-Maritime), voie com-munale 18. Découverte d’une pointe de Palmela sur le site campaniforme de laPasse de l’Écuissière. Rapport de diagnostic d’archéologie préventive, INRAP GSO,DRAC - SRA Poitou-Charentes, 2010, 56 p., dactylographié.
Vacher 2011 : VACHER (S.), Dolus d’Oléron. Voie communale n° 18, la Passe del’Écuissière. In : Bilan Scientifique Régional Poitou-Charentes 2010. DRAC - SRAPoitou-Charentes, Poitiers 2011, p. 74.
Vacher, Maitay, à paraître : VACHER (S.), MAITAY (C.), Les occupations de l’Âgedu Bronze des Jardins de Ribray à Épannes, Deux-Sèvres, Bulletin de l’Associationpour la promotion des recherches sur l’Âge du Bronze, t. 9, à paraître.
Van Gijn 1989 : VAN GIJN (A.-L.), The wear and tear of flint, principles offunctional analysis applied to dutch neolithic assemblages. University of Leiden(Analecta praehistoria leidensia ; 22), Leiden 1989, 181 p.
Vanmontfort et al. 2008 : VANMONTFORT (B.), COLLET (H.), CROMBE (P.),Les industries lithiques taillées des IVe et IIIe millénaires dans les bassins del’Escaut et de la Meuse (Belgique). In : DIAS-MEIRINHO (M.-H.), LÉA (V.),GERNIGON (K.), FOUÉRÉ (P.), BRIOIS (F.), BAILLY (M.) dir., Les industrieslithiques taillées des IVe et IIIe millénaires en Europe occidentale. Colloque
548
Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen IIUn monument au mobilier exceptionnel de la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France
international, Toulouse, 7-9 avril 2005, BAR International Series 1884, Oxford2008, p. 11-39.
Vaughan, Bocquet 1987 : VAUGHAN (P.-C.), BOCQUET (A.), Première étudefonctionnelle d’outils lithiques néolithiques du village de Charavines, Isère,L’Anthropologie, t. 91, n° 2, 1987, p. 399-410.
Verjux et al. 2008 : VERJUX (C.), MILLET-RICHARD (L.-A.), WEISSER (S.),LINTON (J.), LEROY (D.), Deuxième campagne de fouilles (2007) sur les ateliersde taille du silex du Néolithique final à Abilly “Bergeresse” (Indre-et-Loire),Bulletin des Amis du Musée de Préhistoire du Grand-Pressigny, t. 59, 2008, p. 39-64.
Verlinder, Janti 1960 : VERLINDER (C.), JANTI (P. de), Le cerf et sa chasse. Éd. Crepin-Leblond et Cie, Paris 1960, 239 p.
Viau 1999 : VIAU (Y.), Cholet, La Ferronière. Bilan Scientifique Régional duService Régional de l’Archéologie des Pays de la Loire, 1999, p. 50.
Viellet 2005 : VIELLET (A.), Synthèse chronologique des bois d’œuvres des sitesnéolithiques de Clairvaux-les-Lacs et de Chalain (Jura, France). Les aléas de laméthode dendrochronologique, Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 102, n° 4, 2005, p. 803-812.
Villes 1985 : VILLES (A.), Sur les rapports SOM/Artenac entretenus dans le Bassinparisien, Revue archéologique de Picardie, t. 4, n° 3-4, 1985, p. 27-38.
Vuaillat 1991 : VUAILLAT (D.), Limousin, premier métal. In : MOHEN (J.-P.),ELUÈRE (C.) dir., Découverte du métal. Amis du Musée des Antiquités nationales(Millénaires ; dossier 2), Éd. Picard, Paris 1991, p. 223-228.
Vuaillat et al. 2006 : VUAILLAT (D.), SANTALLIER (D.), GRAVELAT (C.), Leshaches polies en roches tenaces du Limousin. Étude pétrographique, Préhistoiredu Sud-Ouest, t. 13, n° 2, 2006, p. 179-230.
Walter et al. 2008 : WALTER (B.), AUBRY (T.), ALMEIDA (M.), THIENNET (H.),Apport de trois nouveaux sites de la moyenne vallée de la Claise à notreconnaissance des méthodes de production laminaire du Néolithique, Bulletin desAmis du Musée du Grand-Pressigny, t. 59, 2008, p. 31-37.
Welsch 1910 : WELSCH (J.), La géologie des environs de Thouars (Deux-Sèvres)et l’étage Toarcien, Mémoire de la Société de Vulgarisation des Sciences Naturellesdes Deux-Sèvres, t. II, 1910, p. 93-123.
Wyns, Le Métour 1983 : WYNS (R.), LE MÉTOUR (J.), Le Précambrien du Massifvendéen. Étude détaillée de deux coupes de référence (coupe de l’Evre et coupede la Divatte) et synthèse des données récentes. Éd. BRGM (Documents ; 68),Orléans 1983, 60 p.
Imprimé par Grapho12 SA imprimeur F-12202 Villefranche-de-Rouergue Tél. 05 65 65 01 12
Dépôt légal 4e trimestre 2011
Association des Publications Chauvinoises - A.P.C.B.P. 64 - 86300 CHAUVIGNY
Tél. : 09 50 20 35 45Tél.-Fax : 05 49 46 35 45
e-mail : [email protected]
Directeur de publication : Max AUBRUNMaquette - Mise en page : Sylvie CLÉMENT-GILLET
©
ISSN 1159-8646
ISBN 979-10-90534-02-5