Vieille Ville, Nouveaux Fondements: L'Istanbul de Le Corbusier
LEHRER, 2010,Deux nouveaux genres de Rhiiniinae
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of LEHRER, 2010,Deux nouveaux genres de Rhiiniinae
Bull. Soc. ente Mulhouse, 2010,- 66 (3) : 46-51
Deux nouveaux genres de la sous-famille Rhiniinae, affines du genre Rhyncomya Robineau-Desvoidy
(Diptera, Calliphoridae)
par Andy Z. LEHRER
Résumé: On décrit deux nouveaux genres de la sous-famille Rhiniinae : Habeshomyia o. gen. et Kilimophalla n. gen., qui ont été isolés de l'ancien genre Rhyncomya RobineauDesvoidy sur la base de caractères morphologiques des sclérites abdominaux. On donne la description générale du mâle de K. cassotis (Wiedemann) et on présente les nouvelles combinaisons pour les espèces des genres.
Summary : One describes two new kinds of the Rhiniinae subfamily: Habeshomyia o. geo. and Kilimophalla o. gen. which were isolated from the old kind Rhyncomya RobineauDesvoidy on the basis of morphological chatacters of the abdominal sclerites. One gives the general description of the male of K. cassotis (Wiedemann) and one presents the news combination for the species of the kinds.
Le genre Rhyncomya Robineau-Desvoidy, 1830 est une des plus grandes entités taxonomiques de la famille Calliphoridae et est très bien représenté dans la région afrotropicale. Cependant, il a été étudié de façon peu satisfaisante, parce que ses espèces ont été et continuent d'être examinées presque exclusivement sur la base des caractères somatiques généraux et habituels. Même quand on essaie de faire la séparation des différentes espèces par leurs genitalia mâles, ceux-ci sont très rares et limités aux figures schématiques des éléments postabdominaux qui ne permettent pas une identification exacte.
Zumpt· a été un des spécialistes les plus importants pour la famille Calliphoridae, qui a réussi à amasser, réviser et illustrer, sous une forme modeste, les taxons africains connus jusqu'à la moitié du XXème siècle ou un peu plus tard. Il a présenté aussi sommairement les aspects graphiques des cerques et du phallosome d'un grand nombre d'espèces, sans y accorder une attention spéciale pour son système. Mais, même de ses clés d'identification des espèces du genre Rhyncomya (Zumpt, 1958 : 127), excepté la dichotomie des caractères chromatiques et chétotaxiques, paraissent quelques symboles structuraux des genitalia, qui doivent être étudiés sous une forme particulière. Parmi ceux-ci nous signalons les espèces avec les paralobes très courts et les espèces avec les cerques très courts et ayant un stemite V avec des prolongements médio-postérieurs très longs ou un développement très grand. Nous avons donc considéré que du genre Rhyncomya Robineau-Desvoidy il faut obligatoirement détacher au moins deux groupes avec le rang de genres, nommés par nous: Habeshomyia n. gen. et Kilimophalla o. geo., qui seront analysées plus bas.
Il n'est pas sans intérêt de rappeler que chez toutes les espèces du genre Rhyncomya les cerques et les paralobes ont presque la même longueur, que les stemites préabdominaux sont normaux et que le stemite V n'a pas de prolongements médio-postérieurs. Si dans ce genre existe une seule espèce avec une déviation morphologique. de ces structures postabdominales, on ne peut pas admettre qu'elle représente un élément avec la mênle origine phylogénétique. Le genre Rhyncomya, comme beaucoup d'autres unités taxonomiques, est un groupement établit d'après les opinions plus ou moins justifiées de~ auteurs, un simple groupement délimité artificiellement et sur la base des connaissances datant d'un certain temps. Pour cela, à la suite des nouvelles recherches taxonomiques, ces unités doivent être révisées et mises à jour, ce qui implique le renoncement, à tout prix, des classifications anciennes, désuètes ou conservatoires.
46
Bull. Soc. ent. Mulhouse, 2010 - 66 (3) : 46-51
Genre Habeshomyia n. gen.
Espèce-type: Rhyncomya masaimara Lehrer, 2007.
Diagnose. ac = 2-3 + 4-5, dc = 2-3 + 4, ia = 1 + 3, sc = 3 + 1. Ailes transparentes. R5 ouverte. Postabdomen très développé, bombé. Stemites abdominaux 1-11 développés normalement; stemites III-IV très réduits. Stemite V très développé, aussi long que la moitié du préabdomen et pourvu de deux prolongements médio-postérieurs longs.
Composition spécifique. H forcipata (Villeneuve, 1927) n. comb. et H masaimara (Lehrer, 2007) n. comb.
Distribution géographique. Région afrotropicale.
Derivatio nominis. Du mot Habesha, utilisé en Éthiopie pour désigner tous les Éthiopiens et Érythréens.
Zumpt (I.c.: 132) a signalé correctement dans sa clé d'identification que l'espèce Rhyncomya forcipata Villeneuve se distingue par un caractère particulier, a savoir: « Pregenital sternite of CS strikingly enJarget, Iying opposite tergite III-V, with a pair of forceps-Iike protruding processi ». Malheureusement, il n'a pas saisi la signification phylogénétique de ce caractère et il ne l'a pas associé à d'autres caractères de la même valeur taxonomique.
Nous avons décrit l'espèce R. masaimara Lehrer, 2007 de la faune du Kenya et d'Éthiopie et, récemment, nous avons trouvé dans les collections TAU, encore quelques spécimens de Tanzanie, colligés par le Prof. Dr. A. Freidberg. D'après la forme des cerques, des paralobes et du stemite V (fig. 1) celle-ci se distingue facilement de R. forcipata (fig. 2), mais les deux ont les paralobes beaucoup plus longs que les cerques et le stemite V est pourvu de longs prolongements médio-postérieurs. Ces faits constituent une exception par rapport à la majorité des espèces de Rhyncomya, ce qui justifie leur séparation taxonomique dans un genre nouveau.
Fig. 1. Habeshomyia masaimara (Lehrer). A, cerques et paralobes, vue dorsale; B, cerques et paralobes, vue de profil; C, stemite V ; D, phallosome ; E, prégonites ; E, postgonites.
47
Bull. Soc. ent. Mulhouse, 2010 - 66 (3) : 46-51
Fig. 2. Habeshomyiaforcipata (Villeneuve). Selon Zumpt.
Genre Kilimophalla n. gen.
Espèce-type: Rhyncomya galaniella Lehrer, 2008.
Diagnose. ac = 3 + 4, dc = 3 + 4, ia = 1 + 3, sc = 4 + 1. Ailes transparentes. R5 ouverte. Sternites abdominaux normaux. Postabdomen noir luisant, peu développé et bombé. Cerques normaux, mais les paralobes sont très réduits, rudimentaires. Sternite V avec de petits sommets sur la partie intéro-postérieure des lobes latéraux.
Composition spécifique. K. aravaensis (Rognes, 2002) n. comb., K. cassotis (Walker, 1849) n. comb., K. galaniella (Lehrer, 2008) n. comb., K. viduella (Villeneuve, 1927) n. comb.
Distribution géographique. Région afrotropicale et afro-asiatique.
Derivatio nominis. Du nom Kilima, mont en langue swahili.
Dans les collections TAU, nous avons été surpris pour la première fois de constater que Kilimophalla galaniella (Lehrer, 2008) (fig~ 3) est une espèce qui a les paralobes aussi petits par rapport aux cerques. Elle est la troisième espèce afrotropicale connue avec ce caractère, les premières étant K. cassotis (Walker, 1849) et K. viduella (Villenellve, 1927) qui ont aussi un sternite V très distinct. Récemment nous avons trouvé, dans les mêmes collections, 5 spécimens de K. cassotis et, pour cela, nous avons représenté ses structures génitales importantes (fig. 4). Zumpt (I.c. : 181) a discuté sur la variabilité chromatique de cette espèce, mais il n'a pas donné sa description.
o E
c Fig. 3. Kilimophalla galaniella (Lehrer). A, stemite V ; B, cerques et paralobes, vue dorsale;
C, cerques et paralobes, vue de profil; D, phallosome ; E, prégonites ; F, postgonites.
48
Bull. Soc. ente Mulhouse, 2010 - 66 (3) : 46-51
Description de Kilimophalla cassotis (Wiedemann, 1849) n. comb.
MÂLE Tête. Jaune. Les yeux sont holoptiques, avec les grandes facettes sur une zone restreinte parafrontale et parafaciale. Toutes les régions de la tête, y compris les antennes, le péristome et les palpes spatulés sont jaunes. La trompe est noire. Le troisième article de l'antenne est 2 fois plus long que le deuxième. L'arista est brune et glabre. Le péristome mesure 1/3 du grand diamètre oculaire.
Chétotaxie de la tête. On voit les macrochètes verticaux internes, les ocellaires et 5 macrochètes frontaux. Le péristome et la partie postérieure de la tête ont une pilosité jaune.
Thorax. Noir avec tomentum cendré et sans bandes longitudinales distinctes. La pilosité jaune des pleures est assez réduite. Les ampoules et les stigmates sont jaune cendré. Propleures glabres. Les pattes ont les fémurs noirs et les tibias bruns; les fémurs médians ont un ctenidium.
Chétotaxie du thorax. ac = 3 + 4, dc = 3 + 4, ia = 1 + 3, prs = 1, b = 3, ph = 3, n = 2, sa = 3, pa = 2, sc = 4 + 1, pp =1, pst = 1, st = 1 : 1.
Ailes. Transparentes. Épaulette brune. Basicosta et costagium jaunes. R5 ouverte. Cubitulus arrondi. Nervures rI et r4+5 glabres. Épine costale absente. Les écailles sont plus longues que larges, jaunâtres.
Chétotaxie des tibias. Les tibias antérieurs ont 4 ad et 1 pd. Les tibias médians ont 1 ad, 1 pvet 1-2 pd. Les tibias postérieurs ont 2-3 ad et 2 pd.
Abdomen. Tergites 1+11 jaunes. Tergite III jaune avec une bande médiane noire et mince. Tergite IV jaune avec une bande postérieure noire mince et un triangle médian qui n'arrive pas jusqu'à la marge antérieure du tergite. Tergite V noir avec tomentum cendré et une bande médiane noire, luisante. La partie ventrale des tergites 1+11, III et les sternites 1-3 sont jaunes; le tergite IV noir. Les sternites du préabdomen sont normaux. Le postabdomen est noir luisant, peu développé et bombé.
Genitalia : fig. 4.
Fig. 4. Kilimophalla cassotis (Wiedemann). A, cerques et paralobes, vue de profil; B, cerques et paralobes, vue dorsale; C, phallosome ; D, prégonites' E, postgonites ; F, sternite V.
49
Bull. Soc. ent. Mulhouse, 2010 - 66 (3) : 46-51
FEMELLE. Inconnue de moi.
Longueur du corps. 5,5 - 6 mm.
Matériel étudié. Nigeria: 3 aa, los-Kaduna, Rt. A236, 500-1000 m, 10-XII-1987, leg. A. Freidberg; 1 a, Idem, leg. Fini Kaplan. - Kenya: la, Bungoma, 23-XI-1986, leg. A. Freidberg.
Kilimophalla aravaensis (Rognes, 2002) n. comb.
Cette espèce est proche de K. galaniella (Lehrer), mais les genitalia et surtout le stemite V sont distincts.
E
Fig. 5. Kilimophalla aravaensis (Rognes). A, stemite V; B, cerques et paralobes, vue de profil ; C, cerques et paralobes, vue dorsale; D, phallosome ; E, gonites (selon Rognes)
Observation. Rognes (2002 : 35) a trouvé l'espèce « Rhyncomya aravaensis» (fig. 5) dans les collections TAU, originaire de la Péninsule du Sinaï: Bir Zrir et de certaines localités du sud d'Israël: Eilat, En Gedi, En Yahav, Nahal Qetura, Nahal Ramon, Ramon.
Kilimophalla viduella (Villeneuve, 1927) n. comb.
Fig. 6. Kilimophalla viduella (Villeneuve). Stemite V (selon Peris)
Concenant cette espèce éthiopienne il n'y a pas beaucoup d'informations sur ses genitalia. Seul Peris (1952 : 78) a donné la figure du stemite V (fig. 6), dans laquelle on peut voir que ses proéminences sont situées au milieu de la marge intérieure des lobes latéraux.
50
Bull. Soc. en!. Mulhouse, 2010 - 66 (3) : 46-51
Références
LEHRER, A.Z., 2007, Calliphorides de l'Afrique orientale du genre Rhyncomya RobineauDesvoidy, avec la description de trois espèces nouvelles (Diptera, Calliphoridae). Fragm. Dipt., nr. 9 : 11-20.
LEHRER, A.Z., 2008, Une nouvelle espèce de Rhyncomyia avec les paralobes courts (Diptera, Calliphoridae). - Fragm. Dipt., nr. 17 :19-22.
PERIS, S.V., 1952, La subfamilia Rhiniinae (Dipt., Calliphoridae), Ann. Est. Experim. de Aula Dei, 3(1), Zaragoza.
ROGNES, K., 2002, Blowflies (Diptera, Calliphoridae) of Israël and adjacent areas, including a new species from Tunisia. - EntomoI. Scand. Suppl. 59.
ZUMPT, F., 1958, Calliphoridae (Diptera Cyclorrhapha) Part II: Rhiniini. Explor. Parc Nat. Albert. fasc. 82, Bruxelles.
(TAU - Zoologie Rue'Hanasi, 49/1, P.O.B. 7049,21029 MAALOT, ISRAËL
51


















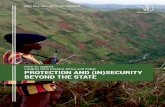


![Texte und Textsorten [Texts and Genres in Political Discourse, handbook article]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6321856abc33ec48b20e660f/texte-und-textsorten-texts-and-genres-in-political-discourse-handbook-article.jpg)





