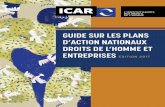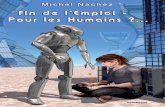Bulletin Apdhac N°40 Conflits armés en Afrique, migrations et droits de l'homme
Développement durable, renforcement du statut social des femmes et adolescents, droits humains...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Développement durable, renforcement du statut social des femmes et adolescents, droits humains...
Développement durable, renforcement du statut social
des femmes et adolescents, droits humains
L’exemple du programme « Santé sexuelle, droits humains » (PROSAD) au Burkina Faso
.
Programme « Santé sexuelle, droits humains » (PROSAD)
1
Eva Neuhaus et Werner Heuler-Neuhaus (2007)
Développement durable, renforcement du statut social des femmes et adolescents, droits humains
L’exemple du programme « Santé sexuelle/ droits humains » (PROSAD)
au Burkina Faso
Introduction
Le Burkina Faso fait partie des pays les plus pauvres de la planète. Près de la moitié de la popula-tion vit au-dessous du seuil de pauvreté. Les femmes, les adolescents et les jeunes adultes sont particulièrement défavorisés. Mais la société burkinabè commence à prendre conscience du fait que la faiblesse de leur statut social est devenue un obstacle majeur au développement. Le gou-vernement en a tenu compte en modifiant la législation et en lançant des programmes nationaux d’action. Les programmes nationaux portant sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents, la lutte contre le sida, l’abandon des mutilations génitales féminines et la lutte contre le trafic et le travail des enfants commencent déjà à produire des effets. Toutefois, un fossé subsiste entre l’intention politique et la réalité sociale. Dans la région de l’Est et la région du Sud-Ouest, le pro-gramme « Santé sexuelle/droits humains » (PROSAD) aide le pays à combler progressivement ce fossé en réalisant les programmes nationaux de manière exemplaire.
Partant du programme PROSAD, la présente étude cherche à déterminer dans quelle mesure un programme d’aide au développement reposant sur une démarche de promotion des droits hu-mains peut contribuer au développement durable dans un pays qui compte parmi les moins déve-loppés de la planète.
Quatre questions sont abordées :
1. Quelle est l’ambition du développement durable ? 2. Quelle forme peut prendre le développement durable dans les conditions du Burkina Faso ? Quels sont les principaux obstacles au développement durable du pays ? 3. Que peut faire le programme PROSAD pour contribuer à traduire le développement durable dans les faits et lever les obstacles au développement ? 4. Quels sont les résultats obtenus jusqu’à présent par le programme PROSAD et les projets qui l’ont précédé ?
2
L’annexe met en relation les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et leurs in-
dicateurs avec le concept de développement durable et récapitule les résultats obtenus par le Bur-kina Faso dans la réalisation des objectifs du Millénaire. L’accent y est mis sur les objectifs que le programme PROSAD contribue, directement ou indirectement, à réaliser.
1. Qu’est-ce que le développement durable ?
Le rapport de la Commission Brundtland de 1987 définit le développement durable comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs »1 et de choisir leur niveau de vie.
C’est donc d’abord le rapport entre les générations actuelles et futures qui est en jeu. Comme une génération coexiste avec celles qui les précèdent, notamment dans les sociétés africaines, caractérisées par une étroite imbrication des générations, il s’agit aussi du rapport entre les géné-rations qui se côtoient aujourd’hui. Il s’agit en fin de compte des relations entre les différents grou-pes sociaux au niveau national et entre les peuples, les nations et les États au niveau internatio-nal.
Chaque groupe ou génération doit pouvoir accéder à un développement qui réponde à ses be-soins sans compromettre le bien-être des autres groupes et générations. Le « laissez faire, laissez aller » des économistes est complété d’un « mais » : mais il faut agir de telle manière que ce qui contribue à ton bien-être ne nuise pas au bien-être des autres. Ce n’est pas la « main invisible » de l’économie politique classique (Adam Smith) qui arrange tout pour le mieux à l’insu des acteurs concernés qui recherchent uniquement leur avantage particulier. C’est l’action visible et transpa-rente des acteurs concernés qui fixe les mécanismes de régulation.
Dans cette optique, les intérêts des générations futures ne doivent pas être de simples cons-tructions intellectuelles abstraites émanant de représentants autoproclamés. Il faut trouver les for-ces de la société qui – en raison de leurs propres intérêts bien compris – sont les plus aptes à re-présenter les intérêts des générations futures (ou l’intérêt général) et donner la parole à ces forces.
Le développement durable présuppose une négociation des intérêts. Les groupes qui ont un statut social faible doivent être soutenus et défendus (advocacy). L’objectif est de les renforcer (émancipation ou empowerment) afin qu’ils n’aient plus besoin d’un tel appui.
Le développement durable peut être considéré comme un processus qui réduit au minimum les contradictions entre la croissance économique, la préservation de l’environnement et des res-sources naturelles et le bien-être social.
2. Quelle forme peut prendre le développement durable dans les conditions du Burkina Faso ? Quels sont les principaux obstacles
au développement ?
Situation actuelle
Selon le Rapport mondial sur le développement humain de 2007, le Burkina Faso se trouvait en 176e position sur 177 pays en 2005.2 L’espérance de vie moyenne était estimée à 51,3 ans en 1 Rapport Brundtland 1987. Commission mondiale sur l’environnement et le développement. Notre avenir à tous. Mon-tréal : Éd. du Fleuve : Les Publications du Québec, 1989. 2 La faible valeur de l’indice de développement humain, 0,370 (rapport 2001 : 0,230 ; 2004 : 0,342), est essentiellement due au très faible taux d’alphabétisation des adultes, qui n’évolue que très lentement par nature. Le Burkina se situe en dernière position (139e sur 139 pays). Pour le taux de scolarisation combiné (primaire, secondaire et supérieur), il se situe en quatrième position depuis la fin. En ce qui concerne le produit intérieur brut par habitant, le pays occupait la 157e place sur 174 (avec 1 213 US-$). La probabilité d’atteindre la 40e année de vie était plus faible dans 32 pays, la proportion de la population ayant accès à une eau potable propre est plus faible qu’au Burkina Faso dans 28 pays. Pour l’indicateur sexospécifique du développement humain (ISDH), le Burkina Faso se situe en 121e position sur 156 pays. (Cet indicateur tient compte de l’espérance de vie, de l’alphabétisation des adultes et du taux de scolarisation combiné des femmes par rapport aux données des hommes.)
3
2005.3 En l’espace de dix ans (1996-2006), la population est passée de 10,3 millions à 13,7 mil-lions d’habitants4, ce qui correspond à une croissance démographique de 2,9 % par an en moyenne. Cette croissance rapide est en partie liée à la crise politique ivoirienne qui a commencé a faire sentir ces effets lentement à partir de 1999 et de manière plus intense à partir de septembre 2002.5 La région de programme Sud-Ouest a été particulièrement touchée par le reflux de popula-tion (et l’arrêt de l’émigration de travail). En quelques années, la population a augmenté de plus de 130 000 habitants, ce qui correspond à 20 % environ de la population initialement attendue en 2006.6
Graph. 1 Les conséquences de la crise politique ivoirienne
sur l’évolution démographique dans la région du Sud-Ouest Développement attendu et effectif 1996-2006
En 2015, la population devrait atteindre 17,5 millions7 d’habitants, même en tenant compte d’une baisse du taux de croissance résultant de la normalisation du flux migratoire. D’ici à 2034, la po-pulation devrait doubler.
La structure démographique est caractéristique d’une période de forte croissance : la majorité de la population (55 %) se compose d’enfants et d’adolescents âgés de moins de 18 ans. 3 Le pays se trouvait ainsi en 155e position sur 177 pays. 4 RGPH 1996 et résultats provisoires du RGPH 2006. Ce chiffre n’inclut pas les quelque 3,5 millions de Burkinabè qui vivent à l’étranger, dont environ 2,5 millions en Côte d’Ivoire. 5 Fin 2006, la population était supérieure de 800 000 à celle qui pourrait être extrapolée d’après les données du recense-ment de 1996. Cette croissance supplémentaire est un résultat de la crise politique ivoirienne. Elle se compose de quel-que 440 000 rapatriés (la croissance naturelle de ce groupe depuis son rapatriement étant pris en compte) et d’environ 360 000 émigrants potentiels qui ont renoncé à leurs projets d’émigration de travail en raison de la crise. 6 La croissance supplémentaire se compose de : 60 000 rapatriés, 7 000 enfants nés depuis dans les familles des rapa-triés et environ 36 000 émigrants potentiels qui sont restés dans la région. (Calculs personnels d’après : INSD 1998 ; INSD 2007 ; SP-CONASUR 2004 ; Heuler-Neuhaus 2003 et 2004) 7 Le DESA de l’ONU avance même le chiffre de 18,5 millions pour 2015 (DESA 2007 : 42).
4
Un autre problème important pour l’évolution démographique résulte du volume de l’émigration de travail8 surtout à destination de la Côte d’Ivoire. Comme le nombre d’émigrants dépasse large-ment le nombre de rapatriés, la forte croissance de la population n’apparaît pas à première vue. Comme les émigrants sont en majorité des hommes, alors que la plupart des rapatriés sont des femmes, la structure démographique se modifie de telle manière que les femmes sont nettement en surnombre dans la population adulte. Au Burkina Faso, il y a déjà en moyenne 100 hommes pour 128 femmes dans la classe d’âge des 20 à 44 ans. Dans les principales zones d’émigration, telles que la province de Poni, la proportion de femmes est encore plus élevée (160).9 Il en résulte que le taux de natalité (défini comme le nombre de naissances pour 1000 habitants) continue d’être orienté à la hausse bien que le nombre de naissances par femme diminue.
La crise ivoirienne n’a nullement atténué ce processus. En effet, souvent, les femmes et les enfants sont retournés dans leur pays d’origine, tandis que les hommes restaient en Côte d’Ivoire.
Les villes, particulièrement la capitale, Ouagadougou, connaissent une croissance supérieure à la moyenne10, mais quatre cinquièmes de la population continue à vivre en zone rurale. Près de la moitié de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté, 27 % de la population dispose de moins d’un dollar US par jour et 72 %, de moins de deux dollars US.
Les revenus familiaux sont plus également répartis que dans tous les autres pays d’Afrique de l’Ouest, à l’exception du Bénin. Le coefficient de Gini, qui est un indicateur de l’inégalité des reve-nus, se situe à 39,5 %, soit moins qu’aux États-Unis. Mais cela ne signifie pas grand-chose, parce qu’il y a très peu à répartir. En outre, la pauvreté ne se résume pas au faible niveau de revenu, elle est surtout caractérisée par l’exclusion : les pauvres ont un accès limité à l’éducation, à la santé, aux services publics, aux ressources, au pouvoir et aux processus de décision politique. La discri-mination va de pair avec le manque de possibilités d’évolution économique.
En 2003, parmi les femmes appartenant au quintile le plus pauvre de la société, seules 4,6 % ont pu satisfaire le besoin en méthodes modernes de planification familiale que 36,7 % avaient ex-primé, tandis qu’elles étaient presque une sur deux (47,0 %) parmi les 56,4 % de femmes du quin-tile le plus riche à avoir exprimé ce besoin.11
Le développement économique présente une tendance positive, avec une croissance annuelle moyenne du produit intérieur brut réel de 5,1 % durant les années 2001-2006. On ne saurait tou-tefois sous-estimer les effets de la crise ivoirienne. Celle-ci a certes entraîné une diminution des transferts des migrants à moyen terme, mais elle a également boosté l’économie burkinabè à court terme en incitant des nationaux à revenir dans leur pays avec leurs économies. La crise ivoirienne a sans aucun doute contribué au boom de la construction qu’on peut observer dans la capitale, Ouagadougou, depuis quelques années.
8 Entre 1976 et 2002, environ 2,2 millions de travailleurs burkinabè ont émigré en Côte d’Ivoire. L’émigrant type avait entre 15 et 29 ans et était de sexe masculin. La durée de son séjour était comprise entre deux et trois ans. Durant la même période, environ 1,6 million de Burkinabè sont retournés dans leur pays. La majorité des rapatriés étaient des enfants d’émigrants nés en Côte d’Ivoire. Le nombre de femmes rapatriées était plus que trois fois supérieur au nombre de femmes émigrantes. Dans le système de la migration circulaire, le migrant navigue non seulement entre des espaces géographiques, mais aussi entre différents sous-systèmes sociaux et différentes sphères économiques. Ainsi, un individu peut quitter son village burkinabè pour s’installer dans une petite ville ivoirienne, puis aller à Abidjan, revenir ensuite dans son village burkinabè pour enfin aboutir à Ouagadougou en passant par une petite ville burkinabè. Dans le même temps, il passe de l’économie paysanne de subsistance au petit commerce, le quitte pour l’économie de plantation, fait ensuite une incur-sion dans l’industrie alimentaire, puis revient à l’économie paysanne de subsistance pour aller finalement travailler dans le secteur informel à Ouagadougou. Ce mouvement migratoire peut même s’accompagner d’une alternance entre les religions. Environ trois millions de personnes ont participé directement à ce mouvement circulaire depuis 1975, soit un Burkinabè sur quatre, un sur trois à la campagne et un sur deux dans les principales zones d’émigration. (Cf. Heuler-Neuhaus 2004 : 13 et suivantes et 2003 : 17 et suivantes) 9 Dans les autres provinces de la région Sud-Ouest : province de Noumbiel - 132, Bougouriba – 149 et Ioba 150 ; dans la région Est : 117 femmes pour 100 hommes dans chaque cas. 10 D’après les résultats provisoires du recensement de 2006 (INSD 2007), la population de la capitale a augmenté de 66,87 % en dix ans pour passer de 709 736 à 1 184 321 habitants, ce qui correspond à une croissance annuelle de 5,3%. Si le taux de croissance reste constant, la population de la ville devrait passer le mur des 2 millions en 2016/2017. 11 Westoff 2006 : 61 (sur la base des données de l’EDS III).
5
Graph. 2 Proportion de femmes (dans la tranche d’âge 15-49 ans), qui souhaitent utiliser les
méthodes modernes de planification familiale (besoins exprimés totaux) et proportion de femmes qui les ont effectivement utilisées (besoins satisfaits)
en 2003 en %12 par quintiles de richesse
Obstacles au développement
Les principaux obstacles au développement durable sont les suivants : 1. Le manque de ressources naturelles, les aléas climatiques et les difficultés en résultant, ainsi que l’enclavement du pays, qui ne dispose d’aucun accès direct à la mer, ni même de fleuves naviga-bles. La crise ivoirienne a encore aggravé les effets de l’absence d’accès à la mer. 2. La croissance rapide de la population et la structure démographique qui en résulte. 3. Le mouvement migratoire circulaire, dans la mesure où il reste un processus qui se renforce lui-même et se superpose au développement villageois, et la déformation de la structure démographi-que qui en découle.
12 Calculé sur la base des données de l’EDS III, ORC Macro, 2004.
6
4. La pauvreté, qui se traduit par la faiblesse des revenus disponibles et l’exclusion par rapport aux services et ressources. Cette double pauvreté a des conséquences directes, telles que la mortalité infantile, la mortalité maternelle et la prévalence élevée de maladies qui frappent les femmes et hommes à l’âge actif (morbidité et mortalité des adultes). Les maladies endémiques et épidémi-ques y trouvent un terrain favorable. La mortalité des adultes est nettement plus élevée que celle qu’on pourrait attendre d’après les tables de mortalité de l’ONU pour l’Afrique occidentale.13
Graph. 3
Mortalité des adultes au Burkina Faso, valeurs effectives et valeurs attendues d’après les tables de mortalité de l’ONU pour l’Afrique occidentale
1994-1998 et 1997-2003 (d’après EDS II et III)
Femmes (15-49)
13 Quand on compare les taux de mortalité au cours des années précédant l’EDS II (1994-98) et l’ EDS III (1997-2003), on remarque une mortalité particulièrement élevée pour les femmes de 15 à 24 pendant la première période et pour les femmes de 25 à 34 pendant la seconde période. Chez les hommes, on observe un décalage correspondant de la classe d’âge des 30 à 39 ans vers la classe d’âge des 40 à 49 ans. Ce décalage semble lié en premier lieu à l’évolution de l’épidémie de SIDA (prévalence plus faible chez les plus jeunes en raison des succès remportés dans la lutte contre la pandémie ; survie des séropositifs prolongée par un meilleur accès à des traitements efficaces).
7
Hommes (15-49)
5. La pandémie de VIH/SIDA et les maladies qui lui sont associées, qui regagnent du terrain de ce fait (p. ex. tuberculose), et le paludisme, dont l’agent pathogène développe de plus en plus de ré-sistances. 6. Un espace de non-droit qui se forme quand les règles traditionnelles se délitent sans être rempla-cées par des conventions sociales nouvelles et quand des institutions traditionnelles, par exemple le placement des enfants, sont détournées de leur but initial, qui était l’entraide dans le cadre des liens de parenté, pour ouvrir la voie à des relations d’exploitation. 7. La contradiction entre la loi et la réalité (standard élevé fixé par la législation – standard modeste de la mise en application), la faiblesse des institutions juridiques, le respect insuffisant des droits humains dans la pratique sociale. 8. La vulnérabilité aux crises d’une économie peu diversifiée14 9. La faiblesse du secteur des services publics. 10. L’augmentation de la corruption.15 14 Le secteur primaire qui contribue seulement pour 35 % au produit intérieur brut, occupe néanmoins 80 % de la popula-tion active. Les autres secteurs sont fortement marqués par leur relation avec le secteur primaire. La concentration sur un petit nombre de produits rend le développement fortement dépendant des conditions climatiques et sensible aux influences externes (prix du coton, évolutions des taux de change, prix de l’énergie). L’économie de subsistance est toujours en danger de ne pas atteindre l’objectif de la sécurité alimentaire. Le développement du secteur agricole est surtout entravé par les conditions naturelles (voir 1), les marchés (commercialisation des produits agricoles), les restric-tions d’accès aux terres agricoles utilisables, qui touchent surtout les femmes, et les capacités des paysans. 15 Bien que le pays s’appelle fièrement « Burkina Faso » (patrie des incorruptibles), l’évolution ne va pas dans le bon sens. Selon les estimations de Transparency International, le Burkina Faso a reçu seulement 3,2 points sur les dix pos-sibles (10 = pas corrompu) en 2006 et 2007. En 2005, il obtenait encore 3,5 points. (Transparency International 2005-2007).
8
Importance du statut social des femmes et des adolescents
Ces dix obstacles au développement sont liés à deux obstacles clés pouvant les aggraver comme les atténuer : le faible statut social des adolescents et le faible statut social des femmes.
Les femmes et les adolescents sont les victimes du développement social. Tant qu’ils en res-tent les victimes, la société dans son ensemble tend à être privée de la capacité à mener un dé-veloppement durable.
Pendant des décennies, le flux d’émigration circulaire (obstacle 3) a contribué à reporter le dé-bat sur le statut social des adolescents et des jeunes adultes16. Le statut de la femme est devenu de plus en plus précaire. Les femmes ont subi les inconvénients du flux migratoire sans en tirer d’avantages.17
Un exemple extrême est fourni par la structure sociale de la société traditionnelle des Lobi dans la région du Sud-Ouest. Ce n’est pas le manque de ressources naturelles dans leur région d’origine, mais le désir d’échapper à la dépendance économique vis-à-vis de leur père qui pousse les jeunes hommes lobi à émigrer.
S’ils restent dans leur village, ils n’ont même pas le droit de se procurer les outils aratoires. Le père donne la première houe à son fils. Mais presque tout ce que le fils produit à l’aide de cette houe (à l’exception des produits dits « froids » tels que le riz ou l’igname que le fils cultive sur son champ personnel après le travail sur le champ du père) appartient au père et cette situation per-dure jusqu’à ce que le père accorde l’indépendance à son fils. Même alors, le fils est tenu de céder une partie de sa récolte à son père – surtout les produits « amers » (dont fait partie le millet). Le fils n’a même pas la perspective de récupérer les biens qu’il a produits quand il était en quelque sorte au service du père. En effet, dans les systèmes d’héritage, en apparence matrilinéaires, des Lobi, ce n’est pas le fils qui hérite, mais le fils aîné de la sœur aînée du père18. Ce système d’héritage a deux aspects : il vise en premier lieu à renforcer le patriclan. Comme il arrivait souvent que les hommes lobi ne soient pas sûrs d’être véritablement les pères des enfants de leurs fem-mes, ils léguaient leurs terres et leurs biens au fils aîné de leur sœur, avec qui ils étaient sûrs d’avoir une parenté biologique. Il existe aussi un aspect gérontocratique.19 L’ordre de succession est en quelque sorte décalé en arrière d’une génération et la femme est indirectement déshéritée. Elle reste une étrangère dans la famille de son mari.20
Le principe d’égalité des sexes inscrit dans la constitution est très éloigné de cette réalité so-ciale. Même dans les villes, les filles et les femmes restent généralement dans une position subor-donnée tout au long de leur vie. C’est toutefois dans les zones rurales que les possibilités économiques des femmes sont le plus limitées. Si elles disposent de terres, ce sont en général les champs les plus éloignés et les moins fertiles. Les veuves sont souvent déshéritées, en dépit de la loi. La violence domestique est très répandue. La pratique des mutilations génitales féminines (MGF) ne recule que très lentement. En 2003, 77 % des femmes de plus de 15 ans étaient exci-sées. À 18 ans, 48 % des jeunes femmes sont déjà mères. Ces grossesses précoces sont rare-ment désirées. Elles sont dues aux mariages forcés et mariages d’enfants, à la violence sexuelle ou tout simplement au manque d’information. Cela explique le nombre élevé d’avortements clan-
16 Cf. Heuler-Neuhaus 2003 et 2004. 17 Cf. Heuler-Neuhaus 1994, 2003 et 2004. 18 Pourquoi travaillerait-il, pour son père qui ne lui donne rien et dont il n’héritera pas ? L’émigration lui permettra au moins de s’habiller à son goût. A-t-il besoin d’une bicyclette ou d’un transistor pour séduire sa belle ? L’émigration lui permettra de se les procurer. Veut-on qu’il épouse cette fille qui ne lui plaît pas, alors qu’il aime cette autre ? L’émigration lui permet de partir avec cette dernière, sans cultiver pour la belle-famille. Mais même l’émigration ne libère pas le Lobi entièrement des règles traditionnelles. Il évitera de cultiver des produits « amers », mais seulement des produits « froids » qu’il peut commercialiser pour son propre compte et il enverra plus bien plus rarement de l’argent à la famille de son père que les migrants, issus des autres régions, notamment les régions Moose. 19 Quand un homme de 70 ans meurt, ce n’est pas le fils de 40 ans de sa femme de 60 ans qui hérite, mais le fils de 60 ans de sa sœur de 80 ans qui est peut-être déjà morte. 20 Ne perdons pas de vue que cette règle entretient un conflit chronique entre les femmes (entre les sœurs du mari et ses femmes, entre les femmes de la famille et les autres).
9
destins parce qu’illégaux : 28 % des décès de femmes dans la tranche d’âge de 15 à 24 ans leur sont imputables. Cette discrimination des femmes et des filles ancrée dans les traditions a créé un milieu favorable à la pandémie du VIH/SIDA : en 2003, la proportion de personnes atteintes du VIH était trois fois plus importante chez les femmes âgées de 20 à 24 ans que chez les hommes du même âge (d’après les résultats de l’EDS III).
Seulement 9 % des femmes âgées de plus de 15 ans (2 % à la campagne) savent lire et écrire. Le taux net de fréquentation scolaire à l’école primaire (qui compte 6 classes)21 atteint 48,7 % pour les filles (2006/07), mais reste en retrait de 15 % par rapport à celui des garçons22. La majorité des enfants scolarisés ne terminent pas le cycle primaire.23
D’après les résultats de l’EDS III, dans les familles, même les décisions qui concernent directement les seules femmes sont prises exclusivement par les hommes dans la majorité des cas. Trois quarts des femmes ne participaient même pas à la décision de leur faire consulter un service sanitaire en cas de maladie. Dans 61,5 % des cas, l’homme seul décide si la femme peut rendre visite à des amis ou aux parents. 55,9 % des femmes ne sont pas consultées pour les déci-sions concernant les dépenses du ménage.24 En outre, la famille est un lieu de violence pour de nombreuses femmes.25
Le trafic des enfants et les pires formes de travail des enfants font partie des atteintes les plus graves aux droits humains. Plus de 160 000 enfants en sont victimes. Parmi les enfants de la tran-che d’âge de 6 à 15 ans, 5 % sont des travailleurs migrants qui vivent séparés de leurs parents. Dans la seule Côte d’Ivoire, plus de 60 000 enfants burkinabè âgés de moins de 15 ans, des gar-çons en majorité, exercent une activité génératrice de revenus. Près de 25 000 d’entre eux ont moins de 10 ans. Le nombre d’enfants, des filles en majorité, « placés » dans des centres urbains a été estimé à 80 000. Les filles subissent souvent une exploitation sexuelle en plus de l’exploitation économique.
Les garçons et les jeunes hommes sont souvent dépendants de leurs parents masculins sur les plans social et économique jusqu’à l’âge adulte.
3. Que peut faire le programme PROSAD pour contribuer à traduire le développement durable dans les faits et lever les obstacles au dévelop-
pement ?
Conception : droits humains et développement durable
Le projet adopte l’approche de la « prise en compte généralisée (mainstreaming) des droits hu-mains », mais va au-delà. La planification du développement dans tous les domaines devrait veiller à la promotion des droits humains, à la protection et au renforcement du statut social des femmes et des adolescents. Les femmes et adolescents ont souvent besoin de protection. Dans leur cas, le respect des droits humains peut être considéré comme une ligne minimale de protection. Mais ils doivent surtout être considérés comme des sujets agissants. Il s’agit de développer et renforcer leurs potentiels de telle façon qu’ils soient eux-mêmes en mesure de faire valoir leurs droits. Dans la conception du projet, le changement du statut social des femmes et adolescents est appréhendé comme une tâche à part entière qui nous conduit au cœur des problèmes sociaux.
Le programme santé sexuelle/droits humains (PROSAD) essaie d’accomplir cette tâche dans le cadre de son objectif global, qui est le suivant : les femmes, les hommes et les jeunes font
21 Le taux net met le nombre d’écolières de la classe d’âge de 7 à 12 ans en rapport avec le nombre total de filles de cette même classe d’âge. 22 Sur ce point, la situation s’est lentement améliorée au cours des dernières années. Durant l’année scolaire 1999/2000, seulement 27,8 % des filles étaient scolarisées ; le taux de la fréquentation scolaire des filles était inférieur de 28 % à celui des garçons. (MEBA 2000-2007). 23 Durant l’année scolaire 2006/2007, 46,94 % des filles ont interrompu leur scolarité avant d’atteindre le CM2 (2005/06 : 50,27 %). 44,75 % des filles qui étaient arrivées jusqu’au CM2 ont échoué à l’examen final. 24 UNICEF 2007 (d’après EDS III). 25 Le projet a commandité une étude sur ce sujet : CERFODES (équipe ; Yaro et al.) 2007. Voir à ce propos (ci-après) la section : Secteur d’activité : promotion des droits des femmes.
10
usage de leurs droits et des possibilités qui leurs sont offertes: en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive, dans la lutte contre le VIH/SIDA et pour la protection contre la discrimina-tion, les pratiques traditionnelles de violation des droits humains, contre le trafic et les pires formes de travail des enfants.
Les principes : - égalité et non-discrimination, - participation et « empowerment » (capacitation et autonomisation) des groupes cibles, - responsabilité et respect de l’État de droit de la part des autorités publiques (respect des droits
humains, lutte contre les violations des droits humains des groupes à risques, transposition de l’idéal des droits humains dans la réalité sociétale),
- indivisibilité et universalité (il ne faut pas réaliser un droit humain aux dépens d’un autre ; les droits humains concernent tous les groupes sociaux),
ne peuvent être réalisés dans l’abstrait. Pour choisir le point d’attaque, il faut, d’une part, intervenir là où les droits des femmes et des adolescents sont négligés de manière grave dans la situation sociale actuelle et, d’autre part, là où il existe déjà des mouvements sociaux que l’on peut soutenir dans leur lutte pour la promotion et la défense de ces droits.
Le projet essaie de « prendre en pince » le processus de développement : la chaîne des résultats se déroule à partir de deux pôles.
1. Il faut appuyer les individus et les groupes, surtout les femmes et les adolescents des couches pauvres de la population, pour qu’ils gagnent en assurance et se comportent davantage comme des titulaires de droits. Ils doivent avoir accès à l’éducation et à la santé, aux ressources et servi-ces publics, au pouvoir et aux processus de décision politique. Ils doivent avoir des possibilités d’évolution économique garanties par un système juridique efficace dans la pratique sociale qui protège effectivement l’accès aux terres arables, le droit à un logement suffisant et à une rémuné-ration appropriée ainsi que l’accès aux ressources vitales. Ils doivent être protégés de la discrimi-nation, de l’exclusion et de la violence.
L’utilisation des prestations du programme permet aux ONG, aux associations villageoises et régionales, aux associations culturelles, aux troupes de théâtre et aux stations régionales de radio d’effectuer un meilleur travail de sensibilisation. Dans un premier temps, on transmet des connais-sances aux membres des groupes cibles, puis on les aide à développer la capacité d’utiliser ces connaissances. Les connaissances deviennent un savoir vivant. Les prises de conscience ponc-tuelles se traduisent en changements ponctuels de comportement. La demande en services de l’État et de la commune dans les domaines de la santé sexuelle des adolescents, de la planifica-tion familiale, de la lutte contre le VIH/SIDA, des droits des femmes, des adolescents et des en-fants augmente et les utilisatrices/utilisateurs exigent une qualité supérieure des prestations de service.
2. Par ailleurs, il est demandé à l’État burkinabè de répondre aux obligations qu’il a contractées en ratifiant les instruments relatifs aux droits humains. Le gouvernement, l’administration et les parle-ments doivent s’attaquer à la mise en application des droits humains, qui est une tâche complexe, au niveau du pays, des régions, des provinces et des communes et au niveau local. Le projet aide les partenaires à accomplir ces obligations et à mettre en place les structures nécessaires au lieu de contourner les services étatiques et communaux et de les remplacer par ses propres services. L’utilisation des prestations du programme améliore la qualité des services de l’État. Des services supplémentaires sont proposés au niveau communautaire.. Les structures étatiques, initiatives communales, groupes d’entraide et prestataires privés collaborent mieux. La demande de services de l’État et de la commune peut être mieux satisfaite et augmente.
Il est essentiel d’obtenir une participation aussi grande possible des personnes concernées. À l’intérieur des différents groupes sociaux, le projet fait appel à des promoteurs (promotrices) de groupes de pairs qui y jouissent d’une certaine considération et influence. Des femmes conseillent les femmes. Des adolescents contribuent à la sensibilisation des personnes de leur âge. Des hommes plaident pour un comportement sexuel responsable auprès des autres hommes.
11
Le dialogue à l’intérieur des groupes crée des conditions pour le dialogue entre eux : entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes, entre les enfants ou les adolescents et les adultes. Le projet utilise des formes innovantes de communication qui vont de pair avec les servi-ces et mesures de soutien. En effet, les changements de conscience ne débouchent sur des changements durables du comportement qu’en présence d’alternatives réelles pour l’action. Les adolescents et les enfants qui étaient prêts à émigrer le resteront si la communauté villageoise ne peut pas leur offrir de perspective de vie. Quand on a dissuadé les parents d’envoyer leurs enfants travailler à l’étranger, il reste à les aider à scolariser leurs enfants ou à leur faire suivre une forma-tion artisanale qualifiante. Les femmes qui se défendent contre la violence dans leur environne-ment domestique ne doivent pas seulement recevoir la protection et le soutien d’un centre de conseil, mais bénéficier aussi de l’appui de la communauté. C’est de cette manière que les chan-gements de conscience obtenus peuvent se traduire peu à peu en changements durables du com-portement.
Que faut-il en conclure pour les différents secteurs d’activité du projet ?
Secteur d’activité : sexualité des jeunes et planification familiale
Dans le dialogue entre les générations, la sexualité est un sujet qui est souvent passé sous si-lence. La vie sexuelle des adolescents, particulièrement celle des filles, commence tôt et souvent sans préparation. À l’âge de 18 ans, presque une femme sur deux est déjà mère. Les grossesses précoces peuvent être dues à un manque d’information, elles sont souvent aussi la conséquence de la violence sexuelle, du mariage forcé ou du mariage d’enfants. Le nombre d’avortements clan-destins, parce qu’illégaux, est en augmentation. La mortalité maternelle est élevée. La mise en place de services relatifs à la santé sexuelle et reproductive à l’intention des jeunes en est à ses débuts. Le nombre d’adolescents qui bénéficient de ces services est encore faible.
Le projet intervient ici à cinq niveaux :
1. au niveau des adolescents et des jeunes adultes eux-mêmes,
2. au niveau de la famille,
3. au niveau des communautés villageoises et des communes,
4. au niveau de l’école et d’autres établissements éducatifs et
5. au niveau des établissements de santé.
La chaîne des résultats ci-après récapitule les principaux éléments de la démarche et les effets attendus de la première phase (2007-2009). Le tableau indique également les effets directs et indi-rects que le projet vise à réaliser d’ici à son terme (horizon 2015).
Chaîne des résultats : sexualité des jeunes
Activités : • Un programme de formation du personnel de santé à la planification familiale et à la sexualité des jeunes est mis au point et réalisé ; le personnel de santé est supervisé.
• Les locaux des services de santé sont adaptés aux jeunes. • Un système est conçu et réalisé pour diffuser les méthodes de planification
familiale au niveau communautaire • Dans les écoles ou au niveau communautaire, des pairs-éducateurs sont for-
més à la sexualité des jeunes.
12
• Certains collaborateurs d’ONG bénéficient d’une formation concernant l’organisation d’actions d’information sur la planification familiale, les questions de santé reproductive et sexuelle des jeunes et la direction des pairs-éduca-teurs.
• Des supports didactiques sont conçus et produits.
Produits : • Services relatifs à la santé reproductive et sexuelle axés sur les besoins des clients et des jeunes.
• Services relatifs aux méthodes de planification familiale à base communautaire • Pairs-éducateurs en matière de sexualité des jeunes dans les écoles. • Pairs-éducateurs en matière de sexualité des jeunes dans les quartiers
d’habitation.
Utilisation : • Les services de santé proposent des prestations relatives à la planification fami-liale et à la santé reproductive qui sont conformes aux normes et directives du Ministère de la Santé et axées sur les besoins des clients.
• Les services de planification familiale à base communautaire sont un concept diffusé par les autorités sanitaires.
• Les autorités scolaires soutiennent et diffusent dans les écoles la conception des pairs-éducateurs en matière de sexualité des jeunes.
• Les ONG et pairs-éducateurs accomplissent un bon travail de sensibilisation. • L’utilisation des prestations du programme permet d’abord d’améliorer la qualité
des services étatiques. Des services supplémentaires sont proposés au niveau communal. Les structures étatiques, initiatives communautaires, groupes d’entraide et prestataires privés collaborent mieux. La demande peut être mieux satisfaite et elle augmente. L’utilisation des prestations du programme permet ensuite aux ONG, associations villageoises, compagnies de théâtre de mieux accomplir leur travail de sensibilisation. La demande augmente encore. Les uti-lisatrices/utilisateurs gagnent en confiance en soi. Les exigences en matière de qualité des services augmentent.
Résultat direct :
• Les méthodes modernes de planification familiale sont plus utilisées. (Objectif selon l’indicateur de phase 1.1. : « Augmentation du taux d'utilisation des mé-thodes modernes de planification familiale : dans la région Sud-Ouest de 10,3 % (2005) à 14%, dans la région Est de 3,8 % (2005) à 6,2 % »
• Le nombre d’adolescents qui bénéficient des services relatifs à la santé re-productive des adolescents est en hausse. (Objectif selon l’indicateur de phase 1.2. : « Doublement du nombre des filles et garçons (15-24 ans) qui utilisent les services de SR des jeunes (2005 dans la région Sud-Ouest : 3.075 ; dans la ré-gion Est : 634 utilisateurs »).
• La grande majorité des utilisatrices/utilisateurs a une opinion positive de la qua-lité des prestations. (Objectif selon l’indicateur de phase 1.3. : « Évaluation po-sitive des prestations de service de SR par au moins 80% des jeunes utilisa-teurs/utilisatrices »)
• La proportion d’adolescents et de jeunes adultes qui disposent de connaissan-ces suffisantes pour se protéger d’une infection par le VIH est en hausse. (Ob-jectif selon l’indicateur de phase 1.4 : »Augmentation de la proportion des filles et garçons (15-24 ans) de la zone d'intervention qui disposent de connaissan-ces suffisantes sur la protection contre une infection au VIH (2006 Est 53 %; Sud-Ouest 55 % ; objectif : 75 % »).
À l’horizon 2015 : • La prévalence contraceptive augmente. (Objectif selon indicateur 1 : de 10,3 %
à 18 % dans le Sud-Ouest et de 3,8 % à 10 % dans l’Est.)
13
• Le recours à des services adaptés aux adolescents contribue à la diminution de la prévalence du VIH/SIDA, particulièrement chez les adolescents et les jeunes adultes. (Objectif selon l’indicateur 2 : baisse de la prévalence chez les femmes de la tranche d’âge 15 à 24 ans de 5,4 % à moins de 2 % dans le Sud-Ouest et de 2,3 % à moins de 1 % dans l’Est. Cet indicateur se rapporte aussi aux autres secteurs d’activité du projet.)
Résultat indirect (impact) :
Le nombre de grossesses dans la vie d’une femme diminue. Il est de plus en plus possible d’éviter les grossesses non désirées. Le nombre d’interruptions volontai-res de grossesse diminue. Il en résulte une baisse de la mortalité infantile et de la mortalité maternelle. La prévalence du VIH/SIDA et d’autres maladies sexuelle-ment transmissibles baisse. Le recul du taux de natalité, le ralentissement de la croissance démographique, l’abaissement du taux de mortalité des jeunes adultes et l’amélioration de la structure démographique font partie des autres conséquen-ces. (Résultat indirect)
À long terme, le projet contribue à réduire la pauvreté, renforcer le statut social des femmes et diminuer la pression sur les ressources naturelles. (Impact)
Secteur d’activité : mainstreaming (prise en compte généralisée) du VIH/SIDA
La prévalence du VIH/SIDA diminue nettement depuis quelques années. En 2001, ONUSIDA es-timait qu’elle s’élevait à 6,5 % pour l’ensemble des adultes. Pour l’année 2006, l’estimation se situe autour de 2,0 %26. Pour les femmes de la classe d’âge de 15 à 24 ans, elle s’élevait à 1,7 % en 2005 et à 1,4 % en 2006.27 Toutefois, le véritable recul a été plus lent que les chiffres ne semblent l’indiquer. Jusqu’en 2002, les estimations se rapportaient presque exclusivement à des enquêtes effectuées dans les villes, si bien que les zones rurales à faible prévalence n’étaient pas suffisam-ment prises en compte.
Le projet se concentre ici sur le groupe cible des adolescents et jeunes adultes (voir ci-dessus) et sur la prise en compte généralisée du sida dans le cadre de la coopération au développement (CD) allemande.
Chaîne des résultats : mainstreaming du VIH/SIDA
Activités : • Les équipes des programmes sont conseillées durant l’analyse de la problé-matique du sida dans leur domaine d’intervention.
• Les équipes des programmes sont soutenues en permanence au moyen d’informations pour mettre au point et réaliser des mesures de lutte contre le sida adaptés à leurs groupes cibles.
• Les équipes des programmes reçoivent des supports didactiques pour la ré-alisation de leurs mesures de lutte contre le sida.
Produits : • Le concept « Mainstreaming de la lutte contre le sida » est ancré dans les pro-grammes de la CD allemande.
26 ONUSIDA/OMS 2006 27 Enquêtes par échantillonnage effectuées parmi les sites sentinelles par les femmes enceintes
14
Utilisation : • Les programmes intervenant dans ces pôles d’intervention prioritaires que sont l’agriculture, la décentralisation ou l’eau intègrent des mesures de lutte contre le sida dans leurs chaînes des effets.
• Les programmes réalisent des mesures de lutte contre le sida pour les groupes cibles.
Résultat direct :
• L’approche multisectorielle du programme national de lutte contre le sida est renforcée.
• Le risque dû au VIH/SIDA pesant sur les collaboratrices/collaborateurs et les groupes cibles des programmes sectoriels de développement diminue.
• Avec le recul de la prévalence du VIH/SIDA dans les groupes cibles spécifi-ques, les risques pesant sur la réalisation des objectifs des programmes dimi-nuent.
• Les membres séropositifs des groupes cibles sont protégés de la discrimination. Leur accès à un traitement efficace est facilité.
• Avec d’autres secteurs d’activité du projet, ce secteur d’activité contribue à ce que la proportion d’adolescents et de jeunes adultes qui disposent de connais-sances suffisantes pour se protéger d’une infection par le VIH soit en hausse. (Objectif selon l’indicateur de phase 1.4, atteindre au moins 75 %.)
Horizon 2015 : • Le secteur d’activité contribue à la diminution de la prévalence du VIH/SIDA,
particulièrement chez les adolescents et les jeunes adultes. (Objectif selon l’indicateur 2 : baisse de la prévalence chez les femmes de la tranche d’âge 15 à 24 ans de 5,4 % à moins de 2 % dans le Sud-Ouest et de 2,3 % à moins de 1 % dans l’Est. Cet indicateur se rapporte aussi aux autres secteurs d’activité du projet.)
Résultat indirect (impact) :
• La prévalence du sida diminue dans les régions d’intervention prioritaire de la CD allemande.
Secteur d’activité : promotion des droits des femmes
Très peu de femmes savent que l’État leur garantit de nombreux droits. Même celles qui connais-sent leurs droits n’ont souvent pas la possibilité de les faire valoir en cas de refus. Elles ne connaissent ni les instances compétentes, ni les règles à respecter. De plus, bien souvent, elles n’ont ni les moyens ni la possibilité d’intenter une action en justice. Les femmes qui osent faire ap-pel à des personnes extérieures en cas de conflit au sein de la famille doivent s’attendre à être ex-clues de l’unité familiale. Seules les femmes qui n’ont plus rien à perdre acceptent de prendre ce risque. En effet, les instances traditionnelles de conciliation (pour autant qu’elles existent encore), telles que les conseils des anciens du village ou les forgerons, peuvent certes régler certains conflits en faveur des femmes, elles ne porteront jamais atteinte au statut traditionnel de la femme dans la famille et leurs jugements seront souvent contraires aux lois en vigueur. Dans de nom-breux cas, même les collaborateurs des structures étatiques et communales chargés de défendre les droits des femmes ne connaissent pas les lois quand ils ne les bafouent pas délibérément. Il arrive même que certains passent du côté des coupables.
Il n’existait pas d’informations fiables sur l’ampleur et les formes de la violence contre les femmes, sur l’attitude des personnes concernées et sur les possibilités d’obtenir une protection.
15
C’est pourquoi le projet a commandité une étude qualitative et quantitative dans les deux régions d’intervention prioritaire.28
L’étude a révélé que 73 % des femmes de la région du Sud-Ouest et 71 % des femmes de la région de l’Est connaissaient des cas de violence contre des femmes de leur entourage personnel. Dans le Sud-Ouest, 37 % des femmes interrogées avaient subi des violences ; dans l’Est, 30 %.
La proportion des femmes qui rejettent la violence contre les femmes s’élevait à 86 % dans le Sud-Ouest et à 88 % dans l’Est. Parmi les hommes, ces pourcentages s’élevaient à 76 % dans le Sud-Ouest et 75 % dans l’Est. Dans l’Est, 7 % des hommes approuvaient expressément la vio-lence contre les femmes même vis-à-vis de l’enquêteur, alors qu’ils n’étaient que 3 % à le faire dans le Sud-Ouest.
Le principal lieu où s’exerce la violence est la famille : Les auteurs d’actes de violence étaient principalement les conjoints (dans 78 % des cas dans l’Est, dans 62 % des cas dans le Sud-Ouest) et d’autres personnes de la famille (28 % dans l’Est, 25 % dans le Sud-Ouest).
Le projet aide les partenaires burkinabè à faire en sorte que - Les femmes connaissent leurs droits fondamentaux : En collaboration avec le Ministère de l’Action sociale et le Ministère de la Promotion de la Femme, le projet a élaboré et testé des supports d’information grâce auxquels les associations féminines et des assistantes sociales améliorent leur travail d’information auprès des femmes ; une pièce de théâtre a été créée et plusieurs compagnies de théâtre ont été formées à la technique du théâtre forum . Les stations de radio locales ont créé des émissions en langue locale et les diffusent. Des collaboratrices du Ministère de l’Action Sociale, du Ministère de la Promotion de la Femme et des associations féminines ont suivi des cours pour devenir formatrices.
- Les femmes aient accès à des services de conseil : Il s’agissait ici de trouver une approche qui tienne compte d’une situation socioculturelle complexe avec ses conflits d’intérêts et ne mette pas les femmes en danger.
Après des entretiens avec les représentants des autorités, les leaders d’opinion dans les villa-ges et les représentantes des associations féminines, le concept des conseillères juridiques ccommunautaires.a été mis au point.. Des membres d’associations féminines sont sélectionnés et formés afin d’être en mesure de conseiller les femmes. Elles sont guidées par des assistantes so-ciales du Ministère de l’Action Sociale qui peuvent fournir un conseil plus approfondi si nécessaire. Les leaders d’opinion, qui représentent l’instance traditionnelle de conciliation, reçoivent une in-formation complète sur les droits fondamentaux des femmes et le rôle des conseillères juridiques ccommunautaires et ils sont invités à participer aux actions.
- Les femmes soient traitées correctement par les autorités : Le projet ne peut avoir qu’une influence limitée sur les agents des services de l’État (police, gen-darmerie, préfecture), car généralement ils ne restent pas longtemps en poste au même endroit. De ce côté-là, l’information et la formation sont des tâches à reprendre en permanence. Quand les femmes veulent s’adresser à de telles instances, des conseillères bénévoles jouent le rôle d’intermédiaires (avec l’appui du projet) pour établir le contact avec les assistantes sociales et as-sistants sociaux du Ministère de l’Action Sociale.
Chaîne des résultats : promotion des droits des femmes
Activités : • Des supports didactiques concernant les droits des femmes, la violence contre les femmes et les mutilations génitales féminines sont rédigés, produits et mis à la disposition des actrices.
28 CERFODES (équipe - Yaro et al.) 2007 ; cf. aussi l’annuaire statistique du programme : Congo/HeulerNeuhaus, (réd.), 2007
16
• Les membres des ONG qui accomplissent un travail de sensibilisation bénéfi-cient de formations concernant les droits des femmes, la violence contre les femmes, les mutilations génitales féminines et les techniques de communica-tion.
• Une approche de « communication familiale » est élaborée en collaboration avec les services de l’État, les ONG et les associations féminines.
• Des membres d’ONG et d’associations féminines sont formés à la technique de la « communication familiale ».
• En collaboration avec les services de l’État, les magistrats et les associations féminines, un concept est mis au point pour que des conseillères juridiques communautaires fournissent un conseil aux femmes .
• Les conseillères juridiques communautaires sont formées et pourvues des supports didactiques nécessaires.
Produits : • Des acteurs/actrices de la communication pour le changement de comporte-ment (CCC) qui sont qualifiés pour fournir un travail de sensibilisation de qua-lité en ce qui concerne les droits des femmes, la violence contre les femmes, les mutilations génitales féminines et l’éducation scolaire des filles.
• Des acteurs/actrices qui sont qualifiés pour l’approche « communication fami-liale ».
• Des conseillères juridiques communautaires formées.
Utilisation : • Les services de l’État, les ONG et les associations féminines proposent aux femmes, hommes, adolescents et enfants de leurs zones d’action des informa-tions de qualité sur les droits des femmes, la violence contre les femmes, les mutilations génitales féminines et l’éducation scolaire des filles.
• Les ministères compétents et autres structures adoptent les supports didacti-ques mis au point.
• Avec l’appui des services de l’État, les ONG adoptent l’approche « communication familiale » dans leur répertoire d’actions de communication visant à changer les comportements.
• Les femmes victimes d’actes de violence ou dont les droits sont violés s’adressent à des conseillères bénévoles
• Les conseillères juridiques communautaires orientent les femmes qui veulent intenter une action en justice vers les assistantes sociales et assistants so-ciaux du Ministère de l’Action Sociale.
Résultat direct :
• Les femmes, les hommes, les adolescents et les leaders d’opinion sont mieux informés sur les droits des femmes, la violence contre les femmes, les mutila-tions génitales féminines et l’éducation scolaire des filles.
• Dans les villages d’intervention prioritaire, la proportion d’hommes et de fem-mes qui connaissent les droits fondamentaux des femmes et qui les acceptent est en augmentation. (Objectif selon l’indicateur de phase 2.1. : augmentation de 50 %.)
• Les couples échangent leurs idées sur les questions de sexualité, de planifi-cation familiale, d’éducation scolaire pour leurs enfants et peuvent prendre des décisions sur la base d’informations.
• La proportion d’hommes qui condamnent la violence domestique contre les femmes augmente dans les villages d’intervention prioritaire. (Objectif selon l’indicateur de phase 2.2., atteindre au moins 85 %.)
• La proportion moyenne de filles augmente dans les six classes de l’école pri-
maire. (Objectif selon l’indicateur de phase 2.3., atteindre au moins 48 %.)
17
Horizon 2015 : • Le taux de fréquentation scolaire des filles augmente. (Objectif selon
l’indicateur 4 : augmenter d’au moins 50 %.) • La proportion de filles qui abandonnent l’école avant le CM2 recule. (Objectif
selon l’indicateur 4 : recul d’au moins un tiers.)
Résultat indirect (impact) :
• Les femmes exercent leurs droits sans entraves. • Les femmes participent aux décisions dans la famille et la communauté. • Les femmes et les hommes règlent leurs conflits de façon non violente. Les
hommes et les femmes respectent les droits de l’autre sans discrimination sexuelle.
• Les rapports sociaux évoluent dans le sens de l’égalité des sexes.
Secteur d’activité : abandon des mutilations génitales féminines (MGF)
Dans le débat sur l’abandon des MGF, on a tendance d’ordinaire à négliger le fait que les groupes ethniques et sociaux qui les pratiquent « traditionnellement » n’ont pas de justification philosophi-que, métaphysique ou religieuse de cette pratique. Comme chez presque tous les peuples d’Afrique de l’Ouest où les MGF sont pratiquées « traditionnellement » ou l’ont été, il existe, dans les groupes ethniques des deux régions du programme, des villages ou unités familiales dans les-quels les filles ne sont pas excisées, là aussi « conformément à la tradition ». C’est même le cas chez les Dogons (au Mali et dans le Nord du Burkina Faso), qui sont un des rares peuples ouest africains où une justification à caractère métaphysique et religieux de l’excision est connue.
Même les familles qui appartiennent à un même groupe ethnique ayant une religion tradition-nelle commune peuvent avoir des attitudes différentes vis-à-vis de l’excision. Les familles qui font exciser leurs filles le justifient par le fait que leurs ancêtres ont pratiqué l’excision depuis toujours ou (comme chez les Moose) depuis un moment historique précis. Les familles qui ne font pas ex-ciser leurs filles le justifient généralement par le fait que leurs ancêtres n’ont jamais pratiqué l’excision ou ont cessé de le faire à partir d’un certain moment historique (p. ex. parce que l’excision a entraîné la mort de filles).
La coutume et la religion divergent considérablement, la coutume correspondant au niveau de la famille étendue ou au niveau local, tandis que la religion se situe au niveau du groupe ethnique (ou même de plusieurs groupes ethniques). Cette divergence s’explique par les processus histori-ques de sédimentation. Les différents groupes ethniques et sociaux qui ont immigré successive-ment dans un territoire donné (soit pacifiquement, soit par la conquête) ont eu tendance à rappro-cher leurs usages religieux et culturels, mais ont aussi négocié au niveau local – selon les lieux et les rapports de force – des règles concernant la coexistence immédiate, aboutissant ainsi à des résultats différents.
Si trois différents groupes A, B, C, dont A n’a jamais pratiqué l’excision29 jusque-là se retrou-vent dans trois unités locales avec des rapports de forces différents, il peut se produire que le groupe A impose sa règle aux groupes B et C dans un village et qu’il se soumette à la règle de B et C (pratique de l’excision) dans les deux autres villages. Il va de soi que les sanctions ne peuvent s’appliquer qu’au niveau où la règle est en vigueur.
Les résultats de l’EDS-III de 2003 (INSD/ORC MACRO 2004b) confirment cet argument. En effet la base de données de l’étude révèle, par exemple, qu’en 2003, 21 % des femmes lobi adhé-
29 Nous utilisons ici et par la suite le terme « excision » pour désigner les « mutilations génitales féminines » parce que c’est la forme de MGF la plus répandue au Burkina Faso. En outre, « excision » s’est imposé comme terme générique dans l’usage linguistique du mouvement burkinabè contre les MGF. Le comité national s’appelle : Comité national de lutte contre la pratique de l’excision.
18
rant à la religion traditionnelle nées avant 1973 (et qui avaient donc dépassé l’âge de l’excision au début du mouvement contre les MGF) n’étaient pas excisées, ce qui correspond approximative-ment à la moyenne burkinabè (femmes adhérant à la religion traditionnelle) de 21,5 %.
Au début de la remise en question de l’excision, le seul argument avancé dans les villages était : la tradition. En moré, la coutume/tradition s’appelle « rog-n-miki », qui signifie « être né(e) /trouver/voir/savoir », soit « ce que l’on a trouvé en venant au monde ». Dans les discussions, no-tamment au niveau des collaboratrices et collaborateurs des établissements de santé, certains participants ont affirmé que la tradition avait force de loi.
Toutefois, c’est plutôt dans les « entretiens confidentiels » que l’on avoue que l’enjeu véritable est la maîtrise de la sexualité de la femme et cette idée est avancée plutôt par les femmes que par les hommes. Monique Ilboudo (1999 : 169) cite la déclaration d’un accusé lors d’un procès : « C’est pour les tenir tranquilles ! ».
C’est surtout depuis que la discussion s’est orientée vers une interdiction légale de l’excision – qui ôtait pratiquement toute force de loi à la tradition – que les partisans de l’excision ont com-mencé à utiliser des arguments d’ordre religieux. S’ils tentaient de trouver une justification reli-gieuse à l’excision (que ce soit dans le contexte des religions traditionnelles ou dans le contexte de l’islam), c’était déjà parce qu’ils comprenaient que l’argument de la tradition ne suffisait pas pour emporter la conviction dans le débat social concernant l’interdiction de l’excision. Dès le début, d’importantes autorités religieuses ont réfuté ces arguments des partisans de l’excision.
Au Burkina Faso et dans les régions d’intervention du programme, il n’est pas judicieux d’adopter une tactique du rituel de substitution comme cela se fait dans d’autres pays, puisque les MGF ne sont pas pratiquées dans le cadre de rites religieux.30
Dans les sociétés traditionnelles, la décision se limite à l’alternative suivante :
nous faisons exciser nos filles (conformément à notre tradition) ou :
nous ne faisons pas exciser nos filles (conformément à notre tradition).
On ne connaît pas de rituels de substitution, car l’excision est déjà elle-même une action de substitution. Dans les premières phases de la discussion, l’ancien président, Thomas Sankara, a placé ce fait au cœur de sa position :
« L’excision c’est aussi dans le subconscient, la marque physique que l’on fait sur un animal pour lui rappeler les limites de son droit au plaisir. De son droit à la vie. Celui qui peut décider l’excision n’est pas très loin de décider du droit de vie ou de mort sur la personne. » 31
L’excision est un acte qui marque la soumission de la femme, son conditionnement et sa ré-duction à sa fonction de génitrice. On ne peut pas envisager de sanctionner la soumission de la femme par un rituel modifié, un rituel de substitution, il s’agit plutôt de remettre en question l’acte même de soumission de la femme.
Pour obtenir ce résultat à long terme, il est nécessaire de négocier de nouvelles règles et cela aux niveaux où l’excision est considérée comme une règle traditionnelle. Pour que cette négocia-tion soit possible, il est nécessaire de renforcer le statut social des femmes et des filles et il faut que les hommes se montrent ouverts à un changement dans ce domaine. Si elle est utilisée à bon escient, l’interdiction de l’excision peut constituer un atout lors de la renégociation des règles.
Le principal niveau où se déroule la confrontation est l’unité familiale. La création d’une opinion publique qui se prononce contre les MGF (par un travail de sensibilisation et de persuasion et par une interdiction légale) renforce les actrices et acteurs qui sont prêts à abandonner cette pratique au sein de l’unité familiale.
Il ne fait aucun doute que la lutte menée depuis plusieurs décennies contre les MGF au Bur-kina Faso commence à porter des fruits. Le sujet est traité en public comme dans aucun autre pays ouest africain. Il est intégré aux programmes scolaires. Les exciseuses surprises en flagrant délit encourent une peine d’emprisonnement.
Une faiblesse de l’EDS III de 2003 réside dans le fait qu’elle ne fournit pas de données sur les filles âgées de moins de 15 ans. L’étude se rapportait donc uniquement aux femmes qui avaient
30 L’étude de prévalence du printemps 2005 montre que l’idée d’un rituel de remplacement ne s’est pas répandue parmi les jeunes de 15 à 24 ans. 31 Cité ici d’après Bendré, nº 413 du 16 octobre 2006.
19
déjà au moins dix ans au moment de l’interdiction des MGF. C’est pour cette raison qu’à la fin de 2005, le projet a commandité une enquête représentative qui a été menée dans la région du Sud-Ouest et s’est concentrée particulièrement sur la classe d’âge de 5 à 14 ans en prenant aussi en compte les filles de moins de 5 ans. Même si la prévalence des MGF reste bien trop élevée (la moitié des filles de 14 ans étaient concernées), les résultats de l’étude font apparaître un recul net.
Le graphique ci-après compare la prévalence observée dans les générations nées en 1991-2005 à celle à laquelle on aurait pu s’attendre si la prévalence n’avait pas changé (d’après les données de l’EDS de 2003 pour la cohorte 198132). On se réjouira particulièrement d’observer que la prévalence était inférieure à 10 % dans les cohortes 2003-2005 (filles de moins de 3 ans), alors qu’elle se situait encore entre 30 % et 40 % 20 ans plus tôt.
Graph. 4 MGF – prévalence parmi les filles de la tranche d’âge de 0 à 14 ans
(cohortes 1991-2005) dans la région du Sud-Ouest, fin 2005 (prévalence attendue d’après les données de la cohorte 1981 et prévalence
effectivement observée
Après l’interdiction des MGF en 1996, nombreux sont ceux qui ont exprimé la crainte que l’âge de l’excision tende à baisser du fait que l’excision s’effectuait de plus en plus clandestinement. Heu-reusement, ces craintes se sont révélées infondées. La troisième EDS de 2003 montre déjà que, parmi les femmes excisées de la classe d’âge 14 à 49 ans, 41 % l’ont été durant la première an-née de vie, tandis que parmi les filles excisées de ces femmes, 28 % l’avaient été pendant la pre-mière année de vie. On notera que les filles sont excisées dans une proportion nettement moins élevée que leurs mères.
32 Calculé sur la base des données de l’EDS III (fichier BFIR41RT.SAV).
20
Dans la région du Sud-Ouest, 33,2 % des femmes de la génération 1981 étaient déjà excisées à la fin de la première année de vie, ce qui n’était le cas que pour 2,2 % des filles de la génération 2005.
Outre les filles concernées elles-mêmes, le groupe cible le plus important est constitué par les unités familiales. L’approche principale est une action au niveau de la famille.
Une deuxième approche est l’intégration du sujet à l’enseignement scolaire. Cette approche a été testée avec succès par le projet sectoriel de la GTZ « appui aux initiatives pour l’abandon des mutilations génitales féminines » avec la Direction des questions de population du Ministère de l’Enseignement Supérieur.
Le projet soutient les directions régionales chargées de l’enseignement primaire et supérieur dans les deux régions d’intervention prioritaire pour le lancement d’initiatives dans d’autres écoles, met le matériel didactique à disposition, implique des compagnies théâtrales et organisations fémi-nines locales dans le travail de sensibilisation et appuie les structures régionales du comité natio-nal contre l’excision dans l’accompagnement technique de toutes les activités.
Pour avancer, il était important d’obtenir l’assentiment des parents, car sinon la scolarisation des filles aurait pu être mise en danger. C’est pourquoi l’introduction du sujet dans les écoles est accompagnée d’actions d’information à l’intention des parents et des familles vivant à proximité des écoles : projections de films, représentations théâtrales suivies d’un débat. Il faut également convaincre les enseignants d’adopter une attitude positive dans l’ensemble avant que certains d’entre eux suivent une formation portant sur l’utilisation du module d’enseignement concernant les mutilations génitales. Les réunions d’enseignants s’y prêtent bien.
Cette approche produit un effet double : d’une part, la future génération de parents rejettera les mutilations génitales féminines et, d’autre part, les élèves qui ont participé à cet enseignement pourront remarquer que l’excision d’une petite sœur se prépare dans la famille et tenter de s’y op-poser (par exemple en alertant une institutrice ou les membres d’une association). Des excisions ont ainsi pu être évitées dans plusieurs cas documentés.
L’intégration à l’enseignement scolaire n’est qu’une des approches soutenues par le projet, car ses effets se feront sentir surtout à long terme. Il faut aussi s’adresser aux adultes pour protéger les filles des mutilations génitales. Le projet essaie ici de mettre l’accent sur les groupes sociaux qui défendent la pratique des mutilations génitales féminines de manière ouverte ou voilée. Il n’est pas question ici d’appliquer une stratégie prédéfinie, il faut savoir nouer un contact avec ces per-sonnes, connaître leurs arguments et présenter des arguments contraires convaincants. Un de ces « pieds dans la porte » est, par exemple, la coopération avec un groupe de leaders d’opinion de la province du Ioba, qui a retenu un certain nombre de problèmes, notamment les mutilations géni-tales féminines, dont il veut débattre avec les habitants. Le projet encourage la coopération de ce groupe avec la direction provinciale du Ministère de l’Action Sociale et fournit une assistance-conseil à ce groupe.
Chaîne des résultats : abandon des mutilations génitales féminines (MGF)
Activités : • Des supports didactiques concernant les droits des femmes, la violence contre les femmes et les mutilations génitales féminines sont rédigés, produits et mis à la disposition des actrices.
• Les membres des ONG qui accomplissent un travail de sensibilisation bénéfi-cient de formations concernant les droits des femmes, la violence contre les femmes, les mutilations génitales féminines et les techniques de communica-tion.
• Des membres d’ONG et d’associations féminines sont formés à la technique de la « communication familiale ».
• Les enseignants des établissements primaires et secondaires suivent des uni-tés de formation consacrées aux mutilations génitales féminines.
21
Produits : • Des acteurs/actrices d’actions de communication destinées à modifier les com-portements, ces personnes étant qualifiées pour fournir un travail de sensibili-sation de qualité en ce qui concerne les droits des femmes, la violence contre les femmes, les mutilations génitales féminines, l’éducation scolaire des filles.
• Des acteurs/actrices sont qualifiés pour l’approche « communication familiale ». • Les collaboratrices et collaborateurs des deux ministères de l’éducation, les
enseignant(e)s des écoles primaires et secondaires sont capables de mettre en œuvre et diffuser l’approche scolaire.
Utilisation : • Les services de l’État, les ONG et les associations féminines proposent aux femmes, hommes, adolescents et enfants de leurs zones d’action des informa-tions de qualité sur les droits des femmes, la violence contre les femmes, les mutilations génitales féminines et l’éducation scolaire des filles.
• Avec l’appui des services de l’État, les ONG adoptent l’approche « communication familiale » dans leur répertoire d’actions de communication vi-sant à changer les comportements.
• Les deux ministères de l’éducation mettent l’approche scolaire des MGF en œu-vre dans de nouvelles écoles.
• D’autres donateurs s’intéressent à cette approche et soutiennent sa mise en œuvre dans d’autres écoles.
Résultat di-rect :
• Les femmes, les hommes, les adolescents et les leaders d’opinion sont mieux informés sur les droits des femmes, la violence contre les femmes, les mutila-tions génitales féminines et l’éducation scolaire des filles.
• Les couples échangent leurs idées sur les MGF, les questions de sexualité, de planification familiale, d’éducation scolaire pour leurs enfants et peuvent pren-dre des décisions sur la base d’informations.
• Les enfants dont l’enseignement inclut des modules relatifs aux MGF parlent des effets nocifs des MGF avec leurs familles et les autres enfants.
• La proportion moyenne de filles augmente dans les six classes de l’école pri-maire. (L’objectif selon l’indicateur de phase 2.3., atteindre au moins 48 %, se rapporte aussi aux autres secteurs d’activité du projet.)
• La proportion d’élèves, de femmes et d’hommes qui se prononcent contre les MGF et sont capables de justifier leur position est en augmentation. (Indicateur de phase 2.4.)
Horizon 2015 : • La prévalence des MGF diminue nettement. (Objectif selon l’indicateur 3 : parmi
les filles de la tranche d’âge de 5 à 14 ans, elle diminue d’au moins un tiers pour tomber à 29,5 % dans le Sud-Ouest et à 23,7 % dans l’Est.)
Résultat indirect (impact) :
• Les violences contre les femmes diminuent dans les familles. • Les femmes et les hommes règlent leurs conflits de façon non violente et
respectent les droits. • Le taux de la fréquentation scolaire des filles augmente, ainsi que celui des gar-
çons.
22
Secteur d’activité : lutte contre le trafic des enfants et les pires formes du travail des enfants
Toute réflexion sur les problèmes du travail des enfants, les pires formes de travail des enfants et le trafic des enfants dans les deux régions du programme se heurte à certaines questions fonda-mentales auxquelles il n’est pas facile de répondre :
Où finit l’enfance dans les régions où tous les adolescents âgés de moins de 18 ans sont considérés légalement comme des enfants, mais où la majorité des enfants âgés de 6 à 14 ans sont économiquement actifs (1996), où la majorité des enfants n’ont jamais été scolarisés et où l’âge moyen du mariage des femmes oscille entre 14,9 ans (Est) et 18,9 ans (Sud-Ouest) ? Où commence le travail des enfants dans un tel contexte et à partir de quand peut-on parler de ses pires formes ?
L’Organisation internationale du travail (OIT) établit une distinction entre « child work » et « child labour ». Dans le premier cas, il s’agit d’une forme d’activité enfantine qui contribue à la socialisation et à l’éducation de l’enfant (par exemple quand les parents transmettent certaines connaissances agricoles ou compétences artisanales aux enfants). Cette activité doit occuper un temps raisonnable par rapport au temps libre et elle ne doit, dans les conditions actuelles, ni em-pêcher la scolarisation de l’enfant, ni mettre sa réussite en question. Le « child labour » en revan-che se rapporte aux enfants qui sont obligés de mener avant l’heure la vie d’un adulte, travaillent du matin au soir pour un salaire dérisoire et dont la santé et le développement psychique et mental sont menacés par la dureté et la durée du travail ainsi que par les conditions dans lesquelles il est effectué. Il est certainement difficile de tracer une limite nette, d’autant plus qu’une partie impor-tante du travail des enfants se déroule dans les unités familiales et que les personnes qui en bé-néficient le considèrent comme un droit traditionnel. De plus, la population n’a souvent guère conscience que des relations traditionnelles de solidarité – développées dans l’intérêt mutuel et à l’avantage de chacun – ont dégénéré en relations d’exploitation plus ou moins dissimulées.
Il est possible de tracer une limite à partir du droit à l’éducation. En effet, le travail des enfants a des conséquences d’autant plus importantes pour la vie ultérieure qu’il rend la scolarisation im-possible. On peut en déduire que la démarche à adopter serait de lutter non pas contre le travail des enfants en soi (ce combat devrait se concentrer sur les pires formes du travail des enfants et le trafic d’enfants), mais de lutter pour le droit à une éducation scolaire appropriée. Pour faire valoir ce droit, il ne suffit pas que les parents et le reste de la famille soient prêts à permettre à leurs en-fants (filles comme garçons) d’aller à l’école, il faut également œuvrer pour l’amélioration du sys-tème scolaire et un développement économique et social tel que les personnes formées puissent trouver une place dans la société.
La région du Sud-Ouest est en tête de toutes les régions burkinabè en ce qui concerne la mi-gration intérieure et extérieure des enfants travailleurs. La région de l’Est est dans les premières places en ce qui concerne l’émigration transfrontalière des enfants travailleurs, mais contribue dans une moindre mesure au flux qui se dirige vers les grandes villes burkinabè.
Quels sont les facteurs qui favorisent ou renforcent l’extension du trafic des enfants et des pires formes de travail ?
1. L’obligation pour les enfants (à partir de l’âge de 6 ans) de travailler dans le cadre de l’économie domestique ou paysanne, particulièrement si elle exclut l’éducation scolaire, crée un marché po-tentiel pour le travail des enfants. Cette obligation a ses racines dans l’économie paysanne tradi-tionnelle caractérisée par de longues pauses et de courtes périodes de travail très intense durant lesquelles toute la main-d’œuvre est nécessaire. Autrefois, ces obligations s’inséraient dans des formes traditionnelles, souvent justifiées religieusement, de la division du travail qui en fixaient les limites, or ces formes traditionnelles ont souvent disparu aujourd’hui. Une part excessive du travail social est imposée aux enfants. Ce phénomène est dû à différentes évolutions : dégradation des sols, changement des méthodes de production (particulièrement en cas de cultures commerciales) et émergence d’une structure démographique caractérisée par la baisse tendancielle de la propor-tion d’adultes en âge de travailler.
23
2. Selon qu’ils sont filles ou garçons ou selon leur degré de parenté avec le chef de famille au sein d’une ferme, les enfants ont une charge de travail plus ou moins importante. Il en résulte une iné-galité des chances d’accès à la scolarité. De nombreux enfants subissent ouvertement des rap-ports d’exploitation dans le cadre de la famille. Pour échapper à la dépendance, beaucoup d’entre eux cherchent leur salut dans l’émigration de travail. Aussi, il arrive dans de nombreux cas que les parents et le reste de la famille apprennent après coup qu’un enfant a quitté la ferme.
3.
Le système de la migration circulaire, qui avait commencé sous la contrainte coloniale, est devenu une tradition sociale depuis les années 1960 et 1970 et exerce une grande attraction sur les en-fants. Il constitue un instrument aux mains de ceux qui profitent du trafic des enfants sous ses dif-férentes formes.
4.
Le comportement des enfants travailleurs qui rentrent chez eux a un effet amplificateur. Au lieu de raconter ce qui leur est arrivé et de prévenir les plus jeunes, ils ont tendance à utiliser le peu qu’ils ont rapporté (p. ex. vêtements, bijoux fantaisie, radiocassette, peut-être un vélo, de l’argent) pour acquérir un certain prestige dans le village.
5.
Il est ancré dans la tradition de confier ses propres enfants à des parents ou à des amis économi-quement mieux lotis pour assurer leur éducation ou leur formation. Cette tradition s’est elle aussi déformée, notamment à cause de la grande disparité de richesse entre la ville et la campagne. Dans de nombreux cas, elle est devenue un instrument d’exploitation des enfants. Les membres de la famille établis en ville, qui utilisent les enfants comme une main-d’œuvre bon marché et en abusent même au-delà, invoquent leur droit à exiger un enfant vis-à-vis des membres de la famille restés au village. Souvent, les parents des enfants ne savent pas dans quelles conditions leurs enfants vivent en ville.
6.
Une facteur contribuant largement à affaiblir la position des jeunes dans le village est le fait que ce sont les hommes âgés qui contrôlent les relations de mariage.
7.
Un facteur facilitant réside dans la faiblesse du système public d’éducation.
8.
Les lacunes des institutions publiques et la corruption des fonctionnaires laissent particulièrement la porte ouverte aux formes plus ou moins organisées du trafic des enfants.
9.
La migration des adolescents et des jeunes adultes et les pires formes de travail des enfants se favorisent et se renforcent mutuellement.
Les facteurs antagonistes pourraient être :
1.
La mise en application croissante du droit à la scolarisation, notamment des filles.
2.
L’amélioration du statut social des enfants et des adolescents dans le village, p. ex. par la trans-formation de regroupements spécifiques de certaines classes d’âge en associations d’entraide et une représentation appropriée dans les structures villageoises d’auto-administration.
3.
Le renforcement de la position des filles et des femmes en matière de mariage. (Droit à une sexualité autodéterminée, élévation de l’âge du mariage, diffusion du mariage civil.)
4.
La création de conditions économiques qui favorisent ou encouragent les adolescents et jeunes adultes à s’autonomiser.
24
Chaîne des résultats : lutte contre le trafic des enfants et les pires formes du travail des enfants
Activités : • Les communes et les communautés villageoises bénéficient d’un appui pour créer des comités de lutte contre le trafic des enfants et l’exploitation des en-fants.
• Les supports didactiques concernant les droits des enfants, le trafic des enfants et l’exploitation des enfants sont conçus, produits et mis à la disposition des acteurs chargés des opérations de communication visant à faire évoluer les comportements.
• Les actions de formation destinées aux femmes devant intervenir dans les opérations de communication visant à faire évoluer les comportements sont mi-ses au point et réalisées.
• Une aide est fournie aux collaborateurs des services des Ministères de l’Action Sociale et du Travail et aux acteurs communaux et privés pour révéler le trafic d’enfants, mettre les enfants concernés en sécurité et les rendre à leurs famil-les.
• Une aide est fournie aux acteurs étatiques, communaux et privés pour prendre des mesures efficaces de prévention : scolarisation, formation professionnelle, microcrédits pour des activités créatrices de revenus.
• Les ministères concernés sont soutenus au niveau central et décentralisé dans les actions visant à mettre en place un système de planification, suivi et évalua-tion.
• Avec le concours d’autres donateurs, les services étatiques décentralisés sont soutenus dans la coordination de toutes les actions menées contre le trafic d’enfants et l’exploitation des enfants.
Produits : • Des actrices et acteurs compétents pour réaliser les actions de communication visant à modifier le comportement, promouvoir les droits des enfants et lutter contre le trafic d’enfants et l’exploitation des enfants.
• Mesures efficaces pour prévenir le trafic d’enfants et l’exploitation des enfants, assister les victimes et les réinsérer dans leurs familles.
• Un système opérationnel de planification, suivi et coordination sur le trafic d’enfants et l’exploitation des enfants.
Utilisation : • Les groupes cibles de la population et les leaders d’opinion et décideurs locaux manifestent de l’intérêt pour les droits des enfants, le trafic d’enfants, l’exploitation des enfants et participent aux activités de sensibilisation.
• Les services étatiques coopèrent avec les acteurs des actions de communica-tion pour élaborer des opérations de communication efficaces et les pérenniser.
• Les services étatiques assistent les enfants victimes de trafic ou d’exploitation. Ils ramènent les enfants dans leurs familles et coordonnent les mesures d’intégration avec les acteurs communaux et privés.
• Les acteurs communaux et privés réalisent des projets de protection des en-fants.
• Les structures décentralisées des ministères concernés organisent des ren-contres régulières avec tous les acteurs pour planifier et assurer le suivi de stratégies contre le trafic d’enfants et l’exploitation des enfants sur la base de la politique nationale.
• Les structures décentralisées des ministères concernés échangent leurs expériences, les capitalisent et les mettent à disposition au niveau du ministère.
25
Résultat direct :
• Les parents s’opposent à la migration de travail de leurs enfants et acceptent l’idée que la scolarisation est un droit fondamental. (Objectif selon l’indicateur de phase 3.1. : 85 % à 95 % dans les communes d’intervention prioritaire.)
• Les parents, les employeurs, les leaders d’opinion et décideurs locaux connais-sent les droits des enfants et les conséquences nuisibles du trafic d’enfants et de l’exploitation des enfants.
• Les ministères concernés mettent au point les stratégies et plans nationaux contre le trafic d’enfants et l’exploitation des enfants sur la base des expérien-ces mises à leur disposition.
• Un nombre croissant de victimes du trafic d’enfants sont ramenées dans leurs familles. (Indicateurs de phase 3.2.)
• Dans les communes d’intervention, un nombre croissant de victimes du trafic d’enfants et des pires formes du travail des enfants bénéficient de mesures de soutien socioéconomique (indicateur de phase 3.3.).
Horizon 2015 : • Le nombre d’enfants et adolescents (de la classe d’âge 6 à 17 ans) qui se lan-
cent dans l’émigration de travail sans leurs parents diminue. (Objectif selon l’indicateur 5 : diminution d’au moins un tiers.)
Résultat indirect (impact) :
• Les leaders d’opinion et décideurs locaux mettent au point des initiatives visant à protéger les enfants du trafic et de l’exploitation.
• Les enfants et adolescents disposent d’autres possibilités que l’émigration de travail dans leurs localités et en tirent parti.
• Les ministères compétents coordonnent les interventions de tous les donateurs concernant les droits des enfants, le trafic d’enfants et l’exploitation des enfants.
4. Quels sont les résultats obtenus jusqu’à présent par le programme PROSAD et les projets qui l’ont précédé ?
Projets précédents
Le programme PROSAD a été précédé par deux autres projets : • Planification familiale (1995-2003), • Lutte contre le VIH/SIDA dans le cadre de la planification familiale et de la promotion des jeunes
(2003).
Ces projets ont été réalisés dans la région du Sud-Ouest et la région Boucle du Mouhoun.
Depuis 2004, les actions de la CD allemande sont concentrées sur la région de l’Est et celle du Sud-Ouest. À partir de 2004, dans la région Boucle du Mouhoun, les activités se sont limitées à la consolidation des résultats obtenus.
Les deux projets antérieurs (2004-2006) : • projet en association « Droits humains/lutte contre le trafic et les pires formes de travail des
enfants » et • programme « Santé sexuelle/VIH/SIDA » pourraient aussi être considérés comme une 1re phase de PROSAD.
26
L’équipe actuelle du programme PROSAD a également mené le projet « réintégration sociale et économique des familles, femmes et enfants rapatriés dans les régions rurales » (2003-2005) qui a assuré de manière exemplaire la réintégration dans onze villages de plus de 3 500 rapatriés de Côte d’Ivoire.
Exemples de résultats obtenus à ce jour :
Planification familiale
Une observation de l’évolution à long terme dans la région du Sud-Ouest (où PROSAD et les pro-jets antérieurs sont actifs depuis 1998) et la région Boucle du Mouhoun (où le projet de planifica-tion familiale était actif de 1998 à 2003) fait apparaître un écart significatif par rapport à la ten-dance dans les autres zones rurales du pays. Dans le Sud-Ouest, la prévalence contraceptive a plus que quadruplé en dix ans. En 2006, elle y a atteint 11,8 %, et 11,6 % dans la région Boucle du Mouhoun (Burkina rural : 6,3 %).
Dans le cadre du projet, le système d’information sanitaire des services de santé s’est amélioré de sorte qu’elle permet une observation régulière de l’évolution. Les estimations de prévalence établies d’après les données des services de santé s’avèrent congruentes avec les résultats des enquêtes représentatives sur la prévalence effectuées dans le cadre des EDS.
Graph. 5 Évolution relative de la prévalence contraceptive
27
Graph. 6 Proportion de femmes qui utilisent les méthodes modernes de planification familiale
(Les flèches indiquent dans chaque cas la 1re année d’intervention)
Dans la région de l’Est aussi, où l’emploi de méthodes modernes de planification familiale stagnait depuis des années (1998 : 2,3 % -2003 : 2,6 %), on enregistre une hausse de 70 % sur les trois années suivant le début du programme (4,4 %). La progression observée de 2003 à 2006 corres-pond assez précisément à celle connue par la région du Sud-Ouest de 1997 à 2000. Le pro-gramme s’est bien implanté. Les conditions devant être créées au niveau des médiateurs sont en place. L’emploi des méthodes de planification familiale se propagera vite avec l’extension rapide des structures de distribution à base communautaire.
Lutte contre le VIH/SIDA
En moyenne nationale, la prévalence a diminué parmi les femmes de la classe d’âge de 15 à 24 ans (2003 à 2006), passant de 1,9 % à 1,4 %. Selon ONUSIDA, la prévalence pour l’ensemble des adultes s’élève à 2,0 % en 2006.
Même si la rectification des anciennes estimations par ONUSIDA après 2003 a rendu la situa-tion quelque peu confuse, on peut considérer que depuis trois ans la prévalence du VIH/SIDA a cessé d’augmenter en moyenne nationale et dans presque toutes les régions. L’estimation de pré-valence pour 2003 (adultes) avait été révisée à la baisse (de 4,2 % à 2,1 %) parce qu’il est apparu que l’on avait sous-estimé l’écart entre ville et campagne. En 2003, un nombre approprié de « sites sentinelles » ont été créés dans les zones rurales pour effectuer des enquêtes par échantillonnage parmi les femmes enceintes, si bien que les données sentinelles se sont aussi infléchies vers le bas à partir de 2003.
28
Dans le groupe des femmes de la tranche d’âge de 15 à 49 ans, la prévalence est restée rela-tivement constante dans la moyenne nationale : 2,7 % en 2003 et 2006.33 Dans la région de l’Est, la prévalence (de l’ensemble du groupe) s’élevait à 1,2 %, en dessous de la moyenne nationale.
Graph. 7 Prévalence du VIH (femmes de 14 à 49 ans)
dans la région du Sud-Ouest et à Ouagadougou
On remarquera l’évolution dans la région du Sud-Ouest qui était en 2001 la région la plus frappée. Bien que cette région ait absorbé, après la capitale, la plus grande proportion des rapatriés de Côte d’Ivoire, la prévalence y est aujourd’hui inférieure à la moyenne. Aucun des autres sites sen-tinelles observés depuis 1998 n’a connu de plus forte baisse de la prévalence. Peut-être faut-il y voir une réponse de la société à l’évolution de l’épidémie qui aurait déjà atteint le stade où les changements de perception commencent à se traduire aussi en changements de comportement.
Ouagadougou, la capitale, constitue une exception inquiétante à cette tendance générale qui pourrait être liée au flux des retours de Côte d’Ivoire. La prévalence chez les femmes de 15 à 29 ans y a augmenté, passant de 4,1 % en 2003 à 5,4 % en 2005 et 4,7 % en 2006.
Scolarisation des filles
Le taux de scolarisation des filles augmente plus vite que celui des garçons. De 2002/03 à 2006/07, il a augmenté de 52 % en moyenne burkinabè (pour passer à 49 %). Le taux des filles a atteint 83 % du taux des garçons (contre 75 % l’année scolaire 2002/03).
Cette évolution était plus positive encore dans les deux régions du programme puisque la hausse du taux était de 90 % dans l’Est et de 72 % dans le Sud-Ouest. Le taux des filles atteignait
33 En 2004 et 2005, les estimations étaient légèrement inférieures : 2,5 % et 2,6 %.
29
88 % du taux des garçons dans les deux régions du programme alors qu’il était encore de 70 % dans l’Est et de 73 % dans le Sud-Ouest l’année scolaire 2002/03.
Quelle a été la part du programme dans cette évolution ? Dans le cadre de la campagne nationale, le programme a entrepris, en collaboration avec les di-rections régionales du Ministère de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation (MEBA), d’élaborer des modèles de procédure à suivre qui soient reproductibles dans les 70 communes d’intervention prioritaire. L’effort consiste d’une part à améliorer l’offre. Les enseignantes et ensei-gnants des écoles communales sont acquis à la cause de la scolarisation des filles. Le programme permet de leur faire suivre une formation continue spécifique, fournit des modules de formation traitant de sujets particulièrement importants pour les filles et conseille les structures publiques sur l’organisation de la supervision.
D’autre part, le travail avec les associations villageoises, les associations de parents et les parents individuels ainsi que l’intervention de troupes de théâtre et de stations de radio locales aboutissent à donner à cette question une importance élevée dans l’opinion locale, ce qui accroît la demande (et par là la pression sur le système éducatif).
Outre le taux de scolarisation, il est important de s’intéresser aussi à l’évolution de la proportion de filles qui abandonnent l’école avant le CM2. Cette donnée est révélatrice de la mesure dans laquelle la qualité de l’enseignement arrive à suivre l’augmentation des exigences. Le bilan ressortant de la moyenne nationale ôte bien des illusions. L’année 2006/07, 47 % des filles ont quitté l’école prématurément. Une tendance qu’il a été possible de contrer dans le Sud-Ouest – où cet abandon ne représentait plus que 44 % des filles (contre 59 % encore en 2002/03) – et dans l’Est (recul de 49 % à 42 %).
Tab. 1 Évolution de la scolarisation des filles
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07
Hausse/ recul (-)
en %
Région de l’Est
Écolières (nombre) 15 911 17 782 22 613 26 781 33 878 112,9
Taux net officiel 18,4 20,9 24,6 28,4 34,8 89,6
Taux net corrigé 17,7 19,2 23,7 27,3 34,1 92,4
Abandon avant le CM2 (%) 49,1 53,1 52,1 35,2 42,1 -14,2
Région du Sud-Ouest
Écolières (nombre) 13.072 15.302 17.804 20.162 23.305 78,3
Taux net officiel 29,3 30,1 39,2 44,0 50,4 72,1
Taux net corrigé 28,5 33,1 38,2 42,9 49,2 72,6
Abandon avant le CM2 (%) 58,6 49,7 50,1 51,7 44,5 -24,1
À titre de comparaison :
Taux net (moyenne nationale) 32,1 35,0 39,8 43,2 48,7 51,8
Taux net (régions rurales) 20,2 23,1 27,5 30,8 36,1 78,7
Abandon (moyenne nationale) en % 52,8 47,8 46,8 50,3 46,9 -11,1
30
Graph. 8 Évolution du taux de scolarisation des filles de 7 à 12 ans dans les deux régions du programme34 et, pour comparaison, dans l’ensemble des régions rurales du pays35
Dans les villages où le programme concentrait son action, ces résultats du programme sont encore plus criants :
Dans ces villages, non seulement la proportion de filles parmi les élèves entrant à l’école était plus élevée que dans la moyenne régionale (50 % dans les écoles de ces villages contre 45 % dans la région du Sud-Ouest en moyenne, et 48 % contre 46 % dans la région de l’Est) ; mais on est surtout parvenu à maintenir une forte proportion de filles dans les classes supérieures, ce qui peut être attribué tant à des changements de perception et de comportement des parents – qui considéraient auparavant que deux à trois ans d’école suffisaient pour les filles – qu’à des chan-gements d’état d’esprit des filles elles-mêmes.
Un résultat surprenant est ressorti de l’étude de l’évolution de la scolarisation des orphelins de la région de l’Est : les filles dont le père était mort, mais dont la mère était encore en vie, avaient plus de deux fois plus de chances (230 au lieu de 100) d’être scolarisées que les filles dont les deux parents étaient en vie. Les femmes en situation difficile semblent donc avoir davantage recours aux offres du programme. Les femmes renforcent les femmes.
Mais les garçons dont le père est mort ont eux aussi été particulièrement encouragés par leurs mères. Leur probabilité d’être scolarisés était tout de même de 22 % supérieure à la moyenne (122 par rapport à 100).
34 Région Sud-Ouest, zone d’intervention depuis 1998 ; Région Est, depuis 2004. 35 Calculé d’après MEBA 2003 et suivantes.
31
Graph. 9 Proportion de filles dans les six classes de l’enseignement primaire
Écoles des villages d’intervention prioritaire et ensemble des écoles dans les deux régions du programme
2006/2007
32
Résumé
(Égalité des sexes, équité intergénérationnelle et développement durable)
Les problèmes auxquels le programme s’attaque se rejoignent au niveau des groupes cibles pour former un tout. A bout du compte une femme ne se contente probablement pas d’utiliser une mé-thode moderne de planification familiale : elle rejette aussi l’excision de sa fille et impose son point de vue. Elle permet à ses enfants de fréquenter l’école. Elle les préserve du trafic des enfants et des pires formes de travail. Elle sait empêcher la violence dans le couple. Elle se protège du sida et protège son partenaire. Au fil de ces changements d’attitude, elle a renforcé son statut social et acquis une nouvelle confiance en elle. Et ce statut et cette confiance se répercutent à leur tour sur son attitude vis-à-vis des différentes questions, rendant cette attitude durable. La quantité se transforme en qualité. Le manque d’attribution entre résultat direct et résultat indirect qui se fait jour dans chacun des secteurs individuels se réduit. Il en résulte des effets positifs par delà les domaines d’intervention directs du programme.
Quand les femmes et les jeunes voient leur statut social renforcé, c’est la communauté villageoise tout entière qui gagne en compétence sociale et en volonté de changement. Les problèmes rencontrés par les femmes, les adolescents et les enfants trouvent une place appropriée dans l’opinion villageoise. Même des règles traditionnelles comme celle interdisant aux femmes la propriété de terres agricoles personnelles sont remises en question.
L’UNICEF a intitulé son dernier rapport sur la situation des enfants dans le monde36 : « Women and Children. Reaping the Double Dividend of Gender Equality ». Ce rapport met en avant qu’il est nécessaire de faire reculer la discrimination sexuelle pour que les enfants puissent épanouir toutes leurs capacités et contribuer ensuite pleinement au développement de la société. Si tel est le cas, alors le renforcement de la position des femmes est un garant essentiel de l’équité intergénérationnelle.
Et nous voilà ramenés à nos considérations de départ. Toute politique de développement du-rable, c’est-à-dire d’un développement qui satisfait les besoins de la génération actuelle sans compromettre les possibilités des générations futures, trouve dans la lutte pour l’égalité des sexes un point d’attaque essentiel et prometteur. Les diverses expériences de PROSAD montrent qu’on peut même parler d’un triple dividende. Car les deux maillons que sont l’égalité des sexes et l’équité intergénérationnelle mènent directement et indirectement au troisième : le développement durable.
36 UNICEF 2007
33
Bibliographie
AKPAGA (Odile)/ YARO (Yacouba), 2005 - L’impact du VIH/SIDA sur le système éducatif au Bur-kina Faso, Ouagadougou : Institut International de Planification de l’Éducation
BAYA (Banza), 2003a - Adolescent’s Sexual Behaviour and Their Risk of HIV in Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, (=Series on HIV/AIDS in Sub-Saharan Africa : Sex, Gender and Policy. Working Paper Series, Volume 13 Number 7), Harvard : Center for Population and Develop-ment Studies
BAYA (Banza), 2003b - Girl’s schooling and risk of HIV/AIDS : Hope or Anxiety ? Evidence from Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, (Paper 2/ Work in progress), Harvard/ Ouagadougou
CERFODES (Équipe - YARO et al.), 2007 - Étude de base sur les droits des femmes, les violen-ces faites aux femmes et le recours aux services juridiques dans la zone d’intervention du PSV-DHTE, Ouagadougou : PSV-DHTE
CERFODES (Équipe, coordonnée par Yacouba YARO), 2006 - Étude de Base sur la Lutte contre le Trafic et les Pires Formes de Travail des Enfants dans la Région de l’Est du Burkina Faso, Ouagadougou : GTZ, PSV-DHTE/ KfW, Fonds Enfants
CNLPE, 2005 - Évaluation et analyse du rythme d’évolution de la pratique de l’excision au Burkina Faso. Livre I : Analyse de l’évolution de la pratique de l’excision à partir des données exis-tantes. Rapport provisoire, Ouagadougou : CNLPE/ Population Council
CNLS-IST (SP), 2007 - Bilan Général de la mise en œuvre du Plan national multisectoriel de lutte contre le VIH/SIDA et les IST (ONM) de l’année 2007. VIIe Session du Conseil National Lutte contre le sida et les IST (CNLS-IST), 21 décembre 2007, Ouagadougou : Présidence du Faso/ CNLS-IST
CNLS-IST, 1999 et suivantes – Rapports sur la surveillance sentinelle du VIH, Ouagadougou : CNLS-IST
CNLS-IST/ ONUSIDA, 2005 - Suivi de la déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA (rapport UNGASS) – Burkina Faso 2005, Ouagadougou : CNLS-IST
CNLS-IST/ SP, 2004 - Récapitulatif de Statistiques sur le VIH/SIDA et IST au Burkina Faso. Pé-riode 1986-2003, Ouagadougou : CNLS-IST
CNLS-IST/ SP, 2005a - Cadre stratégique de lutte contre le VIH/SIDA et les infections sexuelle-ment transmissibles (CSLS) 2006-2010, Ouagadougou : CNLS-IST
CNLS-IST/ SP, 2005b - Rapport général des travaux de la session extraordinaire du CNLS-IST (le 30 juin 2005), Ouagadougou : CNLS-IST
CNLS-IST/ SP, 2006 - Ve Session du CNLS-IST. Document de travail (17 février 2006), Ouaga-dougou : CNLS-IST
CNLS-IST/ SP, 2007 - Plan national multisectoriel de lutte contre le VIH/SIDA et les IST. Année 2008, Ouagadougou : Présidence du Faso/ CNLS-IST
CONGO (Zakari), 2005 - Étude quantitative sur les Connaissances, Attitudes et Pratiques en santé sexuelle et reproductive des jeunes scolarises dans quelques établissements d’enseignement secondaires des Régions du Sud-Ouest et de l’Est. Rapport final, Ouaga-dougou : MFB/ GTZ
CONGO (Zakari), 2007a - Étude quantitative sur les Connaissances, Attitudes et Pratiques en santé sexuelle et reproductive des adolescentes et des jeunes dans les régions du Sud-Ouest et de l’Est, Ouagadougou : MFB/ CA/ PROSAD
CONGO (Zakari), 2007b - Les facteurs de la contraception au Burkina Faso au tournant du siècle. Analyse des données de l’enquête démographique et de santé de 1998/ 1999, (=La planifi-cation familiale en Afrique. Documents d’analyse N° 5), Paris : CEPED
CROS (Michèle), 1990 - Anthropologie du sang en Afrique. Essai d’hématologie symbolique chez les Lobi du Burkina Faso et de Côte-d’Ivoire, Paris : Harmattan
CROS (Michèle), 2005 - Résister au sida. Récits du Burkina, Paris : Presses Universitaire de France
DERA (Lassané)/ ILBOUDO (François)/ KABORE (Idrissa)/ OUATTARA (Adama N.)/ YE (Ami-nata), 1997 - Enquête Nationale sur l’Excision au Burkina Faso, Ouagadougou : INSD
DESA (UN-Department of Economic and Social Affairs. Population Division), 2007 - World Popula-tion Prospects. The 2006 Revision. Highlights, New York : UN
34
FRIBOULET (Jean-Jacques)/ LIECHTI (Valérie), (eds.), 2003 - Mesurer un droit de l’homme ? L’effectivité du droit à l’éducation II. Enquêtes, (=Documents du travail de l’IEDH No 8), Fri-bourg/ Ouagadougou : Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’homme/ APENF
GRAWERT (Elke), (Hg.), 1994 - Wandern oder bleiben? Veränderungen der Lebenssituation von Frauen im Sahel durch die Arbeitsmigration der Männer, Münster/ Hamburg
GUIELLA (Georges), 2004 - Santé sexuelle et de la reproduction des jeunes au Burkina Faso. Un état des lieux, (=Occasional Report No. 12), New York/ Washington : The Alan Guttmacher Institut
HEULER-NEUHAUS (Werner), 1994 - Mit den Frauen verliert auch die dörfliche Gemeinschaft die Initiative. Gesellschaftliche und ökologische Auswirkungen von Emigration in der Provinz Yatenga (Burkina Faso), in : Elke Grawert, 1994 : 133-156
HEULER-NEUHAUS (Werner), 2003 - Émigration du travail des Burkinabè en Côte d’Ivoire et l’impact de la crise politique ivoirienne sur la dynamique de migration et les transferts, Oua-gadougou : GTZ
HEULER-NEUHAUS (Werner), 2004 - Die Arbeitsemigration von Burkinabè in die Elfenbeinküste und die Auswirkungen der ivoirischen politischen Krise auf Migrationsdynamik und Geld-transfers, (University of Leipzig Papers on Africa No. 72), Leipzig : Institut für Afrikanistik
HEULER-NEUHAUS (Werner), 2005a - Réflexions sur l’état de la pandémie du VIH/SIDA au Bur-kina Faso, Ouagadougou : GTZ, PSV-DHTE
HEULER-NEUHAUS (Werner), 2005b - La Région de l’Est. Étude sur l’analyse des conditions de départ et sur la situation des groupes cibles du Programme PSV-DHTE, Ouagadougou : GTZ
HIEN (Constantin)/ NYAMBA (André)/ TOGOURI (Julien)/ Toe (Simplice), 2001 - Les jeunes du Burkina face au condom : étude sur les connaissances, attitudes, croyances et pratiques (CACP) des jeunes de 13 à 25 ans. Rapport final, Ouagadougou : PROMACO
ILBOUDO (Monique), 1999 - L’Infraction d’excision, in : revue burkinabè de droit, nº 36 – 2e se-mestre 1999 : 163-194
INSD DIRECTION DE LA RECHERCHE DEMOGRAPHIQUE, 1984 - Enquête post-censitaire en Haute-Volta 1976. Quelques aspects de la fécondité des femmes voltaïques, Ouagadougou : Ministère du Plan et de la Coopération
INSD, 1978 a - Recensement Général de la Population. Décembre 1975. Résultats définitifs. Vol. I. Les données nationales, Ouagadougou : Projet P.N.U.D./ Ministère du Plan et de la Coopé-ration
INSD, 1978b - Recensement Général de la Population. Décembre 1975. Résultats définitifs. Vol. II. Les données départementales, Ouagadougou : Ministère du Plan
INSD, 1989 - Recensement Général de la Population 1985. Structure par âge et sexe des villages du Burkina Faso. Deuxième édition, Ouagadougou : INSD
INSD, 1990 - Recensement Général de la Population. Burkina Faso 1985. Analyse des résultats définitifs, Ouagadougou : INSD
INSD, 1991 - Enquête démographique 1991. Donnes brutes, Ouagadougou : INSD INSD, 1995 - Analyse des résultats de l’enquête démographique 1991, (deuxième édition), Oua-
gadougou : Direction de la Démographie/ FNUAP INSD, 1996a - Analyse des résultats de l’enquête prioritaire sur les conditions de vie des ménages,
Ouagadougou : INSD INSD, 1996b - Le profil de pauvreté au Burkina Faso. Étude statistique nationale, Ouagadougou :
Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan/ INSD INSD, 1997 - EP-94. Profil de la pauvreté, Ouagadougou : Ministère de l’Économie et des Finan-
ces/ INSD INSD, 1998 - Recensement Général de la Population et de l’Habitation du Burkina Faso (du 10 au
20 décembre 1996). Population résidente des départements, communes, arrondissements et provinces. Résultats définitifs, Ouagadougou : INSD
INSD, 2000a - Recensement Général de la Population et de l’Habitation du Burkina Faso (du 10 au 20 décembre 1996). Fichiers des villages du Burkina Faso, Ouagadougou : INSD
INSD, 2000b - Analyse des résultats du Recensement Général de la Population et de l’Habitation du Burkina Faso, 2 volumes, Ouagadougou : INSD
INSD, 2000c - Profil et évolution de la pauvreté au Burkina Faso. Étude statistique nationale, Oua-gadougou : Ministère de l’Économie et des Finances/ INSD
35
INSD, 2001 - Analyse des résultats de l’enquête prioritaire sur les conditions de vie des ménages en 1998. Dimensions sociales de l’ajustement. Étude statistique nationale, Ouagadougou : INSD
INSD, 2003a - Analyse des résultats de l’enquête burkinabè sur les conditions de vie des ména-ges. Rapport final, Ouagadougou : MEF
INSD, 2003b - Burkina Faso. La pauvreté en 2003. 2e édition, Ouagadougou : MEF INSD, 2005 - Tableau de Bord Social du Burkina Faso N°3, Ouagadougou : Ministère de
l’Économie et du Développement (MED) INSD, 2007 - Résultats préliminaires du Recensement Général de la Population et de l’Habitation
de 2006, Ouagadougou : Ministère de l’Économie et du Développement (MED) INSD, 2007 - Suivi des la Situation des Enfants et des Femmes. Résultats de l’Enquête Nationale
à Indicateurs Multiples. Burkina Faso 2006, Rapport préliminaire, Ouagadougou : Ministère de l’Économie et des Finances (MEF)/ UNICEF
INSD, s.d. – CD-ROM : Enquête Prioritaire sur les conditions de vie des ménages. Année 1994, Ouagadougou : INSD/ Ministère de l’Économie et des Finances
INSD, s.d. – CD-ROM : Enquête Prioritaire sur les conditions de vie des ménages. Année 1998, Ouagadougou : INSD/ Ministère de l’Économie et des Finances
INSD/ MACRO INTERNATIONAL, (éds.), 1993 - Enquête Démographique et de Santé. Burkina Faso 1994, Ouagadougou/ Calverton, Maryland
INSD/ MACRO INTERNATIONAL, (éds.), 2000 - Enquête Démographique et de Santé. Burkina Faso 1998-1999, Ouagadougou/ Calverton, Maryland
INSD/ ORC MACRO, (éds.), 2004a - Enquête Démographique et de Santé. Burkina Faso 2003. Rapport préliminaire, Ouagadougou/ Calverton, Maryland
INSD/ ORC MACRO, (éds.), 2004b - Enquête Démographique et de Santé. Burkina Faso 2003, Ouagadougou/ Calverton, Maryland
INSD/ UNICEF, 1987 - Étude socio-économique sur les femmes des provinces de la Tapoa, du Sourou et du Kadiogo, Ouagadougou : UNICEF
INSD-DR DE L’EST, 2007 - Annuaire statistique de la Région de l’Est, Fada N’Gourma/ Ouaga-dougou : Ministère de l’Économie et du Développement (MED)
JACKSON (Elizabeth F.)/ AKWEONGO (Patricia)/ SAKEAH (Evelyn)/ HODGSON (Abraham)/ ASURU (Rofina)/ PHILLIPS (James F.), 2003 - Women’s Denial of Having Experienced Fe-male Genital Cutting in Northern Ghana : Explanatory Factors and Consequences for Analy-sis of Survey Data, (=Policy Research Division Working Paper No. 178), New York : Popula-tion Council
JONES (Heidi)/ DIOP (Nafissatou)/ ASKEW (Ian)/ KABORÉ (Inoussa), 1999 - Female Genital Cut-ting Practices in Burkina Faso and Mali and Their Negative Health Outcomes, in : Studies in Family Planning, Vol. 30, No. 3 : 219-230
KABORÉ (Alain), 2004 - Étude de base sur l’offre l’utilisation et l’appréciation des services de santé reproductive des adolescentes et jeunes dans les districts sanitaires de Batié, Diebou-gou et Gaoua, Ouagadougou : GTZ/ PSV-DHTE
KABORÉ (Alain), 2005a - Étude de base sur l’offre, l’utilisation et la satisfaction des adolescents et des jeunes par rapport aux services de santé de la reproduction (SR) dans les formations sanitaires de Batié, Dano, Diébougou, Dissin, Gaoua et Kampti dans la région sanitaire du Sud-Ouest. Suivi, Ouagadougou : GTZ/ PSV-DHTE
KABORÉ (Alain), 2005b - Étude sur l’offre des services de planification familiale et de santé repro-ductive des adolescents et des jeunes dans les Districts Sanitaires de Bogandé, Diapaga et Fada (Région Sanitaire de l’Est), Ouagadougou : GTZ/ PSV-DHTE
KABORÉ (Alain), 2006 - Étude de suivi de l’offre, de l’utilisation et de la satisfaction sur les servi-ces de santé reproductive des adolescents et des jeunes dans les régions sanitaires de l’Est et du Sud-Ouest en 2006, Ouagadougou : MFB/ CA/ PROSAD
KABORÉ (Alain), 2007 - L’offre, de l’utilisation et de la satisfaction des utilisateurs des services de santé repro-ductive des adolescents et des jeunes (SRAJ) dans les régions sanitaires du Sud-Ouest et de l’Est, Ouagadougou : GTZ/ PSV-DHTE
KABORE (Yimian)/ SOUBEIGA (André)/ OUEDRAOGO (Diénéba)/ SAWADOGO (Pierre), 2002 - Étude de base sur la pratique de l’excision dans 16 provinces du Burkina Faso. (Banwa, Ba-zèga, Kossi, Kourwéogo, Loroum, Nayala, Mouhoun, Passoré. Sanguié, Sissili, Tuy, Ouda-lan, Houet, Zondoma, et Ziro), Ouaga-dougou : CNLPE/ Coopération Pays-Bas
36
KABRÉ (Marie Bernadette)/ SAWADOGO (Félicité)/ NIKIEMA (Delphine), (Équipe de consultants/ BEST), 2001 -Situation des enfants domestiques et le trafic des enfants au Burkina Faso. Rapport d’étude, Ouagadou-gou : Anti-Slavery International/ WAO-Afrique/ GRADE-FRB
KANN (Michel Adrien)/ SINARÉ (Koudbi)/ SAGNON (Célestin Lallé), (2003 ?) - Genre et pauvreté au Burkina Faso, Ouagadougou : INSD/ PARI
KIELLAND (Anne)/ SANOGO (Ibrahim), 2002 - Child Labor Migration from Rural Areas. The Mag-nitude and the Determinants, Ouagadougou : World Bank/ Terre des Hommes
LABORATOIRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE, BAZEGA, 1998 - Évaluation de la prévalence, de la typologie et des complications liées à l’excision chez les patientes fréquentant le for-mations sanitaires du Bazèga, (Série Documentaire N° 21), Ouagadougou : Ministère de la Santé/ UERD/ Mwangaza/ Population Council
LABOURET (Henri), 1931 - Les Tribus du Rameau Lobi, (=Travaux et Mémoires de l’Institut d’Ethnologie XV), Paris : Université/ Institut d’Ethnologie
McFARLAND (Daniel Miles)/ RUPLEY (Lawrence A.), 1998 - Historical Dictionary of Burkina Faso. Second. Ed., Lanham (Md.) and London : The Scarecrow Press
MEBA, 1999 - Statistiques scolaires 1998/1999, Ouagadougou MEBA, 2000a - Plan décennal de développement de l’éducation de base 2000-2009, Ouagadou-
gou : MEBA MEBA, 2000b - Statistiques scolaires 1999/2000, Ouagadougou : MEBA/ DEP MEBA, 2001 - Statistiques scolaires 2000/2001, Ouagadougou : MEBA/ DEP MEBA, 2002 - Statistiques de l’éducation de base 2001/2002, Ouagadougou : MEBA/ DEP MEBA, 2003 - Statistiques de l’éducation de base 2002/2003, Ouagadougou : MEBA/ DEP MEBA, 2004 - Statistiques de l’éducation de base 2003/2004, Ouagadougou : MEBA/ DEP MEBA, 2005 - Statistiques de l’éducation de base 2004/2005, Ouagadougou : MEBA/ DEP MEBA, 2006 - Statistiques de l’éducation de base 2005/2006, Ouagadougou : MEBA-DEP MEBA, 2007a - Statistiques de l’éducation de base 2006/2007 (Statistiques scolaires), Ouagadou-
gou : MEBA-DEP MEBA, 2007b - Tableau de bord de l’Education de Base. Année scolaire 2006/07, Ouagadougou :
MEBA-DEP MEBA/ MESSRS, 2004 - Rapport national sur le développement de l’éducation au Burkina Faso,
Ouagadougou MEDA (Nicolas), 1998 - Suivi et évaluation des programmes nationaux de lutte contre le sida :
Examen de l’expérience du Burkina Faso, 1987-1998, ( Monographie préparée dans le cadre de l’initiative OMS/ONUSIDA/MEASURE EVALUATION (USAID) sur le suivi-évaluation des programmes de lutte contre le sida), Ouagadougou/ Bobo-Dioulasso : Ministère de la Santé/ O.C.C.G.E Centre Muraz
MEF, 2000 - Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (PRSP), Ouagadougou MESSRS, 2006 - Annuaire Statistique de l’Enseignement secondaire 2005-2006, volume 1, Oua-
gadougou : MESSRS-DEP MESSRS, 2006 - Annuaire Statistique scolaire et universitaire 2004-2005, Ouagadougou :
MESSRS-DEP MESSRS, 2007 - Annuaire Statistique de l’Enseignement secondaire 2006-2007. Version détaillée,
volume 1, Ouagadougou : MESSRS-DEP MESSRS, DR Région du Sud-Ouest, 2006 - Synthèse des rapports de rentrée 2005-2006, Gaoua :
MESSRS/ DR MINISTÈRE DE LA SANTÉ, 1997 - Carte sanitaire du Burkina Faso, Ouagadougou MINISTÈRE DE LA SANTÉ, 1998 ( ?) - Statistiques sanitaires 1996, Ouagadougou MINISTÈRE DE LA SANTÉ, 2000a - Draft Annuaire Statistique 1998, Ouagadougou MINISTÈRE DE LA SANTÉ, 2000b - Annuaire Statistique 1999, Ouagadougou MINISTÈRE DE LA SANTÉ, 2001a - Plan National de développement sanitaire 2001-2010 PNDS MINISTÈRE DE LA SANTÉ, 2001b - Annuaire Statistique 2000, Ouagadougou : DEP MINISTÈRE DE LA SANTÉ, 2002 - Annuaire Statistique/ Santé. Année 2001, Ouagadougou : DEP MINISTÈRE DE LA SANTÉ, 2003 - Annuaire Statistique 2002, Ouagadougou : DEP MINISTÈRE DE LA SANTÉ, 2004 - Annuaire Statistique 2003, Ouagadougou : DEP MINISTÈRE DE LA SANTÉ, 2005 - Annuaire Statistique 2004, Ouagadougou : DEP MINISTÈRE DE LA SANTÉ, 2006 - Annuaire Statistique 2005, Ouagadougou : DEP MINISTÈRE DE LA SANTÉ, 2007a - Annuaire Statistique 2006, Ouagadougou : DEP
37
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, 2007b - Tableau de Bord Santé 2006, Ouagadougou : DEP MS/DRS DE Fada N’GOURMA, 2004 et suivantes - Région sanitaire de Fada N’Gourma. Statisti-
ques des Services), Fada N’Ngourma MS/DRS DE GAOUA, 1995 et suivantes. - Région sanitaire de Gaoua. Tableaux synoptiques (Ac-
tivités trimestrielles des districts sanitaires de la région), Gaoua NIKIEMA (André), 2007 - Rapport Annuel 2006 de l’unité régionale de L’Est Du Programme Santé
Sexuelle, Droits Humains. Composante 3 : Planification familiale, santé sexuelle des jeunes et lutte contre le VIH/SIDA, Fada N’Gourma : PSV-DHTE
OMS, 2004 - Summary Country Profile for HIV/AIDS Treatment Scale-up. Burkina Faso (July 2004), Geneva
OMS, 2006 - Country Health System Fact Sheet 2006. Burkina Faso, Geneva ONAPAD (Observatoire National de la Pauvreté et du Développement humain durable), 2005 -
Données. Pour suivre et évaluer la pauvreté et le développement humain durable, Ouaga-dougou : MED
ONUSIDA/OMS, 2000 - Burkina Faso. Epidemiological Fact Sheet on HIV/AIDS and sexually transmitted infections. 2000 Update, Geneva
ONUSIDA/OMS, 2002 - Burkina Faso. Epidemiological Fact Sheets on HIV/AIDS and sexually transmitted infections. 2002 Update, Geneva
ONUSIDA/OMS, 2004 - Burkina Faso. Epidemiological Fact Sheets on HIV/AIDS and sexually transmitted infections. 2004 Update, Geneva
ONUSIDA/OMS, 2006 - Burkina Faso. Epidemiological Fact Sheets on HIV/AIDS and sexually transmitted infections. 2006 Update, Geneva
OUATTARA (Marcel), 2003 - Pauvreté et vulnérabilité au Burkina Faso. Rapport final, Ouagadou-
gou : INSD OUEDRAOGO (Diénéba)/ KABORE (Yimian)/ SANON (Edème), 2001 - Étude de base sur la pra-
tique de l’excision dans cinq provinces du Burkina Faso, Ouagadougou : GTZ (Projet secto-riel suprarégional appui aux initiatives pour l’abandon des mutilations génitales féminines)
OUEDRAOGO (Richard)/ ARMBRUSTER (Stephan), 2004 - Étude de faisabilité portant sur : L’identification des perspectives en matière de scolarisation et formation dans la région de Sud Ouest du Burkina Faso, Ouagadougou : Coopération financière allemande – Fonds pour la Lutte contre le Trafic et les Pires Formes de Travail des Enfants
OUEDRAOGO (Salimata)/ ZOUGBA (Alain Dominique)/ OUEDRAOGO (Eloi), 1998 - Pauvreté et santé au Burkina Faso, Ouagadougou : Ministère de l’Économie et des Finances/ INSD
PÈRE (Madeleine), 1988 - Les Lobi. Tradition et Changement. Burkina Faso, 2 Tomes, Laval PÈRE (Madeleine), 2004 - Le royaume Gan d’Obiré. Introduction à l’’histoire et à l’anthropologie.
Burkina Faso, Saint-Maur-des-Fossés : Éditions Sepia PNUD, 2001 – Rapport sur le développement humain. Burkina Faso PROJET PLANIFICATION FAMILIALE, 2001 - Annuaire statistique 2000, Ouagadougou : Minis-
tère de la Santé/ GTZ PROJET PLANIFICATION FAMILIALE, 2002a - Annuaire statistique 2001, Ouagadougou : Minis-
tère de la Santé/ GTZ PROJET PLANIFICATION FAMILIALE, 2002b - Rapport de suivi et d’évaluation de la mise en
œuvre des microplans IST/VIH/SIDA dans les régions sanitaires de Dédougou et de Gaoua : Ministère de la Santé/ GTZ
PROJET PLANIFICATION FAMILIALE, 2002c - Enquête de base 2002 dans les districts sanitaires de Dano et Nouna. Présentation de quelques résultats (PowerPoint-présentation), (rédac-tion : Tinga Sinaré), Ouagadougou : Ministère de la Santé/ GTZ
PROJET PLANIFICATION FAMILIALE, 2002c - Synthèse des rapports d’évaluation par les pairs dans le cadre du projet Planification Familiale : Ministère de la Santé/ GTZ
PROJET PLANIFICATION FAMILIALE, 2003a - Annuaire statistique 2002, Ouagadougou : Minis-tère de la Santé/ GTZ
PROJET PLANIFICATION FAMILIALE, 2003b - Auto-évaluation de la structure d’appui GTZ/PF Deuxième phase du projet PF 2000-2003 : Ministère de la Santé/ GTZ
PROJET PLANIFICATION FAMILIALE, 2004a - Annuaire statistique 2003, (rédaction Eva Neu-haus et Werner Heuler-Neuhaus), Ouagadougou : Ministère de la Santé/ GTZ
38
PROJET PLANIFICATION FAMILIALE, 2004b - Enquête de base dans la « zone DBC » de la zone d’intervention du Projet DGSP/GTZ/PF. Rapport de synthèse des résultats des enquê-tes de base réalisées à Dano (2002), à Nouna (2002) et à Solenzo (2003), (rédaction : Tinga Sinaré), Ouagadougou : Ministère de la Santé/ GTZ
PROMACO, 1995 et suivantes - Rapports d’activités trimestrielles, Ouagadougou PROSAD, 2007 – Annuaire statistique des Programmes PSV-DHTE (2004-2006) et PROSAD
(2007-2015), (rédaction Zakari Congo et Werner Heuler-Neuhaus), Ouagadougou : MFB/ CA/ PROSAD
PSV-DHTE (Programme Santé Sexuelle/ VIH/SIDA, Droits Humains, Lutte contre le Trafic et les pires formes de travail des Enfants), 2005 - Étude de bas sur les mutilations génitales fémi-nines (MGF) dans la région du Sud-Ouest, Ouagadougou : GTZ/ PSV-DHTE
PSV-DHTE, 2006 - Annuaire statistique 2004-2005, (rédaction : Eva Neuhaus et Werner Heuler-Neuhaus), Ouagadougou : Ministère des Finances et du Budget (MFB)/ Coopération Alle-mande au Développement
SCHMITT (Gerald), (avec la collaboration de Bèkouonè Hien Yirtièro Yves), (1993) - Le droit fon-cier chez les Dagara et les relations interethniques dans l’ouest du département de Dissin, Frankfurt/ Diébougou : Projet VARENA
SOMBIÉ (Michel)/ SOMÉ (Mathias)/ SOMÉ (Romaric) et al., 2001 - Santé et pauvreté au Burkina Faso : Progresser vers les objectifs internationaux dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté, Washington : Banque mondiale
SP DU CNLS-IST, 2004a (janvier) - Récapitulatif de statistiques sur le VIH/SIDA et IST au Burkina Faso. Période 1986-2003, Ouagadougou : CNLS-IST (Conseil National de Lutte contre le sida et les IST)
SP DU CNLS-IST, 2004b (mai) - Présentation des résultats synthétiques de la sérosurveillance du VIH a travers les sites sentinelles au Burkina Faso. A l’occasion de la conférence de presse sur les résultats provisoires de l’Enquête Démographique et de Santé 2003-2004 au Burkina Faso (volet VIH/SIDA), Ouagadou-gou : CNLS-IST (Conseil National de Lutte contre le sida et les IST)
SP DU CNLS-IST, 2005 (janvier) - Description de l’évolution de la situation épidémiologique du VIH/SIDA dans le monde et au Burkina Faso, Ouagadougou : CNLS-IST (Conseil National de Lutte contre le sida et les IST)
SP-CONASUR, 2004 - Analyse des données sur les rapatriés de Côte d’Ivoire, Ouagadougou : CONASUR/ UNI-CEF/ PAM
TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2004 - Annual Report 2004, Berlin : Transparency Interna-tional
TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2005 - Annual Report 2005. Major Anti-Corruption Stories, Berlin : Trans-parency International
TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2006 - Annual Report 2006, Berlin : Transparency Interna-tional
TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2007 - Global Corruption Report 2007. Corruption in Judicial Systems, Cambridge : University Press
PNUD, 2007 - Human Development Report 2007/08. Fighting climate change : Human solidarity in a divided world, New York : Palgrave Macmillan
UNICEF Innocenti Research Centre, 2003 - Trafficking in Human Beings, Especially Women and Children, in Africa, Florence : UNICEF
UNICEF, 1994 - Analyse de la situation des femmes et des enfants au Burkina Faso, Ouagadou-gou
UNICEF, 2007 - The State of the World’s Children 2007. Women and Children. The Double Divi-dend of Gender Equality, New York
WESTOFF (Charles F.), 2006 - New Estimates of Unmet Need and the Demand for Family Plan-ning, (=DHS Comparative Reports No. 14), Calverton : Macro International
YARO (Yacouba), 1995 - Les stratégies scolaires des ménages au Burkina Faso, in : ORSTOM, Cah. Sci. hum. 31 (3) : 675-696
YARO (Yacouba)/ PILON (Marc)/ KABORÉ (Idrissa), 2006 - Les conséquences du conflit ivoirien sur l’éducation dans les pays limitrophes : un état de lieu au Burkina Faso, Yaoundé : FASAF/ ROCARE
39
YODER (P. Stanley)/ ABDERRAHIM (Noureddine)/ ZHUZHUNI (Arlinda), 2004 - Female Genital Cutting in the Demographic and Health Surveys : A Critical and Comparative Analysis, (=DHS Comparative Reports No 7), Calverton, Maryland : ORC Macro
YONLI (Gérard Bruno), 2005 - Étude sur la situation des enfants travaillants dans les sites aurifè-res de Boungou dans la Région de l’Est et de Mamina et Fofora à Kampti dans la Région du Sud-Ouest. Rapport préliminaire, Ouagadougou : ABSE
ZAGRE (Ambroise)/ ZEMBA (Paul)/ IBRIGA (Luc Marius)/ Ouedraogo (Ferdinand)/ ZOURI (Toro Pierre), 2002 -Étude prospective sur le trafic des enfants au Burkina Faso, Ouagadougou : MTEJ/ MASSN/ Programme BIT/ IPEC-LUTRENA/ Aid à l’enfance Canada, Save the Chil-dren UK, UNICEF
ZANGREYANOGO (Danielle)/ BATIONO (Bouma Fernand), 2004 - Étude sur la stratégie d’IEC/CCC du Programme Santé Sexuelle - VIH/SIDA, Droits Humains et lutte contre le Tra-fic et les pires formes de travail des Enfants, Ouagadougou : PSV-DHTE
ZOUNGRANA (Steve Léonce), 2003 - Connaissance de la situation et conditions de réinsertion des familles rapatriées, plus particulièrement les femmes et les enfants dans le Sud-Ouest du Burkina Faso (Étude socio-anthropologique), Ouagadougou : GTZ
40
Annexe
Les objectifs du Millénaire et le concept du développement durable
La seule occurrence de la notion de « développement durable » dans les objectifs du Millénaire pour le développement tels qu’ils sont inscrits dans le document des Nations unies se trouve dans l’objectif 7 : « Préserver l’environnement » (cible 7 : « Intégrer les principes du développement durable dans les politiques et programmes nationaux et inverser la tendance à la déperdition de ressources naturelles »).
Pris dans leur globalité, ces objectifs pourraient cependant aussi être compris comme une tentative de décrire ce que le développement durable se propose concrètement de réaliser. En effet, leurs cibles comme leurs indicateurs se rapportent majoritairement à la situation des enfants et des jeunes ainsi qu’au statut social des femmes.
Ils ont cependant l’inconvénient de ne pas reposer sur des analyses concrètes, par pays, des principaux obstacles au développement. Mais cet inconvénient est acceptable, à condition de ne pas être passé sous silence, parce qu’il a le mérite d’autoriser les comparaisons. Dans le cas de certains indicateurs, les difficultés de collecte des données n’ont pas été assez prises en compte. Ainsi pour la mortalité maternelle, où l’on ne dispose pas de données de 1990 vérifiables pour la plupart des pays d’Afrique subsaharienne et où il n’y a donc pas grand intérêt à rapporter l’indicateur pour 2015 à de telles « données de départ ». (« Cible 6 : Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité maternelle. »)
Aperçu de l’état d’avancement des objectifs du Millénaire au Burkina Faso, à la réalisation desquels le programme « Santé sexuelle/droits humains » (PROSAD)
contribue directement ou indirectement
Objectifs du Millénaire : 1. (Réduire l'extrême pauvreté et la faim) ; 2. (Assurer l’éducation primaire pour tous) ; 3. (Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes) ; 4. (Réduire la mortalité infantile) ; 5. (Améliorer la santé maternelle/réduire le taux de mortalité maternelle) ; 6. (Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies - cible 6A : D’ici à 2015, avoir arrêté
et commencé à inverser la progression du VIH/sida) ; 7. (Assurer un environnement durable) ; 8. (Mettre en place un partenariat mondial pour le développement ; cible 16 : en coopération avec
les pays en développement, créer des emplois décents et productifs pour les jeunes.) Les indicateurs servant à évaluer l’avancement des objectifs du Millénaire peuvent être répartis en trois groupes en fonction de l’état des données au Burkina Faso :
Le premier groupe rassemble les données qui sont régulières (annuelles dans l’idéal) et vérifiables, ces données pouvant toutefois être disponibles avec un important retard. Cela s’applique aux indicateurs de l’OMD 2, à la plupart des indicateurs de l’OMD 3 et aux indicateurs de l’OMD 6 (cible 7). Ces données autorisent des conclusions précises sur l’état d’avancement et sur les perspectives de réalisation des objectifs en question.
Il n’en va pas de même pour les OMD 4 et 5, pour lesquels les seules données régulières dis-ponibles concernent des indicateurs secondaires (indicateur 15 : proportion d’enfants d’un an vac-cinés contre la rougeole, et indicateur 17 : proportion d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié).
Dans le deuxième groupe, les données les plus précises proviennent des estimations des en-quêtes démographiques et de santé (EDS) de 1993, 1998/99 et 2003. La collecte de ces données est relativement espacée. Il est difficile de procéder à des comparaisons à cause des différences
41
dans la précision statistique des enquêtes. C’est le cas des principales données relatives à l’évolution de la mortalité infantile. De plus, les données sur la mortalité infantile sont rétrospecti-ves. Elles se rapportent chaque fois à la période de cinq ou dix ans qui a précédé. La situation est similaire pour les données relatives à l’OMD 1. Ici, les données les plus précises proviennent des estimations des enquêtes prioritaires (EP) de 1994, 1998 et 2003. En plus des rapports publiés, on peut accéder aussi aux bases de données tant pour les enquêtes prioritaires que pour les EDS.
Le troisième groupe rassemble les estimations dont la fiabilité est douteuse. Cela s’applique particulièrement à l’indicateur de mortalité maternelle.
Les OMD dans le détail :
OMD 1 :
(Ne peut être considéré qu’en additionnant les résultats des interventions du programme.)
OMD 2 :
L’achèvement du cycle d’études primaires par tous est un objectif très ambitieux qui ne pourra certainement pas être atteint d’ici à 2015. Cependant, de grands efforts sont entrepris et des suc-cès considérables ont déjà été obtenus.
En l’espace de 5 ans (2001/2002-2006/2007), le taux net de scolarisation a augmenté de près de 60 %, passant de 35,2 % à 53,1 %. Pour les filles : hausse de 61,8 % (de 30,1 % à 48,7 %).
Les deux régions du programme ont enregistré des augmentations supérieures à la moyenne du pays : 65,2 % dans le Sud-Ouest (de 31,9 % à 52,7 %). Pour les filles : hausse de 88,5 % (de 26,1 % à 49,2 %). Et 105,6 % dans l’Est (depuis un taux de départ très faible de 17,8 % pour at-teindre 36,6 %). Pour les filles : hausse de 138,5 % (de 14,3 % à 34,1 %).
OMD 3 :
Ici aussi, les efforts déployés sont considérables. La cible « Éliminer les disparités entre les sexes dans les enseignements primaire et secondaire » semble accessible pour partie (enseignement primaire) et (surtout) dans les régions d’intervention prioritaire. (Cf. la section « scolarisation des filles » au point 4.)
OMD 4 :
On ne dispose que des données des EDS. Pour les périodes quinquennales précédant 1998 et 2003, elles montrent que la mortalité infantile (0 à 5 ans) a reculé de 16,2 % pour tomber à 183,7 ‰ et la mortalité des nourrissons (0 à 1 an) a chuté de 22,7 % pour passer à 81,4 ‰. Ce recul faisait toutefois suite à une augmentation de la mortalité infantile au début des années 90 qui était peut-être liée à l’évolution de l’épidémie de sida.
L’objectif d’une baisse des deux tiers ne pourra être atteint qu’au prix d’efforts supplémentai-res.
Une évolution positive concerne les vaccinations. La proportion d’enfants (de moins d’un an) vaccinés contre la rougeole est passée de 43 % à 84 % entre 1999 et 2005.
OMD 5 :
On ne dispose que d’estimations de l’OMS concernant l’évolution de la mortalité maternelle. Elles oscillent entre 930 (1990), 1 400 (1995) et 1 000 (2000), rapportés chaque fois à 100 000 naissan-ces vivantes.
La tentative de l’EDS II de faire l’état de la mortalité maternelle par la « méthode des sœurs » a été peu prise en considération parce que le résultat de 484 (pour la période 1994-1998) semblait peu crédible. Une vérification et pondération des données qui a été réalisée dans le cadre du pro-gramme aboutit à une valeur moyenne quelque peu plus réaliste de 587. L’intervalle de confiance est cependant considérable. Il va de 214 à 960. Les estimations de l’OMS semblent donc être trop élevées dans tous les cas.
42
L’évolution de la proportion des accouchements assistés par du personnel médical qualifié, laisse mal augurer de la réalisation de l’OMD 5. Ce taux oscille entre 30 et 40 % depuis les années 1990 et il a plutôt légèrement tendance à baisser ces dernières années (en 2005 : 33,4 %). La qualité de l’assistance obstétricale fournie évolue très lentement elle aussi. La mortalité maternelle lors des accouchements assistés variait entre 160 et 220 pour 100 000 naissances vivantes de 1999 à 2005. En tout cas, elle était nettement inférieure à la mortalité maternelle quand les accou-chements ne bénéficiaient pas d’une assistance médicale qualifiée.
Plutôt que de miser sur un changement rapide et profond des institutions d’aide à l’accouchement, on peut travailler dans ce domaine à faire changer les regards et les comporte-ments des groupes cibles (particulièrement des femmes, adolescents et jeunes adultes).
Améliorer les perspectives d’éducation des filles, mettre en place des services de santé sexuelle et reproductive axés sur les jeunes, améliorer l’offre de méthodes de planification familiale et en accroître la demande, favoriser le dialogue entre les générations et entre les sexes en ma-tière de sexualité, apporter une protection contre les violences sexuelles, les mariages forcés et les mariages d’enfants, voilà les principales lignes d’action à suivre pour empêcher les grossesses non désirées et apporter un accompagnement optimal à celles qui ont été voulues.
On peut certainement arriver à diminuer considérablement la mortalité maternelle en renfor-çant le statut social des femmes. Mais il demeure difficile d’apporter la preuve qu’on progresse dans la diminution de la mortalité maternelle.
OMD 6 – cible 7 :
L’objectif du Millénaire concernant la lutte contre le sida peut être atteint au Burkina Faso. (Cf. la section « lutte contre le VIH/SIDA » au point 4.)
En 2003, 52,8 % des femmes (selon EDS II) ont utilisé un préservatif lors de leur dernier rap-port sexuel en dehors d’une relation fixe. Elles n’étaient que 42,4 % cinq ans auparavant.
De manière générale, la prévalence contraceptive augmente relativement vite dans l’ensemble du pays. L’évolution observée dans le Sud-Ouest, où le programme est parti du programme anté-rieur de planification familiale, montre qu’il demeure néanmoins là un potentiel inexploité. (Cf. la section « planification familiale » au point 4.)
L’indicateur du taux de scolarisation des orphelins peut seulement se fonder sur des données des deux régions du programme. Ces données montrent que les orphelins ont un taux de scolari-sation qui est en moyenne égal à 95 % de celui de la totalité des enfants. Les filles orphelines de la région de l’Est constituent une exception surprenante : à 170 au lieu de 100, leur probabilité d’être scolarisées était plus élevée et ce, de manière significative. Une analyse plus fine indique que cela tient surtout aux filles dont le père est mort, mais dont la mère est encore en vie. Elles avaient plus de deux fois plus de chances (230 au lieu de 100) d’être scolarisées que les autres filles. Les femmes en situation difficile semblent donc avoir davantage recours aux offres du pro-gramme. Les femmes renforcent les femmes. Mais les garçons dont le père est mort ont eux aussi été particulièrement encouragés par leurs mères. Leur probabilité d’être scolarisés était tout de même de 22 % supérieure à la moyenne (122 au lieu de 100).
Taux de scolarisation des orphelins par rapport au taux de scolarisation de tous les enfants (en % ; taux moyen de scolarisation de tous les enfants = 100)
2003/04 2004/05 2006/07
Est : filles 169,8
Est : garçons 95,5
Est : filles et garçons 121,7
Sud-Ouest : filles 88,7 94,0
Sud-Ouest : garçons 92,6 98,3
Sud-Ouest : filles et garçons 89,1 91,3 96,4
43
OMD 7 :
(Assurer un environnement durable)
Contribution indirecte due à l’action conjuguée de l’évolution démographique et de la préservation des conditions écologiques.
OMD 8 :
(Mettre en place un partenariat mondial pour le développement ; cible 16 : en coopération avec les pays en développement, créer des emplois décents et productifs pour les jeunes.)
En luttant contre le trafic d’enfants et les pires formes de travail des enfants, le projet a pu contribuer à rapprocher le pays de cet objectif (voir ci-dessus).
Résumé
Pour les objectifs du Millénaire 2, 4 et 5, de grands progrès sont accessibles, même si l’accomplissement total de ces objectifs est improbable.
Dans le cas de l’objectif 3, il est possible d’atteindre des cibles importantes. Les régions d’intervention jouent ici un rôle de précurseurs.
Concernant l’objectif 6 (cible 7), il y a bon espoir de surmonter la phase actuelle de stagnation de la prévalence du VIH pour amorcer une baisse. Il ne faut pas cependant sous-estimer l’évolution inquiétante observée dans la capitale. Le traitement des malades et l’aide à apporter aux orphelins du sida sont des problèmes qui continueront à gagner de l’ampleur. Mais la préven-tion reste plus que jamais la clé de la lutte contre cette pandémie.
44
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
- Coopération allemande au développement -
Bureau de la GTZ à Ouagadougou
Avenue de l’Université Angle Boulevard Charles de Gaulle
B.P. 1485
Ouagadougou 01
Burkina Faso
T +226-50311672
F +226-50310873
I www.gtz.de