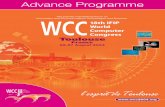L'esprit républicain. Droits naturels et vertu civique chez Algernon Sidney (Classiques Garnier...
Transcript of L'esprit républicain. Droits naturels et vertu civique chez Algernon Sidney (Classiques Garnier...
INTRODUCTION
Vertu civique et droits naturels dans l’historiographie républicaine
« Le républicain le plus opiniâtre de tout [m]on royaume »Charles II parlant de Sidney, rapporté à Louis XIV par l’ambassadeur de France en Angleterre, J. Scott, Algernon Sidney and the English Republic, p. 234.
Ce livre cherche à démontrer, par la reconstruction conceptuelle de la pensée politique et morale d’Algernon Sidney (1623-1683)1, que l’usage qu’il fait du langage des droits naturels est non seulement compatible avec son républicanisme, mais indissociable de celui-ci. Le républicanisme, comme le libéralisme, a%rme que la finalité première de la société politique est de protéger la liberté individuelle ; mais à la di&érence de ce dernier, il prétend que les structures institution-nelles et constitutionnelles élaborées à cet e&et doivent à leur tour être soutenues par la vertu civique des membres de la communauté. La vertu civique est alors conçue non plus comme la finalité de l’État et d’une existence pleinement humaine, ainsi qu’elle est pensée dans l’humanisme civique reconstruit par John Pocock, mais bien comme la disposition des citoyens à soutenir dans leur action les institutions
1 Pour quelques éléments biographiques sommaires, cf. la Notice biographique à la fin de l’ouvrage. Pour des études complètes, cf. J. Carswell, The porcupine : the life of Algernon Sidney, Londres, John Murray, 1989, et surtout l’incontournable biographie intellectuelle en deux volumes réalisée par J. Scott, Algernon Sidney and the English Republic, 1623-1677, Cambridge, Cambridge University Press, 1988 (désormais cité Sidney I), et Algernon Sidney and the Restauration Crisis 1677-1683, Cambridge, Cambridge University Press, 1991 (désormais cité Sidney II).
8 L’ESPRIT RÉPUBLICAIN
libres qui créent les conditions de leur liberté. Dans ce cadre, la spéci-ficité du républicanisme des droits est de penser la liberté individuelle – protégée par les lois et soutenue par la vertu – comme le statut qui rend e&ectif le droit naturel de l’homme à vivre émancipé de toute forme de domination.
L’enjeu de cette démonstration n’est pas de souligner de manière générale la perméabilité des traditions politiques1. Ce souci historique est certainement salutaire pour se prémunir contre la tendance philo-sophique qui consiste à réifier les modèles historiographiques construits pour interpréter les textes du passé. En lui-même légitime, ce souci historique de restituer l’enchevêtrement des traditions dans les textes incite pourtant aussi à sous-évaluer les conséquences philosophiques de la rencontre des traditions : en soulignant à juste titre que certains auteurs républicains ont recours au langage des droits, on présuppose néanmoins le plus souvent qu’ils utilisent des notions relevant de l’univers intellectuel du libéralisme, et non de la tradition républicaine.
Or c’est ici que réside l’enjeu philosophique essentiel, et plus radical, de la présente étude : il s’agit, par la reconstruction conceptuelle de la pensée d’un auteur du passé, de remettre en cause l’intuition, aussi tenace chez les théoriciens contemporains que chez les historiens des idées politiques, selon laquelle le concept des droits naturels est essentiellement un concept libéral2, et qu’il est par conséquent essentiellement étranger à la pensée républicaine. Cette intuition manifeste l’emprise du modèle exclusiviste que Pocock a proposé aux historiens des idées et sur lequel nous reviendrons en détail ; elle explique d’une part pourquoi les droits sont en règle générale marginalisés dans l’historiographie et la philosophie
1 À ce sujet, cf. notamment les analyses suggestives de M. Geuna, « La tradizione repubblicana e i suoi interpreti : famiglie teoriche e discontinuità concettuali », Filosofia Politica, 12, 1998, p. 101-32, et le recueil dirigé par I. Hont et M. Ignatie& (dir.), Wealth and Virtue. The Shaping of Political Economy in the Scottish Enlightenment, Cambridge, Cambridge University Press, 1983, notamment les contributions de J. Robertson (p. 137-78), N. Phillipson (p. 179-202), M. Ignatie& (p. 317-43) ; K. Haakonssen, « Republicanism », in R. Goodin and P. Pettit (dir.), A Companion to Contemporary Political Philosophy, Oxford, Oxford University Press, 1993, p. 570-1.
2 M. Viroli, Repubblicanesimo, Roma-Bari, Laterza, 1999, p. 46 : « la doctrine des droits naturels (ou innés, ou inaliénables) est propre au libéralisme » ; en s’appuyant sur Skinner, Viroli soutient qu’il en va de même d’un point de vue théorique, même s’il souligne que la théorie « moderne des droits est parfaitement cohérente avec l’idéal républicain de la liberté » (p. 50).
INTRODUCTION 9
politique républicaines1. Mais elle permet surtout de comprendre pour-quoi le constat qu’un nombre significatif d’auteurs républicains utilisent le langage des droits a toujours donné lieu à l’hypothèse que ces auteurs empruntent un langage qui leur est étranger et demeure aux marges de leur théorie de la liberté, et jamais à l’hypothèse que ces auteurs conçoivent les droits naturels en termes républicains. Ainsi, même les interprètes qui ont remis en cause la thèse de l’incompatibilité entre droits et vertu que Pocock a contribué à façonner ont néanmoins résisté à l’idée qu’une conception républicaine des droits puisse être envisageable ; comme si, finalement, les républicains ne pouvaient utiliser le jusnaturalisme que comme un langage d’emprunt.
Cette réticence à envisager pour elle-même une conception républi-caine des droits a pu trouver une justification de poids dans une lecture rapide des Cato’s Letters, écrites par John Trenchard et Thomas Gordon entre 1720 et 1723. Le Caton anglais fait de Machiavel la « grande autorité » à consulter en matière de vertu publique et de corruption2. Mais dans la mesure où Caton s’appuie aussi largement sur des éléments de théorie politique qu’il reprend explicitement à Locke, on peut aisé-ment en conclure qu’il a combiné les thèses républicaines qu’il hérite de Machiavel avec celles, libérales, qu’il hérite de Locke. Cette conclusion invite à son tour à se dispenser d’envisager dans le détail la possibilité que cette alliance des droits et de la vertu ait des e&ets sur la manière dont Caton conceptualise e&ectivement ces notions.
C’est précisément sous ce rapport que la pensée politique et morale de Sidney est précieuse : elle fournit un angle de vue à partir duquel il est impossible, historiquement parlant, de voir dans son jusnaturalisme l’e&et de l’influence de Locke. Elle invite en ce sens à considérer pour elle-même la théorie des droits de Sidney. Notre thèse, ici, est simple : si nous admettons, à titre d’hypothèse de travail, que le libéralisme, ou
1 Par exemple au nom de « leur faiblesse théorique » (M. Viroli, Repubblicanesimo, op. cit., p. 46), ou au nom de leur rôle avant tout rhétorique (P. Pettit, Républicanisme. Une théorie de la liberté et du gouvernement (1997), trad. P. Savidan et J.-F. Spitz, Paris, Gallimard, 2004, p. 137 (et n. 4, p. 432), p. 404-5). V. Bourdeau : « La liberté comme non-domination peut-elle se passer du langage des droits naturels ? » in M. Belissa, Y. Bosc et F. Gauthier (dir.), Républicanismes et droit naturel. Des humanismes aux Révolutions des droits de l’homme et du citoyen, Paris, Kimé, 2009, p. 227-42.
2 J. Trenchard et T. Gordon, Cato’s Letters : or Essays on liberty, Civil, Religious, and Other Important Subjects (1720-23), 2 vols., Indianapolis, Liberty Fund, 1990, Lettre 16, p. 121.
10 L’ESPRIT RÉPUBLICAIN
du moins son prélude, commence avec la théorie des droits de Locke1, alors nous devons reconnaître qu’au moment même où se forme le libé-ralisme, la pensée républicaine fait un usage abondant, souvent précis, et radical du jusnaturalisme.
Si elle vise directement à enrichir la connaissance conceptuelle de la tradition républicaine, la présente étude entend également contribuer, de manière indirecte, à la théorie politique républicaine. Les réflexions analytiques contemporaines portant sur les concepts de droits et de vertu s’appuient certes sur autre chose que la seule histoire des idées pour justifier leurs a%rmations. Toutefois, les philosophes politiques, de manière générale, se réclament aussi plus ou moins explicitement de certaines traditions politiques : John Rawls présente l’outil théorique de la position originelle, destiné à faciliter l’identification des principes de la justice, comme une reformulation contemporaine du concept d’état de nature forgé dans les théories classiques du contrat, et l’on sait l’intérêt qu’il porte à l’histoire de la philosophie morale2. Les théoriciens de la démocratie délibérative, de leur côté, se réfèrent fréquemment, non sans quelque tension, à Rousseau3. De même, Philip Pettit ouvre sa théorie républicaine de la liberté et du gouvernement par la reconstruction d’une histoire de la liberté républicaine4. Bien entendu, ces théoriciens se gardent de prétendre que la validité de leur argumentation analytique dépend de la reconstruction historique qu’ils proposent : d’une part, leur projet n’est pas historique ; d’autre part, ils estiment à raison que la validité conceptuelle d’une thèse et sa formulation historiquement datée sont, en elles-mêmes, tout à fait indépendantes. Pour autant, ils sont certainement sensibles à la pertinence que peut avoir, pour la théorie contemporaine, la restitution précise de la pensée d’un auteur du passé.
1 Cette hypothèse, que nous ne discuterons pas, est radicalement remise en cause par C. Miqueu, Restaurer l’idée de citoyenneté à l’aube des Lumières. Le républicanisme moderne de Locke et Spinoza, Thèse de doctorat, sous la dir. de C. Lazzeri, Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense, novembre 2009.
2 J. Rawls, Leçons sur l’histoire de la philosophie morale (2000), trad. B. Guillarme et M. Saint-Upéry, Paris, La Découverte, 2002.
3 Cf. C. Girard, « Jean-Jacques Rousseau et la démocratie délibérative : bien commun, droits individuels et unanimité », Lumières, 2010. Cass Sunstein puise explicitement dans l’histoire de la république américaine certains éléments qu’il estime particulièrement per-tinent pour la pensée et la pratique politiques contemporaines, « Beyond the Republican Revival », The Yale Law Journal, 97, 8, 1988, p. 1539-90.
4 P. Pettit, Républicanisme, op. cit., chap. 1, p. 35-75.
INTRODUCTION 11
Le travail accompli en ce sens par Q. Skinner sur le concept de liberté à partir de Machiavel a montré, plus que tout autre, à quel point l’histoire des idées politiques pouvait être une ressource féconde pour interroger les thèses et les présupposés de la philosophie politique contemporaine1.
L’idée que l’examen des traditions politiques est susceptible d’éclairer et de préciser les termes en jeu dans les débats théoriques se vérifie particulièrement pour la question qui nous occupe. Pour en prendre la mesure, on peut considérer le projet de Richard Dagger, dans son livre Civic Virtues : Rights, Citizenship, and Republican Liberalism. Dagger se donne en e&et pour objectif de construire une « théorie qui joigne […] l’insistance libérale sur l’autonomie à la dévotion républicaine pour la vertu civique2 ». Une telle entreprise implique de remettre en cause l’idée d’une incompatibilité conceptuelle de principe entre les droits et la vertu. Mais il est frappant qu’en cherchant à montrer que le libéralisme et le républicanisme ne sont pas incompatibles, Dagger entérine le présupposé selon lequel les concepts de droit à l’autonomie et de liberté individuelle sont des concepts libéraux et non républicains. Car déclarer possible et souhaitable le « mariage du républicanisme et du libéralisme3 » au motif que le concept républicain de vertu civique et les concepts libé-raux d’autonomie et de droits sont « complémentaires4 », c’est valider la distribution habituelle des concepts et reconnaître implicitement leur appartenance à des langages politiques distincts. Si Dagger remet bien en cause l’incompatibilité théorique des droits et de la vertu, il accepte néanmoins visiblement l’idée que l’autonomie et les droits sont des concepts libéraux, c’est-à-dire des concepts non républicains5.
1 Q. Skinner, « Machiavelli on virtù and the maintenance of liberty », et « The idea of negative liberty : Machiavellian and modern perspectives », tous deux in Visions of Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, vol. 2, respectivement p. 160-85 et 186-212. S. Burtt a fait un travail similaire pour le concept de vertu ; cf. « The Good Citizen’s Psyche : On the Psychology of Civic Virtue », in Polity, 23, 1, 1990, p. 23-38 ; Virtue transformed : Political argument in England. 1688-1740, Cambridge, Cambridge University Press, 1992 ; « The Politics of Virtue Today : A Critique and A Proposal », The American Political Science Review, 87, 2, 1993, p. 360-8.
2 R. Dagger, Civic Virtues : Rights, Citizenship, and Republican Liberalism, Oxford, Oxford University Press, 1997, p. 191.
3 Ibid., p. 116.4 Ibid., p. 5.5 Il en va de même dans la remarque de I. Shapiro, au début de son ouvrage sur l’évolution de
la conception des droits dans la tradition libérale. Il précise qu’il ne vise pas, en se penchant sur la tradition libérale des droits, à contester l’importance de la tradition républicaine
12 L’ESPRIT RÉPUBLICAIN
Le fondement de ce présupposé apparaît quand Dagger justifie son choix de démontrer cette compatibilité par l’analyse conceptuelle plutôt que par une reconstruction historique. Il reconnaît, dans un premier temps, que « les idées que nous identifions maintenant comme répu-blicaines et libérales ont été mêlées entre elles dans les ouvrages d’un certain nombre d’auteurs1 ». Mais au lieu d’en déduire que l’histoire des idées politiques devrait inviter à utiliser plus prudemment, voire à réviser, les catégorisations contemporaines, il fait de ces dernières la grille d’intelligibilité des auteurs du passé :
mais aucun des [auteurs du passé] n’était consciemment engagé dans le développement d’un ensemble d’idées que l’on pourrait appeler le libéralisme républicain. C’est seulement le regard rétrospectif rendu possible par ceux qui ont cherché à démêler le républicanisme et le libéralisme qui nous permet de concevoir une telle théorie2.
Selon Dagger, autrement dit, la clarification conceptuelle, en démê-lant les concepts d’autonomie, de droit et de vertu civique et en les rapportant à leurs langages respectifs, montre que les auteurs du passé, n’ayant pas opéré ce travail analytique, n’ont pas pu contribuer à l’élaboration du libéralisme républicain. Seule la théorie normative contemporaine est donc en mesure de formuler cette articulation de manière cohérente et systématique puisqu’elle seule a au préalable nettement distingué libéralisme et républicanisme et identifié les concepts qui s’y rattachent.
Mais il y a dans ce raisonnement une pétition de principe évidente : en e&et, sur quoi repose le jugement selon lequel ces auteurs du passé « mélangeaient » des concepts relevant de deux langages distincts, sinon la catégorisation préalablement non questionnée selon laquelle
mise au jour notamment par Pocock. « En revanche, ajoute-t-il, je mets bien en question la mesure dans laquelle ces deux idéologies [i.e., le langage républicain de la vertu et le langage libéral des droits] ont évolué historiquement de manière exclusive l’une de l’autre, que ce soit dans leur genèse ou à toutes les époques historiques dans lesquelles Pocock les considère comme ayant été distinctes, mais il faudrait un autre livre pour le montrer de manière définitive », I. Shapiro, The Evolution of Rights in Liberal Theory, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, p. 7. Tout en contestant à juste titre l’incompatibilité des langages, Shapiro présuppose bien que le concept des droits est un concept libéral.
1 Dagger, Civic Virtues, op. cit., p. 5. ( c’est nous qui soulignons – sauf indication contraire, les italiques présents dans les citations ne sont pas dans l’original, mais ajoutés par nous.)
2 Ibid.
INTRODUCTION 13
ces concepts relèvent e&ectivement de deux langages distincts ? Une telle catégorisation a priori semble bien indispensable pour énoncer cette distinction et ce mélange, mais quel poids aura-t-elle si l’on peut juste-ment montrer qu’un certain nombre d’auteurs du passé « mélangent » ces concepts d’une manière cohérente ? Plus précisément, s’il s’avère que des républicains du passé utilisent sans incohérence conceptuelle les notions de droits et d’autonomie, ne sera-t-il pas dès lors artificiel de proposer une construction analytique qui cherche à montrer la compatibilité des droits et de la vertu tout en reconnaissant que le concept de droit est en lui-même un concept libéral ? Ne serait-on pas plutôt fondé à laisser de côté cette catégorisation inadéquate du point de vue historique pour s’intéresser de près à la manière dont les républicains qui font appel au droit naturel le conceptualisent ?
Telle est précisément l’ambition du présent travail : démontrer, par la reconstruction conceptuelle de la doctrine de Sidney, que son usage du jusnaturalisme est indissociable de son républicanisme.
L’« ESPRIT RÉPUBLICAIN » : UN FONDEMENT HISTORIQUE DU RÉPUBLICANISME DES DROITS
On pourrait néanmoins donner raison à Dagger en objectant qu’il est vain de chercher dans l’histoire de quelconques « républicains » qui feraient un usage cohérent du concept de droits naturels. Cette entreprise serait nécessairement vouée à l’échec, pourrait-on dire, tout simplement parce que la terminologie étant elle-même le produit des modèles historiographiques contemporains, il semble établi d’avance que la pensée des auteurs sur lesquels une telle étude se penchera sera au mieux manquée, au pire déformée.
De fait, certaines hypothèses qui ont cherché à rendre le républica-nisme et le libéralisme compatibles ne sont pas exemptes de ce défaut d’anachronisme téléologique. À partir d’une lecture de la déclaration d’Indépendance américaine, M. Zuckert prétend en ce sens identifier rétrospectivement l’émergence d’un « nouveau républicanisme des droits », qui combine une théorie lockienne des droits avec le souci républicain
14 L’ESPRIT RÉPUBLICAIN
de la corruption des mœurs et du gouvernement1. Mais parce que le modèle de ce nouveau républicanisme réside, selon Zuckert, dans la déclaration d’Indépendance américaine2, et parce qu’il a décidé a priori que Locke serait le père fondateur de la république moderne des droits3, son hypothèse le conduit à s’intéresser moins aux auteurs qui, de fait, ont combiné droits naturels et vertu républicaine, qu’à ceux qui sont censés annoncer le modèle4.
Or, exactement à la même époque que Locke, Sidney articule ce que Zuckert ne trouve que dans les Cato’s Letters (1720-3) une génération plus tard, à savoir une théorie des droits liée à une conception de la vertu. Notre objection n’est pas ici historique : le propos n’est pas de reprocher à Zuckert d’avoir manqué l’origine de la tradition qu’il recons-truit (même si à coup sûr il se trompe sur ce point), mais de souligner qu’il a reconstruit cette dernière à partir d’un point de départ qui l’a empêché de considérer les auteurs les plus pertinents du point de vue de sa propre hypothèse. Parce que Sidney n’a pas pu être influencé par Locke, Zuckert n’a strictement rien à en dire – sinon pour comparer son degré de présence dans les bibliothèques du xviiie siècle avec celui de Locke, ou pour reprocher à Pocock de n’en avoir pas lui-même parlé5. Mais la place prépondérante de Locke dans cette reconstruction est malaisée et n’est justifiée que par l’hypothèse rétrospective : si Locke n’a pu contribuer à ce nouveau républicanisme que par sa théorie des droits – car de fait, l’auteur des Two Treatises on government ne fait pas appel à la théorie républicaine de la vertu –, n’est-il pas artificiel d’en faire un auteur essentiel de cette tradition, et n’est-il pas étrange de ne rien dire d’un auteur comme Sidney qui, à la même époque, est
1 M. Zuckert, Natural Rights and the New Republicanism, Princeton, Princeton University Press, 1994, p. xii, 319. Le chapitre VI expose la « Science politique Whig », sensible aux questions républicaines ; les chapitres VII, VIII et IX exposent la théorie de Locke ; le chapitre X expose, lui, la « synthèse » dans les Cato’s Letters (1720-3).
2 Cf. le « Prologue » qui est une reconstruction de la doctrine politique de la déclaration d’Indépendance ; ibid., p. 3-26.
3 Cf. la partie III, « Natural Rights and the New Republicanism », où trois des quatre chapitres sont consacrés à la théorie lockienne ; ibid., p. 187-288.
4 Le raisonnement rétrospectif est la méthode constante de Zuckert ; l’exemple le plus éclatant de cette méthode est l’absence totale, dans la démonstration d’un nouveau républicanisme, de définition précise de l’ancien républicanisme, sinon par la version qu’en donnent les historiens (Baylin, Wood, Pocock) dont il réfute pourtant les interprétations ; cf. ibid., p. 155-9, 161-170.
5 Cf. ibid., p. 22, 175.
INTRODUCTION 15
précisément le meilleur représentant d’un tel républicanisme alliant les droits et la vertu ?
Cette lecture rétrospective ne néglige pas seulement de manière arbitraire certains auteurs pourtant incontournables du point de vue même d’un « nouveau républicanisme », elle en exclut aussi explicitement d’autres en déformant leur pensée. Ainsi Milton n’a-t-il pas sa place dans les prémices du nouveau républicanisme. Mais le critère qui permet à Zuckert de séparer le bon grain de l’ivraie dans la pensée politique de Milton l’empêche à coup sûr non seulement de restituer cette dernière de manière fidèle, mais surtout d’avancer des raisons acceptables de la laisser de côté. Milton, soutient Zuckert, est un auteur significatif puisque « sur deux principes » – le droit de résistance naturel et universel, et l’inaliénabilité de la liberté –, il « se trouve aux côtés de Locke et des auteurs de la Déclaration1 ». Mais il est écarté du nouveau républicanisme au nom « d’immenses di&érences doctrinales » avec la Déclaration : Milton a construit sa doctrine « sur la Bible », laquelle est absente de la Déclaration. Sa pensée politique est donc irrémédiablement ancrée dans une « théologie politique » ; la république qu’il appelle de ses vœux est fondamentalement une « respublica christiana ». Or, nous instruit Zuckert, « la Bible et Milton sont silencieux sur la question des droits naturels ou inaliénables » que Locke et les Pères fondateurs américains ont établis sur la seule raison. On perçoit par conséquent que de même que la pensée de Milton est significative parce qu’elle thématise deux éléments essentiels d’un républicanisme à venir, elle ne peut être un moment décisif dans la genèse de ce dernier parce que Milton n’a pas élaboré la « philosophie politique » des synthèses de la fin du xviiie siècle construites sur la théorie des droits de Locke2. V. Sullivan – dont nous parlerons plus loin lorsque nous présenterons l’hypothèse straussienne – résume parfaitement le motif de cette exclusion de Milton du « nouveau républicanisme des droits » : « bien que ses écrits se réfèrent par endroits à un contrat [i.e., du type que l’on trouve chez Locke], sa pensée doit en définitive trop à la révélation biblique pour qu’on puisse le qualifier de précurseur de la pensée libérale3 ».
1 Ibid., p. 80.2 Ibid., p. 84 ; cf. également p. 87, 91-3 ; bien que sa lecture ne soit pas rétrospective d’un
point de vue méthodologique, J. Scott perçoit chez Sidney la même thèse, cf. Sidney II, p. 217, 227.
3 V. Sullivan, Machiavelli, Hobbes & the Formation of a Liberal Republicanism in England, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, p. 9 n. 19.
16 L’ESPRIT RÉPUBLICAIN
Comme on le voit, la restitution de la logique interne de la pensée de Milton n’intéresse guère Zuckert : la question de savoir quelle est précisément la théorie des droits de Milton, de même que la question de savoir en quel sens on peut qualifier sa pensée de républicaine, ne sont aucunement pertinentes. L’élément essentiel de la « démonstration » de Zuckert réside dans l’argument d’une non conformité de la doctrine de Milton à une synthèse à laquelle il est pourtant évident que ce dernier n’a pas pu vouloir contribuer.
Mais en plus de reposer sur des fondements méthodologiques di%-cilement justifiables, une telle interprétation rétrospective déforme la pensée de Milton. On pourrait en e&et montrer que ce dernier propose précisément une théorie de la société politique, de la vertu civique et du droit de résistance, dont les fondements et les justifications sont intrinsèquement saisissables par la raison naturelle ; à cet égard, le poids des philosophies païennes est pour lui décisif, puisqu’elles permettent justement de montrer que les motifs de la création de la société poli-tique relèvent strictement du souci de la cité terrestre, qu’il n’est pas nécessaire d’être chrétien pour être un bon citoyen, ni d’avoir reçu un commandement de Dieu pour résister légitimement au tyran.
Les travers de l’hypothèse de Zuckert invitent donc à se méfier de la tendance à lire (ou à décider de ne pas lire) les textes sur la base d’un modèle qui ne peut qu’être étranger aux intentions de leurs auteurs1. En revanche, tant que l’analyse conceptuelle des textes du passé expose scrupuleusement autant le sens des termes utilisés par les auteurs que les notions qu’elle mobilise pour mieux en rendre compte, il est légitime de faire appel à des outils conceptuels et historiographiques que n’utilisent pas les auteurs : la tâche de l’historien des idées n’est pas d’écrire dans le même langage que celui de l’auteur qu’il étudie, mais de restituer le mieux possible son argumentation et sa position, s’il le faut avec des termes étrangers à cet auteur.
Mais si une telle prudence dans l’ajustement des outils historiogra-phiques contemporains doit toujours être observée, il convient de noter qu’en l’occurrence – ce point est rarement mentionné2, et jamais exploité
1 Ce point est au centre de la critique méthodologique de ce que Q. Skinner appelle la « mythologie de la prolepse », cf. Visions of Politics, vol. I « Regarding Method », Cambridge, Cambridge University Press, p. 73-9.
2 Cf. néanmoins P. Carrive, La pensée politique d’Algernon Sidney (1622-1683). La querelle de l’absolutisme, Paris, Méridiens Klincksieck, 1989, p. 166-7 ; Scott, Commonwealth Principles.
INTRODUCTION 17
conceptuellement –, les textes du xviie siècle fournissent eux-mêmes la terminologie qui autorise à parler de républicanisme. Il s’agira donc moins ici d’adapter avec prudence un paradigme contemporain aux textes du passé que de comprendre ce que Sidney et ses contemporains entendaient lorsqu’ils parlaient d’« esprit républicain ».
On rencontre en e&et ce syntagme (republican spirit / esprit républicain) dans un certain nombre de textes anglais et français de la seconde moitié du xviie siècle. Quoique notre objet ne soit pas d’étudier ces textes pour eux-mêmes, il est utile de relever certains des passages qui évoquent cet esprit républicain. Car outre que nous rencontrons dans ces textes une critique visant nommément et en ces termes Sidney et Milton, qui intègrent tous deux le droit naturel à leur pensée républicaine, les thèses auxquelles cet esprit est rattaché sont très exactement celles que Sidney adopte, et qui font de lui l’un des tenants de ce que nous proposons d’appeler le républicanisme des droits1.
Mais avant d’en venir à quelques occurrences de l’esprit républicain qui légitiment historiquement l’usage du concept de républicanisme des droits, il convient de préciser que nous ne prétendons aucunement identifier chez Sidney l’origine historique du républicanisme des droits. Autrement dit, nous n’entendons pas montrer que Sidney invente un nouveau langage constitué de deux souches – le républicanisme de la Renaissance2 et le jusnaturalisme de la fin du Moyen Âge3 – qui auraient été distinctes et imperméables avant lui. On a déjà pu observé que la tradition républicaine a rencontré le langage des droits naturels au milieu du xviie siècle en Angleterre, notamment chez Milton4 et
Republican Writing of the english Revolution, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, p. 233, Sidney II, p. 113-5, 120-2.
1 Pour une première approche, cf. C. Hamel, « Prendre les droits et la vertu au sérieux : l’hypothèse d’un républicanisme des droits », Les études philosophiques, 4, 2007, p. 499-517.
2 Q. Skinner, Les fondements de la pensée politique moderne (1978), trad. J. Groosman et J.-Y. Pouilloux, Paris, Albin Michel, 2001, chap. 4-6, p. 111-272 ; M. Viroli, From Politics to Reason of State, Cambridge, Cambridge University Press, 1992 ; J. Hankins (dir.), Renaissance Civic Humanism, Reappraisal and Reflexions, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.
3 B. Tierney, The Idea of Natural Rights : Studies on natural rights, natural law and church law 1150-1625, Cambridge, Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2001.
4 Sur le républicanisme de Milton, cf. D. Armitage, A. Himy, Q. Skinner (dir.), Milton and Republicanism, Cambridge, Cambridge University Press, 1995 ; sur l’usage radical qu’il fait du jusnaturalisme, cf. M. Dzelzainis, « Introduction », in John Milton, Political Writings, éd. M. Dzelzainis, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, p. ix-xxv ; Q. Skinner,
18 L’ESPRIT RÉPUBLICAIN
même dès la première moitié du xviie siècle1, mais également dans la seconde moitié du xvie siècle, dans le contexte de la Révolte Hollandaise. Martin van Gelderen a ainsi parfaitement montré comment la lutte contre le gouvernement de Philippe II a été justifiée par une critique républicaine de la tyrannie au nom de la liberté conçue comme bien suprême de l’homme, et le rôle décisif que joua dans cette lutte la thèse du droit naturel à repousser la force par la force2.
Sidney n’est donc certainement pas le premier républicain à faire usage du langage des droits naturels. Mais une généalogie complète du républicanisme des droits pourrait en revanche di%cilement faire l’impasse sur sa pensée politique. C’est du moins ce que nous espérons démontrer dans cette étude.
Pour entamer cette démonstration, il n’est pas inutile de souligner que le xviie siècle n’est pas du tout étranger aux concepts que nous associons ici au républicanisme. Ainsi, dans un ouvrage qui vise à montrer la supériorité de la monarchie (et en particulier de la monarchie anglaise) sur les autres formes de gouvernement, le royaliste John Nalson expose pour les réfuter les « principes antimonarchiques3 » sur lesquels se sont fondés les « républicains entêtés (sti" republicans)4 », fascinés par « l’exemple de Rome » et des républiques modernes. Son objectif est de dénoncer « l’erreur trop populaire » qui consiste à apprécier la « manière
La liberté avant le libéralisme, trad. M. Zagha, Paris, Seuil, 2000, et C. Hamel, « Prendre les droits et la vertu au sérieux », art. cit., p. 502-6 ; « “The people […] should stand up like men, and demand their rights and liberties” : le motif de la dignité dans le droit de résistance chez Milton », Études Épistèmé, 15, 2009, p. 71-100 ; Le républicanisme des droits : liberté et dignité dans la pensée politique de John Milton, Paris, Vrin-EHESS (à paraître en 2012).
1 Cf. C. Cuttica, « Kentish Cousins at odds : Filmer’s Patriarcha and Thomas Scott’s Defense of freeborn englishmen », History of political thought, XXVIII, 4, 2007, p. 599-616.
2 M. van Gelderen, The Political thought of the Dutch Revolt, 1550-1590, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, p. 116 (sur la valeur suprême de la liberté), p. 108, 168, 223, 225, 228 (sur le droit naturel à la liberté de conscience). Cf. du même auteur, « The Machiavellian moment and the Dutch Revolt : the rise of Neostoicism and Dutch republicanism », in G. Bock, Q. Skinner, M. Viroli (dir.), Machiavelli and Republicanism, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, p. 205-23. D’autres figures, comme Étienne de la Boétie ou Spinoza, devraient également être prises en compte ; sur le premier, cf. J. Terrel, « Républicanisme et droit naturel dans le Discours de la servitude volontaire : une rencontre aporétique, in Erytheis, 4, 2009, p. 11-28 ; sur le second, cf. C. Miqueu, op. cit.
3 John Nalson, The Common Interest of King and People : shewing the Original, Antiquity and Excellency of Monarchy, compared with aristocracy and democracy, and particularly of our English Monarchy, Londres, 1677, p. 26.
4 Ibid., p. 29 ; le substantif « républicains (republicans) » apparaît aussi p. 33, 38, 45.
INTRODUCTION 19
démocratique de gouverner1 ». Ce goût pour les principes républicains est dangereux, car il ne reste pas un objet de curiosité littéraire que l’on enseigne dans les collèges ; cette erreur a en e&et, ajoute-t-il, déterminé ceux qu’il appelle les « républico-presbytériens factieux (factious republico-presbyterians)2 » à passer à l’action, en ébranlant la monarchie anglaise pour lui substituer « le modèle si magnifié d’une république (so much magnified model of a republick)3 ». En décrivant indi&éremment le « free state or commonwealth » proclamé par les révolutionnaires régicides comme un « free state or republick4 », Nalson manifeste clairement qu’à ses yeux, l’esprit « néo-romain » qui fut le nerf de l’abolition de la monarchie fut plus précisément un esprit républicain, hostile par principe à la monarchie5.
Au moment où Sidney rédige ses Discourses, Arnauld attaque dans son Apologie pour les catholiques (1681-2) les « calvinistes républiquains » que sont Buchanan, Junius Brutus, auteur des Vindiciae contra Tyrannos, et – précision qui nous intéresse au plus haut point – John Milton, sur la doctrine desquels se sont fondés les « Cromwellistes » dans le traitement qu’ils ont infligé au roi d’Angleterre6. Cherchant à promouvoir ce que « l’on faisait à Rome pendant la république lorsque par le consentement de tout le monde le gouvernement en était démocratique », le but avoué
1 Ibid., p. 25.2 Ibid., p. 35.3 Ibid., p. 26.4 Ibid., p. 26-7, et p. 28 ; cf. p. 29, pour l’expression « cette jeune république (« this young
republick ») ; la première section du chapitre III s’intitule : « examen du gouvernement d’une république (republick) » p. 47.
5 Nous empruntons l’expression « néo-romain » à Q. Skinner, La liberté avant le libéralisme, op. cit., p. 19 (et n. 31), p. 24 (et n. 67), p. 39 (et n. 174, 176, 177). Skinner entendait signifier par là que les auteurs anglais qui ravivaient cette conception de la liberté et des états libres n’avaient rien contre le principe d’un monarque légitime ; il s’est récemment rendu à l’usage en parlant de théorie « républicaine » de la liberté, tout en réitérant qu’il estime cette manière de s’exprimer « anhistorique » ; cf. Hobbes et la conception républicaine de la liberté, trad. S. Taussig, Paris, Albin Michel, 2009, p. 7. Z. Fink, The Classical Republicans. An Essay in the Recovery of a Pattern of Thought in Seventeenth Century England, Evanston, Northwestern University, 1945, p. 152-5, montre cependant qu’en dépit de certaines de ses déclarations, Sidney s’en prend à la monarchie elle-même au moins autant qu’à la monarchie absolue. On trouve sous la plume du Caton anglais l’expression « esprit romain », pour décrire l’idée que seule la mort de César permet à un citoyen de se considérer comme authentiquement libre ; T. Gordon et J. Trenchard, Cato’s Letters, op. cit., Lettre 23, p. 170.
6 Antoine Arnauld, Apologie pour les catholiques, contre les faussetés et les calomnies d’un livre intitulé La politique du Clergé de France. Fait premièrement en Français, et puis traduit en Flamand, Liège, 1681, p. 39, 44.
20 L’ESPRIT RÉPUBLICAIN
de ces calvinistes est selon Arnauld de « renverser toutes les monarchies, ou en gardant seulement le nom de roi, [de] les réduire en de véritables Démocraties ». Or, au nombre des « terribles principes » que ces répu-blicains mettent en avant, on trouve le devoir du roi de rendre des comptes au peuple de l’usage qu’il fait du pouvoir qui lui a été confié. Ce principe, s’alarme Arnauld, est le meilleur moyen de « donner plus d’occasion aux peuples de se soulever contre leurs princes1 ».
Quelques années plus tard, Bayle se présente dans l’Avis important aux réfugiés (1690)2 comme récemment converti au catholicisme, et conseille aux réfugiés qui désireraient rentrer en France de faire au préalable « une espèce de quarantaine » pour se « purifier du mauvais air » qu’ils ont res-piré en terre protestante, et qui leur a fait contracter « deux maladies très dangereuses, et tout à fait odieuses ; l’une est l’esprit de satyre ; l’autre un certain esprit républicain qui ne va pas à moins qu’à introduire l’anarchie dans le monde, le plus grand fléau de la société civile », comme le montre l’histoire de Rome, qui fut « l’état le plus républicain qui se soit trouvé3 ».
Or, précise Bayle, le second point de cet écrit – qui concerne donc la maladie qu’est l’esprit républicain – « est encore plus important que l’autre », car sa propagation menace la survie même de la « société civile ». En e&et, la doctrine séditieuse que di&use « l’esprit républicain » en question n’est pas du tout étrangère à la théorie du contrat que Locke a rendue si célèbre :
les souverains et les sujets s’obligent réciproquement, et par voie de contrat, à l’observation de certaines choses, de telle manière que si les souverains viennent à manquer à ce qu’ils avaient promis, les sujets se trouvent par là dégagés de leurs serment de fidélité, et peuvent s’engager à de nouveaux maîtres, soit que tout le peuple désapprouve le manquement de parole de ces souverains, soit que la plus nombreuse et la plus considérable partie y consente4.
1 Ibid., p. 30, 39, 29.2 Il est en tout cas le responsable de la publication ; pour une argumentation convaincante
de l’attribution à Bayle, cf. Gianluca Mori, « Introduction », in Pierre Bayle, Avis aux réfugiés. Réponse d’un nouveau converti, éd. G. Mori, Paris, Honoré Champion Éditeur, 2007, p. 7-61 ; le titre original est Avis important aux réfugiés sur leur prochain retour en France, donné pour étrennes à l’un d’eux en 1690. Par Monsieur C.L.A.A.P.D.P., Amsterdam, 1690.
3 Bayle, Avis important aux Refugiés, op. cit., p. 137, 147 [5-6, 26] (les indications entre crochets renvoient à l’édition originale de 1690, disponible en version numérisée et en libre accès sur Gallica).
4 Ibid., p. 165 [70-1] ; dans une lettre à Minutoli (24 septembre 1693), Bayle écrit, parlant des Deux traités de Locke : « c’est l’Évangile du jour, à présent, parmi les protestants »,
INTRODUCTION 21
Plus précisément, l’esprit républicain prétend que les peuples « se réserv[ent] un droit d’examen », qui consiste en une « liberté d’obéir ou de ne pas obéir selon qu’ils trouveraient de la justice ou de l’injustice dans les ordres de ceux qui commanderaient ». Mais, poursuit Bayle, ce droit d’examen est bien incompatible avec la société civile, car il est tout simplement irréaliste d’espérer que les citoyens obéissent pour la seule raison qu’ils trouvent la loi juste, et cette absence d’accord des hommes mettrait en péril le « repos public1 ».
Or Bayle a%rme que cette « prétendue souveraineté du peuple » en fait introuvable, cette « chimère favorite » qui est « le plus monstrueux et en même temps le plus pernicieux dogme dont on puisse infatuer le monde », l’esprit républicain l’a « ressuscitée du tombeau de Buchanan, de Junius Brutus et de Milton, l’infâme apologiste de Cromwell ». Défendre la souveraineté du peuple, c’est donc défendre l’inaliénabilité de sa liberté : « le peuple se réserve toujours le droit d’examiner » ce qu’on lui ordonne de faire « et de n’y pas obéir, lorsqu’il ne le trouve pas conforme aux lois2 ».
L’idée de résistance est donc constitutive de « l’esprit républicain » de l’époque. On voit en outre parfaitement pourquoi, dans cette perspective, il est très dangereux d’« inculquer » aux sujets des royaumes la thèse monarchomaque selon laquelle ils sont « supérieurs à leur monarque. On aimerait mieux qu’ils oubliassent entièrement cette prétention qui n’est bonne qu’à la manière des échafaudages pendant qu’on bâtit, mais non pas lorsque le bâtiment est achevé ». En e&et, ce dogme entraîne nécessairement une justification de la résistance : selon cette doctrine, « un homme qui prendrait les armes pour conserver son bien, adjugé injustement à un autre par celui ou ceux qui représentent la majesté de l’État ( comme en Angleterre par le roi et le parlement) ne serait tout au plus que téméraire », et « non pas injuste », car « ceux qui repoussent la force par la force agissent selon les lois de la nature3 ». Nous verrons
cité par G. Mori, « Introduction », in op. cit., p. 165.1 Bayle, Avis important, op. cit., p. 172 [88-9] : « il ne serait pas possible de conserver le repos
public, ni de rien exécuter pour le bien commun, puisqu’il n’y a point de règlement ni de loi qui plaise de telle sorte à tous les sujets que la véritable raison pour laquelle chacun y obéit, est qu’après avoir bien examiné la chose, on la trouve juste ».
2 Ibid., p. 176, 182 [97-8, 113]. Junius Brutus est le pseudonyme sous lequel l’auteur (pro-bablement Du Plessis Mornay) signe ses Vindiciae contra tyrannos (1579).
3 Ibid., p. 177, 179 [99, 105-6].
22 L’ESPRIT RÉPUBLICAIN
plus précisément qu’aux yeux de Sidney, loin d’être téméraire, l’acte de résistance par la force au tyran constitue au contraire l’acte le plus vertueux qui soit, puisqu’il vise à restaurer la liberté.
Lorsque Bayle conduit la réfutation de tels principes, il le fait au nom des thèses mêmes que Sidney reproche à Filmer : on ne peut, pour ce dernier, laisser l’esprit du peuple, c’est-à-dire « la petite et faible cervelle d’un tas d’ignorants », décider du moment où il est obligé moralement d’obéir au souverain. Car il est impossible que le peuple applique aux a&aires politiques « le principe de la lumière naturelle », puisqu’il en est foncièrement dépourvu : il « n’est pas en état de juger par des idées abstraites de politique […] [ni] qui a tort ou qui a raison en fait de gouvernement ». Un peuple laissé à son ignorance naturelle pour l’examen des questions politiques se précipiterait immanquablement dans la guerre civile1.
Dans ces conditions, le prétendu « engagement moral envers les puissances » que les « élèves de Junius Brutus » osent mettre en avant pour prévenir l’objection de l’anarchie est une « barrière » inutile. Car dès lors que l’on allègue que le serment du peuple « ne peut jamais [l’]engager à quoi que ce soit au préjudice de cette loi universelle, salus populi suprema lex esto », dès lors que l’on soutient que ce serment ne vaut que tant que le roi gouverne « selon les lois » et en accord avec « les fins pour lesquelles il a été élu, qui sont de rendre les sujets heureux », la conclusion est simple : un tel engagement moral n’est rien, et l’on verra bientôt le roi assimilé à un « tyran justiciable du peuple2 ».
En outre, Bayle développe une critique explicite de l’individualisme qui, nous le verrons, informe la doctrine de Sidney : soutenir que « le plus petit nombre dans une société civile n’est pas obligé d’acquiescer à la pluralité des voix », c’est « introdui[re] dans les corps politiques la même divisibilité que les philosophes admettent dans les corps naturels, pour le moins vous admettez celle d’Épicure, c’est-à-dire la divisibilité jusqu’aux atomes, jusqu’à chaque individu, ou chaque personne particulière3 ». Comme nous le verrons néanmoins, cet individualisme ne correspond chez
1 Ibid., p. 182, 209 [113, 186-7].2 Ibid., p. 185 [120-1] ; cf.. L. Simonutti, « Between Political Loyalty and Religious Liberty :
Political Theory and Toleration in Huguenot Thought in the Epoch of Bayle », History of Political Thought, 17, 4, 1996, p. 523-54.
3 Bayle, Avis important, op. cit., p. 178 [101-3].
INTRODUCTION 23
Sidney aucunement à ce que C. Taylor appelle l’atomisme, à savoir cette doctrine qui, parce qu’elle établit la « primauté des droits », « ni[e] qu’un principe d’appartenance ou d’obligation puisse avoir le même rang1 ».
En réalité, Arnauld et Bayle reprennent et développent une expression utilisée dès 1650 dans un libelle français, pour commenter le régicide anglais :
Les monarchiques, c’est-à-dire tous les bons Français, considèrent les désordres d’Angleterre sans s’en émouvoir. Aveugles qui ne voient pas que c’est un préjugé des extrémités où nos révoltes peuvent conduire cet État : l’esprit républicain est contagieux, ses douceurs flairées par les tyrannisés sont des amorces de rébellion ; le prétexte de liberté qui lui sert de titre le plus spécieux est le plus ordinaire motif de ceux qui nient que l’unité de gou-vernement puisse compatir avec la franchise de la raison ; et le pouvoir qu’il donne au mérite de s’élever aux charges sans la conduite de la naissance et de la faveur, est un aiguillon qui n’a que trop souvent regimber les plus fidèles sujets, pour secouer le poids de la monarchie, qui leur commençait à sembler intolérable2.
Passage remarquable qui condense en quelques lignes certains traits fondamentaux de la pensée républicaine que nous rencontrerons chez Sidney : l’esprit républicain abhorre la tyrannie au point de toujours se méfier des monarques, fussent-ils vertueux ; il porte à la révolte, et motive cette dernière par le désir légitime d’une douce liberté ; il nie que la conscience des individus soit libre quand l’autorité politique n’est pas susceptible de rendre des comptes et d’être déposée ; il exige que les honneurs soient les e&ets de la seule vertu, et cette exigence nuit non seulement à la logique courtisane de la fidélité aux puissants, mais
1 C. Taylor, « L’atomisme », in La liberté des modernes, trad. P. de Lara, Paris, PUF, 1999, p. 224.
2 Dubosc-Montandré, L’aveuglement de la France depuis la Minorité, 1650, p. 17 ; il faudrait en réalité remonter plus loin encore : comme le montre A. Herman, « The Huguenot Republic and Antirepublicanism in Seventeenth-Century France », Journal of the History of Ideas, 53, 1992, p. 249-69, bien avant le régicide anglais, le terme républicain est utilisé en France dans la première moitié du xviie pour critiquer les calvinistes français hostiles à la monarchie. Cf. également les travaux de S. Testoni Binetti, « Il mito repubblicano e l’orrore della tirannide. Le reveille-matin des François nella letteratura ugonotta dopo la trage di S. Bartolomeo », in I Percorsi della libertà. Scritti in onore di Nicola Matteucci, Bologne, Il Mulino, 1996, p. 47-68 ; « L’idea di repubblica e il repubblicanesimo ugonotto dopo il massacro di San Bartolomeo », Filosofia politica, 1, 1998, p. 37-56 ; Il pensiero politico ugonotto : dallo studio della storia all’idea di contratto, 1572-1579, Florence, Centro Editoriale Toscano, 2002.
24 L’ESPRIT RÉPUBLICAIN
s’allie en outre au désir de liberté pour contester la monarchie dans son principe même. La même année, à l’aide d’une comparaison peu flatteuse, François Davant reprochera à l’auteur de ce libelle d’avoir ainsi fustigé l’esprit républicain des Anglais qui se sont libérés de la royauté : « celui qui aime un méchant esclavage ne doit pas combattre la juste liberté, et ceux qui ont un bon joug, n’ont point raison de renverser ceux qui ne les tyrannisent pas1 ».
Qu’ils l’aient ou non rencontré dans ses Discourses, les accusateurs de Sidney usent également de l’adjectif republican ; ils entendent en particulier souligner que la doctrine de Sidney est structurée par des « principes républicains (republican principles)2 » a%rmant la thèse du droit inaliénable du peuple à résister au souverain. En ce sens, pour-suivent-ils, ces principes rappellent infailliblement la guerre civile de 1642 et le régicide de 1649 – événements décrits comme « les temps les plus rebelles qui furent jamais en Angleterre3 ». Ces idées doivent donc aux yeux des accusateurs éveiller en chacun la haine la plus profonde, car « mis en application, ces principes républicains ne détruirons pas seulement le roi, mais la meilleure monarchie du monde4 ».
En 1684, l’année suivant l’exécution de Sidney, The Royal Apology cherche à mettre en évidence une équation simple et saisissante qui développe en une cinquantaine de pages l’intuition que le titre complet de l’ouvrage énonce déjà explicitement en quelques lignes : L’apologie royale, ou une réponse à l’argument des rebelles, où sont distinctement considérés les principes anti-monarchiques les plus connus, d’abord publiés par Doleman le Jésuite pour promouvoir un Bill d’exclusion contre le Roi James, ensuite pratiqués par Bradshaw et les régicides dans l’assassinat e"ectif du Roi Charles Ier, et enfin republiés par Sidney et les Associés pour déposer et assassiner sa Majesté actuelle. Avec un parallèle entre Doleman, Bradshaw, Sidney et d’autres membres du party des vrais Protestants5. L’adversaire théorique que se donne l’auteur
1 François Davant, Avis à la Reine d’Angleterre et à la France, pour servir de réponse à l’auteur qui en a représenté l’aveuglement (1650), in La Fronde. Contestation démocratique et misère paysanne. 52 Mazarinades, éd. H. Carrier, Paris, EDHIS, 1982, vol. 1, texte no 16, p. 4.
2 The Tryal of Algernon Sidney Esquire, nov. 7th. 1683, op. cit., p. 13.3 Ibid., p. 12.4 Ibid., p. 13.5 The Royal Apology ; or, an Answer to the Rebels Plea, wherein, The most Noted Anti-Monarchical
Tenents, First published by Doleman the Jesuite, to promote a Bill of Exclusion against King James. Secondly Practised by Bradshaw ant the Regicides in the actual Murder of King Charles the 1st.
INTRODUCTION 25
et qui est censé douter d’une telle démonstration est décrit comme « l’objecteur républicain1 ».
Il en va de même dans l’exposé o%ciel de la conspiration à laquelle Sidney est censé avoir participé. Thomas Sprat, l’auteur de A True Account and Declaration of the Horrid Conspiracy against the late King, his present Majesty, and the government (1685), pense trouver de quoi établir la culpabilité de Sidney « presque à chaque ligne » de ses écrits, et avance que l’auteur des Discourses concerning government ne fait que réactualiser les principes des rebelles puritains du milieu du siècle, puisqu’il y développe, « selon le raisonnement faux et habituel de tous les auteurs républicains (republican writers) », « de nombreuses doctrines horribles contre la monarchie en général et la monarchie anglaise en particulier2 ». Les éléments de cette argumentation républicaine ont déjà été détaillés plus tôt dans le récit (obéissance des sujets conditionnée par un contrat mutuel (mutual covenant) ; recouvrement par le peuple de sa liberté naturelle contre les actions arbitraires du gouvernement, et légitimité du droit de revendiquer cette liberté contre un tyran domestique ou étranger3), et Sprat cite à l’appui de son propos quelques extraits per-tinents des Discourses4. Mais c’est dès les premières pages de son récit qu’il prend le soin de mettre en évidence que ceux qui, à l’instar de Sidney, complotaient contre Charles II et voyaient la tyrannie partout ne faisaient en réalité qu’« a%rmer » à nouveau « toutes les vieilles doctrines républicaines et antimonarchiques (all the old republican, and antimonarchical doctrines)5 » qui s’étaient avérées fatales au gouvernement royal et au roi lui-même quelques décennies plus tôt. Dans la mesure
Thirdly, Republished by Sidney and the Associators to depose and Murder his present Majesty, are distinctly consider’d. With a Parallel between Doleman, Bradshow, Sidney and other of the True-Protestant Party, Londres, 1684 ; sur les « principes anti-monarchiques », cf. p. 3.
1 Ibid., p. 36 ; l’opposant « républicain » est présenté dès les premières lignes (cf. To the Reader, [p. iii]) ; cf. également p. 7 (« républicains dissidents (dissenting republican) »), p. 11 (« la lubie républicaine (republican fancy) d’un pouvoir coordonné entre les Communes, les Lords et le Roi), p. 16 (« politiciens républicains (Republican Polititians) »), p. 37, 44 (republicans), p. 58 (« clubs républicains (republican clubs) ») ; même expression dans A True Account and Declaration of the Horrid Conspiracy against the late King, his present Majesty, and the government, 1685, p. 19.
2 A True Account and Declaration of the Horrid Conspiracy against the late King, his present Majesty, and the government, p. 131.
3 Ibid., p. 43-4.4 Ibid., p. 131-2.5 Ibid., p. 3.
26 L’ESPRIT RÉPUBLICAIN
en e&et où ces idées « jetèrent les bases de la dernière guerre misérable contre le père béni de sa Majesté [i.e., Charles Ier] », « à chaque fois que la multitude sera infectée par de telles doctrines antimonarchiques », les mêmes e&ets s’ensuivront1. Il souligne enfin que la prière qui achève le Sca"old Paper de Sidney n’a pu être « dictée que par la rencontre d’un esprit républicain féroce et d’un esprit enthousiaste furieux (fierce repu-blican, and a furious enthusiastical spirit met together)2 ». La même année, l’auteur de Salus Britannica adopte la même ligne d’attaque, et ce dans des termes fort similaires : décrit comme l’auteur « qui répond à Filmer à partir de Buchanan et Milton », Sidney fait partie avec Shaftesbury des promoteurs d’« associations régicides » qui font du papisme « le seul prétexte pour mener à bien leurs machinations en vue d’établir une république infernale (hellish republick machinations)3 ».
Si l’identification d’un terme ne permet en elle-même jamais de saisir l’éventuel concept qu’il recouvre, et s’il faudrait par conséquent conduire l’étude précise de tous ces textes qui invoquent l’esprit et les principes républicains avant de pouvoir a%rmer qu’une doctrine républicaine en émerge, on peut au moins poser fermement qu’il est tout à fait légitime d’utiliser la catégorie de républicanisme pour rendre compte de certaines thèses et de certains arguments formulés dans la pensée politique anglaise du xviie siècle – ou plutôt, objectera-t-on, pour rendre compte de la manière dont étaient dénoncés ces principes. Car précisément, les quelques citations que nous venons de reproduire n’établissent en rien que Sidney endosse e"ectivement cet esprit républicain à l’aide duquel ses adversaires qualifient les principes à l’œuvre dans les Discourses, et au fondement du régicide de 1649 justifié par Milton. Après tout, la colo-ration rhétorique de toutes les invocations de l’esprit républicain que nous avons rencontrées pourrait n’être que le symptôme d’une stratégie
1 Ibid., p. 133. Lorsque Georges Je&reys, Président de la Haute Cour d’Angleterre chargé de juger Sidney, résume ce qui est reproché à ce dernier, il s’exprime de manière similaire : il souligne que tout ce qu’écrit Sidney ne peut que rappeler « la récente et malheureuse rébellion », qui eut pour e&et de conduire Charles Ier à l’échafaud, et qui fut « initiée par de tels principes », cité par C. Robbins, « Algernon Sidney’s Discourses Concerning Government : Textbook of Revolution », William and Mary Quarterly, 3e série, 4, juin 1947, p. 294.
2 Ibid., p. 135. Le document que Sidney remis sur l’écha&aud est traduit dans son intégralité par P. Carrive dans son ouvrage La pensée politique d’Algernon Sidney, op. cit.
3 [Anon.], Salus Britannica : or, the Safety of the Protestant Religion, against all the present appre-hensions of popery fully discust and proved. Wherein all the popular fears, and imaginary dangers, are wholly dissipated and confuted, against all objections whatever, Londres, 1685, p. 22.
INTRODUCTION 27
de caricature déployée par les défenseurs de l’ordre monarchique afin de décrédibiliser les propositions d’auteurs comme Sidney. Instrument commode pour frapper d’anathème les critiques de l’ordre établi, l’esprit républicain ne serait jamais revendiqué positivement par quiconque.
Cette objection n’a en réalité pas d’objet. Sidney emploie en e&et lui aussi l’expression dans un contexte qui dissipe toute ambiguïté : il s’agit pour lui, comme nous allons le voir immédiatement, de décrire ce que Filmer a jugé si insupportable et si dangereux pour le pouvoir monarchique.
Or, ce que Filmer a cherché à détruire, Sidney s’emploie à le réhabi-liter. Défendre une juste liberté à l’aide de la théorie du droit naturel mais dans le cadre général d’une compréhension républicaine de la société politique, où la vertu est moins la finalité de la république que le soutien des lois protectrices de l’indépendance de chacun, voilà en e&et la tâche que se donne Sidney dans sa réfutation de Filmer. Supposer avec Filmer que « la monarchie soit imposée au genre humain par les lois immuables de Dieu et de la nature », et que « le monarque doive être, selon les mêmes lois, absolu et non contrôlé », a%rme Sidney dans la section qui ouvre les Discourses concerning government, c’est chercher à « détruire les principes qui semblent depuis l’origine avoir été communs à toute l’humanité1 ». Ces principes seront détaillés tout au long de la réfutation que Sidney propose du Patriarcha, mais dès les premières pages, il en donne le précipité :
À en croire Sir Robert […] rien ne fut jamais laissé au choix des hommes ; ces derniers ne doivent pas s’enquérir de ce qui conduit à leur propre bien. Dieu et la nature nous ont assigné un chemin dont nous ne devons pas nous écarter : nous ne vivons pas pour Lui ou pour nous-mêmes, mais pour le maître qu’il a placé au-dessus de nous. (D, I, 1, p. 6)
Ce pouvoir de choisir qui distingue l’homme dans la nature n’est rien d’autre que « le principe de liberté dans lequel Dieu nous a créés et qui comprend tous les principaux avantages de la vie dont nous jouis-sons », principe que Filmer cherche à « renverser » en déclarant ainsi la guerre au genre humain. Or, de cette liberté originaire qui définit la
1 A. Sidney, Discourses concerning government (1681-3), éd. T. West, Indianapolis, Liberty Fund, 1996, I, 1, p. 6-7 (désormais cité D suivi de : chi&res romains (pour le livre), chi&res arabes (pour la section) et numéro de la page).
28 L’ESPRIT RÉPUBLICAIN
nature de l’homme, Sidney déduit ce qu’ont nié les absolutistes à l’aide de di&érents arguments, à savoir que les peuples et les individus qui les forment établissent les sociétés civiles « par un droit universel que Dieu et la nature leur a conféré » (D, I, 16, p. 49).
Inutile donc de multiplier pour le moment les citations : Sidney endosse la thèse de la liberté naturelle des hommes, et conçoit cette liberté comme le droit naturel qu’ils possèdent d’établir la société politique de leur choix et de la modifier quand bon leur semble.
Mais lorsqu’il vient à considérer la question capitale des fondements de la confiance entre le peuple et les magistrats, il fait appel à la « loi de nature » qui consiste à tenir ses promesses. Or, Sidney la relie à un principe moral qui est le propre de l’homme. En e&et, « celui qui s’écarte de ce principe écrit dans le cœur des hommes, pactis standum, semble dégénérer à l’état de bête ». Il n’est pas question ici d’un principe théologique, car c’est « de la loi de nature que nous apprenons la nécessité de respecter nos engagements ». C’est d’ailleurs pourquoi les païens vertueux sont un exemple si pertinent pour cette question : Sidney est sensible à la manière dont Juvénal s’appuyait sur la conscience que l’homme est censé avoir de sa dignité pour l’exhorter à la résistance face aux tentations de la corruption. Même en le menaçant de mort, un tyran ne parviendrait pas à contraindre un homme digne à mentir ou à se dédire, car ce der-nier sait qu’il « doit préférer son intégrité à sa vie ». En réalité, poursuit Sidney, ce devoir de se comporter de manière digne est au fondement de la vertu, et il est aussi constitutif de « l’esprit républicain » :
Bien que l’on puisse excuser Filmer de se tromper souvent en matière de théologie, ses inclinations envers Rome, qu’il préfère à Genève, auraient néanmoins pu le conduire aux principes dans lesquels vécurent les honnêtes Romains s’il n’avait pas réalisé que les mêmes principes qui rendent les hommes honnêtes et généreux les rendent également amoureux de la liberté et constants dans la défense de leur pays. Ces principes sentant trop l’esprit républicain (republican spirit), il a préféré les mœurs de cette cité depuis qu’elles ont été ra%nées par les pieux et charitables Jésuites, à celles par lesquelles les Romains se distinguaient tant qu’ils conservèrent une ombre de leur ancienne intégrité, laquelle n’admettait aucune équivoque ni aucun faux-fuyant honnis. Cette intégrité préservait de la sorte l’innocence aussi bien dans les cœurs des hommes privés pour leur contentement intérieur, que dans les sociétés civiles pour le bien public, dont la disparition plonge immédiatement et nécessairement le genre humain dans la condition que Hobbes a justement appelé bellum omnium contra omnes, condition dans laquelle aucun homme
INTRODUCTION 29
ne peut se promettre aucune autre femme, aucun autre enfant, aucun autre bien que ceux qu’il peut se procurer par sa propre épée. (D, III, 19, p. 431-2)
Autrement dit, la marque de ce que Sidney lui-même appelle « l’esprit républicain » tient au fait que les principes qui rendent les citoyens vertueux, intègres, fidèles à leur parole, et obéissant aux lois, sont les mêmes que ceux qui leur font aimer leur liberté et défendre leur patrie. Contre ceux qui s’inquiètent des tendances tumultueuses, asociales et anomiques d’un peuple élevé dans l’amour de la liberté, Sidney insiste sur le fait qu’un tel peuple est, pour garder l’expression de Filmer1, « avide de liberté » sur les mêmes fondements qu’il est vertueux. Ainsi, là où Filmer craint dans l’amour de la liberté le plus dangereux ferment d’anarchie, là où Hobbes voyait similairement dans l’esprit républicain la cause de la guerre civile2, Sidney en fait au contraire la condition de possibilité de toute société civile, et par conséquent la seule issue possible à la guerre généralisée de l’état de nature3.
Si les commentateurs n’ont pas fait grand cas de l’invocation par Sidney de cet « esprit républicain », tous ont néanmoins souligné la prégnance des thèses et arguments républicains dans sa pensée politique et morale. Pourtant, la nature des rapports précis qu’entretiennent cet esprit républicain et le jusnaturalisme est loin d’avoir été mise en évi-dence dans les études sur Sidney.
La réponse à une telle question ne peut éluder un élément de contexte dont la banalité a peut-être masqué l’importance : la théorie du droit naturel et le républicanisme que mobilise Sidney ici sont tous deux destinés à répliquer à l’attaque de Filmer dans Patriarcha. Si l’on suit la classification de J. Sommerville4, on peut a%rmer que Filmer avait en e&et
1 « a people greedy of liberty », Filmer Patriarcha (1680), in Patriarcha and others writings, éd. J. Sommerville, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, p. 45 [226]. (Nous citons toutes les œuvres de Filmer dans cette édition ; les indication entre crochets renvoient à la page de l’édition française de Patriarcha, in F. Lessay, Le débat Locke-Filmer, Paris, PUF, 1998, p. 143-257.) Sidney cite ce passage en D, III, 24, p. 454 ; cf. également D, III, 33, p. 513.
2 Hobbes, Behemot, or the Long Parliament (1679), trad. L. Borot, Paris, Vrin, 1990, p. 94.3 Di%cile de démentir plus frontalement l’hypothèse straussienne qui voudrait que le
républicanisme de Sidney fût un héritier du « libéralisme » de Hobbes ; V. Sullivan, Machiavelli, Hobbes & the Formation of a Liberal Republicanism in England, op. cit., chap. 6, p. 199-226.
4 J. Sommerville, Politics and Ideology in England, 1603-1640, London-New York, Longman, 1986, chap. 1-2.
30 L’ESPRIT RÉPUBLICAIN
visé les trois formes d’anti-absolutisme disponibles à l’époque : il attaqua le républicanisme romain en décrédibilisant la république romaine au profit de l’empire ; il dénonça comme dangereuse l’idée selon laquelle le peuple est naturellement souverain et ne fait que déléguer son pouvoir aux magistrats ; il s’en prit enfin à la théorie de l’Ancienne constitution qu’il associait aux critiques parlementaires de Charles Ier1. Or, comparée à la réplique mieux connue de Locke et formulée uniquement sur le terrain du droit naturel, celle de Sidney apparaît indéniablement comme plus complète. Si la comparaison détaillée de ces deux réponses reste à faire, elle n’est pas notre objet ; en revanche, l’enjeu qui nous occupe est bien entendu de savoir si la cohabitation des deux traditions2 dans lesquelles Sidney puise pour répondre à Filmer entame ou non la cohérence de son argumentation. L’historien J. Scott – qui a consacré deux livres à Sidney en particulier, deux autres et une dizaine d’articles au républicanisme anglais en général – répond par l’a%rmative à cette question :
Les réponses de Sidney et de Locke sont des réa%rmations, à l’encontre des attaques de Filmer, de l’un ou plusieurs de ces trois types d’anti-absolutismes. La di&érence principale est que Locke choisit de construire sa réfutation sur la base de la seule théorie de la loi naturelle ; le résultat est une réfutation incomplète mais une théorie cohérente. Sidney, inversement, déterminé à réfuter Filmer sur tous les fronts, réa%rme chacune des trois théories que Filmer avait attaquées. Il s’ensuit – conclut Scott, qui ne dissimule pas le parti qu’il choisit – une victoire typiquement sidneyenne de la complétude sur la cohérence3.
Pourtant, le non sequitur saute aux yeux : de ce que la réfutation uni-latéralement jusnaturaliste de Locke est cohérente, il ne suit pas que
1 Sur le langage de l’Ancienne constitution jusqu’au déclenchement de la guerre civile, cf. G. Burgess, The Politics of the Ancient Constitution : An Introduction to English Political Thought, 1603-1642, Londres, MacMillan, 1992.
2 Scott soutient (Sidney II, p. 209) que Sidney défend contre Filmer également la thèse de l’ancienne constitution. En réalité, son rationalisme le conduit à a%rmer clairement qu’une loi ne doit être suivie que parce qu’elle est juste, et jamais seulement parce qu’elle est ancienne (D, III, 25, p. 459-60, et D, III, 11, p. 380-1). Comme l’a montré J. Conni&, cela ne signifie pas que Sidney n’utilise pas les arguments et les exemples familiers dans la littérature de l’ancienne constitution, cf. « Reason and History in Early Whig Thought : The Case of Algernon Sidney », Journal of the History of Ideas, 43, 3, 1982, p. 397-416. Cela signifie en revanche clairement que la légitimité du droit coutumier dépend de sa conformité à la loi naturelle accessible à toute raison individuelle, et non de son immémorialité.
3 Scott, Sidney II, p. 208-9.
INTRODUCTION 31
celle de Sidney, qui s’appuie sur le droit naturel et le républicanisme, est incohérente. À moins, bien entendu, de supposer a priori que le répu-blicanisme et le jusnaturalisme sont par nature incompatibles. Or, un tel présupposé est non seulement loin d’être établi, mais encore mis à mal par l’examen de ce que semble signifier, pour ceux qui l’utilisent, le syntagme « esprit républicain ».
LE PARADIGME POCOCKIEN : L’INCOMPATIBILITÉ THÉORIQUE ENTRE DROITS ET VERTU
La pensée de Sidney, dont Scott croit un moment pouvoir établir l’unité profonde au-delà des schémas historiographiques inopérants, n’est donc, de son propre aveu, qu’un composé incohérent. Comment expliquer que Scott abandonne finalement le projet d’établir la cohérence de la pensée de Sidney ? Il n’est pas impossible que ce soit parce qu’il hérite, à ses dépens, du modèle que Pocock a proposé aux historiens des idées – modèle construit sur l’incompatibilité théorique entre la vertu et les droits.
En e&et, bien que l’hypothèse républicaine de Pocock semble à pre-mière vue historique et circonstanciée – comme le laisse entendre le sous-titre de Vertu, commerce et histoire : « Essais sur la pensée et l’histoire politique au XVIIIe siècle1 » – on s’aperçoit rapidement qu’elle est adossée à un véritable paradigme philosophique, plutôt qu’issue d’une lecture scrupuleuse des textes. Notre critique de principe ne conteste pas la fécondité du paradigme républicain de Pocock : on doit admettre qu’il a contribué plus que quiconque à rendre tout simplement visible une tradition politique républicaine moderne irréductible au libéralisme. Mais dès que l’on aborde des auteurs comme Sidney, il est tout aussi nécessaire de reconnaître que la fécondité même de son paradigme républicain, construit pour s’opposer au libéralisme, s’est avérée un écran
1 Cf. également J. Pocock, « Early Modern Capitalism – the Augustan Perception », in Kamenka & Neale (dir.), Feudalism, Capitalism and beyond, Londres, Edward Arnold, 1975, p. 63 ; « Cambridge paradigms and Scotch philosophers : a study of the relations between the civic humanist and the civil jurisprudential interpretation of eighteenth century social thought, in Wealth and Virtue, op. cit., p. 241-7.
32 L’ESPRIT RÉPUBLICAIN
opaque rendant incompréhensible une partie significative de cette même tradition.
Ainsi le Moment machiavélien ne reconstruit-il pas seulement une philosophie politique et sociale qui émerge à la Renaissance sous la forme de la réhabilitation de l’idée aristotélicienne selon laquelle « seule la vie du citoyen [est] véritablement éthique et humaine1 ». Ce grand livre propose plus fondamentalement de décrire l’incarnation historique du langage de la vertu qui s’oppose intrinsèquement au langage juridique investi par le libéralisme. Comme le confirment cette fois-ci sans ambi-guïté ses articles sur le « modèle pour les historiens de la pensée2 » et sur les « Paradigmes de Cambridge3 », l’hypothèse de Pocock porte sur la nature même des concepts de droit et de vertu : « le concept fondamental de la pensée républicaine est la virtus ; le concept fondamental de toute jurisprudence est nécessairement le ius ; et il n’existe pas de manière connue de faire de la vertu un droit ». Si le concept de droit implique la « nécessité de passer par l’idée que l’homme est propriétaire des choses », c’est le contraire qui est vrai pour la vertu. En e&et, « la virtus (au sens rigoureusement politique du terme) se rapporte exclusivement aux relations entre personnes », alors que « le ius a son origine dans une myriade de points de départ relatifs à la possession, la distribution et l’administration des choses4 ».
La république est en e&et un régime libre (vivere libero), constitué d’hommes qui ne sont libres qu’au sens où ils sont engagés dans une vie civique (vivere civile) : dans le paradigme républicain, l’individu sent « que ce n’est qu’en tant que citoyen, qu’animal politique impliqué dans un vivere civile avec ses semblables », qu’il peut « accomplir sa nature, atteindre la vertu et trouver rationnel le monde » au sein duquel il évolue5. Le citoyen est libre dans la participation politique, parce que c’est
1 J. Pocock, Le moment machiavélien. La pensée politique florentine et la tradition républicaine atlantique (1975), trad. L. Borot, Paris, PUF, 1997, p. 62 ; « Early Modern Capitalism », art. cit., p. 65.
2 J. Pocock, « Vertus, droits et mœurs. Un modèle pour les historiens de la pensée », in Vertu, Commerce et Histoire. Essais sur la pensée et l’histoire politique au XVIIIe siècle, trad. H. Aji, Paris, PUF, 1998, chap. ii.
3 J. Pocock, « Cambridge paradigms and Scotch philosophers », art. cit., p. 235-52.4 Ibid., p. 248.5 J. Pocock, Le moment machiavélien, op. cit., p. 127 ; « Cittadini, clienti e creditori : la repub-
blica come critica del mutamento storico », in M. Viroli (dir.), Libertà politica e virtù civile, Turin, Edizione Fondazione Giovanni Agnelli, 2004, p. 133-147.
INTRODUCTION 33
principalement en s’exprimant directement dans l’activité civique que l’homme développe sa « personnalité morale1 ». Il réalise de la sorte sa nature d’être politique actif : la vertu civique est donc la finalité de la vie humaine, et la participation l’unique forme que revêt la liberté authentique2.
Au contraire, dans une société fondée sur le droit, les hommes n’entrent en relation les uns avec les autres que par l’intermédiaire des choses, et le fondement des droits réciproques qu’ils se reconnaissent relève de leur nature de propriétaires : le langage juridique est « l’expression fondamentale de l’individualisme possessif » parce qu’il nourrit des « intérêts intrinsèques pour le meum et tuum et pour le suum cuique », et parce qu’il induit nécessairement une représentation libérale du monde, où l’individu, et son monde social comme son monde moral, sont définis dans les termes des transactions de propriété dans lesquelles il est engagé3.
Pocock assume donc pleinement la représentation du droit naturel proposée par Macpherson4, pour qui la liberté de l’homme est définie essentiellement dans le cadre d’un individualisme possessif et égoïste5. À cet égard, il n’est pas impossible que pour récuser l’omniprésence de l’individualisme possessif, et pour réfuter la thèse d’un « xviiie siècle monolithiquement lockien6 », Pocock ait été contraint d’élaborer son opposition paradigmatique en ratifiant la conception du droit naturel
1 J. Pocock, Le moment machiavélien, op. cit., p. 46, 311, 324 ; « States, Republics, and Empires : The American Founding in Early Modern Perspective », in T. Ball et J. Pocock (dir.), Conceptual change and the Constitution, Lawrence, University Press of Kansas, 1988, p. 65.
2 Cf. J. Hexter, « Review Essay de The Machiavellian Moment », History and Theory, XVI, 1977, p. 330 ; il souligne ainsi que pour l’humanisme civique, le cœur de la liberté est la participation politique.
3 J. Pocock, « Cambridge Paradigms », art. cit., p. 249, et Vertu, commerce et histoire, op. cit., p. 64.
4 C. B. Macpherson, La théorie politique de l’individualisme possessif de Hobbes à Locke (1962), trad. M. Fuchs, Paris, Gallimard, Folio, 2004.
5 Cf. J. Pocock, « Early Modern Capitalism », art. cit., p. 81 : la « déficience » propre à « l’idéologie individualiste » est que « l’individu d’une théorie rationnelle égoïste » ne pouvait pas faire appel au paradigme de la vertu, là où l’humanisme civique pouvait au contraire fonder la personnalité morale et politique de l’homme ; cf. également, J. Pocock, « The myth of John Locke and the obsession with liberalism », in J. Pocock et R. Ashcraft, John Locke. Papers read at a Clark Library Seminar 10 december 1977, William Andrews Clark Memorial Library, University of California, Los Angeles 1980 ; pour Macpherson, cf. op. cit.
6 J. Pocock, « Early Modern Capitalism », art. cit., p. 70-1 ; « Virtue and Commerce in the Eighteenth century », Journal of interdisciplinary History, III, 1, 1972, p. 127.
34 L’ESPRIT RÉPUBLICAIN
adoptée par son adversaire1. Mais aussi suggestive que soit l’opposition qui en a résulté, elle est manifestement inappropriée pour comprendre la pensée d’un républicain tel que Sidney : à ses yeux, les lois sont constitutives de la liberté du citoyen moins parce qu’elles le définissent comme propriétaire que parce qu’elles assurent l’égalité indispensable à la liberté entendue comme absence de domination. Impossible, dans le paradigme de Pocock, d’expliquer le fait que l’antonyme même de la vertu – la corruption – serve chez Sidney à décrire la manière dont le système juridique se retourne contre sa finalité qui est de protéger les biens, la vie, et la liberté des citoyens2.
En outre, c’est dans un sens exactement contraire à la présentation pocockienne du droit naturel que Sidney envisage l’idée de droit naturel inaliénable à la liberté : les droits que les hommes doivent se recon-naître sont des droits moraux, indissociables des notions d’autonomie, d’indépendance et de dignité attachées à chacun du fait de sa nature d’être libre et rationnel. Violer les droits individuels, pour Sidney, ce n’est pas attaquer les richesses des personnes conçues comme des pro-priétaires, c’est les asservir, et ce faisant les dégrader en les soumettant à une condition sous-humaine3. La notion de droit est donc pour Sidney tout sauf médiatisée de manière intrinsèque par les choses : elle exprime au contraire le propre de l’homme, capable de régler son existence avec ses semblables par des lois qui ne sont pas principalement des règles de distribution des biens, mais des normes qui rendent possible des relations authentiquement humaines, fondées sur l’égale condition de chacun.
Pour autant, la valorisation du système juridique, ainsi que la repré-sentation jusnaturaliste de la liberté, n’empêchent aucunement de concevoir la république comme une structure morale ; mais il ne s’agit pas ici de développer la personnalité de l’homme par la pratique des activités civiques : le but de la république est d’assurer à chacun une existence émancipée de toute forme de domination, et non de conduire les hommes à la vertu.
Il faut donc également réviser la manière dont Pocock conçoit la vertu : celle-ci n’est pas le bien suprême que l’homme aurait à poursuivre afin
1 Cela est particulièrement clair dans « The myth of John Locke and the obsession with liberalism », art. cit. p. 11-3, 18-9 ; cf. « Early Modern Capitalism », art. cit., p. 67.
2 Cf. notre section « La corruption comme atteinte » (2e partie), p. 264-270.3 Cf. notre section « L’individualisme républicain » (2e partie), p. 215-270.
INTRODUCTION 35
de réaliser sa nature d’animal politique, mais le soutien nécessaire des lois protectrices de la liberté individuelle et collective. Sidney reconnaît bien l’importance des vertus cardinales, mais lorsqu’il se prononce sur la finalité de l’État, il n’évoque pas la nécessité de prendre soin des âmes des citoyens en les conduisant à la vertu, mais le devoir du magistrat de protéger la liberté. Il soutient même explicitement que c’est aux gouvernants et aux citoyens d’être vertueux s’ils veulent conserver et défendre leur liberté1. Ce que Sidney appelle « l’intégrité des mœurs » est un élément central de la société libre telle qu’il la conçoit, mais les vertus sont moins des excellences morales intrinsèques que des moda-lités d’exercice de la liberté : le courage est nécessaire pour recouvrer sa liberté perdue, la modération cruciale pour ne pas désirer empiéter sur la liberté des autres et détruire ainsi sa propre liberté, le sens de la justice décisif pour évaluer la conformité des lois à leur fonction de protection de la liberté.
Pour Sidney au moins, il est donc erroné de soutenir que « la répu-blique classique [soit] un produit rare et inaperçu de l’état de nature du juriste2 ». Car cette description est inadéquate : la république classique où les citoyens sont libres parce qu’ils sont vertueux est précisément à ses yeux la structure politique la plus conforme à la loi de nature de l’homme, créature rationnelle destinée à la liberté. Mieux, la descrip-tion de l’état de nature a chez Sidney pour fonction première moins d’exposer la nécessité d’un transfert de droits en vue jouir de sa pro-priété que de rendre compte de la rationalité de l’homme qui cherche à mener l’existence de son choix tout en se conformant à sa nature d’être libre. Autrement dit, loin d’être incompatible avec les notions d’état de nature, de loi et de droits naturels, la république – où la loi souveraine met chacun à l’abri de la dépendance personnelle – est au contraire la forme politique qui protège le plus e%cacement la liberté qui définit la nature de l’homme.
La démarche de Pocock – qui consiste donc à réifier les paradigmes – est d’autant plus frappante qu’il connaît parfaitement le danger que courent les historiens des idées en construisant des modèles rivaux d’explication : « tout le monde est soucieux d’éviter le sophisme des vases communicants (two-buckets fallacy), qui soutient que les explications rivales sont mutuellement
1 Cf. notre section « La vertu civique comme soutien de la liberté », (2e partie).2 J. Pocock, « Cambridge Paradigms », art. cit., p. 249.
36 L’ESPRIT RÉPUBLICAIN
exclusives, si bien qu’en renforcer une, c’est nécessairement a&aiblir l’autre1 ». Il reconnaît même explicitement qu’il serait « faux » de supposer que « les langages républicain et juridique [furent] des rhétoriques distinctes et idéologiquement opposées » chez les auteurs des Lumières écossaises, car leur « méthode syncrétique » les fit intégrer des auteurs comme Sidney et Harrington à leur théorie de la jurisprudence modernisée. Mais demeure toujours la question, selon Pocock, de savoir « dans quelle mesure le concept de “vertu” – par-dessus tout dans son sens rigoureusement civique – était en tension avec le “sens moral”, et dans quelle mesure, si cette tension a jamais existé, elle fut dépassée2 ».
Or, avant de se poser la question des rapports de la vertu civique avec le sens moral des Écossais qui s’inspirent à la fois de Locke, Sidney et Harrington, il serait souhaitable de revenir à ces auteurs du xviie siècle qui eux-mêmes font déjà un usage des deux langages, comme Pocock le souligne d’ailleurs lui-même3. La raison pour laquelle Pocock a laissé de côté cette question tient certainement à la réticence qu’il a manifestée à analyser les modalités de rencontre du langage juridique et du langage républicain. En e&et, lorsqu’il est revenu sur les réactions suscitées par son Moment machiavélien, il a reconnu avoir écrit une histoire abstraite : « puisque toute histoire est écrite de manière sélective, toute histoire peut être accusée d’abstraction ». Pocock, qui s’est intentionnellement concentré sur l’idée de « la liberté active-participative » aux dépens de l’idéal « négatif-libéral4 », plaide donc coupable. Mieux, il admet que l’on puisse écrire l’histoire di&éremment, comme Skinner l’a fait selon lui dans le premier volume des Fondements de la pensée politique moderne, en montrant comment les cités italiennes justifièrent leur indépendance en termes juridiques tout en développant une conception de la vertu civique. Néanmoins, poursuit Pocock, si les deux langages ont pu ici ou là être « alignés du même côté », il est plus juste de supposer que le droit et la vertu sont fondamentalement incompatibles : « nous sommes dans une
1 Ibid., p. 248.2 Ibid., p. 251.3 Cf. J. Pocock, Politics, Language, and Times, Londres, Methuen et Co., 1972, p. 208, où il
parle des « doctrines du contrat, du droit naturel et de la raison proposées par Sidney et Locke » ; « England’s Cato : The Virtues and Fortunes of Algernon Sidney », The Historical Journal, 37, 4, 1994, p. 929-30.
4 J. Pocock, « The Machiavellian Moment Revisited : A Study in History and Ideology », Journal of Modern History, 53, 1981, p. 52.
INTRODUCTION 37
certaine mesure poussés dans cette direction par ce qui apparaît comme étant un hiatus marqué ou une discontinuité entre le vocabulaire ou le langage de l’humanisme civique et celui de la jurisprudence civile1 ».
Mais, objectera-t-on, pourquoi persister à vouloir les opposer théori-quement alors que les textes des républicains eux-mêmes semblent moins exclusifs ? Comment comprendre que Pocock se soit systématiquement désintéressé de cette alliance entre droit naturel et vertu républicaine, pourtant au cœur de l’abolition de la monarchie au milieu du xviie siècle, et constitutive de la réponse de Sidney à Filmer au début des années 1680 ? Pourquoi s’en désintéresser alors qu’il écrit lui-même, certes sans s’y arrêter, que le « canon whig » créé par Toland en publiant massive-ment les républicains du xviie siècle (dont Milton, Harrington et Sidney), fut un « canon républicain » au sens où tous étaient des défenseurs du « gouvernement régicide, pour ne pas dire du régicide lui-même2 » ?
« La raison » pour laquelle « nous sommes poussés » à croire que la vertu et les droits sont opposés, répond Pocock, « ne doit pas être cherchée loin ; c’est du moins ce que suggèrent fortement les prémisses du paradigme humaniste civique3 ». Autrement dit, doit-on comprendre, ce que suggèrent les textes mêmes que le paradigme est censé décrire n’est pas une raison su%sante pour écrire l’histoire de l’alliance entre droits et vertu. Ainsi, au moment crucial où il envisage la possibilité théorique d’une histoire des interactions entre les deux langages, Pocock s’en détourne et réitère de manière claire son présupposé philosophique : la « tension idéologique » entre ces deux langages découle de ce qu’ils contiennent en eux-mêmes « des structures de valeur politique opposées4 ».
Le soubassement conceptuel des paradigmes transforme ainsi la tension idéologique initialement observée dans l’histoire en une « di&érenciation théorique », une incompatibilité conceptuelle hors du temps, assimilable à une loi de la pensée autorisant le même genre de prédiction audacieuse que les lois de la nature :
Cette di&érenciation théorique a pour but d’expliquer un résultat prévisible de la recherche future ; à savoir, que certains aspects de la pensée sociale écossaise au xviiie siècle continueront à répondre au paradigme humaniste civique,
1 J. Pocock, « Cambridge paradigms », art. cit., p. 248.2 J. Pocock, Vertu, commerce, et histoire, op. cit. p. 290.3 J. Pocock, « Cambridge Paradigms », art. cit., p. 248.4 Ibid., p. 250.
38 L’ESPRIT RÉPUBLICAIN
alors que d’autres fourniront de meilleurs résultats quand ils seront traités par le paradigme juridique1.
Par conséquent, c’est uniquement la nature même des paradigmes (et plus du tout la richesse des textes eux-mêmes) qui nous pousse à regarder de cette manière l’histoire des relations entre le langage des droits et le langage de la vertu : le sophisme des vases communicants dénoncé plus haut est, en l’espèce, concluant. S’il faut prendre au sérieux « l’association persistante » entre d’un côté le républicanisme, la vertu comme finalité de l’État et l’idéal civique participatif de la liberté, et, de l’autre côté, le langage juridique, les droits de propriété, et l’idéal libéral de la liberté2, c’est avant tout parce qu’au fond, les concepts-clef qui caractérisent les paradigmes sont par nature mutuellement exclusifs :
La représentation juridique de la liberté s’avère donc être négative : elle fait la di&érence entre libertas et imperium, entre liberté et autorité, entre individualité et souveraineté, entre privé et public. […] Le vocabulaire républicain […] articul[e] une conception positive de la liberté : il a%rm[e] que l’homme, ani-male politicum, [est] constitué de telle manière que sa nature n’[est] pleinement accomplie que dans une vita activa, pratiquée dans le contexte d’un vivere civile3.
Bien sûr, l’intention initiale de Pocock était de rendre visible une tradition républicaine autonome du libéralisme ; on comprend donc qu’il se soit concentré sur Harrington, lequel ne fait pas appel au jus-naturalisme, ni à la théorie du contrat, ni au droit de résistance. Mais lorsque l’on aborde les textes d’une partie significative des républicains anglais du xviie siècle se pose la question de la pertinence conceptuelle de ce modèle exclusiviste.
Rien ne nourrit davantage ce doute relatif à la pertinence d’un modèle exclusiviste que les quelques pages que Pocock a consacrées à Sidney4 dans une revue critique de l’édition moderne des Discourses concerning government, ainsi que de quatre livres parus sur Sidney entre 1988 et 19935.
1 Ibid., p. 249-50.2 J. Pocock, « The Machiavellian Moment Revisited », art. cit., p. 53.3 J. Pocock, « Vertus, droits et mœurs », art. cit., p. 61.4 J. Pocock, « England’s Cato », art. cit., p. 915-35.5 Il s’agit des deux volumes, déjà cités, que Jonathan Scott a consacrés à Sidney (Sidney I, Sidney
II) ; de la biographie proposée par John Carswell, The Porcupine : the life of Algernon Sidney, Londres, John Murray, 1989 ; de l’édition moderne des Discourses concerning governement,
INTRODUCTION 39
Pocock rechigne fondamentalement à voir en Sidney un penseur républicain ; à sa décharge, ce n’est pas sans s’être e&orcé de chercher, selon une interrogation récurrente dans l’article, « quel genre de répu-blicain il fut1 ». Lorsqu’il se résout malgré tout à donner des réponses, c’est souvent pour invoquer la fierté aristocratique et le sens austère de l’honneur si caractéristiques de la personnalité de Sidney, fierté consciente d’elle-même et digne sens de l’honneur qui autorisent selon Pocock à se demander ce qu’il y a de républicain dans sa pensée2.
Pour Pocock, il n’y a en fait, sur ce chapitre, pas grand chose à dire. Dissimulant mal sa réticence, il concède, mais sans aucune conviction, que l’on puisse dire si l’on veut que Sidney est républicain au sens où il est hostile par principe à la monarchie3, et où il avance l’idée que les rois ne sont pas nécessaires, puisqu’un parlement d’élus peut gouverner seul4. De même, ajoute Pocock, si par le terme « républicain », on veut souligner le fait que Sidney se réfère aux modèles glorieux d’Athènes, de Sparte et de Rome, et utilise Tacite pour critiquer l’époque du Principat d’Auguste alors, si « l’on donne » cette « signification à ce terme », Sidney est républicain5.
Mais c’est visiblement en un sens faible : car être républicain au xviie siècle, pour Pocock, c’est être Harrington ou harringtonien6. Sidney, de fait, ne pense pas avant tout la république en termes institutionnels, il n’élabore pas une « république théorique » de l’envergure d’Oceana : il préfère justifier la résistance7. En outre, souligne Pocock, les Discourses de Sidney ressemblent aux Treatises de Locke, a%rment la thèse centrale de la liberté naturelle de l’homme, endossent la théorie de la souveraineté inaliénable du peuple et de son droit de révoquer le gouvernant quand il le veut ; « on peut si on le souhaite, commente Pocock, appeler cela
établie par T. West (Indianapolis, Liberty Fund, 1990) ; et du livre de A. Houston, Algernon Sidney and the republican heritage in England and America, Princeton University Press, 1991.
1 J. Pocock, « England’s Cato », p. 916.2 Ibid., p. 916, 917-8, 919, 921, 926, 929, 930 ; l’invocation du caractère de Sidney est aussi
l’argument avancé par P. Lurbe pour expliquer les prétendues incohérences de Sidney : « homme d’action impétueux, il n’avait guère le goût de théoriser », P. Lurbe, « Le répu-blicanisme belliciste d’Algernon Sidney », Cercles, 11, 2004, p. 36.
3 J. Pocock, « England’s Cato », p. 925, 926.4 Ibid., p. 918, 931.5 Ibid., p. 929-30.6 Ibid., p. 918, 919, 926, 928, 931.7 Ibid., p. 918, 928.
40 L’ESPRIT RÉPUBLICAIN
du “républicanisme” […] mais Sidney, comme Locke [et à la di&érence d’Harrington], est moins intéressé par la forme de la république que par son origine1 ». En somme, dit Pocock, Sidney est « d’abord un monar-chomaque, ensuite un républicain2 ».
Cette hiérarchie ne nous dit cependant toujours pas comment, fût-il secondaire, le républicanisme de Sidney s’articule avec les thèses jus-naturalistes. Mais Pocock, qui s’est, certainement autant que Skinner, distingué parmi les historiens des idées pour avoir montré la fécondité du recours à la notion de langage ou discours politique, n’a presque rien à dire de la coprésence de la vertu et du droit chez Sidney. Quand il parle de la vertu, c’est pour souligner sa dimension irréductiblement aristocratique et invoquer la biographie de Sidney3 : « son républica-nisme est un état d’esprit4 », non un ensemble de principes posés dans ses écrits. Et le seul paragraphe où il évoque la question des rapports entre le langage de la vertu et le langage des droits, c’est pour décré-dibiliser l’entreprise de Houston (auteur d’un des livres dont il fait la revue), qui a précisément cherché à montrer qu’on ne pouvait pas chez Sidney opposer le langage des droits et le langage de la vertu, comme le modèle pocockien y invite, ainsi que nous l’avons vu en détail. Pocock ne prend pas du tout au sérieux la thèse de Houston : Pocock rapporte cette entreprise immédiatement au débat américain entre libéralisme et républicanisme (aspect secondaire dans l’argument de Houston), et s’étonne que Houston tire du « modèle » pocockien « pour les historiens des idées » l’opposition entre droits et vertu5. Il apparaît en fait plutôt que cet étonnement masque un refus de s’engager dans une réponse qui l’obligerait à réviser son modèle.
C’est pourquoi, en définitive, Pocock se détourne des textes où Sidney élabore son républicanisme à l’aide des deux langages, et se réfugie dans le domaine plus consensuel de la biographie républicaine de Sidney. Le titre de l’article de Pocock est, sous ce rapport, instructif : « England’s Cato : The Virtues and Fortunes of Algernon Sidney ». Pocock voit en Sidney un personnage républicain, non un penseur républicain ; il nous parle
1 Ibid., p. 928, 929, 930.2 Ibid., p. 935.3 Ibid., p. 917-8.4 Ibid., p. 918.5 Ibid., p. 934.
INTRODUCTION 41
des vertus de Sidney, non du concept de vertu que ce dernier élabore dans son œuvre politique ; il voit en Sidney un héritier des monarchomaques, mais ne s’intéresse pas à la manière dont peuvent cohabiter la thèse du droit inaliénable à la liberté et la thèse du « sage » Machiavel qui, dit Sidney, « trouve la vertu si essentiellement nécessaire à l’établissement et à la préservation de la liberté qu’il juge impossible qu’un peuple cor-rompu établisse un bon gouvernement, ou qu’une tyrannie s’introduise là où le peuple est vertueux » (D, II, 11, p. 135).
Le problème, on le voit, n’est pas tant que Pocock ait tenté de construire un paradigme républicain – il serait di%cile de surestimer ce que l’histoire des idées politiques lui doit. Le problème est plutôt que la forme même qu’il a donnée à ce paradigme, parce qu’elle repose sur une compréhension inadéquate des concepts de droits et de vertu, l’a forcé à en exclure certains auteurs pourtant unanimement, et à juste titre, considérés comme républicains.
C’est précisément dans le but de remettre en cause ce postulat que nous proposerons ici une reconstruction de la pensée politique et morale de Sidney. Dans la mesure où ce dernier utilise de manière massive les deux langages du droit naturel et de la vertu civique, et étant donné le poids du modèle de Pocock dans l’histoire des idées républicaines, les commentateurs de Sidney n’ont pas pu esquiver la question de savoir comment se positionner sur le rapport qu’entretiennent ces deux lan-gages. Or, la confrontation à cette coprésence chez Sidney a suscité trois réactions principales qui sont à notre sens insatisfaisantes.
Les études plus historiques ont scrupuleusement identifié les sources de la pensée de Sidney, et ont donc perçu la coprésence des deux langages, mais sans s’attacher à expliquer précisément pourquoi ces deux langages ne sont pas contradictoires. B. Worden a%rme simultanément que Sidney fait un usage « prodigue du langage des droits » et que le « langage qui identifie la liberté et la vertu » est « le pouls du républicanisme de Sidney » ; il soutient que Sidney conçoit la liberté naturelle négative-ment comme l’absence de domination d’autrui, mais que, comme chez Milton, la vraie liberté est intérieure. Sensible malgré tout à un certain degré de cohérence, Worden ajoute qu’en utilisant ces deux langages, Sidney « forgea un lien entre le concept négatif de liberté implicite dans les théories des droits naturels, et le concept plus positif qui est celui de Machiavel ». De la sorte, en les « mariant », il contribua à « cré[er]
42 L’ESPRIT RÉPUBLICAIN
un langage de la liberté qui est moitié anglais, moitié romain ; moitié Chrétien, moitié classique », langage destiné à une certaine postérité1. Mais demeure la question de savoir comment précisément pourraient cohabiter dans ce nouveau langage les thèses apparemment contradictoires selon lesquelles d’une part, la finalité de la politique est la vertu des citoyens, et d’autre part, les individus entrent en société pour protéger leurs droits naturels à la propriété et à la liberté.
Sous ce rapport, l’hypothèse « néo-romaine » de Q. Skinner a permis de clarifier les choses2. À l’exception de Harrington – exception haute-ment significative pour comprendre le modèle exclusiviste pocockien, dont le pilier central est précisément l’auteur d’Océana –, les auteurs néo-romains tels que John Milton, Marcharmont Nedham, Henry Neville et Algernon Sidney, font usage de la notion de droits naturels lorsqu’ils décrivent l’état de liberté dans lequel se trouvent les hommes avant de s’associer politiquement3. Or bien que Skinner développe net-tement moins ce point dans son étude des auteurs néo-romains anglais du xviie siècle, ces derniers sont aussi, comme Harrington cette fois-ci, des héritiers de la pensée de Machiavel : ils conçoivent la vertu civique comme le moyen indispensable de soutenir la finalité principale d’un État libre, qui est de protéger la liberté, tant individuelle que collective4. Dès lors, il apparaît aisé de voir comment droits naturels et vertu civique se combinent : si le droit naturel de l’individu est plus ou moins synonyme de liberté, alors la vertu civique sera une condition essentielle du maintien des droits que les individus désirent voir protégés lorsqu’ils établissent des sociétés politiques et des gouvernements. Pourtant, Skinner ne va pas jusqu’à tirer une telle conclusion ; et si ses analyses détaillées de la pensée machiavélienne ont eu l’e&et salutaire de mettre au jour la solidité conceptuelle d’une notion de liberté qui, tout en étant définie de manière négative, est nécessairement liée à la vertu civique, il ne s’est pas penché sur les conséquences engendrées par l’acclimatation du langage des droits naturels dans la pensée républicaine. Or, il n’est pas
1 B. Worden, « Republicanism and the Restauration », in D. Wootton, Republicanism, liberty, and commercial society, 1649-1776, Stanford, Stanford University Press, 1994, p. 173-4.
2 Q. Skinner, La liberté avant le libéralisme, op. cit.3 Ibid., p. 23.4 Ibid., p. 24, 91 (n. 103), 100 (n. 38) ; « Machiavelli on virtù and the maintenance of liberty »,
art. cit., et « The idea of negative liberty : Machiavellian and modern perspectives », art. cit.
INTRODUCTION 43
impossible que cette rencontre modifie de manière significative la manière dont les concepts de droits, de liberté, et de vertu civique sont conçus1.
Si l’on se concentre sur les commentateurs qui se sont intéressés plus en profondeur à Sidney, le travail de l’historien J. Scott est absolument incontournable. Scott n’a pas seulement reconstitué par le menu la bio-graphie de Sidney, il l’a fait en considérant le contexte si important de sa famille et de sa carrière politique, et en identifiant les sources intel-lectuelles de ses écrits. Ces di&érents aspects sont d’ailleurs, à l’échelle biographique, indissociables2 : du fait du séjour de son père, deuxième comte de Leicester, à Paris en tant qu’ambassadeur (1636-41), Sidney fréquente l’Académie huguenote à Saumur, fondée par Du Plessis Mornay en 16023. Le comte, qui disposait d’une bibliothèque extrêmement riche, connaît très bien l’œuvre de Grotius et des monarchomaques, et les commente continuellement à l’aide de citations de ses auteurs pré-férés (Tite-Live, Cicéron, Suétone, Coke, Littleton, Selden, Buchanan, Hooker et Suarez). Il s’intéresse également de près aux débats théoriques contemporains, puisqu’il possède les ouvrages des républicains anglais du xviie siècle Henry Vane et James Harrington, et de leurs ennemis Thomas Hobbes et Robert Filmer. Les Commonplace books de la famille de Sidney montrent à quel point Grotius, les historiens latins, Cicéron, Suarez, Buchanan sont des sources essentielles. Le grand-père de Sidney, le premier comte de Leicester, frère du poète Philip Sidney, y inscrivit ses réflexions sur le problème de l’autorité politique et le danger du mauvais usage de la souveraineté, qui peut se transformer en « anarchie ou en tyrannie » ; conscient de la tendance de l’homme à abuser du pouvoir
1 L’hypothèse néo-romaine de Skinner, très riche, mériterait une présentation et un examen critique indépendant (cf. Hamel, Le républicanisme des droits, op. cit., Introduction). Il l’a développée dans le détail, pour le xviie siècle, à partir d’une lecture de John Milton et des débats parlementaires qui conduisirent à l’établissement de la république en 1649 (cf. « John Milton and the Politics of Slavery » et « Classical Liberty, Renaissance Translation and the English Civil War », tous deux in Visions of Politics, op. cit., vol. 2, respective-ment p. 288-307 et p. 308-43 ; « Classical Liberty and the English Revolution », in M. van Gelderen, Q. Skinner (dir.), Republicanism : A shared european heritage, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, vol. 1, p. 9-28).
2 Cf. Scott, Sidney I, première partie « Family and Ideas », p. 13-72. Cf. également B. Worden, « Classical Republicanism and the Puritan Revolution », in H. Lloyd-Jones, V. Pearl et B. Worden (dir.), History and Imagination : Essays in Honour of H.R. Trevor-Roper, Londres, Duckworth, 1981, p. 187.
3 Scott, Sidney I, p. 53.
44 L’ESPRIT RÉPUBLICAIN
qu’on lui confie, il préconise un encadrement strict de la prérogative par la loi. S’interrogeant sur « la di&érence entre la sujétion et l’esclavage », il faisait par ailleurs des empereurs romains des exemples de politiques absolutistes, et manifestait ainsi l’inquiétude rendue célèbre par Salluste : « comment les hommes peuvent-ils parvenir à la grandeur sous les tyrans1 ? » La lecture de Grotius le conduit à se poser des questions dont la similarité avec la pensée de Sidney est frappante – celle de savoir, par exemple, « si oui ou non, dans certains cas, non seulement les princes et les autres magistrats supérieurs, mais la société entière elle-même dont est dérivé le pouvoir des princes et des magistrats, peuvent être contraints ». Sa réponse a%rmative ressemblera elle aussi de manière saisissante à celle de Sidney : ils doivent être contraints, « bien que cette restriction puisse produire des inconvénients, car dans les a&aires civiles, il n’y a rien qui soit totalement dépourvu d’inconvénients2 ». Ces quelques informations sont loin d’être insignifiantes, car il est tout à fait probable que Sidney ait passé l’une des périodes où il travaille à ses Discourses concerning government dans le château familial (entre la fin de l’année 1681 et le milieu de l’année 1682), où il avait à sa disposition la bibliothèque de son père et de sa famille3.
J. Scott a très bien perçu la coprésence de la vertu et des droits chez les républicains. Il est même très emphatique sur la synthèse que constitue la pensée de Sidney et la « capacité » de ce dernier à « parler dans plusieurs langages politiques4 ». En particulier, soutient Scott,
la distinction [entre tradition républicaine et tradition de la loi naturelle] est relativement artificielle et je souhaiterais la contester en allant chercher derrière elle, car il y a au cœur de la pensée de Sidney un arrière-plan intellectuel qui donne à cette dernière et à toutes les sources qu’il utilise l’unité d’un tout5.
Malheureusement, Scott laisse le plus souvent dans l’ombre les modalités qui rendent cohérentes la rencontre du platonisme de Sidney et de son tacitisme, de l’influence d’Aristote et de son scepticisme, de l’influence de Machiavel et de celle de Grotius, de sa politique de l’intérêt
1 Tous ces textes sont cités par Scott, ibid., p. 54-5.2 Cité par Scott, ibid., p. 57.3 Scott, Sidney II, p. 95.4 Scott, Sidney I, p. 169.5 Ibid., p. 17.
INTRODUCTION 45
héritée des Hollandais et de la tradition « platonicienne chrétienne de la loi naturelle1 ».
En réalité, Scott juxtapose les di&érentes sources de la pensée de Sidney davantage qu’il n’explique conceptuellement la manière dont elles tiennent ensemble dans sa doctrine. Il a même en fait argumenté positivement pour désamorcer l’exigence de justification conceptuelle de la compatibilité qui animera notre étude : l’opposition entre « un langage (classique) de la vertu et un langage (libéral) des droits […] aurait eu peu de sens pour la plupart des républicains anglais, qui combinèrent les deux langages (républicanisme classique et théorie de la loi naturelle) parmi d’autres2 ». Son argument pour ne pas se concentrer précisément sur l’articulation conceptuelle de cette combinaison consiste à se ranger du côté des tenants de la thèse de l’éclectisme. S’appuyant sur le jugement d’historiens du xviie siècle qui a%rment que l’on peut, à cette époque, être à la fois aristotélicien et humaniste, Scott déclare qu’« il est temps que nous prenions au sérieux [leur] éclectisme ». Pour « rendre justice à la complexité de la méthode intellectuelle des débuts de l’époque moderne3 », il convient donc d’élever l’éclectisme « au rang de méthodologie4 ». Par conséquent, si la combinaison du langage des droits et du langage de la vertu dit beaucoup de la complexité de la pensée de ces auteurs, elle ne dit rien de leur cohérence respective. Car l’hypothèse de l’éclectisme, si elle nous rappelle qu’il est « possible » d’être aristotélicien et humaniste – ou, pour ce qui nous intéresse, qu’il est « possible » d’utiliser le langage des droits et celui de la vertu –, elle n’aide guère à préciser ce qui rend possible, conceptuellement, la cohérence de ces deux langages5.
1 Ibid. p. 17, et 207-21 (sur l’intérêt), et Scott, Sidney II, p. 216-8 (sur Platon).2 Scott, England’s Troubles. Seventeenth-century English political instability in European context,
Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p. 291 ; cf. pour la même a%rmation, p. 295, et id., Commonwealth Principles, op. cit., p. 25.
3 M. Todd, Christian humanism and the Puritan Social Order, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, p. 70 ; cf. également J. Co&ey, Politics, Religion and the British Revolutions : the Mind of Samuel Rutherford, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, p. 69 ; cités par Scott, England’s Troubles, op. cit., p. 294.
4 Scott, England’s Troubles, op. cit., p. 294, note 17. 5 Scott donne, malgré cette prudence, une réponse qui sans être fausse, est trop générale
pour faire avancer la question : républicanisme classique et théorie de la loi naturelle ne sont pas « mutuellement exclusifs » parce qu’ils partageaient « un appel à la faculté de la raison humaine qui était d’origine grecque, mais fréquemment en usage dans la
46 L’ESPRIT RÉPUBLICAIN
En outre, certains résultats des analyses plus précises que Scott propose pour comprendre l’articulation de ces héritages sont parfois conceptuellement déroutants. Ainsi tente-t-il d’expliquer par le menu la manière dont Sidney a « combiné Machiavel et Grotius […] pour produire une justification de la rébellion qui était nouvelle1 ». Quelle que soit la validité de la démonstration, et bien que Sidney ait pu sou-tenir explicitement que le De jure belli ac pacis de Grotius était le livre le plus important de théorie politique2, elle occulte largement le fait que sur le plan conceptuel, la théorie de la résistance de Sidney doit plutôt être considérée comme une réfutation des arguments principaux que Grotius avait avancés pour délégitimer le droit de résistance – et non, ainsi que Scott le soutient, comme une réa%rmation de la doctrine de la loi naturelle de Grotius3. Or, ce point est important car cette réfuta-tion engage un désaccord sur les concepts fondamentaux de la théorie politique et morale : là où Grotius défend que la désobéissance est illégitime parce qu’elle menace le devoir des hommes de s’associer dans une société paisible et viole le droit naturel de créatures rationnelles de vivre en société, Sidney refuse l’obéissance aveugle au nom d’une remise en cause de l’idée que la paix civile serait le bien suprême des hommes ; là où Grotius justifie la servitude volontaire au nom de la supériorité de la vie sur la liberté, Sidney prétend que l’homme qui renonce à sa liberté dégrade sa nature d’être libre et rationnel4.
Les deux autres attitudes, présentes dans les études dont l’ambition est plus théorique ou philosophique, consistent à tenter de rendre compatibles les deux langages en redéfinissant les concepts de vertu et de droits qui constituent les termes de l’opposition. Le problème de ces redéfinitions est qu’elles se sont soldées par le sacrifice de la dimension morale de l’individualisme qui est au centre du républicanisme de Sidney.
période chrétienne des débuts de l’époque moderne » (Commonwealth Principles, op. cit., p. 25-6).
1 Scott, Sidney II, p. 209-10 ; cf. surtout « The law of war : Grotius, Sidney, Locke, and the political theory of rebellion », in History of political thought, 13, 4, 1992, p. 565-85.
2 Scott, Sidney I, p. 19, qui fait référence à une lettre manuscrite.3 Scott, Sidney II, p. 209.4 Cf. notre section « Le droit de résistance républicain (2) » (3e partie).
INTRODUCTION 47
L’HYPOTHÈSE STRAUSSIENNE : LA « COHÉRENCE » MODERNE DES DROITS ET DE LA VERTU
La première de ces attitudes théoriques consiste à interpréter la pensée de Sidney à travers le prisme de l’hypothèse straussienne1. Cette dernière semble à première vue prometteuse, parce qu’elle vise explicitement à intégrer la vertu et les droits dans une théorie cohérente2. Ses deux mérites indéniables sont en e&et, d’une part, l’a%rmation que le répu-blicanisme moderne n’est pas une théorie de la vertu aristotélicienne qui assigne à la cité la finalité morale de réaliser l’humanité de l’homme par la citoyenneté active, et, d’autre part, l’intention de remettre en cause l’idée que le libéralisme et le républicanisme seraient « mutuellement exclusifs3 », en développant la thèse d’un républicanisme libéral.
Mais le problème principal de cette hypothèse est que les présupposés philosophiques qui l’animent l’obligent à construire une interprétation des textes extrêmement partiale, et même brutalement contradictoire avec des parties entières de l’argumentation des auteurs. Cette hypothèse tient en une seule a%rmation : le républicanisme libéral est une doctrine politique cohérente parce que ses deux fondements – le républicanisme de Machiavel et le libéralisme de Hobbes – sont des théories politiques modernes. La modernité du républicanisme, en termes straussiens, repose
1 Pour des raisons évidentes relatives à la chronologie, ce n’est pas Strauss mais ses dis-ciples (P. Rahe, V. Sullivan) qui ont appliqué à l’histoire des idées républicaines (qui s’est développée massivement depuis les années 1970) les hypothèses que Strauss a forgées pour analyser le libéralisme moderne. Pour autant, c’est Strauss lui-même qui a fourni l’embryon de l’interprétation « straussienne » du républianisme : dans sa revue de l’ouvrage de Z. Fink, The Classical Republicans. An essay in the recovery of a pattern of thought in Seventeenth Century England, Evanston, Northwestern University, 1945), in Social Research, 13, 3, 1946, il prétend que les « républicains classiques » qui intéressent Fink (Harrington, Milton, Sidney) sont moins les restaurateurs d’un républicanisme ancien que les agents de transformation de ce dernier en un républicanisme moderne. Bien entendu, la modernité de ce républicanisme tient essentiellement à l’influence décisive qu’exerce Machiavel, c’est-à-dire une pensée démocratique, sur leur pensée (p. 394).
2 V. Sullivan, « Muted and Manifest English Machiavellism : The Reconciliation of Machiavellian Republicanism with Liberalism in Sidney’s Discourses Concerning Government, and Trenchard’s and Gordon’s Cato’s Letters », in P. Rahe (dir.), Machiavelli’s Liberal Republican Legacy, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 58-86.
3 V. Sullivan, Machiavelli, Hobbes & the Formation of a Liberal Republicanism in England, op. cit., p. 1, 7.
48 L’ESPRIT RÉPUBLICAIN
sur l’idée d’une « rupture décisive » avec le républicanisme ancien, rup-ture qui prend la forme de l’abandon du rationalisme politique et moral antique articulé autour de « la prémisse aristotélicienne ». D’une part, cette prémisse « situe le fondement de la vie politique dans la capacité humaine du logos1 » inégalement répartie parmi les hommes2 ; et d’autre part, elle pense la politique comme le lieu où l’homme doit réaliser sa nature par l’exercice de la vertu3. Comme Strauss l’a enseigné, cet abandon de la question du devoir-être constitue le propre de la révolution moderne réaliste de Machiavel, par laquelle ce dernier a « abaissé délibérément le but ultime » de l’existence humaine, en réduisant le politique à ce qui, chez les classiques, relevait du domaine de l’infra-politique4 – le républi-canisme d’Aristote est, lui, « hautement respectable5 ». Dès lors, l’ordre des priorités qui règle le rapport de l’homme à la cité s’est inversé : là où les anciens voyaient dans la pratique des vertus politiques et morales la finalité intrinsèque de l’existence de l’homme, la société, pour les Modernes, n’est plus qu’un instrument de leur bien-être subjectif6.
Or, pour les straussiens que sont Sullivan et Rahe, abandonner le rationalisme politique et moral aristotélicien – c’est-à-dire, devenir « Moderne » –, c’est nécessairement abandonner toute forme de rationalisme authentique, et endosser une valorisation, voire une glorification, des passions humaines : « alors que le républicanisme d’Aristote s’e&orce de cultiver la raison de ses citoyens, celui de Machiavel s’e&orce de déchaîner leurs passions7 ». Tel est le point commun essentiel entre Machiavel et
1 Ibid., p. 8, n. 17 ; P. Rahe, « Situating Machiavelli », in J. Hankins (dir.), Renaissance Civic Humanism, Reappraisal and Reflexions, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p. 281-2, 292-4, 297.
2 C’est surtout Rahe qui insiste sur ce point : cf. ce qu’il appelle « la rationalité di&érentielle », c’est-à-dire l’idée que les facultés supérieures ne sont pas distribuées également chez tous les hommes ; Rahe, « Situating Machiavelli », art. cit., p. 288, 290, 297, 298, 299.
3 Cette thèse est constamment réa%rmée par l’étude straussienne du républicanisme : cf. P. Rahe, « Situating Machiavelli », art. cit., p. 275, et « Introduction », in P. Rahe (dir.), Machiavelli’s Liberal Republican Legacy, op. cit.
4 Strauss, Droit naturel et histoire, trad. M. Nathan et É. de Dampierre, Paris, Flammarion, 1986, p. 163 et p. 172 ; cf. également p. 171 (sur l’opposition entre la « vie d’excellence » et « la vie confortable »), Rahe, « Situating Machiavelli », art. cit., p. 302, et p. 305 (sur l’abandon par Machiavel de la thèse de l’homme comme animal politique).
5 Sullivan, op. cit., p. 202.6 Rahe, « The Primacy of Politics in Classical Greece », The American Historical Review, 89,
no 2, 1984, p. 279.7 Sullivan, op. cit., p. 202.
INTRODUCTION 49
Hobbes : ces deux Modernes insistent sur « la nature passionnée des êtres humains », « valorisent le libre jeu des passions », et défendent surtout la thèse selon laquelle le « gouvernement doit être enraciné dans ces passions1 » plutôt que finalisé par l’idéal de la vie bonne.
Le républicanisme moderne de Machiavel développe bien entendu une théorie des vertus. Mais son réalisme l’a conduit à substituer aux vertus morales des vertus simplement politiques et surtout militaires : il ne s’agit plus de chercher dans l’exercice de ces dernières une forme quelconque de bien moral, car les vertus politiques ne sont en réalité que l’expression publique de passions égoïstes du popolo et des grandi, que le gouvernant doit diriger pour parvenir aux seules finalités que se donne la république moderne : la guerre et l’empire2.
Il est vrai, poursuit l’hypothèse, que ces finalités sont incompatibles avec le projet libéral, tel que Hobbes l’a défini, de fonder la société poli-tique avant tout sur la satisfaction du désir de sûreté des individus3. Mais le point important, pour les Straussiens, est de souligner que Machiavel et Hobbes partagent la même volonté d’abandonner le projet politique des Anciens « de prendre soin des âmes4 », abandon indissociable de la valorisation des passions5.
De ce point de vue, le propre du libéralisme d’auteurs comme Hobbes, Locke et Sidney, est d’avoir fondé le droit naturel moderne sur les bases du réalisme machiavélien, en transformant ces désirs – au premier rang desquels celui de sûreté – en droits que tous les hommes possèdent par nature6. La transformation du désir de préservation en droit naturel pourrait sembler rendre possible une compréhension morale du droit
1 Ibid., p. 12, 4, 19, 12 ; cf. Strauss, op. cit., p. 164.2 Strauss, op. cit., p. 164 ; Sullivan, op. cit., p. 10-11.3 Cf. Strauss, op. cit., p. 153.4 Rahe, « The classical republicanism of John Milton », History of Political Thought, 25, 2,
2004, p. 262 ; cf. Platon, Les Lois, 650 b.5 Sullivan, op. cit., p. 19 : « Il se peut que Machiavel et le libéralisme valorisent le libre jeu
des passions avec des intentions di&érentes, mais ce qui les unit est que tous deux les valorisent ».
6 Ibid., p. 171 : « Harrington est un moderne parce qu’il fonde son gouvernement directement sur les désirs du peuple qui le compose ». Mais parce qu’il « refuse de transformer ces désirs en droits », il n’est « pas libéral » ; cf. p. 2 (pour la définition du libéralisme par les droits naturels) ; cf. Strauss, op. cit., p. 165-6 : si pour le libéralisme « le fait fondamental réside dans les droits naturels de l’homme, par opposition à ses devoirs », « le fondateur du libéralisme fut Hobbes ». Dans The Politics of liberty in England and Revolutionary America, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, p. 173, 175, L. Ward suit ici
50 L’ESPRIT RÉPUBLICAIN
naturel : « le seul fait moral absolu est le droit naturel de chacun à sa conservation ». Toutefois, ce fait moral est en réalité absolument réductible à une notion qui précisément nie la spécificité de la morale : car pour ces Modernes, « le bien est fondamentalement identique à l’agréable1 ».
Certains libéraux, comme Locke, se sont arrêtés à cet « hédonisme politique2 », qui consiste à faire du désir de préservation de soi le fonde-ment ultime du gouvernement3 ; mais d’autres, comme Sidney et ceux que Sullivan appelle les républicains libéraux, ne se sont pas contentés de juridiciser le désir de préservation ; ils ont aussi réinvesti la doctrine machiavélienne des vertus civiques. On se demandera comment le républicanisme prétendument expansionniste, guerrier et cynique de Machiavel peut servir en un sens quelconque les finalités libérales. Le tour de force des républicains libéraux fut justement, poursuit l’hypothèse, d’apprivoiser et d’assagir l’impérialisme violent et cynique de Machiavel en « appliquant la férocité machiavélienne à une intention libérale ». Il devenait désormais possible de rendre la vertu civique compatible avec les finalités libérales de paix et de protection4 : la violence que le Florentin encourageait à l’échelle internationale dans la guerre – accompagnée du cynisme qui marquait la vertu civique du sceau de la modernité – est ainsi acclimatée au souci libéral de préservation, puisqu’elle devient le moteur essentiel de la résistance vengeresse aux gouvernants tyranniques ou oppressifs5.
Ces auteurs libéraux sont donc républicains parce qu’ils pensent la vertu comme le moyen de protéger et de défendre le désir de sûreté conçu comme un droit. Mais ces vertus n’ont plus rien à voir avec une quelconque moralité humaine, puisque ces auteurs sont machiavéliens, c’est-à-dire modernes : les hommes ne sont vertueux qu’au sens où ils sont prêts, pour défendre leurs droits, à déployer toutes les stratégies de violence et de cruauté que Machiavel est censé avoir systématisées.
Sullivan et soutient que Sidney reprend l’idée hobbesienne selon laquelle le droit naturel fondamental est le droit à la préservation de soi.
1 Strauss, op. cit., p. 170, 171. p. 217 : « il n’y a pas de nature humaine qui nous permette de distinguer entre les plaisirs conformes à la nature et ceux qui sont contre nature, les plaisirs qui sont par nature élevés, et les plaisirs qui sont par nature bas ».
2 Ibid., p. 155, et p. 170-1.3 Sullivan, op. cit., p. 203.4 Ibid., p. 202 ; la même interprétation est proposée par Ward, op. cit., p. 202.5 Sullivan, op. cit., p. 214-24.
INTRODUCTION 51
À supposer que nous accordions momentanément cette interpréta-tion des deux piliers du républicanisme libéral, une double question vient naturellement à l’esprit : comment d’une part deux auteurs aussi contradictoires entre eux – Machiavel glorifia la guerre au mépris de la vie humaine et de toute morale en justifiant le déchaînement des passions et des vertus violentes ; Hobbes consacra la paix au prix de la liberté et condamna dans son principe toute légitimité de la résistance au pouvoir souverain qui serait conduite au nom de la liberté – peuvent-ils être des fondements indissociables d’une même synthèse qui fuit la guerre au nom de la sûreté et justifie les tumultes contre les partisans de l’ordre ? Et comment, d’autre part, l’esprit du « républicain libéral » – qui conçoit la vertu civique comme le moyen de préserver les droits naturels lockiens à la liberté – a-t-il pu synthétiser des doctrines aussi éloignées de ses préoccupations fondamentales ? Pour le dire avec Sullivan elle-même, comment Machiavel et Hobbes peuvent-ils être les « sources fondamentales », les « composantes essentielles », de ce républicanisme libéral si néanmoins « leur pensée respective dut être radicalement transformée avant que chacune d’elle pût contribuer à cette nouvelle combinaison1 » ?
La réponse que fournit Sullivan nous renseigne sur la manière dont elle procède dans l’interprétation des textes qu’elle étudie : sous prétexte que le républicanisme libéral s’est élaboré progressivement, elle soutient que son hypothèse sera d’autant plus forte qu’elle en proposera une « vue d’ensemble » commençant par la synthèse achevée – c’est-à-dire par la pensée des Cato’s Letters (1720-3), qui élaborent « un républicanisme vraiment libéral2 ». Autrement dit, de même que Zuckert propose de mieux comprendre la genèse du nouveau républicanisme à partir d’un exposé des principes de la déclaration d’Indépendance, Sullivan explique que pour mieux comprendre comment s’est élaboré le républicanisme libéral, il est préférable d’analyser les auteurs censés être les étapes de sa constitution à partir d’un point d’arrivée auquel il est pourtant impossible qu’ils aient pu vouloir tendre3.
1 Ibid., p. 10.2 Ibid., p. 15.3 Cf. par exemple la « démonstration » de l’influence de Hobbes sur Sidney grâce au détour
par Locke : la « preuve » que Sidney est hobbesien tient au fait qu’il « anticipe » Locke (ibid., p. 199, 223). Lorsque Sidney soutient que « ce qui appartient au peuple, c’est sa vie, sa liberté et sa propriété », ajoute Sullivan, c’est « bien sûr une formulation lockienne et libérale » (p. 225). Certaines a%rmations de Sullivan sont de véritables caricatures de
52 L’ESPRIT RÉPUBLICAIN
Mais de ce point de vue, on comprend immédiatement que le choix de Hobbes manque de pertinence : si la raison pour laquelle les auteurs des Cato’s Letters sont des républicains « vraiment libéraux » est qu’ils endossent la théorie de la résistance de Locke et sa conception des droits individuels, pourquoi, au lieu d’ajouter l’hypothèse coûteuse selon laquelle Locke lui-même a dû retourner contre Hobbes ses propres prémisses, ne pas faire de ces républicains libéraux les héritiers des républicains anglais qui utilisent les concepts jusnaturalistes ? De même, quel sens y a-t-il à faire de Caton et de Sidney des hobbesiens alors que l’une des thèses contre laquelle ils se battent avec le plus de détermination – parfois en visant Hobbes nommément1 ! – est précisément l’idée que l’on pourrait sacrifier la liberté à l’ordre social ?
Il est donc clair qu’à mesure que se précise la téléologie rétrospective, l’interprétation s’éloigne du sens que les auteurs ont pu vouloir attri-buer à ce qu’ils écrivaient. Mais au-delà de cette objection concernant la validité formelle de l’hypothèse, il en est une plus sérieuse encore, qui vise son contenu même, à savoir le présupposé philosophique2 selon lequel l’abandon du rationalisme politique et moral des Anciens condamnerait irrémédiablement les Modernes à une anthropologie hédoniste et amorale, et réduirait par là même la société politique à un simple moyen de satisfaire des passions plus ou moins violentes et animales : le républicanisme violent et agressif de Machiavel permet
lecture rétrospective qui vident de sens toute approche visant à déterminer l’intention de l’auteur considéré : si Caton est un vrai libéral parce qu’il s’appuie sur Locke, assure-t-elle, Nedham, lui, qui écrit dans les années 1650, argumente « sans les ouvrages de Locke sur lesquels s’appuyer » (ibid., p. 16). C’est donc d’autant plus remarquable qu’il o&re une « étonnante anticipation du libéralisme de Caton », auquel « il ressemble beaucoup » par le fait qu’il « propulse le peuple dans le domaine politique pour défendre ses droits ». La lecture rétrospective prend des proportions qui confinent à l’absurde, lorsque Sullivan a%rme, visiblement sérieusement, que « la di&érence fondamentale » entre Nedham et Caton dérive du fait que le premier « ne pouvait pas s’appuyer sur la pensée politique libérale de Locke » (ibid., p. 17, cf. également p. 16, 21, 105).
1 Cf. D, III, 17, p. 409, où Sidney décrit Hobbes comme le premier auteur qui a justifié sur le plan théorique la pratique des monarques consistant à se prétendre déliés de toute obligation ; la justification de Hobbes, précise Sidney, repose sur l’idée que le peuple a renoncé à la totalité de sa liberté naturelle (nous citons ce texte plus loin dans l’introduction, p. 58).
2 Cf. la remarque de Pocock sur la méthodologie straussienne, dans l’« Avant-propos de l’auteur pour l’édition française » du Moment machiavélien, op. cit., p. lii : « je rejette cette macrohistoire – qui est en fait une métahistoire – parce que je la considère trop procus-téenne. Elle étend l’histoire sur un lit conçu par des philosophes ».
INTRODUCTION 53
de contenter les désirs de domination des hommes1 ; le libéralisme de la paix et des droits de Locke permet uniquement de satisfaire le désir de sûreté et d’éradiquer la peur de la douleur2.
Or, l’hypothèse de l’hédonisme politique moderne donne lieu à des lectures qui, au mépris des textes, exacerbent au maximum le rôle des passions dans les théories politiques modernes, et minimisent, voire négligent absolument, toute forme de raisonnement moral fondé sur des principes de justice et présupposant toujours la capacité des hommes de modérer l’usage qu’ils font de leur liberté pour des raisons morales. Par conséquent, le problème de ce présupposé philosophique est qu’il est totalement inadapté à la manière même dont les auteurs « modernes » élaborent leur propre pensée.
L’exemple de Grotius est à cet égard éclairant : comme nous le verrons3, il condamne la résistance au pouvoir politique au nom de l’enseignement de la « droite raison » selon lequel « la vie est le fondement de tous les biens temporels ». Or, lorsqu’il fonde le droit naturel dans la rationalité et la sociabilité de l’homme, Grotius le fait précisément contre la thèse de la fameuse réduction du juste à l’utile opérée par Carnéade, qualifiant cette dernière de « suprême folie4 ». Si l’on suit Grotius, fonder une société et la soutenir – au prix de la liberté s’il le faut – est donc pour l’homme un authentique devoir.
Une telle proposition est toutefois absolument incompréhensible en termes straussiens : comment la recherche de la paix peut-elle être un devoir au sens fort ? Si elle est un authentique devoir, supposera un straussien, c’est que la paix se rapporte à une fin plus haute, qui est de réaliser la nature de l’homme par le développement des facultés supé-rieures – ce que ne dit pas Grotius. Au contraire, poursuivra-t-il, si la paix est véritablement la finalité de la politique, alors elle n’est pas une finalité morale, mais relève de l’utilité – ce que nie catégoriquement
1 Sullivan, op. cit., p. 10-1, 205-11.2 Strauss, op. cit., p. 165 : « S’il nous est permis d’appeler libéralisme la doctrine politique
pour laquelle le fait fondamental réside dans les droits naturels de l’homme, par opposition à ses devoirs, et pour laquelle la mission de l’État consiste à protéger ou à sauvegarder ces mêmes droits, il nous faut dire que le fondateur du libéralisme est Hobbes ».
3 Cf. notre section « La priorité de la liberté sur la paix » (3e partie).4 Grotius, De jure belli ac pacis (1625), Le droit de la guerre et de la paix, trad. P. Pradier-
Fodéré, Paris, PUF, Quadrige, 2005, Prolégomènes, § 5, p. 9 (sauf indication contraire, c’est toujours ce livre que nous citons de Grotius, et à cette édition que nous renvoyons).
54 L’ESPRIT RÉPUBLICAIN
Grotius. Bref, parce qu’elle n’admet pas qu’une doctrine morale puisse revêtir une forme di&érente de celle du rationalisme antique – pour lequel l’homme est censé devoir chercher la perfection et la vertu – l’hypothèse straussienne ne peut rendre compte d’une théorie morale qui se donnerait pour bien suprême la préservation de soi. Elle est condamnée à demeurer extérieure à ce type de doctrine.
Cette di%culté de l’hypothèse straussienne à rendre compte d’une dimension morale de la pensée politique moderne éclate au grand jour dans le traitement qu’elle réserve aux auteurs qui ont recours mani-festement à la fois au langage moderne du droit naturel et au langage classique de la vertu.
Le rapport d’exclusion entre les droits naturels individuels et la politique de l’Antiquité est véritablement la pierre angulaire de cette interprétation. Rahe attache ainsi beaucoup d’importance au fait que « dans l’Antiquité, personne n’a jamais a%rmé “les droits inaliénables de l’individu” » que mobilisaient les admirateurs de la révolution américaine pour critiquer les cités anciennes1. Mais une fois que l’on a dit cela, il semble bien plus fécond, pour comprendre les rapports qu’entretiennent les auteurs des xviie et xviiie siècles avec l’Antiquité, de se demander par exemple pourquoi Milton prétend que c’est la thèse de la liberté natu-relle de l’homme qui a « conduit » « Aristote et les meilleurs auteurs » à définir le roi comme un gouvernant qui agit pour le bien commun2. De même, doit-on, sous prétexte que Sidney a%rme que « les droits d’un peuple […] procèdent des lois de la liberté naturelle », ne pas le prendre au sérieux lorsqu’il énonce sa méthode, qui consiste à raisonner avec Aristote – et, pourrait-on ajouter, Grotius (cité dans ce passage) – « comme un philosophe […] examinant ce qui est juste, raisonnable, et bénéfique aux hommes, c’est-à-dire ce qui doit être fait et ce qui, étant fait, doit être considéré comme juste » (D, III, 23, p. 452) ?
Pour un straussien tel que Rahe, il faut opter : lorsque la vertu est, comme chez Milton, manifestement trop imprégnée de moralité pour en faire un simple instrument du bien-être subjectif, le droit naturel est mécaniquement négligé, alors même que Milton fournit l’une des formulations individualistes les plus radicales du droit de résistance
1 Rahe, « The Primacy », art. cit., p. 289.2 Cf. J. Milton, The Tenure of Kings and Magistrates (1649), in Political writings, éd. M. Dzelzainis,
Cambridge, Cambridge Press University, 1991, p. 10-1.
INTRODUCTION 55
au nom de la dignité de l’homme. Milton fut en e&et pour Rahe un « républicain classique authentique et pleinement conscient1 », ce qui signifie sous sa plume non moderne, c’est-à-dire non machiavélien. Car s’il adopte le rationalisme classique qui pose comme finalité de l’État le souci de « prendre soin des âmes », précise Rahe, c’est nécessairement qu’il réfute l’innovation machiavélienne du « populisme moderne2 » et sa traduction libérale dans le langage des droits naturels du peuple à la liberté et à la résistance.
Inversement, lorsque, dans un contexte moderne, un auteur soutient à la fois que la vertu civique ( comprise comme « passion positive pour le bien public ») est au fondement d’un gouvernement libre, et que le bonheur ( compris comme confort matériel et sûreté personnelle) doit être la prio-rité du gouvernement, la véritable prémisse est « le bonheur individuel » et la protection des droits. Mécaniquement, toujours, l’exaltation de la vertu civique n’apparaît plus que comme une rhétorique qui la vide de son contenu du fait de la priorité des droits3. Ainsi Mercy Otis Warren peut bien prétendre qu’une « profonde révérence à l’égard des lois et qu’une noblesse d’âme sont les seuls fondements d’un gouvernement libre ». Cette fervente admiratrice du républicanisme ancien ne fait ici selon Rahe qu’instrumentaliser ou subordonner l’excellence humaine parce qu’elle avance par ailleurs que « les droits des individus devraient être les premiers objets de tout gouvernement4 ». Rahe raisonne donc comme si le fait même de disposer d’une doctrine des droits individuels impliquait nécessairement de renoncer à toute politique de la vertu civique, ce qui est selon lui confirmé par le fait que jamais Mercy Otis
1 Rahe, « The classical republicanism of John Milton », art. cit., p. 247, et p. 274 (« Milton s’est toujours présenté au public comme un républicain classique »). Même démarche chez Sullivan, op. cit., p. 202 : si Sidney n’endosse pas le rationalisme d’Aristote, c’est qu’il est machiavélien.
2 Rahe, « The classical republicanism of John Milton », art. cit., p. 246 ; ce point est pour Rahe une question de principe : « dans tout ce qu’il a écrit en vue d’être publié, il n’y a pas le moindre signe qu’il ait trouvé quoi que ce soit chez Machiavel – à part peut-être sa critique des prêtres – qui ne fut pas déjà présent dans les auteurs classiques qu’il estimait » (p. 274) ; « jamais Milton n’a permis à la pensée de Machiavel d’informer fondamentale-ment la manière avec laquelle il a écrit au sujet de, défendu, et subrepticement tenté de guider, la république anglaise naissance » (p. 245).
3 P. Rahe, Republics Ancient and Modern : Classical republicanism and the American Revolution, Chapel Hill-Londres, The University of North Carolina Press, 1994, vol. II, p. 120-1, et p. 377-8 n. 76 (citant John Adams).
4 Ibid. p. 121 (citant Mercy Otis Warren) ; cf. également p. 120, 139.
56 L’ESPRIT RÉPUBLICAIN
Warren n’attribue au gouvernement la finalité de rendre les hommes nobles et bons. Si par conséquent Rahe conclut que ces auteurs se faisaient une « conception réduite de la finalité de l’association politique », c’est uniquement parce qu’il suppose a priori qu’il est impossible d’adopter simultanément une conception de la vertu civique et l’idée que l’État a pour finalité première de protéger les droits des individus.
Mais pourquoi la protection des droits comme fin essentielle du gouvernement serait-elle en contradiction avec une politique de la vertu ? La seule réponse que donne Rahe est que les Modernes, à la suite de Machiavel et de Hobbes, ont adopté une représentation amorale, matérialiste et utilitaire de l’existence humaine en général et de la vie politique en particulier. Là où les esprits nobles des Anciens pensaient qu’« une patrie était plus qu’un séjour de repos » et qu’il était préférable de mourir plutôt que de vivre asservi, les Modernes, guidés par le souci de la protection de leur droit au bien-être, préfèreront toujours le repos à la vertu trop exigeante. Le primat des droits a donc fait de la vertu, et de l’exercice politique des facultés supérieures, les instruments utilitaires de la paix et de la tranquillité d’hommes réduits à des centres de désirs1.
Cette redéfinition des termes de l’opposition entre droits et vertu implique donc d’identifier dans le républicanisme de Sidney non l’héritage du républicanisme classique de la Renaissance (di%cilement compatible avec le jusnaturalisme) mais la combinaison originale du républicanisme impérialiste et cynique de Machiavel2 et du libéralisme amoral et sécuritaire de Hobbes3. Au-delà des doutes que l’on peut nourrir sur la cohérence interne d’une telle alliance, l’hypothèse straussienne ne peut en aucun cas être retenue, pour au moins quatre raisons.
L’hypothèse selon laquelle Sidney est l’un des « créateurs de la syn-thèse » que serait le républicanisme libéral anglais implique premièrement une réinterprétation du concept de droit naturel hobbesien – car Hobbes est le « fondement » libéral de cette synthèse4. Or, la démonstration fait long feu : lorsqu’il s’agit d’examiner les aspects « libéraux » de la pensée de Sidney ( contrat, liberté et égalité naturelles, consentement au
1 Rahe, « The Primacy », art. cit., p. 277-81.2 Pour des références et des citations précises des commentateurs sur la question du répu-
blicanisme expansionniste, nous renvoyons au début de notre section « Un républicanisme belliciste ? » (2e partie).
3 Cf. Sullivan, op. cit. chap. 6, p. 199-226 ; P. Lurbe, art. cit., p. 41.4 Sullivan, op. cit., p. 27.
INTRODUCTION 57
principe du gouvernement), c’est-à-dire les aspects qu’il est censé hériter de Hobbes, Sullivan ne convoque pas Hobbes mais Locke, et propose des rapprochements entre ce dernier et Sidney – qui sont contemporains – pour conclure que Sidney est hobbesien parce qu’il « partage avec Locke l’acceptation d’une importante prémisse hobbesienne selon laquelle la société est artificielle, et que les êtres humains ne sont pas d’abord et avant tout des êtres politiques. Ils ne deviennent des êtres politiques que pour satisfaire leurs besoins fondamentaux […] : la sécurité1 ». Mais que peut espérer établir l’acrobatie historiographique consistant à défendre que Sidney est influencé par Hobbes parce qu’il anticipe un Locke fon-damentalement hobbesien, sinon encourager dans leur conviction ceux qui ont décidé avant même de lire les textes que toute conception non classique du droit naturel tire ses principes du Léviathan ?
Reste alors la possibilité d’établir l’influence de Hobbes à l’aide d’une analyse conceptuelle de certaines notions centrales. Mais cette voie n’est pas moins vouée à l’échec : Sullivan est bien obligée de concéder que Sidney conçoit la « sécurité » « de manière très di&érente de la compréhension hobbesienne2 ». En réalité, il serait plus exact de dire qu’ils la conçoivent de manière on ne peut plus opposée : quel sens cela a-t-il de dire que la finalité du gouvernement est chez Sidney une reformu-lation de la sûreté hobbesienne alors qu’il répète inlassablement qu’une société tumultueuse et libre est plus souhaitable qu’une cité paisible et asservie sous un pouvoir arbitraire, et qu’il fait de la possession par le peuple d’un droit inaliénable de résister au gouvernement un préalable indispensable à la sûreté authentique des particuliers3 ? Mais plus fon-damentalement encore, s’il est un héritier de Hobbes, pourquoi Sidney construit-il précisément son concept de liberté sur le modèle républicain que Hobbes cherche à détruire ? Pourquoi fait-il du pouvoir arbitraire l’ennemi intime de la liberté de l’homme là où Hobbes en avait fait la seule garantie possible d’une liberté réduite à la sujétion ? Pourquoi précise-t-il à l’envi que l’homme n’est pas qu’un centre de désirs, mais également un être rationnel qui a des devoirs objectifs qui dérivent de la loi de sa propre nature rationnelle ? Pourquoi, enfin, sur la question décisive de l’obligation de tenir sa parole qui se trouve au cœur de
1 Ibid., p. 220-3. 2 Ibid., p. 202.3 Cf. notre section « Le droit de résistance républicain (2) » (3e partie).
58 L’ESPRIT RÉPUBLICAIN
la théorie de l’obéissance aux lois, Sidney avance-t-il que « Monsieur Hobbes fut je pense le premier qui, fort ingénieusement, trouva un moyen concis pour justifier les plus abominables parjures, et tous les méfaits qui s’ensuivent, en prétendant que puisque c’est au peuple que le roi prête serment, le peuple peut dégager le roi de l’obligation à laquelle ce serment l’engage » (D, III, 17, p. 409) ?
Sidney utilise en fait le concept de droit naturel dans un sens exac-tement contraire à celui de Hobbes : si la description qu’il propose de l’état de nature manifeste que le souci de préservation de soi est central, sa théorie de la résistance démontre clairement qu’il n’a absolument pas abandonné la hauteur de vue qui consiste à ne pas se satisfaire d’une servitude paisible. Il hérite en e&et de l’association classique entre liberté et dignité. Mais là où la pensée romaine – qui inspire abondamment Sidney sur cette question – voyait essentiellement cette dignité comme l’e&et moral d’un statut social rendu possible par la liberté civile dont jouissait seul le citoyen1, Sidney l’inscrit dans la nature même de l’homme, créature rationnelle et libre. Ainsi, de même qu’il systématise l’idée que l’absence de domination – pensée par le droit civil romain comme l’e&et de la citoyenneté – définit la liberté naturelle de l’homme2, il attribue cette dignité à tout homme en tant qu’homme. Mais quand la philosophie morale de la Renaissance déployait principalement dans une réflexion cosmologique l’intuition cicéronienne de la dignitas hominis, Sidney en tire avant tout des implications politiques. En e&et, il n’use de la rhétorique de la dignité de l’homme que pour défendre la liberté civile des individus contre les politiques de la servitude. Sa dénonciation de la tyrannie, de toute forme de gouvernement arbitraire où les lois ne seraient pas strictement souveraines, et même de tout gouvernement que le peuple ne pourrait modifier quand il juge souhaitable de le faire, a pour principal ressort l’idée que, en violant le droit de l’homme à la liberté, la servitude l’avilit et le dégrade3.
1 Cf. P. A. Brunt, The Fall of the Roman Republic, Oxford, Clarendon Press, 1988, « Libertas in the Republic », p. 281.
2 Ce que Ockham disait de la loi chrétienne contre les prétentions du pape, à savoir qu’elle est une loi de liberté qui interdit que l’homme soit soumis à un maître quelconque (cf. Tierney, The Idea of Natural Rights, op. cit., p. 187), Milton et Sidney en font le cœur de la loi naturelle.
3 L’idée que le droit naturel est structuré par la thèse de la dignité de l’homme est au cœur du livre d’ E. Bloch, Droit naturel et dignité humaine (1961), trad. D. Authier et J. Lacoste,
INTRODUCTION 59
Indissociable de la revendication de la liberté et des droits naturels, la thèse de la dignité de l’homme informe donc son jusnaturalisme1, et joue un rôle crucial et direct dans sa théorie de la résistance : résister au pouvoir tyrannique qui asservit et dégrade, c’est restaurer sa dignité d’homme libre. Et comme nous le verrons, c’est précisément contre la condamnation des tumultes civils, et contre la thèse de la supériorité de la paix ou de la vie sur la liberté que Sidney argumente en faveur de cette digne liberté. Si tel est le cas, c’est bien que son concept de droit naturel n’est pas un simple désir de sécurité juridicisé, mais un pouvoir moral de se maintenir dans une existence qui soit digne de la nature libre de l’homme.
Deuxièmement, la description straussienne ne convient pas car l’adoption par Sidney d’une conception moralisée du droit naturel ne s’accompagne pas du projet d’établir une république de la vertu ; l’homme a bien le devoir de chercher son bien, mais ce bien suprême – ce que Sidney appelle « le sommet du bonheur humain » – n’est rien d’autre que la liberté dont il peut jouir dans une société2. On chercherait en vain, dans ses déclarations relatives à la question de la finalité de la société, l’idée d’une priorité de la vertu sur la liberté. Sidney fera du droit « laissé » par la société à chacun de mener son existence comme il l’entend, l’un des traits principaux permettant de reconnaître une société libre. Or, cette frange importante de l’existence laissée à la discrétion de l’individu n’est pas l’e&et du renoncement à statuer sur la question du bien de l’homme : elle est au contraire la condition même pour que tout ce que l’homme entreprenne ait une quelconque valeur3.
Troisièmement, la lecture straussienne est erronée parce que la repré-sentation de part en part moralisée du droit naturel permet de comprendre
Paris, Payot, 2002 ; cf. notamment cette remarque, qui convient parfaitement à la théorie de la résistance de Sidney : « dans la personne qui ne s’incline pas » et refuse la servitude, « c’était la dignité de l’humanité qu’il s’agissait de sauver » (p. 142-3).
1 Cf. B. Tierney, The Idea of Natural Rights, op. cit., p. 46, qui souligne la présence de cette thèse de la dignité dans les théories médiévales des droits naturels des individus.
2 N. Matteucci est l’un des seuls interprètes à avoir souligné ce point ; cf. « Dal costitu-zionalismo al liberalismo », in L. Firpo (dir.), Storia delle idee politiche, economiche e sociali, Turin, UTET, rééd. 1983, vol. IV-2, p. 21 : « l’intention est claire et la construction cohérente ; toute l’œuvre est dominée par la passion de la liberté, bien suprême qui est la source de tous les autres biens et le fondement de la félicité terrestre ». Malheureusement, il poursuit en soulignant que la pensée de Sidney manifeste les tensions entre modernité et républicanisme renaissant (p. 21-2), sans expliquer ces tensions.
3 Cf. notre section « L’individualisme privatiste… » (2e partie).
60 L’ESPRIT RÉPUBLICAIN
la place et le statut de la vertu civique. Cette dernière est bien chez Sidney subordonnée à la finalité suprême qu’est la liberté : pour le dire dans les termes de l’hypothèse skinnerienne sur les rapports entre liberté néo-romaine et vertu civique, Sidney, comme la majeure partie des « néo-romains » anglais, conçoit la vertu civique comme un moyen de se maintenir en liberté1. Mais là où Hobbes redéfinit la vertu civique par les qualités qui favorisent la paix et encouragent à obéir au pouvoir souverain par essence arbitraire, Sidney opère le mouvement inverse : sous un gouvernement libre, la vertu consiste à obéir aux lois parce qu’elles sont conformes à la finalité de la société qui est de promouvoir la liberté et d’assurer la justice2. Et sous un gouvernement tyrannique, la vertu suprême consiste à lui résister par la force lorsque les voies juridiques font défaut3. Être vertueux en ce sens, résume Sidney, c’est faire un bon usage de son droit naturel. Mieux encore, le fait que la liberté soit le bien suprême de l’homme rend ce droit inaliénable à la liberté identique à un devoir. La résistance active contre la tyrannie et la défense de sa liberté ne sont donc pas seulement permises : moralement parlant, ce sont des obligations, car la nature humaine est normée par ce que Sidney appelle « la loi de la liberté », que les hommes « ne peuvent pas abroger ».
Mais si la vertu a une place subordonnée dans l’ordre des finalités, son statut n’est pas réductible à l’intérêt bien compris ni à l’utile. De ce qu’elle est conçue comme le soutien de la liberté, les commentateurs ont inféré que la vertu n’avait pas de valeur morale irréductible. Cette inférence est en partie compréhensible car Sidney a%rme que la pour-suite des intérêts particuliers est dans une mesure non négligeable compatible avec la vertu. Toutefois, loin d’en conclure qu’il n’y a pas de motif intrinsèquement vertueux, il s’e&orce aussi de montrer que c’est « le sens du droit » que possède l’homme, c’est-à-dire sa moralité propre, et non la seule poursuite de l’intérêt particulier, qui doit être au fondement de l’action vertueuse du citoyen.
Surtout, l’inférence évoquée n’est pas valide, parce que selon Sidney, la vertu est un moyen non pas contingent mais nécessaire de soutenir
1 Q. Skinner, « Machiavelli on virtù and the maintenance of liberty », art. cit., p. 160-85 et « The idea of negative liberty : Machiavellian and modern perspectives », art. cit. p. 186-212.
2 Cf. notre section « L’irréductibilité de la vertu à l’intérêt » (2e partie).3 Cf. notre section « Dignité et vertu… » (3e partie).
INTRODUCTION 61
les institutions qui protègent la liberté. La preuve la plus concluante de cette indissociabilité de la finalité (assurer la liberté) et du moyen (être un citoyen vertueux) est que Sidney, dans ses écrits politiques, conceptualise les vertus essentiellement comme des modalités d’exercice de la liberté. L’excellence propre de ces vertus ne réside pas dans des dispositions morales détachables de la liberté, mais seulement dans des aptitudes de l’âme qui mettent l’homme en mesure de bien user de la liberté que les lois protègent. Dès lors – et c’est le point crucial pour comprendre le statut irréductiblement moral de la vertu dans une hié-rarchie de finalités au sein de laquelle elle est néanmoins subordonnée à la liberté –, la valeur morale de la vertu n’est pas dissoute dans la finalité qu’elle sert, mais au contraire constituée par elle. Car c’est précisément parce qu’elle sert le bien suprême de l’homme qu’est la liberté, et parce qu’elle lui est indispensable, que la vertu doit être voulue. Cela revient certes à rendre liberté et vertu indissociables, et à prétendre que seule la liberté civile vertueuse est une authentique liberté ; mais parce que la vertu n’est pas autre chose que ce qui soutient la liberté civile, cela revient surtout, corrélativement, à ne définir le vice que par les actions qui minent la liberté civile, et à prétendre qu’une liberté qui abuse de son pouvoir aux dépens des droits des autres s’est transformée en licence.
Pour comprendre ce genre de proposition, il est donc impératif d’abandonner la manière dont l’hypothèse straussienne se représente le droit naturel moderne comme incompatible avec un devoir authentique. Car si Sidney voit, inscrite au cœur même du droit naturel, une norme de justice qui oblige chacun, il ne prétend pas pour autant que l’homme ait pour devoir de réaliser son humanité dans une vie vertueuse. Plus précisément, ce n’est pas seulement qu’il estime le droit naturel limité de l’extérieur par un devoir, ni qu’il croie la liberté légitime déterminée par une rationalité morale qui lui serait extrinsèque1. Il soutient que le droit n’est authentiquement un droit que parce qu’il est en lui-même conforme à la loi de nature ; et il avance que la liberté n’est légitime que parce qu’elle est intrinsèquement rationnelle. Un droit naturel de faire ce qui est contraire à la justice est une contradiction dans les
1 C’est exactement ce que nie le modèle straussien ; cf. Strauss, op. cit., p. 166, 165 : les droits « expriment et veulent exprimer ce que tout le monde désire réellement et de toute façon ; ils consacrent l’intérêt particulier de chacun, tel que chacun le conçoit ou peut être aisément amené à le concevoir ».
62 L’ESPRIT RÉPUBLICAIN
termes ; le fait d’abuser de son droit est de la licence. Mais jamais il ne laisse entendre que ce droit serait absorbé dans une finalité morale ou un devoir plus fondamentaux, distincts de l’exercice de la liberté. Car l’accomplissement de ce devoir consiste justement dans l’exercice du pouvoir de s’autodéterminer qu’est le droit à la liberté.
Or, l’hypothèse straussienne exclut l’idée que le droit naturel moderne puisse contenir un intérêt moral à ne pas être dominé ; au mieux, ce dernier est compris comme l’expression d’un préalable nécessaire à la pratique des vertus1, car la simple garantie de ne pas vivre sous la coupe d’autrui ne peut pas, dans cette hypothèse, être un idéal moral intrinsèque su%sant. Ainsi, parce que cette hypothèse repose sur l’idée que le bien de l’homme est par nature défini par la pratique d’une vertu, la revendication de la valeur morale intrinsèque d’une existence émancipée de la domination ne peut qu’être réduite au désir hédoniste de vivre en sûreté.
Pourtant, lorsque Sidney soutient que la soumission à un pouvoir arbitraire réduit l’homme à un statut de bête, il est bel et bien en train de réinvestir l’idée héritée de l’antiquité selon laquelle l’homme se distingue radicalement du monde animal par une forme de moralité supérieure. L’indissociabilité de la dignité et de la liberté implique donc que Sidney se démarque d’une tradition du droit naturel comme droit « de l’homme en tant qu’animal2 ». En ce sens, Sidney refuse ce que Ernst Bloch a fort justement appelé le « modèle de réduction par l’extension », par lequel « le droit naturel, étendu à tous les êtres vivants, perd sa fierté et son éclat humains3 ». Le droit naturel de l’homme est le droit moral à vivre dans une digne liberté. Néanmoins, cette thèse a pour caractéristique – invisible en termes straussiens – le fait que la dignité de l’homme ne correspond pas à une perfection dans la pratique des excellences éthiques que sont les vertus, mais à sa nature d’être moral et rationnel, doté du
1 P. Rahe, « Situating Machiavelli », art. cit., p. 284-6 ; cf. également T. Pangle, The Spirit of Modern Republicanism. The Moral Vision of the American Founders and the Philosophy of Locke, Chicago, University of Chicago Press, 1988, p. 263, 262, pour l’idée que l’exercice des droits politiques serait uniquement le moyen de la préservation de soi.
2 Cf. R. Tuck, Natural Rights Theories. Their origin and development, Cambridge, Cambridge University Press, 1979, p. 34, qui cite François Connan, Commentarium Iuris Civilis libri X (Paris, 1558).
3 Bloch, op. cit., p. 35 ; cf. le texte classique d’Ulpien, Digeste, I, I, 3 : « le droit naturel est celui que la nature inspire à tous animaux. Ce droit n’appartient pas seulement aux hommes, il convient aussi à toutes les brutes qui vivent sur la terre et dans les eaux : il appartient de même aux oiseaux ».
INTRODUCTION 63
pouvoir et des facultés qui, dans le cadre d’une norme de justice imposée par la loi de nature, le rendent capable de choisir pour lui-même, en toute indépendance, l’existence qui lui convient1.
Quatrièmement, l’hypothèse straussienne ne peut être retenue parce qu’elle repose sur une interprétation erronée de l’influence de Machiavel sur Sidney. Que ce dernier soit un épigone du Secrétaire florentin ne fait pas de doute ; en revanche, qu’il endosse et radicalise le type de républicanisme agressif et conquérant que Sullivan attribue à Machiavel est non seulement discutable, mais proprement intenable.
En e&et, dans la mesure où il formule son républicanisme en s’opposant à la qualification filmerienne des républiques comme « abattoirs », ne serait-il pas étrange que Sidney vante leur violence et exalte la guerre pour elle-même après avoir précisément loué la « douceur » des lois de Rome à l’égard des criminels, ainsi que l’intelligence de cette cité à prévenir les crimes en incitant les citoyens à la vertu2 ? De même, s’il célébrait, comme le prétend Sullivan, les méthodes violentes de Machiavel, pourquoi parle-t-il de « cruauté inhumaine » (inhuman cruelty) et de « violence » pour dénoncer les pratiques des tyrans qui réduisent les peuples à un esclavage misérable, et pourquoi prétend-il que « la violence qu’il [i.e., Filmer] blâme n’est ni l’e&et de la liberté, ni compatible avec elle3 » ? Surtout, s’il était vraiment le machiavélien cynique, « plus assoi&é de sang » encore que Machiavel4, et obsédé par la conquête violente, pourquoi Sidney aurait-il pris la peine d’écrire qu’une guerre n’est légitime que si ses motifs sont justes5 – précision
1 Pour cette compréhension du droit naturel de l’homme, articulé à une conception de la nature humaine où liberté et rationalité sont des caractéristiques essentielles, cf. Tierney, The Idea of Natural Rights, op. cit.
2 Cf. notre section « La vertu comme soutien de la liberté » (2e partie).3 D, II, 19, p. 184. Pour la cruauté cf. D, II, 11, p. 139 ; D, I, 3, p. 14, 15 ; D, I, 8, p. 26, 27 ;
D, I, 10, p. 31 ; D, I, 17, p. 55 ; D, I, 20, p. 71, 73. Pour la violence, cf. D, II, 11, p. 139.4 Cf. le titre emphatique de l’une des sections du chapitre sur Sidney : « More Than Machiavelian
Bloodthirstiness », p. 213, 213-8 ; malheureusement, la démonstration de Sullivan peine à établir sur des textes précis cette a%rmation démesurément outrancière.
5 Sidney, Court Maxims, Discussed and refelled (1664-5), H. Blom, E. H. Mulier, R. Janse éd., Cambridge, Cambridge University Press, 1996 (Les maximes de la cour discutées et réfutées (1664-5), trad. L. Carrive, Paris, Éditions Kimé, 1998), Maxime II, p. 12 (désormais cité comme suit, directement dans le corps du texte : M, suivi du numéro de la Maxime, en chi&re romain, et du numéro de la page du manuscrit, reproduit dans la marge dans l’édition anglaise de Cambridge University Press, et dans le corps du texte entre crochets dans l’édition française). – Toutes les citations extraites des Maxims sont nos traductions.
64 L’ESPRIT RÉPUBLICAIN
dont son maître florentin s’était lui-même dispensé ? Sullivan n’évoque que dans une note le fait que pour Sidney la guerre d’expansion doit être juste pour être entreprise1. Or, dans la mesure où cette thèse s’intègre au type de raisonnement que Sidney propose lorsqu’il réfléchit sur les relations politiques intérieures, il n’y a aucune raison de la marginaliser de la sorte. Il est vrai, cependant, qu’elle semble entrer en tension avec les déclarations de Sidney a%rmant la nécessité du recours à la guerre. Mais comme nous le verrons2, le présupposé qui permet d’expliquer l’a%rmation de la nécessité, pour les nations, de s’engager dans des guerres de conquêtes, n’est pas la fascination pour la violence ou la domination, mais l’absence de lois de nature régissant les rapports entre les nations.
Indépendamment de ce point, la thèse qui encadre la guerre par la justice est essentielle surtout parce qu’elle renvoie à une conception de la vertu que Sullivan occulte totalement. Si Sidney donnait au politique la fonction de « satisfaire le désir humain », si son républicanisme avait pour finalité de « déchaîner les passions3 » des hommes tels qu’ils sont, pourquoi insiste-t-il à ce point sur la nécessité d’être vertueux et de ne pas céder aux passions destructrices de l’intégrité des mœurs néces-saires à la protection de la liberté et au respect de la justice4 ? Pourquoi s’e&orce-t-il de distinguer ce qui de fait est désiré et ce qui en droit est désirable5, l’intérêt égoïste et la vertu (M, IX, p. 126) ? Si Sullivan a raison, comment dès lors comprendre la définition formelle de la vertu comme précepte moral qui prescrit aux hommes de faire le bien de leurs semblables, c’est-à-dire de contribuer à maintenir leur liberté6 ? Et quel sens attribuer à ces nombreux passages où Sidney a%rme que la justice d’une loi ne tient à rien d’autre qu’à sa rectitude inhérente ? Surtout, comment comprendre que le droit naturel des peuples et des individus à résister par la violence à la tyrannie soit conçu comme un acte qui, comme l’action vertueuse, se justifie par lui-même, c’est-à-dire
1 Sullivan, op. cit., p. 209, n. 24.2 Cf. notre section « Un républicanisme belliciste ? » (2e partie).3 Ibid., respectivement p. 226 et 202 ; cf. également p. 203.4 M, III, p. 27 : « La justice est cette vertu qui devrait perpétuellement diriger toutes nos
actions en ce monde, et qui devrait être la règle du commerce » ; sur cette question, voir notre section « La vertu civique comme soutien… » (2e partie).
5 M, I, p. 3 : « ce n’est pas celui qui a ce qu’il désire qui est heureux, mais celui qui désire ce qui est bon et en jouit ».
6 Cf. notre section « La finalité du gouvernement » (1re partie).
INTRODUCTION 65
par sa « rectitude inhérente1 » ? Tant qu’elle ne prend pas en charge ces questions en négligeant purement et simplement certains éléments doctrinaux, l’interprétation straussienne de la signification du concept de vertu chez Sidney est sujette à caution.
Si l’hypothèse straussienne apparaissait initialement prometteuse pour comprendre les rapports entre droit naturel et vertu civique chez Sidney, elle conduit en réalité à rendre ces concepts tout aussi incom-patibles que dans le modèle de Pocock : dans cette hypothèse, Sidney ne peut endosser le droit naturel moderne que s’il disqualifie toute moralité indépendante des soucis amoraux au cœur du libéralisme et s’il souscrit à la manière dont les Modernes ont vidé la politique de tout contenu éthique en lui attribuant comme but de protéger des désirs amoraux juridicisés. De même, il ne peut être machiavélien sans faire des vertus les instruments de satisfaction de désirs humains dénués de tout statut moral objectif.
Bref, le principal problème de cette lecture straussienne est qu’en plus de taire des pans entiers de l’argumentation de Sidney, elle en déforme gravement certains aspects : sa conception de la vertu civique ne se réduit ni à la vertu guerrière dans la politique extérieure, ni à la vengeance contre les tyrans dans la politique intérieure2. De même, sa conception des droits naturels n’a rien à voir avec la réduction hobbesienne du droit moral au droit de préservation de soi3.
La seconde tentative de redéfinition des termes de l’opposition consiste à acclimater le concept républicain de la vertu à la logique libérale de la défense de la liberté et des intérêts individuels. Dans un court livre sur les Discourses de Sidney, S. Nelson a explicitement cherché à reconstruire de manière rationnelle et normative la doctrine4. Selon lui, la conception de la nature humaine qu’endosse Sidney suppose ce que les sciences sociales appellent un « acteur rationnel5 ». Mais cette rationalité est plus large que la simple considération de l’intérêt, car le calcul n’est pas seulement « hédoniste » ou purement « individualiste » :
1 Cf. notre section « Le droit de résistance républicain (2) » (3e partie).2 Cf. notre section « La vertu civique comme soutien… » (2e partie).3 Cf. notre section « Le concept républicain de la liberté » (1re partie).4 S. Nelson, The Discourses of Algernon Sidney, London-Toronto, Associated University Press,
1993, p. 7-10, 31, 36, 149.5 Ibid., p. 35.
66 L’ESPRIT RÉPUBLICAIN
« la vertu – incluant le courage de se plaindre et de résister à l’autorité quand cela est nécesaire, ainsi que le fait de tenir sa parole et de dire la vérité – est également rationnelle1 ».
Or, précise Nelson, « on a des raisons de penser que Sidney devait partiellement à Aristote son concept de vertu sociale, composante de sa théorie qui le distingue d’autres théoriciens du contrat2 ». Sans avoir ni explicité ces raisons, ni spécifié la proportion en question, ni même identifié son e&et précis dans la doctrine de Sidney, Nelson a%rme dans la conclusion de son ouvrage que par son insistance sur la vertu civique, Sidney permet de donner sens, au sein du contractualisme, à la possibilité de réaliser les finalités de la société par la cohésion, l’obligation et une forme « d’esprit communautaire ». C’est pourquoi Nelson rapproche Sidney de Rousseau : comme celle du Genevois, la doctrine de Sidney est « similairement communautarienne, enracinée dans l’obligation d’un peuple, ce qui peut demander des sacrifices extrêmes ». Il fait valoir pour finir que « la théorie de Sidney est une synthèse, bien que parfois inélégante, de la perspective de l’acteur rationnel et de la pers-pective communautarienne3 ». Le problème est que Nelson postule, mais n’explique aucunement, la raison pour laquelle le sacrifice pourrait s’insérer dans la logique d’un « agent rationnel ».
De plus, à côté de cet argument qui laisse entendre que la rationa-lité est irréductible à l’utile, Nelson semble soutenir au contraire que l’originalité de Sidney est de montrer que la vertu relève avant tout de l’utile. Si le courage, l’industrie, la sagesse, la sincérité et le fait de tenir ses promesses, sont « de bonnes qualités », c’est « parce qu’elles conduisent à la sûreté, à l’ordre et au bonheur ». « La vertu est profitable aux régimes4 », insiste Nelson. Par conséquent, lorsqu’il soutient que « le comportement vertueux fait partie du calcul rationnel de l’homme5 », et que le gouvernement doit mettre les hommes dans les conditions de « maximiser leur propre avantage6 », il reste finalement peu de place pour une quelconque raison non calculatrice, et pour une conception non strictement utilitaire de la vertu.
1 Ibid., p. 149 ; cf. également, p. 35, 37, 90, 116.2 Ibid., p. 67.3 Ibid., p. 152, 153.4 Ibid., p. 37 (italiques dans l’original).5 Ibid., p. 38.6 Ibid., p. 41.
INTRODUCTION 67
Enfin, Nelson valide une interprétation subjectiviste de la rationalité des contractants, lorsqu’il considère les textes délicats où Sidney donne l’impression de réduire la proposition rationaliste et normative selon laquelle c’est en considérant leur propre bien que les hommes se sont rassemblés, à la proposition subjectiviste selon laquelle c’est « l’opinion de ce bien [qui] doit avoir été la règle, le motif et la fin de tout ce qu’ils décrétèrent » (D, II, 5, p. 99). Le problème de cette interprétation est qu’elle entre en totale contradiction avec les axiomes anthropologiques à partir desquels raisonne Sidney ; en particulier, s’il su%t que l’individu considère une chose bonne pour que cette dernière le devienne, il faut alors renoncer à convaincre ceux qui aiment la servitude qu’ils se trompent1, et il faut renoncer à l’ambition de montrer que lorsque les hommes cherchent leur propre bien, ils doivent chercher à satisfaire les intérêts fondamentaux qui correspondent à leur nature d’êtres rationnels et libres2.
L’hypothèse de A. Houston tente elle aussi de rendre compatibles les deux langages ; elle est d’emblée plus satisfaisante parce qu’elle semble prendre au sérieux la dimension morale de la doctrine de Sidney : Houston parle en e&et d’une « éthique de la liberté individuelle », et soutient que « le concept de liberté exprimait les idéaux et les aspirations les plus élevés de Sidney, et fournissait le fondement moral de sa théorie de l’autogouvernement3 ». Selon cette lecture, la compatibilité se joue dans une redéfinition « des fondements psychologiques de la citoyenneté républicaine4 » : là où les républicains classiques soutiennent que la vertu est désintéressée et avant tout d’ordre moral, le républicanisme moderne de Sidney aurait pour originalité de faire de « l’intérêt égo-ïste » (self-interest) le « fondement le plus puissant de la vertu civique ». Dès lors, le langage de la vertu et le langage des droits ne sont plus opposés, parce que la vertu civique est redéfinie à partir d’une anthro-pologie intéressée5. Une telle lecture est sans aucun doute plus fidèle au texte de Sidney, mais elle semble finalement rejoindre l’hypothèse selon laquelle la conception moderne de la vertu républicaine peut être
1 Cf. notre section « Les axiomes anthropologiques » (1re partie).2 Cf. idem et notre section « La vertu civique comme soutien… » (2e partie).3 Houston, op. cit., p. 101, 102.4 Ibid., p. 147.5 Ibid., p. 166.
68 L’ESPRIT RÉPUBLICAIN
réduite à l’intérêt bien compris1. Or faire de l’égoïsme, même éclairé, le contenu de la vertu, c’est contredire la lettre du texte de Sidney2 – ce qui ne signifie pas qu’il n’accorde pas une place à l’intérêt dans sa conception de la vertu.
Plus précisément, Houston soutient d’un côté que Sidney a réussi à montrer les « interconnexions » entre « le langage de la vertu et de la corruption » et « la logique des droits, des intérêts, des lois et des contrats », au point de rendre ce langage et cette logique « insépa-rables3 ». En e&et, avance-t-il, Sidney propose une « nouvelle éthique » où ce n’est plus le contrôle de soi mais l’obéissance aux lois qui définit la vertu civique. Cela implique « une reconfiguration spectaculaire des concepts de vertu et de corruption », car la vertu ne relève dès lors plus d’une « éthique du caractère » aristocratique, mais d’une « éthique du comportement4 » compatible avec la démocratie. Mais cette a%rmation est ambiguë : elle est juste si l’on veut souligner que Sidney abandonne l’idée d’une vertu aristocratique morale et sacrificielle inaccessible au peuple commun, au profit d’une conception plus égalitaire ; mais elle est erronée si l’on veut prétendre par là qu’il lui substitue une notion de vertu réduite à la simple conformité extérieure de l’action aux lois positives. Car c’est toujours l’examen, opéré par la conscience, de la justice des lois – ou de la conformité de l’action à la finalité de la société qu’est la liberté –, qui constitue la vertu individuelle d’obéissance aux lois. La motivation de l’action, et donc l’éthique du caractère, ne sont pas évacuées mais au contraire tout à fait centrales dans le dispositif de la souveraineté des lois, parce que ce qui définit la vertu civique n’est pas la simple conformité de l’action aux lois, mais l’obéissance à ces lois pour la raison qu’elles sont justes5.
De même, Houston est également allé trop loin dans sa caractérisa-tion de la relation entre les intérêts et la vertu. Il soutient que la raison pour laquelle Sidney ne développe pas de théorie de l’éducation tient
1 C’est la position de Q. Skinner pour Machiavel, et de S. Burtt pour les Cato’s Letters [1720-23], cf. Virtue transformed : Political argument in England. 1688-1740, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, chap. 4, p. 64-86.
2 Cf. notre section « La vertu civique comme soutien… » (2e partie).3 Houston, op. cit., p. 169 (et note 98) ; cf. p. 3, 6, 137 (note 161), 147.4 Ibid., p. 157.5 C’est d’ailleurs ce que suggère Houston lui-même lorsqu’il redécrit l’éthique du
comportement comme une « éthique de la responsabilité publique » (ibid., p. 168).
INTRODUCTION 69
au fait que « la fusion du langage de la vertu et de la logique des droits et des intérêts a pu rendre moins urgent de proposer une méthode pour inculquer la vertu » : « à la di&érence de la vertu, les intérêts naissent spontanément et n’ont pas besoin d’être cultivés1 ». Or, il suggère par là que la vertu consiste simplement à respecter les lois qui protègent les intérêts spontanés des hommes, ce qui rend incompréhensible l’e&ort constant que fait Sidney précisément pour hiérarchiser les intérêts des hommes et montrer que l’amour de la liberté n’est naturel qu’au sens où la raison est la nature de l’homme2. En outre, non seulement Sidney pose les linéaments d’une conception de l’éducation à la vertu tout à fait cruciale pour l’intégrité des mœurs, mais le sens même de cette éducation est de faire naître en l’homme l’irréductibilité de la vertu à l’intérêt3.
En e&et, s’il insiste volontiers sur l’idée que la vertu est favorable à l’intérêt individuel – et s’il loue les républiques pour avoir compris le lien qui unit cet intérêt au bien commun – Sidney ne fonde pas la vertu dans l’égoïsme mais au contraire dans la capacité morale de l’individu à vouloir ce qui est bien. Or, cette capacité est le fondement de l’intégrité des mœurs et de l’obéissance aux lois.
Mais si la vertu civique est dotée d’une valeur morale irréductible, on demandera alors comment Sidney peut continuer de soutenir que la société politique a avant tout pour objet de protéger les droits des individus. La réponse consiste précisément à dire que cette thèse morale selon laquelle l’homme est doté de la capacité à vouloir ce qui est bien est au centre de la conception jusnaturaliste de Sidney : le droit naturel qu’est la liberté n’est pas seulement un droit qui protège des intérêts, mais encore un devoir objectif que l’homme doit honorer s’il veut vivre conformément à sa nature d’être libre. Par conséquent, si la vertu est dotée d’une valeur morale irréductible, c’est parce que la liberté qu’elle est censée maintenir (et qui reste l’objet premier du gouvernement) est elle-même identifiée au devoir de l’homme.
De plus, loin d’endiguer le développement de thèses fortement individualistes, cette conception morale du droit naturel est au principe de plusieurs séquences où Sidney s’attache à montrer que l’individu doit pouvoir régler sa vie comme il l’entend tant qu’il respecte les lois
1 Ibid., p. 178.2 Cf. notre section « Les axiomes anthropologiques » (1re partie).3 Cf. notre section « La vertu civique comme soutien… » (2e partie).
70 L’ESPRIT RÉPUBLICAIN
protégeant la liberté de chacun, et que l’État n’est en rien fondé à dicter aux individus libres leur conduite1. Toutefois, cet individualisme ne contraint aucunement Sidney à croire que la vertu se réduise à l’intérêt bien compris, ou que le fondement de l’obéissance aux lois relève d’un calcul prudentiel. Jamais Sidney ne renonce à l’idée que l’existence pro-prement humaine est caractérisée par une dimension morale, laquelle consiste à s’interroger sur le sens et la valeur des motifs de son action, et rend par là possible la capacité de l’homme à agir en citoyen vertueux. En outre, cette dimension morale constitue aussi bien le fondement de la valeur que l’homme attribue au désir de liberté, que celui de la légitimité du droit de défendre cette dernière2.
Par conséquent, pour donner sens à la coprésence non contradictoire des deux langages dans la pensée de Sidney, il est impératif de redéfi-nir à la fois la conception du droit naturel et la conception de la vertu civique. D’une part, ce n’est pas parce que le jusnaturalisme comporte le développement d’une dimension privatiste qu’il est une doctrine de l’utilité a%rmant le droit de l’individu à la sûreté et au bonheur per-sonnel entendu subjectivement. De l’autre côté, de ce que la liberté est la finalité première du gouvernement et l’objet même du bonheur de l’homme, on ne peut pas inférer que la vertu soit réductible à l’intérêt bien compris.
Ce livre est issu d’une thèse de doctorat en philosophie soutenue en 2009 à l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne et dirigée par J.-F. Spitz. Je remercie l’École doctorale, l’équipe Philosophies Contemporaines, le laboratoire NoSoPhi et leurs directeurs respectifs de m’avoir o"ert d’excellentes conditions pour la réaliser. Ma reconnaissance va aussi au Département de philosophie de l’Université de Rouen, qui m’a accueilli lorsque je préparais cet ouvrage. Enfin, ce livre doit beaucoup aux encouragements et au soutien de L. Foisneau et C. Larrère.
1 Cf. notre section « L’individualisme républicain » (2e partie).2 Cf. nos sections «Le droit de résistance républicain » (1) et (2) (3e partie).