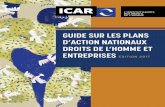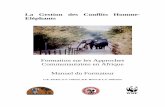Bulletin Apdhac N°40 Conflits armés en Afrique, migrations et droits de l'homme
-
Upload
ministryhighereducationscientificresearch -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Bulletin Apdhac N°40 Conflits armés en Afrique, migrations et droits de l'homme
Bulletin de l’APDHAC --- N°40 Janvier 2014 --- Diffusion gratuite --- [email protected] 1
Bu
lle
tin
de
l’A
PD
HA
C
Au
ser
vice
de
la v
érit
é, d
e la
just
ice
et d
e la
dig
nit
é h
um
ain
e e
n A
friq
ue
cen
tra
le
Editorial L’Afrique ou la malédiction des conflits ar-
més et des mouvements migratoires ?
« Conflits armés en Afrique, migration et droits
de l’homme », le thème de ce Bulletin n°40 de
l’APDHAC est d’une lancinante actualité, tant il
s’annonce comme un ultime avertissement au
célèbre slogan : « L'Afrique « noire » est mal
partie » (René Dumont, 1962). En témoigne, la
vague de naufragés migrants aux larges des côtes
italiennes de Lampedusa et ailleurs, dont de mul-
tiples morts et disparus ; la résurgence des con-
flits en Afrique, notamment au Maghreb (Libye,
Egypte et Tunisie), en Afrique de l’Ouest (Mali,
Côte d’ivoire et Guinée), en Afrique de l’Est
(Somalie, Kenya et Soudan du Sud) et en Afrique
centrale (RCA et RDC), etc., entraînant la migra-
tion de populations aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur des Etats, et sonnant comme un orgue
de jetée sur toute l’Afrique.
Les conflits armés, aussi bien que l’insécurité, la
dégradation de l’environnement et la pauvreté
sont autant de causes de migrations et de dépla-
cements forcés en Afrique. Certes, le phénomène
n’est pas le propre de l’Afrique, en cette période
de mondialisation, mais les contributions d’ici
sont raisonnables, « non pas parce que l’utopie
d’aujourd’hui est souvent la réalité de demain »,
mais parce que de nombreux éléments, disparates
certes, ont déjà posé les jalons d’une gestion
globale organisée de la migration en périodes de
conflits armés. La question des migrations et des
droits de l’homme dans des situations peu sûres
et imprévisibles telles que les situations de con-
flits armés ou de violence généralisée représente
dès lors un grand défi. Cette question est an-
cienne en Afrique, avec la fréquence des micro-
déplacements transfrontaliers, notamment parmi
les communautés qui vivent de part et d'autre des
frontières nationales. Ces mouvements se pour-
suivent, voire s'amplifient, et ce malgré les res-
trictions croissantes imposées aux frontières1.
Certaines contributions ont laissé voir que
l’approche normative de la migration en période
de conflits armés a surtout mis l’accent sur les
droits des personnes concernées. Il existe bon
nombre de conventions aux niveaux mondial et
régional concernant les droits des personnes
impliquées dans la migration, mais ces instru-
ments sont dispersés dans différentes branches du
1 Voir Colloque sur les Migrations et protection des droits de l’homme, Organisation internationale pour les migrations (OIM),
Dakar, Sénégal, 25 au 28 octobre 2004, 166 p, p. 5.
droit (droits de l’homme, droit humanitaire, droit
des travailleurs migrants, droit des réfugiés, droit
des NTIC, droit du développement, etc.). Il n’existe
aucun pôle de convergence qui les réunisse tous, ni
aucune source d’information centrale donnant faci-
lement accès à l’ensemble des informations corres-
pondantes, et peu de tentatives ont été faites pour
comprendre les relations unissant ces différents
instruments les uns aux autres. De plus, le contenu
exact ou la raison d’être de ces instruments ne sont
pas toujours clairement perçus, et il règne à ce sujet
une incertitude qui tient au manque d’information
sur l’état d’avancement de leur ratification et de
leur application par les Etats2.
D’autres synopsis ont mis en perspective que le
nombre croissant des migrants (travailleurs,
réfugiés et déplacés internes) et la complexité des
flux migratoires à l’intérieur des régions mettent en
évidence la nécessité de développer des approches
de coopération entre les Etats pour la gestion des
migrations en période de crises. Ces partenariats de
collaboration et de coopération doivent s’étendent à
travers tout le continent africain, et même au-delà à
d’autres pays et entités régionales.
Les activités visant à prévenir et à gérer les conflits,
à la promotion de la bonne gouvernance et de l’Etat
de droit, à l’éradication de la pauvreté et à la
protection de l’environnement sont capitales pour
assurer le succès futur des politiques de gestion des
migrations au niveau national, régional et
continental. Car ce sont principalement d'autres
pays africains qui subissent le choc des fortes
pressions migratoires liées aux conflits qui
surviennent sur le continent. Une lecture
prospective des textes de ce numéro témoigne donc
d’un consensus sur le fait que des politiques
intégrées doivent s’attaquer à la racine du problème
migratoire en période de crises en Afrique.
En espérant que la 20ème
session du Sommet de
l'UA qui s’est tenue du 21 au 28 janvier 2013 à
Addis Abéba, sous le thème « Panafricanisme et
renaissance africaine », n’aura pas accouché d’une
sourie et contribuera, à l’instar de l’hypothèse de la
« malédiction des ressources »3, à conjurer la « ma-
lédiction des conflits armés et des mouvements
migratoires » en Afrique.
Docteur Martial JEUGUE DOUNGUE
2 Voir Rapport de la Commission de l’Union africaine sur le
cadre stratégique pour une politique de migration pour l’Afrique, Conseil exécutif, Neuvième Session ordinaire, 25 – 26 juin 2006,
Banjul (GAMBIE), EX.CL/276 (IX), 45 p, p. 33. 3 Lire à ce sujet, Audrey AKNIN, « Le développement durable peut-il conjurer la malédiction des ressources ? », in Mondes en
développement, 2009/4 n° 148, p. 15-30.
Université Catholique d’Afrique centrale Association pour la promotion des droits de l’homme en Afrique centrale
EX CATHEDRA N°40 Janvier 2014 Gratuit
Bulletin de l’APDHAC --- N°40 Janvier 2014 --- Diffusion gratuite --- [email protected] 2
Les déterminants de l’émigration
internationale en période de conflits
armés
Le concept de migration1 suppose un
déplacement de populations humaines se
déroulant à la fois dans le temps et dans
l’espace. Il faut également signaler que
le principe migratoire n’est pas simple-
ment lié au concept d’Etat qui est de
création récente à l’échelle de l’histoire
de l’humanité2. Les individus se sont en
effet toujours déplacés hors de leurs
foyers et pays d’origine. Les migrations
peuvent être le fait des conflits armés ou
troubles internes. Ces conflits se carac-
térisent aujourd’hui par leur complexité
et leur diversité. La migration peut être
volontaire ou involontaire mais, la plu-
part du temps, elle procède d’un mé-
lange de choix et de contraintes3. En
Afrique comme ailleurs, les conflits
armés provoquent de nombreux flux
migratoires des populations vers des
pays voisins. Des mouvements des po-
pulations qui fuient la guerre pour les
pays de refuge sont perceptibles à
chaque fois, mouvements qui alimentent
par le fait même ce qui est connu
comme migration irrégulière4 et la crise
de réfugiés. C’est le phénomène
d’émigration5 internationale dont la
cause principale est le conflit armé. En
période de conflit armé ou de crise gé-
néralisée, un certain nombre de facteurs
conditionnent les déplacements des
civils vers les pays voisins pour éviter
de subir les exactions et les violations
découlant du phénomène de crise. Ces
facteurs appelés déterminants sont tribu-
taires aussi bien du pays d’accueil (I)
que du pays d’origine (II) où sévit la
crise.
1 Déplacement d'une personne ou d'un groupe de personnes, soit entre pays, soit dans un pays entre
deux lieux situés sur son territoire. 2 La notion d'Etat remonte au contrat social, théorie politique et philosophique développée aux XVIIe et
XVIIIe siècles par les philosophes (J. LOCKE, T.
HOBBES, J. J. ROUSSEAU) du droit naturel, postulant que l'individu se trouve au fondement de la
société et de l'État, lesquels naissent de l'accord
volontaire entre des individus libres et égaux. 3 Fédération internationale des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, Politique relative à la
migration, novembre 2009, p.2 4 Migration internationale contrevenant au cadre
légal du pays d'origine, de transit ou de destination. 5 L’émigration s’entend comme l’action de quitter son Etat de résidence pour s’installer dans un Etat
étranger.
I. Les facteurs de « pulsion »6
Il s’agit des facteurs qui déterminent ou
qui « poussent » les gens à quitter leur
pays d’origine en période de guerre. Si
ces facteurs sont multiples, notons que
certains sont notables ou déterminants
pour l’émigration.
A. L’obstruction des possibilités
d’emploi L’une des conséquences premières d’un
conflit armé est l’arrêt ou la diminution
des activités économiques. En effet, la
crise ouvre souvent droit à des compor-
tements qui portent atteinte à la fortune
économique aussi bien de l’Etat que du
privé. Au niveau de l’Etat, la fermeture
des institutions et établissements publics
obligent les fonctionnaires à ne plus se
rendre au travail. La conséquence im-
médiate est le non paiement des salaires.
Les personnes qui n’ont pour seul reve-
nu que les salaires se retrouvent donc en
difficultés. La situation n’est pas diffé-
rente dans le privé et le secteur informel.
Cet état de choses favorise le pillage des
magasins pour les besoins de subsis-
tance. Lorsque la situation devient in-
soutenable, il ne reste que la voie de
l’émigration du travail pour la subsis-
tance de la famille ou tout au moins des
membres de la famille qui ont échappé
aux exactions et violations graves des
droits de l’homme.
B. Les exactions et violations des
droits de l’homme Les parties au conflit se livrent souvent
à des exactions et des violations graves
des droits de l’homme qui conditionnent
le départ des civils vers d’autres terri-
toires. L’instinct de sauver sa vie, quitte
à perdre tous ses biens, animent les
populations qui sont prises pour cible
par les groupes armés. Pour ce qui est de
la RCA, par exemple, Human Rights
Watch (HRW) a rapporté dans son rap-
port du 10 mai 2013 que les rebelles en
s’emparant de Bangui, se sont livrés à
une frénésie de pillages, ont assassiné
des civils, et violé des femmes.
L’organisation à par la suite précisé
qu’un grand nombre de ces meurtres ont
été commis en ville en plein jour, ce qui
6 Expression empruntée à Kuzvinetsa Peter Dzvimbo, La Migration Internationale du Capital Humain
Qualifié des Pays en Développement, Banque Mon-
diale, Département des Ressources Humaines, Une étude de cas préparée pour une Conférence Régio-
nale de Formation sur L’Amélioration de
l’Enseignement Supérieur en Afrique subsaharienne : Ce qui marche ! Accra, du 23 au 25 Septembre
2003
dénote de la situation de chaos dans la
ville7. Les mêmes exactions sont percep-
tibles en RDC. Selon un décompte des
enquêteurs de l’ONU sur la crise congo-
laise, 17 personnes, dont deux garçons
avaient été tués dans l’offensive pour la
conquête de Goma, qui avait durée une
semaine. Pendant près de 10 jours
d’occupation de Goma et de la ville
voisine de Sake, au moins 11 civils
avaient été exécutés arbitrairement et les
combattants du M23 avaient commis 58
viols8.
C. La crise humanitaire Les conflits armés engendrent souvent
des crises humanitaires qui poussent les
populations à se déplacer et à se réfugier
dans des pays voisins. Ces populations
ont souvent besoin d’une aide humani-
taire d’urgence. Cette aide s’analyse
souvent en termes de fourniture d’abris,
de la nourriture, des équipements sani-
taires et des services médicaux. Le cas
le plus récent de la RCA présente des
situations insupportables dans lesquelles
vivent les personnes qui fuient les zones
de conflit. Selon le porte parole du
HCR9, la situation humanitaire en Ré-
publique centrafricaine continue de se
dégrader avec des dizaines de milliers
de personnes qui ont été contraintes de
fuir leurs maisons à cause des violences.
Dans la capitale Bangui, les combats et
la violence sectaire ont déplacé environ
159 000 personnes. Par ailleurs, 450
personnes auraient été tuées dans la
capitale et 160 autres à travers le pays,
selon la Société de la Croix-Rouge cen-
trafricaine et le Conseil danois pour les
réfugiés. A l'aéroport de Bangui, il y a
38 000 personnes. Il n'y a pas de la-
trines, ni d'installations sanitaires, ni
d'abri contre la pluie ou le soleil. Dans
ce genre de situation, la solution con-
siste à se réfugier ailleurs pour faire face
à la crise humanitaire. Cela n’est pos-
sible que si les pays sollicités présentent
des conditions d’attraction.
7http://fr.wikinews.org/wiki/RCA_:_de_graves_violations_des_droits_humains_commises_par_la_Séléka
_selon_HR, consulté le 25 décembre 2013. 8 http://radiookapi.net/lu-sur-le-web/2013/05/08/viols-en-rdc-lonu-denonce-les-
exactions-de-larmee-des-rebelles-congolais-
liberation/, (consulté le 25 décembre 2013). 9 Adrian Edwards, conférence de presse du 13 dé-
cembre 2013 au Palais des Nations à Genève sur la
dégradation de la crise humanitaire en RCA. http://www.unhcr.fr/52ab2938c.html, consulté le 26
décembre 2013.
Bulletin de l’APDHAC --- N°40 Janvier 2014 --- Diffusion gratuite --- [email protected] 3
II. Les facteurs d’ « attraction »10
Les facteurs dits d’ « attraction » sont en
fait des éléments déterminants de
l’émigration internationale dans un con-
texte de crise ou de conflit armé. Ces
facteurs commandent donc le déplace-
ment des populations victimes des
guerres vers d’autres territoires.
A. La stabilité politique et la position
géographique Grâce à leur potentiel socio-économique
et à leur relative stabilité politique, cer-
tains pays font l’objet de sollicitation
par les personnes victimes de guerres et
qui recherchent des conditions de vie
meilleures. Les pays ainsi sollicités
deviennent des destinations des flux
migratoires. Pour la majorité des per-
sonnes qui entrent dans ces pays, leur
intention est d’obtenir l’asile ou le statut
de réfugié. La position géographique
constitue également un facteur détermi-
nant en termes de choix de destination
pour les personnes qui cherchent à
échapper aux exactions commises pen-
dant les conflits armés. S’il est vrai que
ces personnes ont souvent tout perdu en
termes de bien matériels et financiers,
leur premier reflexe est de migrer vers le
pays le plus proche de leur territoire,
pour éviter de faire face à des dépenses
exorbitantes, en pensant aussi à la pos-
sibilité de retour. Le Cameroun par
exemple constitue une zone privilégiée
des flux migratoires, en raison de sa
relative stabilité politique et de son po-
tentiel socio-économique actuel. Au
cours de ces dernières années, la popula-
tion a augmenté de manière significative
à cause des conflits qui se déroulent
dans les pays voisins. Les personnes qui
fuient les conflits dans leur pays
d’origine cherchent des conditions de
vie meilleures. Elles sont encadrées par
les autorités nationales et le HCR. La
priorité est souvent accordée aux activi-
tés nécessaires à leur survie, notamment
la réduction de la malnutrition et
l’anémie, la fourniture des abris, de
l’énergie domestique et de l’eau,
l’assainissement et l’hygiène, ainsi que
l’accès à l’éducation. Ces personnes
pourront également bénéficier des deux
principes qui sont les pierres angulaires
de la protection : le non-refoulement et
l'accès des réfugiés et des demandeurs
d'asile au territoire.
10 Expression empruntée à Kuzvinetsa Peter
Dzvimbo, op. cit.
B. La recherche d’un environnement
sain et vivable Au-delà des enjeux humanitaires évi-
dents, les conflits armés soulèvent
d’importants et de cruciaux enjeux envi-
ronnementaux. Ces enjeux paraissent de
plus en plus évidents quand on songe
aux effets immédiats que peuvent en-
gendrer les déplacements massifs de
populations ou l’installation de camps
de réfugiés. Par ailleurs, les situations de
conflit anticipé ou ouvert, ou les ten-
sions qui les précèdent et les accompa-
gnent, mobilisent en général dans les
pays impliqués des ressources finan-
cières pour l’armement ou le déploie-
ment et la stratégie militaire, ressources
qui ne sont plus disponibles pour le
bien-être et le développement écono-
mique des populations. Les conflits
armés s’accompagnent aussi d’un effon-
drement de la gouvernance environne-
mentale, qui engendre à son tour une
dégradation accélérée de
l’environnement. Parfois la destruction
provoque des dégradations irréversibles
dans les écosystèmes ; c’est le cas lors-
que des espèces peuvent être amenées à
l’extinction, ou que des écosystèmes
fragiles peuvent être irréversiblement
dégradés, ou des ressources irrémédia-
blement détruites ou contaminées. S’il
est vrai que personne ne se préoccupe de
l’environnement lorsque des vies hu-
maines sont en danger ou que des va-
leurs humaines fondamentales doivent
être défendues, notons qu’après les con-
flits, c’est sur l’environnement et ses
ressources que devra se fonder la re-
construction. On connaît à ces fins
l’importance de l’eau, de la biodiversité,
de la forêt, des espaces agricoles. Les
dommages causés à ces ressources peu-
vent entraîner, bien après les conflits,
des effets néfastes, voire létaux, sur les
populations affectées11
.
C. Les liens familiaux et
l’attachement à la patrie Si ces facteurs passent souvent inaper-
çus, il faut dire qu’ils s’avèrent détermi-
nant pour les étrangers qui se retrouvent
en territoire de conflit armé d’une part et
pour les nationaux d’un pays en conflit
qui ont des ramifications familiales au-
delà des frontières, d’autre part. Dans le
11 Al–Hamandou Dorsouma et Michel-André Bou-
chard, « Conflits armés et environnement », Déve-
loppement durable et territoires [En ligne], Dossier 8 | 2006, mis en ligne le 07 janvier 2013,
http://developpementdurable.revues.org/3365 ; DOI :
10.4000/développement durable.3365, consulté le 25 décembre 2013.
premier cas, les étrangers qui fuient les
hostilités dans un pays en crise bénéfi-
cient souvent du coup de pouce de leur
gouvernement. C’est ainsi qu’on assiste
dans la plupart du temps aux rapatrie-
ments des étrangers par leur gouverne-
ment comme c’est le cas avec l’Etat
camerounais. Des instructions ont été
données de rapatrier des camerounais
vivant à Bangui sur Douala pour leur
éviter de subir les exactions souvent
commises lors des conflits armés. Pour
certains de ces camerounais, ils étaient
la cible de quelques groupes armés selon
qu’ils étaient musulmans ou chrétiens.
L’un d’eux interviewé à l’aéroport de
Douala a laissé entendre qu’il remerciait
Dieu d’avoir survécu au carnage subit
par sa famille. Il a vu deux de ses en-
fants massacrés à la machette et brûlés
devant lui, au même titre que ses biens
mobiliers et immobiliers. Dans le se-
cond cas, le découpage des frontières à
l’ère coloniale a divisé des familles qui
ont gardé des liens jusqu’à ce jour. Ain-
si, il suffit qu’il y’ait crise ou troubles
sur un territoire donné pour voir des
familles migrer vers d’autres territoires
où elles ont gardé des liens d’affection
depuis des années. Cela est également
favorisé par le phénomène de mariage
entre les ressortissants de pays voisins.
Mais, il faut signaler que, ces deux fac-
teurs sont perceptibles dans des zones
ou sous-régions où la circulation libre
des hommes et des biens constitue une
réalité palpable.
ONANA Maurice Magloire
Expert en droits de l’homme
Président de l’ADDHAH
Secrétaire Exécutif du RAEDH
Une possible protection des naufragés
migrants en Droit international de la
migration ? À propos du naufrage du
3 octobre 2013 à Lampedusa
Encore un naufrage ! Le large des îles
italiennes est-il devenu le cimetière des
migrants ? Que faire pour stopper de
telles tragédies ? Il faut dire que la tra-
gédie de Lampedusa vient accroitre le
nombre de naufragés migrants à la quête
des meilleures conditions de vie12
. En
12 On estime à 20 000 le nombre de personnes qui ont perdu la vie au cours des deux dernières décennies en
essayant de rejoindre les frontières sud de l'Europe
depuis la bordure septentrionale de la Méditerranée (FIDH, « Le naufrage de Lampedusa : un coup de
semonce pour l'Union Européenne ? » Lettre ouverte
aux Ministres de l'Intérieur de l'UE et à la Commis-saire européenne aux affaires intérieures, 8 octobre
2013). Voir aussi les statistiques suivantes : Selon
Bulletin de l’APDHAC --- N°40 Janvier 2014 --- Diffusion gratuite --- [email protected] 4
effet, le phénomène migratoire a com-
mencé en 1992 et s'est progressivement
amplifié. La plupart des victimes sont
des personnes qui fuient la dictature et
les conflits se déroulant en Érythrée, en
Somalie, en Éthiopie et, plus récem-
ment, en Syrie, au Soudan, en Libye et
qui ont droit à la protection que leur
confère le droit international relatif aux
réfugiés et aux droits humains. C’est
ainsi que le flux des migrants qui pren-
nent le risque de voyager en mer dans
des conditions précaires posent ainsi des
problèmes particuliers aux États fronta-
liers13
. Certaines zones font ainsi l'objet
de tentatives récurrentes d'accostage,
tentatives se soldant souvent par la mort
des migrants à l’instar du Canal de Si-
cile entre l’Italie et le Libye, les en-
claves espagnoles au Maroc de Ceuta et
de Melilla ou les îles Canaries sont des
points d’entrée possibles sur le territoire
européen. Le 3 octobre 2013, une em-
barcation transportant environ 500 mi-
grants clandestins africains fait naufrage
près de Lampedusa, île italienne proche
de la Sicile. La catastrophe a fait 366
morts14
, ce qui en fait la plus grande
tragédie depuis de début du XXIème
siècle. Ce drame questionne à nouveau
l’effectivité du droit international de la
migration et de la protection des droits
de l’homme. Il soulève à nouveau la
question de la législation italienne et
européenne relative aux migrants clan-
destins qui arrivent de plus en plus
nombreux. Existe-t-il une protection
spécifique à l’endroit de naufragés mi-
grants en droit international de la migra-
tion? Quelles sont les mécanismes de
Le Centre international pour le développement des
politiques migratoires, au moins 10 000 immigrants
sont morts entre 1997 et 2007 en essayant de re-joindre les rives du sud de l'Europe. Selon l'ONG
United for intercultural action plus de 16 000
migrants sont morts entre 1988 et 2012. Les données collectées avant février 2011 ont été mises sous
forme de carte interactive par Le Mémorial des morts
aux frontières de l’Europe. Selon l’association Fortess Europe, basée en Italie, plus de 12 000
clandestins ont trouvé la mort et plus de 5 000 ont été
portés disparus entre 1988 et 2008, en tentant de traverser la Méditerranée dans la zone du Canal de
Sicile. En mer Méditerranée, ont perdu la vie 8 315
migrants. Dans le Canal de Sicile, 2 511 personnes sont mortes entre la Libye, l'Égypte, la Tunisie,
Malte et l'Italie, dont 1 549 disparus, et 70 autres ont
perdu la vie le long des nouvelles routes entre l'Algé-rie et l'île de Sardaigne; 4 091 personnes sont mortes
au large des îles Canaries et du détroit de Gibraltar,
entre le Maroc et l'Espagne, dont 1 986 disparus; 895 personnes sont mortes en mer Égée, entre la Turquie
et la Grèce, dont 461 disparus. 13 Djamchid MOMTAZ, « Les infractions liées aux activités maritimes », in Droit International Pénal,
sous la direction de Hervé ASCENSIO, Emmanuel
DECAUX et Alain PELLET, Paris, Editions Pedone, 2000, pp. 517- 518. 14 FIDH, op. cit.
renforcement des politiques migra-
toires ?
I. La protection spécifique des mi-
grants La Convention des Nations Unies de
1990 sur la protection des droits de tous
les travailleurs migrants et des membres
de leurs familles est un subtil amalgame
de codification et de développement
progressif15
. C’est ainsi que des bar-
rières sont mises en place autour de
l'Union européenne pour freiner la mi-
gration en vue de limiter les naufrages.
Mais il s’agit d’une protection limitée.
A. Les mécanismes de gestion com-
mune des frontières Face à la récurrence des naufrages des
migrants, l’UE a crée des agences spé-
cialisées de la gestion de ses frontières.
FRONTEX est l'Agence européenne
pour la sécurité et les frontières exté-
rieures de l’UE. Elle est responsable de
la coordination des activités des garde-
frontières dans le maintien de la sécurité
des frontières de l'UE avec les États non
membres. Frontex a été créée par le
règlement (CE) no 2007/2004 du Con-
seil de l’Europe du 26 octobre 2004,
modifié par le règlement (CE)
n°1168/2011 du 25 octobre 2011. Fron-
tex peut notamment signer des accords
avec des pays tiers, organiser des vols
de retour conjoints, échanger des don-
nées personnelles avec l’agence euro-
péenne de coopération policière Europol
et initier des opérations terrestres et
maritimes de contrôle des frontières.
Selon l’article 1 du Règlement (CE)
n°1168/2011 du 25 octobre 2011, Fron-
tex accomplit ses tâches dans le plein
respect des dispositions pertinentes du
droit de l'Union, y compris de la Charte
des droits fondamentaux de l'UE, du
droit international applicable, dont la
Convention de Genève relative au statut
des réfugiés, de ses obligations relatives
à l'accès à la protection internationale,
en particulier le principe de non-
refoulement, et des droits fondamen-
taux. En février 2008, la Commission
européenne examiné la possibilité de
créer un Système européen de surveil-
lance des frontières extérieurs (EURO-
SUR). Il s’agit d’un système destiné à
prévenir les mouvements de migrants et
à éviter des tragédies.
15 « Les droits de l’homme de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille : la conven-
tion des nations unies du 18 décembre 1990 », in Migration et protection des droits de l’homme,
Cahier du CREDHO, n° 3, OIM, 2005, p. 81.
L’UE prévoit dans l’exercice du mandat
de ces deux mécanismes le lancement
des opérations de recherche et sauve-
tage. Mais il se pose le problème de leur
effectivité et de leur efficacité.
B. Les limites des mécanismes de ges-
tion des frontières Depuis la création des agences spéciali-
sées de la gestion des frontières de l’UE,
on peut constater que chaque année, des
centaines de migrants périssent dans des
naufrages, en tentant d’arriver en Eu-
rope pour demander une protection.
L’on peut se demander si FRONTEX
respecte véritablement les droits hu-
mains dans son fonctionnement ? Re-
foule-t-elle les migrants ou les secourt-
elle lorsqu’ils sont en danger de mort ?
En cas de violation des droits humains,
est-ce la responsabilité de l’Agence
FRONTEX qui est engagée ou celle des
États européens, ou bien, suivant les cas,
celle des États tiers ?16
1. Une politique de limitation de
l’immigration qui va à l’encontre de
la protection des droits humains
L’agence Frontex dont la fonction est de
surveiller et dissuader les mouvements
migratoires entraîne plutôt le recours à
des passeurs et trafiquants qui utilisent
des moyens et empruntent des itinéraires
toujours plus dangereux. Une approche
exclusivement sécuritaire oriente depuis
plus d’une décennie les politiques mi-
gratoires européennes, on le voit no-
tamment dans la délivrance restrictive
des visas, dans la construction de murs
et de barrières, dans le contrôle militari-
sé des frontières et le renvoi forcé dans
les pays d’origine, dans la sous-traitance
du contrôle migratoire à des États peu
démocratiques. Par ailleurs, les nau-
frages au large des frontières de FRON-
TEX, notamment à Lampedusa, à Malte,
en Sicile et au large des îles de la Grèce
continuent sans cesse de provoquer la
mort de migrants. Ces nouveaux dispo-
sitifs comme EUROSUR forcent plutôt
des personnes migrantes à emprunter
des chemins d'exil de plus en plus ris-
qués qui mettent leur vie en péril. Asso-
ciées aux possibilités limitées offertes
en matière de migration régulière et aux
embûches semant la route des procé-
dures de demande et d'octroi d'asile, ces
mesures font partie des causes qui pré-
cipitent encore le nombre des victimes
16 Rêzan ZEHRÊ, « Un jour pour les migrants et 365
jours pour les expulser », Journée internationale des migrants, Caritas Suisse, service de presse 17, 12
décembre 2013.
Bulletin de l’APDHAC --- N°40 Janvier 2014 --- Diffusion gratuite --- [email protected] 5
qui meurent aux frontières de l'Europe
en cherchant à en atteindre le rivage17
.
2. L’absence de coercition comme
corollaire à l’ineffectivité des opéra-
tions de recherche et de sauvetage
L’UE et ses États membres n'ont pas
d'approche efficace et coordonnée pour
lancer des opérations de recherche et
sauvetage. Les récents naufrages meur-
triers montrent les limites des procé-
dures de sauvetage des bateaux de mi-
grants. En l'absence de règles précises et
harmonisées concernant ces opérations
et les procédures de débarquement, les
migrants continuent à être les victimes
d'un ensemble de politiques complexes
qui permettent aux États de fuir leurs
responsabilités et qui sont un facteur de
risques supplémentaires. Si les mandats
de Frontex et EUROSUR font certes
référence à des opérations de recherche
et sauvetage, il n'en reste pas moins que
la « lutte contre l'immigration illégale »
continue à primer sur de telles obliga-
tions. En outre, les lois nationales qui
rendent les opérations de sauvetage
passibles de poursuites judiciaires, en
les qualifiant d'activités visant à aider et
soutenir l'immigration clandestine, con-
tribuent à ce que des transporteurs pri-
vés manquent aux obligations qui leur
incombent au titre du droit maritime
international et ne portent donc pas
secours aux bateaux en détresse.
Au regard de ces limites, il faut dire que
la migration est un fait. On ne peut pas
lutter contre la migration en installant
des clôtures qui pourraient causer en-
core plus de naufrages au large des fron-
tières de l'Europe18
.
II. Le renforcement des politiques
migratoires La tragédie du Lampedusa est un sym-
bole de l’échec de la politique
d’immigration européenne. D’où la
recherche des solutions plus efficaces
qui peuvent être incitatives ou judi-
ciaires.
A. Les mesures incitatives Au niveau européen, la question migra-
toire est devenue omniprésente dans
l'actualité européenne. En effet, Giusi
Nicolini, maire de Lampedusa et Luigi
Manconi, président de la commission du
Sénat pour les droits de l’homme, ont
présenté au gouvernement une proposi-
tion de loi visant à convaincre les parte-
17 FIDH, op. cit. 18 Rêzan ZEHRÊ, op. cit.
naires de l’Italie de la nécessité
d’affronter, la question des migrants qui
fuient des situations de guerre, de fa-
mine, de persécution religieuse ou eth-
nique en étudiant avant tout tous les
moyens possibles pour permettre aux
réfugiés demandeurs d’asile d’exercer
leurs droits, avant de monter sur les
« bateaux de la mort »19
. Le Président
du Parlement européen a souligné qu’il
s’agit d’ « une tragédie qui doit marquer
un tournant dans la politique euro-
péenne »20
et promeut la création d’un
système d’immigration légale21
. A l'ini-
tiative de l’Union Africaine, plusieurs
pays africains comme la Tunisie, le
Tchad, l’Éthiopie ou la Mauritanie ont
fait du 3 novembre un jour de deuil
national pour rendre hommage aux vic-
times de ce naufrage et à toutes les
autres. Selon les Nation Unies, en l'ab-
sence de migrations, dans les cinquante
ans à venir, l'Union européenne verrait
sa population diminuer de 43 millions,
soit 11 %. Pour éviter cela elle aurait
donc besoin de 47 millions d'immi-
grants, soit presque un million par an, ce
qui correspond pratiquement à la situa-
tion actuelle22
. Elle est donc revoir in-
terpellée pour la révision de ses poli-
tiques d’immigrations.
B. Les mesures contraignantes
La garantie des droits aux migrants
irréguliers sonne comme une révolution
en droit international23
. Des solutions
judiciaires sont entrain d’être adoptées.
Dans cette perspective, il faut relever
qu’au regard du droit international du
respect de la dignité humaine, les États
sont liés par le droit coutumier qui les
oblige à porter secours aux immigrés
clandestins en détresse. Ils sont égale-
ment tenus de respecter le principe de
non-refoulement, et aussi, chaque mi-
grant intercepté a le droit de demander
l’asile. Il s’agit des principes qui
s’appliquent même en haute mer,
comme l’a confirmé l’arrêt de la Cour
européenne des droits de l’Homme de
février 2012 dans l’affaire Hirsi, Jamaa
et autres c/ l’Italie. Cette dernière avait
19 RFI, octobre 2013. 20 Martin SCHULZ, Conseil européen, 24 octobre 2013. 21 Martin SCHULZ, Allocution prononcée à
l’occasion du Conseil européen du 24 octobre 2013. « Migrations : l’UE veut renforcer ses frontières avec
Eurosur », in Le Monde, octobre 2013. 22 Joseph GRINBLAT, L'Atlas des migrations, Le Monde, Hors-série, 2008-2009, p. 8-9 23Yao AGBETSE, « La Convention sur les droits des
travailleurs migrants : un nouvel instrument pour quelle protection ?», Droits fondamentaux, n° 4,
janvier - décembre 2004, p. 55.
été condamnée pour ses pratiques de
refoulement vers la Libye. Selon la
Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer du 10 décembre 1980 et
la Convention internationale de 1974
pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer, les États méditerranéens sont res-
ponsables de zones de «recherche et de sauvetage». Les États ont des responsa-
bilités. C’est cette évolution qui a con-
duit les survivants des 63 migrants dans
un bateau au large de la Libye en 2011,
avec le soutien d’une coalition d’ONG,
à déposer en France une plainte mettant
en cause l’armée française pour non
assistance à personne en danger24
.
Même comme la décision des juges du
Tribunal de Paris reste attendue, cette
action est salutaire.
NOUAZI KEMKENG Carole Valérie
Attachée de Recherche au CNE / MINRESI,
Doctorante en Droit public,
Université de Yaoundé II – Cameroun
Phénomènes migratoires et Conflits
armés en Afrique centrale : Le cas
Centrafricain
La République centrafricaine (RCA)
subit encore les effets des crises poli-
tiques et militaires qui se sont succédé
pendant de longues années. Les viola-
tions des droits de l'homme continuent
de susciter l'inquiétude et le pays souffre
d'une pauvreté endémique, plus grave
encore dans les régions touchées par des
conflits. Le haut niveau de chômage
persiste25
. Et les départs massifs du pays
et des endroits jugés les plus dangereux
prennent de plus en plus des ampleurs.
D’ailleurs, à en croire Monsieur Fran-
çois Goemans26
, la montée récente de la
violence impliquant les milices d’auto-
défense et les combattants des forces
rebelles dissoutes dans le pays ont pro-
voqué la fuite d’environ 10% des 4,6
millions d’habitants de RCA. L’on peut
donc comprendre que le lien entre phé-
nomènes migratoires et conflits armés
en République Centrafricaine est inex-
tricable. Mais il est important de clari-
fier les termes de ce sujet pour mieux
l’aborder. La migration est un fait pour
une personne de se déplacer d’un pays
24 FIDH, 63 migrants morts en Méditerranée : l’armée française mise en cause pour non-assistance
à personne en danger, Rapport des migrants, 7 oc-
tobre 2013. 25 Confère rapport sur le profil d’opération 2013 du
UNHCR disponible sur le site : www.unhcr.fr,
(consulté le 27 Décembre 2013). 26 Directeur de l’opération de l’Organisation
Internationale des Migrations en RCA.
Bulletin de l’APDHAC --- N°40 Janvier 2014 --- Diffusion gratuite --- [email protected] 6
dans un autre et d’y séjourner27
.Aussi,
c’est le déplacement d'une personne ou
d'un groupe de personnes, soit entre
pays, soit dans un pays entre deux lieux
situés sur son territoire. Le conflit armé
est une situation dans laquelle des Etats
emploient la force pour la solution d’un
litige les opposant28
. Dans d’autres sens,
le concept « conflit armé » est une ex-
pression générale qui s'applique à diffé-
rents types d'affrontements qui peuvent
se produire entre deux ou plusieurs enti-
tés étatiques, entre une entité étatique et
une entité non étatique, entre une entité
étatique et une faction dissidente et / ou
entre deux ethnies à l'intérieur d'une
entité étatique29
. Après ces clarifica-
tions, il convient de se poser la question
suivante : existe –t-il un rapport entre
les phénomènes migratoires et les con-
flits armés dans le cadre centrafricain ?
Les phénomènes migratoires sont dans
certains cas la résultante des conflits
armés et de ce fait font naître des diffi-
cultés quant à la gestion du flux migra-
toires. L’intérêt de cet article provient
du fait que le sujet est actuel et non
seulement la CEMAC et la communauté
internationale se sont mobilisées pour la
recherche des solutions de sorties de
crise afin d’éviter que l’Afrique Cen-
trale déjà berceau de l’immigration du
fait des conflits ne batte le record.
L’objectif est de montrer les effets du
conflit armé en lien avec les migrations
mais surtout de proposer des pistes pou-
vant aider à gérer les situations pré-
sentes. Avant de poursuivre l’analyse, il
convient de dire que le conflit en RCA
est un conflit armé interne. Pour la
commodité de cette réflexion, il con-
vient de dire que les phénomènes migra-
toires sont engendrés par les conflits
armés (I). Toutefois il faut pour y faire
face des stratégies de réponse aux im-
pacts de la migration en rapport avec la
recrudescence des conflits armés en
République Centrafricaine (II).
I- I. Les phénomènes migratoires en
RCA, résultante des conflits armés
D’après le Professeur MULAMBA
MBUYI Benjamin, « depuis que les
hommes habitent la planète terre, il y a
toujours eu des guerres, il y aura tou-
27 CORNU(G), Vocabulaire Juridique, 9e éd, mise à
jour, Août 2011, p. 653. 28 Ibid., p. 229. 29 VERRI (P), Dictionnaire du droit international des
conflits armés, CICR, Genève, 1988, p.36. Cette
définition permet de relever qu’il existe trois types de conflits armés : international, interne et
internationalisé.
jours des guerres, guerre entre les
peuples, guerre entre les Etats30
». Ces
guerres ont pour conséquence des dé-
parts tantôt volontaires pour raison de
protection de son droit à la vie (A) mais
aussi involontaire du fait des inconvé-
nients anormaux subis par
l’environnement (B).
A. Le départ volontaire au nom de la
protection du droit à la vie.
L’insécurité en République Centrafri-
caine favorise un déplacement continu
de la population. Le coup d'Etat des
troupes de la SELEKA et les affronte-
ments actuels ont provoqués des dépla-
cements de population. Des habitants
de Bangui ont fui vers les campagnes du
nord. Ils sont estimés à environ 20 000
par le Haut Commissariat aux Réfugiés
des Nations unies (HCR). Au 26 no-
vembre, des familles entières, à l'excep-
tion de leurs chefs, préféraient rester en
brousse considérant toujours Bangui peu
sûr31
. Au sens strict, le droit à la vie
protège l'être humain contre les atteintes
à l'intégrité corporelle de la part d'une
autre personne. Il s'agit donc principa-
lement de l'interdiction du meurtre,
condition indispensable à la vie en so-
ciété, sur laquelle tous les libéraux s'ac-
cordent. Le droit à la vie doit être com-
pris comme le droit de ne pas être tué.
Suite à des affrontements, entre des
éléments anti-Balaka32
et des forces de
l'ex-Séléka, une vague de déplacements
de populations33
a eu lieu à Bouca, dans
le nord de la République centrafricaine
(RCA). Des déplacements allant même
au-délà de la frontière centrafricaine ont
été constatés ; notamment pour la plu-
part des cas vers le Cameroun. Ce fut
pour sauvegarder son droit à la vie, droit
fondamental de l’homme. Toutefois,
l’on assiste aussi aux départs involon-
taires du fait de nombreuses atteintes à
l’environnement.
B. Le départ involontaire du fait des
atteintes à l’environnement ou de son
instrumentalisation à des fins mili-
taires. D’emblée, il faut définir
l’environnement. La définition la plus
élaborée est donnée par la CIJ dans un
avis du 08 Juillet 1996. Elle affirme en
effet que « l’environnement n’est pas
30 MULAMBA MBUYI( B), Cours de droit
international humanitaire dispensé en première année de licence, syllabus, inédit, ulpgl-goma, faculté de
droit, 2001-2002, p. 2. 31 Ibid. 32 Groupes d’auto-défense armés. 33 La deuxième en moins de deux mois.
une abstraction, mais bien l’espace ou
vivent les êtres humains et dont dépen-
dent la qualité de leur vie et leur santé, y
compris pour des générations futures34
.
Les conflits armés sont source de catas-
trophes majeures pour l’environnement.
Les luttes répétées pour affirmer qui
contrôle quoi, et les changements de
pouvoirs, ont des impacts dévastateurs
sur les vies humaines et sont « la cause
d’un effondrement de la loi » et des
autres modes de contrôle pendant et tout
de suite du déclin de la production agri-
cole et du commerce. Aussi, convient-il
de noter que l’impact négatif des con-
flits armés sur l’environnement est le
résultat de plusieurs facteurs tels que le
déplacement de populations humaines,
le manque d’application de la loi le
déclin de la sécurité de la propriété pri-
vée qui incite encore plus les popula-
tions à exploiter les ressources natu-
relles. Mais les parcs et les réserves
peuvent aussi souffrir d’un impact envi-
ronnemental encore plus important que
les zones non protégées car ils sont si-
tués dans les zones frontières éloignées
et peuvent « offrir » aux rebelles un
refuge où un point d’appui commode, en
violation de la convention sur
l’utilisation des techniques de modifica-
tion de l’environnement à des fins mili-
taires ou toutes autres fins hostiles35
.
C’est la raison pour laquelle des straté-
gies de réponse aux impacts de la migra-
tion en rapport avec la recrudescence
des conflits armés en République Cen-
trafricaine s’imposent.
II. Des stratégies de réponse aux im-
pacts des phénomènes migratoires en
rapport avec la recrudescence des
conflits armés en République Centra-
fricaine De nombreuses solutions peuvent être
proposées, à l’instar des forces
d’interposition comme ce fut le cas au
Mali et aujourd’hui en RCA avec la
participation de l’armée Française, de la
MISCA. Loin de cela, dans le cas
d’espèce, les stratégies appropriées sont
le dialogue, la réconciliation nationale
34 Voir CIJ, Avis du 08 Juillet 1996, Licéité de la
menace ou de l’emploi d’armes nucléaires,
Rec.1996, s .29. 35 Convention ENMOD qui stipule en son article 1er
que : « Chaque Etat partie à la présente Convention
s'engage à ne pas utiliser à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles des techniques de
modification de l'environnement ayant des effets
étendus, durables ou graves, en tant que moyens de causer des destructions, des dommages ou des
préjudices à tout autre Etat partie ».
Bulletin de l’APDHAC --- N°40 Janvier 2014 --- Diffusion gratuite --- [email protected] 7
(A) et le jugement des auteurs des exac-
tions causent des départs (B).
A. Le dialogue et la réconciliation
nationale Face aux difficultés que connaissent non
seulement les convois humanitaires pour
venir en aide aux déplacées centrafricain
mais aussi des rivalités sans cesse crois-
sante entre les ethnies et groupes reli-
gieux, il est plus que jamais souhaitable
d’entrer dans un processus de dialogue
et réconciliation nationale afin les cen-
trafricains se parlent en se regardant
entre eux. Aussi, Il faut une reforme du
secteur de la sécurité. La protection et la
réintégration des personnes et des com-
munautés déplacées et affectées par les
conflits
B. L’action de la justice La RCA est en outre tenue de respecter
le droit international relatif aux droits
humains, qui comprend des normes
issues du droit international coutumier
et des normes inscrites dans les traités
internationaux et régionaux auxquels le
pays est partie. Elle est également liée
par le droit international humanitaire qui
s’applique aux conflits armés ne présen-
tant pas un caractère international. Par
ailleurs, certains des actes dénoncés par
la communauté internationale peuvent
constituer des crimes de guerre ou des
crimes contre l’humanité, pour lesquels
il existe une responsabilité individuelle,
y compris une responsabilité hiérar-
chique36
. De ce fait, la justice centrafri-
caine, de façon indépendante et impar-
tiale devrait s’y pencher ; de même que
les juridictions internationales.
Eu égard à tout ce qui précède, il con-
vient de relever que les conflits armés
sont à l’origine des phénomènes migra-
toires. Le cas centrafricain est le plus
patent en zone CEMAC. Ils obligent les
populations à fuir pour sauver leur vie
mais aussi aboutissent à l’usage de
l’environnement comme moyen de
guerre rendant ainsi périlleux le flux
migratoires. Pour y remédier à long
terme, il faut un dialogue politique, le
pardon et la réconciliation nationale
débouchant sur des élections justes,
libres et régulière ; afin que les centra-
fricains reconstruisent leur pays et évi-
tent la répercussion de ce conflit armé
interne sur le développement de la CE-
MAC.
36 Amnesty international République centrafricaine
après des décennies de violence il est temps d’agir.
MBOUMEGNE DZESSEU Serges
Frédéric
Attaché de recherche au Centre Na-
tional d’éducation/MINRESI,
TCHINDA Giscard
Attaché de recherche au Centre Na-
tional d’éducation/MINRESI
L'émigration internationale des ca-
merounais : Essai d'analyse histo-
rique
Une relecture attentive de
l’historiographie africaine fait état de ce
que cette Afrique a connu une pluralité
de crises notamment socio-politiques
qui seraient à l’origine de son retard à
l’échelle internationale rendant ainsi
l’environnement délétère pour un
épanouissement personnel. Cet
environnement malsain serait à l’origine
du départ massif de ses populations à la
recherche d’un mieux-être à l’Étranger
notamment dans les pays du Nord
considérés comme riches. Comment en
est-on arrivé à cette situation ? Il va
s’agir ici d’analyser les différents
facteurs historique qui auraient
contribué à l’émigration internationale
des camerounais.
En s’appuyant sur l’idée selon laquelle
la migration fait partie de la nature
humaine, elle est devenue un phénomène
universel. Toutes les nations du monde
l'ont connue et continuent à la connaître
à des degrés divers, selon les époques et les circonstances, l’on peut se rendre
compte que l’histoire de l’humanité a
toujours été jalonnée de mouvements
des populations de part et d’autres des
frontières aussi bien nationales
qu’internationales. Il est alors possible
de présenter quelles que soient les forces
qui déterminent certains exodes
particuliers, ce phénomène qui a des
conséquences spécifiques non sans
complexité.
I. De la traite négrière à la
colonisation
L’historiographie retient le quinzième
siècle comme le début de la Traite
négrière par les Européens. Ce
commerce honteux des Noirs a
contribué à une émigration massive du
peuple africain en général et des
Camerounais en particulier pour les
plantations d’Amérique, paralysant ainsi
le développement des forces
productrices en Afrique Noire. (Canal,
1980 :52). D’après Elikia M’bokolo
(1995 :205), ‘‘la traite négrière prit effet suite à l’ouverture de l’Océan
Atlantique’’, d’abord dans le but de faire
du commerce international et ensuite
pour favoriser la vente des esclaves. Ce
transport maritime fut le canal emprunté
par les Européens pour exporter les
richesses de l’Afrique Noire et plus
spécialement les hommes valides et
intrépides dont regorgeaient les
différents pays de ce continent. C’est à
Bimbia, village camerounais situé au
bord de l’Océan Atlantique dans la
région du Sud-Ouest, à Douala, à
Bonabérie et surtout autour de l’estuaire
du Wouri que les esclaves étaient
embarqués pour l’Amérique. Il est
difficile de se faire une idée précise du
nombre d’esclaves vendus sur les côtes
camerounaises. Néanmoins, au XVIe
siècle, on pense que les Portugais
prenaient environ 500 esclaves par ans
(Mveng, 1979). Cette impitoyable
chasse à l’homme noir a contribué à la
déportation de près de 14 millions
d’individus (Nbgwa, 2008), considérés
comme un produit d’échange privilégié.
C’est ce qu’affirme E. M’bokolo
(1995 :206) en ces termes : ‘‘les
esclaves (…) représentent le seul bien,
voire le principal bien d’échange’’. Ce
qui précède montre que le Cameroun a
souffert terriblement de ce trafic
honteux qui a ravagé toute l’Afrique. Et
ce pendant près de 400 ans.
D’autres spécialistes de l’étude de la
traite négrière estiment à plus de 30000
le nombre d’expéditions négrières trans-
atlantiques effectuées dans des bateaux
contenant quatre cents cinquante à cinq
cents esclaves pour une quarantaine
d’hommes d’équipages (Pondi,
2007 :78). En outre, ils établissent avec
certitude que le taux de mortalité lors
des expéditions était compris entre 0 et
20%. Les esclaves gravement malades
ou décédés étaient jetés à la mer pour
servir de repas aux requins.
Toutes ces statistiques mettent en relief
la force productrice des pays africains,
et surtout camerounaise arrachée à leur
terre pour développer d’autres pays et
continents. La main d’œuvre des
travailleurs européens dont le statut
juridique était bien meilleur que celui
des Africains, mais qui ‘‘ployaient sous
les mêmes contraintes et conditions de travail et de vie’’ (M’bokolo, 1995 :215)
commença à être concurrencé avec
l’arrivée des Africains. Ces derniers très
habiles au travail, deviennent la main
d’œuvre quasi exclusive aussi bien dans
les plantations que dans les travaux
ménagers. Le commerce des Noirs
s’organisa alors en véritable système
Bulletin de l’APDHAC --- N°40 Janvier 2014 --- Diffusion gratuite --- [email protected] 8
coordonné par les Européens et donna
naissance à ce qu’on appela ‘‘le
commerce triangulaire’’. Las Casas étant
selon Daniel Abwa (2007 :20) ‘‘le
dernier coup d’accélérateur à l’histoire
de l’émigration forcée des Africains’’.
Cette prise de position de Daniel Abwa
permet de comprendre qu’on est là
devant le premier type d’émigration des
Camerounais et des Africains qui est
involontaire. Ce type d’émigration est
un facteur inhibiteur au développement
et est même l’une des causes du retard
du Cameroun et de l’Afrique.
Pour des raisons purement
économiques, les pays africains, après
avoir connu l’ignominieuse traite
négrière allaient à nouveau subir
l’impérialisme occidental. Cette
nouvelle forme de domination vidait
non seulement le continent de ses
ressources, mais utilisait son potentiel
humain, d’où l’émigration de certains
Camerounais comme Douala Manga
Bell pour des besoins de
communication. Même cette autre forme
apparemment volontaire ne sert que les
besoins de la métropole. Toujours pour
l’intérêt de l’occident, on a vu les
mouvements des Camerounais lors des
deux grandes guerres mondiales.
La première guerre mondiale a fait près
d’un million et demi de victimes
françaises. Dès 1915, la France mit sur
pied une politique destinée à attirer la
main d’œuvre, à la fois pour répondre
aux besoins de l’effort de guerre et puis
dès 1918 pour la reconstruction de la
France dévastée. (Naïr, 1999 :16).
Le bilan des deux guerres est lourd de
conséquences pour le Cameroun et
l’Afrique en général. Pour cette cause,
on a noté un exode massif des
populations camerounaises. En effet, ces
guerres européennes dans lesquelles les
Territoires d’Outre-Mer où les Colonies
furent contraintes de participer, aussi
bien en ressources économiques qu’en
ressources humaines, ont forcé les
Africains à l’émigration. Ce qui ‘‘permit
à la vieille Europe de triompher de
l’ennemi et de se libérer de la tutelle allemande’’ (Abwa, 2007 :22). Une fois
de plus, les troupes africaines et
singulièrement camerounaises venaient
de prouver leur bravoure au combat
pour l’intérêt de l’Europe. Au regard de
ce qui précède, il apparait que la
sélectivité des ressources africaines par
les Occidentaux n’est pas récente.
II. De l’indépendance à nos jours
Du fait de sa trajectoire historique
complexe, le Cameroun a connu dans
les années 1960 d’importantes vagues
migratoires. Cette migration vers les
pays du Nord a été déclenchée par
l’existence des relations politiques et
économiques entre ‘‘l’ancienne colonie’’
et sa métropole. À ce niveau, on a noté
deux types de mouvement des
Camerounais.
Le premier type était encouragé par
l’État nouvellement indépendant qui
avait besoin de cadres pour lancer son
évolution. En effet, plusieurs
Camerounais purent obtenir des bourses
pour aller poursuivre leurs études dans
les Universités du Nord. Même si cette
autre forme de migration prenait en
compte la volonté du migrant, elle
n’était véritablement pas favorable à
l’émergence d’un pays économiquement
puissant car les cadres formés l’étaient
beaucoup plus en théorie. En dehors des
disciplines à nécessité technique
marquée, les moules occidentaux
forgeaient des cadres quelque peu
déconnectés des préoccupations et des
aspirations africaines. Ils leur
inculquaient un savoir et un savoir-faire
ayant vocation à solutionner les
difficultés du lieu d’accueil, et qui
accouchait fatalement de produits
désarçonnés et stériles une fois mis en
situation hors du site de formation.
Le second type de mouvement des
populations des camerounais vers
l’Occident est plutôt involontaire. Il
s’agit là des personnes en désaccord
avec le système hérité de la colonisation
et surtout partisantes du principal
mouvement nationaliste camerounais :
l’UPC.37
Dans un cas comme dans l’autre, le
décalage entre les programmes de
formation, les compétences et les
besoins réels restent croissant. De nos
jours encore, les secteurs nationaux
prioritaires et même le marché de
l’emploi sous régionaux continuent de
poser un problème dans la mesure où il
y a dichotomie entre la formation et
l’emploi. Cet état de chose ne favorise
pas l’émergence économique du pays.
Les secteurs de l’enseignement
classique de formations universitaires
restent encore des voies d’excellence
alors même qu’ils sont pourvoyeurs de
chômeurs. Au Cameroun, dans 80% des
cas, ces formations sont destinées à la
37 À titre d’exemple, nous pouvons citer : Abel
Eyinga et Achille Mbembe entre autre.
fonction publique qui déjà peine à
recruter. Les formations techniques
comme le secteur de la mécanique de
pointe, de l’agriculture, de
l’électronique, de l’électrotechnique
sont encore marginalisées alors même
qu’elles répondent directement aux
besoins locaux. Ceci rend
permanemment dépendant du Nord.
La théorie de la dépendance illustre
mieux cette assertion en recherchant la
dépendance des pays du Sud ou encore
de la périphérie dans l’histoire de la
colonisation et par les échanges
commerciaux inégaux. S’opposant à la
théorie classique du commerce
international calqué sur le modèle
théorique de la modernisation pour
qui ‘‘tout pays peut augmenter son
revenu grâce au commerce, chaque pays
a avantage à se spécialiser dans l’exportation des marchandises qu’il
produit au meilleur coût relatif, le libre-échange produit une division
internationale du travail favorable à
tous puisqu’elle permet de produire plus de biens en utilisant au maximum les
facteurs de production et a accès à un
marché plus vaste. Le développement technique fera baisser le prix des
produits industriels, au profit des producteurs de matières première’’
(Smith, 2000), les théoriciens de la
dépendance pensent que les pays sous-
développés ne sont pas une image des
pays développés à un stade antérieur,
mais qu’ils font partie d’un système
mondial ayant forgé leur structure. De
même, les facteurs culturels ou religieux
ne peuvent pas expliquer le sous-
développement, car aucun pays n’est
foncièrement « traditionnel » et les
explications en termes de « cercles
vicieux de la pauvreté » sont erronées.
En effet, pour Samir Amin (1976), ‘‘le
sous-développement des pays de la
périphérie est le produit du développement du Centre, la division
internationale du travail maintient les
pays sous-développés dans un échange
inégal, les efforts d’industrialisation du
Tiers-Monde augmentent sa dépendance car son économie est extravertie.’’ En
menant une analyse profonde, l’on
pourrait mieux comprendre la
conjoncture des années 80-90 au
Cameroun où, les pays en
développement qui ont amorcé leur
transition politique et démographique
voient l’effectif de la proportion de leur
population en âge d’activité s’accroître
fortement sans qu’il y ait un
accroissement équivalent de l’emploi.
Bulletin de l’APDHAC --- N°40 Janvier 2014 --- Diffusion gratuite --- [email protected] 9
Ceci est sans compter les versatilités qui
ont caractérisé l’économie du
Cameroun, à l’instar des villes mortes,
de la crise économique, de la baisse des
salaires, de la dévaluation du Franc
CFA.
Dans un environnement fortement
marqué par l’érosion des référents
éthiques et de plus en plus hanté par des
idéologies de domination et
d’affirmation de pouvoir, sévissait donc
une grave précarité économique qui
achevait de ruiner chez les intellectuels
tout espoir de réussite sociale dans leur
propre pays, ce qui conséquemment les
incita ainsi à l’émigration. Paul Biya
(2006 :2), Président de la République du
Cameroun l’avait sincèrement reconnu
et s’était alors interrogé en ces termes :
‘‘Comment faire lorsque la dureté de la
vie amène à donner la priorité à la satisfaction des besoins quotidiens,
lorsque la réussite sociale n’est pas toujours en rapport avec le mérite,
lorsqu’au terme du parcours scolaire ou
universitaire l’emploi n’est pas au rendez-vous ?’’
Un tel aveu présidentiel raisonne
comme le constat d’une crise sociale
profonde dont les jeunes diplômés sont
la principale victime. Et Françoise
Bahoken (2005 :11) faisait déjà
remarquer que : ‘‘La situation de
défaillance économique et sociale du
Cameroun dite de conjoncture, les
dévaluations du franc CFA et l’absence de perspectives de développement
conduisent depuis 1995 à une
accélération des flux de migrants Camerounais vers l’Europe de l’Ouest,
et de plus en plus vers l’Amérique du
Nord et le Canada en raison du durcissement des procédures d’entrées
légales en France’’. En s’insurgeant contre l’environnement
délétère du paysage socioéconomique
du Cameroun, Bahoken estime que le
flux des émigrants camerounais en
direction des pays riches du Nord est
motivé par le désir de mettre en valeur
son savoir et savoir-faire. Ceci afin de
générer des revenus devant permettre de
mener une vie de bien-être. Toutefois, il
faut signaler que l’émigration des
Camerounais vers le Nord pendant cette
période de crise ne concerne pas
exclusivement l’intelligentsia. Les
années 90 marquent le début d’une
véritable hémorragie humaine des
Camerounais dans toutes les directions
du monde. Ce type est volontaire bien
que provoqué par des conditions de vie
extrêmement difficile. D’ailleurs de nos
jours encore, cette ruée des
Camerounais vers le Nord continue.
Cependant, cette fois les capitaux
empruntent le sens inverse des
mouvements migratoires.
Conclusion
En bref, on se rend compte que
l’émigration camerounaise à travers la
traite négrière et les deux guerres
mondiales d’une part, l’avènement de
l’indépendance et la conjoncture des
années 90 d’autre part est un phénomène
qui s’enracine dans l’histoire. Cette
émigration, nous pouvons l’affirmer
sans risque de nous tromper, a drainé
avec elle une bonne partie des
compétences camerounaises vers les
pays du Nord.
KAMDAM Ronsard Stéphane
PLEG/Doctorant en Histoire des
Relations Internationales, Université
de Yaoundé I
Les migrations et la mondialisation :
quelles dispositions pour une facilita-
tion de mouvements temporaires des
personnes physiques conformément
aux dispositions du Mode 4 dans
l’Accord AGCS et des lois du travail
La mobilité des personnes, des biens et
des services est l’une des caractéris-
tiques de la mondialisation. On compte
aujourd’hui environ 190 millions de
migrants dans le monde, soit quelque
2.9 % de la population mondiale, contre
environ 2.2 % dans les années 70. L'Ac-
cord Général sur le Commerce des Ser-
vices (AGCS) définit le mode 4 comme
"la fourniture d'un service par un four-
nisseur de services d'un Membre, grâce à la présence de personnes physiques
d'un Membre sur le territoire de tout
autre Membre"(OMC, 2012 p317). Ain-
si, le mode 4 concerne les personnes
physiques étrangères qui entrent dans le
pays d'accueil pour: exécuter directe-
ment des contrats de services en tant que
travailleurs indépendants ou en qualité
d'employés d'un fournisseur de services
étranger; ou encore pour travailler dans
une filiale étrangère qui fournit des
services (personnes transférées à l'inté-
rieur d'une société ou recrutées directe-
ment par la filiale), négocier la constitu-
tion / l'acquisition d'un établissement
fournissant des services, commercialiser
un service, etc. Si leur nombre a globa-
lement augmenté en termes absolus, il a
évolué en dents de scie (Brian Keeley,
2009)38
. Cette situation a conduit plu-
sieurs chercheurs à considérer la relation
entre la migration et
l’internationalisation du commerce
comme un fait de la mondialisation. Car,
le mode 4 défini dans l'AGCS va au-
delà de la fourniture directe de services
par des personnes physiques étrangères.
La relation « migration-commerce »
dans le cadre de la mondialisation est
complexe et multidimensionnelle. En
effet, elle comporte des dimensions
politiques, économiques, sociales et
juridiques et fait intervenir plusieurs
acteurs dont les organismes
internationaux, les migrants, les pays
d’origine et d’accueil. Cette relation a
été abordée par de nombreux chercheurs
sur la base des modèles classiques de
Mundell (1957)39
et en utilisant le cadre
de Markusen40
et al (1997). Les deux
domaines se croisent de plus en plus, et
la nature de la relation est fonction du
cadre réglementaire de chaque pays
(Fatma et al, 2010). L’objectif de ce
papier est d’apporter quelques éléments
de réponse aux différentes questions
suivantes : Existe-il une relation entre la
migration et la mondialisation ? Le
commerce mondial peut-il être un
déterminant de la migration
internationale ? Quelles sont les
conditions nécessaires pour la
facilitation des mouvements des
personnes en rapport avec les
dispositions du commerce mondiale des
services en rapport avec les lois du
travail ?
Pour mener à bien notre analyse, nous
examinerons dans un premier temps, la
contribution théorique de l’évaluation de
la relation entre migration et de
l’internationalisation du commerce. Le
second point sera consacré à la mise en
évidence des barrières et des mesures à
mettre en œuvre pour la facilitation des
mouvements des personnes physiques.
I. Le lien entre la mondialisation du
commerce et migration
internationale : une contribution
théorique
Dans le cadre de l’évaluation de la
relation entre l’internalisation du
38 Brian Keeley, 2009) « Les migrations internatio-nales : Le visage humain de la mondialisation ». 39 Mundel, R.A, (1975): « International trade and
factor mobility », American Economic Review, 47, June, p.321-335. 40 Markusen James and Steven Zahniser (1998),
Liberalisation and incentives for labour migration: theory with applications to NAFTA, in R. Faini, J.
De Melo, K. Zimmermann (eds.), op. cit.
Bulletin de l’APDHAC --- N°40 Janvier 2014 --- Diffusion gratuite --- [email protected] 10
commerce et la migration internationale,
plusieurs modèles théoriques ont été
développés. Il s’agissait pour chacun de
ces modèles d’examiner la nature de la
relation existante entre la migration et la
mondialisation du commerce et les
raisons susceptibles d’alimenter le
mouvement des personnes et des biens.
De ce point de vue, Fatma Mabrouk
(2010), sur la base du modèle « Hump »
Migration, distingue les effets de court
et de long terme de la libéralisation des
échanges mondiaux sur les migrations
entre les pays présentant des conditions
économiques différentes (pays
développés et pays en développement).
Il parvient à la conclusion que le libre-
échange entre nation est susceptible
d'augmenter les pressions migratoires en
provenance des pays moins développés
à court et moyen terme car la
libéralisation des échanges et la mobilité
des facteurs de productions sont
complémentaires. S’inscrivant dans la
même logique, le tableau ci-dessous
présente les résultats des différents
modèles développés et traitant de la
question du lien entre la migration et la
mondialisation des échanges
commerciaux.
Tableau : l’internationalisation du
commerce et la migration
internationale: Constatations théoriques
en rapport avec les modèles
économiques développés. Le modèle Relation entre commerce et
Migration
Heckscher-Ohlin-Samuelson Substitution
Différentes technologies Complémentarité
Rendements d'échelle
croissants
Complémentarité ou substituable
Facteurs spécifiques de
Ricardo-Viner
Complémentarité ou substituable
López et Schiff Complémentarité ou substituable
« Hump » Migration Complémentarité long terme et
Substitution à
long terme.
Feenstra-Hanson Possibilité de complémentarité/ pas
de
convergence entre les prix des
facteurs
Markusen et Venables Possibilité de complémentarité/ pas
de
convergence entre les prix des
facteurs
Sources : Fatma Mabrouk et al (2010)41
Suite à l’observation du tableau ci-
dessus présenté, nous pouvons affirmer
que la migration et l’internationalisation
du commerce sont étroitement liées.
Mais cette union est fonction de la
manière dont les instruments de l’étude
sont agencés. Ainsi, chaque modèle
parvient à un résultat spécifique tel que
présenter dans le tableau. Malgré tout, la
question de la mobilité des personnes
connait encore des restrictions. Car Il y
41Fatma MABROUK, Stéphane BECUWE (2010) : « Migration internationale et commerce extérieur:
quelles correspondances? ».
a l’écheveau de règles et de réglementa-
tions qui déterminent le statut juridique
et la possibilité d’installation des mi-
grants dans les pays d’accueils.
II. Les barrières et les mesures de
facilitation liées aux mouvements des
personnes
A. Types de barrières au mouvement
des personnes
Le mode 4, présence de personnes phy-
siques, fait référence aux personnes qui
se déplacent temporairement sur le terri-
toire où se trouve le consommateur pour
fournir le service, que ce soit comme
travailleur indépendant ou comme sala-
rié d'un fournisseur étranger. Cette re-
cherche du mieux-être par des individus
des mouvements migratoires dans le
monde42
. Considérée comme l’une des
composantes essentielles de la
mondialisation économique, les
migrations internationales constituent
une préoccupation des Etats et des
institutions internationales et non
gouvernementales au regard des
obstacles liés à la libre circulation et du
nombre de personnes candidates à la
migration chaque année. A l’heure de la
mondialisation, les migrations
internationales ne sauraient se résumer à
des mouvements de populations fuyant
une vie difficile dans des pays pauvres
pour rejoindre des contrées occidentales
riches de bienfaits économiques. Toutes
les régions du monde sont concernées
par ces flux, comme zone de départ,
d’accueil ou de transit, parfois l’une et
l’autre à la fois. En 2005, l’Europe est le
premier continent d’accueil de migrants
internationaux (34 %), suivie par l’Asie
(28 %), l’Amérique du Nord (23 %),
l’Afrique (9 %) et enfin l’Amérique
latine-Caraïbes (4 %). Cependant, les
raisons de migrer se complexifient :
elles sont économiques, politiques,
climatiques, familiales, ethniques,
religieuses, personnelles43
. A cet égard,
plusieurs facteurs militent en faveur de
la restriction à la migration. Il s’agit :
des barrières physiques (les mers et des
océans), les barrières financières (besoin
d’argent croissant pour tout
déplacement), les barrières légales (la
réglementation interne des pays en
matière migration), les barrières
42 OMC (2012) : « commerce des services, E-
learning » 365 p. 43Lydie Fournier Les migrations internationales Mis
à jour le 15/06/2011
http://www.scienceshumaines.com/les-migrations-internationales_fr_24921.html, consulté le 2013
Décembre
politiques. Pour ce qui est des pays en
développement, on peut noter la crainte
de la perte d’identité culturelle et le
« vol » des emplois des locaux. Quant à
l’Europe, elle favorise la migration
temporaire tel que spécifié dans le mode
4 de l’AGCS.
B. Mesures pour faciliter les
mouvements des
personnes conformément aux
dispositions de l’AGCS
Pour faciliter le mouvement des
personnes et afin de mieux mesurer ses
effets sur la mondialisation du
commerce et sur le marché du travail,
plusieurs mesures doivent être prises
autant dans le pays d’origine que dans le
pays d’accueil. De ce fait, il est
important qu’un accord sur le
recrutement soit signé entre les
partenaires afin de fixer les conditions
d’entrée dans le pays d’accueil et de
retour dans le pays d’origine pour les
candidats à la migration. De ce fait, les
conditions de recrutements et de
formation (condition d’entrée et séjours
dans le pays d’accueil).
Pour ce qui est des conditions de recrutement, elle nécessite une plus
grande transparence et d’équité. De ce
point de vue, le pays d’accueil doit
communiquer sur les disponibilités
d’offres d’emplois (caractéristiques,
durée, quotas) tout d’abord. Ensuite, la
mise en place d’une structure formelle
chargée de recruter les travailleurs et de
la signature des contrats de travail. En
fin, une vérification de la qualification
(diplôme académique et/ou expérience
professionnelle) est importante: le rôle
des associations professionnelles et
l’implication des pays d’origine dans le
processus.
S’agissant des conditions de formation
(conditions d’entrée et séjour dans le
pays d’accueil), il est nécessaire qu’une
règlementation soit mise en place dans
chaque pays. Néanmoins, on peut noter :
l’existence d’une structure chargée de
l’attribution des visas (types et durée),
l’organisation du transport, la
participation du pays d’origine et des
transporteurs pour vérification des
documents de voyage, le contrat de
travail : possibilité de contrat « multi
employeurs ». Le respect des termes du
contrat les employeurs est un impératif.
De ce fait, ils doivent s’acquitter de
leurs obligations (respect des droits de
travail, des dispositions de sécurité
sociale, exploitation des immigrés,
conditions de vie et de travail). Outre les
Bulletin de l’APDHAC --- N°40 Janvier 2014 --- Diffusion gratuite --- [email protected] 11
dispositions précédemment énoncées, il
importe que (i) l’extradition des
travailleurs ne respectant pas les
contrats soit organisé, (ii) le refus de
renouvellement du bénéfice du dispositif
par les entreprises ne respectant pas les
contrats. d’autres à mettre en place
s’articulent autour de la mise en place
d’un mécanisme de suivi pour respect de
la durée du séjour, de la formation des
travailleurs, du paiement d’une partie du
salaire dans le pays d’accueil et
perception du reste dès retour dans le
pays d’origine et enfin la garantie de
recrutement futur liée aux performances,
la mise sur pied des mécanismes liés à
l’amélioration des conditions
économiques et sociales des migrants
dans le pays d’origine. De plus, la mise
en place d’autres conditions comme la
participation à la vérification de
qualifications, l’assistance pour la mise
en œuvre des projets et de création
d’entreprises44
et l’inclusion des
migrants parmi les bénéficiaires des
programmes humanitaires.
EHODE ELAH Raoul,
Chercheur au Centre National
d’Education / MINRESI
Ph. D. candidat en économie à
l’Université de Yaoundé
Les migrations et la mondialisation
L’ère contemporaine se caractérise ma-
joritairement par les effets structurants
de la mondialisation qui touchent à
toutes les activités de l’homme. Du fait
des impacts de la mondialisation per-
ceptibles dans tous les domaines sociaux
dont celui de la paix et de la sécurité de
nombreux phénomènes se sont accen-
tués depuis le triomphe de l’idéologie
libérale. Il s’agit entre autres des mou-
vements migratoires qui se sont accélé-
rés au cours des dernières décennies
sous l’effet de la levée des verrous des
barrières inter nations.
La mondialisation se traduit par une
remarquable accélération du degré
d’ouverture des économies, une plus
grande amplitude des échanges des
biens et des services, ainsi que qu’une
plus grande circulation des capitaux et
des personnes à travers le monde. Ces
mouvements sont en outre amplifiés par
l’éclosion sans précédent des nouvelles
technologies de l’information et de la
communication dont le corollaire le plus
44 Notes de cours de M. le Professeur TCHABOURE Aime Gogue, sur la « Migration et Mouvements
temporaires de personnes physiques », 2013, 20 p.
perceptible est la compression de
l’espace et du temps. Le monde ainsi
réduit à un simple « village global »
devient propice aux phénomènes migra-
toires qui s’expriment par les déplace-
ments des populations ou des personnes
humaines d’un pays ou d’une région à
un(e) autre. Ces déplacements migra-
toires de la population vers l’extérieur
du pays d’origine sont qualifiés
d’émigration et d’immigration dans le
mouvement inverse. Au regard des défis
de la paix et de la sécurité auxquels les
nations et les régions sont confrontées
dans un contexte global, ou le contrôle
devient difficile, il y a lieu de
s’interroger sur les justifications pos-
sibles des déplacements humains et ses
impacts dans le monde. Ceci étant, les
phénomènes migratoires
s’accommodent-ils du contexte actuel de
la mondialisation ? Autrement dit, la
mondialisation accélère-t-elle les migra-
tions et leur impact dans le monde ?
Plus simplement, quels sont les liens
possibles entre la mondialisation et les
migrations ?
A nos jours, cette préoccupation se justi-
fie par le fait qu’aucun territoire ou Etat
membre du village global ne peut pré-
tendre ne pas être concerné par les dé-
placements humains. Il convient de ce
fait d’approfondir la compréhension de
cette réalité contemporaine en situant les
phénomènes migratoires dans la résul-
tante de la mondialisation (I), tout en
envisageant l’importance de les contenir
afin d’en limiter les éventuels méfaits
(II).
I. La mondialisation, moteur des phé-
nomènes migratoires Le contexte globalisant actuel est pro-
pice à des migrations multiformes (A)
qui ont des impacts (B) sur ce nouvel
ordre mondial.
A. Les migrations nées de la mondia-
lisation : caractéristiques et formes La mondialisation a ouvert de nouvelles
voies aux migrations qui sont moins
dépendantes des passés coloniaux. A ce
titre, l’internationalisation du modèle
occidental de consommation dans ce
contexte se caractérise par la libre circu-
lation de l’information et des biens, le
développement des moyens de trans-
ports de plus en plus allégés…Tous ces
effets de la mondialisation suscitent
l’envie accrue des populations de partir
pour réussir ailleurs, notamment dans
les pays occidentaux qui sont les plus
attractifs. Si tous les continents sont
alors concernés, l’Asie centrale et orien-
tale, l’Europe de l’Est et l’Afrique cen-
trale sont devenues depuis vingt ans de
nouvelles zones de mobilité.
La surpopulation, la pauvreté, les crises
politiques, les désastres environnemen-
taux, les regroupements à caractère
religieux ou ethnique, l’attraction du
mode de vie occidental sont les nou-
velles causes de mobilité. Ceux qui
migrent disposent de réseaux transnatio-
naux (familiaux, commerciaux, écono-
miques et parfois mafieux) et d’argent
pour franchir les frontières, même illé-
galement. Une seule exception, la mi-
gration forcée de réfugiés, qui se dé-
roule pour les trois quarts dans le tiers-
monde. Le profil des migrants évolue
également : les jeunes hommes ruraux et
peu qualifiés sont désormais rejoints par
des jeunes hommes qualifiés voire très
qualifiés des classes moyennes urbaines,
des femmes isolées, qualifiées, aspirant
à une indépendance, et même des mi-
neurs.
Quant aux formes, elles sont de nos
jours plus pendulaires, de courte durée,
permettant des allers et retours entre
pays d’origine et pays d’immigration.
Les politiques de visas tendent néan-
moins à provoquer l’installation durable
des migrants qui craignent de ne plus
pouvoir revenir et font venir leur fa-
mille.
La mondialisation des migrations se
poursuit, non sans effets compte tenu
des déséquilibres mondiaux et de la
meilleure connaissance des filières
d’entrée, y compris dans les pays à poli-
tiques de contrôle des frontières.
B. Les impacts des migrations du fait
de la mondialisation Le continent africain est le continent le
plus exposé aux migrations. L’on es-
time, compte tenu de l’imprécision des
statistiques, que les migrations légales
ou illégales provenant de l’Afrique sub-
saharienne à l’intérieur et à l’extérieur
de l’Afrique concernent 2 à 4 millions
de personnes par an45
.
La perte de nationaux talentueux ou la
« fuite des cerveaux » à cause de
l’image positive de l’Occident profite
aux pays d’accueil, qui utilisent ces
compétences hautement qualifiées pour
satisfaire les besoins de croissance. Par
ailleurs, l’existence dans certains pays
d’une diaspora trop importante crée la
difficulté à trouver sur place un travail
45Confère : Résolution 1611 (2008) de l’Assemblée
parlementaire du conseil de l’Europe.
Bulletin de l’APDHAC --- N°40 Janvier 2014 --- Diffusion gratuite --- [email protected] 12
correctement rémunéré. Dans le même
sillage, la trop grande proportion de
migrants peut provoquer des réactions
de xénophobie dans le pays d’accueil,
pouvant générer des conflits sociaux
d’identité physique et culturelle.
D’autre part, grâce aux progrès des TIC
et la baisse des frais de déplacement, la
mondialisation maintien les migrations
en contact avec leur pays d’origine ou
établir des liens durables avec les dias-
poras et les réseaux transnationaux.
L’accent est également parfois mis sur
le rapatriement des compétences et du
savoir-faire, ainsi que des fonds sans
obliger les migrants à rentrer physique-
ment ou définitivement chez eux.
Toutefois, la dépendance excessive à
l’égard des compétences extérieures
pourrait limiter les investissements na-
tionaux, en plus des autres difficultés
d’insertion des migrants, d’où l’intérêt
pour les politiques de s’organiser pour
réguler le flux des mouvements migra-
toires.
II. L’impératif d’endiguer les migra-
tions dans le contexte de la mondiali-
sation Les défis de la stabilisation sociale re-
quièrent l’implication préalable de
l’Etat ou du territoire concerné (A),
avant d’envisager des solutions concer-
tées ouvertes (B) au plan régional et
international.
A. L’Etat, initiateur des solutions
endogènes De même que le développement des
pays africains ne viendra pas seulement
du seul soutien des pays industrialisés et
des aménagements sur la dette.
L'arrêt du phénomène migratoire et du
développement du continent africain,
qui est plus concerné par l’émigration,
notamment la fuite des cerveaux, passe
d'abord par la prise de conscience de la
vitalité ,de la créativité et des aspirations
de ses habitants, en majorité, par les
gouvernants à travers des programmes
de société fondés sur l'égalité des
chances, une distribution équitable des
revenus, la bonne gouvernance et l'unité
de ses peuples.
Les migrations irrégulières progressent
et les avancées technologiques offrent
des outils sans cesse plus sophistiqués
aux trafiquants et aux réseaux criminels
pour déjouer les efforts déployés par les
gouvernements afin de contrôler et sur-
veiller les mouvements migratoires. Ce
faisant, dans un contexte ou coexistent
des situations migratoires complexes, la
communication interne et la concerta-
tion dans une optique d’élaboration des
politiques et des programmes complets
et efficaces en matière de gestion des
migrations. Par exemple, le contrôle
préalable des profils individuels et la
nécessité d’une plus grande circonspec-
tion à l’égard des personnes représentant
une menace pour la sécurité.
B. Les solutions concertées régionales
et internationales Les Etats n’ayant pas la même législa-
tion malgré l’harmonisation progressive
des politiques internationales. En dépit
de nombreux accords bilatéraux et des
mécanismes de coopération régionale et
internationale mis sur pied pour gérer
certains aspects des migrations46
, les
migrants choisissent naturellement le
pays où ils trouvent le plus d’avantages
et le moins de risques, notamment d’être
reconduits. C’est pourquoi en matière de
connaissance et de gestion globale des
flux migratoires, de nombreux défis sont
à relever, lesquels se résument dans le
rapport de l’Assemblée parlementaire
du conseil de l’Europe du 18 avril 2008
sur l’immigration47
.
L’aide à l’Afrique subsaharienne et les
relations entre pays d’origine et pays
d’accueil serait favorisée dans les Etats
membres du conseil48
par le développe-
ment de la connaissance de l’Afrique
dans l’opinion publique, et notamment
l’encouragement des jumelages et le
relai des actions de coopération décen-
tralisée. Il serait également judicieux de
travailler à l’élaboration d’un fichier
central de spécialistes des diverses
langues africaines, susceptibles de con-
verser avec les ressortissants des pays
d’origine quand ceux-ci ont du mal à
communiquer avec les autorités;
d’encourager financièrement les trans-
ferts légaux de fonds vers le pays
d’origine, en prenant à leur charge une
partie des coûts de transfert;
d’encourager les transferts de savoir-
faire des membres de la diaspora vers
leur pays d’origine, par l’instauration
d’une procédure simplifiée de visas et la
prise en charge d’une partie du manque
46 A titre d’illustration, voir ALEINIKO (A), et
CHETAIL (V) dans la contribution de l’OIM, Cha-
pitre 18 : les normes juridiques internationales en matière de migrations, TMC, Asser Press, New
York, 2003. 47 Il s’agit du rapport de la commission des migra-tions, des réfugiés et de la population. 48 Ces Etats membres du conseil de l’Europe sont les
plus concernés par les mouvements migratoires en provenance de l’Afrique Subsaharienne ou les dé-
parts sont plus considérables.
à gagner pour ceux qui se déplaceraient
dans ce but; de prendre les mesures
nécessaires pour respecter les traditions
religieuses et les pratiques culturelles
des migrants originaires de l’Afrique
subsaharienne; de sanctionner les pra-
tiques contraires aux droits de l’homme,
comme l’excision et toute forme de
mutilation génitale; de mettre en place
ou de renforcer des mesures de discri-
mination positive à l’égard des migrants
subsahariens, notamment dans le do-
maine de l’éducation, du logement et de
la santé; de mobiliser un maximum de
ressources pour freiner ou enrayer les
pandémies qui plombent la croissance
des régions infectées de l’Afrique sub-
saharienne.
Dans la perspective d’un alignement
progressif des procédures relatives aux
migrants d’Afrique subsaharienne sur
celles des autres migrants, il est impor-
tant que soit remis à tout migrant origi-
naire de l’Afrique subsaharienne un
document d’accueil du migrant, préci-
sant ses droits et ses devoirs; que ces
derniers puissent bénéficier des services
d’un interprète dans leur langue
d’origine; que les pays d’accueil
s’efforcent de conclure des accords de
réadmission et de développer l’aide au
retour pour les personnes déboutées du
droit d’asile; que les pays concernés
renforcent la lutte et les sanctions contre
les réseaux de passeurs.
Par ailleurs, au niveau des Etats
membres, il est impératif de mettre en
place un observatoire national et des
observatoires régionaux des migrations;
de tenir un registre local des installa-
tions, destiné à suivre l’insertion et les
déplacements de ces migrants, afin
d’accueillir ou de venir en aide à des
populations souvent en grande difficul-
té; de sécuriser les reconduites par une
formule de charters internationaux, for-
tement encadrés, avec la garantie d’une
procédure judiciaire préalable et
l’établissement d’une procédure con-
tractuelle avec le pays qui s’est engagé à
la réadmission, dans le respect des droits
de l’homme pour les migrants recon-
duits.
En matière de migrations spécifiques les
Etats se doivent d’offrir une alternative
à l’asile politique pour les migrants qui
ne sont pas persécutés par le pouvoir
mais par une autre ethnie implantée dans
leur pays, ou par des groupes armés
opérant illégalement; d’organiser un
suivi personnalisé des étudiants mi-
grants, en collaboration avec les pays
d’origine et les services des consulats ou
Bulletin de l’APDHAC --- N°40 Janvier 2014 --- Diffusion gratuite --- [email protected] 13
des ambassades existant dans ces pays,
afin de faciliter la réussite universitaire
des uns et le retour au pays ou
l’insertion professionnelle des autres.
Au terme de notre analyse, nous rete-
nons que la libéralisation mondiale des
échanges et la circulation effrénée des
capitaux, des biens et services ont des
répercussions énormes sur les popula-
tions. Même si les frontières et le temps
sont abolis par l’avènement des techno-
logies de l’information et de la commu-
nication, il n’en va pas de même en ce
qui concerne les déplacements des po-
pulations. Ces flux migratoires du fait
de la mondialisation posent de nom-
breuses difficultés tant au pays de départ
qu’à celui de l’accueil. Au regard des
motivations de ces migrants qui sont très
variées (économiques, familiales, so-
ciales ou politiques) et se diversifient de
plus en plus divers et de ses impacts, de
ce phénomène plusieurs défis concer-
nant la maîtrise de ces migrations
s’imposent aux dirigeants de tous les
Etats. Dans ce contexte de mobilité, la
recherche de la stabilité humaine, so-
ciale et économique demeure un défi
majeur de l’ère actuelle, que la commu-
nauté internationale se doit de relever,
dans le respect de l’intégrité et du droit
des migrants.
NGOUNMEDJE Firmin
Doctorant à l’Université de Yaoundé
II Soa
Les migrations et les technologies de
l’information et de la communication
Selon le rapport annuel 2009 du Pro-
gramme des Nations unies pour le déve-
loppement (PNUD) intitulé « Lever les
barrières : mobilité et développement
humain », les migrations à l’échelle
mondiale concerneraient un milliard de
personnes dont 740 millions seraient des
migrants internes et 260 millions, des
migrants internationaux. Et parmi ces
260 millions de migrants internationaux
près de la moitié se déplaceraient dans
leur région d’origine et moins de 30%
partiraient d’un pays en développement
vers un pays développé (PNUD,
2009)49
. Le continent africain est le
continent le plus exposé aux migrations.
On peut estimer, compte tenu de
l’imprécision des statistiques, que les
49 Véronique LASSAILLY-JACOB, « Réflexions
autour des migrations forcées en Afrique sub-
saharienne », Perspectives de la géographie en Afrique sub-saharienne, Université de Cocody,
Abidjan : Côte D'Ivoire, 2009.
migrations légales ou illégales prove-
nant de l’Afrique subsaharienne à
l’intérieur et à l’extérieur de l’Afrique
concernent 2 à 4 millions de personnes
par an. Leur proportion augmente au
détriment des migrations internes, ren-
dues plus difficiles par les conflits ar-
més, qui touchent de près ou de loin
aujourd’hui 24 pays africains, et par la
fermeture des frontières pratiquée par
certains d’entre eux50
.
Les évolutions récentes du phénomène
migratoire montrent que les parcours
des migrants d’aujourd’hui passent aus-
si, et parfois bien avant d’investir le
parcours physique, par les territoires
numériques. L’un des changements
majeurs intervenu depuis les années
1980 dans le domaine des migrations
tient à la multiplication des communau-
tés en dispersion dans l’espace physique
et à leurs nouvelles formes de regrou-
pement, d’action, d’occupation et de
contrôle dans les territoires numé-
riques51
. Équipé en téléphone mobile,
Internet, etc., ce migrant connecté
s’inscrit dans une « modernité liquide
»52
et pourrait étendre ses racines par-
tout. Les conflits armés étant la princi-
pale cause des migrations en Afrique,
quelle est donc l’influence des techno-
logies de l’information et de la commu-
nication (TIC) sur ce phénomène ?
Cette interrogation nous conduit à éla-
borer un postulat divisé en quatre volets
principaux lesquels sont organisés selon
deux axes. L’un en effet considère les
usages des TIC par les migrants en lien
avec leur pays d’origine ou leur pays
d’accueil; l’autre distingue les usages
des TIC en phase pré migratoire ou post
migratoire. Au cœur de ce modèle se
tient la figure du migrant connecté. Ce
renouvellement de la conception du
migrant résulte de la conjoncture de
deux phénomènes: d’une part,
l’accroissement du rôle des réseaux et
de l’interconnexion; d’autre part,
l’accroissement de la mobilité interna-
tionale ; ces deux phénomènes étant
étroitement liés.
50 Voir à ce sujet Immigration en provenance de
l’Afrique subsaharienne, rapport de la Commission des migrations, des réfugiés et de la population,
Texte adopté par l’Assemblée le 18 avril 2008 (18ème
séance), Conseil de l’Europe, Assemblée parlemen-taire, Résolution 1611. 51 Dana DIMINESCU, Dominique PASQUIER
(coord.), « Les migrants connectés. T.I.C., Mobilités et migrations », Revue Réseaux, N° 159, Université
Paris-Est, disponible sur http://revue-reseaux.univ-
paris-est.fr/fr/numeros-precedents/document-1068.html (consulté le 15/01/2014). 52 Idem.
L’Afrique, qui connaît un nombre élevé
de conflits internes est le continent qui
compte le plus de réfugiés : aujourd’hui,
« […] près de 12 millions de migrants
forcés sont africains »53
. Les récents et
perpétuels conflits armés au Soudan, en
République centrafricaine, au Mali, en
Côte-d’Ivoire, pour ne citer que ces
Etats illustre à profusion cette malédic-
tion caractéristique du continent. Les
nouvelles TIC semblent être à l’origine
de modifications dans l’organisation des
mouvements migratoires. Cette réorga-
nisation des réseaux de migrants modi-
fie sensiblement le contact avec les
familles restées au pays. Le cybercafé
devient ainsi un véritable carrefour de
l’information et de la communication,
permettant une interconnexion entre le
pays d’origine et les différentes sphères
de la diaspora. Les nouvelles généra-
tions, plus aptes à s’approprier ces ou-
tils, deviennent les intermédiaires privi-
légiées dans leur pays. Ce rôle de « mé-
diateur » de la part des jeunes implique
de nouvelles responsabilités aux niveaux
politiques, économiques et information-
nels, qui sont responsables de potentiels
bouleversements dans les organisations
traditionnelles des pays d’origines54
.
En phase pré-migratoire et en lien avec
le pays d’accueil, les TIC offrent deux
opportunités pour les futurs migrants.
Parce que la mobilité va croissante, les
futurs migrants, avant même d’élaborer
leur projet migratoire, sont générale-
ment déjà en contact au moyen des TIC
avec d’autres migrants issus de leurs
réseaux familiaux et sociaux. En effet,
les non-migrants, les futurs migrants et
les migrants d’une ethnie sont liés. Ce
faisant, les coûts et les risques encourus
par la migration sont réduits et la tenta-
tion migratoire renforcée. Il est possible
de penser que les sites de réseaux so-
ciaux tels que Facebook (et d’autres
variantes), les courriels, et les cartes
d’appel téléphonique internationales ont
largement contribué à renforcer
l’interconnexion au sein des réseaux
migratoires. Les TIC constituent donc
une opportunité de migration dans le
sens où elles exposent les futurs mi-
53 Idimana KOTOUDI, Les migrations forcées en
Afrique de l’Ouest, Institut PANOS Afrique de
l’Ouest, Faits et documents, Novembre 2004. 54 Jonathan STEBIG, Yveline DEVERIN, «
L’appropriation des TIC par les diasporas : Analyse
des répercussions potentielles dans les pays d’origine», Les cahiers de NETSUDS [En ligne],
NETSUDS n° 3, Numéro intégral, mis à jour le :
10/05/2011, URL : http://revues.mshparisnord.org/netsuds/index.php?id
=221 (consulté le 15/01/2014)
Bulletin de l’APDHAC --- N°40 Janvier 2014 --- Diffusion gratuite --- [email protected] 14
grants à une réalité migratoire entrevue
à travers l’expérience des pairs.
En phase post-migratoire et en lien avec
le pays d’accueil les TIC représentent un
moyen d’intégration dans la société
d’accueil en ceci qu’elles permettent
l’accès à des informations, des services
et des opportunités pour les migrants
tels que des informations officielles
(ex. : sites Web gouvernementaux sur
différents aspects politiques, écono-
miques et sociaux) ou informelles (ex. :
sites Web de réseautage) ; un empower-ment, lorsque les migrants utilisent les
TIC pour se donner une voix et une
visibilité ou pour établir le dialogue
avec la société d’accueil (ex. : sites Web
de communautés ethniques) et diffé-
rents services, notamment liés à
l’emploi (ex. : sites Web de recherche
d’emploi) ou à l’éducation. « Cepen-
dant, bénéficier de ces informations,
opportunités et services permis par les
TIC demandent au préalable des compé-
tences TIC suffisantes »55
. La littératie
numérique56
prend ici toute son impor-
tance, de même que les initiatives qui la
soutiennent au sein du pays d’accueil.
L’accroissement du rôle des réseaux, de
l’interconnexion; ainsi que de la mobili-
té internationale favorisent également
les flux migratoires. L’information
qu’un peuple peut retirer d’un journal
officiel télévisé ou radio sur le caractère
inhérent d’un conflit au sein de sa com-
munauté l’amènera surement à prendre
des dispositions pour se protéger. Mais
la faiblesse institutionnelle, la maigre
culture africaine…en la matière consti-
tuent une réelle entorse à l’utilisation de
toutes les autres expressions des TIC et
partant freinent l’usage que les popula-
tions peuvent en faire en période pré ou
post conflictuelle.
L’enjeu quand on évoque la notion de
TIC dans les conflits armés est intime-
ment lié à l’usage qu’on a fait. Si les
moyens d’utilisation de ces technologies
étaient suffisamment vulgarisés en
Afrique, de nombreuses victimes au-
raient été épargnés. Si les populations
qui en ont accès l’utilisent de manière
intelligente et constructive, les ravages
des conflits armés pourraient dorénavant
être résorbés.
55 Simon COLLIN, Évaluation du cadre descriptif sur les TIC et la migration, 2012, disponible sur
http://simoncollin.weebly.com/eacutevaluation-du-
cadre-descriptif-sur-les-tic-et-la-migration.html (consulté le 15/01/2014) 56 La littératie numérique peut être entendue comme
l’ensemble des compétences de base techniques, cognitives, sociales et culturelles nécessaires à
l’utilisation des TIC au sein d’une société donnée.
MANGWA TAYOU Mireille Stéphanie
Doctorante, Assistante administrative
chargée des programmes à
l’APDHAC
Migration, développement et Droits
de l'Homme : Quelles dialectiques ?
Selon le rapport de la commission
mondiale sur les migrations interna-
tionales (CMMI) remis au Secrétaire
Général des Nations Unies le 05 Oc-
tobre 2005, la distribution géogra-
phique inégale des opportunités socio-
économiques, les problèmes de gou-
vernance et de respect des droits
humains, qui sont généralement à
l’origine de flux migratoires feront
que le nombre de personnes cherchant
à migrer va s’accroître sensiblement
durant les prochaines années. Les migra-
tions sont généralement effectuées des
pays les moins développés vers les pays
les plus développés. Alors les flux mi-
gratoires soulignent de façon ostensible
un fait : les migrants quittent la pauvreté
pour les zones dont l’environnement est
selon eux plus propice à la production
des richesses. Le sous- développement
est toutefois loin de constituer l’unique
facteur qui alimente les flux migratoires.
Ils peuvent être dus : aux conflits armés
et violations des Droits de l'Homme
sévissant dans la localité de départ, à
une catastrophe naturelle, aux condi-
tions environnementales hostiles comme
la sècheresse…Quel que soit le facteur
ayant déterminé la mobilité, celle-ci
draine avec elle une problématique dé-
terminante qui celle de la protection des
Droits de l'Homme dans un contexte de
migration. Le capital humain étant la
source première de production des ri-
chesses, sa mobilité impacte inévitable-
ment sur le développement tant du pays
de destination que du pays d’origine. La
migration soulève donc des questions
des Droits de l'Homme comme des vio-
lations de ceux-ci déclenchent des flux
migratoires ; parallèlement, un contexte
de sous-développement alimente les
phénomènes migratoires tandis que
l’exode ainsi créée influence la courbe
du développement. Quel le fil d’Ariane
lie Migration, développement et Droits
de l'Homme tel une triade ? A la base du
phénomène migratoire se trouve un déficit de développement et une viola-
tion des Droits de l'Homme (I), oppor-
tunément, le phénomène migratoire
motorise le développement et dynamise
la question de la protection des Droits
de l'Homme (II).
I. Migration : symptôme d’un double
déficit de développement et des droits
de l'Homme Au rang des facteurs qui déterminent la
décision de migrer se trouvent en bonne
place la quête des conditions matérielles
d’existence (A) et la quête d’une meil-
leure protection des Droits de l'Homme
(B).
A. La quête de l’amélioration des
conditions matérielles d’existence Les déséquilibres économiques entre les
pays sont notoires. Certains savent valo-
riser leur capital humain, leur potentiel,
ou possèdent des sources d’énergie ou
des minerais précieux qui peuvent per-
mettre d’avoir une économie de rente. À
l’inverse, d’autres ne savent pas créer
les conditions permettant l’essor éco-
nomique ou ne parviennent pas à valori-
ser leur atouts. Constatant ces écarts, et
lorsqu’il n’y a guère d’espoir
d’amélioration au pays, l’explication de
la migration internationale la plus
simple, la plus immédiate et sans doute
la plus proche du sens commun est de
dire que les gens vont la où ils peuvent
améliorer leur condition de vie et leur
qualité de vie. Le lien en surbrillance
entre la migration et le développement
est celui selon lequel les populations
incitées par le souci d’amélioration des
conditions matérielles d’existence vont
des zones économiquement plus défavo-
risées vers celle économiquement pros-
pères57
. Dans cette perspective, il con-
vient aisément que les inégalités dans la
répartition géographique des richesses et
du travail sont parmi les déterminants
essentiels de l’émigration des popula-
tions les plus défavorisées58
. Les mi-
grants sont donc des êtres rationnels qui
vont vers les régions où il existe une
chance de mieux gagner leur vie ; à
condition que les Droits de l'Homme y
soient respectés.
B. La quête d’une meilleure protec-
tion des droits de l'Homme
La violation des Droits de l'Homme est
à la source du phénomène migratoire. Si
beaucoup de déplacés ont librement
57 En 2001, le rapport sur le développement humain
du PNUD indiquait que plus de 21 000 médecins
nigérians exerçaient aux Etats-Unis. Il y aurait au total plus de cadres africains qui travaillent aux
Etats-Unis qu’en Afrique. en outre, plus 20 000
cadres ou étudiants quittent chaque année l’Afrique. 58 Migration internationale en Afrique de l’ouest face
à la crise, Richard LALOU.
Bulletin de l’APDHAC --- N°40 Janvier 2014 --- Diffusion gratuite --- [email protected] 15
choisi de s’installer ailleurs pour des
raisons variables (familiales, éducatives,
professionnelles, recherche de terres
agricoles ou quête d’un emploi), des
dizaines de millions d’autres sont con-
traints de fuir les périls tels que les
guerres civiles, l’oppression gouverne-
mentale, les soulèvements politiques, les
persécutions ethniques, politiques ou
religieuses, ainsi que les catastrophes
environnementales comme la sécheresse
et la famine : il s’agit là de migrations
forcées ou involontaires59
. En 2009, la
RDC comptait environ 186 mille réfu-
giés dont 3 mille demandeurs d’asile,
principalement en provenance de
l’Angola, du Rwanda, du Burundi de
l’Ouganda, Soudan, Congo, RCA60
.
Plusieurs intellectuels ont également
quitté l’Afrique pour avoir manier une
plume jugée trop sarcastique et saty-
rique dans un contexte politique hostile
à la liberté d’expression. Entre 1961 et
1978, près de 6.000 intellectuels ouest-
africains ont dû fuir leur pays pour se
réfugier aux États-Unis d’Amérique où
ils espéraient être libres. Pour avoir
critiqué ouvertement (dans leurs ou-
vrages) le système totalitaire, certains
écrivains de la région ouest (WOLE
Soyinka, entre autres) ont été contraints
de vivre hors de leurs patries. D’autres
ont fait l’expérience des geôles61
.
Le déficit de développement et les viola-
tions des Droits de l'Homme sont des
facteurs qui dynamisent les flux migra-
toires de l’Afrique vers l’extérieur. Cer-
taines conditions réunies, la migration se
mue en outil de croissance en même
temps qu’un ferment d’amélioration des
Droits de l'Homme.
II. Migration : facteur de développe-
ment et d’amélioration des droits de
l'Homme. L’impact positif de la migration sur le
développement (A) est conditionné par
le respect des droits et libertés des mi-
grants (B).
A. Impact de la migration sur le déve-
loppement
59 Institut Panos Afrique de l’Ouest, les migrations forcées en Afrique de l’Ouest, 2005. 60 UNHCR, 2010. 61L’écrivain nigérian CHINUA ACHEBE en fournit l’exemple. Il a été persécuté par les autorités poli-
tiques de son pays après la parution, en 1966, de son
roman sarcastique intitulé A Man of the People, dont la version française – parue aux Éditions Abidjan –
s’intitule Le Démagogue. Le livre dénonce, en effet,
les dérives autoritaires d’un chef d’État africain ; c’est aussi une critique sociale des politiciens cor-
rompus d’Afrique. Achebe s’est exilé aux États-Unis.
Migration et développement sont des
phénomènes complexes et intiment
connectés62
. Selon qu’on situe l’analyse
du point de vu du pays d’origine ou du
pays d’accueil, la migration impacte le
développement à plusieurs niveaux.
Vue du pays d’origine, l’incidence de la
migration sur le développement entre-
tient des nuances. Il est postulé que la
migration appauvri le pays d’origine en
le vidant de son capital. Cet exode des
cerveaux et de la main d’œuvre consti-
tue un manque à gagner qui tire la crois-
sance vers le bas. Cependant, bien enca-
drée, la mobilité de la main-d'œuvre a
une incidence positive sur le dévelop-
pement, de diverses façons et à divers
niveaux.
La migration peut avoir pour effet de
résorber le chômage, accroître les reve-
nus, améliorer le niveau de vie, renfor-
cer le potentiel par exemple grâce à une
meilleure éducation. Les fonds envoyés
au pays par les migrants, à leur tour,
peuvent aider les individus, les familles
et les communautés à sortir de la pau-
vreté. Les rapatriements de fonds consti-
tuent une source importante de flux
financiers vers la région ; ils ont triplé
depuis 1990 pour atteindre plus de 12
milliards de dollars E.-U. en 2008. Pour
le Maroc et le Sénégal, ils représentaient
8 pour cent au moins du PIB63
. Ces flux
peuvent contribuer directement au déve-
loppement en appuyant les revenus dans
les pays d'origine, et indirectement dans
la mesure où les rapatriements de fonds
contribuent à soutenir l'éducation, l'in-
frastructure et l'investissement dans le
secteur privé. La mobilité des travail-
leurs contribue également au dévelop-
pement national. Dans les pays d'ori-
gine, les fonds envoyés par les migrants
peuvent aider à atteindre les objectifs de
développement nationaux et un solde
budgétaire positif64
.
Les pays de destination tendent à tirer
profit des migrations en ce sens que
l’afflux de travailleurs peut aider à ré-
pondre aux pénuries de main-d'œuvre
qualifiée ainsi qu'au vieillissement de la
population ; contribuer à la reprise po-
tentielle de nombreux secteurs tradition-
62 Séminaire de l’OIM sur la migration et le
développement, Genève, 1992. 63 Faire des migrations un facteur de développement, institut international d’études sociales, 2010. 64 Le montant global des transferts habituellement
reçu par les autorités maliennes ainsi que par les partenaires au développement est de 180 millions
d’euro (120 milliards de FCFA/ an). XVIe
Assemblée régionale d’Afrique, Communication de la section malienne, « la problématique de la
migration en Afrique :le cas du mali ».
nels tels que l'agriculture et les services ;
et participer au financement des pro-
grammes de retraite et autres mesures de
sécurité sociale. Dans le même temps, il
convient de pondérer ces bénéfices en
fonction de l'impact ou des consé-
quences perçu(es) que la présence des
travailleurs migrants peut avoir sur le
marché du travail des pays de destina-
tion, ce qui soulève d’importantes ques-
tions liées aux Droits de l'Homme.
B. L’amélioration des droits de
l'Homme entre migration et dévelop-
pement L’absence de protection des Droits de
l'Homme entrave le potentiel de déve-
loppement humain de la migration65
.
Les Droits de l'Homme garantissent le
respect des capacités, des libertés et des
responsabilités, c’est pourquoi ils per-
mettent le développement de chaque
personne comme celui de chaque socié-
té. Chaque droit de l’homme est à la fois
une fin et un moyen du développement
personnel et social. Car la réalisation de
chaque droit, liberté et responsabilité
permet le développement d’une res-
source humaine, capable de participer au
respect des équilibres civils, culturels,
écologiques, économiques, politiques et
sociaux. Développement personnel et
développement des sociétés sont insépa-
rables66
. Il est donc impératif, pour
qu’après la migration le développement
suive, que les droits des migrants où
qu’ils soient, soient respectés : lutte
contre le trafic des migrants, la xéno-
phobie, la discrimination, le racisme...
C’est sans doute à la faveur de cette
optique qu’il existe une panoplie de
textes protégeant les droits des mi-
grants67
.
Conclusion
La migration contribue au développe-
ment tant des pays de destination que
des pays d’origine en même temps
65 Les Droits de l'Homme, frein ou moteur au développement ? François A. DE VARGAS,
itinéraire, leçon inaugurale n°6, 2004. 66 Selon la définition qu’Amartya Sen donne du développement : « Pour l’essentiel, j’envisage ici le
développement comme un processus d’expansion des
libertés réelles dont les personnes peuvent jouir. De cette façon, l’expansion des libertés constitue à la
fois, la fin première et le moyen principal du
développement, ce que j’appelle respectivement le « rôle constitutif » et le « rôle instrumental » de la
liberté dans le développement ». Amartya SEN, Un
nouveau modèle économique. Développement, justice, liberté. 1999, Chapitre 8, p.
56. 67 Il existe plus de 9 traité fondamentaux relatifs aux Droits de l'Homme auxquels s’ajoute des traités
particuliers.
Bulletin de l’APDHAC --- N°40 Janvier 2014 --- Diffusion gratuite --- [email protected] 16
qu’elle déclenche des problématiques
relatives aux Droits de l’Homme. Le
lien entre migration, développement et
Droits de l'Homme peut être résumé de
la façon suivante : la migration est
source de développement à condition
que les Droits de l'Homme soient res-
pectés, le développement est source
d’amélioration des Droits de l'Homme et
rééquilibre les migrations. Alors « Il
faut arrêter de faire du répressif, du
sécuritaire ou même de la gesticulation
et de la diabolisation du phénomène
migratoire. « Ce n’est ni un phénomène
pervers, ni un phénomène criminel. Considérons – le et traitons- le comme
un phénomène naturel qu’il faut accom-
pagner, modaliser et positiver »68
.
MEFEUZA TSOFACK
Carlos Dumas
Doctorant à l’APDHAC/UCAC
Les liens entre migration, développe-
ment et droits de l’homme
Depuis la nuit des temps, les migrations
sont pour l'homme une manière coura-
geuse de manifester sa volonté de sur-
monter l'adversité et d'avoir une vie
meilleure69
. La révolution dans les do-
maines du transport et de la communica-
tion, ainsi que la mondialisation des
économies ont, plus que jamais, trans-
formé la perception de ce phénomène.
Les questions en matière d’asile, de
migration et de mobilité occupent une
place de choix parmi les missions assi-
gnées aux objectifs du millénaire pour le
développement70
. On se déplace plus
vite, plus loin ; dans le village le plus
isolé d’Afrique noire, on voit des
images de l’Europe prospère qui font
rêver. Mais les pays les plus convoités
tendent à se fermer pour préserver leur
niveau de vie, voire leur identité que
mettrait en péril la venue de populations
différentes par la culture, la langue, le
mode de vie, la religion, la couleur de la
peau ou les vêtements71
. Dans ce con-
68 Louis MICHEL, Commissaire Européen au Développement, décembre 2006. 69 Dialogue de haut niveau sur les Migrations interna-
tionales et le développement, Assemblée générale des Nations Unies, 14 et 15 septembre 2006, Le point
sur les migrations internationales, Rapport du Secré-
taire général (A/60/871), http://www.un.org/french/migration/background.htm
l. 70 Observatoire ACP sur les migrations, Rapport de la première réunion du Forum mondial sur la
migration et le développement, Belgique, du 9 au 11
juillet 2007 Bruylant Bruxelles, 2008, p. 48. 71 Alexandre PAPA FAYE, Migration et développe-
ment : de l’immigration subie à l’immigration choi-
texte, il est important de s’interroger sur
les liens que peuvent entretenir migra-
tions, développement et les droits de
l’homme. Pour mieux appréhender la
réponse à ce questionnement, il convient
d’envisager d’une part, le lien entre
migration et développement (I) et
d’autre part, le lien entre migration et
droits de l’homme (II).
I. La migration : un facilitateur du
développement pour les pays
d’origine et de destination L’impact de la migration sur le dévelop-
pement des pays d’origine réside essen-
tiellement dans les envois de fonds par
les migrants. Le rôle que jouent les en-
vois de fonds dans la réduction de la
pauvreté et leur contribution au déve-
loppement local, sous-régional, et natio-
nal est indéniable. Selon les estimations
de la Banque mondiale, les transferts
monétaires officiellement enregistrés
dans le monde représentaient un total
approximatif de 406 milliards de dollars
en 2012, soit une croissance de 6,5 %
par rapport à l'année précédente. La
Banque mondiale estime en outre que
les transferts de fonds pourraient at-
teindre 534 milliards de dollars d'ici
2015. Environ 325 milliards de dollars
de transferts monétaires vont aujourd'hui
vers les pays en développement. Dans
de nombreux pays, les transferts repré-
sentent une proportion importante du
produit intérieur brut (PIB)72
. Il est im-
portant de noter qu'il existe aussi un
important flux de versements en dehors
des mécanismes officiels, par exemple
par des contacts personnels, des
échanges informels ou des intermé-
diaires commerciaux comme Western
Union ou encore Moneygram. Enfin, il a
été estimé, en 2005, qu'entre 10 et 29 %
des envois de fonds reçus dans les pays
de l'hémisphère Sud sont envoyés par
des migrants également situé dans l'hé-
misphère Sud73
.
Au-delà de la réduction de la pauvreté
aux niveaux individuel et familial, il a
été découvert que les envois de fonds
contribuent plus largement au dévelop-
pement durable, et ce de plusieurs ma-
nières. Les envois de fonds peuvent
sie, in http://cadtm.org/Migration-et-developpement-
de-l, (consulté le 22/12/2013) 72 L'Organisation internationale pour les migrations,
Vers le dialogue de haut niveau sur les migrations
internationales et le développement de 2013, Rapport final des séries de dialogues de haut niveau, 2013, p.
23. 73 Ratha DILIP, W. SHAW, South-South Migration and Remittances, Banque Mondiale, Washington,
D.C., 2007.
contribuer à la formation de capital
humain. Une variété d'études nationales
et d'études comparatives internationales
a démontré que les envois de fonds sont
souvent ensuite investis dans l'éduca-
tion. Les envois peuvent également
contribuer au développement écono-
mique des régions rurales, en fournis-
sant par exemple un flux de capitaux
aux petites exploitations agricoles si-
tuées dans les zones rurales périphé-
riques. Les envois de fonds peuvent
engendrer des effets multiplicateurs au
sein de l'économie locale74
. Ils peuvent
également contribuer à la réalisation des
objectifs nationaux de développement.
Un examen approfondi des données
prélevées dans 71 pays a établi une forte
corrélation entre les envois de fonds et
la réduction de la pauvreté. Dans cet
examen, il est estimé qu'au niveau na-
tional, une augmentation de 10 % des
envois par habitant entraine une diminu-
tion de 3,5 % du nombre de personnes
vivant dans la pauvreté75
.
Au niveau macro-économique, lorsque
les fonds sont reçus à une échelle impor-
tante, ils peuvent aider à maintenir une
balance des paiements positive, mais
aussi aider les pays en développement à
maintenir une économie stable, à aug-
menter les réserves de change, et à rem-
bourser la dette. C'est de ces manières
que les envois de fonds ont contribué à
atténuer les répercussions de la crise
financière mondiale dans un certain
nombre de pays en développement, et
ont également servi d'« amortisseur »
suite aux catastrophes naturelles et aux
guerres civiles76
. Enfin, les emprunts
obligataires de la diaspora sont un autre
outil pour permettre aux pays en déve-
loppement de collecter les financements
externes «bon marché», en profitant de
ce que la diaspora, qui a une plus grande
tolérance aux risques de change, abais-
sera les coûts de l’emprunt. Les gouver-
nements pourront ainsi financer des
projets de développements sociaux im-
portants ayant un retour économique
très faible tels que les habitations, les
projets communautaires, etc.77
.
Mais, alors que les transferts et la con-
sommation pourraient booster la crois-
sance, ils peuvent aussi être néfastes,
74 L'Organisation internationale pour les migrations, op. cit., p. 24. 75 Adams, R.H, J. Page, Do international migration
and remittances reduce poverty in developing coun-tries? World Development, 2005, 33(10):1645-69. 76 PNUD, Towards Human Resilience, New York,
2011. 77 Observatoire ACP sur les migrations, op. cit., p.
118.
Bulletin de l’APDHAC --- N°40 Janvier 2014 --- Diffusion gratuite --- [email protected] 17
dépendant du vaste contexte écono-
mique du pays bénéficiaire. Par
exemple, l’argent utilisé pour la con-
sommation peut, dans certains pays,
permettre en majorité l’achat des biens
importés, ce qui limite la contribution au
développement de l’économie nationale.
Ceci est un autre exemple de ce qui peut
arriver lorsqu’il y a absence
d’infrastructures adéquates pour faire le
lien entre les transferts et le développe-
ment équitable. Leur impact positif par
conséquent dépend de l’existence d’un
secteur privé domestique solide78
.
Dans le pays de destination, les migrants
qualifiés peuvent combler des lacunes
importantes sur le marché du travail, et
stimuler l'innovation. Aux États-Unis,
des recherches ont prouvé que les immi-
grants sont 30 % plus susceptibles de
former de nouvelles entreprises que les
citoyens nés aux Etats-Unis. En fournis-
sant une « main-d'œuvre souple », les
migrants moins qualifiés peuvent ré-
duire les coûts du travail pour les em-
ployeurs qui, à leur tour, pourront con-
server des prix bas pour les consomma-
teurs79
. Il apparaît que la migration
augmente relativement les sources de
revenus, les possibilités d'emploi et les
revenus financiers, moins pour les mi-
grants situés dans les pays en dévelop-
pement que pour ceux qui se trouvent
dans les pays développés.
Pour les pays de destination avec un
vieillissement et une prévision de crois-
sance négative de la population, les
travailleurs migrants peuvent aider à
répondre à des pénuries de main-
d’œuvre et permettre à l'économie na-
tionale de gagner en efficacité, réduisant
ainsi le coût des produits pour les con-
sommateurs domestiques et renforçant
la compétitivité des exportations. La
mobilité de main-d’œuvre entrante peut
diminuer le recours à l'externalisation, et
peut réduire les destructions d'emplois
locaux. Et malgré les inquiétudes con-
cernant l'effet contraire, il a été démon-
tré que la migration est un phénomène
qui a un effet négatif minime sur les
salaires et l'emploi dans les pays d'ac-
cueil80
. Lorsqu'elle est correctement
gérée, la mobilité de la main-d’œuvre
peut donc contribuer à la mise en œuvre
de stratégies pour assurer le dynamisme,
la flexibilité et la compétitivité de l'éco-
nomie des pays de destination.
78 Ibid, p. 116. 79 L'Organisation internationale pour les migrations,
op. cit, p. 28-29. 80 OIM, Rapport mondial sur la migration 2005,
Genève, 2005.
Ces liens tissés entre la migration et le
développement seront renforcés par le
respect des droits de l’homme.
II. Le respect des droits de l’homme :
renforcement des liens entre migra-
tion et développement Historiquement, les migrants ont sou-
vent été privés de leurs droits et soumis
à des mesures et actions discriminatoires
et racistes, dont notamment
l’exploitation, les expulsions de masse,
les persécutions et autres exactions. Les
violations des droits des migrants sont
monnaie courante tant dans les pays de
transit que de destination81
. Mais on le
sait, la politique d’immigration repré-
sente, pour tous les Etats, un enjeu tel-
lement important que ces derniers
n’hésitent pas à violer les dispositions
qui encadrent cette matière82
. Les évé-
nements du 11 septembre 2001 ont accé-
léré le processus d’érosion des droits
fondamentaux des étrangers qui se trou-
vent désormais associés à la menace
terroriste. Le contrôle de leurs mouve-
ments relève maintenant d’une logique
sécuritaire, voire militaire, nécessitant
des alliances stratégiques entre les Etats
et le déploiement de moyens techniques
sophistiqués83
. Pourtant, l’individu est
au centre de toute migration et cet indi-
vidu est protégé par le droit en sa double
qualité de migrant et de travailleur. Ce
double aspect fut particulièrement pris
en compte par les derniers développe-
ments normatifs intervenus en la matière
au niveau universel, à savoir la Conven-
tion des Nations Unies de 1990 sur la
protection des droits de tous les travail-
leurs migrants et des membres de leur
famille84
.
Si Cummins et Rodriguez relèvent que
« plus il coûte à un employeur d'embau-cher un travailleur migrant, et plus les
droits du travailleur migrant s'accrois-
sent, moins l'employeur est susceptible
81 Migration et droits de l’homme, Réunion d’experts
sur la migration et le développement, Alger, Algérie 3-5 avril 2006, Union Africaine, Aide-mémoire. 82 Alexandre PAPA FAYE, Migration et développe-
ment : de l’immigration subie à l’immigration choi-sie, in http://cadtm.org/Migration-et-developpement-
de-l, (consulté le 22/12/2013) 83 François CRÉPEAU, Delphine NAKACHE, Idil ATAK, Les droits des étrangers menacés par les
contrôles migratoires, L’Institut National de Statis-
tique et d’Economie Appliquée (INSEA, Rabat) et la Chaire de recherche du Canada en droit international
des migrations (Université de Montréal), l’Université
Ouverte 2007 sur le thème : Migration, droits de l’homme et développement, Rabat, du 27 au 30 Mars
2007, p. 107. 84 R. PERRUCHOUD, Migrations et protection des droits de l’homme, n°3, Droit international de la
migration, p. 71.
d'employer des travailleurs mi-
grants »85
, force est de constater que la
protection des migrants protège aussi les
travailleurs locaux en décourageant les
employeurs de recruter des migrants
parce qu'ils sont moins protégés. De
plus, il existe une forte corrélation entre
les droits des migrants et leur capacité à
contribuer au développement. Un grand
nombre de migrants ne suffit pas néces-
sairement à conduire au développement,
ce qui compte, c'est la protection des
droits de l'individu, de son bien-être et
de sa santé afin de renforcer la capacité
du migrant à accéder à un travail décent,
à développer son potentiel, et à écono-
miser de l'argent pour l'envoyer au pays.
Bien plus encore, un traitement diffé-
rencié pour les migrants et les travail-
leurs locaux saperait la base des sociétés
qui sont construites sur la non-
discrimination et des droits de l'homme,
et en particulier les sociétés multicultu-
relles et multiethniques86
.
Le respect pour les droits des migrants
sous-tend et renforce les liens positifs
pouvant être tissés entre les migrations
et le développement. La protection des
droits des migrants tant dans les pays
d’origine (avant le départ) et de destina-
tion est d’une importance fondamentale
pour réaliser son plein potentiel. En
effet, au-delà de l’impératif moral, la
protection des droits des travailleurs
migrants favorise l’efficacité et le coût-
efficacité, puisqu’un environnement
antidiscriminatoire permet aux femmes
et hommes migrants de déployer leur
plein potentiel. Il leur permet
d’améliorer leurs revenus et les condi-
tions de vie de leur famille, d’accroître
leurs contributions au développement et
de renforcer leur participation écono-
mique, culturelle et sociale dans les pays
d’origine et de destination. Refuser ou
entraver l’accès aux droits des migrants
comporte un risque élevé se traduisant
par une exclusion sociale et écono-
mique, portant de graves conséquences
pour eux-mêmes aussi bien que pour
leurs communautés d’accueil que celles
de leur origine.
Il faut bien comprendre que les droits
des migrants ne sont pas importants
seulement en raison de la nécessité et de
l’obligation de protéger les êtres hu-
mains, mais aussi en raison du lien qui
85 M. CUMMINS, F. RODRIGUEZ, “Is there a
numbers versus rights trade-off in immigration policy? What the data say”, Journal of Human
Development and Capabilities, 2010, 11 (2): 281-
303. 86 L'Organisation internationale pour les migrations,
op. cit, p. 98.
Bulletin de l’APDHAC --- N°40 Janvier 2014 --- Diffusion gratuite --- [email protected] 18
existe entre ces droits et le développe-
ment. On s’est rendu compte que
l’absence de protection des droits de
l’homme entravait le potentiel de déve-
loppement humain de la migration,
même si c’est encore loin d’être le cas
aujourd’hui. La protection et le respect
des droits humains des migrants, tels
qu’établis par la législation internatio-
nale, régionale et nationale, sont néces-
saires pour s’assurer que les individus
vivent en sécurité et mènent une vie
productive, mais aussi pour veiller au
respect de l’Etat de droit et à l’existence
d’une société productive et qui fonc-
tionne bien dans son ensemble.
Il est ainsi primordial de protéger les
migrants et de leur assurer des condi-
tions de travail décentes dans un monde
où les droits découlent encore souvent
de la nationalité. Ceci pointe vers le
besoin d’une meilleure intégration des
migrants dans les pays de destination et
interpelle, parmi les mesures à prendre,
l’encouragement de la double citoyenne-
té afin de protéger les droits des mi-
grants et de faciliter leur intégration
dans les pays de destination, tout en leur
permettant d’entretenir des liens avec
leur pays d’origine. Cette façon de faire
pourrait aussi favoriser le développe-
ment dans le pays d’origine de diverses
manières (en facilitant la mobilité trans-
frontalière de la main-d’œuvre et en
augmentant les transferts de fonds des
émigrés).
Charles M. DONGMO GUIMFAK,
Avocat, Doctorant,
Universités de Poitiers/
Catholique d’Afrique centrale (co-
tutelle)
Les migrations internationales et dé-
veloppement du Cameroun : Une
perspective du Co-développement
Selon le Rapport de l’Organisation In-
ternationale de la Migration (OIM) de
2009, la mobilité internationale est au-
jourd’hui reconnue comme facteur de
développement87
. Partant du postulat
selon lequel la diaspora se définie
comme « un état de dispersion d’un
peuple ou d’un groupe ethnique à tra-vers le monde »
88, le Cameroun compte
une forte représentation diasporique qui
ne cesse de croitre. Selon Jean Pierre
GUENGUANt, « […] le problème posé
réellement par les migrations interna-
87 Roger Charles EVINA, Migration au Cameroun profil national, OIM, 2009, p.85. 88 Glossaire OIM N˚9, 2007.
tionales […] pourrait bien être, non pas
celui de leur arrêt, mais celui de leur régulation»
89. En effet, exiger un arrêt
ou une réduction des migrations interna-
tionales dans le contexte actuel de la
mondialisation des échanges pourrait
être considéré comme paradoxal.
Quelles sont ainsi les stratégies à adop-
ter pour réguler les migrations interna-
tionales dans une optique de maximisa-
tion de leurs effets positifs90
et de mini-
misation de leurs effets négatifs91
tant au
Cameroun92
que dans les pays d’accueil
?
La grille d’analyse jugée adéquate pour
l’interprétation de données collectées
relève des Relations internationales. De
manière plus précise, il sera question
d’employer l’objectivisme qui permettra
d’énoncer les nécessités sociales et les
mesures adoptées pour les résoudre.
Selon Fanny Pigeaud, 20 000 infirmiers
africains et docteurs émigrent chaque
année vers les pays occidentaux. Il en
est de même dans le secteur éducatif,
chaque année 5000 jeunes diplômés
sortent de l’université plusieurs choisis-
sent de poursuivre leurs études à
l’étranger. La France est la destination
de premier choix de la majorité des
migrants camerounais, ces derniers
étaient estimés en 1999 à 32 541 per-
sonnes. En 2005, ils sont estimés à 45
000 personnes93
. En 2007, le nombre
d’émigrés camerounais était estimé à
170 363 de par le monde94
.
Tableau : Emigrants camerounais,
par pays de destination, 1995-2005 PAYS EFFECTIFS %
France 38 530 23
Gabon 30 216 18
Nigeria 16 890 10
Etats-Unis 12 835 8
Allemagne 9 252 5
Tchad 5 135 3
Centrafrique 5 103 3
Congo 4 312 3
Burkina Faso 3 513 2
Royaume-Uni 3 468 2
Autres 41 109 23
Total 170 363 100
Source: OIM, 2009.
89 Jean-Pierre GUENGANT, « Migrations internatio-nales et développement : Les nouveaux para-
digmes », in Revue européenne de migrations inter-
nationales, vol. 12, n°2, 10ème anniversaire, p. 107-121. doi : 10.3406/remi.1996.1069, p.108. 90 Accélération du processus de développement
socio-économique. 91 Durcissement des législations migratoires et recru-
descence des actes de xénophobie. 92 Pays de départ. 93 Voir l'Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques. 94 Fanny PIGEAUD, « Cameroun : les citadins précédent les ruraux », Défis du Sud n° 77 – Bimes-
triel – mai, 2007.
Ce tableau présente l’effectif important
de la diaspora camerounaise. Il est im-
portant de mentionner qu’il ne s’agit là
que de chiffre estimatif. Ce qui justifie-
rait la variation des effectifs selon les
sources.
Tableau : Etudiants camerounais
dans l’enseignement supérieur à
l’étranger, par pays, 2000- 2006 Pays 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
France 3 279
3 315 3 563 4 612 4 963 5 043 5 387
Allemagne 3 628
4 141 4 464 4 896 5 332 5 393 -
Italie 665
745 679 897 1 041 1 364 1 405
Etats-Unis 834
754 967 1 171 1216 1 425 168
Autres pays 1 224 1 302 1 640 1 787 1 153 1 870 1 540
Source: OIM, 2009.
Selon Yves Alexandre CHOUALA,
lorsque le nombre de la diaspora devient
de plus en plus considérable, elle consti-
tue une conjoncture favorable à
l’affirmation nationaliste au sein des
pays d’accueil. Cette affirmation natio-
naliste glisse parfois dans la xénophobie
qui à son tour a une incidence considé-
rable sur les relations internationales et
régionales.
La diaspora joue un rôle central dans les
politiques d’influence et de puissance
des Etats. A l’instar du Cameroun, ce
dernier jouit d’une espèce d’influence
structurelle sur ses voisins gabonais et
équato-guinéen, avec plus de 50 000
camerounais sur son sol maitrisant les
secteurs vitaux et sensibles comme le
marché des vivres, le transport urbain, le
secteur non formel, etc. Par ailleurs, le
renforcement de la « politique promo-
tionnelle de l’Etat camerounais »sur la
scène internationale et sous régionale
dans l’optique d’une amplification des
gains matériels et symboliques prove-
nant du phénomène migratoire ou dias-
porique.
Considérant la question migratoire in-
ternationale dans son nouveau contexte
qui est celui de vecteur de croissance
économique et source de développement
social, l’impact des activités écono-
miques de la diaspora est de plus en plus
important sur les conditions de vie des
populations camerounaises. Selon le
rapport de l’OIM de 2009, les transferts
de fonds des camerounais vers leur pays
d’origine ont considérablement aug-
menté depuis 2001. Ceci est visible par
la multiplication des compagnies finan-
cières spécialisées dans les transferts de
fonds au Cameroun. La retombée de ce
fait est la stimulation de l’activité éco-
nomique du pays par l’initiation des
projets et autres activités génératrice de
revenus, ce qui contribue à la lutte
contre la pauvreté et pour la création
d’emploi. Par ailleurs, l’envoi des fonds
réduit la perte de devises causée par les
Bulletin de l’APDHAC --- N°40 Janvier 2014 --- Diffusion gratuite --- [email protected] 19
déficits de la balance des paiements.
Selon Tousse JUTEAU, la somme men-
suelle transférée par un camerounais
résidant aux Etats-Unis d’Amérique au
pays, est évaluée en moyenne à 150
dollars américains soit 90 000 francs
CFA95
.Ces transactions sont dites plus
productives que l’aide publique au déve-
loppement qui n’atteint pas toujours les
populations cibles. Par contre, les trans-
ferts d’argent sont personnalisés et dans
la plupart des cas ont pour but la prise
en charge des frais médicaux, la scolari-
sation, au paiement des loyers ou l’achat
des biens de consommation.
Tableau 32 : Transferts de fonds des
Camerounais vivant à l’étranger,
2000-2007 (en millions dollars améri-
cains)
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
Envois
de
fonds
de
travail-
leurs
Rému-
néra-
tions
12 7 14
61
98 - -
- -
Sa-
laires
10 10 15 15 5 - - -
Trans-
ferts
mi-
grants
18 3 6 - - - - -
Total 40 20 35 76 10
3
77 13
0
16
7
16
7
Source: OIM, 2009.
Il est important de relever que ce tableau
rend compte uniquement des envois de
fonds enregistrés par les canaux offi-
ciels. Le volume réel de transfert si l’on
tient compte des envois non officiels est
certainement plus élevé. Selon la
Banque mondiale, le montant des envois
de la diaspora camerounaise était évalué
à 103 millions dollar américain en 2005,
soit 2,5% de l’aide publique au déve-
loppement. Aussi, les données de la
Banque mondiale indique que le mon-
tant des fonds transférés passe de 11
millions de dollars américain. en 2000, à
103 millions en 2004 et à 167 millions
en 2008, 0,8% du Produit Intérieur Brut
camerounais. C’est dans la prise en
compte de toutes ces données qu’un
nouveau concept fut élaboré par la
Communauté scientifique : le «Co-
développement ». Ce dernier consiste à
énoncer des mesures de facilitation pour
tout migrant96
désirant créer une activité
95 Tousse JUTEAU, « Diaspora, développement et
rayonnement international de l’Etat d’origine : cas de la diaspora camerounais aux Etats-Unis », Mémoire
de fin d’études, Institut des Relations internationales
du Cameroun, 2005. 96 Hommes d’affaire, universitaires, médecins,
ingénieurs, etc.
génératrice de revenus ou des projets
sociaux97
ou de faire profiter de leurs
compétences, connaissances et réseaux
de relation98
.
NZINO MUNONGO
Victorine Ghislaine
Chercheure - Researcher
MINRESI / CNE
Les conséquences des mouvements
migratoires (conséquences politiques,
économiques et socio- culturelles) en
période de conflits armés
Depuis la fin de la guerre froide, la vraie
menace pour le monde aujourd’hui n’est
plus le communisme. Des phénomènes
nouveaux ont émergé tels que le terro-
risme, la criminalité transfrontalière, la
piraterie maritime, les conflits armés.
Ceux-ci sont d’autant plus préoccupants
qu’ils ne sont plus seulement l’affaire
des Etats, mais aussi d’autres acteurs
(groupes d’individus, organisations
islamiques, organisations à caractères
politiques et économiques, multinatio-
nales). Il s’ensuit, curieusement que, le
monde n’a jamais retrouvé la paix et la
sécurité internationale, comme
l’espéraient certains auteurs après la
chute du mur de Berlin. Malgré les mul-
tiples efforts que fournissent les pou-
voirs publics nationaux en collaboration
avec les organisations internationales
(ONU), régionales (UA) et sous régio-
nale (CEDEAO), on assiste depuis plu-
sieurs années sur la scène mondiale à de
nombreux conflits armés dus à des
causes multiples avec entre autres les
contestations post électorales (RCA,
Egypte…), les différends frontaliers
(Cameroun-Nigéria), les modifications
de la constitution (Niger, Cameroun), la
violation des droits de l’homme (RCA,
Mali) et bien d’autres.
Un conflit armé peut opposer les forces
armées d’au moins deux Etats et on
parlera de conflit armé international par
opposition au conflit armé non interna-
tional qui oppose, sur le territoire d’un
même Etat, les forces armées régulières
à des groupes armés identifiables, ou
des groupes armés entre eux. Pour être
qualifiées de conflit armé non interna-
tional, les hostilités doivent atteindre un
certain degré d’intensité et se prolonger
97 Ecoles, dispensaires, etc. 98 Jérôme AUDRAN, « Gestion des flux migratoires : réflexions sur la politique française de Co-
développement », Annuaire suisse de politique de
développement [En ligne], vol. 27, n°2 | 2008, mis en ligne le 22 mars 2010, Consulté le 11 mars 2012.
URL : http://aspd.revues.org/187, p. 4.
un certain temps99
. La conséquence
immédiate des combats et du manque de
sécurité est le déplacement massif des
populations civiles vers les régions plus
calmes. Lorsqu'elles franchissent une ou
plusieurs frontières pour gagner un pays
d'accueil, ces populations en fuite pren-
nent le statut de « réfugiés »; si elles
demeurent dans leur pays d'origine, ces
populations seront alors qualifiées de
« personnes déplacées à l'intérieur de
leur propre pays »100
. Cette consé-
quence se décline aussi diversement et
se manifeste aussi bien sur le plan poli-
tique et socioculturel (I) que sur le plan
économique (II).
I. Incidences politiques et sociocultu-
relles du déplacement des populations
en période de conflits armés
Le déplacement massif des populations
vers d’autres régions a pour principale
cause la guerre. Ce déplacement en-
traine plusieurs conséquences. Dans un
premier temps, nous mettrons en lu-
mière les impacts de ce phénomène sur
le plan politique (A). Ensuite, nous pré-
senterons l’impact socioculturel d’un tel
phénomène (B).
A. Impacts politiques Les conflits armés occasionnent des
mouvements migratoires incontrôlés de
la population. Une forte population des
refugiés déplacés s’ajoutent à la popula-
tion autochtone créant ainsi un risque
énorme de désorganisation des Etats
voisins. La criminalité transfrontalière
en est l’une des conséquences majeures.
Elle implique que ces Etats redéfinissent
leurs politiques sécuritaires et prennent
des mesures d’accueilles qui s’imposent
en fonction de leurs moyens, des intérêts
et enjeux en présence et conformément à
leurs engagements internationaux.
A long terme, l’émigration à des consé-
quences sur la politique intérieure du
pays en crise, notamment la gestion post
conflit (réinstallation des populations,
organisations de nouvelles élections,
légitimité de l’équipe dirigeante).
Au-delà des incidences politiques, le
déplacement massif des populations
99 CICR, « Droit International Humanitaire ; réponses à vos questions », 2e éd., février 2004, p. 5. 100 Bob CHECHABO BALOKO, Impact
environnemental du déplacement des populations en situation de conflit armé : cas des réfugiés la
République Démocratique du Congo, mémoire
présenté en vu de l’obtention du Master pro (M2) en Droit International et Comparé de
l'Environnement 2007, Limoges / Faculté de Droit et
des Sciences économiques - Source : http://www.mémoireonline.com/08/09/2620,
(consulté en janvier 2014)
Bulletin de l’APDHAC --- N°40 Janvier 2014 --- Diffusion gratuite --- [email protected] 20
soulève d’importants et cruciaux enjeux
socioculturels.
B. Impacts socioculturels
Moins délibérés, mais toujours dévasta-
teurs, sont les effets des mouvements
migratoires sur le plan socioculturel.
Pendant les déplacements, l’on note de
pertes en vies humaines. C’est aussi le
lieu de violation flagrante des droits de
l’Homme (viol de femme, enlèvements,
prise d’otage…).
Par ailleurs, le déplacement des popula-
tions déclenche le processus de solidari-
té internationale. En période de conflits
armés, les organismes internationaux
(CICR, ONU etc.) se mobilisent en vue
d’apporter du soutien aux populations
en détresses. Ceci se matérialise généra-
lement à travers l’aide humanitaire ap-
portée aux victimes de guerres.
Bien que cette aide profite aux victimes,
elle pose néanmoins quelques défis
(impact environnemental, redistribution
de l’aide) qui sont de nature à ralentir
l’activité économique des pays concer-
nés.
II. Incidences économiques des mou-
vements migratoires en période de
conflits armés Il est important d’étudier la consistance
de ces conséquences dans le pays de
départ (A) et dans le pays d’accueil (B).
A. Dans le pays de départ Les principales conséquences de ces
phénomènes sont la fuite des cerveaux
et des investisseurs et le ralentissement
des activités économiques.
L’expression « fuite des cerveaux » a
été d’abord utilisée pour décrire
l’émigration des ingénieurs et des scien-
tifiques britanniques partis aux Etats
Unis dans les années 1960 puis a été
étendue au transfert de compétence
entre pays101
. Aujourd’hui elle est l’une
des conséquences des mouvements
migratoires en période de conflits armés
ayant une incidence grave sur
l’économie des pays en voie de déve-
loppement. Pendant les conflits armés,
une grande majorité de civils et plus
particulièrement des travailleurs quali-
fiés se déplace pour trouver refuge ail-
leurs et, si possible, y offrir leur savoir
faire. La fuite des cerveaux est un défi
majeur pour les pays en voie de déve-
loppement car elle entre en conflit avec
les objectifs de développement.
101 Cité par MIENDJEM (I.), Migration internationale des travailleurs, conférence, Université
de Dschang, mars 2011.
Ce phénomène pourrait également avoir
une incidence négative sur les mouve-
ments des capitaux et des investisse-
ments nationaux et étrangers. Les inves-
tisseurs et les entreprises tiennent
compte du climat politique, économique
et social du pays considéré pour décider
d’y investir ou non.
Tous ces phénomènes contribuent au
ralentissement de l’activité économique
du pays en crise entrainant des consé-
quences sur le pays d’accueil.
B. Dans le pays de destination
L’insécurité grandissante dans nos pays
et villes est la conséquence des mouve-
ments migratoires. Les pays riverains
aux pays en crises sont les plus atteints.
Ces pays sont victimes d’insécurité avec
la présence de nombreux sans papiers,
des prises d’otages, le phénomène de
coupeurs de route et de criminalité
transfrontalière (BOKO HARAM). Face
à une telle insécurité, ces pays se trou-
vent dans l’obligation de renforcer la
sécurité aux frontières par un surcroit de
déploiement sécuritaire. Pour prévenir
de tels besoins, certains Etats tel que le
Cameroun procède régulièrement aux
recrutements dans les forces armées et
de défenses, à l’achat et au renouvelle-
ment du matériel sécuritaire. Toute
chose qui vaut un coût considérable à
l’économie de ces pays (plus de dé-
penses militaires conduit à un délaisse-
ment ou un relâchement d’attention en
ce qui concerne d’autres secteurs tels
que la santé, l’éducation, la protection
de l’environnement).
Aussi, cette migration serait l’une des
causes de l’augmentation du taux de
chômage dans les pays de destination.
D’un coté certains estiment que,
l’augmentation de la main d’œuvre par
un apport des migrants qualifiés appor-
tera une baisse des salaires et une aug-
mentation du taux de chômage.
Par contre, d’autres soutiennent que, les
travailleurs migrants complètent les
travailleurs nationaux plus qu’ils ne les
remplacent. Il en résulte que les travail-
leurs migrants améliorent la perfor-
mance économique ; ils peuvent avoir
une incidence sur les salaires des travail-
leurs nationaux mais cette incidence est
faible102
.
Bien plus, la répartition des travailleurs
migrants par profession est pour
l’essentiel très différente de celle des
travailleurs nationaux. Ce qui prouvent
qu’ils ne sont pas en concurrence (les
102 Idem.
maliens qui fabriquent les marmites et
les ont appris aux camerounais, les
tchadiens qui eux, font le gardiennage)
mais en complémentarité.
Par ailleurs, les travailleurs migrants
provoqueraient une élévation du niveau
de consommation qui pourrait entrainer
un niveau d’augmentation de la main
d’œuvre et stimulerait la croissance
économique qui profiterait aux natio-
naux. En apportant leur capacité entre-
preneuriale, les migrants stimulent la
croissance économique dans les pays
d’accueils.
Les conséquences des mouvements
migratoires en période de conflits armés
nous permettent de dresser un portrait de
l’état de guerre qui n’est plus la bienve-
nue au 21e siècle. Les consciences inter-
nationales sont interpellées en vue trou-
ver des voies et moyens pour résoudre et
mettre fin à une telle barbarie.
TCHUENKAM KUISSI Sandrine
Doctorante à l’APDHAC
Actualités de l’APDHAC
Pour sortir de la pseudo fatalité afri-
caine liée au problème migratoire et des
droits de l’homme dans les conflits ar-
més, cette rubrique consacrée à
l’actualité de l’APDHAC vous pré-
sente l’Ecole doctorale régionale Droits
de l’Homme et Droit humanitaire et ses
axes de recherche prioritaires. Ensuite,
sont explicitées les conditions d’entrée
au Master droits de l’homme et action
humanitaire, également possible sous
réserve d’une formation initiale en
droits de l’homme (certificats, sessions,
etc.) et/ou d’une expérience profession-
nelle dans les domaines de la justice, des
droits de l’homme ou de l’action huma-
nitaire. Par ailleurs, le programme de
formation continue, communément
appelé « Certificats et diplômes
d’Université », vise en amont à réaliser
les idéaux de paix et de justice, et à
préparer à différentes carrières, par la
simplification des conditions d’accès, la
richesse et la diversité des modules de
formation. L’APDHAC organise égale-
ment d’autres formations, des manifes-
tations scientifiques, des séminaires, des
conférences, des ateliers… qui tous
promeuvent l'excellence dans la re-
cherche et maintiennent des pro-
grammes d'enseignement de qualité ; à
travers les valeurs d’humanité, d’égalité,
de progrès et de solidarité.
Bulletin de l’APDHAC --- N°40 Janvier 2014 --- Diffusion gratuite --- [email protected] 21
Doctorat Droits de l’Homme et Droit
Humanitaire
Depuis quelques années, il est possible
pour les titulaires du Master particuliè-
rement méritants de s’inscrire en Docto-
rat « Droits de l’homme et droit humani-
taire » à l’APDHAC/UCAC.
L’école doctorale régionale anime 28
groupes thématiques de recherche re-
groupés dans les 4 parcours spécialisés
du Doctorat. Le doctorant doit s’inscrire
dans un groupe en fonction de son sujet
de thèse :
1. Droit international des droits de
l’homme (Effectivité des conventions
internationales relatives aux droits de
l’homme ; réfugiés, populations dépla-
cées et migrants ; minorités et popula-
tions autochtones ; victimes, responsabi-
lités et réparations ; Démocratie, Etat de
droit, élections, gouvernance et lutte
anti-corruption ; Discriminations, inéga-
lités et violence ; Indépendance de la
justice, accès à la justice, procès équi-
table, délai raisonnable et droits de la
défense, etc.).
2. Droit international de
l’environnement (Effectivité des con-
ventions internationales relatives à
l’environnement ; responsabilité sociale
de l’entreprise ; développement du-
rable ; forêts du Bassin du Congo, codi-
fications, régulations, évaluations et
certifications environnementales ; bio-
diversité et aires protégées ; mondialisa-
tion et changements climatiques, etc.).
3. Droit international humanitaire (Effectivité des conventions internatio-
nales humanitaires, mouvements de la
Croix-Rouge et du Croissant-rouge en
Afrique ; intégration du droit internatio-
nal humanitaire dans les législations
nationales ; sociétés militaires privées et
droit international humanitaire ; sécurité
humaine et droit humanitaire ; droit
international humanitaire et opérations
de paix ; action humanitaire et recons-
truction, etc.).
4. Droit international pénal (Effectivi-
té du droit international pénal ; intégra-
tion des crimes internationaux dans les
législations pénales ; coopération entre
les juridictions internationales et les
Etats africains ; responsabilité pénale
internationale ; victimes et réparations
des crimes internationaux ; procès pénal
international ; droits de la défense et
preuves dans le procès pénal internatio-nal, etc.
L’école doctorale régionale entend no-
tamment revaloriser l’activité scienti-
fique au sein des universités d’Afrique
centrale dans les domaines des droits
de l’homme et du droit humanitaire, et
encourager la mobilité académique et
les réseaux thématiques structurés sur
les ateliers doctoraux. Il est prévu
l’organisation de trois ateliers :
- Les ateliers de recherche ont pour
objectif d’initier les doctorants à la re-
cherche scientifique. Le but est
d’accompagner le doctorant à publier au
moins un article scientifique par an
durant sa formation doctorale. Il s’agit
également d’encourager les doctorants à
participer aux manifestations scienti-
fiques.
- Les ateliers méthodologiques ont
pour objectif d’accompagner les docto-
rants dans la réalisation de leurs thèses.
Le but est de guider le doctorant dans
les procédures scientifiques du docto-
rat à savoir : l'admission définitive, la
confirmation, la soutenance privée et la
soutenance publique. Il s’agit également
d’initier les doctorants à différents outils
et techniques de recherche, et
d’encourager l’usage de l’anglais.
- Les ateliers de professionnalisation permettent aux doctorants, dès leur pre-
mière année de thèse, de rencontrer des
professionnels. Ces ateliers ont pour
objectifs de donner les outils nécessaires
à l’obtention d’un stage doctoral ou d’un
emploi, dans la sous-région et ailleurs. Il
s’agit de valoriser les compétences en
mettant en forme et en mots les expé-
riences vécues.
Des séminaires doctoraux proposés par
le directeur du doctorat comportant,
outre les situations d’ateliers ci-dessus,
la discussion d’apports de chercheurs
confirmés ayant travaillé dans des do-
maines proches des préoccupations des
membres du séminaire. Les séminaires
doctoraux comprennent des séminaires
fondamentaux, complémentaires et op-
tionnels.
Le programme de doctorat est réalisé
dans le cadre d’un contrat de recherche
pluriannuel (36 mois) qui implique,
outre le doctorant et l’Université catho-
lique d’Afrique centrale, les autres par-
tenaires intéressés par les résultats de la
recherche et la valorisation des produits
scientifiques. Il appartient à chaque
candidat de trouver, au besoin avec
l’appui du centre de recherche, les par-
tenaires techniques, opérationnels et
financiers pour l’exécution de son con-
trat de recherche. C’est l’une des condi-
tions d’admission au programme.
L’école doctorale a connu depuis lors,
son tout premier docteur, en la personne
de M. JEUGUE DOUNGUE Martial,
dans le sillage d’une thèse de Doctorat
en co-tutelle internationale, soutenue le
29 mai 2013 à l’Université de Nantes en
France. Il est l’actuel secrétaire acadé-
mique de l’APDHAC et enseignant-
chercheur aux Universités de Nantes et
Catholique d’Afrique centrale (AP-
DHAC). Autant dire que la perspective
d’un doctorat à l’APDHAC/UCAC est
bien effective et que l’Ecole doctorale
régionale entend relever de nombreux
autres défis.
Dr. JEUGUE DOUNGUE Martial
Master Droits de l’homme et action
humanitaire
En Master droits de l’homme et action
humanitaire (MDHAH), les cours, pour
le compte de l’année académique 2013-
2014, ont repris depuis le 01 octobre
2013 et les étudiants viennent
d’horizons différents : Cameroun,
Tchad, Centrafrique, Congo, Gabon,
etc.). Les étudiants inscrits pour suivre
cette formation sont au nombre de 88
répartis ainsi qu’il suit :
Master
1
Master
2
Total
Présence 39 30 69
Distance 6 13 19
Total 45 43 88
Les nouveaux étudiants inscrits en Mas-
ter 1 ont eu jusqu’au 15 novembre 2013
pour opérer un choix d’un sujet de mé-
moire. Une fois ce choix opéré et validé
par le Secrétaire académique, il leur
revient alors de préparer un avant-projet
de mémoire à soumettre avant leur dé-
part pour les congés de noël. Celui-ci a
fait l’objet d’une pré-soutenance du 06
au 10 janvier 2014. Quant aux étudiants
du Master 2, c’est désormais la dernière
ligne droite. Ceux-ci ont également leur
projet de mémoire avant leur départ
pour les congés de noël. Le mois de mai
est celui prévu pour le dépôt des mé-
moires qui feront l’objet d’une soute-
nance en juin 2014. Passé ce délai, les
retardataires seront renvoyés à la session
de décembre de la même année.
MANGWA TAYOU Mireille
Doctorante à l’UCAC/APDHAC
Assistante administrative et chargée
des programmes à l’APDHAC
Bulletin de l’APDHAC --- N°40 Janvier 2014 --- Diffusion gratuite --- [email protected] 22
Profil du diplôme de Master Droits de l’homme et action
humanitaire Que peut-on faire avec les droits de
l’homme à la sortie de l’Université ? A
quoi cela sert-il ? Quel service profes-sionnel peut rendre un master en
droits de l’homme ? Rien de tel pour
démontrer l’utilité d’un service que de
faire apparaître qu’il est l’objet d’une
demande dans la société. On ne peut
souhaiter, sans doute, une demande
dense et mesurable comme pour la
médecine ou l’informatique ; mais, il
s’exerce sur les droits de l’homme et
l’action humanitaire une attractivité
professionnelle toute différente et plus
tangible.
La demande vient d’abord du milieu
des organisations internationales et
régionales qui font des droits de
l’homme, de l’action humanitaire, de la
démocratie et du développement du-
rable non seulement la base de leurs
programmes de coopération technique.
La diplomatie des droits de l’homme
est dans une dynamique de développe-
ment constant qui attire et emploie de
nombreuses ressources humaines. De
même, les juridictions internationales ont un besoin croissant d’une expertise
de haut niveau pour assurer la répres-
sion des crimes internationaux. Ensuite,
les Etats ont besoin d’un personnel
qualifié et spécialisé pour respecter
leurs engagements internationaux et
constitutionnels. Enfin, d’une part les
organisations de la société civile et les
victimes des violations des droits de
l’homme ont besoin des matériaux
explicatifs pour mieux porter leurs
causes devant les tribunaux ou devant
l’opinion publique internationale. Et,
d’autre part, les entreprises et autres
acteurs économiques entendent
s’inscrire aujourd’hui dans le cadre
d’une dynamique de responsabilité
sociale et humaniste.
Ainsi, le secteur professionnel des
droits de l’homme et de l’action huma-
nitaire est donc vaste, transversal et
dynamique.
Le Master droits de l’homme et action
humanitaire est ouvert aux candidats
titulaires d’un diplôme BAC + 3 dans
les domaines du Droit, de la Science
Politique et des Sciences Sociales. A
titre exceptionnel, certains candidats peuvent être admis sur la base d’un titre
équivalent dans certains domaines des
sciences humaines, sous réserve d’une
formation initiale en droits de l’homme
(certificats, sessions, etc.) et/ou d’une
expérience professionnelle dans les
domaines de la justice, des droits de
l’homme ou de l’action humanitaire.
Dans tous les cas, le jury d’admission
évalue chaque candidature au regard du
dossier fourni et des résultats d’un
entretien sur convocation. Le Master
est structuré en quatre semestres consé-
cutifs comprenant chacun 30 crédits. La
formation présentielle se déroule selon
le même calendrier que la formation à
distance et selon les mêmes règles
d’évaluation.
Les enseignements sont organisés en
unités d’enseignement. Une unité
d’enseignement (UE) est constituée par
un regroupement de matières. Chaque
matière peut comprendre un cours ma-
gistral (CM), des travaux pratiques
(TPR) ou des travaux personnels
(TPE). Chaque semestre se termine par
une session d’examens. Sur la base des
notes des travaux (50 %) et des exa-
mens (50%), l’étudiant qui obtient une
moyenne égale ou supérieure à 12/20
dans une unité d’enseignement obtient
les crédits de l’UE. Les matières où la
moyenne est inférieure à 12/20 font
l’objet d’un examen de rattrapage. Pour
s’inscrire dans les matières des se-
mestres 3 et 4, l’étudiant doit valider
les 60 crédits des semestres 1 et 2.
Les évaluations des trois premiers se-
mestres comprennent des travaux pra-
tiques (analyse des dossiers, études de
cas, commentaires de textes et d’arrêts,
etc.), des travaux personnels (notes de
synthèse, colloques et séminaires, lec-
tures conseillées, etc.) et des examens
oraux ou écrits de fin de semestre.
Après la validation des trois premiers
semestres, la formation se termine au
quatrième semestre par : a) La rédac-
tion d’un rapport à l’issue d’un stage de
professionnalisation ; b) Le grand oral
devant un jury sur une spécialisation
choisie ; c) La soutenance d’un mé-
moire de recherche. L’APDHAC dis-
pose d’une bibliothèque spécialisée en
droits de l’homme et action humani-
taire.
Professeur BOUKONGOU Jean Didier
Directeur du Master
PROCÉDURE D’INSCRIPTION : Dossier à consti-tuer et à déposer avant le 5 juillet au secrétariat de l’APDHAC (Campus d’Ekounou) : Lettre de motivation (présentant éventuel-lement son expérience professionnelle), CV, copie d’acte de naissance ou autre acte officiel justifiant l’état civil du candi-dat, copie de chaque diplôme depuis le Baccalauréat, Relevés de notes, 2 photos d’identité, certificat médical. Frais d’examen du dossier : 15 000 FCFA Frais de scolarité : 1 300 000 FCFA + Frais de documentation et logiciels : 200 000 FCFA (Facultatif) + Frais d’assurance : 27 500 FCFA Héber-gement campus : 32 500 FCFA/mois
(places limitées)
Certificat droits de l’homme et action
humanitaire
Certificat 2013-2014
Dans le but de promouvoir la culture des
droits de l’homme, de la démocratie, de la
bonne gouvernance en Afrique, il est ou-
vert chaque année à APDHAC/UCAC,
depuis 1997, une ou plusieurs sessions de
formation d’auditeurs libres en droits de
l’homme et action humanitaire. Chaque
session dure environ trois mois et se ter-
mine par la délivrance aux auditeurs méri-
tants d’un « Certificat en droits de
l’homme et action humanitaire ».
Le public visé par cette formation est
large. La formation vise notamment les
membres du corps des forces armées et
police, les membres d’associations de
défense des droits de l’homme ou ceux
menant des activités dans les domaines
ayant un impact sur l’amélioration des
conditions de vie des populations, et toute
autre personne désireuse d’acquérir une
culture des droits de l’homme.
Cette année académique 2013-2014 dix
certificats ont été lancés (Expertise en
droits de l’homme ; Expertise anti corrup-
tion ; Expertise en démocratie et élec-
tions ; Expertise en gouvernance et biens
publics ; Expertise paix et sécurité ; Ex-
pertise en Genre ; Expertise en protection
des réfugiés et migrants ; Ingénierie de
l’action humanitaire ; Ingénierie du déve-
loppement durable ; Ingénierie de la RSE),
le certificat débutera le 20 février 2014. Le
programme du certificat a été structuré en
trois (03) modules pour chaque certificat,
pour permettre aux auditeurs d’aborder
toutes les questions actuelles sur les droits
de l’homme, de manière pratique et théo-
rique. Le module 3 est commun à tous les
certificats et est structuré tel qu’il suit Emplois et applications
Bulletin de l’APDHAC --- N°40 Janvier 2014 --- Diffusion gratuite --- [email protected] 23
Documentation et bases de don-
nées
Lobbying, leadership, Networ-
king & fundraising
Les personnes intéressées par la forma-
tion, peuvent passer déposer leur dossier
au Secrétariat de l’APDHAC à
l’Université Catholique d’Afrique Cen-
trale, campus d’EKOUNOU, sur la base
des informations ci-dessous.
Conditions d’accès
Les candidats doivent être titulaires d’un
diplôme de niveau BAC +2 ou Licence.
Les candidats n’ayant pas le diplôme
requis, mais qui peuvent justifier d’une
expérience professionnelle, peuvent être
admis à l’issue d’un test de niveau. Le
dossier de candidature est à déposer au
Secrétariat de l’APDHAC (Campus
d’EKOUNOU). Il devra comprendre :
· Un C.V + 1 demande manuscrite
· 2 photos + 1 photocopie du diplôme
· 1 copie d’acte de naissance (ou photo-
copie légalisée de la CNI, passeport,
carte de séjour)
· 10.000 FCFA de frais de dossier
4. Frais de scolarité
Le coût de la formation est de 200 000
FCFA pour chaque Certificat. Après ac-
ceptation écrite de la candidature par le
Directeur de l’APDHAC, le postulant
devra confirmer sa place par le règlement
des frais (200 000 FCFA). L’entrée en
salle n’est autorisée qu’après paiement des
frais.
BATA Pierre Thibaut
Assistant Administratif et scientifique
Coordonateur du certificat
Autres informations à l’APDHAC
Manifestations scientifiques de
l’APDHAC : Ateliers diplomatiques et
Conférences
Dans le cadre des manifestations scienti-
fiques, il est prévu l’organisation de Con-
férences publiques « EX CATHEDRA » et
des ateliers diplomatiques tout au long de
l’année académique 2013-2014. En corré-
lation avec les différentes formations de
l’APDHAC. Ces conférences publiques et
ateliers d’intégration professionnelle ont
pour objectif de permettre aux étudiants
d’approfondir leur connaissance sur les
problématiques que soulèvent les droits de
l’homme.
C’est dans cette optique que tous les
jeudis du 10 octobre 2013 au 16 janvier
2014, dix conférences ont été organisées
avec les thèmes suivants : Enjeux et défis
de la transparence des affaires publiques
en Afrique ; Sécurité humaine et respon-
sabilité de protéger : expériences récentes
(Lybie, Mali, RDC, RCA, Syrie, etc.) et
perspectives juridiques ; ‘Institutions
fortes’ et séparation des pouvoirs en
Afrique : éléments pour la consolidation
de l’Etat de droit et la protection des droits
de l’homme ; Les défis de la démocratie et
de la paix en Afrique de 2013 à 2016 :
approches comparées des dynamiques
électorales et de la stabilité des pays de la
CEMAC ; L’effectivité du « droit du dé-
veloppement durable » ; Le droit et la
pratique de l’ingérence humanitaire à la
lumière des crises arabes et africaines du
XXIème siècle ; Le juge international et la
protection des droits de l’homme en
Afrique ; Les enjeux et défis de
l’architecture panafricaine de paix et de
sécurité ; Management et droits de
l’homme ; Le responsable des projets
droits de l’homme face à l’Auditeur finan-
cier : normes, contraintes, enjeux et défis
pour un management efficace ; Normes et
pratiques de la RSE en Afrique centrale :
approches comparées des entreprises dans
la CEMAC ; L’Afrique face au change-
ment climatique : impacts, projets et pers-
pectives.
En plus des Conférences publiques, des
ateliers professionnels ont eu lieu. Les
ateliers diplomatiques se présentent sous
la forme d’un exposé magistral par le
Représentant résidant ou Chef de mission
d’une institution ou ONG internationale
basé au Cameroun. Ces ateliers visent
comme objectifs à : permettre aux diffé-
rents auditeurs de l’APDHAC d’acquérir
des connaissances sur le fonctionnement
des institutions et ONG internationales
œuvrant dans le secteur des droits de
l’homme et de l’action humanitaire en
Afrique, édifier les étudiants sur des ques-
tions d’actualité ayant un rapport étroit
avec ces institutions et ONG internatio-
nales, susciter davantage l’adhésion des
étudiants aux valeurs défendues par ces
institutions et ONG internationales et
établir un partenariat avec ces institutions
et ONG internationales. Pour le compte de
cette année académique, nous avons été
honorés de la présence de plusieurs repré-
sentants d’ONG, et de la fonction pu-
blique. A l’instar de Transparency Interna-
tional, HCR, IUCN, la direction de la
protection civile, AES SONEL, MINADT,
etc. Au delà des échanges, les différents
intervenants ont laissé à la portée des
étudiants une documentation importante
pour leur cursus. Au terme de toutes les
interventions, un rendez-vous a été pris
pour l’organisation d’une journée porte
ouverte de l’APDHAC ou toutes ces orga-
nisations viendront exposer leur savoir
faire, et donner la possibilité aux étudiants
et chercheurs d’emploi de déposer leur
CV. BATA Pierre Thibaut
Assistant Administratif et scientifique
Coordonateur du certificat
Bibliothèque
L’APDHAC est un centre de recherche qui
traite des problématiques liées aux droits de
l’homme et à l’action humanitaire. A cet
effet, il est doté d’une bibliothèque. Cette
dernière constitue le « Laboratoire » du
centre. En quête de connaissances approfon-
dies sur des questions de droits de l’homme,
les étudiants, enseignants et chercheurs
viennent régulièrement consulter la docu-
mentation disponible. Pour le compte de
l’année académique 2014-2015, les maisons
d’édition que sont l’Harmattan, Bruylant,
Oxford, les Presses de l’UCAC, etc. seront
contactées, et des centaines d’ouvrages
seront commandés pour compléter la docu-
mentation existante. Cette importante com-
mande répondra à n’en point douter aux
attentes de tous. Ceci est d’autant plus cer-
tain que les ouvrages commandés traitent
non seulement des questions de droit inter-
national public, de droit de l’environnement,
de droit humanitaire, de droits de l’homme
mais également de sociologie et de philoso-
phie. Le souci est donc de répondre à la
pluridisciplinarité qui caractérise une forma-
tion en droits de l’homme. De grands pla-
cards vitrés permettent d’assurer une meil-
leure protection et conservation desdits
ouvrages. Ils accueilleront les ouvrages en
provenance des différentes maisons
d’édition et librairies à solliciter. Outre la
recherche documentaire, la recherche sur
internet est également possible dans la bi-
bliothèque de l’APDHAC. Les usagers de
cette dernière disposent également d’une
connexion au réseau internet sans fil. Les
enseignements se font à l’aide d’un rétro-
projecteur suivant la présentation Power-
Point. L’APDHAC s’arrime ainsi à tous les
profils et tend à cultiver son image presti-
gieuse de pôle d’excellence régional en
matière de droits de l’homme et action hu-
manitaire, tout en s’adaptant à la modernité,
peut-on dire à la modernisation.
Dr. JEUGUE DOUNGUE Martial
Directeur de publication :
Pr. Jean Didier BOUKONGOU
Comité scientifique
Pr. Jean Didier BOUKONGOU
Pr. Bernard-Raymond GUIMDO
Pr. Marie-Thérèse MENGUE
Dr. Martial JEUGUE DOUNGUE
M. Parfait OUMBA
Secrétariat de rédaction
Dr. Martial JEUGUE DOUNGUE
M. Parfait OUMBA
M. Carlos MUKAM
APDHAC B.P. 11628
Université catholique d’Afrique centrale
http://www.apdhac.org