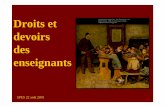L L La a a S SO OM MM MA AI IR RE E INTRODUCTION L'universalité des Droits de l'Homme, à quelles...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
7 -
download
0
Transcript of L L La a a S SO OM MM MA AI IR RE E INTRODUCTION L'universalité des Droits de l'Homme, à quelles...
LLLaaa qqquuueeessstttiiiooonnn dddeee lll’’’eeexxxccciiisssiiiooonnn
RRReeennnééé SSSOOOBBBRRRÉÉÉRRROOO
1
SSOOMMMMAAIIRREE
INTRODUCTION
L’universalité des Droits de l’Homme, à quelles conditions ?
PREMIÈRE PARTIE
La mutilation des organes génitaux, rite plusieurs fois millénaire
1.- HISTOIRE DES MUTILATIONS SEXUELLES
2.- L’EXCISION ET SES CONSÉQUENCES
2.1.- Ce qu’est l’excision
2.2.- Les conséquences médicales de l’excision
2.3.- Les conséquences psychologiques de l’excision
3.- LES POINTS DE VUE SUR L’EXCISION
3.1.- Les tentatives scientifiques d’explication
3.2.- La position de l’église catholique
3.3.- Les préjugés socioculturels et médicaux de ceux qui pratiquent l’excision
3.4.- Les positions et l’action de l’Organisation des Nations Unies
4.- QUELQUES QUESTIONS D’ÉTHIQUE
SECONDE PARTIE
Excision et intégration dans les pays d’Afrique concernés
1.- Le Sénégal
2.- La Mauritanie
3.- La Côte d’Ivoire
4.- Le Mali
5.- Le Burkina Faso
6.- L’Égypte
7.- La Guinée
TROISIÈME PARTIE
Droit et philosophie : Les questions posées en France
1.- LA QUALIFICATION APPLICABLE EN DROIT FRANÇAIS
1.1.- Torture, acte de barbarie ?
1.2.- Acte criminel « ordinaire » ?
2.- EFFICACITÉ DE LA PRÉVENTION PAR LA SANCTION
3.- PRÉVENTION PAR L’INFORMATION ET L’ÉDUCATION SOCIALE
CONCLUSION
La lutte contre l’excision des femmes, au nom des Droits de l’Homme,
pour quelle intégration dans la société ?
ANNEXES
Annexe 1 : L’excision, un témoignage
Annexe 2 : Exemples de législations africaines
Annexe 3 : Bibliographie
2
IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN
« Les Droits de l’Homme sont universels, car ils relèvent de l’Éthique ». Fran-
çois Mitterrand, lors d’un discours à Orléans pour les fêtes de Jeanne d’Arc en
1989, n’eut pas de contradicteurs parmi les éditorialistes du lendemain. Son
affirmation allait de soi. Mais pour peu que l’on approfondisse le sens des
mots, des questions complémentaires viennent à l’esprit, qui nous obligent à
remettre en cause nos certitudes.
Éthique vient du grec êthicon, de êthos, la manière d’être. Le lexicographe po-
sitiviste Émile Littré, dans son Dictionnaire de la Langue Française 1, la définit
comme « la science de la morale », celle-ci étant « l’ensemble des règles qui
doivent diriger l’activité libre de l’homme ». Doivent ? Au nom de Qui, ou de
Quoi ? A chacun de choisir, sans doute, selon qu’il croie en Dieu ou pas… Acti-
vité libre ? Liberté de pensée, notamment…
L’ami de ce dernier, Pierre Larousse, dans le Grand Dictionnaire Universel du
XIXè siècle 2, est plus explicite. Il est vrai que cet encyclopédiste aimait « ex-
pliquer les mots pour mieux parler des choses ». Selon lui, la morale est
« l’ensemble des règles de conduite considérées comme impératives dans une
société donnée et souvent érigées en doctrine 3 ». Voilà qui est parfaitement
clair et replace la Morale et l’Éthique dans la temporalité 4 de chaque civilisa-
tion.
Les Droits de l’Être Humain relèvent bien de l’Éthique, mais, comme elle, ils
sont inséparables de la société dans laquelle ils ont émergés et de l’époque de
leur formulation. Ils ne pourront donc être considérés comme universels, n’en
déplaise à François Mitterrand, que si l’ensemble des peuples de la terre les
perçoit un jour comme tels et les adopte librement.
1 Qu’il rédigea de 1863 à 1873.
2 Publié entre 1866 et 1876.
3 « Ensemble des dogmes, soir religieux, soit philosophiques, qui dirigent un homme dans l’interprétation des
faits et dans la direction de sa conduite », Émile Littré, op. cit. « Ensemble des croyances ou des opinions professées par une religion, une philosophie ou un système poli-tique », Pierre Hachette, op. cit. 4 Lire à ce sujet les écrits philosophiques de Martin Heidegger, et notamment L’Étre et le Temps (1927) qui le
rendit célèbre. Il entreprend de réveiller, en pleine modernité, l’intérêt pour l’antique question de la compré-hension de l’être. Il décrit et analyse « le mode d’être » de l’homme comme celui de « l’existentialité tempo-relle » dont le propre est de « se rapporter au monde, à soi-même, à autrui, à la vérité, à sa propre historicité et finitude ».
3
Si d’autre cultures les vivent comme une doctrine que les occidentaux vou-
draient leur imposer, il sera probablement difficile de les faire accepter par
tous. Pour parvenir à construire une morale universelle, faudra-t-il donner rai-
son à Nietzsche qui affirme, provocateur, que « le christianisme, en tant que
Morale, doit aller à sa ruine » 5 ?
La question des mutilations sexuelles, plus que toute autre pratique culturelle
ou religieuse, semble être un sujet d’affrontement entre les cultures, les mo-
rales, les religions. Dans une première partie, nous tenterons d’identifier
l’origine de ces pratiques, les justifications qu’on en donne et les prises de po-
sition des organisations internationales. Puis nous aborderons la question sous
l’angle de la question de société posée aux pays africains concenés. On verra
comment l’intégration des femmes dans la société, dans une volonté de plus
en plus forte de leur accorder respect et droits égaux, est en train d’évoluer en
grande partie grâce au débat sur l’excision.
Il faut en effet rappeler que ces deux dimensions majeures de la réalité hu-
maine, le sexuel et le social, s’imbriquent totalement. En effet, toutes les so-
ciétés connues procèdent selon des structures identiques (prohibition de
l’inceste, mariage, éducation, tabous) mais en déployant une somme illimitée
de modalités afin de réguler la sexualité. Réciproquement, la sexualité dé-
borde toujours, par quelques dérives, les voies institutionnelles.
Les légalités de toute espèce s’emparent du sexuel comme d’un excès (légalité
religieuse, morale juridique). Mais l’excès social est contraint, à son tour, de
se régler sur une sorte de légalité « naturelle » irréductible de la sexualité des
aspects typiques de la condition humaine.
Au commencement de la société humaine était le renoncement à l’instinct, à la
sexualité. Cette hypothèse sous-tend presque toutes les interprétations données,
au long des siècles, de l’origine de la culture. Ainsi, la sexualité est plus ou moins
cachée, mais surtout, elle doit être conforme à l’institution ; elle est donc traitée,
modelée à l’aide de pratiques éducatives qui existent dans toutes les sociétés.
La sexualité est l’intégration primordiale du corps, du signe et de l’image, en
quoi consiste le corps propre.
5 Dans Généalogie de la Morale (1887) où il reprend, sur un mode polémique, le thème philosophique qu’il
avait développé dans Zarathoustra, celui du « surhomme » (le génie empli de certitudes) condamné à la ruine pour son rapprochement avec l’humanité (en perpétuel questionnement sur son devenir).
4
Et les complexes de castration et d’Œdipe, qui forment les péripéties ma-
jeures, déterminent l’essentiel de la destinée humaine puisque, par-delà la fa-
bulation d’un organe menacé et d’une rivalité triangulaire de l’enfant, de la
mère et du père, l’individu y accepte de se situer autant dans des signes que
dans des réactions organiques, dans la loi que dans la pulsion, dans le langage
que dans l’image.
Blesser, répandre son sang est un geste universel et immémorial. Mais de
toutes les altérations corporelles intentionnelles qui ont traversé le cours de
l’histoire, seules les mutilations sexuelles conservent une place active impor-
tante, dans la psychologie collective sinon dans le droit pénal. Comme toutes
les autres, la mutilation est fondamentalement ambivalente : désorganisatrice
et maléfique lorsqu’elle est subie, elle peut devenir réorganisatrice et béné-
fique lorsqu’elle est acceptée, intentionnelle individuellement ou collective-
ment. Source de vie et de mort selon les religions, elle se répercute sous la
forme de rituels qui apparaissent comme les échos des castrations primor-
diales. Quelle est la signification profonde des mutilations sexuelles, leur sens,
leur valeur et leur portée ? Il convient de poser le problème avant d’envisager
les solutions en droit positif.
Nous verrons donc les efforts faits par les pays africains concernés pour que la
loi anticipe, accompagne ou suive les évolutions de la société et facilite ainsi
l’intégration des femmes.
Enfin, nous nous pencherons sur le droit français. Car les possibilités
d’intégration des femmes - excisées ou non - dans la société qui les a vues
naître ou celle dans laquelle elles tentent de vivre lorsqu’elles ont fait le choix
d’émigrer, sont étroitement liées, en premier lieu, à l’état du droit, avant de
relever – noble défi s’il en est - de l’éducation.
5
PPRREEMMIIÈÈRREE PPAARRTTIIEE
LLaa mmuuttiillaattiioonn ddeess oorrggaanneess ggéénniittaauuxx
rriittee pplluussiieeuurrss ffooiiss mmiilllléénnaaiirree
11..-- HHIISSTTOOIIRREE DDEESS MMUUTTIILLAATTIIOONNSS SSEEXXUUEELLLLEESS
La mutilation de l’appareil génital est un rite qui serait né en Afrique centrale
et subsaharienne, le long des vallées des grands fleuves que sont le Congo ou
le Niger, où on l’infligeait aux garçons pubères à la fin de l’initiation. L’initié est
informé des secrets de la tribu, mis à l’épreuve, molesté, mutilé puis « ressus-
cité » après une mort symbolique. Le même mécanisme vaut pour les filles, à
ceci près qu’après avoir été amputées de leur clitoris, elles sont réduites à
l’état d’objets sexuels et de procréatrices.
Ce rite se serait étendu vers le nord, suivant les sources et la basse vallée du
Nil. Les égyptiens étaient en contact avec les nubiens, qui fournissaient des
esclaves vigoureux au gland toujours découvert. Cet aspect de leur phallus
impressionna surtout le clergé qui détenait le véritable pouvoir en Égypte an-
cienne. Férus de rites magiques, les prêtres d’Amon-Râ ont été séduits par ce
symbole initiatique. Ils se circoncirent les premiers, puis imposèrent cette pra-
tique aux pharaons, après la Vème dynastie (vers –2560).
L’hébreu Abraham, introduit auprès des nobles du palais lors de son voyage en
Egypte aux environs de –1700, fut lui aussi impressionné par ce qu’il prit pour
un signe de distinction, de pouvoir cautionné par la divinité. C’est sur l’ordre
express de Yahvé – dit-il – qu’il se fit circoncire et exigea la circoncision de
tous les enfants mâles au 8ème jour, en signe d’alliance avec Dieu. Moïse en fit
une obligation absolue, sous peine de se voir exclure du peuple de Dieu.
Le christianisme naissant reprit à son compte la circoncision. Mais la pratique
répugnait souverainement aux grecs et surtout aux romains. Par une habile
métaphore, Saint Paul fit beaucoup pour la propagation de sa religion en dé-
clarant inutile la circoncision selon la chair.
Il valait mieux circoncire son cœur, c’est à dire endurer toutes les privations
sexuelles dont le christianisme a fait l’essentiel de sa vie vertueuse.
6
Reprenant les thèses de la religion d’Abraham, Mahomet trouva que la circon-
cision allait de soi. En ce qui concerne l’excision des filles, le Coran n’en parle
pas, mais selon un haddith de la Sunna (le haddith de Ahmad, rapporté par
Bayhagi), le prophète aurait dit : « la circoncision est une obligation pour
l’homme et un acte honorifique pour la femme ». L’excision serait donc licite,
sans être obligatoire. C’est une makruma, une pratique religieuse, cependant
inconnue au Maghreb.
Les pionniers chrétiens qui colonisèrent le nouveau monde firent subir à leurs
descendants la sainte opération de la circoncision de façon quasi systéma-
tique, pour des raisons de morale et d’hygiène. En occident, dans la première
partie du siècle, les médecins avaient parfois recours à l’ablation du clitoris
comme remède pour les femmes hypocondriaques.
En France, les pro-circoncision tirent encore aujourd’hui argument du fait que
le prépuce serait un résidu parasite de la féminité sur le corps masculin,
comme le clitoris serait un organe identique à la verge. Ce mythe de la « bi-
sexualité native » a été repris par la théorie freudienne.
Il est un des éléments culturels avancés aujourd’hui dans les sociétés qui pra-
tiquent la mutilation sexuelle. Selon les Bambaras, l’être humain possède
avant l’initiation quatre éléments spirituels : deux âmes (ni) ou aspects in-
conscients de la personne, et deux doubles (dya) principes de la volonté et de
l’intelligence. Une âme et un double logent dans le prépuce (et dans le clitoris)
ou plus exactement un ni (principe femelle) et un dya (principe mâle) résident
dans le prépuce, un ni (principe mâle) et un dya (principe femelle) dans le cli-
toris. L’opération va supprimer cette bisexualité, puisque l’homme (après la
circoncision) et la femme (après l’excision) ne conservent plus que le ni et le
dya qui correspondent à leur sexe.
Nous nous contenterons d’aborder, dans la suite de cette étude, la question de
l’excision féminine, qui, dans ce domaine des mutilations sexuelles, est la pro-
blématique la plus forte d’affrontement inter-culturel et dont aucune religion
(contrairement à la circoncision masculine) ne fait une obligation. Ce thème
est aujourd’hui au centre du questionnement de la place de la femme dans les
sociétés traditionnelles en évolution.
7
22..-- LL’’EEXXCCIISSIIOONN EETT SSEESS CCOONNSSÉÉQQUUEENNCCEESS
Pratiquée aujourd’hui dans vingt-six états africains (dans une large zone le
long de l’équateur) ainsi qu’en Indonésie et en Malaisie, l’excision a été impor-
tée en France au début des années 1980 par certains ressortissants de ces
pays venus y trouver accueil et travail. Dans le monde, de 85 à 114 millions
de femmes vivent avec cette mutilation. Chaque année, 2 à 3 millions de fil-
lettes dans le monde subissent, au nom de la tradition, une mutilation de leurs
parties génitales qui, effectuée souvent dans des conditions d’hygiène déplo-
rables, entraînent parfois la mort. Ce rite est donc très répandu.
22..11..-- CCee qquu’’eesstt ll’’eexxcciissiioonn
Il existe trois types d’excisions :
Souvent appelées « circoncision féminine », l’excision « sunna » comporte la
résection du prépuce clitoridien. Elle est essentiellement pratiquée dans cer-
taines sociétés musulmanes d’Afrique du nord-est : Egypte, Soudan, d’Arabie
du sud et d’Indonésie.
L’excision « complète » comporte l’ablation du clitoris, de ses annexes et des
petites lèvres. C’est la plus répandue : elle est pratiquée dans les sociétés
animistes, musulmanes et chrétiennes disséminées en Afrique intertropicale.
La « circoncision pharaonique ou infibulation » peut se définir comme la créa-
tion d’une obstruction vulvaire partielle permanente laissant subsister un petit
orifice résiduel habituellement postérieur, permettant l’issue des urines et du
flux menstruel. Elle est circonscrite à certaines sociétés musulmanes d’Afrique
orientale : Nubie, Soudan, Erythrée, Djibouti, Somalie et de façon plus excep-
tionnelle en Afrique occidentale : Mali, Nord Nigéria. Elle suscite lors du ma-
riage des souffrances atroces, lorsque le mari (ou l’exciseuse) élargit l’orifice
avec un couteau ou un bistouri.
En raison de son caractère social, l’excision s’applique à toutes les femmes
d’une société donnée, et se déroule selon des règles chronologiquement défi-
nies. Tout comme l’infibulation, elle est pratiquée dès les premiers jours de la
vie (du 3ème au 8ème jour en Ethiopie ; du 4ème au 8ème jour en Afrique noire, in-
dividuellement ou collectivement). La future excisée est le plus souvent une
enfant ou une préadolescente d’âge variable (4 à 8 ans en Côte d’Ivoire, 4 à 9
8
ans en Egypte, 8 à 10 ans en Ethiopie, 8 à 14 ans au Mali, au Kenya, 13 à 18 ans
au Tchad) devant remplir des conditions préalables plus ou moins strictes,
propres à chaque société, parmi lesquelles le statut sexuel joue un rôle impor-
tant.
22..22..-- LLeess ccoonnssééqquueenncceess mmééddiiccaalleess ddee ll’’eexxcciissiioonn 66
« A plus ou moins long terme, la femme excisée ou infibulée doit faire face à
des problèmes physiologiques graves. Les plaies des organes voisins touchés
lors de l’opération constituent les complications les plus importantes et fragili-
sent le développement futur de l’enfant : blessure du méat urétral, de la ves-
sie, de l’anus... Les infections urinaires sont fréquentes et récidivantes, ainsi
que les kystes clitoridiens qui peuvent empêcher une éventuelle fécondation,
de même que les hématocolpos 7. On a d’ailleurs décrit une plus grande fré-
quence des avortements à la suite d’infections urinaires chroniques consécu-
tives à l’infibulation.
Lors de l’accouchement, une défibulation est nécessaire et entraîne aussitôt
une réinfibulation après la naissance de l’enfant. D’un point de vue médical, il
apparaît d’ailleurs dangereux de procéder à une défibulation au cours du tra-
vail, en raison des risques maternels (hémorragie, plaies diverses) et fœtaux
(plaies du cuir chevelu). Et même dans le cas où la parturiente a subi une dé-
fibulation satisfaisante, l’état scléro-cicatriciel des tissus vulvaires entraîne un
allongement du travail, des déchirures périnéales, des hémorragies parfois
graves avec nécessité de pratiquer de fréquentes césariennes.
Toutes ces manœuvres chirurgicales sont en elles-mêmes génératrices d’une
mortalité maternelle (plaies vésico-vaginales, vagino-rectales) et fœtale (bles-
sure de la tête, souffrance fœtale). Après l’accouchement, il est d’usage de
procéder à une nouvelle fermeture de la vulve. Cette répétition d’actes chirur-
gicaux ante et post-partum développe très souvent une fibrose cicatricielle du
périnée, fragilisant la santé de la mère et réduisant sa capacité reproductrice
jusqu’à l’annihiler parfois. Dans certains cas, les mutilations rituelles infligées
peuvent donc constituer une castration réelle puisqu’elles privent la victime de
sa faculté à donner la vie. Parfois même qualifier excision et infibulation de
6 D. Halliez, La castration et l’excision, justifications et répression, mémoire 1990-1991, Université de Nan-cy, sous la direction du professeur A. Seuvic. 7 Masse d’importance variable faite d’un agglomérat de caillots menstruels, incarcérée dans le vagin et re-
montant parfois jusqu’à la cavité utérine et consécutive à une fermeture des voies génitales.
9
tortures, d’actes de barbarie, ou encore de castration peut être dans certains
cas justifié par la souffrance infligée. »
22..33..-- LLeess ccoonnssééqquueenncceess ppssyycchhoollooggiiqquueess ddee ll’’eexxcciissiioonn
Un récent rapport médical signale des crises de pleurs beaucoup plus longues
et des réactions à la douleur beaucoup plus élevées parmi les bébés circoncis
ou excisés que parmi ceux qui ne le sont pas, en particulier lors des vaccina-
tions 8. En effet, selon la présidente de la société française de la douleur,
l’enfant est susceptible de ressentir, dès sa naissance et même avant, la dou-
leur et d’en souffrir autant voire davantage que l’adulte. Si le bébé à la nais-
sance n’est pas totalement mature, il a du moins tous les circuits nécessaires
pour transmettre l’information douloureuse. Ce qui lui manque peut être ce
sont les circuits inhibiteurs de la douleur qui deviennent matures plus tardive-
ment (au deuxième trimestre de la vie), laissant supposer que paradoxale-
ment le nouveau-né souffre plus.
Chez le bébé de moins de six mois, la douleur est une rupture du bien-être 9.
Selon plusieurs anesthésistes la douleur aiguë postopératoire existe donc, en
particulier pour des interventions telles que la circoncision ou l’excision. Ce
sont ces souvenirs de la douleur qui forgeront l’expérience ultérieure de
l’enfant et, par réflexe conditionné, influenceront son comportement à l’âge
adulte. En tout cas, avant l’acquisition du langage, seule la composante émo-
tionnelle peut se manifester. Le registre non verbal des signes que l’enfant va
utiliser est varié : signes physiques (tachycardie, hypertension), comporte-
mentaux (agitation ou immobilité, mouvements de protection des zones dou-
loureuses…) 10.
D’un point de vue psychologique, la douleur chronique a des conséquences di-
rectes sur le développement de l’enfant et sur les relations avec son entou-
rage, en particulier avec ses parents. Lorsque la douleur est vive et durable,
l’enfant se désintéresse du monde extérieur et s’installe dans une indifférence
morne, sans plainte ni larme. La mimique s’appauvrit, la mobilité corporelle
est comme engainée, les initiatives psychomotrices sont diminuées, et la ré-
ponse motrice aux sollicitations s’affaiblit. Parallèlement, on observe une chute
8 Société canadienne de pédiatrie, La circoncision néonatale revisitée, site Internet nocirc.org.
9 S. Rosenberg-Reinen, C. Buisson et F. Chéru, La douleur postopératoire chez l’enfant, Objectif soins n°44,
juin-juillet 1996. 10
A. Gauvain-Piquard, La douleur chez l’enfant, Medsi, 1989.
10
des initiatives et des réponses aux sollicitations de l’entourage, ainsi qu’une
aggravation des troubles de la communication 11.
Entre quatre et six ans, l’opération est perçue par l’enfant comme un acte
d’agression et de castration, sentiment qui réapparaît d’ailleurs à l’âge adulte
chez les circoncis et les excisées. Certains auteurs ont, à ce titre, insisté sur
l’effet néfaste de ces actes sur le moral et l’adaptation du mineur 12.
Or la psychologie adulte est souvent travaillée par des considérations qui relè-
vent de la petite enfance. Circoncision et excision sont des blessures qui ris-
quent de laisser à vie des séquelles psychiques et physiques douloureuses. Le
problème est alors de savoir comment le psychisme de l’enfant mutilé va gérer
les suites d’un acte qui ne peut pas, de par sa violence, être vécu autrement
que comme un traumatisme grave.
Les complications psychologiques de ces mutilations, notamment l’hostilité re-
foulée ou niée envers le sexe opposé ainsi que celle forcément ambivalente
envers les parents et le groupe, peuvent être profondément enfouies dans le
subconscient de l’enfant. Ne pourraient-elles pas alors déclencher l’apparition
de troubles du comportement : à court terme, la perte de confiance de l’enfant
dans ses propres parents, et à plus long terme, des risques d’anxiété, de dé-
pression, d’irritabilité chronique, d’impuissance ou de frigidité ?
Ne pourrait-on pas aussi en inférer que les remaniements psychoaffectifs pro-
voqués en leur temps dans le psychisme des parents, au moment de leur
propre mutilation, tendent à créer en eux une séquelle psychique agissant en
tant que compulsion, qui les pousse à recréer plus tard le même traumatisme
chez leur enfant 13 ?
Chez l’enfant plus âgé (entre sept et quinze ans environ), le symbolisme atta-
ché à ces pratiques peut revêtir un caractère traumatisant qui doit être perçu
comme un avertissement dans sa chair, afin que le réflexe conditionné infrac-
tion-châtiment corporel-douleur puisse fonctionner, même si cette souffrance
paraît dominée. En effet l’intégration de l’enfant juif, musulman, ou africain
dans sa communauté d’origine, qu’elle soit religieuse, culturelle ou ethnique,
ne se fera qu’au prix d’une épreuve de courage et d’endurance. A ce titre un
11
A. Gauvain-Piquard, L’impact de la douleur physique dans la vie psychique, Synapse, décembre 1994, n°111, p.25. 12
G. Cansever, British Journal Medical of Psychology, décembre 1995. 13
P. Dunezat, Les Mutilations sexuelles rituelles sur les femmes in Congrès de Criminologie intitulé De La castration en général et de quelques pratiques rituelles ou médicales en particulier, organisé à Villefranche les 10 et 11 octobre 1997 par l’Association de criminologie et de prévention Nice-Côte d’Azur-Corse.
11
sociologue propose un modèle théorique sur les rapports entre les trauma-
tismes sexuels, rituels, et les fonctions d’affiliation au groupe. Il s’agit d’une
analyse de la logique du traumatisme sexuel en tant que rite initiatique que
l’on retrouve d’ailleurs dans certains excès du bizutage que veut condamner le
projet de loi sur la délinquance sexuelle.
Selon lui, la violence extrême du traumatisme produit un chaos puis une réor-
ganisation du psychisme individuel. Le concept qui nous intéressera ici est que
la logique de l’évolution des séquelles psychiques post-traumatiques débou-
cherait nécessairement sur une affiliation au groupe. Cela passerait par une
séquence évolutive définie qui pourrait être énoncée en quatre phases succes-
sives de remaniement psychique :
1- « Ce qui m’arrive est impensable » (c’est ici la violence du traumatisme qui
bloque la capacité de penser),
2- « Il existe nécessairement quelqu’un qui sait et qui vit dans un monde où
cela possède un sens »,
3- « Il existe nécessairement un groupe où « celui qui sait » partage avec
d’autres les mêmes références »,
4- « Donc moi qui ai subi, je suis nécessairement des leurs ».
Selon ce modèle théorique, les traumatismes sexuels rituels peuvent donc
avoir une fonction initiatique et d’affiliation au groupe 14. L’adolescent devra
ainsi subir stoïquement l’opération plus ou moins étendue et pratiquée le plus
souvent sans anesthésie, sans pleurer, sans crier, sans montrer qu’il a peur,
s’il veut faire partie du groupe. Or combien de tristes récits mentionnent, hé-
las, l’angoisse et la panique éprouvées par l’enfant avant et pendant
l’opération 15 ?
14
T. Nathan, in Nouvelle Revue d’Ethnopsychiatrie, n°8, 1992. 15
Voir Cass. crim. 7 mars 1972, Bull. crim. n°85 : « la violence ou voie de fait est caractérisée suffisamment par un geste ou une attitude de nature à impressionner une personne raisonnable ».
12
33..-- LLEESS PPOOIINNTTSS DDEE VVUUEE SSUURR LL ’’EEXXCCIISSIIOONN
33..11..-- LLeess tteennttaattiivveess sscciieennttiiffiiqquueess dd’’eexxpplliiccaattiioonn
« Rejeter un rite, c’est rejeter la société dans ce qu’elle a de plus profond » dit le so-
ciologue Henri Mendras 16, nous invitant ainsi, avant de juger, à mieux comprendre.
Pour les anthropologues dont Bruno Bettelheim cite les travaux 17, l’excision et
la circoncision sont des « rites de passage qui introduisent les adolescents
dans le monde adulte ». Se situant au carrefour de l’anthropologie et de la
psychanalyse, Bruno Bettelheim a « l’impression que l’excision a été imposée
aux filles par les hommes » et la considère comme « des tentatives mâles
d’acquérir le contrôle des fonctions sexuelles féminines ». Marie Bonaparte,
première traductrice de Freud, soutient l’idée 18 que « les hommes se sentent
menacés par ce qui aurait une apparence phallique chez la femme, c’est pour-
quoi ils insistent pour que le clitoris soit enlevé ».
Michel Erlich 19 trouve d’autres explications : préservation de la chasteté, peur
des infidélités, volonté de réduire le plaisir féminin ou encore considérations
esthétiques ou hygiéniques.
Jean-Marie Somny, magistrat de Pontoise 20, explique que « ces pratiques qui
nous paraissent barbares traduisent une appartenance au groupe qui offre, en
retour, une solidarité dont nous avons perdu le secret et dont nous gardons la
nostalgie ».
33..22..-- LLaa ppoossiittiioonn ddee ll’’éégglliissee ccaatthhoolliiqquuee
Les missionnaires, témoins privilégiés de la vie locale en Afrique, n’ont laissé
que de rares témoignages sur les mutilations sexuelles féminines. Le respect
de ces « mythes puérils pourtant si pittoresques », comme l’écrit le R.P.
Daigre en 1932 21, explique en partie la longue discrétion des Pères et des
Sœurs en Afrique. La première à s’être élevée contre « cette mutilation si dou-
loureuse, qu’aucune raison médicale ne peut justifier et qui s’accomplit dans
16
Henri Mendras, Éléments de sociologie, Armand Colin, Paris, 1975. 17
Bruno Bettelheim, Les Blessures symboliques, Gallimard, Paris, 1971. 18
Marie Bonaparte, Notes sur l’excision, Revue Française de psychanalyse, XII, 1946. 19
Michel Erlich, La Femme blessée, essai sur les mutilations sexuelles féminines, L’Harmattan, Paris, 1986. 20
Cité par Dominique Vernier, Droits à la différence contre droits de l’enfant, in Le Monde Diplomatique d’octobre 1998. 21
R.P. Daigre, Les Bandas de l’Oubangui-Chari, Anthropos T.XXVII, 1932.
13
un manque total d’asepsie » est Sœur Marie-André du Sacré-Cœur 22, en
1953. Docteur en droit, infirmière, elle est missionnaire chez les Sœurs
Blanches et dénonce le fait que « en Oubangui, 2 % des jeunes filles meurent
des suites de l’opération ». Dès 1956, les Sœurs Blanches disaient simple-
ment : « l’excision est défendue, car c’est une mutilation » 23.
En 1961, le R.P. Hébert publie un article dans lequel il expose les risques de
l’excision. En 1980, le R.P.Luneau, désireux de respecter les traditions locales
affirme que « dans des pays où le taux de mortalité est de quinze fois supé-
rieur au notre, le droit à l’orgasme n’apparaît pas comme le premier des biens
et rien n’est plus important que la fécondité » 24.
L’Alliance Internationale Jeanne d’Arc, association féministe chrétienne fondée
en 1911 et seule reconnue par l’UNESCO, ne cesse de faire pression sur le Saint-
Siège pour obtenir une condamnation officielle de ces pratiques : « Quand les
évêques prendront-ils le temps de dire officiellement aux familles que Dieu
veut que les femmes restent entières, telles qu’Il les a faites ? » 25.
Dans son exhortation apostolique, publiée à la suite du synode de l’Église en
Afrique, le pape Jean-Paul II devait simplement déclarer : « l’Église réprouve
et condamne toutes les coutumes et pratiques qui privent les femmes de leurs
droits et du respect qui leur est dû ».
En fait, l’attitude souvent ambiguë de l’épiscopat s’est souvent fondée sur une
sincère admiration pour le courage devant l’épreuve physique et témoigne en-
core d’un mépris certain pour le plaisir sexuel. Plus le corps souffre, mieux se
porte l’âme.
33..33..-- LLeess pprrééjjuuggééss ssoocciiooccuullttuurreellss eett mmééddiiccaauuxx ddee cceeuuxx qquuii pprraattiiqquueenntt ll’’eexxcciissiioonn
Les préjugés relatifs à l’excision varient d’une ethnie à l’autre. Mais certains
critères se retrouvent cependant dans beaucoup de cultures.
Selon une enquête réalisée par CI-AF/Bénin en 1992 26, 70 % des personnes
interrogées considèrent que l’excision permet aux filles de se conformer à une
norme sociale. Les femmes non excisées sont l’objet de railleries et exclues de
22
Sœur Marie-André du Sacré-Cœur, La Condition humaine en Afrique noire, Grasset, 1953. 23
Citées par Natacha Henry, L’excision vue par la religion, in Notre Histoire, n° 151, 1997. 24
R.P. Luneau, Chants de femmes au Mali, Ascot, 1981. 25
In Revue de l’Alliance Internationale Jeanne d’Arc, Liège, 1995. 26
Citée par le journal béninois Le Matinal, dans un article du 4 novembre 1998.
14
certaines cérémonies, leur dot est moins importante au moment du mariage.
Mais cette épreuve est perçue avant tout comme une formation au stoïcisme.
Pour les Peuls, le clitoris est dangereux car il risque, s’il est trop long,
d’obstruer l’entrée du vagin et d’affecter ainsi la pénétration masculine. Son
ablation faciliterait, pour la même raison, l’accouchement.
Or, dans la tradition africaine, la venue au monde d’un enfant est perçu
comme un passage très dangereux, celui du monde des morts d’où l’on vient,
au monde des vivants toujours menacé par les forces du mal qui rôdent autour
de la mère et de son enfant. Dans leur étude sur les sculptures et images afri-
caines de maternité, deux médecins de Cergy-Pontoise 27 estiment que « le
couple des parents géniteurs n’est pas considéré comme seul participant à cet
acte procréateur. Si la mère donne la forme à l’être de chair et de sang, si le
père assure l’insertion dans la lignée, il y a une autre instance, qui n’est ni le
corps biologique ni la dimension culturelle, qui fournit au nouveau-né son es-
sence vitale : c’est une concentration de forces issues de l’esprit des ancêtres
et de l’énergie du cosmos ».
En Égypte, « une jeune fille non excisée ne peut pas trouver de mari » ex-
plique l’écrivain Anis Mansour, pour qui « les coutumes ont plus de pouvoir
que la Loi » 28. Le nom courant de l’excision est tahara, qui signifie pureté.
Valentin Sovide, éditorialiste africain 29, critique « ces femmes "évoluées" qui,
après avoir vu le monde des blancs, déclarent une guerre sans merci aux va-
leurs africaines qui les ont vues naître et grandir. » Il affirme d’autre part que
« le clitoris est l’organe central du désir sexuel de la femme, et non du plaisir.
Force est de constater qu’avec le recul de l’excision, les femmes sont de plus
en plus dévergondées et infidèles ».
Au nom de certaines valeurs, peut-on interdire à la femme le droit au désir
qu’on accorde pourtant sans condition à l’homme ? Dans toutes les régions du
monde qui la pratiquent, l’excision passe ainsi pour un moyen d’amener la
jeune fille à résister à ses instincts et pulsions sexuels, ce qui garantirait la pé-
rennité de la famille.
27
Dr Gilles Marie Valet et Dr Serge Fiorina, médecins hospitaliers de pédo-psychiâtrie, in Les Archives de Carnet Psy, 1999. 28
Cité dans l’article d’Amine El-Sayad et Hanan Hajjaj, L’excision, un drame égyptien, in Courrier Interna-tional n° 210, 10 au 16 novembre 1994. 29
Valentin Sovide, Excisée ou dépravée, in La Nation, quotidien béninois, 27 novembre 1998.
15
33..44..-- LLeess ppoossiittiioonnss eett ll’’aaccttiioonn ddee ll’’OOrrggaanniissaattiioonn ddeess NNaattiioonnss UUnniieess
Lors de la création des Nations Unies, en 1945, la lutte pour l'égalité entre les
sexes était encore balbutiante. Seuls trente, parmi les cinquante et un pre-
miers Etats Membres de l'Organisation, accordaient aux femmes les mêmes
droits de vote qu'aux hommes ou les autorisaient à travailler dans l'adminis-
tration publique. Néanmoins, les rédacteurs de la Charte des Nations Unies,
prévoyants, firent délibérément mention de « l'égalité des droits entre les
hommes et les femmes » alors qu'ils déclaraient « la foi [de l'Organisation] en
les droits de l'homme » ainsi que « la dignité et la valeur de la personne hu-
maine ». Aucun document légal international n'avait auparavant affirmé avec
une telle vigueur l'égalité de tous les êtres humains ou n'avait considéré la dif-
férence de sexe comme possible motif de discrimination.
Au cours des trois décennies qui suivirent, le travail des Nations Unies relatif
aux femmes fut principalement consacré à la codification de leurs droits juri-
diques et civils ainsi qu'à la collecte d'informations sur leur statut dans le
monde. Avec le temps, il devint toutefois de plus en plus évident que les lois,
en elles-mêmes et comme telles, ne suffisaient pas à garantir aux femmes des
droits égaux à ceux des hommes.
Le second stade de la lutte en faveur de l'égalité entre les sexes commença
avec l'organisation, par les Nations Unies, de quatre conférences mondiales 30
destinées à développer des stratégies et des plans d'action pour la promotion
des femmes.
Entrée en vigueur en 1986, la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples dispose dans son article 4 que : « La personne humaine est inviolable.
Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et mo-
rale de sa personne. Nul ne peut être arbitrairement privé de ce droit ». De
même, la Charte africaine sur les droits de l’enfant précise dans son article 21,
1er que : « Les Etats parties à la présente charte prennent toutes les mesures
appropriées pour abolir les coutumes et les pratiques négatives, culturelles et
sociales qui sont au détriment du bien-être, de la dignité, de la croissance, et
du développement de l’enfant en particulier :
a/ Les coutumes et pratiques préjudiciables à la santé, voire à la vie de l’enfant ;
30
Mexico, 1975 ; Copenhague, 1980 ; Nairobi, 1985 ; Pékin, 1995.
16
b/ Les coutumes et pratiques qui constituent une discrimination à l’égard de
certains enfants, pour des raisons de sexe ou autres ».
D’autre part, l’article 19 de la Convention de l’ONU sur les droits de l’enfant,
adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989,
précise que « Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, admi-
nistratives, sociales, et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre
toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales,
d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y com-
pris la violence sexuelle pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de
l’un d’eux, de son ou de ses représentants légaux ou de toute autre personne
à qui il est confié ». L’article 24-3 de cette même Convention vise en outre à
« abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé de l’enfant ».
L’accent est donc mis sur la protection du corps humain et en particulier sur ce-
lui de l’enfant, ce qui est une préoccupation très moderne si ce n’est nouvelle.
Une évolution mérite en effet d’être ici soulignée. Jadis, comme à Rome,
l’enfant était la chose des parents ; ces derniers en avaient la disposition ab-
solue. Jusqu'à sa majorité, le mineur restait sous la domination parentale. De-
puis, les sociétés ont évolué, les mœurs ont changé et avec elles la place de
l’enfant au sein de la famille. De nos jours, le mineur est au centre de toutes
les attentions juridiques.
Il est une personne à part entière et ne dépend plus strictement de ses père
et mère. A cet égard, il dispose de droits propres que le législateur ne cesse
de vouloir protéger et renforcer.
De plus en plus, le corps humain est pris en considération par le droit pour en
assurer la défense. Ainsi on ne doit pas hésiter à protéger l’enfant contre le
groupe social et même contre ses propres parents lorsque ceux-ci voudraient
porter atteinte au mineur.
Ce n’est cependant qu’à la conférence de Pékin, en 1995, que fut abordée ex-
plicitement la question des violences envers les femmes (violences domes-
tiques et mutilations génitales féminines), après qu’on ait réaffirmé énergi-
quement que les droits des femmes faisaient partie intégrante des droits de
l'homme et que l'égalité entre les sexes était une question universelle dont la
prise en compte bénéficiait à tous.
17
L'Assemblée générale des Nations Unies a convoqué une session extraordi-
naire consacrée au suivi des progrès réalisés au cours des cinq années qui ont
suivi l'adoption du Programme d'action de Pékin, du 5 au 9 juin 2000, à New
York (« Les femmes en l'an 2000 : égalité entre les sexes, développement et
paix pour le XXIè siècle »).
Depuis Pékin, l’OMS a élaboré des outils de formation et organisé des ateliers
de sensibilisation à l’intention des sages femmes africaines et de l’est de la
Méditerranée, pour les inciter à se mobiliser.
Le 9 avril 1997, les directeurs de trois institutions des Nations Unies - l'Orga-
nisation mondiale de la Santé (OMS), le Fonds des Nations Unies pour la Popu-
lation (FNUAP) et l'UNICEF - réunis au Palais des Nations à Genève, ont lancé
un appel à la communauté internationale et aux dirigeants mondiaux, leur
demandant de soutenir les efforts visant à éliminer les mutilations sexuelles
féminines. Leur objectif est d’obtenir une réduction sensible des mutilations
sexuelles féminines d'ici dix ans, et éliminer totalement cette pratique en trois
générations.
Les trois institutions entendent privilégier une approche multidisciplinaire et le
travail d'équipe à la fois dans les pays où les mutilations sexuelles féminines
sont pratiquées et aux niveaux régional et mondial. Ce travail d'équipe ras-
semblera les gouvernements, les institutions politiques et religieuses, les or-
ganisations internationales, les organisations non gouvernementales et les or-
ganismes de financement en vue d'éliminer cette pratique néfaste.
Dans les pays, des équipes inter-institutions aideront les gouvernements à
élaborer et à mettre en oeuvre des politiques nationales claires pour « abolir
les mutilations sexuelles féminines, y compris, si nécessaire, par l'adoption de
textes législatifs qui les interdisent ». Les efforts de ces équipes viseront à
faire évoluer l'opinion publique des pays concernés, par l'éducation et la prise
de conscience des effets physiques et psychologiques préjudiciables des muti-
lations sexuelles féminines. Ils devront s'adresser au grand public, au corps
médical, aux décideurs, aux gouvernements, aux responsables politiques, reli-
gieux et de villages, en même temps qu'aux accoucheuses et aux guérisseurs
traditionnels.
18
44..-- QQUUEELLQQUUEESS QQUUEESSTTIIOONNSS DD’’ÉÉTTHHIIQQUUEE
Sur le plan plus général des Droits de l’Homme, une telle atteinte à l’intégrité
physique de l’enfant et de la femme est-elle en effet acceptable ? La mutilation
sexuelle ne peut-elle s’apparenter à une torture ou à un acte de barbarie ? Se-
lon la Convention de New York du 10 décembre 1984, le terme de torture dé-
signe « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aigües, physiques
ou mentales, sont infligées à une personne ». Le témoignage de femmes exci-
sées semble permettre cette assimilation 31.
L’avis rendu, le 30 juin 1998, par la Commission Consultative des Droits de
l’Homme, présidée par M. Jean-Pierre Pierre-Bloch, également président de la
LICRA, va dans ce sens : « Nul respect d’une identité culturelle ne saurait légi-
timer des atteintes à l ‘intégrité physique de la personne, telle l’excision, qui
ont le caractère de traitements criminels à cause de la douleur intolérable in-
fligée à des fillettes incapables de s’en défendre ».
Pour contourner cet obstacle de la douleur, certains préconisent une médicali-
sation de l’excision. Outre le fait qu’elle est difficile à mettre en œuvre, pour
des raisons de moyens, notamment dans les pays qui la pratiquent le plus,
cette proposition présente l’inconvénient de cautionner, sur le fond, la pratique
même de l’excision.
Alors, défendre le relativisme des cultures signifie-t-il pour autant accepter
n’importe quelle tradition au nom du droit à la différence ? Certes pas, mais
comme toute notion relative aux droits fondamentaux de l’être humain, la
question de l’excision doit d’abord s’inscrire dans le Droit des États et les pré-
occupations des instances internationales pour devenir une référence. Ensuite,
cette question doit être posée en termes d’éducation, car ce sont bien les po-
pulations les plus démunies qui en sont les premières victimes.
A ce titre, les efforts patients des Nations Unies et des ONG tracent mieux la
voie à suivre que le reportage de CNN lors de la Conférence du Caire sur le
développement et la démographie, en 1994. Les deux minutes d’images bru-
tales et sanglantes diffusées avaient soulevé une tempête de réactions qui
n’eurent d’autre effet dans ce pays que de radicaliser les positions. On verra
que le dialogue continu sur le terrain apporte beaucoup plus de résultats.
31
Voir, en annexe 1, Khadidia Diawara, L’excision, un témoignage, in Femme Actuelle du 24-30 mai 1999.
19
SSEECCOONNDDEE PPAARRTTIIEE
EExxcciissiioonn eett iinnttééggrraattiioonn
ddaannss lleess ppaayyss dd’’AAffrriiqquuee ccoonncceerrnnééss
A la suite des conférences de l’ONU, nombre de pays africains ont accepté de
travailler en relation avec les organisations internationales pour faire évoluer
les mentalités 32. Progressivement, le débat devient public. Et c’est probable-
ment par la libération de la parole que les populations pourront avancer 33. Les
femmes africaines elles-mêmes ont pris le relais et se mobilisent. En voici des
exemples.
11..-- LLee SSéénnééggaall
Pour la première fois en 1997, des femmes sénégalaises du village de Mali-
counda, à une heure de route de Dakar, se sont dressées pour refuser les mu-
tilations sexuelles dont elles sont victimes depuis la nuit des temps.
Le serment de Malicounda s’est ensuite répandu comme un feu de brousse
dans les villages des environs et la presse de la capitale. Ces femmes faisaient
partie de l’ethnie Bambara, dont beaucoup de familles établies en ville avaient
progressivement abandonné une coutume qui, dépouillée de ses alibis mytho-
logiques et rituels, n’avait plus d’autre justification que la volonté brutale de
contrôler la virginité des filles et la sexualité des femmes en les mutilant. En
se positionnant ainsi, elles imitaient la culture dominante de l’ethnie Ouolof,
majoritaire dans le village, qui ignore ces pratiques. C’est à dire qu’elles
s’intégraient avec fierté à un groupe plus large.
Tous les Bambaras du Sénégal n’ont cependant pas encore abandonné
l’excision, qui est aussi massivement pratiquée chez les Peuls, les Toucou-
leurs, les Mandingues, les Sonikés et les Diolas.
Roland-Pierre Paringaux 34 explique que 39 femmes de Malincounda partici-
paient, depuis 1996, à un programme d’éducation de base mis au point par
l’ONG Tostan, avec le soutien de l’ONICEF et du gouvernement sénégalais.
Lorsque l’interlocutrice (une femme Ouolof, fille d’exciseuse) avait abordé le
32
Des exemples de législations adoptées par ces pays sont donnés en annexe 3. 33
"Tais-toi, il ne faut plus parler de ces choses-là", disait la mère de Khadidia Diawara (voir annexe 1). 34
Roland-Pierre Paringaux, Le serment de Malicounda, in Le Monde du 14 octobre 1997.
20
chapitre de l’excision, les femmes bambaras avaient au départ refusé de parti-
ciper au débat. Elle a repris son cours plusieurs jours de suite jusqu’à ce
qu’une femme, puis plusieurs, acceptent de répondre aux questions.
Le 20 novembre 1997, le président sénégalais, Abdou Diouf, rendant hommage aux
femmes de Malicounda, appelait à « combattre vigoureusement la pratique des mu-
tilations sexuelles ». En mai 1998, le gouvernement sénégalais adoptait un plan na-
tional de lutte contre l’excision. Quelques mois plus tard, l’Assemblée Nationale
adoptait une loi visant à punir les adeptes de telles pratiques. « Des efforts considé-
rables d’information doivent encore être fournis pour familiariser les sénégalais à
cette nouvelle loi, car il y a un déficit d’information sur les effets de l’excision sur la
santé de la femme », déclarait le 30 janvier 2001 Soguy Ndiaye (présidente de
l’Association pour la Promotion de la Femme Sénégalaise, APROFES) 35.
22..-- LLaa MMaauurriittaanniiee
Dans ce pays, l’infibulation n’existe pas. Seule se pratique l’ablation du clitoris,
essentiellement chez les Soninkés (95 % de la population féminine). Chez les
Ouolofs, elle n’existe pas et chez les Maures, elle est de l’ordre de 30 %. Le
débat n’est pas encore national et le pays n’a pas adopté de loi particulière.
33..-- LLaa CCôôttee dd’’IIvvooiirree
En 1998, le gouvernement ivoirien adoptait une loi réprimant sévèrement des pra-
tiques traditionnelles néfastes pour la femme : excision, mariage précoce ou forcé,
harcèlement sexuel. Selon la présidente de l’Association Ivoirienne des Droits de la
Femme, Constance Yaï, « désormais le plus dur reste à faire : sensibiliser les popula-
tions qui ont recours à ces pratiques et sont aux ¾ analphabètes » 36.
44..-- LLee MMaallii
Le Centre Djoliba a organisé, du 13 au 15 mai 2000, au Palais des Congrès de
Bamako, un forum national sur le thème de l’excision, suite au projet de modi-
fication de la législation du pays.
35
Soguy Ndiaye, APROFES, Sénégal, Loi contre l’excision et poids de la tradition, in Documents, site inter-net penelopes.org. 36
AFP, 4 juin 1998.
21
Les autorités religieuses se sont mobilisées (le pays est en majorité musul-
man). L’imam de la mosquée de Torokorobougou (Les méfaits de l’excision),
l’imam de la mosquée Aïcha de La Mecque (Traditions musulmanes et excision)
et deux délégués de l’université Alhazar du Caire (Résultats de recherche sur la
crédibilité des haddiths se référant au sujet) souhaitaient lever toute équivoque
sur le caractère non religieux de l’excision 37. Une brochure en arabe a été éditée
pour sensibiliser les élèves des médersas et les fidèles des mosquées.
55..-- LLee BBuurrkkiinnaa FFaassoo
Le gouvernement burkinabé s’est engagé résolument en 1996 dans la lutte
contre l’excision. Après des années d’effort, les mentalités changent lente-
ment. 65 % des femmes sont encore excisées en 1998, contre 70 % vingt ans
plus tôt.
La très active présidente du Comité National de Lutte contre l’Excision
(CNLPE), Miriam Lamizana, affirme : « Nous avons réussi à briser le tabou et à
susciter une prise de conscience nationale » 38.La stratégie utilisée (la projec-
tion en 1996, à 80 chefs coutumiers d’un documentaire volontairement trau-
matisant, La Duperie, où l’on assiste à l’excision d’une petite fille dans les
pleurs et les hurlements) a provoqué « un choc maximal ». Depuis, les leaders
d’opinion (journalistes, commissaires de police, exciseuses) ont été la cible
privilégiée des quelques 168 causeries, 35 séminaires de sensibilisation et 30
conférences organisées par le CNLPE.
Un homme politique du parti au pouvoir estime qu’ « il faudrait scolariser da-
vantage dans les campagnes et l’on verrait automatiquement baisser
l’excision ». 35 % en effet des garçons et à peine 10 % des filles vont en effet
à l’école au Burkina. L’excision n’y est pas la seule question cruciale. Les habi-
tants vivent dans un univers où les décrets du ciel et de la terre comptent bien
plus que ceux du gouvernement. Où l’on se demande comment échapper à la
disette lorsque les récoltes sont maigres. Et rien n’est plus important que de
mettre des enfants au monde, puis de les maintenir en vie, afin que ne se
rompe jamais le fil qui relie aux ancêtres. Or la pratique de l’excision permet
aux communautés de se sentir reliées aux ancêtres et touche au cœur de
l’identité sexuelle.
37
Information parue sur le site internet famafrique.org. 38
Citée par Joëlle Stotz, Le Burkina Faso fait reculer l’excision, in Le Monde Diplomatique, septembre 1998.
22
66..-- LL’’ÉÉggyyppttee
La Conférence Internationale sur la Population et le Développement du Caire,
en 1994, a lancé publiquement le débat sur l’excision dans ce pays, du fait du
reportage de CNN. 3.600 petites filles sont excisées chaque joue en Égypte,
selon les statistiques du Ministère de la Santé.
Dans la cacophonie des réactions anti-occidentales, le rédacteur en chef du quo-
tidien Al Akhbar écrit cependant : « Les images montrées par certaines chaînes
étrangères et qui provoquent notre indignation sont en fait le reflet de réalités
égyptiennes, auxquelles il est de notre responsabilité de mettre un terme ».
Au cours de la conférence, le Ministre de la Santé égyptien a expliqué qu’il
« n’est pas possible, pour le moment, de promulguer une loi interdisant tota-
lement l’excision ». En 1997, la Cour Suprême égyptienne a cependant pro-
mulgué une loi dans ce sens : La Loi interdit de pratiquer l’excision, même
dans les hôpitaux et cliniques ; mais les chirurgiens la réalisent tout de même
pour, disent-ils, éviter le pire. Le serment d’Hippocrate leur demande de dé-
fendre la vie, qui les en blâmera ?
Selon une étude réalisée par le Conseil National égyptien de la Population, pu-
bliée en février 1997, 8 femmes égyptiennes sur 10 sont favorables à la pour-
suite de l’excision, car elles estiment que « c’est une bonne tradition ». Selon
une enquête du Ministère égyptien de la Santé 39, 97 % des femmes seraient
excisées en Egypte. 85 % d’entre elles le sont par des dayas, sages femmes
traditionnelles, sans aucune anesthésie ni asepsie.
77..-- LLaa GGuuiinnééee
En décembre 1999, plusieurs milliers d’habitants de Kouroussa, à l’est de la
Guinée, étaient présents lorsqu’une douzaine d’exciseurs jetèrent leurs cou-
teaux et refusèrent de continuer à pratiquer la mutilation des fillettes et des
femmes.
39
Citée par Christophe Ayad, Egypte, les exciseurs plus forts que la Loi, in Libération du 29 décembre 1997.
23
TTRROOIISSIIÈÈMMEE PPAARRTTIIEE
DDrrooiitt eett pphhiilloossoopphhiiee
LLeess qquueessttiioonnss ppoossééeess eenn FFrraannccee
11..-- LLAA QQUUAALLIIFFIICCAATTIIOONN AAPPPPLLIICCAABBLLEE EENN DDRROOIITT FFRRAANNÇÇAAIISS
La protection pénale de la personne humaine a toujours été une nécessité
comme en témoignent :
• La Déclaration des droits de l’homme du 26 août 1789 ;
• La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ;
• La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme de 1950
(articles 2 à 5 et 8 à 11) ;
• Et enfin, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de
1966 (article 7).
Pour traduire ces objectifs, la loi n°92-684 du 22 juillet 1992 a réformé les
dispositions de l’ancien code pénal relatives à la répression des crimes et délits
contre les personnes. Contrairement au code de 1810 qui privilégiait la dé-
fense de l’État et de la propriété individuelle, le nouveau code pénal protège
en premier lieu la personne humaine et la loi n°94-953 du 29 juillet 1994 rela-
tive au respect du corps humain ajoute l’interdiction de toute atteinte à la di-
gnité de la personne (article 16 du code civil). La sauvegarde de cette forme
de dignité est un principe à valeur constitutionnelle.
Mais un problème se pose : étant donné que la dignité ne se confond pas avec
l’intégrité, ne doit-on pas admettre l’atteinte à l’intégrité dès lors qu'elle ne
heurte pas la dignité de la personne ? Pour résoudre ce problème (ou le com-
pliquer) on citera l’article 16-1 du code civil qui déclare que le corps humain
est inviolable et l’article 16-3 qui ajoute la nécessité thérapeutique.
De plus l’évolution des valeurs conduit à dépasser la protection de la personne
pour viser globalement l’humanité tant dans son intégralité, ses groupes, que
dans sa diversité et à travers elle le milieu de vie et l’environnement. On as-
24
siste même aujourd’hui au renforcement de la protection pénale de certaines
catégories de victimes particulièrement vulnérables.
Aujourd’hui l’accent est donc mis sur l’importance d’un système de protection
des droits individuels s’imposant aux législateurs nationaux. Tout être humain
doit bénéficier de la protection prescrite par les lois internes mais aussi les
conventions internationales. La protection pénale est accordée directement à
l’être physique et s’attache moins à chaque citoyen pris comme membre du
groupe social qu’à chaque personne envisagée comme représentant à part en-
tière du genre humain.
Dans un système pénal objectif de protection de l’intégrité physique des êtres
humains, tout s’organise en fonction de l’atteinte effective portée à l’intégrité
ou à la vie d’une personne. Le législateur s’appuie sur l’intérêt qu’il entend
protéger et incrimine les différents types d’atteintes qui peuvent survenir. Il
mesure ensuite la sanction pénale en fonction de la gravité de chacun de ces
différents types d’atteintes. En revanche, il ne prête que très peu d’attention à
la responsabilité subjective du prévenu et il s’attache peu à la culpabilité de
l’auteur des actes dommageables.
A l’inverse, un système pénal subjectif de protection de la vie humaine
s’organise en fonction de la responsabilité morale de celui qui a porté atteinte
ou tenté de porter atteinte à cet intérêt juridique majeur.
En pratique, on assiste à une combinaison des deux systèmes : le législateur,
assurant un minimum de répression en maintenant la sanction au niveau né-
cessaire pour qu’elle produise un effet de réparation et de prévention géné-
rales, peut alors prendre en considération la responsabilité subjective de
l’agent et réserve les sanctions les plus lourdes aux agissements qui révèlent
une intention criminelle caractérisée.
L’objectif de la politique pénale est donc cette protection de base. S’agissant
précisément des atteintes corporelles à l’intégrité de la personne humaine
telles que la circoncision ou l’excision, le problème est de savoir quelles seront
les qualifications applicables au Droit Français et quelles sont les responsabili-
tés en cause.
L’exigence d’une incrimination pénale adéquate apparaît alors comme un im-
pératif catégorique. Le législateur doit rédiger des incriminations protectrices
des personnes en des termes garantissant effectivement les intérêts des fu-
25
tures victimes, et avec le souci permanent d’assurer le respect des droits des
futurs défendeurs. Et formellement ces incriminations doivent être libellées en
termes clairs, précis, tant dans leurs éléments matériels que moraux, afin
d’éviter par la suite tout arbitraire judiciaire.
Or force est de constater que notre Droit actuel ne comporte aucun texte spé-
cial réglementant ou stigmatisant les atteintes à l’intégrité physique résultant
de l’excision ou de la circoncision. Il paraît donc nécessaire de rechercher un
texte général pouvant englober ces pratiques.
11..11..-- TToorrttuurree,, aaccttee ddee bbaarrbbaarriiee ??
A première vue, la recherche d’une qualification pénale de la circoncision et de
l’excision apparaît malaisée. Comment qualifier ces pratiques religieuses et ri-
tuelles ? De la manière la plus objective, on peut dire que toutes deux portent
atteinte à l’intégrité corporelle puisque la circoncision implique l’exérèse du
prépuce et l’excision, celle du clitoris et des petites lèvres.
Devant la gravité de ces actes, certains auteurs ont proposé de retenir la qua-
lification de tortures et actes de barbarie. D’autres, en revanche, insistant sur
l’aspect symbolique de ces interventions touchant aux organes sexuels, ont pu
jadis opter pour la qualification de castration 40.
Dans le code pénal de 1810 cette mutilation atroce était spécialement prévue,
non pas en tant que châtiment mais en tant que crime contre les personnes. A
l’inverse le nouveau code pénal a banalisé cette infraction en lui ôtant toute
spécificité en tant qu’ablation ou amputation volontaire d’un organe de repro-
duction masculin ou féminin. En d’autres termes ce type d’atteinte ne diffère
pas d’une autre atteinte physique portée à toute autre partie du corps. Le droit
pénal compte seulement en fonction de l’importance du dommage et selon ses
propres échelles. La castration n’est plus qu'une forme de violences parmi
d’autres.
Le sexe n’est donc plus pris en compte en tant que tel et sa protection n’a plus
aucune importance particulière au regard du droit pénal 41.
40
Le crime de castration suppose cependant la réunion de deux éléments : l’un matériel, l’amputation d’un
organe nécessaire à la génération ; l’autre psychologique, l’intention coupable d’anéantir la faculté de procréa-tion. 41
R. Gassin, Rapport de synthèse in Actes du Congrès de Criminologie intitulé De la castration en général et de quelques pratiques rituelles ou médicales en particulier, organisé à Villefranche les 10 et 11 octobre 1997. Voir également P. Couvrat, Mutilations sexuelles et qualifications pénales, in Actes du Congrès précité.
26
Dans le cas de l’excision, ce sont les conséquences médicales éventuelles (et
non voulues, bien au contraire) de l’acte qui peut entraîner une incapacité à
procréer et donc une castration de facto, en portant atteinte à une partie de
l’anatomie humaine qui participe du processus de l’enfantement, sans toute-
fois en constituer le principal élément. Si l’acte en lui-même n’empêche certes
pas la femme d’enfanter, il en complique systématiquement le déroulement 42.
Les tortures et actes de barbarie constituent le premier paragraphe des at-
teintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne, après les atteintes
à la vie, mais avant les violences même les plus graves. Comme le législateur
de 1810, le nouveau code pénal a omis de définir les « tortures et actes de
barbarie » qu’il incrimine. Cette situation est fâcheuse au regard du principe
de légalité dans un domaine où les peines sont particulièrement sévères 43. On
sait que la Cour européenne des droits de l’homme considère les tortures, au
sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, comme
impliquant des « traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et
cruelles souffrances » et « marqués d’une spéciale infamie » 44.
En définitive, quelle que soit la nature de l’acte, celui-ci est lié à l’idée de
cruauté et de perversité. Tout au plus l’atteinte à la dignité de la personne est-
elle plus marquée s’agissant des actes de barbarie.
Peut-on alors assimiler circoncision et excision à des tortures ou à des actes
de barbarie ? On a vu que l’élément matériel du crime de tortures ou actes de
barbarie consiste dans la commission d’un acte occasionnant à la victime une
douleur ou une souffrance aiguë. Or s’agissant des mutilations sexuelles, il ne
fait aucun doute qu’elles entraînent des souffrances importantes.
Mais, outre le facteur de l’âge, l’intensité de la souffrance infligée sera fonction
des techniques employées et de l’étendue de l’opération.
La fillette âgée d’une dizaine d’années, couchée sur le dos et maintenue par
plusieurs femmes, subit dans un premier temps l’excision du clitoris, d’une
partie des petites lèvres, puis l’avivement du bord des grandes lèvres sur
toute sa longueur, ne laissant subsister qu’un petit orifice au niveau de la ré-
gion périnéale dans lequel est inséré un petit tube afin d’assurer le passage
42
Voir annexe 1. 43
Cette lacune a d’ailleurs été soulignée par la doctrine, voir notamment J.P. Doucet, La protection pénale de la personne humaine, n°129 et Angevin, Jurisclasseur pénal, art. 222-1 à 222-6, Tortures et actes de barbarie n°29, qui suggère une interprétation restrictive de la notion de torture pour éviter une dérive dangereuse. 44
Arrêt Irlande c/Royaume-Uni, 18 janvier 1978, Publication de la Cour, Série A, n°25.
27
des urines et des règles. A l’issue de l’opération, un pansement est appliqué
sur la vulve et les membres inférieurs de la fillette sont immobilisés à l’aide
d’une longue pièce de cotonnade par un ligotage pelvipédieux maintenu en
place pendant dix à vingt jours. La fillette demeure au lit pendant un à deux
jours puis est autorisée à se déplacer en sautillant sur ses jambes entravées
en s’aidant d’un long bâton. Après cicatrisation complète, la vulve demeure
fermée et ne sera ouverte qu’au moment du mariage par l’exciseuse ou le ma-
ri au moyen d’un couteau si nécessaire.
Comment à la lecture de ces descriptions ne pas considérer qu’il s’agit de véri-
tables tortures ? On pourra rétorquer qu’il ne peut s’agir d’actes de barbarie,
étant donné que l’élément moral spécial de l’infraction fait défaut.
Car reconnaître la qualité de tortures ou d’actes de barbarie à certaines muti-
lations sexuelles revient donc à condamner toute pratique qui vise à briser la
volonté de l’homme et à détruire son humanité. L’individu a des droits qui doi-
vent lui être reconnus parce qu’il est une personne humaine, marquée comme
telle du sceau de la dignité. Ce fut le cas de mutilations sexuelles pratiquées
lors de la guerre en Yougoslavie.
Dans l’excision rituelle pourtant, ne pourrait-on pas admettre que le rôle de
l’opérateur est d’infliger des souffrances, l’enfant devant en quelque sorte ac-
quitter une dette de douleur pour une plus grande part de bonheur futur ? En
effet, dans les systèmes tribaux qui pratiquent des cérémonies rituelles, la
douleur s’inscrit dans une logique de totémisation. Elle n’est pas infligée au
hasard ; elle est le prix à payer par la jeune fille pour devenir un être à part
entière dans la société, pour y être réellement et totalement intégrée.
11..22..-- AAccttee ccrriimmiinneell «« oorrddiinnaaiirree »» ??
Dans la perspective criminelle, la qualification envisagée est celle de violences
volontaires ayant entraîné mutilation. Et il faut reconnaître que si, s’agissant
de la circoncision, la qualification de violences est la première qui vient à
l’esprit, s’agissant de l’excision, la Chambre criminelle de la Cour de cassation
s’est nettement prononcée en faveur de la compétence de la Cour d’assises 45.
45
G. Levasseur, Infractions contre les personnes, Rev. Sc. Crim. 1991, p.565.
28
Qu’il s’agisse de violences matérielles ou psychologiques, celles-ci doivent ce-
pendant être volontaires, intentionnelles. Selon Garraud 46, ce que la loi dé-
signe par l’expression « volontairement », c’est l’intention de se mettre hors la
loi, c’est à dire « la détermination de commettre une infraction dont on connaît
la criminalité ».
Qu’en est-il des exciseuses qui officient en France ? Le plus souvent informées
de la perception « criminelle » de leurs actes par la justice française, elles ne
peuvent accepter de se détacher de leur culture et agissent, en toute bonne
foi, pour assurer une bonne intégration de la jeune fille dans la société, perçue
« à l’américaine », c’est à dire comme l’intégration économique et géogra-
phique d’un groupe social qui garde ses valeurs originelles.
L’intégration « à la française » est individuelle et prépare en fait, sans le dire
explicitement, une assimilation ultérieure.
Par un arrêt célèbre du 20 août 1983, la Cour de cassation a décidé que
l’ablation du clitoris est une mutilation au sens de l’article 312 du code pénal,
introduit en 1981 : « Les faits révélés, à les supposer établis, réuniraient à la
charge de l’inculpé les éléments constitutifs du crime de violence exercé par
une mère légitime sur un enfant de moins de quinze ans et ayant entraîné au
sens de l’article 312 alinéa 3 du code pénal, une mutilation ».
Mais par la suite, les procès français se caractérisent par une gradation dans la
répression, c'est-à-dire une « dé-correctionnalisation » de l’excision et son as-
similation à une mutilation. Sur cette base qui conduit à criminaliser la qualifi-
cation de l’excision, le tribunal correctionnel de Créteil, saisi sur la qualification
de non-assistance à personne en danger, constata le 1er mars 1984 que les
faits étaient de nature à entraîner une peine criminelle et se déclara incompé-
tent. Cette décision fut confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Paris en
date du 4 avril 1984. En l’espèce, une petite fille, Bobo Traoré âgée de trois
mois et demi mourut le 13 juillet 1982, deux jours après avoir été excisée, pé-
riode au cours de laquelle elle a saigné sans discontinuer. Les faits devaient
être en réalité qualifiés « de coups et blessures volontaires sur mineure de
moins de quinze ans ayant entraîné la mort sans intention de la donner ». Il
convenait alors de retenir les parents comme complices.
46
R. Garraud, Traité de Droit pénal, 3ème
Ed., TV, p.323.
29
Dans cette affaire dite « de la petite Bobo », la dé-correctionnalisation de
l’excision n’a pas été uniquement la conséquence d’un montage juridique facile
mais aussi et surtout le fruit d’un travail de fond mené par les associations
constituées partie civile pour obtenir que le tribunal correctionnel de Créteil se
déclare incompétent et faire valoir, avec l’avocate des associations Maître Lin-
da Weil-Cureil, que l’excision, acte volontaire et mutilation, relevait bien de
l’article 312 du code pénal.
Par une décision du 4 décembre 1989, qui marque une autre escalade dans la
répression, la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Paris a renvoyé de-
vant la Cour d’assises de Paris deux parents et une exciseuse, pour y répondre
des crimes de coups, violences et voies de fait volontaires commis sur enfant
de moins de quinze ans ayant entraîné mutilations. Et la Cour d’assises de Pa-
ris, par arrêt du 8 mars 1991, a retenu la culpabilité des trois accusés, pro-
noncé à l’encontre des parents une peine de cinq ans de prison avec sursis et
mise à l’épreuve pour deux années, et condamné l’exciseuse à la peine de cinq
ans de réclusion criminelle. L’examen de ces décisions pénales permet de dé-
composer les fondements de l’approche juridique française en trois éléments :
• en premier lieu : l’excision constitue une atteinte à l’intégrité physique
et ses auteurs tombent de ce fait sous le coup de la loi pénale.
• ensuite : l’excision est susceptible de caractériser un état de danger
pour le mineur.
• et enfin : l’excision est considérée comme une mutilation.
La jurisprudence postérieure n’a fait d’ailleurs que confirmer le caractère muti-
lant et par conséquent criminel de ces pratiques. Les Cours d’assises saisies
par la suite, ont décidé de prononcer des peines de privation de liberté sans
sursis à l’encontre des exciseuses et parfois même des parents.
Depuis quelques années on assiste donc à une aggravation des condamnations
concernant les personnes responsables d’excision. Cette escalade des peines
démontre l’importance accordée par les tribunaux à la lutte contre ces mutila-
tions. Par conséquent, l’article 222-10 du nouveau code pénal (qui prévoit le
cas de violences ayant entraîné une mutilation) est donc a priori applicable
dans la mesure où il y a ablation du clitoris de la femme, qui on le rappelle
est un petit organe érectile situé sur la partie supérieure de la vulve. Mais on
30
voit combien (ce qui est normal) la jurisprudence est ici tributaire de l’opinion
médicale.
L'immixtion du judiciaire, dans ce qui est considéré en France comme un pro-
blème de société sur lequel l'opinion publique s'exprime, dénote incontesta-
blement la volonté des pouvoirs publics de privilégier la répression comme
moyen d'éradiquer ces pratiques. Mais l'action des tribunaux, dans cette lutte,
devait être confortée et appuyée par le législateur afin de lui donner une base
légale plus claire.
22..-- EEFFFFIICCAACCIITTÉÉ DDEE LLAA PPRRÉÉVVEENNTTIIOONN PPAARR LLAA SSAANNCCTTIIOONN
D’un point de vue criminologique, la sanction a une fonction bien précise dont
l'effet doit être apprécié en toute objectivité.
La sanction a pour principale fonction d'intimider la collectivité, d'impression-
ner les membres du groupe afin que ceux-ci ne commettent pas d'infraction.
La peine a, par conséquent, un effet dissuasif inhibiteur sur une éventuelle ac-
tivité répréhensible. C'est une épée de Damoclès qui plane sur chaque indivi-
du, une « conscience forcée » de respecter les règles sociales. La sanction in-
tervient donc, a priori, pour prévenir l'infraction. Mais elle intervient égale-
ment, a posteriori, une fois l'acte commis. Dans ce cas, la peine a pour but la
prévention spéciale individuelle, c'est à dire qu'elle empêchera le délinquant
de recommencer.
Aujourd'hui, en effet, l'accent est mis sur l'importance d'un système de protec-
tion des droits individuels s'imposant impérativement au législateur. Cette pro-
tection pénale est accordée directement à l'être physique, qu'il soit ou non su-
jet de droit. Le corps de l'être humain, support matériel de la personnalité,
doit être protégé dans son intégralité. La notion de corps humain est entendue
dans son acception la plus large : elle recouvre non seulement tous les élé-
ments corporels dont la conservation intéresse la société, mais encore certains
éléments particulièrement intimes.
Aujourd'hui, en France, la circoncision n’a pas fait l'objet de nombreuses con-
damnations pénales, ce qui est peut-être à déplorer.
Pour les personnes qui enfreignent la loi pénale en pratiquant une excision, en
particulier lorsqu'il s'agit des parents, l’acte n'obéit à aucun calcul et s'impose
31
presque à leur conscience. Dans ces conditions, la force contraignante de la
menace de la sanction s'avère relativement limitée. De plus, si ces personnes
connaissent le risque de répression, la plupart affirment n'en avoir pas connu
l'application. Cela tient d’ailleurs au fait que beaucoup de condamnations sont
assorties du sursis. Or, pour les auteurs d'excision, la peine avec sursis n’est
pas perçue comme une véritable condamnation car ils sortent libres du tribu-
nal. Dans ces conditions, la plupart d’entre eux ne comprend pas le « pour-
quoi » de la procédure.
Sur le plan psychologique, il semble que les condamnations en Cour d’assises
ne soient pas comprises et entraînent une série de manifestations cliniques
regrettables : anxiété liée à une culpabilité provoquée, angoisse d'abandon,
dépression consécutive au sentiment de rupture de filiation, de perte d'identité
et d'appartenance au groupe.
La plupart des Africains qui comparaissent devant les juridictions françaises
pour excision restent donc hermétiques à toute la procédure. Ce procès de-
vient celui d'une culture face à une autre culture, ce qui implique de devoir
choisir entre deux victimes : les mères-victimes de l'excision et leurs filles. Les
associations parties civiles le savent bien ; elles affirment, entre les deux vic-
times, choisir la plus faible c'est à dire l'enfant, choisir l’avenir plutôt que le pré-
sent. Mais n’est-ce pas le présent, et plus encore le passé, qui modèlent l’avenir ?
Une bonne justice n'est certainement pas celle rendue à l'aide de considéra-
tions ethnocentriques. Bien au contraire, valoriser les données de sa propre
culture prise comme élément de référence conduit à la diabolisation des diffé-
rences et au rejet de l'autre.
Finalement, le constat de l'effet dissuasif de la répression est bien sombre : les
mesures de traitement pénal de l'excision connaissent un certain échec. Non
seulement la justice française apparaît cruelle, injuste et surtout incompréhen-
sible, mais encore, elle ne semble pas aboutir à la resocialisation du délin-
quant, et à son intégration dans « notre » société.
32
33..-- PPRRÉÉVVEENNTTIIOONN PPAARR LL’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN EETT LL’’ÉÉDDUUCCAATTIIOONN SSOOCCIIAALLEE
La profession médicale est, dans le domaine qui nous préoccupe, la mieux pla-
cée pour émettre une opinion et envisager les différentes formes de lutte
contre des pratiques qui portent atteinte au corps humain. Mais, à côté des
médecins, gravite tout un personnel de soutien et d'encadrement qui est sou-
vent directement confronté au problème. Dans un cas comme dans l'autre, il
s'agit de personnes compétentes et actives, mais il faudrait aussi former ces
personnels à l’importance de l’excision pour certaines cultures. Il faut dévelop-
per chez les professionnels un sentiment de compréhension si l’on veut qu’ils
trouvent ensuite les mots et les attitudes qui permettent aux personnes con-
cernées d’évoluer. A l’obligation d'information du corps médical et para-
médical, et même social, s'ajoute une obligation de conseil. L'activité médicale
ne se limite pas à l'accomplissement de l'acte sur le corps humain, elle s'étend
également aux conseils, au dialogue, à l'aide morale. Tout le personnel doit
pouvoir répondre aux attentes d'une population ignorante et mal informée.
Les moyens de lutte et de prévention doivent en effet s'adapter à des popula-
tions où l'analphabétisme atteint parfois les 75%. Une fois le barrage de la
langue dépassé, grâce à la présence d'interprètes lors des consultations, tous
les moyens doivent être mis en œuvre pour véhiculer une autre image de
l'homme et de la femme. Ainsi l'action des associations para-médicales et des
centres éducatifs se développe autour des moyens modernes de communica-
tion et d'accès à la culture (campagnes publicitaires, conférences, films, chan-
sons ...). En 1959, un film a été réalisé sur les pratiques d’excision chez les
Banda, tribu des Linda (Oubangui Chari). En 1963, un autre documentaire ci-
nématographique présentait les cérémonies d’initiation et de passage aux-
quelles sont soumis les jeunes gens de la société des Niakari (République
Centre-Africaine) 47.
En pratique, l'information devrait porter sur les mutilations en elles-mêmes
ainsi que sur les conséquences physiques et psychologiques qu'elles impli-
quent. Afin de prévenir ces pratiques mutilantes, le médecin doit expliquer les
répercussions corporelles qu'elles entraîneront inévitablement. Cela présup-
pose une certaine connaissance anatomique chez les personnes concernées.
Or force est de constater la méconnaissance des gens sur leur propre anatomie.
47
Cérémonies d’excision chez les Banda-Linda et circoncision chez les Niakari, Internet, nocir.org.
33
Les excisions pratiquées sur le sol national concernent essentiellement les po-
pulations maliennes. L'infibulation caractérise les sociétés somaliennes et sou-
danaises. Ces populations étrangères se trouvent principalement dans les dé-
partements de la région parisienne, mais aussi en Seine-Maritime, dans les
Bouches du Rhône, la Marne, la Gironde, l'Isère, le Var, le Haut-Rhin.
Le service des étrangers de la préfecture de Seine-Saint-Denis a fourni au Mi-
nistère de l'Intérieur quelques données démographiques concernant l'excision
dans ce département. Ainsi les ressortissants des pays où se pratique l'exci-
sion représentent 5,8 % de la population immigrée au-delà de seize ans, et 1,3
% de l'ensemble de la population du département de la Seine-Saint-Denis au-
delà de dix-huit ans. Aujourd’hui, le pourcentage de l'ensemble des immigrés
par rapport à la population totale du département est d’environ 18,9 %. La po-
pulation globale âgée de plus de dix-huit ans représentant 1.008.704 per-
sonnes, il est probable que parmi les 5.040 femmes résidant en Seine-Saint-
Denis, 70 % environ sont excisées ou infibulées, soit au moins 3.500 femmes.
Ces statistiques, plutôt alarmantes, démontrent que les ressortissants étran-
gers qui s'installent en France sont tout à fait ignorants de la législation natio-
nale. Ils apportent avec eux leurs traditions, leur culture, qu'ils vont appliquer
en totale méconnaissance des règles du pays d'accueil. C'est pourquoi il est
nécessaire d'informer les immigrés sur la teneur des textes en vigueur dès
leur arrivée en France. De plus la justice peut, dans certains cas, envisager
des modes d'intervention en terme d'aide apportée au mineur et à sa famille.
Tel peut être l’un des objets de la procédure d'assistance éducative, qui peut
manifestement s’appliquer dans ces situations.
On peut se demander si, pour plus d’efficacité, on ne devrait pas faire systé-
matiquement intervenir les représentants des communautés religieuses, comme
ce fut le cas au Mali. D’autant que depuis quelques jours, la religion islamique
a signé une convention avec l’État instituant une représentation nationale offi-
cielle. C’est par ce biais que l’on peut progresser pour aider les populations
étrangères d’origine africaine.
34
CCOONNCCLLUUSSIIOONN
LLaa lluuttttee ccoonnttrree ll’’eexxcciissiioonn,,
aauu nnoomm ddeess DDrrooiittss ddee ll’’HHoommmmee,,
ppoouurr qquueellllee iinnttééggrraattiioonn ddaannss llaa ssoocciiééttéé ??
Il est clair que les pays africains sont en mutation sur la question de l’égalité
des sexes. L’UNESCO espère que l’excision aura pratiquement disparu d’ici
trois générations. Il est indéniable que l’idée des Droits de l’Homme, au sens
occidental du terme, fait son chemin de par le monde. Il ne faut pas mésesti-
mer cependant les obstacles qu’il reste à franchir.
Le premier est certainement le sentiment de supériorité trop couramment affi-
ché par les occidentaux. Cela crée régulièrement, comme au Caire, des senti-
ments de rejet qui ne peuvent que freiner l’appropriation par tous les peuples
des principes d’égalité entre tous les êtres humains et du respect nécessaire
de leur intégrité physique.
Le second est probablement financier. Mettre en œuvre des programmes
d’éducation comme il en a été monté dans différents pays coûte cher. Mais
l’investissement serait particulièrement rentable.
Le troisième obstacle est finalement la poutre que nous avons dans l’œil. Ne
faudrait-il pas commencer en cherchant à faire évoluer, en France, d’une part
notre propre droit, d’autre part les conditions d’accompagnement des per-
sonnes concernées ? Pour faciliter leur intégration, il paraît nécessaire de les
informer. Les immigrants au Canada reçoivent pendant six mois gratuitement
(et perçoivent même une allocation pendant ce temps) une formation spéci-
fique aux langues , aux lois et aux coutumes canadiennes. On pourrait s’en
inspirer et faciliter ainsi la connaissance de notre pays, préalable incontour-
nable à toute intégration éventuelle.
Pourquoi d’autre part ne pas organiser en France une conférence nationale sur
le sujet de l’excision ? Cela pourrait être l’occasion de réaffirmer, dans une pé-
riode où les « communautés » étrangères déclarent subir de plus en plus de ré-
actions racistes, à quel point la France souhaite à la fois respecter les cultures,
préserver la santé des individus et faciliter leur intégration individuelle.
35
AANNNNEEXXEE 11
LL’’eexxcciissiioonn,, uunn ttéémmooiiggnnaaggee Khadidia Diawara 48
48
in Femmes Actuelles du 24-30 mai 1999, p. 22
A l'âge de trois ans, j'ai été excisée. En même temps, j'ai été scarifiée, c'est-à-dire qu'on m'a marqué le visage. Je n'ai pas de souvenir de cette sombre journée. Mais toute ma vie je me suis demandée pourquoi. A mes sempiter-nelles questions, ma mère me répondait que c'était une tradition Soninké - mon ethnie - de scarifier et d'exciser les femmes :
"Une femme qui ne l'est pas est impure. Elle ne peut ni se marier ni faire ses prières", me disait-elle. C'était sa seule explication. Puis elle finissait par dire: "Tais-toi, il ne faut plus parler de ces choses-là."
Je croyais donc que toutes les petites filles du monde subissaient l'excision. Mais à dix ans, j'ai découvert que je me trompais, car des co-pines Wolof, une autre ethnie du Sénégal, m'ont dit qu'elles savaient que j'étais excisée, contrairement à elles, et que ce n'était pas bien.
A quatorze ans, j'ai osé lui dire que je ne fe-rais jamais exciser ma fille, car c'était une af-freuse coutume. "C'est une honte, m'a-t-elle dit. C'est le devoir d'une mère".
Je me suis mariée à 16 ans. J'étais promise depuis mes 8 ans, comme cela se fait mal-heureusement dans mon ethnie. J'étais terri-fiée. Je ne voulais pas me marier. Mon mari travaillait en France et faisait des allers-retours pour me voir. J'ai eu mon premier en-fant à 19 ans. J'ai souffert le martyre. Tous mes accouchements ont été aussi abomi-nables.
En 1983, j'ai rejoint mon mari en France. Loin de mon pays, j'ai commencé à déprimer. Alors, je me suis inscrite au centre social du quartier. Je voulais rencontrer d'autres femmes.
En 1994, une amie qui en faisait partie m'a parlé du GAMS, le Groupe des femmes pour l'abolition des mutilations sexuelles et m'a poussé à assister à une conférence. Des mé-decins y ont parlé de l'anatomie de la femme. A 40 ans, je découvrais comment était formé mon appareil génital, et surtout la différence entre une femme excisée et non excisée.
En Afrique, personne ne parle jamais de sexe. Et là, j'ai ressenti une grande colère. Depuis longtemps, je rêvais de lutter contre cette pra-tique, pourtant j'ignorais les problèmes médi-caux qu'elle implique: les hémorragies, les douleurs abdominales, les accouchements difficiles et risqués...
Toute ma vie, j'ai vécu avec des douleurs in-supportables au ventre. Et le soir de mes noces, j'ai eu tellement mal que je me suis évanouie.
Le sexe d'une femme excisée, c'est comme une plaie constante qu'on aspergerait d'al-cool. Mais en Afrique, personne ne lie ces maux à l'excision.
D'ailleurs, les femmes ne peuvent faire de rapprochement, car elles ne parlent jamais de ça entre elles. Lorsqu'une mère ou un bébé meurt pendant l'accouchement, on dit que c'est Dieu qui l'a voulu, que les femmes sont nées pour souffrir.
Aujourd'hui, je milite dans le GAMS, je vais à la rencontre des familles africaines pour les convaincre de ne pas faire exciser leurs filles. Elles changent souvent d'avis lorsqu'on leur explique que leurs filles risquent de mourir pendant la "cérémonie".
Les mères sont étonnées d'apprendre que l'excision est la cause de leur propre souf-france. Les hommes musulmans, eux, accep-tent de ne pas le faire quand ils apprennent que ce n'est pas inscrit dans le Coran.
Pour ma part, je n'ai pas eu à persuader mon mari, il trouvait déjà cette coutume abominable.
Je suis africaine et fière de l'être, mais une société doit évoluer. Il faut savoir garder les bonnes coutumes, celles qui participent à l'épanouissement de nos enfants et se sépa-rer des autres.
Je ne me suis jamais sentie une femme à part entière. Ma chair est mutilée. Pour moi, le sexe n'est que douleur. Longtemps j'en ai voulu à ma mère. Je lui ai expliqué ce qu'était l'excision. Elle a enfin compris, et mes sœurs n'ont pas fait exciser leurs filles.
36
AANNNNEEXXEE 22
EExxeemmpplleess ddee llééggiissllaattiioonnss aaffrriiccaaiinneess
7 pays africains sur les 26 pratiquant l’excision se sont déjà dotés d’une loi la réprimant. Il
s’agit du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, de la Guinée, du Nigéria, du Gha-
na et de l’Égypte.
11..-- LLee SSéénnééggaall
Depuis 1998, ce pays punit de 6 mois à 5 ans quiconque aura porté, ou tenté de porter
atteinte à l’intégrité de l’organe génital d’une personne de sexe féminin. Lorsque ces muti-
lations auront entraîné la mort, la peine des travaux forcés à perpétuité sera toujours pro-
noncée.
22..-- LLaa CCôôttee dd ’’IIvvooiirree
Depuis 1998, L’excision est punie de un à cinq ans d’emprisonnement et de l’équivalent
de 2 à 20.000 FF. Si la victime est décédée des suites de l’opération, la peine est portée à
20 ans de prison.
33..-- LLee BBuurrkkiinnaa FFaassoo
Le code pénal burkinabé prévoit un emprisonnement de six mois à 3 ans, et de 5 à 10 ans
si l’excision a entraîné la mort.
Les exciseuses traduites devant les tribunaux sont en général condamnées à des peines
allant jusqu’à cinq mois de prison et l’équivalent de 500 FF d’amende (soit le prix de 50
excisions).
44..-- LL ‘‘ÉÉggyyppttee
En Égypte, aucune loi n’interdit l’excision, mais elle doit impérativement être pratiquée par
un médecin (ce qui n’est pas le cas pour 85 % des fillettes). Le gouvernement a de plus
interdit que ces opérations se fassent dans les hôpitaux, mais il n’est pas suivi.
37
AANNNNEEXXEE 33
BBiibblliiooggrraapphhiiee
ANGEVIN H., Atteintes volontaires à la vie, Juris-classeur Pénal art. 221-1 à 221-5, février 1995. Tortures et actes de barbarie, Juris-classeur Pénal, art. 222-1 à 222-6, février 1998. AUFFRET S., Des couteaux contre les femmes, Des Femmes, 1983. AYAD Christophe, Egypte, les exciseurs plus forts que la Loi, in Libération du 29 décembre 1997. BESSON JM., La douleur, Odile Jacob, 1992 ALDEEB A.S., Mutiler au nom de Yahvé ou d’Allah, légitimation religieuse de la circoncision masculine et fémi-nine, Institut de Droit comparé de Lausanne, Suisse. AMBROSELLI C., L’éthique médicale, coll. Que sais-je ?, PUF, 1994. BETTELHEIM Bruno, Les Blessures symboliques, Gallimard, Paris, 1971. BONAPARTE Marie, Notes sur l’excision, Revue Française de psychanalyse, XII, 1946. BOUHDIBA A., La sexualité en Islam, Quadrige / PUF, 1986. BOURGEOIS B., Droit, religion et droits de l’homme, in Archives de philosophie du droit, Droit et religion, t. 38, Dalloz 1993. CANSEVER G., British Journal Medical of Psychology, décembre 1995. CARBONNIER J., La religion, fondement du droit, in Archives de philosophie du droit, op. cit. CHAZAL, La notion de danger couru par l’enfant dans l’institution française d’assistance éducative, Mélanges An-cel, 1975. COMITE INTER-AFRICAIN, Rapport d’activité régional sur les pratiques traditionnelles ayant effet sur la santé des femmes et des enfants en Afrique, G.A.M.S., Paris, 1994. CONVENTION adoptée à New York le 10 décembre 1984 relative aux tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants J-Cl. Pén., app. Art. 295 à 378, février 1992. COQUERY-VIDROVITCH C., Les Africaines : histoire des femmes d’Afrique noire du 19
ème au 20
ème siècle, 1994.
38
CORNAVIN T., Théorie des droits de l’homme et progrès de la biologie, PUF, coll. Droits, N°2, 1985. COUVRAT P., Mutilation sexuelle et qualification pénale in Congrès de criminologie intitulé « De la castration en général et de quelques pratiques rituelles ou médicales en particulier » organisé à Villefranche les 10 et 11 octobre 1997. DAIGRE (R.P.), Les Bandas de l’Oubangui-Chari, Anthropos T.XXVII, 1932. DEKEUWER-DEFOSSEZ F., Droits des femmes, dictionnaire juridique, Dalloz 1985. Les droits de l’enfant, 2
ème Ed., coll. Que sais-je ?, PUF, 1993.
DESPORTES F., LE GUNEHEC F., Le nouveau droit pénal, T.1 : Droit pénal général, 2
ème Ed., Economica, 1996.
DIAWARA Khadidia, L’excision, un témoignage, in Femme Actuelle du 24-30 mai 1999. DOUCET J.P., La protection pénale de la personne humaine, vol. 1, Protection de la vie et de l’intégrité corporelle, 2
ème Ed, Litec, 1994.
DUNEZAT P., Les mutilations sexuelles rituelles sur les femmes in Congrès de criminologie de Villefranche, op. cit. EL KHAYAT-BENNAI G., Le monde arabe au féminin, L’Harmattan, Paris 1985. EL MASNY Y., Le drame sexuel de la femme dans l’orient arabe, 1962. EL-SAYAD Amine et HAJJAJ Hanan, L’excision, un drame égyptien, in Courrier International n° 210, 10 au 16 novembre 1994. ERLICH M., Notion de mutilation et criminalisation de l’excision en France, in Atelier des droits des peuples et droits de l’homme, Mutilations sexuelles : l’excision, Droit et culture, 20, 1990. Les mutilations sexuelles, coll. Que sais-je ?, PUF, 1991. La femme blessée : essai sur les mutilations sexuelles féminines, l’Harmattan, 1995. FAINZANG S., Excision et ordre social, in Atelier droits des peuples et des droits de l’homme, op. cit. GARRAUD R., Traité théorique et pratique du droit pénal français, 5
ème Vol, 3
ème Ed., 1935.
GASSIN R., Rapport de synthèse du Congrès de Criminologie intitulé in Congrès de criminologie de Ville-franche, op. cit. Précis Dalloz de Criminologie, 3
ème Ed., 1994
GAUDIO, ATTIKLIO et PELLETIER, Femmes d’Islam ou le sexe interdit, Denoël-Gonthier, Paris, 1980. GAUVAIN-PIQUARD A., L’impact de la douleur physique dans la vie psychique, Synapse décembre 1994, N°111, p 25. La douleur chez l’enfant, MEDSI, 1989. GIUDICELLI-DELAGE G.,
39
Excision et droit pénal, in Atelier des droits des peuples et droits de l’homme, op. cit. GOETZ M., Circoncision et religions in Congrès de criminologie de Villefranche, op. cit. GORDON P., L’initiation sexuelle et l’évolution religieuse, Paris, PUF, 1946. GROULT B., A. DE BENOIST et R. COOK, Articles, au sujet de l’excision et de l’infibulation, Revue internationale de criminologie et de police tech-nique 1978, p. 259 et s. HALLIEZ D., La castration et l’excision, justifications et répression, mémoire année 1990-1991, Université de Nancy, sous la direction du Professeur A. SEUVIC. HENRY Natacha, L’excision vue par la religion, in Notre Histoire, n° 151, 1997. LARGUIER J. et AM, Le droit pénal, coll. Que sais-je ?, PUF, 1994. LAROUSSE Pierre, Grand Dictionnaire Universel du XIX
è siècle, 1876.
LEVASSEUR G., Infractions contre les personnes, Revue de Sciences Criminelles 1991, p.565. LITTRÉ Émile, Dictionnaire de la Langue Française, 1873. LUNEAU (R.P.), Chants de femmes au Mali, Ascot, 1981. MAERTENS J.T., Les mutilations rituelles encore et toujours, in Atelier des droits des peuples et droits de l’homme, op. cit. MAUSS M., Sociologie et anthropologie, Paris, PUF, 1950. MENDRAS H., Eléments de sociologie, Armand Colin, Paris, 1975. NDIAYE Soguy, APROFES, Sénégal, Loi contre l’excision et poids de la tradition, in Documents, site internet penelopes.org. NEIRINCK C., La protection de la personne de l’enfant contre ses parents, LGDJ, Paris, 1984. NATHAN T., in Nouvelle Revue d’Ethnopsychiatrie, n°8, 1992. PARINGAUX Roland-Pierre, Le serment de Malicounda, in Le Monde du 14 octobre 1997. RIDEAU-VALENTINI S., L’excision, rapport de recherche en psychiatrie criminelle, sous la direction du professeur JARRET, 1995-1996. L’excision : victimes de coutumes, in Congrès de criminologie de Villefranche, op. cit. ROBERT J., avec la collaboration de DUFFAR J., Droits de l’homme et libertés fondamentales, Montchrétien, 1994.
40
ROSENBERG-REINER S., BUISSON C. et CHERU F., La douleur postopératoire chez l’enfant, Objectif Soins n°44, juin-juillet 1996. RUDE-ANTOINE E., L’immigration face aux lois de la République, l’excision : un exemple de conflit de lois et de cul-tures, Kathala, 1991. SACRÉ-COEUR (Sœur Marie-André du), La Condition humaine en Afrique noire, Grasset, 1953. Société canadienne de pédiatrie, La circoncision néonatale revisitée, site Internet nocirc.org. SOVIDE Valentin, Excisée ou dépravée, in La Nation, quotidien béninois, 27 novembre 1998. STOTZ Joëlle, Le Burkina Faso fait reculer l’excision, in Le Monde Diplomatique, septembre 1998. VALET Gilles-Marie et FIORINA Serge, médecins hospitaliers de pédo-psychiâtrie, in Les Archives de Carnet Psy, 1999. VAN GENNEP A., Les rites de passage, étude systématique des rites, 1909, A. et J. PICARD Paris, 1981. VERDIER R., Chercher remède à l’excision : une nécessaire concertation, in Atelier des droits des peuples et droits de l’homme, op. cit. VERNIER Dominique, Droits à la différence contre droits de l’enfant, in Le Monde Diplomatique d’octobre 1998. WEIL CURIEL L., Excision : culture et blessures, Droit de l’enfance et de la famille, 1985. ZWANG G., Le sexe de la femme, La Musardine, 1997.