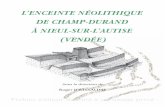Eperons barrés du Néolithique récent en contexte insulaire : l’Île d’Yeu (Vendée)
-
Upload
archeodunum -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Eperons barrés du Néolithique récent en contexte insulaire : l’Île d’Yeu (Vendée)
Néo.
Sous la direction deRoger JOUSSAUME et Jean-Marc LARGE
Sophie CORSON, Nelly LE MEUR et Jean-Pierre TORTUYAUX
Enceintes néolithiquesde l’Ouest de la France
de la Seine à la Gironde
Association des PublicationsChauvinoises (Mém. XLVIII),Chauvigny, 2014
1
Actes du colloque CrabeNéoEnceintes néolithiques de l’Ouest de la France de la Seine à la Gironde
Sommaire
– p. 7 –Organisation du colloque
Comité scientifiqueComité de lecture
Comité d’organisation et secrétariat du colloqueAuteurs
– p. 11 –Préface
Guy SAN JUAN, Christophe VITAL
– p. 15 –Avant-propos
Jean-Pierre TORTUYAUX
– p. 17 –
Colloque sur la Recherche Archéologique du Bâti et des Enceintes du Néolithique
“Les enceintes néolithiques de l’Ouest de la France entre Seine et Gironde”
Roger JOUSSAUME, Jean-Marc LARGE
– p. 21 –Excursion du 19 septembre 2012
Roger JOUSSAUME, Nelly LE MEUR, Jean-Marc LARGE
Fichier éditeur destiné à un usage privé
Fichier éditeur destiné à un usage privé
– p. 27 –SESSION 1 : ARCHITECTURES
NÉOLITHIQUE MOYEN, RÉCENT ET FINAL
Premières reconnaissances du site du Castel à Barneville-Carteret (Manche) et de ses structures internes – p. 29
Cyrille BILLARD, Fabien DELRIEU, Nicolas LE MAUXavec la collaboration de
Axelle GANNE, Sophie QUEVILLON, Anne ROPARS
Données préliminaires sur les structures internes de l’enceinte de Goulet “Le Mont” (Orne) – p. 51
Cyrille BILLARD, François CHARRAUD, Axelle GANNE, Cécile GERMAIN-VALLÉE, Emmanuel GHESQUIÈRE, Guillaume HULIN, Fanny JUDE, Chantal LEROYER,
Cyril MARCIGNY, Nancy MARCOUX
Enceintes du Néolithique moyen 1 et du Néolithique moyen 2en Normandie : exemples récents – p. 63Emmanuel GHESQUIÈRE, Cyril MARCIGNY
L’enceinte néolithique de Sublaines (Indre-et-Loire) – p. 83Éric FRÉNÉE, Morgane LIARD, Tony HAMON
Le site des 4 Chevaliers à Périgny (Charente-Maritime).Présentation et contexte chrono-culturel d’une enceinte du Néolithique moyen du Centre-Ouest de la France – p. 99
Ludovic SOLER
Le Priaureau à Saint-Gervais (Vendée).Un exemple de l’évolution d’une enceinte du Néolithique récent – p. 117
Benoît POISBLAUD
Occupation, architecture et fonction d’une enceinte fossoyée du Néolithique récent. Apport des fouilles récentes du site de
Bellevue à Chenommet (Charente) – p. 131Vincent ARD
L’enceinte du Néolithique récent/final de Basly “La Campagne” (Calvados).Un habitat groupé, ostentatoire et défensif ? – p. 149
Nicolas FROMONT, Guy SAN JUAN, Jean-Luc DRON, Michel BESNARD
2
Enceintes néolithiques de l’Ouest de la France de la Seine à la Gironde
Fichier éditeur destiné à un usage privé
Sommaire
La Chevêtelière (L’Île-d’Olonne et Saint-Mathurin, Vendée).Présentation du site et représentation SIG tridimensionnelle. Interprétation stratigraphique – p. 163 (Article non parvenu)
Patrick PÉRIDY, Mathieu HILLAIRET
Les enceintes néolithiques de La Rue des Venelles à Chaillé-les-Marais (Vendée)et de Matheflon à Seiches-sur-le-Loir (Maine-et-Loire) – p. 165
Bertrand POISSONNIER
Éperons barrés du Néolithique récent en contexte insulaire : l’île d’Yeu (Vendée) – p. 179
Audrey BLANCHARD
– Session 1 – Échange collectifArchitectures – Néolithique moyen et récent – p. 193
Les bâtiments sur poteaux plantés de l’enceinte de la fin du Néolithique à Avrillé “rue des Menhirs” (Vendée) – p. 201
Nicolas FROMONT, Philippe FORRÉ, Vincent ARD, Klet DONNART
Trois, voire cinq nouvelles enceintes à proximité du Marais d’Olonne. Données préliminaires sur l’occupation et les berges du marais aux “Caltières”
et à “la Goujonne” à Olonne-sur-Mer (Vendée) – p. 215Nicolas FROMONT, Philippe FORRÉ, Mathieu HILLAIRET, Carole VISSAC, Denis FILLON
Les enceintes du Néolithique récent et final dans les régions de la Loire moyenne : état de la question – p. 227
Tony HAMONavec la participation de Nicolas FOUILLET, Rolland IRRIBARRIA
– Session 1 – Échange collectifArchitectures – Néolithique moyen et récent – p. 237
– p. 253 –SESSION 2 : ENVIRONNEMENT
Les composantes du paysage et des territoires au Néolithique moyen : deux exemples dans la plaine sédimentaire bas-normande – p. 255
Emmanuel GHESQUIÈRE, Cyril MARCIGNY
3
Quelques remarques d’archéologie spatiale concernant la distributiongéographique des enceintes néolithiques du Centre-Ouest de la France et
des marges du Massif armoricain – p. 273Gwenolé KERDIVEL
– Session 2 – Échange collectif – Environnement – p. 291
La place des coquillages marins dans les enceintes néolithiques de l’Ouest de la France : bilan quantitatif et notion de territoire – p. 293Catherine DUPONT, Vincent ARD, David CUENCA SOLANA, Yves GRUET,
Gwénaëlle HAMON, Luc LAPORTE, Sandra SICARD, Ludovic SOLER
– Session 2 – Échange collectif – Environnement – p. 307
L’exploitation de la végétation ligneuse sur le site de Champ-Durand, Nieul-sur-l’Autise (Vendée) au Néolithique récent – p. 309
David AOUSTIN
– Session 2 – Échange collectif – Environnement – p. 317
La question de l’utilisation du torchis dans l’aménagement des enceintesnéolithiques du Centre-Ouest de la France : exemples comparés des
enceintes de Champ-Durand à Nieul-sur-l’Autise (Vendée) et de Bellevue à Chenommet (Charente) – p. 321
Marylise ONFRAY
– Session 2 – Échange collectif – Environnement – p. 335
– p. 337 –SESSION 3 : FUNÉRAIRE
Représentations différentielles d’ossements humains et fonction funéraire des fossés – p. 339
Patricia SEMELIER
Les dépôts humains en contexte d’enceinte néolithique.De nouveaux regards sont-ils possibles ?
Le cas du Centre-Ouest de la France – p. 351Ludovic SOLER
– Session 3 – Échange collectif – Funéraire – p. 363
4
Enceintes néolithiques de l’Ouest de la France de la Seine à la Gironde
Fichier éditeur destiné à un usage privé
Sommaire
– p. 369 –SESSION 4 : COMPLEXES TECHNO-CULTURELS –
TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE, LITHIQUE
Des enceintes qui ne manquent pas de sel.Les vases de “type Champ-Durand” comme témoins d’une activité spécifique
aux pourtours des Marais poitevin et charentais – p. 371Vincent ARD, Olivier WELLER
De l’opale résinite débitée par pression au Néolithique récent en Vendée – p. 387
Justine PAPON, Jacques PELEGRIN
Du début du Néolithique moyen au Néolithique récent en Normandie et dans les îles Anglo-Normandes :
chronologie et sites enclos – p. 405Cyril MARCIGNY
– Session 4 – Échange collectifComplexes techno-culturels – Technologie céramique, lithique – p. 419
L’apport de l’expérimentation à la lecture des grands fossés ouverts – p. 427Bertrand POISSONNIER
Étudier différemment les ensembles fossoyés néolithiques.Regards croisés entre géophysiciens et archéologues – p. 437Vivien MATHÉ, Vincent ARD, François LÉVÊQUE, Adrien CAMUS
– Session 4 – Échange collectifComplexes techno-culturels – Technologie céramique, lithique – p. 449
– p. 453 –SESSION 5 : RÉFLEXIONS
Enceintes néolithiques de l’Ouest de la France : une archéologie des fossés ? – p. 455
Luc LAPORTE, Catherine BIZIEN-JAGLIN, Jean-Noël GUYODO
Synthèse du colloque – Perspectives de recherches – p. 489
5
Fichier éditeur destiné à un usage privé
179
Actes du colloque CrabeNéoEnceintes néolithiques de l’Ouest de la France de la Seine à la Gironde
Éperons barrés du Néolithique récent en contexte insulaire : l’île d’Yeu (Vendée)
Audrey BLANCHARD
Résumé Au Néolithique récent (3e-2e millénaires avant J.-C.), en parallèle des traditionnelles enceintesfossoyées, de nouvelles modalités d’implantations humaines émergent sur le littoral sud-armoricain :des éperons barrés par des talus font ainsi leur apparition. L’île d’Yeu (Vendée) compte plusieursgisements de ce type, tout comme le littoral morbihannais. Ces sites présentent de nombreux pointscommuns : modalités d’implantations, architecture et culture matérielle. Cet article propose dediscuter plus particulièrement de l’architecture et des modalités de construction des talus. Cesstructures solides et modulaires sont adaptées à la configuration du terrain, ce qui explique la variétédes modèles architecturaux. Les techniques architecturales sont très proches de celles mises en œuvredans le mégalithisme. L’hypothèse d’une saisonnalité et/ou temporalité de ces implantationscôtières, déjà soupçonnée pour les installations littorales sud-armoricaines et les contextes insulairesmorbihannais, trouve ici un écho méridional.
Mots-clefs : éperon barré, talus, architecture, pierres sèches, dalles dressées, Néolithique récent, îled’Yeu.
Abstract In the Late Neolithic (IVth-IIIrd mill. BC), contemporary with the causewayed enclosures, newmodalities of human occupation emerged on the south-Armorican coast: promontories cut off bybanks. Île d’Yeu (Vendée) counts several sites of this type, just like the Morbihan coast.
These sites present numerous common points: modalities of settlement, architecture and materialculture. This article suggests discussing more particularly the architecture of earthworks and theirvarious construction techniques. These solid and modular structures are adapted to the lie of theland, which accounts for the variety of architectural models. The architectural techniques are veryclose to those used in megalithism. The hypothesis of a seasonality and/or temporality of the coastalsettlements, already envisaged for south-Armorican coastal installations and island contexts, findshere a southern abetment.
Key-words : barred spur, earthwork, architectures, dry stones, standing stones, Late Neolithic, îled’Yeu.
Fichier éditeur destiné à un usage privé
Différentes formes d’habitat caractérisent le Néoli-thique récent de l’Ouest de la France. Les enceintesfossoyées du Centre-Ouest constituent les gisementsles plus emblématiques de cette période. Néanmoins,de récentes fouilles programmées mettent en évidencel’émergence de nouvelles modalités d’implantationshumaines sur le littoral sud-armoricain et sur les îlesde la façade atlantique. Des éperons sont alors barrés(et non cernés intégralement) par des architecturesbâties, pour certaines encore partiellement conservéesen élévation ; c’est notamment le cas à l’île d’Yeu.
Au large des côtes vendéennes, ce petit territoireinsulaire de 23 km² culmine à 35 m NGF. L’île d’Yeuest constituée d’un socle ancien de roches magma-tiques et métamorphiques dominées par l’orthogneiss.Son insularité est assurée au Néolithique, ce en dépitde l’existence d’une chaussée basse appelée Pontd’Yeu, alors déjà submergée. Le rivage qu’on admetpour cette période, de quelques mètres inférieur àl’actuel (autour de - 5 m ; Morzadec-Kerfourn 1973 ;fig. 1), ne modifie en rien la configuration actuelle du trait de côte du secteur occidental, constituéd’abruptes falaises.
L’historique des recherches archéologiques sur ce territoire est assez court. Quelques travaux ont été menés sur les monuments mégalithiques par
M. Baudouin, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle.Plus récemment, quelques inventaires des sites préhis-toriques, délaissant les contextes domestiques, ont étéréalisés jusqu’à une reprise globale et diachronique detoute la documentation en 2009-2010 (Chauviteau2010). Dès lors, plusieurs implantations sont apparuesparmi lesquelles au moins deux installations domes-tiques du Néolithique récent : la Pointe de la Trancheet Ker Daniaud. Toutes deux sont localisées sur despointes rocheuses de la côte ouest, dite “sauvage” del’île. Ces promontoires sont barrés par un talus depierres, architecture encore partiellement visibleaujourd’hui en surface. Le premier fait l’objet d’unefouille programmée depuis 2010 tandis que le secondn’a été appréhendé que par le biais de différentsrelevés.
A. La Pointe de la Tranche
Le site de la Pointe de la Tranche est localisé ausud-ouest de l’île. Il surplombe actuellement la merde dix-huit mètres. Cet éperon d’orthogneiss œillé,parcouru par des filons de quartz, compte de nom-breux affleurements, dont certains particulièrementimposants culminant à plus de 22 m NGF.
180
Enceintes néolithiques de l’Ouest de la France de la Seine à la Gironde
Fig. 1 – Localisation des sites mentionnés (DAO : A. Blanchard d’après la carte marineSHOM 7402L au 1/50 000).
Fichier éditeur destiné à un usage privé
employés sont beaucoup plus volumineux, environ1,50 m de longueur pour plus d’1 m de hauteur à lasurface du sol.
Après une première campagne de sondage (2010),une fouille programmée pluriannuelle a été entrepriseen vue de caractériser l’architecture, mais égalementd’étayer notre perception de ce type de gisement(statut/fonction), rarement fouillé. En effet, ces sitessont localisés sur des secteurs peu sujets à l’archéo-logie préventive et relèvent de conditions d’inter-ventions complexes, avec des protocoles de fouillesspécifiques aux sites naturels classés.
La surface fouillée est de fait modeste (moins de100 m²), mais elle offre néanmoins de nombreusesinformations.
A.1 Architecture
Plusieurs horizons stratigraphiques associés àl’architecture ont été mis en évidence, pour uneépaisseur cumulée de 0,50 à 0,75 m (fig. 3). Àl’intérieur de l’enceinte, deux niveaux d’occupationsuccessifs ont été reconnus (US 3 et 4), le plus ancienreposant sur un horizon d’altération du substrat très
Éperons barrés du Néolithique récent en contexte insulaire : l’île d’Yeu (Vendée)
Si des prospections pédestres ont été menées delongue date par différents passionnés, la collection n’a été que récemment étudiée. Cette importantesérie lithique, renvoyant au Néolithique récent à final,attire alors rapidement l’attention sur ce gisement,d’autant plus qu’un certain nombre de structuresapparaissent à la surface du sol : outre une levée deterre sur son pan nord / nord-est, une ligne de blocs,en arc de cercle, vient barrer l’éperon sur environ 80 m de longueur. Dressées entre deux affleurementsmassifs, ces dalles verticalisées marquent l’emplace-ment d’un talus préhistorique.
Réalisés en 2010, le plan topographique de lapointe ainsi qu’un relevé général du talus en précisentle tracé (fig. 2). Il est implanté sur une pente descen-dante partant du sommet de l’éperon. Légèrementcurviligne, il barre la pointe sur son pan nord-est,précédant de peu une légère déclivité. Le relevé desdalles affleurantes a permis d’identifier clairementdeux systèmes d’entrée. Les limites de la premièreouverture, en partie nord, sont matérialisées de partet d’autre par des dalles verticales espacées de 3,50m.La seconde entrée, en partie médiane, a les mêmesdimensions (3,50 m), mais les trois blocs verticaux
181
Fig. 2 – Pointe de la Tranche : plan topographique et plandu talus (DAO : A. Blanchard).
Fichier éditeur destiné à un usage privé
Enceintes néolithiques de l’Ouest de la France de la Seine à la Gironde
Fig. 3 – Pointe de la Tranche : coupe stratigraphique (DAO : A. Blanchard).
182
Fig. 4 – Pointe de laTranche : vue du talus
en cours de fouille(Cliché : A. Blanchard).
Fichier éditeur destiné à un usage privé
La partie 1, orientale, se distingue partiellementà la surface du sol, car les dalles d’orthogneiss poséesde chant affleurent (F01, dalles A 1 à 5 ; fig. 2, 4-6).Cet alignement de blocs matérialise la limite externedu talus. Un muret de pierres sèches (MR02) constituel’extrémité occidentale de cette partie dont la lar-geur varie de 2,50 m (sud-est) à 2,80 m (nord-ouest).Quatre caissons trapézoïdaux et triangulaires, délimitéspar des murets de pierres sèches transversaux, ont été individualisés. Ils sont comblés de blocs d’ortho-gneiss, de galets marins et de sédiments (US 7a). Lesdeux caissons les plus orientaux présentent un blocageun peu différent mêlant sédiment et galets, et blocs de petites dimensions (US 8). C’est dans cet horizonque viennent prendre place les dalles d’orthogneiss(F01) ainsi que trois calages de poteaux, alignés enarrière de ces dernières, correspondant à une possiblepalissade.
La partie médiane (partie 2) large de 1,50 à 1,80mest dépourvue de blocs à l’exception de ceux formantun calage de poteau, bien esseulé.
La partie 3 a des dimensions variant de 2m (nord-ouest) à 3,10 m (sud-est ; fig. 4-6). Elle est délimitéede part et d’autre par des murets de pierres sèches(MR06 et MR07). De même que pour la partieorientale, trois caissons de formes trapézoïdale ettriangulaire comblés de blocs d’orthogneiss, galetsmarins et sédiments (US 7c), sont apparus. Plusieurs
Éperons barrés du Néolithique récent en contexte insulaire : l’île d’Yeu (Vendée)
induré parfois épais (plus d’une quinzaine de centi-mètres : US 5).
La stratigraphie du talus est plus complexe puisqueles trois parties qui le composent se distinguent pardes comblements différents (plus ou moins graveleux,US 7a, b, c, US 8). La construction repose sur unniveau préparatoire (US 9) appliqué sur le substratsain (US 11) ou partiellement altéré (US 5). L’extérieurde l’enceinte n’a été abordé que succinctement (1 mde largeur) et compte un horizon qui lui est propre(US 10).
Un niveau correspondant à l’abandon dugisement (US 2) recouvre l’intégralité des zonesfouillées et est surmonté du couvert pédologiquerécent (US 1).
Le talus ainsi découvert mesure 7 à 7,50 m delargeur et se caractérise par l’association de différentesexpressions techniques architecturales : murets de pierres sèches longitudinaux et/ou transversauxconservés sur une à quatre assises, dalles verticalisées.Il se décompose en trois parties, reposant toutes sur un seul et même niveau sédimentaire (fig. 4, US 9),limono-sableux, brun foncé, grossier et compactcouvrant le substrat orthogneissique ponctuellementarénisé. Cet horizon résulte vraisemblablement d’unapport anthropique, permettant d’aplanir et d’assainirla surface naturelle irrégulière.
183
Fig. 5 – Pointe de la Tranche : plan de la zone fouillée (DAO : A. Blanchard).
Fichier éditeur destiné à un usage privé
184
Enceintes néolithiques de l’Ouest de la France de la Seine à la Gironde
Fig. 6 – Pointe de la Tranche : différentes étapes de la construction (DAO : A. Blanchard).
Fichier éditeur destiné à un usage privé
Après l’édification du talus, un premier niveaud’occupation se met rapidement en place (US 4). Dansl’angle occidental de la zone fouillée, une concentra-tion de blocs d’orthogneiss et de galets, dont denombreux macro-outils, suggère un aménagement dusol ou un rejet spécifique. Un second niveau, plusrécent (US 3), succède à cette première implantation.Différents blocs relatifs à l’éboulement partiel del’architecture ainsi que plusieurs calages de poteaux y apparaissent, sans qu’il soit à ce jour possibled’envisager de plan d’un véritable bâtiment.
L’ensemble de la zone fouillée est enfin scellé parun niveau sablo-limoneux fin brun clair à jaune.
A.3 Un ensemble complexe
Le talus s’avère complexe d’un point de vuestructurel puisque mêlant plusieurs techniquesarchitecturales (murets de pierres sèches principauxet transversaux, dalles verticalisées). Les matièrespremières engagées dans la construction sont toutesd’origine locale. La majeure partie des blocs d’ortho-gneiss a été extraite du socle rocheux de l’île : nom-breux sont en effet les blocs portant des stigmatesd’extraction (encoches, face d’arrachement) ou ayantété taillés. Les dalles verticalisées présentent des faces d’affleurement suggérant qu’elles n’ont pas été recherchées profondément dans le substratcontrairement à certains blocs de dimensions plusmodestes. Aucune carrière n’a, à ce jour, été décou-verte, mais l’existence de telles structures colmatéesreste probable. Seuls les galets marins résultent d’unerécupération, vraisemblablement en contrebas dugisement, sur l’estran.
Le plan de la structure interpelle également. Lestrois parties forment un tout puisqu’elles reposent sur le même horizon préparatoire. Les caissons trian-gulaires ou trapézoïdaux assurent certainement lastabilité de la structure. L’orientation oblique desmurets transversaux par rapport aux parementsprincipaux répond vraisemblablement à la nécessitéde maintenir la structure, de contenir les différentespoussées sur ce secteur incliné de la pointe. Ce talusrésulte donc d’un programme architectural cohérent.
Le mobilier récolté, principalement à l’intérieurde l’espace enclos, renvoie au Néolithique récent et plus particulièrement au Groh-Collé, groupe du littoral sud-armoricain (Blanchard 2012b). Il serapproche de l’ensemble distingué au sud de l’estuaire
Éperons barrés du Néolithique récent en contexte insulaire : l’île d’Yeu (Vendée)
calages de poteaux, dont certains au contact direct desmurets principaux, s’y ajoutent.
A.2 Étapes de construction
Les relations stratigraphiques entretenues par les différents murets informent sur la chronologie de la construction (fig. 6). L’implantation néolithiques’effectue visiblement sur un substrat partiellement à nu. Ainsi que l’indique la présence ponctuelle d’unhorizon d’altération, de petites zones végétaliséesdiscontinues recouvrent alors en partie le rocher.Aucun écrêtement ni affouillement du substrat n’a étérepéré sur la zone explorée. Le niveau préparatoirebasal est donc disposé sur l’orthogneiss œillé laissé enl’état.
L’architecture édifiée a été largement réfléchie etconstruite comme un ensemble cohérent ainsi qu’entémoigne l’étroite imbrication des murs formant lescaissons avec les murets principaux.
Pour la partie orientale, dans une première étape,le muret transversal MR01 semble édifié peu ou proudans le même temps que le mur principal MR02. Leurfait suite dans la construction le mur MR05 tandisqu’au nord les murs MR03 et MR04 s’ajoutent aumuret principal (MR02). Les caissons ainsi aménagéssont alors comblés. Côté oriental, un horizon sablo-limoneux, très gravillonneux, à grains moyens à groset petits blocs et galets, brun (US 8) prend ensuiteplace, dans lequel sont insérés les dalles verticalisées(F01) ainsi que les calages de poteaux.
La partie médiane du talus présente un enchaîne-ment stratigraphique équivalent aux deux partieslatérales, indiquant clairement que cette portion a étépensée comme telle dans la construction.
Le mur principal (MR06) de la partie occidentale(fig. 6) a sans doute été bâti durant la première étape.L’aménagement transversal comprenant notammentun calage de poteau (ST01) lui succède dans la cons-truction. Enfin, dans une dernière étape, les mursMR07 et MR08 sont construits dans le même tempspuisque tous deux possèdent des assises imbriquées.Le comblement de sédiments, blocs d’orthogneiss et galets marins est mis en place ; seule une portiond’un des caissons au nord révèle un blocage un peudifférent avec des fragments de quartz et de gneissdécimétriques (US 6), correspondant vraisemblable-ment à une recharge.
185
Fichier éditeur destiné à un usage privé
de la Loire, comprenant notamment les sites desGâtineaux (Saint-Michel-Chef-Chef, Loire-Atlantique),des Prises (Machecoul, Loire-Atlantique) ou encorede La Chevêtelière (Saint-Mathurin - L’Île-d’Olonne,Vendée ; Blanchard 2012b). La date de 4595 ± 30 BPsoit entre 3501 et 3127 av. J.-C. (Lyon-8822) obtenuesur un charbon de bois provenant du niveaud’occupation le plus ancien (US 4) corrobore cetteattribution.
A.4 Ker Daniaud et autres gisements suspectés
À 5 km vers l’ouest, le site de Ker Daniaudculmine à 26 m NGF et surplombe la plage de la Belle Maison (fig. 1). En partie érodée, cette pointed’orthogneiss est parcourue de filons de quartz etd’aplite. De même que pour la Pointe de la Tranche,ce gisement est apparent en surface, où l’on remarqueaisément plusieurs files de blocs. L’érosion importantede la pointe laisse ici poindre l’essentiel de la struc-ture. En dépit de prospections répétées depuis lesannées 1980, le mobilier récolté en surface reste peu abondant et ubiquiste, dont seule se démarqueune armature à tranchant transversal trapézoïdale àretouches abruptes des bords (Bugeon, Esseul 1992 ;Coutureau, Maheux 1994).
Aucune fouille n’a été menée, mais de nombreuxrelevés (topographique, pierre à pierre, prospec-tions géophysiques) offrent une bonne vision del’ensemble. La grande proximité architecturale de ce gisement avec le précédent va dans le sens d’uneattribution au Néolithique récent.
Le talus empierré a été reconnu sur près de 120mde longueur et cerne un espace modeste, d’environ0,5 ha (fig. 7). Les trois tronçons qui le compo-sent prennent appui sur les éminences rocheuses.L’extrémité méridionale est ainsi marquée par unaffleurement surplombant la falaise. Un premiersegment d’une trentaine de mètres s’étend vers lenord-ouest, jusqu’à l’affleurement le plus massif de la pointe. Le talus s’infléchit alors vers l’ouest surenviron 70 m pour atteindre un nouvel affleurement.Enfin, la dernière section, peu lisible en raison del’érosion, s’oriente au sud-ouest sur une vingtaine demètres pour s’achever au surplomb de la falaise.
Seul le premier tronçon permet de préciserl’organisation architecturale. Ainsi, le talus mesureenviron 4,50 m de largeur et est délimité de part etd’autre par des blocs verticalisés de modules moyens(0,20 à 0,30 m), mais plus imposants à l’extrémitéméridionale (0,50 m de longueur). Dans ce secteur,une entrée mégalithique se dégage de l’ensemble : desblocs imposants (environ 1 m de hauteur à la surfacedu sol) interrompent le talus sur une largeur d’environ2 m. Les roches employées pour la construction sonttoutes d’origine locale, probablement extraites dusubstrat du site (Guyodo 2011). L’orthogneiss est ainsiprivilégié et quelques blocs d’aplite (présente sur lapointe sous forme de filons massifs) complètentponctuellement le tracé. Enfin, quelques galets marinsont été identifiés dans le comblement de l’architecture.
Ce développement architectural profite indénia-blement des irrégularités du substrat. Les affleurementsconstituent des points marquants de l’architecture(début, fin, inflexions), mais aussi des barrièresnaturelles. Cette connexion peut donc résulter d’unevolonté d’économiser moyens et énergie dans la cons-truction de ces talus mégalithiques. L’architecturebâtie de ce gisement présente une grande proximitéformelle avec celle de la Pointe de la Tranche.
Deux autres gisements de l’île ont eu droit de cité en tant qu’éperons barrés néolithiques dans lalittérature : il s’agit de la Pointe du Port de la Meuleet de la Pointe du Châtelet (fig. 1). Toutefois, derécentes prospections géophysiques réalisées sur lepremier invitent à tempérer le propos, car aucunélément ne vient étayer l’hypothèse d’une implan-tation humaine. L’extrémité occidentale de la Pointedu Châtelet présente, quant à elle, une série de blocsalignés à la surface du sol. Leur position, à l’encontrede l’orientation naturelle des affleurements, plaide enfaveur d’un aménagement anthropique préhistorique.Cette proposition est soutenue par une collection desurface importante, comptant notamment diversespièces lithiques de la fin du Néolithique (armaturesperçantes à pédoncule ; Morel 1979). La réoccupationde cette pointe durant la Protohistoire (rempart)engage néanmoins à la prudence (Maitay et al. 2009).
186
Enceintes néolithiques de l’Ouest de la France de la Seine à la Gironde
Fichier éditeur destiné à un usage privé
Éperons barrés du Néolithique récent en contexte insulaire : l’île d’Yeu (Vendée)
187
Fig. 7 – Ker Daniaud : plantopographique et plan du talus (DAO et cliché : A. Blanchard).
Fichier éditeur destiné à un usage privé
B. Les éperons barrés de l’île d’Yeu dansleur contexte régional au Néolithiquerécent
L’île d’Yeu compte ainsi au moins deux éperonsbarrés par des talus au Néolithique récent. Aucunautre type de gisement domestique n’y a été identifiépour cette seule phase. Les pointes ainsi cernées nesont toutefois pas propres à ce contexte insulairepuisque deux sites équivalents ont été explorés cesdernières années sur le littoral morbihannais : Groh-Collé (Saint-Pierre-Quiberon, fouille 2006-2008, dir.J.-N. Guyodo) et Pen-Men (île de Groix, fouille 2003,dir. J.-N. Guyodo).
Le site de Groh-Collé, sur la côte occidentale de lapresqu’île quiberonnaise, est établi sur un éperonleucogranitique surplombant la mer d’une quinzainede mètres. Un talus curviligne barre la pointe sur sonpan oriental. Deux phases architecturales successivesont été distinguées (Guyodo 2008). Un premier talusest édifié sur une semelle de matériaux souplesinstallée sur le substrat préalablement écrêté. Largede 5m, il est délimité par des murets de pierres sècheset comblé de blocs de leucogranite et de galets marins.Dans une seconde phase, le talus est élargi à 7 m etest alors bordé par deux files de dalles disposées dechant, l’espace central étant colmaté par des sédimentset des blocs de pierres. Deux niveaux d’occupationsont associés à ces deux architectures. En relation avecle niveau le plus ancien, une carrière a été découverteseulement quelques mètres en arrière du talus etsemble avoir alimenté la construction en moellons.C’est à cette première phase également que seraccorde une tranchée de palissade implantée encontrebas du talus.
Le site de Pen-Men, au nord-ouest de l’île deGroix, est localisé sur une pointe micaschisteuse. Untalus légèrement curviligne repéré sur près de 80 mde longueur, possédant deux interruptions, clôt unesurface d’environ 1,5 ha (Guyodo 2003). La structure,large de 2,20 à 2,50 m, est délimitée par des muretsde pierres sèches auxquels sont associés des muretsinternes transversaux perpendiculaires. Ces derniersforment des caissons quadrangulaires de largeursvariables comblés de plaquettes de schiste etsédiments. L’architecture est posée sur un niveaupréparatoire aménagé sur le substrat exploité. En
effet, des carrières ouvertes de part et d’autre du talus ont permis un approvisionnement direct enmatériaux de calibres variés.
Tous ces gisements partagent de nombreux pointscommuns, qu’il s’agisse de situation topographique,d’organisation, de forme ou encore d’exploitation del’environnement minéral. Ils se raccordent à un mêmeensemble chrono-culturel, Groh-Collé (Blanchard2012b). Les techniques de construction identifiées sur ces sites sont assez proches (niveau prépara-toire, dalles verticalisées, murets de pierres sèches,caissons). Néanmoins, les architectures abordéesprésentent une grande variété de formes. En effet,chaque talus semble posséder ses propres caracté-ristiques, en termes de dimensions ou d’associationsde structures bâties : murets de pierres sèches, puisdalles disposées de chant à Groh-Collé, murets depierres sèches et caissons quadrangulaires à Pen-Men, murets de pierres sèches, dalles verticalisées etcaissons triangulaires et trapézoïdaux à la Pointe de laTranche. La forme des caissons semble déterminée par la position topographique de l’architecture. Lescaissons triangulaires et trapézoïdaux aménagés pardes murets de pierres sèches transversaux obliquesaux parements longitudinaux à la Pointe de la Tranchesemblent en effet compenser les poussées axiales etlatérales liées à la déclivité du terrain. Ils offrent àl’ensemble plus de stabilité. La position en rebord deplateau du talus de Pen-Men ne nécessite pas de telsaménagements internes : des caissons quadrangulairessont, dans ce cas, à même de contenir les différentespoussées. À Groh-Collé, en revanche, ce sont lesdimensions des blocs employés qui semblent condi-tionnées par le positionnement de la construction. La forte déclivité du terrain impose l’utilisation dedalles verticales plus massives (1 m de hauteur) côtéextérieur de la structure que côté intérieur (0,40 m),permettant ainsi l’obtention d’un sommet relative-ment plat. Le développement architectural et lestechniques de construction sont conditionnés par desnécessités techniques.
Il est évident que ne subsiste aujourd’hui de cestalus que l’architecture basale, en pierres. L’ensembleétait originellement comblé de sédiments et seuls les dalles et/ou murets marquant les extrémités de la structure devaient être apparents. Une élévation en bois, de nature indéterminée à ce jour, existaitprobablement sur ces architectures. Des calages depoteaux, assez discrets, apparaissent régulièrement
188
Enceintes néolithiques de l’Ouest de la France de la Seine à la Gironde
Fichier éditeur destiné à un usage privé
relles. Ces affleurements constituent des points defixation (Vaquero Lastres 1998) imposants, pérenneset assurent ainsi une bonne visibilité dans le paysage.D’autres arguments peuvent également être évoquéscomme la charge symbolique conférée aux affleure-ments qui, pour certains auteurs, disposeraient d’unepuissance “mythique ou religieuse” (Bradley 2002).
L’intérieur de ces enceintes est en revanche peuconnu car souvent érodé, mais les quelques structuresobservées et le mobilier archéologique, inclus dansdes niveaux de sols en place, plaident en faveur d’unespace domestique.
Le choix d’édifier de telles structures plutôt quede creuser des fossés d’enceinte peut, de prime abord,paraître plus adapté au substrat rencontré (socles durs : granite, orthogneiss). Néanmoins, le substratmicaschisteux (semi-dur) à Pen-Men, par exemple,invite à modérer cette idée trop réductrice.
La position de ces sites, sur le littoral, surplom-bant l’océan, essentiellement sur les côtes occidentalesdes îles et des presqu’îles, induit de plus un certainnombre de contraintes (climat peu clément, éloigne-ment de certaines ressources comme le bois, l’eaudouce, etc.) qui laissent envisager des occupationstemporaires, par un groupe réduit de personnes(Blanchard, à paraître). Les espaces cernés par cestalus sont en effet modestes (moins d’1,5 ha) auregard de ceux des enceintes fossoyées. La culturematérielle va également dans le sens d’implantationstemporaires et/ou saisonnières : l’assemblage lithiqueprésente en effet des spécificités notamment auniveau de l’outillage (un outil prédominant surchacun des sites), suggérant une ou des activité(s)spécialisée(s) ; la production céramique réunit, quantà elle, peu de grands récipients de stockage (Blanchard2012a et b).
En définitive …
Cerner l’espace peut donc prendre des formesbien différentes au cours du Néolithique. Lesenceintes fossoyées ne sont pas les seules structurespermettant de délimiter l’espace domestique auNéolithique récent puisque des éperons sont barréspar des talus. Les structures excavées ne sont pourautant pas absentes sur ces derniers sites : unetranchée de palissade a été reconnue en contrebas du
Éperons barrés du Néolithique récent en contexte insulaire : l’île d’Yeu (Vendée)
dans le comblement des talus. Si certains d’entre eux, comme à la Pointe de la Tranche, alignés etrégulièrement espacés, suggèrent l’existence d’unepalissade, d’autres, isolés, sont plus difficiles à inter-préter. Si la base du calage paraît légère, la masse de sédiments comblant le talus permet, à n’en pasdouter, de maintenir des bois verticaux, largementsujets à la prise au vent.
L’originalité des éperons barrés de l’île d’Yeurepose sur l’importance donnée aux affleurementsdans les constructions. Ces derniers semblent en effetjouer un rôle important dans le positionnement destalus, qui s’y appuient systématiquement. Ce rapportétroit affleurement/architecture n’est toutefois paspropre aux seuls contextes domestiques puisque les monuments funéraires et plus particulièrementceux relatifs à la fin du Néolithique (récent/final) sont régulièrement érigés, voire clairement appuyés sur des affleurements. Le dolmen des Petits-Fradets(fig. 1), dont ne subsistent que la chambre et quel-ques vestiges du cairn, est établi sur un affleurementd’orthogneiss entre deux éminences rocheusesmassives. Bien qu’extrêmement proches, ces dernièresne sont pas intégrées à l’architecture, contrairement à ce qui est observable au monument transepté de la Planche à Puare, dont l’extrémité du couloir estappuyée sur un affleurement massif d’orthogneiss,imitant une table de couverture et donnant l’illusiond’un édifice plus allongé (Mens in Guyodo 2011). Ce phénomène n’est pas exclusif au mégalithismeinsulaire. De nombreux monuments mégalithiques,dits évolués (sépulture à entrée latérale, allée couvertenotamment), ont une configuration similaire sur le continent : allée couverte de Kerherne-Bodunan(Saint-Jean-Brevelay, Morbihan ; Gouézin 1994),Men-Guen-Lanvaux (Plaudren, Morbihan ; Gouézin1994), tombe à couloir de Conguel (Quiberon,Morbihan ; L’Helgouach 1962), sépulture à entréelatérale de Pont-Bertho (Plaudren, Morbihan) ainsique la sépulture à entrée latérale du Petit Vieux-Sou(Brécé, Mayenne ; Bouillon 1989) où l’affleurementforme une à plusieurs parois du monument. Laproximité de l’affleurement avec les architecturesbâties, funéraire ou domestique, peut trouver desexplications tant économiques que spirituelles. Ces éminences rocheuses permettent une évidenteéconomie de matériaux et d’énergie. Toutefois, il est intéressant de constater que leur intégration àl’architecture talutée semble limitée puisqu’aucunepierre interstitielle ne vient créer de jonction stricteentre les parties construites et ces émergences natu-
189
Fichier éditeur destiné à un usage privé
talus à Groh-Collé, de même que des carrières à Groh-Collé et Pen-Men. Toutefois, ces carrières restent defaibles étendues et ne descendent pas profondémentdans le substrat contrairement à ce qui est observé par ailleurs dans le Centre-Ouest de la France ou au sud de l’estuaire de la Loire. De plus, de nombreuxfossés d’enceintes semblent avoir été, en premier lieu, des carrières (Burnez, Louboutin 1999, p. 342), lesmatériaux extraits ayant été rapidement employésafin de constituer des talus au contact des fossés.Néanmoins, ces talus ne semblent pas structurés, onimagine plus aisément des amas pierreux. Aucuneassise basale n’ayant été observée, il est bien souventdifficile d’envisager des constructions véritablementarchitecturées, à quelques exceptions près (Champ-Durand à Nieul-sur-l’Autise, Vendée ; Joussaume 2012).
Les promontoires littoraux sont en revanchebarrés par de solides structures. Tout est mis en œuvrepour obtenir des talus stables (écrêtement du substrat,mise en place de semelle souple avant la structure,matériaux utilisés, etc.). Il s’agit également d’archi-tectures modulaires. Les techniques architecturalessont communes aux différents sites évoqués, maisleurs développements varient en fonction de laconfiguration du terrain, dans le but d’assurer lemaintien de la structure (diversité des formes descaissons internes, rectangulaires ou triangulaires ettrapézoïdaux).
La proximité est forte entre ces structures bâtiesdomestiques et les architectures mégalithiques funé-raires. Les techniques exprimées sont identiques :mégalithes dressés, murets de pierres sèches, assisesalternées, etc. Les caissons observés sur les sitesdomestiques font écho aux alvéoles régulièrementidentifiées dans les cairns (pour n’en citer qu’un :tumulus C de Péré à Prissé-la-Charrière, Deux-Sèvres ;Laporte et al. 2002). De la même façon, des carrièrescommencent à être détectées à proximité, voire aucontact direct des monuments mégalithiques (Champ-Châlon A à Benon, Charente-Maritime ; Joussaume2006 ; tumulus C de Péré à Prissé-la-Charrière, Deux-Sèvres ; Laporte 2013). Les affleurements, points mar-quants du paysage, sont utilisés tant en contextesfunéraires que domestiques et jouent un rôle impor-tant, puisque intégrés aux architectures.
Enfin, les éperons barrés relèvent de statut etfonction bien différents. Plusieurs arguments (culturematérielle spécifique, surface enclose restreinte,légèreté des structures internes, etc. ; Blanchard 2012b)
suggèrent que ces promontoires ne sont occupés que sur des temps courts, mais à de multiples reprises,les réoccupations cycliques justifiant en partie laconstruction d’imposants talus. La tenue d’une activitéspécialisée, comme le suggère la culture matérielle,pourrait expliquer de telles implantations. Le caractèrecôtier de ces gisements engage assez logiquement à rechercher ces atouts vers le milieu maritime(ressources halieutiques, voies de communication,etc.). Leur position leur procure aussi une vue dégagéesur la mer, particulièrement favorable à la surveillanceet/ou au contrôle maritime. Corrélées à la fréquencegrandissante des échanges constatée à l’échelle de lafaçade atlantique au Néolithique récent, ces installa-tions littorales, au même titre que d’autres occupéesdurant la Protohistoire (Maguer 1996 ; Maitay et al.2009), sont susceptibles d’avoir un rôle dans le traficmaritime (Blanchard 2012b et à paraître). Les éperonsbarrés par des talus seraient peut-être occupés ponctu-ellement, à des moments de plus forte fréquentationnavale.
Bibliographie
Blanchard 2012a : BLANCHARD (A.) – Le Néolithiquerécent de l’Ouest de la France : “le” Groh-Collé. In :MARCHAND (G.), QUERRÉ (G.) dir. – Roches et sociétésde la Préhistoire. Entre massifs cristallins et bassinssédimentaires. PUR, Archéologie & Culture, Rennes, 2012,p. 465-481.
Blanchard 2012b : BLANCHARD (A.) – Le Néolithiquerécent de l’Ouest de la France (IVe-IIIe millénaires avant J.-C.) : productions et dynamiques culturelles. Thèse dedoctorat de l’Université de Rennes 1, 2012, 2 vol., 649 p.
Blanchard, à paraître : BLANCHARD (A.) – Organisationet gestion de l’espace littoral du sud du Massif armoricainau Néolithique récent. In : Actes du colloque internationalHOMER. Vannes, 2011, BAR, à paraître.
Bouillon 1989 : BOUILLON (R.) – La sépulture méga-lithique à entrée latérale du Petit Vieux-Sou à Brécé(Mayenne), Revue Archéologique de l’Ouest, vol. 6, 1989, p. 51-70.
Bradley 2000 : BRADLEY (R.) – An archaeology of naturalplaces. Routledge, London, 1st éd. 2000, 177 p.
Bugeon, Esseul 1992 : BUGEON (C.), ESSEUL (M.) –Inventaire des Monuments et Sites Préhistoriques de l’îled’Yeu. Rapport de prospection inventaire, SRA Pays de laLoire, Nantes, 1992, 2 vol., 400 p.
Burnez, Louboutin 1999 : BURNEZ (C.), LOUBOUTIN(C.) – Les enceintes fossoyées néolithiques : architecture et
190
Enceintes néolithiques de l’Ouest de la France de la Seine à la Gironde
Fichier éditeur destiné à un usage privé
tumulaires. Mégalithismes de l’Ouest de la France, projetsarchitecturaux, stratégies d’approvisionnement et techni-ques mises en œuvre pour l’extraction. In : GUYODO (J.-N.), MENS (E.) dir. – Les premières architectures en pierreen Europe occidentale du 5e au 2e millénaire avant J.-C.Actes du colloque international, Nantes (2-4 octobre 2008),PUR, Archéologie & Culture, Rennes, 2013, p. 79-106.
Laporte et al. 2002 : LAPORTE (L.), JOUSSAUME (R.),SCARRE (C.) – Le tumulus C de Péré à Prissé-la-Charrière(Deux-Sèvres), Gallia préhistoire, t. 44, 2002, p. 167-214.
Maguer 1996 : MAGUER (P.) – Les enceintes fortifiées del’Âge du Fer dans le Finistère, Revue Archéologique del’Ouest, 13, Rennes, 1996, p. 103-121.
Maitay et al. 2009 : MAITAY (C.), BÉHAGUE (B.), COLIN(A.), DUCONGÉ (S.), GOMEZ DE SOTO (J.), KÉROUANTON(I.), LANDREAU (I.), LARUAZ (J.-M.), LEVILLAYER (A.),ROUZEAU (N.), SIREIX (C.), SOYER (S.), VUAILLAT(D.), ZÉLIE (B.) – Formes et variabilité des habitats fortifiésdes Âges du Fer dans le Centre-Ouest de la France et sesmarges. In : BERTRAND (I.), DUVAL (A.), GOMEZ DESOTO (J.), MAGUER (P.) dir. – Les Gaulois entre Loire etDordogne. Actes du 31e colloque international AFEAF, t. I,Association des Publications Chauvinoises, Mémoire XXXIV,Chauvigny, 2009, p. 371-421.
Morel 1979 : MOREL (J.) – Une armature de flèche de laPointe du Châtelet à l’île d’Yeu, Bulletin de la Sociétéd’Émulation de la Vendée, La Roche-sur-Yon, 1979, p. 317-322.
Morzadec-Kerfourn 1973 : MORZADEC-KERFOURN (M.-T.) – Variations de la ligne de rivage armoricaine auquaternaire : analyses polliniques de dépôts organiqueslittoraux. Thèse de doctorat de l’Université de Rennes I,1973, 208 p.
Vaquero Lastres 1998 : VAQUERO LASTRES (J.) – Lesextrêmes distincts : la configuration de l’espace dans lessociétés ayant bâti des tertres funéraires dans le nord-ouestibérique. Thèse de doctorat de l’Université de Paris 1, 1998,438 p.
Éperons barrés du Néolithique récent en contexte insulaire : l’île d’Yeu (Vendée)
fonction, Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 96, n° 3, Paris, 1999, p. 329-352.
Chauviteau 2010 : CHAUVITEAU (A.) – Inventaire dessites et du mobilier archéologiques, commune de l’île d’Yeu(85). Rapport de prospection inventaire, SRA des Pays dela Loire, Nantes, 2010.
Coutureau, Maheux 1994 : COUTUREAU (E.), MAHEUX(H.) – Yeu et Noirmoutier, Îles de Vendée. Inventairegénéral des monuments et des richesses artistiques de laFrance, Région Pays de la Loire, ADIG, Nantes, 1994, 504 p.
Gouézin 1994 : GOUÉZIN (P.) – Les mégalithes duMorbihan intérieur. Institut Culturel de Bretagne, Univer-sité de Rennes 1, 1994, 127 p.
Guyodo 2003 : GUYODO (J.-N.) – Pen-Men (Groix,Morbihan). Rapport final d’opération, SRA de Bretagne,Rennes, 2003.
Guyodo 2008 : GUYODO (J.-N.) – L’habitat néolithiquede Groh-Collé (Saint-Pierre-Quiberon, Morbihan). Rapportfinal d’opération, SRA de Bretagne, Rennes, 2008.
Guyodo 2011 : GUYODO (J.-N.) avec la collaboration deBLANCHARD (A.), BOULUD-GAZO (S.), MENS (E.),HENIGFELD (Y.), MONTEIL (M.), POLINSKI (A.) – Îled’Yeu (Vendée) : rapport d’expertise. Rapport d’expertise,SRA Pays de la Loire, Nantes, 2011, 50 p.
Joussaume 2006 : JOUSSAUME (R.) avec la collaborationde CADOT (R.), GILBERT (J.-M.) – Les tumulus de Champ-Châlon à Benon (Charente-Maritime). Bulletin du GroupeVendéen d’Études Préhistoriques, 42, 2006, 90 p.
Joussaume 2012 : JOUSSAUME (R.) dir. – L’enceintenéolithique de Champ-Durand à Nieul-sur-l’Autise (Vendée).Association des Publications Chauvinoises, Mémoire XLIV,Chauvigny, 2012, 685 p.
L’Helgouach 1962 : L’HELGOUACH (J.) – Le dolmen deConguel en Quiberon (Morbihan), Bulletin de la SociétéPréhistorique Française, t. 59, n° 5-6, Paris, 1962, p. 371-381.
Laporte 2013 : LAPORTE (L.) – Les carrières fournissant lepetit appareil employé dans la construction des masses
191
Fichier éditeur destiné à un usage privé