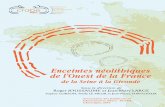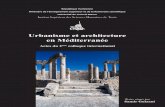Organisation et gestion de l'espace littoral au Néolithique récent
-
Upload
archeodunum -
Category
Documents
-
view
7 -
download
0
Transcript of Organisation et gestion de l'espace littoral au Néolithique récent
BAR International Series 25702013
Anciens peuplements littoraux et relations Homme/Milieu sur les côtes
de l’Europe atlantique
Ancient Maritime Communities and the Relationship between People and
Environment along the European Atlantic Coasts
Sous la direction de / Edited by
Marie-Yvane Daire, Catherine Dupont, Anna Baudry, Cyrille Billard, Jean-Marc Large, Laurent Lespez, Eric Normand and Chris Scarre
Avec la collaboration de / With the collaboration of
Francis Bertin, Chloé Martin et Kate Sharpe
Published by
ArchaeopressPublishers of British Archaeological ReportsGordon House276 Banbury RoadOxford OX2 [email protected]
BAR S2570
Anciens peuplements littoraux et relations Homme/Milieu sur les côtes de l’Europe Atlantique / Ancient Maritime Communities and the Relationship between People and Environment along the European Atlantic Coasts
© Archaeopress and the individual authors 2013
ISBN 978 1 4073 1191 3
pour citer ce volume / how to cite:
Daire M.Y., Dupont C., Baudry A., Billard C., Large J.M., Lespez L., Normand E., Scarre C. (dir.), 2013. Ancient Maritime Communities and the Relationship between People and Environment along the European Atlantic Coasts / Anciens peuplements littoraux et relations Home/Milieu sur les côtes de l’Europe atlantique. Proceedings of the HOMER 2011 Conference, Vannes (France), 28/09-1/10/2011. British Archaeological Reports, International Series 2570, Oxford: Archaeopress.
Printed in England by Information Press, Oxford
All BAR titles are available from:
Hadrian Books Ltd122 Banbury RoadOxfordOX2 7BPEnglandwww.hadrianbooks.co.uk
The current BAR catalogue with details of all titles in print, prices and means of payment is available free from Hadrian Books or may be downloaded from www.archaeopress.com
295
IDENTITÉS - IDENTIIES, BLANCHARD ; ORGANISATION ET GESTION DE L’ESPACE LITTORAL DU SUD...
INTRODUCTION
Dès la période préhistorique, la mer constitue pour les hommes un milieu tout à fait particulier. Tantôt favorable, tantôt contraignante, elle fait néanmoins partie intégrante de l’environnement des populations. Au Néolithique récent (3800-2900 BC), ce rapport à la mer apparaît prédominant, tout particulièrement sur les côtes méridionales du Massif armoricain. Le groupe culturel de Groh-Collé, caractéristique du 4ème millénaire avant J.-C., y connaît en effet une répartition essentiellement littorale et insulaire. Les gisements recensés s’égrainent ainsi le long de la façade Atlantique, du Finistère au sud de l’estuaire de la Loire. Si les intensives recherches menées de longues dates sur le littoral, morbihannais notamment, expliquent en partie cet état de fait, cette concentration n’en reste pas moins marquée. Cette distribution particulière n’est toutefois pas inédite pour la période. Dans le Centre-Ouest de la France, deux styles céramiques au sein d’un même groupe culturel qu’est le Peu-Richard ont été distingués traduisant une dichotomie géographique. La culture matérielle permet ainsi d’individualiser une production dite « maritime » d’une production « continentale » (Roussot-Larroque et al., 1986). Cette partition, même par le seul biais du mobilier céramique, révèle l’existence d’un espace littoral confronté à un territoire continental. L’absence, à ce jour, de gisements « continentaux » marquant ne permet aucunement d’étendre cette partition au Massif armoricain. À l’appui des données issues de fouilles récentes, il reste néanmoins possible de proposer une image pertinente de l’organisation et de la gestion de ce territoire. Les communautés néolithiques s’articulent autour ou le long de l’espace maritime qui devient dès lors un lieu privilégié d’activités économiques.
LES IMPLANTATIONS HUMAINES
Les formes de l’habitat
Les données disponibles quant à l’habitat néolithique récent sur le Massif armoricain sont qualitativement très hétérogènes. Les gisements reconnus lors de prospections fournissent, des informations lacunaires mais restent les témoins de l’occupation du territoire. De la même façon, les gisements anciennement fouillés tel Er Yoh (Houat, dir. M. et St-J. Péquart et Z. Le Rouzic, 1923-24 ; Le Rouzic 1930a ; Figure 1) livrent des indications non négligeable sur l’organisation des espaces domestiques avec des zones dédiées à certaines activités (débitage, etc. ; Guyodo 2007). Dans l’Ouest de la France, les récents travaux menés sur des sites littoraux et insulaires offrent assez logiquement plus d’informations.
L’habitat au Néolithique récent se caractérise ainsi par différents modes d’implantations dont les enceintes fossoyées et les éperons barrés par des talus.
au sud de l’estuaire de la Loire bien que quelques gisements plus septentrionaux, repérés par prospection aérienne, tels La Trappe (Boistrudan, Ille-et-Vilaine ; Le Roux 1992) et La Charronière (Saint-Aubin-des-Landes, Ille-et-Vilaine ; Le Roux 1992), puissent s’y apparenter. La fouille du camp des Prises à Machecoul (Loire-Atlantique ; Boujot et L’Helgouac’h 1986) ainsi que celle plus récente des Gâtineaux (Saint-Michel-Chef-Chef, Loire-Atlantique ; Guyodo 2003a), de la Chevêtelière (Saint-Mathurin, Vendée ; Péridy 2009) ou encore du Priaureau (Saint-Gervais, Vendée ; Poisblaud 2011) permettent d’appréhender les principales caractéristiques de ces installations (Figure 2). Si les travaux portent le plus souvent sur les fossés d’enceinte qui livrent la plus grande quantité de mobilier et logiquement le plus d’informations chrono-culturelles, l’existence de structures domestiques internes est clairement attestée que ce soit par les différents trous de calages de poteaux observés aux Prises (Boujot et L’Helgouac’h 1986) et au Priaureau (Poisblaud 2011) ou les deux plans de bâtiments sur poteaux porteurs mis au jour aux Gâtineaux (Guyodo 2003a). La plupart des gisements prennent place sur des éminences naturelles situées à quelques kilomètres du rivage actuel (Péridy 1999 ; Pineau 2007). A ce titre, le site des Gâtineaux, à deux kilomètres du trait de côte, est établi
ruisseaux. La situation est analogue pour le site des Prises, implanté sur une butte de calcaire gréseux surplombant de quelques mètres seulement la zone basse humide qu’est l’actuel Marais breton. Cette même étendue marécageuse est également dominée, plus au sud, par l’enceinte du Priaureau. Leurs formes et leurs dimensions ne diffèrent pas (ou peu) des modèles d’enceintes fossoyées connus
jusqu’à plus de quatre hectares pour La Chevêtelière (Péridy 2009). Ces surfaces sont intégralement ceinturées par une ou plusieurs lignes de fossés. Néanmoins ces dernières peuvent être positionnées sur un seul pan de l’éperon, généralement le moins abrupt ; ce dernier cas de
sont escarpés. Ces fossés sont régulièrement réoccupés,
impliquant une occupation longue de ces gisements.Les éperons barrés par des talus sont essentiellement localisés sur des promontoires surplombant la mer ou d’importants bras d’eau (estuaire, golfe, ria). Le trait de côte traditionnellement admis pour la période néolithique se situe cinq mètres plus bas que l’actuel niveau de la
ORGANISATION ET GESTION DE L’ESPACE LITTORAL DU SUD DU MASSIF ARMORICAIN AU NÉOLITHIQUE RÉCENT.
Audrey BLANCHARDUMR 6566 « CReAAH », LUNAM, Université de Nantes, Laboratoire LARA, France, email : audreyblanchard1@
hotmail.com
296
HOMER : ANCIENS PEUPLEMENTS LITTORAUX / ANCIENT MARITIME COMMUNITIES
mer (Morzadec-Kerfourn 1973). Ce retrait n’a donc que peu d’incidences sur les côtes abruptes et les contextes
distinguent des enceintes fossoyées par une architecture cette fois en élévation barrant une pointe, dans le cas présent cernée par l’eau. Ces talus n’encerclent cependant pas l’espace dans son intégralité puisque les abords abrupts de ces promontoires, à l’aplomb d’espaces
Ces architectures sont par ailleurs encore nettement
raison d’anomalies topographiques. Les habitats de Pen-Men (Groix, Morbihan ; Guyodo 2003b), de Groh-Collé (Saint-Pierre-Quiberon, Morbihan ; Guyodo 2008) et de la Pointe de la Tranche (Ile d’Yeu, Vendée ; Blanchard 2010) évoquent une grande variabilité des systèmes architecturaux contemporain voire culturellement
identiques (Pen-Men et Groh-Collé ; Figure 2). Ces talus, de forme curviligne, sont systématiquement implantés au niveau de changements topographiques (rupture de pente, rebord de plateau). Ils cernent des espaces réduits, dépassant rarement l’hectare. La zone de construction propose un substrat dit « dur » (micaschiste à Pen-Men, leucogranit à Groh-Collé, orthogneiss à la Tranche) qui va cependant subir différents aménagements : écrêtement sur certains gisements et ajout d’un niveau limono-argileux préparatoire systématique. Les modes de construction développés divergent selon les sites. Ainsi, le talus de Pen-Men, long de 80m pour 2,20 à 2,50m de largeur est constitué d’une architecture de pierres sèches. Deux murets parallèles limitent ainsi l’emprise de la structure. Associés à des murets transversaux, ils ménagent des caissons comblés de blocs, galets marins et sédiments (Guyodo 2003b). A Groh-Collé, deux phases architecturales ont
0 50 km
Marais maritime
Limite du Massif armoricain
Site assuré
Site probable
N
Site-atelier
Enceinte fossoyée
Guernic
GâtineauxGroah-Denn1
La Chevêtelière
Groh-Collé
Pointe de la Tranche
Le Priaureau
Beg an Aud
Champ-Durand
Guernic
Er Yoh
Eperon taluté
Habitat
Toul Goulic
Les Prises
Le Lizo Pointe du Blair
Bilgroix
La ChausséeLe TabierLa Frénelle
Chantepie
La Ferté
Chantepie
Pen-Liousse
La Charronnière
La Trappe
Ker Daniau
Roc’h an Evned
Pointe du Châtelet
Coh-Castel
Les Caltières
Castel Coz
Pen-Men
Figure 1. Localisation et types des gisements mentionnés.
297
IDENTITÉS - IDENTIIES, BLANCHARD ; ORGANISATION ET GESTION DE L’ESPACE LITTORAL DU SUD...
Pointe de Pen Men Pointe de la Tranche Groh-Collé
100 m0
FossésTalus architecturés
N
Gâtineaux Le Priaureau Les Prises
La Chevêtelière
Enceinte A
Enceinte B
Figure 2. Plan des sites (Pointe de Pen-Men d’après Guyodo 2003b ; Groh-Collé, d’après Guyodo 2008 ; Gâtineaux, d’après Guyodo 2003a ; Le Priaureau, d’après Poisblaud 2011 ; Les Prises, d’après Poulain ; La Chevêtelière, d’après Péridy 2009, repris)
298
HOMER : ANCIENS PEUPLEMENTS LITTORAUX / ANCIENT MARITIME COMMUNITIES
implantée, large de cinq mètres, est délimitée par deux murets de pierres sèches auxquels s’adjoignent en partie centrale des blocs et des galets marins. Le second talus succède au premier sur le même emplacement mais
matérialisent les limites, le comblement est identique au précédent. Des aménagements complémentaires existent toutefois puisqu’une tranchée de palissade contemporaine du premier talus a été érigée quelques mètres en avant. L’architecture explorée sur la pointe de la Tranche propose une construction encore une fois différente, alliant murets de pierres sèches et dalles dressées au sein d’un même talus (Blanchard 2010). Ce dernier, de six mètres de largeur, se compose de trois parties délimitées par des blocs verticaux. Un espace central vierge de tout aménagement est cerné de deux murets de pierres sèches. Les parties latérales alors ménagées présentent un blocage de galets marins, blocs et sédiments.L’utilisation de matières premières locales pour
Si une partie des matériaux nécessaires à la construction peut faire l’objet d’un simple ramassage sur l’estran (galets marins, blocs), l’extraction de blocs est attestée par des carrières, mises en évidence quelques mètres en arrière du talus de Groh-Collé et le long de son tracé de Pen-Men.
percuteurs confortent l’idée d’une extraction de matériaux sur tous ces éperons bien que les carrières n’aient pas été systématiquement recherchées. A l’intérieur de l’espace enclos, des trous de calages de poteaux, bien rares et isolés, témoignent d’installations d’ordre domestique.
Des sites de statuts différents
Enceintes fossoyées et éperons barrés par des talus partagent des points communs qui renvoient indubitablement à des communautés dont l’intention est de s’installer sur des sites de hauteur dominant pour les uns des ruisseaux, pour les autres la mer. Ces zones, de surcroît, ceinturées constituent de forts marqueurs territoriaux.Cependant les divergences sont nombreuses et renvoient, plus qu’à des occupations relevant de groupes distincts, à des gisements aux statuts différents. Tout d’abord le contraste est assez fort entre les enceintes fossoyées repérées à quelques kilomètres du trait de côte, au sud de l’estuaire de la Loire et les éperons barrés par des talus recensés sur tout le littoral, au contact direct de la mer. Cette répartition ne doit pas être, pour sa compréhension totalement dissociée des contextes géologiques. Les talus sont établis sur des socles dits « durs » (orthogneiss, leucogranite, micaschiste) bien que les pointes privilégiées
altérées plus friables de failles. A l’inverse, les enceintes fossoyées prennent place sur des substrats plus tendres : le micaschiste porphyroïque, à Gâtineaux et au Priaureau, semble facile à creuser, tout comme le calcaire gréseux des Prises. Les modalités de clôture de ces espaces s’opposent de façon franche (creusement/élévation) bien qu’une grande variabilité architecturale subsiste entre enceintes fossoyées et éperons barrés. Les creusements concernent généralement des structures de dimensions importantes : les fossés peuvent ainsi cerner une grande partie du
gisement. En revanche, les talus sont implantés sur un seul côté des éperons et nécessitent donc un investissement, à première vue, moins important. Conséquemment, les dimensions des surfaces encloses se démarquent ; les enceintes fossoyées cernent de larges espaces habitables tandis que les éperons côtiers barrés par des talus ont des
bien ancrées et stables dans les premières tandis qu’elles sont peu nombreuses et légères pour les seconds. La fouille, bien que limitée, des surfaces internes, n’a en effet permis de mettre en évidence que de rares calages de poteaux, de diamètre et de profondeur modestes. L’érosion importante
Toutefois, les enceintes fossoyées ne sont pas épargnées par ces dégradations naturelles, à l’instar de ce qui a pu être indiqué à de nombreuses reprises dans le Centre-Ouest. L’intérieur de l’espace ceinturé y est rarement exploré et les traces d’implantations domestiques sur ces gisements de hauteur sont peu nombreuses. Néanmoins, l’existence de structures domestiques internes est clairement attestée que ce soit par les différentes fosses d’ancrage ou de calage de poteaux observée, formant régulièrement des plans de bâtiments, parfois imposants.Les enceintes fossoyées apparaissent ainsi comme des habitats pérennes, occupées sur des temps longs, ce que corroborent la réutilisation et le réaménagement de certains
supposent l’implantation d’une communauté sans doute numériquement importante. L’investissement en temps pour la création de tels établissements est relativement conséquent mais peut être pondéré par la main d’œuvre à disposition. Il s’agit de véritables espaces habités, ce que soutient la variété des vestiges recueillis (récipients céramiques de différents types, outillage lithique, outillage macro-lithique lié au traitement des céréales, restes fauniques et parfois végétaux). La culture matérielle y est également abondante (quel que soit les niveaux d’occupation), plus que sur les éperons barrés.Au contraire les éperons côtiers barrés par des talus semblent n’être occupés que temporairement et par un groupe de
tendent l’installation d’une communauté moins importante, peut-être constituée par une fraction d’un groupe. Ces sites connaissent également une localisation particulière qui les astreint à de fortes contraintes climatiques. Ces espaces de hauteur sont en effet exposés et sensibles, comme en témoigne aujourd’hui encore la forte érosion des sols et la végétation rase. Les pointes barrées surplombant l’océan se situent à l’ouest des îles et des presqu’îles. Ces côtes traditionnellement dites « sauvages », sont soumises, à différentes périodes de l’année, à des vents violents rendant pénible toute occupation annuelle. Ce phénomène est déjà rapporté dans la littérature au début du 20ème siècle ap. J.-C. sous la plume de Z. Le Rouzic ou encore de M. et St-J. Péquart, véritables récits épiques de fouilles. Ces phases défavorables sont néanmoins saisonnières et donc ponctuelles, ce qui va dans le sens d’installations temporaires. Le caractère monumental de
retours sur sites. Ce phénomène est moins tranché pour les implantations estuariennes, de golfes ou de rias qui subissent de façon moindre ces effets climatiques. Ces
299
IDENTITÉS - IDENTIIES, BLANCHARD ; ORGANISATION ET GESTION DE L’ESPACE LITTORAL DU SUD...
derniers gisements sont de plus à proximité directe de source d’eau douce pérenne a contrario des implantations littorales une nouvelle fois soumises aux contraintes de la saisonnalité. En effet, si les ruisseaux sont proches des sites côtiers, ils ne semblent pas alimenter annuellement. Leur assèchement à certaines périodes de l’année induit alors pour l’approvisionnement des déplacements de l’ordre de quelques kilomètres.
de talus (extraction de matériaux, construction) est important et paraît excessif pour un habitat fréquenté occasionnellement. Ainsi, le bois d’œuvre nécessaire
à proximité directe des sites puisque la végétation arboricole est peu abondante sur le littoral et les îles, notamment à la période concernée (Gaudin 2004). La forte représentation de chêne à Groh-Collé témoigne de cet approvisionnement lointain (Jude 2010). De plus, l’emplacement des architectures ne concourt aucunement à pallier les aléas climatiques puisque les talus prennent place sur le pan terrestre des pointes et relèvent donc d’une fonction différente. Ces promontoires sont donc plus vraisemblablement occupés sur des temps courts mais à de multiples reprises. Pour autant, les modalités déterminant ces déplacements ne nous sont pas connues. Si les facteurs naturels jouent un rôle important, d’autres causes, plus fonctionnelles, peuvent expliquer ces migrations.Le mobilier recueilli plaide en faveur d’implantations
des récipients de tous types (présentation, consommation, préparation et plus rarement stockage des aliments). Les macro-outils liés à la mouture ou encore à certaines activités halieutiques (poids de pêche) sont autant d’indices supplémentaires. On peut néanmoins déplorer l’absence
bien attestée par la présence de poids et pesons d’argile sur les sites d’enceintes fossoyées (Prises, Gâtineaux, Priaureau) au contraire des poids de pêche, absents. Le mobilier lithique suggère une activité spécialisée sur
jour en l’absence d’analyses tracéologiques. Le débitage s’effectue bien in situ puisque l’assemblage lithique récolté rend compte de toutes les phases de la chaîne opératoire. Cette dernière est courte et simple, principalement développée sur galets côtiers de silex, matériau local. L’investissement technique est peu important puisque la percussion posée sur enclume est engagée de façon quasi systématique pour l’obtention des seuls éclats. Au contraire, le mobilier issu des enceintes fossoyées présente une plus grande diversité et une plus grande complexité tant concernant les matières premières que les techniques engagées et productions (Blanchard 2012a ; Fouéré 1994 ; Guyodo 2001). Chacun des éperons talutés se distinguent par un taux d’outillage relativement faible (4 à 7%) au regard de celui exprimé dans les enceintes fossoyées pourtant contemporaines (6 à 44%). La grande quantité de déchets produits par le débitage de galets côtiers sur les
élevé : le nombre de supports impropres et délaissés étant largement plus important que le nombre de supports voulus et transformés. Néanmoins, force est de constater la faible variété de l’outillage, composé principalement de grattoirs, perçoirs, pièces esquillées, coches retouchées. Les pièces
importées y sont également moins fréquentes que sur les enceintes fossoyées. De plus une catégorie particulière d’outil domine l’ensemble lithique de chacun de ces gisements littoraux, de façon écrasante ; c’est le cas des pièces esquillées à Groh-Collé (plus de 50% de l’outillage) ou encore des perçoirs à Er Yoh (plus de 60%). Une activité spécialisée nécessitant la production en nombre d’un outil
l’autre. Chacun d’eux serait alors dévolu à une activité en particulier, que seules des études tracéologiques menées sur les outils majoritaires permettraient de préciser.
A l’inverse des enceintes fossoyées, dont la pérennité en terme d’occupation ne peut être remise en cause, les éperons talutés constituent, eux, des implantations temporaires à saisonnières, régulièrement fréquentés où
particulière. Reconnues sédentaires, ces populations font néanmoins preuve d’une mobilité partielle répondant vraisemblablement à des besoins économiques stratégiques. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une simple
(« logistical or radiating mobility », Whittle 2001, 150) puisque la présence de constructions pérennes et somme toute monumentales à ostentatoires que sont les talus renvoie à une mobilité ancrée (« embedded or tethered mobility », Whittle 2001). Il s’agit d’une organisation particulière du territoire d’un groupe où coexistent différents types d’implantations humaines.
Différents paramètres semblent donc conditionner le positionnement de ces implantations côtières qui résultent d’un véritable choix et sous-tendent donc une
et propices à une occupation annuelle durable sont en effet accessibles à seulement quelques kilomètres de ces pointes notamment sur les côtes orientales de certaines îles. Cependant les avantages des sites choisis peuvent être nombreux : gestion de ressources naturelles exploitables, activité de productions particulière, etc. Le caractère côtier de ces gisements engage assez logiquement à rechercher ces atouts vers le milieu maritime (ressources vivrières importantes, voie de communication, etc.).
Comme pour de nombreux espaces ceinturés, le caractère défensif de ces sites paraît le plus évident. Il soulève, de plus, de réelles questions : se protéger de qui ou de quoi ? N’envisager que cette seule fonction paraît depuis longtemps réducteur puisque les témoignages de violence sont rares. Ces promontoires disposent d’autres particularités qu’il convient également d’apprécier. Ainsi, leur position procure une vue dégagée sur la mer, particulièrement favorable à la surveillance et/ou au contrôle saisonnier du domaine maritime et des éventuelles activités associées. Ces gisements sont de surcroît positionné sur des pointes visibles depuis la mer. Ainsi, de récentes approches archéogéographiques menées dans la région de Lorient ont permis de constater la bonne visibilité de la côte nord de l’île de Groix (et notamment de la pointe de Pen-Men) depuis de nombreux points pris sur l’océan (Lopez-Romero 2008). Cette hypothèse n’est pas
300
HOMER : ANCIENS PEUPLEMENTS LITTORAUX / ANCIENT MARITIME COMMUNITIES
été proposée en 1998, pour le camp du Lizo notamment (Sherratt 1998). Outre les pratiques halieutiques, l’existence d’axes de circulation maritime est également à prendre en considération et nécessite donc une attention toute particulière.Cette hypothèse fonctionnelle ne serait en aucun cas propre au Néolithique puisque des propositions similaires ont vu le jour il y déjà quelques années pour la période protohistorique. Les éperons côtiers barrés par des remparts, à l’Âge du Fer notamment, sont eux bel et bien considérés comme concourant à l’organisation territoriale et maritime.
particulière en lien avec une maîtrise de technique ou de
surveillance des axes de circulation maritime (Maitay et al., 2009), hypothèses bien établies pour ces périodes ultérieures.
parfois envisagées comme de véritables « postes de guet » (Maguer 1996, 113). Il n’est de plus pas rare de voir ces populations gauloises s’implanter sur des pointes déjà
(Beuzec-Cap-Sizun, Finistère ; Maguer 1996) ou encore à la pointe du Châtelet (Ile d’Yeu, Vendée ; Chauviteau 2010). De la même façon, des remparts protohistoriques se surimposent à des talus préhistoriques comme à Beg-an-Aud (Quiberon, Morbihan ; Galles 1869 ; Le Rouzic 1930b). Ces implantations perdurent également jusqu’aux époques modernes à contemporaines. Ainsi, le sémaphore Saint-Sauveur (Ile d’Yeu, Vendée) surplombe de quelques mètres la Pointe de la Tranche ; de même, la maison des Douaniers prend place sur la pointe du Percho à l’ouest de la presqu’île de Quiberon. Cependant ce type d’implantation particulier semble émerger au Néolithique récent, les exemples antérieurs (Néolithique moyen notamment) étant exceptionnels.Les axes de circulation maritime sur l’océan Atlantique peinent à être reconnus pour les périodes antérieures à la protohistoire, alors que la navigation est maîtrisée depuis bien longtemps. Dès le début du Néolithique, nombre d’échanges sur des distances parfois importantes sont assurés en Méditerranée. L’obsidienne en est un des marqueurs les plus documentés (Costa 2007). De la même façon, les contacts entre les côtes bretonnes ou normandes et la Grande-Bretagne ou l’Irlande sont largement étayés (Callaghan et Scarre 2009). Les systèmes navigants doivent être considérés différemment de ce que l’on admet traditionnellement. L’absence de témoignages directs limite nécessairement cette approche. Quelques gravures dans des monuments mégalithiques (L’Helgouac’h 1998) tel le Mané-Lud à Locmariaquer (Morbihan ; Cassen 2007) sont parfois interprétées comme des représentations d’embarcations. La localisation de ces éperons semble correspondre à des axes de circulation distincts, pour certains encore existants. Ainsi, le franchissement de l’île d’Yeu s’effectue vraisemblablement, pour cette période, et assez logiquement, par la côte occidentale ; la présence du Pont-d’Yeu, chaussée ennoyée mais surélevée à l’est de l’île est en effet susceptible de contrarier localement le passage. Un couloir au large de la presqu’île de Quiberon paraît plausible, tout comme un autre à l’est de l’île de Groix.
Bien qu’offrant des potentialités similaires, force est de constater que tous les promontoires n’ont pas été aménagés. D’autres facteurs sont donc pris en compte parmi lesquels on peut supposer l’importance de la forme et la dimension de l’éperon, de la qualité du substrat (faille, altération) et de sa composition (roche exploitable) ou encore du potentiel des ressources naturelles (matériau, eau douce,
LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Les sites-ateliers
Des sites de productions lithiques émergent sur le Massif armoricain au Néolithique récent. Ces véritables ateliers traduisent le développement d’une forte activité économique. Ils diffèrent néanmoins, dans leur organisation et leur production, des ateliers connus dans d’autres régions comme le Centre-Ouest de la France.Ces gisements, actuellement au nombre de deux, se situent sur le littoral morbihannais. Le site de Guernic prend place sur un petit îlot du même nom au nord-ouest de la presqu’île de Quiberon (Guyodo 2000) tandis que Groah Denn 1 est établi au nord de l’île d’Hoedic (Blanchard 2012b ; Large et al., 2009 ; Figure 1). Si ce dernier est clairement un contexte insulaire, il n’en va pas de même de Guernic qui se trouve, au Néolithique, en bordure du plateau continental et ainsi relié au reste de la presqu’île quiberonnaise. Ces sites se caractérisent par la présence d’amas de débitage, zones de production nettement circonscrites qui se distinguent par une très forte concentration de pièces lithiques souvent
d’importants raccords physiques indiquent avec certitude un débitage in situ.La chaîne opératoire développée sur ces zones de production est courte et simple, en tout point similaire à celle observée sur les sites d’habitat de la même époque. Ainsi, les galets côtiers de silex constituent la matière première exclusivement engagée dans cette production dévolue à l’obtention d’éclats. Le ramassage de galets s’effectue comme pour les sites d’habitat sans distinction de qualité puisque des galets impropres à la taille (faibles dimensions, difformités) se rencontrent sur ces gisements. Un stockage de ce matériau est néanmoins clairement attesté à proximité directe de la zone de taille : à Guernic, c’est un cordon de galets côtiers qui a été littéralement réagencé à proximité du poste de travail. La percussion posée sur enclume est la plus fréquemment exprimée au détriment de la percussion directe dure. Des distinctions d’intentions transparaissent dans ces ateliers : à Groah Denn 1, un amas au taux d’esquille restreint semble dévolu à l’obtention de supports tandis qu’un autre est plus vraisemblablement destiné au façonnage d’outils (Blanchard 2012b). Une segmentation de la chaîne opératoire, entre un intervenant qui extrait des supports et un second qui les transforme, peut expliquer ces différences. Le taux d’outillage dans ces amas est logiquement très faible et bien loin de ceux attendus en contexte d’habitat. Ces zones de productions sont en effet constituées pour l’essentiel de déchets de taille dont la quantité ne traduit pas une activité nécessairement longue. Au regard de la chaîne opératoire développée et de l’absence de sédiment entre chacune des pièces, ces amas
301
IDENTITÉS - IDENTIIES, BLANCHARD ; ORGANISATION ET GESTION DE L’ESPACE LITTORAL DU SUD...
sont susceptibles de résulter du travail d’une personne sur un temps court (une journée ?). Ces gisements sont donc fréquentés ponctuellement par un individu ou un groupe restreint. Si le type d’outil produit est indéterminé à ce jour, il est évident que cette production est loin d’être spécialisée ; les différents éléments recueillis plaident en faveur d’un outillage domestique commun. La destination de ces pièces reste méconnue puisque ces faits archéologiques sont déconnectés de toute ambiance domestique (aucun ou de rares éléments céramiques, pas de structures en creux type calages de poteaux). Les
proximité d’un alignement mégalithique. De la même façon le site de Guernic ne compte aucun habitat dans son environnement proche. Les pièces ainsi produites sont donc destinées à des lieux de consommation qu’il est
plus, aucun aménagement, aucune protection n’intervient pour cette activité qui s’effectue donc très ponctuellement lorsque le contexte y est favorable. Ces gestuelles courtes sont, de plus, répétées puisque le seul îlot de Guernic compte plus d’une centaine d’amas (Guyodo 2000), dont certains se superposent (cyclicité de l’acte). Le recouvrement sédimentaire de ces faits est très rapide. Les fouilles menées en 1998 et 1999 ont permis d’observer un dépôt éolien occultant l’ensemble de l’amas de débitage en moins d’un an (Guyodo 2000). La multiplication des amas ne résultent donc pas de fréquentation du lieu sur des périodes différentes mais de fréquentations ponctuelles répétées au cours du Néolithique récent. Ces gisements relèvent d’une véritable mobilité logistique.La grande quantité d’objets produits ponctuellement sur ces gisements impose l’existence d’axes de circulation appropriés pour leur exportation. Les sites de consommations semblent en effet distincts et vraisemblablement éloignés des sites-ateliers. Si cette distance peut être de l’ordre de seulement quelques centaines de mètres, des exportations plus lointaines (île/continent par exemple) sont également possibles. Les échanges par voie d’eau apparaissent alors comme une solution judicieuse aux problèmes posés par la
Les phénomènes de dépôts
Des actes volontaires de dépôts, en contexte insulaire notamment, traduisent eux de gestes particuliers autour de l’espace maritime. S’ils se distinguent, sur le fond, de la forte activité économique ambiante, ils relèvent néanmoins des mêmes axes de circulation.Des dépôts céramiques et lithiques ont ainsi été observés de part et d’autre de l’alignement mégalithique de Groah Denn 1 sur l’île d’Hoedic (Blanchard 2012b ; Large et al.,de productions locales ni même insulaires. Ainsi la lame de hache polie en roche métamorphique indéterminée et le fragment de lame de hache polie en dolérite résultent d’importations puisque ces deux matériaux sont absents du substrat local (Audren et Plaine 1986). L’analyse pétrographique de lames minces céramiques effectuées sur les récipients déposés, complétée par des analyses au spectromètre RAMAN conduisent à un constat identique : les minéraux exogènes présents impliquent une circulation
qui le compose. Les fragments céramiques se caractérisent par une grande variété dans la composition des pâtes. Les minéraux originaires de roches locales sont prédominants (quartz, feldspath, muscovite, biotite) mais s’accompagnent parfois de minéraux tel la staurotide ou le disthène. Ces derniers, typiquement continentaux, induisent de fait une circulation continent-île (Audren et Plaine 1986). Toutefois la provenance demeure limitée puisque régionale (Figure 3). Le phénomène inverse s’observe dans les productions céramiques de Groh-Collé, site éponyme. Des amphiboles (glaucophane) dont la provenance est à rechercher sur l’île de Groix font partie intégrante de récipients rencontrés cette fois sur le continent. Les transferts par voie maritime sont donc indéniables, et dans les deux sens.
La diffusion de matières, de produits, d’idées
Si les échanges entre îles et continent sont depuis bien longtemps reconnus, l’importance d’axes de circulation à l’échelle de la façade Atlantique est encore contestée. Pourtant les preuves indirectes - particulièrement dans les assemblages lithiques - ne manquent pas.La diversité des matières premières rencontrées en est l’exemple même. Les matériaux de provenance locale sont prépondérants. Les galets côtiers de silex se rencontrent fréquemment sur les plages perchées occidentales de la presqu’île quiberonnaise et sur les proches îlots (Téviec). Leur ramassage semble s’effectuer en quantité si l’on en juge par le nombre important de galets impropres à la taille recueillis et par de ponctuels phénomènes de stockage. Il paraît donc plus aisé et nettement moins pénible de transporter ces grandes quantités de matériau par voie d’eau. La plus grande variété de matière propre à la taille disponible au sud de l’estuaire de la Loire apparaît dans les corpus des enceintes fossoyées (Figure 3). Toutefois, des gestions différentes apparaissent selon les gisements et les phases chronologiques concernées. Ainsi, le silex des Moutiers-en-Retz est fréquent sur les sites des Gâtineaux mais également aux Prises ou au Priaureau (Goudissard 2008 ; Guyodo 2003a ; Poisblaud 2011). Le quartzite de Montbert est plus fréquent aux Gâtineaux (phase ancienne) et à La Chevêtelière tandis qu’il est quasi-inexistant à totalement absent des sites des Prises, du Priaureau ou des Caltières (Guyodo et Rousseau 1997 ; Péridy 2009). Il est également attesté dans de faibles proportions (deux pièces) sur la pointe de la Tranche (île d’Yeu ; Blanchard 2010).
récente des Gâtineaux.Les importations extra-régionales constituent un complément non négligeable à ces matières premières locales (Figure 3). Parmi elles, l’opale résinite, originaire des marges orientales du Massif armoricain, est présente dans les niveaux anciens des Gâtineaux, au Priaureau et dans la collection ancienne de Groh-Collé (fouilles Z. Le Rouzic 1911-1913 ; Guyodo 2001). Elle est également particulièrement présente dans l’assemblage de Champ-Durand (Nieul-sur-l’Autise, Vendée ; Papon 2009). Une lamelle en opale résinite à la Chevêtelière plaide en faveur du transfert d’un support. De la même façon, le silex crétacé charentais est attesté sur le site des Gâtineaux (nucléus, éclats très à non corticaux) et sous la forme de supports - laminaire le plus souvent - à la pointe de la
302
HOMER : ANCIENS PEUPLEMENTS LITTORAUX / ANCIENT MARITIME COMMUNITIES
Tranche, au Priaureau et aux Caltières. C’est toutefois sous la forme d’outils qu’il est importé aux Prises.Le silex turonien de la région du Grand-Pressigny
(poignards) et supports (essentiellement des lames ; Figure 3). Les fragments laminaires ont été observés sur les sites du Priaureau et de la pointe de la Tranche tandis que les poignards connaissent une diffusion plus importante. Leur présence est ainsi assurée sur les sites des Gâtineaux, des Prises, de la Chevêtelière, d’Er Yoh (Guyodo 2007). Les collections de surfaces des sites du Tabier (Sainte-Marie-Sur-Mer, Loire-Atlantique) ou encore de Chantepie (La Plaine-sur-Mer, Loire-Atlantique), en livre également quelques spécimens au sud de l’estuaire de la Loire (Pineau 2007). Les poignards à dos poli sont eux uniquement recensés à Groh-Collé et de rares armatures perçantes en silex turonien de la région du Grand-Pressigny sont à mentionner à La Ferté (La Plaine-sur-Mer, Loire-Atlantique ; Pineau 2007). Les lames de haches polies d’origine extra-régionale sont nombreuses. Les produits en métadolérite de type A des ateliers de Séledin à Plussulien (Côtes-d’Armor ; Le Roux 1999) ont été découverts sur les sites des Gâtineaux, du Priaureau, des Prises et de la Chevêtelière. En dehors de ces enceintes fossoyées du
sud de l’estuaire de la Loire, des pièces identiques ont été récoltées sur les sites côtiers d’Er Yoh, du Lizo mais également de Groh-Collé (fouilles Z. Le Rouzic 1911-1913 ; Guyodo 2008 ; Le Rouzic 1932). Les lames de haches polies en silex issues des ateliers saintongeais d’Ecoyeux-Taillebourg sont présentes jusqu’au sud de l’estuaire de la Loire puisque des exemplaires existent aux Gâtineaux, au Priaureau, aux Caltières, à la pointe de la Tranche et potentiellement à la Chevêtelière. Le mobilier lithique n’est pas le seul témoignage d’échanges sur la façade Atlantique. Ainsi, de rares récipients Peu-Richard (un à deux exemplaires), aux Prises, au Priaureau mais également dans le Bassin de Penhouet (Saint-Nazaire), zones bien éloignées du Centre-Ouest de la France, plaident en faveur de la circulation d’autres
en l’absence d’études archéométriques systématiques, de tracer ces déplacements.
Des transferts techniques sont également perceptibles. La confection d’outils lithiques typologiquement exogènes sur matière première locale traduit des échanges d’idées
traditionnellement cantonnées au Bassin moyen à
Figure 3. Axes de circulations potentiels.
303
IDENTITÉS - IDENTIIES, BLANCHARD ; ORGANISATION ET GESTION DE L’ESPACE LITTORAL DU SUD...
inférieur de la Loire se rencontrent sur les sites littoraux, aux Gâtineaux, aux Prises, au Priaureau ainsi qu’à la Chaussée (Le Clion-sur-Mer, Loire-Atlantique), la Ferté (La Plaine-sur-Mer, Loire-Atlantique), la Frenelle (La Plaine-sur-Mer, Loire-Atlantique ; Pineau 2007) ou encore à Pontchâteau (Loire-Atlantique). Plus exceptionnelle est cette armature typologiquement Sublaines sur galet côtier de silex découverte en contexte insulaire à Groah Denn 1 (Hoedic). De la même façon, un perçoir Moulin-de-Vent, type dit peu-richardien, dénote à Er Yoh ; ils sont plus fréquents à la Chevêtelière et au Priaureau. La pointe de la Tranche fait état du même phénomène avec une raclette,
Ces échanges concernent des biens de valeurs variables
et restent limités puisqu’il ne s’agit pour chacun des gisements que de quelques témoignages relevant d’échanges ponctuels. Si traditionnellement les axes terrestres sont privilégiés, la possibilité de circulation
: la Loire apparaît comme l’axe le plus pertinent pour le transfert de matières premières (opale résinite), de produits (silex turonien de la région du Grand-Pressigny) ou encore d’idées (armatures typologiquement Sublaines) depuis les marges orientales et sud-orientales du Massif armoricain. Le transport par voie maritime est également des plus probables pour le silex crétacé charentais et les lames de haches polies en silex turonien saintongeais. Dans le Centre-Ouest, de nombreux sites sont implantés
La proximité des ateliers Ecoyeux-Taillebourg avec des voies navigables conduit P. Fouéré à constater que « l’approvisionnement en silex turonien brut ou en produits ébauchés ne devait poser guère de problèmes à tous les Néolithiques de Saintonge, voire même, par la Charente, à ceux du cognaçais et de l’Angoumois et par cabotage à la Vendée et aux côtes bretonnes » (Fouéré 1994, 396). De la même façon, les ateliers de Sélédin à Plussulien sont
Haut-Blavet, débouchant dans la rade de Lorient (Le Roux 1999).Bien que les témoignages archéologiques relatif à la navigation soient rares voire inexistants pour l’océan Atlantique, il ne faut pas pour autant sous-estimer l’importance de tels axes de circulations qui offre notamment la possibilité de déplacer tout ou partie de la production par voie d’eau.
CONCLUSION
L’organisation territoriale subit d’importants changements au Néolithique récent. Si la sédentarité de ces populations n’est plus à prouver, une mobilité de tout ou partie du groupe peut être proposée. De nouvelles modalités d’implantations émergent ainsi en parallèle d’une
Les enceintes fossoyées, localisées à quelques kilomètres du trait de côte, constituent des sites à occupation humaine longue qui regroupent une communauté sans doute importante. En revanche, les éperons barrés par des talus architecturés semblent destinés à n’accueillir qu’une
petite communauté. Ils prennent place sur le littoral, en bord de rias, de golfes ou d’estuaires et sont soumis à des contraintes climatiques, parfois fortes. Des occupations temporaires et/ou saisonnières sont donc des plus plausibles ; des retours réguliers sont attestés sur des laps de temps court. La tenue d’une activité spécialisée, à ce jour indéterminée, pourrait expliquer de telles implantations. La position tant topographique que géographique de ces gisements leur confère parfois un rôle particulier. La proximité avec de vastes étendues d’eau en fait des points stratégiques pour la surveillance et/ou le contrôle
pour des implantations protohistoriques similaires. Ce phénomène est connu jusqu’à l’époque actuelle puisque des postes de surveillance prennent place sur des pointes au contact direct de gisements néolithiques. L’occupation du territoire ne s’arrête toutefois pas là puisque des sites-ateliers, à ce jour, déconnectés de structures d’habitat ont
à des occupations parfois extrêmement courtes, de la part de quelques individus. La production lithique y est avérée, tournée vers l’obtention d’un outillage dit commun. La localisation des sites et la quantité de produits suggèrent un possible transport par voie d’eau vers le (ou les) site(s) consommateur(s).Ces implantations côtières semblent liées à l’essor grandissant des échanges. Matières premières, produits
de la façade Atlantique. L’existence de gîtes et/ou de
et océan renforce l’hypothèse de modalités de transports
de pièces et de masses conséquentes, tout en accroissant la vitesse de déplacement a contrario des pérégrinations par voies terrestres. Toutefois les importations ne constituent qu’une faible part de la culture matérielle récoltée, laissant envisager une mobilité ponctuelle. En effet, toutes les saisons ne sont pas propices à la navigation (Callaghan et Scarre 2009).Les éperons barrés par des talus seraient peut-être occupés à des moments correspondants à une plus forte fréquentation des routes maritimes.
Au Néolithique récent, les implantations humaines du littoral sud-armoricain sont variées et relèvent de statuts et de fonctions bien différents. Les groupes humains connaissent et maîtrisent leur territoire. La mer ne constitue en aucun cas une barrière mais, au contraire, un espace privilégié de contacts et d’échanges. Le domaine
majeur dans l’organisation du territoire.
BIBLIOGRAPHIE
Audren, C. et Plaine, J. 1986. Notice explicative de la carte géologique du BRGM au 1/50 000 de Belle-Île en Mer, Houat et Hoëdic, 447-477. Orléans, Bureau des Recherches Géologiques et Minières.
Blanchard, A. 2010. Le site néolithique de la Pointe de la Tranche. Rapport d’opération archéologique programmée. Nantes, Service Régional d’Archéologie des Pays de la Loire.
304
HOMER : ANCIENS PEUPLEMENTS LITTORAUX / ANCIENT MARITIME COMMUNITIES
Blanchard, A. 2012a. Le Néolithique récent de l’Ouest de la France : le Groh-Collé. In G. Marchand et G. Querré (dir.), Roches et sociétés de la Préhistoire. Entre massifs cristallins et bassins sédimentaires. Actes du colloque international de Rennes, 28-30 avril 2010, 465-481. Rennes, Presses Universitaires de Rennes.
Blanchard, A. 2012b. Occupations insulaires au Néolithique Annales
de Bretagne et des Pays de l’Ouest 119 (1), 7-30.
Boujot, C. et L’Helgouac’h, J. 1986. Le site néolithique à fossés interrompus des Prises à Machecoul (Loire-Atlantique). Études sur le secteur oriental. In B. Vandermeersch (dir.), Préhistoire de Poitou-Charentes. Problèmes actuels. Actes du 111ème Congrès des Sociétés Savantes, Poitiers, 1986 commission de Pré et Protohistoire, 255-269. Paris,
Callaghan, R. and Scarre, C. 2009. Simulating the western seaways. Oxford Journal of Archaeology 28 (4), 357-372.
Cassen, S. 2007. Le Mané Lud en images : interprétations de signes gravés sur les parois d’une tombe à couloir néolithique (Locmariaquer, Morbihan). Gallia Préhistoire 49, 197-258.
Chauviteau, A. 2010. Inventaire des sites et du mobilier . Rapport
de prospection inventaire. Nantes, Service Régional d’Archéologie des Pays de la Loire.
Costa, L. J. 2007. L’obsidienne, un témoin d’échanges en Méditerranée préhistorique. Paris, Errance.
Fouéré P. 1994. Les industries en silex entre néolithique moyen et campaniforme dans le nord du Bassin aquitain. Approche méthodologique, implications culturelles de l’économie des matières premières et du débitage. Thèse de doctorat, Université de Bordeaux I.
Galles, L. 1869. Compte-rendu sur la fouille du tumulus de Beg-en-Aud, Saint-Pierre-Quiberon. Bulletin de la société polymathique du Morbihan, 112-116.
Gaudin, L. 2004. Les transformations spatio-temporelles de la végétation du nord-ouest de la France depuis
paysagères. Thèse de doctorat, Université de Rennes 1.
Goudissard, S. 2008. Les assemblages lithiques du sud du Pays de Retz au Néolithique, l’exemple du site des Prises à Machecoul (Loire-Atlantique). Mémoire de Master 1, Université de Rennes 2.
Guyodo, J. N. et Rousseau, J. 1997. L’industrie lithique du site néolithique des Caltières (Commune d’Olonne-sur-Mer, Vendée). Revue Archéologique de l’Ouest 14, 5-16.
Guyodo, J. N. 2000. L’atelier de débitage de Guernic (Saint-Pierre-Quiberon, Morbihan) : résultats des campagnes 1998-1999. Bulletin de l’Association Manche Atlantique pour la Recherche Archéologique dans les Îles 13, 43-64.
Guyodo, J. N. 2001. Les assemblages lithiques des groupes néolithiques sur le Massif armoricain et ses marges. Thèse de doctorat, Université de Rennes 1.
Guyodo, J. N. 2003a. Le site d’habitat néolithique de Gâtineaux à Saint-Michel-Chef-Chef (Loire-Atlantique).Service Régional d’Archéologie des Pays de la Loire.
Guyodo, J. N. 2003b. Le site de Pen Men.d’opération. Rennes, Service Régional d’Archéologie de Bretagne.
Guyodo, J. N. 2007. Installations néolithiques et gauloises à Er Yoc’h (Houat, Morbihan) : état de la question.
4, 229-250.
Guyodo, J. N. 2008. L’habitat néolithique de Groh-Collé (Saint-Pierre-Quiberon, Morbihan)d’opération. Rennes, Service Régional d’Archéologie de Bretagne.
Jude, F. 2010. Étude anthracologique de deux sites d’habitat néolithiques dans l’Ouest de la France (Morbihan, Loire-Atlantique). Mémoire de master 1, Université de Rennes 2.
L’Helgouac’h, J. 1998. Navigation et navires durant la période néolithique en Bretagne. Sur l’interprétation des gravures mégalithiques. In G. Camps (dir.), L’Homme préhistorique et la mer. Actes du 120e Congrès National des Sociétés Historiques et
Large, J. M., Mens, E., Guyodo, J. N., Blanchard, A. et Deloze, V. 2009. Hoëdic, Groah Denn. Rapport de fouille programmée pluriannuelle. Rennes, Service Régional d’Archéologie de Bretagne.
Le Roux, C. T. 1992. Découvertes de structures d’habitats néolithiques dans le bassin oriental de la Vilaine. In C. T. Le Roux (dir.), Paysans et bâtisseurs, l’émergence du Néolithique atlantique et les origines du mégalithisme. Actes du 17e Colloque interrégional sur le Néolithique, Vannes, 29-31 octobre 1990, 79-83. Rennes, Revue Archéologique de l’Ouest supplément 5.
Le Roux, C. T. 1999. L’outillage de pierre polie en métadolérite du type A. Les ateliers de Plussulien (Côtes-d’Armor). Production et diffusion au Néolithique dans la France de l’Ouest et au-delà. Rennes, Université de Rennes 1.
Le Rouzic, Z. 1930a. Carnac, fouilles faites dans la région 1924-
305
IDENTITÉS - IDENTIIES, BLANCHARD ; ORGANISATION ET GESTION DE L’ESPACE LITTORAL DU SUD...
1925. Vannes, Lafolye et de Lamarzelle.
Le Rouzic, Z. 1930b. Carnac, les gisements ou ateliers de silex de la région. Bulletin de la Société Préhistorique Française 27 (4), 240-247.
Le Rouzic, Z. 1932. Carnac, Restauration faites dans la région, talus de défense avec dolmen et fonds de cabanes de Croh-Collé (commune de Sainte-Pierre-Quiberon). Rapport manuscrit. Carnac.
Lopez-Romero, E. 2008. Monuments néolithiques de la région de Lorient (Morbihan, Bretagne) : à propos des modes d’organisation des territoires. L’Anthropologie 112 (4-5), 572-597.
dans le Finistère. Revue Archéologique de l’Ouest 13, 103-121.
Maitay, C., Béhague, B., Colin, A., Ducongé, S., Gomez De Soto, J., Kerouanton, I., Landreau, G., Laruaz, J. M., Levillayer, A., Rouzeau, N., Sireix, C., Soyer, S., Vuaillat, D. et Zelie, B. 2009. Formes et variabilité des
de la France et ses marges. Les Gaulois entre Loire et Dordogne. Actes du XXXIe colloque international de l’Association Française pour l’Étude de l’Âge du Fer, 17-20 mai 2007, Chauvigny (Vienne, France), 371-421. Chauvigny, Association des publications chauvinoises, Mémoire XXXIV.
Morzadec-Kerfourn, M. T. 1973. Variations de la ligne de rivage armoricaine au quaternaire : analyses polliniques de dépôts organiques littoraux. Thèse de doctorat, Université de Rennes 1.
Papon, J. 2009. Étude lithique de l’enceinte de fossés interrompus de Champ-Durand (Nieul-sur-l’Autise, Vendée). Mémoire de master 1, Université de Rennes 2.
Peridy, P. 1999. Les enceintes néolithiques à fossés interrompus entre Loire et Marais poitevin. Bulletin de la Société préhistorique française 96 (3), 421-426.
Péridy, P. 2009. La Chevêtelière, Saint-Mathurin.
d’Archéologie des Pays de la Loire.
Pineau, A. 2007. Néolithique (IVème-IIIème millénaire) au sud de l’estuaire de la Loire (Pays de Retz, Loire-Atlantique). Mémoire de master 1, Université de Rennes 2.
Poisblaud, B. 2011. L’enceinte du Néolithique récent du PriaureauRégional d’Archéologie des Pays de la Loire.
Roussot-Larroque, J., Bouchet, J. M., Burnez, C., Gruet, M. et Villes, A. (1986). Sites de hauteur et de vallée dans le bassin de la Charente. L’exemple de la Seugne et du Né. In B. Vandermeersch (dir.), Préhistoire de Poitou-Charentes. Problèmes actuels. Actes du 111ème Congrès des Sociétés Savantes, commission de pré- et protohistoire, Poitiers 1986, 347-384. Paris,
Sherratt, A. 1998. Points of exchange: the later Neolithic monuments of the Morbihan. In A. Gibson and D. Simpson (eds.), Prehistoric ritual and religion. Essays in honour of Aubrey Burl, 119-138. Stroud. Stutton Publishing.
Whittle, A. 2001. From mobility to sedentism: change by degrees. In R. Kertész, and J. Makkay (eds.), From the Mesolithic to the Neolithic. Proceedings of the International Archaeological Conference held in the Damjanich Museum of Szolnok, September 22-27 1996, 447-461. Budapest, Archeolingua Alapitvany 2.
306
HOMER : ANCIENS PEUPLEMENTS LITTORAUX / ANCIENT MARITIME COMMUNITIES
ORGANISATION ET GESTION DE L’ESPACE LITTORAL DU SUD DU MASSIF ARMORICAIN AU NÉOLITHIQUE RÉCENT.
Audrey BLANCHARD
MOTS-CLÉS : Néolithique récent – Groh-Collé, éperons barrés, enceintes fossoyées, sites-ateliers, surveillance maritime, échanges, circulation maritime, mobilité des groupes.
RÉSUMÉ :Nos connaissances concernant l’habitat au Néolithique récent sud-armoricain se cantonnent pour l’essentiel aux données offertes par les sites littoraux et côtiers. Les modalités d’implantations humaines sont variées et relèvent de statuts et fonctions différents. Si des occupations longues sont attestées pour les enceintes fossoyées, les éperons côtiers, barrés par des talus, semblent eux occupés régulièrement mais de façon temporaire et/ou saisonnière. Des sites-ateliers (ateliers de débitage du silex), fréquentés sur des temps extrêmement courts et à de multiples reprises, complètent le maillage territoriale. La mobilité, toute relative, de ces groupes humains semble aller de pair avec le développement des échanges que ce soit à l’échelle locale ou extra-régionale. Il est désormais possible de proposer, outre l’existence d’axes
de golfes ou d’estuaires. De telles implantations peuvent ainsi être considérées, de la même façon que pour les périodes ultérieures, comme des points stratégiques de surveillance et/ou de contrôle des voies navigables.
ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF THE COASTAL SPACE IN THE SOUTH OF THE ARMORICAN MASSIF DURING THE LATE NEOLITHIC.
Audrey BLANCHARD
KEY-WORDS:Late Neolithic, Groh-Collé, promontory, ditched enclosures, workshop-sites, maritime surveillance, exchanges, maritime routes, mobility of groups
Abstract:Our knowledge concerning the living environment in the south of the Armorican Massif during the Late Neolithic is
statutes and functions. While the ditched enclosures are known to have been occupied over long periods, the coastal barred spurs (promontory forts) seem to have been regularly occupied but in a temporary and/or seasonal way. Workshop
territorial network. The quite relative mobility of these human groups seems to be associated with the development of
can now propose a particular function for the barred spurs, which are observed just as well on the coast as on the edges of rias, gulfs and estuaries. In the same way as for the later periods, such structures can thus be considered as strategic points for the surveillance and/or control of inland waterways.