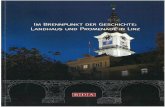«Philosophes au jardin : une promenade sceptique» in La culture d’André Lenôtre. 1613-1700....
Transcript of «Philosophes au jardin : une promenade sceptique» in La culture d’André Lenôtre. 1613-1700....
ANonÉ LE NÔTRE,
FnnGMENTSD,IJN PNYSAGE
Ct-ILTTJRELtNST|TUT|0NS, ARTs, SCtENCES Ê TECHNIQUES
Sous la direction de Georges FARHAT
MUSEE DE TI[E.DE.TRAl{CE
D(,MAINE DE SCEAUX
SCEAUX, 2006
PHIL()S()PHES AU JARDIN : UNE PR0MENADE SCEPTIQUE
Permcre FercurÈnrs
Normalienne, ancien membre de l'Ecolefrançaise de Rome, Patricia Falguières estprofesseur agrégé à l'École des hautes étudesen sciences sociales de Paris. Ses travauxportent, principalement, sur la philosophie
et l'art de la Renaissance, et sur l'artcontemporain. Elle a publié Les chambresdes merveilles, (Bagard, 2003),Le Maniéisme, une avant-gardeauXVle siècle (Découvertes, 2oo4)et une édition üilique du StAle rustiqued'Ernst Kris (Macula, 2oo5).
1. Voir Monique Mosser, " Les Duchêneet la réinvention de Le Nôtre ", HÀrolredes jardins de la Renaissance à nosjours, sots la dir. de M. Mosser& G. Teyssot, Paris, Flammarion, t99r,p. 442-446.2. Studies in the History of Gardensand Designed Landscapes vol. 18 / r(janvier-mars r998), n" spécialSeuenteenth Century French GardenHistory, dirigé par Susan Taylor-Leduc.3. Allen S. Weiss, Miroirs de I'infini.Le jardin à la française et la métaphy-sique au xvtf siècle, trâductionMathilda Sitbon, Paris, Le Seuil, 1992.4. Jurgis Baltrusaïtis, Anamorphosesou perspectiues curieuses, Paris, OlivierPerrin, 1955 (3' édition, Anamorphosesou Thaumaturgus optirzs, Paris,Flammarion, r984).5. Maurice Medeau-Ponty, La Structuredu comp ortement, Paris, (r9 4zl, ry 5 3,p. zo7-Lr3 i IlCEil et I'esprit (t96tl,Paris, Gallimard, ry64, p. 36-6o.6. Symptomatique, de ce point de vue,l'article de Susan Taylor-Leduc, « A NewTreatise in Seventeenth-Century GardenTheory ; André Félibien's Descriprionde la grotte à Versailles,, Studies inthe History of Gardens and DesignedLandscapes, op, cit., p. 35-45.
130
I est peu de lieux communs mieux établis que celui de l'affiliation de Le Nôt e,de son art, des jardins dont il a créêIa tradition, au cartésianisme. Relique d'unerhétorique nationale désuète, mais qui ne manque pas d'être périodiquement
réactivéet,le mythe du jardin de Le Nôtre -joyau d'une n clarté de conception touûefrançaise » et pour tout dire « cartésienne », s'est épanoui, au prix, on le verra, dequelque aggiornamento théorique, jusque dans l'historiographie la mieux accrédi-tée. En témoignent par exemple la récente publication d'un numéro spécial de larevùe Studies in the History of Gardens and Designed Landscapes, rout enrierconsacré au jardin français du xvrre sièclez ou le succès rencontré, en France commeaux États-Unis, par le très séduisant ouvrage d'Allen Weiss Miroirs de I'infini. Leiardin à la française et la métapbysique au xVIf siècle3 .Il semble décidément qu'onne puisse évaluer la granderir et la cohérence des projets de l'architecte-jardinier qu'àl'aune de l'épisode fondateur de la métaphysique moderne, le cogito. Simple effet decontexte qui associerait Le Nôtre à la litanie des grands noms du " classicisme fran-çais, ? Ou nécessaire prise en compte du nouveau statut fait à la géométrie par lemécanisme moderne ? Et dans ce cas pourquoi Descartes plutôt que Galilée ouKepler... ou Gassendi ? Or l'affiliation de Le Nôtre au cartésianisme a connu unrenouvellement décisif dans les années cinquante, avec la publication desAnamorphoses ou perspectiues curieuses de Baltrusaïtis4, et des cours de Merleau-Ponty qui restituèrent à l'optique cartésienne sès enjeux philosophiquess. Une triades'est solidement installée dans l'historiographie, sans qu'on prenne garde aux disso-nances des deux approches dont elle procède. Elle associe les scénographies corrup-trices du « malin génie " développées dans les Méditations métaphysiques, les dispo-sitifs optiques de la Diotrique et les manipulations perspectives déployées avec artpar le Nôtre en ses iardins. Ainsi la cartésianisation de le Nôtre, si longtemps admisepar convention, trouvait-elle enfin un semblant d'assise conceptuelle6.
Or il convient de rappeler l'ampleur et la pérennité, dans la France et l'Europedu xvrrt siècle, de la science aristotélicienne de la nature. I1 y a là un socle cultureltrès peu entamé par la révolution galiléenne, qui perdure, entre autre§, par l'ensei-gnement des collèges. Lawrence Brockliss a montré la permanence de la philosophienaturelle des scolastiques dans la culture académique du xvlrt siècle, voire au-delà:la théorie des formes substantielles, dominante encore dans les ânnées 167o, estenseignée dans les collèges parisiens jusque dans le premier tiers du xvure siècle et ilfaut attendre les vingt dernières années du règne de Louis XIV pour qu'à l'Académiedes sciences, elle cède la place au mécanisme cartésien7. Mais cette pérennité ne s'ap-puie pas, loin de là, sur la seule contrainte institutionnelle. Elle est étayée, sansdoute, par la force d'inertie des structures d'enseignementS. Elle a pu, à I'occasion,bénéficier des censures de l'Université de Paris. Mais on ne saurâit réduire à ces épi-sodes, largement commentés par l'historiographie, et ce dès le xvrre siècle, la perma-nence autrement significative d'un horizon épistémologique.
Je rappellerai que dès lors qu'il est question de qualifier un corps, d'en distinguerIa couleur, la texture, l'ensemble de ce que l'on nomme sss " propriétés secondes ",comme doit le faire par exemple un jardinier soucieux de ses terrains et de ses plan-tations, on ne saurait se passer de l'appareil descriptif aristotélicien -quoique la cos-mologie à laquelle il êtait implicitement associé ait été évincée par la physique nou-velle. La permanence du lexique aristotélicien des qualités secondes est du reste écla-tante chez ceux-là mêmes qui, gagnés au parti des " Modernes >> en matière d'astro-nomie ou de mécanique, ont affaire aux animaux ou aux plantes dont ils rédigentles inventair"rs. qr'il suffise de citer les noms de Federico Cesi, fondateur del'Académie des Lincei ou) en France, celui de Pereisc: quelle que soit l'affiliation de
SCIENCES
Abraham 8055E« Pour la reflection dans l'eau, des ()bjectz ",pl. 41, in Traité des pratiques géométrales
et perspectives enseignées dans 1'Académie
rogale de peinture etsculpture, Paris, 1665.Détail.
7. Voir Lawrence §7.B. Brockliss,n Aristotle, Descartes and the NewScience: Natural Philosophy at theUniversity o{ paris, t6oo-r74o,,Annals of Science, 18 (r98t), p. 33-69ainsi que French Higher Education inSeuenleenth and Eighteenth Cen îuries.A Cubural History, Oxford, ClarendonPress, 1987; " Lss atomes et le vide dansles collèges jésuites de France (164o-173o)", Gassendi et I'Europe (r592-t79z), sors la direction de Sylvia Murr,Paris, Vrin, 1992, p. 175-r87,8. Roger Chartier, Dominique Juliaet Marie-Madeleine Compère, I-i é du-cation en France du xvf au xvnf siècle,Paris, t976.
131
,lll
PHIL0S0PHES AU JARDIN : UNE PROMENADE SCEPTIQUE
9. J'ai développé ce thème dans n Extasede la matière. Note sur la physique desmaniéristes " dans les métamorphoseset les éléments de la nature, H. Brunon,M. Mosser & D. Rabreau (éd.),Bordeaux, §ÿilliam Blake & Co./Art& Arts, zoo4, p. 55-84.10. Cf, Allen Weiss, op. cit., p. z7:" Comme Saint-Simon, parlant deVersailles, l'a rapporré dans sesMémoires,le principe directeur du iar-din français était de " forcer la nature,,ou de « tyranniser la nature ,. A l'inver-se, le lardin anglais suivait [e principeopposé, n laisser la nature tranquille , ;p. 4r: " le jardin à la française étaitconstruit contre la nature; qui plus est,l'utilisation du jardin comme scènesociale, politique et rhéâtrale ne pouvairqu'exacerber les senriments antinâtura-listes dans ce domaine ". Cf, aussile chapitre 3 n Versailles. Versionsdu soleil: I'effroyable différencc -.p. 67-roz, qui est à l'origine d'innom-brables variations de la topique univer-sitaire anglo-saxonne sur " le systèmepanoptique de contrôle qu'était la courde Louis XIV, (slc) (A. §üeiss, op. clf.,p. 35).11. Voir " Extase de la matière,cité supra.12. Sur la constellation conceptuellede la greffe et du bouturage, et leur
fonction de paradigmes esthétiquesdans la culture gréco-latine. je renvoieà l'ouvrage essentiel de Jackie Pigeaud,Liart et le uiuant, Pais, Gallimard,ry 9 5, chap. v,vr,vrr,vrrr.13. Cela échappe aux analyses conven-tionnelles qui, à la suite de l'ouvrageclassique de Rensselaer Lee, tiennentpour immuable le paftage « moderne »
des arts (il ne remonte pas en deçà duxvIIIe siècle), c'est à dire la dissociationdes enieux des beaux-arts et des enieuxde la technique, soit l'opposition, étran-gère à l'aristotélisme, des objets de cul-ture et des objets de nature. RensselaerYl. Lee, Ut picturd poesis. Humanismeet tbéorie de la peinture x\f-xvilfsiècles (1967), trad. ll./.amice Brock,Paris, Macula, r99r.14. Les stratifications épistémologiquessont alors suffisamment complexes pourqu'une référence manifeste à Paracelse,par exemple, nourrie de la rhémariquestoitienne dt mélange des substances,s'" encastre " dans une poétique toutearistotélicienne (on peut ici évoquerPalissy ou Boyceau), ou qu'une pratiquerrès sophistiquée de la perspective soit« traduite » dans la langue pré-galiléen-ne de la merueille. Et l'on se gardera decompliquer encore le tableau en rappe-lant la pérennité, dans la littératureromanesque et la poésie d'apparat, chezle Félibien dela Description de la grotteà Versailles par exemple, de toute unerhétorique de la célébration et de l'élo-ge, une strâtégie deI'ehphrasis, dontles ressorts demeurent ceux dela Seconde Sophistique.
1,32
l'un et de l'autre à la cosmologie galiléenne, Aristote et Théophraste fournissentencore, et jusqu'au xvIIIe siècle, la matrice de toute classification botanique ou zoo-logique.
De manière plus spécifique encore, les arts du jardin ne sauraient échapper auxmodalités de qualification du site dont on trouve les prescriptions dans un corpuspresque immémorial, qu'étayaient les textes aristotéliciens: le traité hippocratiquedes Eaux, des Airs et des Lieux, ou les chapitres que Vitruve, dans le DeArcbitectura, consacre aux questions de localisation, d'exposition aux vents,d'orientation solaire, de drainage des sols, etc. Et l'on trouyera chez Dezallier, audébut du xvIIre siècle, des recommândations qui relèvent très précisément de la«prudence" des anciens: de cet«art de l'opportunit!", des«circonstances» et de«la mesure"(version renouvelée de l'art sophistique duhairos) qui est la plus cer-taine qualification épistémologique du jardinage, comme l'a rappelé ici mêmeBernadette Bensaude-Vincent.
Je ne puis ici qu'effleurer un troisième ordre d'affiliation à l'aristotélisme qui meparaît âssez peu entamé par l'essor de la science nouvelle : l'appareil de la mimesis,le branchement privilégié de l'art sur les rhouvements naturels dont il constitue l'ins-trument et l'accomplissement, toui cet apparerlN poétique, (au sens grec du terme)demeure, au xvlle siècle, intégralement en place. Il accompagne et nourrit le déploie-ment des artse. Il est indispensable, à ce propos, dlinsister sur la fidélité de Le Nôtreà l'exigence toute aristotélicienne de"seconder la naturer, de l'aider, de l'accom-plir: en somme d'inscrire les compétences de l'art dans le jeu des causalités natu-relles.
On a cru devoir étendre à l'art de Le Nôtre les critiques formulées par les mémo-rialistes contre les excès de Versailles, et assimiler le jardin à la française à un n for-Çag€», une«tyrannis" imposée à la nature. On faisait ainsi coup double: pointer" l'artifice » revenait à déceler la puissance du paradigme cartésien de " maîtrise etpossession de la nature, à l'æuvre, semblait-il, dans les rigueurs géométriques desjardins nouveauxro. C'était surtout ne pas tenir compte de la puissance rhétoriquede l'hyperbole, dans l'éloge courtisan comrrrè dans la critique. Le " forçage de lanature ", dâns la langue classique, est un thème politique : la démesure, I'ubris, quicontrevient aux mouvements naturels, est le signe le plus sûr de l'infléchissemençfyrannique du pouvoir. Que le jardinier ait du se faire, ponctuellement, l'instrumentde l'excès royal ne nous dit rien sur son art, tout au contraire. Ce dernier a parti lié,par essence, aux vertus de prudence, d'économie, à la gestion ingénieuse des patri-moines et des déterminations naturelles, toutes notions qui sont aussi, et sans qu'onpuisse les discerner, des prescriptions poétiques: en témoignent la savante adapta-tion des jardins aux conditions topographiques et climatologiques, à l'assiette fon-cière et seigneuriale du domaine en son entier, la gestion avisée de ses ressourcesannexes, (les bois, les prairies, etc.), toutes pratiques indissociablement économiqueset esthétiques auxquelles aucun des grands jardins de Le Nôtre, hormis peut êtreVersailles (mais cela reste à prouver), ne contrevient. Et l'on ne saurait tirer argu-ment de la sophistication des appareillages hydrauliques et mécaniques mis enæuvre pour invoquer quelque « contre-nature ". C'est le propre dela mimesis aristo-télicienne que de donner pleine légitimité au jeu de la technique, de l'inscrire dans lesillage des mouvements de la nature, plus encore, de lui donner place au cceur mêmedes procès naturelsrr. La technique,l'ars, est l'accomplissement méthodique, extrin-sèque, de cette puissance jaillissante qui porte spontanément à l'être les corps natu-rels. Elle ne s'y oppose pas. Pas plus que la n machine ,, fût-elle de MarlS ne s'op-pose à la greffe, au bouturage, à l'émondâge, ni les pratiques du jardinage aux pro-
cà naturels, lunaisons, cycles végétaux ou modes de reproduction animaux, qu'elles. imitent » et prolongent". Que la mimesis soit d'abord une pensée de la techniqueexplique l'extraordinaire pérennité du socle aristotélicien dans la culture de la pre-mière révolution scientifique malgré le désaveu de la cosmologie qui lui est associée:les praticiens, les hommes de.l'art >), sont, au xvrrt siècle, dès lors qu,il est questionde penser la technique, nécessairement aristotéliciens'3.
Mais au-delà de ce " bloc épistémologique , solidement implanté dans la culruredu siècle de Le Nôtre, il conviendrait de prêter une attention affinée à la complexitéde I'archive des savoirs sur laquelle s'édifie la théoriqwe du jardinage. J,emploie icià dessein le terme d'archive, puisqu'il conviendrait de repérer le jeu de traces, degreffes, de reports et d'oublis, la sédimentation des renvois et des implications tex-tuelles dont s'autorise tout traité moderne de jardinage'a. Ijappréhension au plusiuste des paradigmes de la physique mis en æuvre par les prariques et les rrairés deiardinage ne saurait donc s'accommoder de simples effets de contexte, à quoi nousramène touiours la référence cartésiennet5.
Or la référence jusque alors massive et ininterrogée au cartésianisme qui a tantmarqué l'histoire des jardins n à la française,, â connu, au fil des développementsles plus récents de I'historiographie une complicarion inatendue. Lart de Le Nôtres'est vu rapporté dans nombre de publications récentes, à une théàtralité globale-ment identifiée au Baroque... sans jamais cesser d'être cartésien.
Sans doute, les meilleures parmi les études récentes ont-elles souligné I'impor-tance de l'expérience théàtrale, de la danse, de la musique, des fêtes, des feux d,ar-tifice, des jeux d'eau dans l'élaboration des jardins royaux et restirué leur fonctionaux espaces de Le Nôtre'6. Ntrl do.rte que notre compréhension de l,æuvre du grandarchitecte ne gagne à une approche plus fine des modes de la sociabilité de cour auxvrre siècle, des enjeux du pouvoir, des techniques du corps, etc. Mais si l,on soup-çonne que l'art de Le Nôtre doit trouver sa place dans une histoire européenne du" Baroque )>, on ne l'a guère jusqu'ici démontré que sur le mode de l'amargame'7.Il n'est pas sans ironie de noter que cette affiliationup to date de l'art de Le Nôtreau Baroque, véritable catégorie transcendantale des historiens du xvrrt siècle, si ellea pu jouer dans un premier temps contre la référence au rationalisme cartésien, s'estYue rattrapée par une " baroquisatien » plus paradoxale encore: Descartes lui-mêmepromu, mascarade du malin Génie aidant, au titre de penseur des anamorphoses etautres " effets merveilleux, dignes du père Kircher... Descartes n baroquisér8 ,.
Il est frappant de constater que l'affiliation de Le Nôtre au cartésianisme parI'historiographie récente tourne essentiellement autour de la question de l'anamor-phose. Depuis que Baltrusaiiis, en t955, révéIa la prégnance des.perspectivesdépravées » au cceur de la culture du xvrrt siècle, et jusque dans ce qui apparaissaitalors comme le sanctuaire du rationalisme, l'æuvre de Descartes, les historiens ne sesont pas fait faute de reconnaître dans les savants calculs des effets perspectifs de LeNôtre une ,, application " de tel pâssage de la Dioptrique:
" [...] les règles de la perspective [qui] souvent représentent mieux des cercles par desovales que par d'autres cercles, et des carrés par des losanges que par d'autres car-rés, ainsi que toutes les figures: en sorte que souvent pour être plus parfaites en qua-lité d'images, et représenter mieux un objet, elles doivent ne pas lui ressembler'9. ,
Comme les. machines merveilleuses ») automates et surprises hydrauliques, dontelles constituent le pendant sur le versant figuratif, les anamorphoses témoigneraientde la prééminence d'une thématique baroque de n l'illusion, riche d'incidences phi-
SCIENCES
15. Elle doit en ourre se doubler d'uneapproche fine des niveaux de langage etdes modes d'énonciation, de ce dont onparle, de ce qu'on fait en distnt, de cequ'on dit qu'on fait, et de ce qu'on fait(en ef{et) - dont on n'a encore que bienpeu d'exemples. Symptomatique des
" écrasements " de niveaux d'énonciationdont se soutiennent beaucoup d'analysesrécentes, le traitement que S. Taylor-Leduc, loc. cit. supra, identifiant texte etjardin, fait subir aux si fines analyses dela rhétorique de l'éloge et de la célébra-tion jadis tissées par Louis Marin dansLe récit est un piège,Paris, 1978, oa Leportrait du roi,Paris, r98r,16. Voir Hervé Brunon, MaurizioFagiolo, Adriana Giusti, " Tra giardino,scena, festa: il nodo di Versailles ",La specchio del paradiso. Giardinoe teatro dall'Antico al Nouecento,Milan. A. Pizzi. r997, p. 78-ro9, ainsique la bibliographie et l'état de la ques-tion présentés par H. Brunon, o Les pro-rirenades du roi,, Le jardin, notredouble. Sagesse et déraison, dirigé parH. Brunon, Paris, Autrement, 1999,p. r57-tBz. Sur l'association baroquedu jardin à la représentation théâtrale,voir Y. Cazzato, M. Fagiolo, M.A.Gitsti,Teatri di uerzura. La scena delgiardino dal Barocco al Nouecento,Florence, Edifig ry93.17. Cf. Michel Conan, " Il giardino dellasovrana volontà del potere ", I trionfidel Barocco. Architellura in Europar6oo-t75o, Henry Millon (éd.), cata-Iogue de l'exposirion de laPalazzinadi Caccia di Stupinigi, Turin, 4.vrr-7.xr,1999, Mrlan, Bompiani, p.z7 9 -1 r 4.Faut-il rappeler que l'annexion des iar-dins de Le Nôtre, en l'occurrence desiardins de Versailles, au Baroque futopérée par Spengler dans Le déclin del'Ocddent, référence encore bien peuinterrogée par les historiens de l'art ?
Il semble que les mises en garde formu-lées dès 1967 par Pierre Charpentratdans Le mirage baroque (Paris,I$tmitln'aient pas ralenti la progression du my'thebaroque dans l'aire disciplinaire nouvellequ'est l'historiographie des jardins.18. Voir la stimulante recontextualisâ-tion de l'æuvre de Descartes proposéepar Jean-Pierre Cavaillé, Descartes.La fable du monde, Paris, Enrss-Vrin,r99r, ainsi que l'ouvrage pionnier deJurgis Baltrusaïtis, Anamorph oses,op. cit. supra, n. 4; on se râpporteraaux réseryes émises très tôt parGeneviève Rodis-Lewis, " Machinerieset perspectives curieuses dans leurs rap-ports avec le cartésianisme ", xyti?siècle, Bulletin de la Société d'étudesdu xvrf siècle, n" 3z ljuillet ry66),p. 46r-474. Témoigne du caractèredésormais acquis dans la littératurearchitecturale de l'association des ana-morphoses à la dioptrique cartésiennel'ouvrage d'Alberto Perez-Gomez &Louise Pelletier, Architectural represen-tation and the perspectiue Hinge,MIT Press, Cambridge, Londtes,t997, passim.
133
PHIL0S0PHES AU IARDIN : UNE PROMENADE SCEPTIQUE
Abraham 8055t
" Pour prouuer qu'il ne faut pas dessinerng peindre comme l'eil voit», pl. 58,
iîtaité des pratiques géométrales
et pe$pectives enseignées ddns l'Académierogale de peinture et sculpture, Paris, 1665.
I
losophiques voire religieuses, dont on veut retrouver les prémices dans la scène inau-gurale des Méditations cartésiennes2o.
Mon hypothèse ici est qu'à vouloir inscrire sans nuances l'æuvre de Le Nôtre auregistre du Baroque âutânt qu'à l'associer obstinément à la pensée cârtésienne, onmanque la spécificité, le " style épistémologique " propre à l'invention de Le Nôtre.On manque aussi toute la fécondité du moment historique dangJequel sa poétiques'inscrit.
PR()MENADE
Demandons nous plutôt, par exemple, en quelle langue il eût été possible de tra-duire, au xvrre siècle, ces ajustements continuels du regard, ces surprises, ces correc-tions, ces rectifications optiques, ces réévaluations répétées des distances, des places
et des interÿalles à quoi nous invite toute prome-nade dans un jardin de Le Nôtre". C'est-à-dire
-f8 ce plaisir si particulier qu'on y prend et dont je necrois pas que la langue hyperbolique de la mer-veille, si appropriée par ailleurs à la culture de
1.1
i....t
., 't,
,,.ti
..,c1...
?ær Trowr yù! njut 7u,/d.iliitr aÿ qcin&t rav '?lôtif aoit",
'v.'r'.
cour de ce temps, rende justement compte.Plaisir dont ne nous dit rien non plus une
« vue >> d'Israêl Silvestre ou d'Adam Perelle, surquoi semble-t-il tant de travaux récents persistentà fonder leurs analyses. Une gravure de Silvestreou Perelle propose bien cette maîtrise souverainedu regard, cette domination conceptuelle d'unespace de part en part intelligible et cohérentdont raffolent les tenants du " iardin-à-la-françai-se-comme-expérience-de-maîtrise-et-possession-de-1a-nature" r. Mais cette gratification estpropre à la gravure. Elle ne peut rendre compte,par exemple, de cet avènement progressif del'image du château de Vaux dans le miroir d'eaucarré qui s'offre au promeneur lorsque, paryenuau terme de son périple à travers le jardin, ados-sé au socle de l'Hercule Farnèse qui a jusque 1à
guidé ses pas, il se retourne pour constater lechemin parcouru : une image, avérée pour telle
19. Dioptrique,4' Discours, citépar G. Rodis- Lewis, op. cit., p. 469.20. C'est que l'alternative, naguère,n'offrait guère de jeu. Ou l'on rappor-tait les anamorphoses aux savoirs obs-curs de la " magie naturelle , d'un DellaPorta, d'un Agrippa, et l'intérêt quesemble y avoir pris Descartes appelait àune révision globale de son inscripriondans la culture baroque. C'est l'optionqu'ouvrit Baltrusarïis aux promoteursrécents d'une " baroquisation , deDescartes. Ou l'on rationalisait la" curiosité " cartésienne, ce fut la voieempruntée par G. Rodis-Lewis '. [...]C'est pourquoi Descartes ne s'est pas...
1,34
par Ie cadrage d'un bassin, une apparition, improbable à une telle distance du châ-teau lui-même,ùî simulacrà évanescent que le moindre souffle d'air vient défairesous nos yeux - sans doute l'un des moments les plus « miraculeux " (pourreprendre la langue de l'époque) de l'art de Le Nôtre. Au contraire, les gravures duparc de Sceaux, de Meudon, de Vaux ou de Chantilly, comme autant de visions cata-leptiques, offrent une saisie unique et assurée du plan de I'architecte, elles en décou-vrent les intentions et l'ampleur d'un projet où tout prend sens -sans reste23.Tableaux synoptiques dont la seüle temporalité possible est celle de l'instant: l'éclaird'une n révélation,. C'est le temps propre de ces " représentations compréhensives "auxquelles les Stoîciens confiaient l'intelligibilité de leurs romans et du monde. Maiselles dissimulent tout l'art de Le Nôtre à susciter cadrages et décadrages, à manipu-ler distances, niveaux, reliefs, échelles, à instaurer au prix d'un jeu de caches et derévélations dramatisées son emprise sur l'imagination et les pas du promeneur,
--l
lequel jamais n'a accès à la totalité du n tableau », emporté qu'il est d'une apparen-ce à une autre au gré d'une transition, d'une jouissance continues. Au siècle suivantcet art-là, et le plaisir singulier qu'il suscite, semblent oubliés etDézallier ne manquepas de stigmatiser ces jardins " à la Le Nôtre, qui, prenant modèle des gravures etdes plans sans prendre en compte les parcours qu'ils autorisaient, ont tout cédé audessin de vastes espaces découverts: o Il y a vingt jardins considérables autour deParis, manqués par cet endroit et où il est inutile de desceridre pour les visites:6iiles voit tout d'un coup d'æil du vestibule du bâtiment, sans être obligé de se lasser:cela n'est pas plus beau...'4 r."Oubli » ratifié par l'historiographie, tant sont raresles analyses qui savent restituer à la science de la perspective, dont Le Nôtre utilisatoutes les ressources, la charge de plaisir qui lui est propre: les descriptions deHamilton Hazlehurst naguère, aujourd'hui les analyses de Georges Farhat sontd'autant plus précieuses"5.
5U5PEr{5
En r6zt Pierre et Jacques chouet publièrent, à Paris et à Genève en mêmetemps' en grec et en latin, les G,uures du philosophe hellénisrique Sextus Empiricus.uédition regroupait les deux principaux ouvrages de sextus, les Hypotyposes (ouEsquisses) Pyrrboniennes, et le Contre les mathématiciens, traduits en latin, pour lepremier, par Henri Estienne en 1562, le second en 1569 par Gentien Hervet. Cesdeux traductions avaientbénêficié d'un énorme retentissement dans le dernier tiersdu xvrt siècle (en témoignent les lectures de Montaigne et Charron) ; rassemblées parl'édition de 16zr, elles allaient irriguer la culture philosophique et religieuse deI'Europe du Grand Siècle. Au reste, le succès de la publication des frères Çhouetn'empêcha pas, bien au contraire, que des traductions manuscrites en langue fran-çaise, celle de Sorbière par exemple circa 163o, circulent chez les mondains et lescurieux qui n'entendaient pas le latin'6.
Les æuvres de Sextus présentaient le tableau le plus complet des arguments scep-tiques récoltés et mis en ordre au rr' siècle après Jésus-Christ par un médecin grec,tout le répertoire des thèmes et des lieux des polémiques philosophiques qui oppo-sèrent, du rvt siècle av. J.-C. au second siècle de l'ère chrétienne, sceptiques et n dog-matiques, (qu'ils fussent platoniciens, aristotéliciens ou stolques). Les Hypotyposesen particulier résumaient de manière limpide et comme en un mânuel les u modes,ou « tropes » argumentatifs destinés à saper toute assertion doctrinale, toute possib!lité de connaissance et jusqu'aux modes et instruments de la logique. Cet arsenalpolémique se présentait sous la forme d'un catalogue d'effets propres à enrichirn'importe quel cabinet de curiosités (des miroirs concaves et convexes, aux machinescurieuses des prestidigitateurs), qui contribuèrent beaucoup à la popularité d'uneæuvre, par ailleurs aridement dialectique, dans la culture du premier xvrr" siècle.c'est du moins ce qui ne peut manquer d'apparaître au lecteur moderne familier dela"culture de la curiosité". or, et cela nous importe bien davantage ici, lesHypotyposes rassemblaient une série d'arguments destinés à porter le soupçon surla fiabilité des sens appelés à devenir topiques.
Une véritable physiologie de la connaissance, mettant en cause les conditionsorganiques de la perception ouvre la liste des tropes qui doivent conduire le sage à« suspendre son jugement » et gagner par là l'état apaisé de l'indifférence, l'ataraxie.Qu'il ne saurait y avoir de connaissance assurée par I'appréhension des sens, que nulêtre vivant, homme ou animal, ne puisse prétendre à la généralité de ses. impres-sionsr, c'est ce que devait prouver la diversité des pupilles, lavariété des appareils
SCIENCES
... arrêté aux anamorphoses: des tra-vaux mathématiques sur la perspective,il dégage certains calculs sur l'angle deréfraction dont il établira la loi en saDioptrique [...] le philosophe ne faitappel à ces thèmes de l'âge baroque quepour les surmonter en les rationalisant.C'était maintenir à la fois l'intégrité durationalisme cartésien et sa positiond'initiateur de la modernité. G. Rodis-Lewis, op. cit., p. 466-467, 47o.21. Voir les minutieuses analyses deH. Hazlehurst, Gardens of lllusion.TheGenius of André Le Nostre, VanderbiltUniversity Press, Nashville, r98o, et deG. Farhat, " Le Nôtre: Anamorphoses,topographie, territoires ", Pdges paysdge/ Diachroniques, zooo-2.ooa, p. 44- 5 j.22. Cf . Ie catalogue de lieux communségrenés par Allen S. Veiss, Miroirs deI'infini. op.cit., p. 22-4;-.23. On trouvera une très fine analysedes différents modes de figuration desæuvres de Le Nôtre, et des consé-quences historiographiques des planimé-tries et vues à vol d'oiseau, qui ont lapréférence des graveurs: exaltation duschéma régulateur, de la trame, de l'or-thogonalité, de la symétrie, accentuarionde I'axialité, etc., dans l'article d'HervéBrunon. " De l'image à I'imaginaire:notes sur la figuration du iardin sous lerègne de Louis XIV", xvrf siècle,n' zo9 (oct.-déc. zooo), p. 67r-69o.24. La Théorie et la pratique du iardïnage, Paris, r7o9, p. 19.25. Pour les études d'H. Hazlehurst,voir supra, Georges Fahrar. .. Pratiquesperspectives et histoire de l'art desjardins: l'exemple du Grand Canal deSceaux ", Reuwe de I'Art, n" rz9 I 3(zooo), p. z8-4o, sans oublier l'articlepionnier de Marguerite Charageat,* André Le Nôtre et l'optique de sontemps,, Bulletin de la Société d'Histoirede l'Art Français, 1955,p. 66-69.26. Sur la diffusion et les lectures deSextus en France aux xvle et xvrrt siè-cles, voir le classique de RichardH. Popkin. Histoire du scepticismed'Erasme à Spinoza, rrad. ChristineHivet, Paris, PUF, r99j.
135
PHILOSOPHES AU JARDIN : UNE PROMENADE SCEPIIQUE
27. Sextus Empiricus, Esquisses Pyrrho-niennes, laduction et commentairePierre Pellegrin, Paris, Le Seû|, ry97,p.83.28. Sextus Empiricus, Esquisses pyrrho-niennes,I, 14 [rr8-rzr], p. tr9-rzr.29. Diogène Laerce, Vies et doctrinesdes philosophes illustles, x, 85-86.30. Cicéron, Premiers A«démiques,t\ 7, 19-2-1i il, 25, 79-83.
digestifs, des humeurs, des appareils tactiles, etc. Dans un univers où l'humanité nejouit d'aucune préséance, il est manifeste que « les chiens, les poissons, les lions, les
humains et les sauterelles ne voient les mêmes choses ni égales en grandeur ni deforme identique r, de sorte que « si les mêmes choses apparâissent différentes selonla diversité des animaux, nous serons capables de dire ce qu'est l'objet en tant qu'ilest observé paf nous, mais quant à ce qu'il est par nature, nous suspendrons notreassentiment. Car nous ne serons pas capables de décider par nous-mêmes entre nosimpressions et celles des autres animaux'7,. Cette équivalence da.t\ la diversité,cette « force égale , des impressions qui rend impossible toute énonciation dogma-tique, Sextus, au fil des tropes, la transpofte ensuite à f intérieur du genre humain,et en chacun. On notera qu'ici la traduction moderne par n impressions " ne restituepas, malgré son exactitude, le riche héritage conceptuel du terme grect phantasidi.La perception engage ce que nous nommons " f imagination " (elle ne s'en distingueque dans l'ordre du temps par une sorte d'effet d'après-coup) et la topologie de ce
qui nous affecte: au pluriel, les phantasiai comme des images ou des apparitionsvenues de l'extérieur, nous affectent; au singulier, la phantasia désigne la dyna-mique, la puissance d'affect de notre capacité imaginative. À luste titre Montaigne,traduisant pbantasiai au fil des Essai.s, osait-il le pluriel : " nos imaginations ».
Mais c'est le cinquième trope qui concerne plus précisément, me semble-t-il, l'ex-périence du promeneur dans un jardin de Le Nôtre, ou celle de l'amateur de peintu-re ou d'architecture. Le cinquième mode est « celui qui se rapporte aux positions,aux distances et aux lieux " :
* En effet selon chacun d'eux [les positions, les distances, les lieux] les mêmes objets
paraissent différents, par exemple le même portique vu d'une de ses extrémités paraît
moins large du sommet, mais complètement symétrique quand il est vu du milieu, le
même naüre paraît de loin petit et à I'arrêt, et, de près, grand et en mouvement, lamême rour paraît ronde de loin et carrée de près. Cela dépend de la distance. Selon
les lieux: la même lumière paraît pâle au soleil et brillante à l'ombre, la même rame
paraît brisée dans la mer et droite en dehors [...]. Selon la position: le même tableaurenversé en arrière paraît plat; incliné selon un certain angle, il semble avoir des
creux et des reliefs. Et le cou des pigeons apparaît de couleur différente quand ils l'in-clinent de diverses manières. Puisque donc toutes les choses qui apparaissent sont
observées quelque part, d'une certaine distance, dans une certaine position, et que
chacun de ces points de we fait beaucoup varier les impressions [...] nous serons
contraints d'aboutir à la suspension de I'assentiment selon ces points de vue'8.,
Les dix modes, attribués à Aenésidème, ont imprégné la culture de la Renais-sance et de l'âge baroque avant même les premières traductions de Sextus. On en
trouvait une formulâtion plus râmassée dans un texte capital pour la culture euro-péenne depuis le Quattrocento, les Vies des pbilosophes de Diogène Laetce'e.Omniprésente dans Ia culture hellénistique, leur liste apparaissait par bribes dans les
Académique.s de Cicéron3o et, déployée, elle faisait du quatrième livre du De rerumnatura) un traité des images. Lucrèce avait ainsi consacré cent quarante deux versaux distorsions optiques, aux anamorphoses de la nature et de l'art, longue énumé-ration dont l'amateur de jardins ne peut manquer de o reconnaills " quelques épi-sodes :
«Les tours carrées d'une ville dans le lointain / nous paraissent rondes [...] /le bateau qui nous emporte semble immobile, / celui qui reste au port le croise, nous
semble-t-il, [...] / L atrium tourne, dansent en rond les colonnes / Aux yeux desenfants à peine ont-ils eux-mêmes / cessé de tournoyer [...] / mais une flaque d'eaupas plus haute qu'un doigt / logée dans l'interstice des pavés du chemin / ouvre sousterre une perspective aussi vaste / que l'abîme du ciel au-dessus de la terre, / et tucrois voir à tes pieds le ciel, les nuages, / les astres miraculeusement enfouis dans lesol. / [...] Un portique fût-il parfaitement symétrique, / soutenu par des colonnes tou-iours égales, / s'il est vu tout en long depuis une extrémité, / pen à peu se rétracte etd'un cône prend les dehors, / ioignant le toit au sol, le côté droit au gauche, / iusqu'àles confondre en l'obscure pointe d'un cône. / [...] droite est la partie des rames sur-gissant / des flots salés et droit le haut du gouvernail / mais les parties plongées dansI'eau semblent brisées: / leur direction change, tôut se dresse à rebours / et retournepresque flotter à l4 surface3'. "
SCIENCES
Abraham 8055E«Axtre mouen de prendre ces longueurslargerrs et hauteurs», pl.47,
--.jn Traité des pratiques géonétrûIesàt perspeaives..., Paris, 1665.
Tablette sur piedpour l'arpentage et Ie nivellement.
ks tropes et particulièrement le cinquième, furent largementexploités par Montaigne dès I'Apologie de Raymond Sebond.Dépecés, réduits à leur noyau topique et mis en listes, ils purentnourrir les recueils de moralités, de prodiges, de proverbes et deparadoxes qui assurèrent leur survivance dans le tissu de la cul-ture commune. Au xvrre siècle ils réapparaissent dans La uéritédcs sciences de Mersenne, et puis dans les traités de La Mothe LeVayer, l'Opuscule ou petit traité sceptique sur cette façon de par-ler n'auoir pas le sens comftrun) oule Discours pour montrer queles doutes de la philosophie sceptiqwe sont de grand usage dansles sciences, dans le lugement des actions humaines du secrétairede Richelieu, Léonard Marandé, chez du Faur de Pibrac, dans lesfables de La Fontaine... comme dans les Méditations métaphy-siqaes ou la Dioptrique de Descartes. J'émettrai l'hypothèsequ'ils auront fourni l'appareil théorique des traités de perspecti-ve, dioptrique, catoptrique et autres . raisons des ombres "publiés au cours du siècle.
IIBERTINS ET CARTÉsITN5
Il est d'usage de passer très vite sur les années de formationde Le Nôtre. Son associâtion au règne personnel de Louis XIV,après r66r, l'éclat de sa vieillesse versaillaise, ont plongé dansI'ombre son éducation dans Ie cercle des jardiniers du règne deLouis XIII, dans l'atelier de Vouet, au Louvre, dans cette galeriequi fut un haut-lieu de la science et de la technique nouvelles. LeNôtre est un homme du Paris d'avant la Fronde, grandi à l'ombre de Ia cour deGaston d'Orléans, du palais du Luxembourg, de l'hôtel de Condé: soit de ces cerclessavants et mondains dont René Pintard a tracé la cartographie et qu'il a rassembléssous le terme générique du n Libertinage érudit "3'. Il y a là, à dire vrai, rout un chan-tier à rouvrir, du point de vue de I'histoire des jardins, tant ceux-ci occupent de placedans les correspondânces et les préoccupations des amateurs et des curieux quefurent les " libertins » et les savants du premier tiers du xvrI" siècle. On mettrait aujour des connexions oubliées entre Boyceau, Pereisc, Rubens, Mersenne pour neciter que quelques uns des noms les plus prestigieux de la République des Lettres: letracé des jardins du Luxembourg, de Belgencier, la résidence campagnarde dePereisc, le projet de canal de la Meuse au Rhin, celui que Pereisc imagine entre
31. Lucrèce, De la nature, tv, 387-442,traduction José Kany-Turpin, Paris,Arbier, 1993, p. 265-267.32. René Pintard, Le Libertinage éruditdans la première moitié du xvrf siècle(r943 ), nouvelle édition augmentée,Genève, Paris, Slatkine, 1983.
137
PHIL0S0PHES AU IARDIN : UNE PROMENADE SCEPTIQUE
Pierre GASSTNDI
Parélie observée à Rome le 20 mars 1629,
in lnstitutio dstronomics iwtd hgpothesestam veterun qudm Cop ernici et TAchonis.
Accedunt ejusden vaii trdctatus Ntron|-mici...,La Hage, 1656.
Durance et Verdon, les fresques de la galerie du Luxembourg, autant de thèmes dontl'écheveau, s'il était déroulé par les historiens, nous apprendrait beaucoup sur lagénéalogie intellectuelle d'André Le Nôtre.
Mais le plus important de ces années de formation du grand jardinier me sembletrès précisément énonçable, avant toute confirmation ultérieure par l'érudition. Lajeunesse de Le Nôtre est scandée par des affrontements intellectuels que la traditionphilosophique, accaparée par le souci d'édifier en majesté la figure héroïque deDescartes, a passés sous silence33. Ce n'est pas l'affrontement du cartésianisme à
l'enseignement des scolastiques qui est susceptible de nous faire entrevoir la poé-tique de Le Nôtre. C'est au contraire cette vaste offensive, polymorphe, complexe,
parfois paradoxale, qui mobilise, autour de Gassendi, Libertins ethéritiers de la philosophie naturelle de la Renaissance contre les
dogmatiques du temps: contre les cartésiens autant que contre 1'É-cole34. Le cartésianisme est alors ce dogmatisme en voie de consti-tution contre lequel les Libertins vont recourir aux opérations tac-tiques et âux concepts qu'ils empruntent au Yaste corpus de la phi-losophie hellénistique, médiévale et renaissante. Ici, le terrain d'af-frontement est très précisément établi, c'est celui de la fiabilité dessens, et tout particulièrement du sens de la vue. Ses termes sont leslieux communs sceptiques dont chacun des protagonistes Ya tenterde recueillir à son profit la puissance corrosive. Il y a alors concur-rence entre une réappropriation cartésienne du corpus sceptique(dont la thématique du " doute , et du " malin Génie , dans lesMéditations métaphysiques est l'expression la plus spectaculaire) etla recherche, par les Libertins, d'une thérapeutique anti-dogmatiquebeaucoup plus générale qui ne se satisfait pas d'avoir abattu l'épou-vantail scolastique mais veut résister tout autant au nouveau dog-matisme de l'n intuition » et du dualisme de l'âme et du corps. C'estdonc la question du doute et de la suspension du jugement qui cris-tallise l'affrontement des cartésiens et des gassendistes. La fiabilitéde la perception visuelle, le statut de l'apparence sont au cæur dudébat: les conditions de la vision, la position de l'observateur, s'il aun corps et si la vision en est affectée, si nous en tirons accès à
quelque savoir sur la nature des choses, autant de thèmes qui mobilisent les énergiesphilosophiques et accompagnent chronologiquement la constitution d'une sciencenouvelle de la perspective. Moment crucial où la récupération du corpus méthodo-logique antique, si nécessaire à la constitution de la science moderne (quoiqu'en aitdit l'historiographie positiviste) dote toute entreprise d'érudition d'un enjeu épisté-mologique précisr5. La chronologie des premiers travaux de Gassendi éclaire cetteconjoncture érudite. C'est dans le droit fil des anatomies d'yeux (de dauphin, dethon, de chat et de chat-huant, de monstre marin, de renard, de chevreuil et de din-don36) pratiquées avec Pereisc, en Provence, dans les années 1634-1635, pour éclai-rer les rôles respectifs du cristallin, de " l'humeur vitrée ", de la rétine et du nerfoptique dans la vision, et comprendre comment s'opèrent le redressement et l'unifi-cation des images dans l'æil, que Gassendi, entreprenant la rédaction d'un vastetableau de la méthodologie épicurienne (la " Canonique " ), explore n les modes scep-tiques de la Suspension du Jugemeît37,,, et livre ses premières Lettres sur la gran-deur dpparente dw Soleil3\. La restauration des tropes sceptiques dans une médita-tion sur la vue et ses instruments prend, chez l'astronome professionnel qu'étaitGassendi, tout son sens.
33. Sur l'éclipse du gassendisme etla victoire historiographique du carté-sianisme, voir Thomas M. Lennon,The Battle of the Gods and Giants.Tbe Legacies of Descartes and Gas-sendi, r 65 5- r 7 t 5. Princeton, PrincetonUniversity Press, r993, chap. I, r," The Gassendist Failure ", p. l-25.34. Voir Robert Lenoble, Mercenne oula naissance du mécanisme, Paris, Vrin,1943, pdssim, et Alexandre Koyré," Gassendi le savant." (r953), PierreGassendi, sa uie, son æuure,Paris, AlbinMichel, 1955, p. 60-69, et n Gassendi etla science de son temps, (r955), reprisdans A. Koyré, Etudes d'histoire de lapensée scientifique, Paris, Gallimard,1973, p. 32-0-333.35. Voir les précieuses remarques deTullio Gregory, . Perspectives sur PierreGassendi à l'occasion du IVe cente-aai1s" (t992) repris dans T. Gregory,Genèse de la raison classique deCharron à Descartes, trad. MarilèneRaiola, Paris, PUF, zooo, p. r57-t89.
138
UWTAPPARTITLÉEG-E.R. Uoyd rappelait que l'argument des distorsions perceptives, topos de la phi-
lmophie grecque, s'il n'est pas sans écho dans les textes scientifiques hellénistiques, nemstitue en rien alors un obstacle dirimant pour les praticiens de la sciencese. Dansle champ de ce que l'on nommera, à la Renaissance, les " mathématiques mixtes »
(geométrie pratique, optique, acoustique, astronomie, gnomonique, harmonique),toute vérité requiert ses instruments et procède par âpproximations.
fnnsil'Optique etla Syntaxe de Ptolémée abordent, entre autres, la question deserreurs qu'engendre la réfraction atmosphérique: l'observation des corps célestes àI'horizon est gênée par l'évaporation de n l'humide terrestre, (comme les objets vusà travers I'eau, ils paraissent plus grands alors qu'au zénith). Mais le constat n'em-@he nulle paft la résolution pratique: si la rame plongée dans l'eau apparaît bri-sée, il est possible de mesurer et de prédire l'indice de réfraction des différentsmilieu:r (air, eau, verre) qui filtrent la vision et, en général, de calculer les angles d'in-cidence et de réfraction. Le calcul et l'instrumentation de la vérité supposent lerecours à deux outils conceptuels: Ia notion d'intervalle de variabilité, qui permetde déterminer les limites supérieure et inférieure entre lesquelles doit tomber lavaleur recherchée. Et la notion d'approimation vers une limite, fondamentale pour laméthode mathématique de l'exhaustion: elle fait I'objet du traité De la mesure du cercled'Archimède. Dans l'Arénaire, l'un des traités les plus commentés du xvr" siècle,Archimède enseigne à mesurer le diamètre angulaire du soleil à l'aide d'une dioptreen tenant compte de la magnitude de l'æil de l'observateur -car I'ego archimédien,à Ia différence du sujet cartésien, n'est pas un point situé à l'extrémité de la dioptre:.défaut» auquel on remédiera par la duplication des disques de f instrument quilivrera un intervalle de variables. IJaraignée d'Eudoxe que décrit Vitruve au livre xde son Architecture, l'armillaire, le quadrant, I'astrolabe, les instruments astrono-miques dont Théon d'Alexandrie, Pappus, Proclus commentent la construction etl'usage, tous ces instruments livrent un « canon », une norme, une règle, une mesurequi donnent accès à la connaissance par inférence: par exemple la règle, présentéepar Ptolémée dans sa Syntaxe, qui permet d'évaluer les parallaxes. Ou le mode decalcul de la distance de la lune au soleil lorsque la première apparaît par quartiers,objet d'un traité ancien Swr les dimensions et les distances. Plus encore, la détermi-nation d'un canon permet de produire à volonté ces distorsions perceptives quiembarrassent les sceptiques. Les principes fondamentaux de la réflexion sur toutesurface plane ou courbe sont énoncés dans l'Optique de Ptolémée, et I'on y trouve,comme dans le commentaire de Proclus à Euclide qui envisage tous les modes de cal-cul des angles de réflexion et de réfraction, la liste des apparences paradoxales quisont à la portée de l'art. Savoir propre à La scaenographia, que la Catoptrique (lascience des reflets) de Héron porte à son âccomplissementl on y apprend, parexemple, à " disposer un miroir de telle sorte que celui qui s'en approche n'y verrani sa propre image ni celle d'un autre, mais seulement l'image que l'on voudra4or...
,CÆNOGPAPHIA
De cette antique configuration des savoirs, l'architecte vitruvien, dans l'Europemoderne, était de fait l'héritier. Le dixième livre de Vitruve lui donnait compéten-ce en matière de machines, le neuvième requérait de lui la science des gnomons, lecinquième la connaissance de I'acoustique, le septième des enduits, etc. Mais demanière plus générale, les exigences de la scaenograpbia supposaient que l'archi-tecte fût capable de construire pros phantasian, c'est-à-dire en tenant compte des
SCIENCES
36. Olivier Bloch, Ia Philosophie deG assendi. N ominalisme, matérialismeet métaplrysique, Martinus Niihof(La Haye, ryZa, p.7.37. Les " Modi Epoches Scepticorumcirca Veritatem ipsiusque Criteria, (Lo-gique :rt, z) apparaissent dans le Syz-tagma Philosopbicun, l, 7zb-7 6b, etles Exer citationes Paradoxicae aduersusAristoteleos, rl, rgza-ztob fOperaOmnia,Lyon, 1658, rrr, p. 95-zro).38. De apparente magnitudine Solishumilis et sublimis Epistolae quatuor,Paris, chez Louis de Heuqueville, r642.Sur la chronologie des Lettres sur lagrandeur apparente du Soleil et la daæde rédaction des " Modi epochesScepticorum ", chapitre x, rv deson Vie et tn(Êurs d'Epicure, ptbliéen t647, cf, Bernard Rochot, Les tra-uaux de Gassendi sur Epicure et I'ato-misme, t6t9-r670, Paris, Vrin, 1944,p. 8o et suiv.39. G. E. R. Lloyd, " Observationalerror in later Greek Science ", J. Barnes,J. Brunschwig, M. Burnyeat, M. Scho-field (éd.), Science and Speculation. Stu-dies in Hellenistic Theory and Practice,Cambridge/Paris, t 98 z, p. rz&-t 6 4.40. Héron, Catoptrique, x,iltr,358, r et suiv.
1,39
PHIL0S0PHES AU IARDIN : UNE PR0MENADE SCEPTIQUE
41. Sur ce point, je dissocieraimon analyse de celle que présenteAgnès Rouveret, op, cit., infra, p. 7 4.42. Voir les analyses crucialesde [a construction des décors de scèneantiques et de l'optique qui la fondeproposées par Agnès F.ot:.veret, Histoireel imaginaire de la peinture ancienne('f siècle au. J.-C. - f' siècle ap. J.-C.),Rome, Ecole française de Rome, 1989,p. 65 et suiv. r.43. vt, 2,3. En rrr, 5, 9, Vitruve évoquela question du placement des statuescolossales et de la perception, " de basen haut", des æuvres placées dans desendroits élevés et des monuments colos-saux.44. Jean l|dartin, Architecture ou aftde bien bastir de Marc Vitrwue PollionAuth eur romain antique, P aris, chez
Jacques Gazeau, t547, p. 89.45. Claude Perrault, Les Dix liures d'ar-chitecture de Viûuue corrigés et traduitsnouuellement en français, seconde édi-tion revüe, corrigée et augmentée, Paris,chez Jean-Baptiste Coignard, r684,vI,2, p. ?-o4, a. 3.46. lean Mzrtin, Arcltitecture, op. cit.,p. 89.47. A. Rouveret, op. cit., p.9o, qui pré-cise: " Mais ce point ne paraît en rien lepoint de fuite principal de la perspectivemoderne [...] en aucun cas [a faussearchitecture n'apparaît comme la pro-jection d'un bâtiment réel sur le plan dutableau,, p. 93.48. Lucrèce, De la nature,tv, ztt-2.r5,loc. cit., p. 255.
1,40
points de vue privilégiés, des rapports angulaires, des ouvertures sur l'arrière-plande ce qu'il offre au regard. Comment traduire pros phantdsian? Je proposerai ici« pour l'æil de l'imagination r. Il ne s'agit pas de penser l'élévation au sens moder-ne du terme mais de prédisposer les parcours de l'æil glissant sur la façade ou iau-geant une statue colossale placée à distance, et ses attentes: ce que l'æil ne voitpas encore mais anticipe4r. Inversement, cette maîtrise dela scaenographid donneà l'architecte compétence pour dresser l'image apparente des bâtiments sur le pan-neau de la scène de théâtre, en tenant co777pte des déformations optiques42. Il estdonc tout à fait cohérent que Vitruve, reprenant à son tour les tropes de la ramebrisée dans l'eau et du trompe l'æil pictural, consacre un chapitre du DeArchitectura aux distorsions perceptives ou rectifications optiques43 que JeanMartin nommait savoureusement « températures [des mesures] par additions ousoustractions » ou « mutation des symétrie544r, Perrault, plus sobrement, « chan-gement de proportion45,. Chez l'un et I'autre traducteur, c'est l'incertitude de laperception (.vu mêmement que les yeux des hommes ne font pas toujours leurrapport véritable, ains deçoivent souventefois la fantasis+6") qui est ici invoquée,et la nécessité d'une préméditation des effets dont on voit que l'architecte, ou Iejardinier, du xvrr" siècle tirera le meilleur parti. Outre la perception da sotto in sudes architraves et des colonnes, et le placement à distance des statues colossales(rrr, 5, S) (qui mobilise aussi le commentaire de Proclus à Euclide), le livre vrr b, 9)du De arcbitectura évoque, en des termes quasi lucrétiens, les effets que l'on pour-ra tirer de la plus ou moins forte épaisseur de la lame d'argent dont on fait les
miroirs. Si la lame est trop fine, les réflexions de lumière (remissiones splendoris)seront incertaines et sans force, si elle est bien épaisse, les images iailliront auregard, claires et distinctes . Certus / incertus i ce sont tous les degrés de transitionde f indistinct au distinct, de l'obscur et de f incertain à l'évident, au manifeste, auclair, qui sont ici alloués en partage à l'architecte. Il nourrit sa compétence de leurmaîtrise. Autant dire qu'il est maître des images. Qu'il sait fixer leur degré deconsistance. Agnès Rouveret attire justement l'attention sur les verbes qui dési-gnent le renvoi maîtrisé des reflets, reddere, respondere: le miroir restitue lesimages, elles répondent aux objets. Le terme désignait aussi le rapport de corres-pondance des lignes du dessin scénographique au centre du cercle, c'est à dire laconvergence des parallèles au plan du tableau sur un point. Soit la compétence dudessinateur traçaît la perspective d'une ârchitecture feinte sur un pânneau descène47. Mais c'est encore respondere qu'emploie Lucrèce lorsqu'il décrit la subti-lité et la vitesse de propagation des simulacres qui forment la texture de l'universsensible:
. Mais voici une preuve évidente entre toutes / De la vitesse qui emporte les simu-lacres. / Dès que l'éclat d'une eau s'expose à découvert / Sous la voûte étoilée, aus-
sitôt les astres répondent, / Calmes fulgurances du ciel du fond de l'eau48. 'Serena sidera respondent in aqua radiantia mwndi: le miroir d'eau est la
chambre d'écho de toutes les résonances, de toutes les émanations substantielles(les simulacres) qui tissent l'univers. On voit qu'il n'est pas besoin de chercherloin au-delà du patrimoine théorique de l'architecture classique de quoi nourrir lapoétique de Le Nôtre ; la réactivation de l'épicurisme au début du xvrr" siècle vaprécipiter le mouvement de réappropriation, par l'architecte o baroque », par lejardinier, d'une architectufe conçue pros pbantasian, et ouverte aux résonances dela nature.
tE STATUT DE UEVTDENCE ",,
*..Hors les travaux de P. L. Rose, rares
sont encore les études consacrées à larenaissance des textes scientifiques ettechniques de l'ère hellénistique auxxvrt et xvrr' siècles49. Un préjugé scien-
I'essor de la science moderne à l'aban-don des bibliothèques et semble dotermathématiques et sciences nouvelles dela nature d'une intemporalité qui récu-s€ toute philologie. Cependant les
mède ou Héron, outre qu'elles aurontnourri la culture scientifique et tech-nique du xvr" siècle, n'ont pas connu,
DB. r.! t!
au siècle suivant, l'éclipse totale que semblaient leur promettre les publications deCÉlilée, Kepler ou Huygens. À cela au moins deux raisons. La Culture des techni-cien\ des praticiens des " mathématiques mixtes r, leur conserve une large pertinenceqrrc commence à peine à entamer les concepts et les méthodes de la science nouvelle.,Arrtorurtes, anamorphoses ou machineries hydrauliques relèvent d'un âge du savoirerrrÉrieur aux développements de la science galiléenne5o. En outre les textes antiquesoftaient des ressources encore insurpassables en matière d'épistémologie. Le statut dudEDe, la constitution de la preuve, les modalités de l'inférence: autant d'enjeux riche-r'*,nt travaillés par les philosophes et les savants de l'époque hellénistique dont lesmdernes surent tirer parti -beaucoup plus que ne l'ont cru les historiens modernes.
Àinsi, c'est le destinataire de la troisième des Lettres swr la Grandeur apparen-w fu Soleil,l'astronome Ismaël Boulliaud, qui s'attacha à publier, en r663, traduc-mirr 6 commentaire du traité de Ptolémée, Dw critère et de I'bégémoniqwes'. Unurrage largement ignoré des historiens de Ia philosophie parce que marqué au coinffirrnent de l'éclectisme: le traité du géographe antique, rêdigé par un praticiengm des praticiens, dans la langue commune des experts grecs et romains des pre-m et second siècles, brasse, non sans désinvolture, les concepts stoïciens et épicu-nfonq €t toute la casuistique sceptiques2. Mais le Traité du critère, comme les textesdc Scmus, les Entretiens d'Epictète ou les manuels logiques de Galien, auront irri-gnÉ de fait, via les manuels doxographiques et les joutes scolaires dans les écoles demÉdæine et de philosophie, toute la culture technicienne antique, diffusant ainsi lesû;rns et les enjeux d'un débat philosophique de toute première importance. On nemr$, en l'état actuel des recherches, que remarquer la continuité des préoccupationsry rfu par le cercle gassendien. Des Hypotyposes et du Contre les mathématiciens
çi nourrirent la réflexion de Gassendi,le Traité du critère de Ptolémée reprenait etpr6cisait I'un des principaux enjeux épistémologiques: la question du " critère deuÉriÉ ", soit (comme le mot ne I'indique pas pour nous) de notre accès à l'éuidence.§niet cmcial qu'il revient à la philosophie hellénistique d'avoir exploré, posant lesdmnées fondamentales d'une épistémologie de l'observation et de l'enquête, dusavoir comme organisation systématique des données des sens dont les praticiensmodernes ne négligèrent pas de tirer parti.
C.e n'est pas le lieu ici de décrire, à la suite de Gisela Strikers3 et de JacquesBnmschwig5a, la série de déplacements et de retournements conceptuels au terme@uels le"critère de vérité ,, qui désignait à l'origine l'appréhension immédiate
SCIENCES
0ronce FINÉ
« Quadrant géométique », in Compositionet usrye du quarré géonétique, par lequelon peut nesurer fidèlement toutes longueurs,hauteurs et prolunditez... Paris, 1556.
49.Yoir Paul L. Rose, Tbe Italian Re-ndissdnce of Mathematics, Studies onHumanists and Mathematicians fromPetrarch tc> Galileo, Genève, Droz,r97 5.50. Voir, sur ce point, Hélène Vérin," Salomon de Caus, un mécanicien pra-1içisa», Reuue de I'art, rz9 @ooo/31,p.7o-76.5l . De judicandis facultate et animiprincipdtü, Paris, r663, chez SébastienCramoisy.52. C'est, du reste, à l'occasion de l'unedes premières tentâtives de réévaluationde l'éclectisme antique, le Huitièmecongrès international d'Etudes c[as-siques, en 1984, à Dublin, que AnthonyLong a consacré une érude décisive autraité de Ptolémée, et mentionné sonpremier éditeur moderne, Boulliau, cfl,A. A. Long,. Ptolemy on the Criterion.An Epistemology for the Practising§çis11is1,, John M. Dillon et ÀnthonyA. Long (êd.\,The Question of "Eclec-ticism». Studies in Later Greek Philo-sopüy, University of California Press,1988, p. t76-2o7.53. Gisela Striker, Essays on HellenisticEpistemology and Eth ics, CambridgeUniversity Press, r996, p.L2-77et r50-167.54. Jacques Brunschwig, " Le problèmede l'héritage conceptuel dans le scepti-cisme: Sextus Empiricus et la notion dekritérion ", Études de philosophie hellé-nistique. Epicurisme, stoicisme, scepti-cisme, P aris, PuF, r99 5, p.289- 3 r 9,
Friiii,ô roüml, iriC,;
PHIL0S0PHES AU IARDIN : UNE PROMENADE SCEPIIQUt
0ronce tlNÉUtilisation flu « quadrant géométrique ",in op cit Paris, 1556.
et certaine des données sensibles et intelligibles, la saisie de l'évidence (par opposi-tion au signe, à la preuve et à la démonstration), en vint à s'identifier au procès tech-nique de la mesure. Ce qui nous importe, c'est que dans le corpus hellénistique, dansle Contre les mathématiciens de Sextus, dans le Traité du critère de Ptolémée, le typede connaissance immédiate et par soi, dont la vue, I'ouie, le goût fournissaient lepremier modèle, et qui constituait l'étalon et le discriminant de tout savoir, vient seconfondre avec l'application d'un cdnon: l'usage de la règle, de l'équerre, du niveauet du cordeau du maçon55. Technique et distance ne s'opposent plus à la certitude del'expérience perceptive: où l'æil ne suffit plus, dans le trop lointain, au-delà de la por-tée du regard, l'instrument fournira la certitude de ses mesures) parce que le travail de
l'æil n'est pas essentiellement différent de la manipulationd'un compas. Dans l'un et l'autre cas, l'appréhension del'évidence est l'effet d'une élaboration technicienne, le fruitd'une décisioî dppareillée dont l'usage constructif del'équerre et de la règle est le paradigme:
" En architecture, si la règle est fausse au départ, / si l'équerre estmenteuse et s'écarte des lignes droites, / si le niveau en quelqueendroit cloche d'un rien, / il s'ensuit que tout est gauche et de tra-vers, / difforme, affaissé, plongeant en avânt, en arrière: / l'édlfi-ce discordant semble vouloir s'écrouler, / croule même en partie,tout entier faussé / par la fausseté des premiers jugements56. ,
Par le jeu d'inférences successives, le critère, qui dési-gnait toute mesure de saisie, en vient à nommer toutemesure technique de saisie, puis toute mesure technique desarsie qui passe outre l'éuidencesT. Ptolémée a même
recours au modèle de la cour de justice, et au jeu des différentes instances quiconcourent à I'élaboration de la preuve et du jugement. Pour le géographe antique,donner statut à la perception sensorielle dans l'élaboration du savoir, c'est être àmême de " localiser l'erreur " en distinguant les parts respectives de l'agent de la per-ception, de son objet, de l'iqstrument (l'organe de la perception), du mode d'appli-cation de celui-ci, de la plaidoirie de la phantasia. du jugement du /ogos, etc,comme, dans l'enceinte du tribunal, on distinguera les parties, l'accusé, l'acte d'ac-cusation, l'avocat, sa plaidoirie, le juge, le verdict et la loi invoquée...58
On conçoit que Boulliaud, continuant Gassendi et la lecture que celui-ci avait pro-posée de Sextus et d'Épicure, ait pu transformer son édition de Ptolémée en manifesteanti-cartésien: puisqu'il était question, dans le débat entre cartésiens et gassendistes,du savoir immédiat et de I'ampleur réelle de sa juridiction, de la légitimité que pou-vaient en tirer les sciences nouvelles, Boulliaud, en réactivant le modèle ptoléméen,venait opposer à la dramaturgie du cogito, aux certitudes essentielles de l'n intuition r,à l'absence de corporéité du sujet cartésien, la richesse de la réflexion antique sur leproche et le lointain, le manifeste et le dérobé, l'immédiat et l'inaccessible.
0RGANA
Thierry Mariage a souligné, dans un livre marquant, combien " la géométrie com-plexe des jardins classiques s'explique par l'emploi d'instruments appropriés, alorsnouvellement mis au pointS9 ». Outre les quadrants et les boussoles d'usage courantau siècle précédent, les astrolabes, les règles, les compas, les olomètres, les théodo-lites,"graphomètres» et autres"distanciomètres,, les jardiniers du xvrrt siècle ontl
t,
iI!
iiL
55. Voir J. Brunschwig: "Un kanon,règle ou équerre. est paradigmarique-menr droir I il permet de resrer si uneligne est vérirablement droite, ou si unangle est véritablement droit. De mêmeun kriterion de vériré est un fournisseurde vérités, immédiatement évidentes parelles-mêmes, qui peut être utilisé pourtester la valeur de vérité d'opinions (oude rhéories ou d'hyporhèses) qui portentsur des états de choses non perceptiblesou non immédiatement connues er quipar Ie fair ne sonr ni clairement vraiesni clairement farsses." lbidemp. 3t6 - 3t7.56. Lucrèce, De lanature, rv, 5r3-5r9,p. 27r.57. Contre les logiciens, t, z9-37fContre les Mathématiciens vtt, z9-77];Es quis ses pyrrh onienne s, ll, t 4- r 6.58. Voir Claudius Ptolemaeus," On the Kriterion and Hegemonikon",trad. angl. sous la dir. de P. Huby etG. Neal, The Criterion of Truth. Essaysin Honour of George Kerferd togetherwith a text and translation of Ptolemy'son the Kriterion and Hegemonikon,Liverpool University Press, r989,p. 779-2-3o.59. Thierry Mariage, Xuniuersde Le Nostre. Les origines de I'aména-gemenl du territoire, Bruxelles,Pierre Mardaga, r99o, p, 45.
142
bénéficié de l'extraordinaire effervescence créatrice qui, dans:1â seconde moitié duxvlt et le premier tiers du xvlIt a multiplié les appareils de mesure et de triangula-tion destinés au relevé topographique et signé n l'irruption de l'optique dans la mesu-re des distançs5". eue la lunette d,approche associe ses effets aux outils tradition_nels de la triangulation, que l'usage conjoint de l'observateur et du rapporteur auto-rise des calculs de distances et de valeurs angulaires d'une précision inégalée, et l'onput, renversant l'usage, se servir des instruments de relevé pour aménager topogra-phies et perspectives, avec une précision inouïe. Ainsi Hélène Vérin, rappelant lesneuf rypes de compas à I'usage du jardinier répertoriés par La théorie et la pratiquedu iardinage de Dézallier d'Argenville, signalait-elle que le nivellement de l'assiettedu grand canal de Versailles (long de r65o mèrres) avait mobilisé jusqu'aux compé-tences de l'Académie des Sciences6o.,
U]{E SCIENCE DES APPARENCES
On trouve chez Gassendi une riche pensée de f instrument. Qu'il dresse, dans leSyntagma, un vaste tableau des techniques nouvelles et de leurs outils, le télescopeou l'engyscope, et décrive en général les perfectionnements des instruments d'op-tique6', qu'il consacre un traité entier, Ia Proportio gnomonis, aux modes de déter-mination des longitudes et des latitudes, il s'agit toujours de démontrer par ses effetsla possibilité d'une. science apparentielle, ou expérimentale, : tout cela qui était au-delà de la portée de nos sens parce qu'infime ou trop lointain, le ciron ou la voielactée, devient sensible à qui manipule à bon escient les engins inventés par lesModernes. Les adela, ce mot-clef des sceptiques qui désignait le non manifeste, ledérobé, l'inaccessible, ce sur quoi on ne peut se prononcer,les adela sont des loin-tains, la lunette les rapproche, ils nous deviennent sensibles à mesure. Ce qui nesignifie pas que les apparences premières, celles qui, à distance, nous faisaientprendre une tour ronde pour une tour canée, aient étê. fausses, :. quelque gran-deur d'une chose que nous voyions, elle est yé:ritable6',. Toutes les apparences sontvraies swccessiuement63. C'est ce que Bernier, divulgateur de la pensée de Gassendià la fin du siècle, étaye de l'exemple topique du chatoiement coloré si cher auxpeintres maniéristes, le cangiante. La couleur n'est pas un fard trompeur, elle estnotre accès aux choses. Mais là où les Epicuriens pouvaient évoquer la matérialitéd'une émanation (la couleur est altération et dissémination de l'objet dans l'espace,dans l'intervalle entre l'objet et nous), les gassendistes déploient une pensée dutemps. La " science des phénomènes , ou " science expérimentale , est d'emblée une.. science historique6a, :
. Ce serait ici le lieu de réfuter ce que l'on obiecte ordinairement, que ces couleurs,comme aussi celles que I'on voit dans I'Arc-en-ciel, dans les couronnes, ou au traversd'un verre coloré, d'un prisme, d'une fiole pleine d'eau ou de quelque autre sem-blable manière, sont seulement apparentes, trompeuses, fausses, à la différence desautres qu'on a coutume d'appeler véritables, et effectives I mais il est constant qu'iln'y a point de différence qu'on dise couleur vraie ou apparente [.J.La différencen'est que dans la durée mais la courte durée d'un effet, ou d'une cause, n'ôte pas lavérité de l'effet, à moins que vous ne veuilliez dire que la verdeur d'une herbe n'estpas véritable parcequ'elle dure si peu à l'égard de celle d'une émeraude [...]65. "
En 1636,l'année même du Discours de la Méthode, Gassendi avait consacré unchapitre essentiel de sa Logiqwe (x,7) au..Canon generalis. Est aliquid nerLtm,
SCIENCES
60. Hélène Vérin. - La technologieet le parc: ingénieurs et jardiniers dansla France du xvrre siècle ", Hr'srolredes jardins de la Renaissance à nosjours, op. cit., p. r3t-t42. Il vaut lapeine de citer ici, in extenso,la précievse description que livre Charles Perraultde ce nouvel âge du jardinage où lamaîtrise de la géométrie pratique et deses outils assure la maîtrise du chantier :- Certe précision si juste ne venair passeulement de l'habileté des niveleurs,mais de l'excellence du niveau. quin'avait point eu de pareiI jusqu'alors.[...] Cette excellence consiste particuliè-rement en trois choses : l'une qu'au lieude la ficelle que les maçons mettent àIeur niveau. MM. De I'Académie y onrmis un cheveu de femme fort long. quimarque l'aplomb du niveau avec uneprécision infiniment plus grande que nefait le cordeau qui est âux niveaux ordi-naires ; la seconde, en ce que ce cheveuest enfermé dans un tuyau de tole quiempêche le vent de le mouvoir en aucu-ne sorte [...] La rroisième consiste en cequ'on met une lunette d'approche sur latraverse du niveau ; cette lunette fixe tel-lement la vue, qui vacille toujoursquand le niveau est sans lunette, qu'onpeut mesurer juste des distances de centet -deux cents toises, sans se ttomperde l'épaisseur d'un cheveu. Tous lesouvriers ne pouvaient comprendre com-menr on pouvait parvenir à cette jusres-se d'opération, car avec leurs niveauxordinaires, ils ne pouvaient pas nivellerune distance de trente toises sans setromper de rois ou quatre pouces.»Ch. Perrault. Mëmoires de ma uie.Précédé d'un essai d'Antoine Picon,'. Un moderne paradoxal ". Paris.Macula, 1997, p. zt5.61. Syntagma pbilosophicum, r, r64bet j6oa i Exercitationes Paradoxicae, |t,rr5b. Voir le commentaire d'OlivierBloch (op. cit., p. 55 et suiv.) au « baco-nisme gassendien ,.62. François Bernier, Abrégé de la philo-sopbie de Gassendi, Lyon, r684, Paris,Fayard, r992, t. vr, livre z,p. ar3.Bernier reprend très précisémentles arguments épicuriens présentés parSextus Empiricus dans Contre les logïciens, t, zo3-zto lcontre les mathéma-ticiens vtt, zo3-zto]: " de fait l'objetvisible non seulement apparaît visible,mais il est tel qu'il apparaît [...] de sorteque toutes les représentations sontylajçs, [zo4].63. Ce postulat correspondait du reste àl'idée développée par Euclide, dans sonOptique, qu'aucun objet regardé n'estperçu simultanément tout entier, que lavision d'une chose esr une saisie pro-gressive, de plan en plan.64. Sur la " scien!ia historica seu experi-mentalis", voir la lettre de Gassendi àLouis de Valois, z8 juin 164r, citée parO. Bloch, La philosophie de Gassendi,op. cit., p. 83.65. F. Bernier, Abrégé, op. cit., lt, r9r.Voir Jean-Charles Darmon, philosophieépicurienne et littératwe aw xvrf siècle,Paris, r998, p. 17r-r72,.
143
PHIL050PHES AU IARDIN : UNE PROMENADE SCEPTIQUE
66. Pierre Gassendi, Disquisitio metd-physica, seu dubitationes et instdntiaeaduersus Renati Cartesii Metapbysicamet respofisa, édition et traductionB, Rochot, Yrin, t962, Doüte tt,article 2, l8g b, p. Sl8.67. Ibidem.68. O. Bloch, La philosophiede Gassendi, op. cit., p. 24.69. Gassendi, Syntagma Philosophicum,loc. cit.,Il, p. 387388.70. J.- Ch. Darmon, op. cit., p. 4r.
t44
quod possit diiudicari ac sciri " : " Qu'il y a des vérités, et qu'on les peut discerner etjuger,. La Disquisitio metapbysica reprenait et amplifiait la polémique engagéecontre la radicalisation du doute sceptique dramatisée par Descartes dans la scèneoriginelle du " malin génie " :
" Ainsi quoique nous puissions penser que nous sommes naturellement sujets à l'er-reur, même dans des choses qui nous semblent très véritables, il n'en faut pas moinspenser aussi que nous sommes naturellement câpables de vérité; et quoique nousnous trompions quelquefois, par exemple à l'occasion d'un sophisme non découvert,ou d'un bâton à demi plongé dans l'eau, nous connaissons aussi quelquefois la véri-té, par exemple dans les démonstrations géométriques ou quand le bâton est sorti del'eau, et cela d'une manière telle que nous ne pouvons absolument pas douter de lavérité dans les deux cas. Et quand il serait permis de douter de tout le reste, du moinsne pouvons-nous pas douter que de telles choses nous apparaissent, et il n'est paspossible qu'il ne soit très vrai qu'elles nous apparaissent telles66.,
Çs " quelquefois " de la vérité, le temps et f instrument, leur puissance expéri-mentale, nous le livrent:
" Car lorsque par exemple ie regarde une tour de près et que ie puis examiner tout àl'entour ses quatre faces, à l'æil nu pour une part, pour le reste en y appliquantl'équerre, lorsque je puis compter les angles, je pense l'avoir suffisamment étudiéepour être assuré qu'elle est carrée plutôt que ronde [...] le fait que de loin je me trom-pe quelquefois est supprimé par le rapprochement fttropinquiusl6T .,
Décisive est alors la réinterprétation, aux inflexions nominalistes, que Gassendipropose du paradoxe épicurien de la grandeur des astres: ce qui est un peu plusgrand ou un peu plus petit que notre image visuelle du soleil, ce n'est pas l'astre lui-même, « mais son image réelle du point de vue optique, sa brillance, sa magnitudetel qu'un appareil d'enregistrement optique pourrait les recevoir68,. On ne se satis-fera donc pas de l'alternative vulgaire: réalité ou apparence. Gassendi pose troistermes, trois grandeurs. Le premier est celui de la grandeur apparente illusoire:l'astre perçu plus grand qu'il n'est par l'æil qu'éblouit sa luminosité. Le second, lagrandeur apparente objective, le phénomène: l'astre vu dans la lunette, ou, lorsd'une éclipse, par l'intermédiaire de son ombre portée. Quant à la grandeur réelledu soleil, elle nous demeure inaccessible: on ne pourra que la déduire de la confron-tation des apparences objectives6e. Comparaison, confrontation, rectificationmutuelle des signes qui sont l'effet d'une configuration, non l'expression des choses:notre accès à la vérité se nourrit de ce passage continuel d'une apparence à uneautre, d'un effet à l'autre et I'usage des instruments d'optique en âugmente l'enchaî-nement sans terme assignable. Gassendi invente (je reprends ici une heureuse expres-sion de Jean-Charles Darmon) « un protocole de déplacement du point de vue7o,. I1
subjectivise la vision, non pour en ruiner la fiabilité: pour l'objectiver au contraire.Pour doter de consistance l'apparaître même. Et donner statut à l'emploi des instru-ments d'observation. Ils sont les vecteurs de la ratiocinatio, de cette confrontationméditée des critères à quoi s'identifie la connaissance: les convertisseurs logiquesd'un jeu d'inférences successives.
On voit ici se dessiner une poétique, celle des jardins de Le Nôtre. Le jardinmaniériste supposait du promeneur une adhésion immédiate aux formes de la natu-re. Non que ses auteurs aient ignoré les ressources architecturales de la perspective
SCIENCES
pour la construction des points de vue, l'aménagement des. surprises ", la disposi-tion des " merveilles " : la villa Lante à Bagnaia, la villa d'Este à Tivoli, Saint-Germain-en-Laye en témoignent assez. Mais il ne s'agissait alors que d'aménager desaperÇus sur les swbstances. Dans un contexte globalement aristotélicien, l'. aspect »
ou l'« espiçs » est un accident de la substance qu'elle signifie ou manifeste sans tru-chement: toute substance, déterminée ontologiquement comme forme, s'offre sansréserve au regard, à l'ouie, atJ tact, à l'odorat, sans qu'il soit besoin d'interrogerautrement la perception. De sorte que s'il est sensible aux variations des formes, lepromeneur a accès aux choses-mêmes. De ce point de vue la promenade dans le jar-din maniériste est une exploration des modalités hautement formalisées par les-quelles se livrent les substânces. C'est, en outre, la fonction de l'appa-reil mythologique qui scande le parcours de statues, d'automates, defontaines et de grottes, que de constituer une sorte de mode d'emploide ce " trésor de choses " : les fables, telles qu'on les figure aux jardins,sont touiours en fin de compte une initiation aux substances, qui vientredoubler l'expérience directe de leur texture, de leur arôme, de leurgoût, de leur couleur. Au contraire le jardin moderne, le jardin de LeNôtre, dramatise l'accès du promeneur à la perception. Il fait'de lavisibilité une aventure incertaine et subjective. La perspective est alorsbien plus qu'une modalité technique de l'aménagement des jardins: unenjeu philosophique. La vue (et toute modalité de la perception) est l'ef-fet d'un calcul, la visibilité est construite. C'est l'enjeu propre des jardinsde Le Nôtre. Rien de plus éloigné de l'intuition cartésienne ou de la sai-sie cataleptique des Stoi'ciens. Les étapes de la progression dans le jardinsont les effets d'un procès de construction des vues, les moments succes-sifr d'une connaissance par degrés. Mais la vision ici est le modèle d'uneconnaissance par les signes, pâs d'une appréhension des choses-mêmes:les signes, dans l'acception nominaliste que Gassendi a restaurée, ne sup-posent aucun lien substantiel entre la chose et son concept.
SI U PROMENTUR A UN C()RPS
Que la référence à Épicure ait nourri une bonne part de la culturefrançaise du xvrrt siècle, les travaux de René Pintard, de TullioGregory Marc Fumaroli, aujourd'hui de Jean-Charles Darmon etJackie Pigeaud, l'ont amplement démontré. Mais il faut ici insister surles incidences épistémologiques de cette référence au matérialisme antique: l'éthiquede la uolupta.s, si opportune dans la désignation du plaisir qu'on prend aux jardins,et qui a nourri la veine des poètes français du Grand Sièclè, n'épuise pas l'enjeu phi-losophique du jardin moderneT'. La Fontaine lui-même, pourvoyeur de l'épicurismemondain, n'a pas manqué d'évoquer, au moins sur un mode allusif, les débats rou-lant sur la fiabilité des sens, et, très précisément, les tropes sceptiques, ainsi dans.Un animal dans la lune ":
. Mais aussi si l'on rectifie / Uimage de I'objet sur son éloignement, /Sur le milieuqui l'environne, / Sur l'organe et sur l'instrument, I Les sens ne tromperont person-ne [...] / Quand I'eau courbe un bâton ma raison le redresse. "
Mais on n'accordera jamais assez d'importance à la résolution épicurienne des apo-ries sceptiques proposée par Gassendi. Où Descartes réélaborait, au profit d'un sujet
4
Pierre GASSIllDlPlases de Vénus vues de la Terre,in lnstitutio ustrunomicd iwtd hupothesestsm veterum quam Copernici etlgchonis,dlctdts..., Paris, 1647.
71. Voir Jackie Pigeaud, " Les quatreliwes des Jardins du Père René Rapin",xvtf siècle, oct.-déc. zooo,no zo9,5z' tnlnée, n'4, p. 6or-626.
Àstxoxour ca, Lib. IlI. r77deltsrredit ad Solem vefperi ; nifi quia dimidio mi-nùs. Neque tursùscorniculara, cirm mar:è à Solcemergcnsritropcrat adstetionem fecundaminifi quietunc quoguc obucrtit minusdimidio. Nequs ruilLrbifÊ&; fub mcdirs lonsitudiaes; nifi ouie irerum-dimidium, N.quedem[m itcrbm plenejcùm mer:è-Solera rep,etiti riifi quia runùs hcmifph"rrium totr,rm..(p.roxrmdvc ; illuJtratum o§uudr, -
145
PHIL0S0PHES AU IARDIN : UNE PROMENADE SCEPTIQUE
dégagé de toutes les pesanteurs de la matière, de I'image et de la mémoire, dépour-vu de corps enfin, les grandes distinctions de la métaphysique classique,apparence/essence, sensible/intelligible, le grand æuyre de Gassendi fix la réactiva-tion, à l'aube de la science moderne, de la canonique d'Épicure, c'esi-à-dire unelogique où les signes sont sensibles et la représentation une version de l'évidence.Que le corps ne puisse éviter d'accorder crédit à ce qu'il perçoit - hors fiction philo-sophique (et l'on sait combien Gassendi aura démonté avec jubilation toutes lesficelles narratives du cogito cartésien) - c'était déjà l'argument invoqué par Lucrècepour réfuter la portée du doute sceptique:
4. Er EN GENERAL ToufÉs r,xs sAtr,r,rrs. Cela neËuguve point evoir edté obGrvé dans liaffique, où les faillies lbntle pfirs lôuvent un peu moindres quc hhauieur des merubres Êil-larË. I y a des Arihireétes qui prâtcndent grre Ies faillies des Cor-nichcs àoivent fiupalIèr leuis Ë"weurs darïs tes grandcs * enor-mes malfes d'ouvrâges; Cc qui ne me femble poiic avoir de fon-dernenr dans lOpIque: perèqu€ lesæuvrcs êoloffales ayanruneplus grandc clev,æion au dellus dc feiLelles augmenrenr davan-
tâge làp,parence des âiüies cn élar-gilîant les angles qu'ellesfonr danstæil. Car Ia faillie A B dune chofeélevée fait un plus srand ansle ouela faillie C d d,iie cl,olè"moinsélevée , bien que I'unc & Pautrefoit égale.
r. Tyrrap e.x. Tïnnatæ fi-goifi. ,.y le de&insid fronron;
" Tu découwiras que les sens formèrent les premiers / lanotion de vérité et qu'ils sont infaillibles / Et si la raisonne peut expliquer pourquoi / des obiets qui de près étaientcarrés paraissent / arrondis de loin, mieux vaut, à défautde son aide, /expliquer incorrectement les deux figures /que laisser échapper de nos mains l'évidence, / que trahirnotre foi première et ruiner toste / l'assise de nos vies etde irotre salut. / Car non seulement ta raison s'écroulerait/ Mais ta vie périrait dès lors que tu n'oserais plus / Te fieraux sens qui te gardent des précipices, / Ou d'autres mau-vais pas, et te guident à l'opposé. / Considère donc commeun vain amas de paroles / les arguments fourbis pour com-battre les sens7t. r,
Les lecteurs de Vitruve, Perrault au xvrrt siècle,soucieux de fixer la doctrine légitime des rectificationsoptiques, ne manqueront pas d'alléguer ce fond devérité de la perception qui leste nécessairement touteexpérience de la perspective:
o Mais tous les architectes et tous les sculpteurs ne croientpas qu'il faille avoir touiours égardà ces raisons 8c il y ena quelques uns qui estiment que ces précautions ne doivent
,À il a dautres fignficarions ailleurcS§ dans Vitruve: câren maticre de
Menuiferie c'e(t unpanneau, enHorlogerie Ce{tune roiie den-telée , en Hydraulique Ce{t une rouë crarlè. Ilfignifie en fran-çois un Tambour, & il y a apparence qu'rl e{t ainfi apellé dansIes fron(ons . Dercequ'il fcmble que cette partie foit tenduë par lesCorniches qu.,i *",i,of.ot le frdnton, de'mefme qræ la pciu I cltfut les bordsàe ta oràitie d'un Tamboun
Claude PERRAULT
notes 4 E 5, p. 96, livre lll, chap. 3,in Les Dix livres d'arîhitectwe de Vitruve,corrigez et truduits nouvellementen lrançois, Paris, I 673.
72. Ltcrèce, w, 478-479, éd. cit.,p. 269, 5oo-5r2,73. Cl. Perrault, Les Dix liures...,op. cit,, vt, 2, p. zo4.
146
être employées que rarement. La raison en est que la vue n'est pas si sujette à se ffom-per âutant que Vitruve le prétend, non pas seulement parce que la vue de même queles autres sens extérieurs ne se trompe jamais, mais même pârce que le iugement dela vue qui est le seul à qui on puisse imputer les erreurs qu'elle commet, est pour l'or-dinaire très sûr et presque infaillible, quand une longue habitude et une expérienceaussi souvent Éit&ée qu'elle l'est à un age partait a tant de fois corrigé les premièreserreurs qu'on n'y retombe que rârement: car en effet il n'arrive guère à personned'avoir peur que le plancher d'une longue gallerie lui touche à la tête quand il sera âubout, où il le voit abaissé jusqu'au droit de son front, Ec on n'est point en peine com-ment on pourra passer par une porte, que de loin on couvre toute entière avec le boutdu doigt73. "
Ainsi le " raccourcissement qui arrive aux choses qui sont vues obliquement »
n'est pas si puissant qu'il puisse durablement nous induire en erreur. S'il y a « trom-perie", ce ne peut être qu'avec notre assentiment: nous serons toujours enfindétrompés par ce qu'une image n'est jamais seule à nous affecter. Elle fait toujourspartie d'un train de représentations et de sensations, d'affects, qu'à chaque pas nous
trions et comparons. Et Perrault de recourir, dans les notes de son commentaire, àune analogie résolument étrangère au monde cartésien: ici la réfêrence au « senscorlmun » est une évocation (toute nourrie de Plutarque) de la faculté d'apprentis-sage... des animaux:
" [...] car il y a apparence que la première fois qu'un animal voit, il a bien de la peineà iuger de la grandeur des choses éloignées dont les images n'occupent dans son æilque comme un point indivisible; & qu'il faut qu'après avoir été trompé beaucoup defois, et ensuite détrompé par des expériences et par d'autres moyens de connaître lagrandeur des choses que par celui de la vue, il ait fait un grand nombre de réflexionsexpresses. Mais pour entendre ce que Vitruve veut dire, il faut considérer que ce iuge-ment de la vue n'est point infaillible et qu'il peut être surpris, en sorte qu'il est quel-quefois nécessaire que l'autre iugement le secoure ; c'est à dire que l'animal ait atten-tion aux réflexions qu'il faut employer pour bien iuger des images, comparant toutesles choses qui leur appartiennent les unes aux autres, et faisânt servii ce que l'on ade connu et d'assuré pour juger de ce qui ne l'est pas, se servant par exemple de lagrandeur connue pour faire juger de la distance dont on est assuré, pour iuger de lagrandeur, et ainsi du reste74. ,
Loin de la scénographie raréfiée du malin génie, oi toute vérité procède dedÉrnonstrations, ici l'évidence est o de circonstances », pour citer Olivier Bloch: " leproduit variable d'une situation du sujet par rapport aux actions physiques descorps, et non une intuition physique de leur substantialité75 " :
" [...] le sens commun aioutant incontinent à l'image qui est dans l'æil, les circons-tances des choses qu'il connaît, telles que sont l'éloignement ôc la situation de sonobiet, ôc la grandeur des choses auxquelles il le compare, empêche que ces images nesoient prises l'une pour l'autre: car en effet [...] une ovale et un carré oblong qui sontvus obliquement Ec de loin font le même effet dans notre æil qu'un rond ou qu'uncarré parfait lorsqu'ils sont vus directement. [...] sans que nous songions aux règlesde la perspective, 6c sans que notre imagination examine expressément les raisons &les différents effets de l'éloignement, qui dépendent de I'étressissement des angles queforment les lignes visuelles, & de I'affaiblissement des teintes des obiets, le sens com-mun manque rarement à observer ces circonstances; 8c s'il arrive lorsqu'il y mânquequelquefois que la peinture ou la perspective nous trompe, c'est une marque bien cer-taine qu'il n'y manque pas d'ordinaire76, ,
Iihyperbole cartésienne n'est, pour un architecte praticien, pas tenable. Le plai-sir et la douleur, les sensations et les affects, restaurés de plein droit dans le procèsde connaissance, donnent forme à notre appréhension des phénomènes. C'est uncorps qui fait l'expérience du jardin, de ses anamorphoses, de ses senteurs, de sescouleurs, de ses distances, un corps sensible au plaisir et à la peine. Un corps en proieaux images.
P}UNTASIA
Nous ne pouvons faire que nous ne soyons affectés par les images, la pensée n'estrien d'autre que le mouvement qui les interprète, les trie, les compare. De même quela grandeur réelle du soleil nous demeure celée, mais que l'astronome peut la déduirede la confrontation des apparences, nous ne percevons grandeur ou distance que dans
SCIENCES
74. lbidem, p. zo1-2o4, n. a.75. O. Bloch, La pbilosopbiede Gassendi, op. cit., p. 22,76. Cl.Pena,,it, op. cit.,vt,2, p. zo4,note 3) E -2o5, B.
PHILOSOPHES AU JARDIN : UNE PROMENADE SCEPTIQUE
77. La polémique et ses enjeux(peut-on se donner une représentationdt chiliogone? s'agit-il d'une pure intel-lection ? ou simplement d'un mot ?)sont présentés par J.-Ch. Darmon,op. cit., p. ro2-ro1.7 8. Syntagma P h ilos op hicum, l,406-409, voir J.-Ch. Darmon. op. clt..p. ro6.79. Sv la" logique des forces au seinde la phantasi.a ", voir J.-Ch. Darmon,op. cit., p. to7.80. F. Bernier, Abrégé, op. cit.,vr,p. rr4.
la mesure où nous les imaginons. C'était le sens de la polémique engagée par Gassendiavec le cartésianisme à propos de la chimère exhibée par la sixième Méditation, lepolygone à mille côtés ou chiliogone77. Où Descartes distinguait radicalement imagi-nation et intellect et conférait àl'ego,"libéré de tout préjugé,, c'est-à-dire de touteimage et de toute mémoire, le caractère transcendantal d'un point archimédien,Gassendi, dépliant tous les syllogismes escamotés par l'ellipse de l'évidence cartésien-ne, restaurait la notion antique de phantasia. Et proposait une métaphore d'une riches-se singulière: celle d'un papyrus qui, incessamment plié, déplié, replié, enveloppe dansses plis et replis des enchaînements infinis d'images s'attirant les unes les autres parséquences et suites disjointesTs. Notre relation au monde est tissée du flux des images,diurnes autant que nocturnes, qui affectent indissociablement notre corps et notreintelligence: la conscience est l'effet de leur ffavail incessant, de leur véhémence, deleur force motrice79. C'est l'activité ininterrompue de la phantasia, (( une successioncontinuelle d'imaginations qui sont quelquefois sans liaison », qui fonde l'homogénéi-té sous-jacente des facultés, mémoire et iugement. Une physiologie fonde son pouvoirheuristique et herméneutique: la pbantasia imagine, juge, infère, ratiocine.
Toute vision est donc d'emblée une expérience de la mémoire et de l'attente: onne voit que parce qu'on a vu, parce que notre regard est tissé des traces laissées ennous par l'expérience de la vision. Il n'y a pas pour l'æil de"première fois".Prolepse ouprénotion est le nom épicurien du souvenir des perceptions passées, dusillage d'images dans lequel toute nouvelle expérience du regard est prise. La préno-tion est l'horizon d'attente de la perception et le n nom d'action de l'idée » : nous nevoyons que par anticipation ou vraisemblance, par représentation et conjecture, aufil des rectifications successives qu'apportent les déplacements du corps et les mou-vements de la pensée. Bernier décrira ainsi le jeu de I'oopinion antécédente" dansl'évaluation des distances à laquelle se livre le promeneur:
" [...] je dis que la distance [qui est entre l'æil et la chose] n'est appréhendée que parla comparaison des choses qui sont interceptées entre elle et l'æil. Car encore que lacomparaison soit l'ouvrage d'une faculté supérieure au Sens, néanmoins il la fautjoindre au Sens pour pouvoir iuger de la distance. [...] Je dis plus, la distance mêmede l'horizon n'est perçue ou appréhendée que par la diversité des choses qui sont vuesentre nous et lui; car âutant d'ailleurs qu'il y aura de fosses, et de vallées, autant sera-t-il retranché de la vraie distance; la vue appréhendant ces chosesJà contiguës ou, sivous aimez mieux continues, dont elle reçoit les rayons contigus ou continus, et entrelesquels il n'y en a aucun qui vienne des espaces interceptés [...] Or il est à remarquerque la préoccupation ou l'opinion aîtêcédeîte qu'on a de la grandeur d'une chosecontribue souvent à nous faire juger de sa distance, et réciproquement que de l'opi-nion qu'on a précédemment conçue de la distance d'une chose, on iuge souvent desa grandeur [...] Et c'est de cette Opinion antécédente qu'on a de la distance deschoses que la plupart des tromperies qu'on attribue à la vue tirent leur origine, et cetArt des Peintres par lequel ils représentent les choses avec tânt d'industrie qu'il n'y a
. personne qui n'y soit d'abord trompéSo. ,
I.EJEU DU L(}INTAIN
C'est avec un grand luxe de détails que le corpus épicurien décrivait le jeu desreprésentations et des conjectures, des évidences et des opinions entrelacées. I1 s'agis-sait de repousser au plus lointain toutes les inférences possibles qui établissent unlien entre l'évidence des anticipations, des sensations et des affects, et ce qui est
errcore inconnu: de repousser les limites de l'aire de certitude, dans l'espace commedens le temps. Ce jeu on le décrivait comme un ensemble d'opérations de " confir-mation, et d'. implication r, d'n infirmation » et de " réfutation », qui rapportenttoujours l'inconnu à quelque objet visible. Le modèle le plus simple en esr le type dedémenti qu'oppose à mon opinion première (doxa) l'avancée progressive, à ma ren-@ntre, dans l'allée, de celui que je prenais de loin pour Platon: je puis en effet véri-frer en lui serrant la main que ce n'est pas le philosophes'. Comme j'anticipe la dis-tance qui me reste à parcourir en évaluant le nombre de cônes de buis déjà passés etælui qui s'offre à mes regards, et la largeur des " fosses » et des " vallées, à mesureqne ie les découvre. Le véritable critère, on I'a vu, est la vérité du phénomène queproduit I'objet vu de près à le towcher: Épicure, et Gassendi après lui, l'appellent évi-deoc€- La confirmation ou (ainsi traduisait Amyot) I'attestation de mes conjectures,de mes opinions, opère graduellement, dans le temps et dans l'espace. Ici la notioncrnciale est celle d'interualle ou de distance (diastema) réactivée, on l'a vu, parGassendi et Bernier: elle désigne autant la distance aux phénomènes célestes surhquelle opèrent les conjectures de l'astronome que la contingence des futurs. Ondmine que la véritable difficulté commence avec les deux déclinaisons successives deh vérification, l'implication et la réfutation. Elles mettent en jeu le calcul logique, etc'est su.r la déductivité du critère d'évidence au-delà de I'objet uisible, sur le sratur& signe et de la preuve, que s'affrontent les logiciens: est-il licite et à quelles condi-tions peut-on passer de l'évident au non-visible ? La question des limites de validitédcq critères est alors cruciale. Que se passe-t-il lorsque la distance rend impossiblemfirmation ou infirmation de la conjecture ? Lorsque j'essaie de calculer le rapportde Ia terre à la lune? Bref lorsque j'ai affaire à l'imperceptible? La réponse deCæendi, fidèle en cela à Épicure, est que nous n'avons pas accès à la science desgrus'es nniverselles et nécessaires, auxosanctuaires les plus retirés», aux«retraiteslcs plus intimes de la nature " (abdita ov adunata naturae). Seulement à ses . ritesertÉrieurs», aux«vestibules du sanctuaire". Au-delà s'ouvre l'empire du possiblequ'aucune vérification ne viendra infirmer. Il y a de l'imperceptible, donc de l'indé-uminable: par exemple la taille du soleil, ou l'existence d'autres mondes. La limi-æ du monde, comme l'accès aux essences, la métaphysique, excèdent notre portée:txxls ne pouvons nous prononcer sur les choses-mêmes,
I-a théorie épicurienne de la connaissance dont Gassendi est le restaurateur nehirpas de nous les"maîtres et possesseurs de la nature". Tout au plus d'un jardindont il nous est loisible d'explorer et laire reculer un peu plus chaque jour les limites.
rIDlSIilttrOn aperçoit le jeu de la limite qui sous-tend, me semble-t-il, l'expérience du jar-
din Ir Nôtrien. Il faut que le jardin soit enclos, qu'un mur en matérialise la limiteorterne. Et que celle-ci soit redoublée au cæur du jardin par le jeu des caches, des6crans, des cadres, des pentes et contre-pentes qui ménagent aperçus et yues: on nesort à aucun moment du royaume des apparences et de l'empire de l'art. Les réali-És triviales des exploitations agricoles des alentours, des villes avoisinantes parfoissi proches (à Sceaux par exemple) sont hors-champ, de même que la forêt et tôutenature " non dessin ée o : aire infra-logique des sensations pures autant que réserve dematière brute, étrangère à la ratiocinatio dont le jardin propose l'expérience. À l'ho-rizon, inaccessibles, le soleil et f infinité des mondes imaginables: l'empire illimité deh fable et des conjectures invérifiables, le royaume des essences. Telles sont les deuxfrondères qui cernent le jardin, domaine du probable. Cette insularité est de princi-pe- Et l'on sait combien les accès, les portails avec leur appareil de grilles et de bla-
SCIENCES
81. Sextus Empiricus, Contre les logi-ciens, t, zrz l= Contre les mathématïciens, vtt, ztzl.
PHILOSOPHES AU IARDIN : UNE PROMENADE SCEPTIQUI
;. P.Ln,crq,rr sr LoRsqE r'oN ItlcÂRor. Laveri-ublerailàn de ce ræo'rrcitlèment deschoGs élevées ra efté expli-ou& cv-Cevant dans la Planchc X V L ori il s'asit dc Ia differèn-tdimiiu*on du haut des colonnes fuivant le"ur diflèiente hau-mr,quieltle rctreffillcment è l'angle. Celle qucViuuve rappnc icy, qui eft Ia longueut de s lignes , rt'eft point vraye , par-ieque quelques Iongucs que foient les lignes vifuelles , mnt qir'cl-
D ' ' ' Y ; Iesferoatuo-'*.Ê
sons, se prêtent à la dramatisation monumentale des seuils. Mais enfin cette limite,à mesure que je m'enfonce dans le jardin, je ne cesse de l'expérimenter sur le modede f incertitude, de l'anticiper, de la repousser, de la perdre de vue. Elle m'est tou-jours dérobée. C'est l'art du jardinier. Et l'on attribue à bon droit à Le Nôtre ou à
Mansart, qui le précède, l'invention de cette limite singulièrequ'est le ah-ah: arrêté dans sa course, le promeneur doit laisser àson æil de jauger les lointains, d'imaginer ce dont il ne pourrafaire autrement l'expérience -f inaccessible, I'incommensurable,l'adelos. Les jardins de Le Nôtre sont faits pour un être de mou-vement et d'imagination, toujours enquérant la limite de sonregard.
Cette limite, donc, on ne peut à aucun moment la confondreavec le trait dont le graveur cerne le champ d'une image. C'est là,du reste, que me semble reposer l'illusion propre aux historienssoucieux de cartésianiser le jardin à la française. Le jardin n'estpas la gravure en taille-douce de la Dioptrique. Et l'expériencequ'il propose ne se résume pas au rapport projectif du plan à l'es-pace. IJespace cartésien, « cet être parfait en son genre, clair,maniable et homogène, que la pensée survole sans point de vue,et qu'elle reporte en entier sur trois axes rectangulaires [...] a.r-delà de tout point de vue, de toute latence, de toute profondeur,sans aucune épaisseur vraieS' », cet espace-là n'est pas l'espaceque trame le jardinier, ni l'espace dans lequel s'enfonce le prome-neur, qui requièrent tous deux, pour autant qu'ils se confondent,une phénoménologie. Je suppose que le scepticisme et l'épicuris-me antiques en ont fourni, au xvlle siècle, la matrice. Gassendi enfut l'initiateur.
Souvenons-nous du topos sceptique: une tour carrée, vuede loin, paraît circulaire. La difficulté ici est de penser desvolumes, des bords, des arêtes, des formes solides - pas desplanimétries. Nous sommes loin de la " géométrisation àoutrance, de la physique, du " déni de toute spécificité propreàla réalité matérielle » qui caractérise la version cartésienne dumécanisme83. Ce que Gassendi retrouve dans l'épicurismeantique, c'est la possibilité d'une physique qualitative: que lamathématisation de l'espace n'entraîne pas celle de la matière.Prismes, cylindres, pyramides, cônes, et leurs sections: la n chairde l'apparencer. Et les formes de l'atomisme. Le nom de
me aagle, ( fuppo-re que lcs aüÎescircon{tances quipeuvçnr faire iu-ger de l'éloigne-ment foient na-reilles , re[es Ëuefont Ia force oü Ia
p foiblelleducoloris& levoifinaec dcschoGs doni onconnoift la sran-deur ) elbs Ëpre-I Gntcronttouiàrsà I æil une defme
, grandcur. CarlesIignesAC& BC,qui font plus lon-gues que leslignesDC &EC, nefont point paroî-ue Ie coms ,tBplus perit lue kcorTs D E, maiscllis lc font oa-roltre égaLpaice-
qu'dfts fontun mefme rnqle. Et au conueire les lignes H K &iK, quifontésalesen lo-osue\t aux liqnes FK & GK, font**;fuï, h.o*il I & Ie coips F G , dc "erolleu differcnte , par-t q,r.tt r foht dss englcs âifferens.' EiIa taifsn pou la$ie[etin-dinaifon fait paroîire Ies faces plus lonsues , eft qu'elle élapicles angles, parce{uc h face L O,iui eft iplomb, fiit I'argle lesIisncJL N & O N ulusoctit que .'ansle que ccs lignes font lorÊoi'elle eft panchée âorri," L ir,I , doi't l.siie""t vifirelles L N actilN fooË un plus grand angle quc ne fànt les lignes LN 6cO N , IorQu'clle rfeft poir:t panchée commc L O.
Claude PERRAULT
note 3, p. 96, Livre lll, chap. 3,in Les Dix Livres d'architecture de Vitruve,corrtgez et traduits nouvellementen lrançois, Paris, 1673,
Démocrite leur était associé. On lisait dans Plutarque que le philosophe avaitposé la question de l'infinitésimal à propos du tronc du cône, et Vitruve luiattribuait une géométrie de ces formes qui, vues de loin, prennent du relief,sur laquelle auraient pris appui les praticiens de la perspective théâtrale. Or,pour les mathématiciens antiques, l'illusion suscitée par la vue à distancerecoupait la question de l'infinitésimal qu'on formulait sur Ie modèle de " l'ex-haustion » : une tour ronde à distance, c'est une tour anguleuse à la limite8a.Comme la génératrice du cône est une ligne brisée, la sphère devient « unesorte d'angls», un polyèdre: il faut imaginer emplir sa courbure par uncontour polygonal, comme on épuiserait un cercle par l'inscription de millecarrés superposés ou un cône par une pyramide au nombre croissant de faces.Perspective et infinitésimal ici coïncident : les épicuriens concrétisaient cette
150
conjonction par la théorie des simulacres. Les eidola, bords fluctuants, enve-loppes et superficies des limites des corps pris dans le flux tourbillonnaire sedétachent des choses par un traitement infinitésimal, comme autant d,émana-tions, de fragrances, de rumeursss. Elles viennent frapper l'æil qui les perçoit,tramant le monde d'images, d'apparences, d'éclats et de reflets que l,eau, l,airet les miroirs se renvoient sans fin:
" [...] les tours carrées d'une ville dans le lointain / nous paraissent rondes pour laraison suivante: / à grande distance tout angle devient obtus, / ou plutôt disparaît,son impulsion se perd, / les chocs ne peuvent plus parvenir à nos yeux / parce que àtânt frapper ses images qui la traversent, / la grande masse d'air le force à s'émous-ser. / Quand donc tous les angles échappent à nos sens, / Ces édifices de pierre sem-blent modelés sur une tolur; / s'ils n'ont l'aspect d'objets arrondis, présents et wais,/ Ils leur ressemblent un peu, à la façon d,esquissesS6. ,
De cette phénoménologie " littérale " conçue sur le modèle d'une physique duchoc, le xvrre siècle retint, outre le postulat des atomes et du vide, la géométrie desindivisibles: le problème physique de la division d'un segment en"un nombre fini ouinfini de parties ne cessa, au xvrr", d'accaparer l'attention de Galilée et de ses dis-ciples, pour se déployer dans la prestigieuse histoire de l'infinitésimal. Il me sembleque c'est précisément cene quesrion du passage à la limite -limite de l,acuité duregard, limite du discernable -qui informe la poétique des jardins à la française. Pasle pathos de l'infini. Les horizons indistincts des perspectives de Le Nôtre interro-gent le vraisemblable, l'incertain, l'obscur. obscwrus, incertus: soit, chez lesAnciens, o la pointe obscure du cône, où convergent les droites perçues par l,æil,"le point non calculable où cessait la perception distincte8z,. un enjeu philoso-phique de première importance, on l'a vu, où coihcident l'optique et la constitutionatomique, la perspective et l'infinitésimal. Soit une ontologie, un modèle épistémo-logique et une méditation sur la perception: la. science apparentielle ,, fut,Alexandre Koyré le rappelait à l'occasion du tricentenaire du philosophe, l,apportde Gassendi à la science moderne. Elle lui valut une gloire immense en son siècle etiusqu'au siècle suivant une influence cruciale sur le déploiement de l'empirismemoderness. Le jardin en fut, au xvrre siècle, le champ expérimental.,)
SCIENCES
82. M. Merleau-Ponty, I)(Eil et I'esprit,op. cit., p. 48.83. A. Koyré, " Gassendi er la sciencede son temps ", art. cit., p. 3zz.84. Voir Michel Serres, la naissancede la physique dans le texte de Lucrèce.Fleuues et turbulences, Paris, Minuit,1977, p. r2.7 et sùiy.85. ldem, p, rz7 et suiv. ; Jean Salem,Démocrite. Grains de powssière dansun rayon de soleil,Palis,Yrin, t996,p. t79-r86.86. Lucrèce, De la nature, w, 353364,loc. cit., p. 263.87. A. Rouverer, Histoire et imagi-naire..., op. cit., p. 9t.88.. t...1 il a été effectivement un rival,et même à certains égards, un rival vic-torieux, de Descartes, et a exercé sur ladeuxième moitié du siècle une influencedes plus considérables,. A. Koyré," Gassendi et la science de son temps ",art. cit., p. 32. Voir T. Gregory,n Perspectiyes sur Pierre Gassendi ,, art.cit.; le n' zolzt de Corpus, reuue dephilosopbie, Bernier et les gassendistes,sous la direction de Sylvia Murr, Paris,CNRS, r99z; Gassendi et I'Europe,op. cit., en parriculier, sur la filiationGassendi-Locke, les remarques deRainer Specht, n La connaissance sen-sible chez Gassendi et Locke,,p.237-L43, yoir aussi les remarquesde T. M. Lennon, The Battle of theGods and Giants, op, cit., chap. tt,. Locke Gassendist Anti-Cartesian .,p. r49-r9o et 274-314, qui (si ['onsonge à l'association de Locke à l'esthé-tique du jardin anglais) devraienr incirerles historiens des jardins à reconsidérerl'opposition convenue iardinfrançais/ jardin anglais,
151