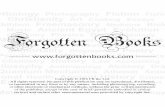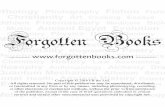E Congo - Forgotten Books
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of E Congo - Forgotten Books
LE C O N GO
C HA P ITRE PREM IE R.
S i tuat ion . L im i tes . E tendue . Le fl euve e t ses afflue n t
On dés ignai t autre fo i s sous le n om de Congo,un
royaume minuscule,enclavé dan s les possess i on s
portugaises de la cô te occidental e d ’
Afri que, et s i tué
près de l ’embouchure d ’un grand fleuve appelé Z a i re
ou C ongo .
Actuel lemen t , ce tte dénomi nat io n s'
app l ique à
l ’ immense régio n de l’Afr i que cen tral e arrosée par
l e Congo et ses nombreux a ffluents . Toute cette
co ntrée,qu i va des lacs de l ’ i n tér ieur aux rives de
l’
O céan ,é ta i t
,i l y a quelques années encore , i nd iquée
sur les cartes géographiques par ces mots : Rég i o ns
i n exp l orées Au j ourd’ hu i
,s i l e bass i n du Cong o
n ’ e s t pas ent iè rement con nu, du mo ins a - t- on re levé
l e cours du grand fl euve depui s sa source j usqu’
à so n
embouchure,e t exp l o ré quelques —uns de ses a ffluents
l es p lus importants .
L ’état des co nnaissances g éog raphiques ne perme t
pas,cependant
,de fixer des l im i tes ab so lumen t
exactes au bass in du Cong o ; sur b ie n de s po in ts ses
8 LE CONGO .
front1eres so nt puremen t co nvent i onnel l es,notam
ment au n ord,où s
’
étenden t d ’ immenses régio ns
que n ’ on t pas encore parcourues l es voyageurs .
Les bornes officie l le s du bass in du Congo sont,à
l’
est,une l ign e imagi nai re su ivan t à peu près le 27
°
mérid i en ori enta l de Pari s,passan t par l e lac Tan
gan i k a et venant about ir au l ac Banguelo . Au sud,
cette l igne rej o i n t la mer,en décrivan t quel ques
courbes san s importance . A l ’ oues t,l es r ivages de
l’
O céan Atlan t i que , depu i s Ambri z au sud,j usqu ’à
la r ivi ère S ette au nord .
Ai ns i détermi née,l a régi on du Congo représente
e nvi ron tro i s m i ll i on s e t dem i de ki l omètres carrés,
c’ es t -à -d ire p lus du t iers de l’Europe , ou la sup erfici e
réun i e d e tous l es pays d ’
Europe , moins la Russ i e et
la pre squ’
île scand inave .
Par su ite des d i fférentes convent ion s survenues
e ntre les pu i s sances européenn es, et en vertu des‘
déci s i on s de la con férence de Berl in,le bass in du
Co ngo comp rend
l ° L’
E tat l i bre du Congo , propriété de l’
Asso ciat i on
i n ternati o nal e du Congo , reconnu auj ourd’hui comme
E tat indépendan t et n eutre,et don t l e s ouvera i n
nomi nal est l e ro i des Belges . I l e s t s i tué au cen tre
du co nt i n en t africa i n et compri s en tre l e 4° de lat i
tude nord,au nord ; l e 27
“ paral lè l e e t l es lacs,à
l ’ es t ; l e royaume du Monato—Y anvo et l es p o s ses
s io n s p ortugai s es d’
Ang o la, au sud ; à. l’
oues t e t au
nord - oues t,i l es t l imité par le cours même du Congo ,
l e Tch i loang o, peti t fl euve côti er, e t l’
O céan .
LE CONGO . 9
2° Le Congo frança i s , qu i s é tend de l’ embouchure
du Tch i loang o aux r ives du Congo , qu’ i l l o nge depu i s
Manyanga j usqu’
à l ’ équateur ; au n o rd , i l va rej o i ndre
nos posses s ion s de l ’Ogooué e t du Gabon a l ’oues t,i l borde l’Atlan ti que .
3° Le Congo portugai s , au sud des bouches du
fleuve .
Cet immen se terr i to i re fo rme l e bass i n du Congo .
Les origi nes du Congo ont été longtemp s un mys
tere,e t on t donné l i eu à. b ien des suppos i t io ns le s
mo i nes portugai s e t i tal i en s qu i débarquèren t,i l y a
quatre cen ts an s,à. son embouchure
,l u i supposa ie n t
avec le N i l des sources communes . L ivi ngs to ne
croyai t que sa parti e supér i eure,qu
’
i l avai t en trevue .
appartenai t au bass in du Zambeze,ce grand fleuve
qui se j ette dan s l’o céan Ind ien . Auj ourd ’hui
, g râce
aux voyages de Cameron , de S tan l ey et de G i raud ,i l
est é tab l i que l e Congo forme un système i l uv ial
a part .
La r iv ière Tcham bes i , qu i p rend sa source au sud
est du lac Tangan ika e t s e j ette dans l e lac Bangue l o ,e st main tenan t con s idérée comme la source du Cong o ;sous l e n om de Louap ou la ,
e l l e sort d u lac e t s e
d i rige sur l e lac Mo éro qu’ e l l e traverse . Du lac Mo éro
coule,vers l e n o rd
,un e r iv i ère nommée Louvo rz a
,
don t le tracé e st encore i ndéci s ; el l e se d i rige vers le
nord - oues t et ren con tre l e lac Sandj i ou Ou landj i . Au
sud —oues t,ce la c reço i t un autre cours d
’
eau appe lé
Loualaba,nom q u i sembl e donn é a p lus i eurs r iv iè re s ;
s e l o n S tanley ,ce n om n e sera i t lu i - m ém e qu
’
une a lté
10 LE CONGO .
rat i on de Loua laohoua,ai ns i que les gens de Manyena,
l es Vouenya, nomment l e fleuve comme celu i - ci
change a chaque affluen t qu’ i l reçoi t,a parti r de
l’
embarcadère de Kammpoom z ou , Stan ley l’
appela
Livingsto n e ou Congo .
A cet endro i t,l e fleuve a déjà on z e cen ts mètres de
large : I l cou le en tre deux l ignes n o i res de bo i s,écr i t
S tan ley,avec une grandeur i nexp r imab le . Calmes e t
profondes,ses eaux brunes gl i s sen t maj estueu
sement vers l’
i n connu,dont le s réci ts fabul eux
qu'
o n m ’ava i t fa i ts,sou levaien t seul s l e vo i l e . Peut
être longeai en t—el l es l e pays des an thropoïdes et des
pygmées ; peut - être l e Makoko,ce ro i redoutab l e
ci té par D iaz,CadaMosto et Dapper
,avait- i l u n repré
sen tan t dan s l es cen tai nes d e l ieues i nexp lorée s
qu ’ el l es traversa ien t .
S tan l ey avai t rencontré l e Loualaba en su i van t un
de ses affluents,l a Louam a, qu i sort du Tangan ika .
B ientôt commencent le s rap ide s du fleuve ; l es p re
miers sont ceux d’
Oukassa pu is l e Congo décr i t des
coudes aigus,e t so n cours
,ju squ’ i c i tranqui l l e
,forme
des tourno i ements dangereux,où tourb i l lo nnen t san s
cesse de larges nappes d ’
é cum e b lanche . Tout à. coup
le l i t du fl euve se rétréci t et pendan t cm q ou s ix k i l o
mètres coul e entre des r ives escarpées,que sépare
un espace de hui t cen ts mè tre s‘
a p e i n e,pour s’ é larg i r
san s trans i t i o n e t atte i ndre d ix - sep t cen ts mètres .
Depui s O ukomghé , l e Congo forme deux b ras , d’un
ki l omè tre chacun , que séparen t des i les bo i sées d’une
merve i l leuse ferti l i té ; pu i s vi ennent le s sep t cata
LE CONGO . 1 l
ractes de S tan l ey, s i tuées sous l equateur ; e l les son t
abso lumen t i n franchi s sabl es . Ap rè s avo i r bo nd i d e
rap ide en rap ide pendan t un mi l le,le fleuve rencontre
une nappe tran sversal e co ntre laquel le s’
emp i len t
des vagues énormes ; l e b lan c l iqu ide surmon te la
crête de la rampe et retombe de l’
autre cô té en u n
chao s i ndescr ip t i b le .
Au dessous , l e fleuve mesu re d ix -hu i t cen ts mè tre s
e t de douze à. quatorze mètres de pro fo ndeu r ; e ntre
la s ix ième e t las ep ti èm e chute,i l s e resserre de nou
veau pour ne p l us atte indre que douze cents mètres ,do n t prè s de sep t cen ts s o n t o ccupés par des i l e s .
Ains i res serrée,la r iviè re court bruyammen t entre
des berges escarp ées et l es ro chers ab rup ts des
î l es ; ses fl o ts roul en t a toute v i tes se , p rennen t une
force indescrip tib l e,e t , bond i s san ts , s e j etten t dan s
un gouffre où i l s forment des l ignes de grandes
vagues qu i se p ress en t les unes co ntre les au tres ave c
un e véri tab l e rage . La sorti e du N i l aux chute s du
Ripo n n'
est r i en,comparée à. ce fleuve d ix fo is p lus
vo lumineux et resserré dan s le m ême espace .
Depu i s sa sort ie du lac Moéro jusqu‘
à l’
équateur
le Congo su i t une d irect io n nord - ouest , avec que lques
courbes i n fléchi ssant vers le nord , pui s vers le nord
es t ; ces détours firen t cro i re un i n s tan t a S tan ley
que le fleuve al la i t rej o i nd re le N i l . A parti r d e
S tan ley fa lls, chutes de S tan ley , l e Congo décri t u n
arc de cercle au nord e t,couran t a l
’
es t quart no rd —e s t
d ’ abord,se d i rige ensu i te vers l e sud , pour reven i r
couper la l igne a N ‘
g o ndo ; pu is i l co nt i nue dans cet te
1? L E CONGO .
dern i ere d i recti on jusqu a S tan l ey Poo l . Sur tout ce
parcours,l e l i t du fleuve atte i n t u ne largeur qu i s ou
vent excède ci n q mi l l e mètres ; de ses eaux ahondan
tes et rap i des s’
é lèvent des mi l l i ers d ’
îles et d’
i lo ts
bo i sés,trè s fert i l es
,et do nt un grand nombre s o nt
hab i té s par une populat io n guerr iè re,don t S tan ley
eut souvent à. sub ir l es attaques ses r ives auss i s o n t
s i populeuses que, pendan t de l ongues d i s tances, l e s
v i l lages s e touchen t presque .
De grandes r ivières, dont l e s s ources son t en core
incon nues,apporten t l eurs eaux dan s l e Congo
,à.
dro i te e t a gauche ; les p lu s co ns idérab les son t
l’
Arouwim i,qu i n ’a pas mo in s de d ix -hu i t cents mètres
à. son confluen t ; l’
Ikelamba,l arge de se iz e cents
mè tres et don t l e s eaux no i res cou len t p endan t l ong
temp s san s se mélanger à. cel l es du grand fleuve ;l’
Oubandj i , l e Rouk i , l’
A l ima,appelée Lawson
par Stan l ey ,et l e Lefin i ces deux dern i è res tra
versent le terr i to i re françai s .
De l ’ équateur à. S tan ley- Poo l,l e fl euve s e rétréci t
,
l es i les devi ennent mo in s n ombreuses,et l es r ives
p lus escarpées .
Stan ley—Poo l,l etang de S tan ley
,est un vaste é lar
g i ssem ent du fleuve,p lutô t qu’un étang ; i l mesure
enviro n qui n z e cents ki lomètres carrés de superfi ci e .
Une lo ngue i le i nhab itée l e d ivi se en deux part ies,
su ivant à peu près l a d i recti o n de l ’axe du fleuve .
Chacun des bras es t parsemé d’
i lots e t de bancs de
sab l e peu él evés,couverts de grandes herbes
,de
papyrus et de palmiers borassus . Outre ces î l es,on
LE CONGO . l a
aperço i t des î l o ts en t i erem en t formés de papyrus
enchevê trés ce son t d es î l es fl o ttan tes qu’
empor te l e
couran t ve rs les cataractes .
Le règne an imal est l argement représen té sur l es
r ives de S tan ley-Pool des mi l l i ers d’ o i seaux aquat i
ques : a igrette s b lanches , canards , p luvi ers dorés ,pé l i cans
,héro ns
,prennen t leurs ébats aux bords du
fleuve sur les bancs de sab l e et de vase, d’ énormes
crocod i les dormen t au so l e i l,e t de monstrueux hippo
po tam es se j ouen t en tre le s i l es .
Autour de l ’ étang se dressen t de hautes co l l i ne s
bo i sées,en tre autres
,les Dovers cli ffs ou montagne s
d e Douvres . A l’ extrémité mérid io nale d e cet é larg i s
s emen t,a l ’ endro i t où l e fl euve rentre dan s so n l i t, se
dress e la p o i nte de Kal l i na,sorte de p romo nto i re
formé par un e roche rouge de c i nquan te p i eds de haut,au bas de laquel le tourb i l lo nnent des remou s dange
reux,d i ffi c i les à franch i r , même pour un vapeur ; so n
nom lu i vi en t d ’un o ffic ier autri ch ien qu i s ’y noya
en décembre 1882 . M . Kal l i na deva i t remonte r l e
Congo ; au l ieu d ’attendre l e bateau qui , tous les
mo is,part de Léopo ldvi l l e pour al ler rav ita i l le r les
sta ti o n s du haut fl euve,i l s
’
embarqua sur un cano t
i nd ig è ne . Le l ieutenan t éta i t trè s g rand e t t rè s lourd ,i l s
’
ass i t,malgré les observa ti o ns des cano t ie rs , à
l ’arrière du bateau celu i - ci,déséqu i libre, fut p ri s
par l e tourb i l lo n e t englout i en un i nstan t . Le l ie n to
nant Kal l i na et les hommes d’
équipage fure n t noyés .
Au sorti r de Stan ley—Poo l,l e Congo se d i rig e vers
le sud—oues t j usqu’
àViv i où i l remonte un peu vers
16 LE CONGO .
l ’ouest p our former l ’ estuai re par l eque l i l s e déverse
dan s l’O céan . De Stan l ey- Poo l a Vivi,so n cours est
coupé par de nombreux rap ides et par l es tren te - deux
cataractes de L ivi ngs tone .
Ce n’es t p lus,écr i t S tan ley
,l e cours d
’
eau maj es
tueux don t la b eauté myst iq ue , l a n ob le grandeur, l e
flo t calme et in in terrompu sur une d i stan ce de neuf
cents mi l l es k i l omètres) , avai en t pour nous un
charme irrés i s t ib le,en dép i t de la féroci té des tr i bus
de ses bords , C’ est un to rren t furi eux
,rou lan t dan s
un l i t p rofond,obstrué par des réci fs de lave
,des
proj ecti on s de fala i ses,des bancs de roches errat i
ques,traversan t des gorges tortueuses , franchi s san t
des terrasses et tomban t en une lo ngue sér i e de
chutes , de cataractes et de rap ides .
A Boma,commence l ’ es tuaire du Congo
,mai s c’ es t
vues de l ’Océan que l es bouches du fleuve son t vér i
tab lement imp o san tes .
J
A mesure qu ’ on s ’approche,par mer
,de l’ embou
chure du Congo, l e s hautes fala i ses de roches rouge s
qu i tombent à p i c dan s l ’O céan et renden t l ’accè s
de la côte d i ffici le,s’
aba i ssent gradue l l emen t p rès
du fleuve s ’ é tend une p lage immense,bas se e t sab lo n
meuse, que recouvre une épa is se ce in ture de palé tu
v iers . La mer change de ton, et p endan t des l i eues on
peut su ivre les eaux brun rouge du Congo , qu i tra
versent l es flo ts verts de l’O céan‘
sans s ’y mê le r .
Contrai remen t aux autres grands fleuves de l’Afr i
que, au N i l , au N iger, au Zambèse , qu i fo rmen t d’
im
men ses deltas , l e Co ngo s e j ette dan s l’
Océan par
20 LE CONGO .
nan e à. l a terre es t basse, marécageuse et p resque
toujours te l l emen t recouvert e par l es eaux, qu’ i l faut
p rendre u n bateau pour gagner l ’ étab l i s semen t ; en
résumé,c’ es t b i en p l utô t une î l e qu’une pén i n sul e .
A part le bass i n de l’
Am az one,i l n
’
est pas de système
fluvial,au monde
,qu i reço ive une masse d ’ eau com
parable à. cel l e qu i se déverse dans le Congo : quel ques
un s de ses a ffluents son t des r ivi ères p lus grandes
que l es p lus grands fl euves de l’Europe ; des lacs im
menses,comm e l e Banguel o
,qu i mesure vi ngt - c in q
mi l le k i l omè tres carrés de superfici e,l es al imen ten t ;
et ce s réservo i rs sont s i tués a des hauteurs qu i var i en t
en tre mi l l e et d ouze cents mè tres au - dessus du n iveau
de la mer .
Du lac Banguel o a son embouchure,l e Congo me
sure ki lomètres ; sa largeur entre Banane e t
Po i nte del Padrao e st de d ix- sep t m i l l e mètres,e t son
déb i t est évalué à mè tres par seconde pendan t
la sai so n sèche ; a l’ époque des p lu i es
,i l d oubl e
p resque de vo lume , quand ses eaux e t cel les de se s
affluen ts sont gonflées au po i nt de déborder .
CHAP ITRE I I .
Découve r te du C ongo . Le s exp lo ra te u rs an c iens . L iv i ngs to ne . S tan l ey . C am e ro n .
Dès le commencemen t du xves i ecl e , le s ro is de Por
tugal rêvaien t de concen trer entre leurs main s tou t
l e commerce des Indes ori en tal es,don t les Grecs e t
les républ i ques i tal i e nnes s e d i sputa ie n t le monopo le .
Pour atte indre ce but,i l fal la i t trouver
,en deho rs de
la Méd i terranée , une vo i e qu i condui s i t d i rectemen t
aux Indes .
A la fin du xv° s 1e cle,de nombreuses expéd i ti o n s
furen t envoyées avec m i s s i o n de pro l onger l a côte
occiden tal e d’Afr ique . En 1484 , Barthélemy D ia z par
t i t avec tro i s va i s seaux,e t
,malgré l e mauva is temp s
e t l es dangers d ’une navigat io n d i ffi ci l e sur ces mers
enco re i n con nues,atte ig n i t l a po i n te sud de l
’
Afr ique ,
qu’ i l nomma Cap des Tem pêtes . Le ro i Jean I I , p lus
confi an t dan s l ’ aven i r,l’
appe la cap de Bon ne—E spé
ran ce . E n 1497,Vasco d e Gama
,p lus heureux , dou
b la i t le cap e t , traversan t l’ océan Ind ien , abordai t a
Cal i cutt .
Cependan t,d ’autres flottes é tai en t charg ée s de v i s i
ter l a cô te,d ’y créer des é tab l i s sements , d
’
y i n stal l e r
des miss io nnai re s . C ’ es t pendan t un de ces voyag es
d’
exp l o rat io n que le Congo fut découvert .
En 148 4, sel o n les un s , e n 148 1 , su ivan t l e s au tres ,
22 LE CONGO .
D i ego Cân ,cap i taine portugai s
,ayan t traversé la l ig ne
formidab le de l ’ équateur,découvri t l
’
embouchure du
Z aïre ou C ongo, qu i sor t des m êm es sources que le N i l
e t précip i te so n cours vers l es p l ages de l’O ccident . I l
est large d ’ envi ron d ix- sep t m i l l es à. son embouchure ,et s i impé tueux que pendant p lus ieurs l i eues i l tend
les flo ts de l ’O céan san s s’y mêler et san s en p rendre
l ’amertume .
D iego débarqua dan s cette part i e du pays qu i est
suj ette au pri nce de S ogno ; au po i n t où i l toucha terre ,i l p lan ta l e s igne de la cro ix pour perpétuer la m é
moire de ce j our, et i l n omma cet endro i t la Pun ta, ou
promonto ire de l Padrao .
Càn voulut pénétrer dans l ’ i n téri eur et vo i r un
ro i pui ssan t ; o n lu i dés igna le ro i de Congo . I l s e ren
d i t dan s sa métropo le, et le ro i sauvage ayant cru aux
paro les de D iego , l u i co nfia quatre de ses suj ets pour
qu’ i l l e s emmenât et qu’
i l s pussen t porter au ro i de
Portugal les hommages de so n ami ti é .
C’
est ai ns i qu’ en 1687 Gavazz i décrivai t la décou
verte des bouches du fl euve Congo .
Ap r è s D i ego et les re l igi eux qu ’ i l débarqua,de nom
breux m 1ssmnna i res portugai s e t i tal i en s v i nren t s’ é
tab l i r dans l e royaume de Congo pour évangél i ser les
i ndigènes . B ientô t, i l s qu i ttèrent l es cô tes pour s’
a
van cer dan s l ’ i ntéri eur . Les uns,al lan t dro i t à. l ’ es t
,
g agnèrent les bords du Tangan i k a ; d’
autres,remon
tan t au nord,en su ivan t l e cours du fleuve, vi s i tèrent
l’
emp ire de Mako k o .
Vers 152 1 , un de ces m i ss i o n nai res su iv i t l e cours
LE CONGO . 23
du fl euve, don t i l décr i t les rap ides , les cataractes e t
l e larg e l i t tout parsemé c’
île s , hab i tées par des tri
bus guerri ères qu i se l ivren t des combats con t i nuel s
e l les monten t de grands cano ts creusés dan s des
troncs d’
arbres ; i l s s on t s i grands que s ix hommes n e
pourrai ent l e s embras ser ; i l s p euven t porter j usqu’
à
deux cents hommes
Ne son t—ce pas là. l es sauvages i nd igènes,mo n tés
sur de lo ngs bateaux , qu i as sa i l l i ren t s i souven t S tan
ley pendan t sa descente du Zaïre,al ors qu’ i l décri t
l e fleuve comme encombré d’
île s hab itées par de s
tr ibus host i l es,auxquelles i l fut ob l igé de l ivrer mai n ts
combats
Vers la même époque,l ’un de ces mis s i o n naire s
pénétra i t dan s l ’ empi re de Mak0 ko ; en 1552 , le P .
Bonaven ture de Sorente se proposai t de remon ter l e
Congo,de gagner l es sources du N i l e t
,descendan t
ce dern i er fleuve,d ’atte i ndre la Méd i terranée .
Onze an s p l us tard,l e P . S i lve ira
,qu i mou ru t a
Lunda,dan s la régio n des lacs ,rencon tra un rel ig ieux
accompl i ssan t la traversée du cont i nen t a fri ca i n ;part i de Sai n t- Pau l de Loanda
,sur la côte de l
’
A tlan
t i que,ce miss i onnai re su ivi t l a route parcourue p lus
tard par Cam éron ,dans la parti e mérid io na le du
bass i n du Congo ; pu i s i l g agna la cô te de Mo z am
b ique,sur l
’
O céan i nd ien , où i l s’
embarqua pour Goa .
Le xvm ° s iè cl e n e fi t guère p rogresser l’
explo ra
ti o n du Congo de nombreux voyageurs , cependant ,parcoururen t la route ouverte vers les g rands lac s
mai s l e réci t de leurs voyages n’
a p as é té écri t ou n’
es t
LE CONGO .n
'
pas parvenu j usqu a nous . E nfi n , en 1789? 1e Portugai s
Lacerda fi t une véri tab le exp lo rat i o n géographique .
Con nu déjà par ses travaux au Brés i l , i l fut mi s par
l e gouvernement portugai s a l a tê te d’
une expéd i ti on
chargée de reconnai tre l ’ i n téri eur . Part i d e Tè té,sur
l e haut Zambè z e , i l s’
avança j usqu’
aux E tats duMuata de Ca z embé e t j usqu ’
à. l a cap i tale du pays de
Lunda ; mai s l a mort l’
empêcha d’
accomp l i r l a tra
versée complète du cont i n en t afri cai n .
A parti r de cette époque, i lsemb le que l’o n ai t aban
don né toute ten tat ive d’
exp l o rat i o n ,e t
, même , que l e
souven i r des routes tracées s e so i t p erdu . Ce n’
est
qu ’au commencement de no tre s i è cle que les nat i o n s
européen nes s’
élancèrent de nouveau a l’
assaut du
cont i nent mystéri eux .
Trompés san s doute par la d i rect i o n du fleuve dan s
sa part i e déjà. con nue , les géographes se figurai en t
qu’ en remontant so n cours,o n a tte indra i t le s région s
i nexp l o rées du Soudan mérid i o nal,e t
,peut - ê tre
,l e
sud de l ’Abyss i n i e et l e N i l . On étai t lo in de s’ imagi ner
qu ’ i l décr ivai t u ne courbe immense,et venai t
.de la
régi on des lacs .
E n 18 16, l’
Ang leterre chargea le cap ita i ne Tuc k ey
de remo nter l e fl euve Co ngo auss i l o i n que p os
s ib l e,d’ étud ier les product io n s de ses r ives et de
recue i l l i r des do nnées géographiques sur l ’ in téri eur
du cont i nen t . Le cap i tai n e Tuc k ey s’
embarqua sur l e
fleuve mai s,à. qua tre cen t c i n quan te m i lles de so n
embouchure,i l rencon tra les p rem i ers sauts
,qui l ’ ar
rêtèren t dan s sa marche , a un endro i t appel é I sang i la,
LE CONGO . 2 5
qu’ i l nomme Sang alla ; pu is i l fut p ri s par la malad ie ,
e t mourut ; so n expéd i t i o n , p rivée de s on che f, démo
ral isée par la sou ffrance,déc imée par la fi èvre
,re
gagna a g rand’
pe i ne les rives de l’
O céan e t seuls,
quelques rares survivants rev i n ren t e n Ang le terre
C’ es t a S tan ley qu ’é ta i t ré servée la g l o i re de su ivre
l e grand fl euve sur tout so n parcours ; m a i s,avan t lu i
,
de nombreux voyag eurs avai en t v is i té p lus i eurs
po i nts du bas s i n du Co ngo ; le but pou rsu iv i par ces
exp l orateurs éta i t l’
étud e de l a rég i o n de s g rand s lacs ,des sou rces du N i l e t de s sources du Zambeze . Le s
pri ncipaux,Burton , Speke ,Gran t, Living s to ne , pé nè
trèren t au centre du conti nent par la cô te orie n ta l e ;c’ est auss i de ce po i n t que Camero n e t S tan ley par
ti ren t pour leur pér i l leuse traversée .
Le p lus con nu e t l e p lus cé lèbre de ces exp l o rateurs
e st Livi ngsto ne . C ’ é ta i t du m i s s io n na i re p ro tes tan t
anglai s , qu i s’
éta i t co n sacré tou t e nti e r a la mi ss i o n
d ’é tud ier l ’ i ntéri eur du cont i n en t . Dan s se s p remiers
voyages , de 1840 a 1853, i l v is i ta l e pays compris e ntre
la co lo n ie du Cap e t l e cours du Zambeze . De 1853 a
1856 , i l qu i tta l e bass i n du Zambeze e t , pou r g agne r
Loanda sur la cô te o cciden tale,t raversa la rég i o n
arro sée par l es a ffluen ts de g auche du Congo ; pu i s i l
revin t sur la cô te deMozambique,accomp l i s san t a i ns i
l a traversée de l’Afr i que .
De 1866 51 1873, i l parti t de Zan z i ba r , v i s i ta le Caz em bé ,
découv r i t le lac Moé ro,remonta la r i v iere Louapo u la ,
qui s’
y déve rse ,e t découvri t le lac Bangue l o c
’
e s tdans
ce voyage qu’
i l acqu i t la certi tude que le s cours d’eau
26 LE CONGO .
qu’ i l ren contra i t formaien t un système flu vi al a part,
et n ’
appar tena i en t pas au bas s i n du Zamb èz e , comme
o n l ’avai t cru j usqu’
alors .C’
é ta i t l a part i e or i en tal e du
Congo,et i l ava i t vu l e cours supérieur du grand
fleuve,l e Loualaba .
Cependant, en 1869, o n étai t san s nouvel l e s de Li
v i ng stone des trente- quatre l ettres qu’ i l ava i t é cr i tes
depu i s 1868,aucune n ’ éta i t parvenue à dest i nat i o n . La
Société de Géographi e de Londres décida,en 187 1
seulement,d ’ envoyer une mi ss i on à. l a recherche de
l’
exp lorateur . Les chefs de cette expéd it i o n m iren t
une telle l en teur dans leurs préparat i fs, qu
’
à. pe in e
arrivés à. Zanz ibar,l e té l égraphe apprenai t à. Lon
dres que Livi ngsto ne étai t retrouvé vivan t ; et par
qu i par u n j ournal i ste améri cai n,Henr i S tan l ey .
Le d i recteur du N ew-York Hera ld,j ournal am ér i
cai n,M . James Gordon Bennett
,s ’étai t décidé à en
voyer a ses frai s un r epor ter au centre de l’
Afr i que ,
pour retrouver l e mi ss ionnai re anglai s .
Vo ici en quel s termes S tan l ey,l u i -même
,raco nt e
la façon don t son d i recteur lu i co n fi a cette mi ss io n
Le 16 o ctob re de l’an du Seigneur 1869
,j ’ étai s à.
Madrid,rue de la Cro ix ; j
’arr ivai s du carnage de
Valence . A d ix heures du matin,Jacopo m’apporte
une dépêche ; j’y trouve l es mots suivants
Rendez—vous à Pari s,affai re importante
Le télégramme est de James Gordo n Bennett fi l s,
d irecteur du N ew York Hera ld . A tro i s heures,j ’ étai s
en route . Obl igé de m ’ arrêter à. Bayonne,j e n ’
arr iva i
a Pari s que dans la nu i t su ivante .
28 LE CONGO .
gu ide un gu ide p rat i que . Vous d i rez tout ce qu i
mér i te d etre vu et de quel l e man ière o n peut l e vo i r .
Vous ferez b i en,après cela, d
’ all er à Jérusalem ; l e
cap i ta i ne Warren fai t,di t- on,l
'
a- bas, des découvertes
importantes ; pu i s a Con stant i nop l e , où vous vous ren
se ig nere z sur les d i s sent iments qu i d ivi sen t l e Sultan
e t l e Khédive . Après Voyon s un p eu . Vous pas
serez par la Crimée et vous v i s i terez les champ s de
bata i l l e ; pu i s vous s ui vre z l e Caucase jusqu’
à la mer
C asp i enne ; o n d i t qu’
i l y a la une expéd i t i o n en par
tance pour Khiva . E nsu i te vous gagnerez l’ Inde e n
traversant la Perse . Vous p ouvez écr i re de Persépo li s
une lettre in téressante . Bagdad sera sur vo tre pas
sage ; adres sez - nous quelque chose sur l e chemin de
fer de l’
Euphrate ; e t quand vous sere z dan s l’
Inde,
embarquez —vous p our rej o i ndre L ivi ngsto ne . A ce tte
époque,vous app rendrez san s d ou te qu’ i l est en rou t
pour Zanz ibar ; s i n on , al le z dan s l’ i n tér i eur et cher
chez — le j usqu’à. ce que vous l ’ ayez trouvé . I n fo rmez
v0 us de ses découvertes ; enfin , s’ i l e st mort
,rapp ortez
des preuves certa i n es .
Maintenan t, bon so i r, et que D i eu so i t avec vous .
B onso i r , Mons i eur ; tout ce que l’
huma i ne nature
a le pouvo i r de fai re,j e l e ferai , aj outa i- j e e t! dan s
la m iss ion que j e vai s accomp l i r,veu i l l e D i eu ê tre
avec mo i .
Aprè s avo i r fai t l a tournée qu’ o n l u i ava i t i nd i
qué e , S tanl ey s e d ir igea sur Zan z ibar, qu’ i l atteign i t
l e 6 j anvier 187 1,venan t de Bombay . I l o rgan i sa rap i
demen t une forte c aravane et marcha vers l ’ ouest . Le
LE CONGO . 20
10 novenflne 187 1,zq nè s un voyage de deux cent
trente - s ix j ours,i l rej o ignai t Livi ngstone a Oudj ij i ,
sur l e Tangan ika .
Le 3 novembre,écri t S tan ley dans s on l ivre
Comm en t j’
a i r e trouvé L i v ingston e , une caravane
composée de quatre—vi ngts nat i fs du pays de G ouhha,
provi nce s i tuée à l’ oues t du Tangan i k a
,e st arr ivée
d’
0 udj ij i . J’a i demandé les nouve l l es . Un homme
b lan c est lei - bas depu is t ro is sema i nes m ’a - t- ou
répondu . Cette répo nse m ’ a fai t tressai l l i r .
Ihi honnn e l flanc ? zuj e reprüL
Oui,un homme blanc
Connn en t est fl lndnflé ?
Comme le mai tre .
C’ es t mo i que l ’ o n dés ignai t a i n s i .
ÏE st flj eune ?
Non,i l e st vi eux , i l a du po i l b lan c sur la figure .
E t pui s,i l es t malade .
D ’ où vi en t— i l ?
D ’un pay s qu i e st de l ’autre côté du Gouhha ,
trè s lo in,trè s lo i n ,
e t qu ’ o n appel l e Manyena .
Vra imen t E t pen sez—vous qu ’ i l so i t e ncore a
Oudj ij i?
Nous l ’avo ns vu i l n ’y a pas hu i t j ours .
Hourrah ! C’ est Liv i ngsto ne
,c’
es t L ivi ng s to ne !
Le l endemain,S tan ley
,avec ses hommes ,
se d irig e
sur Oudj ij i ; sept j ours ap rè s , i l arrive a mo i n s de
500 mè tres du vi l lage .
— D ép l oye z vos d rapeaux,s ecr i e S ta n ley , et
charge z le s armes.
30 LE CONGO .
Prè s de c i n quante fus i l s rugi s sen t . Leur ton
n erre,pare i l à.ce lu i du canon , p rodui t son effet dan s l e
vi l lage .
K i rang o z y, portez haut la bann ière de l’homme
b lan c ! qu’
à. l’
arr i ère—garde flo tte l e drapeau de Zan
z ibar ! Serrez la fi l e , et que les décharges con t i nuen t
j usque devan t l a mais on de l ’homme b lanc !
Nous n ’ avio n s pas fa i t 200 mètres,que la foule se
pres sai t a n o tre renco ntre . La vue de nos drapeaux
fai sa i t comprendre qu’ i l s ’agi ssai t d ’une caravane
mai s la bann ière éto i lée qu’
ag i ta i t fièremen t Asman i
p rodui s i t dan s l a fou l e un mouvement d ’ i n cert i tude ;c’ éta i t la première fo i s qu
’
el l e parai s sa i t dan s l e
Prenant alors l e part i qui me parut l e p lus
d igne,j ecarta i la fou le et me di rigeai
,entre deux hai es
d e curi eux,vers l e demi - cercl e d ’
Arab es devant leque l
s e tenai t l’
homme à. barb e gri se .
Tand is que j’
avança i s l en temen t, j e remarquai sa
pâleur e t son air de fatigue . I l avai t un pan talon gri s,
une veste rouge e t une casquette b l eue à galon d ’ o r
fané . J ’aurai s voulucour i r à. l u i ma is j ’ éta i s lâche en
présence de cette fou l e . J ’aurai s voulu l’ embrasser
mais i l é tai t Anglai s,e t j e ne sava i s pas comment j e
sera i s reçu . Je fi s donc ce que m ’
i nsp i ra i t l a couardi se
e t le faux orguei l j’
approchai d’un pas dél ibéré , et d i s
e n é tant mon chap eau
Le docteur Livi ngsto ne,j e p résume ?
O u i, répond i t - i l avec u n b ienvei l lan t souri re .
Nos tê tes furen t recouvertes e t nos mai n s se ser
rèrent .
COpb
LE CONGO .
L iv i ngstone emmena S tan ley dan s sa demeure .
Alors commença le réc i tdes événements do n t l’Europe
e t le monde enti er é ta i en t l e théâtre depui s des années
que le doc teur étai t san s nouvel le s d’
Europe .
Que se pas se - t - i l dan s l e monde ? demandaLivi ngsto n e ?
Vous ê tes san s doute au courant de certai n s
fa i t s, répond i t S tan l ey ; vous savez , par exemp l e , que
le canal de Suez est ouvert,e t que l e tran s i t y e st
régul i er e n tre l’
Europe et l’
Asi e E t l e chem i n
d e fer du Pacifique, Gran t p rés ident des E tats - Un i s,l’
Egypte i n o ndée de savants , l a révo l te des Créto is,I sabel l e chassée du trô ne
,Prim assass i né
,l a l iberté
des cultes en E spagne,l e Danemark démembré
,l ’armée
p russi enne à. Pari s , la Fran ce va i n cue
Quel l e avalanche de fa i ts pour un homme qu i sort
des forê ts v i erges du Manyema !
Pendant quatre mo i s,Livi ngsto ne e t Stan ley explo
rèrent en semb le les r ives du Tangan ika , pu i s , empor
tant l e s pap iers du docteur,l e repor ter américa i n
revi n t en Europ e .
Avant so n départ,S tan ley avai t tout fai t pour eng a
g erLivi ngstone,arev en i r en Angleterre afi n de réparer
ses forces ; mais l e m iss i o nnai re fut i nébranlabl e
J e veux comp l éter mon oeuvre,d isa i t- i l ; tous me s
ami s l e souhai ten t
Le . 14 mars 1872 , S tan l ey s e lo ig na i t , la i s san t
Livi ngstone à. Kou ihara,où i l a ttenda it l
’
arr ivée d’
une
caravane que l e reporter amér i ca i n deva i t lu i envove r
32 LE CONGO .
de Zanz ibar . L 1mm Ob i l i té pesa i t au docteur , et les
j ours lui parai ssaient longs ,
E nfin,l e 14 août , l es c i nquan te—sep t hommes an
nonces par Stan ley arr i vè ren t ; parmi eux se trouvai t
JohnWai nwright,qu i sava i t l i re et écri re , et j oua u n
rô l e important lors de l a mort de L ivi ngstone .
Le 25 août l e voyageur se mettai t en route,dans la
d irecti on de l ouest i l n ’
arr i va que le 8 o ctobre en vue
du lac de Tangan ika .
Tout l e monde es t fatigué , écri t—i l , et j e me réj oui s
qu’
on marche lentement . A cette époque,la santé
de’
L iv i ng stone éta i t comp lè tement détru i te , e t chaque
j ournée cle -marche ne fai sai t qu’
emp i rer l e mal .
Pendant deux moi s , l a caravane contourne l e lac et
voyage dans u n pays montagneux ; pu i s e l l e s e d i rige
au sud - ouest,traversan t un pays p lat et couvert
d ’arbres ébranchés pour fai re de l’é toffe et des cendres.
Le 26 décembre,e lle traverse le Lafouba,un affluen t du
Loualaba . e t un pays fortement o ndulé Nous mon
tons évidemment, a mesure que nous approchons du
Zam bèz e .
Jusqu’
au 20 avri l 1873 , Liv i ngsto ne su i t, à. une certa ine d i stance , l es bords du lac Banguel o , traversan tune régio n coupée de nombreux cours d ’ eau
,et de ter
rai n s marécageux et mouvants qu ’ i l appe l l e épong eA part i r de ce momen t
,l e voyag eur devien t d
’une fai
b lesse extrême la mort arrive à grands pas.Chaque
jour , son j ournal , qu’ i l réd igeai t avec l e p lus g rand
so in , ne contien t p lus que la date et une l igne ou deux
de renseig nements .
L E CONGO . 33
21 avr i l . E ssayé de monter a ân e mai s o bl igé de
me coucher . J ’a i perdu trop de sang (i l avai t l a dys
senter i e ) e t n’
ai p l us de force,i l faut me por ter . On
l e ramena au vi l lage . Le lendemain,i l repartai t .
22 avr i l . Porté en ki tanda,a travers une boug a .
Sud - ouest,deux heures e t quar t .
Le j our suivan t, i l n e put i n scri re sur son j ournal
que la date du j our
23 avr i l .
E t a i n s i l e 24,l e 25 e t l e 26 avri l .
2 7 avr i l . Je n ’
en peux p lus,e t j e res te . Mieux .
E nvoyé acheter des chèvres lai t iè res . Nous sommes
au bord du Mo li lam o .
C es l ignes son t les dern ières qu ’ i l a i t écr i tes .
Le 29,avec des pe ines i nouïes
,o n lu i fi t traverser
l e Mo l i lamo et on l’
i nstalla dans l e v i l lage d e Tch i
tammbo .
Le 30,vers on ze heures du so i r, Livi ng s to ne appela
son servi teur Souz i , qu i coucha i t dan s une case vo i
s i n e de la s ienne ; de grands cri s re ten ti ssai en t dan s
le l o i n ta in .
E st—ce que ce son t n o s hommes qu i fo n t tou t ce
bru i t demanda L ivi ngstone .
Non,maitre
,d i t l e servi teur ; ce son t les bab i
tants qu i chas sen t les buff1es de s champs de so rgho .
Quelques minutes après,i l d i t len temen t, e t comme
en dél i re :
Cette r ivière,e st ce l e Louapou la
Sou z i l u i répo nd i t q ue c’
é ta i t le Mo lllamo .
A comb ien de j ours sommes - nous du Louapou la?
LE C ON GO .
3
3 4 LE CONG O
— Je pen se que nous en sommes a tro i s j ours ,
maitre .
Pui s,comme sous l ’ i n fluence d ’une doul eur excè s
s ive, i l murmura
Oh ! dear ! dear !
Et i l retomba dans u n assoup i s semen t pro fond .
Vers mi nu i t,i l rappel a Sou z i et lu i demanda de
l ’ eau chaude et la bo i te de médicaments i l cho i s i t l e
calomel , qu’ i l fi t p lacer auprès de lu i
,et d i t d ’une vo ix
faib le :
C’ es t b i en ; main tenan t vous pouvez vou s en
a l l er .
Ce furen t ses dern i ères paro les .
A quatre heures du mat i n,Madj ouara vi n t trouver
S ou z i .
— Venez vo i r l e maitre,l u i d i t- i l ; j
’ai p eur,j e n e
sai s pas s ’ i l e st vivant.
Sou z i réve i lla les autres serv i teurs, et tous en trèren t
d an s l a chambre .
L e l i t étai t v ide . Agenou i l lé au bord de sa cou
che,la figure dan s ses mai n s posées sur l’ore i ller
,
Livingsto ne semblai t ê tre en pri ère ; e t par un mou
vement i n sti ncti f, chacun d’ eux se recu la .
Quand j e me su is réve i l l é,d i t Madj oura, i l é ta i t
c ommeaprésen t ; e t puis qu’ i l ne remue pas, j
’
a i peur
qu’ i l so i t mort .
Les serviteurs s’
appro cha i en t . Une bougi e co l l é e
sur la tab le par sa p rop re c i re j etai t une clarté suf
fisante pour l e b ien vo i r . I l s l e regardèren t p endan t
q uel ques in stants et ne vi ren t aucun s igne de resp i
LE CONGO .C.:
C?
et l e Loung e , fonta i ne d’
O swald,es t la tê te de Ka
toué ; toutes les deux s’
écoulen t dan s l’E thi op ie cen
trale . Il es t p oss ib l e que ce n e s o i t pas l es quatre
fontai n es don t l e trésori er de M i nerve a parlé‘
a Héro
dote ; mais e l le s n’ en méri te nt pas mo i n s qu’ on l e s dé
couvre,en tan t qu’ e l l es sont p lacées dan s l es cen t der
mi ers des 700 mil les anglai s à k i l omètres)de la l igne de fa i te don t p roviennen t la p lupart des
sources du N i l .
C ’ est ce prob lème que L iv i ngsto ne voula i t ré sou
d re, quand la mort vi nt l e surp rendre .
A pei ne app renai t—on en Angleterre que le cé lèbre
exp l orateur éta i t retrouvé,qu’un l i eutenan t de la
m ar i ne anglai se,Vern ey Lowe t Cam eron ,
offra i t de
vi s i ter la région des lacs et de re lever l e cours du
Loualaba . Su ivan t l a route tracée par ses devanciers,
i l gagna l e Tangan ika et arr iva à. Nyangoué, sur l e
haut Congo . Cameron s apprêtai t à. descendre l e cours
du fleuve, l ors qu’ i l fut arrêté par les exigen ces d
’
un
chef i ndigène .
Pendan t un sej our de p lus de tro i s semaines sur ce
p o i n t , Camero n put s e rense igner sur l e cours du
Loualaba ; vo ic i l e resu l tat de ses observati on s
Tous l es cours d’ eau rencon tré s par une caravane
venant du Soudan se d irigera ien t vers l e Loualaba,qui à. l ’ ouest de Nyang, recevra i t du nord tro i s
grande s r ivières l e L i l oua,l e L i n ndi et l e Lohoua .
Celu i - ci,qui
,d ’aprè s l es ren se ignements que j
’
a i pu
recuei l l ir,sera i t auss i large que le Loualaba à. Nyan
g oué et aurai t deux tributa i res importan ts , nommés
‘
LE CONGO .3 7
tous l es d eux Loul ou , i ne parai t ê tre l’
Ouel lé de
Schwe i n furth .
Les n iveaux don t j ’ a i fai t le re lèvemen t é tabli ssen t
d ’une man ière concluante que le Loualaba n e p eu t
avo i r aucun rappor t avec le N i l, so n a l t i tude a Nyan
goue é tan t i n féri eure à cel l e du N i l a Gondo k oro,
même a cel l e du po i n t où l e fl euve d’
Eg ypte a reçu
tous ses affluen ts .
Une autre preuve n on mo in s déc i s ive e st donnée
par l e déb i t du Loualaba celu i—ci,dans la sa iso n
sèche,roul e a Nyang oué cen t v i ngt mi l l e p ied s cubes
d ’ eau par seconde , où le N i l, dan s le même lap s de
temp s,n e charri e que vi ngt et u n mi l l e p ied s . Le
Loualaba est don c b i en l’un e des têtes du C ongo san s
lu i, Où ce géan t , qu i n e le cède en é no rm i té qu
’
à
l’
Ama z one , peut - ê tre au Y ang— tse—Kiang, trouvera i t- i l
les deux mi l l i o n s de p i eds cubes d’ eau qu
’
à. chaq ue
seconde i l verse dan s l’A tlan t ique ?
E n qu i ttan t Nyang oué, Camero n se d i rigea vers l e
sud , traversa l e v i l lage d e T ipo -T ipo,dans u n pavs
popu l eux ; partou t i l rencon tra i tde g randsv i llag e s bien
bâ t i s,don t les cases trè s p rop res , a l ig nées sur p lu
s i eurs rangs , formaien t de l o ngues rues bordées d’
ar
bres des deux côtés . Tou tes ce s rues,orie ntées de
m ême,coura ien t du nord au sud
,afin qu ’ el les so ien t.
p lus p romp temen t séchées par le so le i l .
D’ abord b ie n reçu par les i nd ig ènes , l e v o vaueur
eu t b ien tô t a se p la ind re de l a cup id ité de s che fs . I l
traversa i t alo rs de s pays entiè remen t dévastés,de s
v i l lag es i ncend ié s, don t tous le s hab itan ts avaien t été
8 3 LE CONGO .
en l evés par les marchands d’
e sclaves . Il arriva enfi n
dan s l e pays de Kassonng o , chef suprême de l’
Ou
roua et en outre,souvera i n de p l us i eurs p eup lades
des bord s du Tangan ika . Pendan t s on séj ou r chez ce
ro i,et aprè s de l ongues p r i ères , i l obt int d es gu ides
p our al ler vi s i ter l e lac Kassali ou Kikondj a ; mai s i l
n e put atte i ndre ses bords , l e s dev ine ayant prévenu
les chefs que s i l e b l an c s’
approcha i t du lac , ses eaux
se tar i ra ien t auss i tô t . Camero n dut s e con ten ter de
regarder l e lac du haut d ’une co l l i n e .
Les gens du Kassali hab i ten t des demeures l aon s
tres,é l evées sur de hauts p i l o ti s au
'
—dessus des eaux
ou des i l es flottan tes . Les îles fl o ttan tes qu’
hab i ten t
les gen s du Kassal i , d i t Cameron , on t pour base de
grandes p i èces de la végétat i o n du lac, p i è ces déta
chées de la masse qu i borde l e r ivage . Sur ce radeau
végétal on a établ i un parquet formé de troncs d ’ar
bres et de broussai l le s ; l e parquet a été recouvert
d ’une couche de terre e t l ’ î l o t s ’ es t trouvé con st i tué .
Les gen s y on t p lan te des banan i ers,pui s bât i des
cases dont i ls on t fa i t l eur demeure permanen te .
Hab ituel lemen t l es i l e s son t amarrées à. des p i eux
e n foncés dan s l e lac ; quand les hab i tan ts veul ent
changer de s i tuat i on,l e s p i eux sont arrachés , et l
’ î l o t
est hal é au moyen de ses amarres qu on va atta
cher a d ’au tres p i eux .
De retour chez l e ro i Kassonng o , Cam eron'
fi t mar
ché avec un mét i s portugai s du nom d’
Alve z,qu i
condui sai t a B ihé une caravan e d ’ esclaves .
Le so i r de mon arrivée,j e reçu s un m essage d‘
un
LE CONGO . 39
tra i tan t portuga i s qu i é tai t dan s l e pays depu i s un an .
Par ce message,Anto n i o Alvez
,que l es i nd igène s
appela i ent Kenndé lé,e t qu i fa i sa i t surtout l e com
merce d ’esclaves,m
’
annonça i t sa v i s i te p our l e len
d emain .
LE LILUTENAN'
I‘
VEItN EY LO \VET CAM ERON .
E n attendan t,j ’ eu s ce l l e d ’une part i e de bande,
une réun i on d ’ê tres gro ss i e rs , a l’
a i r farouche de s
sauvages p resque nus,armés de vieux fus i l s a p ierre ,
don t le s cano n s,d
'
une l ong ueur i n so l i te , é ta ie n t dé
corés d ’un n ombre i nfin i d’
an neaux de cu ivre .
Le lendema i n,Jo sé An ton io A lve z v in t d onc me
4 0 LE CONGO .
v o i r. I l arr iva en grande cérémon i e , couché dans un
hamac surmonté d ’un tende le t,et porté par des hom
mes don t la ce in ture é ta i t garn i e de clo chettes d’
a i rai n .
Derrière l e palanqu in vena i t une es co rte d ’un certa i n
n ombre de mousquets , et l e j eun e garçun charg é du
taboure t et de l’ arme du mai tre
,: u n mauva i s fus i l d e
B i rmingham .
Le voyan t ven i r en s emblab l e équipage , et l’
ayan t
touj ours e ntendu qual ifier de Msoun gou, j e m’
atten
dai s a trouver u n homme de race b lanche qu i p ourrai t
me don ner d ’
uti les ren se ignemen ts . Grande fut ma
décep t i o n quand j e v i s so rt i r du hamac un horri bl e
v i eux nègre .
Certes,i l é ta i t hab i l l é a l’ eu ropéenne , et parlai t
p ortugai s ; mais c’ é ta i t la tout ce qu’ i l ava i t emprunté à
l a civi l i sat i on,b ien qu’ i l s e d i t comp l è temen t c iv i l i sé
,
à l ’ égal d ’
un Angla i s,ou de tout autre i ndiv i du à. l a
peau blanche .
Aprè s s’
ê tre mi s d ’accord avec le tra i tan t,Cam eron
s ol l i c i ta une audience d u ro i pour p rendre congé ; mai s
le ro i venai t de parti r p our un e expéd iti o n,et
,avan t
d e s e mettre en route,le voyageur et le tra i tant duren t
attendre l e retour du souverai n ; cel u i—c i ren tra l e 21
j anv i er 18 75 mai s ce n ’ es t que l e 25 févr i er que l e
convo i put s e mettre e n marche .
Pendan t ce long s éj our forcé dans les E tats de
Kassonng o , Camero n put é tudier l es populat i o n s de
l’
Ouroua, et l eur o rgan i sat i o n soc ial e , qui para i t
p lus avancée que dan s l es autres nat io n s du bas s i n
du Congo .
LE C 0 NGO . 4 1
Cette vas te co ntrée,d i t l e voyageur
,se d iv i se e n
un g rand n ombre de d i s tri cts , gouvernés chacun par
un Ki lo lo ou cap i ta i n e . Quelques—uns de ces g ouve r
neurs on t un pouvo i r héréd i ta i re ; l es autre s son t
nommés pour quatre an s . A l ’ exp i ratio n de ce terme ,s ’ i l s on t b ie n remp l i leurs fo ncti o n s
,i l s peuven t
ê tre renommés,so i t dans l e même d is tri ct
,so i t
ai l leurs . S i Kassonng o n’
es t pas conten t d ’ eux,i l l eur
fai t couper l e n ez,les ore i l l es ou les mai n s .
La hiérarchie soc ial e e s t fortem en t é tab l ie, e t une
déférence e st exigée des i n féri eurs . J’
e n a i eu de
nombreux exemp les,don t l ’un surtout m ’ a b ie n
frappé . Un homme de cond i tio n , en causan t avec
mo i,v i nt a s
’ asseo i r,oub l ian t qu ’un de ses supé r ieu rs
é tai t la immédiatemen t i l fu t pri s a part et chap i tré
sur l’ éno rm i té de son o ffen se . J’
appr i s ensu i te que s i
j e n ’ava i s pas é té so n i n terl ocuteur, i l eû t payé de
ses deux o re i l les la faute qu’
i l ava i t comm i se .
On ne conna i tdans l’Ouroua que deux châtimen ts
la muti lat i o n e t la pe i n e de mort . toutes les deux fort
e n usage , surtout la p rem iè re . Pour la mo ind re pec
cad i lle, l e che f e t ses l ieutenan ts fo n t couper un
d oig t , une lèvre , u n morceau de l’
o re i l l e ou du ne z .
Pour les fautes p lus sér ieuses , i l s p rennen t le s ma i ns ,l e s ore i l l e s
,l e ne z
,les orte i l s , e t souven t tou t e n
s emble . Kassonng o ,comme ses prédé ce s æ urs
,s
’
ar
roge des honneurs d ivi ns . I lse d i tau —de ss us de s néces
s i tés de l a v ie e t p ré tend qu’
i l n’
a pas beso i n d e
nourr i ture s ’ i l mang e , s’
i l bo i t , s’
i l fume,c
’
es t tou t
s imp lemen t parce qu’ i l y trouve du p la i s i r.
42 LE CONGO .
Tou s les hommes du pays fon t l eur feu et l eur cu i
s i ne eux—mêmes l e ro i es t l e seul qu i échappe à cette
règle ; mai s s i son cu i s i n i er s’
ab sen te , c’
es t lu i qui
p répare son d îner . I l e s t également d ’usage que cha
cun p renn e so n repas tou t s eul aucun de ces i ndigè
nes n e permet qu’ o n l e regarde mang er ou bo i re .
Quand on l eu r o ffre de la b ière,i l s demanden t qu’ on
dépl o i e devan t eux une p ièce d’
étoffe . I l s t i ennen t par
des sus tout à. n ’ avo i r pas de femmes pour témo in s .
Outre Alvez , l a co lonne se composai t enco re de
p lus ieurs mét i s p ortugai s en tre autres un certai n
Co imbra qu i n e cessai t d importuner l e voyageu r
de ses demandes,e t qu i lu i o ccas i o nna mi l l e désag ré
ments pendant la route .
Après quel ques j ours de marche, nouve l arrê t, qu i
s e p ro longea jusqu’ au 10 j u i n . Le 2 7 jui l le t,l e convo i
pénétra i tdans l’
Ou lonnda,con trée étro i te
,peupeup lée ,
où les vi l lages son t p et i ts et fort é lo ignés l es uns des
autres ; l e s o l e st en parti e couvert d’
épa i sses forêts .
C ’ es t en traversant cette reg i on, que Camero n s e
donna une en to rs e qu i l’ob lig ea a s e fa ire porter dans
son hamac pendan t p lus ieurs j ours .
Duran t toute la route,l e voyageur fut témo in des
a ffreux trai tements i nfl igés aux esclaves , et surtout
aux femmes . Mai ntes fo i s,sur la route , j
’avai s é té
navré de l’horr ible cond it ion d e ces malheureuses qu i ,accab lées de fat igue
,a demi -mortes d e faim
,étai ent
couvertes de p la ie s résu l tant d e l eurs fardeaux e t des
coup s,de s b lessures qu i l eur étaien t i nfl igés p our
act iver l eu r marche . Le s l i en s qu i l es retenai en t pene
LE CONGO . 4
tra ien t dan s leurs chai rs,qu ’ i l s avaien t rong
‘
ées . I l en
é ta i t a i n s i pour tous l es capt i fs . J ’a i vu une femme
continuer a porter l e cadavre de son en fant mort dan s
ses bras .
Après avo i r travers é l e pays de Lovalé , franchi l a
r ivière C oen z a , qu i va se j e ter dans l’
O céan,un pe u au
sud de Sain t -Paul de Loanda,Cameron ar “iva a B i hé
,
où i l resta que lques j ours , pu i s i l repri t sa route vers
l’
Océan,au mi l i eu de souffrances atro ces , m i né par la
fièvre et l e scorbut,mourant de faim ; un j our enfi n ,
l e voyageur s e tra îna j usqu’
au sommet d’
une ém i
nence,d
’
où i l aperçut C atombe la
Je descend i s,e n couran t
,la pen te qu i s ’avance
vers Catomb ela, agitan t mo n fus i l au- dessus de ma
tête,que la j o i e avai t tournée . Sous l ’ i n fluence de la
même ivresse,m es compagno ns me suivi ren t ; nous
courûmes a i n s i jusqu ’ aux approches de l a v i l le . La ,
j e clép loya i mon drapeau ,et nous avançâmes p lus
tranqu i l lemen t .
Deux l i t i è re s su 1v1es de tro i s hommes portan t des
pan i ers remonta ien t l a route ; quand e l l e s furen t p rès
de nous rej o indre,un pet i t França i s a l
’
ai r j oyeux
sauta de sa maxi l la, pr1 t un de s pan iers , e n t i ra une
boute i l le,l a déboucha e t bu t au p rem ier Européen
qu i eût travers é l’
Afr i que trop i ca l e d’
o r i e n t e n o cc i
den t » .Je devais ce t accue i l chaleureux .\ I . C aucho is ,
ancie n offic ier de l a mari ne frança i se , é tabl i a Ben
guela .
A son retour en Europe , Camero n fut accue i l l i ave c
en thous iasme l’
Ang le te rre l u i re nd i t de s honneurs
46 LE CONGO .
pres que royaux . La Socié té de Géographi e de Lon
dres l ui décerna en 1876 sa grande méda i l l e d ’ or . La
France auss i vou lut rendre un hommage à. ce grand
voyageur en 1877 , l a So ci été de Géographi e de Pari s
l u i envoya la médai l l e d ’ or,et l e min i s tre de l’ instruc
t i o n publ i que lu i d onna l es palmes d ’ offici er de l’Un i
v ers i té . Dès 1877,Camero n
,promu au grade de com
mandan t dans la mari ne b ri tann i que , a repri s s on
serv ice .
Vo ici ce qu’
écr i t Camero n de la r ichess e du bass in
du Congo qu’ i l a traversé
Presque tout l e pays,du Tangan ika a l a cô te occ i
dental e, e st d ’une r i chess e i ndes cr ip tib le . Parmi l e s
métaux , o n y trouve le fer, l e cu ivre , l’argen t et l ’o r
o n y trouve auss i de l a hou i l l e . Les p rodu i ts vég é
taux son t l ’hui l e de palme,l e coton
,outre que lque s
e sp èces de café et de po ivre . Les habi tan ts cul
t ivent beaucoup de p lan tes o l éagineuses,te l l es que
I’
arach ide et la sen i—s en i . Auss i l o i n que les Arabes
o nt pénétré,i l s o nt i n trodui t l e r i z
,l e froment
,l ’o i
gno n et quelques arbres fru i t i ers qu i para i s sen t
assez b i en réuss i r .
Les con trées de Bihé et Ba i lounda son t ass ez
é l evées pour comp orter une o ccupati o n européenne ;e l le s p rodui ra i en t tout ce qu i p eut ê tre cult ivé dans l e
mid i de l’Europe . Les orangers que Jenhor Gonçalve s
a p lan tés a Bihé,où i l a passé p l us de tren te an s
,
éta ient p lu s beaux qu’aucun de ceux que j ’ai vus en
Europe .Les ro s iers et l es vignes ava ien t p oussé d ’uneman ière
LE CONGO . 49
Le cen tre de l’
Afri que pré sen te un système
hydrograph ique suscep t ib l e d ’ ê tre uti l i s é pour l e
commerce,e t te l qu ’ on n
’
en trouve de pare i l nu l l e par t
a i l l eurs A l ’ es t du pays de Lovalé,i l exi s te des
quant i té s é tonnan te s d ’ ivo i re ; chez les marchands
musulman s de Nyang oué , l e p r i x éta i t de 2 15 m i l l i
grammes de verro ter i e ou 143 mi l l igrammes de coqu i l
l ages marin s appelé s Cyp r ea m on e ta,par k i logramme
d ’ ivo i re . Les caravanes qu i partai e n t de ce p o i n t,en
quête d ’ ivo i re,acheta i en t u ne den t c ’ é l éphan t
,quel que
fû t son po ids,pour un v ieux couteau
,un bracel et d e
cu ivre,ou p our tout autre obj et i nuti l e qu i p ouvai t
sédui re les ind igènes .
La tache honteuse de ce beau pays,c’ es t que la
tra i te des es c laves y pers i s te , qu’ el l e e stmême la base
d ’affa i res co n s idérab l es,act ivées par la n écess i té de
combler les vide s des pays dép eup lés par l ’ancie n
commerce des esclaves sur la Le seu l
moyen de la fai re d i sparaî tre , c’ es t d ’ ouvri r l ’Afr i que
à. un commerce régul i er, e t dans ce bu t , le m i eux
sera i t d ’uti l i ser l e magn ifique réseau des fleuves e t
des r ivi ères de l ’ i n tér i eur .
Les nat i on s c iv i l i sée s de l’Europe trava i llen t actue l
l emen t a réali ser le vœu fo rmulé en 1876 par Cameron .
LE C ON GO .
52 LE CONGO .
S i n ous vous chargion s de résoudre ces d i ffé
rents prôb lèmes ! pen sez—vous pouvo i r y arriver ?
Avant ma mort, i l y aura i t quel que chose de
fai t,et s i j e vivai s le temp s nécessai re à. l’accomp li s
semen t de ma miss io n,tout sera i t fin i .
M . James Gordon Bennett ayan t à. mes servi ce s
des dro i ts an tér i eurs,la dépêche su ivan te fut expéd iée
à. N ew—Y ork
M . Bennett voudra i t- i l s e j o i ndre au Da i ly Te le
graph pour envoyer Stan l ey en Afri que complé
ter les découverte s de Burton Specke et L iving
stone
Mo ins de vingt- quatre heures aprè s , mon voyage
étai t décidé par cette courte répons e lancée sous
l’
Atlant i que
Bennet t
Le 12 novembre 1874 , Stan l ey quitta i t l’ i l e de Zan
z ibar avec un e parti e de ses recrues , et cinq j ours
p lus tard, l e 17, i l s’
é lo ig nai t de Bagamoyo a l a tête
d ’une caravane composée de tro i s cen t cinquan te—six
ind iv idus de race no i re,e t de tro i s Européen s
Baker,Frank et Edouard Pococ k .
Nous n e su ivron s pas S tan ley dans son voyage de
la côte ori en tale de l’
Afr i que au Tangan ika : ce sera i t
trop nous écarter de notre suj et . Qu ’ i l nous suffise
de d ire que la route fut p én ib le,qu ’ i l eut à. souten ir
p lus i eurs combats co ntre l es i ndigènes,à. surmon ter
des d ifficul tés,à. vai ncre des obstacles qu i eussen t
fai t reculer les hommes les mieux trempés de p lus,
LE CONGO . 53
i l eut à dép lo rer la mor t de deux Europée n s,Edouard
Pocock e t Baker .
Le 27 mai, S tan l ey arrivai t avec sa troupe a O udj ij i ,s’
y repo sa i t quelques j ours, e t l e 13 j u i n ,la i s san t se s
hommes sous l es o rd res de Fran k,i l parta i t avec
remu e r. DE LA Lady A l i ce .
o n ze cano ti ers pour fa i re le tou r du Tangan i k a,
sur so n bateau , l a Lad y A li ce ba teau spé c 1a l, con s
tru i t a Lo ndres sur le s p la n s du vo y ageur ; cette
embarcat i o n , q u i po uva i t co n ten i r u ne tren ta i n e
d’
hommes , s e démo n ta i t e n p lus i eu rs mo rceaux e t
é ta i t po r té e ù de s d’
homme s depu is le départ de l a
54 LE C ONGO .
cô te . La barge é ta i t u ne de m es i nven t i ons . Fai te en
bo i s de cèdre de tro i s hu i t ièmes de pouce d’
épa is seur ,e l l e au rai t quaran te p ieds de l o ng
,s i x d e large, deux
et dem i de p ro fondeur . Quand el l e s era i t fin ie , o n la
d ivi sera i t en s ix fragments ; s i l e s sect i on s é ta ien t
trop l ourdes,on les s c iera i t par la mo i ti é p our les
rendre portatives .
La Lady A li ce, montée par son équipage ord i na ire ,
fut l an cée sur l e lac. L’
i nsolen te pet i te barge, qu i a
fou i l l é tou s l es p l i s du Victor ia,s’
écr i e S tan ley, fran
ch i le s p la i n es et l e s rav i n s de l’Ounyoro fi l é ga i e
me n t sur l es peti ts lacs brun s du Karag oue , pas sé les
r iviè re s à. crocod i le s d e l’
Ouv i nn z a , es t ma i n tenan t
su r les eaux bleues du Tangan ika .
Le 3 1 j u i l l e t , S tan ley revenai t à Oudj ij i , ap rès une
absence de ci n quan te et un j ours,pendan t les qu el s
i l avai t parcouru p lu s de hu i t cen ts mi l le s , exp l o ran t
l e lac dan s tous se s rep l i s . Ce qu’ i l chercha it sur
tout , c’
é ta i t le déverso ir des eaux du lac , parce que ,
en su ivan t l e déverso i r,i l étai t sûr d ’ atte i ndre le
grand fleuve ; un in s tan t i l cru t l e trouver dans la
r ivière Loukonga . Rapp rochés de l’asser tion de Came
ro n,écr iva i t—i l, tou s les ren se ignements que j e
recue i l l e sur cette r iv ière,cette cri que ou cette e n trée
,
so nt i ncomp réhen s ib les . Les v ie i l lard s et l es chefs
d i sen t d’un e man ière formel l e que l e Loukouegha i,venant de l ’ es t, rencon tra jad i s la Lou k onga , venan t
du couchan t,et que de leur un io n naqu i t l e Tangan ika .
La bon ne i nte l l igen ce ava i t touj ours régn é en tre l es
deux époux ; mais i l para i t que , depu i s quelque temp s .
LE CONGO . 53
l a Loukonga a des capri ces . des bouderi es ; e n
d’
autres termes , que pendan t la sa ison p l uvi euse el l e
apporte a u lac une grande quanti té d’ eau ; pu is , que ,
dan s l a sai son sèche , el l e va a l’ occide n t e t rou le ver s
l e Kamo lonndo, sous l e nom de Rou i nd i ou Lou i nd i .
Jusqu’ au mo is de mars 1876 , un ban c de terre ou
de vase , de p lus i eurs cen tai nes de p as d e large , sépara i t , d i t -o n , l e Lou i ndi de la Loukouga ; mai s les p lu i e s
de la même année réun i ren t l es d eux riviè res de la,
un confl i t d ’ op in i on s . Le che f p ré tend qu ’ i l me fera
vo ir,à. n ’en pas douter, l
’
eau se di r igean t vers le lac,
et au s s i l ’ eau coulan ten s en s con tra i re . I l e st éviden t
qu’une cri se dan s la nature des choses s e p répare
ou qu ’ el l e est en tra i n de s ’opèrer
Le lendemai n , M . S tan ley ten ta lu i -même l’ expér ien ce une baguette j etée dans la r iviè re fut e ntra in éc vers l’ ouest ; mai s , ayant renouve lé l ’es sa i
l e 17 , i l trouva au contraire que l e couran t rame
nai t l a baguette vers l e lac . Cependan t,M . S tan l ey
res ta co nvain cu qu’
au trefo i s l a Loukouga é ta i t l e de'
verso i r du Tangan ika ; que , par su i te d’une baiss e
su rvenue dan s l e n iveau des eaux du lac,ce déverso i r
avai t ces sé u n i n s tan t d ’ ex i s ter,mais que ,«m a i n te na n t
que la grande auge p rodui te par le tremb lemen t de
terre qu i fractura l e p l ateau,commence a déborde r
,
l a Loukouga va rep rendre so n ancie n rô l e d‘
ém issa i re
et convoyer l e trop —p le i n du Tangan i k a dan s l a va l lée
de l a Loua laba, d’
où la r iviè re de Livi ngsto n e l e pe r
tera dan s l’A tlan tique
D ’ aprè s les calcu ls fa i ts par M . S tan l ey pendan t
56 LE CONGO
cette navigat ion , l e Tangan ika mesure en l ongueur
tro i s cen t v i ngt- neuf mi l l e s géographiques (six cen t
neuf ki l omètres ) . Sa larg eur var i e de d ix à. quaran te
c inq mil l e s en moyen ne, ce qu i donne une superfici e
de neuf m i l l e deux cen t quaran te mi l le s carrés
k i l . carrés) . Dan s un s ondage fai t au cen tre du lac ,la sonde n ’a pas touché le fond à. douze cen t quatre
v i ngts p i ed s .
A son retour a Oudj i j i , Stan ley trouva son esco rte
déc imée par un e ép idémie de peti te- véro l e,et son l i eu
tenant Frank Poc-ock trè s malade de la fièvre . I l fal
l ai t qu i tter au p lu s vite ce foyer d’
i nfecti on‘
: l e 25
août,i l se rem ettai t en marche e t arr ivai t l e 12 o ctobre
au sommet d ’une rampe,d
’
où i l découvrai t l e Loua
laba .
Le mystère que depui s tan t de sœcles l a nature
cachai t à. l a sci ence attendai t qu’
on le dévo i lât . J ’ avai s
su iv i la Louam a pendan t deux cen t v ingt mi l l es j e
l a voyai s s ’un i r au fl euve superbe don t e l l e con st i tue
l’
une des sources ma tâche éta i t mai n tenan t de su i
vre l e fleuve,de le su ivre jusqu’
à l a m er .
Pendant p lus ieurs j ours,S tan l ey dut res te r a
Mouana Mammba,dan s l ’ impos s ib i l i té de poursu ivre
sa route , éprouvan t de la part des chefs la meme
oppos it i on que Cameron . Là,le mêm eTipo
—Tipo,que
Stan ley appel le Tipou—Tib,fai sa i t de s d ifficul tés pour
lu i fourn ir l’
escorte nécessa i re a la co nt i nuat i on
de son voyage i l essayai t par tous les moyen s de lu i
faire abandonner son proj et de des cendre l e fleuve,e t voula i t l
’
emmener par la route su ivi e par Cameron .
LE CONC O . 57
Enfin,à. des cond it i on s fort onéreuses , S tan ley obtin t
le nombre de porteurs i nd i spensab le e t l’ escorte com
mandée par Tipou en personn e ; mai s avantde s igner
l e tra i té e t d ’accep ter l e s clauses l eo n i nes que lu i
imposai t l e tra i tan t,i l vou lut con su lter son ami et
l i eutenan t Frank Pocock .
Aprè s l e d i ner,ayan t
,comme à. l ’ ord inai re , versé
l ’hui l e de palme dan s deux pots,où éta i en t des
mèches de coton, j
’
alluma i l es lampes,et
,en tre la
p ipe e t l e café,que nous p ren i on s touj ours en semb le
,
j e d i s a Frank
J ’a i à. vous parler de choses séri euses : no tre
dest i née , cel l e d e tous nos hommes dépend de la déc i
s i o n que j e vai s p rendre .
Je lu i racon ta i alo rs où j ’ en é ta i s avec Tipou ; j e
lui montra i tou s les péri l s qu i n ous attendaien t ; j e
lui rappela i tous ceux que nous avi on s courus ma is
a uss i l a man iè re do nt nous le s avi on s surmon tes .
E t mai ntenan t,Fran k
,quel l e e st vo tre op i n i o n
E n avan t ! d i t— i l.
Réfléchi s sez , mon ami la chose es t grave . N e
pourrio n s - nous pas exp lorer l e pays qu i e st au levan t
d e la route de Cameron ?
Oh ! Mons ieur,r i e n n ’ est tel que la r iv 1ere .
Mai s l e L inco ln,l e Kam o lo nndo
,l e Bemmba
toute l a con tré e qu i va jusqu’
au Zambeze ?
Ah ! c ’ es t u n beau champ d'
exp l orati o n ,e t peut
ê tre l es i nd igènes ne son t- i ls pas auss i fé roces .
Oui,mais
,comme vous l e d is i e z tou t a l
’
heure ,ri en n ’est te l que cette én orme riviè re qu i coule pe n
1 3
0 0 LE CONGO .
dan t des cen tai nes, peut—être des mi l l iers de mi l les ,don t on n e sai t pas un mot . Imagi n ez , par exemple,qu’ ayant acheté ou co nstru i t des canots
,nous des
cend ions l e fleuve , e t nous arr ivio n s so i t au N i l,so i t
à. un grand lac s i tué vers l e n ord,so i t
’
a l’O céan .
Quel b i en fai t pour l’Afr i que ! Vous figure z - vous des
s teamers remontan t l e Congoju squ’
au lacBemmba,re
montan t toutes les grandes r ivières que reço i t l efleuve
Eh b ien Mon s ieur,à. p i l e ou face.
Vo i là. une roup ie face pou r la riwere ,p i l e pou r
le sud .
Frank tend i t s a main,sa figure rayonna i t. La
p iè ce retomba .
Pi l e ! d i t Frank d’ un ai r désappo in t
Recommençons .
Même résul tat s ix fo i s p i l e !
Tiro n s‘
a la courte pai l l e,Mon s i eur.
Très b ien l a courte pour le sud,l ’autre pour le
Loualaba .
Le sud gagna touj ou rs .
I nut i l e de cont i nuer, Frank su ivon s notre des
t inée , en dép i t du sort . Avec votre aide, j e descendra i
la r ivière .
Comp tez sur mo i,M . S tan ley .
Le 5 novembre 1876, l a co lonne se mettai t en mar
che vers la sombre forê t du Manyena, qu i commence
au bord du fleuve et décri t un e courbe vers l e sud
es t , où el le va se perdre à. l’hori zon . La caravan e
su iva i t la r ive dro i te du fleuve,afin que la courbe que
6 0 LE CONGO .
che à. travers bo i s et j ungle,l a fatigue, l e s pr ivat ion s,
les sou ffrances qu i en résu l ta i en t,amenai en t la ma
lad ie . Il fal lut embarquer les i nfirm es dan s de
vi eux canots abandonnés qu’ on répara a l a hâte . Pui s
v inren t les premiers rap ides ; l es embarcat ion s
éta i en t m i ses à. sec sur la r ive,portées de l ’autre
cô té de la chute et rem i ses à. flot ; mais l es popula
tion s s e montrai en t ho st i les : tan tô t,montés dan s
d ’ immen ses p irogues,l e s i nd igènes es s
‘
ayai en t d ’ar
rêter l es voyageurs ; tan tô t , embusqués dans l es épai s
fourrés qu i borden t l e r ivage,i l s at taquai en t les
hommes p endan t l e portage des cano ts p our évi ter
l es cataractes . I l fal la i t s e frayerun chemin et repous
ser a coups de fus i l s l es féro ces assa i l lan t s .
Après quelques j ours,S tan ley dut s e convaincre
que l e chemin du bord du fl euve n ’ é ta i t p lu s p rat i
cab le . Tip ou et l’
escorte qu’ i l commandai t venaien t
d’
abandonn er la co l on ne . Stan ley,rédu i t à s es p ropres
forcé s,au mil i eu d ’une p opulat i o n nombreuse
,n e
pouvai t d iv i ser sa troup e ; i l acheta donc vingt—tro i s
canots,y embarqua tou t so n mo nde et repri t sa route
vers l ’ inco n nu .
A part ir de ce j our,ce furen tdes combats cont i nuel s ;
l e fleuve,encombré d ’
îles hab itées,s e couvrai t de
grandes p i rogues de guerre qui attaquai ent la flo tt i l l e
de S tan ley b ien souvent,i l pu t évi ter un e nnem i trop
nombreux en s e d i s s imulant derr ière les i les mai s
b ien souven t aus s i i l dut l ivrer bata i l le.
Le combat l e p lus terr ib le fut celu i des bouches de
l ’ ArouW1m i
LE CONGO . 6 1
Le nombre des can ots ennemi s es t de ci nquante
quatre , écri t S tan ley ; l’un d ’ eux a sur ch aque bord
quarante rameurs qu i pagayent debout, au son d ’un
chan t barbare c ’es t lu i qu i condu i t laflo tte . A l’ avan t e stune p late - forme qui p orte d ix j eunes guerri ers co i ffés
de p lumes cramo i s i e s de p erroquet a queue rouge .
Hui t hommes p lacé s à. l ’arrière gouvernen t l ’ embar
cati o n avec de l ongues pagaies . E ntre ces deux grou
pes , dix p ersonnages qu i para i s sen t être des che fs ,exécuten t une danse guerri ère . Toutes l es pagaies
s on t surmon tées de bou le s d’
ivo ire tous les bras on t
des anneaux,égalemen t en ivo i re
,que chaque mou
vemen t fa i t br i l l er ; toutes l es têtes son t couronnées
de p lumes .
« Le bru i t é crasan t des tambours,celu i de cen t
trompes d ’ ivo i re,l e chan t de deux mi l l e vo ix sauvag e s
n e son t pas fa i ts pour calmer nos ner fs ; mais nous
n ’ avon s pas l e temp s d ’y penser . Le grand canot se
précip i te ve rs n ous, les autres l e su iven t , fo n t ja i l l i r
l’
écum e autour d ’ eux .
E nfants,tenez ferme
,attendez l e p remier coup
,
et aprè s ce la,v i se z j uste !
Le canot monstre fo nd vers l a Lady A l i ce , qu Il
semble vou lo ir couler pu is,arrivé a moin s de vingt
c inq bras ses,i l se détourne e t lu i envo ie une bordée d e
lances . Tous les b ru i ts so n t couverts par la fus i l lade .
Qu’
arr ive —t - i l ? N ous sommes trop abso rbés par
le grand canot pour le savo i r ; mais, au bout de c in q
m inutes,nous voyo ns l ’ ennemi refo rmer ses l ignes en
avant . Notre sang boui l lo nne . Nous l evo ns l’
ancre e t
62 LE CONGO .
nous les poursu ivo n s . A un détour de l a r iv1ere , nous
voyons leur v i l lage . I l s on t abordé,nous gagnons la
berge,n ous nous batto n s dans l es rues, nous en
chasso ns l ’ enn emi ; ce n ’ es t qu’ap rè s l’
avo ir rej e té
dans les bo i s qu’ o n son ne la retrai te .
L’ exp éd i ti o n l ivra a ins i tren te - deux combats avan t
d ’ atte indre un endro i t où l e fleuve s ’ é largi t sub i te
men t et forme un étang immense ; Frank Pococ k l’
ap
pela S tan ley - Poo l,e t donna le n om de Dover C l i ffs aux
c o l l i n es qu i l ’ en touren t . On étai t au 12 mars 1877 .
Le 12,d i t S tan ley
,l a r ivière s ’ é largi t par degré s
jusqu ’
à former une nappe que m es hommes qua
lifièren t du nom d’
é tang ; en face de nous,des î le s
sableuses formaien t une espèce de p lage à. dro i te ,une lo ngue fi le de rochers b lan cs , pare i l s aux falai ses
de Douvres , é ta i t couro nnée d’
herbag es qui la fa i
sa i en t te l lement ressembler aux dunes du Ken t,que
Fran k s’ écri a avec en thous iasme C’ es t un co i n de
l’
Ang leterre ! I l pr i t ma lunette,escalada la parti e
la p lus haute des dunes,examina ce curi eux endro i t
e t v i nt me trouver .
C’
es t b ien un étang,me d i t—i l ; un bass i n en touré
de montagnes .
E t comme j e l e p ria i s ,de le bap t i ser
,i l demanda
pourquo i o n n e l’
appellera i t pas E tang de S tan ley ,
e t ses co l l i nes Dover C l i ffs
Plus tard, m e rappelant ces paroles, j’a i conservé
l e nom de Stan ley a cette expans io n lacustre du
fleuve .
Un m O i s ap rè s , pour franchi r l es chutes de l’ Im
LE CONGO . 65
ki ss i,i l fal lut mettre l es canots a terre e t fai re un por
tage sur u n p lateau de douze cen ts p i ed s d ’ élévatio n .
C e j our- là,la Lady A li ce , montée par S ta n l ey e t son
brave patron Ouledi , fai l l i t s e perdre dan s la cata
rac te .
Le 10 avri l,nou s sortio n s de la bai e d e Gammfoué ,
ayan t devan t nous l e rap id e auquel la Lady A l i ce a
donné son nom . I c i l a r ivière,aprè s avo i r fa i t un sau t
qu i précip i te sa course,rencon tre un i l o t de gran i t
tran sversal . Arrêté par cette d igue,le flo t se rue de
chaque côté en vagues hori zon tales , qu i v i ennen t s e
heu rter au cen tre,et qu i
,mon tant le s unes sur les
autres , forment une rampe écumeuse .
Des câb les trè s forts furen t attachés à. l’avan t e t a
l ’arri ère du bateau, où j’
entra i avec ci nq de mes
hommes . A notre dro i te,un entassemen t a p 10 de
b lo cs énormes s e terminai t a tro is cen ts p ied s d ’ é
levat ion , par une terras se ; derrière l es banquettes
s’
élevai en t des co l l ines, soutènemen t du p lateau qu i
dominai t l e fleuve d ’une hauteur de douze cen ts p ieds .
Sur la gauche , a une d i s tance seulemen t de deux
cen ts brasses,se dressa i t u ne prod ig i euse fa lai s e cou
ronnée d’
une forêt , e t flanquée , a sa base , d’une l ig n e
de tro i s îlots rocheux, co ntre les que l s l e fleuve a l la i t
se bri ser en l ames mugi ssantes .
A pe i ne approch ions- nous des rap ides , que, par
su ite d ’un relâchemen t du câb le de l’ arrière
,l e cou
ran t arracha le bateau des mai n s de ceux qu i le re
tenaien t .
A vo s rames , enfan ts Ouled , au g ouve rna i lL E C ONG O .
66 LE CONGO .
Debout a l ’avan t , j e l e guida i s de la main l a vo ix
n e pouvai t l utter co ntre l e tonnerre des chutes.
Jamais rochers n ’ on t été p lus hauts,plus sourci l
l eux j amai s i l s n’ o nt révé lé p lus d ’horreur qu’ en ce
mom en t où la Lady A l i ce, j ouet de l a furi e des
eaux tourb i l lo n nan tes , é tai t fouettée comme une
toup i e,lancée d
’
un cô té à. l ’autre,p l o ngée dan s un
gouffre qu i la rej etai t sur une crête b lanche,d ’ où el l e
retombai t dan s l e gouffre su ivan t . Quel l es s ensa
t i on s p roduites en nous par ce tte force imp lacab le !
Quel s éclai rs j eté s dan s notre passé ! Quel s en ti
ment de n otre impu issance !
Tout à coup ,u n brui t s ourd
,pare i l fa ce lu i
d ’un tremb lem en t . de terre , n ous fi t regarder en bas
l e fl euve se g onfla i t comme s i u n vo l can eût soulevé
ses eaux . La barque monta au sommet du tertre l i
quide devi nant ce qu i al la i t avo i r l i en,j e cr ia i
Nagez Des coup s de ram es fré néti ques nous firen t
descendre l e monti cule ; et avan t qu’ i l fût remp lacé
par l ’ entonno i r hab ituel , nous éti o n s emportés en aval
des rap ides .
Quelques j ours auparavan t,un canot m ont é par
Kaloulou ,l e p référé de S tan ley , étai t englout i dan s un
précip i ce, et tout son équ ipag e noyé .
Le 3 j u i n , Fran k , qu i souffrai t horr ib l emen t de la
fièvre e t d’une b lessure au p ied, s e fi t
,malgré l a dé
fense de Stan ley, porter dan s l e cano t l e J ason . Ma
noua Sera , O uled i , tout l e monde l’avai t suppl ié de ne
pas s’ ave nturer
,l u i i nfirm e
,dan s cette mauva i sepasse .
Mais i l les avai t repoussés avec l ’ impatie nce d’un ma
LE CONGO . 00
l aci e ; et i l étai t parti . A Massassa,O uled i ayan t es ca
lade l a falai s e,é tai t revenu d i re qu’ i l n ’y ava i t pas
moyen de passer . Frank n ’ avai t pas voulu l e cro i re,
e t sîi rr i tant des obj ec ti on s qu i l u i é tai en t fai tes , l u i
qu i jusque—la n ’ avai t pas trouvé de termes asse z forts
pour fai re l ’é loge de ceux qu i l’
accompagna i en t, l u i
avai t rép ondu
S i j’
avai s avec mo i des b lan cs, nou s pas ser i o n s
mai s vous avez peur .
Pet i t maitre,ava i t rép l iqué Ouled i p iqué au vi f
,
vo ici mes mains ; j e n’ai pas assez d e do igts pour
compter l e n ombre d ’hommes que j ’ a i sauvés de cette
rivi ère ; commen t p ouvez—vous d i re que j’
a i peur ?
E t se tournan t vers ses camarades
La mort e st là. : voul ez -vous m on trer que les no i rs
saven t mour i r comme le s b lancs ?
La répon se avai t é té unan ime .
L ’ ins tan t d ’après,i l s é ta i en t emporté s vers les chu
tes . Béve i llé de so n i l lus i on par l e tonn erre cro i ssan t
de la cataracte, Frank s’
étai t l evé . Le momen t d’
an
go i sse et de regrets éta i t venu .
Tenez -vous au cano t,prenez l e câb le, te nez
ferme ! cria i t— i l e n déch iran t sa chemis e pour nager
p lu s l ibremen t .
Avant qu ’ i l l’ eût arrachée,l e canot é tai t dan s l ’ a
b ime,qu i se refermai t sur l u i . Pui s u ne vague avai t
remon té du gouffre, ramenan t l e J ason , auque l se
cramponnaien t des hommes su ffoqués .
Lorsqu ’ i l s ava ien t repr i s l eurs sen s,i l s n e ta ie n t
p lus que hui t .
70 LE CONGO .
Tout a coup,p rès d ’ eux
,avai t surgi une nouvel l e
masse d ’ eau,soutenant un e forme humai ne d ’ où é tai t
sorti un gémissemen t . Oubl ian t l e tourb i l l o n qui v e
nai t de l e sai s i r,l a m ort
’
a laquel le i l venai t d’
é chap
p er , Ouledi s’ é ta i t précip i té
,l es b ras é tendus
,vers ce
corp s flottan t mais,avant d ’avo ir pu l
’
at te i ndre,_O u
l ed i é tai t ressai s i par l e gouffre . L’
ab ime l ’avai t rej eté
une seconde fo i s,et
,défai l lan t, i l ava i t regagné l a
r ive,sans avo i r r evu Frank .
Cet événemen t tragi que p l o ngea S tan l ey dan s un
mem e désespo i r,dont put seul e l ’arracher l a n éces
s i té de pourvo i r au salut de sa troupe,et de lutter
contre l e découragement qu i s ’ empara i t des hom
mes de l’e'
scor te ; p rès d’atte indre l e but
,i l s r efusa ien t
d ’al ler p l us lo i n .
Enfin,l e 4 août
,ap rè s tren te -deux m o i s de marche
,
l es débri s de l ’ expéd i t i o n arrivèren t à N ’
san nda . S tan
l ey réso lut de s’ arrê ter la et d ’ envoyer une l e ttre a
Emmboma, peti t é tab l i s semen t européen . I l é cr ivi t
l a l ettre su ivan te'
A n im p or te que l gen tlem an rés i dan t à E mm bom a
e t comp ren an t l’
an g la i s .
V il lage de N ’
san nda,4 aoû t 1877.
CHER MONSIEUR ,
J ’ arr ive de Zan z ibar avec cent qu i n ze person nes ;nous mouron s de faim ; les i ndigènes refusent
no tre éto ffe,no s perles
,no tre fi l métal l i que ; c
’ es t
LE CONGO . 7 1
poùrquo i j e m’
adresse à. vous . Je n e vous connai s
pas,mai s j ’entends d i re qu ’ i l y a a Emmboma un
Anglai s ; en votre qual i té de chrétien et d e gentl e
man ,vous ne repousse re z pas ma requê te . J’
a i beso i n
de douze cen ts yards de coto nnade,p lus encore d e
douze ou qui n ze charges de grai n ; e t i l fau t que tout
cela m’
arr ive dans deux j ours,ou les morts sero n t
n ombreux . Je répo nds naturel l emen t du p rix de
tous les ob j ets demandés , j e réponds de la dépense
qu i sera fai te .
Henry M . STANLEY ,
Commandant l ’ expéd i t ion angle — amé r ica in epou r l ’exp lo rat ion de l ’Afrique ce lu i q u 1 a
retrouvé L ivi ngstone en 1 87 1 .
La même lettre fut écri te en françai s et en espagno l
e t portée par Ouled i e t deux autres . Le surle nde
mai n,couchés sur la route
,p rè s de mour i r d
’
i nan i
t i o n,tous ces malheureux fou i l lai en t l
’
hori zo n pour
découvri r l e messager . I l arr iva enfin .
Je vo i s Ouled i,Katche tché e t beaucoup d
’
hom
m e s qu i l e s su ivent cri a tout à coup la vo ix perçante
d ’un enfan t .
De no i rs squel e ttes surg i re n t de l’
herbe ; tous le s
yeux se d i rigè ren t vers le même po i n t .
C ’ es t vra i ! Nous sommes sauvés ! O u led i e s t
un l i on .
E ffectivemen t,O uled i e t Ka tche tché arriva i en t 51
grand s pas, m on tran t la le ttre q u’
i ls appo rta ie n t e t
que j’ eus b ie n tô t dan s le s ma i ns . Tous se pressè ren t
72 LE CON GO .
pour en entendre la l ecture,
- pui s l e réc i t d e Katchet
ché,p lus hab i l e à. man ier la paro l e qu
’
Ouled i .
Pendan t ce temps - là,les v ivres approchaien t . Mes
pauvres épui sés coururen t au - devan t des porteurs,
qu’ i l s déchargèren t,prenan t l es sacs de r i z , l es pa
n iers de p o i s son,l es paquets de tabac
,les j e tan t avec
une v igueur incroyab le,et déposan t avec se i n une
dame—j eanne où i l y avai t du rhum .
Tandi s que Maurabo improvi sai t un chan t de
triomphe où les cataractes, l a forêt, l es cann i bal es , l a
fami ne , l a dureté des i ndigè nes s e mêlai en t aux
louanges données aux frères du maître , qu i n ous ra
chetai en t de l’ en fer de la fami ne l es en fants e t l es
femmes al lai en t chercher de l ’ eau,chercher du bo i s
les cap i ta ines éventrai en t l es sacs ; chaque tab l i er,chaque séb i lle recevai t sa part .
Chantez , amis chantez,l e voyage es t fin i .
Chantez,amis ! chantez fort ; vo i c i la grande
mer ! répétai t l e chœur avec v ites se .
Je regagnai ma tente,accompagné d’
Ouled i,du
chef des porteurs et de Katchetché . Celui—ci , l e regard
p le i n d ’affecti o n,me présenta al ors des boute i l l es mys
tér i euses , attachant sur ma figure son œ i l p éné tran t
pour j oui r de ma surp r i s e : Pal e ale, ! é rès , Porto,Champagne . E t du pai n
,du pai n de fromen t pour
toute la semaine ! Pui s du beurre,du thé
,du café
,du
sucre , des sardi nes , du saumon ,du p lum-puddi ng
,
des co nfi tures , du rai s i n et des
Après l e repas , l es bal les de coto nnades furent
ouvertes et l es hai l lons j etés au feu . Les membres
LE CONGO . 73
décharnés, l es o s sai l lan ts d i sparuren t sous l e to ffe
blan che ou la perse aux v ives cou l eurs ; mai s i l fal la i t
des moi s avant que les j oues creuses , l e s tra i ts haves
eussent recouvré cet te bel l e te i n te de bronze qu i d i s
tingue l’
Afr i ca i n b i en nourri .
Le lendemai n 9 aoû t 1877 , n euf cen t qua tre - v i n g t
d ix - n euf j ours après avo ir qui tté Zan z ibar, nous par
times pour Emmboma .
Sur l a rou te apparut une fi l e de hamacs . L’ in stan t
d ’après,j ’ étai s en face de quatre hommes b lancs ; j e
rougi s d e l a surp ri se que me causa l eur pâleur .
Pauvres A fri ca i n s ! J ’ eus l e secre t de leur curi o s i té,
de l eur é tonnement à l a vue de ma figure spectral e.
La blancheur de ces Européen s me donnai t une sorte
de fri sson ; et p ourtan t , comparé a ce que j e vo i s au
j ourd’
hu i,l eur te i n t brûlé par l e so le i l é tai t franche
men t O l ivâtre .
Deux j ours après l eur arr ivée à Emmboma,S tan
ley e t tou te sa su i te s’
embarqua i en t sur un vapeur qu i ,des cendan t l e fl euve
,l e s co ndu isa i t à Kab i nda .
S tan l ey rapa tria tou s ses hommes,et
,le 13 décem
bre, s
’
embarqua a Zan z ibar , a bo rd du Pacham ba,
pour gagner Aden,e t de la l
’
Europe .
Le p robl ème é tai t main tenan t résol u l e fleuve
Congo ne venai t pas du no rd,comme l ’ i nd iqua i t l a
première part i e d e son cours ; i l n’avai t pas avec l e
N i l d e sources commun es , e t s on bass in éta i t d i s t in ct
de celu i du Zambè z e .
Le p rob lème é tai t réso lu avec la co n na i s sance
du fleuve, S tan ley apportai t des détai ls sur tous ces
74 LE CONGO .
terri to i res i nconnus et sur. l e s féroces tr ibus qu i l es
peup l e n t ; tr i bus anthrop ophages , con tre l esquel l es ,malgré son arden t dés i r d e n e pas répandre l e
sang,i l ava i t dû lutter l es armes à la main .
Pendant que S tan l ey traversa i t l’
Afri que , S . M .
Léopo ld I I,ro i des B elges
,réun i ssa i t, le 12 sep tembre
1876,une con fé rence géograph ique pour j eter l es
bases de l’Associ a ti on In tern ati on a le Afr i cai n e,dont
l e but é tai t d ’ exp l orer l es part i es i nco nnues de l’A
fr ique,de faci l i ter l ’ ouverture de vo ie s qu i fissent
pénétrer la c ivi l i sat i o n dan s l ’ i ntéri eur du co nt i nen t
a fri cai n , et de rechercher des moyen s effi caces pour
am en er la supp res s io n de la tra i te des n o i rs » .
La con férence déclara qu’ i l fal lai t co n sti tuer une
comm i ssi on i n tern a ti on a le d’
exp lora ti on e t d e c i v i li
sa t i on d e l’
Afr i que cen tra le,et des com i tés n a ti onaux
qui se t iendraien t en rapport avec l a commi ss ion,
pou r central i ser,autant que p oss i b le
,les efforts fa i ts
par l es voyageurs de tou s l es pays .
A la su i te de cet te première déci s i on,des comi tés
nat io naux s’
é tab l i ren t en Al l emagne , en Autri che
Hongri e , e n Belgique, en Hol lande , en E spagne , en
I tal i e , en France , en Russ i e e t aux E tats - Un i s . L’
An
g le terre s’
ab st i n t la S ocié té deGéographi e de Londres,
pen san t que, pour la Grande - Bretagne
,l ’ exp l orat i o n
de l’Afr i qu e sera i t p l us effi cacemen t cont i nuée e t que
les fonds sera ien t p lus faci lemen t réun i s par un e
entrep ri s e nat iona l e séparée, que par une associat i on
i nternat i ona l e
76 LE CONGO .
Nous éti on s arr ivés depui s tro i s heures apeine
au vi l lage de Bwa- bwa N j al i,écri t M . Stan l ey , quand
nous vîmes s ’approcher u n drapeau françai s précédé
par un nègre europ éenn i sé de bel l e p restan ce ,vêtu du costume b leu des mar ins ; s es manches
étaien t o rn ées des gal on s de sous—offici er . C’ étai t
Malam i n e, l e sergen t sénégalai s,la i s sé par M . de
Braz z a à la garde de son terri to i re . I l étai t aecom
pagné de deux marin s gab onnai s en un i forme l’
un
d ’ eux portai t l e drap eau .
Malamine parl e b i en françai s ; i l me souhai ta l a
b ienvenue en termes d ignes et courto i s . Aprè s un
échange de quel ques paro les , l e sergent me présenta
un pap i er , qu i n’ étai t autre que le traité par l equel un
certai n chef, du nom de Makoko , cédai t a l a France
un terr i to i re s ’ étendant depu is la r ivière Gordo n
Benn ett j usqu’
à Empi la,sur l a r ive s ep tentri onal e de
l ’ étang . Par cet acte , M . de Brazza n o tifiai t et fai sait
savo i r a tous ceux que de dro i t qu ’ i l p renai t po sses
s i on du terr i to i re au nom de la Fran ce .
Malami ne con nai s sai t tous l es détai l s de l a trans
act ion . Makoko avai t é té g énéreux en échange de
que lques cadeaux san s importan ce,i l ava i t cédé à. l a
France un terri to i re d ’une étendue de neuf mi l le s (14
ki lomètres et demi) sur l es bord s de S tan ley- Pool , e t
dont les l imi tes , dan s l’ i n tér i eur
,n
’
étai en t pas fixées .
Le sergent me di t qu’ i l n ’avai t pas d ’autres i n s
truct i ons que de montrer l e trai té a tous l es Euro
péens qui s’
approchera i ent de l’ étang .
Comme i l éta i t tard, le sergen t Malami ne et son
LE CONGO . 77
escorte couchèren t dan s notre camp,e t par l ’ inter
méd ia ire de mes d omest iques, j e fus b ien tô t au cou
ran t d e tout ce qu i s e passa i t de l’autre côté du Go r
don Bennett .
Le lendemain matin,l e sergen t retourna sur so n
terr i to ire,e t aun e heure n ous nous préparâmes a le
su ivre,con formément à. l ’ invi tat ion qu’ i l n ous ava i t
fa i te au nom de son maitre .
I l résu l te des très courtes relati on s que j ’a i eues
avec l e sergent Malamine que, quo ique Sénégalai s ,
c’ es t un homme supér i eur . I l é tai t b ie n dan s son
élémen t au mi l i eu de ces Afri cai n s d’
un rang i nfé
ri eur au s ien,e t i l exécutai t l es i n structi on s de son
che f avec tact e t i n tel l igence .
M . S tan ley passa su r la r ive gauche, et fo nda Léo
po ldv i lle en face e t au - dessous de Brazzav i l l e , pu is
Ki n tchassa e t K im p oro sur le s bords de l’
étang .
C ’est au moment de l a créa t i o n de ce dern ier po s te
que M . S tan ley eut avec Ma k o k o p lus i eurs entrevues ,
pendan t l esquel le s i l e s saya d’
obte n i r des terr i to i res
sur la r ive d ro i te,e t te n ta de décider le ro i de nous
reti rer le s terra i n s concédés . Toute so n hab i le té e t sa
d ip lomati e n ’
ame nèren t aucun résu l tat, Ma k oko fut
i nébran lab le .
M . S tan ley lança sur l e fleuve son cano t à. vapeur
le IZn -Avan t, battan t pav i l l o n be lge ; i l remonta l e
C ong o j usqu’
à S tan ley - Fal l s,créan t des stati o n s a
l ’abri du drapeau be lge , le s peup l an t de Be lges , e n’donnan t la d irect i o n a des offic iers be laes . D
’
i n ter
78 LE CONGO .
nat io nal e qu ’ el l e é tai t,l ’ as so ciat i on menaçai t de de .
ven i r exclus ivement belge .
No n seulem en t e lle é tab l i s sai t sa souvera ineté sur
des pays qu i eussent dû res ter indépendants , mais ,par ses tra i tés
,el l e contra ignai t l e s chefs a p rendre
l ’engagement de repousser par la force l es a ttaques
dont e lle pourra i t ê tre l’ obj e t de la part d ’
i n trus de
n’
imp or te qu elle cou leur
Nous n ’ avion s,assurémen t
,r ien à cra indre des
Belges ; mais derr iè re eux, et surtout derr i è re leur
che f,se cachaien t l es Anglai s . Pour n e pas men ti r a
son origi ne , M . S tan ley , dan s tous ses actes , n’ avai t
qu’
u n but nu i re à l a France,empêcher l ’exécut io n
du trai té co nclu avec Makoko,e t nous la i sser le mo in s
de terr i to i res poss i b le .
Du reste, des compéti t i o n s, des quest io n s p o l i t i
ques que nous n ’avo ns pas à. rappeler i c i,menaçaien t
de créer, à. propo s du Congo , des comp l i cati on s dan
g ereuse s, et de mettre cet E tat i ndép endan t s ous la
mai n de l’Ang leterre . I l fal la i t coup er cour t a cette
s i tuati on,régl er la pos i t i on des puis sances i nteré s
sées,tracer l es l im i tes de chacun e t rétab l ir l ’ i ndé
pendance du Congo ; cette m i ss i on fut accomp l i e par
la co n férence européen ne réun i e à. Berl in le 15 novem
bre 1884 .
Pendant les exp l o rat i on s qu’ i l poussa sur l e hau t
Cong o , avan t so n rappel e n Europe , M . Stan ley dé
couvri t l e lac Léopo ld H et reco nnut l e cours d ’
un
certai n nombre de s a ffluents du g rand fleuve .
CHAP ITRE IV .
Marche . De C omp i ègne . Savorg nan de B raz za.
Pendan t que le li eutenan tCameron traversai t l e bas
s in du Congo,et que S tan l ey rel evai t l e cours dug rand
fleuve , et créai t des é tab l i ssements , des voyageurs
françai s exp l ora ien t l e cours de l’Og ôoué , qu i se j ette
dans l’Océan Atlan t i que , au sud du cap Le pez, a
quatre degrés au nord du Congo,et trouvai ent un che
min conduisan t vers ce fl euve ; i l s créa ien t l e Congo
françai s .
Le bas Og ôoué é ta i t expl oré ,mai s i l resta i t à. résou
dre le problème de son origine : venai t- i l des grands
lacs du cen tre de l’
Afr i que , e t, s i on l e remon ta i t ,trouvera i t- on la une nouvel le route pour péné trer au
coeur du cont i nen t mys tér i eux ? ou b ien,n
’
é ta i t- i l
qu ’ un bras immense dé taché du Congo
Poussés par l’
ardent dés i r de trouver une réponse a
ces d ivers es ques t io n s , deux de nos compatrio tes , l e
marqui s de Comp iègn e et A lfred Marche, e n trepri
rent,en 1872, de remon ter l e cours du fleuve pour
pénétrer j usqu’
aux grands lacs e t rej o indre L ivi ng
stone,sur l e s or t duque l o n n
’
é ta i t pas encore fixé
en Europe .
I l s par ti ren t donc , subven ti o nnés par M . Bouvier,
natural i s te a Pari s,qui leur ava i t ouver t un créd i t i l l i
m ité,a l a seul e cond i t i o n que l e p rodui t de l eurs
LE C ONGO . 6
82 LE CONGO .
chasses e t de l eurs co l lecti ons lu i s era i t réservé .
Le 9 janvi er 1872, g râce’
a deux chefs indigènes,amis person nel s des voyageurs
,ceux—c i puren t com
mencer l eur aventureux voyage . L ’ expéd it i on se com
posai t de tren te In engas e t cinquan te Gal lo i s mon té s
sur quatre p irogues ; i l s avaien t pms l’engagemen t de
l es condui re à. Lopé , po i n t extrême atte in t par le doc
teur al lemand Len z . I l s y arr ivèrent le 21 j anvi er,après
b ien des d i fficul tés susci tées par leurs équ ipages . I ls
firen t la un séj our de ci n q semain es,tant dan s le but
d ’ é tud ier les pays envi ro nnan ts,que pour recruter l es
hommes nécessai res à. l a con t i nuati o n de leurvoyag e .
I l s réus s i ren t‘
a enrô l er cen t v i ngt Okandas , qu i s’ en
gageaien t a l es co nduire dan s l e pays des Madonnas ,é lo igné de vingt j ournées de canotage .
L’ expéd i t i on s e mi t de nouveau en route l e 28 fé
vri er mais,après tre ize j ours de marche
,ell e fut
attaquée par l es O ssyebas, écrasée sous l e nombre, et
ob l igée de fu i r . Harcelés,et même poursuivi s par l es
i nd igènes des pays qu ’ i l s venaien t de traverser, et
don t i l s avaien t reçu bon accuei l quel ques j ours au
paravan t , c’ es t au mi li eu de péri l s san s nombre que
les voyageurs réuss i ren t à gagner Lope, après avo i r
atte i nt un po in t nommé Ivondo,s i tué par 10
° 7’ de lon
g i tude .
No s compatri otes ne purent mettre à exécu tion l e
hard i p roj et qu’ i l s ava ien t formé de recommencer
l eur en trepri se . Rentrés en France,i l s s e trouvèren t
séparés : le marquis d e Comp iègne,nommé secréta ire
d e la Socié té khéd ivi al e de g éographi e , se rend i t au
84 LE CONGO .
Nous ne racon teron s pas i ci toutes les mi sères qu ’ i l s
euren t’
a souffri r,tous l es empêchemen ts qu
’
i l s du »
ren t surmonter dès l es débuts de l eur entrepr i s e ; les
vici ss i tudes étai en t cruel les, l es ob stacl es semblai en t
insurmon tab l es .
I l s arrivèrent enfin dan s le pays des Okandas , où
M . de Brazza étab l i t son quart ier général . Le docteur
Ballay , resté chez l es Bakalai s , reçut l’ordre de ral l ier
l ’ expéd i t i on et d ’amener avec lu i l es marchandi ses
d’ échange restées en arr i ère . Au momen t d e son
arr ivée,alors que les voyageurs croyaient pouvo i r se
remettre en route,l es Okandas, qui primi tivemen t
avai ent promis l eur concours , refusèren t de marcher .
De Brazza profi ta de ce retard forcé, pour vi s i ter l es
chefs,avec l esquel s Comp iègne et Marche s ’ étai en t
mi s en rapports pendant l eu r premier voyage ; i l se
d irigea à. p ied sur Lopé . Arr ivé là,i l rencon tra l e
voyageur al lemand Lenz , qui, depuis deux ans dan s
ces régio n s,luttai t con tre la mauva ise vo lon té des
ind igènes lu i refusant les moyens de conti nuer sa
route o u de retourn er sur ses pas . Grâce au secours
que lu i donna M . de Brazza, l e docteur Len z put
reven i r en Europe .
Le j eun e offici er arrivai t l e 20 jui n 1876 a Doume ;mais sa san té étai t tel lem ent ébran lée qu ’ i l dut y
fai re un l ong séj our .
MM . Marche et Bal lay,ne voyant pas reven i r l e che f
de l’ expéd i t ion, s e décidèren t à. conti nuer seul s l ’ex
p loratio n du fleuve . I l s atte ign i ren t Ivondo po i n t où,
deux ans auparavan t,Marche et de C omp i èg ne ava i en t
LE CONGO . 85
été con train ts de rebrousser chemi n ; cette fo i s encore ,le s rameurs
,n
’
osant pénétrer su r l e terr i to i re des
féroces O ssyebas, refusèren t d’
al ler p lus lo i n ; i l s
ren trère nt au quarti er général .
Retenu à. Doum é , M . de Brazza n omma M . Bal lay
commandan t de l’
expéd it i on , et chargea M . Marche
de pousser une reconnai ssance sur l’Og ôoué , j usqu’au
delà du po in t qu’
avai t atte in t l e D r Lenz . L’ami d e
Comp iègne part i t, et arr iva , l e 23 sep tembre 1876,51 75
ki lomètres au delà du po i n t extrême qu’aucun Euro
péen eût j amai s atte in t .
Pendan t ce temps , l e docteu r Bal lay rej o ignai t d e
Brazza a Doum é . Quand ce dern ier fut guéri,i l
retourna à. Lopé , réun i t lu i -même tout ce qu’ i l possé
dai t de marchand i ses , et , en avri l 1877, rej o ign i t ses
compagnon s .
C’
est à. cette époque que Marche ac cabl é par la
malad ie,dut se résoudre a qu i tter 1 expéd i ti on pour
ren trer en France .
MM . Bal lay et d e Brazza étai en t al o rs sur l e po in t
d ’ en treprendre la deuxième parti e d e leur expéd i t i on .
Les cond i ti on s se présen tai en t peu favorab les , i l e st
vrai,mais l eur réso luti on éta i t p ri s e , e t leur courage
inébran l abl e . Abandonnés par leu rs pagay eurs , les
membres de l’ expéd i ti o n duren t prendre eux-mêmes
les avi ron s ; l es rameu rs imp rovisés fi ren t un dur
appren t i s sage b ie n souven t , i ls chav i rè ren t dan s les
rap ides e t cou ruren t le s p lus grand s dangers .
Enfin en j u i l le t 1877 ,l ’expéd i ti o n atte ign i t les
chutes de l’ ambara,a part i r desque lles l’
Og ôoué n’
es t
86 LE CONGO .
p lus qu’une r iwere san s importan ce ; sa source ne
peut certain emen t être é lo ignée de l’
a .
La miss i o n avai t don c accomp l i s a tâche : e l l e avai t
acqui s la preuve que l’Og ôoué n’ es t pas un bras du
Congo . Mai s les courageux exp lorateurs , craignan t de
n ’avo i r pas encore as sez fa i t p our la s ci ence,rés o lu
rent de qu i tter l e bass in de l’Og ôoué ,et , se d i rigean t à.
l’
est, de gagner leTangan ika et la région du Haut-N i l .
La besogne devenai t d i ffic i l e on n ’avai t p lus pour
les tran sports l a ressource des p i rogues e t du traj et
par eau : i l fal la i t s’avancer a travers les terres,et
trouver des porteurs pour l e s cai ss es contena nt des
obj ets d ’ échange . Après de nombreuses ten tat ives
i nut i l es,M . de Brazza se décida à. acheter quaran te
e s claves .
C’ est dan s ces cond i ti on s que l es voyageurs traver
sèrent success ivement le terri to i re des Ondoumbo,
des Umbe ti et des Batékés , où i l fal lut dével opper
autan t d ’ i n te l l igen ce que de courage et de fermeté,
pour empêcher le p i l lage des cai s ses par l es i nd igènes .
La co lo nne atte ign i t enfin un peti t cours d’
eau,l e
N’
Gam bo, qu i b ien tô t s e transforma en une grande
rivière : l ’Al ima . M . de Brazza réso lut de descendre
l’
Al ima,qu i , suivan t l es indigèn es , se j eta i t dan s une
grande r 1we re . Mai s i l n e pouvai t l es cro i re ; i l éta i t
p ersuadé,au contrai re , que l
’
Alima l e conduirai t aux
grands lacs . Ne connai s sant pas l es découver tes de
S tan ley,M . de Brazza n e pouvai t supposer que l e
grand fleuve dont o n lu i parlai t é tai t l e Congo .
Après un voyage dont n ous n e décri ron s pas les
LE CONGO . 89
pér i p éti es , M . de Brazza atte ignai t, l e 1 1 aoû t 1878 ,tro i s an s après s on départ d’
Europe ,l e Leba i
N’
Gouco . Les porteurs refusèren t d ’al ler p lus l o in .
Cette r ivi ère des cend de co l l ines r i ches en sel , e t
son eau est saumâtre . E l l e venai t encore,dan s l’es
pr i t du chef de l ’ expéd it io n,compl iquer l e problème
de l ’hydrog raph i e afr i ca ine .
L’ expéd i t i o n rebrous sa chemin et rentra en Eu
rope ; l es voyageurs avaien t fa i t, en pays inconnu ,p lus de tre ize cen ts ki lomètres
,don t hu i t cen ts à. p ied ;
i ls avai en t étud i é la faune e t l a flo re d ’une ri che
con trée qu’ i l s devaien t, quelques années p lus tard ,ouvr ir à. l a civi l i sat i o n .
A son retour e n Fran ce,M . de Brazza appri t l es
résul tats du voyage de S tan l ey ; quand i l su t que l e
reporter améri cain avai t descendu l e cou rs du Congo,
e t qu’ i l connut la d i rect i on exacte de ce fleuve
,i l com
pr i t que l’
Al ima éta i t u n de ses affluen ts . Comme i l
savai t, en outre , que ,deV i v i à. Stan ley—Poo l, le Congo ,
sur u n parcours de 450 k i l omètres à. vo l d ’ o iseau,
est coupé de nombreux rap ides qu i empêchen t la na
v ig ation ,i l réso lut de tourner cet obstacle
,e t de fray er
une vo i e d irecte vers le hau t Congo , qu i est navigable .
S ’ i l réuss i s sai t dan s son en trep ri s e , i l ouvrai t a no s
bateaux à vapeur, à. notre commerce e t a l a c ivi l i sati on
une vo ie de on ze cen t m i l l es a travers l e pays l e
p lus ri che et l e p lu s ferti l e de l’
Afr ique .
Le but de l ’ en trepr i se avai t d e quo i ten ter M . de
Brazza ; et pu is , le j eun e exp l o rateur apprenai t que
S tan l ey venai t de s’
embarquer pour fonder les p re
LE CONGO .
miers établ i ssemen ts de l’Association i n ternat i onale
du Congo ; s on cœur de Françai s s ou ffrai t a l’ idée
que sa patr i e pourrai t n e pas prendre sa part des
immen ses terr i to i res qu i s’
offrai ent a l a co lon i sat ion
i l ne pouvai t ass i s ter impass ib l e « a l a lu tte en tre
pr i s e par Stan l ey con tre l a nature,e t p eut—ê tre à son
tri omphe qu i assurera i t, à. notre détrimen t, la p ré
pondérance des i ntérêts don t i l éta i t chargé
Ses vœux al la i en t ê tre exaucés .
92 LE CONGO .
pecté aux no irs qui réuss i ssen t à. se soustraire à. l’
es
clavage, d ispose, à. un moment donné , de mi l l e à.
quin ze cen ts pagayeurs , qui p euven t armer quatre
vi ngt à. cen t p i rogues,et el l e reço i t tous l es tro i s mo i s
de quatre-vingt 51 cen t tonnes de marchand ises (1 )Au commencemen t de j u i l le t 1880, M . de B razza
qui tta Francevi l l e,s e d ir igeant sur Stan l ey
- Pool , ou
N’
Tamo . Il eut la bonne fo rtune de ramener à. de s
d i spos it i ons conci l ian tes l es Apfourous , qu i , à. son
premier voyage,l ’avaien t reçu à. coup s de fusi l . Sur
cet i t i néraire de cinq cents ki l omètre s en pays jus
qu’
alors incon nus , notre bonn e répu tati o n , acqui se
depuis 1876 dan s l e hau t Ogôoué , nous valut partout,d it M . de Brazza , un excel len t accuei l des p opulat i ons
Ba tékés,Ach i couyas , Abomas ,
Le ro i Makoko , chef des Batékés, sur l e terr i to ire
duquel se trouvai t l e voyageur,envoya un de ses
grand s d ign i ta i res au -devan t d e lu i pour lu i servir de
gu ide i l usa de toute son i nfluence sur la nat io n des
Apfourous, ses vo is i n s , pour faci l i ter l a tâche de
M . de Brazza,et terminer les négociat i ons entamées
avec ces ind igènes . La hai n e des Apfourous pour l e s
b lancs date du passage de Stan ley : i l s accus en t l e
voyageur américai n d ’avo i r vers é i nuti lement l e sang
des l eurs ; or, comme ces naturel s supposen t que
tous les blancs son t frères,i l s voulai en t faire payer à.
Brazza les r igueurs exercées par S tan ley .
Après une marche pén ib l e dans l e pays des Batékés,
11 ) Le ttre de M . de Braz za .
LE CONGO . 93
M . de Brazza aperçut, un so i r, à.onz e heures , l e grand
fleuve coulan t maj estueusemen t à. ses p i eds e t fe r
man t une immen se nappe d ’ eau don t l ’ éclat argenté
al la i t s e fondre et s e perdre à l ’hori zon dan s l ’ombre
des hautes mon tagnes . Mon cœur de Françai s batt i t
p lus fort, d i t- i l , quand j e s ongeai que la al la i t se déci
der l e sort de ma miss i on
Le ro i ayan t voulu vo i r l e s b lancs,M . de Brazza e t
son escorte firen t l eurs préparati fs p our se présenter
d ignemen t devan t l e no ir poten tat .
Nous ne fai s ions ,ma fo i ,pas trop mauvai se figure ,écri t M . de Brazza . Tand i s que l e Batéké Oss ia al la i t
frapper les doub les c l o ches de la porte du pala i s,pour
préven ir de l’achèvemen t d e no s préparat i fs,j e fi s
fa i re l a hai e à mes hommes,qui
,suivan t l ’usage du
pays,porta i en t l es armes
,l e canon incl i n é vers l a
terre . Auss i tô t la porte s’
ouvr i t , e t M . de Brazza
pénétra avec ses gen s dan s ce qu ’ i l appel le les Tu ile
r i es de Makoko, et qui n
’
étai t en somme qu ’une grande
case . Devan t les balle ts que l’ exp l o rateur o ffrai t en
présen t,de nombreux servi teurs é tend i rent des tap i s
et une peau de l i on,emblème de la royauté .
On apporta un p lat de cu ivre,de fabricat i on por
tugai se , sur lequel Makoko devai t poser les p ieds ;pui s u n grand dai s rouge ayan t été d i sposé au -des
sus du trône,l e ro i s ’avança ,précédé de son fét icheur,
en touré de se s femmes e t de ses pri nc ipaux offic iers .
Makoko s’ é tend i t sur sa peau de l i o n , accoudé sur
des couss in s ses femmes et ses en fan ts s’
accroup i
ren t a s es côtés . Alors , l e g rand féticheur s’
avança
94 LE CONGO .
vers l e ro i et s e précip i ta à. ses genoux en p laçan t , ses
main s dan s l es s i ennes ; pu i s , s e re levan t, i l en fi t
au tan t avec m o i,ass i s su r mes balle ts en face de
LE ROI MAKOKO .
Makoko . Le mouvement de génufl exi o n ayan t é té
imi té success ivement par tou s les ass i s tants , le s pré
sentations éta i en t accomp l ies . E l l e s furen t su ivi e s
d’
un court en treti en,dont vo ici l e résumé
Makoko est heureux de recevo i r le fi l s du grand
LE CONGO . 95
chef b lanc de l’O cciden t,don t l e s actes s on t ceux
d’
un homme sage . I l l e reço i t en con séquence,et i l
veut que l orsqu’
i l qu i ttera ses E tats,i l p ui s s e d i re a
ceux qu i l’
on t envoyé que Makoko sai t b ien recevo i r
l es b lancs qu i v ie nnen t chez lui,non en guerr i ers
,
mais en hommes de paix .
M . de Brazza res ta pendan t v i ngt—cinq j ours chez
Makoko ; ce pri nce, qu i ne con nai ssai t l e s b lancs
que par la tra i te des no i rs mon tra d’
abord une cer
ta i ne défiance ; p eut—ê tre auss i s e s ouvenai t— i l des
coup s d e fus i l s t i ré s sur l e fleuve . B ien tô t rassuré,l e
ro i man i fes ta l e dés i r de p lacer s es E tats sous l a pro
tection de la France,pour év i ter les hosti l i tés qu i peu
va ient éclater de nouveau en tre l es b lancs et l es no i rs .
L e trai té fut s igné l e 3 octobre 1880, e t M . de Brazza
pr i t offici el lemen t p os sess io n des terr i to i res concédés’
a la France . Vo ici l es termes de cet acte :
Au nom de la France e t en vertu des d ro i ts qu i
m ’ on t é té con férés,l e 10 sep tembre 1880, par le ro i
Makoko,l e 3 o ctobre 1880, j
’
a i p ri s po ssess i o n du
terri to i re qu i s ’ étend entre la r ivière Dj oué e t Emp i la .
En s igne d e cette p ri s e d e p ossess i on , j’
a i p lan té le
pavi l lo n françai s a Oki la,
en p ré sence de N o tba ,
Sc ianho , Ngaekala, Ngaeko , Juma, N voula, che fs
vas saux de Makoko,e t de Ng al ièm e
, l e représen tan t
offici e l de son autori té en cette c i rconstance . J’
ai
remis a chacun des chefs qu i o ccupen t cette partie de
terr i to i re u n pavi l l o n frança i s , afi n qu’
i ls l ’arborcn t
sur l eurs vi l lages en s igne de ma p rise de possess io n
au nom de l a France C e s che fs , offi cie l lemen t i n fo r
96 LE CONGO .
mésparNgaheme de la décis i on deMakoko, s’ incl inen t
devan t son autori té e t accepten t l e pavi l lon, et , par
leur s igne fa i t c i—dessous,donnent acte de l eur adhe
s ion à. la ces s ion de terr i to i re fai te par Makoko .
Le sergen t Malami ne,avec deux matel o ts , res te
à. l a garde du pavi l l on,et est nommé provi so iremen t
chef de la stati on françai se de N couna . Par l ’ envo i à
Makoko de ce document,fa i t en tr ip l e et revêtu de
ma s ignature et du s igne des chefs vassaux, j e donne
à. Makoko acte de ma p r i s e de possess i on de son ter
r i to ire pour l’
étab l i s s emen t d’une stati on françai se .
Fai t à. N couna, dans les E tats de Makoko,le
3 o ctobre 1880 .
Suiven t l es s ignatures de M . de B razza et des chefs
i nd igènes .
Auss i tôt l e trai té paraphé,l e ro i et l es chefs p ré
sentèrent a M . de Braz za une bo i te remp l i e de terre,
et l e grand féti cheur ou sorcier s’
adressa en ces
termes à notre compatriote
Prends cette terre,et porte—l a au grand chef des
b lancs ; e l l e lu i rappellera que nous lu i appartenon s !
M . de Brazza,p lantan t a lo rs l e drapeau tr i co lore
devant la case de Makoko,répond it
Vo ic i l e s igne d ’amit i é e t’
de p rotect i on que j e
vous lai ss e . La France es t partout où flo tte cet em
blème de paix,et el l e sai t fai re respecter l es dro its de
tous ceux qui s’abr i tent a so n ombre .
Pour scel l er le pacte d ’al l iance,l es chefs furen t
réun i s en un grand palabre,e t l ’o n procéda à l
’ enter
rement de la guerre . Un g rand trou fut creusé dans
LE CONGO . 97
l e s o l,e t chaque chef v i n t y dépo ser une arme ou un
obv
e t rapp elan t l a guerre : poudre , ba l les . p i erres ,fus i l s
,lances
,sagaies ; pui s , B razza e t ses hom
mes y j etèren t d es cartouches,e t l e trou fut bou
ché au - des sus,on p lanta u n arbre .
Nous en terro n s la guerre,d i t un des che fs
, e t
nous l’ e nterrons s i p ro fo ndémen t que n i nous n i no s
en fan ts n e pourron t la déterrer ; l’arbre qu i pous
sera en cet endro i t témo ignera de l ’al l iance en tre
l es blancs e t l es n o i rs .
E t nous auss i,répo nd i tM . de B razza
,nous en ter
ro n s l a guerre pu i s se la paix durer j usqu’
à ce que
ce t arbre porte comme fru i t des bal le s , des car tou
ches e t de la poudre
B ien tô t ap rè s,tous l es chefs des di stri cts envi ron
nan ts vm rent,eux auss i
,s e p lacer sous l e pro tecto ra t
de la France , e t chacun d’ eux re tourna dan s sa tr ibu ,
p orteu r du pavi l lo n françai s .
M . de Bra z z a j e ta l e s fo ndat i o n s de l e tabl i ssemen t
de N’ tamo
,auque l la S oci é té de Géographie de Paris ,
sur la p ropos i t i o n de M . de Quatrefages , donna le
nom de B razzav i l l e,pu i s i l s’ é lo ig na seu l , pour ga
gnor la côte en descendan t l e Congo . E n partant , i l
co nfi a la garde du drapeau au sergen t Ma lami ne ,des t ira i l leurs sénégalai s
,avec deux hommes
Je ne pui s te don ner n i argen t , n i ressources
l u i d i t M . de Brazza en s’
él o ignan t ; tu as tes hommes ,
tes armes,débrou i l le - to i comme tu pourras , ma i s
n’
abando nne pas to n poste .
Nous avon s vu comment l e brave sergen t s’
es t ac
LE CONG O . 7
98 LE CONGO .
qu itté de la mi ss ion d h o nneur qu i lu i éta i t co nfiée , et
que l jugement M . S tan ley a porté sur Malamine .
C ’ es t p endant ce voyage que l'
exp lorateur fran çai s
renco ntra M . S tan ley a Mdam b i -Mbongo ; i l resta son
hôte pendant que lques j ours , e t n’ eut qu
’
à s e louer de
la cord ial e ho sp i tal i té que lu i o ffri t l e voyag eur
amér i ca i n M . de Brazza racon te a i ns i sa récept ion
chez S tan ley
Le hasard a réun i u n i n stan t deux hommes,
deux an ti thèses la rap i d i té e t l a l enteur,l a hard iesse
e t la p rudence,l a for ce et l a faib l es se ; mais l es extrê
m es s e touchent l eurs s i l l o n s,d i fféremment tracés
avec persévérance,co nvergent au même but : l e p ro
grè s . Ces deux hommes o nt reconnu les dures néces
s i tés de l eur tâche : i l s se renden t j ust i ce . Votre mi s
s i onna i re s’
honorera touj ours du cord ia l accue i l que
lu i a fai t l e p l us i ntrép id e exp l orateur de l’Afr i que .
Nous devon s rendre cette j ust i ce a M . S tan ley que,
racon tant so n entrevue avec B razza,i l fa i t l e p lus
grand é loge de l ’ énergi e, de la vai l lance et de l’
i nte lli
gence de no tre compatrio te ; en mai nts endro i ts , i l
rend j ust i ce a M . de B ra zza Avec un pare il ch ef et
cent hommes comme Malamine et Guira l (un quar
t ier m ai tre de la mari ne fran çai se détaché a Brazza
vi l l e) , o n peut conquéri r toute l’
Afr i que .
I l est regrettab le que,p l us tard
,dan s un banquet
o ffer t a Stan l ey à. l’
Hôte l Co nt i nen tal a Pari s , Où éta i t
également M . de Brazza,l e voyageur améri cai n
,
aveuglé par sa ha i ne contre la France,ai t, en parlan t
d e ce tte rencon tre,p ro noncé les paro les suivan tes
,
100 LE CONGO .
b les sure lu i fa i san t défau t,i l eut recours aux remèdes
du pays ; mais l eur e ffe t fut terr ib le la p la i e devi n t
spongieuse , e t i l fal lut en l ever avec de gro s ci seaux l e
morceau de chai r attaquée par la médecine ind igèn e .
I l dut envoyer chercher a deux j ours de marche de
l ’acide phén ique e t du n itrate d ’argen t,et
,grâce a
cette méd icat ion én ergi que,i l p ut b i en tô t reprendre
sa marche . Le 6 avr i l 188 1,i l arr iva i t à Francevi l le .
La stati on é ta i t p ro spère . Décidément,écr iva i t - i l
alors,l a c iv i l i sat i o n a pri s raci n e a Francevi l l e
,car
on m ’
offr i t,a mon arrivée
,des tomates
,des navets et
des hari cots verts .
Que lques semai nes p l us tard,M . de Brazza qui tta i t
la stati o n française et exp l o rai t p resque seu l l e pays
en tre l’Og ooué e t l’
Al ima i l fondai t,sur ce dern i er
fleuve,au confluent de l
’
Ob ia e t de la Lek iba,un tro i
si èm e étab l i s semen t, qu i p r i t l e nom de Poste de
l’
A lima pui s i l s e m it e n devo i r de créer une route
entre l’A l ima et l e Congo . Quand M . Mizon arriva,
une vo i e carro ssab le de cent V i ngt ki lomètres,don t
quarante - c i nq ava ient é té rendus prat i cab les par les
so i n s du chef de l ’ expéd i t i o n , éta i t ouverte entre
Francevi l l e e t l e p o i n t cho i s i sur l’Al ima pour lancer
n os vap eurs ; en outre ,toutes les populat i o n s , gagnées
par nos bon s procédés , éta ien t dan s n o s i ntérê ts .
Auss i tôt que M . Mizo n eut pri s p o ssess ion du p oste
de Francevi l l e confié à sa garde, M . de B razza se mi t
à l a recherche d’
une vo ie pouvan t re l i e r l e Congo su
pér ieur a l a côte . I l se d irigea vers les sources du
N iari,qui
,sous l e n om de Qu i llou ,
s e j ette dans l ’A
LE CONGO . 10 1
tlant i que , un peu au nord de Loango . Arrivé l e 9mars 188 1 sur les bo rd s de ce fleuve
,don t la source
ori ental e est vo i s i n e de la r ivière Dj oué , i l put, e n
cont i nuan t sa route , s’
as surer que tout ce bass in est
ri che en mines de fer ,de p lomb e t de cu ivre ; à. Mboko,n o tammen t, ce dern ier m inera i s e ramasse à. fleur de
t erre .
L’
exp lorateur co n stata que , j usqu’
à so n confluen t
avec l a r ivi ère Lal l i , l e N iari, j o l i e r ivière de quatre
v ingt a quatre -vi ngt- d ix mètres de large,ne présen te
aucun obstacl e à. la navigati o n . Quan t a l a popula
t i o n qu i hab ite ce s co ntrées ferti les , el l e est p lus dense
que cel l e de l a Fran ce .
Ce bas s i n es t séparé de celu i du Congo par des
montagnes a i sémen t franchi s sab les,mai s sur un
po in t s eul ement . Ce co l est s i tué a l a hauteur du
coude formé par l e N iari a so n con fluent avec l e
Ndouo . I l d evenai t dè s l o rs éviden t qu’
i l falla i t ré
n oncer’
a la route d i ffici l emen t p rati cab le qu ’ o ffre
l’
Ogooué , et que la vo i e la p lus avan tageuse e t la p l us
courte pour rel ier l e Congo i n téri eur navigable a
l’
Océan Atlan ti que s e d irigea i t p resque e n l ign e
dro i te a l ’ ouest . Le seul obs tacl e qu ’ el l e p résen ta i t à.
l a con struct i o n d ’une l igne ferrée co n s i s ta i t dan s l e
passage du co l , entre la val lée de Dj oué , qu i débouche
à. Brazzav i l le , e t cel l e de N iari,généralemen t p late
et faci le,qu i débouche à. l’Atlan t ique . Comme
,d ’autre
part,l’
Al ima et l’Og ôoué so nt re l iés par une route car
rossab le ,e t que le trans i t e s t assuré par des porteurs
e t des bêtes de somm e,l ’ un ique e ffort à fai re con
102 LE CONGO .
s iste à j eter hard imen t une vo i e ferrée de B razzavi l l e
a l a côte, c’ est - à - d ire sur une étendue d ’ envi ron 350
ki lomètres
Cette exp l o rat io n termi née,M . de B razza regagna
le Gabon et de la l a Fran ce,où i l arr iva l e 7 jui n 1882
,
porteur du trai té s igné avec Ma k o k o .
Outre les résul tats commerciaux i napp réciab l es que
peut avo i r p our la France l a p osses s i o n de ces im
men ses terr i to i res , le v oyag e de M . de Bra z z a a eu pour
con séquence de fai re fai re un grand pas à. l ’abo l i t i o n
de l a tra i te des n o i rs e t de l’ esclavage dan s toute cette
régi on . Dan s tout l e bass i n de l’
Og ôoué , i l a p resque
détru i t ce commerce honteux , en prouvant aux popu
lat i ons qu’u n commerce l i c i te l eur don nerai t des bén é
fices p l us sûrs e t p lus con s idérab les ; e t, j o ignan t
l ’ exemp l e‘
a la paro le,i l a rendu la l iberté a tous l e s
esclaves qu i so n t venus se ré fugier à l ’ ombre du dra
p eau de la Fran ce .
Au début,d i t M . de Braz za , j
’a i dû racheter
des hommes a pr ix d ’argent, e t fort cher , sel o n l e
cours,tro i s ou quatre cents francs . Je l eur d i sai s
,
quand i l s étai en t à mo i , bûche aux p i eds et fourche
au cou
To i,de quel pays es - tu ?
Je su i s de l ’ i n tér i eur .
Veux- tu rester avec mo i,ou retourner dan s ton
p ays ?
( 1) Génm ,L es E xp éd i t i on s d e M . d e B ra z z a.
104 LE CONGO .
Cependan t M . de Brazza ne pouvai t abandonner
a i ns i l’
œuvre commencée avec tan t de peine,au mi l i eu
de d ifficul tés s i grandes ; i l retourna au Congo
CHAPITRE V I .
Tr0 i 5 1e 111 e voyage de M . de Braz za.
Le 19 mars 1883,M . de Brazza s
’
embarqua i t a Bor
deaux,a bord du Précurseur ; i l partai t avec l e t i tre de
comm i s sai re de la Républ ique françai se . Au oommen
cement d ’ avri l,i l atte ignai t Da k ar
,où i l embarquai t
cen t tren te lap to ts,e t l e b rave sergen t Malami ne .
Dan s les prem i ers j ours d’ avri l
,d i t M . de Brazza
,
nous touchion s à Dakar . 130 lap to ts toute no tre
force armée montaien t à. bord , et parm i eux mon
brave sergent Malamine,rentré depui s quelques mo is
de Brazzavi l le,sur l ’ ordre de M . Mizon . Mélange
de sang arabe e t de sang maure,ce Malamine , don t o n
vous a s i souven t par lé,est u n homme de hau te ta i l le
,
so l id emen t musclé . Son profi l e st p resqu e européen
et sa phys io nomie resp i re une v i ri l e fierté . On sent
imméd iatemen t e n l u i l ’ homme capable de remp l i r
in te l l ig emmen t des o rdres , e n les i n terp ré tan t suivan t
les ci rco nstances . Quand,en 1880, j e le la i ssa i seu l a
l a garde du pavi l lo n français sur l e Co ng o , sans res
sources et a 500 ki l omè tres de no tre p lus vo is i n e s ta
t i o n,j e savai s a l ’ avance aqu i j e confia i s ce dangereux
honneur . Hard i d é fen seur de s faible s , Malam i ne fut
v i te a imé des i nd igènes, auxquels i l app ri t a a ime r la
Fran ce.
Avec lu i p lus ieurs de m es v ieux se rv i teurs
d ’autrefo i s avaient voulu m’
accompag ne r
106 LE CONGO .
Nous p ren i o n s encore quel ques Krowb oys dan s
l e go l fe de Gu i née, e t l e 22 avri l 1883 , aprè s un e excel
l en te traversée,n ous j et i ons l
’an cre en rade du Gabon .
Une avan t—garde,cbmmandée par M . de Lastour
,
parti e de France au mo i s de j anvi er,s ’ étai t rendue
d i rectement sur l e bas Og ôoué , où el l e attendai t l’ar
r ivée du chef de l a m i ss i on .
A Librevi l l e,M . de Brazza éta i t arrê té par l e débar
quemen t de ses marchand i ses v ivres,effets
,mun i
t i on s qu ’ o n n è put abri ter sous l es hangars du gou
vernem en t,et qui
,p endant p l us i eurs s emai nes
,res
tère n t sur le quai,exp osées au so le i l
,a l a p lu ie et aux
attaques des vo leurs .
Le 30 avri l,M . de Braz za s e rendai t dan s l e bas
Ogooue et au cap Lop ez , pour s’assurer que l e chef
de sta t i o n ava i t b i en exécuté l es i n structi on s do nnées ;
puis i l re tournai t au Gabo n .
Pendan t qu’
arrêté a Librevi l l e,M . de Braz za term i
nai t les dern iers p réparat i fs de s o n exp éd i t i o n,l e
l i eu tenan t de vai sseau Cord i er, commandan t l e Sag i t
ta i r e,s’
empara i t de Lo ango , à. l’ embouchure du fl euve
Qu i llou et de Pon ta N egra, sur la côte . I l ren con tra
une vive oppos i t io n de l a par t des négociants angla i s
et portugai s étab l is sur ce po i n t ; i l s re fusèren t même
de vendre des v ivres‘
a n o s mari n s,qu i s ou ffra i en t de
la fièvre ; mai s une ci rcon stan ce fortu i te v i n t l e t i rer
d’
em barras .
U ne des embarcat i on s du navi re françai s l’
O r i
flamm e ava i t chavi ré dans la barre auss i tôtles mate
l ots s’
élancèren t aso n secours,et
,pour être p lus li bres
108 LE CONGO .
et M . de Chavannes se mi ren t en route , p récédés d’un
p iquet d ’honneur,de mus ic ien s , de porteurs de da i s
e t de féti cheurs le rep résen tant de la France s’
avança i t
au mi l i eu du cortège flanqué de hal lebard i ers .
L ’arrivée du p l én i p otent ia i re françai s fut saluée
par l e vacarme assourd i s san t des tam- tam . Au bout
d’
un quart d ’heure d ’ atten te,l a p orte du palai s de
Makoko s’
ouvr i t et l ivra passage aux fami l i ers du
souvera in et à. ses femmes , portan t chacune, qu i l a
p ip e de Makoko, qu i son verre à. bo i re, qu i la cl oche
qu i so nne quand i l b o i t,qu i l’ é toffe do nt i l s e couvre
p endan t cette cérémon ie,
car c’ es t un e véri tab l e
cérémon i e que l a façon don t l e s chefs bo iven t i c i,
qu i son tabac,so n bri quet
,l es féti ches
,etc . Derrière
ce fl o t de monde assez mêlé et trè s peu vêtu , s’
avan
ça i t le Makoko sourian t a M . de Brazza,et marchan t
gravement sur la po in te des p i eds,ce qui es t le com
ble de la d i s t inct i o n .
Makoko p ri t p lace un i n stan t sur sa p eau de l i on,où M . de Brazza avai t fai t déposer des tap i s et des
couss in s de vel ours rouge,qu ’ i l lu i apportai t ; pui s ,
se l evant , i l tendi t la mai n a notre compatr iote , l e p ri t
à. bras l e corp s e t l u i donna une vigoureuse acco lade
Les transports de j o i e un peu calmés,le ro i afr ica in
s e tournan t vers ses suj ets,l eur d i t une chanso n
improvi sée en l’
honneur de M . de Brazza,dan s
laquel l e i l fai sai t al lus io n aux faux bru its que lesti n téressés avaient fai t couri r sur son comp te
,aussf
b ien en Afri que qu ’ en Europe
N gan i ou ,N gag n i o (ce que j e va i s d i re es t vra i ) .
LE CONGO . 109
E t le p eup l e répondai t en chœur
N gagn i oam e la (ou i , c’ es t vra i) .
Vous tou s qu i êtes la,voyez
Celu i qu’
o n ava i t d i t perdu, i l e st l‘
a !
Celu i qu’ o n ava i t fa i t mort,i l est revenu !
On avai t d i t qu ’ i l é ta i t pauvre,regardez
r i ches présents !
Ceux qu i o n t d i t cela son t des menteurs !
E t l e peup l e répétai t en chœur
Ceux qu i o n t d i t ce la son t des men teurs !
Le surl endemain , un grand palabre réun i s sai t tou s
l es chefs,qu i devai en t as s i s ter a l a remi se du t ra i té .
Assemblé s autour de Makoko , sous un immen se
velum de la ine rouge, chaque che f é tai t ass i s , te nan t
devan t lu i l e grand fé ti che de sa tribu,quelque chose
comme un d ieu larc apporté pour don ner p lus d e
so lenn i té la cé rémo n ie .
C ’ é ta i t u n spectacl e b ie n étrang e que ce tte n om
b reuse réun io n , fou l e compacte accroup i e, où ,dan s
l a b igarrure des é to iles a cou leurs v ives , l e mouve
men t d ’une lance ou le dép lacement d’
un fus i l fai sa i t
passer de s écla i rs . C.
‘
i e t la , tranchan t sur le reste ,quelques pagnes de sat i n ou de ve lours nous i nd i
qua i ent qu e des généro s i té s étrang è res avaien t de
van cé l es nô tres e t que tous n’
ava ien t pas en ,comme
le grand che f, le courage de re fuser .
Ma k oko trô nai t sur ses peaux de l ion,nég lig em
LE CONGO .
ment accoudé sur des cou ss i n s,en touré de ses femmes
e t de ses favori s . E n face,
’
a quel ques pas de l u i,
M’
pohon taba, l’ un de ses prem i ers vas saux, et l es
autres che fs as s i s à. terre sur des peaux d e l éopard,
attendai ent que l e souvera i n do nnai t l e s ignal du
palabre . Nous éti o n s en tre l es deux group es , un peu
sur l e côté .
Ma k oko,san s s e l ever, souhai ta la b ienvenue a
tout so n monde ; i l exp l i qua en quel ques mo ts l e but
de la réun i o n,pu i s
,chaque chef
,M
’
pohon taba en tête,vi nt à. genoux p rotester de sa fidél i té
’
a Ma k o k o,seu l
vra i chef,di sai en t— i ls
,s eu l p ropri étai re et s ouverain
de tous les terri to i res batékés . Tou s s e déclarent,
comme autrefo i s,heureux et fiers d ’ ê tre p lacés sous
la p rotect i o n de no tre d rapeau,et l e j uren t sur les
fétiches e t par les mêmes de leurs p ères .
A mo n tour . j e rappelai le passé en quelque s mots ;mes hommes prés en ta ie n t l es armes, o n so n na aux
champs,e t j e fi s a Mako k o la remi s e des tra i té s au
nom de la France . Procès - verbal de la cérémon i e fut
dressé et s igné,et o n se rendi t sous l e ha l l imp ro
vi sé,où se trouva ien t
,exposés à l ’admirat i o n de tous
,
l es présents des ti nés à. chacun e t ét i quetés a son n om .
Les cri s de surp ri se,l es marques de j o i e
,l es remer
c iments,j etèren t leur note bruyante e t gai e dan s l e va
e t- vient d ’une foule curi euse ; pu i s , chacun emportan t
ses nouvel les r i chesses, o n se d i t gaîment au revo ir .
Aprè s quelques j ours passés chez Ma k oko,de
B razza descend i t l e Congo jusqu’
à. Brazzavi l l e ; arrivé
la , i l voulut se mettre e n rapport avec l es ag en ts d e
1 12 LE CONGO .
Ces moyen s ne suffi san t pas, i l s répand i ren t le
bru i t de la mort de M . de Braz za et de son frère .
Heureusemen t M . Dutreu i l d e Rh i n s , anci en
compagnon de M . de Braz za, et rep résen tan t à. Paris
de la mi s s ion de l’Ouest a fr i cai n , éta i t e n mesure de
démentir ces calomn i es et d ’ i n d i quer cla i remen t l eur
source . On n e s’
en i n qu iéta pas outre mesure en
France,et j ama i s on n ’ a ces sé d
’avo i r la p lus grande
confiance dan s l e succè s de l ’œuvre en trep ri s e par
notre compatr i ote
Ap rè s avo i r i n stal l é M . de Chavann es a Brazza
v i lle , le chef de la m i ss io n retournai t , l e 1er j u i n 1884,
auprè s de Ma k oko ; celu i - ci , apprenan t les en nu i s de
M . de Brazza, lu i offr i t imméd iatement de l e mettre a
l a tê te d ’ une armée ; notre compatr i o te eut b i en de l a
p e in e a lu i fai re comp rendre que sa mi s s io n éta i t
toute pacifique,et que d ’ ai l l eurs i l n ’y avai t pas ma
t i ère a combat .
La fin de la mi ss i o n de M . de B razza approchai t
n ou s lu i lai s so n s raconte r lu i -même les dern iers tra
vaux sur l e co nt i nen t a fri ca i n
A ce momen t- là,
décembre 1884,no s dro its eta
b l i s à Braz zav i l l e nous as suraien t , par avance , la
possess io n procha i ne de Qu i llou ,et no tre i nfluence
al lai t s ’ étendre sur la r ive d ro i te du Congo,en amon t
du confluen t de l’Al ima . I l resta i t déso rmai s à. fa i re
certa i n es exp l o rat i on s importan tes que j e n’avai s pu
en trep rendre ju squ ’alors,faute de m onde ; i l res ta i t
également à p rodu i re un e act i on auss i l o i n que pos
s ib le sur l e haut Congo , pour avo i r en main ,a l’heure
L E CONGO . 1 1 3
voulue,des é l émen t s de compensati on . C etai t l a se
co nde part i e du p rogramme,l a p l us i n téressan te ,
mais n o n la p lus faci l e,é tan t données l
’
ex ig u i té de
no s res sources e t l a faib l es se de nos moyens d ’ac
t i o n .
Avan t de me con sacrer à. ce tte part i e n ouvel l e de
la tâche , i l fa l lai t la i s ser derr ière mo i une s i tuati o n
auss i n ette que p oss ibl e,rassembler les é léments des
expéd i t i on s futures et les pousser devan t mo i . J ’ em
p loya 1 près de tro i s mo i s a ce travai l ; tro i s mo i s pen
dan t l esque ls j e courus d’
un po i n t a l ’autre,réglan t
une d ifficul té à. Loango , causan t po l i ti que a Vivi
v e i l lan t au ravi ta i l lemen t de tous,donnant partout
des co n se i l s o u des ordres e t surve i l lan t les prépara
t i fs de mon p rop re départ .
Cen t cinquante porteurs de Loango,recrutés par
m es so i n s,montaien t a Francevi l l e e n longean t l
’
O
g ôoué sous la condui te du maréchal des log i s \Ve i s
troffer . On éta i t au commencement de mars . D ix j ours
encore furent con sacrés à. m es de rn i ers prépara t i fs,
e t , pour la seco nde fo i s , j e me lan ç a i a l’ i n téri eur
,
décidé à. al l er l o i n,s i r ie n n e vena i t e n traver m e s
proj ets .
L’
Og ôoué s embla i t fou cette an née - là ; une crue
énorme survenue à. l a mei l leure époque de l ’an née
avai t causé , dè s le s prem i ers j ours, l a perte de p l u
s ieurs p iè ces importantes d e la cano nn iè re démonta
b l e l e Dj ue‘
. I l fal la i t redemander e n Europe le double
des p ièces perdues .
E n at tendant la bai s se des eaux ,j e 111
’
arrê ta i 51L E CONG O . 8
1 14 LE CONGO .
a chaque agglomérati o n de v i l lages r iverai n s pour
achever l ’ importan te o rgan i sat i on i nd igèn e dont
j ’avai s jad i s j eté l es bases e t que M . de Lastours avai t
poussée su ivant m es vues ; ce n’ éta i t pas là. perdre
mon temp s .
Je fus retenu a Mad iv i lle,stat ion de s Adoumas
,
par la crue pers istant e du fleuve . M . de Lastours
o rgan isai t la p rem ière des expéd i t i o n s p roj etées a l a
tête de laquel l e i l deva i t parti r . Cette expéd i t i o n qui t
terai t l’
Og ôoué pour gagner d i rectemen t l e bass in de
la Bénoué , en s e mai ntenan t autan t que po ss ib le sur
l a crê te qu i sépare l e bass i n du Congo des autre s
bass i n s côtiers du nord .
Enfin,l es eaux de l ’Og ôoué ayan t bai ssé de p lu
s i eurs mè tres en quelques j ours , l a navigat i o n deve
nait normale ; en une sema i ne j e fus à. Francevi l l e,où j e trouvai M . Deca z es qu i s e rétab l i s sa i t d
’ une
fièvre . Le s nouve l l e s qu’ i l me donna du Co ngo e t de
l’
Al ima éta i en t bo nnes . M . Do l i s i e , en deux voyages
succes s i fs , ava i t découvert e t reco nnu le Mossaka et
l e Shanga , pui s l e cours supér i eur de l’
Oubangu i
N’
Kundj a , et avai t fa i t de n ombreux tra i tés avec l es
tr ibu s r iverai nes dan s l e haut cours de ce fl euve et
fo ndé de nouveaux postes .
M . Decaz es, avec l e tact pat i en t qu i e st l e fond
de so n caractère , d i rigeai t tout so n monde , aimé de
tou s ; sous sa d i rect i o n , notre i n fluence s’ é tai t beau
coup développée chez le s Batékés et,avec cette i n
fluence , la faci l i té d’
obten i r des res sources so i t en
vivres , so i t en hommes . Le servi ce des porteurs étai t
1 16 LE CONGO .
qu i dormen t lai —bas l e j uste tri but de regret s qu ’ o n
n ’est pas en dro i t d ’accorder au cours de l’
œuvre ! Ce
n ’ es t qu’ap rès la lutte qu ’ o n p eu t so ng er a comp ter
ses morts e t à. l es p l eurer . Les n ôtres garden t é ter
ne llem en t, sur l es r ives de l’
Og ôoué et du Congo , l e
nom de la France,martyrs de l a fo i patri o ti que et du
dévouemen t au pays,muettes sen t i ne l les endormies
dan s l es p l i s du drap eau nat i o nal .
Auss i tô t l es dern iers devo i rs rendus à n o tre pau
vre am i,j e fi s vi o l ence ama tri stes se et me hâta i vers
Francevi l l e . J ’espère qu ’ o n m ’aura pardo n né cette
p erte de temps de qu i nze j ours,sacr ifiée a une fai
b les se de sent iment don t j e n ’avai s pas su tri ompher .
S i j e n ’ ava is pas travai l lé durant ce temp s—là,j ’avai s
du mo in s beaucoup souffert .
Quand j’
arr i va i à Francevi l l e, M . Decaz es et mon
b rave Roche me con so lèrent de l eur mieux .
E n qui ttan t l es Adoumas et faute d’
avo i r d ’autre
Européen imm éd iatem ent sous la m a i n, j
’
ava i s chargé
m on frère de condui re l ’ expéd i t io n don t M . de Las
tours al la i t p rendre l e commandement au momen t
ou i l succombai t . I l eût été p ro fo ndémen t regrettab le
de ne pas ut i l i ser immédiatemen t l es é lémen ts p ré
parés p our ce voyage et qu i se fus sen t san s cela désa
g rég és en pure p erte . Mon frère part i t don c,accompa
g né d’ un camarade p ro fo ndémen t dévoué q ui l
’
avai t
suivi partou t,M . Péc i le .
Nous é ti o n s déjà. au 15 j ui l l e t 1 885 ; i l semblai t
que ce fût tard pour entreprendre un voyage de longue
hale i n e . La nouvel le de la Conventi on du 5 févri er
LE CONGO . 1 17 .
entre la France et l’Assoc iation,e t l e résu l ta t de l a
Con férence de Berl i n,qu i v i n ren t me trouver a lo rs
,
rendaien t i nuti l e l ’actio n p roj etée dans le hau t Congo .
La Compagn ie d ’
auxi lia i res i nd ig ènes que j e condu l
sai s,al la i t me servi r du mo ins
,pensa i s - j e, a co n ti nuer
l ’ exp lo rat ion de la N’
Kundj a- Oubangu i . On pousse
ra i t aus s i l o i n qu ’ on pourra i t dan s ce t afflue n t,pour
tâcher d ’atte i nd re l a l im ite d e so n bas s i n e t d e recon
naître l es nœuds orographiques qui dé term i ne n t,a
propremen t parler,l e bass i n du Co ngo , du cô té du
nord . Je rêva i s de ces hypo thè ses quand vi n t me sur
p rendre l ’ o rd re de ren trer en France .
La mis s i o n de l’
O ue st afr icai n é ta i t d écla rée ter
minée,e t l
’
Adm i n i s trati on de la mari ne p rena i t la
su i te de mes travaux j e devai s ren tre r au p l us v i te .
Deux l ignes de re tour s’
ouvra i e n t mo i reven i r
sur m es pas par l’
Og ôoué , où j e n’
ava i s r ie n a fa i re
(des ravita i l l emen ts p lus que suffi san ts s’ y trouva i en t
accumulés e t tout y é tai t o rgan i sé e t tranqui l le ) , ou
b ien poursu ivre par l’A lima et l e Congo e t ren trer par
B razzavi l l e d irectemen t a l a cô te .
J’
opta i pour ce dern ier parti , qu i m e perme ttra i t
de me rendre comp te de v i su de l a s i tuati o n po l i t ique
e t matériel l e de no s possess i o n s du Cong o , d’
où
j ’éta i s absen t depui s long temp s . E n outre,i l éta i t de
mon devo i r de ne pas rentre r e n Europe san s avo i r
donné une d i rect io n aux moye ns e t aux forces que
j ’ avai s amenées,no n san s d i fficu l té s , sur l
’
A l ima
c’
eû t é té sacrifier , e n pure por te , u n p remier résulta t .
Je descend i s do nc avec M . De ca z e s, auque l j a l lai s
1 18 LE CONGO .
remettre,en partan t, l a d i rect i on de tout l
’ i n téri eu r .
Le j our même où notre fl o tt i l l e de qu i n ze p i rogues
atteign i t l e p os te du bas Al ima,M . de Chavannes y
arrivai t ; l a vue de nOs pavi l l o n s en berne lu i annonça
de lo in qu’ i l al la i t appre ndre de tri stes nouvel le s . Lu i
auss i nous en apporta i t l e quarti er -mai tre Le Bri z
vena i t de s uccomber sur l e Congo . E n brave mari n , i l
é tai t mort comme i l l’
eû t fa i t sur l e p o nt de son vai s
s eau,un j our de bata i l l e . Quand v i n t l a dern ière m i
nute : Je m ’ en vai s,d i t— i l d ’une vo ix ferme en
core vous d irez‘
a M . de Brazza que j’
a i touj ours
fa i t mon devo i r . I l s emblai t n e regretter de la v ie
que la sat i s facti on du devo i r accompl i
Ah ! Mess ieurs, que d e grandes choses on fera i t
avec d e te l s hommes e t de tel s dévouemen ts
M . de Chavannes , que j’ étai s heureux de retrou
ver ap rè s un e l ongue séparat io n,me mit vi te au cou
ran t des affai res du Congo , et n ous reprimes tous
notre route . M . Deca z es al la i t d ro i t n ous attendre à.
Brazzavi l l e,pendant que j e montai s al’Oubangu i .
L’ o rdre de rentrer au p l us vi te n e me permi t pas
de res ter auss i l o ngtemp s que j e l e dés i rai s dan s ces
pays que j e voyai s p our l a p remière fo i s et où mes
co l laborateurs avai en t étab l i n otre i nfluence auss i
b ien et auss i sagemen t que_j’
eusse pu fai re mo i
même . M . Dol i s i e é tai t de retour d ’une tro i s ième expé
d it i o n dan s l’Oubangu i , poussée ju sque par 3 degrés
envi ro n au —dessus de l ’ équateur . Sur ces nouvel l es
r ives, i l ava i t j eté l e s bases d’une future organ i sat i on .
Ayant fa i t une vi s i te à. no s postes de Bonga et
120 LE CONGO .
tra i tés avec l es tr ibus i nd igènes vivan t sur ces terr i to ires , i l s
’
es t assuré l eur co ncours et a i nauguré parm i
el l es un système de servi ce ob l igato i re qu i assure à
no tre possess i o n du Congo l ’aide et l e secours de sep t
m i l l e i nd igènes . Cette esp è ce de recrutem en t e st fondé
sur l es mêmes bases que l ’ i n scrip ti on marit ime les
hommes do iven t à. l a s tat i o n françai s e un serv ice d ’un
certai n temp s , so i t comme so ldats , s o i t comme pa
gayeurs ou p orteurs .
Pour résumer ces travaux, nous n e pouvon s mieux
fai re que de ci ter textuel l emen t les paro les p rononcées
par M . de Brazza rendant comp te de sa mi ss ion
Qu’
avo ns- nous fai t duran t ce voyage commen t
a i—j e profi té , dan s l’ i n térêt du pays
,des pouvo i rs et
des ressources pécun ia i res qui m’ on t é té co nfi és
Au p o i nt d e vue géographique,de nombreux
tracés o nt été fai ts ; l es travaux de MM . de Rhins,
Dufourcq , etc .
,o nt comp lé té m es anci en s travaux sur
l’
Og ôoué ; l e bass i n de l’
A l ima est donné par l es tra
vaux de MM. Bal lay, de Chavann es , Decaz es, de
mon frère Jacques et l es m ien s p ropres ces travaux ,
qu i s e co ntrô l en t,o ffren t do n c certa i nes garan t ies
d’
exacti tude .
Deux exp éd i t i o n s marchent auj ourd’hu i parallè
l ement dans l e b lan c de la carte,s i tué au nord de
l’
Og ôoué e t de l’
A l ima : l ’une e st co ndui te par mon
frère Jacques,j e l ’a i d i t p lus hau t l ’autre par M . De
l i s i e,a idé de M . Fromen t
,un homme j eune et
tenace , qu i venait d e passer p l us d’un an au mi l i eu
des populat ion s de l’
Oubangu i . C es deux expéd it i ons
LE CONG O . 12 1
son t comme l e couronnemen t de l a tâche e t n e sau
raien t manquer d ’amener des découverte s impo r
tan te s a tou s égards .
Des don nées astronom i ques on t é té fourn ies pour
fixer les po i n ts géograph iques, e t avec el les o n t é té
e ffectuées de s observat ion s de météo ro logie , de m i
néralog ie , de géo logie . De bel les co l lect i on s d’his to i re
naturel le o n t é té réun ies, g râce au con cours de tous ,
par les so i n s spéc i aux de mon frère ; el l es do ivent
arriver trè s p rochai nemen t‘
a Pari s . A ces co l lect io n s
vien nen t se j o i ndre une quant i té d e croqu i s, de des
s i n s,de photographies e t de no te s ethnograph iques
d ’un grand i n térê t .
Tous ces travaux ont é té exécutés au m i l i eu d’ oc
cupat i o ns imposées par la créat i o n de hu i t s tat io n s
ou pos te s dans l e bass i n du Cong o , de hu i t au tres
dans celu i de l’Og ôoué , e t de cin q sur l a cô te ou dan s
la val lée du Qu i llou .
A côté de ces résu l tats scien t ifiques se p lacen t
des résultats éco nomiques p l us importants encore .
Le prem ier e st d’
avo i r conquis sur les popu la
ti o n s cette i nfluence défin i tive qu i do i t , a mon av is,
con sti tuer l ’ é lémen t p rimord ia l es sent i e l de toute
créati o n de co lo n ie . T i rer part i de s i nd igènes , fo ndre
leurs i n térêts dan s les nô tre s,e n fa i re no s auxil ia i res
naturel s,c’ éta i t lit , su ivan t mo i , l
’un des p lus hauts
obj ecti fs de ma miss io n .
A l ’heure p ré sente ,le s anc iennes tribus de l’
Og é oué
son t comp lè temen t dans no s ma in s . Par les tra i té s
qu i le s l i ent,l eurs hommes nous do ivent an nuel le
122 LE CONGO .
ment un temps détermi né de servi ce ; en dehors de
leur salai re,el l es trouven t
,dans de sér ieux avantages
économiques et dan s n otre p rotect i on,une compen
sat io n au temps qu ’ e l l es n ous co n sacren t .
Les Pahou i n s eux -mêmes,ces tr ibus cann ibales
que de pui ssantes migratio n s condu is i ren t autrefo is
sur l es bords de l’
Og ôoué , et que leur sauvagerie
comme leur i n sti n ct de p i l l age avaien t l ongtempsé lo ignés de no s vues
,y arriven t enfin . Ces m êmes
Pahoui n s,qu i depui s vi ngt an s son t en révol te co n s
tan te et ouverte con tre l’ autori té du Gabon
,on t é té
amenés,par l es i n térêts que nous l eur avons créés
,
à. trai ter avec n ou s sur l es mêmes bases que les autre s
peup l ades . I l s o n t dû , eux auss i, con s ent ir à nous
fourn i r des auxi l ia i res , et c’ es t la une garanti e cons i
dérab le au po i n t de vue de la tranqu i l l i té peut - ê tre
est- ce même le seu l moyen de mai nten i r une sécuri té
comp lè te dan s un pays qu i es t abso lumen t j’
a l la i s
d i re heureusemen t ho rs de l a portée des can on
n ières . C es nouve l l es recrues s ont venues sans trop
de répugnance s’
encadrer dan s les rangs de nos p re
miers auxi l ia i res : Adoum as , Okandas , Ap i ng i s , Oko
tas,Bang oués , toutes tr i bu s dont les ava ien t touj ours
é lo ignés auss i b i en u ne i n im i t i é i n s t i n ct ive que des
i ntérê ts faussés et mal compr i s .
Peu à peu ces Pahou in s viendron t doub l er et
trip l er l e n ombre de nos aux i l ia i res l eurs ap ti tude s
naturel les , l eur force phys ique, leur sobri été extrême ,l es rendent mervei l l eu semen t p ropres à nous secon
d er dan s ces contrées neuves .
1 24 LE CONGO .
n’
en e ffectuen t pas mo in s ho nnêtemen t et régul i è re
men t n o s tran sports .
Les Ba tékés du haut Al ima on t commencé_
a de
ven i r no s pagayeurs,et a l’ ouest de Brazzavi l l e les
Ballali s,en attendan t d e deven i r n o s porteurs , nous
fourn i ss en t p lus de travai l l eurs qu’ on n ’ en saurai t
uti l i ser .
Dan s l e hau t Congo , enfin , chez l es peup l ades
en core barbares,n otre acti o n est trop récente pour
avo i r pu produ i re de semblab l es résu l tats ; j e ne doute
pas,toute fo i s
,que nous ne l es ob ten i on s par la
pat ien ce . Les immolati on s humaines , qu i sont dan s
les coutumes de ces peup les, devi ennent mo in s fré
quentes . S i nous avio n s voulu les moral i ser par l a
force,nous n ’aur i o n s pas obtenu ce commencemen t
de p rogrès qu i nous a dédommagés de len ts e t
pacifiques efforts .
E n un mot,
‘
a d i fféren ts t i tres et dans des contrée s
d i fféren tes,depu i s l’ i nd ig ène tran sformé en so ldat e t
qu i pas se un an sous le s armes , j usqu’
à. celu i qu i
p orte un ballot pendan t sept j ours , envi ro n hom
mes sont emp l oyés an nuel lement par nous . I l s perden t
a notre con tact les vi ces de l eur sauvageri e p rimi t ive ;notre langue et notre i nfluence se répandent dan s
l eurs fami l le s et dan s l eurs tri bus,et ce group e qu i
rep résen te une populati o n d ’ envi ro n cinq mi l l i on s
d’
âm es, s e forme p rogress ivemen t
’
a l ’ éco l e du trava i l
et du devo i r . Une i n fluence ai ns i basée do i t ê tre
stab le e t féconde,et j e pui s en do n ner une p reuve . Il
y a douze ans, l e seu l commerce du haut Og ôoué é ta it
p N.)
en
LE CONGO .
l a tra i te des es claves l e ch iffre to tal du commerce du
Gabo n atte ignai t ape i nc cieux m i l l i o n s ; auj ourd’hu i l e
commerce l ic i te .a remp lacé l ’an cien trafi c , e t l e ch i ffre
des tran sacti on s atte i n t envi ro n quato rze mi l l i o n s de
francs .
E nfin,nos pos sess io n s
,qui j ad i s n e comprenai en t
qu ’une bande étro i te e t i ns ig n ifiante de cô te , entre l e
cap Sain t -Jean et l e cap Sai nte - Catheri ne,so n t actue l
l emen t p l us que cen tup lées . E l les o n t auj ourd’
hu i
p our l imi te s : au n ord,l a r iv iè re Campo ; à. l
’
es t,l’
Afr i que central e,pu i s que la Conven t i o n du 5 fé
vr i er 1885 nous do nn e l e bass i n de la N’
Kundj a—Ou
bangu i ; au sud,enfin
,el l e s touchen t le Cacongo
,
l im i te qu i borna i t au nord les prétent i o n s d’
une natio n
amie . Cette l imi te,hi s tori que p l utô t que réel le
,nous
avio n s tenu touj ours a l a respecter,nous e n avi o n s
donné l e gage ; l e Portugal voudra certai nemen t , a
son tour,l a respecter au j ourd
’
hui .
I l n ous a fal l u,au D“Bal lay e t a moi
,d ix an s pour
atte i ndre l es résul tats que j e v ien s d'
expo ser . Dans
ces d ix années,nous avon s dépensé deux m i l l i o n s
deux cent c i nquan te mi l l e francs . No tre créd i t moral
auprè s des i nd igènes e t no tre man iè re d’
agi r o n t é té
pour nous l ’équ iva len t de s somm es con s id érables
qu ’a dû dépenser l ’A ssoc ia tio n i n ternati o na le a fri
caine . No tre l en teur même a valu a notre auto ri té d e
s ’ é tab l i r dans ces co n trées san s coûte r du sang n i a
l’
Eu rope n i a l’
Afr ique , e t san s amener aucun fro i sse
men t n i aucun troub l e dan s la po l i ti que générale de
la France .
126 LE CONGO .
Lai s sant m ai n tenan t l e passé pour l’
aven ir , j e m e
demande ce qu i res te a fa i re encore .
Ces co ntrées de l ’O uest afri ca in qu i con st i tuen t
notre nouvel l e co lo n i e sont l o i n d ’ être toutes parfai
temen t étud iées,comp lètemen t o rgan i sées , et n e p eu
ven t en trer en exp l o i tat i o n que le j ou r où des vo i es
d e commun i cat i on auro n t re l i é à la mer l ’ imm ens
réseau navigabl e d e l ’ i n téri eur . Il res te do n c a p our
su ivre n o tre œuvre d’ é tude et d
’
organ i sat io n , et, pour
la cont i nuer dan s l es m e i l leures co nd i t i o n s p oss ib l es,
i l suffirai t d ’y emp l oyer un e ci n quanta i n e d’
Euro
peen s e t‘
a p eu p rè s deux cen ts n o i rs , so i t une
dépen se an nuel le d ’ envi ron un mi l l i o n c ’ est prêter à.
un aven i r que j e cro i s so lvab le,mais i l s era i t d e
toute nécess i té d ’ étab l i r un séri eux programme d ’
en
semb le . I l faudrai t,tout d ’abord
, que de s créd i ts suc
ce ss i ls fus sent,dè s auj ourd ’ hu i
,assurés d
’
an née en
année . San s un aven i r a i n s i garan ti , u n programm e
comp let d’
exp l orat io n et d’
organ isa ti o n n e saurai t
êt re exécuté , n i mêm e prépa ré . J’
aj oute que ce
programm e do i t abso lument s ’ i n sp i rer des vues e td es
p rocédés que nous avo ns emp l oyés,seu le sauvegarde
de l a s écuri té et du sage développemen t commercia l
du pays,seul garant i e du mai nt i e n de nos moyen s
d’
ac ti o n e t de l ’ économ i e dans n os budgets futurs .
L’aven i r du bass i n du Congo, co n s idéré d‘une
façon tout à. fai t générale,dépend e n part i e des vo ies
de commun i cat io n a créer . Dans les obscur i tés
actuel les de la ques tio n,j e n e sa is n i où
,n i quand
,n i
commen t ces vo i es sero nt é tab l i es mai s j e pui s affir
128 LE CONGO .
b l i ssemen t des cu ltures , représen te une main—d’
œu
v re con s idérab l e ,qu ’ on n e p eut demander n i aux
A rabes , n i aux Chino i s, n i surtout aux ouvriers de
race b lanche .
Or cette main- d’
œuvre ,nous la trouvon s sur p lace ,
dans des p opulat i o n s fort p rimi t ive s,i l es t vrai , mais
n on p o i n t i n in te l l igen tes,et qu i so n t assez man iab les
pour qui sa i t l e s man i er,ne pas l es heurter
,apporter
dan s l es re lat i on s avec el l e s b eaucoup de fermeté,une b ienvei llance san s fa ib l es s e et un e pat i en ce san s
l im ites .
E n voulant l eur imp oser brusquement no s rég le
mentat i o n s,nos man ières de fa i re
,de vo i r e t de pen
ser,nous arr iver i o n s in fai l l ib l emen t a une lutte ou
nous les conduiri o n s à l’
anéanti ssem ent . A part meme
la quest i on d ’ human i té,l a p rotect i o n des i nd igènes
me sembl e être,en ce cas
,l ’hygiène la p lus sûre pour
la poule aux œufs d ’ or .
Auss i b i en que personn e , j e con na i s l es d i fficultés
de créat io n d ’une co lo n i e san s en forcer l e déve loppement
,san s voul o i r qu’ el l e rentre dan s u n type
détermin é . Que la haute admi n i strat i o n,que
‘
l e haut
commerce p rennent garde de voulo i r me ttre trop v ite
en coup e réglée une possess io n qu’
à vra i d i re nous
connai s son s en core i n suffi samment e t do nt l es i ndi
gènes n e so n t pas encore i n i t i és a ce que nous vou
lo n s d ’ eux .
A i n s i donc notre acti o n,j usqu a nouvel ord re
,
do i t tendre surtout‘
a préparer l a tran sfo rmat io n des
indig ènes en agents de travai l,de p roduct i o n e t
LE CONGO . 199
de consommatio n p lus tard vi endra l’
E uro péen avec
l e s imp le rô l e d ’ i n terméd iai r e .
« Je ne saurai s assez l e répé te r i c i p réparer u n
pays à. l a co lo n i sat i o n e st oeuvre de temp s e t de
pat i en ce . Ce qu’
i l res te do ne à fa i re,c’ es t d ’ é tendre a
nos posses s i o n s du haut Congo l ’acti o n qui s ’exerce
actuel lemen t sur l e s r ive s de l’
Og ôo ué , e t cette tâche
ne saurai t ê tre n i l ’œuvre d’
un p ur , n i ce l l e d’ orga
n i sateurs qu i aurai en t tout a app rendre,quel s que
so i en t l eur in te l l igen ce e t l eur bo n voulo i r .
L’ in fluence personnel l e est grande ma îtresse e n
ce s ques ti on s ; auss i , a des i n fluences changeantes e t
vari ées i l faudra pré férer l’
act i o n cont i nue e t pers i s
tante des mêmes hommes , qui condui t a tous les ré
su ltats chez l es peup l ades pr im i t ives . Ces peup lades
a imen t d ’abord l e drapeau pour celu i qu i l e porte, e t
l a p lupart du temp s personn ifien t en ceux qu'
el le s
connai s sen t l ’ idée vague du pays l o i n tai n do n t on leur
parl e . Vo i là. p ourquo i i l faudra i t,autan t que poss i b le ,l es mêmes vo lo n tés a l a m ême tâche
,sur le s mêmes
l i eux,les m êmes dévouemen ts aux mêmes i n térê ts .
Faute de s imi l i tude dans le s p rocédés don t o n use
envers eux,les i nd igènes perden t rap idemen t con
fi ance e t de la m éfi an ce à l a peur e ta l a méchanceté i l
n ’y a qu’un pas .
Outre que l a force est un mauva i s moyen , i l est
imposs ib le de l’ employe r actuel lemen t dans les co n
trées de l’ i n téri eur . La p résence de no s cano nn iè res
du Gabo n dans le Bemb oe e t le C om ô s on t b i e n l o i n
d ’ avo i r c ivi l i s é ou pac ifié l e pays . Le s rap ides d e l'
O
LE C ONGO .
130 LE CONGO .
g ôoué son t du res te, pour ces eng in s de guerre, un e
barri ère i nfranch i s sab le .
Ce qu’
i l fau t redouter par- dessus tou t , c’ es t de
renverser en un j our l ’œuvre de d ix années,car l ’ i n
tervent i on de l a force dans un e œuvre p réparée par
la patie nce et la douceur peut tout perdre d ’ un seul
coup .
Les terr i to i res asse z vastes dejà que les tra i tés pas
sés par.
mo i avec d i fférents che fs avaie n t p lacés sous
l ’ i n fluence frança i se , leCongrè s de Berli n leur a do nné
p lus d ’amp leur encore . Il a i n scr i t sur l a carte d ’
A
fr ique,a côté des pos ses s ion s portugai ses
,deux É tats
nouveaux : l e Congo frança i s,plus étendu que la France
el l e -même,e t l
’
É tat i ndépendan t du Co ngo . Par la
vertu des proto co les , ces deux immenses co ntrées,
peup lées d ’ enfants de la nature,so nt comme entrées
dans l e concert des É tats civi l i sés . J e veux d ire par
la que, su ivant l es c i rco nstan ces et bon gré mal gré ,i l s pè sero nt p l us ou mo ins sur l eurs métropo les . L
’ !
tat i ndépendant du Congo , vo is in du Congo françai s,relève nominal emen t du souverain d ’ un royaume
avec leque l la France entreti en t l e s mei l l eures rela
ti o n s . Ces relat io n s s ero nt certa i neme n t le s mêmes
sur l es r ives du Congo,car j e ne
e
dou te pas ”que les
nob les vues auxquel le s l e nouvel É ta t l ibre do i t ses
orig i nes , ne co nt i nuen t à p rés ider de haut so n déve
loppemen t .
132 LE CONGO .
De son cô té,l e Portugal fa i sai t valo i r des dro i ts de
pri ori té à l’ o ccupat ion des rives du fl euve ; mai s quand
l es déclarat i o n s du min i s tre de s affa i res étrangères et
l es rapports de l a Chambre e t du Sénat euren t fai t
savo i r que notre gouvernemen t reco n nai ssai t au Por
tugal la po ssessmn de la r ive gauche du Congo , et la
l égi t imi té de ses p réten t i o n s sur l es te 1 r lto i res s i tués
sur la côte,au - dessous de 5° 12 ’ de lat i tude sud ,
l’
émo
t i o n se calma, e t l a p resse portugai se fut unan ime à
l ouer la généro s i té de notre condui te.
Sur ces en tre fai tes,un accord fut co nc lu en tre la
Fran ce et l ’Assoc iat ion i n ternati o nale,qui comprenai t
e nfin que notre concours lu i éta i t i nd i spensab le pour
mener à. b ien l ’œuvre qu’ el l e avai t e ntrep r i se . Sans
aller auss i l o in que le s E tats —Uni s , qu i reco nnai s sa i en t
l’
Assoc iat i on comme pu i s sance co nst i tuée , nous pre
n ion s l ’ engagemen t de respec ter tous l es terri to i res
o ccupés par el l e , de n’
apporter aucun obstacl e‘
a la
miss io n qu ’ el l e s ’ es t don née e t d’
ag i r avec el l e en bon
vo i s i n de so n cô té,l’
Assoc i at i on déclara i t qu ’ el le ne
céderai t jamai s a aucune pui s sance l es stati on s fo n
dees par el l e au Congo e t dans l es val lées du N i ar i .
Toutefo i s , voulan t témo igner de ses sent imen ts
am i éauxpour l a France , e l le s’ engagea a l u i donner l e
dro i t de p ré férence s i,par des circo n stances impré
vues , el l e étai t amenée u n j our a réal i ser ses posses
s ion s (1)
(I) L i vre Jau ne, affa i re s du Congo .
LE CONGO . 133
B ien accue i l l i à. l a Haye et a Berl i n,ce t arrange
ment n’
eut pas l’
heur de p la ire à nos vo i s i ns les Angla i s ;les j ournaux de la Grande —Bretagne n
’ euren t pas assez
de sarcasnies co ntre cette même A ssoc ia ti o n qu ’ i l s
avaien t tan t admirée quand i l s ’ é tai t agi de l a p lacer
sous ki dnecüon ckaGordon .
La ou les Angla i s avaien t rêvé d e tabl i r,a l eur
profi t,un mo nopo l e de douanes , comme en Chi ne , i l s
s e voyaient forcés de vivre avec les autres nati o n s sur
l e p ied de la p lus parfa i te égal i té .
John Bull n e pouvai t accep ter cette s i tuat i on . A l ors
i n terv i nt avec le Portugal un trai té dan s lequel, en
échange de la reco nnai s sance des dro i ts du Portug al
sur certain s terr i to i res co ntes tés , ce lu i —c i as sura i t à.
l’
Ang le terre l e protectorat de t oute la régi o n du Congo .
Ce tra i té souleva , de la part de toutes l es nat io ns de
l’
Europe , d’
unan im es pro testat i ons,e tM . de B ismarck
alla j usqu’
à déclarer, dan s une l e ttre rendue p lub li que ,que S . M . l
’
Empereur n e pouva i taccep te r l’app l icat i o n
des clauses du tra i té angle - portugai s aux suj ets al le
mands . Ce tra ité éta i t te l lemen t dé fectueux e t arb i
tra ire que,l e 16 mai 1884 , l o rd Grandvi l l e, répo ndan tà
une quest i o n qu i lu i é tai t adressée a l a Chambre de s
l o rds,déclara : Que tous les délég ués des chambres
de commerce e t i l s so n t nombreux venus au
Foreign—C ffi ce adm e tta i en t que l e tra i té é ta i t b ie n fai t ;mais qu’ en même temp s
,i l s co n fessa ie n t q ue la p r i n
c ipale obj ecti o n vena i t de ce q ue l’
Ang le te rre aura i t d û
prendre p ossess i on du pays
Le résu l tat de toutes ce s réclamat i o ns fut Ia déno n
134 LE CONGO .
c i at i on du tra i té . Cette s i tuat i on n e pouva i t s e dén ouer
que par une con férence europ éen ne . L’
Allemag ne e n
p ri t l ’ i n i t iat ive,et l a Con férence s’ ouvr i t
‘
a Berl in l e 15
n ovembre 1884 . Dès lors, l’act ivi té d ip l omat i qu e fu t
in ces san te .
Pendan t quatre mo i s,d i t M . Bann i ng , tou t e n
s’
acqu i ttan t de sa m is s i o n p ropre , l a Conférence de
Berl i n a été l e foyer de n égo ciat i o n s act ives , pour
su ivi es en dehors d ’ el l e mai s étro i temen t l i ées à
l ’obj et de ses dél ib érat i o n s . I l s ’ es t agi de général iser
la reconnai s sance et de fi xer l es l im ites du terri to i re
de l’Assoc iat i o n . Jusque dans l es prem i ers j ours de
j anvier 1885,l es tra i tés de reco nnai s sance furent suc
cess ivem en t conclus,sur la base commune de la l ib erté
commercial e abso lue,av ec l
’
Ang leterre , l’
Ita l i e,l’
Au
tri che —Hong r i e , l e s Pays -Bas,l’
E spag ne , l a France ,la”
Russ ie , l a Suède et la Norvège, l e Danemark et le
Portugal .
Les négociat i o n s avec l a Fran ce furen t longues e t
l abor ieuses nous n e vou l i on s pas abandonner la pos
sess io n du bass i n du Qu i llou que Braz za et ses com
pag nons avaien t exp l o ré ; mais, d’un autre cô té
, l’
As
sociat i on y avait créé quelques compto i rs, et n e vou
lai t l es céder que contre un pai ement de c inq mil l i ons
de francs d ’autre part,l’
Assoc iati on ne pouvai t nous
reconnaitre p rop ri étai re de ces terr i to i res san s avo i r
l a certi tude de l ’abandon des p rétent i o n s du Portugal
sur la r ive dro i te du Congo .
Cependant , nous obtî nmes gain de cause, et cett erégion n ous fut att ib ué e .
136 LE CONGO .
Abordan t la quest io n de l ’ es cl avage , l es plén i
po ten t ia i res on t voté la déclarat i o n su ivante : Les
pu issan ces qu i o n t la souvera i neté ou qui exercent
une i n fluence sur les terr i to i res formant l e bass in
conventio n nel du Congo,déclaren t que ces terr i to i
res n e peuven t ê tre uti l i sés n i comme marché n i
comm e passag e pour l a tra i te des esclaves de n im
porte quel l e race . Chacune de ces pui s sances s ’ en
g ag e à prendre tout es l es mesures en son pouvo i r
pou r mettre fin a ce commerce et pun i r ceux qu i l e
fon t
La d i scu ss i o n des formal i té s à remp l ir pourprendre
possess i o n d’
un terr i to i re no n en core soum is a une
n atio n c ivi l i sée,donna l ieu a de longs pourparlers ;
nou s ne nous en o ccuperon s pas,cette questi on étan t
en dehors de notre suj et .
La Co nférence de Berl in réglai t a i n s i la quest i on
du Congo dan s s es grandes l ignes,i l ne resta i t p l us à
chaque E tat que l e so i n de travai l l er en paix a cette
œuvre de civi l i sat i o n . E n outre,el l e fai sa i t cesser
toutes l es r ival i tés exi s tan t en tre l es d iverses nati o n s
i n sta l lées au Congo, en dél imi tan t d’une faço n cer
tai ne les front ières de chacune .
La grande p lace qu’
y occup e la France est due au
{ courage , a l a p ers évérance e t a l ’ énerg i e de M . de
B razza et de ses compagnons,Marche
,Ballay
,Du
treui l de Rhin s , et de ceux qu i en core aujourd ’hu i
travai l lent, là- bas, pour l
’ extens i o n de l ’ i nfluence
française sur le g rand con ti n en t afr i cai n .
CHAP ITRE VII I .
E tat actue l du Congo . E tat l ib re du Congo .
Par su i te des déc i s io n s de la Conférence de Berl in ,
l ’ immen se régi o n con nue sous le nom de Congo se
trouve d ivi sée en tro i s part ies : l’E tat l i bre du Congo ,
don t n ous avon s do nn é les l im i tes au chap i tre l e
Congo françai s, et le Congo portugai s .
De l’E tat l ibre du Congo,nous avo ns peu de chose
a d ire cette vaste contrée est a pe in e connue ; seules,
l es r ives du fleuve o nt é té exp l o rées par de s Eu ro
péens ; mais la maj eure parti e de ses a ffluents,dans
la régi on supéri eure , sont abso lumen t ig norés . Des
cataractes de S tan l ey a l’
équateur,s ’ é lèven t mai n te
nant,sur les deux r ives du fleuve
,de nombreux
étab l i s sements ; de l’
équateur a l a m er, la r ive g au
che du Congo fa i t seu le parti e d e l’E tat l i bre .
Les pri ncipales s tati o ns de l’
E ta t l ibre du Co ngo
so nt, en remontan t so n cours :
Banan e, dont nous avons déj a par lé . Sur ce pe ti t
co i n de terre,où le so l a une valeur vénale p lus
grande que dans beaucoup de nos vi l les europée n
nes , s’
é lèven t de n ombreuses facto reri es ; ce l l es de la
Compagn ie ho l landai se so n t de beaucoup les p l us
importan tes . La N i euwe .» lfr i kaansche IIande ls Ge noo t
schaap occupe p rès de la mo it ié de la po i n te de Banane . Ma lgré les marécag es qu i l
‘
e nv i ro nnen t. sa
138 LE CON GO .
s i tuat i o n es t extrêm ement salubre, parce qu’ el l e est
sans cesse ra fra i ch ie par l es bri ses de la mer. Son
terr i to i re est, du reste,d ’une admirabl e p ropreté
,
grâce à l a p résence d’
i n nombrables corbeaux a sea
pula i res qu i dévoren t, a mesure qu’ i l s arr iven t
,l es
dé tritus de toute sorte que la i s s e l’
O céan sur la
p lage .
C es uti l e s an imaux, qu i se chargent du n ettoyage
de la vo i e pub l i que,comme les zop i lo tes au Mexique
,
et les urubus dan s la Guyane françai se,son t l ’ obj et
d ’une p rotect i o n toute spéc ial e de la part des hab i
tants de Banane . I l s s on t presque appr ivo i sés,e t n e
s’
enfu i en t pas a l’
approche de l’
homme,dont i l s n ’ o nt
r i e n à crai ndre ; i l s s e réun i s sen t en grand nombre
sur la p lage sab lo n neuse e t enl èven t avec une rap id i té
inouïe tout ce que l es crabes de terre so nt trop l o ngs
à manger .
L’ étab l i ssemen t ho l landai s o ccupe env i ron qua
rante emp l oyés blancs . Les Krowbays , Krowm en et
Kab i ndas , chargés , dan s la facto reri e, des travaux
pén ib les,du déchargemen t et du chargemen t des na
vires,sont au nombre de tro i s ou quatre cents .
Sur la r ive gauche du fl euve , à tren te k i lomètre s
de la mer envi ron est l e vi l lage de K i ssange'
; l e
terrai n sur l equel s e lève l a s tati o n e st entouré de
tou s cô té s par un bras du fleuve . Les maison s et les
factorer ie s sont cachées dan s une végétati o n luxu
riante de palmiers , de papyrus et d’arbres des trop i
ques, qu
’
hab i ten t des mi l l iers d’
o i seaux au p l umage
mu l ti co lore .
140 LE CONGO .
par un nombre con s idérab le de nav i res de tous
to nnages .
Au - dessus de Boma,l e fl euve o ffre un e vague res
semblan ce avec les env i ro n s de S tan ley- Poo l ce son t
les mêmes col l i n es é l evées , l es mêmes r ives désertes
et san s hab i tat i on s .
Vo ici commen t M . S tan ley exp l i que cette so l i tude
qu i éto nne,auss i près de l’Océan
Boma a son histo i re,hi sto i re cruel l e e t sanglan t e .
C’ es t la qu’
au trefo i s on réun i ssai t, pour les envoyer
au Brés i l,dans l es Indes occ iden tal es , dan s l
’
Am ér i
que du Nord , d’
où i l s n e revena i en t j am ai s, l e s ese la
ves en levés de v ive force dan s l es v i l lages enviro n
nants . Des flottes ent ières fa i san t ce honteux com
merce j eta i en t l’
ancre devan t B oma . Les navi res arr i
va i ent chargés de gin ,de rhum et d ’ eau— de—vi e e n
échange de ces l iqueurs fortes, l es cap ita i n es enga
g ea i en t les gen s de Boma a se répandre dans l’ i nté
r ieur et,par tous les moyen s pos s ib l es
,à s ’ emparer
des malheureuses vi ct imes .
B ientô t,Boma n ’ eut p lus s eule ce mo nopo le .
-Ga
g nées par l’ exemp l e
,Punta da Lenha
,N okk i ,Mussura
et autres v i l l es r iverai nes dépêchèren t auss i leursém i ssa i res
, j usqu’
à ce qu’ i l n’
y eû t p lus un seul v i l lage
hab i té , de la m er a Stan ley—Poo l vo i là. pourquo i l es
populat i on s no ires s e so nt é lo ignées du fl euve e t
pourquo i ses r ives son t auj ourd ’hu i d ésertes .
E n 1879, viva i t encore un homme qui aurai t pu d ire
les scènes d ’horreur do n t Boma fut témo i n ; i l demeu
rai t dan s une pet i te facto rer ie, p rè s de l
’
O céan . Cet
LE CONGO . 14 1
homme s eta i t rendu coupab le d’
un crime atroce : une
nu i t,al ors qu’ i l hab i ta i t Boma, ses magas i n s avaien t
é té i ncendi és ,e t o n lu i avai t vo l é so n gi n e t son rhum
c’
est a i n s i que ses escl aves, poussés à bout par ses
mauvai s trai tements , avaien t réso lu de se venger .
Après une enquê te sommai re,les coupab les furen t
l
arré té s ; l eur m a ître l es pri t , r iva un co l l i e r de fer au
cou de chacun e t y fi xa une courte chai ne , don t l’
ex
trém i té fut rattachée à une longue cha i ne . Ains i l ié s
e n sembl e,les malheureux furen t embarqués e t co n
dui ts au mi l ieu du fleuve,pui s j etés par- dessus bord .
G râce à la p récautio n du m i sérab le , tous furen t noyés .
Le courant en traî na cette grappe humaine vers la
m er,mai s l e flo t l a rej e ta sur la p lage les cadavres
furen t retrouvés l i és en semble par l e con su l angla is
a Banane,e t l
’ o n con nut l e coupabl e par la chai ne
el l e porta i t so n nom gravé sur un mai l lo n . E s t- i l be
so i n de d i re qu’ i l n e fu t pas poursu iv i Ses e scla
ves lu i appartenaien t ; i l les avai t payés . De p lus , i l s
avaien t brûlé u n de ses magas i n s . Nous ta i ron s so n
nom e t sa nat io nal i té .
Boma est u n endro i t fo rt mal sa i n des marécages
p lan tés de palétuviers en tourent la s ta ti o n ; i l s’
en dé
gage san s cess e de s miasmes pes ti le n ti e l s , que le s
vents so nt impu is san ts a d i s s iper . Le s moustiques e t
le s maringou i n s son t , a Boma , u n véri tab le fléau, e t l e
fl euve est i n fes té de crocod i les .
l E ntre Boma e t Y e llala ,l’
Asso c ia tio n comp te d ix
neufstations . La p lus impor tan te, ce l le de V i v i ,s’
é lève
sur une roche escarpée ,haute de“270 p i ed s ; de blanches
142 LE CONGO .
mai so ns couro nnen t l e s ommet de emi nen ce ; o n d i
ra i t une casbah,ou vi l l e forteress e o ri en tal e . La mai
son p ri ncipale de Vivi est l a mai son de S tan l ey
confortab lemen t aménagée a cô té , des baraques ser
ven t de logement aux b lan cs . Au bas de ces construc
t i on s,en descendan t la co l l i n e
,l es dem eures des Zan
z ibar i tes, des Krowm en et des Kab i ndas cette sorte
de pet i te vi l l e i ndigè ne es t très prop re,et con t i en t p lu
s ieurs cases importantes . Par sa pos i ti on,Vivi res
semble b i en p lutôt à. un poste m i l i ta i re qu’
à. une s ta
ti o n commerciale ; c’
e s t de la que part la route qu i,
long ean t la r ive dro i te du Co ngo , rej o i n t I sangi la . De
vant Vivi , l e fl euve n’
a pas p lus de s ix cen ts mètres
de large ; mais sa pro fondeur atte i n t tro i s cen ts p i ed s .
A quelques ki lomè tres de Vivi , ap rès un coude du
fl euve,son t l es cataractes de Y e llala avan t d’ arriver
aux chutes,l e Co ngo coul e maj estueux et tranqu i l le
jusqu '
à. un large ban c de roches qu i barren t son l i t ;furi eux de l’ ob stacle qu i arrête son cours,i l s
’
é lance pourl e surmonter , et tombe de cascade en cascade jusque
dan s la dern ière chute , où i l tourb i l lo nne écumant ; l e
bru i t de la chute s ’ entend à. p l us i eurs ki l omètres.E n
réal i té ,la séri e de descen tes qui formen t l a“cataracte
n’ on t guère p lus de tre i sà quatre mètres chacune ; mai s
cette success io n de chutes et l es hauts rochers qu i l e s
su iven t , impr iment aux eaux du fleuve un e fo rce et
un e vi tes se étonnantes ; c’ es t u n chaos d e vagues fu
r ieu ses qu i semblent lutter de vi tes s e e t de vi o le nce
le sommet est couvert d’
une blanche écume,don t l es
embruns se répandent dan s l ’ai r comme un brou i l la rd
LE CONGO . 143
Non l o in des chutes,son t le s peti ts v i l lages i nd i
gènes de Y e llala e t de Kai,perdus dans un immen se
bouquet de palm iers e t de banan iers ; l a d i s tance qu i
sépare les deux vi l lages e st admirab lemen t cul t ivée
par l es ind igènes .
A Y e llala hab ite un ro i,N
’
té té M ’ bongo,don t l a d o
minatio n s ’é tend sur Ka i et tro i s ou quatre autres vi l
lages c’ est un homme d ’une ci nquan ta i n e d ’années ,
relat ivemen t i nte l l igen t ; i l a ime beaucoup le s b lancs
e t semble heureux quand un de ceux—ci v i en t lu i fa i re
vi s i te . Pou r l a c i rcons tance,i l revê t so n p lus beau
costume une blouse de la in e rouge e t une so rte de
large pantal o n de couleur foncée,ou s imp l emen t une
p ièce d’
é toffe roulée autour de ses re ins ; de l ourds
bracele ts de cu ivre ornen t ses po ignets e t ses che
vi l les . Accroup i sous la vé randah de sa maiso n,se s
femmes a ses cô tés, i l reço i t les voyageurs e t leur o ffre
une hosp i tal i té qu i n ’ es t pas toujours dés i ntéressée .
Comme Vivi,l san g i la s
’ é lève sur une ém i n ence com
mandan t le fl euve . Le vi l lage i nd igène e s t s i tué a
quel que d i stance dans les terres , sur l’
anc ie nne rou te
que su iva ie n t le s nature ls pour porter l’
ivo i re e t le s
marchand i se s d ’ échang e de S tan ley—Poo l a Sa n
Salvado r . Dans le v i l lage se t ie n t,tous les qua tre
j ours,un marché fort importan t ; les i nd ig ènes v vien
n en t,de p l us d e cen t c i nquante k i l omè tres , appo rte r
le s p rodui ts d e leurs champ s e t de l eurs basses
cours . Rien n’
e st plus bruyan t qu’
un marché a fri ca i n ,
e t le s cr i s des négresses o ffran t leurs marchand i ses
s ’ en tendent a de grandes d i s tances . Le marché du re
LE C ONGO .
1 0
146 LE CONGO .
un j our,et
,le res te du temps , l a p lace où i l s e t i en t
est déser te et s i l e nci euse .
I sangi la est l e p o i n t extrême atte i n t par l e cap i ta i ne
Tuckey ; i l l’ appela i t
,dan s so n j ournal , Sangalla .
E n face,dan s Pri nce - I s land (l
’
i l e du Prince ) , sont
enterré s les membres de la miss ion morts dans ces
parages .
Manyanga es t a un j our de marche d’
Isang i la ;
comme les deux autres stat i o n s , e l l e est p lacée sur
une hauteur escarpée ; e l l e se compose de quelques
maisons pour les Européens , et d e cases pour les
Zan z ibar i tes, que l’ o n renco ntre dans tous l es é ta
li ssem en ts fondés par S tan l ey ; i ls forment son
armée . De grands magas i n s en bri ques cui tes au
so le i l s erven t aux approvi s i onnements des autres
s tat ion s .
I l y a quelques an nées,pendant l
’
absence de
S tan ley,les i nd igènes des e nvi ro n s , des Sundi , s e
pri ren t de querel l e avec les hommes de la garn i so n
i l s reprocha ien t à. ceux - ci,d é l a i s ser errer l eurs porcs
,
qu i ravagea ien t l es p lantati o ns . Leur réclamatio n
étan t restée sans effet,i l s attaquèren t la s tati on .
Mal leur en pri t : l es Européen s e t l es so ldats zan
z ibar it e s fi ren t une sort ie , repoussè ren t les naturel s ,e t
,en man ière de rep résa i l l es
,brû lèren t leurs vi l
lages e t confisquèren t une parti e de leurs terri to i res .
A la su ite de cette rébel l i o n,Manyanga a été fortifiée
de te l l e s orte qu’ i l faudra i t des so ldats européen s et
du canon pour s’ en emparer .
Manyanga e st l e dern i er po in t de la r ive dro i te
LE CONGO . 149
appartenan t à. l’
Assoc iat i on la comm encé l e term
to i re françai s . C ’es t auss i l e cen tre d ’un marché qu i
r ival i s e avec ce lu i d’
l sang i la l a p ri ncipale monna ie
d’
échang ede cette p l ace es t l a perl e b leue ; l e foulard
rouge,l a perl e rouge , l e b racelet de cu ivre , u
’
o nt pas
la faveur des i nd igènes qu i fréquenten t l e marché de
Manyanga . Chaque régio n a,du res te
,son obj e t
d ’échange préféré .
Un peu au—des sus de Manyanga pas se la route qu i,
ds S tan l ey -Poo l , va rej o indre l e Haut-N i ar i e t co n
du it d irectemen t a l a mer’
a travers no s possess i o n s .
En tre Manyanga et S tan ley - Poo l , sur l a route
d ’ ivo ire de San —Salvador e t d’
Amb i z ette,o n ren
contre l a pet i te s tati o n de Lu te te, fo ndée par S tan
l ey el l e a pri s l e nom d’
un vi l lage ind igène s i tué
dans l e vo i s inage , rés idence d’
un pet i t ro i qu i po rte
l e même nom . Fort pacifi que du res te , e t depu is l ong
temps soumis a S tan l ey, l e j eune Lute te pass e son
temps ab o i re du soda—water, qu’
i l .appe lle eau du
d iab l e a cause du bru i t que fo n t l es bouchons e n
sautan t,e t de l ’ effervescence de cette eau gazeuse i l
co l l ect i o n ne des gravures pe i n tes d es j ournaux i l l us
tré s anglai s ; c’ es t en accompagnan t a l a cô te se s
suj ets p ortan t l’ ivo i re,qu ’ i l se p rocure ce s obj ets ;
l ’ i n téri eur de sa case en est en tièremen t tap issé ; i l
l e s montre avec fi erté aux che fs vo i s i n s qu i vie n nen t
l e v i s i ter . I l est touj ours vêtu d’
une vi e i l l e tu n ique
d’
un iforme,d
'
une jupe aux couleurs choquan tes , e t
co iffé d’un bon net de co to n .
Léopo ldv i lle s’ é lève en amphi théâtre sur le s p en te s
150 LE CONGO .
qu i forment la r ive gauche du S tan ley- Poo l ; l a sta
ti on ressemb le à. toutes ce l le s créées par S tan ley ; e lle
es t s i tuée à l’
extrémité sud—ouest de l ’é tang,près de
l’ endro i t ou l e fl euve rentre dan s so n l i t en face de
B razzavi l l e . Tout autou r de l a stat i o n s é tenden t de
grands j ard ins, b i en cu l t ivés , où poussen t en abon
dance des banan i ers des fruits,des légumes
, et
surtout du man i o c.
Bolobo,récemmen t en core la dern i ere stati on euro
péenn e sur l e haut fleuve, es t s i tuée‘
a l ’ endro i t où l e
Congo,s’
élarg i ssant démesurémen t, coul e au mi l i eu
d ’ i nnombrables îlots bo i sés ; cette s tat i on ,encore peu
importante , es t rendue part i cul ièremen t désagréab l e
par l ’ abondance des moust i ques . Créé par Stan l ey en
1882 , l a s tat i on de Bolob o eut des commencements
d iffi ci l es : elle fut détru i te par deux incend i es dus à l a
malve i l lance des ind igènes . Le second se déclara dans
l es c i rco n stances su ivante s M . Stan l ey venai t de
recon stru i re la s tat i on , et d e par ti r pour exp lorer l e
haut Congo , quand , un so i r, l e feu éclata dans la mai
son réservée au chef ; o n arrê ta un i nd igèn e s e sau
van t a toutes j ambes ; i n terrogé , i l se déclara l’
auteur
du méfai t . Quand on lu i demanda pourquo i i l avai t
vou lu brûler la stat i o n , i l répo ndi t qu’ un de ses
camarades,emp loyé comme lu i dans l ’ étab l i ssemen t
,
al lai t mou r i r ; or, c’ est la coutume
,dan s la tr ibu de cet
homme , de sacrifier un certai n nombre d ’ esclaves
sur la tombe du défun t . Vou lan t do nc fai re a so n ami
des funérai l l es d ignes de lu i, i l avai t i ncend i é l es
bâtiments,espéran t qu’une part i e des no irs attachés à.
1 52 LE CONGO .
ron t sur l e cours des affluents du Congo,é largi ront
l a zo ne exp l orée , et b i en tô t tou te cette part i e du con
t inent africai n s era j alo n née d’
un nombre con s idérable
de stat io n s a la fin de 1885,l eur ch i ffre dépassai t
déjà. c i n quante .
CHAPITRE I ! .
Les po sse ss ions frança i ses . Le C ongo pO PtU”S N .
Nous dés igneron s sous l e nom de Congo frança i s
toute l a régio n compri s e en tre l e Congo e t l’
OgOoué,
et ren ferma n t le bass i n du Qu i llou ou N iar i . E n réa
l i té,i l fa i t su i te a no s pos ses s io n s du Gabo n (1) e t
n ous cons ti tue p roprié ta i res d’
une l igne de cô te s
s ’ é tendan t de 5 ° 30’
su d à.‘2°25
’
nord , sur u ne l o n
gueur de p lus d e dou z e cen t qua tre- o i n g t
- c i nq k i lo
mètres . Tro is grand s fleuves traversen t cette régi o n
l e Gabon,l’
Og ôoué e t l e Qu i llou ,qu i re l i e S tan ley
Poo l a l’O céan .
A l’
est,notre terri to i re su i t l a r ive dro i te du Cong o
j usqu’ à l ’ équateur dans ce parcours,tro i s grandes
r ivières v i e nne n t po rter l eurs eaux dan s le Co ng o l e
Libo k o,qu i rel i e l e fleuve a O ubandj i e t do n t M . Do
l i s i e exp l o re le cours a l’ heure actuel l e ; l
’
A lim a, qu i
rej o i n t l e Congo à. l’
Og ôoué e t l es Sel i m i .
Au sud,l e Tch i loang o sépare nos posses s io n s de
cel les du Por tugal e t de l’
E ta t l ibre .
La vo i e fl uvial e la p lus importante du Congo fran
ca i s e st as surémen t le Qu i llou ou N iari,exp lo ré e t
recon nu par M . de B raz za e t ses compag nons . C e
fleuve, large de 90 a 100 mè tres , es t nav ig able par
cano t a vapeur , su r tout so n cours moyen ,e t en parti e
(1 ) Pour le Gab on , \ O l l' N os Pe t i tes C o lo n i es ,
p a r Fe rnand Hu ee t G e o rg e s l lau r ng o t ,
“1 ° é d i t io n . Lo r e ne e t O ud un
,Par is ,
-l SS £ .
15 1 LE CONGO .
sur son cours supéri eur ; i l forme un e route fluvial e
ai sémen t p rat i cabl e et de beaucoup préférab l e à cel l e
du Congo e t même de l ’Og é oué . D e p lus,cette route ,
don t nous pos sédon s l’
entrée par su i te de l ’annex ion
du p ort de Loango sur l’Atlan t ique ,travers e un ter
ri to i re françai s,éminemmen t fert i l e
,Où nou s avon s
déjà. créé p lus i eurs s tat i o n s ; el l e about i t à. cen t v i ngt
k i l omètres s eu lemen t de Braz zavi l l e . Avec u n ser
vi ce régul i e r de p orteurs,l e traj et de S tan lev - Poo l à
l’
O céan par cette vo ie peut ai sément s ’ effectuer en
v i ng t ou v in g t— ci n q j ours .
Le second cours d ’ eau importan t du Congo françai s
est l’
A l ima ,qu i s e j ette dans l e Cong o, au—dessu s de
B olob o,c’ est —à—d i re dan s la port i o n navigabl e du
haut fl euve ; c’ es t par cette r iv i ère et ses affluen ts , l e
D i é lé e t l a Passa, que M . de Brazza a rel i é , au m oyen
d ’une route carro ssab le , l e Congo et l’
Og ôoué , par
Francevi l l e .
_Vo ici
,du reste
,l ’ op i n io n d ’un homme don t on ne
peut susp ecter la part ial i té a notre égard; M . Stan l ey
La Fran ce e st mai ntenan t mai tress e d’
un terr i
to i re oues t afri ca i n remarquab le par ses d imen s i on s ,et qu i ne le cède en r i en aux régio n s trop i cal es les
p lus favori sées p our leurs p roduct io n s végétales ; i l
est ri che en minéraux et i l p romet beaucoup dans l’
a
ven i r,pour son importance commercial e .
Sa superfi c i e est de mi l l es carrés , c’
est—à
d ire qu’ e l l e e st égale à. cel les de la France et de l’
An
g leterre réun i es ; pour pénétrer dan s l’ i n tér ieur
,.i l
possède une vo ie fluv i al e de mi l les ; a l’ ouest , s e
156 ‘ LE CONGO .
insp i re comme un beso in de se reposer en admiran t,
e t en même temps comme un vague dés i r d e marcher
vers l es hor i zon s qu’ on découvre .
Sur l’Alima D ié lé,Ngampo , Leket i e t Mboch i ;
ette dern i ère p rès du confl uentde l’Alima . et du Congo .
Nkémé, sur la r ivi ère du même nom,
un peu av.—des
sus de Bo lob o .
Mbe,cap i tal e de Makoko .
Sur l e Liboko Nkoundj a .
Sur le Congo Vganchouno , e t enfin B razzavi l le .
On se souvi en t dan s quel l es circon stances ce der
n i er étab l i ssemen t fut créé : l ors que S tan l ey vint à
N tamo pour y fonder une stati o n, i l trouva M . de
Brazza déjà i n s tal l é ; l e reporter» améri ca in passa su r
l ’ autre r ive,et
,en face du poste françai s
,étab l i t l e
poste de l’A ssoc iati on . Depu i s l o rs , lu i et ses amis n’ on t
cessé de répéter que M . de Brazza avai t été b ien mal
in sp iré dan s l e cho i x de so n emp lacemen t : qu ’ i l eût
pu s ’ étab l i r sur l es hauteurs . M . John ston,que
nous avo n s déjà. eu l’ occas io n de ci ter
,donne de Braz
z av i lle l a descr ipt i on su ivante De chaque cô té de
l ’ étang,l e s p lag es s
’
aba i ssen ten p la i nes couvertes d’
é
paisses fo‘
rêts la ce i n ture de mon tagnes s ’é lève vers
l’ i n tér i eur
,e t
,l o rsqu’ on atte i n t Mfwa ou Brazzavi l le
,
la cô te es t bass e e t presqu e au n iveau de l’ eau . C’
est là
qu e de Bra z z a se van te d’
avo i r obtenu la cessi on à la
Répu b l i qu e fran ça i se d’
un terra in lon g de n euf m i l les .
Brazzav i l l e s e compo se de quelques huttes i nd igène s
ensevel ies sous des banan iers et bordées par un e
LE CONGO . 157
épai s se forêt . Sur la gauche,en face de l e tang
,ex is te
une pet i te ba ie do nt o n pourra i t fai re un bon port, e t
un îlo t ferti l e do nt les Françai s p ourra ien t t i re r u n
excel lent part i a par t ces deux avan tages, i l est im
poss ib l e de trouver l e cho ix de cette s i tuati o n le mo ins
du monde favorab le , e t même d’
en arriver a une au tre
co nclus i o n que cel le- ci l a s i tuat i o n e s t auss i mal
cho i s i e que pos s i b l e Je n e peux supposer qu’une
chose c’ es t que,en dép i t de l ’ a ffect i o n que les i nd i
gènes témo ignai en t a de Brazza,i l s n ’ on t pas m i s
b eaucoup de terra i n a sa d i spos i ti o n,e t qu ’ i l s ’ es t fixé
la parce qu ’ i l n ’a pas pu obten i r un emp l acemen t
mei l l eur
C ’ est san s doute l e dép i t qu i i n sp i re ces l ignes
et l e regret de n e pas vo i r l e d rapeau rouge de
John Bul l fl o tter sur Brazzavi l l e,a la p lace du dra
peau tri co lo re . Quo i qu’ en d i sen t M . John sto n e t se s
compatrio tes,l a stat i o n françai se n e se com
pose pas,comme a b ien voul u l
’
écri re ce voyag eur
de quelques huttes épai s ses dan s les banan iers .
Vo ic i,du res te
,l a descrip t i o n qu ’ en donne M . de
Brazza
Brazzavi l le,don t o n vous a parlé s i souvent
,es t
s i tuée sur l ’ extrém i té d ’ une croupe assez large q u i
domine l e Congo e t s ’ abaisse brusquemen t 51. cen t me
tres de la r ive,dan s u n ébou lemen t de sab le a rg i l eux .
Cette croupe semble ê tre le prem ie r obs tac l e co ntre
l equel se butte le fleuve p our al ler en tournan t se p ré
( 1 ) M . Il . J ohns ton , The Rw e r C o nua.
158 LE CONGO .
cip i ter à. la p rem iere cataracte . De là. l e regard em
brasse dans son en t ier l ’ immen s i té du S tan l ey- Pool
et tout le ci rque de hautes montagnes qu i l’ en tou
rent . Le pays es t peup l é , l e s o l est ferti l e, l’ai r est
sai n et la bri s e co nstan te d ’
ouest y apporte l a fra i
cheur re lat ive des p lateaux qu’ el l e a traversés
Quan t aux avantages que p résente sa s i tuati on,
i l s n e so n t pas mo i n s grands ; nous n’ en voulon s
do nner p our preuve que les l ignes su i van tes écri te s
par M . Stan ley, quelques heures ap rès la v i s i te dusergent Malamine , vi s i te que nous avon s racon téep lus haut
,e t qui lu i éta ien t i n sp i rées par l ’ examen
même du terra i n où s’
é lève auj ourd ’hui Braz zavi l l e
Le Gordo n Bennett es t une riv ière rap ide et p ro
fonde , qu i descend en catarac tes , et par deux bras s e
j ette dans l e Co ngo,‘
a ci nquan te mètre s e u—dessus du
premier rap ide dangereux .
S i l e Gordo n Bennett s e tai t j eté dans l e grand
fleuve deux cen ts mètres p lus hau t (c’ es t—à—d ire la où
est Braz zavi l l e) , i l eût été avan tageux pour mo i d’ ob
ten i r l e dro i t d’
étab l ir u n poste auprès du Gordon
Bennett ; j’
aurai s pu ains i m ’
assurer la n av iga t i on
d’
un e é ten du e de p lus de on z e cen ts m i l les sur le hau t
C ongo .
I l nous semb l e que cet aveu est l e p lus j uste é loge
que l ’ o n pui s se fa ire de l ’ emp lacemen t cho i s i par
M.de Brazza, et qu
’ i l n ous évi te la p e ine de réfuter
les cr i t iques de M . Johns to n . É tan t données les res
sources p lus que modestes don t d i sp o se notre com
patr iote , on peut d ire qu’ i l a t iré l e me i l l eur part i
100 LE CONGO .
La miss io n frança i s e du Congo con t inue a pour
su ivre partou t ses é tudes et ses recherches , avec l e
zè l e et l e dévouement qu i l u i o n t déjà. permis de tra
verser les d ifficul tés s i grandes et s i d iverses du dé
bu t ; e lle main t i ent dan s tout l’
Ouest afr i ca i n l’
i nfluence
françai se,l e p res tige qu i en toure notre pavi l l o n , à.
l ’ ombre duquel, g râce a l a modérat i o n dèM . de Brazza
et de ses c ompagnons , nous avon s su conquér i r la
confiance et l’
amit i é de toutes les tr ibus qui hab i te n t
ces co ntrées
Les nat i on s qu i p eupl en t no s terr i to i res sont nom
breuses c’
est d ’abord , au nord de l ’Ogôoué , l es
Pahou in s,Ossyebas ou Fans , tribus féroces , p i l
lardes et,d i t- o n , anthropophages au sud
,les Okan
das,Bang ouas, Adoumas . Dans l e bass i n du N i ar i
le s Baloumb os près de la cô te, et l e s Ballali s sur l e
haut fleuve . Sur l es bords du Congo,l es Batékés . Au
n ord de l’
Alima, l es Ba-Pfourous
,l es Oubangui s et
l es Mbocos .
Toutes ces nati o n s on t entre e l le s beaucoup de
s imi l i tude,au mo in s dans l eurs coutumes nous les
é tud iero n s au chap i tre su ivant,en même temps que
les autres races du Congo . Pour l e moment,qu ’ i l n ous
suffise d e d ire que leur féroc i té a été s i ngul iè remen t
exagérée par certai n s voyageurs,peu t—ê tre pour exon
ser une répress io n s i no n i nut i l e,du mo in s par trop
cruel l e . Lorsque M . de Brazza a pu p ersuader a ces
peup lades qu ’ i l n ’avai t r i en de commun avec cet autre
b lanc qui avai t des cendu l e Congo que lque temp s
avant lu i,qu’ i l n ’ éta i t pour ri en dans les représa i l le s
LE CONGO . l t'
l
lexercéespar l e voyageu r améri ca i n , i l a ob tenu de ce s
tribus tou t ce qu ’ i l a voulu ,e t s
’
en es t fa i t no n seule
men t de s amis, mai s encore des al l i é s e t de pu i ssan ts
auxi l iai res .
Le no i r es t défi an t cra i n ti f, e t veu t ê tre tra i té avec
douceur ; de p lu s , i l est essent i el lemen t supers ti t i eux
tan t qu ’ i l n ’ a pas compr i s l e but que poursuiven t les
Européen s en venan t s’
i n s tal l er chez lu i,i l es t d isposé
a vo i r e n eux de mauvai s gén ies ; dans l eurs actes ,
qu ’ i l n e comprend pas,qu i l u i semblen t surnature ls ,
i l cro i t vo i r des maléfi ces . Mais,quand a fo rce de
pat ien ce,de douceu r e t de bon s p rocédés
,on lu i a fa i t
entendre ce que l ’ o n attend de lu i,i l devien t tou t (118
posé à nou s recevo i r, et mêm e a nous aider .
Le Congo p or tuga i s est mai n te nan t compri s en tre
les r ivi ères Camba et Cuango a l’ es t ; au nord ,
i l e s t
l im i té par une l igne imagi na i r e qu i,partan t de cette
même rivière Cuango , v a rej o i nd re l e Congo a Ko k hi ,e t par la r ive mérid i onale du Congo à. l ’ o ues t .
par l’O céan ,depu is l a Pun ta de l Pad rao
,a l
’
embou
chure du fl euve,ju squ ’
à. Ambri z au sud,par la pro
vince d’
Ang o la . Au nord du Congo , l e Portuga l po s
sède encore un pet i t terri to i re p ri s sur l’E tat l ib re
e t séparé du Congo français par l e Tch i loang o su r
la cô te so n t les pet i te s v i l le s de Landana, Ma l emba e t
Jab i nda .
Cette po s sess io n es t prospère ; depu is quatre cen ts
a n s que les Portuga i s so n t é tabl i s dan s cette régio n ,
i l s y on t créé de s é tabl i s sements sé rieux e t possè
de n t un g rand nombre de facto reri e s répandues dan sLE CONG O . 1 1
162 LE CON GO .
tout l e pays . C’ es t grâce a certa ines concess i o n s fai te s
par l e Portugal que nous avon s obtenu la reconnai s
sance de nos dro i ts de s ouvera i n eté sur la r ive dro i te
du Congo ; nous avons don c un in térê t rée l à . con ser
ver l es sympathi es de ce p eup l e,qu i
,dan s cette région ,
a déjà. tan t fa i t p our la cause de la c iv i l i sat i o n i l a
fondé des éco l es,l an cé des bateaux avapeur sur l e
grand fl euve , et créé des l ignes tél égraph i ques . Pres
que tout l e commerce de la con trée es t en tre s es mains
c’ es t dan s l es p o sses s i on s p ortugai ses que les tr ibus
de l ’ i n tér i eur apporta i e n t l eurs p rodu i ts la p lupar t
des tra i tan ts du bas Congo son t Portugai s , et , grâce
à l’
i n fluence con s idérab l e qu’ i l s o n t su prendre dans
tout ce pays , i l s p euven t favori ser nos p roj ets et n ous
a ider dan s no tre œuvre de c ivi l i s at i on .
On a accuse et l ’ o n accuse e ncore l es Portugai s ,
s inon de fai re la tra i te des no i rs,tout au mo i n s de la
favori ser . Certai n s auteurs,d e bon ne fo i , o n t écr i t que
les Portugai s a l la ien t dan s l ’ in tér i eur chercher des
caravanes d e bo i s d’
e'
bèn e nous croyo n s que ces écr i
vain s o n t é té i ndui ts en erreur et qu’ i l s on t p r i s p our
des suj ets du ro i de Portugal des mét i s p o rtugai s
hab itan t l ’ i n tér i eur . Camero n,dan s s o n voyage , parl e
e n effet de bandes d ’ es claves achetées e t co ndui te s
par des Alvez,des Co imbra et autres mé ti s p ortan t d es
noms portugai s ; mais ces b rutes n e p euven t ê tre p ri s
pour des E uropéns ; l eur n ombre es t , du res te,for t
restre i nt . Nous tra i teron s cette ques ti o n au chap i tre
que nous con sacron s à. l’es clavage .
104 L E CONGO .
en fan ts de la nature,ignoran t jusqu a l
’
exi s ten ce de
la c ivi l i sat i o n,ayan t tous les vices e t toute s les qua
l i tés de l’homme p r im i t i f .
La race Bantou se d i s ti ngue par une g rande pureté
de formes les hommes sont de haute tai l l e,b ien
b ât i s,avec des extrémi tés fi nes et dél i cates ; l a figure
est bel le,l e nez p eu ou po i nt épaté
,l a cheve lure abon
dante,crépue mai s n o n la i neuse ; la barbe es t l ongue
et b ien fourn i e .
San s ê tre abso lumen t j o l i es , l es femmes son t cepen
dant lo i n d’ ê tre aus s i la ides que les négresses en géné
ral ; comme les hommes , el l es so nt b i e n fa i tes,l eurs
tra i ts o nt une certaine régu lari té,et la p lupart
,sur
tout quand el l es sont j eunes, son t fort graci euses .
Plus o n app roche des r ivages de l’Atlan tique ,p lus
ces caractères d i s t i n cti fs d im i nuen t, e t même di spa
ra i ssent . Sur certai n s p o i n ts du l i ttoral,o n ass i s te
aun phénomène d ’abso rp t i on qu i méri te d ’ ê tre s ignalé ;i l est surtout remarquabl e dans la part i e s epten tri o
nale du Congo françai s,sur la r ive gauche de l
’
Og ôoué ,
et dans notre co l o n i e du Gabon .
Les p eup lades qui hab i ten t l e l i tto ral n e s ont pas
origi naires de la côte ; el les vi en nent de l ’ es t,et
,
comme la p lupart des nat i o n s r ivera i n es,e l l es s em
bkufl: avofi *
o b é i à. une grande un de n üg raü on qu i
pousse l es nat io n s du centre vers la mer . C es dép la
cements s ’ opèren t avec le n teur, m ai s fatal emen t, e t
touj ours au préj ud i ce des premiers o ccupants . Parti
du centre de l’
Afr i que, l e trop —p l e i n d’une tribu
s’
avance vers l es rives de l’O céan,poussan t devan t
LE CONGO . 165
l u i d’
autre s tribus ; ce l les— c i, à. l eur tou r, se me tte n t
en marche e t absorben t les nati o n s qu’
e’
les re nco n
tren t ; el les -mêmes fi n i s sen t u n j our par ê tre abso r
bées e t con fondue s dan s l a foule d ’ un autre peup l e qu i
arrive . C’
es t l e cas des Pahou i n s qu i,venus des terr i
to ires de l’
E s t, chasse nt d evan t eux les Kakala i s .
C e travai l d’
abso rp t i o n es t pu i s sammen t a idé,d ’ai l
l eurs , par la tran s fo rmatio n qu i s’ opère au contact
des Européen s sur la cô te . A notre fréquen tati on,i l s
dépou i l l e n t e n parti e l eu rs croyances superst i ti eu seset l eurs coutumes barbares
,ma i s i l s perden t auss i
l eur vigueur nat ive . Pr im i t ivem en trobustes,i ls s
’
ahru
t i s sen t par l a bo i s son e t s’
use n t dan s les excès .
C e phénomèn e de migrat i o n n’
e st pas n ouveau au
xvee t au xwe s iècles
,les Jaggas ou G iaggas , u ne
grande nation hab i tan t les terri to i res q u i s’ étendent
au sud du Tangan i k a,en tre les sources du Za i re e t
du Zambè z e,s’
avança comme un fl o t envahissan t jus
qu’
aux r ive s de l’O céan I nd ie n . Sous la condu i te d’
un
chef nommé Z imbo , ces hordes p i l l ardes ravag è rc n t
Mon tba z e,Zang uebar e t Qu i l oa ,
se répand i ren t dan s
le pays des Cafres,pu i s
,revenan t sur l eurs pas , e l les
envah iren t le grand royaume de Congo e t m enacè rcn t
son pu is san t monarque j usque dan s sa cap i ta le de
San - Salvador .
Nous d ivi serons les peup l es qu i hab iten t l e bass i n
du Congo en tro i s classe s tr i bus de l a cô te e t du bas
Congo ; tr i bus vivan t sur le s terri to i res frança is ;
tribus du haut Co ngo .
Outre ces tro is d ivi s i o ns,nous pourri o n s e n aj outer
166 LE CONGO .
une quatr i è me comprenan t l e s hommes de races d iffé
GUERRIER BATÉKÉ .
rente s,qu’ i l s s o i en t venus s é tab l i r au Congo comme
e s claves, .ou qu’ i l s y so i en t à t i tre d ’
engag és tempo
rai res, comme le s Krovvmen ou les Krowboys .
CHAPITRE ! I .
Ilab i tan ts de la cô te . V i lle s e t V i llage s . La v ie . Ma r i age s.
K rowm e n . E sc lave s .
Sur tout l e l i tto ral , e t no tamment dans les po sses
s io n s portuga ise s ,on renco n tre les fi l s dégénérés des
Ka- Kongo ou Kab indas,des Much i ro ngo s , et des
Ba- Kongos . Sans accep ter en t ièremen t la C i v i l i sat i o n
européen ne,i l s o n t mêlé a l eurs coutumes anci ennes
quelques - unes de cel l es des Portugai s un grand
nombre on t adop té la re l igio n chré ti enn e,sans cepen
dan t abandon ner les supers ti ti o n s qui fo rmen t le fond
de l eurs croyances ; beaucoup auss i o n t renoncé a la
paress e e t a l’
i ndo lence communes a tous le s hommes
de race no i re . I l s trava i l le nt , e t, véri tabl es li rowm en
du sud,s e l ouen t comme mari n s
,porte fa ix
,labou
reurs ; i l s passe nt avec ceux qu i le s empl o ien t de s
contrats pour un certa i n n ombre d’
an nées,e t , le temps
de l eur engagement te rm iné,retournen t dans leur
vi l lage,rapportan t toutes leurs économies , qu
'
i l s s’
em
pres sen t de dévorer e n compagn i e de l eurs parents
e t de leurs ami s .
Le s Ba- Kong os son t g énéral emen t cons idé rés
comme la natio n au tre fo is mai tresse de tous ce s ter
r i to i res ; c’ es t ce peup l e qu i j ad is fonda le g rand cm
da C o n p i reg o ,qu i ex i s tai t e nco re i l v a quatre cents
U
170 LE CONGO .
a n s,et qui fut démem bré en 152 1 par deux i nvas io n s
success ives de G iaggas .
Au jourd’
hui , rédu i te à quel ques tr ibus , cett e peu
plade hab i te p rè s de la cô te , autour de San -Salvador,
sa cap i tale,où règne touj ours u n ro i du Congo . San s
réal i s er l e typ e pur du Bantou,i l s o n t cependan t
conservé quelques - un s de l eurs caractère s propres ,au po i nt de vue phys i que
,notamment la barbe . S ’ i l s
son t,malgré leur contact avec l es Europ éen s
,au ss i
peu vêtus que leurs congénère s de l ’ i n téri eur,i l s
s emblen t avo i r renoncé aux ornements dont s ’ affu
b len t ces dern iers ; i ls son t rarement tatoués , ou cou
turés de ci catr i ces ; seul s , quel ques - un s o n t con servé
l ’hab itude de se l im er l es deux i nci s ives de la mâcho i re
supérieure .
I l s sont généralemen t doux et pacifiques , semblen t
avo i r une horreur p ro fonde p our toute e ffus i o n de
sang,amoin s cependant qu’ i ls n e so i en t accusés de
sorcel l eri e ou qu’ i l s s e cro i en t v ict imes d ’ un maléfice :
dans ce cas,l eur co lère n e connaî t p lus de bornes
,e t
i ls sont capab les de se l ivrer à. toutes l es cruau tés e t
à. tous les excès .
Ce n ’ est véri tab lemen t qu a part i r de S tan l ey- Pool,
en remon tan t l e Congo,qu’ o n retrouve l es mœurs et
l e s coutumes des i nd igènes , c’ es t- à- d ire, su r la r ive
gauche,chez lesBa- sund i
,l e s Ba -wende
,l esWabuno ,
et sur la r ive dro i te , chez l es Batékés .
Quo i qu’
e lles fas sent part i e d ’une seu l e et même
fami l l e,i l n ’ exi ste aucun l i en , aucune cohés ion
entre ces p eup lades : l eurs mœurs,son t à. p eu de
172 LE CON 3 0 .
tre i n t d’hab itan ts
,et ce que l
’
o n dés ign e sous le nom
de vi l l e n ’ es t,à proprement parler, que la réun i o n de
tro i s ou quatre v i l lages .
Plus o n avance dans l ’ i n téri eur c’
es t- à -d ire
plus o n s ’ é lo igne des po i n ts Où a péné tré la c ivi l i sa
tio n,p lus l ’ i ndustri e des p eup les est dével oppée : les
vi l lages so n t p lus spacieux,mieux co ns tru i ts ; l e s
mai so ns son t fa i tes avec p lus d ’ art et l e s us ten s i l e s
do nt s e s erven t le s indigènes dénoten t une p lus
grande somme d ’adresse e t de trava i l .
En général,sur l e hau t fl euve
,l e v i l lage se com
pose d’
une large rue b ordée de maison s rectangu
l a i res ; quel qu efo i s , l es vo ies rayo nnen t autour d’une
p l ace centrale : dan s l e p remier cas,une hab i tat ion
p lus grande que les autres s’é lève à chaque bout de
la chaussée,fai san t face au m i l i eu de la rue : c ’ es t
la que se t i en nent l es grandes assemb lées .
Les maiso n s so nt rectangula i res ; el l es s e lèven t
sur u n ban c de terre battue,sorte de p late - forme
haute d ’ un p i ed . La charpente est fai te de troncs d e
palmiers et l es mura i l l es de latte s fines,
e ntre- cro i
sées et recouvertes d’
une épai s se couche d ’herbes
sèches . Le to i t, t rè s débordant, forme , devant l’en
trée de la mai so n,une large v érandah don t l’ extré
m i té e st supportée par deux troncs . Quelques —unes
d e ces demeures,en tre autre s cel l e s d
’
Ikoundou,
so nt tout s imp l ement de doub l es cages é légamment
fa i tes avec la t ige du p e n i s . Chacune des cages a sep t
p ieds de lo ng,c i n q de large e t s ix de haut . Toutes
les deux sont re l i ées par la to i tu re et o n t entre e l l es
1 75 LE CONGO .
des jard in s b ien en tretenus,où l es indigènes cul tiven t
le s b ananes , l e p lan ti n e t surtou t l e man ioc,base de
l eur n ourri ture, à l aquel le i l s aj outen t l e po i s son
frai s ou fumé . e t des graines de toutes sortes .
Ces vi l lages so n t peu p eup l é s d e deux cents à.
s i x cents hab i tan ts , en moyen ne . Les hab i tan ts s o n t
forts et vigoureux . Cel a ti en t,en tre autre s choses
,à.
ce qu’
i l y a chez eux un e sorte de sé l ect i on naturel l e
e n fai t peu de cas des e nfan ts chéti fs , e t l’ o n ne prend
so i n que de ceux qu i v i ennen t au monde b ien con s
ti tués ; i l e n résulte que les hommes fa ib l es e t m ala
d i fs so nt l’ i nfim e mi n’
or i té .
Les en fan ts so n t,du res te
,soumi s à. un mode d edu
cat i o n tout sp écial dès qu ’un en fan t v i en t au monde,
sa mère qu i tte la mai so n commune et v i t a part jus
qu’
à ce qu ’ i l s o i t s evré,c
’
es t - à—d i re j usqu ’
à. tro i s an s ;l a mère al la i te s o n en fan t tan t qu’ i l n ’ a pas p ercé ses
dents . Quand la mère revien t dan s la fami l l e avec sa
p rogén iture,s i c’ es t u n garç o n qu’ el l e ramèn e
,l e p ère
s e charge de so n éducat i o n,lu i app rend à. nager
,à
fabriquer un arc e t des flèches et a s’
en servi r,à
tendre des p ièges à gib ier,en un mot , i l l
’
hab i tue à
tous les exerci ces du corp s,e t le met
,fort j eun e , à. m ême
de su ffire a s es beso i n s . S i c’ es t un e fi l l e, el l e rest !
avec l es femmes , qui l’
i n i ti en t aux s ecrets du ménage,e t alors co mmen ce , p our la pauvre en fan t , cette vie
de dur labeur qu i do i t durer jusq u ’
à sa mort .
La femm e e s t tra i tée par l ’Afr i cai n,n i p lus n i
mo i ns qu’ une b ê te d e s o mm e ; c’ e s t ell e qu i p répare
le s repas,l ab oure l e champ
,cul t ive le j ard i n , so igne
LE CONGO . 1 77
les an imaux ,tres se les corbei l l es
,fabr i que les pote
r i es ; en route, el l e p orte l es bagages . E tan t donnés
les services que renden t ces malheureuses créatures ,et l a paresse des hommes, o n comprend que ces
peup les so i en t po lygames .
Dan s la p lupart des tr ibus , l e mariage ne donne
l i eu à aucune cérémon i e,c’ est un achat , e t r ien de
p lus . Cependan t,Livi ngstone chez les Manyenas, et
Cameron dan s l’Ouroua ,o nt été témo in s de semblants
de cérémon i es
Les Manyenas, d i t Livi ngstone , achèten t l eurs
femmes une j eune fi l l e vaut d ix chèvres . Auj ourd'
hui,
j’
en ai vu conduire u ne au domici l e conj ugal . E l l e
marchai t gai emen t,accompagnée d ’une servante et
suivi e de l’ épouseur . I l s vo nt rester ci n q j ours chez
eux , pui s i l s revi endron t chez les parents de la femme,où cel l e - c i restera égalemen t c i nq j ours
,aprè s l es
quel s son ép oux i ra l a rechercher de nouveau .
La cérémon i e décr i te par Cameron est un peu p lus
comp l i quée : l a fê te dura p lus i eurs j ours . Deux
tambours battus v igoureusement fai sa ien t tourner
une douzai n e d ’ i nd ividus ceux— c i éta i en t pourvus de
gross i ers p ip eaux d ’où i l s t i ra ien t des notes d i sco r
dantes . Une foul e en thous ias te j o ig na i t a ce charivari
des cri s p erçan ts,accompagnés de battements de
main ; et cela n e s’
arrê ta i t pas : quand un dan seur
étai t fatigué,un autre prenai t sa p lace .
Dan s l’après -mid i du seco nd j our,apparut l e
mari é ; i l exécuta un caval ie r seul qu i dura une demi
heure . Au momen t où ce so lo fin issa i t,une j eune fi l l e
LE CONGO .
1 78 LE CONGO .
de neuf a d ix an s , parée de ses p l us beaux atours rut
app ortée près des dan seurs . Cette j eune fi l l e, qu i
étai t l’ épou sée , arr iva i t a cheval sur l es épaules
d ’une robuste commère,où la mai ntenai t une autre
Œmm e
On en toura les arr ivan tes ; pu i s la porteuse, s e
mettant à bond i r,fi t sauter la mar iée, don t l e corp s e t
les bras s e lai s sai en t al l er à. l ’abando n . Quand la pau
vre en fant eut été suffisammen t secouée, l’
époux lui
don na de p et i tes quan t i té s de p erl es et des fragments
de feu i l le s de tabac qu’ e l l e j eta,l es yeux fermés
,parmi
les dan seurs . Ce fut l e s ignal d ’une lutte ardente,
chacune de ces bribes devan t porter bonheur à celu i
qu i Pobfi endraü.
La mariée fut ensu i te déposée à terre et dansa
pendant d ix minutes avec l e marié,qu i tout a coup l a
mi t sous so n bras et l’ emporta chez lu i .
Chaque Afri ca i n épouse l e p lus de femmes qu’ i l
peut,augmentant a i ns i l e nombre de ses servi teurs et
des ouvr iers qu i travai l l en t à. son b i en - ê tre en revan
che,el l es n e coûtent r i en à l’homm e ; que l e prix d
’
achat,
c’ est—à—d ire une somme fort m in ime, puisqu’ e lles cul
tive nt la terre et fon t e l l e s - mêmes leurs v é tements ,qu i
son t des p l us s imp les .
Les hommes porten t un e sorte de j upe fa i te d ’her
bes sèches et te i n tes en brun marro n ; l e co stume des
femmes est,
‘
a peu de chose p rè s,l e même
,s i ce n ’ es t
que la jupe est p l us l ong u e . Dan s certai n es tr ibus ,cel les desManyenas ,par exemp le , le j upon est remp lacé
par une ce i n ture ; chez le s Kab i ndas , au co ntra i re ,
LE CONGO . 18 1
le s femmes se drap en t dan s u ne l o ngue p iece de co to n
nad e aux coul eurs voyantes e t de fabricati o n euro
péenne , qui tombe des épaules jusque sur l es p ieds .
Les en fan ts des deux sexes von t nus,le s fi l l e ttes po r
tan t pour tout un co l l ier ou un bracele t d e
cu ivre . Cet ornement es t for t répandu dans tout l e
Congo,chez l es homm es et chez les femmes ; dans
certai nes tr ibu s de l’
Ouroua et du ! Lovale, l e
co l l i e r es t r ivé au cou de l ’ épouse par so n mar i ; el le
l e p orte jusqu ’à. sa mort .
Un j our,le l ieutenan t Camero n demandai t à. un
grand che f comment,à. l a mort d ’une de ses femmes ,
i l s ’y prenai t pour re ti rer l e co l l i er . Le chefn e répon
dit pas , mai s i l pas sa son do igt étendu contre so n cou ,
en fai san t un ges te s ig n ificat i f. On leur coup e la
gorge pour ô ter l e co l l i er .
Hommes e t femmes se te ig nent le s o ng l e s en rouge ;i l s obti ennen t cett e cou leur en tr i turan t l ’ éco rce du
Bap hi a ,qu’ i l s emp lo ien t auss i pour te i ndre leurs vé te
ments et s e tatouer .
Le tatouage est général ; i l s e fai t, so i t au moyen de
pe i ntures b lanches,jaunes ou no i res , so i t par de s
c i catri ces . La c i catr isa t i on s’ obtien t en sou levan t, dcs
lambeaux de peau,avec la lame d ’un cou teau ; o n i n
trodu i t en su i te dans la b les sure une drog ue i rr i tante
pour l‘empêcher de se ferm er trop vi te , e t pour qu’
el le
lai ss e une ci catr i ce p lus apparente e t durab le . Cette
opérati o n se prat i que sur la fig ure e t sur tout le corps ;l e nombre d ’
i nc i s i o ns qu i bala fren t les joues d‘
un
guer r i er,vari e su ivan t la tr ibu
,l e rang ou le g rade
182 LE CONGO .
I l serai t fort d i ffici l e de décri re les d iffé ren tes co if
fures de ces i nd igènes ; i l y a presque autan t de mOdes
que d ’ i nd ividus en tous cas , l’
arrang em ent des che
veux est,pour les hommes comm e p our les femmes ,
une impo rtante occupati o n . Les un s héri s sen t l eu r
tête d ’une foul e de p et i te s co rnes fa i te s avec des m è
ches de cheveux endui tes de terre g lai s e ; d’autres
n’
en fo n t que quatre ou ci n q , qu i son t é normes ;d ’ autres
,au contra i re
,o n t l a tê te en tiè remen t rasée
,
n e gardan t , comm e les mahom é tan s,qu
’
un e tou ffe sur
l’
o cc iput . Un certai n n ombre endui sen t leur cheve
lure de terre glaise e t l a p laquen t de faço n a lu i fa i re
p rendre exactemen t la forme du crân e,sur l e devan t
d e la tê te,tand i s que derr ière i ls l a dép l o ien t e n éven
ta i l ou l ’ en rou len t en un énorme chigno n .
Le s femmes o nt les co i ffures le s p lus extraordi
na i res, so i t qu
’ el l es é l èvent avec l eurs cheveux un
édifice formidable , soutenu par une carcasse de j o n c,so i t qu’ el l es le s tressen t en un e i nfin i té de nattes mi
nu scule s qui p enden t sur l eurs j oues . Quand l ’ar
rangemen t de la chevel ure est fin i,arrangemen t trè s
comp l i qué, d i t Cameron , l’ en sembl e e st revêtu d ’un e
couche d e gra i s s e et d ’argi le que l ’ on travai l l e de
man i ere a la rendre l i s se et br i l lan te . Quelques
femmes d ivisen t l eurs cheveux en une quant i té depet i tes houppes , de la gross eur d
’une ceri se ; d’autres
en composent des to rt i l l o n s do nt el l es formen t des
boucles , tan tô t séparées , tan tôt réun ies et mê lées
d’
une faço n i nextri cab le . Quelque fo i s,c ’ es t une masse
de grosses torsades dont l es bouts sont d i sposés de
184 LE CONGO .
frotten t l es yeux,l es femmes se l ivren t aux travaux
du ménage et s ’ occupen t des enfan ts .
Le lever du so le i l,qu i ramène la chaleur et la v i e
,
met un terme à. cet engourd i s s ement l e v i l lage
s’
an ime , les femmes sorten t des mai soqs, saluen t
l eurs vo i s i nes et commencen t les app rê ts du repas ;les hommes préparent l eurs engi n s de chas se ou de
pêche, et s
’ é lo ignen t pour v i s i ter l eurs p i èges et l eurs
fi l e ts ; ou b ien , i l s réun i s s en t l es marchandi ses qu’ i l s
do iven t p orter aux marchés qu i s e t i ennen t dan s les
grands vi l lages .
I l e stdiffic i le de d ire quel les sont l es heures de repas
des i nd igènes toute la j ournée les femmes son t occu
pées à p réparer de la nourriture, et les hommes man
gent a tout in stan t ; mai s l e repas pri nc ipal do i t ê tre
cel u i du mat in,après l eq
‘
uel chacun va s e l ivrer à. ses
occupat i ons . Les femmes von t au champ , cul t iven t la
terre,fabri quen t l es poter i es ou con struisen t l es cages
pour les vo la i l l e s .
A mid i , tout l e monde s e réun i t s ous l a vérandah ;l es hommes fon t la s i este ou fument l es femmes cau
sen t ou se peignent . Quand la chaleur es t passée,chacun va reprendre so n travai l .
Le so i r, après l e coucher du sole i l,l o rs que les
hommes so nt rentrés au vi l lage,l es groupes s e fo r
ment,o n cause en buvant du vi n de palme ; que lque
fo i s (l e fai t est heureusemen t rare) , pour s e d i s tra i re,on brûle un malheureux accusé de sorcel l er i e
,ou on
mange un pri so nn ier, chez les O ssyebas ou les Ma
nyenas ; ou b ien , p la i s i r p lus i n nocen t, on danse au
LE CONGO . 185
son d’un in s trumen t b i zarre . Les sortes de dan ses
son t nombreuses ; mais M . Stan l ey en décri t une fort
cur i euse , don t i l a é té témo in chez les N’
dung o s .
Une cinquan te d’
i nd ig èn es dan saie n t devan t lu i
Les figures,con s idérées au po i n t d e vue i nd i
gène,n e l a i s sa i en t r i e n à. dés i rer ; el l e s étaien t exé
cutées avec u ne grande hab i le té ; ma i s l a final e méri te
d ’ être no tée les danseurs s e tenaien t par la ma in ,comme dan s le s ro ndes que fon t le s en fants , e t for
ma i en t un grand cercl e . Deux d’ en tre eux péné trèren t
dan s l e rond l e p lus j eune grimpa sur les épaul es de
l ’au tre,pu is
,t i ran t so n couteau
,poussa u n grand cri ,
répété par l e chœur . Chaque fo i s que ce cr i é ta i t j e té
par l es dan seurs,i l p romenai t l e tranchan t de son
couteau sur sa langue j usqu’
à. ce que l e sang v i n t .
Alors,l e cercl e v ivan t s e metta i t à. tourner p lus v i te
a chan ter p lus fort ; imi tan t l e mouvemen t des dan
seurs,l e j eune garço n se ta i l lada i t la langue p lus vite
e t p lu s fort,j usqu ’
à. ce qu’ i l eû t le s mâcho i res p le i ne s
de sang .
J e cr ia i : Halte La ro nde s’arrê ta ,
le j eune homme
serra tran qu i l lemen t so n couteau,se le va la bouche
avec de l ’ eau fra îche e t vi n t m e regarder e n sourian t ,
san s para i tre autremen t i n commodé .
Ce n ’ es t que tard,dan s la nu i t , qu
’
au mi l i eu de s
r i res e t des chants , chacun reg ag ne sa demeure , pour
recommencer l e l endemai n une j ournée en tout sem
blab le a la précéde n te .
C e s rmmndafi o ns, à fexüfi e nce cui appare nce s i cahn e
et s i tranqu i l le,son t dévo rée s par une p l a i e ho n teuse
186 LE CqNGO .
l ’ esclavage . La trai te des n o i rs ex i s te dan s tout l’ i ntér i eur du co nti nen t ; chaque tr ibu a ses escl aves
,
qu’ el le en l ève dan s s es guerres avec l es p eup l ades
vo i s ines et qu’ el l e achète aux tra itan ts arabes contre
de l’ ivo i re et du caoutchouc , ou qu’ el l e l eur vend en
échange de poudre , de p erl es , de coton nades . Sur la
côte occidentale , s i l a trai te n’ exi s te p lus , l
’escl avage
exi ste en core,d ’ une faço n dégui s ée
,i l e s t vrai
,mai s
i l exi ste et i l exi stera touj ours tan t que les i nd i
gènes trouveron t a troquer un no i r , en l evé dan s un
vi l lage vo i s in,con tre l es p rodui ts européen s ; i l ex i s
tera touj ours tan t que l es hab i tan ts qu i o n t beso i n de
travai l l eurs i nd igènes n’
auro n t pu amener l es naturel s
adon ner l eur travai l co ntre une rémunérat i o n quel
conque .
Sur l e l i tto ral,l es Européen s engagen t des Krowm en
et des Krowb oys ; nous avon s déjà d i t ce qu ’ êta ient
les premiers dan s n os po sses s i o n s duGab on : des en
gagés pour un temp s l imi té . Au Congo , e t n otamment
dan s l es p o ssess i on s portugai ses , l a dén omi nat io n de
Krowm en ne s ’ app l i que pas aux i ndividus travai l lan t
dan s l es mêmes co ndi t i on s . Les engagés venan t d e la
cô te de la Krow s ’ app el le nt Krowboys .
i ls sont comp l è tement i ndép endants,con serven t
,
chez l es nat ion s où i l s travai l l en t,l es coutumes d e
leu r pays , viven t en dehors des autres hab i tan ts ; i l s
s e réun is sen t un certai n nombre,co nstru i sen t une
grande case et hab i ten t en semb le . Leur temp s de ser
v ice termi né,i l s retournent i nvariabl emen t chez eux
avant de co ntracter un nouvel engagemen t,ce qu ’ i l s ne
188 LE CONGO .
cipaux de l’
Asso c iat ion créatr ice de l’E tat l ib re du
Congo,i l y a tout l i eu d
’
espérer que cette p lai e aura
b ien tô t d i sparu de tout l’
Ouest afr i ca i n ; pour cela, i l
suffi t que les trai tan ts de l ’ in téri eur ne trouven t p lus
avendre l eur marchand i s e humai ne , et que les Euro
péens étab l i s sen t avec l es chefs des tr ibus un mouve
ment commercial suffi sammen t rémunéra teur n ’ayan t
p lus de débouchés pour les esclaves,l es tra i tan ts n ’en
achèteron t p lus et n e p ortero n t p lus la déso lat i on et
l a mort dan s les con trée s de l ’ in tér i eur .
S i l a mi sère de l ’esclave tran sporté lo in de sa patri e,
.
qu’ i l n e do i t p lus revo i r,séparé de ses paren ts
,sou
mis a un travai l p én ib le et p eut— ê tre en butte à. de
mauvai s tra i temen ts,est révo ltan te
,que d ire de l a fa
con do nt ces malheureux son t en l evés , des cr imes
i nou i‘
s qu i s e commetten t au cœur de l’
Afri que pour
se l es pro curer ? Livi ngstone est imai t a un mi l l i on
d’hommes chaque année les v i ct imes de la trai te .
Camero n,qu i a parcouru la route de Nyang oué à.
Bihe avec un convo i d e femmes escl aves , écr i t :
La somme de misère et l e nombre de morts q u’
a
vai t p rodui ts la capture de ces femmes (el l es é ta ien t
c i nquante- hui t) es t au delà. de tout ce que l’On p eut
imagi ner . Il faut l ’avo i r vu pour l e comprendre . .
Pour obten i r l e s cinquante- hu i t femmes don t Alvez
se d isai t propri é ta i re,d ix v i l lages avaien t été détru i ts
,
d ix vi l lag es ayan t chacun de cent à deux cents âm es
Un to tal de qu i nz e cen ts hab itants Quelques- uns
avaien t pu s ’ échapper mai s la p lupart avaien t pér i
dans le s flammes,été tués en dé fendan t l eurs fam i l le s
C IIAPITRE ! II.
Re l i g ion . Funé rad les . Sup e r s t i t ion . Légende s .
Sorc i e i s .
On n e p eut appeler rel ig io n ou cul te,le s pratiques
supers t i t i euse s auxquel les se l ivren t tou s ces i nd igè
nes ; i l s n’
o n t qu ’une croyance l ’ i n fluence co n ti nue l l e
d e s mauva i s espr i ts sur tou te leur v i e ; tous l eurs
e fforts tendent do nc a l es écarte r .
Infirm i tés, malheurs, malad ies
,maux de tou tes
so rtes , so n t l e résul tat de m aléfice s o u de sorti l èg es
j eté s par un en nem i , souven t i ll \'
lS lb l0,con tre l equel
i l s n e peuven t se défendre : l eur exi s te nce se passe
dans de s cra i ntes cont i nuel les .
Pour conjurer les mauva is esp ri ts e t auss i pour
accomp l i r certa i nes cérémo n ies secrè tes,i l y a deux
sortes de so rci ers ou féticheu rs : les N’
him bas e t les
N’
gangas .
Le s p rem ie rs ne so n t pas po s i tivem en t de s feti
cheurs ; ce so n t p lutô t les membres d ’une con fréri e
do n t o n n e co nna i t pas exac temen t le bu t e t l’
o rg a n i
sat i o n . Cette franc - maçonneri e se compose de j eunes
gen s de douze a qu i n ze an s,e t que lque fo is d
’
hommes .
La période d’
i n i t iat i on, qu i comp te tro i s ou q ua t re
degré s,dure deux années i nd igè nes
,c
'
es t—à- du e
douze mo is ap rès quo i l e N’
k imba ren tre dan s l a
vi e commune .
7. F CO NG O .
194 LE CONGO .
Pour se d i s t i nguer des autres,ces hommes son t
ta toués d ’une façon parti cu l iè re leur co rp s est ent iè
remen t recouvert d ’une couleur b lan che qu’ i l s fabri
quen t au moyen d ’une terre spécial e ; pendan t l es s ix
p remiers mo i s de l eur novi ciat,i l s ne se l aven t pas
u ne seul e fo i s , de cra in te d’ en lever cet endu i t
,qu ’ i l s
o nt au co n tra i re la précauti o n de renouve ler souven t .
Duran t toute la durée de leur i n i t iat i on , i l s son t nour
r i s aux fra i s de l eurs conc i toyen s .
Les N ’
k imbas ne v iven t pas en con tact avec les
profanes , i l s évi ten t surtout l a renco n tre des femmes
et des en fan ts,qui , ne pouvant être in i ti é s , son t con
s idérés comme des ê tres impurs . Lorsqu ’ i l s voya
gen t e t s e renden t d ’un vi l lage dan s un autre,i l s
an noncent l eur p résence par des roulemen ts d e
tambour cont i nuels ; ceux qui ne fon t pas part i e d e
la confrér i e sont ob l igés de s ’é lo igner e t de la i s ser l e
chemin l ibre . S i quel qu’ un refusai t de s e con former
à cette coutume, i l s era i t fustigé d’ importance par les
N’
k imbas .
Outre la couche de b lan c qu i l es d i st i ngue de leurs
conci toyen s,l e s i n i t i é s s e couvrent la tête d ’une cou
ron ne,en forme de cage , d
’où penden t des bandel ettes
d’
é toffe et où son t fixées l es p l umes d’ o i seaux aux cou
l eurs voyantes . Autour de leurs re i n s,une large ce i n
ture de laine souti en t un l o ng j up on d ’herbes sèches
tombant jusqu’aux chevi l les ; des baguettes d i sposées
en cercl e é largi s sen t ce jupon,comme un e cri no l ine .
Souvent auss i,de leur cou et de l eurs épaules pende
‘
n t
de grosses touffes d ’herbe ; mais cet orn ement es t
196 LE CONGO .
sauraien t attr ibuer l es accidents , l a malad i e , l a mort
ades causes naturel l e s ; i l s n e vo i en t la que la man i
festat ion d ’un esp ri t,exc ité par un e nnem i ; auss i ,
o nt— i l s un démon pour chaque malad ie , l e démon de
la dyssen ter i e , de la fièvre , de la p eti te véro l e ; sur
tout celu i - là,car les ép i démies de vario l e son t fré
quentes dan s ces régi o n s . C’ es t l e N’
ganga qu i es t
app el é à. donner ses so i n s à l a vi ct ime du sorti lège .
Ces sorci ers n ’ o nt aucun e no ti on de l’
art de guérir ;l eurs con na i s san ces méd ical es s e born ent a l a fabr i
cat io n de quelques p oudres extrai tes de l’
éco rce d ’ ar
bres et de pot i o ns don t la formule es t i nco nnue . Ces
remèdes n e s’
adm i n i strent pas en rai son de leurs
vertus curat ives,mais a cause de l eur pu i ssan ce ma
gi que . On i nfl ige souven t aux malades un tra i temen t
te l que s ’ i l s guéri s sen t,c’ est assurémen t en vertu de
ce princip e u n mal en chasse un au tre .
Chez l es C handas,par exemp le
,l e malheureux
attei n t de la p et i te véro l e es t p l o ngé a p l us i eurs
repr i s es dans un ba in auss i fro id que poss ib l e ; s i l a
malad ie ne cède pas a cette médi cat i o n énergi que,on
no i e tout s imp lemen t l e pati en t .
Le rô le du N ’ganga ne se borne pas à admi n i s trer ses
drogues pendan t que,sur son ordre
,l e s parents et
les am i s du malade fon t dan s sa maiso n un vacarme
épouvantabl e p our chasser l es esp r i ts,l e sorci er
cherche quel est celu i qu i a exc i té cet esp ri t i l trouve
touj ours un coupable,l e dés igne
,et so n jugemen t es t
sans appel .
Celu i qu i es t co nvai ncu par l e N ’ganga d ’avo i r j eté
LE CONGO . 197
un sort a un de ses semblab les, est condamné
,s ’ i l
e st r iche , a paver une forte amende,don t l e devi n
empoche la me i l l eure part ; s’
i l e st pauvre,i l est sou
mi s a l ’ ép reuve du po i so n ou casca qu i peut tuer
sel o n la do se a l aquel le i l est adm i n i s tré . S’ i l y a
mort d ’homme , l e cas e st p lu s grave pour chaque
personn e qu i meurt,une au tre e s t fa i te Ndokl<i
(possédée du démon ) ,et c’
est encore le N’gang a qu i est
chargé de dés igner l e malheu reux e t de lu i adm in i s
trer l e casca . S i la do se es t faib le,l e po i so n p rodui t
l ’ effet de l’ émé ti que , e t, avec p lus ou m o i n s de hi le , l e
coupab l e vom it l e démon . S i la dose e st trop forte , i l
en meurt . Quelque fo i s , i l arr ive que l e possédé ne
rend ;xus kæ dénung cfiz cependant n e 1n eur t pas ; dan s
ce cas,l es ass i s tants se p récip i ten t sur lu i l e ta i l l e n t
en p ièces avec l eurs couteaux,ou b ien encore
,le fon t
cu i re a pe ti t fe ll,le so i r a l a ve i l lée .
Malgré cette façon de . tra i te r le s m alades,la mo rta
l i té n ’es t pas p lus grande chez ces i nd ig ènes que chez
d ’autres .
Le sorci er d i t en core la bonn e aven ture aux fem
m es, en l eur crachan t au v i sag e ; vend de s amu le ttes,
des tal i smans,con su l te les augures avan t que le s
i nd igènes ne parten t en guerre , n’
e n trepre n ne n t un
voyage ou même n ’
a i llen t a la chasse . C e s ta l i sman s
son t o rd ina i remen t u ne corne remp l i e de boue e t
d’
écorce,don t l ’ extrém i té i n féri eure po rte tro i s pet i ts
(1) Le casca e st extra i t de l e co rce é pa isse e t du re d ’
un a rb r ehaut de 40 a 'l 00 p ieds E ry thr op hæ um Gm e n sc .
198 LE CONGO .
corn i llon s . Les marchands d ’es claves on t tou s un
de ces amulettes q u’ i l s fro tten t a chaque i n s tan t d e
terre et d ’hu i le,afin de s e rendre favorab l e l ’ espri t
qu i l’hab i te,et d’ empêcher l e s esclaves de s’ évader
I l e s t b ien entendu qu’aucun e des fo nct i o n s de
N’ganga n ’ est gratu i te ; i l s e fai t même payer fort cher
e t d’avance .
Camero n raco n te l es cérémon ies d ’ i n can tat i o n ac
comp l i e s par u n fét i cheur pour préserver l e camp
contre l es i n cend i es .
La cérémo n i e eut l i eu un p eu avan t l e coucher du
so l e i l ; o n apporta au sorc i er une p ou le, une chèvre,un grand vase rem p l i d ’ eau, un pan ier, de la boue,une branche dépou i l l ée de feu i l l es , des couteaux et
un e auge d’ éco rce . Le sorc ier é ta i t accompagné d ’un
aco lyte,un j eun e homme
,app ren t i fét i cheur san s
doute .
L’
aco ly te al la s’ asseo i r sur l’ang e , au mid i ; l e fé ti
cheur s’ ass i t du côté opposé , l u i tournan t l e do s et fa i
sant face au nord . Ai ns i p lacés,i l s s e fro ttèren t mu
tuellem en t l es b ras en p rono nçant des paro les mysti
cette opérat i o n , l e fét i cheur traça sur l e
so l , av ec le p i ed , une cro ix don t l’un des bras dés ignai t
l e couchant ; i l pr i t une po ignée de p oudre d’
écorce,en
souffla une part i e vers l e so le i l et l e res te dans la d i
recti o n contra i re .
A la p l ace Où l a cro ix ava i t été fai te,on ouvri t
un e tran chée , dan s laquel le fut déposée l’auge magi
que . Le fét i cheur y versa un peu d ’ eau et aspergea le
sol,au nord d
’
abord , pu i s au mid i … . L’
aco lyte , p lacé
200 LE CONGO .
l ’acti o n d ’un feu doux,pour le dessécher, ju squ a ce
que la chai r so i t rédu ite à l ’ é tat de parchemin co l lé
aux o s ; l es main s seules son t exceptées de cette
cu i sson .
Cette Opérat ion terminée , ce qu i fut la figure du
cadavre est po i n t en rouge , en j au ne et en b lan c l e
corp s es t recouver t d’
une épai s s e couche de rouge ;autour du nez et de la bouche o n rou l e des bandes
d’
é toffe , et l e mort tout en tier es t emmai l l o té de ban
del ettes de co to n touj ours‘
a l ’ excep ti on des main s
qu i resten t l ib res .
Ains i p réparé,l e cadavre es t p lacé
,ass i s
,dan s une
fo ss e creusée sou s un e hutte ; s i c’ es t un chef, l a
demeure est en su i te abandonnée s i c ’est un s imple
mortel,ses femmes y resten t en fermées p endan t c in
quante j ours,l e v i sage barbou i l l é de poudre de char
bon,e t se l ivran t à. toutes les démon strat i on s d’une
grande dou leur . Dan s la fos se,l e corp s es t soulevé
et recouvert de p i è ces d’
é toffe de coto n , qu i , dan s le
pays,o nt une grande valeur.
Etan t don née l ’ i dée vague que ces peup les ont de
la vie future , i l s supposen t que l e monde des espri t s
est une pâle reproducti o n de notre mOnde S ub lunaire :
c ’ es t pour cette ra i so n qu’ i l s dép osen t,près du cada
v re,une foule d ’ obj ets usuel s
,afin qu ’ en arrivan t
dans l’ autre monde,l e défun t trouve tout ce qu’ i l lu i
faut . I l s y metten t do nc des vê tements,des p oter i e s
,
des armes et des vivres ; s i c’ es t un ro i
,o n y aj oute
des esclaves préalab lem en t pendus . Les poter i es son t
bri sées,l es couteaux tordus
,l es vê temen ts lacérés
l -E CONGO . 20 1
on l es tue , en un mot, afin qu’ eux auss i
,étan t m or ts
,
passen t avec leur maître dan s l e monde des esp ri ts .
Les VVabuma o nt un endro i t spécial pour ensevel i r
l es che fs de leur nat io n : l es ro i s e t les re i nes son t
en terrés dan s l’
île de Kermeh,ou i le sa i n te
,al
’
omb re
des grands arbres don t ce t i l o t e st couvert .
S tan ley donn e des déta i l s sur u n massacre d ’
e s
claves a l’
occa8 1on des funérai l les d ’
un che f Ba l<uti
c’ es t un de ses agents de la stati o n de l‘
Equa teur qu i
fut témo in de ce fa i t .
Un grand chef é tant mort,on déc ida d
’
imm o le r
qua torze esclaves en so n hon neur . Le s parents du
défun t se mi ren t auss i tô t en quê te de v i ct imes ; comme
i ls n e pouvaien t e n réun i r un n ombre su ffi san t,i l s
vi n ren t a Equateur - stat i on pour acheter de s em plové s
no i rs de l’Assoc iation ,qu
’
i l s prenaien t pour des e s
claves . Le l ieutenan t Vang è le les fi t chasser .
A force de recherches,i l s réuss iren t a se procu
rer quatorze hommes dan s l’
i n térieu r . Le s co ndam
nés furen t amenés sur la grande p lace du v i l lag e, où
se tenai t réun i e toute la populati o n . On les fi t mettre
ag enoux,le s mai n s l iées derr iè re le do s ; la corde
fut en su i te pas sée su r l a ma i tres se branche d’
un
j eune arbre e t des hommes la ha l è ren t , de faço n a
courber la branche ; l’ extrém i té de l a co rde fu t en su ite
a ttachée au cou de la v ictime . Dans ce tte pos i ti o n , l a
corde é ta i t trè s tendue , de so rte que , pour n’
ê tre pas
é tranglé,l ’homme leva i t la tê te e t al long eai t l e cou .
Un i nd igène,armé d
’
un coupe re t tranchan t,déca
p i ta l ’ esclave d’un seul coup ; l
’
arb r e , se red ressan t
202 LE CONGO .
sub i temen t,fi t sauter en l ’ ai r la tête
,qu i v i n t retomber
sur l e so l . Le même supp l i ce fut infl igé‘
a tou s le s
esclaves success ivemen t . Les corp s furen t j eté s au
fl euve , et l e s têtes , bou i l l i e s et décharnées , p lan tées
sur des p i ques autour du tombeau . Quan t au so l ,saturé de sang
, en l e recue i l l i t so igneusemen t, et o n
l e m it dan s la tombe du défun t .
I l n ’ ex i s te pas , que nous sach i o n s , de ri te spéc ia l
p our l’
enterremen t des femmes cependant Camero n
racon te qu’
é tan t chez l e ro i Kassonng o ,i l re sta sep t
jours san s p ouvo i r ê tre reçu par l e souvera i n,parce
que celu i - ci,ayan t perdu une de ses épouses
,ava i t
dû rester une semain e couché avec so n cadavre
Pour les es claves,o n n e fai t pas tan t d e cérémon i es
on abando nne l eur corp s dans la brous sa i l l e,où i l s
devien nen t l a p ro ie des fauves, ou b ie n o n l es j ette
dan s l e grand fleuve, qu i l es emporte dans quel que
cataracte où i l s s e bri se n t,a moi ns que les crocod i l e s
ne l es arrêten t au passage pour les dévo rer .
D e cette croyance aux espri ts,que l es naturel s
vo ien t partout,résul te n écessai rement l ’ i dée que ces
ê tres malfai san ts o n t des demeures spéciales : c’ est
d’
abord les souterra i n s deM’
kama,sur le s bords du lac
Tangan ika,dont l ’ in téri eur est formé de voûtes et de
co l o n nades d ’une grande beauté ; l a sup ers t i ti on des
ind igènes a peup l é ces gro ttes d ’ hab i tan t s b i zarres ’
e t
surnaturel s du reste,l e lac i n sp i re un e crai n te
superst i t i euse aplus i eurs tr ibus e nvi ronnan te s c’ es t
ai n s i que les che fs de l ’Ogarou so nt persuadés que
s’ i l s voyai en t l e Tangan i k a
,i l s mourra ie n t a l ’ i n s tan t .
201 LE C ONG O .
tan ces.E l l e l e condui s i t al o rs p rè s de la fo ntain e .
Jamai s i l n ’ ava i t r i e n vu de s emblab l e i l regardai t
ave crav i ssem en t l e s po i sso n s ét i n ce ler , se poursu ivre ,
sauter, p lo nger , quand un craquement terr ib l e s e fi t
e n tendre la terre s ’ ouvr i t , l a p la i n e en fo nça , en fonça
tel l ement que le s l ignes l es p lus longues ne p ourrai en t
l’
atte i ndre .
La source déborda,emp l i t l a g rande fen te .Le bétai l ,
l es champs,l e s maison s
,l e s jard i n s
,l es hommes ,
tout fut recouvert par l es eaux ; l e l ac é ta i t formé .
Quand l ’homm e eut fin i ses affai res,i l s e m i t en
rou te pour reven i r chez l u i . Tout a coup , i l t rouva
des montagnes qu ’ i l n e connai s sa i t pas ; l orsqu’ i l
fut au s ommet,i l v i t l e l ac a l a p lace de la vi l l e et de s
champ s ; i l sut al o rs que la fo ntai ne ava i t été regardée ,et que tout l e monde avai t p erdu l a v i e par la faute de
sa Èmm e
V o i là ce que n ous o nt d i t n o s v ie i l l ards au suj e t d e
Tangan i k a .
Camero n ci te la l égende relat ive à l a format i o n du
lac D i l o l o ; el l e es t surtout cur i euse parce q u’ el l e
rappel l e l e réci t de la B ib l e‘
a p rop os de la Mer Morte .
A l a p l ace où est auj ourd ’hu i l e lac,i l y ava i t autre
fo is un grand v i l lage où l ’ o n étai t heureux . Tous l e s
hab itants éta ient r i ches ; i l s p os sédai en t tous beau
coup de chèvres , de vo la i l les et de cochon s , du gra in
et du man io c en b i en p lu s grande quant i té qu’ i l s n ’ en
est mai n tenan t accordé . Ces gen s r i ches passai en t
l eur v i e a bo i re et amanger,san s s ’occuper du len
demai n .
LE CONGO . 905
Un j our,un homm e trè s âgé vi n t dansce t heureu
’
x
vi l lage . I l é ta i t las e t a ffamé ; i l d emanda aux hab i
tan ts d ’avo ir p i ti é de l u i,car i l ava i t encore une l o ng ue
route à. parcouri r . Lo in d’
écou ter sa demande, le s
hommes r iches l e chassèren t e t engag èren t les en fants
a l u i j ete r des p ierres,de la boue e t des ordures .
Mouran t de fa im,l es p i eds déch i rés
,i l s orta i t du
vi l lage, quand un hab i tan t,p lus généreux que les
autres,l’
emm e na dan s sa case , lu i prése n ta a b o i re ,tua une chèvre e t p laça devan t lu i une boui l l i e d e
grai n et un p lat de viande pu is,quand le vie i l lard fut
rassas i é,l e v i l lageo i s lu i do nna sa p rop re demeure
pour do rmir
Au mi l i eu de la nu i t,l e v i e i l lard se l eva , al la réve i l
l er l ’homme g é néreux et l u i d i t :
Vous avez été bo n pour mo i j e veux a mo n
tour vous rendre service ; mais ce que j e va is vous
confier ne do i t pas être con nu de vo s vo is i n s .
L’ autre promi t l e secret. Sur quo i le vie i l lard lu i
d i t :Avan t peu
,i l y aura pendan t la nu i t un g rand
orage ; dès que vous en tend rez l e ven t sou ffler ,
l evez-vous,pre nez tout ce que vous pou rrez empo rter
e t fuyez au p lus v i te .
E t l e v ie i l lard s’
en al la .
Deux nu i ts aprè s,l ’homme généreux entend i t p l eu
vo i r e t venter comme on n e l’
ava i t j ama i s en te ndu .
L’ étranger a d i t vra i pen sa - t i l .
E t se levan t auss i tê t, i l part i t avec se s femmes , se
chèvres,ses esclaves , ses pou les e t tou t so n avo i r .
206 LE CONGO .
Le l endemai n matin,à. la p lace où éta i t l e vi l lage
,!
s’ étendai t l e lac D i l o l o .
I l nous resté main tenant aparl er d ’un e accusati on
souven t p ortée contre l es hab i tan ts du Congo, et qu i
ne parai t que trop fo ndée : nous voulon s parler de
leur cann i bal i sme .
Livingstone ahési té à. les déclarer an throp ophages
S tan l ey ne doute pas un s eu l i n stan t qu’ i l s n e mangen t
leurs semb lab les i l va même jusqu’à d i re qu’en l ’at
taquan t sur l e hau t fl euve,l es indigènes voyai en t
dan s sa cap ture un moyen de se pro curer de l a
viande fraîche Quan t aux O ssyebas, i l n’y a pas
à douter qu’ i l s mangent l ’homme .
Nous n ’avons pas l ’ in ten t i on de prendre la défen se
de ces sauvages ; nous voulon s même admettre qu’ i l s
son t an thropophages . Cep endan t, nous devo ns con s
tater que M . Stan l ey,qu i e st leur p lus vi o l en t accu
sateur,n’a j amai s ass i sté à. leurs hon teux fes tin s
dan s certa i n s v i l lages , i l a vu descrânes p lan tés sur
des p i ques,et des mai son s o rnées d
’
ossements
humain s : ceci n ’ est pas une rai son concluan te, car lu i
même,dans un autre endro i t, a pu con stater que ces
débri s humain s son t des féti ches, et que les crânes des
esclav es tués e n l’
honeurd’
un chef défun t so nt exposés
a i n s i autour de son tombeau .
Pour être anthropophages , l es hab itan ts du Congo
n’ ont pas les mêmes rai so n s que les insulai res de
l’
O céan i e i l s é lèvent des chèvres,des p orcs , des vo
lai lles l eurs forêts regorgent de gib i er,e t l es p r i s on
n i ers de guerre son t vendus comme esclaves .
CHAPITRE ! I I I .
C u l tu re . Industr ies .
— C omm e rce . Aven i r de la race nèg re .
Autour de chaque vi l lage,e t souven t même autour
d e chaque case , les i nd ig ène s cu lt iven t les l égumes e t
les p lante s don t i l s se n ourri s sen t ; cette cul ture e st , a
vra i d i re , des p lus rud imen ta ires : l a terre vierge de
mande a pe i ne a être labourée l e so l fécond,arrosé
par des p lu ies péri od iques e t chaque nu i t par une
abondan te ro sée,chauffé par l es rayo n s b rûlants du
so le i l,donne
,presque san s travai l
,l e man ioc
,le m i l
le t , l e mai s , le p lanta in . I l sera i t don c p lus j us te de d i re
que l es ature ls réco l ten t e t n e cult ivent pas .
Le se trava i l co n s i ste , en somme , a dé fri cher . S i
la tr ibu est é tab l ie dans un pays bo isé,l e dé friche
ment demande une certa i n e pe i ne s i c ’ est dans une
p la ine,i l s e fa i t d ’une façon b ien s imp le : vers la fin de
la sa i so n sèche , al ors que les hautes herbes son t ré
dui tes a l ’ é tat d e pai l le par l e so le i l,i l s mette n t tou t
s imp lemen t l e feu a l a pra i ri e ; les cendres res ten t su r
la terre . Quand vi en t l a sai so n des p lu i es,l’
eau nu
prèg ne cet te couche , l a fa i t pénétrer dans le so l e t l’
on
grai s se i l n ’ es t même pas nécessa i re de labourer
quand v i en t l’
époque de s sem is ; l a g ra i ne dépo sée
sur la terre germe,pousse e t produi t en que lques
semaines .
Les hab i tants ne se bornen t pas a réco l ter les frui tsL E CONGO . 1 4
2 10 LE CONGO .
des p lan te s qu’ i l s cul t iven t i ls s’
approv i s i onnent
auss i dan s la forê t v i erge,qu i l eur donne l ’hu i l e de
palme,l a no ix de terre
,l es gra ines o l éagineuses et
tous les p rodu its qu’ i l s emp lo i ent a. leur co nsomma
ti on perso nnel l e et don t i l s trafiquent
Mai s l es i nd igènes ne se con ten ten t pas de deman
der a l a terre s es mei l l eurs p roduits i l s é lèven t
encore des an imaux domesti ques chèvres,cabri s
,
porcs,volai l l es ; v ivan t p resque tous sur les bords du
grand fl euve et de ses affluents,i l s s e l ivren t à la pêche
et con serven t l e p o i s so n en l e fai san t s écher ; i l s tra
quent l e s bêtes fauves dan s l es forêts,pour s’ emparer
de leurs dépou i l l es dé fen ses d’
é léphants, den ts de
rhi nocéro s, peaux de léopards ou de l i o n s ; et l es ustens i les
, l e s armes , l es can ots qu’ i l s emp lo i en t
,i ls
les fabri quen t eux-mêmes .
Nous avo ns déjà d i t que p lus o n s’
avançai t dansl’
i n tér ieur, p lus l’hab i leté e t l ’ industri e des indigènes
semblai en t développées . D ’abord l es meubles de leursmaisons son t p lu s con fortab l es , p lus nombreux etp lus é légants chacun a son tabouret
,de forme gra
c i euse et orn é de scu lp tures dan s chaque fami l l e,on
trouve un canapé,so igneusement fai t
,en canne
,où
tro i s perso nnes p euven t s ’asseo ir a l ’ai se,et
,de p lus
,
un banc,de quatre à. c i n q p i eds de long, tai l l é d’un seu l
morceau dan s une b i l l e de bo i s tendre . Ces s i èg esferai ent supposer un espri t émi nemmen t s ociab le chez
l eurs propr i é tai res .
Une autre p i èce i n téressan te du mob i l i er se com
pose de la fourche d ’un arbre,coupée à. peu de d i s
2 12 LE CONGO .
fers,des co l l i ers
,des an neaux de bras et de j ambes
,
des épées,des couperets , des couteaux . L ’art du for
geron est tenu en grande est ime,et chaque générati on
apprend à. son tour les p rocédés trad i t ionnel s , qu i
so nt n ombreux , et p rouven t que , mêm e à l’ état sau
vage et rédu i t à. ses p rop res ressources,l ’homme est
suscep t ib l e de s e perfect i onner et d e progress er .
Les poter i es,vases , p lats , pots , révè le n t une grande
hab i leté de mai n et même , dans la forme , un certain
sentimen t arti st i que . I l en est de même pour le s in s
trum ents de mus ique . S i,dans l e bas Congo
,o n ne
trouve que des tambours gro ss iers creusés dans un
tronc d ’ arb re,des t rompes fabri quées avec des cornes
d’
ant i lopes , on vo i t, sur l e haut fl euve , l a trompe d’
i
vo i re,le tambour a l a ca i s se curi eusement scu l p tée
,
pour appeler l e s guerr i ers au combat,et p our accom
pag ner l eurs chan ts monotones , l a lyre a c i n q co rdes ,dont ces sauvages mus ici ens t i re n t des son s d ’une
douceur et d ’ une mélod i e surp renantes .
Les grands canots portant deux cen ts .hommes, _
qu’ i l s montent pour l eurs expéd i t i o n s , ou les p i rogues
sur lesquel les i l s s ’embarquen t pour al ler a l a pêche ,s ont creusés
, a l a hache , dans un s eu l tro nc d’arbre ;
quel ques - unes de ces embarcat i o n s son t immenses .
S tanl ey a vu un canot mesuran t quatre— vi ngt- tro i s
p i eds de l’
avant a l ’arr ière ; l es pagaies son t longues,fl exib l es
,et l a palette es t généralemen t creuse .
Mais l es i nd igènes excel l en t surtout dan s l a fabri
cat i on des ouvrages de van neri e . I l s j e ttent sur les
pet i tes riv ières des p onts su spendus,dont l e tab l ie r
2 16 LE CONGO .
date fixe dan s chaque régio n,su r un p o i nt cen tral, à.
prox imi té de tou s l es v i l lages . Dan s l e pays mon ta
g neux,i l s so n t p lacés sur une éminence commandan t
tous l es environ s ; dan s la p la i n e , sur un emp lacemen t
spaci eux,débarrass é des hautes herbes e t des b rous
sa i l l es . Les naturel s v i enn en t de trè s l o in pour y
ass i s ter et s ’y trouven t quelquefo i s réun i s au nombre
de mi l l e .
I l s y amènent des mouton s , des chèvres , des ca
nards,des vo la i l l es
,en fermés dan s des cages suppor
tée s par une perche que porten t deux hommes pu i sd es œufs
,des fru i ts
,des l égumes
,de la cann eâ sucre
,
du m a is e t du lcikwang o , sorte de cassave fai te avec
du man io c et du sel .
Les femmes vi en nen t à. ces marchés,et c’ es t e l l e s
qu i p orten t le s p l us lourds fardeaux ; à. el l es auss i es t
réservé l e so i n de vendre et , comme par tout ,e lles s on t
hab i les,empress ées , cr i en t , s e démènen t, fo n t un
vacarme assourd i s san t . Pendan t ce temp s — là l es
hommes s e promènen t ,ou ,réun i s dan s un co in
,fumen t
en s i l ence .
Outre ces marchés, i l en exi ste d’
autre s dan s l e s
grands centres , où les hab itan ts se renden t souven t
de d i stances fort é lo ig nées ; ceux de l’ i n téri eur orga
mi sen t de vér itab l es caravan es ; i l s y p orten t l’
ivo i re,
l ’hu i l e de palme , le s art i cl es de leur fabri cati on , l e
po i s so n sec et l es p rodui ts de l eur régi o n .
Les rivera i n s v ienn en t dan s leurs grands canots
a uss i tôt arr ivés , l es p irogues son t halées sur l a p lage
,
'
e t l es femmes se metten t en devo i r de décharger l es'
220 LE CONGO .
M . Stan ley a rêvé un i n s tan t de réun ir tous ces
é l éments épars p our en former une grande nat ion ;n ous n ’avons pas à app réci er i c i l es mot i fs qu i pous
sai ent l e reporter améri ca in dan s cette en trep ri se, et
quel p rofi t i l p en sai t e n ret irer,so i t p our lui
,so i t p our
ceux qu’ i l rep résen te . Nous croyon s que ce n ’ es t heu
reusem ent qu’un rêve
,et u n rêve i rréal i sab l e .
D ivi sés comme i l s l e s o n t, ces p eti ts p eup l es son t
d i sposés à. recevo i r l e s b lan cs , à. accepter l es b ien fa i ts
de l a c iv i l i sat i o n européen ne ; mai s supposon s ce qu i
d ’a i l leurs nous paraît imposs ib le qu’ i l s e trouve un
no i r as sez i n te l l igen t , assez fort p our réun i r sous son
scep tre ci nquan te m i l l ion s d ’hommes,quel sera la
p remière mesure que p rendra ce souvera in Assuré
ment , i l d éfendra l’ entrée de son emp i re aux Euro
péens, et i l aura les moyen s de les ten i r à d i stance ;car i l n e pourra i t vo i r d
’
un œ i l tran qu i l l e le s b lan cs
armés,étab l i s dan s ses domai nes .
Auj ourd ’hui , nous venon s en maî tres ; nous nous
imposon s dans chaque v i l lage qu i se s oumet,faute
souvent de pouvo i r se dé fendre . S i l’
E tat l ibre du Congo
n ’ éta i t qu’
un vaste emp i re, o’ es t en supp l ian ts que nous
y s eri on s entrés,et l a durée de notre s éj our serai t
s oumise au bon p la i s i r d’un desp ote afri ca i n .
Malgré ses défauts , ses v i ces même, cette race
nègre es t i n te l l igente , adro i te, i ndustr i euse ; en traî né s
par l ’ exemp l e,s édu i ts par l es b énéfi ces , ces no irs
nouero n t avec nous des relati o n s commerciales c’ es t
sur n os marchés à nous qu ’ i l s apporteront leurs pro
du its, et i l s comprendront b i en tô t ceux qu’ i l s do iven t
LE CONGO . 22 1
cul t iver de préférence ; i l s s’
apercevro nt v i te que
p lus i l s clemandero n tau so l e t p l us l e so l leurdo n ne ra,
i l s devi endron t agri cul teurs . Beaucoup v i e nd ro n t chez
nous e t reporteron t en sui te dan s l eurs v i l lages le s
hab i tudes qu ’ i l s n ou s auron t pri ses .
I l n e fau t pas juger l e nègre sur l ’ esclave que nous
avon s vu j ad i s dan s no s co l on ies ; sur ce t homme
en l evé au so l natal e t condamné a v ivre e t mouri r
l o i n de sa patr i e . Dans s o n pays,travai l lan t pour lu i
,
pour son b ien - ê tre perso nnel,i l d eviendra labo r i eux .
Dél ivré de ses supers ti ti o n s e t de ses i n sti tut i o ns abo
mi nabl e s,i l accep tera nos p rogrès e t no tre civi l isa
t i on . Parsemée comme el l e l ’ es t d etabl i ssemen ts
européen s,traversée
,vi s i tée
,recon nue dan s tous le s
s en s, l
’
Afr i que n e peut rés i ster l o ngtemp s a la co n
quête de la c ivi l i sat i on sur la barbari e .
224 LE CONGO .
la p lus terr i b l e d e ces pays es t l a fièvre b i l i euse, que
les Portugai s appel l en t la febre p ern i ci osa .
Le grand fl éau dan s toute cette régi o n vo i s i n e
de l ’ équateur,et celu i qu i fa i t l e p lus de v ict imes
,c’ es t
l’
i nso lati on . Dans ces pays trop icaux , où l e so le i l
darde presque d’
aplom b se s rayons embrasé s,l a
mo i ndre imprudence p eut am ener la mort , et la mort
imméd iate . Ce qui , en Europe , ne s era i t qu’une s im
p l e imprudence , devi en t sous l’ équateur un danger
mortel . Un excès de bo i re ou de manger par
exemple,au l i eu de p rovoquer , comme sous notre
ci el , une vulga ire i ndig esti o n , peut détermi ner un
accès de fièvre b i l i euse ; dan s ce cas , trop s ouven t, l e
dénouement ne s e fa i t pas attendre .
Il es t cependan t poss ib l e de b i en s e p orter,sous ce
cl imat réputé meurtri er : i l suffi t pour cela de p ren
dre certa i nes précaut io n s , e t, surtout, d’user de tout
avec modérat ion , de s’
absten i r autan t que p oss ib l e
d’
alcoo ls, de se vêti r chaudemen t, de b ien s e couvri r
l a nu i t . Dans ces cond it i o n s , un homme peut parfa i
temen t supporter le cl imat du Congo .
Le grand danger de tous ces p ays v ie nt de l ’hum i
d i té ; même pendan t la sai s on sèche , l’a i r est saturé
de brou i l lards , s emb lab les‘
a des nuages fl o t tan t trè s
bas , qui dép osen t partout comme une abo ndan te
rosée . C’es t l e cac imbo des Portugai s,et les
fumées des côtes de Guinée .
La durée de la sa i s o n p luvi euse augmente à.
mesure que l’
on s’
é lo igne des côtes de l’O céan ; près
de l’
embouchure du Congo,i l p l eut p endan t quatre
LE CONGO .
mois : n ovembre , décembre , févri er e t mars,coupés
par quelques j ours de sécheres se pendant le mo is de
j anvier . A S tan ley- Poo l,les p lu ies comme nce n t e n
octobre e t dure nt j usque vers le 20 mai , san s arrê t e n
j anvier ; c’
es t 8 mo i s de saison p l i i V i é i i S é . Plus pre.
de l’
équateur encore , o n peut d i re que le s averse s
sont j ournahères .
La saiso n sèche,qu i e st auss i l
’époque de s chaleurs
torrides, e s t peut- ê tre la p lus dure a supporter,aus s i
b ien pour les p lantes que pour les arbres . A pe i ne les
p lu i es o nt - el les cessé depuis un mo is , que le so l se
crevasse,la luxur ian te végétati o n se fane , les feu i l
les s i vertes e t s i bel les perden t leur cou l eu r e t j o n
chen t le so l ; le s hau tes herbes ,hier enco re hum ides
e t fra i ches , s’ i n cl i nen t vers la terre
,brûlées e t de ss é
chées . C ’es t ce moment que les i nd igènes cho is issen t
pour défri cher,c ’ es t- â -d i rc pour i ncend ier des p la i nes
immenses .
’ époque la p lus agréabl e e s t assurémen t cel le ou
tombent le s prem ières averses : c’
es t comme le pr…
temps de ces régio ns . La nature en tiè re semb l e rev i
v re l e so l calc i né perd sa te in te g risâtre les j eunes
pousses se forment e t cro i ssen t presque a v ue d’
œ i l ,
et,e n quelques j ours , la vég é ta ti o n reprend toute sa
vig ueur e t so n éto nnan te pu i ssance , éma i l lant de
fl eurs aux tons le s p lus br i l lan ts ce s même s bu isson s
qu i , hier enco re , semb la ien t compos és de l11‘ i i i d i llé s°
mortes e t desséchées .
Faut- i l s’ é to n ner que . dan s ce s cond i t i on s e l ima té
r i ques , o n rencon tre au Cong o toutes le s p lan tes don t
LE C ON GO .
226 LE CONGO .
l es fru its s ont s i recherchés : l e p almi er de toutes l es
espèces,cocoti e r
,palm ier datt ier
,palmier à hui le , et
une sorte de palmier don t l e fru i t j aun e , de la forme etde la grosseur d ’une pomme , cont i en t u n noyau dur et
b lan c comme de l ’ ivo i re le s éléphan ts o n t une véri tab l e
pass ion pour ce fru i t . C iton s encore l e banan i er,la
cann easucre,que cul t iven t l e s indigènes
,et leman i oc
cette dern i ère p lante méri te une men t i on parti culi ère .
La racine de man i o c , que l’
on pourra i t appeler l e
pain de tous l es hab i tan ts des pays trop i caux , es t de
deux sortes : l ’un e con t i en t un po i son vi o len t qu i do i t
être é l iminé par un trempage pro l ongé dan s l ’eau
c ’est l e cas du man i o c du Congo ; l’autre es t parfai te
men t anod ine , comme cel le de la’
Guyane . Vo i ci com
men t se p répare le man i oc
On rédui t la racine en une poudre trè s fine, comme
de la farine , et on l e met à. tremper dan s l’eau p our
en l ever son pri ncipevénéneux ; pendan t cette opérat i on
une pulp e trè s l égère remonte a la surface de l ’ eau
c’ est l e tap i oca . On reti re en su ite la fari n e de man io c
du bain,et on l a fai t s écher sur des p laques de tô le
,
ou s imp lemen t des p i erres chaudes ; el l e e st en su ite
pétr i e comme du pa in ou b i en,on l a la i s se fermen ter
,
et quand e l l e fo rme une espèce de pâte,o n la coupe
par tranches m in ces,que l’on apprê te de d i fféren tes
façon s , en les faisan t fr i re dan s du beurre ,par exemp le.
A ces producti on s du so l,aj outon s l es légumes
pommes de terre, choux sauvages , ananas , no ix de
terre, ma i s, tabac , café sauvage, p lan tes texti l es de
toutes sortes, arach ides ,p lan tes o léagineuses ,pui s les
2 28 LE CONGO .
sab le couverts par l es eaux la tête seul e émerge au
dessus des flots,et la vue de leurs imm en ses mâcho ires
qu i s’ ouvren t et s e fermen t pendan t leurs fréquents
bâi l l emen ts es t vra imen t e ffrayante . La nu i t, i l s qu i t
ten t le fleuve,et par bandes de hui t ou d ix vo nt, dan s
l es prai ri e s vo i s i nes,brouter l es hautes he rbes i l s y
res ten t j usqu’au lever du so le i l .
La femel le de l’h ippopotam e a l e sen t imen t matern el
très développé pendan t les p remières semai nes qu i
su iven t la nai s sance de son pet i t, el l e res te avec lu i
sur l es r ives du fleuve , san s y entrer p eut - être parce
qu ’el l e crain t que so n bébé hippop otame ne so i t une
pro ie trop faci l e pour l es crocodi les .
Quelquefo i s , un vi eux mâle qu i tte ses compagnons
et va vivre s eul,en so l i ta i re ; alo rs , i l d evien t méchan t,
et o n d irai t qu’ i l prend p lai s i r à détru ire tout ce qu i
se trouve sur son passage . M . Johnston en a vu un
qu i s’
étai t é tab l i dan s l e vo i s i nage deM ’
suata . Cette
méchan te bête, d i t - i l , étai t la terreur des i nd igènes de
tous l es v i l lages avo i s i nan ts l e so i r,au crépuscule,
caché dans de hauts bu i sson s , i l guettai t l e retour des
pêcheurs ren tran t au logi s ; i l s e d irigeai t alo rs vers
eux , nageant en tre deux eaux ,et renversai t l eur canot
.
Pendan t que j ’ étai s a cet étab l i s semen t, n ous
envoyâ.mes une p i rogue p orter des lettre s aS tan ley .
Le cano t, part i au po i nt du j our , fut renverse , p rè s de
la stati on , par cet h ipp opotame , et un des hommes qui
l e monta i en t fut emporté par un crocod i le.
En résumé , l’
h ippopotam e peut ê tre con s idéré
LE CONGO .
229
comme l e p l us terr ibl e en nemi de l’
homme sur le
CongoLe lie n est trè s commun sur le haut Congo e n com
mence à l’
en tendre aux env i rons «le S tan ley—Poo l, e t
plu s lo i n .dan s l
’ i n téri eur,i l do i ty e n avo i r beaucoup .
La plupart desgrands che fs de tr ibu ont des peaux de
l i o n . C’ es t ass i s sur une peau de l i on que Ma k o k o
reçut de Brazza , à. sa p rem ière vi s i te. Beaucoup de s
v i l l ages de la r ive dro i te du Congose barricadent so i
attaques poss ib le s de la part dugneuse
ment, en vue d’
haque nu it,l es troupeaux son t
ro i des an imaux, e t, c
a l ’ abr i dan s la forteresse . Du res te , S tan ley,
n voyage, en rencontra p lus i eurs fo is .
s,c i tons le l éopard ,
que les i nd igènes
r quand un de ce s an imaux e s t
rappe , tous le s v i l lag es env i ron
fete , pendant lequel le s é s
pu is deux ou
pendant so
Parmi le s fé l i n
appel le nt se ig neu
tué ou pri s dan s une t
nants célèbrent un j our de
c laves son t exemp ts de touttravai l
tro i s espèces de chats t igres , qui fon t auxvo lai l le s
une guerre acharnée .
Notons encore la hyène e t le chacal.
Sur les r ives du fleuve ,v i t une sorte de buffle , p lus
pet i t que celu i de l'
Afr iquemérid iona l e
,mai s tout
auss i dangereux , quo ique , pari nstants , i l fasse preuve
d ’une douceur surpre nante , témo i n l’ aven ture qu i
a Stan l ey ,entre V i v i e t I sangi la
a tè te de sa caravane , e t venai t , sous
Comme
arriva
i l marchai t à l
un sole i l b rû lan t ,degrav i r une haute col l i ne .
Johnston , The Ri ve r C ongo .
230 L E CONGO .
i l atteignai t l e sommet,et que
,exténué de fatigue, i l
s’apprê ta i t à. s e lai s ser tomber sur l’herbe couvrant l e
so l,i l s e trouva tout à. coup face à face avec un buffle
rouge qu i l e con temp la i t d ’un œ i l p rofondément é
tonné . Déjà, i l s’
avança i t sur S tan ley , la tête basse, les
cornes en arrê t,quand celu i—ci l ’aj usta et fi t feu ; mais,
b ien qu’ i l n e fût qu’
à. d ix mètres du but,l ’ émotion l e
fi t trembler, et i l manqua la bête . A la grande surpri s e
de l ’ exp lorateur,l e buffle lu i tourna le dos et s’ en al la
tranqui l l ement .
L’
an t i lope , s i commune dan s toute l’
Afri que , es t
assez rare au Congo i l n ’y a pas de vraies gazelles .
La seule espèce un peu nombreuse est l’ant i 10 pe cobus ,que l’ o n rencontre surtout au bord des ru isseaux . Les
sabots sont fort l ongs et p o i ntus . Cet an imal, qu i es t
d ’un brun roux avec des rai es blanches,hab i te surtout
l es terrai n s marécageux,dans l e vo i s i nage des peti t s
cours d’ eau . Ses cornes son t employées par les i nd i
gènes pour en fa i re des trompettes .
La fami l l e des s i nges est largemen t représen tée ;quelques voyageurs prétenden t que le gori l l e exi s te
au Congo , mai s la questi o n est très d i scutée .
L’
e spèce la p lu s répandue est l e so k o , sur l equel
L iv i ng stone a donné d‘
i n tére ssants détai l s , quo ique, à.
première vue,i l s parai ssen t un peu fanta i s i s tes ; i l l e
prend à. tort p our un gori l l e .
Le soko,d it— i l
,marche souvent debout ; mai s al ors
i l se m e t l es bras sur la tête,comme pour fai re équ i li
bre . Vu dans cette pos i t i o n,c’ est un an imal trè s gau
che . Le j aune clair de safig ure fai t ressort i r ses affreux
232 LE CONGO .
l e remède les fourmis rouges, qui dévoren t ces puan
tes best i o les par mi l l i ers parfo i s,l e remède est p ire
que le mal des bandes innombrab les de fourm i s rou
ges,l es m aj i m o to (eau chaude) des hab i tant s de Zan
z ibar,fon t des ravages inappréciab les ; quand une
mai so n se trouve sur l eur route,el l e s l ’envah i ssent ,
et le propri éta i re n’a rien de mieux à. fai re que de se
sauver,et d
’
abandonner son doma i ne à. la bande p i l
larde . Après ces te rrib l es envahi s seurs,v i en nen t
d ’autres espèces de fourmi s qu i , pour être pet ites,n’ en son t pas mo in s terr ib l es ; el l es s
’
attaquent aux
vivres,aux sucreri es de p référence
,et, a mo i n s d e
se résoudre à. manger un e compote de fourmi s,l e
mieux est de l eur abandonner l eur p ro i e,et de p ren
dre ses précaution s pour une autre fo is .
Pui s v i ent la séri e, inévi table dan s l es pays trop icaux,des mousti ques ,mari ngoui ns ,ch iques , et autres tour
menteurs de l ’homme, et surtout du b lanc ; des mou
ches de toutes les espèces , et p our les détru i re , un
nombre incal culable d ’araignées de toutes l es cou
leurs e t de toutes l es gro s seurs .
Un fleuve comme le Congo est naturell emen t trè s
po i s sonneux ; i l n e pos sède guère d ’ espèces qu i l u i
so ient propres , et ses hab i tants son t a peu p rès les
mêmes que ceux du haut N i l . Malheureusemen t , ce
ne sont pas l es seu l s hôtes du grand fl euve outre l es
hippopo tames dont nous avo ns déjà parlé,o n y ren
co ntre encore de nombreux crocod i l es,qui son t p our
l e voyageur u n danger i ncessan t ;a u mo i ndre accident
pendan t la nav ig ati o n ,o n e st certa i n de vo i r l eurs
LE GONG“. 93
têtes hid euses éclai rées par deuxyeux g lauques s’avan
cer, en quête d’ une p ro i e
, quæ rens quem devore t . Le s
i nd igènes prétendent que pendan t la saison p l uv i euse ,quand souffle n t sur l e Congo le s tempê tes v io len tes ,l es crocod i les su ivent l e cano t bal lo tté par les !l o ts ,
dans l ’ espo i r qu ’ i l chavirera avan t d’
a tte ind re la rive .
I l est as sez cur i eux de remarquer que , dan s cette
régio n,l e crocod i le se conten te d ’ en lever une jambe
ou un bras de sa v i c t im e,la la i ssan t
,m u ti lée , a tte i nd rc
l e bord a moi ns,cependant
,qu ’un autre de ce s an i
maux ne se trouve a portée e t n ’ e n lève un second
membre au malheureux . E n agissan t a in s i,l e croco
d i le du Congo fa i t preuve d ’une certa i ne i n te l l igence :
i l préfère se contenter d ’un morceau en levé a la hâ te ,
e t s’ en fu ir avec cette pro ie au fond du fleuve , p lutô t
que de ri squer les chances d’
une lutte avec sa v ic
t ime ; en e ffet , quand un i nd ig ène e s t p ris par un cro
cod i le , s’ i l pèut se retourner , i l en fon ce s e s po uc es
dans les yeux de so n adversa i re , o u lu i pl o n g e so n co u
teau dans le ven tre ,auque l cas l
’
an ima l lâche sa pr…e .
Quelque é to nnant que ce la pu isse pa ra i tre , i l v a dos
hommes qui,ayan t la i ssé un bras dan s le s terr i b les
mâcho i res du saurien ,on t eu a ssez de co u rage e t de
force pour lutter contre la dou leu r e t le courant , e t
atte i ndre la r ive a la nag e .
La queue du crocod i le e s t , on le sai t , une arme
terrib l e : d'un coup de ce t append ice , i l peut tuer u n
homme,quand i l nage , ou ,
d’
un bond , le p récip i ter
dans l e fleuve . Vo ici u n exemple de ce ta i t :
Dan s la p rov i nce d ’
Ang o la ,sur la riv iè re Quan za , le
234 LE C ONGO .
steamer qu i fai t l e service étai t amar ré con tre la r ive ;
des Krowmen déchargeaien t le navire, e t , pour at
teindre le bord , passai en t sur une p lanche peu élevée
au-dessus du banc de sab le forman t l a berge . A la
nui t tomban te,un crocodi le, qu i depu i s l ongtemps
probabl ement guettai t sa pro i e,cho i s i t l e momen t ou
un Krowman pesammen t chargé étai t au mi l i eu de la
p lanche,pour lu i asséner un v ig oureux coup de queue
le malheureux fut envoyé du cho c dan s l e fl euve.
Ou se précip ita au secours de l’
homme mai s déjà. l e
crocod i l e lu i avai t ouvert le ven tre d ’un coup de dent,
et le portefaix n ’
atte ig n i t l a r ive que p our mou r i r .
Il es t parfai temen t exact que l e crocod i l e est ac
compagné et p ro tégé par un pet i t o i s eau qu i p ousse
un cri d’
alarme quand un danger menace l e sauri en
endormi au so le i l sur un banc de vase c’ es t une es
pece de p luvier, l e lobi oan e llus a lbi cep s , que les Egypt ien s appel len t z ig—zag . Il v i t avec l e crocodi le sur le
p ied de l a p lus grande int imi té, perchan t sur l e do s
dum onstre, quand i l es t hors de l’ eau . Souven t
,on s’ es t
demandé comment le crocodi le payai t s on proteo
teur a i l é ; quel ques savan ts z oologues on t affirmé que
le z ig—zag avai t l e p rivi lège de remp l ir auprès du cro
codi le le rô le de cure—den t . D ’autres,n e prenan t pas
cette asserti on au séri eux, on t prétendu que le p et i t
o i seau se con ten tai t de manger lesvers qui fo i ssonnentsur l es par ties mol les de lamâcho ire du mon stre . Mal
gré notre peu de compétence en la matière,nous
o son s m e ttre en doute ces deux op in i on s, e t nous
croyons b ien p l utô t que l e p l uvier z ig—zag se nourri t
236 LE CONGO .
du nord de l’Afr i que l a b reb i s n ’ a pas de cri n i ère .
Le boeuf d ’ origi ne i nd igène est ab so lument i nconnu .
Dan s tout l e haut Congo,l e ch i en
,qu i est trè s abo n
dan t,a une certa i ne ressemblance avec celu i des
Indes et avec l e ch ien sauvage d e Sumatra tête fine
du renard,o re i l l es dro i tes et p o in tues , pelage fauve
et queue lég èrem ent rel evée . Ces ch i en s n ’
ab o i entpas,
i l s don nen t l ’ éve i l par un l o ng hurlemen t i l s o n t peu
de sympathi e p our les Européen s,mai s montren t un
grand at tachemen t à l eurs m aîtres i nd igènes,qu i le
l eur renden t b i en . Leur chai r est con s idérée comme un
mets tel l ement dé l i cat et savoureux que l ’usage en est,para i t - i l
,réservé aux grands chefs seulemen t .
Haut p erchés sur des j ambes mal i ngres , l e s chats
sont très laide,mai s i l s renden t de grands servi ces
aux i nd igènes en l es a idan t‘
a se débarrasser des
pet i ts rat s no i rs qu i envah i s sen t les v i l lages’
a cer
tai nes époques de l ’année .
L’ é levage du porc domest i que es t un e des industri es
des i nd igènes,et sert a l eur nourri ture . I l es t no i r
,
avec de longuesj ambes,et ressemble un p en au cOchon
i rlandai s .
Les vo la i l l es pul lu len t dan s l es vi l lages e l l es son t
pet ites e t t rè s p roduct ives ; l e s i nd igènes mangen t
rarement l es œufs et la i s sen t les pou les couver tous
ceux qu’ el les pondent : auss i l eur nombre est— i l con
s idérab le . Les canards,de l ’ espèce d i te russe
,s e
rencontren t auss i a l ’ état domest i que o n d i t qu ’ i l s
o n t été i ntroduits dan s l e bass i n du Congo,au d ix
sep t i ème s ièc le,par l es Portugai s .
CONCLUSION .
Es t— i l poss i b l e d e résumer l ’ his to i re de la créati o n
de l’
E tat du Congo sans rendre hommag e aux hom
m es courageux qu i se son t dévoués pour exécuter
cette oeuvre gigan tesque ? a ceux qu i par leurs tra
vaux, l eurs voyages on t re levé l e cours du g rand
fleuve et ouvert au commerce de toutes les nati on s
l e chemin de l’Afr i que central e?
A Livi ngs to ne qui a con sacré sa v ie a l e tude de la
régi on des grands lacs a Cameron qu i a comp lé té
le s travaux du célèbre docteur ; a S tan ley , don t le
courage e t l’ énerg ie on t ap lan i toutes le s d iffi cu l tés ,
renversé tous les obstacles e t qu i a réso lu le grand
p rob lème
A Savo rg nan de B razza qui, pendan t d ix an s , a
poursu ivi s o n oeuvre sans se l a i s ser rebuter p . r
les fatigues , san s s’
e ffraye r de la grandeur de la
tâche,sans fa idl i r un seu l i n s tan t sous le po id s de s
attaques d on t i l é ta i t l ’obj e t . Sans verser de sang,i l
a acqu i s à. l a France des terri to i res p lus g rands q ue
l a France el l e -m èm e ; san s lu tte , s an s comba t,i l a
,
par l a seu le pe rsuas io n ,soum i s de s peup lades sous
l a souvera i ne té de no tre patri e i l a ouvert a no tre
commerce la rég i o n la p l us be l le ,la p lus riche , la
mieux s i tuée de tou t l’
O ue s t a fr i cai n .
Déso rmais , ces pays sont nô tre s ; la route qu i de s
238 LE CONGO .
sert l e grand fleuve,par où passeron t tous les pro
duits du haut Congo,par où les r i ches ses de l
’
Afri que
cen tral e gagnero nt la cô te,travers e no s pos sess i on s ;
les peup les qu i l’hab i ten t,et qu i étai en t l es ennem i s
des b lancs , s on t no s al l i és et no s auxi l iai res .
B ientô t,à. l ’ ombre du drap eau françai s, d i spa
ra îtra l ’ esclavage ; dan s ces région s lo in ta ines et s i
longtemps barbares,l e pavi l l o n tr i co lo re fl ottera
comme un emb lème de paix et de j ust ice,et l e Congo
françai s aura mér i té son nom de FRANCE ÉQUATO
RIALE
ND
40 TABLE DES MATIERES .
CHAP I TRE ! I I I .
C u l tu re . C omm e rce . Aven i r de la
race n ègre .
CHA P I TR E x1v .
C l imat . Produc t io n du sol . An imaux .
CON C LUS ION .
TABLE DES GRAVURES
M . Savorg nan de B raz za .
S tan ley - Pool .
La Po int e de Banan e .
C am e ron .
C ame ro n,b l e ssé
,se fa i t po r te r dans son ham ac .
S tan ley ,so n gu i de Kalou lou e t son in te rp rè te Se l im .
Po r tage de la Lady Al i ce .
C am pem en t a l ’ en t rée de S tan l ey-Poo l .Le Lady A l zce desc endan t les rap i des.
M . Savorg nan de B raz zaTrave rsée d ’
une 1 iwère p rès des sou rce s de l’Ogôo n e .
Le ro i Makoko .
Le ro i de Y e llala .
Le ro i Lu te te .
Un gue r r i e r Batéké .
V i l lage ind i gèneFemm es Kab i ndas .
Case de Krowb oys .
Pon t ind i gène .
Un e caravane .
PO IT IERS . TY POGRAPHIE OUD IN .