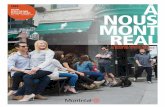D’AGDE À BÉZIERS: LES GRECS EN LANGUEDOC OCCIDENTAL (DE 600 À 300 AV. J.-C.)
Transcript of D’AGDE À BÉZIERS: LES GRECS EN LANGUEDOC OCCIDENTAL (DE 600 À 300 AV. J.-C.)
FROM THE PILLARS OF HERCULES TOTHE FOOTSTEPS OF THE ARGONAUTS
Edited by
ANTOINE HERMARY and GOCHA R. TSETSKHLADZE
COLLOQUIA ANTIQUA————— 4 —————
PEETERSLEUVEN – PARIS – WALPOLE, MA
2012
93773_Hermar_voorwerk.indd III93773_Hermar_voorwerk.indd III 1/06/12 11:111/06/12 11:11
1 Le Languedoc est habituellement subdivisé en deux parties (Languedoc oriental et Languedoc occidental), distinctes par la géographie, l’histoire et l’archéologie, mais dont les limites sont variables selon les auteurs. Dans ce travail (Fig. 1), le Languedoc oriental désigne la partie orientale du départe-ment de l’Hérault, à l’Est d’une ligne Nord–Sud matérialisée par le Massif de la Moure, jusqu’à Sète/Frontignan. Caractérisé par les étangs côtiers et les garrigues de l’arrière-pays, le Rhône en constitue la limite orientale naturelle. Le Languedoc occidental désigne l’espace situé à l’ouest de cette ligne nord–sud, comprend l’étang de Thau, les vallées de l’Hérault, du Libron, de l’Orb et de l’Aude, ainsi que les étangs de la région de Narbonne et les Corbières. Géographiquement, Languedoc oriental et occidental sont donc séparés par le Massif de la Moure, qui descend du Causse d’Aumelas vers le Bassin de Thau et dont le relief s’estompe entre Mèze et Bouzigues. Ce relief constitue une barre rocheuse bien visible et marquant de manière spectaculaire la diversité des paysages à l’est et à l’ouest.
D’AGDE À BÉZIERS:
LES GRECS EN LANGUEDOC
OCCIDENTAL (DE 600 À 300 AV. J.-C.)
Daniela UGOLINI
AbstractGreek sources have shown evidence of a Greek presence in western Languedoc: Agathe (Agde) was a city of Massalia. Greek influence and economic presence were long con-fined to the lower valley of the River Hérault as well as the immediate hinterland, but recent research on material culture and chronologies have brought about the identification of one aspect mainly concerning coastal sites where a Greek presence is admitted, as in Agde, or strongly presumed, as in Béziers. The continuation of this research consists in gathering an ensemble of criteria giving evidence of the Greek aspect of a site, or even of the role that the Greeks might have played in indigenous sites, or even among a mixed population. Analysis of regional dynamics in terms of the functional collaborations neces-sary to support an economic system, shows the birth and development of a Greek branded synergy, which it is possible to identify from examination of some sites – each with their own characteristics and complementary roles – which provided a structure for everything until the end of the 4th century BC. It is through these articulations that we should now read the archaeological data in order to understand the goals pursued by the Greeks in this part of the coast, which was a meeting place for land routes, waterways and seaways, where their development was even more important that we have tended to believe. Béziers is at the heart of the question, in itself because we are dealing with an ‘original’ site and, in a more general way, because it determines a change in perspective. The Greek hold in western Languedoc, the way we perceive it nowadays, could develop its own diversified dynamics, facilitating the exchange within the continent, through control of land-bases communications, and by sea, through control of the best harbour along this coast.
On sait que les Grecs se sont établis en Languedoc occidental1 grâce aux sources anciennes concernant Agde (Fig. 1). Les découvertes faites ici, à
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 16393773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 163 1/06/12 11:211/06/12 11:21
164 DANIELA UGOLINI
proximité et dans d’autres sites de cette région, ont mis en évidence une emprise grecque étendue dont l’importance dépasse largement celle, étriquée, qu’on lui a attribuée jusqu’à date récente et que, parfois, on lui attribue encore. Grecs et indigènes sont à l’origine d’un système économique articulé, qui a fonctionné et évolué avec le temps et qui a impliqué plusieurs établissements complémentaires entre eux.
Ces recherches, conduites dans un cadre ordonné et programmé au cours des vingt dernières années, invitent à repenser le rôle et l’importance des Grecs dans cette zone de la côte gauloise, à mi-chemin entre Marseille et l’Ibérie, mais posent aussi d’une façon nouvelle la question du développement des sociétés indigènes et des contacts avec la civilisation ibérique.
Dans ce contexte, les découvertes faites à Béziers ont eu un rôle de premier plan. Les aménagements immobiliers et les vestiges mobiliers des premiers siècles de vie de cette ville (Béziers I) sont tellement hors normes – en regard de ce que l’on observe habituellement en milieu indigène au cours de l’Âge du
Marseille
Arles
Béziers
La Cité deCarcassonne
Agde
La Monédière
Mont-Joui
St-Siméon
Ensérune
Le Cayla
Montlaurès
LattesLe
Caïlar
Espeyran
Aude
Orb
Hérault
(Carte D. UGOLINI, 2002)
GOLFE DU LION
Casse-Diables
Languedococcidental
Pech Maho
Rhodé
Emporion
Mèze
Mas de Pascal
Le Fort Étang de Thau
Fig. 1: Carte du Languedoc avec localisation des sites mentionnés dans le texte(carte de D. Ugolini, 2002).
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 16493773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 164 1/06/12 11:211/06/12 11:21
D’AGDE À BÉZIERS: LES GRECS EN LANGUEDOC OCCIDENTAL 165
2 Ugolini et al. 1991, 197.3 Le Peyrou: Nickels et al. 1981; Nickels 1989. Le Bousquet: Mazière et Gomez 2001;
Mazière 2003.4 Ugolini 2001a–b.5 Au Ve s. ap. J.-C., Étienne de Byzance (s.v. Ethniques), écrit qu’Agathè était une ville des
Ligures ou des Celtes, que Scymnos (seconde moitié du IIIe ou première moitié du IIe s. av. J.-C.) considérait comme une ville des Phocéens, alors qu’Eudoxe (IIIe s. av. J.-C.) mentionnait ‘une’ Agathè. Toujours selon Étienne de Byzance, Timosthène (deuxième quart du IIIe s. av. J.-C.) l’appelait Agathè Tychè dans son Stadiasme et Philon (IIe s. ap. J.-C.) connaissait une ‘autre’ Agathè chez les Ligures, située sur le ‘Lac Ligystien’.
fer – que l’hypothèse d’une présence grecque massive a paru la seule à même de les expliquer de manière satisfaisante2. C’est dans la confrontation avec les autres établissements grecs et indigènes du Midi que l’idée a progressivement acquis tout son poids archéologique et historique. On sait maintenant que Béziers a puissamment contribué – depuis le début du VIe s. et jusqu’à la fin du IVe s. av. J.-C. – au fonctionnement d’un réseau économique efficace et rentable qui a fait prospérer des Grecs établis aux limites occidentales de leur suprématie commerciale en Gaule.
AGDE
Agde occupe une légère éminence basaltique sur la rive gauche de l’Hérault, à 4 km de la mer, dans un environnement anciennement modelé par les marais et les étangs. Les possibilités d’implanter un port fluvio-maritime, à la sortie du puissant courant rhodanien, ont certainement guidé le choix de cet endroit. D’ailleurs, l’intérêt des navigateurs méditerranéens pour le Languedoc occi-dental est ancien puisque c’est notamment dans les nécropoles indigènes mises au jour dans la zone de la future Agde3 qu’ont été découvertes les plus anciennes importations de typologie grecque du Midi (troisième quart du VIIe s. av. J.-C.). Indépendamment de l’origine des distributeurs de ces pièces (Grecs, Étrusques ou Phéniciens), cela renforce l’idée qu’Agde se trouve dans un point clé de la géographie de cette côte, une particularité qui en a fait le port principal, voire même le seul, du Golfe du Lion.
Les résultats des recherches menées depuis 1938 (une cinquantaine de points de découverte: Fig. 2) permettent de dresser un tableau cohérent d’Agde grecque.4
LES SOURCES
Les textes les plus anciens concernant Agde datent entre le IIIe s. et le milieu du IIe s. av. J.-C. Ils sont conservés de manière indirecte et ne sont, en réalité, que des mentions du toponyme.5 Plus tard, deux auteurs seulement, le Pseudo-
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 16593773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 165 1/06/12 11:211/06/12 11:21
166 DANIELA UGOLINI
Scymnos et Strabon, livrent des renseignements plus étendus qui se recoupent. Pour le Pseudo-Scymnos (208: seconde moitié du IIe s. av. J.-C.), les Pho-céens de Marseille, après avoir fondé Emporion et Rhodè, ont occupé Agathè.
HERAULT
rue Jean Roger
rue d
u Por
talet
rue
del'Amour
rue L
ouis
Bages
SquarePicheire rue Perben
rue
Terri
sse
rue C
assa
n
Place des Aires
PlaceJean Jaurès
PlaceMolière
rue H
onoré
Mura
tet
Impa
sse
Molière
rue du 4 Septembre
Placede laGlacière
Plan
Cécile
rue de
la V
ille
rue d'Embonne
Cathédrale
Saint Etienne
Cathédrale
Saint Etienne
Quai de
s Troi
s Frèr
es Azém
a
PlaceGambetta
rue Kléber
rue Je
an Ja
cque
s Rou
sseau
Placedu jeude Ballon
rue de la République
EgliseSaint André
EgliseSaint André
Eglise Saint Sever
Eglise Saint Sever
HERAULT
Halles
MuséeAgathois
C. OLIVE 1995
0 100 200 m
N 1
23
4
5
6
7
89
10
11
12
13
14
16
18
19
20
21
22
23
24
28
27
2931
32
34
33
37
40 41
44
45
A C
B
D
35
36
38
39
15 17
25 26
30
4243
46 47
4849
50
21
48
observation/découverte ponctuelle
sondage archéologique
Fig. 2: Agde. Fouilles et observations archéologiques effectuées en ville depuis 1938 (plan de C. Olive, 2000; d’après Lugand et Bermond 2001, fig. 3).
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 16693773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 166 1/06/12 11:211/06/12 11:21
D’AGDE À BÉZIERS: LES GRECS EN LANGUEDOC OCCIDENTAL 167
6 Pline l’Ancien (NH 3. 5) l’appelle ‘Agatha’ et écrit qu’elle avait appartenu à Marseille. Pomponius Méla (De Chorographia 2. 5. 80), au Ier s. ap. J.-C., se contente de la localiser sur l’Hérault. Ptolémée (au IIe s. ap. J.-C.) est le dernier auteur à la mentionner (2. 10. 2): il place Agathè entre l’embouchure de l’Hérault et le Mont de Sète, mais dans le passage suivant, il décrit Agde et Blascon (Brescou) comme deux îles ‘au-dessous’ de la Narbonnaise.
7 Ugolini 2001b, 120.
Pour Strabon (4. 1. 5–6), à l’époque d’Auguste, les établissements fondés en Ibérie défendaient Marseille des Ibères, alors que Rhoen (Rhodanousia?) et Agathè la protégeaient contre les Barbares de la vallée du Rhône.
Après les auteurs du Ier et du IIe s. ap. J.-C., qui, à nouveau, citent à peine le toponyme6, Agde disparaît des textes grecs et latins de la période romaine, jusqu’à l’Antiquité tardive7.
LA CHRONOLOGIE
Agde a été fondée autour de 550–525 av. J.-C. et plutôt vers la fin de ce quart de siècle, en un lieu vierge de toute occupation antérieure. Deux nécropoles du VIIe s. av. J.-C. témoignent de la présence d’au moins deux communautés indigènes établies à proximité immédiate du futur pont (celle du Peyrou se trouve à 500 m et celle du Bousquet à 3 km), mais aucune présence indigène n’est attestée, à l’époque de la création, sous l’Agde grecque.
L’occupation a été continue, depuis la fondation jusque vers 50 ap. J.-C. Trois périodes sont particulièrement marquées: 1) les premiers temps, notam-ment entre le dernier tiers du VIe s. et le début du Ve s. av. J.-C.; 2) le déve-loppement, au IVe s. av. J.-C., et notamment la première moitié de ce siècle; 3) l’époque des contacts avec Rome, entre 150 et 50 av. J.-C., qui est la période la plus importante, tant du point de vue de l’extension du site que du point de vue des activités économiques.
Agde a été plus ou moins abandonnée en tant que centre urbain vers 50 ap. J.-C. Le port a pu faiblement fonctionner à l’époque impériale pour les besoins des villas romaines du territoire de Béziers, auquel Agde appartenait alors, mais les indices dans ce sens sont particulièrement ténus. Bien plus tard, au Ve s. ap. J.-C., la ville est réoccupée.
ÉPIGRAPHIE, ÉCRITURE, MONNAYAGE
Aucune inscription grecque (ni latine) de provenance et chronologie sûres n’a été recueillie jusqu’ici. Le seul texte grec, une plaque en plomb inscrite en ‘ionien’, aujourd’hui perdue et jamais vraiment déchiffrée, était probablement une lettre commerciale que le contexte de découverte situe entre le IVe s. et la
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 16793773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 167 1/06/12 11:211/06/12 11:21
168 DANIELA UGOLINI
8 Lugand et Bermond 2001, 127–28 fig. 11.9 Bénézet 2002.10 Aris et Richard 1979.11 Lugand et Bermond 2001, 123–63, avec bibliographie antérieure.12 Pour les diverses hypothèses, voir Ugolini 2001b, 123. Récemment, 200 ou 300 m en
amont d’Agde et sur la rive droite de l’Hérault – et donc sur la rive opposée du fleuve –, on a repéré une zone, aujourd’hui immergée, qui pourrait être un débarcadère (Tourrette 2002). Si tel était le cas, alors il aurait été en fonction durant la dernière phase de la ville grecque (–150/+50).
13 Lugand et Bermond 2001, 140–41.14 Lugand et Bermond 2001, 145–46.15 Mazière et Gomez 2001.16 Ugolini 1999.
fin du IIe s. av. J.-C. Dans cette fourchette chronologique, c’est vraisemblable-ment la dernière période qu’il faut retenir8.
Les graffitis sont rares (lettres grecques isolées ou signes tels que croix ou barres) et ne se rencontrent que sur des vases importés à vernis noir des IIe-Ier av. J-C. 9
Agde n’a pas frappé monnaie et il n’y a aucun indice de circulation moné-taire avant le IIe s. av. J.-C., lorsque sont attestées les monnaies de Marseille, celles de la République romaine et aussi des pièces attribuées aux indigènes de la région.10
L’ÉTABLISSEMENT
Les données disponibles ont fait l’objet d’un bilan récent.11 Pour résumer, Agde couvrait environ 3 ha enserrés dans un rempart. La ville
a pu s’étendre tardivement (fin IIe-Ier s. av. J.-C.) au-delà de l’enceinte pour atteindre une superficie totale d’environ 4.5 ha. Le port n’est pas localisé12 et aucun lieu de culte n’a été identifié. Le seul espace funéraire jouxtant la ville a été mis au jour à Saint-André, où quelques tombes du Ier s. av. J.-C. ont été fouillées anciennement13. Une trentaine de tombes échelonnées entre le IVe s. et le Ier s. av. J.-C. ont été découvertes au Peyrou14 et une tombe du IIe ou du Ier s. av. J.-C. a été découverte au Bousquet.15
Le plan du site était orthogonal et a été établi dès la fondation. L’occupation comportait des quartiers d’habitation et, au IVe s. av. J.-C., au moins une zone publique.16 On ne connaît presque rien des formes de l’habitat du VIe s. av. J.-C. et l’on a peu de renseignements pour celles des siècles suivants. Toute-fois, dès le début, les murs ont des solins en pierres non taillées et des éléva-tions en adobes. Les sols sont toujours en terre battue, sauf ceux de l’édifice public du IVe s. av. J.-C., mentionné plus haut, que l’on a obtenus en compac-tant des éclats de basalte dans de l’argile.
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 16893773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 168 1/06/12 11:211/06/12 11:21
D’AGDE À BÉZIERS: LES GRECS EN LANGUEDOC OCCIDENTAL 169
17 Ugolini et Olive 2002; 2003b; 2004.18 C’est la proposition de Nickels 1981, qui garde encore toute sa valeur. Selon une autre
hypothèse (Garcia 1995a–b), jusqu’ici non confortée par l’archéologie, le territoire serait immen-sément plus grand, en place et en production dès le IVe s. av. J.-C.
19 Lugand et Bermond 2001, 150 fig. 57–61; Gomez 2002; 2003c.20 Reille 2000.21 Nickels 1978.22 Demoule 2004, 115 fig. à gauche.23 Ugolini 2002.
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Agde était un port et a sûrement eu un rôle commercial. La recherche a long-temps cantonné son rayon d’action à la vallée de l’Hérault, que l’on a vue comme une zone de ponction économique, plus ou moins directement sous son contrôle. En fait, l’évaluation du volume des échanges montre que les efforts commerciaux d’Agde étaient tournés essentiellement vers l’Ouest, en fonction de dynamiques économiques que l’on cerne de mieux en mieux17.
Les activités vivrières sont peu représentées, sans doute parce que la fonction d’Agde n’était pas – au moins pendant les premiers siècles – celle de produire et le territoire a dû longtemps se limiter à une ceinture de jardins.18 Par contre, d’importantes exploitations agricoles, en fonction entre le IIe s. av. J.-C. et le tournant de l’ère, laissent entrevoir le développement tardif d’un territoire dont la production était apparemment centrée sur la viticulture.19
Aucune activité artisanale n’a été identifiée en ville, ni à sa périphérie immé-diate. Tout au plus peut-on rappeler un éventuel travail du cuir (mentionné sur la plaque en plomb citée plus haut), si toutefois cela concernait Agde. L’exploi-tation des carrières de basalte du Cap d’Agde et de Rochelongue pour la fabri-cation des meules rotatives n’a pris son essor qu’au IIe s. av. J.-C.20
Agde n’a pas produit de céramiques jusqu’au milieu du IIe s. av. J.-C. Tou-tefois, l’étude des vases gris monochromes du Languedoc occidental a fait envisager la présence d’ateliers dans la vallée de l’Hérault,21 une idée que conforte maintenant la découverte de deux fours de potiers à Aspiran, au Mas de Pascal,22 37 km au nord d’Agde, sur la rive droite du fleuve.
LE FACIÈS MOBILIER
Dans le mobilier d’Agde, la céramique non tournée est relativement abondante
entre le VIe s. av. J.-C. et la première moitié du Ve s. av. J.-C., puis elle se stabilise autour de 5% des vases formant la vaisselle car les pots tournés à gros dégraissant, produits à Béziers, la remplacent rapidement pour la fonction ‘cuire les aliments’.23 À partir de la seconde moitié du IVe s. av. J.-C., lopades
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 16993773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 169 1/06/12 11:211/06/12 11:21
170 DANIELA UGOLINI
24 Ugolini 2002.25 Gomez 2000a.26 Ugolini 1995b.27 Bénézet 2002, 74–75.28 Pour les quelques ensembles cohérents de cette période, voir Nickels 1995.29 Ugolini et Olive 2002.30 Lugand et Bermond 2001, fig. 59–61; Gomez 2002; 2003c.31 Nickels 1995, fig. 13.17 et 18.25–26; Ugolini 1993b; à paraître.32 Nickels 1995, fig. 16.1 (IVe s. av. J.-C.) et 20.11 (IIIe s. av. J.-C.).33 Fouilles de la Place: Conesa 1999.
et chytrai grecques importées, d’abord du monde grec (tournées) puis de la région de Marseille (non tournées) vont progressivement augmenter.24 En d’autres termes, au fur et à mesure que les produits biterrois se raréfient, d’autres vaisselles culinaires importées vont les substituer. Les mortiers de cuisine en céramique, servant à la transformation de certains aliments, sont en progression depuis le VIe s. av. J.-C.25 Quant à la vaisselle de table, la céra-mique grise monochrome est représentée jusque vers le milieu du IVe s. av. J.-C., mais la quantité est en baisse constante. Les vases à pâte claire se par-tagent entre productions massaliète (±17%), biterroise (±17%) et ibériques (±10%) jusqu’à la fin du Ve s. av. J.-C. Les productions ibériques tendent à disparaître dès le début du IVe s. av. J.-C. La céramique attique atteint le taux le plus élevé dans la première moitié du IVe s. av. J.-C.,26 alors que la présence d’autres vases à vernis noir est très discrète.27
Le faciès du IIIe s. av. J.-C. reste encore flou, dans la mesure où ce siècle a laissé peu de vestiges,28 alors qu’au cours des deux siècles suivants la céra-mique en usage doit désormais beaucoup au monde italique.
Les amphores présentent une certaine diversité des origines dans la période initiale, mais, dès 450 av. J.-C., celles de Marseille sont pratiquement les seules à arriver29 (Fig. 3.3–4). À partir du début du IIe s. av. J.-C., elles sont déjà presque exclusivement d’origine italique et l’on produit, dans la cam-pagne d’Agde, des amphores copiant justement le modèle italique.30 Les amphores représentent pratiquement toujours environ 40% du nombre total des vases.
Enfin, à Agde on a utilisé quelques lampes31 et des pesons pyramidaux pour le tissage;32 dont un, du IVe s. av. J.-C., a été mis au jour récemment.33
LES GRECS À AGDE
La présence grecque à Agde n’a jamais posé de problème grâce aux mentions anciennes citées ci-dessus. Toutefois, la confusion induite par ces mêmes sources sur l’origine des fondateurs (Phocéens ou Massaliètes) a suscité des
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 17093773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 170 1/06/12 11:211/06/12 11:21
D’AGDE À BÉZIERS: LES GRECS EN LANGUEDOC OCCIDENTAL 171
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Indéterminée magno- grecque
punico- ébusitaine
punique ibérique grecque massal. étrusque
–350/–300 –400/–350 –450/–400 –500/–450 –550/–500 –600/–550
% NFr
BÉZIERS (Hérault). Centre ville. Les amphores en nombre de fragments, par périodes.
1
0
20
40
60
80
100
ibérique massaliète grecque étrusque
-250/-180 -350/-250 -450/-350 -550/-450
% NMI
AGDE (Hérault), Rue Perben. Les amphores en nombre d’individus.
3
0
20
40
60
80
100
Indéterminée ibérique grecque massaliète étrusque
-IIIe s. -IVe s. -Ve s. (% NFr) (% NMI) (% NFr) (% NFr) (% NMI) (% NMI)
0,5% (A-GRE)
% AGDE (Hérault), Square Picheire. Les amphores en nombre de fragments et d’individus
4
0
20
40
60
80
100
Indéterminée ibérique et punique
grecque et massaliète
étrusque
-475/-400 -500/-475 -550/-500 -600/-550
(NFr) (NFr) (NFr) (NFr) (NMI) (NMI) (NMI) (NMI)
% LA MONÉDIÈRE (Hérault). Les amphores en nombre de fragments et d’individus, par périodes. 5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Indét. magno-grec. punique ibérique grecque massal. étrusque
–IVe s. –Ve s. NFr NFr NMI NMI
BÉZIERS (Hérault), Place de la Madeleine. Les amphores en nombre de fragments et d’individus, par siècles.
%
2
Fig. 3: Tendances de la circulation amphorique entre l’Orb et l’Hérault de 600 à 300 av. J.-C. (d’après Ugolini et Olive 2004). 1–2. Béziers; 3–4. Agde; 5. La Monédière.
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 17193773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 171 1/06/12 11:211/06/12 11:21
172 DANIELA UGOLINI
34 Gaches 1947.35 Résumé de la question dans Ugolini 2001b, 121.
divergences d’opinion sur la date de fondation ainsi que sur la composition ethnique des premiers habitants. On a alors envisagé une solution intermé-diaire permettant de contourner l’obstacle: Agde aurait pu faire l’objet de deux fondations successives;34 la première (VIe s. av. J.-C.), phocéenne, aurait pu correspondre à un noyau de Grecs, établis peut-être dans un établissement indigène, alors que la seconde, autour de 400 av. J.-C., aurait été purement massaliète.35
Or, les Massaliètes étant eux-mêmes des Phocéens, le fait que les sources ne concordent pas exactement sur ce point précis n’est pas bien grave et ne jus-tifie pas, en soi, l’idée d’une fondation en deux temps. En effet, créée avant la
0 100 300 500 m.
L’ORB
Le Lirou
N
10
3
9
11
13
15
1
16
4
56
7
8
12
14217
18
19
Plan C. Olive
2021 22
23
24
26
23 13Fouille ou sondage�:absence de vestiges de l'Âge du fer.
Fouille archéologiqueObservation lors de travaux Limites de l'agglomérationde lʼÂge du fer
7 25
26
27
28
29
30
31
32
Fig. 4: Béziers. Fouilles et observations archéologiques effectuées en ville depuis la fin du XIXe s. (plan de C. Olive, 2004).
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 17293773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 172 1/06/12 11:211/06/12 11:21
D’AGDE À BÉZIERS: LES GRECS EN LANGUEDOC OCCIDENTAL 173
36 Ugolini 2001c; Ugolini et Olive 2002; 2003b; 2004; 2006a; Olive et Ugolini 2003.
majorité des autres comptoirs massaliètes de Gaule, Agde prend place dans le mouvement d’expansion grecque qui, de Marseille à la côte ibérique, couvre le VIe s. av. J.-C. D’un autre côté, le mobilier mis au jour à Agde évolue évidem-ment avec le temps, mais l’on ne saisit pas des changements qui marqueraient de façon décisive une nouvelle fondation, que ce soit vers 400 av. J.-C., avant ou après. Il reste que ce mobilier se différencie toujours de celui des sites indigènes contemporains et l’on sait maintenant que les meilleures comparaisons s’ob-tiennent avec le mobilier de Béziers, du moins jusque vers 300 av. J.-C., date de l’abandon de ce dernier site. Les similitudes entre les faciès de ces deux sites incitent à regarder ces questions d’une autre manière. On y reviendra.
BÉZIERS
Béziers occupe une colline sur la rive gauche de l’Orb, 20 km à l’ouest de La Monédière, 22 km à l’ouest d’Agde et à 15 km de la côte actuelle. Site de hauteur dans une situation idéale pour le franchissement du fleuve, Béziers dispose de sources pérennes jaillissant sur la colline même, qui garantissent l’approvisionnement en eau douce. Le site domine un terroir vallonné extrê-mement fertile et bien drainé.
Comme pour Agde, les fouilles y sont limitées en surface et plutôt rares car le bâti postérieur s’est superposé à la première ville (Fig. 4). Pendant long-temps, la profondeur des vestiges a masqué l’évidence archéologique et c’est seulement à partir des fouilles de 1985–86 que la documentation s’est étoffée et a pu être analysée et comparée à celles des autres habitats de la région. Depuis, le suivi attentif de toutes les opérations affectant le sous-sol a permis de collecter les renseignements nécessaires aux premières synthèses tenant compte des nouveaux acquis.36
LES SOURCES, LE TOPONYME
Le premier Béziers (Béziers I) n’est pas mentionné par les sources, du moins pas sous le toponyme actuel. La forme la plus ancienne de ce dernier est Betarra (ou plutôt Betarratis, ‘de Betarra’), qui apparaît inscrit en caractères grecs sur les monnaies des IIe-Ier s. av. J.-C. émises par l’établissement gau-lois érigé sur les ruines de la première ville, un siècle après son abandon. C’est le nom que connaissaient Strabon (4. 1. 6: Baitera) et toutes les sources d’époque romaine.
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 17393773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 173 1/06/12 11:211/06/12 11:21
174 DANIELA UGOLINI
37 Ugolini et Olive 1987; 2003a, 299–300 et n. 19; 2006a, 135–38.38 Ugolini 1995a, fig. 19.39 Clavel 1970, 180–200.40 Ugolini 2005.
Aviénus (Ora Maritima 589–590), poète du IVe s. ap. J.-C., l’appelle ‘Besara’ et, puisque l’on a attribué à son œuvre des sources du VIe s. av. J.-C., on a pu croire que le nom de la ville a toujours été le même. En fait, on sait aujourd’hui qu’Aviénus ne s’est pas inspiré de textes ‘très anciens’ pour sa description de la côte gauloise occidentale.37 Par contre, il faut retenir que le passage de l’Ora Maritima est le seul à transmettre que la Betarra gauloise était construite sur les ruines d’une ville plus ancienne dont le territoire était prospère et que Aviénus a forcément glané cette information chez un (ou des) auteur(s) postérieur(s) au IIIe s. av. J.-C. Le nom de la première ville peut donc fort bien avoir été différent et son souvenir a pu se perdre suite à l’aban-don du site: en effet, un intervalle d’au moins un siècle sépare la désertion de Béziers I de sa réoccupation gauloise, Béziers II/Betarra (que l’on situe autour de 200/175 av. J.-C.). C’est un point important de l’histoire de la ville dont la méconnaissance a occasionné beaucoup de confusion.
Les linguistes qui se sont penchés sur le toponyme Betarra ont proposé, tour à tour, de le faire dériver de toutes les langues non latines connues, du basque à l’ibérique, du pré-indoeuropéen au gaulois. Au vu de la situation que l’on vient de décrire, il est logique de croire que l’étymologie renvoie au gaulois.
ÉPIGRAPHIE, ÉCRITURE, MONNAYAGE
Béziers I n’a pas restitué d’inscriptions grecques. Quelques graffitis sur céra-miques importées (le plus souvent une ou deux lettres, sur céramique attique et parfois sur amphores), mais aussi, dans deux cas, sur grise monochrome locale, sont à signaler.38 Tous semblent se rapporter au grec. Tout récemment, a été mis au jour le premier graffito en caractères ibériques sur céramique attique (aimable renseignement d’É. Gomez). Ces graffitis sont rares, mais moins qu’à Agde.
Béziers I n’a livré aucune monnaie antérieure au IIe s. av. J.-C. Comme pour Agde, la circulation monétaire, et donc l’économie fondée sur la mon-naie, n’est pas envisageable avant ce siècle. Par contre, Betarra a émis des séries relativement bien connues s’échelonnant entre le IIe s. et la fondation de la colonie romaine, en 36 av. J.-C. Les légendes utilisent la langue grecque,39 signe évident, à une époque où les tribus de la région de Narbonne inscrivent leurs monnaies en caractères ibériques, de la continuité du rattachement de Béziers au domaine culturel et économique grec.40
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 17493773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 174 1/06/12 11:211/06/12 11:21
D’AGDE À BÉZIERS: LES GRECS EN LANGUEDOC OCCIDENTAL 175
41 Un sondage profond (rue Mairan, S. 2: Olive et Ugolini 2001; 2003) a permis d’observer pour la première fois une stratigraphie du cœur de ville montrant l’existence de strates couvrant la totalité du VIe s. av. J.-C. C’est sur la chronologie des couches les plus anciennes que repose désormais cette date pour la création du site. Auparavant, on retenait que les premiers vestiges dûment attestés remontaient à 525–500 av. J.-C. (Ugolini et Olive 1987; Ugolini et al. 1991; Ugolini 1995a; Olive 1997).
42 Ugolini, et Olive 1987; 2003; Ugolini et al. 1991, 143.43 Ugolini 2001b–c; 2005; Ugolini et Olive 2002a.
LA CHRONOLOGIE
Après des fréquentations néolithiques et de l’Âge du bronze, dont on n’a pas retrouvé de vestiges en place, Béziers a été créé, dans un lieu inhabité, vers 600–575 av. J.-C.41 Béziers I apparaît donc avant Agde. Dès lors, l’occupation a été continue jusque vers 300 av. J.-C., lorsque la ville a été plus ou moins abandonnée.42 Tout se passe comme si, en l’espace de quelques décennies, la ville s’était vidée de ses habitants, pour des raisons qui restent inconnues. On dira simplement que le IIIe s. av. J.-C. a été une période difficile pour toute la région, au point que très peu de sites offrent alors des preuves incontestables de leur occupation. Les deux principaux établissements indigènes qui per-durent au cours de la totalité de ce siècle (Pech Maho, dans l’Aude, et Ensé-rune, quelques kilomètres à l’Ouest de Béziers) évoluent alors dans un cadre économique tourné surtout vers la Péninsule Ibérique. Quant à Agde, les témoins mobiliers et immobiliers indiquent qu’elle survit, mais qu’elle n’arrive plus à tirer profit de son port.43
La réoccupation de Béziers (Béziers II/Betarra) par les Longostalètes, vers 200–175 av. J.-C., s’accompagne d’un important changement du faciès mobi-lier. Les nouveaux venus ont une culture matérielle qui permet de les rattacher parfaitement aux autres tribus du Midi gaulois et cela conforte l’idée que la première ville a bien été désertée par ses premiers habitants.
Il faut donc garder à l’esprit que tout ce qui se rapporte aux IIe–Ier s. av. J.-C. n’est pas dans la continuité des siècles antérieurs et s’insère dans des dynamiques différentes, tant du point de vue culturel qu’économique ou politique.
Vers 36 av. J.-C., les Longostalètes perdent la maîtrise de la ville, qui, à seulement 25 km de Narbonne, capitale de la Transalpine, devient la deuxième colonie de droit romain entre le Rhône et les Pyrénées.
L’ÉTABLISSEMENT
La superficie occupée entre 600 et 300 av. J.-C. était vaste (Fig. 4). La ville s’est développée à partir d’un noyau central qui a pu atteindre une dizaine
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 17593773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 175 1/06/12 11:211/06/12 11:21
176 DANIELA UGOLINI
44 Olive et Ugolini 2003.45 Ugolini et al. 1991, 143–45; Olive et Ugolini 1997, 88–89, 116, 118–19.46 Ugolini et Olive 1988; Olive et Ugolini 1997.47 Olive et Ugolini 2001; 2003, fig. 5; Ugolini et Olive 2006a, 58–59.48 Olive et Ugolini 1998.49 Olive 2002; Olive et Ugolini 2003.50 Olive et al. 1999; Olive et Ugolini 2003; Ugolini et Olive 2006a, 61–62.51 Ropiot 2003b.
d’hectares dans la deuxième moitié du VIe s. av. J.-C., pour en arriver à cou-vrir un minimum de 35/40 ha.44 Béziers était donc une très grande aggloméra-tion, par comparaison avec les autres sites de la région, qui couvrent moyen-nement de 1 à 4 ha.
L’habitat était dense et structuré. La trame urbaine paraît fixée et orientée dès le début, avec des rues qui subdivisaient l’espace. L’une de celles-ci, où circu-laient des attelages, mesurait 9.60 m de large, avant d’être réduite à 5 m par la construction de boutiques (Fig. 4.1).45 D’autres rues ont été observées en divers points de la ville, mais leur largeur n’est pas connue (Fig. 4.3, 13, 20–21, 28).
Dans ce tissu urbain, les quartiers d’habitations alternaient avec des zones artisanales ou commerciales, voire publiques.
– À la périphérie immédiate du noyau le plus ancien, un quartier de potiers a fonctionné pendant une période indéterminée avant d’être déplacé lorsque le bâti civil a investi cette aire (Fig. 4.1). Vers 460 av. J.-C., ici est construite une maison qui va rester en usage jusque vers 300 av. J.-C. Au cours du IVe s. av. J.-C., une boutique lui a été accolée (Fig. 4.1).46
– Des foyers en batterie se rattachant à une activité artisanale non précisée (Fig. 4.3) ont été observés au centre de la ville. La découverte d’un bas-fourneau (Fig. 4.20)47 conforte l’intense activité de forge pour le fer qui avait été pressentie par le grand nombre de scories trouvées partout en ville.48
– Un grand édifice (public?) a été construit entre la fin du Ve s. et le début du IVe s. av. J.-C., sur un remblai de préparation aménageant la rive de l’écou-lement à ciel ouvert d’une source pérenne (Fig. 4.7).49
– La colline Saint-Jacques, en position idéale pour contrôler la vallée de l’Orb et surplombant une voie d’accès à la ville, était ceinturée d’un fossé au pro-fil en V, large plus de 10 m (Fig. 4.10, 19, 29), qui a perdu son intérêt par la suite et a été recouvert par des habitations de la première moitié du IVe s. av. J.-C. (Fig. 4.9, 16).50
– On n’a aucune donnée sur un éventuel rempart, ni sur un éventuel port, mais on sait que, à partir de son embouchure, l’Orb est sûrement navigable jusqu’au pied de la ville et peut-être plus loin.51
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 17693773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 176 1/06/12 11:211/06/12 11:21
D’AGDE À BÉZIERS: LES GRECS EN LANGUEDOC OCCIDENTAL 177
52 Gomez et Ugolini dans Ugolini et Olive 2006a, 67–69.53 Ugolini et Olive 2006a, 62–63.54 Olive et Ugolini 1997, 90–115 fig. 8 et 16; de Chazelles dans Ugolini et Olive 2006a,
49–50.55 de Chazelles dans Ugolini et Olive 2006a.56 Olive et Ugolini 1997, 92–94 fig. 19.2; 2003; Olive 2002; C.-A. de Chazelles dans Ugolini
et Olive 2006a, 57.
– On n’a pas identifié de lieux de culte, mais la découverte de terres cuites décorées, peut-être des petits autels votifs, pourrait concerner la sphère spi-rituelle.52
– Les nécropoles de Béziers I ne sont pas localisées.53
La conception de l’espace privé d’habitation est matérialisée par un plan, malheureusement incomplet. Structurée autour d’une cour centrale, cette mai-son à plusieurs pièces occupait plus de 150 m2 au sol. Construite vers 460 av. J.-C., elle est restée en usage jusqu’à la fin du IVe s. av. J.-C. Elle offre un exemple qui reste, vingt ans après sa découverte, unique dans le Midi (Fig. 4.1).54
Les constructions mettent en œuvre des murs habituellement sur un socle en pierre, parfois à deux rangées d’orthostates et remplissage. L’élévation est toujours en adobes, dont l’usage est courant depuis le VIe s. av. J.-C. Les murs externes ont parfois reçu un enduit de finition mêlant argile et chaux. Les sols sont le plus souvent en terre battue, mais ils peuvent être pavés d’adobes, alors que des sols hydrofuges ont été réalisés en compac-tant des éclats de calcaire. D’autres sols ont reçu un revêtement fait d’un mélange de terre et chaux (première moitié du VIe s. av. J.-C.: Fig. 4.21), ou sont dallés, voire caladés, ou encore pavés de fragments d’amphores massaliètes.
La couverture en tuiles de certains toits (des bâtiments publics?) est assu-rée.55 On trouve des fragments de tuiles dès le milieu du Ve s. av. J.-C., ce qui signifie forcément qu’elles étaient en place bien avant cette date (Fig. 5). Il s’agit de tuiles plates et de couvre-joints courbes ou pointus dont il existe plu-sieurs mesures, adaptées à différents types d’édifices. Elles sont, après celles de Marseille, les plus anciennes de Gaule, portent parfois des traces de pein-ture rouge et sont produites localement dans une pâte caractéristique. Ces toits très lourds étaient portés par des charpentes adéquates, mises en place grâce à de très gros clous forgés en fer.56
Les éléments que l’on vient d’énumérer traduisent une ambiance véritable-ment urbaine qui n’a pas de comparaison dans le milieu indigène contempo-rain et qui paraît exceptionnelle à tous les égards.
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 17793773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 177 1/06/12 11:211/06/12 11:21
178 DANIELA UGOLINI
57 Mazière 1998; Ugolini 1997c; Ugolini et Olive 2003b; 2004.58 Mazière et al. 2001; Ugolini et Olive à paraître.59 Ugolini et Olive 1998.60 Un four de boulanger a été fouillé et un petit pain brûlé a été trouvé: Olive et Ugolini
1997a, fig. 20 et 27; Ugolini et Olive 2006a, 60–61.
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Dès son installation vers 600–575 av. J.-C., Béziers instaure des relations avec l’arrière-pays.57
La constitution du territoire se perçoit clairement déjà dans la deuxième moitié du VIe s. av. J.-C. (Fig. 6).58 De cet espace économique diversifié, qui couvrait un minimum de 150/200 km2, où se trouvaient des unités d’exploita-tion agricole,59 Béziers tirait sa subsistance et probablement des excédents. Ce territoire devait être bien organisé et son aménagement imposant puisque, même après son abandon, il donnait l’impression d’avoir été riche et prospère, selon les mots qu’Aviénus (Ora Maritima 589–590) a empruntés à sa source.
Outre les inévitables céréales (utilisées dans maintes préparations et notam-ment pour le pain),60 le poissage des pithoi biterrois suppose l’utilisation de résine et la transformation d’une production agricole vraisemblablement en liaison avec la vigne. La faune consommée montre que les animaux abattus
BZ.P.02.us 56 Tuile BZ.P.02.us 56
Tuile
BZ.P.02.us 56 Tuile
BZ.P.02.us 56 Tuile
BZ.P.02.us 56 Tuile
0 1 5 10 20 cm
Fig. 5: Béziers. Quelques fragments de tuiles plates et courbes de la fin du Ve s. av. J.-C. (Sondage sous l’ancienne Poste centrale, en 2002, fig. 4, n° 7;
dessins de C. Olive).
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 17893773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 178 1/06/12 11:211/06/12 11:21
D’AGDE À BÉZIERS: LES GRECS EN LANGUEDOC OCCIDENTAL 179
Corneilhan
Béziers moderne
Zone de marais
Zone de divagation de l'Orb
60 m 40 m 20 m 0 m
80 m 100 m
4000 m 2000 0 4 km
N
Site de hauteur
Découverte isolée
Point d'occupation (ferme, fosse, fossé,...)
Chemin
49 (?)
11
7
8
10 9
1
2
3
5
6
12
4
13
14
16
Orb
Lirou
Libron
Aude La Moulinasse
Ensérune
15
56
57 (?)
Fig. 6: Béziers. Le territoire vivrier tel qu’on peut le percevoir par la présence de sites ruraux contemporains de la ville (VIe–IVe s. av. J.-C.)
(plan de F. Mazière; d’après Mazière et al. 2001, fig. 6).
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 17993773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 179 1/06/12 11:211/06/12 11:21
180 DANIELA UGOLINI
61 Columeau dans Ugolini et al. 1991, 189–91; Columeau 2000; Columeau dans Ugolini et Olive 2006a, 70: zootechnie évoluée ou achats ciblés au sein de troupeaux élevés par les indi-gènes?
62 Ugolini et Olive 1988, fig. 10; Olive et Ugolini 1997b, fig. 19.3; de Chazelles 1999; de Chazelles dans Ugolini, Olive 2006a, 64–66.
63 Outre ceux de Béziers, les seuls autres fours de potier du Languedoc contemporain sont ceux déjà mentionnés du Mas de Pascal (Aspiran), qui sont isolés de tout habitat.
64 Ugolini et Olive 1988; 2006a, 51–54.65 Jandot 2000; Olive et al. 2001; Ugolini et Olive 2006a, 54–55.
étaient souvent plus grands qu’ailleurs.61 Le filage (fusaïoles) et le tissage (pesons) impliquent que l’on disposait de laine et la forme ronde d’un peson tourné en céramique grise monochrome trahit le tissage de toiles particulière-ment fines, peut-être du lin.62
Grâce à un environnement riche en gisements d’argile, Béziers I a massive-ment produit diverses classes de céramiques tournées. En dehors de Marseille, il s’agit de l’unique cas où des fours de potiers de type grec sont rattachés à une agglomération du Midi.63
Le premier four a été trouvé à la périphérie de la ville du VIe s. av. J.-C., dans une vaste aire où alternaient fosses remplies de dégraissants à la granulo-métrie calibrée et autres zones de cuisson. On envisage l’existence d’un véri-table quartier des potiers où l’on produisait des vases tournés: gris mono-chromes et à pâte claire pour la table, mortiers et vases à gros dégraissant pour les préparations alimentaires et leur cuisson.64
À 3 km du centre-ville, un deuxième four a été mis au jour récemment. Beaucoup plus grand que le premier, la chambre de chauffe présentait une travée centrale et des voûtains perpendiculaires supportant une sole fixe perfo-rée. L’alandier débouchait sur une aire pour le feu (Fig. 7).65 On localise ici une production de pithoi et il vaut la peine de préciser que cet atelier est le seul, découvert en Gaule, qui permette de saisir le mode de cuisson de ces grands vaisseaux.
On sait que Béziers produisait aussi des lampes, des terres cuites architecto-niques (tuiles) et des terres cuites décorées (autels votifs?).
Béziers offre donc l’exemple – unique en Languedoc et, dans le Midi, com-parable seulement à Marseille – d’une production massive de céramique, qui rendait le site quasiment autosuffisant et qui alimentait un commerce vers les communautés indigènes de sa région et même vers des contrées plus loin-taines.
Les amphores parvenaient à Béziers principalement de l’est et c’est ici que l’on observe la plus grande variété des origines, signe évident d’une demande honorée par des arrivages réguliers (Fig. 3.1–2). En volume, le nombre d’am-phores se situe moyennement autour de 20 à 30% des vases recueillis: il
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 18093773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 180 1/06/12 11:211/06/12 11:21
D’AGDE À BÉZIERS: LES GRECS EN LANGUEDOC OCCIDENTAL 181
66 Ugolini et Olive 2004.
s’agit de chiffres inférieurs à ceux de La Monédière ou d’Agde (sites qui sont des points de rupture de charge), mais qui reflètent un niveau élevé de consommation.66
Béziers a été un intermédiaire dans la vente et/ou l’acheminement de cer-tains biens ou matières (amphores de Marseille, ibériques et étrusques, céra-miques attiques, lampes, autres céramiques, corail) vers des sites de la région,
0
1m 49,90m
1 0
2 3 m
1
2
3
1
2
3
Fig. 7: Béziers, ZAC de la Domitienne. Four de potier pour la cuisson des pithoi. Ve s. av. J.-C. 1. Plan; 2. Restitution; 3. On pouvait disposer sur la sole jusqu’à
sept pithoi de taille moyenne (diamètre de la panse autour de 0,80 à 1 m)(dessins de C. Olive).
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 18193773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 181 1/06/12 11:211/06/12 11:21
182 DANIELA UGOLINI
Fig. 9: Mont-Joui. Applique (de vase?) en terre cuite de couleur grise. 525–475 av. J.-C. (d’après Nickels 1987, fig. 31).
0
10
20
30
40
50
AT-VN
IB-PEINTE
CL-Indét.
CL-pun ?
CL-Béziers
CL-grecque
GR-MONO (imp)
GR-MONO (Bz)
CCT-Béziers
CCT-importée
CNT
540-500 600/540
%NFr BÉZIERS, Rue Mairan, Sondage 2. La vaisselle du VI e s. av. J.-C., exprimée en pourcentage du nombre de fragments
Fig. 8: Béziers, rue Mairan, S. 2. La vaisselle du VIe s. av. J.-C.exprimée en pourcentage du nombre de fragments.
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 18293773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 182 1/06/12 11:211/06/12 11:21
D’AGDE À BÉZIERS: LES GRECS EN LANGUEDOC OCCIDENTAL 183
67 Voir Ugolini et al. 1991, 185–88; Séguier et Vidal 1992; Ugolini et Olive 1995b; Rondi-Costanzo et Ugolini 2000; Rondi-Costanzo 1997; Gomez de Soto et Milcent 2000; Olive et Ugolini 1998; 2003; Ugolini et Olive 2004; 2006a–b.
68 Étudié et présenté sous différentes formes, on se reportera à la bibliographie (Ugolini et al. 1991; Ugolini et Pezin 1993; Olive et Ugolini 1997; Gomez 2000a; 2000c; Bénézet 2001; Rat-simba 2002; 2005; Bénézet in Ugolini et Olive 2006a, 114–16; Gomez, dans Ugolini et Olive 2006a, 95–97; Ratsimba, dans Ugolini et Olive 2006a, 98–102; Ugolini 1993b; 2000; à paraître; Ugolini et Olive 1988; 1990; 1995b; 2003b; 2004; 2006a–b).
69 Grands vases habituellement classés dans la vaisselle, leur taille fait qu’il faudra se résoudre à les compter parmi les récipients de transport ou de stockage, tant il paraît invraisemblable qu’ils aient pu arriver vides.
70 Ugolini 1993b; à paraître.
mais aussi vers l’intérieur du continent, dans une dynamique économique ouverte également aux échanges avec le monde étrusque et le monde médi-terranéen, au centre de laquelle se trouvait probablement le commerce du métal.67
LE FACIÈS MOBILIER
Le mobilier domestique présente, tout au long de la vie du site, une étonnante régularité dans les proportions respectives des classes de vaisselle et une très grande homogénéité des pâtes.68 Les niveaux du VIe s. av. J.-C., importants pour la chronologie du site comme pour l’origine du faciès local, sont parti-culièrement significatifs et il vaut la peine de signaler les principales ten-dances.
Dans le graphique (Fig. 8), le mobilier de 10 couches antérieures à 500 av. J.-C. est partagé en fonction de l’apparition des amphores de Marseille (que l’on fait remonter aux années autour de 540 av. J.-C.) (Fig. 3.1). La céra-mique non tournée est beaucoup moins abondante qu’à Agde. Les vases culinaires tournés locaux sont tout de suite présents et le démarrage des productions à pâte claire et de grise monochrome est rapide. Quelques jarres pithoïdes ibériques, ou plutôt puniques, arrivent également.69 Le graphique de la Fig. 3.1 rend compte des tendances observées pour les amphores. Pour les Ve et IVe s. av. J.-C., la documentation est beaucoup plus abondante et permet de saisir l’évolution d’un faciès qui est fixé dès le début de l’occupation.
Enfin, deux autres éléments forts des modes de vie biterrois sont l’utilisa-tion des lampes de type grec (beaucoup plus abondantes qu’ailleurs et pré-sentes dès le VIe s. av. J.-C.;70 pour le VIe s. av. J.-C., voir les deux exem-plaires de la Fig. 10.10–11) et des métiers à tisser verticaux.
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 18393773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 183 1/06/12 11:211/06/12 11:21
184 DANIELA UGOLINI
0 1 5 cm
Béziers - CV
Ø 6,5
Ø 7,8
Ø 18,8
Ø 18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Fig. 10: Béziers, centre ville. Ensemble de mobilier daté vers 525 av. J.-C. (dessins de C. Olive; d’après Wiégant et al. 2001, fig. 12). 1. Amphore ‘ionio-massaliète’;2. Anse d’amphore massaliète; 3. Anse d’amphore étrusque; 4. Fragment de jarre
ibérique peinte; 5. Fond annulaire de vase ouvert peint en rouge en pâte claire biterroise; 6. Fond de coupe à pied haut imitant le type B2 en pâte claire biterroise peinte; 7. Anse de coupe en pâte claire indéterminée; 8–9. Coupes attiques à vernis noir de type C; 10. Lampe attique à vernis noir; 11. Lampe ‘ionienne’ en pâte claire
peinte en rouge.
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 18493773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 184 1/06/12 11:211/06/12 11:21
D’AGDE À BÉZIERS: LES GRECS EN LANGUEDOC OCCIDENTAL 185
71 On peut comparer, par exemple, le mobilier de Mèze (Rouquette et Ugolini 1997), ou d’autres établissements au bord de l’étang de Thau (Bermond 1998), d’une part avec ceux d’Agde ou de Béziers et, d’autre part, avec, par exemple, ceux de Lattes, du Cayla de Mailhac, de Pech Maho.
LES GRECS À BÉZIERS
La présence grecque à Béziers n’est pas suggérée par les auteurs anciens. Par contre, d’une part, elle transparaît de l’évidence archéologique et, d’autre part, elle ressort de la comparaison avec les autres sites languedociens. Question particulièrement lourde de conséquences, l’hypothèse de cette affiliation a pro-voqué la surprise et la controverse. Il n’en reste pas moins que Béziers est un site très particulier et, en l’actuelle absence d’arguments sérieux qui feraient envisager un autre cas de figure, il n’y a pas lieu de douter du fait que les Grecs sont à l’origine de sa création. D’ailleurs, la documentation suffit déjà pour assurer quelques points.
– La date de son implantation se place dans la même période que les fonda-tions de Marseille et d’Emporion.
– L’apparition immédiate d’une vaisselle tournée locale (qui ne transite pas par une première phase ‘indigène’ caractérisée par la présence quasi exclu-sive de céramique non tournée, ni par une phase intermédiaire d’apprentis-sage des techniques complexes que suppose la fabrication des vases au tour) se comprend mieux, me semble-t-il, en admettant que les ‘fondateurs’ n’étaient pas indigènes. Bien plus, on décèle à Béziers la genèse d’un faciès qui va s’étendre à toute la zone comprise entre la vallée de l’Aude et l’étang de Thau, Agde comprise,71 mais qui reste toujours plus marqué et plus net à Béziers que partout ailleurs. D’un autre côté, les importations attestées à Béziers proviennent toujours en majorité de l’Est: l’établissement a donc fonctionné dans le cadre d’un circuit ‘gréco-étrusque’, ce qui le libère de supposés liens avec le monde ibérique que les adeptes d’une tradition dépas-sée ne cessent de remettre à l’ordre du jour malgré les données récentes.
– Béziers I n’était pas une agglomération comme tant d’autres. Sa grande taille en fait le plus grand site de son temps entre le Rhône et les Pyrénées, un critère qui doit être évalué par rapport aux autres sites de la région pour en apprécier le sens. La densité du bâti et son organisation complexe, le nombre élevé d’habitants, la distribution du travail, l’économie locale (par ses pro-ductions et par le déploiement durable sur le territoire) et à grand rayon (au travers de son commerce à courte, moyenne et longue distance), la consom-mation régulière et ciblée de produits importés, les relations instaurées avec les sites de sa périphérie et, enfin, la position au carrefour des voies terrestres et maritimes, ont suscité une dynamique sans parallèle en Languedoc.
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 18593773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 185 1/06/12 11:211/06/12 11:21
186 DANIELA UGOLINI
72 Résumé dans Lugand et Bermond 2001, 214–16; Olive 2003.73 Jully 1971; 1976; 1983, 614 et suiv.74 Nickels 1989a.
Béziers était donc une ville, au sens classique du terme, et c’est dans l’ensemble des observations, qu’elles soient d’ordre matériel, économique, archéologique ou historique, que cela apparaît avec force. En définitive, ce qui importe est que, grecque ou non, elle a assuré la prépondérance économique grecque dans toute cette zone et a eu un rôle central au service des intérêts grecs.
LES SITES COMPLÉMENTAIRES
Outre Agde et Béziers, qui sont les sites où la présence grecque est la plus palpable, d’autres établissements ont fait fonctionner une économie qui a dû faire recours à des collaborations indigènes. Les sites pris en compte ci-des-sous présentent, chacun, des caractéristiques propres qui laissent transparaître des niveaux inégaux de contact et qui traduisent plus ou moins clairement la nature de leur rôle dans ce système.
A. LA MONÉDIÈRE
La Monédière (Bessan, Hérault) est à 10 km de la mer et à 6 km au nord d’Agde. Sur la rive droite de l’Hérault, elle occupe un plateau surélevé d’une dizaine de mètres au-dessus de la plaine inondable, à 300 m du fleuve. Connu de longue date et toujours mis en relation avec Agde, le site a fait l’objet de recherches intenses.72
Le toponyme originel est inconnu. Aucune monnaie n’y a été retrouvée, ni aucune inscription. On a toutefois mis l’accent sur les graffitis en lettres grecques que l’on observe sur des céramiques importées. Ils sont peu explicites, mais c’est ici que l’on en compte le plus grand nombre pour le Languedoc.73
Le site couvrait une superficie de 3 ou 4 ha. L’existence d’un rempart a été évoquée, mais les sondages sur le tracé présumé n’ont donné aucun résultat. Les vestiges de l’habitat n’ont pas d’ordre apparent. Le site n’avait donc pas un plan régulier.
On a distingué quatre phases de l’occupation:74
– La Monédière I (600–540 av. J.-C.): l’habitat (traces de cabanes en maté-riaux légers) est inconnu.
– La Monédière II (540–500 av. J.-C.): c’est la ‘période grecque’ d’A. Nic-kels. Les habitations couvrent un peu plus de 40 m2. Les murs ont des solins
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 18693773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 186 1/06/12 11:211/06/12 11:21
D’AGDE À BÉZIERS: LES GRECS EN LANGUEDOC OCCIDENTAL 187
75 Jully 1972–73.76 Nickels 1976.77 Nickels et Genty 1974.
en pierres non taillées et des élévations en adobes. Le plan, rectangulaire, est complété par un petit espace en forme d’abside sur l’un des côtés courts.
– La Monédière III (500–475 av. J.-C.): vestiges de deux habitations en maté-riaux légers de plan rectangulaire.
– La Monédière IV (475–400/375 av. J.-C.): peu de vestiges bâtis s’y rap-portent, mais le mobilier est abondant.
Le site est ensuite abandonné. Une réoccupation partielle (une ferme) a été observée pour le IIe s. av. J.-C.
Les activités vivrières et artisanales n’ont pas laissé de traces, ce qu’il faut certainement corréler à la difficulté de mettre en évidence un territoire que le site aurait pu contrôler. Il semble, donc, que le principal rôle de La Monédière était lié aux échanges. Plus précisément, La Monédière garantissait l’achemi-nement des marchandises. L’Hérault étant facilement navigable sur ce tronçon, ici arrivaient les bateaux chargés des produits destinés aux sites de la rive droite de l’Hérault et plus à l’Ouest, notamment vers Béziers, qui a sans doute été le principal consommateur. Parallèlement, c’est à La Monédière que se concentraient les contreparties en partance.
Les Grecs et La Monédière
La Monédière a toujours été rattachée à Agde et son caractère particulier, dans le cadre des contacts entre Grecs et indigènes, a été souligné par tous. Deux hypothèses principales ont été formulées.
1) J.-J. Jully pensait que La Monédière était un site indigène, créé vers 600 av. J.-C., en réponse aux premières fréquentations phocéennes de ces côtes.75 D’accord sur le principe, A. Nickels a proposé un schéma plus élaboré. Après une phase indigène (600–550 av. J.-C.), les Grecs auraient tenté de s’y implan-ter dans un mouvement de prise en main de l’arrière-pays. Les maisons à abside (considérées comme ‘grecques’ par ce chercheur)76 ont été mises en parallèle avec l’augmentation des amphores grecques, la baisse de la céra-mique non tournée, la présence importante de céramiques grises monochromes et claires, ainsi qu’avec la découverte d’une fosse contenant un mobilier (restes d’un banquet) essentiellement de type grec.77 Le remplacement des maisons à abside par d’autres à plan rectangulaire (premier quart du Ve s. av. J.-C.), qu’A. Nickels considérait comme ‘plus primitives’, et l’augmentation des amphores ibériques ont été vus comme les signes de l’échec subi par les Grecs,
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 18793773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 187 1/06/12 11:211/06/12 11:21
188 DANIELA UGOLINI
78 Il faut désormais limiter la notion de ‘grécité’ au mobilier, dans la mesure où cette phase marque les débuts de la domination du commerce grec dans cette zone.
79 Ugolini 2001c; Ugolini et Olive 2002; 2003b; 2004.80 Ugolini et Olive 2004; 2006b.
qui auraient été chassés par leurs partenaires locaux. Enfin, l’abandon du site vers 400 av. J.-C., que l’on a fait coïncider avec la ‘refondation massaliète’ d’Agde, a été interprété comme la preuve de la réussite, cette fois-ci, de la mainmise grecque sur l’arrière-pays, qui aurait rendu inutile cette escale flu-viale.
2) La position géographique du site, qui matérialise un lieu de transfert des marchandises (pour le regroupement des biens en partance, le débarquement de biens arrivés par la voie fluviale, ou, encore, lors du franchissement du fleuve sur l’axe terrestre qui longe toute la côte d’Est en Ouest, la mythique ‘Voie Héracléenne’) indique, de manière évidente, que celles-ci étaient desti-nées aux sites à l’ouest de l’Hérault, et surtout à Béziers. Depuis la mise au jour des niveaux les plus anciens de Béziers, la création plus ou moins contem-poraine de La Monédière a acquis tout son sens. On remarque encore que le synchronisme entre la fondation d’Agde, la ‘phase grecque’ de La Monédière78 et le développement de Béziers, sont des phénomènes concomitants qu’il faut une fois de plus relier entre eux, dans le cadre d’une complémentarité qui est forcément fonctionnelle. En effet, du point de vue du mobilier domestique, Béziers, Agde et La Monédière présentent des caractéristiques voisines, bien qu’à La Monédière la composante indigène soit plus marquée.79
Contrairement à ce que pensait A. Nickels, le site ne ‘s’indigénise’ pas après 500 av. J.-C., car la tendance générale est plus ‘hellénisée’ au cours du Ve s. qu’auparavant et l’on sait aujourd’hui que les maisons à plan rectangulaire ne sont pas ‘plus indigènes’ que celles à abside, bien au contraire.
Enfin, si l’abondance des amphores n’a échappé à personne, l’appréciation des volumes par origines varie selon l’optique retenue. L’estimation basée sur le nombre d’individus (Fig. 3.5), plus proche de la réalité, montre bien la ‘diminution’ des amphores grecques au début du Ve s. av. J.-C., mais montre aussi que les amphores massaliètes atteignent le taux le plus haut au cours de ce même siècle. C’est donc la poussée des amphores ibériques qui produit, par un effet d’optique, la baisse des amphores grecques, mais, en réalité, ces der-nières (essentiellement massaliètes) ont continué à arriver et toujours dans des proportions élevées. Cette remarque, associée au fait que le commerce ibérique a connu une phase intense, mais de courte durée, au cours du premier quart du Ve s. av. J.-C., élimine le principal argument à l’hypothèse du recul des inté-rêts grecs sur le site.80
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 18893773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 188 1/06/12 11:211/06/12 11:21
D’AGDE À BÉZIERS: LES GRECS EN LANGUEDOC OCCIDENTAL 189
81 Ugolini 2001c; Ugolini et Olive à paraître.82 Dedet 1990; Moret 2002.83 Moret 2002.84 Lugand et Bermond 2001, 101.85 Nickels 1987.
Pour terminer, l’abandon de La Monédière (vers 400–375 av. J.-C.) ne reflète pas nécessairement un plus grand pouvoir d’Agde sur son immédiat arrière-pays, puisque le relais est pris par Le Fort (Saint-Thibéry), un peu plus au Nord (voir ci-dessous). On aurait juste le déplacement du port fluvial d’un site à un autre, un événement sans doute motivé par de nouveaux besoins81.
En résumé, la taille, le plan et les vestiges immobiliers de La Monédière sont le reflet de la communauté indigène et trouvent de nombreuses comparai-sons sur d’autres sites. Les maisons à abside, dont le plan appartient au fonds indigène et se rencontre sur d’autres sites,82 présentent tout de même une ori-ginale construction sur solin de pierres et élévation en adobes – et non en matériaux légers comme les cabanes indigènes. En regard de leur datation tar-dive (540–500 av. J.-C.), ces habitations sont sans parallèle dans le Midi. Elles constituent, ainsi, une sorte de synthèse entre un plan traditionnel et de nou-velles techniques de construction et c’est donc avec raison que P. Moret retient l’idée d’un certain ‘conservatisme’.83
Dernier point, la chronologie de La Monédière, qui existe avant Agde, exclut ce lien direct et exclusif avec le pont grec qui a guidé jusqu’ici toute réflexion à son sujet. Il reste que le partenariat entre indigènes et Grecs est ici évident et confirme le rôle joué par ce site durant deux siècles.
B. MONT-JOUI
Mont-Joui (Florensac, Hérault) se trouve 5 km au Nord d’Agde, sur la même rive de l’Hérault, sur une hauteur dominant la plaine. À quelques centaines de mètres du fleuve, le site constitue le pendant exact de La Monédière, qui est pratiquement en face, à seulement 4 km.
Après une phase chalcolithique et une autre de l’Âge du bronze, le site a été réoccupé vers 550 av. J.-C., et donc peu après La Monédière et peu avant Agde. Autour de 480 av. J.-C., le site subit une destruction par le feu qui marque l’arrêt de l’occupation. De faibles traces du IVe s. av. J.-C. font sup-poser une fréquentation épisodique des lieux.
Établissement connu de longue date,84 les premières recherches ont mis au jour les vestiges partiels d’une cabane et une petite portion d’un fossé ceintu-rant le site.85 Le tracé du fossé, une enceinte double, a été précisé récemment: il dessine une forme sub-circulaire, avec des accès, délimitant un peu plus de
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 18993773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 189 1/06/12 11:211/06/12 11:21
190 DANIELA UGOLINI
86 Gomez 2000b; 2003b.87 Ugolini 2001c.88 Lugand et Bermond 2001, 363–64.89 Pline l’Ancien (NH 3. 36) le mentionne parmi les oppida latina et Ptolémée (Géogr. 10. 2)
donne la position de cet établissement ‘des Tectosages’. Cessero est encore mentionné par les itinéraires routiers (gobelets de Vicarello, Itinéraire d’Antonin, Itinéraire de Bordeaux à Jérusa-lem et Table de Peutinger).
90 Voir en dernier Ropiot 2003c–d.
2 ha, pour le fossé intérieur, et 4.5 ha pour le fossé extérieur.86 L’habitat, très dégradé par les travaux agricoles, n’est pratiquement pas conservé.
Les Grecs et Mont-Joui
Le toponyme originel est inconnu. Ses liens avec Agde n’ont pas donné lieu à des études circonstanciées, essentiellement parce que les informations ont été très limitées jusqu’à date très récente.
L’aménagement général rapproche Mont-Joui d’un établissement indigène, malgré une double enceinte circulaire fossoyée qui n’a pas de parallèle dans le Midi côtier contemporain.
Sa position géographique, sa date de création et son mobilier témoignent du rapport évident entre ce site et la mise en place, au VIe s. av. J.-C., du système de circulation des biens dans cette zone, au cœur duquel se trouve le franchis-sement du fleuve Hérault.87
Signalons encore que d’ici provient une terre cuite figurée, une applique de vase gris monochrome, que l’on peut rapprocher de modèles grecs de la fin de l’archaïsme (Fig. 9).
C. LE FORT
Le Fort (Saint-Thibéry, Hérault), site mal connu et en partie détruit par la construction d’une voie ferrée et par d’autres aménagements modernes, occupe un promontoire dominant d’une quinzaine de mètres le confluent de la Thon-gue et de l’Hérault, 3 km au nord de La Monédière.
Les résultats des recherches archéologiques restent peu explicites,88 mais Le Fort est identifié avec Cessero, toponyme conservé par les itinéraires routiers d’époque romaine89 qui le mentionnent dans le cadre du franchissement de l’Hérault, sur le tracé de la Via Domitia, et comme point de départ de la voie menant à Segodunum (Rodez). Le toponyme, qui est celui de l’époque de la conquête romaine, a donné lieu à de nombreuses conjectures,90 mais il a pu être différent avant le IIe s. av. J.-C.
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 19093773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 190 1/06/12 11:211/06/12 11:21
D’AGDE À BÉZIERS: LES GRECS EN LANGUEDOC OCCIDENTAL 191
91 Jully 1983, 784–92; Ropiot 2003c–d.92 Lugand et Bermond 2001, 364.93 Ugolini 2001c, 74; Ugolini et Olive à paraître.94 Ropiot 2003d, 264.
Après une occupation de l’Âge du bronze final, qui est la plus profonde et donc la mieux conservée, le site est réoccupé vers le début du IVe s. av. J.-C.91 Les témoins archéologiques manquent entre la fin du IVe s. ou le début du IIIe s. et la deuxième moitié du IIe s. av. J.-C., lorsque commence une période qui pourrait s’arrêter vers le tournant de l’ère. Par la suite, il se peut que l’établissement soit déplacé vers le bas de la colline, sous le village actuel.92
On ne dispose d’aucune information sur les formes de l’habitat antérieur à la Conquête. Sa surface actuelle couvre environ un hectare.
Les Grecs et Le Fort
Le Fort n’a pas été mis en relation directe avec les Grecs. L’incertitude chro-nologique de ses phases d’occupation et la méconnaissance des tendances générales de son mobilier l’ont fait laisser de côté et, encore aujourd’hui, la tentative de l’insérer dans les dynamiques économiques des trafics grecs de cette zone est une hypothèse de travail. Il reste que sa position géographique, dans un point de franchissement de l’Hérault repris par la Via Domitia, indique l’existence, dès une haute époque, d’un passage obligé, peut-être sur une nou-velle voie (ou sur un nouveau tronçon de voie).
Le Fort émerge au moment où La Monédière est délaissée, mais, aussi, concomitamment à l’augmentation des trafics commerciaux d’Agde et à une faible fréquentation du Mont-Joui, des coïncidences qui ne peuvent être for-tuites. D’un autre côté, c’est lorsque Béziers périclite jusqu’à l’abandon et qu’Agde se replie dans une survie qui va durer environ un siècle que l’occupa-tion du Fort se raréfie ou, même, disparaît à son tour. Cela fait supposer une logique événementielle en réponse à une situation nouvelle.93
Le mobilier, étudié récemment, offre quelques ancrages. Premièrement, parmi la vaisselle, la part la plus importante revient à la céramique non tour-née, ce qui désigne à coup sûr les occupants comme des indigènes. En second lieu, les relations avec le monde grec côtier sont attestées par les classes céra-miques représentées. Troisièmement, le nombre des amphores parvenues au IVe s. av. J.-C. est faible et fait douter que le rôle du Fort ait pu être d’ordre purement commercial.94
Dernier point, Le Fort se trouve dans un environnement basaltique qui a été exploité au IVe s. av. J.-C. pour la fabrication de meules rotatives à grain, qui
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 19193773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 191 1/06/12 11:211/06/12 11:21
192 DANIELA UGOLINI
95 Reille 1995; 1999.96 Voir en dernier Ropiot 2003a.97 La présence de vases non tournés dans les phases initiales d’un établissement grec doit se
comprendre comme une solution provisoire, avant que ne se mettent en place soit des ateliers locaux, soit des réseaux d’approvisionnement.
98 Pour le Languedoc occidental, voir l’essai proposé dans Ugolini 2000. Quant au Langue-doc oriental, la céramique non tournée est présente massivement même sur les sites que l’on lie – à tort ou à raison – au monde grec, comme L’Argentière d’Espeyran (Saint-Gilles-du-Gard, identifié à la Rhodanousia des sources: Barruol et Py 1978); Le Caïlar (Gard, qui serait un ‘nou-veau comptoir’: Py et Roure 2002); Lattes (Hérault, ‘ville portuaire’ où l’on suppose des pré-sences d’abord étrusques puis massaliètes: Arnal et al. 1974; Py 1995).
99 Bats 1988.
ont été exportées,95 et l’intérêt que représentait cette industrie est évident puisque Agde l’a reprise au début du IIe s. av. J.-C.
On comprend mieux alors le double intérêt de la position géographique de ce site, qui se trouve à la fois sur un gisement d’une matière première et au carrefour idéal des voies d’acheminement d’un matériau lourd et difficile à transporter. Les meules pouvaient atteindre le port d’Agde par voie d’eau,96 où elles étaient chargées sur des bateaux sillonnant la côte. En alternative, elles pouvaient aussi être transportées par voie de terre, le long du grand axe de communication Est-Ouest, qui dessert quasiment tous les sites côtiers.
CONCLUSIONS
La question des Grecs en Languedoc occidental a considérablement évolué depuis trente ans. De nouvelles découvertes ont donné matière à l’élaboration de nou-veaux schémas. De nouvelles études ont montré que la présence grecque peut se saisir même lorsque les textes antiques sont muets et en l’absence de ces macro-phénomènes caractéristiques (architecture monumentale, sculpture, sanctuaires, inscriptions, etc.) dont la grécité de l’extrême Occident est particulièrement avare.
Notamment, le travail effectué sur les traceurs de l’hellénisme dans la civi-lisation matérielle a mis en évidence des comportements spécifiques permet-tant d’isoler un site donné de son environnement indigène. Il vaut la peine d’énumérer les principaux critères retenus par les dernières recherches.
– La rareté de céramique non tournée est un signe très fort, sûrement jusqu’à la fin du IVe s. av. J.-C.97 et sans doute aussi plus tard. Les indigènes ont toujours continué à utiliser des vases non tournés, au moins pour une large partie de leur vaisselle à cuire.98 Parallèlement, la vaisselle culinaire tournée est donc aussi un bon indicateur.99 Mais, mises à part quelques chytrai importées au VIe s. av. J.-C., absentes
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 19293773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 192 1/06/12 11:211/06/12 11:21
D’AGDE À BÉZIERS: LES GRECS EN LANGUEDOC OCCIDENTAL 193
100 Ugolini et al. 1991, 169; Ugolini 2002; Ugolini et Olive 2006a, 62–64. On notera que Marseille a importé beaucoup d’ollae étrusques pour sa propre consommation et semble ne pas avoir produit de vases à cuire. L’imitation de cette forme étrusque en milieu grec n’a donc, en soi, rien de surprenant.
101 Ugolini et al. 1991; Ugolini 2002.102 Gomez 2000a; 2000c; 2003a; Gomez dans Ugolini et Olive 2006a, 95–97.103 Ugolini 2000.104 Dans l’Aude et en Roussillon, on trouve principalement le plat à marli, qui est assurément
la forme la plus courante; la coupe à bord convergent; quelques imitations des coupes B2; le gobelet dit de l’Âge du fer; de rares cruches; la jarre/grande urne et autres grands vases tulipi-formes. À part le plat à marli, les autres formes sont absentes de Béziers et d’Agde, où l’on trouve en revanche des coupes mono-ansées à bord droit, des gobelets carénés ou, plus rarement, à profil en S et des cratères.
d’Agde, rares à Béziers et peut-être plus ‘courantes’ à Marseille (sans que l’on puisse dire, dans le détail, quelle y fut leur fortune), lopades et caccabai n’arri-vent en Languedoc que tardivement. Et, contrairement à ce que l’on a pu croire auparavant, cela n’apparaît pas comme quelque chose de ‘typiquement grec’, dans la mesure où ces formes sont alors relativement courantes quasiment par-tout. Par contre, le pot fabriqué à Béziers, qui copie l’olla étrusque,100 a envahi les cuisines biterroises et agathoises, a eu un certain succès auprès des indigènes et a atteint des contrées éloignées (attesté au moins jusqu’à Carcassonne et jusqu’à Marseille101). C’est donc la présence massive et l’utilisation précoce de ce vase à cuire qui acquiert une forte valeur ‘culturelle’ en Languedoc occidental. Une proportion importante de mortiers en céramique tournée est de règle en milieu grec.102 Cet ustensile, manifestement indissociable de certaines recettes ou préparations, a été produit, en Gaule, seulement par Marseille et par Béziers. Marseille en a diffusé le long des côtes un très grand nombre, mais les mortiers biterrois ont aussi eu une large distribution, bien qu’en quantité plus modeste.
– L’analyse de la composition de la vaisselle de table livre de multiples indices. Toujours faite au tour en milieu grec, les catégories d’usage font apparaître des besoins spécifiques. Par exemple, la part des vases destinés à servir la boisson est plus importante là où l’on suppose des présences grecques103 et c’est aussi en ces lieux que l’on observe une plus grande diversité typologique des cruches. Il s’agit de vases le plus souvent à pâte claire et certaines formes (le cratère ou l’amphore de table) sont courantes en milieu grec et rares ailleurs. Il en va de même pour les grises monochromes, qui ont eu un grand succès chez les indigènes mais dont le répertoire morphologique n’est pas iden-tique dans les deux mondes.104 Dans un autre ordre d’idées, la jarre de réserve (petite ou moyenne et quelle que soit sa forme) est plus courante dans les agglomérations indigènes, ce
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 19393773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 193 1/06/12 11:211/06/12 11:21
194 DANIELA UGOLINI
105 Ugolini et Olive 1995; Ugolini 1993a.106 Et tenter donc de répondre aux questions: Quel objet ou quel vase? Quelle provenance?
Dans quel cadre? Pour quelle utilisation? Quelle place parmi d’autres produits, éventuellement analogues et fabriqués localement ou également importés?
107 Ugolini et al. 1991, 192–96; Ugolini 2000.108 Gomez 2000a.109 Marseille: Hermary et al. 1999, 49–51. Emporion: Aquilué et al. 2002. Béziers: Olive et
Ugolini 2001, 43–52; Wiégant et al. 2001, passim. Agde: Lugand et Bermond 2001 123–25, 130–31. À Pech Maho, un groupe de maisons à murs mitoyens, adossées au rempart et construites en dur, daterait de la fin du VIe s.: il s’agirait du plus ancien exemple indigène du Languedoc occidental d’appropriation d’un schéma ‘méditarranéen’ (Moret 2002, 336–38 fig. 111a).
110 de Chazelles 1999.111 de Chazelles 1995; Moret 2002.
qui traduit sans doute des fonctionnements différents dans la gestion des denrées alimentaires.105
– Les tendances commerciales aident à saisir l’adhésion à une sphère écono-mique, mais ne suffisent pas à caractériser un site grec. Il est plus utile d’analyser ‘l’ensemble de ce qui arrive’ par rapport à une ambiance géné-rale.106 Ce n’est donc pas (ou pas seulement) par le nombre de vases attiques achetés (ou par leur qualité) que l’on appréciera le degré d’hellénisation d’un site donné, mais par l’étude des formes présentes et par leur insertion dans un service de table aux besoins affirmés, stables à travers les siècles.107 L’étude des mortiers de cuisine est, à ce titre, exemplaire. Béziers, site pour-tant producteur, a acheté des mortiers massaliètes, étrusques et grecs, mais il s’agit de pièces de tailles non proposées par les ateliers locaux,108 ce qui indique des achats ciblés, destinés à satisfaire une demande précise.
– L’organisation du site, la précocité d’un plan régulateur et la conception de la maison font évidemment partie des phénomènes les plus visibles. Mar-seille, Emporion, Béziers, Agde, sont les sites109 où l’on observe la mise en place d’un schéma urbain régulier dès le VIe s. av. J.-C., avec des construc-tions en dur, et la Maison I de Béziers, qui date du plein Ve s., reste sans comparaison dans le Midi.
– Certaines techniques ne sont peut-être pas spécifiquement grecques, mais il reste que, dans le Midi, elles ne sont mises en œuvre que sur de très rares sites. C’est le cas des métiers à tisser verticaux nécessitant des pesons pyramidaux ou ronds: ce système de tissage n’est pas en usage chez les indigènes jusqu’au IIIe s. av. J.-C.110 C’est aussi le cas de l’emploi de la chaux dans le bâtiment, des toitures en tuiles, de la diversité des solutions pour la finition des sols, de la maîtrise technique dans le domaine de la production de la céramique tournée etc., alors que l’emploi de la brique crue soulève plus d’incertitudes.111
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 19493773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 194 1/06/12 11:211/06/12 11:21
D’AGDE À BÉZIERS: LES GRECS EN LANGUEDOC OCCIDENTAL 195
112 Ugolini et Olive à paraître.113 Columeau 2000.
On attribue aux Grecs l’introduction des pithoi en Gaule et force est de constater que Béziers en a produit et utilisé en grand nombre, au moins dès la deuxième moitié du VIe s. av. J.-C. Ces grands récipients ont été vendus aux indigènes de la région déjà autour de 500 av. J.-C., mais la façon de stocker à long terme qu’ils supposent, et donc le produit à stocker, ont tardé à s’imposer chez les indigènes du Languedoc qui ne feront couramment usage de ces grands récipients qu’à partir du IVe s. av. J.-C.
– L’emploi régulier des lampes de type grec est également un indice fort.
– La mise en place d’un ‘territoire’ s’observe pour tous les sites de la bande côtière entre la fin du VIe s. av. J.-C. et le début du siècle suivant. Toute-fois, son maintien et son exploitation durable ne concernent, à l’heure actuelle et dans notre région d’étude, que Béziers.112 C’est le signe évident qu’ici, dès l’origine, on est en présence d’une organisation structurée, qui a été satisfaisante et qui a traversé le temps. Dans cette perspective, les résul-tats de l’étude comparée de la faune consommée sur divers établissements du Midi, qui a identifié des tendances citadines concernant Marseille, Béziers et Emporion, distinctes des pratiques observées sur les sites indi-gènes,113 acquièrent tout leur poids.
Les recherches sur la civilisation matérielle et sur les chronologies ont ainsi amené à définir un faciès concernant des sites côtiers où la présence grecque est admise (Agde) ou très fortement présumée (Béziers). Il n’est pas évident que ce faciès soit strictement identique à celui de Marseille, mais il est suffi-samment affirmé pour donner corps à un phénomène qu’il faut d’une façon ou d’une autre rattacher au monde grec.
Le prolongement de ces travaux a permis de mettre en avant un ensemble de critères concrétisant cette grécité, voire le rôle que les Grecs ont pu jouer dans des sites indigènes ou, éventuellement, à population mixte.
Dernier volet de l’enquête, l’analyse de l’occupation des sols doit pouvoir contribuer à signaler des dynamiques régionales spécifiques. Au cours des deux dernières décennies, ici comme ailleurs, de nombreuses études ont concerné la définition de l’espace contrôlé par un site donné, le plus souvent perçu comme une zone d’exploitation agro-pastorale. Malgré des approches de plus en plus diversifiées et des méthodes d’analyse de plus en plus pointues, il demeure difficile de proposer une lecture de l’occupation des sols qui ne met-trait pas simplement un établissement principal face à un autre. Cela aboutit à une vision cloisonnée qu’il est souvent impossible de dépasser. Il reste que
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 19593773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 195 1/06/12 11:211/06/12 11:21
196 DANIELA UGOLINI
114 Ugolini 2001c; Ugolini et Olive 2002; 2003b; 2006b; à paraître.115 Voir en dernier Ropiot 2005.116 Garcia 1995c. C’est seulement en maintenant cette condition que la vallée de l’Hérault
aurait un intérêt économique direct et que la notion de Languedoc ‘central’ aurait un sens. Cette subdivision territoriale est d’apparition récente et a été créée dans le but de séparer la vallée de l’Hérault de son contexte géographique et culturel pour la relier au Languedoc oriental.
l’idée ancienne d’un petit noyau de Grecs, établis à Agde, qui aurait fait face – ne serait-ce que du point de vue économique – à l’immensité d’un monde indigène captif ne correspond sûrement pas à la réalité. La tendance à la com-partimentation qui régit souvent la réflexion sur le réseau des sites du Midi conduit, en définitive, à opposer les sites entre eux ou à les juxtaposer. Par contre, si on conçoit l’occupation des sols dans la perspective des collabora-tions fonctionnelles nécessaires au soutien d’un système économique, il est alors possible de saisir la naissance et le développement d’une synergie qui, en Languedoc occidental, a tout verrouillé jusqu’à la fin du IVe s. av. J.-C., chaque site ayant des caractéristiques propres et chacun ayant un rôle complé-mentaire par rapport aux autres.
C’est par le biais de ces articulations complexes qu’il faut désormais lire les données de l’archéologie pour mieux appréhender les buts poursuivis par les Grecs dans cette partie de la côte gauloise, lieu de rencontre des voies de terre, des voies d’eau et des routes maritimes, où leur déploiement a été bien plus important qu’on ne l’a cru.114
Béziers est au cœur de la question: en soi, parce qu’il s’agit d’un très grand site, de surcroît ‘original’, et, en général, parce que le fait même qu’il existe sous cette forme, ce que l’on a ignoré jusqu’à date relativement récente, déter-mine un changement de la perspective historique. Jusqu’à l’acquisition d’une documentation adéquate, Béziers ne pouvait échapper aux schémas en vogue au cours de la deuxième moitié du XXe s., qui rattachaient tous les sites à l’Ouest de l’Hérault au complexe ‘ibéro-languedocien’, sorte de transition indigène entre le domaine de Marseille et l’Ibérie. La réalité qui se dégage maintenant a longtemps été masquée par la vielle idée – qui semble bien ne pas avoir de fondement115 – d’une frontière sur le fleuve Hérault, qui aurait été à la fois ethnique (entre Ibères à l’Ouest et Ligures à l’Est) et politico-écono-mique (entre intérêts de Marseille et intérêts des Ibères). Agde, considérée comme la limite physique du domaine économique de Marseille, en aurait été la gardienne en même temps que le débouché commercial.116
Les acquis récents, désormais basés sur des observations et considérations convergentes, modifient la façon de voir, même si l’importante emprise grecque en Languedoc occidental n’est pas, en soi, une nouveauté. En effet, l’archéologie des années 1950 en avait pressenti l’ampleur. Par exemple, J.
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 19693773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 196 1/06/12 11:211/06/12 11:21
D’AGDE À BÉZIERS: LES GRECS EN LANGUEDOC OCCIDENTAL 197
117 Jannoray 1955, 312 et 418 n. 18.118 Ugolini 1993a.119 Ugolini 2005.120 Ugolini et Olive 2004; 2006b.
Jannoray117 signalait déjà qu’à Ensérune (site à une douzaine de kilomètres à l’Ouest de Béziers) les amphores massaliètes étaient nombreuses et que, par contre, les ibériques étaient rares… Lorsque la ‘vague ibérique’ s’est imposée dans les années 1960–80, ces premières avancées scientifiques ont été oubliées.118
On peut saisir maintenant que les Grecs ont développé et géré, ou contribué à gérer, des dynamiques diversifiées, notamment en garantissant les échanges avec l’intérieur du continent, par le contrôle des axes de communication ter-restre (Béziers), et ceux avec le monde méditerranéen, par la voie maritime appuyée sur le meilleur port de cette côte (Agde). L’aire commerciale ibérique atteignant ses limites septentrionales dans la vallée de l’Aude, le domaine éco-nomique de l’enclave grecque du Languedoc occidental s’étend principale-ment de la rive gauche de l’Aude au Bassin de Thau.119 Ici arrivent les mar-chandises véhiculées par au moins deux réseaux commerciaux (l’un étrusco-massaliète et l’autre ibéro-punique), qui en quelque sorte se croisent, et c’est ce qui explique la diversité comme l’abondance des approvisionne-ments dont a bénéficié cette zone.120
De fait, à travers un ensemble de sites reliés entre eux par des intérêts éco-nomiques communs, se dessinent les contours d’un pôle grec. Peut-être non strictement massaliète dans son essence, cet espace a été néanmoins en étroite liaison avec la métropole phocéenne et a contribué à renforcer l’impact du monde grec le long des côtes du Midi.
BIBLIOGRAPHIE
Archéologie en pays d’Agde 2003: Archéologie en pays d’Agde. Bilan des découvertes récentes (Catalogue de l’exposition) (Agde).
Aris, R. 1963: ‘L’industrie du basalte dans l’Antiquité à Agde, les fabriques de meules, les carrières et la ville légendaire d’Embonne’. Dans Actes du XXXVIe congrès de la Fédération Historique du Languedoc Méditerranéen et du Roussillon (Lodève, 1963) (Montpellier), 129–35.
—. 1974: ‘Le site préromain d’Embonne: une antique fabrique de meules sous la nou-velle ville du Cap d’Agde’. Dans Études sur Pézenas et sa région 5.1, 3–18.
Aris, R. et Picheire, J. 1960: ‘Essai sur le développement topographique d’Agde’. Annales du Midi 72.2, 129–35.
Aris, R. et Richard, J.-C. 1979: ‘Les découvertes monétaires d’Agde (Hérault)’. Études sur Pézenas et l’Hérault 10.3, 20–30.
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 19793773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 197 1/06/12 11:211/06/12 11:21
198 DANIELA UGOLINI
Arnal, J., Majurel, R. et Prades, H. 1974: Le Port de Lattara (Lattes, Hérault) (Bor-dighera/Montpellier).
Barruol, G. et Py, M. 1978: ‘Recherches récentes sur la ville antique d’Espeyran à Saint-Gilles du Gard’. RAN 11, 19–100.
Bats, M. 1988: Vaisselle et alimentation à Olbia de Provence (v. 350–50 av. J.-C.). Modèles culturels et catégories céramiques (Paris).
Bénézet, J. 2001: La céramique à vernis noir non attique de Béziers (Mémoire, Uni-versité d’Aix-Marseille I).
—. 2002: La colonie massaliète d’Agde à travers la céramique à vernis noir (IVe–Ier s. av. n.è.) (Mémoire, Université d’Aix-Marseille I).
Bermond, I. 1998: ‘L’occupation protohistorique au Nord-Est du Bassin de Thau (région de Mèze, Hérault)’. Dans Mauné, S. (éd.), Recherches récentes sur les établissements ruraux protohistoriques en Gaule Méridionale (Actes de la table ronde de Lattes, mai 1997) (Montagnac), 29–43.
Buxò, R. et Pons i Brun, E. (éd.) 2000: Els productes alimentaris d’origen vegetal a l’edat del Ferro de l’Europa Occidental: de la producciò al consum (Actes del XXII Colloqui Internacional per a l’Estudi de l’Edat del Ferro, Girona, maig 1998) (Gérone).
Clavel, M. 1970: Béziers et son territoire dans l’Antiquité (Paris).Columeau, P. 2000: ‘Nouveau regard sur la production et la consommation de la
viande dans le Languedoc occidental’. Dans Mata Parreño, C. et Pérez Jordà, G. (éd.), Ibers, agricultors, artesans i comerciants (III Reuniò sobre Economia en el Mòn Ibèric) (Valence), 167–73.
de Chazelles, C.-A. (éd.) 1993: Contribution au problème ibérique dans l’Empordà et en Languedoc-Roussillon (Actes de la table ronde de Lattes, Lattes 1992). DAM 16, 9–110.
—. 1995: ‘Les origines de la construction en adobes en Extême-Occident’. Dans EtMass 4, 49–58.
—. 1999: ‘Éléments archéologiques liés au traitement des fibres textiles en Languedoc occidental et Roussillon au cours de la Protohistoire (Ve–Ier s. av. n.è.)’. Dans Cardon, D. et Feugère, M. (éd.), Archéologie des textiles des origines au Ve s. (Actes du colloque de Lattes, octobre 1999) (Montagnac 2000), 115–30.
Dedet, B. 1990: ‘Une maison à absides sur l’oppidum de Gailhan (Gard) au milieu du Ve s. av. J.-C. La question du plan absidial en Gaule du Sud’. Gallia 47, 29–55.
Demoule, J.-P. (éd.) 2004: La France archéologique. Vingt ans d’aménagements et découvertes (Paris).
Gaches, R. 1947: ‘Les origines d’Agde’ (I à XII). L’Agathois, 23 août 1947, 1; 30 août 1947, 1; 6 septembre 1947, 1; 12 septembre 1947, 1; 20 septembre 1947, 1; 27 septembre 1947, 1; 4 octobre 1947, 1; 11 octobre 1947, 1; 18 octobre 1947, 1; 28 octobre 1947, 1; 1er novembre 1947, 1; 8 novembre 1947, 1.
Garcia, D. 1993: Entre Ibères et Ligures. Lodévois et moyenne vallée de l’Hérault protohistoriques (Paris).
—. 1995a: ‘Agglomérations et territoires aux Ve–IVe s. av. n.è. dans l’interfluve Aude-Hérault: propositions d’analyse’. Dans Clavel-Lévêque, M. et Plana Mal-lart, R. (éd.), Cité et Territoire (Actes du Ier colloque européen de Béziers, 1994) (Paris), 175–86.
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 19893773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 198 1/06/12 11:211/06/12 11:21
D’AGDE À BÉZIERS: LES GRECS EN LANGUEDOC OCCIDENTAL 199
—. 1995b: ‘Le territoire d’Agde grecque et l’occupation du sol en Languedoc central durant l’Âge du fer’. Dans EtMass 4, 137–67.
—. 1995c: ‘L’Hérault, un fleuve-frontière durant la Protohistoire’. Dans Rousselle, A. (éd.), Frontières terrestres, frontières célestes (Paris), 67–80.
Gomez, É. 2000a: ‘Contribution à l’étude des mortiers de cuisine: les mortiers du Languedoc occidental du VIe au IVe s. av. J.-C.’. DAM 23, 113–43.
—. 2000b: ‘L’enceinte fossoyée du site protohistorique du Mont-Joui à Florensac’. Archéologie en Languedoc 24, 151–70.
—. 2000c: ‘Les mortiers de cuisine en Languedoc (VIe–IVe s. av. J.-C.)’. Dans Buxò et Pons i Brun 2000, 367–70
—. 2002: Aspects de la colonisation grecque d’Agde et de l’exploitation de son terri-toire: le site de Saint-Michel-du-Bagnas (Mémoire, Université d’Aix-Marseille I).
—. 2003a: Les mortiers de cuisine étrusques en Languedoc. Dans Landes 2003, 58–59. —. 2003b: ‘Mont-Joui (Florensac): l’enceinte fossoyée de l’âge du Fer’. Dans Archéo-
logie en pays d’Agde 2003, 19–20.—. 2003c: ‘Saint-Michel-du-Bagnas (Agde): les fours à amphores’. Dans Archéologie
en pays d’Agde 2003, 35–37.Gomez de Soto, J. et Milcent, P.-Y. 2000: ‘De la Méditerranée à l’Atlantique: échanges
et affinités culturelles entre le nord-ouest (Armorique, Centre-Ouest, Limousin) et le sud-ouest de la France (principalement Languedoc occidental) de la fin du Xe au Ve s. av. J.-C’. Dans Janin, T. (éd.), Mailhac et le premier Age du fer en Europe occidentale: hommages à Odette et Jean Taffanel (Actes du colloque de Carcassonne, 17–20 septembre 1997) (Lattes), 351–71.
Hermary, A., Hesnard, A. et Tréziny, H. (éd.) 1999: Marseille grecque. La cité pho-céenne (600–49 av. J.-C) (Paris).
Jandot, C. 2000: ‘Béziers. ZAC de la Domitienne’. Bilan Scientifique Région Langue-doc-Roussillon (Montpellier), 117–18.
Jannoray, J. 1955: Ensérune. Contribution à l’étude des civilisations préromaines de la Gaule méridionale (Paris).
Jully, J.-J. 1971: ‘Exemples et signification de graffites sur des céramiques attiques en provenance de la Monédière, Bessan, Hérault’. Dans Béziers et le Biterrois (Actes du XLIIIe Congrés de la Fédération Historique du Languedoc Méditerranéen et du Roussillon, Béziers 1970) (Montpellier), 27–34.
—. 1972–73: ‘A propos du site de La Monédière (Bessan), remarques sur la préhis-toire et la protohistoire de la basse vallée de l’Hérault’. Études sur Pézenas 3, 3–21.
—. 1976: ‘Graffites sur vases attiques en Languedoc méditerranéen, Roussillon et Catalogne’. DHA 2, 53–70.
—. 1983: Céramiques grecques ou de type grec et autres céramiques en Languedoc méditerranéen, Roussillon et Catalogne aux VIIe–IVe s. av. n.è. et leur contexte socio-culturel (Paris).
Landes, C. (éd.) 2003: Les Etrusques en France. Archéologie et collections (Cata-logue de l’exposition) (Lattes).
Lugand, M. et Bermond, I. (éd.) 2001: Agde et le Bassin de Thau (Paris).Mazière, F. 1998: L’occupation des sols dans la moyenne vallée de l’Orb du Bronze
Final III au second Âge du fer (IXe–IVe s. av. J.-C.) (Mémoire, Université d’Aix-Marseille I).
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 19993773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 199 1/06/12 11:211/06/12 11:21
200 DANIELA UGOLINI
—. 2003: ‘Le Bousquet (Agde). Une nécropole du premier Âge du fer’. Dans Archéo-logie en pays d’Agde 2003, 24–27.
Mazière, F. et Gomez, É. 2001: ‘Agde. Nécropole du Bousquet’. Bilan Scientifique Région Languedoc-Roussillon (Montpellier), 120–21.
Mazière, F., Olive, C. et Ugolini, D. 2001: ‘Esquisse du territoire de Béziers (VIe–IVe s. av. J.-C.)’. Dans Martin Ortega, A. et Plana Mallart, R. (éd.), Territori polític i territori rural durant l’edat del Ferro a la Mediterrània occidental (Actes de la taula rodona celebrada a Ullastret del 25 al 27 de maig de 2000) (Gérone), 87–114.
Moret, P. 2002: ‘Maisons phéniciennes, grecques et indigènes: dynamiques croisées en Méditerranée occidentale (de l’Hérault au Segura)’. Dans Habitat et urbanisme dans le monde grec de la fin des palais mycéniens à la prise de Milet (494 av. J.-C.) (Actes de la table ronde de Toulouse, 9–10 mars 2001) (= Pallas 58), 329–56.
Nickels, A. 1976: ‘Les maisons à abside d’époque grecque archaïque de La Moné-dière, à Bessan (Hérault)’. Gallia 34, 95–125.
—. 1978: ‘Contribution à l’étude de la céramique grise archaïque en Languedoc-Rous-sillon’. Dans Les céramiques de la Grèce de l’Est et leur diffusion en Occident (Actes du colloque international de Naples, Centre Jean Bérard, 6–9 juillet 1976) (Paris/Naples), 248–67.
—. 1981: ‘Recherches sur la topographie de la ville antique d’Agde’. DAM 4, 29–50.—. 1987: ‘Le site protohistorique du Mont Joui à Florensac, Hérault’. RAN 20, 3–41.—. 1989: Agde. La nécropole du premier Âge du fer (Paris).—. 1989a: ‘La Monedière à Bessan (Hérault). Le bilan des recherches’. DAM 12,
51–120.—. 1995: ‘Les sondages de la rue Perben à Agde (Hérault)’. Dans EtMass 4, 59–98. Nickels, A. et Genty, P.-Y. 1974: ‘Une fosse à offrandes du VIe siècle avant notre ère
à La Monédière, Bessan (Hérault)’. RAN 7, 25–57.Nickels, A. et Marchand, G. 1976: ‘Recherches stratigraphiques ponctuelles à proxi-
mité des remparts antiques d’Agde’. RAN 9, 45–62.Nickels, A., Pellecuer, C., Raynaud, C., Roux, J.-C. et Adgé, M. 1981: ‘La nécropole
du Ier Âge du Fer d’Agde: les tombes à importations grecques’. MEFRA 93, 89–125.
Olive, C. 2002: ‘Béziers. Ancien Hôtel de la Poste’. Bilan Scientifique Région Langue-doc-Roussillon (Montpellier), 100.
—. 2003: ‘La Monédière (Bessan): l’agglomération de l’âge du Fer. Dans Archéologie en pays d’Agde 2003, 17–18.
Olive, C. et al. 2001: ‘Béziers. Le four de potier de la Domitienne’. Bilan Scientifique Région Languedoc-Roussillon (Montpellier), 125–26.
Olive, C. et Ugolini, D. 1997: ‘La Maison 1 de Béziers et son environnement (Ve–IVe s. av. J.-C.)’. Dans Ugolini 1997a, 87–129.
—. 1998: ‘Le travail du fer à Béziers (Hérault) pendant l’Âge du fer’. Dans Feugère, M. et Serneels, V. (éd.), Recherches sur l’économie du fer en Méditerranée nord-occidentale (Actes de la table ronde internationale de Lattes 1997) (Montagnac), 76–79.
—. 2001: Béziers (34). Centre ville (rue Mairan), Sondages 1 et 2 (Rapport déposé au S.R.A. Languedoc-Roussillon) (Montpellier).
—. 2003: ‘Béziers: un site majeur du Midi de la Gaule’. Dans Landes 2003, 147–55.
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 20093773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 200 1/06/12 11:211/06/12 11:21
D’AGDE À BÉZIERS: LES GRECS EN LANGUEDOC OCCIDENTAL 201
Olive, C., Ugolini, D. et Wiégant, J.-P. 1999: ‘Béziers. Saint-Jacques’. Bilan Scienti-fique Région Languedoc-Roussillon (Montpellier), 105–06.
Py, M. 1995: ‘Les Etrusques, les Grecs et la fondation de Lattes’. Dans EtMass 4, 261–276.
Py, M. et Roure, R. 2002: ‘Le Caïlar (Gard). Un nouveau comptoir protohistorique au confluent du Rhône et du Vistre’. DAM 25, 171–214.
Ratsimba, A. 2002: Les pithoï de Béziers: analyse d’une production et première approche de sa diffusion (VIe–IVe s. av. J.-C.) (Mémoire, Université d’Aix-Mar-seille I).
—. 2005: Le pithos en Gaule méridionale: production, diffusion et utilisation d’un mobilier d’origine grecque (VIe–IVe s. av. J.-C.) (Mémoire, Université d’Aix-Marseille).
Reille, J.-L. 1995: ‘La diffusion des meules dans la vallée de l’Hérault à l’époque protohistorique et l’identification microtexturale des basaltes’. DAM 18, 197–205.
—. 1999: ‘Détermination pétrographique de l’origine des meules en basalte de Lattes au IVe s. avant notre ère, changements et contrastes dans les importations’. Dans Py, M. (éd.), Recherches sur le IVe siècle avant notre ère à Lattes (Lattes), 519–22.
—. 2000 ‘Agde et le commerce des meules à grain en Gaule méditerranéenne à la fin de l’Âge du fer (IIe–Ier s. av. J.-C.)’. Dans Buxò et Pons i Brun 2000, 361–66.
Rondi-Costanzo, C. 1997: ‘Corail de Béziers, du Midi de la Gaule et de Méditerranée’. Dans Ugolini 1997a, 197–239.
Rondi-Costanzo, C et Ugolini, D. 2000: ‘Le corail dans le bassin nord-occidental de la Méditerranée entre le VIe et le IIe s. av. J.-C.’. Dans Morel, J.-P., Rondi-Cos-tanzo, C., et Ugolini, D. (éd.), Corallo di ieri, corallo di oggi (Atti del convegno di Ravello, Villa Rufolo, 13–15 dicembre 1996) (Bari), 177–91.
Ropiot, V. 1999: Les voies d’eau en Languedoc occidental et en Roussillon protohis-toriques (Mémoire, Université Montpellier III).
—. 2003a: ‘La question du port fluvial d’Agde et le trafic sur l’Hérault durant l’âge du Fer (VIe s.–IIe s. av. n.è.). Dans Berlanga, G.-P. et Perez Ballester J. (éd.), Puer-tos fluviales antiguos: ciudad, desarrollo e infraestructuras (Actas IV Jornadas de Arqueologìa Subacuàtica, Valencia 2001) (Valence), 213–25.
—. 2003b: ‘Trois exemples d’axes fluviaux en Languedoc occidental et en Roussillon du VIe s. au IIe s. av. n.è.’. DHA 29, 77–107.
—. 2003c: ‘Cessero-Le Fort (Saint-Thibéry)’. Dans Archéologie en pays d’Agde 2003, 15–16.
—. 2003d: ‘Le Fort (Saint-Thibéry, Hérault)’. Dans Olive, C. (éd.), Habitats protohis-toriques du Languedoc occidental et du Roussillon (Rapport trisannuel 1999–2001 du P. C. R. 14–15 du Ministère de la Culture) (Montpellier), 259–305.
—. 2005: ‘Une représentation confuse du peuplement dans les sources antiques du fleuve Rhodanos aux Pyrénées?’. Dans Mercadal, O. (éd.), Mon ibèric als països catalans. Homenatge a Josep Barberà i Farràs (XIIIe colloqui internacional d’ar-queologia de Puigcerdà, 13–15 novembre 2003), vol. 1 (Puigcerdà), 279–86.
Rouquette, D. et Ugolini, D. 1997: ‘Mèze antique (Hérault). Les sondages de 1988 aux Pénitents’. Dans Ugolini 1997a, 131–50.
Séguier, J.-M. et Vidal, M. 1992: ‘Les rapports commerciaux le long de l’axe Aude-Garonne aux Âges du fer’. Dans EtMass 3, 431–44.
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 20193773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 201 1/06/12 11:211/06/12 11:21
202 DANIELA UGOLINI
Tourette, C. 2002: ‘Agde, Belle Île’. Bilan Scientifique Région Languedoc-Roussillon (Montpellier), 94.
Ugolini, D. 1993a: ‘Civilisation languedocienne et ibérisme: un bilan de la question (VIIe–IVe s. av. J.-C.)’. Dans de Chazelles 1993, 26–40.
—. 1993b: ‘Lampes grecques et de type grec de Béziers. Utilisation et diffusion de la lampe grecque dans le Midi entre le VIe et le IVe s. av. J.-C.’. DAM 16, 279–93.
—. 1995a: ‘Béziers pendant la protohistoire (VIe s.–Ier s. av. J.-C.). Spécificités de l’occupation dans le cadre régional’. Dans Clavel-Lévêque, M. et Plana Mallart, R. (éd.), Cité et Territoire (Actes du Ier colloque européen de Béziers, 1994) (Paris), 149–68.
—. 1995b: ‘La céramique attique d’Agde dans le cadre du Languedoc central et occi-dental’. Dans Sabattini, B. (ed.), La céramique attique du IVe s. en Méditerranée occidentale (Actes du colloque international d’Arles, décembre 1995) (Naples 2000), 201–07.
—. (éd.) 1997a: Languedoc occidental protohistorique. Fouilles et recherches récentes (VIe–IVe s. av. J.-C.) (Aix-en-Provence).
—. 1997b: ‘Les oppida du bassin audois côtier: questions de chronologie et de mobi-lier (VIe s. av. J.-C.)’. Dans Ugolini 1997a, 157–72.
—. 1997c: ‘Le cratère corinthien de Puisserguier (34)’. Dans Ugolini 1997a, 67–76.—. 1999: ‘Agde, Place Conesa’. Bilan Scientifique Région Languedoc-Roussillon,
99–100.—. 2000: ‘Consommer les aliments: boire, cuire et manger en Languedoc-Roussillon
au cours de l’Age du fer’. Dans Buxò et Pons i Brun 2000, 389–400. —. 2001a: ‘Agde. Notices’. Dans Lugand et Bermond 2001, 123–43.—. 2001b: ‘Agde’. Dans Lugand et Bermond 2001, 119–23.—. 2001c: ‘L’Âge du fer’. Dans Lugand et Bermond 2001, 71–78.—. 2002: ‘La céramique à cuire d’Agde (VIe–IIe s. av. J.-C.)’. Dans Méniel, P. et
Lambot, B. (éd.), Repas des vivants et nourriture pour les morts en Gaule (Actes du XXVe colloque de l’Association Française pour l’Étude de l’Age du Fer, Charleville-Mézières, 24–27 mai 2001) (Reims), 191–200.
—. 2005: ‘Les Ibères des Pyrénées au Rhône. Bilan de vingt ans de recherches et nou-velles perspectives’. Dans Mercadal, O. (éd.), Mon ibèric als països catalans. Homenatge a Josep Barberà i Farràs (XIIIe colloqui internacional d’arqueologia de Puigcerdà, 13–15 novembre 2003), vol. 1 (Puigcerdà), 165–262.
—. à paraître: ‘Les lampes grecques du Languedoc-Roussillon antérieures au IIIe s. av. J.-C.’. Dans Archéologie et histoire de l’éclairage en Gaule, de la Préhistoire au début du Moyen-Age (2e Table-Ronde Internationale ILA, Musée de Millau, Aveyron, 22–24 mars 2007).
Ugolini, D. et Olive, C. 1987: ‘Béziers et les côtes languedociennes dans l’Ora Mari-tima d’Aviénus’. RAN 20, 143–54.
—. 1988: ‘Un four de potier du Ve s. av. J.-C. à Béziers, Place de la Madeleine’. Gal-lia 45 (1987–88), 13–28.
—. 1990: ‘La chronologie et la place des amphores massaliètes dans le commerce biterrois aux Ve et IVe s. av. J.-C.’. Dans EtMass 2, 119–23.
—. 1995a: ‘Grecs et Ibères entre l’Orb et l’Hérault (VIe–IVe s. av. J.-C.)’. Dans Iberos y Griegos: lecturas desde la diversidad (Actes du colloque international de La Escala, avril 1991) (= Huelva Arqueologica 12.2), 275–90.
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 20293773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 202 1/06/12 11:211/06/12 11:21
D’AGDE À BÉZIERS: LES GRECS EN LANGUEDOC OCCIDENTAL 203
—. 1995b: ‘La céramique attique de Béziers (VIe–IVe s.). Approche de la diffusion et de l’utilisation de la vaisselle attique en Languedoc occidental’. Dans EtMass 4, 237–60.
—. 1998: ‘La ferme protohistorique de Sauvian (34). Casse-Diables, zone 2 (Ve–IVe s. av. J.-C.)’. Dans Mauné, S. (éd.), Recherches récentes sur les établissements ruraux protohistoriques en Gaule Méridionale (Actes de la table ronde de Lattes, mai 1997) (Montagnac), 93–119.
—. 2003a: ‘Autour de la fondation de Narbo Martius: Atacini et autres peuples pré-romains de l’Aude’. Dans Bats, M., Dedet, B., Garmy, P., Janin, T., Raynaud, C. et Schwaller, M. (éd.), Peuples et territoires en Gaule méridionale. Hommages à Guy Barruol (Montpellier), 297–302.
—. 2003b: ‘La place des importations étrusques dans le cadre de l’évolution du Lan-guedoc centro-occidental côtier (650–300 av. J.-C.)’. Dans Landes 2003, 35–48.
—. 2004: ‘La circulation des amphores en Languedoc occidental: réseaux et influences’. Dans Sanmartì, J., Ugolini, D., Ramon, J. et Asensio, D. (éd.), La circulaciò d’àmfores al Mediterrani occidental durant la Protohistòria (segles VIII–III aC): aspectes quantitatius i anàlisi de contiguts (Actes de la II Reuniò International d’Arqueologia de Calafell, 21–23 de març del 2002) (Barcelone), 59–104.
—. 2006a: Béziers I (600–300 av. J.-C.). La naissance de la ville (Catalogue de l’ex-position) (Béziers).
—. 2006b: ‘De l’arrivée à la consommation: l’impact des trafics et des produits étrusques en Languedoc occidental’. Dans Gori, S. et Bettini, M.C. (éd.) Gli Etruschi da Genova ad Ampurias (Atti XXIV convegno di studi etruschi e italici, Marseille-Lattes, 26 settembre–1 ottobre 2002) (Pise/Rome), 555–81.
—. à paraître: ‘Sites grecs, sites indigènes. Essai sur le fonctionnement des habitats de l’Hérault occidental (VIe–IVe s. av. J.-C.)’. Dans Habitats et paysages ruraux en Gaule, du VIe au Ier s. av. J.-C. (Actes du XXXIe colloque international de l’As-sociation Française pour l’Étude de l’Âge du Fer, Chauvigny, 17–20 mai 2007) (Chauvigny).
Ugolini, D., Olive, C., Marchand, G. et Columeau, P. 1991: ‘Un ensemble représenta-tif du Ve s. av. J.-C. à Béziers, Place de la Madeleine, et essai de caractérisation du site’. DAM 14, 141–203.
Ugolini, D. et Pezin, A. 1993: ‘Un aperçu sur le mobilier du Ve s. av. J.-C. en Langue-doc occidental et en Roussillon’. Dans de Chazelles 1993, 80–87.
Wiégant, J.-P., Olive, C. et Ugolini, D. 2001: Béziers (Hérault). Rues Mairan, de la Coquille et Guibal. Rapport de suivi archéologique des travaux sur les réseaux (2000) (Montpellier).
93773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 20393773_Hermary_CA4_09_Ugolini.indd 203 1/06/12 11:211/06/12 11:21














































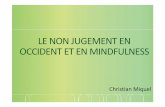






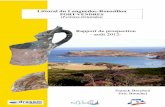


![Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/632443be4d8439cb620d4d1d/tressan-jusquen-1914-la-naissance-dun-village-viticole-en-languedoc-version.jpg)