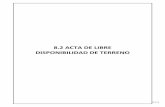Essai de bibliographie sur les États de Languedoc - Études ...
Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]
-
Upload
univ-montpellier -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]
0
Bruno JAUDON
TRESSAN JUSQU’EN 1914 : LA NAISSANCE
D’UN VILLAGE VITICOLE EN LANGUEDOC.
Nota Bene
Ceci est le tapuscrit original du livre Tressan jusqu’en 1914 : la naissance d’un village viticole en Languedoc (Tressan, Association « Au fil de l’Histoire », 2004, 216 p.). Il s’agit d’une monographie villageoise, qui a été réalisée à partir de la relecture d’un mémoire de Master 1, soutenu en 1996 (Montpellier III), d’un mémoire de Master 2, soutenu en 2000 (Montpellier III), ainsi que de nombreux dépouillements annexes, menés aux Archives départementales de l’Hérault et aux Archives municipales de Tressan. Le dépouillement informatisé des compoix de 1597, 1770 et des cadastres de 1826 et 1913 forme le socle de ce travail. En tant qu’historien ruraliste, je n’avais que rarement trouvé mon compte dans les monographies languedociennes existantes. Le genre s’avère en effet très inégal, parce que les amateurs d’histoire, même éclairés, ne sont pas des professionnels de la mise en contexte, ainsi que de la maîtrise des définitions des mots d’époque. On y lit souvent, malgré de nombreux efforts produits par leurs auteur-e-s, nombre de sur-interprétations et de contre-sens, au milieu de réflexions autocentrées sur la commune traitée. C’est pour ces raisons que je m’étais essayé à l’exercice. Et aussi parce qu’étant né et ayant grandi à Tressan (Hérault), j’avais envie de faire plaisir aux habitants de mon village, vers lequel j’aime tant, aujourd’hui encore, faire retour. Depuis plusieurs années, les 400 volumes initiaux sont épuisés et il me semble utile de proposer une version téléchargeable de ce travail. Les nombreuses photographies et illustrations qui parsèment le livre sont hélas absentes des pages qui suivent.
Rieutort-de-Randon (Lozère), le 11 février 2015
Tressan Association « Au fil de l’Histoire »
2004
1
AVERTISSEMENT.
Tressan, pour ses anciens et ses nouveaux habitants, constitue à bien des égards un
repère fort, mais ne lui manque-t-il pas aujourd’hui, à son tour, certains repères venus du passé ? Gignac, Canet, Saint-Pargoire, Paulhan, Montagnac et bien d’autres communes du val d’Hérault disposent à l’heure actuelle de monographies historiques rappelant, de manière plus ou moins heureuse et plus ou moins rigoureuse, l’histoire de leur village. Ces œuvres, au-delà d’un caractère heureusement toujours critiquable, ont le mérite d’exister, d’être le fruit du travail de passionnés et d’amoureux de leur commune, soucieux de réveiller chez leurs concitoyens le goût de la mémoire. Mémoire de faits, de lieux et surtout d’hommes à jamais oubliés. Cela est inestimable et il était temps, à l’image des travaux cités, de redonner à Tressan l’épaisseur de sa petite histoire, celle d’un village au moins deux fois millénaire. C’est évidemment d’une histoire rurale dont il s’agit. De telles monographies sont cependant, dans le monde de la recherche, un genre historique parfois mal vu, car elles ont souvent, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, alimenté une littérature où tout pouvait être écrit et souvent hélas imaginé, dans un contexte d’après la Guerre de 1870 puis d’après-Grande Guerre très ou trop cocardier. Des chapitres entiers de l’Histoire de Gignac et des communes de son canton, écrite puis publiée en 1887 par Jacques Mestre, ont par exemple été inventés de toute pièce en l’absence de documents écrits ou archéologiques. De la même façon, des pages complètes de ce livre sont des digressions sans aucun rapport avec l’histoire. Et les ouvrages de ce type se comptent par dizaines à l’échelle du Languedoc des campagnes, vivement remis en cause par une critique spécialisée et -on l’aura compris- devenue à juste titre méfiante.
Essayons donc plutôt de répondre aujourd’hui aux attentes suscitées par toute monographie honnête, tant le genre se renouvelle depuis peu avec une grande vigueur et un souci évident de minutie et d’exactitude. Il s’agit donc de limiter l’étude de Tressan de la fin du XVIe siècle au tout début du XXe siècle. En effet, les documents anciens se multiplient significativement après les années 1590 : eux seuls autorisent une restitution correcte de l’histoire. Après 1914, le village entre définitivement dans l’ère contemporaine et dans les récits transmis par nos aînés sur leur passé : il entre alors dans le domaine des souvenirs familiaux et collectifs. Des siècles précédant la décennie 1590, on connaît quelques bribes chronologiquement éparses et il serait déformant de leur donner une importance désormais impossible à mesurer, même si les époques gallo-romaine et médiévale restent bien souvent les plus attirantes pour le lecteur. Je n’ai en outre ni les compétences ni la formation requises pour m’attarder sur ces deux périodes. Enfin, du XVIe au XXe siècle, le fait saillant et connu de l’histoire de Tressan est la mise en place en son terroir de la monoculture viticole, comme dans toutes les communes de la vallée de l’Hérault, du Biterrois ou du Narbonnais. C’est donc pourquoi Tressan jusqu’en 1914 se veut une micro-histoire, celle d’un terroir de 400 hectares, centrée sur les évolutions de l’agriculture et du village lui-même. De la rue la plus étroite aux terres s’offrant à nos yeux, le paysage rural et villageois qui nous est familier n’est pas neutre en effet : il parle d’un héritage et d’un patrimoine patiemment façonnés car, jusque récemment en effet, les activités agricoles ont modelé notre plus proche horizon ou, si vous voulez, notre cadre de vie. Si les vieilles venelles du village sont étroites, si autour des placettes les bâtisses sont imposantes et perchées au-dessus de hautes et larges remises, si la plaine envahie de vignes est surveillée par des collines dénudées et comme grossiérement rabotées, seule une histoire rurale peut dire quand et pourquoi ces éléments singuliers du paysage se sont mis en place. Le lecteur ne doit donc pas espérer trouver ici une histoire complète du village, car cela est impossible, encore moins un catalogue des événements les plus marquants de
2
la vie quotidienne au cours des trois siècles envisagés. L’anecdote ne fait jamais sens, surtout arrachée à son contexte et l’histoire, même locale, n’est pas du journalisme réalisé à partir de vieux papiers.
C’est pour cela que si rédiger des articles universitaires spécialisés sur Tressan ne m’a jamais angoissé, il m’a été terriblement difficile d’écrire une histoire du village où j’ai grandi par peur de deux fautes graves : peur de ne pas attacher assez solidement cette monographie à l’histoire du Languedoc rural et peur d’un chauvinisme détestable et contagieux. L’identité d’un pays ou d’un village, la principale condition de sa survie, est bel et bien sa capacité à s’ouvrir aux autres, nouveaux et anciens, ainsi qu’à leurs idées, sa capacité à trouver le fragile équilibre entre ouverture et repli sur soi. Alors, suivant le mot d’Emmanuel Le Roy Ladurie dans son Histoire de France des régions, tout village du Midi doit garder « des liens dignes de ce nom avec la culture d’oc », c’est-à-dire avec une culture cent fois intégratrice par le passé de familles venues de tous les horizons de la Méditerranée, de ses abords ou de plus loin. C’est dire si Tressan ne peut pas se soustraire au respect d’un passé humainement riche, qui a toujours battu à un même rythme, celui de l’histoire du Languedoc et de la France. Passé riche, donc, d’Aveyronnais, d’Espagnols, de Maghrébins et de tant d’autres « tard-venus », qui comprendraient mal toute tentation de repli identitaire à l’intérieur de notre clocher. C’est peu dire aussi que Tressan jusqu’en 1914 est une histoire incomplète, juste un état actuel des recherches universitaires menées sur ce village depuis l’été 1995. J’ai en outre évité de développer certains passages pour me concentrer sur l’essentiel, pour échapper à l’obsession du détail et pour ne pas fatiguer le lecteur. Beaucoup reste donc à faire et à dépouiller dans les dépôts d’archives, en particulier les très dispersés actes notariés anciens, pour étoffer ce livre qui, à tout prendre, n’est pas une histoire de Tressan, mais un cadre commode pour mieux la comprendre.
Pour les Tressanais les plus anciens, enfin, la localisation des lieux et leurs noms ne sont pas forcément ceux leur étant familiers, car ils ont été dictés par les seuls documents d’époque. Or, les noms de lieux, leur orthographe et leur emplacement varient beaucoup d’un document à l’autre, de tel cadastre à tel autre et sont souvent très différents de ceux connus actuellement. Puissent malgré tout ces quelques pages réveiller en eux le goût de la mémoire d’un passé constamment agricole et paysan et, au regard de deux mille ans d’histoire, peut-être pas aussi viticole et vigneron qu’il n’y paraît aujourd’hui en regardant autour de nous.
3
INTRODUCTION.
Quitter Montpellier pour venir à Tressan, c’est entrer dans la campagne et traverser un raccourci de quelques-unes des mille facettes du Languedoc rural. Ce chemin du retour, principalement pour cause d’études, je l’ai emprunté pendant presque dix ans, souvent avec nostalgie. Nous voilà sur la route de Lodève et jusqu'après Saint-Paul-et-Valmalle, l’automobiliste franchit les austères garrigues du Montpelliérais et ses innombrables clapas. A hauteur de la Taillade, avant de culbuter vers Gignac, le conducteur se trouve au milieu du moutonnement de collines de calcaire gris à la végétation rase. Quelques virages encore et voilà l’horizon ouvert sur la vallée de l’Hérault et ses dizaines de villages et de bourgs. C’est un immense ruban vert, fortement boisé le long du fleuve, au cours dessiné par de hautes futaies. Au loin, le relief accidenté du Mont Liausson, du pic de Vissou, des sommets de l’Escandorgue et du pic d’Arboras souligne plus encore le contraste entre les rudes paysages à peine traversés, ceux que l’on aperçoit et la richesse des espaces de la plaine. Une fois contourné Gignac, une fois empruntée la route de Pézenas, nous sommes dans une autre campagne, moins sauvage, où chaque kilomètre ou presque fait buter sur un hameau, un village, un mas, où un vignoble partout présent submerge désormais le paysage. Sur la rive gauche de l’Hérault, des coteaux calcaires s’avancent depuis l’est et demeurent le domaine du chêne vert, du genêt, du thym, de la végétation méditerranéenne traditionnelle. Lorsque les gradins bordant le cours d’eau se resserrent à l’extrême pour accueillir le lit le plus étroit de l’Hérault depuis le Pont du Diable, nous voici aux pieds de Tressan. C’est un petit village juché sur sa colline, dont les versants boisés et taillés en forme de marches d’escalier disent que, jadis, il n’y eut pas ici que des bouquets d’arbres fous et des hermes. Du pied du coteau jusqu’à l’Hérault, tout ou presque est vigne, vignes rarement bordées d’oliviers, parfois encore d’amandiers et de cerisiers, parcourues par le réseau des petites rigoles d’irrigation du vieux canal de Gignac, qui finit ici une course entamée à Saint-Jean-de-Fos. Ici commence ce livre, ainsi que notre histoire et elle est longue. La vigne en témoigne, là, tout autour de nous, qui semble désormais éternelle et irremplaçable. Vivre à Tressan aujourd’hui, c’est connaître les terribles difficultés des viticulteurs, observer leur(s) solidarité(s), leurs rapports avec le reste de la population dont ils furent la majorité mais ne le sont plus. C’est donc vivre un quotidien où la vigne définit à la fois le paysage et ses habitants, en somme leur environnement et leur identité. Mais, en était-il de même hier et de quand date « hier » en deux mille ans et plus d’existence du terroir ? Depuis quand la vigne est-elle à Tressan ce personnage incontournable et inamovible ? Le premier chapitre sur le village et son terroir avant 1597 peut donc sembler anecdotique et peu en rapport avec un tel questionnement. Il est là, je le concède, pour mémoire, pour compiler et pour partager des informations patiemment accumulées depuis 1995 sur les périodes gallo-romaine et médiévale. Pour autant, la vigne n’en est pas totalement absente. Le second chapitre commence en 1597 et aboutit en 1770. Pourquoi ? En 1597, Tressan dispose d’un compoix nouvellement mis en service : il permet de reconstituer la mise en valeur du terroir et de dresser l’état du village lui-même à cette date. Ce cadastre servit jusqu’en 1770, quand la « municipalité » d’alors décida de le réviser et de le refaire. Le troisième chapitre analyse la période 1770-1914, pour laquelle les documents cadastraux et de tous horizons se multiplient et se recoupent : nouveau compoix homologué en 1770, autres archives de même nature en 1805, 1826 et 1914. L’analyse des quatre documents permet littéralement de disséquer les progrès de la vigne dans le paysage, ses mécanismes d’extension et d’expansion. Des trois chapitres, le second et le troisième sont incontestablement les plus longs, le plus étoffés et les plus documentés.
4
S’ils forment le cœur de ce livre, c’est une simple concession à ma formation universitaire, centrée sur les Temps Modernes, à l’écoute d’enseignants et de chercheurs montpelliérains remarquables.
Au seuil de ce livre, regrettons tout de même l’absence dans les archives communales des délibérations « municipales » jusqu’en 1836. Bien des documents anciens ont disparu de la mairie jusque récemment ; d’autres sont des documents familiaux secrètement gardés. Ce silence pesant nous prive hélas d’un patrimoine ancien qui pourrait être plus vivant et plus dense, d’une porte ouverte sur une histoire finalement encore plus proche de notre quotidien et plus riche de sens. A l’heure actuelle, la connaissance de Tressan est donc indissociable de ses cadastres anciens et contemporains, elle s’y résume presque. Sans eux, l’histoire du village et de son terroir se résumerait à quelques lignes dérisoires eu égard à la richesse d’un passé à jamais disparu.
5
Chapitre I.
AVANT 1597 : UNE CONNAISSANCE TÉNUE DU VILLAGE.
Avant 1597, la connaissance de Tressan
est extrêmement limitée, les documents sont rares, le premier remonte au milieu du Xe siècle. Les textes du Moyen Age sont le plus souvent des transactions seigneuriales dans lesquelles le village, comme d’autres liés au même destin féodal, est un élément constitutif de seigneuries bien plus vastes. Quant aux écrits évoquant sur la vie villageoise à proprement parler, ils ne se comptent même pas sur les doigts d’une main. C’est dire si, avant les années 1100, chercher à redonner un peu de son passé à Tressan est une tâche délicate et basée sur un rigoureux travail d’interprétation de textes dont le but n’est pas de parler de la vie quotidienne. Il est néanmoins possible de comprendre quelle fut l’origine du village et son évolution au cours du Moyen Age.
6
I) DES ORIGINES GALLO-ROMAINES : LA VILLA TERENCIANO.
Pour tout spécialiste de l’histoire moderne, il est très aventureux de remonter aussi haut qu’à l’époque antique. Les publications récentes sur la vallée de l’Hérault à l’époque gallo-romaine permettent toutefois, associées à des prospections sur place et à la connaissance de vestiges archéologiques, d’émettre un certain nombre d’hypothèses sur la naissance de Tressan. 1- TRESSAN : ETYMOLOGIE D’UN NOM PROPRE.
Le premier document à évoquer Tressan est le cartulaire d’Aniane, recueil des chartes et des actes passés par l’abbaye depuis sa fondation. Un acte y concerne quelques pièces de terres situées à Terrenciano en 9591. Huit ans plus tard, en 967, le Livre Noir de l’évêché de Béziers parle d’une Terenciano villa2. Tressan est alors évoqué comme une villa mais, au Xe siècle, ce mot ne signifie déjà peut-être plus une exploitation agricole composée d’une ferme et d’un certain nombre d’habitations3. Au Xe siècle, une villa peut en effet consister en « un « territoire » dont on ignore presque toujours la genèse et surtout s’il comportait un ou plusieurs pôles d’habitat »4. Un indice fort reste pourtant donné au détour de ces textes : l’origine de Tressan repose probablement sur la fondation d’une villa à l’époque gallo-romaine, autrement dit, cette fois-ci, d’une ferme plus ou moins luxueuse, selon la définition employée par les archéologues et les historiens de l’Antiquité5.
Le plus intéressant réside en outre dans le nom donné à la villa. Il indique vraisemblablement le contexte de sa naissance. Lorsque Béziers fut créée en 36 avant J.C., son territoire fut encadastré, puis colonisé « par des vétérans de la VIIe légion de César »6. Or, l’implantation actuelle de Tressan le place aux confins nord-est du territoire de la cité romaine de Béziers. Il n’est pas inimaginable qu’un certain Térence fut à l’origine doté de terres dans l’actuel terroir et put alors peut-être fonder une villa, la villa Terenciano et lui laisser son nom7. Du fondateur de ce domaine rural on ne sait rien, ni même si le nom donné par les textes du Xe siècle garde son souvenir ou si Térence n’est pas un personnage beaucoup plus tardif. Le nom du village ne signifie donc pas que l’air de Tressan était « très sain »8, ni même qu’il fut fondé par trois saints, légendes locales auxquelles ils est difficile de tordre le cou. Comme toutes les localités de la France du Sud dont le nom se termine par les suffixes –an et –ac, il existe de grandes chances pour affirmer l’origine gallo-romaine du village actuel9, grâce à la fondation d’une villa par un aristocrate ou un colon gallo-romain, installé là en pleine période de romanisation de la province de Narbonnaise. La villa a probablement été établie sur aux Condamines entre les années 100 et 50 avant J.-C., parmi « une quinzaine de sites (…) fondés à cette période »10. 2- UN TERROIR FORTEMENT ROMANISE.
L’origine gallo-romaine de Tressan ne fait donc actuellement aucun doute, mais on peut tout aussi bien se demander si elle ne remonte pas à une époque antérieure. Quelques rares trouvailles de frappes monétaires indigènes et une statuette de divinité gauloise pourraient inviter à le penser11. Des indices archéologiques épars laissent en effet penser à plusieurs auteurs qu’une ferme indigène existait déjà avant l’apparition de la villa des Condamines. Dans un tel cas de figure, le passage d’une ferme gauloise à une ferme romaine ressemblerait plus à un réaménagement de l’habitat et du terroir qu’à une véritable création. Pour de nouveaux arrivants, cela n’était sans doute pas dénué d’intérêt. Néanmoins, au-delà de telles hypothèses, trop aléatoires, seules les racines romaines du village demeurent acquises. Tressan fut vraisemblablement une villa particulièrement importante et dont la vie a perduré environ six siècles, du dernier tiers du Ier siècle avant
7
J.C. au VIe siècle de notre ère12. Quant au Biterrois, il fut d’ailleurs parsemé dès le début de notre ère de très nombreuses villæ parfois précédées d’exploitations indigènes13.
Trois éléments décisifs commandaient alors la fondation de tels domaines ruraux14. Il fallait d’abord établir la villa dans une plaine, ici dans la vallée de l’Hérault, pas trop près du fleuve cependant, afin de se prémunir de ses crues printanières et automnales. En installant la ferme gallo-romaine aux Condamines, les colons s’assurèrent la complémentarité de terroirs différents. Il reste évidemment impossible de savoir à quelles productions se vouait la villa. La seconde condition essentielle à l’installation d’une villa à Tressan résidait dans la proximité d’un point d’eau permanent. Ce fut chose acquise avec la source captée de la Fon de las Costes, l’actuelle Fontaine Fraîche. En effet, tout près des Condamines, la source coule en permanence et débouche aujourd’hui dans un bac central de facture ancienne, sinon antique. Une condition aussi vitale satisfaite, la villa, pour vivre, devait évidemment être reliée à un axe de communication assez important. Or, l’ancien chemin de Gignac à Pézenas, le Cami Ferrat, qui double à l’ouest la route départementale n° 32, est un axe ancien de communication nord-sud. Il jouxte le tènement des Condamines et devait donner à l’exploitation agricole une certaine vitalité économique en l’intégrant à un monde d’échanges très anciens entre la plaine languedocienne et les plateaux bordant le sud du Massif Central. Le Cami Ferrat double en effet, sur la rive gauche de l’Hérault, la voie romaine reliant Cessero (Saint-Thibéry) à Segodonum (Rodez) par Lodève et Millau, qui court elle le long de la rive droite du cours d’eau15. Ce Cami Ferrat, longeant plus ou moins le fleuve, pose aujourd’hui problème aux chercheurs, qui ont encore du mal à fixer son tracé exact16. Sans doute, la villa Terenciano fut-elle, on l’a dit, une ferme gallo-romaine importante. Des prospections sur place, dans les rangées des vignes recouvrant aujourd’hui ses vestiges, donnent des indices forts abondant dans ce sens, même pour un œil peu averti. Les fragments de céramique sigillée, d’une grande finesse et d’une grande qualité, sont assez nombreux. Les tas d’épierrement en bordure des parcelles ou sur les talus donnent d’abondants fragments de tegulae, ces larges tuiles plates romaines. Le fragment à peine courbé d’une épaisse lèvre d’un col de dolium a été repéré : les dolia étaient d’énormes jarres enterrées et faisaient office de silos à grains et autres vivres. Pour Laurent Schneider, qui eut la chance de prospecter les Condamines en 1983 à l’occasion d’un labour profond, la villa était imposante, dans la mesure où il avait pu observer sur place des fûts de colonnes et des fragments de mosaïques17. Des anciens du village assurent qu’au cours des années 1960, d’autres labours profonds, au même endroit, auraient livré une abondante quantité de poteries hélas jetées à l’Hérault. De manière plus certaine, un matériel monétaire abondant et de précieux instruments agricoles métalliques, ainsi que des statuettes en argent de divinités romaines (Mercure), attestent d’une relative richesse de la ferme gallo-romaine18. Mais, il reste préférable de relier cette villa aux autres gisements archéologiques du terroir et des environs, afin d’illustrer l’intensité de l’occupation humaine dans l’actuel territoire communal tout comme dans le reste de la moyenne vallée de l’Hérault19.
Au Mas de Fraïsse, un atelier de potiers des Ier et IIe siècles après J.C. a été fouillé par l’abbé Maistre : les deux mètres carrés sondés ont livré des centaines de tessons d’amphores 20. Le reste du sol de cette vigne de J. Donnadieu est d’ailleurs jonché de milliers de minuscules éclats de terre cuite, réduits à cet état par des centaines d’années de labours. Le potier installé là produisait surtout des amphores dites « Gauloise 4 », dont l’Hérault, tout proche, « autorisait un transport (…) par voie d’eau »21. Un autre atelier était d’ailleurs situé à Aspiran, sur l’autre rive de l’Hérault et produisait le même type d’amphores et de la céramique sigillée22, peut-être utilisées dans la villa Terenciano. Les travaux archéologiques de sauvetage menés sur le chantier de l’autoroute A 75 et ceux de
8
prospection démontrent l’insertion de la villa à un val d’Hérault intensément romanisé23. Enfin, intégrée au territoire de la civitas de Béziers, la villa était certainement comprise dans l’antique cadastre C de Béziers24, même si rien ne saurait être affirmé sur un sujet très délicat et discuté. A. Pérez note toutefois « la présence d’un decumanus qui relie Tressan à Puilacher (…) capturé sans doute lors de la constitution du noyau médiéval [des deux villages] »25.
La villa, installée dans la plaine, pouvait donc être le cadre d’une agriculture tournée vers la production céréalière et le pastoralisme, ainsi que d’une modeste activité artisanale. Au Mas de Fraysse, S. Mauné signale, outre l’atelier de potiers, « un habitat correspondant (…) [qui] semble appartenir à la catégorie des exploitations moyennes, sans doute en partie tournée vers la viticulture »26. Le même auteur démontre d’ailleurs avec beaucoup de précision le développement de la viticulture dans les environs d’Aspiran vers 70 de notre ère, auquel Tressan, par sa production d’amphores, devait prendre part27. Il est en revanche bien plus prudent lorsqu’il évoque les autres facettes et composantes de l’agriculture et de l’élevage dans la moyenne vallée de l’Hérault, « mal attestées par les indices matériels mais néanmoins vitales pour la survie des domaines »28. Enfin, le commerce semble alors très dynamique au cours du Ier siècle ap. J.-C.29. Par la suite cependant, la région est touchée par une véritable crise, qui a entraîné, à la fin du IIIe siècle après J.-C. « la disparition de près de 70 % des exploitations rurales » : la villa des Condamines est d’ailleurs l’une des rares à franchir ce cap difficile, au cours duquel la production viticole semble elle aussi sombrer30. La survie de la villa à la débâcle des campagnes locales reste d’ailleurs le seul fait certain qu’elle laisse à notre connaissance, comme le rappelle Laurent Schneider31. Les dernières traces de la villa s’effacent au cours du VIe siècle après J.-C., avec de nombreuses trouvailles archéologiques de surface datées de cette époque32.
9
II) LA STABILISATION DE L’HABITAT ET DU TERROIR AU MOYEN AGE.
Après l’abandon de la villa Terenciano au VIe siècle, la connaissance de l’habitat et du terroir s’efface dans le silence des sources. Les documents écrits sont absents pour quatre siècles encore, lacune immense et irréparable, tandis que les traces archéologiques se font plus ténues. Ce phénomène n’est hélas pas isolé et concerne l’histoire languedocienne en général33. En revanche, le passé redevient plus facile à restituer à partir du Xe siècle, même si une chronologie fine des principales évolutions du village reste impossible à dresser. 1- QUATRE SIECLES PRATIQUEMENT INCONNUS.
La villa Terenciano fut donc délaissée au cours du VIe siècle après J.-C. pour des raisons inconnues. Ce fut le cas de bien des villae de la région à la même époque, disparaissant pour la plupart au Ve siècle et en moindre mesure au VIe siècle34. Stéphane Mauné, spécialiste de la vallée de l’Hérault pendant l’Antiquité, montre l’importance de trois éléments combinés pouvant expliquer l’abandon de ces villæ : passage et/ou implantation des Wisigoths, multiplication des épidémies parmi la population, crises alimentaires35. Dès lors, plus rien ne nous permet de dire ce que devinrent les habitants de l’exploitation. Déguerpirent-ils définitivement des lieux ? S’installèrent-ils à proximité de la villa ruinée, sur le tènement des Faïsses, à l’est de la villa36 ? Les questions posées restent en suspens, tant les indices d’occupation humaine à cette époque sont rares. Deux belles plaques-boucles mérovingiennes ont été retrouvées au nord du terroir et font partie des collections du musée de Cluny à Paris37. Contemporaine, une minuscule monnaie en or de Caribert II a fait l’objet d’un recensement par la D.R.A.C.38. Stéphane Mauné signale aussi une francisque, la hache de guerre des Francs, trouvée par hasard aux Condamines39. Le folklore de la fin du XIXe siècle signale d’ailleurs une bataille entre Francs et Wisigoths aux pieds des collines d’Aspiran ou de Tressan en 67440... Mais, aucun des objets cités ne se localisait au même endroit : ils donnent plutôt l’impression d’une présence humaine faible ou de passage. Le Haut Moyen Age reste donc obscur. On sait tout de même qu’un enclos ecclésial, lieu de culte et cimetière, s’est développé à hauteur d’un gué sur l’Hérault, au vocable éloquent de Saint-Etienne-de-Gaupeyrous, « Saint-Etienne-du-Gué-Pierreux »41. Non loin de là, un tènement porte un toponyme basé sur un gentilice, un nom de famille gallo-romain : Bazilliac42. L’existence d’un domaine gallo-romain disparu dans ce tènement n’est pas exclue43. Mais, on ne pressent pas pour cette époque l’existence d’un habitat aussi stable que l’antique villa des Condamines. S. Mauné, quant à lui, a prospecté les Faïsses en 1994. Il a trouvé là des restes de céramiques qui couvrent une période allant essentiellement du Ve au XIe siècle, ce siècle-là étant particulièrement bien représenté44. Ce dernier repère archéologique et chronologique est pour nous, nous allons le voir, d’une importance capitale.
Des quatre siècles de silence auxquels nous confrontent des sources inexistantes, on ne peut rien retenir de précis, sinon, avec la probable fondation de Saint-Etienne, près de l’Hérault, la trace sûre de la christianisation des environs de Tressan à la fin de l’Antiquité ou aux tous débuts du Moyen Age45. Le vocable de l’église paroissiale, Saint-Geniès, très ancien (paléochrétien), confirme cet ordre d’idée. D’ailleurs, même si aucune fouille archéologique n’a été menée, le pôle principal de peuplement aux environs de Tressan est lui aussi un sanctuaire paléochrétien : il s’agit de Saint-Jean-Sainte-Eulalie sur le terroir du Pouget. On y trouve avant l’an Mil deux églises et un cimetière, qui constituent probablement dans le voisinage de la villa des Condamines un des tous premiers liens communautaires associant les habitants à leur terroir46. Cela a probablement aidé à fixer la
10
population d’un certain nombre de villae autour de Saint-Jean-Sainte-Eulalie avant le Xe siècle. A cette époque en effet, la villa de Tressan et d’autres environnantes ont probablement été dynamisées grâce à la fondation des monastères d’Aniane après 777 et de Gellone vers 80047. Les moines tissent alors un véritable réseau d’églises autour desquelles se rassemble l’habitat, protégé par « les institutions de la paix de Dieu. L’église et son cimetière, strictement protégés par la nouvelle législation, constituent une terre d’asile pour le monde paysan en proie aux violences châtelaines »48. En cas de problème, les habitants de la villa peuvent donc trouver refuge à Saint-Jean-Sainte-Eulalie, mais aussi à Saint-Etienne-de-Gaupeirous, où se trouve une autre villa, dont la moitié est possédée en 990 par l’abbaye de Saint-Thibéry. Dans ce cas d’ailleurs, l’habitat semble nettement attaché au lieu de culte dont un texte de 1605 et des plans anciens de 1770 et 1779 gardent la trace : une chapelle et un cimetière.
Sinon, à titre d’hypothèse seulement, Tressan semble avoir toujours balancé entre l’environnement des Condamines en temps de prospérité et le versant nord de la colline en temps de difficultés. Le phénomène de descente et de montée des villages suivant la conjoncture des moments est particulièrement bien connu dans toute la France méridionale. A partir des Xe et XIe siècles, les faits s’éclairent heureusement à nouveau, grâce aux premières mentions de Tressan sur les parchemins médiévaux. 2- DEUX SIECLES DE BOULEVERSEMENTS (XIIe-XIVe
SIECLES).
En apparence, les premiers textes évoquant le village ne nous apprennent pas grand chose de son histoire, sinon les noms des seigneurs se succédant à sa tête. L’information est de qualité et d’importance, bien sûr, mais au final bien maigre et peu satisfaisante pour qui veut connaître un peu mieux le cadre de vie des Tressanais au cœur du Moyen Age. Car, les trois faits majeurs de cette période furent le perchement du village sur son site actuel, son organisation « politique » et les défrichements à la lointaine origine du paysage que nous connaissons aujourd’hui.
Le perchement du village.
Il est assez simple d’arriver à dater de manière large à quelle époque Tressan s’est perché au sommet du coteau sur lequel il continue à s’étendre de nos jours. La manière de dénommer le village par les rédacteurs des parchemins médiévaux est en effet grandement révélatrice de son évolution « morphologique ». On sait déjà que le Livre Noir de Béziers situait des terres cultivées en 967 dans le terroir de la « Terenciano villa »49. Bien plus tard, en 1010, la même source, évoque une certaine « villa Terenciano »50. A la fin du Xe siècle, le mot villa a peut-être changé de sens et peut désigner un village et son terroir51. Jusqu’au XIe siècle, rien ne semble donc avoir changé depuis l’époque romaine, chose tout à fait classique dans le Biterrois et la vallée de l’Hérault où « les structures du monde rural seraient ainsi restées stables (…), avec, en particulier, un réseau d’habitat qui demeurait dispersé, en fermes isolées ou en hameaux lâches (…) »52. Les choses changent néanmoins radicalement dans la plaine de l’Hérault à partir du milieu du XIe siècle : la population, après une grave crise, croît fortement, tandis que se met en place la société féodale53. Tressan n’échappe bien sûr pas à de si profondes mutations et la dénomination du lieu évolue de manière décisive et définitive. Le terme de villa disparaît ainsi des documents à partir de 1113, laissant la place à la désignation plus générale et plus vague de « Trencianum » ou de « Trenciano » dès 114054. Qu’est donc Tressan dans la première moitié du XIIe siècle ? Peut-être encore une ferme, peut-être un véritable petit village : rien n’est certain. Il est donc fondamental de mettre en relation la disparition du mot villa dans les parchemins médiévaux avec les trouvailles archéologiques de surface de H. Leyris et S. Mauné sur le site des Faïsses55. Pour cet auteur en effet, en même temps que la villa
11
disparaît des Condamines, un habitat précaire se met en place sur le versant nord de la colline, puisque des restes céramiques du XIe siècle y ont été trouvés en nombre56. C’est une information capitale : avant de se percher au sommet du coteau, Trencianum a peut-être marqué une étape à mi-hauteur de la pente y menant, là d’ailleurs où aboutit ce qui fut jusqu’en 1854 le chemin reliant Tressan à la route de Gignac, l’ancêtre du Chemin Neuf. Notons toutefois, en 1202, l’apparition d’une orthographe nouvelle et durable du nom, celle de « Trenssanum »57, ou les deux « s » remplacent le « c » originel. L’orthographe actuelle du nom de lieu se met ainsi doucement en place.
Quatre des ides de mai 1264 : voilà enfin une date précise livrée par les textes58. Ce jour-là, Guillaume de Roquefeuil reçoit l’hommage et le serment de fidélité de l’un de ses vassaux, Raimond de Castries, « dominus castri de Tressano », seigneur du castrum de Tressan. L’acte en soi est commun, banal. Mais, l’habitat est désormais désigné comme un castrum. Nul doute alors : Tressan s’est juché au sommet du coteau qui dominait jadis la villa ; il s’est entouré d’une muraille faisant office, pour les maisons y étant adossées, de façade extérieure. A l’angle sud-est du mur du village se dresse le château du seigneur, vaste bâtisse tenant plus de la forte maison de maître que du château proprement dit. L’édifice est daté par les services de l’Inventaire du XIVe siècle ; il aurait longtemps compris les vestiges d’une vieille chapelle seigneuriale de facture médiévale59. Un plan cadastral de 1770 montre d’ailleurs fort bien le noyau originel du village, dont la muraille est percée de trois portes, à l’ouest, au sud et à l’est et ponctuée de quelques tours défensives. L’église, de plan original, très éloigné d’une croix, est intégrée au système défensif, son clocher servant de tour et garni de meurtrières simples. Elle est datée par l’Inventaire des XIIIe-XIVe siècles. Des traces du chemin de ronde, qui arpentait le haut des fortifications, sont d’ailleurs encore visibles dans les maisons de quelques particuliers de la place du Jeu de Ballon. Tous ces caractères originaux de Tressan, en grande partie toujours apparents dans les rues du village, s’enracinent donc dans la fondation du castrum. On peut ainsi, sans tenter le diable, en se fiant aux seuls textes, dater l’incastellamento de Tressan des années 1200-1250, c’est-à-dire au cours de la première moitié du XIIIe siècle. Peut-on être plus précis ?
On sait que les Guilhem, seigneurs de Montpellier, se sont étendus en faisant « reconnaître leur autorité aux châtellenies des environs de Montpellier (…) et de la moyenne vallée de l’Hérault de Popian et Aumelas à Paulhan et Saint-Pons de Mauchiens »60. Ce développement fut terminé, grossièrement, au début du XIIe siècle61. Il eut lieu aux dépens des comtes de Melgueil et grâce à l’appui des comtes de Barcelone, soucieux de freiner l’expansion des comtes de Toulouse, leurs rivaux en Languedoc62. La société est donc devenue pleinement féodale à cette époque et de nombreux châteaux furent alors bâtis dans la vicomté d’Aumelas. Peut-être un lien existe-t-il entre cette histoire féodale compliquée et le perchement de Tressan sur sa colline. Tressan faisait en effet partie de la vicomté d’Aumelas, elle-même inféodée à Guilhem VIII de Montpellier en 118763. Guilhem VIII acheta le lieu dix ans plus tard, en 1197, à Raymond de Castries, son châtelain du moment, puis le lui rendit en fief64. La transaction permet donc au seigneur de Montpellier d’acheter la fidélité de Raymond, déjà propriétaire d’un château « dans le lieu ». Peut-on imaginer que l’argent ainsi gagné par le seigneur de Tressan le pousse alors à la création du village perché et à encourager son peuplement ? Une telle initiative n’est pas impossible ni inconnue en Languedoc, même si elle n’est pas la norme. En effet, on l’a vu, « le Xe siècle (…) est marqué par des amorces de regroupements villageois auprès des églises » et de leurs cimetières65. La fondation d’un castrum à Tressan, plus tardive, a donc pu relever d’une décision seigneuriale, autour de l’an 1200 en tout cas, tant le destin de Tressan est alors lié à l’histoire politique régionale troublée de l’époque. Si, dans la naissance d’un castrum, « ce qui est (…) difficile à déterminer ce sont les
12
mécanismes qui ont présidé à une telle concentration. Pression seigneuriale ou plutôt volonté délibérée des paysans »66 ? la réponse pourrait donc sembler dans le cas de Tressan assez simple. Raymond de Castries, fidèle de Guilhem VIII de Montpellier, a probablement veillé à soutenir l’expansion de la seigneurie de son maître vers l’Hérault. La fondation d’un castrum allié dans une région-clé aurait donc eu son importance. Une telle hypothèse est très séduisante, mais aucun élément concret ni aucun témoignage d’époque ne vient cependant l’étayer. Il demeure donc nécessaire de s’en tenir au processus habituel de genèse d’un castrum : la spontanéité et le développement autour d’une église ou d’un château67.
Car le rôle des castra dans le peuplement des campagnes languedociennes est par ailleurs très important et date, de manière large, des XIIe et XIIIe siècles68. Outre le soutien de possibles desseins politiques, un castrum permet surtout de loger une population en pleine expansion tout en la protégeant des dangers extérieurs, par la présence de fortifications mais aussi d’une autorité seigneuriale69. Le cas de Tressan n’est d’ailleurs pas isolé et reste commun à la plupart des villages voisins, comme celui fort bien étudié de Saint-Pargoire70. Avec la transaction de 1197, il n’est peut-être pas farfelu de dater au plus tard le perchement de Tressan du début des années 1200. Aniane, Clermont ou Gignac, habitats déjà importants au début du Moyen Age, sont par exemple devenus des castra un peu plus tôt, au cours du XIIe siècle71. A la naissance du village actuel dans les années 1200 correspond, grosso modo, la mise en place d’un embryon de municipalité.
L’embryon d’une vie municipale. Un document de 1351 nous apprend en effet l’existence d’un « syndicus universitate
boni homines castri de Tressano », c’est-à-dire un « syndic de l’université des bons hommes du castrum de Tressan ». Cela signifie l’existence d’une organisation municipale assez récente, en tout cas jamais mentionnée auparavant, où les « bons hommes », probablement des chefs de famille, se réunissent régulièrement pour s’occuper de la gestion du village. Lors de ces très anachroniques « conseils municipaux », un représentant de la population, le fameux syndic, faisait office de « maire ». Bien que la situation soit ici extrêmement simplifiée, cela signifie la mise en place, au plus tard autour des années 1300, d’une forme de municipalité assez forte pour se gérer et relayer l’autorité seigneuriale, celle du « dominus castri de Tressano », « le seigneur du castrum de Tressan », alors issu de la famille De Castries. Mais, le syndicat est encore doté de pouvoirs réduits au XIVe siècle : il soutient encore peu la comparaison avec les consulats de l’époque moderne et l’autorité seigneuriale reste à cette époque très forte. Ajoutons qu’à l’échelle du Languedoc, la fondation du castrum de Tressan et la formation de sa « municipalité » demeurent toutes deux habituelles bien que tardives. En même temps et de façon strictement indissociable, le terroir connut une grande période d’expansion.
Un terroir remanié. La première moitié du XIIIe siècle fut en même temps décisive pour la genèse des
paysages actuels à Tressan et dans ses environs. Elle n’est hélas pas facile à connaître et seule l’étude des noms de lieux, la toponymie, apporte une secours précieux pour éclairer cette période. On a la chance de disposer de trois cadastres anciens pour recenser les noms des tènements constituant le territoire communal : le compoix de 159772, celui de 177073 et le cadastre « napoléonien » de 182674. Le dépouillement intégral et informatisé de ces trois registres livre une trentaine de toponymes. On se gardera bien de localiser le même lieu-dit en 1770 et en 1826, tant les tènements ont vu varier leur orthographe, leur localisation et leur superficie dans le demi-siècel considéré75. Si, en effet, les compoix de 1597 et de 1770 se servaient des noms de tènements pour localiser grossièrement les parcelles des
13
propriétaires, le cadastre de 1826 respecte des limites de lieux-dits strictement fixées aux chemins, aux fossés et aux ruisseaux76. Heureusement, des plans cadastraux accompagnent le dernier compoix et le premier cadastre du village. En reprenant le découpage de l’espace communal en trois zones différentes, la toponymie nous livre peut-être des informations d’importance sur la gestion médiévale de l’espace, à condition de se servir le plus possible des noms de lieux utilisés dans le document le plus ancien, en l’occurrence le compoix de 1597. Attention cependant : les passages suivants ne se servent pas de l’étude des toponymes pour affirmer ou démontrer la pratique de telle culture à tel endroit au Moyen Age, car les noms de tènement ne trouvent pas forcément leur origine à l’époque étudiée ici et –bien souvent- « révèlent les anomalies observées par les agriculteurs »77. L’utilisation de la la toponymie tressanaise a toutefois un grand intérêt. Elle illustre bien, en l’absence de texte, un propos fort connu depuis les travaux de M. Bourin sur le Biterrois : l’organisation des villages et des terroirs de la plaine languedocienne aux XIIe-XIVe siècles. Ainsi, la colline et ses pentes sont ponctuées de noms de tènements attestant d’une occupation traditionnelle du sol. Toute une série de noms souligne le caractère avantageux du coteau. Ainsi, le Mourre est la pointe ouest de la colline, en forme de museau, serrant au plus près le cours de l’Hérault. Les Badiaux et les Vistes, de part et d’autre du village, signalent des endroits privilégiés pour l’observation de la plaine environnante. A Fonrascasse, sous l’actuelle salle de la Distillerie, une petite source est bel et bien captée et les toponymes en Fon- (source, fontaine) ne manquent d’ailleurs pas en d’autres points du terroir, comme à Fontanilhes78. Les ressources en eau sont évidemment un enjeu de longue date sous les latitudes et le climat méditerranéens. D’autres noms viennent quant à eux trahir l’occupation habituelle du sol autour des murs de Tressan depuis le Moyen Age. Même si la localisation du lieu-dit ne veut pas obligatoirement dire grand chose et varie dans le temps et l’espace, certains noms demeurent éloquents. Pour être alors certain de ne pas interpréter comme d’origine médiévale un nom apparu des siècles plus tard, il est préférable, on l’a vu, d’utiliser les toponymes du compoix de 1597. Aux Verdies se tenaient peut-être des vergers d’arbres fruitiers, aux Vignals quelques vignes bien exposées au sud. Les Costes, en surplomb de la vallée de l’Hérault et les Travesses, tènement très pentu trahissent deux fois l’existence, sur les flancs du coteau, d’une agriculture en terrasses. Tous ces toponymes et leur localisation perpétuent donc peut-être vers 1600 le souvenir d’une gestion plus ancienne des abords de Tressan, une organisation d’ailleurs largement décrite et en tout point similaire pour le Biterrois des XIIe-XIVe siècles. Monique Bourin-Derruau dépeint en effet une organisation similaire du terroir dans les villages des environs de Béziers. En s’approchant du clocher, les noms de lieux indiquent ensuite des activités elles aussi très classiques : les Ayres et les Ayres Vielhes disent le dépiquage du blé, comme les Orts disent l’entretien de jardins potagers aux abords directs du village. L’étude de la toponymie tressanaise devient plus hasardeuse mais plus instructive encore entre les pieds du coteau et le Cami Ferrat de Gignac à Pézenas. Au nord du terroir, aucun nom ne permet de déceler des défrichements contemporains du perchement du village : la Rengue et les Faïsses indiquent des cultures se pratiquant par rangées, par raies ; depuis toujours, les meilleures terres du village ourlent le Plo de la Fon et ses abords, un tènement particulièrement plat sous la Fon, l’actuelle Fontaine Fraîche. Bien plus intéressants sont au nord le Camp de la Croux et Campredon, de part et d’autre du Cami Ferrat. Ces noms révèlent-ils pour autant la mise en culture de ces champs au cours du Moyen Age ? Leur étymologie perpétue-t-elle le souvenir du premier propriétaire ou de leur forme originelle ? Rien n’est moins sûr, mais les camps redouns (champs ronds) sont d’ailleurs légion sur la carte topographique au 1/25.000e de la région. D’autres noms de lieux, hélas tardifs dans les documents cadastraux (pas avant 1770), peuvent véhiculer la
14
mémoire de pratiques agricoles datant du Moyen Age. Ainsi, le Camp de Naude ne manque pas de troubler, car il peut perpétuer le souvenir altéré d’un camp nau, un champ nouveau. Surtout, le cadastre de 1826 livre et localise, entre les deux chemins de Gignac à Pézenas, l’ancien et le nouveau, trois tènements aux noms évocateurs : Fougairas, Peyregas et la Rompude. Fougairas signale sans doute un endroit couvert, avant sa mise en culture, de fougères79. Pour Peyregas en revanche, aucune hésitation, dans la traduction en tout cas : le lieu était envahi de pierres. Enfin, la Rompude, si le toponyme n’apparaît pas de façon imaginaire au XIXe siècle, serait alors un témoin incontestable de l’ouverture médiévale de ces espaces. Une rompude est en effet une novale et les novales étaient des « redevances typiques imposées aux terres nouvellement aménagées, [des] dîmes (…) que l’on levait sur les portions neuves du terroir »80.
Quant aux terrains à l’ouest du Cami Ferrat, coincés entre le chemin et l’Hérault, ils peuvent avoir été défrichés peu ou prou en même temps que fut fondé le castrum de Tressano. La fondation castrale fut, on le sait, éventuellement très progressive et spontanée, auquel cas les terres auraient été plutôt réorganisées que réellement défrichées. Du nord au sud, le marcheur laisse pourtant derrière lui, entre autres tènements, la Sauzarede, le Mas de Fraysse et Garrigues. Autant de noms voulant dire que ces lieux portaient peut-être une végétation caractéristique avant d’être mis en valeur : saules, frênes et chênes kermès. Sans doute les habitants de Tressan ont-ils entrepris au cours des XIIe et XIIIe siècles un défrichement, une reconquête ou un redistribution des espaces incultes de leur terroir, pour répondre à la poussée démographique du moment81. Le rôle du Cami Ferrat dans cette opération d’envergure et de longue haleine semble avoir été primordial : il a alors dû servir d’axe de défrichement pour ses abords et, surtout, en direction du fleuve. Une étude rapide du dessin général des parcelles autour de Dourbies et de Garrigues conforte une telle hypothèse. En examinant quelques extraits de deux plans fonciers de 1770 et 1779, certaines réalités se font jour. On s’aperçoit clairement que le parcellaire s’étire en d’étroites et longues lanières perpendiculaires au trajet du fleuve. L’intérêt d’un tel parcellaire est de limiter les dégâts causés par les crues chroniques et assez fréquentes de l’Hérault, forme d’adaptation assez connue aux contingences naturelles. Ce découpage « rayonnant » permet en effet un partage plus facile des nouvelles terres entre les défricheurs, point central de l’opération on peut l’imaginer, que l’on ait affaire à un vrai défrichement ou à une simple réorganisation des terres82. Ainsi, les ravages commis à une parcelle se limitent à une partie assez restreinte de celle-ci et lèsent moins l’ensemble des propriétaires du tènement. En effet, l’extrait du plan terrier de 1779 reproduit ici présente dans sa partie supérieure une « ille », c’est-à-dire un atterrissement de graviers et de limons dus à une très forte crue83. Il est même dans ce cas précis permis de dater la formation de cette île de 1776. En effet, elle n’apparaît pas dans le plan parcellaire accompagnant le compoix de 1770. Ensuite, lors de la rédaction du mémoire paru en 1777, les experts ayant arpenté le terroir de Tressan signalent la récente constitution de cette île suite à une crue exceptionnelle du cours d’eau survenue l’automne précédent84. Ces excès du fleuve sont une constante pour les villages riverains de l’Hérault. Le curé du village signalait ainsi en septembre 1624 « un delluge et debord d’Herault (…) ayant emporté le Moulin de Carabottes »85. Il n’est donc ni vain ni innocent, dans de telles circonstances, que les paysans aient cherché à se prémunir des effets dévastateurs des orages de l’automne dans la France méditerranéenne. Un tel parcellaire, aboutissant au fleuve, permet en outre aux propriétaires un accès plus équitable à l’eau, extrêmement précieuse pour irriguer les terres. Les témoignages ont le défaut d’être tardifs, mais le compoix de 1597 mentionne trois prés seulement, tous trois riverains du cours d’eau86. De la même façon, le compoix de 1770 mentionne encore un droit d’arrosage entre deux propriétaires d’un vivier en bordure de la rivière87. La forme des parcelles en
15
bordure d’Hérault est ainsi demeurée la même à Tressan en 1826 et, en poussant les investigations jusqu’à nos jours, le parcellaire, pourtant cent fois remodelé, reste aujourd’hui encore très laniéré autour de Garrigues et de Dourbies88. Là en tout cas, l’étude des toponymes et leur confrontation à des plans anciens donne enfin des résultats satisfaisants et ne se borne pas à « établir d’emblée des équivalences naïves avec les réalités qu’ils désignent »89.
Quant à la plaine de l’Estang, portée au compoix de 1597 comme mayre ou estaing, elle était déjà asséchée en 1264, comme le montre l’analyse de parchemins médiévaux actuellement menée par J.-L. Abbé et encore inédite. Le médiéviste y trouve d’ailleurs la mention d’un probable pont (pont des Tines ?), enjambant le rec d’évacuation des eaux, sans doute l’actuel fossé Mayral. L’opération d’assèchement de l’étang avait donc amené vers 1200 une trentaine d’hectares supplémentaires propres à être cultivés. Ce drainage participait en outre à l’effort global de mise ou de remise en culture intensive des terroirs languedociens pour répondre à la montée du peuplement90.
*
L’enracinement des Tressanais dans leur terroir remonte donc au Moyen Age. Une fois le castrum juché sur le coteau, entre 1200 et 1250, Tressan prit alors un visage très proche de celui d’aujourd’hui. Il suffit juste d’imaginer le village actuel contenu dans ses remparts médiévaux, sans bâtiments en ayant encore débordé. Intra muros, d’ailleurs, l’aspect des rues a sans doute bien peu évolué jusqu’à nos jours. Quant au terroir, délimité précisément depuis le XIIIe siècle, il a connu au cours des années 1200, peut-être même un peu avant, une forte extension. L’agriculture, diversifiée aux abords du castrum, était certainement, dans les espaces nouvellement défrichés, très largement consacrée aux céréales. Encore une fois, il est regrettable de ne pas disposer, dans la documentation nous étant parvenue, de textes plus ou moins descriptifs de Tressan au Moyen Age. On peut toutefois se réjouir, malgré de telles lacunes, d’arriver à reconstruire un peu du passé médiéval du village. On aura noté, évidemment, qu’il est encore très peu question de la vigne à Tressan, faute à des documents trop allusifs. C’est alors probablement une culture traditionnelle, mais elle n’est pas forcément limitée au tènement actuel des Vignaux, tout comme il n’est pas obligatoire de l’imaginer totalement submergée par le flot vital des emblavures91. M. Bourin pense d’ailleurs dans sa thèse qu’un tiers des cultures du Bas-Languedoc est consacré à la vigne aux XIIe-XIVe siècles. Toutefois, le silence des textes interdit encore d’appliquer une telle estimation à Tressan.
*
Par rapport aux décennies précédentes, on connaît bien peu de choses du Tressan des XVe et XVIe siècles, faute à une documentation redevenant extrêmement rare et très lacunaire. Rappelons seulement l’arrivée de la peste noire en Languedoc à l’été 1348, suivie d’un large siècle de malheurs pour la province : épisodes pesteux, bien sûr, mais aussi ravages de la guerre de Cent Ans et des bandes de brigands mettant à sac la région92. Le village fut sans doute emporté dans la tourmente générale qui balaya le royaume jusqu’en 1450 environ93. Après cette date, une période de renouveau touche enfin le Languedoc : elle est en général marquée par une très forte augmentation de la population, qui récupère alors le déficit accumulé durant quatre générations94. Pour Emmanuel Le Roy Ladurie, les Languedociens redeviennent aussi nombreux que « des souris dans une grange »95. Seules les guerres de Religion entre catholiques et protestants malmènent ce regain de vie des années 1560 aux années 1590.
16
Bien qu’il soit hautement probable que l’histoire de Tressan fut alors calquée sur celle du Languedoc, rien ne permet donc d’illustrer les deux siècles presque inconnus alors traversés. Seul un compoix de 1597 permet enfin de rompre un tel silence documentaire et de renouer le fil de l’histoire villageoise.
17
Chapitre II.
1597-1770 : UN VILLAGE TRADITIONNEL DU VAL D’HÉRAULT
DANS LA TOURMENTE ?
Des années 1600 aux années 1750, les documents d’époque se multiplient certes, mais pas dans des proportions avantageuses pour l’historien : pas de compoix entre 1597 et 1770, quelques lignes décrivant très indirectement le village et son terroir entre les deux... La démographie, en revanche, peut être désormais sérieusement abordée avec, depuis le dernier trimestre de 1606, la conservation régulière des registres paroissiaux.
Revenons au premier compoix96 conservé de la communauté qui date probablement de 1597. Il permet de dresser un état du village et du terroir à l’extrême fin du XVIe siècle, voici donc plus de quatre siècles. Mais l’analyse détaillée de ce document exceptionnel soulève une interrogation malheureuse : le XVIIe siècle et la première moitié du XVIIIe siècle ne furent-ils pas pour Tressan un siècle et demi particulièrement douloureux ? Cela correspondrait en effet aux tendances de l’économie et de la démographie languedociennes mais aussi au silence des sources. Leur rareté comporte alors un risque à ne pas négliger : celui de noircir le tableau plus que de raison.
18
I) LE VILLAGE VERS 1600 : UN VILLAGE APPAREMMENT IMMOBILE…
Le village est enfin bien connu grâce à deux documents différents et complémentaires : le compoix de 1597 et le procès-verbal de la visite pastorale de 1605. Le compoix est l’ancêtre des cadastres contemporains. S’il est moins exact que nos matrices dans la localisation des parcelles et la mesure de leurs superficies, il est en revanche précis et précieux dans la description des biens alors encadastrés. Quant à la visite pastorale de 1605, il s’agit du compte-rendu de la visite de l’évêque de Béziers Jean de Bonsi à Tressan, paroisse de son diocèse.
Par vieille habitude et non par conviction, commençons par brosser à grands traits un tableau rapide de Tressan en 1597 au moyen de son seul compoix, afin de prendre contact avec le cadre de vie dans lequel évoluaient les villageois d’alors.
1-UN VILLAGE OUVERT SUR LE VAL D’HERAULT.
Le vieux registre foncier n’a pas vocation à dresser un état des chemins du terroir97 mais, grâce aux confronts*, ceux-çi sont assez bien connus : ainsi, le champ, olivette et herme* de Guilhaumes Blanc à Gaupeirous, confronte « de narbonnes le camy de Puechlache de terral le Camy Ferrat », c’est-à-dire à l’est le chemin de Puilacher et au nord le « Chemin Ferré »98. Une fois ces chemins rigoureusement recensés, il est possible d’en dresser la liste et d’en dessiner la carte. Le village lui-même, « dans les meurs », est parcouru de « rues publicques » et de « carrieres* » : il n’est pas nécessaire d’en donner le détail, mais juste de souligner qu’elles n’ont aucun nom, à la différence notable des villes. Dans les Barris, la situation est un peu différente, car les rues sont en réalité le départ des chemins reliant Tressan à son terroir. Du village partent vers l’est lou camy de Montpellier ou vye* del Pioch, vers l’ouest la vye del Badial et lou camy de Fontanilhes, lui-même prolongé par lou camy de la Barque de Garrigues. Vers le nord lou camy de Canredon relie au Camy Ferrat de Gignac à Pézenas… Manque, en direction du sud-est, lou camy de Puechlache, mais cela tient au hasard des confronts conservés dans le compoix, puisqu’un certain nombre de pages ont disparu. Tressan est donc relié à son terroir par un réseau de chemins en étoile. Au-delà de l’auréole bâtie, le nombre des chemins se multiplie de façon remarquable. Nous sommes dans la plaine languedocienne et aucune partie du terroir n’est isolée du village. Si l’on ajoute à cette ouverture de l’espace la petitesse du territoire « communal » (moins de 400 hectares), le réseau vicinal apparaît très dense. Ainsi, les chemins nommément désignés, 26 en tout, sont encore relayés, dans le compoix de 1597, par une foule de vyes et de carrieres, c’est-à-dire des voies d’accès à des parcelles et des chemins un peu mieux aménagés. La liaison village-terroir est à ce point bien assurée que les parcelles traversées par un chemin ne sont pas rares : sept en tout sont mentionnées. C’est le cas d’un petit champ d’Amans Pourtal aux Vignaulx, refendu par une « carriere al miech », un chemin au milieu99. Si le terroir semble bien irrigué par le réseau vicinal, cela ne fait pas obligatoirement de Tressan un village ouvert sur l’extérieur. La connexion de l’habitat à sa région est une question fondamentale dans l’étude des sociétés anciennes et de leur mode de vie. C’est un facteur explicatif puissant pour comprendre l’économie d’un village et sa sociabilité. En 1629-1632 par exemple, la mort frappe durement et durablement quelques villages du Lodévois, pauvres et isolés « dans la zone peu fertile des garrigues et des avants-monts »100. Cela, ajouté à la nature très originale et contraignante des sols, induit une agriculture très différente de celle pratiquée vers 1600 dans la vallée de l’Hérault, comme l’a montré S. Olivier pour le terroir de ruffes de Salasc101. Qu’en est-il de Tressan au même moment ?
19
Vers 1597, le village est directement rattaché à un important et très ancien axe de communication entre le nord et le sud : le Camy Ferrat, le chemin ferré reliant Pézenas au sud à Gignac au nord. Ce dernier fut décisif, on l’a vu, pour l’installation de la villa au cours de l’Antiquité102, ainsi que pour mener à bien les opérations médiévales de défrichement103. Le chemin garde son caractère irremplaçable vers 1600, dans la mesure où il traverse le terroir sur quatre kilomètres du nord au sud : nombre de voies villageoises de circulation y aboutissent ou en partent. Elles relient Tressan aux échanges économiques régionaux, mais aussi à tout un monde de colportages nous échappant désormais. Si à cette époque le val d’Hérault et le village se sont tournés au moins en partie vers la Réforme, ils le doivent aux idées neuves courant elles aussi sur de tels chemins104. Le Camy Ferrat apparaît évidemment comme le vecteur majeur ouvrant alors Tressan sur l’extérieur. Mais il n’est pas le seul. Vers l’est, Tressan est relié au Camy Salinié par lou camy de Montpellier. La route du sel ne passe pas dans le terroir, mais dans celui du Pouget : elle noue les abords des étangs de Bagnas et de Thau au Lodévois et au Larzac105. Du Camy Salinié, Montpellier peut en effet être rejointe en franchissant les collines couvertes de garrigue à l’ouest de la grande ville. Quant à l’Hérault, il ne constitue pas un obstacle infranchissable en soi, hors périodes de crues évidemment. Un bac permet de traverser le fleuve à hauteur de Garrigues : il existe dès avant 1600, puisqu’un camy de la Barque de Garrigues court, d’après le compoix, à travers le terroir et aboutit toujours à une pensière, reconstruite plusieurs fois. L’enrochement de celle-ci demeure en partie visible des deux côtés de l’Hérault, cinquante mètres en aval de la retenue actuelle. Le bac se tenait en amont de la pensière : le voyageur pouvait ansi traverser le fleuve puis, côté Aspiran, longer la maison du passeur et déboucher alors sur la route menant à Clermont-l’Hérault. Au nord de Tressan, un autre bac permettait de traverser le cours d’eau à hauteur de Canet ; au sud, les bacs de Bélarga et de Roquemengarde reliaient la rive gauche à la rive droite en direction de Paulhan. Toute la moyenne vallée de l’Hérault était ainsi ponctuée de bacs, dont l’activité a cessé bien tardivement, sous la concurrence sévère de nouveaux venus : les ponts. Vers 1597, grâce au compoix, Tressan et son terroir apparaissent donc ouverts sur le monde extérieur par un enracinement solide au val d’Hérault.
2-UN VILLAGE QUI VIENT DE S’AGRANDIR.
Dans tout le Languedoc, la population a très fortement augmenté entre 1450 et 1550 environ, mais aucun document d’époque n’en atteste hélas pour Tressan. Le compoix de 1597 décrit heureusement les parcelles avec une précision redoutable, à la différence des cadastres d’aujourd’hui. Prenons un exemple : Mathieu Razes possède une « maison partide a troys estages et partide a quatre dans les meurs » de plus de 200 m². Mieux, Gabriel Razes détient au Plo de la Fon un « hort* dans lequel a ung noguier* », c’est-à-dire un jardin de quatres dextres (60 m²) dans lequel il y a un noyer. Comme les noyers étaient assez rares sous nos latitudes, leur présence était signalée dans les vieux cadastres, comme c’est aussi le cas à Salasc en 1601106. Grâce à l’analyse approfondie du compoix de 1597 et à la traduction des termes occitans en français, on peut alors connaître Tressan voici quatre siècles avec de nombreux détails. Vers 1600, le village est composé d’un cœur médiéval entouré de remparts contenant au moins 89 parcelles et couvrant un peu plus de 5000 m². C’est la partie de Tressan dite « dans les meurs ». Les propriétaires portés au compoix sont en outre classés dans le registre en fonction de leur lieu de résidence, Tressanais en tête, eux-mêmes divisés entre résidents du « lieu » (village médiéval) et résidents des « Barris » (autour du village médiéval). C’est la plus vieille mention pour l’instant connue des Barris : cela prouve que Tressan s’est agrandi depuis la fondation du castrum… Les Barris se divisaient justement, avant 1600 déjà, en deux parties. A l’est des remparts se trouvaient les Ayres, où
20
se mélangeaient sur plus de deux hectares des dizaines de maisons, de jardins, de creux à fumier, d’aires à battre le blé. Les Ayres se situent de part et d’autre des actuelles descentes de la Fontaine Fraîche (camy del Lavadou) et de la Calade (camy de Puechlache). A l’ouest de la place du Maître Jean (Pourtal de la Fon) se trouvaient les Ayres Vielhes, de moins d’un hectare, avec déjà beaucoup moins de maisons et de parcelles associées. Ces Ayres Vielhes étaient contenues entre les actuels chemins de Fontanilles et des Badiaux. Les deux toponymes comparés, Ayres et Ayres Vielhes, constituent un second argument pour attester de l’agrandissement du village, lui-même dû à une augmentation locale de la population au cours des années 1450-1550, comme dans le reste du Languedoc. Pour compléter ce tableau très rapide du village, on peut ajouter que les Tressanais disposaient déjà de l’actuelle Place du Jeu de Ballon, appelée en toute simplicité la Place. Ils pouvaient aussi guetter la circulation du Camy Ferrat de Gignac à Pézenas depuis lou Badial, l’endroit d’où l’on observait sans doute très sérieusement l’irruption de toute menace possible et imaginable.
A la fin du XVIe siècle, Tressan présente donc toutes les caractéristiques des villages tassés traditionnels de la plaine languedocienne, qu’ils soient perchés ou non sur les pentes ou le sommet d’une colline. Avec 110 maisons au moins et vraisemblablement à peu près autant de familles, le village abritait grosso modo, vers 1600, entre 400 et 500 habitants, ce qui constitue une estimation grossière et imparfaite, mais reste un odre de grandeur sans doute acceptable à défaut de vraie statistique.
3-UN VILLAGE URBANISE AUX CARACTERES AGRESTES.
Même si quinze folios du compoix de 1597 ont disparu, les bâtisses se concentrent immédiatement dans l’espace villageois. Sur 166 bâtiments de toute nature, cinq se trouvent excentrés dans le terroir. Deux pôles d’habitat agglomèrent 97 % des maisons, des mas et des cazals de Tressan : le village « dans les meurs » et les Barris, composés de trois minuscules tènements : lou Pourtal de la Fon, las Ayres et las Ayres Vielhes. Le plus ancien plan de Tressan date de 1770 : il matérialise les fameuses « murailhes de la ville », dont le tracé n’a sans doute pas ou très peu varié de la fin du XVIe à la fin du XVIIIe siècle. En utilisant les confronts des parcelles du compoix de 1597, il est assez simple de replacer au bon endroit les trois tènements prenant le Tressan intra muros en écharpe, comme signalé voici quelques pages. L’aspect si caractéristique de ces unités est proverbial : rues étroites, impasses, façades s’élevant fréquemment à trois étages et autres caractères donnent au village de Languedoc un aspect « urbanisé » très marqué107. En s’éloignant à peine des remparts, tous ces villages affichent cependant un caractère bien plus agreste et Tressan, une fois encore, n’échappe pas à la règle.
nature nombre m² % m² 1 – « dans les Meurs »
maison 85 5820 99 cazal 4 65 1 Total 89 5885 100
2 – « als Barris » maison 25 1074 3,4 mas 22 1054 3,3 cazal 45 1445 4,6 galinye* 1 4 0,1 patu 14 802 2,5 ayre* 45 7787 24,8 femouras* 35 1112 3,5 hort 35 2816 9,0 ferrajeal* 6 896 2,9 amellarede* 2 563 1,8 camp 12 5297 16,8 houlivette 6 7024 22,3 vigne 1 720 2,3
21
herm 3 845 2,7 Total 252 31439 100,0
Village 341 37324 100
Tableau n° 1 – Le village et ses abords : l’occupation du sol vers 1597. Vers 1597, il existe donc dans le même villages deux quartiers très différents. L’intérieur des murs est bel et bien exclusivement réservé à l’habitat, les quatre cazals étant en outre d’anciennes maisons ruinées108. Dans ce village-là, pas de mas, donc pas de bâtiment à vocation agricole : c’est en général le cas de l’intra muros, qui rejette à l’extérieur des remparts les hangars, les bergeries, les étables et autres bâtisses rurales. L’hygiène n’est pas en cause pour autant et ce rejet s’explique par le manque d’espace à l’intérieur des remparts. « Dans les meurs », on dispose en effet d’à peine plus d’un demi-hectare et les parcelles sont déjà minuscules, 66 m² en moyenne. Il n’est sans doute pas question de laisser alors un creux à fumier, un jardin ou une aire à dépiquer dévorer de la place pour rien ou bien peu. Hors les murs, un second quartier se dessine donc sous des traits nettement différents. Une foule de parcelles (252) couvre un espace un peu plus dilaté (3,14 ha), où chaque bien s’étend en général sur 126 m², soit à peu près le double d’une parcelle moyenne « dans les meurs ». Le quartier des Barris ne se développe pas au sud du village pour une bonne raison : on y trouve la terrasse du château du seigneur, large promenade disparue exposée au soleil et surplombant le verger de « monsieur »109.
Aux Barris, l’habitat occupe une place somme toute limitée, puisque 25 maisons seulement (10 % des parcelles) occupent à peine 1074 m² (3,4 % de l’espace) et sont en moyenne minuscules (43 m²). Bien sûr, les 45 cazals, du temps où ils étaient encore de vraies maisons, augmentaient ici la proportion de l’habitat. De toute façon, les bâtisses occupent à peine plus de 11 % de l’auréole formée par les Barris. Hors les murs, Tressan offre ainsi un visage puissament agreste avec, au milieu des 92 bâtisses encore debout ou à terre, un enchevêtrement d’aires à dépiquer le blé, de creux à fumier et de jardins potagers. Un tel imbroglio se justifie pourtant. Le blé est battu non pas aux champs, mais près du village et le seul chiffre de 45 aires montre à quel point la population s’adonnait à la culture des céréales110. Les 35 jardins sont évidemment proches du village, où tout un réseau de puits permet de les arroser sans grande peine. La seule présence des potagers éclaire sur le nombre curieusement identique de 35 creux à fumier, au produit précieux pour engraisser les plates-bandes de ces jardins, mais aussi quelques ferrajeals. Femouras et ferrajeals posent d’ailleurs le problème de l’élevage à Tressan vers 1597, sans doute très limité, puisque nous en avons seulement des traces très indirectes. Mais, pour une raison inconnue, les bâtiments où les bêtes étaient parquées n’ont pas été encadastrés comme tels dans le compoix. Sans doute sont-ils inclus dans les mas du compoix, sans avoir fait pour autant l’objet d’un enregistrement particulier. Par ailleurs, l’intrication des maisons et autres bâtisses avec des parcelles agricoles est totale dans les Barris, où s’ajoutent des vergers d’amandiers et d’oliviers, des vignes et des champs. Ces Barris forment donc un quartier particulier qui joue le rôle d’espace de transition entre le village lui-même et le reste du terroir, espace forcément très encombré :
11,4 % de l’espace est occupé par l’habitat ;
15,4 % par des parcelles arrosées ;
24,8 % par les aires à battre le blé ;
43,2 % par des cultures à part entière ;
5,2 % par des terrains encore libres (patus* et hermes). L’exiguïté du village dans les murs contraint visiblement celui hors les murs à se
charger de fonctions agricoles. Au final, les deux quartiers sont complémentaires : l’un est consacré à l’habitat et l’autre est beaucoup plus agreste. Cette organisation concentrique de l’espace villageois est traditionnelle en Bas-Languedoc, tout comme l’intrusion des cultures
22
au milieu de bâtiments plus espacés s’intensifie en s’éloignant des murailles du lieu. Les Barris présentent donc une grande homogénéité : c’est un espace pour loger et pour nourrir. La structuration somme toute banale de Tressan en fait-elle pour autant un village immobile, replié sur lui-même et vivant hors du temps et de ses soubresauts ?
23
II-LES STIGMATES DES GUERRES DE RELIGION.
Avec la diffusion de la Réforme et du protestantisme, le Languedoc connaît, comme le reste de la France, les temps douloureux des guerres de Religion. L’actuel département et la vallée de l’Hérault n’ont bien sûr pas échappé à de tels troubles. Le protestantisme s’installe et « va jusqu’à Uzès, Montpellier, Pézenas » au cours des années 1550-1560111. Parmi les représentants envoyés au colloque protestant de Montpellier du 12 novembre 1561, certains viennent de Clermont, Gignac, Montagnac et Pézenas112. Tressan, au centre de cet ensemble, a certainement été touché par la Réforme113, mais aussi par les combats entre catholiques et protestants qui firent rage, particulièrement entre l’automne 1572 et décembre 1595114. La paroisse de Tressan relevait du diocèse de Béziers et son évêque, Jean de Bonsi, fut très dynamique pour reconstruire le tissu religieux de son évêché entre 1598 et 1621, immédiatement au lendemain d’une trentaine d’années de guerre. Il effectue donc pour cela la visite pastorale de toutes les paroisses de son diocèse.
1-DES RAPPORTS TENDUS ENTRE LE CURE ET SES PAROISSIENS115.
Le compoix de 1597, bien que légèrement fragmentaire, prend une dimension nouvelle dans l’écho que lui renvoie à quelques années de là le procès-verbal de la visite pastorale de Jean de Bonsi. L’évêque de Béziers et ses hommes sont à Tressan le 9 septembre 1605, ils s’installent au château et travaillent en deux temps. Ils interrogent d’abord cinq habitants de Tressan sur la vie religieuse du village : les deux consuls Jean Razes et Pierre Forestier, le baille du seigneur Jacques Cabassut, ainsi que deux autres habitants plus âgés, Jean Navas et Claude Jouvet. Le prélat pose ensuite à peu près les mêmes questions à Estienne Tansson, jeune prêtre et prieur de Tressan, « aagé de trente trois ans ». Les réponses des deux parties sont parfois contradictoires, mais riches de renseignements concrets sur la vie du village au début du XVIIe siècle.
Le souvenir des guerres de Religion. En 1605, le jeune prêtre Estienne Tansson semble vivre à Tressan dans une
ambiance difficile. La vie religieuse de sa paroisse, de ses paroissiens et la sienne apparaissent tout d’abord intimement mêlées et sont l’objet d’enjeux encore passionnés. Estienne Tansson vit avec 90 livres par an, dont quatre écus de rente seulement (soit 12 livres), information de notoriété publique, dans la mesure où son « salaire » est dévoilé par les cinq habitants interrogés par Jean de Bonsi. Décidément près de leurs sous, nos cinq habitants savent parfaitement que le curé du village doit à son évêque une pension annuelle de dix-neuf setiers moitié blé et moitié orge, renseignement confirmé par le prêtre. Le service des messes, une le dimanche et une par fête, ne convient pas vraiment aux habitants. Le curé reconnaît bien effectuer le service hebdomadaire indiqué, mais aussi célèbrer des messes les lundi, mercredi et vendredi « sans touteffois y estre obligé ». Entre des paroissiens sans doute soucieux de se montrer bons fidèles auprès de l’évêque et un prêtre désireux de signifier à son prélat qu’il est un curé sérieux, on sent bien émerger une tension. Un passage de l’interrogatoire de Tansson souligne en effet les temps encore proches d’une situation de crise religieuse ouverte, peut-être en partie provoquée par l’indigence du ou des prédécesseurs du prêtre questionné. Tansson signale ainsi « que pour certaines années ung certain prieur ayant arrenté led(it) prieuré ne voulant faire le service actuel print un prieur p(our) le f(air)e, ce qui ne doibt estre tiré en conséquence ». Si le nom du prédécesseur incriminé est habilement tenu secret, il semble qu’au moment des guerres de Religion ou juste avant, un curé ne souhaitait pas assurer lui-même ses fonctions : il aurait même loué les biens de l’église, puis engagé un autre prêtre pour officier à sa place. Si tel
24
fut en effet le cas, ce curé-là avait seulement une fonction honorifique et on peut légitimement s’inquiéter de la qualité des services effectués par son remplaçant. De telles pratiques n’étaient pas rares parmi le clergé languedocien du XVIe siècle et constituèrent un terreau très favorable au mécontentement des fidèles, puis à la diffusion rapide du protestantisme116. Le curé, vraisemblablement par le dire de quelques-unes de ses ouailles, témoigne d’une situation de laisser-aller religieux à Tressan bien avant le début du XVIIe siècle.
Des reproches mutuels. La population du lieu n’est pas non plus exempte de tout reproche quant à sa
moralité religieuse. L’exemple du corratage en porte l’écho : le corratage ou droit de mesurage était un droit se prélevant sur toutes ou partie des marchandises vendues dans le ressort d’une seigneurie117. Les cinq témoins laïques signalent à Jean de Bonsi que le corratage de Tressan appartient aux habitants et ne sert pas à payer l’huile utilisée pour faire brûler jour et nuit la lampe du Saint-Sacrement dans l’église, « assez est des émolumentz de la ville ». Tansson, apparemment scandalisé, donne une version des faits complètement différente : « la maison et ancestres du seigneur du lieu donnèrent ancienem(ment) le corratage p(ou)r la fabrique de l’eglise et p(ou)r tenir l’huyle* à la lampe qu’ardoit devant le S(ain)t Sacrem(ent) mais les consulz puis ces guerres le se sont appropriés & employé aux émoluments de l’université ». Ici, une fraction du corratage semble bien avoir été détournée de sa pieuse destination au profit exclusif des caisses de l’hôtel de ville avant ou pendant les guerres de Religion. L’enquête sur les biens et droits des communautés de Languedoc donne d’ailleurs raison au curé en 1687, puisque la « municipalité » reconnaît alors détenir « le couratage quelle afferme tous les ans avec led(it) four au proffit de la communautté sur le prix de laquelle afferme les fermier, payent tous les ans trois mesures dhuille pour la lampe de l’esglise quy brûle devant le Saint Sacremant jour et nuict »118. Cette information tardive rétablit l’Eglise dans son bon droit et confirme les troubles religieux passés. D’autres indices abondent d’ailleurs dans le même sens. Le curé et les témoins laïques signalent bien « qu’il y avoit une confrairie du corps de Dieu à p(rése)nt abolie (…) & de ce y a tesmoings en vie », c’est-à-dire une assemblée dévôte et charitable119, mais le relâchement du sentiment religieux ou la poussée de la Réforme en sont venus à bout depuis peu. Cela n’est pas étonnant à une époque où « les témoignages collectifs de piété ont tendance à disparaître »120. Quant à la chapelle Saint-Etienne-de-Gaupeirous, plus aucune messe n’y est célébrée et un certain Jean Darmoye « en est possesseur », possession certainement illégale et usurpée d’un bien d’Eglise. En 1605, Tressan baigne donc dans une atmosphère religieuse tendue, au lendemain des guerres civiles. Les paroissiens reprochent peu de choses à leur curé, si ce n’est, à leur goût, le nombre insuffisant de messes auxquelles ils peuvent communier. Tansson, somme toute, leur convient plutôt, même s’il est « vray qu’il est ung peu addoné aux jeux ». Le curé a la dent plus dure envers ses fidèles. Il leur reproche, globalement, d’avoir profité des moments difficiles de l’Eglise catholique au temps de la Réforme et des troubles pour s’inscrire dans un rapport de force avec lui. Celui-ci signale d’ailleurs à son évêque l’existence d’« environ dix ou douze maisons d’Eretiques » soit entre quarante et cinquante protestants installés au village121. Estienne Tansson n’est ni aveugle ni dupe : il est alors aux prises avec une forte minorité huguenote et une majorité catholique pas vraiment fâchée d’une telle situation. En 1605, le prêtre a encore du mal à faire reconnaître les droits et les biens de son église paroissiale ; il en est de même dans un autre domaine sensible : la question de la dîme.
La polémique n’est pas loin lorsque l’évêque aborde ce sujet. Les villageois et le prêtre répondent au prélat : la dîme prélève le onzième des fruits poussant dans la paroisse de Tressan, c’est-à-dire « de touts grains (…) le vin a l’onz(ieme), l’huyle de mesme ». S’il existe
25
une dîme portant sur les autres produits du terroir et sur les animaux, elle n’est pas mentionnée. Tansson modère toutefois les propos des autres témoins, qui « disent quils diment a l’unzieme, si est ce qu’ilz doibvent dimer au dix(ieme) ». Ce point est anecdotique, car les dîmes au dixième sont rares et ont un taux souvent plus faible122. Le curé fait sans doute preuve de plus de sincérité et d’objectivité quant à la manière de prélever l’impôt dont il fait l’objet, car « on le constraint dimer aux aires bien que les au(tre)s prenants fruitz décimaulx diment en gerbe ». Si tel est à nouveau le cas, les propriétaires se sont octroyé l’avantage de payer certes leur part de céréales, mais en grugeant la paille correspondante, qui devait aussi revenir entre les mains du curé. Heureusement, tous les personnages interrogés restent absolument d’accord sur un point. Le montant de la dîme est partagé, sans détail des proportions, entre cinq bénéficiares : les prieurs de Tressan, de la chapelle Saint-Estienne-de-Gaupeirous, de Sainte-Eulalie (sur le terroir voisin du Pouget), de Puilacher et de la chapelle Notre-Dame-de-Rouvièges (au terroir de Puilacher).
Un document de 1792 nous apprend que le prieur de Tressan bénéficiait du tiers de la dîme prélevée dans tout le terroir123. Dans ce cas, les quatre autres bénéficiaires se partageaient déjà en 1605 les deux tiers restants. La perception de la dîme par Tansson pose de toute façon problème. Les travaux d’Emmanuel Le Roy Ladurie ont depuis longtemps apporté la preuve d’une intime concordance entre progrès de la Réforme et grève des décimables124. Pour l’historien, la période 1550-1600 correspond même en Languedoc à un véritable « effondrement décimal », qui pousse parfois les ecclésiastiques à aliéner leurs biens125.
2-UN VILLAGE D’EVIDENCE SACCAGE.
Les tensions ressurgies entre le curé Tansson et ses paroissiens sont une chose, mais leurs causes en sont une autre. Le procès-verbal de la visite pastorale de septembre 1605 nous apprend surtout que les guerres de Religion ont bel et bien frappé Tressan, dans l’esprit des gens sans doute, mais aussi dans leurs biens.
Des bâtiments religieux malmenés. En ce début du XVIIe siècle en effet, Estienne Tansson célèbre la messe dans une
église Saint-Geniès, où l’autel « se voit & est fort mal commode p(ou)r n’estre couvert qu’a demy et encores les habitants p(re)tendent icelle [église] estre maison commune ». Jean de Bonsi s’étonne par ailleurs auprès des témoins laïques : « qui a ruiné leur eglise ? », « qui a emporté les joyaulx & ornem(en)ts qu’estoient en icelle, et la pierre des murailles ? » Pour les cinq villageois, ce sont « les gents de guerre ». Il existe donc de grandes chances d’attribuer la dévastation de l’église Saint-Geniès non pas à des militaires exclusivement, mais à des protestants peut-être armés. D’autant plus qu’au même moment la chapelle Saint-Estienne-de-Gaupeirous est décrite comme « couverte & descouverte & une partie des murs tombée ». Par ailleurs, Tansson « est constraint loger une maison qu’il loüe pour estre la maison claustralle abbattüe ». Les biens ravagés au moment des troubles sont ciblés : église, chapelle rurale, maison du curé, soit autant de biens catholiques et autant de signes de probables exactions de bandes huguenotes. De tels dégâts et traitements de faveur réservés par de petites troupes protestantes armées aux bâtiments et aux notables catholiques furent monnaie courante durant les guerres de Religion dans tout le Languedoc126. Des épisodes tristement célèbres sont connus : les sacs des cathédrales Saint-Nazaire de Béziers et Saint-Pierre de Montpellier en 1561 et 1562 ; la profanation épouvantable du cadavre de saint Fulcran à Lodève en 1573127. Mireille Laget signale, hors Montpellier, que « dans les (…) régions dominées par les calvinistes, les églises catholiques ont été matériellement détruites à 100 % »128. Les bâtiments catholiques de Tressan mis à sac et à terre furent-ils les seuls touchés ?
26
Un village probablement assailli. La visite épiscopale atteint ici les limites des réponses aux questions qu’elle soulève.
Le compoix de 1597, semble néanmoins confirmer les ravages traversés par Tressan pendant cette véritable guerre civile. Comme il a été réalisé quelques années avant la venue de Jean de Bonsi, il permet de compléter le tableau du village au sortir des guerres.
Nature du bâtiment Nombre %
bastimant 1 0,6 cazal 44 26,5 maison 110 66,3 maison et cazal 2 1,2 mas 9 5,4 Total 166 100,0
Tableau n° 2 – Cazals, mas et maisons d’après le compoix de 1597 : des traces des guerres de Religion ?
En 1597, Tressan compte donc 166 bâtiments. Si les maisons ne posent pas problèmes ni même les mas quant à leur utilisation, ce n’est pas le cas de cazals. On trouve des cazals dans tous les compoix : ce sont en général des bâtiments ruinés. Comme il a plusieurs sens, le mot fait d’ordinaire débat auprès des spécialistes, mais la fréquence de son emploi pose ici problème, puisque le registre utilisé, bien qu’incomplet, en dénombre déjà 44, soit plus du quart des bâtiments du village. C’est une proportion inhabituelle. Il est alors tentant de relier ce phénomène aux séquelles des guerres de Religion. L’arpenteur et les experts ayant confectionné le compoix ont décrit les parcelles avec précision, on le sait. Le nombre élevé de cazals n’est donc pas une erreur de leur part. En outre, un cazal est imposable à 0,8 denier la canne (3,95 m²) contre 2,1 deniers la canne pour une maison : c’est deux fois et demi moins. Cela ne laisse presque plus de place au doute : un cazal n’a plus grand chose d’une maison, peut-être quelques pans de murs. Les cazals de notre compoix sont sans doute, pour la plupart, des bâtiments ruinés ou fortement endommagés lors des guerres de Religion des années 1560-1590. Bien que Sylvain Olivier reste prudent dans sa définition du mot, l’exemple de Salasc révèle des proportions identiques à celles relevées à Tressan : en 1601, sur 142 bâtiments, 46 sont des cazals (32 %) et sept des parts de cazal (5 %)129. A Tressan, la localisation de ces bâtisses malmenées est d’ailleurs tout à fait éloquente.
1 – Le village : « dans les meurs ».
Nature du bâtiment Nombre % cazal 4 4,5 maison 85 95,5 Total 89 100,0
2 – Les Barris : « las Ayres », « las Ayres Vielhes », « al pourtal de la Fon ».
Nature du bâtiment Nombre % cazal 38 54,3 maison et cazal 2 2,9 maison 23 32,8 mas 7 10,0 Total 70 100,0
3 – Le reste du terroir.
Nature du bâtiment Nombre % bastimant 1 20,0 cazal 2 40,0 mas 2 40,0 Total 5 100,0
Tableau n° 3 – Localisation des cazals, mas et maisons : les Barris particulièrement touchés par les troubles ?
27
En distinguant trois auréoles différentes, on en arrive aux constats suivants :
le village intra muros semble avoir été à peu près épargné par les violences de la seconde moitié du XVIe siècle, église et maison du curé exceptées, avec seulement quatre cazals signalés. Mais, cela est un chiffre minimum, dans la mesure où, sur quinze folios de compoix perdus, la description d’un certain nombre de bâtiments nous échappe définitivement ;
les Barris paraissent avoir beaucoup souffert des guerres de Religion130. Si l’on ajoute aux 38 cazals les deux maison et cazal, près de 60 % des bâtisses du quartier ont été en partie détruites ou suffisamment abîmées pour ne pas être portées au compoix comme des maisons à part entière. Cette proportion augmente encore si on met de côté les sept mas, qui sont en réalité des bâtiments agricoles : dans ce cas de figure exagéré, les deux tiers pratiquement des habitations des Barris viennent d’être abattues ;
hors village, dans le reste du terroir de Tressan, on dénombre à peine cinq bâtiments, dont deux cazals, mais l’échantillon représenté ici est bien trop faible pour en tirer toute interprétation. Le nombre des bâtiments non villageois est par ailleurs très faible dans les villages languedociens tassés traditionnels comme Tressan. En effet, nous ne sommes pas ici en région d’habitat dispersé131. Une réflexion plus poussée amène à formuler l’hypothèse suivante. Au regard de l’ampleur des dégâts commis dans les Barris, le peu de tribut payé par le village intra muros est étonnant. Pourquoi l’église Saint-Geniès, en partie mise à terre, la maison curiale abattue et quatre cazals sont-ils touchés, alors qu’ils se trouvent à l’abri des murs ? Des épisodes militaires ne pourraient-ils pas avoir eu lieu en deux phases distinctes ? On peut imaginer -et imaginer seulement- une phase d’exactions de motivation purement religieuse, au cours de laquelle les bâtiments d’Eglise et ceux de notables catholiques ont pu être détruits à l’intérieur du village. Une autre phase, alors forcément antérieure ou postérieure, pourrait avoir consisté en une opération de terreur auprès de la population : à cette occasion, une troupe armée, catholique ou protestante, aurait pu ravager plus « scrupuleusement » les Barris. A moins que les maisons à l’intérieur des murs aient été reconstruites très rapidement, il devient difficile de penser à une attaque unique du village, pendant laquelle une faction armée eût presque rasé un quartier, tandis que l’autre ne s’en prît qu’à quelques bâtiments bien ciblés. Protestants et catholiques se sont en effet affrontés dans la province en une guerilla à distance, dans plusieurs escarmouches et en procédant par coups de main sur des villages. Une telle hypothèse formulée avec réserves et prudence, Tressan sort donc, entre 1597 et 1605, d’une période trouble et destructrice. Au cortège bien visible dans le village des maisons devenues cazals et d’une église paroissiale à ciel ouvert, il faudrait ajouter les séquelles morales vécues par la population. Ces dernières ne restent pas totalement dans l’ombre, comme le prouvent une dernière fois quelques passages du procès-verbal de la visite de Jean de Bonsi en 1605. Aux questions du prélat sur les auteurs de la destruction de Saint-Geniès et de Saint-Etienne-de-Gaupeirous, les cinq témoins laïques répondent de manière ambiguë en accusant des « gents de guerre » qui, on l’a vu, n’en étaient peut-être pas. Estienne Tansson élude quant à lui la réponse, comme il dit « n’en rien scavoir » quand son évêque lui demande si des biens d’Eglise ont été usurpés, comme cela est pourtant bel et bien le cas. Les silences et les ambiguïtés de l’un et des autres montrent bien à quel point la tension est encore vive entre le curé et une partie de ses paroissiens au moins. Au tout début du XVIIe siècle, Tressan offre donc un visage dont les traits encore tendus trahissent une souffrance récente, que l’étude seule du compoix ne pouvait pas laisser clairement apparaître, au risque de masquer en partie le spectre de la guerre. Les activités
28
agricoles alors pratiquées subirent-elles des désolations comparables ou suivirent-elles d’un pas moins cahotique les grandes tendances de l’histoire agraire de Languedoc ?
29
III-UN TERROIR ENTRE CRISE ET RENOUVEAU.
Pour la première fois, grâce à un ultime recours au compoix de 1597, un état agricole du terroir peut être brossé. Cela ne passe pas sans démêler le lourd écheveau de cultures fortement emmêlées. Mais une fois ce voile levé, la lumière est faite sur un système de cultures savamment échaffaudé. Si le compoix de 1597 était un cadastre d’aujourdhui, la répartition des masses culturales serait simplifiée et se répartirait en quatre ou cinq grandes catégories, alors qu’ici nous avons affaire au cas de figure strictement inverse. Prenons l’exemple le plus significatif : les héritiers d’Anne Fabresse tiennent à la Viste « un camp houlivette vigne mas pijounier et four », ensemble qui couvre un petit peu plus d’un hectare132. Peut-être ce seul article* se décompose-t-il en effet à lui seul en six vraies parcelles, mais le détail des superficies de chacune nous échappe. La précision fait donc défaut, d’autant plus que l’agriculture languedocienne traditionnelle affectionnait particulièrement les complants, c’est-à-dire la pratique intégrale de plusieurs cultures sur une même parcelle133. Un seul article désigne nommément un de ces fameux complants ; il était conservé sur une feuille volante très endommagée du compoix, qui ne permet plus d’identifier son propriétaire ni le numéro du folio ; il s’agit d’un « camp complantat d’oliviers », un champ complanté d’oliviers. Dans une telle parcelle, les plates-bandes de blé alternaient avec des raies d’oliviers. Emmanuel Le Roy Ladurie propose d’ailleurs une photographie de la même association culturale, encore pratiquée vers Viols-le-Fort dans les années 1950134. Les articles à composantes multiples représentent à peu près le tiers des 1200 articles du compoix de 1597. Dans le détail, les systèmes culturaux régionaux étaient donc très complexes et empêchaient d’obtenir des rendements honorables, loin, très loin de ceux du Bassin Parisien par exemple135. Ils permettaient néanmoins l’extrême adaptation de l’agriculture ancienne à son environnement.
1-VIVRE ET SE NOURRIR : LE BLED ET LES JARDINS.
Sans aucune surprise, une fois dépassée la sensation d’avoir affaire à cent cultures mélangées, l’étude approfondie du compoix de 1597 montre à quel point les préoccupations des Tressanais consistaient à faire pousser des céréales sur leurs terres.
Des céréales omniprésentes dans le paysage. Les blés assuraient en effet le pain quotidien, dans un monde où rien n’était moins
sûr que le lendemain. Nature Nombre Hectares % ha
1 – Les cultures sèches : 999 articles ; 192,36 ha ; 97,3 % du terroir.
champ 303 49,08 24,8 champ complanté 298 80,95 40,9 olivette 230 34,83 17,6 olivette complantée 44 12,18 6,2 vigne 102 11,93 6,0 vigne complantée 12 2,16 1,1 amellarède 9 0,91 0,5 amellarède complantée 1 0,32 0,2
2 – Les cultures arrosées : 141 articles ; 1,64 ha ; 0,8 % du terroir.
jardin136 122 0,98 0,5 ferrajeal 16 0,26 0,1 prés 3 0,40 0,2
3 – L’inculte : 31 articles ; 3,83 ha ; 1,9 % du terroir.
bois de chênes verts 6 1,50 0,7
30
herme 14 1,76 0,9 ribeyral* 11 0,57 0,3 Total 1171 197,83 100,00
Tableau n° 4 – L’occupation du sol à Tressan d’après le compoix de 1597.
Le tableau présenté ici simplifie grandement la réalité agricole du terroir, dont la mise en valeur exacte est détaillée plus loin. Il illustre cependant bien à quel point Tressan fait partie d’une moyenne vallée de l’Hérault, dont les productions agricoles ne laissent guère de place à un élevage important. Le terroir est couvert à plus de 98 % par des cultures de plein champ, arrosées ou sèches. La faible part des ferrajeals et des prés souligne définitivement que l’élevage se résume à un minimum vital, c’est-à-dire à l’entretien de quelques bêtes de trait et de bât. Les Tressanais ne semblent pas produire pour nourrir un véritable troupeau ovin. La grande affaire dans le terroir est bien la culture du blé ou plutôt du bled*, comme le disent les documents d’époque. Le bled, ensemble des céréales semées et récoltées dans les champs, consiste le plus fréquemment en froment, orge, avoine et mistures. Les deux seules céréales dénommées « blé » sont la touzelle et le froment, dont la farine permet la cuisson des pains blancs137. Même si aucun texte contemporain du compoix de 1597 ne nous en parle -ni d’ailleurs ensuite- la question du bled est bien connue dans le Bas-Languedoc et dans la vallée de l’Hérault138. Des enquêtes tardives montrent le froment dominer largement les autres céréales, le méteil, le seigle et l’orge étant réservés à des sols particuliers, où le bon blé vient très mal, sinon à des semis de secours lors d’étés ou d’hivers extrêmes perturbant le cycle céréalier habituel139. L’avoine, elle, est réservée aux mulets et aux chevaux. Quant à Tressan, les seuls champs occupent près de 50 hectares et le quart de tous les biens ruraux enregistrés dans le compoix. Ils sont la plupart du temps laissés en jachère une année sur deux dans la mesure où l’engrais est encore inconnu et la fumure des terres par les déjections des bestiaux réservée à d’autres parcelles. On imagine aisément les faibles rendements céréaliers obtenus dans de telles conditions : à la fin du XVIIIe siècle encore, les rendements du bled sont à peine de l’ordre de cinq à six pour un sur les meilleures terres du village140. Communément en Languedoc, on semait lourd (plus de deux quintaux par hectare) et les blés rendaient peu, environ quatre pour un, jusque vers 1750141. Le domaine des Rocolles, à Béziers, rendait vers 1585 à peine plus de deux pour un142. La pratique du complant, handicapante pour la rentabilité des terres, permettait néanmoins d’insérer des plates-bandes de céréales un peu partout dans les parcelles arbustives. Un tel stratagème compense la faiblesse des rendements céréaliers et la petitesse du terroir par une extension des surfaces emblavées au sein de parcelles déjà occupées par des vignes ou des olivettes. Le complant permet aux blés de couvrir pour partie 81 hectares supplémentaires et à la composante céréalière d’être présente au final dans les deux tiers des terres de Tressan. En tout, sur les 200 hectares encadastrés en 1597, 129 sont un peu ou complètement réservés à la production des bleds et se répartissent sur 594 articles. Le terroir reste donc tourné en grande partie vers la production des grains, quelle que soit leur nature. Seule la pratique du complant permet, on l’aura compris, de diversifier un peu les produits de l’agriculture et d’intensifier sa pratique. Ou bien, dans un contexte d’immédiat après-guerre, d’insérer des céréales partout où il était possible de le faire. Une étude rapide du jardinage souligne à son tour l’importance vitale de la question alimentaire à cette époque. Un jardin potager par famille ? Peut être considérée comme culture proche du jardinage toute composante arrosée de l’occupation du sol, c’est-à-dire l’ensemble des articles qu’il est nécessaire d’irriguer : horts (jardins potagers), ferrageals (ferragines) et prats* (prés). La vocation même de ces
31
cultures, leur crucial besoin en eau, ainsi que leur entretien méticuleux ne laissent pas de place à une localisation innocente et éloignée du village. Les horts sont nombreux à Tressan, 122, alors que le compoix est incomplet. Or, vers 1597, le même document révèle la présence de 110 maisons. Cela reviendrait à préciser une règle : il existe, aux alentours de 1600, un jardin par maison ou –à condition que chaque maison abrite une famille- un jardin par famille. En outre, cinq jardins seulement sont associés à des champs dans un même article, mais il s’agit vraisemblablement, dans ces cas-là, de deux parcelles voisines, artificiellement regroupées par l’agent cadastral. De la même manière, neuf autres horts doivent seulement être mitoyens de l’aire à battre le blé ou du creux à fumier leur étant associés. Intimement mêlés au bâti, on l’a vu, soigneusement engraissés grâce aux creux à fumier, quelques fois ceints de murs, les jardins tressanais font partie du village même et ne se retrouvent jamais loin des murailles du lieu. Les plus éloignés (et les plus nombreux, 80), se trouvent à deux pas de là, près de l’actuelle Fontaine Fraîche, appelée alors la Fon, source captée coulant en permanence. L’irrigation du potager se faisait sinon grâce aux nombreux puits parsemant aujourd’hui encore le Tressan « dans les meurs » et les Barris. Elle permettait la récolte de légumineuses variées, souvent des pois, des haricots, des lentilles et des fèves143.
Les autres cultures arrosées sont sous-représentées en regard des horts. Les ferrajeals partagent avec ces derniers le même espace bâti : 15 seulement sont enregistrés au compoix de 1597, signe de la faiblesse du troupeau local. En effet, les ferragines languedociennes étaient souvent plantées de vesces fauchées pour la nourriture des animaux144. Quant aux trois prats, leur présence pourrait sembler a priori anecdotique, puisqu’ils couvrent à peine 0,4 hectare. Tous trois sont à Gaupeirous et bordent l’Hérault, dont l’arrosage, même accidentel, devait ici être recherché145. En revanche, comme le compoix n’encadastre pas les biens nobles, l’occupation du sol de la plaine de l’Estang nous échappe ce qui, en l’espèce, est très contrariant. En effet, une enquête de 1687 signale une particularité très importante de cet espace, car l’Estang serait en grande partie porteur de prés. Du moins, le texte nous le laisse penser, puisque les Tressanais disent avoir « la faculté de fere dépaistre leur bestiaux dans le ténemant de l’Estan situé dans le terroir dud(it) lieu lequel ténemant est possédé noblement par divers particuliers »146. Il existe donc de grandes chances, moins d’un siècle avant ce texte, pour que les 30 hectares de la plaine de l’Estang soient déjà couverts de prés, dans un tènement où la constance de l’humidité jouerait en leur faveur. Pour autant, la modestie de l’élevage dans le terroir ne paraît pas devoir être remise en cause, tant les difficultés de cohabitation des bestiaux et des paysans sont grandes dans une vallée intensément cultivée. La composante arrosée semble donc bien plus importante dans la vie agricole tressanaise que la seule interrogation du compoix veut bien l’indiquer. Au-delà de l’entretien de nombreux potagers et d’une céréaliculture envahissante, la place est néanmoins laissée à une mise en valeur du sol plus variée.
2-LA POUSSEE DES ARBRES A HUILE.
Puisque le terroir de Tressan est particulièrement marqué par la pratique incontournable du complant céréalier, on ne peut pas se contenter de dresser la liste des masses culturales données rapidement dans le précédent tableau. Certaines catégories de détail, alors simplifiées, peuvent se retrouver dans plusieurs dominantes culturales. Prenons un exemple tiré du tail* de Jeane Chauvete : elle possède une « houlivette et vigne » à Fontanilhes d’un peu plus de 1000 m²147. En sortant du tableau et en réfléchissant par « composantes culturales », cet article relève à la fois de la composante olivette et de la composante vigne, soit 1000 m² dans chacune des deux. Au final, grâce à cette méthode, si le terroir compte bel et bien 200 hectares de biens non bâtis, la pratique du complant porte
32
sa capacité productive à un peu plus de 300 hectares148. Afin de ne pas embrouiller le lecteur, continuons à analyser les composantes culturales les unes après les autres.
L’olivier conquérant.
La composante olivette couvre avant 1600 372 articles et 79,99 hectares, soit 40 % du terroir. Nous avons donc affaire à une oliveraie villageoise particulièrement importante et sans doute très entretenue. En effet, 230 olivettes sont réellement des vergers d’oliviers occupant 34,83 hectares. Les estaquarèdes* sont rares et l’oliveraie sans doute dans le plein de sa production. Comme l’huile d’olive tient alors un rôle exclusif dans la cuisine languedocienne et se vend particulièrement bien en ville et hors du Bas-Languedoc, 56 % de l’oliveraie tressanaise se trouve sous la forme de complants, soit 45 hectares où les souches se mélangent à d’autres cultures. Les deux associations les plus fréquentes sont celles de l’olivier et du blé (plus de 24 hectares), ainsi que celle de l’olivier et de la vigne (plus de 6 hectares), souvent même des trois (plus de 5 hectares). L’oliveraie de Tressan ne se développe pas exclusivement sur les versants bien exposés du coteau. Elle s’y ferait même presque rare : elle est descendue dans la plaine, sur les bonnes terres du village. La descente de l’olivier dans les plaines languedociennes et son beau développement à cet endroit sont connus pour le Narbonnais et le Lodévois tout proche, mais plutôt pour les années 1620-1650. Le compoix diocésain de Lodève de 1627 livre des proportions d’olivettes dans les terroirs très proches de celle de Tressan vingt ans plus tôt. Des pieds d’Arboras à Clermont et Nébian, l’oliveraie de plusieurs villages occupe entre le cinquième et le tiers de leurs terres149. Et encore, un compoix diocésain ne prend peut-être pas en compte la pratique du complant. Les contre-exemples des terroirs de ruffes de la Lergue et du Salagou, mais aussi des pentes du Larzac soulignent bien, en Lodévois, le même phénomène qu’à Tressan : « les olivettes sont particulièrement répandues dans la plaine »150. Le terroir de Narbonne, taillé dans une vaste terra plana, a vu sa composante olivier passer de 250 à 500 hectares entre 1549 et 1597151. A Ginestas (Aude), la vague de l’olivier submerge le terroir de 100 hectares supplémentaire entre 1532 et 1572 (+ 50 %), de 30 hectares à Mirepeisset entre 1571 et 1612 (+ 100 %)152. Au plus près de Tressan, à Gignac, les olivettes simples et celles complantées occupent 60 % des parcelles dans le compoix de 1597153. Au même moment, l’oliveraie tressanaise a donc suivi le grand essor oléicole du Bas-Languedoc154. La multiplication des arbres à huile.
L’olivier n’est pas le seul arbre à huile dans le terroir : l’amandier, loin de le concurrencer, complète la production oléicole, mais d’un manière toute différente. La composante amandier fait de l’ombre sur 78 articles et 17,74 hectares, soit à peine moins de 9 % du terroir. Mais, seules 9 amellarèdes « pures » se partagent moins d’un hectare. Les amandiers sont presque systématiquement complantés, à la différence des oliviers : cela revient à dire que 95 % de l’amellarède tressanaise est associée à d’autres cultures. Elle est donc entretenue plutôt comme une production agricole d’appoint que comme une culture de plein champ commercialisée : l’amandier et sa production demeurent probablement tournés vers la consommation locale, même si un texte de 1517 nous apprend que l’on peut acheter des amelles* à la foire du Pouget155. Cela sera toujours le cas en 1727, puisque le seigneur du lieu y prélévera un « droit d’establage » (droit de tenir un étal) d’un pain pour une charge d’amandes156. L’exemple du Lodévois va dans le même sens157. L’implantation de l’amellarède nous le montre une dernière fois : aucun tènement n’est spécialisé dans la culture de l’amandier, on trouve des amandiers dans tout le terroir. En revanche, comme dans tout le Bas-Languedoc au moins, les « amelliers (…) poussent désormais en grand nombre dans le sillage de l’olivier »158. Un tel engouement pour les huiles végétales semble
33
signer le passage à de nouvelles habitudes alimentaires, où « la cuisine à l’huile, mise à la mode par les Marranes d’Espagne, tend à évincer, au XVIe siècle, la cuisine au lard plus traditionnelle »159. Cet engouement se retrouve jusque dans l’entretien de rares noyers dans le terroir, où ils se comptent sur les doigts d’une main.
3-UN VIGNOBLE REDUIT A SA PLUS SIMPLE EXPRESSION.
Quant au rôle de la vigne dans le paysage et l’économie locale, le compoix permet d’en prendre la pleine mesure. La composante vignoble se décompose, comme on le sait, en deux parties : les vignes simples, qui occupent 102 articles et 11,93 ha, soit 6 % des surfaces non bâties ; les vignes complantées, étalées parmi 60 articles et 22,94 hectares supplémentaires, soit 11,5 % des mêmes superficies non bâties. Un vignoble réduit.
En tout et pour tout, le vignoble tressanais joue donc dans le terroir un rôle très limité : moins d’un cinquième des terres, assez loin derrière l’oliveraie locale et très loin derrière les céréales. C’est aussi le cas à Usclas-d’Hérault en 1585160, à Salasc en 1601161, ainsi qu’à Ceyras, Saint-André-de-Sangonis et Nébian en 1627162. Au sein des cultures sèches, le vignoble est même la composante agricole la plus mal imposée par les agents cadastraux. Ainsi, une vigne simple allivre en moyenne 1,21 livres par hectare. De même, la pratique du complant entraîne une dévalorisation importante : une vigne associée à de l’inculte cotise par exemple 0,89 livre par hectare. En revanche, une autre de taille identique mélangée à des céréales atteint 1,48 livres par hectare. Mal aimée du fisc, la vigne tressanaise l’est donc aussi du paysan, mais qui de l’arpenteur ou du cultivateur se fait le miroir de l’autre ? Le complant viticole touche en effet 66 % de tout le vignoble : c’est la deuxième culture la plus associée à d’autres après les amandiers. Quant aux malheuls, les fameux plantiers de jeunes vignes encore improductives, ils n’apparaissent pas dans le compoix. Soit l’arpenteur les a recensés parmi les vignes, soit il n’en existe pas, ce qui est vraisemblablement le cas. Le vignoble local est donc entretenu, mais son renouvellement ou son expansion ne sont pas encore à l’ordre du jour. Emile Appolis signale d’ailleurs un vignoble bien plus étendu dans la vallée de l’Hérault à la fin des années 1620 que celui aperçu à Tressan avant 1600163. Sérignan voit son terroir couvert de 20 % de vignes en 1550 s’en découvrir jusqu’à 11 % en 1603164. Aux pieds de leur cathédrale, les vignes de Narbonne sont aussi connues grâce à de belles séries de compoix : Gilbert Larguier signale leur très net déclin entre 1561 et 1597. Dans le terroir narbonnais, le vignoble connaît donc une véritable débâcle et est constitué en partie de vignes et de malheuls ruinés165. Selon les lieux, la chute ne se fait pas en même temps et au même rythme : à Ginestas, les vignes passent de 89 à 86 hectares de 1532 à 1572, de 60 à 58 hectares à Mirepeisset dans l’intervalle 1571-1612166. Le reflux du vignoble languedocien à la fin du XVIe siècle touche jusqu’au lointain Vivarais (Ardèche), où le vignoble des deux villages de Nieigles et Thines semble plus important vers 1630 que quelques décennies plus tôt167. Chaussadenches, en Vivarais aussi, perd ses dernières vignes entre 1534 et 1601168. Vers 1600, dans toute la province, seuls quelques vins fins très réputés permettent le maintien, dans quelques rares terroirs, d’une viticulture mangeant un espace honorable, comme autour de Frontignan et de Saint-Georges-d’Orques avec le muscat169. Quant à Tressan vers 1597, si le vignoble villageois semble réduit à son minimum, comme c’était le cas pour Usclas-d’Hérault en 1585, son déclin suit sans doute de près la conjoncture de Languedoc. Emmanuel Le Roy Ladurie résume au mieux la situation : « les vignerons, les défricheurs abandonnent leur vin ou leur grain pour faire de l’huile »170. De plus, la localisation des vignes tressanaises devrait permettre de savoir si la production viticole était alors orientée vers le commerce où l’autoconsommation. Si les ceps s’enracinaient uniquement dans la plaine, cela constituait
34
une recherche de rendements importants et un indice de volonté marchande des propriétaires. Si, au contraire, les souches s’accrochaient au coteau et à ses flancs caillouteux, leur rendement demeurait très maigre et témoigne d’une viticulture au débouché familial. Qu’en est-il donc ? Un vignoble domestique.
On ne trouve des vignes que dans 12 des 26 tènements recensés dans le compoix et encore, dans certains lieux-dits, leur présence est anecdotique. C’est le cas aux abords directs du village et de l’Hérault où le vignoble, complanté ou non, se fait discret, car il y occupe en général moins de 10 % de l’espace cultivé. Dans tout le terroir, entre le Camy Ferrat et le cours d’eau, quatre vignes seulement occupent le terrain, cinq autres complantées complètent un bien maigre tableau de chasse. La plaine au nord du coteau, à l’est du Camy Ferrat, est totalement délaissée. Quant aux pentes exposées aux caprices mordants du vent du Nord, aux Costes et aux Verdiés, les ceps en sont notoirement absents. Finalement, seuls les versants sud, est et ouest de la colline comptent entre 20 et 42% de leurs surfaces plantées en vignes. Une mention spéciale revient même aux pentes de Canredon et de la Viste, où la vigne, ici la plus nombreuse, est aussi la moins complantée de tout le terroir. Quant à Fonrascasse, petit tènement de moins de 2,5 hectares sur le replat du coteau, la vigne y est la maîtresse incontestée des lieux, en occupant plus de 80 % de l’espace. A la fin du XVIe siècle, le vignoble tressanais s’accroche donc à la colline et à ses versants ensoleillés et à l’abri du vent du Nord, c’est-à-dire en des lieux traditionnels de la viticulture ancienne. A Usclas-d’Hérault en 1585, le compoix du village signalait des vignes elles aussi enracinées dans le tènement des Cresses, celui surplombant le plus la vallée de l’Hérault171. Tous les faisceaux de présomptions tirés du cadastre ancien de Tressan convergent pour dire à quel point la viticulture alors pratiquée ne destinait sans doute pas ses fruits à être vendus aux étals de foires ou de marchés voisins, mais sans doute à être consommés sous forme de vin ou de raisin de table dans le cadre local, pour ne pas dire familial. Nous sommes à nouveau loin de 1517, où est « tenu chascune année le jour de Saint Michel foyres audit lieu du Pouget (…) et y vont les gens du dit païs pour vendre leur bestail, passerilhes*, amelles et autres marchandises »172. Si la vendange et la production de vin vont de soi, le vignoble alimentait aussi les habitants en raisins de table et en passerilles (raisins secs)173. Bref, la vigne, à Tressan vers 1597, est probablement entraînée dans un contexte de reflux. Elle reste par conséquent une composante culturale et culturelle de l’économie domestique, mais une composante effacée, au visage et à la récolte très différents de ceux affichés plus tard. 4-DES TERRAINS INCULTES EXTREMEMENT ENVAHISSANTS.
Le tableau de l’occupation du sol à Tressan d’après le compoix ne serait pas complet sans évoquer la composante inculte du terroir. Dans ce tableau d’ailleurs, le raisonnement en masses culturales fausse la réalité de la fin du XVIe siècle : on a signalé un saltus (terres en friche ou à l’abandon) et une silva (terrains boisés) de 3,83 hectares, soit 1,9 % des terres alors encadastrées.
Un inculte très présent. Or la composante inculte consiste aussi en complants où se mélangent des cultures
à part entière (ou ager) et des broussailles plus ou moins développées. Trois natures de terrains incultes se rencontrent dans le compoix : les bosc* deuzes (bois de chênes verts), les erms (terres anciennement cultivées mais abandonnées) et les ribeyrals (bois de rivage). Outre les 3,83 hectares non complantés doivent être ajoutés 34,05 hectares de complants
35
saltus-ager ou silva-ager. En tout, les terres pour partie ou vraiment incultes occupent 18,9 % des surfaces non bâties, c’est-à-dire une part du paysage équivalente à celle du vignoble. Lorsque la méthode de décompte retenue est celle des composantes culturales, le saltus et la silva apparaissent dans leur intégralité et s’insinuent dans dix fois plus de terres qu’il n’y semblait au premier regard.
Si la part de l’inculte s’élève à celle du vignoble, son implantation est néanmoins tout autre. De manière très logique, les tènements riverains de l’Hérault sont parsemés sur toute leur longueur de ribeyrals. Les bois de rivage sont particulièrement importants dans l’environnement des villages bordant l’Hérault. Ils forment avant tout une barrière naturelle aux colères du fleuve lors des crues printanières et automnales. Même si les inondations pouvaient, hier comme aujourd’hui, causer d’énormes dégâts, l’entretien des bois de rivage garantissait les parcelles des propriétaires contre les tumultes du courant, hélas pas contre les dépôts massifs de sables et de graviers stériles, comme en atteste le tènement de Lille, apparu dans le cadastre de 1826174 et d’autres papiers de la même époque. Outre un tel rôle de protection des terres, les ribeyrals, ainsi que les bois de chênes verts d’ailleurs, tenaient une place décisive dans le quotidien des habitants. Des documents tardifs nous apprennent indirectement le droit accordé par le seigneur aux Tressanais de ramasser du bois mort dans le terroir175. Pareillement, comme en témoignent des exemples voisins, les abords des bois de rivages fournissaient roseaux et perches de saules pour monter des claionnades* et tailler les incontournables tuteurs des jardins176. Du Pas Darmaing à Gaupeirous, le paysage est donc marqué aux abords du fleuve par une fûtaie remarquable de ribeyrals, qui accaparent entre 20 et 100 % des terres. Ainsi, le Pas Darmaing, minuscule lieu-dit d’un quart d’hectare est uniquement composé de bois de rivage. Dourbye pose cependant problème avec 50 % de l’espace en partie au moins envahi non seulement par les ribeyrals, mais aussi par l’intrusion de nombreux bosc deuzes* et d’herms au milieu de l’ager. Le tènement voisin de la Croux est lui aussi touché par le même phénomène. Une observation d’ensemble montre que l’inculte est discret voire absent sur les terres assez proches du village et aux abords directs du bâti. Sa présence est par ailleurs forte dans le nord-ouest du terroir, entre Dourbye et les pentes de Canredon. Elle est aussi sensible sur les pentes ouest du coteau, les moins bien estimées du terroir, à Cantausel et Fontanilhes par exemple. Il semble donc que l’inculte se développe sur des terrains peu profitables à une agriculture facilement rentable, à cause de leur éloignement du clocher ou de la nature même des sols. C’est un élément central pour comprendre la gestion de l’espace agricole tressanais vers 1597.
Un inculte sans doute sous-estimé par le compoix. Par ailleurs, le compoix n’enregistre que 201,52 hectares de biens non nobles, bâtis
ou non bâtis. Le compoix de 1770 et le cadastre de 1826 signalent un terroir complet de l’ordre de 350 hectares. Manquent donc à l’appel environ 150 hectares de biens ruraux et de biens nobles. Combien pouvaient contenir les quinze folios disparus ? Nos 201,52 hectares sont consignés en 277 folios, soit 0,73 hectare le folio : l’amputation du compoix peut correspondre à une fourchette de 10 à 30 hectares de terres, sans doute guère plus. En effet, les premiers propriétaires enregistrés sur les compoix étaient en général les notables richement possessionnés du village, en commençant par le seigneur du lieu. Le cadastre de 1770 est complété par le Cahier des biens pretendus nobles de Tressan : son dépouillement montre, tardivement hélas, 45 hectares de terrains, pour la plupart situés dans la plaine de l’Estang177. Addition faite de ces chiffres, il reste encore 75 à 95 hectares de terres manquant à l’appel vers 1597. En reprenant la leçon tirée de l’analyse des pages restantes du compoix, on a pu conclure au resserrement des cultures autour du village lui-même et de fonds de bonne qualité. La connaissance du terrain montre que les toutes meilleures terres de
36
Tressan n’apparaissent pourtant nulle part en 1597 : pas de Condamines, pas de Rengue, pas de Faïsses… D’autres lieux-dits semblent ne pas exister du tout : pas de Bazillac, pas de Pigeonnier, pas de Tines ou si peu, pas de Viviers non plus178… En recoupant les documents fonciers ultérieurs et en ajoutant les superficies moyennes de ces six tènements, on trouve une somme d’environ 45 hectares déjà. Il est aussi nécessaire de signaler que certains lieux-dits cités par le compoix de 1597 ont des surfaces ridicules par rapport à celles données dans les registres suivants179. C’est le cas de Gaupeirous, des Costes ou des Vistes, facilement délimitables par la suite, auxquels un bloc d’environ 10 hectares fait défaut à la fin du XVIe siècle. Quand on sait en outre qu’un hectare d’herm cotise une misère, c’est-à-dire 0,46 livre en moyenne (5,4 fois moins qu’un hectare de champ), certains soupçons se précisent.
Il est fort probable que le compoix de 1597 enregistre une partie seulement des terres incultes du village. Ainsi, les 75 à 95 hectares « disparus » n’ont peut-être pas été, tout simplement, portés au compoix, parce qu’ils consistaient en terrains abandonnés ou en terrains laissés depuis assez longtemps en friche pour ne plus rien produire. Dans les deux cas, cela pourrait expliquer qu’ils ne soient plus imposables en 1597 -sinon symboliquement- et donc retranchés du taillable. La possibilité de voir autant d’hectares de terres nobles disparaître entre les années 1600 et 1770 paraît en outre très improbable : une terre noble, cultivée ou non, échappait de toute façon aux impôts directs ordinaires et il y avait donc tout intérêt à prouver et à maintenir sa nobilité. A Salasc, Sylvain Olivier signale dans le compoix du lieu de 1601 un sérieux problème d’enregistrement des terrains incultes, négligés au point de voir l’arpenteur consigner un bois dans le registre sans préciser sa surface180. A Tressan, la logique semble avoir été portée à son terme. Les terres incultes sont finalement très nombreuses dans le terroir, essentiellement dans la plaine, grandement ouverte on le sait à la circulation : une lecture rapide du compoix n’aurait pas permis de repérer cette réalité fondamentale.
A la fin du XVIe siècle en effet, le terroir de Tressan est sans doute à l’image du village : il se relève des guerres de Religion. La polyculture méditerranéenne est bien là avec le traditionnel triptyque blé-oliviers-vignes et la multiplication des jardins potagers. Mais, les céréales dominent trop nettement une agriculture locale grandement tournée vers l’autosubsistance. Ce souci céréalier si visible dans le paysage se double d’un terroir peut-être envahi par l’inculte, où la vigne se fait particulièrement discrète et atteint sans doute, à cette époque-là, un niveau-plancher dans l’économie villageoise, comme dans le reste du Bas-Languedoc. Trente années de guerre civile ont sans doute contribué à perturber le système des cultures, à malmener l’équilibre des productions agricoles et à laisser les Tressanais abandonner pour un temps une partie de leurs biens aux herbes folles et aux hermas. Pour autant, un sentiment mitigé demeure, car la poussée oléicole villageoise doit sans doutre être considérée comme un signe de redressement économique alors que le beau XVIe siècle, cher à Emmanuel Le Roy Ladurie, est achevé depuis longtemps. Comme le village, le terroir est un espace entre crise et renouveau.
37
IV) PLUS D’UN SIECLE ET DEMI DE DIFFICULTES ?
Dans la mesure où Tressan sort à peine de guerres de Religion véritablement destructrices vers 1600, on peut s’interroger sur leurs conséquences à court, à moyen et à long terme pour la population et l’économie du village. L’absence de documents fonciers et fiscaux pendant plus de 150 ans ne serait-elle pas due à une longue crise démographique ? En effet, l’absence de refonte du compoix entre 1597 et 1770 est inquiétante pour le sort de Tressan et des Tressanais. Les compoix étaient refaits à des dates et à des intervalles très variables sur demande des consuls de la communauté d’habitants. Quand demandait-on à la Cour des Comptes, Aides et Finances de Montpellier l’autorisation de faire refaire son compoix ? Tout simplement quand l’ancien devenait inutilisable à cause de son ancienneté, préjudiciable pour deux raisons :
le vieux compoix était très détérioré et malcommode d’utilisation ;
le vieux compoix était surchargé de mutations et posait de trop gros problèmes de répartition annuelle de l’impôt entre les contribuables, lors de la rédaction du livre de taille. Comme le nombre des mutations enfle fortement en période d’augmentation des
propriétaires, cela témoigne en général d’un essor de la population, du moins en milieu rural. Si rien n’a justifié la refonte du compoix de 1597 jusqu’en 1770, on peut donc soupçonner ces 173 ans de correspondre à un effectif de propriétaires stables ou en déclin et, par conséquent, le village de se dépeupler. Que nous dit l’état civil d’Ancien Régime sur une telle hypothèse ?
1- LES REGISTRES PAROISSIAUX DE TRESSAN (1607-1792)181. Avant la Révolution, on ne parle pas d’« état civil » mais de registres paroissiaux,
leurs ancêtres directs. Les registres paroissiaux furent tenus à Tressan par ses curés successifs et sont conservés depuis la fin de l’année 1606. Le curé inscrivait sur des cahiers de petit format les baptêmes, les mariages et les sépultures survenus dans la paroisse. Jusqu’en 1652, les baptêmes, les mariages et les sépultures furent enregistrés sur trois cahiers différents reliés ensuite les uns à la suite des autres. On trouve dans nos registres paroissiaux les originaux et la copie des actes. Les deux versions doivent être confrontées, car le cahier original conservait, par exemple, la trace de baptêmes oubliés par mégarde lors de la copie. A partir de 1652, les trois sacrements furent comptabilisés dans leur ordre chronologique sur le même cahier, chaque année faisant l’objet de la rédaction d’un cahier propre. En tout, les registres paroissiaux de Tressan sont constitués de huit cahiers d’épaisseur variable conservés dans les archives communales et référencés aux archives départementales182. Les derniers furent tenus par Gept, prieur du lieu, qui enregistra son dernier acte, le baptême de Reine Chauvet, le 12 septembre 1792183. Il passa ensuite la main à l’état civil proprement dit et à son nouvel officier, le maire du village. L’état civil contemporain est lui aussi conservé dans les archives communales et reprend la vieille mode de l’enregistrement séparé des actes de naissance, de mariage et de décès, selon le nouveau vocabulaire adopté à la Révolution.
Les registres paroissiaux de Tressan sont-ils fiables ? Peut-on les utiliser sans inquiétude pour étudier la population du village et son évolution entre le début du XVIIe siècle et la fin du XVIIIe siècle ? On est hélas obligé de nuancer la réponse, car il existe sur deux siècles un moment où ces registres furent assez mal tenus. Il s’agit de la période 1732-1743, durant laquelle le curé Martin sous-enregistra très fréquemment baptêmes, mariages et sépultures. Ainsi, aucun décès n’aurait eu lieu en 1734, 1736, 1738, 1739 et 1742 ; on compte seulement deux baptêmes en 1742 ; quant aux mariages, pas un n’aurait été célébré en 1732,
38
et de 1735 à 1738. La tenue des registres durant une dizaine d’années fut donc particulièrement douteuse et les chiffres à notre disposition très incomplets. L’année 1738 est même la plus mal renseignée, avec seulement quatre baptêmes enregistrés par le curé… Sur les 184 ans de registres paroissiaux dépouillés, douze années posent problème, soit 6,5 % de la période. Aux 3850 actes enregistrés devraient s’ajouter environ 280 baptêmes, mariages et sépultures « oubliés », soit une perte d’informations de l’ordre de 7 %. Au final, les registres paroissiaux permettent d’approcher la démographie du village avec un taux de fiabilité de l’ordre plus de 90 %.
Le dernier écueil n’est pas des moindres et tient dans le contenu même des actes, très variable selon le curé ayant rédigé les registres. Les baptêmes précisent le nom et le prénom du père, parfois son surnom et sa profession, le prénom et le nom de jeune fille de la mère, ainsi que la mention du mariage ou non des deux parents qui présentent l’enfant au curé et le reconnaissent. Sont aussi signalés le prénom, le nom et parfois la profession du parrain et de la marraine. Le baptême survient en général deux jours à une semaine après la naissance, sur les fonds baptismaux de l’église Saint-Geniès. Le baptême est pratiqué par l’accoucheuse ou sage-femme lorsque le bébé est en danger de mort : il est alors « ondoyé », pratique assez fréquente dans les registres et signe de leur bonne tenue générale. Cela permet d’enterrer le nouveau-né au cimetière, parmi les chrétiens, chose plus qu’importante à l’époque. Les mariages permettent de connaître le prénom et le nom des époux et de leurs parents, de même que leur lieu de naissance. La mention de l’activité du mari est très rare ; elle est inexistante pour la femme. De la même manière, l’âge de chacun des mariés apparaît accidentellement avant 1748, puis systématiquement entre 1748 et 1771 et, enfin, épisodiquement entre 1771 et 1792. Quant aux sépultures, elles ont presque toujours lieu le lendemain ou le surlendemain du décès. Les inhumations effectuées le jour de la mort du défunt sont exceptionnelles et justifiées soit par un décès ayant fait suite à une trop longue maladie, soit à cause de trop fortes chaleurs, soit à cause des deux. C’est le triste cas de Marie-Anne Navasse le 2 juillet 1740, morte et « ensevelie le même jour parce quelle mourut dun charboncle et faisait grande chaleur »184. Exceptionnelle reste aussi la mention de la cause du décès et seul le caractère tristement « remarquable » de sa nature explique sa transcription par le curé. Les circonstances de la disparition d’une personne sont donc indiquées en général lorsque le défunt ou la défunte ne sont pas des paroissiens mais des gens de passage, comme Assia Ejeuret, de Villemagne, retrouvée noyée au bord de l’Hérault par des villageois le 21 septembre 1686185. L’acte de sépulture précise presque toujours la filiation du défunt ou de la défunte, sauf s’il s’agit d’un chef de famille, d’un célibataire ou d’un veuf. Enfin, les registres paroissiaux précisent de plus en plus l’âge au décès après 1694.
On aura compris quelle utilisation peut être faite de l’état civil ancien : reconstitution des familles, calcul de l’espérance de vie, de la fécondité des femmes, etc… Mais, ces registres ne permettent pas de fixer le nombre d’habitants de Tressan chaque année et son évolution depuis 1606, encore moins, par conséquent, de définir des taux de natalité ou de mortalité anciens. On peut cependant débusquer du document des pics de natalité et de mortalité, des années de mariage et bien d’autres indices permettant de mieux connaître Tressan et les Tressanais avant 1792.
2- LES ANNEES MALSAINES : 1607-1654. Cette période est couverte par le premier registre paroissial à notre disposition186. Quelles en sont les grandes caractéristiques ? Pour les connaître, il faut avant tout s’attarder sur le solde naturel, c’est-à-dire le résultat de la simple soustraction entre sépultures et baptêmes. Il faut aussi connaître le contexte démographique de la région avant 1607. Celui-ci est très bien éclairé par les travaux de plusieurs historiens, notamment
39
ceux d’Emmanuel Le Roy Ladurie et de Gilbert Larguier. On sait ainsi que de 1450 à 1550 la population des campagnes languedociennes a très fortement augmenté et le mouvement s’est prolongé jusqu’aux début des années 1600. Un peuplement aussi fort constitue en réalité une « reprise », c’est-à-dire un repeuplement des campagnes après les terribles années 1350-1450, qui décimèrent souvent plus de la moitié de la population des villes et des campagnes. Tressan n’a sans doute pas échappé à cette conjoncture régionale, même si, en l’absence de registres paroissiaux antérieurs à 1607, il n’est pas possible de préciser les dates charnières de cette évolution. Retenons l’essentiel : fin 1606, lorsque le prieur Tansson inaugure l’état civil d’Ancien Régime, il est fort probable que le village vient de connaître une période d’augmentation de la population, donc de solde naturel positif, mais jusqu’à quand ? On sait en effet le village ravagé par les guerres de Religion, eu égard au grand nombre de bâtiments détruits, les cazals. Cela n’est pas forcément synonyme de massacres, mais signale un probable dérèglement de la natalité et de la mortalité quelques part dans les années 1550-1590. Si la population tressanaise a augmenté après 1550, la croissance s’est probablement essoufflée lorsque le village a été attaqué, à une date inconnue. Le solde naturel est en tout cas positif jusqu’en 1654, avec 402 baptêmes et 259 sépultures, soit un excédent démographique de 143 personnes. La moyenne annuelle du solde naturel est de trois habitants de plus par an, chiffre assez élevé qui dénote une démographie dynamique. Par moments, l’excédent annuel de population est même bien plus fort : il grimpe à 4,6 en 1616-1620 et à 3,9 en 1630-1645. Un tel dynamisme s’explique par des pics de natalité parfois élevés : 14 baptêmes sont célébrés en 1647, chiffre atteint à nouveau en 1707, puis en 1727. Mais, en même temps, des difficultés ponctuelles apparaissent avec des pics de sépultures très forts pour Tressan, où l’on inhume 16 paroissiens en 1622. Pour l’heure, les accidents de ce type se cumulent heureusement une seule fois en 1621-1622, où le solde naturel atteint –12. D’ailleurs, de 1607 à 1654, le village a un solde naturel négatif ou nul 27 % des années. La démographie de ce demi-siècle est donc malsaine et rien n’y est jamais acquis, car une seule année de forte mortalité peut effacer l’excédent de naissances cumulé les années précédentes : 1622 emporte par exemple la presque totalité de l’excédent constitué entre 1618 et 1621, une année en efface quatre. Le moindre aléa météorologique peut alors avoir des conséquences dramatiques. Ainsi, à l’automne 1624, « Berthellemy Ballansac fils de Jacques du lieu de Florensac (…) est trouvé noyé avec sa mère (…) au delluge et débord d’Hérault fait ce jour dhui ayant emporté le moulin de Carabotte »187. De la même façon, des événements fortuits peuvent faire apparaître, certaines années, des pics de mortalité, comme lors du décès accidentel de « Jean Boudet & André Cabanel et Jaume Gély du lieu de la Bastide de Cernon serviteurs de Mr Izac Forestier lesquels touts troys moururent à une réparation que Monsieur de Tressan faisoit fere au dehors de son chasteau »188. L’impact des grandes épidémies se laisse quant à lui difficilement apercevoir. Ainsi, la peste de 1629, si virulente et meurtrière ailleurs et parfois non loin de Tressan, fait peut-être dix morts dans le village189. Les années 1628-1632, rudes dans une bonne partie du Languedoc, ne prélèvent ici aucun tribut notable sur la population190. En outre, la nuptialité n’est pas vraiment dynamique et la paroisse compte à peine 1,9 mariages par an, ainsi que huit années au cours desquelles personne ne convole (17 % de la période). Cela explique en grande partie pourquoi le nombre de baptêmes n’est pas plus élevé et montre que les crises de mortalité n’ont pas encore dessiné sur les courbes des pics acérés. En effet, grâce à un calcul très mécanique, chaque mariage aurait alors donné 4,4 enfants par couple, chiffre relativement modeste à cette époque. L’ouverture de Tressan sur l’extérieur demeure par ailleurs forte, puisque 42 % des époux sont extérieurs à la paroisse, ainsi que 19 % des épouses. Même si les hommes se marient plus facilement loin de leur clocher que les femmes, l’endogamie touche encore sept mariages sur dix.
40
Ces années de démographie malsaine se concluent toutefois sur un épisode positif, puisque « le 13 7bre [septembre] 1654 ont esté bénites les cloches de Tressan par monsieur l’archiprestre du Pouget par l’ordre de monseigneur de Béziers le parrin est monsieur de Tressan et la marraine madame sa femme »191. La reconstruction de l’église Saint-Geniès, dévastée lors des guerres de Religion, semble donc à peu près terminée.
3- LES ANNEES DE CRISE : 1655-1711.
Avec les années 1655-1711, Tressan rentre dans une crise démographique profonde : 520 baptêmes certes, mais hélas 540 sépultures. La période est donc marquée par un solde naturel négatif : le déficit annuel moyen est de –0,36, soit une population perdant spontanément un habitant tous les trois ans. Le déclin est même marqué par deux épisodes terribles de surmortalité :
entre 1655 et 1660, Tressan perd 73 habitants ;
entre 1693 et 1701, ce sont 103 habitants qui disparaissent. Les difficultés du demi-siècle s’expliquent par de très forts pics de mortalité : 20 décès
en 1678, 19 en 1679. Jamais les pics de natalité de la période n’atteignent de tels sommets avec, au mieux, 17 baptêmes en 1674. La seule période « longue » de solde naturel positif est centrée sur les années 1687-1692. Le solde naturel est sinon négatif ou nul 27 années sur 56, soit 51 % de la période. Ce demi-siècle est donc pour Tressan synonyme de crise. Celle de 1655 trouve peut-être son fondement dans un épisode pesteux avant-coureur, puisque le curé de Tressan signale le décès de « mestre Antoine Vernazobres, prieur de Pouzols ». « Il mourut de la peste au dit Pouzols » en avril 1653192. La crise des années 1690 est elle bien connue pour le Languedoc et a épargné très peu de communautés entre 1691 et 1699193. C’est une des plus violentes de la province, qui trouve son origine dans un contexte de froid intense « avec son cortège de famines et de morts »194. A la conjoncture de dépeuplement s’ajoute hélas le lot habituel d’accidents meurtriers : trois noyades dans l’Hérault entre 1686 et 1707 et la mort de Jean Roche, « lequel fut terrazé par une pierre qui tomba de la voute qui couvre l’entrée de la porte du lieu » au printemps 1687195. Dans la mesure où on ne dispose hélas pas du nombre de Tressanais par défaut de recensement ou de dénombrement, il n’est pas possible de savoir plus précisément à quel point le village s’est alors dépeuplé, mais ce dépeuplement semble acquis. On pourrait fonder des espoirs sur le dénombrement mené en 1693, mais il livre le chiffre peu utilisable de 84 feux, soit à peu près autant de familles196 : comme on ne sait jamais précisément par quoi multiplier ce chiffre pour obtenir un nombre d’habitants, mieux vaut s’abstenir d’effectuer une opération très hasardeuse. En revanche, un nouveau dénombrement de 1711 décompte à nouveau 84 feux, mais quel crédit lui apporter197 ? Car, avec 103 décès et seulement 83 baptêmes entre 1693 et 1701, la population a forcément diminué. La période 1702-1711 ne comble d’ailleurs pas le déficit accumulé dans les années 1690 ; elle l’aggrave même avec un excédent de 12 décès sur les naissances. Les années 1655-1711 se déroulent d’ailleurs dans un contexte de grande pauvreté. Ce sont les seules années pour lesquelles on a connaissance d’une petite fille abandonnée à la porte de l’église Saint-Geniès, à l’automne 1656198. C’est aussi la même période qui voit la mort, dans la paroisse, de deux « pauvres » inconnues : Suzanne Galzine, mendiante venue de Millau et Gabrielle Brun, bohémienne199. La reconstruction de l’église, sans doute partielle en 1654, met d’ailleurs beaucoup de temps à se concrétiser et s’achève par un dernière vague de travaux en 1700-1702, hâtivement décrite par le curé Delagaubertarier : « le dimanche sixieme aoust 1702 par nous prieur sousigné a esté bénitte l’églize paroissialle du présent lieu en vertu du pouvoir que nous avons reçu de messieurs de Maussac et de Salinhac vicaires généraux (…) la première pierre avoit esté bénitte et posée au commencement du mois de may de l’an 1700 »200. La vie villageoise semble donc tourner au ralenti.
41
En effet, la nuptialité trahit une dernière fois ce phénomène de diminution du nombre d’habitants. Sur 129 mariages, 55 époux ne sont pas de Tressan (43 %), de même que 18 épouses (14 %). De tels chiffres soulignent à quel point le village « remplace » ses chefs de familles par de nouveaux, venus d’autres horizons. Plus inquiétant, le repli marqué des femmes sur le village montre que leurs familles ne les laissent presque plus partir s’installer ailleurs. Quant aux noces, elles montrent une population en train de ramener le nombre de ses rejetons à 4 enfants par couple. Ce phénomène de limitation volontaire du nombre des naissances des sociétés anciennes en contexte tourmenté porte un nom : le « malthusianisme ». Le caractère très dur de la mortalité, ajouté à cette donnée, souligne la quasi-impossibilité aux générations de se renouveler entre 1655 et 1711.
4- LES ANNEES DE REPRISE : 1712-1786.
Après cette grande sape démographique, une période de renouveau s’installe entre 1712 et 1786, un moment de « reprise » pendant lequel se comble le déficit des années 1655-1712. Le solde naturel annuel est alors en moyenne de 2,53 avec 883 baptêmes et 693 sépultures. Mais, on se souvient du problème de tenue des registres entre 1732 et 1743, qui nous prive d’un certain nombre d’informations. Retenons seulement les ordres de grandeur à notre disposition. Les deux périodes de repeuplement les plus nettes apparaissent en 1712-1716, avec un solde de 12 habitants supplémentaires et en 1763-1770, avec un nouveau solde de 47 individus de plus. Le village se repeuple donc à un bon rythme et efface les classes creuses du demi-siècle précédent. Au final, 21 années auront été marquées par un solde naturel négatif ou nul, soit 28 % de la période. Le résultat est proche de celui des années 1607-1654, mais le diagnostic est très différent. Entre 1712 et 1786, la démographie ne se dérègle pas, elle se régule à nouveau, après la crise dure et durable l’ayant précédée. D’ailleurs, deux dénombrements comptent enfin le nombre d’habitants en 1761 et 1780 : la population de Tressan serait passée entre ces deux dates de 274 à 349 habitants201. Bien sûr le meilleur côtoie le pire, comme c’est la règle pour les populations anciennes : 21 sépultures en 1762, 23 baptêmes en 1770. Néanmoins, les moments de solde négatif redeviennent ponctuels, avec seulement deux accidents démographiques en 1731 et 1776. Le pic de mortalité de 1776 est d’ailleurs le seul dont la cause est connue pour toute l’époque Moderne. Le curé Auguy avait alors noté dans l’acte de sépulture d’Antoine Cabassut du 4 septembre 1776, que ce dernier était « décédé le même jour âgé d’environ quatre ans n’aiant pù renvoier la sépulture l’enfant étant mort de la petire vérole très venimeuse »202. Onze jours plus tard, il inhume Joseph Bannes, là aussi avec empressement, parce que « mort de la petite vérole »203. Par la suite, Auguy émarge la mention « PV » chaque fois qu’il fait enterrer une victime de la petite vérole, forme très aiguë de la variole, affectant surtout les enfants. Finalement, l’épidémie aura frappé du 14 août au 22 septembre et causé avec certitude 12 des 13 décès de ce mois, faisant des victimes âgées en moyenne d’à peine plus de 6 ans204. Cette crise extrêmement brutale est heureusement sans lendemain et les 21 décès de l’année 1776 forment un pic, qui n’est désormais plus jamais atteint à Tressan.
Comme au cours de la période précédente, la nuptialité se maintient, avec 169 noces en 75 ans, à un niveau honorable de 2,2 mariages par an. Le phénomène de l’exogamie est en léger recul, puisque 37 % des maris sont extérieurs à la paroisse. Quant aux épouses, 93 % sont recrutées à Tressan. La volonté inconsciente de repeupler le village apparaît donc ici très clairement : quasiment aucun femme ne part se marier ailleurs. Et un couple conçoit alors 5,2 enfants en moyenne, signe de temps alors perçus comme meilleurs, en tout cas comme plus favorables pour élever une famille plus nombreuse. Il aura donc fallu 75 ans à Tressan pour se remettre de la crise de 1655-1711 et commencer à voir sa population augmenter à nouveau.
42
* L’absence de compoix après 1597 et jusqu’en 1770 était donc bien synonyme, à Tressan, du développement d’une profonde crise démographique. Le vieux cadastre de la fin du XVIe siècle nous avait déjà fait entrer dans les rues de Tressan et parcourir son terroir ravagés par les guerres de Religion. Les registres paroissiaux complètent et prolongent un tableau au demeurant assez sombre. Les années 1607-1654 semblent bien ici les dernières où, malgré une population qui commence à être assaillie par la mort, le village traverse des moments d’embellie démographique. Comparée à cette époque déjà difficile, la période 1655-1711 porte le sceau de plomb d’années terribles, qui font s’abattre sur Tressan un dépeuplement sans doute sans précédent depuis les années 1350-1450. Ensuite, les années 1711-1782 remettent, non sans rudes à-coups, le village sur le chemin de la récupération. Cette montée de la vie, très nette après 1770, correspond à la date de mise en service du nouveau compoix de Tressan, commandé par la communauté en 1766. Le village, pris dans la tourmente durant un siècle et demi, en sort au moment même où la viticulture connaît, dans le terroir et la région alentour, une expansion spectaculaire. La coïncidence est plus que troublante : elle amène à se demander si, finalement, le développement du vignoble n’est pas la réponse trouvée par les Tressanais pour sortir, vers 1770 justement, de la spirale d’une crise interminable.
43
Chapitre III.
1770-1914 : NAISSANCE ET AFFIRMATION
DU TRESSAN VITICOLE.
Le fait majeur du siècle et demi succédant à la tourmente qui a balayé Tressan reste l’élévation progressive du niveau de vie des habitants grâce aux progrès de la viticulture. De 1750 à 1914, trois étapes se sont succédées. Au terme de chacune d’elles, la vigne avait conquis, dans le village, de nouveaux espaces et un nombre plus grand de propriétaires.
Or, des mécanismes ayant diffusé la vigne et la viticulture dans la plaine languedocienne avant les années 1870, les études historiques se contentent bien souvent de signaler la monoculture comme acquise vers 1850-1860, lorsque se met en place dans notre région le réseau des voies ferrées205. Constat certes valable, mais insuffisant…
44
I) LE DEMARRAGE VITICOLE : 1770-1830.
Le démarrage viticole de Tressan -et à plus forte raison celui de la vallée de l’Hérault- ne s’est évidemment pas fait au milieu du XIXe siècle et du jour au lendemain. Il est antérieur, les documents le prouvent, à 1800. Il peut être daté de manière sûre de 1770, date de mise en service du nouveau compoix de la communauté, qui décrit très précisément l’occupation du sol à cette époque.
1- LES ANNEES 1770 : LE DEBUT DE LA FIN DE LA POLYCULTURE TRADITIONNELLE.
L’analyse du compoix de Tressan de 1770 offre à notre connaissance un village en train de changer. Si l’espace bâti est mieux décrit qu’en 1597, il sort d’une période de longue crise démographique. Quant au vignoble, s’il apparaît bel et bien conquérant dans le terroir, l’agriculture alors pratiquée n’en conserve pas moins des aspects traditionnels, même si ces traits-là tendent sans doute à s’estomper.
Un village en train de se remettre debout. On vient de le voir, Tressan se repeuple nettement après 1763, malgré un dernier pic
de mortalité en 1776. En 1770, la population avoisine sans doute les 300 habitants206. Grâce à un questionnement rapide du compoix, il est à nouveau possible de savoir précisément dans quel cadre de vie évoluent ces Tressanais.
Nature du bâtiment Nombre %
bâtiment en construction 3 1,8 cazal 9 5,4 maison 76 45,8 maison et bâtiment agricole 1 0,6 maison et bâtiment d’élevage 12 7,2 maison, bâtiment agricole et d’élevage 1 0,6 bâtiment agricole 29 17,5 bâtiment d’élevage 34 20,5 bâtiment agricole et d’élevage 1 0,6 Total 166 100,0
Tableau n° 5 – Les bâtiments de Tressan d’après le compoix de 1770. Si on se fie au seul total du tableau, il semble bien que le village n’a pas changé depuis la fin du XVIe siècle, car il est toujours couvert par 166 bâtiments. Mais, la réalité est toute autre et Tressan n’est plus le même en 1770 qu’en 1597. En effet, il ne reste plus que 76 maisons, 90 en comptant celles associées à une écurie ou un pigeonnier, contre 110 avant 1600. La preuve est donc définitivement faite du dépeuplement montré par les registres paroissiaux. Les traces du repeuplement sont encore maigres avec seulement trois bâtiments commencés depuis peu. En revanche, les resserres agricoles et d’élevage se sont multipliées dans l’environnement villageois : les greniers à paille et les remises sont nombreuses, ainsi que les bâtisses abritant des animaux207. Comme en 1597 néanmoins, l’espace bâti conserve des fonctions propres à chaque quartier.
Nature du bâtiment Nombre %
1 – Le village : « dans les murs » maison 48 76,2 maison et bâtiment d’élevage 3 4,8 cazal 3 4,8 bâtiment agricole 4 6,3 bâtiment d’élevage 5 7,9 Total 63 100,0
2- Les Barris. maison 28 30,8 bâtiment en construction 3 3,3
45
maison et bâtiment agricole 1 1,1 maison et bâtiment d’élevage 8 8,8 maison, bâtiment agricole et d’élevage 1 1,1 cazal 3 3,3 bâtiment agricole 20 22,0 bâtiment d’élevage 26 28,6 bâtiment agricole et d’élevage 1 1,1 Total 91 100,0
3 – Le reste du terroir. cazal 3 25,0 bâtiment agricole 5 41,7 bâtiment d’élevage 3 25,0 maison et bâtiment d’élevage 1 8,3 Total 12 100,0
Tableau n° 6 – Les bâtiments par quartier d’après le compoix de 1770. Ces fonctions restent les mêmes qu’à la fin du XVIe siècle et n’appellent pas de longs commentaires. Le village intra muros garde ainsi une fonction résidentielle, même si le dépeuplement récent a permis l’intrusion dans les murs de bâtiments agricoles et d’élevage. Une telle nouveauté respecte cependant la salubrité publique, puisque ces bâtisses sont uniquement des paillers, des écuries et des pigeonniers. Les Barris se chargent eux aussi d’une fonction importante d’habitat, évidemment, mais aussi des bâtiments toujours rejetés à l’extérieur des murailles du lieu : basses-cours, volaillers, loges à cochon et bergeries. A la différence de 1597, les écuries, les magasins, les remises et les greniers à paille ont littéralement envahi l’espace et témoignent d’une agriculture sans doute retournée aux céréales pendant la crise démographique. Le « reste du terroir », en ce qui concerne le bâti, s’est nettement rapproché du clocher et ne s’éloigne jamais du replat du coteau. Sans rentrer dans les détails, les Barris conservent le même caractère agreste que vers 1600 : ils sont parsemés de 25 aires à battre le blé, d’une cinquantaine de champs minuscules souvent arborés, de quelques farrejals, d’une poignée de creux à fumier et d’à peine seize jardins. Le jardinage semble d’ailleurs en plein recul, puisque neuf autres horts seulement sont disséminés dans le terroir. Les degrés de qualité du bâti permettent aussi de cerner un phénomène jamais mesuré jusque-là : l’état du village. En 1770 en effet, les agents cadastraux ont estimé 90 % des bâtiments, quelque soit leur nature, de qualité moyenne ou faible. Cette médiocrité du bâti est très forte intra muros et montre que le cœur médiéval de Tressan s’est probablement dégradé au cours de la crise démographique précédente. Quant aux façades conservées de la seconde moitié du XVIIIe siècle, visibles par exemple sur l’actuelle place de l’Eglise, elles ne portent pas encore d’empreinte spécifique, alors que le terroir est en train d’opérer un net revirement vers la viticulture.
Un vignoble déjà massif. Malgré tout, un réel partage des masses culturales est attesté :
Nature Nombre Hectares % ha
1 – Les cultures sèches : 1052 articles ; 309,44 ha ; 87,2 % du terroir.
champ 174 31,58 8,9 champ arboré 400 127,12 35,8 vigne 403 114,09 32,3 vigne arborée 4 2,61 0,7 luzerne 56 25,32 7,1 luzerne arborée 14 8,60 2,4 mûriers 1 0,12 0,0
2 – Les cultures arrosées : 40 articles ; 2,69 ha ; 0,7 % du terroir.
jardin 25 1,15 0,3 farrejal 11 0,32 0,1
46
prés 4 1,22 0,3 3- L’inculte :
277 articles ; 42,74 ha ; 12,1 % du terroir. brouas208 6 0,31 0,1 herme 162 14,82 4,2 gravier 31 8,95 2,5 rivage 59 14,26 4,1 riveiral 18 4,40 1,2 Total 1369 354,87 100,0
Tableau n° 7 - L’occupation du sol à Tressan d’après le compoix de 1770. Le vignoble tressanais constitue clairement une des principales productions agricoles du terroir, puisqu’il en accapare presque 117 ha et 32,8 %, pratiquement le tiers. Quelle est la place réelle de la vigne dans ce tableau de l’occupation du sol ? Bien plus importante encore que ne le suggèrent les chiffres bruts livrés dans le tableau. En effet, la surface agricole utilisée couvre 312,13 ha, ce qui relève la part du vignoble 37,4 % de cette superficie. En outre, la jachère biennale demeure la première règle de la céréaliculture209, ramenant à 232,93 ha la surface agricole réellement utilisée année commune et portant l’emprise au sol du vignoble à 50 % exactement de ce chiffre. C’est exactement la même proportion de vignes que dans le domaine voisin de l’Estang du Pouget, appartenant au seigneur de ce lieu, où poussent, en 1760, 133 sétérées de ceps210. Pour autant, ce vignoble, si important puisse-t-il sembler, n’en conserve pas moins certains traits caractéristiques de l’Ancien Régime. Et les rendements viticoles alors obtenus en témoignent de manière criante. Ainsi, en 1774, Tressan aurait produit 407 muids211, soit un rendement moyen de 24,9 hl par ha. Un procès entre Tressanais -aboutissant en 1777- a donné lieu à la publication d’un mémoire. D’après le document imprimé, les vignes produiraient d’ordinaire dans le terroir un demi-muid par séterée cadastrale212, soit 13,8 hectolitres à l’hectare. Quelques années plus tard, en 1790, le tiers de la dîme de la paroisse s’élève, entre autres gros grains, à six muids de vin213, soit 198 muids pour le terroir. Si ce dernier était toujours planté de 115 hectares de vignes environ, le rendement serait de l’ordre de 12 hl par ha. Ces faibles rendements correspondent à ceux donnés par Emile Appolis pour le Lodévois tout proche214. Ils s’inscrivent dans la moyenne languedocienne des rendements viticoles d’avant Révolution, qui étaient vraisemblablement de 15,5 hl par ha215. Des chiffres si modestes soulignent que la viticulture du XVIIIe siècle était encore rudimentaire216. De la même façon, la persistance de la mixité des cultures est une spécificité de l’agriculture alors pratiquée, même si les exemples de vignes complantées se raréfient. Celles arborées se comptent sur les doigts d’une main dans le compoix de 1770 : deux vignes avec des amandiers, une avec des arbres fruitiers et une avec des chênes verts217. En revanche, les parcelles continuent d’évoluer et en 1781, d’ailleurs, deux particuliers sont accusés de laisser se dégrader une « olivette & vigne (...) contenant environ deux ceterées »218. Si le vignoble tressanais peut encore sembler archaïque, plusieurs éléments de nouveauté permettent toutefois de nuancer le propos et d’affirmer qu’à cette époque la viticulture est certes traditionnelle, mais en cours de mutation. La première de ces mutations réside dans la localisation même du vignoble au sein d’un terroir facile à reconnaître, grâce au coteau qui domine la vallée de l’Hérault et porte les toits du village. En recourant aux plans parcellaires de 1770 accompagnant le compoix, on constate bien vite que les vignes s’enracinent alors profondément dans la plaine. Le coteau et ses versants sont notoirement délaissés par des ceps dont la plantation a été menée aux abords du cours d’eau, à l’ouest du terroir, entre ses rives et un peu au-delà du Cami Ferrat de Gignac à Pézenas. Là, les terres sont relativement planes et riches : la vigne occupe du tiers à la presque totalité de la surface des tènements de cet espace. Par endroits, le paysage est donc très proche de ressembler à celui d’un vignoble de masse, mais par endroits seulement. La mutation est donc de taille : en 1770, la descente de la vigne dans la
47
plaine est déjà presque acquise. Cette descente est aussi significative d’une extension de la viticulture, stimulée depuis une génération par la pratique croissante de la distillation219. Sans doute faut-il nuancer pour Tressan les conclusions données par A. Soboul pour la plaine du Montpelliérais où « la vigne gagne de nouvelles terres, (…) moins que sur les coteaux et dans les combes des garrigues »220. En effet, le Piscénois, comme alors le Lunellois ou la Vaunage, brûlent intensément leurs vins de piètre qualité pour les convertir en eaux-de-vie221. Le diocèse de Béziers est d’ailleurs celui où l’on dénombre alors le plus de chaudières et il produit la plupart des pièces d’alcool expédiées par Sète222. La conjoncture est donc très favorable à l’extension du vignoble languedocien dès les années 1730-1740. Au marché de Gignac, le prix du vin nouveau apparaît ainsi dans les mercuriales en 1734, preuve supplémentaire de l’engouement viticole naissant223. Cette conjoncture touchait donc largement Tressan en 1770 et motiva le développement sensible de la viticulture dans la vallée de l’Hérault. Quels en furent les effets ? Dans ce terroir, l’économie agricole fut ainsi clairement tournée, bien avant la Révolution, vers plus de spéculation et misa, précisément, sur les revenus de la viticulture. Mais, ce pari audacieux fut-il alors relevé aveuglément par le plus grand nombre ou de façon clairvoyante par quelques-uns ? Une rapide interrogation du compoix de 1770 permet de répondre très précisément à cette question :
Propriétaires de vignes
Nombre d’articles
Ha de vignes
% de vigne dans la propriété
% du vignoble tressanais
ha de vigne par propriétaire
< 5 ha 69/86 241 58,65 36,5 51,8 0,85 5-20 ha 18/18 153 51,02 36,4 45,0 2,83 > 20 ha 2/2 13 3,63 17,9 3,2 3,63 Total 89/106 407 113,30 35,3 100,0 1,29
Tableau n° 8 - La vigne dans les propriétés à Tressan d’après le compoix de 1770. Tout d’abord, 88 des 106 propriétaires possèdent des vignes, soit 83 % de la
population cadastrale. Un chiffre aussi élevé démontre la diffusion très avancée du vignoble dans la société villageoise. Constatons en même temps l’absence de grande propriété à Tressan à cette époque, deux propriétaires seulement possédant à peine plus de vingt hectares chacun, biens nobles compris. Nous sommes loin de terroirs où furent taillés de vastes domaines, comme celui de Pierre Riban, notable montpelliérain possédant presque 40 ha à Pérols en 1763224. Le défaut de voisinage d’un gros bourg ou d’une ville joue donc fortement en faveur d’une structure foncière morcelée entre une foule plus grande encore de petits propriétaires. A Tressan, pas de M. de Duché, procureur général à la Cour des Comptes de Montpellier, possédant presque 90 hectares à Villeneuve-lès-Montpellier. Pas de marquis de Montlaur non plus et ses 201 hectares détenus à Saint-Hilaire225. Les deux seuls bientenants de plus de vingt hectares possédant vigne représentés à Tressan, François Auger et le seigneur, possèdent d’ailleurs 3,2 % à peine du vignoble tressanais. Et la vigne met en valeur moins du cinquième de l’ensemble de leurs biens non bâtis. Tout comme Pierre Riban, à Pérols, ne consacrait alors que 18,5 % de sa propriété à la viticulture226. A Gigean, la vigne occupe 11 % des deux propriétés de plus de 40 hectares227. A Tressan, à cette époque, la viticulture est surtout l’activité reine des petits propriétaires, ceux possédant moins des cinq hectares nécessaires et suffisants à l’indépendance économique d’une famille228. Ils y consacrent 36,5 % de leur propriété et détiennent, tous ensemble, la majorité du vignoble du village, 52 % exactement. Chacun d’entre eux possède à peu près trois ou quatre vignes, chacune d’une sétérée environ (2500 m²). La moyenne propriété, enfin, constitue quant à elle une catégorie intermédiaire à peine moins impliquée dans l’expansion du vignoble que la petite propriété. A tout prendre, le pari de la viticulture fut donc relevé à Tressan en 1770 par le plus grand nombre, celui des petits propriétaires si souvent décrits comme les plus dynamiques au cours de cette période d’expansion viticole. En cela, Tressan participe pleinement des tendances
48
languedociennes229. La vigne infiltre ainsi par le bas toute une structure villageoise. Un village même, comme en attesterait un bref aperçu du bâti tressanais dans les années 1770230. La vigne reste donc une composante habituelle de la polyculture traditionnelle alors pratiquée, traditionnelle avant tout par son entretien et ses résultats. Mais, la vigne est aussi, à ce moment-là, la première composante de cette polyculture, tant par le paysage qu’elle fait naître ici et là que par les petits paysans ayant misé sur elle. L’élément de nouveauté, une génération avant la Révolution, demeure dans la définition par la vigne même de l’identité d’un nombre important de petits propriétaires. Les autres cultures ne font pourtant pas encore figure de parent pauvre au sein des productions locales. D’autres productions solidement représentées.
En 1770, les champs et les champs complantés occupent encore près de 160 hectares dans le terroir agricole (50,8 %), mais c’est un chiffre maximum. En 1597, dans un compoix amputé de 150 hectares, la composante céréales en envahissait déjà presque 130, soit les deux tiers du terroir connu. Les blés sont donc recul à la fin du XVIIIe siècle, d’autant plus que seule une minorité de champs, moins de 32 hectares, n’est pas complantée contre presque 130 hectares arborés. La persistance du complant est d’ailleurs particulièrement visible dans l’agriculture alors pratiquée à Tressan. Les arbres font alors de l’ombre en très grande partie dans les champs, mais aussi un petit peu dans quelques luzernes (14) et quelques vignes (4). Comme le compoix de 1770 a été réalisé avec minutie, la nature des arbres en question est connue avec une assez grande précision.
Arbres Nombre d’articles
Ha
oliviers 293 107,70 amandiers 155 58,58 mûriers 36 6,63 cerisiers 15 4,19 fruitiers 7 1,09 noyers 1 0,07 figuiers 1 0,29 Total 419 137,22
Tableau n° 9 – L’arboriculture à Tressan en 1770. Evidemment, le total du tableau présenté est inférieur à l’addition de chacune de ses lignes, qui se monterait à près de 180 hectares. En effet, très fréquemment, les arbres complantés dans les champs ne sont pas d’une seule espèce : on trouve ainsi un champ de 0,69 hectare dans lequel poussent des oliviers, des amandiers et d’autres arbres fruitiers. Comme cela a été fait pour le compoix de 1597, cette parcelle a été comptée trois fois, dans trois lignes différentes du tableau. Le caractère quasi-inextricable des arbres dans les champs, de même que l’impossibilité de les localiser et de les compter dans chaque parcelle soulignent l’importance toujours d’actualité du complant en 1770. Quant aux arbres plantés dans les jardins des particuliers, c’étaient sans doute des pêchers, des abricotiers, des pommiers, des poiriers et des pruniers, à l’image de ceux poussant dans le verger de la seigneuresse en 1784231. L’arboriculture touche finalement 419 articles de compoix et 137,22 hectares du terroir (38,6 %). Dans ce vaste verger tressanais, l’olivier est le grand perdant si l’on compare sa situation avec celle de la fin du XVIe siècle. Les presque 110 hectares de parcelles supportant des souches d’oliviers ne doivent pas faire illusion. Seulement trois véritables olivettes sont en effet signalées dans le compoix : elles appartiennent toutes les trois au seigneur, se trouvent aux Vignaux et à Fontenilles et couvrent moins d’un hectare chaque fois semé en luzerne232. La structure de l’oliveraie villageoise a donc fortement évolué, puisque les olivettes « pures » couvraient 35 hectares en 1597. Les oliviers sont en outre largement remontés sur la colline et ses versants, sauf à Garrigues et Gaupeirous, et
49
ont abandonné la plaine à la vigne. Concession à la mode agricole languedocienne, les mûriers constituent quant à eux une véritable nouveauté dans le paysage rural233. Leur apparition à la fin du XVIIIe siècle correspond nettement à l’expansion du marché de la soie, dont la production trouve pourtant son berceau dans « la région cévenole et pré-cévenole, de Ganges à Saint-Ambroix », le vrai pays de la magnanerie234. Finalement, la place importante des parcelles arborées dans le paysage souligne bien la coexistence, en 1770, d’une agriculture traditionnelle et d’une viticulture conquérante qui, partageant le même terroir, ne se rejettent pas pour autant. La fin des années 1700 marque donc bien un moment de transition dans l’histoire du village, ce qui est tout sauf une surprise.
La vague des luzernes et la place de l’élevage. En revanche, la place du fourrager dans les productions agricoles et des luzernes en
particulier constitue une grande nouveauté en comparaison avec la fin du XVIe siècle235. Les luzernes, arborées ou non, couvrent pratiquement 34 hectares en 1770, auxquels doivent s’ajouter 5,5 hectares de parcelles fourragères (prés, farrejals, esparcets236, etc…). Le Biterrois est d’ailleurs pris dans une véritable fièvre des luzernes, où leur culture devient « culture du plein champ »237. Ayant besoin d’humidité, parfois irriguées, on ne s’étonnera donc pas de les trouver pour moitié au bord de l’Hérault et pour moitié dans la plaine de l’Estang. En revanche, l’entretien des luzernes, fauchées quatre à six fois par an, coûte cher en main-d’œuvre à ses propriétaires, comme à ceux de la ferme de Saint-Pierre, près de Béziers238. Seules quelques personnes aisées semblent à première vue pouvoir en cultiver. A Tressan, c’est la famille Auger, dont le père, François, est richement possessionné et viguier239 de la communauté, ou bien les Fabre, dont les deux frères Jean et Marc, sont respectivement bourgeois et négociant en vin. Surtout, le seigneur, Carrion de Murviel, détient à lui seul près de 20 hectares des luzernes du terroir, où il est par ailleurs le plus important propriétaire foncier. Pour des raisons évidentes d’économie, les détenteurs de luzerne adoptent alors une véritable stratégie agricole. Ainsi, 71 % des luzernes tressanaises poussent sur des terres nobles et échappent donc aux impôts directs, calculés pour chaque contribuable en fonction de sa fortune foncière non noble. Quant aux 29 % restants, ils sont tenus par quelques propriétaires modestes : dans ce cas précis, chacun possède alors une petite luzerne, guère plus. Dans la mesure où le tri des graines et les ségades240 demandent beaucoup de temps ou d’argent, les possesseurs de luzernes cherchent évidemment à minimiser leurs frais d’exploitation. Du coup, on comprend aisément que la production notable de fourrages à Tressan ne vient pas servir un fort élevage local, mais est vraisemblablement destinée au commerce. En effet, la fin du XVIIIe siècle languedocien se caractérise, dans les campagnes, par un recul marqué des troupeaux face au grand débord des cultures en général et de la vigne en particulier241. La luzerne et les fourrages sont donc sans doute très recherchés sur les marchés de la province242. En regard des progrès de la viticulture et des fourrages, l’élevage reste très limité à Tressan dans les années 1770 et 1780. Le compoix seul ne permet pas en effet de savoir exactement quelles bêtes sont élevées et en quelle quantité ; il donne juste la liste des bâtiments ou parties de bâtiments réservés aux animaux.
Bâtiment Nombre m²
basse-cour 13 1248 pigeonnier 4 845 volailler 1 24 volailler et loge à cochon 2 28 loge à cochon 3 28 bergerie 2 224 écurie 10 403 écurie associée à un autre bâtiment 11 838 Total 46 3638
50
Tableau n° 10 – Les bâtiments d’élevage à Tressan en 1770. Trois élevages villageois coexistent en 1770. En premier lieu, l’entretien de certains animaux relève peut-être d’une certaine forme de luxe. Les pigeons, par exemple, ne sont plus élevés par les seigneurs qui étaient les seuls autorisés à le faire243, mais plutôt par des notables villageois. Les quatre pigeonniers tressanais appartiennent en effet au seigneur, Carrion de Murviel, lieutenant du Roi en Languedoc ; à François Auger, bourgeois et viguier du lieu ; à Jean-Louis Chauvet, conseiller244. Seul Fulcrand Cabanel, un temps second consul, ne semble pas si « notable » que cela, mais reste un propriétaire aisé245. Dans tous les cas, ces pigeonniers se trouvent dans les murs du village et sont systématiquement associés à la maison d’habitation de leurs propriétaires. Il en va différemment des loges à cochon, peu nombreuses, pas forcément entre les mains de notables, situées dans les Barris et à Fonrascasse, c’est-à-dire à distance respectable du village intra muros, pour de probables raisons d’hygiène publique. A Salasc par exemple, à la même époque, les cochons divaguant dans les rues et dans le terroir risquent un coup de fusil, à cause des dégâts qu’ils occasionnent aux récoltes et aux plantes246. De toute manière, le nombre de porcs va en diminuant dans tout le royaume247. Cela semble aussi le cas dans le sud-est du diocèse de Lodève après les années 1650248.
En second lieu, à côté de cet élevage « rare » se développe un élevage très commun, celui des volailles, qui s’ébrouent alors dans treize basses-cours ou se resserrent dans trois « volaliers » ou poulaillers. Les « poules, chapons, canes et coqs formaient le tout-venant de l’élevage paysan » et servaient l’économie de la maisonnée tressanaise249. A Tressan comme dans la vallée de l’Hérault ou le Bas-Languedoc rural, les différentes volailles ne faisaient sans doute pas l’objet d’un commerce spéculatif, contrairement à celles « de Caux, du Mans ou de Bresse »250. Assez nombreuses sans doute, les poules et autres volatiles amélioraient probablement le pain quotidien des villageois. Commun aussi, mais limité en nombre, l’élevage ovin était peut-être plus mixte, à la fois destiné à la consommation sur place et à un proche commerce : Guillaume Cabassut, propriétaire d’une bergerie, est boucher au village251 ; Carrion de Murviel, seigneur de Tressan, possède l’autre. Mais, les deux seules bergeries du compoix soulignent à quel point l’élevage de moutons restait assez discret à Tressan à la fin du XVIIIe siècle. La vie des bêtes à laine dans un terroir massivement tourné vers les productions végétales paraît avoir été particulièrement délicate. En effet, nous ne sommes pas ici dans certains villages du Lodévois, aux terres largement couvertes de bois et de garrigues et ouvertement consacrées à l’élevage ovin, en particulier sur le Larzac et les ruffes du Salagou252. Le manque de place pour les brebis et l’encombrement agricole entraînent inévitablement des conflits entre particuliers. Ainsi, le fils de Guillaume Cabassut, dit Perdigal, l’un des deux possesseurs de bergerie de Tressan, à peine âgé de 11 ans est agressé le 24 juin 1781 à 7 heures du matin, alors qu’il « gardoit son troupeau dans un ratouble253 appartenant aud(it) Cabassut [père] »254. Quant à François Mayran, l’agresseur, il se défend en accusant sa victime d’avoir fait dépaître ses bêtes « au contraire dans une pièce de terre olivette appartenant à lui (…) & lui faisoit dévorer (…) les arbres dont lad(it)e pièce est complantée »255. Les experts, dépêchés dans l’olivette qui se trouve au Mourre, constatent bien que les menus branchages de sept petits oliviers, un amandier et un cerisier plantés dans l’année ont été endommagés, mais « ils n’ont été coupés que par la main de quelque personne »256. Un autre problème a lieu au printemps 1782 : « le troupeau de Guilhaume Cabassut (…) est atteint de la clavelée (…) cette maladie se communique aux autres troupeaux. (…) En conséquence (…) le troupeau dudit Guilhaume Cabassut sera cantonné dans le terroir (…) au tènement de la Viste et Lencire »257. Autres troupeaux ? On peut être surpris, car leur nombre doit se limiter au mieux à une poignée en ces années 1770-1780. Même si aucune enquête ni document d’époque ne dénombre exactement les moutons et les brebis du village, il est possible de savoir à peu
51
près qui en possédait. En 1772, outre Guillaume Cabassut et le seigneur, Jean Audouard, d’Aspiran et Antoine Casse, d’Alès, font office de bergers des héritiers de Marc Fabre258. En tout, trois troupeaux ovins seulement sont sans doute entretenus à Tressan, mais il demeure impossible de fixer le nombre de têtes qui les composent. Toutefois, un arrêt du Parlement de Toulouse est précieux, car il impose aux Tressanais de détenir au plus deux bêtes à laine par livre de compoix259. Avec une cote d’imposition de 225 livres, les habitants sont donc autorisés à élever au plus 450 ovins. Ils disposent pour se nourrir du produit des quatre prés, des quatorze farrejals et peut-être de quelques luzernes portées au vieux cadastre. Ils peuvent aussi dépaître dans les biens de leurs propriétaires et surtout dans la plaine de l’Estang après les récoltes, si ce droit de la communauté signalé en 1687 reste valable et s’applique aux particuliers260.
Le même problème quantitatif se pose avec le troisième type d’élevage alors pratiqué, celui des équidés et des asinés. Avec 21 écuries, souvent associées à une maison, le rôle important du cheval ou du mulet dans la vie villageoise est souligné. S’il est possible que des chevaux aient alors été possédés par quelques Tressanais, la préférence des habitants va probablement à la fin du XVIIIe siècle au mulet, particulièrement apprécié à cette époque à travers le Bas-Languedoc. Le Lodévois, le Toulousain et le Narbonnais sont alors conquis par un animal littéralement bon à faire tous les travaux agricoles et de transport261. Les consuls du village en témoignent d’ailleurs indirectement en 1777, quand ils expliquent qu’« on ne peut transporter les fumiers aux terres qu’à dos de mulet » sur les parcelles mal desservies du terroir262. Pour les environs de Pézenas, le subdélégué Portalon va dans le même sens : « on ne se sert que de mullets ou mulles pour la culture des terres »263. Tous ces mulets vivent à proximité de leurs maîtres, dans des écuries toutes localisées dans le village et son auréole bâtie. Quant aux chèvres, elles sont absentes du terroir, dans la mesure où une ordonnance de 1725 en interdit la possession : les animaux sont estimés trop voraces. Des experts, envoyés dans la région, motivent cette décision : « nousd(its) experts nous sommes transportés aux comm(unau)tés de Vendemian, du Pouget, de St Amans, de St Bauzile, de Tressan, de St Paragoire, de Campagnan, de Belarga, a celle d’Adissan et a celle de Fontés (...), dans lesquelles d(ites) comm(unau)tés et terroirs dicelles, nous avons veriffié et estimé, qu’on ne peut y tenir aucune chevre sans porter préjudice aux arbres fruitiers, olliviers, vignes et bois taillifs en dependants »264. Ainsi, seuls les habitants du Mas de Ratte (Gignac) et ceux d’Aumelas, au milieu des garrigues, sont autorisés à en tenir respectivement 50 et 1420265. Dans l’ensemble, l’Ordonnance de 1725 sur les chèvres semble avoir été bien respectée. A travers le compoix de 1770 et d’autres documents, la viticulture apparaît donc déjà très conquérante à la fin du XVIIIe siècle. Les petits propriétaires commencent à pousser le terroir et les Tressanais à délaisser la polyculture traditionnelle, encore préservée par certaines pratiques agricoles comme le complant. Mais, avec la Révolution, l’agitation politique gagne l’Hérault et touche son économie, qui connaît des moments difficiles, prolongés par le poids des guerres de l’Empire. La conquête viticole est-elle pour autant affectée par les troubles nés de 1789 ?
2- ANNEES 1780-1805 : PREMIERES DIFFICULTES VITICOLES.
Premières surproductions ? et chutes des prix du vin… Face à l’ampleur de l’élan viticole régional, des esprits éclairés, mais anonymes,
faisaient part dès 1781 de leurs Reflexions sur la trop grande quantité de vignes. Derrière ces réflexions, deux craintes apparaissent : l’ancestrale inquiétude de manquer de céréales et celle, très lucide, des dangers d’une possible surproduction266. Notre notable inconnu s’angoisse : « les nouvelles plantations se sont multipliées à l’infini, le voyageur etonné n’apperçoit que des vignes la ou il n’avoit vû que des champs, des bois et des paturages. (...) Autrefois (...) on ne
52
plantoit des vignes que dans des fonds ou le grain avoit peine a germer (...). La liberté du commerce a donné à cette denrée une valeur qui a surpris nos attentes »267. Grâce à l’article fondateur de L. Dermigny sur le prix du vin en Languedoc, il est aujourd’hui possible de replacer les propos de notre auteur dans un contexte de crise viticole touchant la province aux alentours de 1780268. De celle-ci naît « un malaise social quand, à la fin de l’Ancien Régime, le pouvoir d’achat des vignerons diminue en moyenne de 22 % »269. Mais à Tressan, aucune source ne nous renseigne directement sur les conséquences de cette chute du cours du vin sur le développement viticole. Des pétitionnaires de villages proches de Tressan se réunissent pourtant à l’hôtel de ville de Pézenas le 3 mai 1783, afin d’adresser une remontrance à l’intendant de Languedoc. Ils se plaignent de la tentative sétoise de mise en place d’un entrepôt, jugée menaçante pour le commerce local du vin, « denrée devenüe le principal revenû de cette contrée »270. Si une crise survenait, elle toucherait ainsi, d’après les protestataires, une large part de la population rurale du Piscénois, d’autant plus que « les travaux des vignes occupent infiniment plus d’ouvriers que les terres labourables »271. Et cette crise ne manque pas de survenir : en 1782-1788, le pouvoir d’achat du vin en blé a baissé de presque 35 % par rapport à 1768-1774 au marché de Béziers 272. Cela est probablement le cas au marché de Gignac, tout proche de Tressan, même si les données manquent après 1771, tant les courbes des mercuriales de Gignac et de Béziers se ressemblent par ailleurs273. Dans la plaine languedocienne et dans la moyenne vallée de l’Hérault, la conjoncture s’inverse : la vigne nourrit désormais moins bien son homme. Heureusement, le recours au vin de chaudière, c’est-à-dire à l’eau-de-vie, a probablement soulagé les petits propriétaires de vigne du risque de surproduction et de la baisse des prix qui en résulte habituellement. Le commerce des eaux-de-vie était déjà un débouché important pour les vins languedociens en 1768, puisqu’un anonyme signalait à cette époque que la province en vendait pour 5 millions de livres tournois contre 1,5 millions cinquante ans plus tôt274. Les pétitionnaires du Piscénois de 1783 pensent que la création de l’entrepôt de Sète « serait une très grande perte pour le cultivateur qui n’a d’autre debouché pour ses vins que la fabrication des eaux de vie », surtout en contexte de baisse des cours du vin275. Mais, la production continue à tenir bon et le président et les commissaires de la Chambre de Commerce de Montpellier peuvent, en 1786, se féliciter auprès de l’Intendant « des progrés du commerce des eaux de vie, dont il a êté expedié cette année du même port [de Sète] et à la dernière saison, environ cinquante mille pièces pour l’Etranger »276. Ces mêmes « pièces » étaient à peine plus de 12000 en 1754277. Avant 1789, les toutes premières difficultés viticoles mises en évidence par L. Dermigny aux alentours de Béziers et de Gignac sont réelles, mais le recours à la distillation permet sans doute de les atténuer nettement. La distillation est par exemple une pratique connue dans le village voisin du Pouget, où 429 muids de vin, soit environ 3000 hectolitres, furent brûlés en 1789 par divers particuliers278. En 1773, à Puilacher, autre village limitrophe, le seigneur loue ses terres et autorise à placer des chaudières dans le moulin ou le jardin du château pour faire de l’eau-de-vie279. Tressan n’échappe probablement pas à une telle évolution, d’autant que quelques négociants en vin y vivent, dont Marc Fabre, propriétaire d’une distillerie au village et partie prenante à la création d’une autre en Roussillon280.
La progression viticole bloquée par les années révolutionnaires. Le premier document à témoigner de l’état d’avancement de la conquête viticole et
de ses mécanismes ne se fait pas attendre : il s’agit des Etats de sections de la commune. A Tressan, il existe des Etats de sections datant de 1791 et 1792281. On préférera les derniers aux premiers pour respecter quelques menues modifications apportées par les agents fiscaux. En effet, le revenu imposable de certains particuliers en 1791 a été corrigé dans les Etats de sections de 1792282. Cette source est bien entendu précieuse, mais elle n’alimente
53
hélas pas directement notre connaissance du passé viticole. En effet, le document indique uniquement le revenu imposable de chaque parcelle, sans préciser la nature de sa mise en valeur. On sait aussi que la population du village est passée de 274 à 407 habitants entre 1761 et 1792, soit une hausse démographique de l’ordre de 50 %283. Si le nombre des propriétaires a augmenté à proportion, on devrait désormais en compter 150 environ. Or, les états de section de 1792 enregistrent 108 propriétaires contre 106 en 1770… Que penser d’un tel chiffre ? Les débuts de la Révolution sembleraient avoir bloqué le processus de multiplication des propriétés. Cela semble aussi assez conforme à la difficile ambiance économique née au tout début de l’année 1789 et marquée par une vie chère, renchérie encore, après 1790, par le maintien du cours des assignats284. A Pérols, par exemple, la disette menaçait la commune en 1793, alors que le prix du setier de froment était passé au marché de Montpellier de 12 à 29 livres entre novembre 1790 et avril 1793 (+ 4,7 % par mois)285. Le Directoire sonne heureusement le glas au cours de l’année 1797 de ces années révolutionnaires inflationnistes et rudement vécues par l’Hérault286. Le bilan économique et humain de cette courte période fut donc un peu partout désastreux dans le département. Le blocage du nombre des propriétés à Tressan en 1792 paraît en porter l’écho287. Les petites propriétés restent légion et ceux participant à 1 % et moins des contributions directes de la commune constituent presque 80 % de la population cadastrale288. Les listes de contribuables fonciers de 1770 et 1792 permettent une brève analyse du destin des propriétés. A Tressan en 1770, on trouve 106 propriétaires et 54 noms de famille. Vingt-deux ans plus tard, les Etats de Section livrent 58 noms de famille, soit une augmentation de 7,4 %. Mais, dans le même temps, 14 des 54 noms de famille du compoix ont disparu, soit une perte sèche de presque 26 %. Avec la Révolution, Tressan traverserait alors une crise des propriétés aussi ravageuse que celle née de la Grande Peste et de la guerre de Cent Ans… Les chiffres auxquels nous confrontent ce test exigent donc de pousser plus avant les investigations. En 1792, la plus grosse cote foncière est celle d’un certain Spinola, noble génois marié en 1768 à la fille unique de Carrion de Murviel, seigneur du lieu : Gabrielle succéda à son père Henri en 1784289. Or, en 1770, le seigneur était déjà le plus gros contribuable du village, biens nobles compris ou non. Quant aux familles les plus possessionnées en 1770, elles le demeurent en 1792, avec un nombre de parcelles comparable à celui qu’elles possédaient dans le compoix. En 1792, les temps ne semblent pas au morcellement ni au remembrement mais, plutôt, à la difficulté des plus petits à se maintenir à la tête d’un lopin de terre. Auquel cas, la période révolutionnaire serait celle de la valse des petits propriétaires. Les 13 noms de famille disparus en 1770 correspondent en effet à 16 propriétaires possédant en moyenne 1,46 ha. Parmi ces 16 personnes évincés, 13 cultivaient des vignes. La viticulture occupait 38,4 % de la superficie de leurs maigres biens au soleil. Si leur disparition n’a pas favorisé la diffusion de la vigne dans le terroir290, les difficultés économiques pré-révolutionnaires et révolutionnaires peuvent, en revanche, expliquer leur disparition de la liste des contribuables. Avec les dernières années de l’Ancien Régime et les toutes premières années de la Révolution française, on peut donc penser que les temps furent relativement défavorables à la petite propriété viticole291. Cette dernière touchée, le moteur même de l’extension viticole semble alors bloquer, pour un temps, les progrès de la vigne à Tressan, comme probablement dans nombre de communes du Languedoc. A Bessan, d’ailleurs, la poussée bien réelle de la vigne, décrite précisément par C. Sentenac, « se poursuit, dans une moindre mesure semble-t-il, au cours de la période 1772-1790 »292.
En effet, Tressan ou Bessan, dira-t-on, sont des terroirs modestes, sans élasticité, où une population en train de croître a tôt fait de venir à bout de terres presque dépourvues d’inculte. Tressan, c’est encore des biens communaux se réduisant à quelques ares : une bâtisse, une aire, un jardin et un petit herme293. Seuls les biens de la seigneuresse enfuie
54
chez son mari à Gênes sont vendus comme biens nationaux et libèrent une trentaine d’hectares294. Dans le village retenant notre attention, la toute fin de l’Ancien Régime, dangereuse pour les « micropropriétés » viticoles, se prolonge donc par des années révolutionnaires économiquement difficiles. Ces années sont d’autant plus rudes pour les petits propriétaires que le terroir n’a plus de terres neuves à leur offrir. Dans de telles conditions, en gardant à l’esprit la crise viticole intercyclique de la fin de l’Ancien Régime295, il est délicat d’envisager une poursuite de l’extension du vignoble tressanais avant le début des années 1800, tant les petits viticulteurs, cheville ouvrière de cette expansion, semblent alors malmenés. Avec le plan par masses de cultures de l’an XIII, on dispose d’une « photographie » de l’occupation du sol du terroir tressanais moins de dix ans après les débuts de la vraisemblable relance économique de 1797-1798. Ce plan démontre-t-il cependant le délicat redémarrage de la conquête viticole à Tressan ? Quelle foi accorder au nouveau document entre nos mains ?
3- 1805-1820 : LA LENTE REPRISE DE LA CONQUETE VITICOLE.
Une grande confiance peut être placée dans les travaux d’arpentage menés au tout début du XIXe siècle et dans la qualité du plan qui en résulte. Même si une certaine prudence doit entourer son utilisation, il semble bien refléter l’état exact de la mise en valeur du territoire communal en 1805. Le rapport rendu par le directeur des Contributions directes au préfet du département sur l’expertise de la commune par le sieur Olier en atteste : « le prix moyen de l’arpent de la commune de Tressan s’élève à 45f. 64c., tandis que celui des cinq communes de Gignac, Pouzols, St Bauzile de la Silve, Popian et Paulhan réunies donne pour résultat 46f. 78c. Un pareil rapprochement doit inspirer de la confiance dans la justesse de l’évaluation que l’expert a donné en masse aux terres labourables »296. On regrettera bien sûr de ne pouvoir mener une étude précise de la répartition de la vigne dans les propriétés, le document n’autorisant pas, par sa nature, une telle approche. Il est toutefois possible d’estimer la part du vignoble dans le paysage de la commune. Les deux masses culturales de la vigne et des terres labourables semblent s’équilibrer. Cela revient à dire que le sort de la vigne s’est légèrement amélioré à Tressan depuis le second tiers du XVIIIe siècle. Rappelons que le vignoble du village occupait réellement environ 50 % des surfaces productives en 1770 et 1779. Après les tourments économiques révolutionnaires, il est tout à fait honnête d’estimer à 55 % la part réelle de la vigne dans le paysage agricole livré par le plan. Si tel est le cas, Tressan connaît alors un double phénomène : d’une part, reprise timide de la conquête viticole et, d’autre part, fuite en avant d’un village, de son paysage et de sa population vers la viticulture. Paul Marres note ainsi le doublement de la production de vin dans le canton de Saint-Pargoire, « à cheval sur la plaine et la garrigue », entre 1797 et 1805, canton auquel fut un temps rattaché Tressan297. C’est aussi le moment où se met en place le poids croissant du vignoble de l’arrondissement de Béziers, historiquement et géographiquement plus proche de Tressan que l’arrondissement de Lodève298. Les données font hélas définitivement défaut pour mesurer où en est l’expansion de la viticulture chez les villageois vers 1805. Mais, l’étude de la localisation même du vignoble dans le territoire est riche d’enseignements pour suivre, en arrière-plan, l’évolution des mentalités paysannes.
Or, la lecture du plan ne nous apprend rien d’original. La vigne continue son insinuation dans la plaine, vers l’ouest en direction du fleuve et, vers le sud, en direction de la plaine de l’Estang. Aux abords du cours d’eau se développe le domaine des rivages et des bois de rivage, parcelles exiguës se dressant face aux colères chroniques de l’Hérault299. Et cette protection n’est pas un luxe pour Tressan, rappelons-le : « en effet, exposé aux débouchements de cette rivière, son territoire est fréquemment détérioré et même envahi par son Cours, au point que depuis le levé du plan, plusieurs périmètres étaient presque imposssibles à
55
reconnaître »300. L’implantation croissante du vignoble dans ce terroir particulier n’est sans doute pas innocente et témoigne de la part des Tressanais de deux motivations. Tout d’abord, planter des vignes dans des tènements fréquemment sujets aux inondations, c’est ne pas prendre le risque de voir une récolte céréalière ruinée, sans pour autant assister à la perte de sa récolte de vin, sauf crue décennale ou centenaire301. Ensuite, le développement du vignoble sur ces terres limoneuses ou légèrement gravillonneuses garantissait alors des rendements viticoles peut-être plus élevés qu’au flanc des traditionnels coteaux. Ces derniers commencent d’ailleurs à être relativement délaissés, surtout le versant nord de la colline, trop exposé au souffle froid et sec du vent du nord, le Terral. Seule la pointe sud-ouest du coteau reste un terrain de prédilection pour une partie du vignoble tressanais. Cela correspond aux « sections (…) B & D (…) composées de coteaux très élevés, presqu’entiérement plantés en vignes, d’un aussi couteux entretien que d’un faible produit »302 et, très précisément, au sud de la section B, ainsi qu’au sud et à l’est de la section D. Mais, au-delà de ces aspects classiques, le vignoble semble désormais solidement implanté dans la section C, c’est-à-dire dans la plaine de l’Estang, « la seule qui soit d’un bon produit (…) là [où] l’expert a désigné la majeure partie de ses premières classes »303. Or, une trentaine d’années plus tôt, ces terres demeuraient le domaine presque exclusif de la production de luzerne et d’esparcet, changement notable304. La spécialisation du finage ne permet donc pas encore de parler de monoculture viticole, mais facilite le repérage d’une lente mutation du paysage agricole depuis 1770. La vigne gagnes doucement des fonds jusque-là céréaliers ou fourragers et ne se développe pas aux dépens de l’inculte. Ces changements progressifs coexistent avec des permanences remarquables, en particulier le maintien de la vocation céréalière des toutes meilleures terres du village autour du tènement des Condamines. L’étude détaillée du cadastre de 1826 permet une analyse bien différente des mécanismes de conquête viticole alors en jeu à Tressan.
4- 1820-1830 : LA DECENNIE DECISIVE.
Avec le cadastre de 1826, le chercheur renoue avec une source historique aussi complète et précieuse que le compoix de 1770. En revanche, si les articles disparaissent, la description des parcelles se fait maintenant de manière plus mécanique et moins fouillée.
La marche en avant du vignoble. Surtout, certaines cultures semblent avoir disparu, mais cela n’est qu’illusion. Les
luzernes, par exemple, n’ont pas déserté le paysage en une cinquantaine d’années, mais leur trace se retrouve désormais ailleurs, au détour d’autres écrits. Le cadastre contemporain surprend le moderniste, car il simplifie les réalités culturales, tout comme ses plans parcellaires rationalisent l’usage du terroir par l’emploi de noms de tènements désormais limités par des ruisseaux, des haies, des chemins, ce qui était rarement le cas soixante ans plus tôt. La proportion entre les masses culturales demeure néanmoins sérieuse et rend compte d’ordres de grandeur complètement fiables. Le vignoble de Tressan a-t-il progressé depuis l’an XIII dans le territoire communal ? C’est le cas, et de manière très sensible. Les vignes occupent désormais 46 % du terroir, 48 % de l’ager et 63 % de la surface productive réellement utilisée, c’est-à-dire en tenant toujours compte du maintien de la jachère biennale pour les champs.
Commune Date %
terroir % ager
% jachère
Vallée de l'Hérault et garrigues d'Aumelas305
Aumelas 1825 2,7 21,5 34,8
Campagnan 1825 29,9 37,9 54,9
Plaissan 1825 52,0 69,6 83,9
56
Saint-Bauzille-de-la-Silve 1825 23,5 51,7 66,5
Saint-Jean-de-Fos 1825 28,6 46,5 54,9
Saint-Pargoire 1825 13,8 27,2 38,5
Tressan306 1826 45,7 47,6 63,1
Usclas-d'Hérault307 1834 45,8 48,3 64,5
Vendémian 1825 28,1 61,9 75,9
Villeveyrac 1825 22,6 47,4 61,2
Moyenne 1825-1834 29,3 46,0 59,8
Plaine littorale
Gigean308 1825 27,1 63,0 80,2
Montbazin309 1825 23,7 68,8 79,9
Poussan310 1825 25,1 54,0 66,4
"Dix villages"311 1820 33,5 53,5 67,3
Aimargues312 1825 32,8 33,5 48,8
Pérols313 1823 51,0 60,0 75,0
Moyenne 1820-1825 32,2 55,5 69,6
Arrondissement de Lodève
Creuzé de Lesser 1823 13,3 37,2 52,8
Tableau n° 11 - La part du vignoble dans quelques communautés environnant Tressan au premier tiers du XIXe siècle.
En occupant les deux tiers du paysage cultivé, le vignoble est déjà en 1826 la marque d’appartenance du village à un ensemble de communes devenues viticoles. Où situer le village ? Il appartient très nettement aux terroirs de la vallée de l’Hérault et des collines la bordant, où la vigne occupe en moyenne 60 % des espaces productifs. Mais, cet ensemble n’est pas encore aussi viticole que les finages de la plaine littorale plus à l’est, dont les vins trouvent très facilement des débouchés maritimes et urbains : là, pour les villages qu’il est permis de sonder, le vignoble accapare pratiquement les trois quarts des terres qui produisent ; Montpellier et Sète sont toutes proches. Le val d’Hérault en général et Tressan en particulier appartiennent à un ensemble où la vigne se diffuse encore massivement après 1820 et peut encore réaliser des gains substantiels. Cette région s’apparente tout à fait à une zone de contact entre plaine littorale et proches contreforts montagneux du Lodévois, où les débouchés viticoles existent, mais où les vins sont pour l’heure moins aisément acheminés que dans le Biterrois ou la plaine montpelliéraine. La décennie 1820 est donc ici décisive et marque la période où la viticulture devient la principale activité agricole.
Propriétaires de vignes
Nombre de
parcelles
Hectares de vignes
% de vignes dans la
propriété
% du vignoble tressanais
ha de vigne par
propriétaire < 5 ha 116/154 352 81,97 54,7 53,3 0,71 5-20 ha 18/18 197 65,43 45,4 42,5 3,63 > 20 ha 1/1 13 6,45 29,8 4,2 6,45 Total 135/173 562 153,85 43,3 100,0 1,14
Tableau n° 12 - La vigne dans les propriétés à Tressan d’après le cadastre de 1826. La vigne touche toujours au premier tiers du XIXe siècle quatre propriétaires sur
cinq : c’est une réalité vivace dans l’exploitation de chacun. Et, encore une fois, la petite propriété, celle regroupant les moins de cinq hectares, détient la majorité du vignoble tressanais. La mise en valeur par la vigne de ces micro-exploitations s’est largement renforcée. Cette répartition du vignoble tressanais en une foule dispersée de toutes petites unités de production assied solidement la viticulture en une structure productive commune à la plaine du Bas-Languedoc et caractéristique de celle-ci : une « ruche » à vin. Dans cette ruche, la somme du petit peu de chacun améliore sensibleement le sort et le quotidien de toute une société : « les fils, vignerons, même s’ils sont plus à l’étroit sur leurs
57
terres, ne sont pas nécessairement plus pauvres, bien loin de là, que les pères ou les aïeux, laboureurs de blé »314. La grande propriété entretient en effet un lien bien ténu à la vigne à Tressan en 1826, comme à Usclas-d’Hérault en 1834 et dans tant d’autres villages de la vallée de l’Hérault. La règle, dans notre village, est celle du petit propriétaire à la tête de ses trois vignes de mille pieds. Vers 1830, à force de les additionner, toutes ces parcelles forment un paysage très particulier, en train de basculer vers la monoculture.
On avait assisté, à travers l’étude du compoix de 1770 et du plan par masses de cultures de l’an XIII, à la diffusion progressive du vignoble dans la vallée de l’Hérault et dans la plaine de l’Estang. Vers 1826, cette descente est effectuée, signe d’une orientation certaine vers des rendements bien supérieurs à ceux obtenus jusque-là. On assiste même à un reflux de la vigne vers les coteaux qui commençaient pourtant à être délaissés à la fin du XVIIIe siècle315. Alors que les versants et le replat nord de la colline étaient surtout des terres en friche dans le compoix, elles sont grignotées par les ceps, parfois très sensiblement, dans le cadastre napoléonien. Le reflux prend même des allures de reconquête dans certains tènements316. Pour autant, peut-on vraiment encore parler de monoculture et évoquer une modernité de ce vignoble conquérant ? Cela serait abusif, car certains indices trahissent très nettement le caractère toujours traditionnel de l’agriculture vers 1830 et partant de la viticulture. Premiers témoins, les rendements viticoles : on ne les connaît pas directement pour Tressan, mais le village aurait produit, en l’an XIII, 2997 hectolitres de vin pour environ 130 hectares de vignes317, soit grosso modo, un rendement modeste de 25 hl/ha, aussi bon qu’aux meilleures années d’avant la Révolution318. Le second témoin des survivances d’un passé paysan encore proche est à chercher dans la localisation des terres céréalières. Les toutes meilleures terres du village, les « premières classes » du cadastre, se situent de manière presque exclusive dans des tènements séculairement céréaliers, autour des Condamines. Là on compte en 1826 100 % des bonnes terres du village, là on trouve 100 % de terres labourables, c’est-à-dire des champs. Une telle pratique apparaît révélatrice d’une recherche de sécurité alimentaire, comme c’était déjà le cas sous l’Ancien Régime. En 1834 à Usclas-d’Hérault, on note les mêmes archaïsmes agricoles : ils côtoient, sans la contrarier pourtant, la mutation en cours vers la viticulture de masse. Autre témoin du caractère traditionnel de l’économie rurale, les premières délibérations municipales conservées dans la commune de Tressan décrivent parfois certaines terres du village : « le sieur Imbert Vincent fils, agriculteur domicilié en la dite commune, lequel nous a porté plainte que son pére Imbert Vincent s’est pemis de lui arracher de sa terre sise au tènement (...) de Garrigues un amandier qui etait en vie, et une quantité de souches également en vie, il declare qu’il a arraché un serrisier dans une des terres appartenant a la succession de sa mère (...) »319. Au-delà de l’affaire de famille, le texte nous apprend la persistance de l’intrication des culture sur certaines parcelles, ici un amandier et un cerisier, très fréquents dans les champs décrits par le compoix de 1770320. Cet entretien de plusieurs arbres au milieu ou en bordure des parcelles est un héritage des siècles passés et ne s’est donc pas encore éteint au premier tiers du XIXe siècle ; il subsistera tard dans les campagnes languedociennes du XXe siècle.
Les temps sont malgré tout à la conquête viticole dans les années 1820 à Tressan : en quelques endroits, le village commence même à présenter son visage d’aujourd’hui. Sur l’actuelle place de l’Eglise et sur celle du Jeu de Ballon, tout au long de la rue des Barris, de nouvelles maisons sont construites depuis les années 1770 et certaines correspondent précisément aux millésimes portés par la pierre de touche du linteau de leur porte d’entrée321. A partir des années 1820-1830, les quelques maisons datables préfigurent la maison vigneronne du XIXe siècle : à côté de la porte d’entrée du bâtiment est aménagée une vaste ouverture à arc brisé permettant l’entrepôt de matériel. Ce rez-de-chaussée original est surmonté de deux étages aux baies ouvertes sur la rue ou la place. Les maisons
58
postérieures aux années 1830 sont traditionnellement et visiblement vigneronnes : à hauteur de la rue se développe une vaste remise viticole abritant, si possible, plusieurs cuves et quelques foudres. La porte d’entrée s’ouvre pour le visiteur sur un escalier menant à l’étage et à sa cuisine, accolée à une grande pièce et surmontée des chambres de la maisonnée322. Si à Tressan ces maisons exemplaires sont assez rares, elles sont beaucoup plus nombreuses et repérables à Usclas-d’Hérault323, mais aussi à Bélarga et à Montagnac. En 1826, la documentation cadastrale permet en outre de signaler l’agrandissement du village hors de son cœur médiéval, dans les Barris. Le bâti tressanais se compose alors de 129 maisons, de 70 bâtiments agricoles dits « ruraux » (sans plus de précision) et de 11 « maisons et bâtiments ruraux », sans oublier la distillerie, près de l’actuel cimetière. Une telle expansion s’explique évidemment par la forte hausse de la population qui, de 300 habitants en 1770, atteint alors 577 habitants au recensement de 1826, soit pratiquement le double324.
Profitant d’une conjoncture enfin heureuse, le vignoble s’infiltre donc partout, jusqu’aux façades des maisons : le basculement définitif de Tressan vers la monoculture de la vigne se fait donc au cours de la décennie 1820 ; le point de non-retour semble même atteint quand on lit le cadastre de 1826.
59
II) 1830-1873 : LE VIGNOBLE DE TRESSAN « AU TEMPS DE SA SPLENDEUR IMPERIALE »325.
Il faut attendre 1914326 pour disposer d’un nouveau cadastre, certes précieux, mais ici
inutile pour suivre l’évolution de la conquête viticole jusqu’à l’arrivée du phylloxéra à Tressan. Il faut alors recourir à d’autres sources, à d’autres documents, peu utilisables dans le souci de mener une étude détaillée de la structure des propriétés, de leur mise en valeur et de la localisation des vignes. Le premier réflexe est de s’en remettre aux statistiques agricoles conservées dans la série 6 M des archives départementales de l’Hérault. Mais, celles-ci posent de réels problèmes de compréhension et d’interprétation à tous les chercheurs les utilisant327. Utilisons malgré tout ces chiffres dans le but d’y puiser quelque ordre de grandeur acceptable.
1- UNE CONQUETE VITICOLE DIFFICILE A EVALUER.
La vigne couvrait presque 154 hectares en 1826 et elle en couvrirait 171 en 1836, soit 17 hectares supplémentaires en dix ans (+ 11 %)328. Mais, bonheur des statistiques agricoles du XIXe siècle, elle n’occuperait plus que 56,5 % des terres productives contre les deux tiers dix ans plus tôt. Il faut donc ici retenir avant tout le nombre d’hectares du vignoble tressanais, probablement assez véridique. En revanche, juste avant 1840, la viticulture devait occuper les trois quarts des terres qui produisaient. Comme partout en Languedoc, le développement du réseau ferré329 fut alors porteur de tous les espoirs d’expansion définitive du vignoble, dont l’écho résonne au sein de la municipalité tressanaise : « le conseil municipal émet le vœu que la nouvelle ligne de chemin de fer, partant de Montpellier, se dirige sur Béziers, en passant par Gignac, longeant le fleuve d’Herault, et Pézénas, enfin d’avoir l’avantage des communications rapides d’un point à un autre, ainsi les départements de l’Aveyron, de la Lozère, communiqueraient avec cette ligne, en conséquence ce tracé serait trés productif en traversant des contrées populeuses, riches, fertiles et commerçantes en vin et autres denrées. (...) »330. Mais, le rêve devient réalité en 1867 seulement, avec l’ouverture de la ligne Montpellier-Castres qui fait étape à Campagnan et de la ligne Montpellier-Lodève, dont une halte est marquée à Gignac331 : dès lors, la question des débouchés ne se pose plus. Le conseil municipal a d’ailleurs conscience de la prospérité viticole du temps puisque ses membres estimaient en 1854 « que la position des habitants de la commune (vu que tout le monde possède un peu de terrain) ne nécessitait pas la création d’une société de secours mutuel »332. Dès 1857, le mot « monoculture » peut être utilisé sans ambiguïté ni contre-sens pour désigner l’activité économique des communes au sud de Gignac. En effet, dans ce canton qui comprend quelques villages dont les terroirs courent pourtant largement sur les garrigues au nord d’Aniane et à l’est d’Aumelas333, la part du vignoble atteint presque à cette date les deux tiers du paysage rural cultivé, 64,2 % exactement334. Cela relève donc avec plus de force le poids de la vigne à Tressan et dans les villages alentour. C’est le cas, semble-t-il, à Saint-Pargoire à la même époque335. Or, dans le canton, l’oïdium aurait touché la moitié des vignes, tandis que les inondations et les grêles en auraient ravagé le huitième en 1857336. Cela explique le misérable rendement des vignes cette année-là, à peine 12 hl/ha337. En temps normal, les rendements viticoles ont dû nettement s’améliorer : ils sont en effet de l’ordre de 54 hl/ha en 1860 dans l’arrondissement voisin de Béziers338. Si la crise de l’oïdium fut dure, elle fut surtout passagère et relança les cours du vin. Une fois dépassée, elle a même stimulé avec plus de vigueur les progrès du vignoble, qui « va accaparer le moindre lopin de terre cultivable »339. Les Tressanais ne sont pas dupes de cet état de fait et, par conséquent, « ne sont pas en souffrance ou dans la gêne durant ces dernières années par la suite de la maladie de la vigne, puisque, bien que la récolte (…) ait été au-dessous d’une récolte
60
ordinaire, la recette n’en a pas moins été, à cause de l’élévation des prix, triple et pour certains même quadruple »340. Selon un document déjà utilisé, il n’y aurait plus de terrain de parcours dans le canton, ce qui semble montrer, après 1850, le recul inexorable des formes anciennes de l’agriculture méditerranéenne341. Mais, hasard malheureux de la conservation, les sources statistiques concernant Tressan n’existent plus et celles de 1873 concernent cette fois l’arrondissement de Lodève dans son ensemble. Les progrès de la vigne y sont évidemment constatés, mais uniquement dans la partie basse de l’arrondissement, dont fait partie notre village342. Quant aux rendements départementaux, ils continuent à augmenter, s’élevant, pour 1875, à une moyenne de 63 hl/ha343. De toute manière, la viticulture de masse était acquise avant cette date à Tressan, sans doute autour de 1860. Partant, les gains du vignoble permirent clairement l’amélioration du cadre de vie des villageois.
2- RETOMBEES DE L’ENRICHISSEMENT VITICOLE SUR LE CADRE DE VIE.
Entre 1826 et 1873, date vraisemblable de l’apparition du phylloxéra à Tressan, la vigne a réalisé, même s’il est presque impossible de les mesurer, des gains importants dans le territoire de la commune. Tout au plus peut-on se contenter d’émettre l’hypothèse d’une vigne couvrant, à la veille de la crise, entre 200 et 230 hectares. En effet, le chiffre de l’époque doit être un peu inférieur à celui révélé par le cadastre de 1914, contenant presque 240 hectares de vignes344 car, comme le rappelait R. Laurent à Montpellier en 1978, ce vignoble du premier âge d’or était tout de même moins étendu que celui né de la reconstruction345. Si les chiffres sont difficiles à débusquer des sources, ce n’est pas le cas d’éléments indirects évoquant les retombées visibles de la hausse des revenus générés par la monoculture. En effet, entre les années 1830 et les années 1870, Tressan change d’âme et de visage, pour se changer en petit village viticole typique et représentatif de ceux de la vallée de l’Hérault346. On ne reviendra pas ici sur les étapes de l’évolution du bâti tressanais entre le Moyen Age et l’époque contemporaine. On le sait : déjà, à la fin du XVIIIe siècle, certaines demeures extra muros annonçaient les changements à venir dans l’aménagement des façades et la mutation globale des bâtiments nouvellement dressés vers une architecture villageoise viticole, oblitérée en 1826. Constatons donc plutôt ici le parallèle troublant entre engagement croissant de la société villageoise dans la viticulture de masse et modernisation du village. Ce phénomène se poursuit sans doute possible après 1830 et reste à mettre en relation (au moins partielle) avec un mode de vie viticole en train de se généraliser. A un tel changement de morphologie du bâti se greffent des évolutions tout aussi importantes et lourdes de sens à travers le finage. Afin d’en juger en l’absence de cadastre des années 1870, on peut interroger de façon originale les dossiers conservés dans les séries 2 O et 3 O des archives de l’Hérault347. Cela permet de compter le nombre de travaux de voirie et de modernisation du cadre de vie lancés et pris en charge par la commune de Tressan. Chaque année, à partir du XIXe siècle sont ainsi ouverts un certain nombre de dossiers et de projets qui, une fois honorés, entraînent la modernisation progressive du village. Retenons, pour ce simple décompte, la période 1841-1920, qui encadre avantageusement des années 1870 sinon mal connues. Le document obtenu est édifiant : les travaux de modernisation de Tressan initiés et soutenus par la municipalité suivent de manière troublante, avec un décalage moyen de cinq ans, les progrès de la viticulture. Jusqu’en 1870, le village a ainsi modernisé très progressivement ses infrastructures, à petites touches348. Quand le nombre de travaux se multiplie, en 1871-1875, le phylloxéra atteint Tressan et stoppe, pour cinq ans, l’amélioration du cadre de vie villageois. Avec la reconstruction du vignoble, la modernisation reprend, à une allure sans précédent, et marque un nouveau coup d’arrêt avec la crise de mévente et de surproduction. Ces coïncidences sont remarquables. Elles soulignent, sans doute, l’alignement de la vie quotidienne aux
61
battements de la conjoncture viticole, après une longue période de stagnation dans un village vieillissant. On peut interpréter ce phénomène comme un moment de redistribution des profits la vigne. Profits dont les retombées, de proche en proche, se manifestèrent, après la reconstruction du vignoble, par la naissance du village actuel349.
La première avancée notable a lieu dès avant 1850 : elle aboutit à court terme. La mairie envisageait alors de déplacer pour des raisons d’hygiène et sur injonction gouvernementale le cimetière à l’extérieur du cœur du village350, « lequel n’a pas la profondeur nécessaire aux fosses, et (...) n’est pas situé à la distance voulue par le décret du 23 prairial an XIII »351. Mais, les habitants protestent, car ils ne tiennent pas à voir leurs morts s’éloigner d’eux et signent une pétition au cours de l’hiver 1844-1845352. Cependant, le nouveau cimetière s’installe à son emplacement actuel, aux Ayres, en 1847353. La lecture attentive de l’ensemble des dossiers de voirie et des délibérations du conseil municipal montre d’ailleurs pour Tressan une série d’améliorations, qui touchent d’abord le réseau vicinal de la commune, grande préoccupation des autorités locales des années 1840 à 1875. On élargit alors tous les chemins en imposant la population par des centimes additionnels s’ajoutant au montant des quatre contributions directes354. Dossier central, la municipalité entreprend en décembre 1853 la construction du Chemin Neuf, longue, douloureuse et polémique, bien qu’utile, car « le chemin vicinal (…) de Tressan à Gignac se trouve dans un état impraticable »355. Immédiatement, des voies s’élèvent pour remettre en cause la décision des élus : cela commence par des chicanes sur le choix du tracé du chemin (le tracé rouge ou le tracé bleu), pris, aux dires de certains, « avec précipitation et sous l’influence du désir ardent de jouir dans un bref délai de la nouvelle voie »356. Puis, une nouvelle municipalité est élue et revient sur les décisions de la précédente, en adoptant un nouvel itinéraire : le projet du Chemin Neuf fut probablement son cheval de bataille électorale357. Au printemps 1856, le village est au bord de l’explosion ; les anciens conseillers « ont pour but le même noble intérêt privé », tandis que Baptiste Chauvet, membre de la nouvelle équipe municipale, semble le seul à garder l’esprit clair : « le chemin projeté en adoptant le tracé rouge mettrait la division et le trouble dans la commune qui n’y existe malheureusement que trop depuis qu’il est question de ce chemin »358. Le ton redescend ensuite entre les différentes parties et les acquisitions à l’amiable, ainsi que les expropriations, commencent à l’été 1857359. Par ailleurs, les rues, les chemins vicinaux et ruraux de Tressan sont pour la plupart l’objet de multiples travaux de redressement, d’élargissement et de soutènement entre 1859 et 1914360. Une telle fièvre de la voirie sensibilise à un sujet important : les progrès continuels de la viticulture à Tressan ont probablement motivé avec force l’amélioration du réseau vicinal. Cela a certainement favorisé, en retour, l’élan viticole. Cette dialectique du progrès expliquerait mieux le développement rapide de la viticulture avant l’ouverture des premières lignes de chemin de fer. Le rail, après 1865, arrive en pays déjà presque complètement conquis par le vignoble, dans la vallée de l’Hérault comme aux environs de Montpellier361.
62
III) 1873-1914 : LA VITICULTURE MALGRE TOUT.
A peine acquise, la « splendeur impériale » de la monoculture viticole dure le temps d’une chimère. Le rideau s’ouvre alors sur le temps des épreuves à la charnière des XIXe et XXe siècles. 1- LE TEMPS DES EPREUVES ET DE LA RECONSTRUCTION (1873-1907).
La crise du phylloxéra. Le phylloxéra, puceron dévastateur s’attaquant aux racines des ceps et se
multipliant de manière exponentielle, envahit la vallée de l’Hérault au cours de l’année 1873. Il se manifeste dans les vignes par l’apparition de taches de feuilles mortes au moment de la feuillaison. Le témoignage du maire de Tressan indique avec un peu de retard l’arrivée du fléau dans le territoire communal. En effet, le 15 février 1874, le maire de Tressan sonne le glas du premier âge d’or de la vigne lors d’une séance du conseil municipal : « le phylloxéra, par ses progrès incessants, menace la fortune publique d’un immense désastre ; (…) si, par un moyen quelconque, il n’est pas arrêté dans sa marche destructrice, c’en est fait de nos vignes dans un délai très-rapproché »362. D’après le ton employé par l’élu, il ne serait pas surprenant de savoir que les premières tâches jaunâtres avaient déjà fait leur apparition dans le vignoble tressanais. Le phylloxéra s’est en effet répandu d’est en ouest dans tout le Languedoc depuis 1868. La traînée de poudre est signalée dans la vallée de l’Hérault à Montagnac à la fin de l’automne 1873 et gagne ensuite le Biterrois. Le témoignage de l’arrivée du puceron dans les délibérations du conseil municipal est le seul connu à l’échelle du village. En revanche, le sort de Tressan et de son vignoble fut alors similaire à celui du vignoble du canton, de l’arrondissement et du département. De tels points de comparaison locaux pallient l’absence d’informations directes sur le village et permettent de comprendre, par défaut, quel put être ici le cours d’événements frappant l’ensemble du Languedoc. On sait que le phylloxéra est apparu à Pujaut, dans le Gard, en 1863, où il avait été importé incognito sur les racines de cépages américains363. Parti du Languedoc rhodanien, le puceron avance vers l’ouest « chaque année de 12 à 15 kilomètres »364. Dans l’arrondissement de Lodève, dont relève Tressan, deux communes sont déjà touchées en 1871, deux supplémentaires en 1872, trois en 1873 : le village fut donc assailli par le phylloxéra presque aussitôt qu’il avait gagné la vallée de l’Hérault. Sa progression marque cependant le pas après 1876, puisque le nombre de communes sinistrées passe de 58 en 1876 à 60 en 1878365. A-t-on aujourd’hui idée des ravages alors commis sur le vignoble et à quel point la population fut sans doute profondément touchée ? De rares témoignages d’époque, parfois généralistes, permettent toutefois de mesurer l’ampleur des dégâts liés au phylloxéra. L’ingénieur civil de l’Aveyron, A. Ducornot, décrivait en 1878, de Gignac à Tressan, un val d’Hérault « en entier planté en vignes, aujourd’hui complètement détruites par le phylloxéra »366. L’idée de construction d’un canal de dérivation de l’Hérault pour irriguer certaines communes de la rive gauche du cours d’eau avait été émise dès 1872 par ce personnage, ce qui permet de dater son évocation de la monoculture à Tressan et dans ses environs de la période 1872-1878367. Le second témoin des lendemains de la crise du phylloxéra n’est autre qu’Adolphe Joanne : il décrit la vallée de l’Hérault en aval du Pont du Diable vers 1880368. L’auteur remarque que « le fleuve entre dans la région des collines. (…) Toute cette partie (…) n’était naguère qu’un immense vignoble, le premier de la France en étendue, mais où le phylloxéra a exercé bien des ravages »369. Il souligne aussi, plus loin dans son ouvrage, la baisse progressive de la production viticole départementale après 1872, très
63
sensible après 1875 et réduite à une misère en 1879370. Les chiffres dont on dispose dès cette époque lui donnent hélas raison : les 11 millions d’hectolitres annuellement produits dans l’Hérault au cours des années 1860 retombent à 3 millions dans les années 1880371. Heureusement, trois solutions existent pour repousser le puceron et reconstruire le vignoble : planter dans les sables, greffer des cépages français sur des porte-greffes américains (riparia, jacquez et rupestris) ou submerger les vignes pendant un mois et demi372. Le puceron s’attaquant à l’est de l’Aude et à l’ouest du Biterrois, alors qu’il est déjà passé dans la vallée de l’Hérault après 1876, les habitants de cette dernière peuvent se lancer dans un grand effort de reconstruction. Finalement, dès 1883 au plus tard373, Jacques Mestre, notre troisième et dernier témoin, observe in situ à Tressan les efforts des cultivateurs pour replanter leurs vignes aux dépens des « champs à céréales dont le nombre décroît tous les jours pour faire place à de magnifiques plantations de vignes, que leurs heureux possesseurs vous montrent avec une bien légitime fierté » 374. Quelques lignes plus loin, l’auteur est emporté par son emphase : « si Tressan (…) a eu sa petite colonne de braves soldats, cette charmante commune a aussi de braves cultivateurs, qui ont su vaillamment opposer leur énergie et leur intelligence à l’ennemi commun : le phylloxéra »375.
La reconstitution du vignoble tressanais. La reconstruction du vignoble de masse fut sans doute malaisée, pour d’évidentes
raisons financières, car les nouvelles vignes étaient exigeantes en innovations coûteuses et en espace : engrais chimiques, souffrages, traitements des maladies cryptogamiques, espacement plus généreux des ceps replantés, labours plus fréquents, etc376… Quant au financement de cette reconstitution, il passe difficilement, pour les petits propriétaires, par le recours au crédit. Du moins, le Crédit Foncier préfère alors apporter « ses concours (…) sur de grands ou de très grands domaines viticoles »377. Sans doute les petits viticulteurs de la vallée de l’Hérault ont-ils eu recours à la méthode décrite par Ernest Morin qui, dans l’Aude, entretenait des pépinières de plants américains, bouturées chaque année378. On en signale alors à Saint-André-de-Sangonis379. Economique et ingénieuse, cette manière de faire a donc permis de reconstruire peu ou prou le vignoble dévasté entre 1873 et 1877. A Tressan, la reconstitution n’était donc pas terminée en 1883, lorsque Jacques Mestre visita le terroir. Elle l’était déjà un peu plus tard à Saint-André-de-Sangonis et Jonquières380. De quand dater la restauration effective du vignoble villageois ? Lors d’une séance du conseil municipal, le maire souhaite demander le maintien de deux écoles publiques subventionnées, pour des motifs édifiants, « considérant que, si à l’époque du dernier recensement le chiffre de la population était inférieur à 401 habitants, c’est à cause de la crise agricole qui avait obligé bon nombre de familles à quitter la commune pour aller chercher du travail dans les villes ou dans les centres manufacturiers ; considérant que depuis que les vignes se reconstituent, les émigrés sont rentrés en grande partie ; considérant qu’il résulte d’un dénombrement fait par les soins de M. le Maire que le chiffre de la population est actuellement de 427 habitants »381. D’après ce document, les vignes ne sont pas encore totalement reconstruites en 1888, mais le net avancement des travaux permet déjà le retour à Tressan de nombre d’exilés du phylloxéra. Le maire insistait d’ailleurs en juin de la même année et évoquait alors ses administrés, « les contribuables qui se donnent tant de peine pour reconstruire les vignobles »382. Dans tous les cas, les délibérations anciennes du conseil municipal sont précieuses, car leur contenu permet de suivre, mois après mois, allusion après allusion, les étapes de sortie de la crise phylloxérique. Ainsi, le 22 août 1889, la municipalité parle encore de Tressanais accablés par « la crise agricole »383. Puis le ton change progressivement : il n’est plus question, on le verra, de phylloxéra après l’été 1889. La reconstruction semble donc alors à peu près achevée. Elle l’est effectivement avant le 18 août 1895, date à laquelle le conseil « est justement ému des ravages commis par le mildew
64
[mildiou], prie M. le Préfet et le conseil général, de vouloir bien prendre en considération la triste situation de la commune et accorder aux malheureux contribuables, si rudement éprouvés, un dégrèvement d’impôt aussi large que possible »384. L’été 1895 constitue en effet une date-butoir, à plusieurs égards :
si le vignoble tressanais est dans une « triste situation » qui touche pratiquement toute la population, il a donc été restauré et a repris la dimension monolithique qui était la sienne entre 1856 et 1873 ;
si le vignoble tressanais est attaqué par le mildiou, la reconstitution des vignes avec des porte-greffes américains est donc avérée. Cette maladie affecte en effet les plants américains et se communique à la greffe ; il est possible de l’enrayer si les conditions météorologiques autorisent un traitement chimique précoce des vignes385. Or, le printemps et l’été 1895, pluvieux et venteux, avaient fait s’abattre sur le Languedoc viticole une attaque généralisée du mildiou386. Reconstruites entre les étés 1889 et 1895, les vignes remettent donc le village sur les rails de la monoculture viticole. Ce second vignoble de masse, sans doute plus étendu que le précédent387, est évidemment l’objet de toutes les attentions, y compris celles des conseils municipaux successifs, probablement conscients des risques pesant sur une spécialisation agricole aussi marquée. Les attitudes municipales face aux risques de mévente. Les maires et leurs conseillers se montrent désormais très soucieux de protéger la production viticole retrouvée, dès avant 1895. Leur cheval de bataille est double : les vins et les produits de la vigne de Languedoc doivent faire l’objet de mesures protectionnistes ; la fraude à la production de vin doit être vigoureusement combattue. Pour les seules années 1888-1897, les revendications municipales sont continuelles et récurrentes. Ainsi, le 12 février 1888, la mairie consacre une longue délibération à approuver l’intégralité des vœux du Conseil général de l’Hérault en matière de réglementation viticole388. Les cinq points de ce texte touchant à la viticulture et à la vinification sont hautement protectionnistes et anti-fraude, telle la demande du doublement des taxes pesant sur l’hectolitre de « vin étranger ». Ce souhait-là est en outre accompagné du soin particulier à porter à ce « que le droit sur les vins étrangers (…) ne soit, en aucun cas inférieur à celui perçu sur les produits similaires français expédiés à l’étranger »389. Même volonté exprimée deux ans plus tard : à l’occasion d’une séance durant laquelle est discutée la nécessité d’irriguer la région aux moyens de canaux amenant l’eau du Rhône, le conseil insère une revendication devenue classique : « le Midi a besoin d’être protégé contre la fabrication des vins falsifiés et l’introduction des vins étrangers, il est également nécessaire de favoriser le développement de la production vinicole ainsi que de l’agriculture ; (…) l’eau est indispensable pour atteindre ce but, (…) les canaux dérivés du Rhône peuvent seuls la mettre à la portée des petits propriétaires comme des grands »390. Même la production de soie doit être protégée de la concurrence étrangère, au nom des « intérêts de l’agriculture méridionale »391. Cette concurrence étrangère se vit désormais comme une agression permanente contre la production locale : « la concurrence que font à la production française les vins espagnols coupés avec les alcools allemands est vraiment désastreuse tant pour le propriétaire que l’ouvrier ; (…) l’on doit appuyer et encourager par tous les moyens possibles les démarches tendant à améliorer le sort de la viticulture en France »392. L’agression est sans doute d’autant plus patente aux yeux du viticulteur tressanais (et languedocien) que les vins espagnols et italiens seraient coupés. Le souci d’écouler dans les plus brefs délais les produits de la vigne devient ainsi le leitmotiv, quitte à installer le télégraphe, car « l’importance commerciale, industrielle et agricole de la commune lui fait un devoir de profiter des facilités qui lui sont offertes en dotant la population d’un bureau télégraphique municipal », de
65
même que « la commune gagnerait beaucoup à ce que le chemin d’intérêt commun N° 39 de Canet à la Taillade [route de Montpellier…] fût achevé le plus tôt possible » 393. La suppression des taxes intérieures sur le vin prend alors des allures de solution-miracle pour écouler le produit de la vendange : « le projet de réforme des boissons voté par la Chambre donne pleine et entière satisfaction aux revendications des cultivateurs en ce que notamment il assure le dégrèvement complet du vin, seule mesure capable d’en augmenter la consommation et de restreindre la production artificielle en faisant disparaître la prime à la fraude »394. Citons enfin une ultime fois le conseil municipal de Tressan, dont une délibération illustre à merveille l’insertion du vignoble tressanais au marché national des fruits de la vigne, outre celui du vin : « M. le Maire expose les doléances souvent répétées des viticulteurs de la commune au sujet de l’élévation du prix des transports des raisins de table. Le conseil, considérant que la culture des raisins de table a pris une grande extension dans tous les pays viticoles et notamment dans la commune de Tressan qui expédie tous les ans aux halles de Paris une grande quantité de ses produits ; considérant que le prix de transport dépasse presque toujours la valeur de la marchandise qui supporte un tarif beaucoup plus élevé que celui des colis postaux ; que ces frais, beaucoup trop lourds, forcent bien souvent l’expéditeur de suspendre ses envois ; cela au grand préjudice de tous, et de l’ouvrier qui voit disparaître de longues et fructueuses journées, et du consommateur, pour lequel le fruit si hygiénique deviendra un objet de luxe dont il devra se priver. Pour ces motifs, déclare qu’il y alieu de demander aux Compagnies de chemins de fer une diminution, la plus grande posible, du tarif de transport des raisins de table, et supplie M le Préfet de prendre la défense de cette juste cause, en la transmettant à M. le Ministre des Travaux publics, afin que son intervention auprès des Compagnies fasse aboutir nos démarches »395. Une fois le vignoble de masse reconstruit, les années 1890-1900 sont donc consacrées, à Tressan, à sa pérennisation. Face au volume croissant de la production de vin de table, le risque de mévente est ressenti avec une grande lucidité. En cela, Tressan rejoint, par son souci protectionniste, anti-frauduleux et « détaxeur », les préoccupations viticoles languedociennes du moment396. C’est aussi, pour le village, un moyen de se déculpabiliser du péché de surproduction, car « la reconstitution du vignoble a exigé de gros efforts financiers ; l’endettement pèse sur les ménages qui ne peuvent supporter de voir leur vin rester en cave, au moment où les jeunes vignes se parent de belle récolte »397. Rien d’étonnant à cette colère villageoise donc, en des années marquées par de notables méventes, provoquant en décembre 1893 à Montpellier, la première grande manifestation des viticulteurs de la région398. Avec l’entrée dans le nouveau siècle, Tressan s’inscrit probablement dans les événements précédant 1907. Leur déroulement n’est pas connu pour le village, mais il suit probablement le cours des principaux épisodes régionaux399. Après la crise de 1907, le vignoble, reconstruit, échappe désormais et pour quelques temps à la mévente : il triomphe alors à nouveau pleinement dans le paysage et le quotidien des habitants. 2- LA VITICULTURE TRIOMPHANTE (DEPUIS 1907).
Avec le cadastre de 1914, on peut jauger du poids du nouveau vignoble tressanais, une trentaine d’années après sa reconstruction400. La nouvelle matrice cadastrale est une refonte de celle de 1826, utilisée jusque-là. Elle livre une occupation du sol sans aucune surprise.
Nature hectares % ha
terres labourables 89,9283 25,4 vignes 237,5889 66,9 terres vaines 25,1264 7,1 canal de Gignac 1,8348 0,5 jardins 0,4344 0,1 Total 354,9128 100,0
66
Tableau n° 13 – L’occupation du sol à Tressan d’après le cadastre de 1914. En 1914, la vigne vient de se relever des ses propres ruines, avec beaucoup plus de
force encore que par le passé. Elle occupe alors les deux tiers de la surface agricole utilisable, 72 % des terres cultivées et 80 % du terroir réellement utilisé année commune, si les céréales supportent désormais une jachère triennale. La monoculture viticole est donc bien là, définitivement ancrée dans le paysage rural. Mieux, le revenu imposable des propriétés foncières était de 20668,47 F à cette époque, dont 17802,75 F pour les seules vignes, soit 86 % du total de la commune. La vigne est alors exclusive dans la plaine de l’Hérault et de l’Estang, dominatrice sur le replat du coteau. Finalement seules les pentes de la colline sont un peu délaissées au profit des terres labourables : le rendement viticole y aurait probablement été trop faible. D’ailleurs, la recherche de rendements élevés demeure le grand souci, au détriment de la qualité : « en 1914, l’Hérault à lui seul produit autant que l’ensemble de la région avant le phylloxéra (15 millions d’hl) »401. R. Laurent, pour une période un peu postérieure, montre d’ailleurs bien l’élévation vertigineuse des rendements dans la plaine, où récolter 200 hectolitres par hectare « n’est pas exceptionnel »402. Rien ne semble remettre en cause le système viticole de production massive et les cadastres suivants le montrent bien : la position acquise par le vignoble local en 1914 reste la même, de manière ininterrompue, jusqu’en 1984 :
Année ha de vigne % terroir % ager % jachère
1914 237,59 67 72 80 1939 267,90 85 86 93 1963 267,46 77 87 92 1984 245,81 72 81 90
Tableau n° 14 – Le vignoble tressanais de 1914 à 1984. Depuis 1914 en effet, le rôle de la vigne est vraiment central pour le village et dans sa vie, même si sa position dans le paysage a très légèrement reculé depuis 1939 . Elle reste encore l’activité reine menée sur plus de 90 % des terres agricoles utilisées chaque année dans le village : à tout prendre, depuis le début du XXe siècle, seules la taille moyenne et la structure des exploitations ont changé. Avant la Grande Guerre, la viticulture est encore une affaire de famille au sein de propriétés viticoles minuscules, héritées du vignoble de masse antérieur au phylloxéra, où le « morcellement [des propriétés] (…) est moins grave (…), quand le revenu à l’hectare augmente »403. Bien sûr, en raison de la reconstruction, les petites propriétés ont changé de main, mais restent légion dans le cadastre de 1914.
Propriétaires
de vignes
Nombre de
parcelles
Hectares
de vignes
% de vignes
dans la propriété
% du vignoble
tressanais
ha de vigne par
propriétaire
< 5 ha 154/246 644 140,46 67,6 59,1 0,91 5-20 ha 18/18 264 97,13 64,1 40,9 5,39 > 20 ha - - - - - - Total 172/264 908 237,59 66,9 100,0 1,44
Tableau n° 15 – La vigne dans les propriétés à Tressan d’après le cadastre de 1914. Depuis 1826, le morcellement foncier s’est donc poursuivi et atteint désormais un
sommet. Avec des propriétés moyennes de 1,34 hectares, un plancher semble même atteint : toute la structure foncière villageoise a été tirée vers le bas et les plus de vingt hectares ont disparu. Une telle pulvérisation s’explique doublement, d’abord par les revenus unitaires élevés que génère la viticulture par rapport aux autres productions agricoles du temps, ensuite par le haut chiffre de la population, lui-même encouragé par une viticulture dévoreuse d’une main-d’œuvre extérieure au département404. En effet, les recensements successifs de 1872 à 1921 comptent en général entre 460 et 530 Tressanais, soit 30 à 50 % de plus qu’en 1780405. Au cadastre de 1914, huit propriétaires extérieurs à l’Hérault viennent de s’installer : trois viennent du Cher, du Loir-et-Cher et de Dordogne, cinq de l’Aveyron. Les Aveyronnais justement, les fameux Gavachs, descendus s’embaucher comme ouvriers agricoles seraient évidemment bien plus nombreux si on les traquait dans
67
l’état civil. On sait qu’une bonne partie de l’accroissement démographique du département a reposé sur leur « immigration », entre 1851 et 1901406. Bref, on l’aura compris, la viticulture est alors l’affaire de tous à Tressan, selon des modalités communes à toute la plaine viticole du Bas-Languedoc. Dans les cadastres villageois suivants, une concentration des propriétés viticoles se met en place et la viticulture familiale s’intègre peu à peu au réseau coopératif407. La « coopé » de Tressan voit même le jour en 1936, au plus fort de la vague de créations de caves coopératives de la deuxième génération408. Mais, revenons en arrière : Tressan, juste avant la Première Guerre mondiale, dispose donc d’un vignoble jeune, omniprésent, pulvérisé entre mille mains et profite alors, sans doute, du « redressement spectaculaire des cours du vin qui marque la période de prospérité des années 1910-1914 »409. 3- L’ENTREE DU VILLAGE DANS LE MONDE CONTEMPORAIN (1873-1914).
A l’heure où le phylloxéra commet des ravages dans la vallée de l’Hérault, il est surprenant de constater que la crise économique se double peut-être et apparemment pour les habitants de Tressan d’une véritable crise d’identité. En effet, le païs change alors de visage à une allure jusque-là inconnue des paysans et des viticulteurs, au point même de susciter leur mécontentement, expression probable de leur malaise410. Tout d’abord, si Tressan change progressivement d’aspect, l’architecture villageoise suivant fidèlement en cela la lente hausse du niveau de vie, il ne cesse désormais plus de s’étendre, vers l’ouest et vers l’est. Le village compte déjà 131 maisons d’habitation en 1882411. Quelques maisons de maître viennent en outre trahir l’ascension de quelques fortunes familiales construites sur la viticulture. Une branche de la famille de l’architecte Giral, installée à Tressan au cours du XIXe siècle, a ainsi légué à la postérité un de ces bâtiments412. Quant aux bâtisses nouvellement construites, elles sont désormais et le plus souvent des maisons vigneronnes traditionnelles du XIXe siècle viticole, faciles à repérer413. De tels changements du bâti répondaient simplement et progressivement à une utilisation différente de l’espace villageois pour s’adapter à la viticulture, à ses contraintes matérielles, mais aussi aux exigences de l’Etat en matière de salubrité publique. Or, entre 1873 et 1914, en une génération, les mutations du village sont nombreuses et rapides, à commencer par celles des terrains et des bâtiments communaux.
Un cadre de vie bouleversé. Le nouveau cimetière, un temps rejeté, doit par exemple être agrandi en 1872-1873,
puis en 1890-1892414. Au cours de la même période, de nombreux travaux de réparation de l’église et d’exhaussement du clocher ont lieu à Tressan, même si le conseil municipal se heurte parfois aux réticences de certains fidèles : le chantier traîne en effet depuis 1856415. Ils s’accélèrent toutefois, lorsque le clocher menace bel et bien de s’effondrer : abattu, il est reconstruit entre 1884 et 1886 et se dote alors d’une horloge, fonctionnant encore de nos jours416. Mais, les résistances villageoises ne pèsent guère ni ne changent le cours du temps. Parfois même, les travaux publics s’accomplissent particulièrement vite. Lorsque la Place du Jeu de Ballon nécessite un nivellement, les difficultés du phylloxéra vécues par la population semblent trouver là un précieux échappatoire : « M. le Maire appelle l’attention du Conseil sur l’obligation morale dans laquelle se trouve en quelques sorte la commune de fournir du travail aux malheureux ouvriers qui se trouvent inoccupés. Il fait observer que le plan du Jeu de Ballon formant une surface tout à fait irrégulière, la symétrie et la perspective gagneraient beaucoup à ce que le sol fût nivelé. D’ailleurs, tout en ouvrant un atelier de charité, on ferait une réparation utile que réclament depuis longtemps les vœux de la population »417. Les Tressanais suivent leurs élus et la réfection de la place publique est achevée au plus tard en mai 1889418.
68
En revanche, la construction de la mairie touche profondément les esprits, probablement parce que le projet retenu l’installe sur l’ancien cimetière paroissial à peine délaissé419. Du coup, les habitants protestent vivement en 1891420. Mais, une des deux écoles est menacée de fermeture et le conseil souhaite hâter l’édification du nouveau bâtiment421. La municipalité, face au retard accumulé depuis 1882, voit même rouge à la rentrée de septembre 1891 et montre du doigt « la négligence et (…) l’incurie de l’ancien conseil municipal (..) et une protestation collective, comprenant une vingtaine de signatures à peu près(…) et ceux qui ont suivi les promoteurs dans cette voie sont tous, à de très rares exceptions près, des réactionnaires à tous crins, dont quelques-uns faisaient même partie de l’ancien conseil, (…) que tous agissent dans un but d’hostilité systématique »422. Les dernières protestations, une quarantaine, ont lieu un an plus tard, fin août 1892, mais sont rejetées par la municipalité et la préfecture, en raison de la signature d’un certain Marcelin Roudil, qui n’a apparemment jamais existé423. Les esprits s’apaisent enfin et, à nouveau, les desseins communaux s’accomplissent sans coup férir : le groupe scolaire avec mairie est inauguré le 25 mars 1895424. A partir des mêmes années 1890, un bureau de poste est établi dans la nouvelle mairie de Tressan425, alors qu’en 1843 le conseil municipal avait rejeté « l’organisation d’un service postal entre Gignac et Pézénas (...) d’aucune utilité, vû que nous avons assez a temps les nouvelles, par le piéton qui nous vient chaque jour de Gignac, que la commune est imposée, sans lui procurer de nouvelles dépenses »426. Les besoins ont évolué et dès 1889 la population « se plaint beaucoup dans la commune de ce que le courrier arrive tous les jours fort tard, la plupart du temps de deux à trois heures du soir »427. Le bureau ouvre ainsi ses portes en janvier 1893 : il dispose du télégraphe et fonctionne grâce à deux employés, une gérante rétribuée 250 F par an et un « piéton communal » (facteur), payé 50 F par an428. On le voit, à l’intérieur de Tressan, des bâtiments nouveaux apparaissent ; de plus anciens, comme l’église, sont rénovés, non sans attiser une certaine réticence des habitants, car leur quotidien et des habitudes de plusieurs siècles sont profondément remises en cause. En outre, la commune devient un propriétaire comme les autres, pour qui les transactions foncières sont désormais partie intégrante de la gestion municipale429. Progrès considérable, les rues du village s’éclairent peu à peu à la lumière des becs de gaz. La municipalité suit l’avis de ses administrés et émet le souhait d’instaurer « un service d’éclairage des rues du village (…), création utile qui répondrait aux vœux de la population toute entière »430. Quelques semaines plus tard, « le contrat signé avec M. Roque, négociant à Avignon, réglant l’achat de lanternes pour l’éclairage des rues, ainsi que la fourniture des matériaux pour l’éclairage », lance l’installation de l’éclairage public, probablement presque aussitôt effectuée par des employés communaux431. Le 10 janvier 1894, les lanternes éclairent déjà les rues de Tressan depuis un petit moment432. Le confort des habitants semble donc suivre de près la reconstruction presque complète du vignoble. Par la suite, l’adduction d’eau devient le premier souci des autorités municipales et locales. Mais, il faut attendre les premières années du XXe siècle pour que les fontaines villageoises et les dessertes en eau soient analysées, repensées et refondues433. On s’alarme à Tressan dès 1903 de la mauvaise qualité de l’eau des fontaines et des nombreux cas de typhoïde qu’elle a provoquée434. Après de nombreuses péripéties indépendantes des autorités communales435, l’eau est pompée dans l’Hérault à partir de janvier 1913, puis avec plus de sûreté en 1914, après quelques soucis mécaniques causés par une capricieuse pompe centrifuge Hennebic, facilement sujette au hoquet436. C’est la mise en route de la Prise d’eau, aujourd’hui à l’abandon, qui donne définitivement l’eau courante aux Tressanais. La naissance des paysages actuels.
Ces mutations du cadre de vie villageois se répètent évidemment dans toutes les communes rurales de la vallée de l’Hérault à la même époque, mais à une échelle et à des
69
rythmes différents. Le petit village d’Usclas-d’Hérault, lui aussi étudié, a connu la même modernisation que Tressan, mais quelques années plus tard et de manière moins systématique. Le « progrès » se double de mutations au sein même du terroir et se traduit dans le paysage par une nouvelle vague de travaux de voirie. Leur multiplication, ainsi que leur extension à tous les chemins de la commune, interdisent d’en dresser la longue liste. On améliore ou on restaure alors, de 1884 à 1914, les chemins de Tressan à Bélarga, à Aspiran, au Pouget, des Costes, des Badiaux, et d’autres encore avec un pic marqué d’activités vicinales après 1896437. En 1890, les deux municipalité de Tressan et d’Aspiran acquièrent même en commun le « bac de Garrigues servant de passage entre les deux rives de l’Hérault, ainsi que de tous les accessoires, tels que maisonnette du passeur, corde, nacelle, etc », donné par son dernier propriétaire privé, Jules Maistre438. Ce bac communal est hélas très vite malmené et « mis hors d’usage par la forte crue de l’Hérault du mois de septembre 1890, le passage se fait depuis à l’aide d’une petite nacelle insuffisante et peu commode. Le passage de Garrigues a cependant une importance considérable pour les communes de Tressan et d’Aspiran, il conviendrait de le pourvoir au plus tôt d’un outillage convenable »439. Un bac neuf et du menu matériel sont alors achetés par les deux communes en mai 1891. Deux ans plus tard, en 1893, certains villageois peuvent profiter de la mise en service du canal de Gignac, projet porté à bout de bras pendant plus de quinze ans par l’ingénieur Ducornot. Celui-ci souhaitait en effet amener de l’eau d’irrigation à de nombreux villages de la rive gauche de l’Hérault qui, « actuellement privés d’eau, ou qui se la procurent par des moyens très coûteux ou très onéreux, pourront par l’installation du Canal de l’Hérault se procurer facilement à peu de frais celle dont ils manquent et dont ils ont si grand besoin »440. Cet extrait de texte, écrit en 1878, s’explique facilement : dans le contexte de crise du phylloxéra, le « grand besoin » en eau devant être identifié au souci de noyer les vignes, une méthode efficace de lutte contre le puceron dévastateur. En 1893 cependant, la possibilité d’arroser une bonne partie du terroir est une grande nouveauté. Le canal de Gignac présente d’ailleurs à Tressan une double particularité. Il traverse tout d’abord la colline du nord au sud en empruntant un long tunnel et se divise en deux branches à la sortie de celui-ci. Il finit ensuite sa longue course depuis les gorges dans le terroir, puisqu’une partie du canal se déverse dans l’Hérault à hauteur de Lille, l’autre se déversant dans le fossé Mayral qui draine la plaine de l’Estang, puis se jette à son tour dans le fleuve. Mais à Tressan, le « progrès » suscite comme il se doit sa part de mécontentement. Cinquante riverains du fossé Mayral adressent ainsi fin 1897 une pétition au préfet, « considérant que ce n’est que depuis que le canal d’irrigation de Gignac déverse dans le fossé le trop plein de ses eaux que certains propriétaires ont à souffrir de cet excédent, ainsi qu’il résulte de la constatation faite par M. l’Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées dans son rapport du 18 septembre 1897, déclarent s’opposer à la constitution du syndicat tel qu’il est projeté et réservent leurs droits vis-à-vis du syndicat du canal de Gignac pour tous préjudices qu’il pourrait porter à leurs propriétés »441. Dans cette affaire pourtant, le canal de Gignac et ses eaux agissent simplement comme révélateurs d’un problème d’écoulement lié à la faible pente initiale du fossé et à l’abandon progressif de son curage annuel depuis un siècle, comme le signale très honnêtement l’ingénieur dépêché sur place l’automne précédent442.
Entre la crise du phylloxéra et la Grande Guerre, Tressan s’est donc peu à peu paré de ses caractères contemporains, c’est-à-dire tels qu’ils sont encore pleinement perceptibles aujourd’hui quand on arpente ses rues et ses ruelles. L’intensité de la modernisation après 1890 montre une dernière fois la forte coïncidence entre le retour à une viticulture massive et l’amélioration de l’environnement quotidien des habitants : la vigne continue à modeler le village, à le faire à son image, plus riche et plus neuf. Seule vraie nouveauté, l’éclairage électrique se substituera lentement à celui au gaz au cours des années 1910-1930443.
70
*
De 1770 à 1914, Tressan s’est donc converti à la monoculture viticole, en deux vagues distinctes. Pendant presque un siècle (1770-vers 1850), les Tressanais ont construit, progressivement puis de plus en plus vite un premier vignoble de masse, doublement stimulé par la vente de vins de qualité et des eaux-de-vie aux pays d’Europe du Nord, puis des vins de consommation courante pour le marché national. Ravagées par le phylloxéra, les vignes furent reconstruites à une vitesse fulgurante, en moins d’une génération (vers 1880-vers 1895). C’est le second vignoble de masse, ancêtre direct de celui aujourd’hui, si solidement ancré dans le paysage.
Bien peu de choses ont en effet fondamentalement changé depuis les années 1900-1910 : les premières photographies du village offrent à nos yeux un Tressan au paysage déjà très familier. Seul le monument aux morts est absent de ces vues anciennes. Installé en 1926 en bas de la Place du Jeu de Ballon, il signale la fin d’une époque, celle où le village vivait presque exclusivement sur son terroir et de ses fruits. En même temps, sa présence rappelle, comme partout en Languedoc et en France, le douloureux acte de naissance du grand délaissement des campagnes et la date de son baptême : 1914-1918.
71
CONCLUSION.
A la fin de ces quelques pages, une partie de l’histoire de Tressan émerge donc du
passé, partie infime et dérisoire quand on songe aux dizaines de générations d’hommes et de femmes ayant habité ce village et arpenté ce terroir, ainsi qu’à la richesse d’une seule de leurs vies, qui serait déjà si longue à raconter. Si la vigne, pendant deux mille ans, a toujours été présente aux côtés des habitants, elle le fut, on l’a vu, d’une manière longtemps limitée ou fluctuante. Elle devint ce personnage fort, cet acteur incontournable et inamovible de la vie villageoise et du paysage à partir des années 1820 seulement. Aujourd’hui l’impression d’un Tressan et d’une vallée de l’Hérault viticoles depuis des temps immémoriaux se justifie pleinement par le souvenir d’avoir grandi au milieu des vignes et des vignes seulement, sans jamais avoir vu ni connu ici, comme nos parents et nos grands-parents, aucune autre sorte de paysage. A peine plus de 150 ans sur deux mille ont donc été consacrés à la monoculture viticole, bien peu finalement, suffisamment néanmoins pour écrire une histoire économique et sociale du Languedoc contemporain rouge et tumultueuse, pleine de spasmes et de soubresauts. Assez aussi pour définir une identité vigneronne bien ancrée dans les esprits. Pour l’heure, la crise viticole est particulièrement âpre pour les viticulteurs de Tressan comme du Languedoc-Roussillon. Parce qu’elle est en même temps une profonde crise d’identité, alimentée depuis une dizaine d’années par l’urbanisation obsessionnelle et grossière des villages de la vallée de l’Hérault, du fait de municipalités au mieux inconscientes, au pire peu responsables et peu respectueuses de leur environnement archéologique, économique, social et paysager, en un mot de leur patrimoine. Il est alors obligatoire de songer à la morale de l’histoire, de cette histoire de Tressan. Quelle est-elle ?
Par un paradoxe dont l’histoire aime tant se nourrir, la vigne, ici comme dans tout le Bas-Languedoc, est donc fille éloignée de la crise louis-quatorzienne. Elle fut, vers 1750, la réponse trouvée par les Tressanais pour sortir de plus d’un siècle terrible, durant lequel la sape démographique avait engendré une économie atone. Le développement monolithique du vignoble de masse, jamais remis en cause depuis 1850, suspend depuis 150 ans l’économie viticole de la région aux hasards de la conjoncture nationale et désormais internationale. Fille de la crise, la vigne est à sont tour mère de crises. La faveur actuelle du grand commerce pour les vins de table des pays du Sud, moins chers, met par conséquent à mal non seulement les viticulteurs et les caves coopératives mais aussi tout leur environnement. La récente multiplication des caves particulières, le développement du programme Terra Vitis et même les mesures coopératives visant à améliorer la qualité des vins, par la vendange verte par exemple, sont parfois mal vus au sein même du sérail vitivinicole. De telles initiatives constituent pourtant des issues possibles à la mévente et d’intéressantes recherches de solutions à ce mal chronique. Car, il faut bien le dire, ce n’est pas tant la massivité du vignoble languedocien qui pose problème, mais sa structure globale d’exploitation qui atteint, peut-être, aujourd’hui, ses propres limites : les caves coopératives, dans leur forme actuelle, ont-elles vécu ? Question existentielle s’il en est… Toute crise reste cependant inacceptable, qu’elle touche ou non des proches. Peut-on se réconforter à l’idée qu’hier, précisément, le moindre dérèglement économique se traduisait par une grande vague de mortalité et un dénuement total de la population ? Peut-on se réconforter à l’idée qu’à la même époque une querelle religieuse pouvait très bien dégénérer en une longue guerre civile et se traduire par la destruction d’un quart du village ? Cela montre à quel point le concept de crise, même véritable et dramatique, demeure très relatif eu égard au passé. Comme nous ne vivons plus en ces rudes années qu’il ne faut pas regretter, rappelons que la crise de mévente des vins a toujours constitué
72
un événement cyclique : la surproduction a frappé durement au début des années 1800, 1900, 1970 et 2000, oïdium et phylloxéra mis à part. Au-delà de ses causes, c’est aussi et heureusement un phénomène bref, en général de quelques années, terriblement difficiles à surmonter certes, mais ayant toujours jusque-là débouché sur un renouvellement nécessaire à l’évolution d’un vignoble toujours aussi massif et productif. C’est là tout le mal à souhaiter à une profession sinistrée, car elle donne toujours au village et de mémoire d’homme la plus grande partie de son identité et de son rythme de vie.
L’identité de Tressan, justement, je l’espère aujourd’hui un peu raffermie par la connaissance d’une petite partie de son passé et longtemps consciente de ses racines rurales et languedociennes. Elles sont notre berceau, sur lequel doit continuer à souffler un esprit d’ouverture aux autres. Tout le contraire, donc, de vastes lotissements impersonnels repliés sur eux-mêmes, coupés du reste de leurs villages et qui, de l’ouverture, entretiennent décidément une vague illusion ou une lointaine chimère, ainsi qu’une vilaine blessure au cœur, au paysage et au patrimoine.
73
NOTES.
1 - F.R. Hamlin, Les noms de lieux du département de l’Hérault. Nouveau dictionnaire topographique et étymologique, Nîmes, Lacour, 1988, non paginé, article « Tressan », à ce nom. 2 - J. Rouquette (publié par), Cartulaire de Béziers (Livre Noir), Paris-Montpellier, Picard-Valat, 1918-1922, p. 25. 3 - M. Le Glay, « La Gaule romanisée » in G. Duby et A. Wallon (dir.), Histoire de la France rurale, Paris, Seuil, éd. 1992, t. I, p. 234-235. 4 - L. Schneider et D. Garcia (dir.), Carte archéologique de la Gaule. Le Lodévois. Arrondissement de Lodève et communes d’Aniane, Cabrières, Lieuran-Cabrières, Péret, Paris, Maison des Sciences de l’Homme, 1998, p. 75. 5 - Ibid. 6 - G. Cholvy (dir.), L’Hérault de la Préhistoire à nos jours, Saint-Jean-d’Angély, Bordessoules, 1993, p. 77-78. 7 - S. Mauné partage cet avis in Les campagnes de la cité de Béziers dans l’Antiquité (partie nord-orientale) (IIe s. av. J.-C.-VIe s. ap. J.-C.), Montagnac, Mergoil, 1998, p. 468. 8 - J. Mestre, Histoire de la ville de Gignac et des communes de son canton depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours, Gignac, Bibliothèque 42, 1988, rééd. de l’ouvrage de 1887, p. 210. 9 - E. Zadora-Rio, « Archéologie et toponymie : le divorce », Les petits cahiers d’Anatole, n° 8, décembre 2001, http://www.univ-tours.fr/lat/Pages/F2_8.html signale dans cette publication en ligne le danger qu’il existe à utiliser les noms des lieux-dits pour dater leur origine. 10 - S. Mauné in L. Schneider et D. Garcia (dir), Carte archéologique..., op. cit., p. 67. 11 - Mes plus vifs remerciements vont à H. Leyris, amoureux de Tressan et de son histoire, qui a eu l’amabilité de me laisser consulter sa collection privée ; S. Mauné, Les campagnes de la cité de Béziers…, op. cit., fig. 197, p. 469 ; S. Mauné in L. Schneider et D. Garcia (dir.), Carte archéologique…, op. cit., p. 67-68. 12 - S. Mauné, Les campagnes de la cité de Béziers…, op. cit., p. 468 : « l’établissement des Condamines, par sa superficie et le mobilier recueilli en prospection de surface, semble bien être une grande villa établie sur un riche terroir ». 13 - M. Clavel, Béziers et son territoire dans l’Antiquité, Paris, Belles Lettres, 1970, p. 296-302. 14 - Ibid. 15 - L. Schneider in L. Schneider et D. Garcia (dir.), Carte archéologique..., op. cit., p. 82-84. 16 - Idem, p. 86. 17 - Idem, p. 287-288 ; S. Mauné, Les campagnes de la cité de Béziers…, op. cit., p. 468-469. 18 - Collection H. Leyris : une partie est analysée in S. Mauné, Les campagnes de la cité de Béziers…, op. cit., p. 468-469. 19 - S. Mauné in L. Schneider et D. Garcia (dir.), Carte archéologique…, op. cit., p. 67 sq. 20 - Idem, 467-468, ainsi que L. Schneider et D. Garcia (dir.), Carte archéologique…, op. cit., p. 89. 21 - S. Mauné, Les campagnes de la cité de Béziers…, op. cit., p. 468. 22 - G. Cholvy (dir.), L’Hérault…, op. cit., p. 106 ; S. Mauné, Les campagnes de la cité de Béziers…, op. cit., p. 306 et in L. Schneider et D. Garcia (dir.), Carte archéologique…, op. cit., p. 69. 23 - S. Mauné in L. Schneider et D. Garcia (dir.), Carte archéologique…, op. cit., p. 68-69. 24 - S. Mauné, Les campagnes de la cité de Béziers…, op. cit., p. 75-76.
74
25 - A. Pérez, « Les cadastres antiques de la Narbonnaise occidentale. Essai sur la politique coloniale romaine en Gaule du Sud (IIe s. av. J.C.-IIe s. ap. J.C.) », Revue archéologique de Narbonnaise, suppl. n° 29, p. 141 et planche n° XVIII. 26 - Idem, p. 468. 27 - S. Mauné in L. Schneider et D. Garcia (dir.), Carte archéologique…, op. cit., p. 69. 28 - Idem, p. 69. 29 - Idem, p. 69-70. 30 - Idem, p. 71. 31 - Idem, L. Schneider, p. 71 : « la nature précise de la plupart des sites qui perdurent nous échappe totalement ». 32 - S. Mauné, Les campagnes de la cité de Béziers…, op. cit., p. 469. 33 - J.-C. Hélas, « Le Moyen Age » in G. Cholvy (dir.), L’Hérault…, op. cit., p. 117. 34 - S. Mauné, Les campagnes de la cité de Béziers…, op. cit., p. 120-127. 35 - Idem, p. 127-131. 36 - Idem, p. 469. 37 - Catalogue de l’exposition sur l’orfèvrerie mérovingienne au musée de Lattes. 38 - Collection H. Leyris et S. Mauné, Les campagnes de la cité de Béziers…, op. cit., p. 470. 39 - S. Mauné, Les campagnes de la cité de Béziers…, op. cit., p. 128. 40 - J. Mestre, Histoire de la ville de Gignac…, op. cit., p. 208. 41 - F.R. Hamlin, Les noms de lieux…, op. cit., non paginé, à cet article. 42 - Idem, à cet article. 43 - S. Mauné, Les campagnes…, op. cit., p. 468. 44 - S. Mauné, Les campagnes…, op. cit., p. 470. 45 - M. Chalon, « Sous l’Empire romain (IVe-Ve siècles) » in G. Cholvy (dir.), Histoire du diocèse de Montpellier, Paris, Beauchesne, 1978, p. 10-13. 46 - L. Schneider in L. Schneider et D. Garcia (dir.), Carte archéologique..., op. cit., p. 79 et 260-261. 47 - J.-C. Hélas, « Le Moyen Age » in G. Cholvy (dir), L’Hérault…, op. cit., p. 139-142. 48 - L. Schneider in L. Schneider et D. Garcia (dir.), Carte archéologique..., op. cit., p. 78-79. 49 - J. Rouquette (publié par), Cartulaire de Béziers…, op. cit., p. 25. 50 - Idem, p. 64. 51 - Cf. supra. 52 - J.-C. Hélas, « Le Moyen Age » in G. Cholvy (dir.), L’Hérault…, op. cit., p. 147. 53 - Idem, p. 148-149. 54 - A. Germain (publié par), Cartulaire des Guilhems, Montpellier, Martel, 1844-1846, p. 692. 55 - S. Mauné, Les campagnes de la cité de Béziers…, op. cit., p. 470. 56 - Ibid. 57 - P. Alaus et al. (publié par), Cartulaire de Gellone, Montpellier, Martel, 1898, p. 687. 58 - Archives départementales de l’Hérault (désormais ARCH. DÉP. HÉRAULT), 1 E 1455, hommage de Raimond de Castries, 1264. 59 - J. Mestre, Histoire de la ville de Gignac…, op. cit., p. 209. 60 - H. Vidal, « Au temps des Guilhems (985-1204) » in G. Cholvy (dir.), Histoire de Montpellier, Toulouse, Privat, 1984, p. 22-23. 61 - J. Delouvrier, Histoire de la vicomté d’Aumelas et de la baronnie du Pouget (Hérault), Montpellier, Impr. L. Grollier, 1896, rééd. Gignac, Bibliothèque 42, 1990, p. 21-22. 62 - H. Vidal, « Au temps des Guilhems (985-1204) », art. cit., p. 23. 63 - J. Delouvrier, Histoire de la vicomté d’Aumelas…, op. cit., p. 33. 64 - Idem, p. 36.
75
65 - L. Schneider in L. Schneider et D. Garcia (dir.), Carte archéologique..., op. cit., p. 79. 66 - J.-C. Hélas, « Le Moyen Age » in G. Cholvy (dir.), L’Hérault…, op. cit., p. 150. 67 - L. Schneider in L. Schneider et D. Garcia (dir.), Carte archéologique…, op. cit., p. 80. 68 - J.-C. Hélas, « Le Moyen Age » in G. Cholvy (dir.), L’Hérault…, op. cit., p. 150. 69 - Ibid. 70 - G. Fabre, « Les villages ronds ou en ellipse dans le canton de Gignac : études de cas » in M. Bourin, J. Caille, A. Debord, Morphogenèse du village médiéval (IXe-XIIe s.), Montpellier, Cahiers du Patrimoine, 1996, p. 215-226. 71 - J.-C. Hélas, « Le Moyen Age » in G. Cholvy (dir.), L’Hérault…, op. cit., p. 150. 72 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, B 11089, compoix de Tressan, 1597, 274 f°. 73 - Archives communales de Tressan (désormais ARCH. COM. TRESSAN), CC 1, Compoix de la communauté de Tressan de lannée 1770, 1770, 228 f°. 74 - ARCH. COM. TRESSAN, doc. non coté, registre foncier de la commune de Tressan, 1826. 75 - B. Jaudon, Paysage et société rurale en Bas-Languedoc. Les hommes et la terre à Tressan de 1770 à 1826, mém. maîtrise, H. Michel dir., Montpellier, université Paul Valéry, 1996, t. I, p. 66 ; E. Demaille, B. Jaudon, E. Pélaquier, « De la représentation médiévale et moderne du territoire languedocien à la cartographie informatisée », Liame. Bulletin du Centre d’Histoire moderne et contemporaine de l’Europe méditerranéenne et de ses périphéries, n° 1, janv.-juin 1998, p. 89. 76 - Ibid. 77 - E. Zadora-Rio, « Archéologie et toponymie : le divorce », art. cit. 78 - C’est le cas de Fonsaurigade et de Fonsèque, au bord de l’Hérault, dont les toponymes sont livrés par le seul compoix de 1770. 79 - En occitan, « fau » : hêtre ; « falgairas » : lieu couvert de fougères. 80 - G. Duby, L’économie rurale et la vie des campagnes dans l’Occident médiéval (France, Angleterre, Empire, IXe-XVe siècles). Essai de synthèse et perspectives de recherches, Paris, Flammarion, 1977, t. I, p. 150. 81 - Ph. Wolff, « Epanouissement du Languedoc » in Ph. Wolff (dir.), Histoire du Languedoc, Toulouse, Privat, 1967, p. 146. 82 - J.-L. Abbé et P. Portet, « Assécher un étang en Languedoc au Moyen Age : techniques et parcellaire. L’exemple emblématique de Montady (Hérault) » in Actes du colloque de Bâle (10-15 septembre 2002), à paraître. 83 - F. R. Hamlin, Les noms de lieux…, op. cit., à ce mot. 84 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 30 J 313/1*, Mémoire pour les consuls et communauté de Tressan…, Montpellier, impr. J.-F. Picot, 1777, p. 18. 85 - ARCH. COM. TRESSAN, GG 1, registre paroissial, sépultures, f° 8 v°. 86 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, B 11089, doc. cit., f° 54 r°, 252 v° et 262 r°. 87 - ARCH. COM. TRESSAN, CC 1, doc. cit., f° 86 v°: « plus un pred avec un vivier (…) à Gaupeirous dont la veuve du sieur François Auger a le tiers de l’eau du vivier pour l’arrozage de son pred ». 88 - Feuilles du plan cadastral de Tressan, secrétariat de mairie de Tressan, doc. non coté, 1984. 89 - E. Zadora-Rio, « Archéologie et toponymie: le divorce », art. cit. 90 - J.-C. Hélas in G. Cholvy (dir.), L’Hérault…, op. cit., p. 152-153. 91 - Emblavures : superficies couvertes de céréales. 92 - E. Le Roy Ladurie, Les paysans de Languedoc, rééd. Paris, E.H.E.S.S., 1985, t. I, p. 141-145. 93 - H. Neveux, « Déclin et reprise : la fluctuation biséculaire (1340-1560) » in G. Duby et A. Wallon (dir.), Histoire de la France rurale, op. cit., t. II, p. 31-73.
76
94 - E. Le Roy Ladurie, Les paysans de Languedoc, op. cit., t. I, p. 189-196. 95 - Idem, p. 189. 96 - Compoix : en Languedoc, cadastre antérieur à la Révolution. Comme tous les compoix languedociens, celui de Tressan est composé de tails divisés en articles. Un tail est l’ensemble des biens d’un propriétaire ; un article est l’un de ces biens. 97 - Alors que cela sera le cas en 1770, puisque la largeur de tous les chemins confrontant les articles des taillables est alors portée au nouveau compoix sur injonction de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Montpellier (ARCH. COM. TRESSAN, CC 1, doc. cit., passim). Cela visait sans doute à limiter le phénomènes des empiètements sur la voie publique. Autre exemple à la même époque pour Fabrègues (1772) in A. Soboul, Les campagnes montpelliéraines…, op. cit., p. 83. 98 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, B 11089, doc. cit., f° 252 r°. 99 - Idem, f° 107 r°. 100 - E. Le Roy Ladurie, Les paysans de Languedoc, op. cit., t. I, p. 422-423. 101 - S. Olivier, « L’occupation du sol à Salasc d’après les documents fiscaux d’époque moderne », Etudes Héraultaises, n° 28-29, 1997-1998, p. 82-86. 102 - B. Jaudon, « Tressan de 1770 à 1826 : le demi-siècle du changement agricole », Etudes héraultaises, n°28-29, 1997-1998, p. 90 ; S. Mauné, Les campagnes de la cité de Béziers…, op. cit., p. 21 ; D. Garcia, L. Schneider (dir.), Le Lodévois…, op. cit., p. 86. 103 - B. Jaudon, « Tressan de 1770 à 1826 », art. cit., p. 90. 104 - Cf infra. 105 - P.-A. Clément, Les chemins à travers les âges…, op. cit., p. 85-86. 106 - S. Olivier, « L’occupation du sol à Salasc… », art. cit. , p. 84. 107 - Au compoix de 1597, on trouve 85 maisons « dans les meurs », dont le nombre d’étages est systématiquement mentionné : 77 maisons (94 %) ont deux, trois ou quatre étages ; 42 maisons (50 %) ont encore trois étages ou plus. 108 - Cf infra. 109 - ARCH. COM. TRESSAN, CC 1, doc. cit., Cahier des biens pretendus nobles, f° 215 r° : le seigneur détient en 1770 un château et sa terrasse de « cens-septante une cannes » (environ 650 m²). 110 - Cf infra. 111 - E. Le Roy Ladurie, « Huguenots contre papistes » in Ph. Wolff (dir.), Histoire du Languedoc, op. cit., p. 316. 112 - J.-J. Vidal, « L’époque moderne (1500-1789) » in G. Cholvy (dir.), L’Hérault…, op. cit., p. 234. 113 - M. Laget, « La grande crise du XVIe siècle » in G. Cholvy (dir.), Histoire du diocèse de Montpellier, op. cit., p. 115-116. 114 - E. Le Roy ladurie, « Huguenots contre papistes » in Ph. Wolff (dir.), Histoire du Languedoc, op. cit., p. 330-333 ; M. Laget in G. Cholvy (dir.), Histoire du diocèse de Montpellier, op. cit., p. 118-131. 115 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 1 Mi 262 R1, doc. cit., 1605 : les passages qui suivent, extraits du procès-verbal de la visite pastorale de Jean de Bonsi dans la paroisse de Tressan, sont tous tirés de ce document. 116 - M. Laget, « La grande crise du XVIe siècle » in G. Cholvy (dir.), Histoire du diocèse de Montpellier, op. cit., p. 110-111 : « les plaintes des populations sont nombreuses quant à la résidence extérieure du curé, sa négligence, son manque d’intérêt pour la vie du village ». 117 - Ph. Huppé, Le gisant de la féodalité dans l’ombre des Lumières. La féodalité dans la baronnie du Pouget et la vicomté de Plaissan au XVIIIe siècle, Montagnac, M. Mergoil, 1998, p. 81-84.
77
118 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, C 2958, Amortissements du dioceze de Besiers…, f° 373 r°, 9 mai 1687. 119 - G. Cabourdin, G. Viard, Lexique historique de la France d’Ancien Régime, Paris, Armand Colin, 1990, p. 77. 120 - M. Laget, « La grande crise du XVIe siècle » in G. Cholvy (dir.), Histoire du diocèse de Montpellier, op. cit., p. 112. 121 - J. Fouilleron, « Mémoire religieuse ou religion de la mémoire ? Les minimes de Béziers et leurs livres (1609-1790) », Liame, n° 3, janvier-juin 1999, p. 146 dresse une carte de la présence protestante au diocèse de Béziers : en 1660, Tressan compte encore entre 10 et 50 protestants ; ARCH. COM. TRESSAN, GG 2, n.f. : entre 1655 et 1662, quatre protestantes abjurent spontanément leur religion, ainsi qu’un de leurs anciens corréliginaires en 1680 ; ARCH. COM. TRESSAN, GG 3, n.f. : du 7 au 21 octobre 1685, 21 protestants abjurent, dont la fille de Jean de Saporta et enfin Moïse de Saporta le 8 avril 1686. 122 - F. Bluche (dir.), Dictionnaire du Grand Siècle, Paris, Fayard, 1996, p. 479-480. 123 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, L 2776, Comptes de l’abbé Gept pour l’année 1790 afin d’établir sa pension, feuille volante, 1791. 124 - E. Le Roy Ladurie, Les paysans de Languedoc, op. cit., t. I, p. 380-389. 125 - Idem, p. 386 et 388. 126 - M. Laget, « La grande crise du XVIe siècle » in G. Cholvy (dir.), Histoire du diocèse de Montpellier, op. cit., p. 122-124. 127 - Ibid. 128 - Idem, p. 124. 129 - S. Olivier, Un terroir du Lodévois à l’Epoque Moderne : occupation du sol et aspects de la vie agricole à Salasc aux XVIIe et XVIIIe siècles (1601-1791), mém. maîtrise, F.-X. Emmanuelli dir., Montpellier, université Paul Valéry, 1996, t. I, p. 53. 130 - On ne peut pas non plus éluder définitivement l’idée qu’une partie au moins des cazals signale la fin locale du beau XVIe siècle, au cours de laquelle des maisons auraient été peu à peu laissés à l’abandon. 131 - B. Cursente (éd.), L’habitat dispersé dans l’europe médiévale et moderne, actes des XVIIIe Journées Internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran (15-17 septembre 1996), Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1999, 292 p. ; M. Berthe et B. Cursente (dir.), Villages pyrénéens. Morphogenèse d’un habitat de montagne, Toulouse, Méridienne, 2001, 300 p. 132 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, B 11089, doc. cit., f° 80 r° 133 - E. Le Roy Ladurie, Les paysans de Languedoc, op. cit., t. I, p. 200. 134 - Idem, p. 65. 135 - J. Jacquart, « Immobilisme et catastrophes » in G. Duby et A. Wallon (dir.), Histoire de la France rurale, op. cit., t. II, p. 215 : « des rendements de 8/1, voire plus, n’y étaient pas rares ». 136 - Les jardins (horts du compoix) se localisent pour 35 aux abords directs du village (cf. supra) et pour 80 à proximité de l’actuelle Fontaine Fraîche. Sept autres sont dispersés dans le terroir. 137 - E. Appolis, Un pays languedocien au milieu du XVIIIe siècle. Le diocèse civil de Lodève. Etude administrative, Albi, Impr. coopérative du Sud-Ouest, 1951, p. 402. 138 - Idem, p. 402-409. 139 - Ibid. 140 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 30 J 313/1*, Mémoire pour les consuls & communauté de Tressan…, Montpellier, Impr. Picot, 1777, in-4°, p. 22 sq. 141 - E. Le Roy Ladurie, Les paysans de Languedoc, op. cit., t. II, p. 849-852.
78
142 - Ibid. 143 - E. Appolis, Un pays languedocien…, op. cit., p. 410-412 ; E. Le Roy Ladurie, Les paysans de Languedoc, op. cit., t. I, p. 61-69. 144 - E. Appolis, Un pays languedocien…, op. cit., p. 405-406 ; M.-P. Ruas, Productions agricoles, stockage et finage dans la Montagne Noire. Le grenier castral de Durfort (Tarn), Paris, Maison des Sciences de l’Homme, 2002, p. 141-142. 145 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, B 11089, doc. cit., f° 53 r° : tail de Pierre Fourestié ; f° 252 v° : tail de Jehan Blanc ; f° 262 r° : tail d’Esteve Blanc. 146 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, C 2958, doc. cit., f° 373 v°, 9 mai 1687. 147 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, B 11089, doc. cit., f° 165 v°. 148 - Le compoix fragmentaire de 1597 enregistre 199,68 hectares de biens non bâtis. En raison de la pratique du complant, les composantes culturales se recoupent :
composante champ : 129,10 ha ;
composante olivette : 79,99 ha ;
composante vigne : 34,87 ha ;
composante inculte : 37,88 ha ;
composante amandier : 16,76 ha ;
composante arrosé : 2,67 ha. L’addition de ces six composantes donne un total de 301,27 ha. 149 - E. Appolis, Un pays languedocien…, op. cit., p. 425-426. 150 - Idem, p. 425. 151 - G. Larguier, « Cycles viticoles à Narbonne, XIVe-XVIIIe siècles », Bulletin de la Commission archéologique et littéraire de Narbonne, t. 42, 1988, p. 85-86. 152 - J.-F. Marquier, Ginestas, Mirepeisset à l’époque moderne. Deux évolutions des structures foncières et agraires, originales et différentes, mém. maîtrise, A. Blanchard dir., Montpellier, université Paul Valéry, 1986, p. 77-78 et 185-186. 153 - E. Le Roy Ladurie, Les paysans de Languedoc, op. cit., t. I, p. 200. 154 - Idem, p. 200-204. 155 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 1 E 1455, Privilège de la foire du Pouget le jour de la Saint-Michel, parchemin, jeudi 17 janvier 1517. 156 - Ph. Huppé, Le gisant de la féodalité…, op. cit., p. 85. 157 - E. Appolis, Un pays languedocien…, op. cit., p. 429-430. 158 - E. Le Roy Ladurie, Les paysans de Languedoc, op. cit., t. I, p. 200. 159 - E. Appolis, Un pays languedocien…, op. cit., p. 201. 160 - B. Jaudon, De la polyculture traditionnelle…, op. cit., p. 39. 161 - S. Olivier, « L’occupation du sol à Salasc… », art. cit., p. 84. 162 - E. Appolis, Un pays languedocien…, op. cit., p. 425. 163 - Idem, p. 417. 164 - A. Molinier, Une paroisse du Bas-Languedoc. Sérignan, 1650-1792, Montpellier, Impr. Déhan, p. 61. 165 - G. Larguier, « Cycles viticoles à Narbonne… », art. cit., p. 84. 166 - J.-F. Marquier, Ginestas et Mirepeisset…, op. cit., p. 77-78 et p. 185-186. 167 - M. Reynier, « Nieigles en 1641 », Revue du Vivarais, t. CXIV, n° 1, janv.-mars 1990, p. 37 ; J. Schnetzler, « Thines en 1464, en 1624 et au milieu du XIXe siècle. Etude comparative », Revue du Vivarais, t. CXV, n° 1, janv.-mars 1991, p. 22. 168 - J.-R. Pitte, Histoire du paysage français, Paris, Tallandier, 1985, t. II, p. 61 sq. 169 - P. Marres, « L’évolution de la viticulture dans le Bas-Languedoc », Société languedocienne de Géographie. Bulletin, t. VI, 1935, p. 30 ; pour Frontignan et le commerce
79
maritime de son vin en Ligurie : E. Le Roy Ladurie, Les paysans de Languedoc, op. cit., t. I, p. 432. 170 - Idem, p. 200. 171 - B. Jaudon, De la polyculture traditionnelle…, op. cit., p. 40. 172 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 1 E 1455, Privilège..., doc. cit., 1517. 173 - E. Appolis, Un pays languedocien…, op. cit., p. 424-425 ; P. Marres, « L’évolution de la viticulture… », art. cit., p. 31. 174 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 3 P 2939, Cadastre de Tressan, 1826. 175 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 10 B Tressan, ordinaires de justice, 1784. 176 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, C 4960, Plan de l’Hérault à hauteur d’Usclas, 1790. 177 - ARCH. COM. TRESSAN, CC 1, doc. cit., f° 215 r°-228 r°. 178 - B. Jaudon, Paysage et société rurale en Bas-Languedoc. Les hommes et la terre à Tressan de 1770 à 1826, mém. maîtrise, H. Michel dir., Montpellier, université Paul Valéry, 1996, t. II, annexe n° 17, p. 20. 179 - Ibid. 180 - S. Olivier, Un terroir du Lodévois…, op. cit., t. I, p. 46 : « une partie des 300 ha manquants est inévitablement constituée par la somme des surfaces de toutes les parcelles évaluées à vue d’œil ». 181 - Le dépouillement des registres paroissiaux de Tressan n’aurait jamais pu être mené à bien sans Samira Kacimi, qui a effectué une grande partie de la saisie des actes : c’est l’occasion de la remercier affectueusement. 182- ARCH. COM. TRESSAN, GG 1 à GG 8, registres paroissiaux du village, environ 1200 p., 1607-1792. 183- ARCH. COM. TRESSAN, GG 8, registre paroissial, 1786-1792, non folioté, à cette date. 184 - ARCH. COM. TRESSAN, GG 6, à cette date. 185 - Ibid. 186- ARCH. COM. TRESSAN, GG 1 Tressan. 187 - Idem, à cette date. 188 - Idem, 10 avril 1629, à cette date. 189 - E. Le Roy Ladurie, Les paysans de Languedoc…, op. cit., t. I, p. 422-423. 190 - Idem, p. 423-428. 191 - ARCH. COM. TRESSAN, GG 1, doc. cit. 13 septembre 1654, à cette date. 192 - Idem, 2 avril 1653, à cette date. 193 - H. Berlan et al., Démographie et crises en Bas-Languedoc (1670-1890), Montpellier, I.R.H.I.S., 1992, p. 17-18. 194 - Idem, p. 17. 195 - ARCH. COM. TRESSAN, GG 3, 24 juin 1686, 21 septembre 1686 et 21 mai 1687 ; ARCH. COM. TRESSAN, GG 4, 8 février 1707, à ces dates. 196 - C. Motte et al., Paroisses et communes de France. Hérault, Paris, C.N.R.S., 1989, p. 454. 197 - Ibid. 198 - ARCH. COM. TRESSAN, GG 2, 1er septembre 1656, à cette date. 199 - ARCH. COM. TRESSAN, GG 2, 11 mai 1665 et 19 août 1668 ; ARCH. COM. TRESSAN, GG 3, 13 juillet 1678 et 27 juillet 1686, à ces dates. 200 - ARCH. COM. TRESSAN, GG 4, 6 août 1702, à cette date. 201 - C. Motte et al., Paroisses et communes de France…, op. cit., p. 454. 202 - ARCH. COM. TRESSAN, GG 8, 4 septembre 1776, à cette date. 203 - Idem, 15 septembre 1776, à cette date. 204 - Idem, 14 aôut-22 septembre 1776, passim.
80
205 - C’est le cas, en forçant le trait, de la synthèse de G. Cholvy, « D’hier à aujourd’hui (1800-1960) : une révolution économique ? » in G. Cholvy (dir.), L’Hérault…, op. cit., p. 348 : « la principale richesse de l’Hérault, c’est le vin, chacun en convient en 1849 ». 206 - Cf. supra. 207 - Sur l’élevage, cf. infra. 208 - « Brouas » : à l’origine, rivage. Mais, les brouas du compoix, souvent signalés « brouas ou herme », se trouvent uniquement sur les pentes du coteau : ils décrivent sans doute des tas d’épierrement ou des talus envahis de ronces entre deux parcelles. 209 - A. Soboul, Les campagnes montpelliéraines à la fin de l’Ancien Régime. Propriété et cultures d’après les compoix, Paris, P.U.F., 1958, p. 61 et, surtout, ARCH. DÉP. HÉRAULT, 30 J 313/1*, Mémoire..., doc. cit., p. 14. 210 - Ph. Huppé, Le gisant de la féodalité…, op. cit., p. 140-141. 211 - P. Marres, « Le Lodévois », Société languedocienne de Géographie. Bulletin, t. 47, 1924, p. 123-124. 212 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 30 J 313/1*, Mémoire…, doc. cit., p. 22. 213 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, L 2776, doc. cit. 214 - E. Appolis, Un pays languedocien…, op. cit., p. 421. 215 - A. Berger, F. Maurel, La viticulture et l’économie du Languedoc du XVIIIe siècle à nos jours, Montpellier, Ed. du Faubourg, 1980, p. 17. 216 - A. Soboul, Les campagnes montpelliéraines…, op. cit., p. 43. 217 - ARCH. COM. TRESSAN, CC 1, doc. cit., f° 2 v°, 5 v°, 48 r° et 226 r°. 218 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 10 B Tressan, liasse n° 3, pièce n° 3, Dictam de sentence pour Brouillet contre Chauvet et Maure mariés, 21 mai 1781. 219 - G. Geraud-Parracha, Le commerce des vins et des eaux-de-vie en Languedoc au XVIIIe siècle, Montpellier, p. 15-16. 220 - A. Soboul, Les campagnes montpelliéraines…, op. cit., p. 7. 221 - G. Geraud-Parracha, Le commerce des vins…, op. cit., p. 15-16. 222 - Ibid. 223 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 74 EDT HH2 Gignac, passim. 224 - F. Chauvet, Une communauté du littoral languedocien à la veille de la Révolution française. Pérols (1750-1789), mém. maîtrise, A. Blanchard dir., Montpellier, Université Paul Valéry, 1989, p. 84. 225 - A. Soboul, Les campagnes montpelliéraines…, op. cit., p. 34. 226 - F. Chauvet, Une communauté…, op. cit., p. 84. 227 - A. Soboul, Les campagnes montpelliéraines…, op. cit., p. 118-119 et 142-143. 228 - G. Ikni, « Recherches sur la propriété foncière, problèmes théoriques et de méthode (fin XVIIIe-début XIXe siècle) », Annales historiques de la Révolution française, n° 241, juillet-sept. 1980, p. 409 : l’auteur compare les seuils fixés par plusieurs chercheurs et reprend ceux retenus par G. Lefebvre. 229 - G. Gavignaud-Fontaine, Le Languedoc viticole, la Méditerranée et l’Europe au siècle dernier (XXe), Montpellier, université Paul Valéry, 2000, p. 36. 230 - B. Jaudon, « Tressan de 1770 à 1826... », art. cit., p. 92. 231 - Ph. Huppé, Le gisant de la féodalité…, op. cit., p. 144. 232 - ARCH. COM. TRESSAN, CC 1, doc. cit., f° 1 v° et 2 r°. 233 - E. Le Roy Ladurie, Les paysans de Languedoc, op. cit., t. I, p. 91. 234 - L. Dermigny in Ph. Wolff (dir.), Histoire du Languedoc, op. cit., p. 406-408. 235 - Cf. supra. 236 - « Esparcet » : sainfoin. 237 - E. Le Roy Ladurie, Les paysans de Languedoc, op. cit., t. I, p. 69.
81
238 - Ibid. 239 - « Viguier » : juge local. 240 - « Ségades » : fauches. 241 - L. Dermigny in Ph. Wolff (dir.), Histoire du Languedoc, op. cit., p. 396-397 ; 242 - E. Le Roy Ladurie, Les paysans de Languedoc, op. cit., t. I, p. 69. 243 - Ph. Huppé, Le gisant de la féodalité…, op. cit., p. 92 : en 1556, le seigneur de Tressan possédait le droit exclusif de pigeonnier dans sa seigneurie. 244 - ARCH. COM. TRESSAN, CC 1, doc. cit., f° 215 r°, 4 r° et 104 r°. 245 - Idem, f° 114 sq. 246 - S. Olivier, Un terroir du Lodévois…, op. cit., t. I, p. 53-54. 247 - J.-M. Moriceau, L’élevage sous l’Ancien régime, Paris, SEDES, 1999, p. 90-91. 248 - E. Appolis, Un pays languedocien…, op. cit., p. 451. 249 - J.-M. Moriceau, L’élevage…, op. cit., p. 92. 250 - Idem, p. 93. 251 - ARCH. COM. TRESSAN, CC 1, doc. cit., f° 108 r° et 215 r° ; Guillaume Cabassut est signalé boucher à Tressan in ARCH. DÉP. HÉRAULT, 10 B Tressan, liasse n° 5, pièce n° 16, Audition de Guilhaume Cabassut boucher, 18 juillet 1781. 252 - E. Appolis, Un pays languedocien…, op. cit., p. 441-447 ; S. Olivier, Un terroir du Lodévois…, op. cit., t. I, p. 56-57. 253 - « Ratouble, rastouble » : champ qui vient d’être fauché, champ en guéret. 254 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 10 B Tressan, liasse n° 5, pièce n° 2, Information pour Cabassut contre Mayran, 24 juin 1781. 255 - Idem, pièce n° 1, Audition de Mayran, 18 juillet 1781. 256 - Idem, pièce n° 11, Rapport d’experts, 24 juin 1781. 257 - Idem, liasse n° 8, pièce n° 3, Jugement de police pour le procureur fiscal au siège de Tressan contre Cabassut, 26 avril 1782. 258 - Idem, liasse n° 4, pièce n° 2, Information pour le procureur fiscal de la gruyerie de Tressan, 14 avril 1772. 259 - E. Appolis, « La question de la vaine pâture en Languedoc », Annales historiques de la Révolution française, n° 86, mars-avril 1937, p. 27. 260 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, C 2956, doc. cit. 261 - E. Apollis, Un pays languedocien…, op. cit., p. 450 ; G. Frêche, Toulouse et la région Midi-Pyrénées au siècle des Lumières (1680-1750), Toulouse, Cujas, 1978, p. 281 ; G. Larguier, Le drap et le grain en Languedoc…, op. cit., t. III, p. 1087 sq ; S. Olivier, Un terroir du Lodévois…, op. cit., t. I, p. 20-21. 262 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 30 J 313/1*, doc. cit., p. 19. 263 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, C 846, Mémoire sur l’agriculture dans le diocèse de Béziers, 1787. 264 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, C 2841, Estat et depouillement des Comm.tes du Dioceze de Beziers dans les terroirs desquelles ou hameaux en dependans on peut laissér depaitre une certaine quantité de chevres sans aucun risque de domage, suivant la relation des experts cy aprés, 15 décembre 1725, f° 19 v°. 265 - Idem, f° 4 r° et v°. 266 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, C 2949, Réflexions…, anonyme, 1781. 267 - Ibid. 268 - L. Dermigny, « Le prix du vin en Languedoc au XVIIIe siècle », Annales du Midi, t. 75, 1964, p. 505-528, passim. 269 - Idem, p. 528.
82
270 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, C 2686, pièce n° 6, A Monseigneur le Ministre chargé du haut et bas Languedoc, 1783. 271 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, C 2949, doc. cit., 1781. 272 - L. Dermigny, « Le prix du vin… », art. cit., p. 523. 273 - Ibid. 274 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, C 2949, Mémoire sur le commerce général de la province de Languedoc, 1768, non folioté. 275 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, C 2686, pièce n° 6, A Monseigneur…,doc. cit., 1783. 276 - Idem, pièce n° 18, Lettre de la Chambre de Commerce de Montpellier à l’Intendant, 16 avril 1786. 277 - Idem, pièce n° 19, Etat des vins et eaux de vie embarqués au port de Sete dans le courant de l’année mille sept cents cinquante trois, 1er janvier 1754. 278 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 1 E 1446, pièce n°1, Conte de tous gens du Pouget quils ont brulé son vin lannée 1789, 19 avril 1789 279 - Ph. Huppé, Le gisant de la féodalité…, op. cit., p. 73. 280 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 2 F 13/66, Mémoire pour Marc Fabre, habitant du lieu de Tressan, demandeur et deffendeur contre les sieurs Isaac et Louis Martin, négocians de Montpellier…, Montpellier, impr. J. Martel, 1754, in-f°, 11 p. 281 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, L 4847. 282 - Idem, p. 1 : « Nous etant rendûs sur les lieux contencieux etant munis des differents Etats de section composant et formant l’entier territoire de la commune dud(it) Tressan, ainsi que de la matrice de Rôle sur laquelle les impositions foncieres de 1791 avoient eté reparties, le tout à nous remis par la municipalité dud(it) lieu, et après avoir parcourû toutes les differentes sections, et nous etre reumés sur tous les articles et avoir fixé le revenû net de chacun d’iceux, en se conformant a la loi du 26e mars 1791 (...) ». 283 - Cl. Motte et al., Paroisses et communes de France…, op. cit., p. 454. 284 - R. Laurent, G. Gavignaud, « La Révolution et l’Empire » in G. Cholvy (dir.), L’Hérault…, op. cit., p. 294-296, 304-305. 285 - F. Bocage, Le souffle de la Révolution sur les étangs. Pérols (1789-1823), mém. maîtrise, A. Blanchard dir., université Paul Valéry, Montpellier III, 1989, p. 90-92. 286 - Idem, p. 318. 287 - Mêmes problèmes à l’échelle nationale in G. Duby (dir.), Histoire de la France, Paris, Larousse, 1971, t. II, p. 293-294. 288 - D’après ARCH. DÉP. HÉRAULT, L 4847, doc. cit., Tressan, 1792. 289 - Ph. Huppé, Le gisant de la féodalité…, op. cit., p. 10. 290 - Car, les dépossédés de 1770 ont libéré à peine 7,3 % du terroir, 7,7 % du vignoble et 42 des 407 vignes portées au compoix. 291 - G. Larguier, « Structures agraires, structures sociales d’un village narbonnais : Ouveillan (fin XVIIe-début XXe siècle) », Economie et société en Languedoc-Roussillon de 1789 à nos jours, op. cit., p. 161 : a contrario, « la grande propriété (…) traverse très bien la Révolution et l’Empire » à Ouveillan. 292 - C. Sentenac, Bessan, au diocèse d’Agde (1770-1789) : une communauté rurale à la veille de la Révolution, mém. maîtrise, ss. dir. A. Blanchard, université Paul Valéry, Montpellier III, 1985, p. 20. 293 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, Q 237, Etat des citoyens qui présentent à la séance du 25 prairial an III pour soummissionner aux biens nationaux qu’ils désignent sur le registre destiné à cet effet, articles n° 214 et 217. 294 - Ph. Huppé, Le gisant de la féodalité…, op. cit., p. 157. 295 - L. Dermigny, « Le prix du vin… », art. cit., passim.
83
296 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 3 P 109 Tressan, chemise n° 2, pièce n° 1, Rapport fait à Monsieur le Préfet du Departement de l’Hérault par le Directeur des contributions sur l’expertise de Commune de Tressan, 23 janvier 1806. 297 - P. Marres, « L’évolution de la viticulture dans le Bas-Languedoc », Société languedocienne de Géographie. Bulletin, t. 6, 1935, p. 34-35. 298 - J. Sagnes (dir.), Histoire de Béziers, Toulouse, Privat, 1986, p. 229-230. 299 - Cf. supra. 300 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 3 P 109 Tressan, chemise n° 3, pièce n° 1, Rapport du controleur des Contributions attaché à l’arrondissement de Lodève, sur l’expertise de la commune de Tressan, 25 avril 1808. 301 - J. Rougé, « Les crues de l’Hérault », Etudes sur l’Hérault et sa région, t. II, n° 2, 1971, p. 5 : la côte de 10 mètres n’a été franchie à Gignac que six fois au cours des deux derniers siècles (automnes 1812, 1868, 1890, 1907, 1958 et 1963) ; sur les dangers des crues pour la viticulture, p. 8. 302 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 3 P 109 Tressan, chemise n° 3, pièce n° 1, doc. cit. 303 - Ibid. 304 - Cf. supra. 305 - A. Gazagnes, Saint-Pargoire. Deux mille ans d’histoire d’une commune languedocienne, Impr. Maury, 1996, p. 128. 306 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 3 P 2939, doc. cit. 307 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 3 P 2954, doc. cit. 308 - A. Gazagnes, Saint-Pargoire…, op. cit., p. 128. 309 - Ibid. 310 - Ibid. 311 - L. Secondy (dir.), Entre Coulazou et Mosson. Dix villages, dix visages, Montpellier, chez l’auteur, 1985, p. 261 : Cournonsec, Cournonterral, Fabrègues, Juvignac, Lavérune, Murviel, Pignan, Saint-Georges-d’Orques, Saint-Jean-de-Védas et Saussan. 312 - J. Vidal, Monographie de la ville d’Aimargues, Nîmes, Lacour, rééd. de l’ouvrage de 1906, p. 107. 313 - F. Bocage, Le souffle de la Révolution…, op. cit., p. 99. 314 - E. Le Roy Ladurie, Les paysans de Languedoc, op. cit., t. I, p. 654. 315 - B. Jaudon, «Tressan… », art. cit., p. 95. 316 - B. Jaudon, Paysage et société rurale…, op. cit., p. 121-122. 317 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 6 M 1693, Liasse n°1, Etat de la quantité de vin déclarée en l’an 13 dans chacune des communes du département de l’Hérault, an XIII. 318 - Cf. supra. 319 - ARCH. COM. TRESSAN, Délibérations municipales, Délibération du 30 octobre 1842, f° 32 v. 320 - Cf. supra. 321 - B. Jaudon, Paysage et société rurale…, op. cit., t. I, p. 93-94. 322 - R. Ferras et al., Languedoc méditerranéen. Aude, Gard, Hérault, Paris, Bonneton, 1989, p. 109. 323 - B. Jaudon, De la polyculture traditionnelle…, op. cit., photographies n° 9 à 11, p. 267-268. 324 - C. Motte et al., Paroisses et communes de France…, op. cit., p. 454. 325 - R. Laurent, « Les quatre âges… », art. cit. 326 - ARCH. COM. TRESSAN, non coté, matrice cadastrale de Tressan, 1914. 327 - L. Secondy, J. Segondy, Contribution à l’histoire des communautés languedociennes. Pignan en Languedoc, Montpellier, Impr. Languedocienne, p. 292 : les auteurs insistent « sur le caractère souvent douteux des chiffres fournis à cette époque par les maires des villages »,
84
tout comme B. Jaudon et S. Olivier, « Le destin d’un site : la colline des châteaux de Lastours du milieu du XIIIe siècle à la fin du XXe siècle » in M.-E. Gardel (dir.), Cabaret..., op. cit., p. 241. 328 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 6 M 1699, Statistiques agricoles par commune de l’arrondissement de Lodève, 1836. 329 - L. Dumond, « Le chemin de fer Montpellier-Cette, 1839-1852 », Liame. Bulletin du Centre d’Histoire moderne et contemporaine de l’Europe méditerranéenne et de ses périphéries, n° 2, juillet-déc. 1998, p. 109-133. 330 - ARCH. COM. TRESSAN, Délibérations du conseil municipal, 10 mai 1845, f° 59 r et v. 331 - A. Gazagnes, Saint-Pargoire…, op. cit., p. 130-131. 332 - ARCH. COM. TRESSAN, Délibérations du conseil municipal, délibération du 9 novembre 1854, f° 126 r. 333 - C’est le cas des communes d’Arboras, Aumelas, Jonquières, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Guiraud et Saint-Saturnin. 334 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 6 M 1707, Liasse n°3, pièce n°4, Année 1857. Statistique annuelle. Questionnaire récapitulatif, arrondissement de Lodève, canton de Gignac, 1857. 335 - A. Gazagnes, Saint-Pargoire…, op. cit., p. 131. 336 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 6 M 1707, doc. cit. 337 - Ibid. 338 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 6 M 1710, chemise n° 2, pièce n° 1, 1860. 339 - A. Gazagnes, Saint-Pargoire…, op. cit., p. 131. 340 - ARCH. COM. TRESSAN, Registre des délibérations municipales ouvert en octobre 1837, délibération du 20 avril 1856, f° 137 v-138 r. 341 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 6 M 1707, doc. cit. 342 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 6 M 1714, Chemise n° 2, pièce n° 4, Statistiques de l’arrondissement de Lodève, 1873, p. 7. 343 - Idem, pièce n° 1, 11 octobre 1875. 344 - ARCH. COM. TRESSAN, non coté, cadastre, 1914. 345 - R. Laurent, « Les quatre âges… » in Economie et société en languedoc-Roussillon…, op. cit., p. 20. 346 - B. Jaudon, De la polyculture traditionnelle…, op. cit., p. 132-136. 347 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 2 O 313 Tressan, 1840-1940, passim et 3 O 313 Tressan, passim. 348 - E. Weber, La fin des terroirs. La modernisation de la France rurale (1870-1914), Paris, Fayard, 1986, 839 p. 349 - Cf. infra. 350 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 2 O 313-12, pièce n° 1, 24 décembre 1843. 351 - ARCH. COM. TRESSAN, Délibérations du conseil municipal de Tressan, registre n° 7, 28 avril 1844, f° 42 v°. 352 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 2 O 313-12, pièces n° 1 (1843-1844) et n° 2 (1845). 353 - Idem, pièces n° 3 et 4. 354 - Très nombreux exemples in A.C.Tressan, Registre des délibérations municipales, registre ouvert en octobre 1837, délibérations du 15 mai 1838, f° 3 v ; 28 mai 1839, f° 10 v ; 18 octobre 1840, f° 17 v ; 16 mai 1841, f° 20 v… 355 - Idem, délibérations du 20 décembre 1853, f° 121 r°. 356 - Idem, f° 129 r°, 17 mars 1855. 357 - Idem, f° 133 v° et 136 r°, 7 juillet 1855 et 3 janvier 1856. 358 - Idem, f° 138 v°, 20 avril 1856.
85
359 - ARCH. COM. TRESSAN, doc. non coté, nouveau registre de délibérations municipales commencé en 1856, 20 juillet 1856, à cette date. 360 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 3 O 313-1 à 4, 1859-1914. 361 - L. Secondy (dir.), Entre Coulazou et Mosson…, op. cit., p. 262 : « le chemin de fer n’innervera la région que trente ans plus tard. (…). La primauté de la vigne est bien antérieure à cette création (…) ». 362 - AC.T., Registre des délibérations municipales ouvert en avril 1873, non paginé, délibération n° 18, 15 février 1874. 363 - R. Brunet in Ph. Wolff (dir.), Histoire du Languedoc, op. cit., p. 498 ; R. Pech, « Créer et reconstituer un vignoble. Un témoignage du Minervois : le mémoire d’Ernest Morin (1846-1899) », Histoire et sociétés rurales, n° 14, 2000, p. 207. 364 - G. Cholvy in G. Cholvy (dir.), L’Hérault…, op. cit., p. 361. 365 - Idem, p. 362. 366 - A. Ducornot, Canalisation de l’Hérault, Saint-Affrique, Impr. Ducornot, 1878, p. 4. 367 - P. Carrière, « Le canal de Gignac », Bulletin de la Société languedocienne de géographie, t. 14, fasc. 2-3, p. 327. 368 - A. Joanne, Géographie du département de l’Hérault avec une carte coloriée et 11 gravures, Paris, Hachette, 1882, p. 8-20. 369 - Idem, p. 8. 370 - Idem, p. 54. 371 - G. Cholvy in G. Cholvy (dir.), L’Hérault…, op. cit., p. 364. 372 - E. Le Roy Ladurie, Histoire du Languedoc, op. cit., t. I, p. 113 et surtout le témoignage d’époque d’Ernest Morin in R. Pech, « Créer et reconstituer un vignoble », art. cit., p. 208 sq. 373 - J. Mestre, Histoire de la ville de Gignac…, op. cit., p. 6 : la plus grande partie de ce livre était déjà rédigée en septembre 1883. 374 - Idem, p. 209. 375 - Ibid. 376 - G. Cholvy in G. Cholvy (dir.), L’Hérault…, op. cit., p. 363. 377 - G. Postel-Vinay, La terre et l’argent. L’agriculture et le crédit en France du XVIIIe siècle au début du XXe siècle, Paris, Albin Michel, 1998, p. 330. 378 - R. Pech, « Créer et reconstituer un vignoble », art. cit., p. 209-210. 379 - J. Mestre, Histoire de la ville de Gignac…, op. cit., p. 154 380 - Idem, p. 158 et 181. 381 - ARCH. COM. TRESSAN, non coté, Délibérations muncipales, non paginé, 22 janvier 1888, à cette date. 382 - Idem, 18 juin 1888, à cette date. 383 - Idem, 22 août 1889, à cette date. 384 - Idem, 18 août 1895, à cette date. 385 - R. Pech, « Créer et reconstituer un vignoble », art. cit., p. 212, 225 et 226. 386 - Idem, p. 226. 387 - Cf. infra. 388 - ARCH. COM. TRESSAN, non coté, Délibérations municipales, non paginé, 12 février 1888, à cette date. 389 - Ibid. 390 - Idem, 17 août 1890, à cette date. 391 - Idem, 12 avril 1891, à cette date. 392 - Idem, 15 novembre 1891, à cette date. 393 - Idem, 31 janvier et 19 juin 1892, à ces dates.
86
394 - Idem, 28 novembre 1895, à cette date. 395 - Idem, 30 mai 1897, à cette date. 396 - G. Gavignaud-Fontaine, Le Languedoc viticole…, op. cit., p. 57 sq. 397 - Idem, p. 61. 398 - Idem, p. 62. 399 - J. Sagnes et al., 1907 en Languedoc et en Roussillon, Ediud, 1997, 283 p. 400 - ARCH. COM. TRESSAN, non coté, Matrice des propriétés non bâties (copie), 1914. 401 - R. Laurent, « Les quatre âges du vignoble du Bas-Languedoc et du Roussillon » in Economie et société en Languedoc-Roussillon de 1789 à nos jours, Montpellier, université Paul Valéry, 1978, p. 24. 402 - Idem, p. 25. 403 - E. Le Roy Ladurie, Les paysans de Languedoc…, op. cit., t. I, p. 654. 404 - G. Cholvy in G. Cholvy (dir.), L’Hérault…, op. cit., p. 364-368. 405 - C. Mote et al., Paoisses et communes de France. Hérault, Paris, C.N.R.S., 1989, p. 454. 406 - G. Cholvy in G. Cholvy (dir.), L’Hérault…, op. cit., p. 364-365. 407 - G. Gavignaud-Fontaine, Le Languedoc viticole…, op. cit., p. 109-116. 408 - Idem, p. 110. 409 - G. Cholvy in G. Cholvy (dir.), L’Hérault…, op. cit., p. 364. 410 - E. Weber, op. cit., passim. 411 - ARCH. COM. TRESSAN, non coté, Matrice cadastrale des propriétés bâties de la commune de Tressan, 17 avril 1882. 412 - Maison de G. Guerre : 17, rue des Barris. 413 - J.-P. Piniès, « Le cadre de vie et les usages domestiques » in R. Ferras et al., Languedoc méditerranéen, op. cit., p. 109 ; M. Sorre, « Le village languedocien » in P. Marres, L. Blanquet, L’Hérault géographique et historique. Choix de lectures, Béziers, Cavaillé-Montels, v. 1920, p. 58 sq. : cela correspond, par exemple, aux maisons de la partie haute de la rue des Barris à Tressan. 414 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 2 O 313-12, pièce n° 7, mars 1872-1873 ; ARCH. COM. TRESSAN, non coté, Délibérations du conseil municipal, 14 janvier 1890, à cette date et sq. 415 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 2 O 313-9, pièces n° 1 à 6 ; ARCH. COM. TRESSAN, Délibérations du conseil municipal de Tressan, registre n° 7, 1er avril 1839, f° 9 v° ; 4 septembre 1840, f° 15 r° ; 12 mai et 6 juin 1843 ; f° 38 v° et 39 r° ; registre n° 8, 25 janvier 1857, à cette date ; 15 novembre 1857, à cette date et 16 mai 1858, à cette date. 416 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 2 O 313-9, pièce n° 6, 1884-1886. 417 - ARCH. COM. TRESSAN, non coté, Délibérations du conseil municipal, 18 juin 1888. 418 - Idem, 26 mai 1889, à cette date. 419 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 2 O 313-7, pièces n° 1 à 4, 1882-1895. 420 - Idem, pièce n° 2, 1891. 421 - ARCH. COM. TRESSAN, non coté, Délibérations du conseil municipal, 12 août 1891, à cette date. 422 - Idem, 7 septembre 1891, à cette date. 423 - Idem, 31 août 1892, à cette date. 424 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 2 0 313-7, pièce n° 9, 1895 ; plaque commémorative apposée au-dessus de la porte d’entrée de la mairie. 425 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 2 O 313-10, pièce n° 1, 1892-1893. 426 - ARCH. COM. TRESSAN, Délibérations du conseil municipal, registre n° 7, 22 janvier 1843, f° 34 r°.
87
427 - ARCH. COM. TRESSAN, non coté, Délibérations du conseil municipal, 27 mai 1889, à cette date. 428 - Idem, 29 janvier 1893, à cette date. 429 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 2 O 313-11 et 12, passim. 430 - ARCH. COM. TRESSAN, non coté, Délibérations du conseil municipal, 8 juin 1893, à cette date. 431 - Idem, 28 juillet 1893, à cette date. 432 - Idem, 10 janvier 1894, à cette date. 433 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 2 O 313-15 et 16, 1845-1932. 434 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 2 O 313-15, pièce n° 2. 435 - Idem, pièces n° 3 à 9. 436 - Idem, pièces n° 11 à 15. 437 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 3 O 313-2 et 3, passim, 1884-1914. 438 - ARCH. COM. TRESSAN, non coté, Délibérations du conseil municipal, 17 août 1890. 439 - Idem, 28 mai 1891, à cette date. 440 - A. Ducornot, Canalisation de l’Hérault, op. cit., p. 3-4. 441 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 7 S 384, liasse n° 7, chemise n° 1, pièce n° 5, Pétition de propriétaires riverains du fossé Mayral, 5 décembre 1897. 442 - Idem, pièce n° 9, Ruisseau Mayral. Curage de ce ruisseau dans la partie comprise entre l’extrémité du canal de Gignac et 120 mètres en aval du pont des Tines. Constitution d’une association syndicale. Rapport de l’ingénieur ordinaire, 18 septembre 1897. 443 - ARCH. DÉP. HÉRAULT, 7 S 283, 1910-1923 et 2 O 313-17, pièces n° 4 à 8.
![Page 1: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/27.jpg)
![Page 28: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/28.jpg)
![Page 29: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/30.jpg)
![Page 31: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/31.jpg)
![Page 32: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/32.jpg)
![Page 33: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/33.jpg)
![Page 34: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/34.jpg)
![Page 35: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/35.jpg)
![Page 36: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/36.jpg)
![Page 37: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/37.jpg)
![Page 38: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/38.jpg)
![Page 39: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/39.jpg)
![Page 40: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/40.jpg)
![Page 41: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/41.jpg)
![Page 42: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/42.jpg)
![Page 43: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/43.jpg)
![Page 44: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/44.jpg)
![Page 45: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/45.jpg)
![Page 46: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/46.jpg)
![Page 47: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/47.jpg)
![Page 48: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/48.jpg)
![Page 49: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/49.jpg)
![Page 50: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/50.jpg)
![Page 51: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/51.jpg)
![Page 52: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/52.jpg)
![Page 53: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/53.jpg)
![Page 54: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/54.jpg)
![Page 55: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/55.jpg)
![Page 56: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/56.jpg)
![Page 57: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/57.jpg)
![Page 58: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/58.jpg)
![Page 59: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/59.jpg)
![Page 60: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/60.jpg)
![Page 61: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/61.jpg)
![Page 62: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/62.jpg)
![Page 63: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/63.jpg)
![Page 64: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/64.jpg)
![Page 65: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/65.jpg)
![Page 66: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/66.jpg)
![Page 67: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/67.jpg)
![Page 68: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/68.jpg)
![Page 69: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/69.jpg)
![Page 70: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/70.jpg)
![Page 71: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/71.jpg)
![Page 72: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/72.jpg)
![Page 73: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/73.jpg)
![Page 74: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/74.jpg)
![Page 75: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/75.jpg)
![Page 76: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/76.jpg)
![Page 77: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/77.jpg)
![Page 78: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/78.jpg)
![Page 79: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/79.jpg)
![Page 80: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/80.jpg)
![Page 81: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/81.jpg)
![Page 82: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/82.jpg)
![Page 83: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/83.jpg)
![Page 84: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/84.jpg)
![Page 85: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/85.jpg)
![Page 86: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/86.jpg)
![Page 87: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/87.jpg)
![Page 88: Tressan jusqu'en 1914 : la naissance d'un village viticole en Languedoc [version libre]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023030503/632443be4d8439cb620d4d1d/html5/thumbnails/88.jpg)