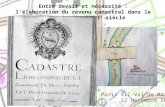"Entre devoir et nécessité : l’élaboration du revenu cadastral en Languedoc au XVIIIe siècle"
-
Upload
univ-montpellier -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of "Entre devoir et nécessité : l’élaboration du revenu cadastral en Languedoc au XVIIIe siècle"
1
Bruno Jaudon
-
doctorant et chargé de cours
Montpellier III
Entre devoir et nécessité :
l’élaboration du revenu cadastral dans le Languedoc du XVIIIe siècle
Depuis les travaux d’Emmanuel Le Roy Ladurie, le Languedoc d’Ancien Régime est
célèbre pour ses cadastres antérieurs à la Révolution, les compoix1. Les compoix
languedociens sont accompagnés d’un long cortège documentaire connexe : livres de
mutations foncières, « réparats » qui actualisent les matrices – mais sans nouvel arpentage –,
lorsque les mutations sont devenues trop nombreuses, compoix « cabalistes » qui fiscalisent
aussi les biens meubles (cheptel, stocks, capitaux prêtés...), préambules et rôles de taille,
redditions annuelles de comptes des administrateurs de la communauté d’habitants, etc2. Les
compoix s’intègrent donc à un abondant corpus fiscal, lui-même encadré par une solide
littérature juridique.
L’histoire de la série documentaire formée par les compoix languedociens a longtemps été
mal connue, sinon dans ses très grandes lignes et la thèse en cours de rédaction sous la
direction d’Élie Pélaquier vise à combler ce manque historiographique majeur3. De même, les
travaux de Gilbert Larguier et ceux d’un groupe de recherches dirigé par Jean-Loup Abbé ont
fini de relancer l’intérêt pour cette source fondamentale de l’histoire d’un vaste Sud de la
France que restent les cadastres languedociens certes, mais aussi provençaux, comtadins, bas-
dauphinois, rouergats et autres, depuis les Alpes jusqu’à la Garonne, aux Pyrénées et au
Massif Central4.
1 E. Le Roy Ladurie, Les paysans de Languedoc, Paris, SEVPEN, 1966, 2 vol., 884 p.
2 Présentation rapide, par exemple dans M. Oudot de Dainville, « Remarques sur les compoix du Languedoc
méditerranéen », Folklore, t. II, n° 15, 1939, p. 132-137 ou M. Derruau, « L’intérêt géographique des minutes
notariales, des terriers et des compoix. Un exemple », Revue de géographie alpine, t. XXXIV, 1946, p. 355-380. 3 B. Jaudon, « Faire un compoix en Gévaudan sous l’Ancien Régime. Six rapports d’opérations cadastrales
(1482-1788) », Histoire & Sociétés rurales, n° 26, 2006, p. 129-168 et « Le paysage cadastral languedocien,
photographie imparfaite du paysage (XVe-XIX
e siècle) », actes de la table ronde de l’université Paul Valéry-
Montpellier III (octobre 2005), Liame, n° 14 : « Cadastres et paysage », 2007, p. 11-29. 4 G. Larguier, « Les communautés, le roi, les États, la cour des Aides. La formation du système fiscal
languedocien » in A. Follain et G. Larguier, dir., L’impôt des campagnes. Fragile fondement de l’État dit
moderne (XVe-XVIII
e siècle), actes du colloque de Bercy (2-3 décembre 2002), Paris, Comité pour l’histoire
économique et financière de la France, 2005, p. 69-95 ou « Du compoix/estime au compoix/cadastre. L’exemple
du Languedoc (XIVe-XVI
e siècle) » in A. Rigaudière, dir., De l’estime au cadastre en Europe (XIII
e-XVIII
e
siècle), actes du colloque de Paris (11-12 juin 2003), Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la
2
Le Languedoc du XVIIIe siècle était composé, en 1789, de vingt quatre diocèses civils qui
regroupaient 2800 communautés d’habitants, institutions qu’on compare souvent et
précipitamment aux municipalités issues de la Révolution5. Dans cette immense province, le
vivier documentaire cadastral semble intarissable. Aussi est-il nécessaire de limiter les propos
tenus ici au cadre géographique retenu pour la thèse : une coupe qui, du nord au sud, traverse
le Bas-Languedoc, depuis le très centralien Gévaudan jusqu’au littoral méditerranéen, coupe
qui englobe les diocèses civils de Mende, Montpellier, Alès et Agde.
Ce territoire livre une grosse vingtaine de compoix du XVIIIe siècle, dont seize s’avèrent
particulièrement exploitables pour analyser l’élaboration du revenu cadastral qui détermina
leur rédaction. Leur excellent état conservatoire livre en effet les procès-verbaux préalables à
France, t. I, 2006, p. 221-244 ; sur le groupe réuni à Toulouse II-Le Mirail par J.-L. Abbé et F. Hautefeuille
autour des cadastres du Midi de la France : http://w3.terrae.univ-tlse2.fr/spip/spip.php?article302 5 A. Blanchard, É. Pélaquier, « Le Languedoc en 1789. Des diocèses civils aux départements. Essai de
géographie historique », Bulletin de la société languedocienne de géographie, fasc. 1-2, 1989, 13 cartes-211 p. ;
É. Pélaquier, dir., Atlas de la province historique de Languedoc, en cours d’élaboration, consultable sur le site de
« Crises », EA 4424 du CNRS : http://recherche.univ-
montp3.fr/crises/index.php?option=com_content&task=view&id=309&Itemid=181 ; sur la communauté
d’habitants : A. Follain, Le village sous l’Ancien Régime, Paris, Fayard, 2007, p. 107-115.
3
la mise en service du document, depuis la demande d’autorisation près la Cour des Comptes,
Aides et Finances de Montpellier du conseil général des habitants de la communauté pour
« refaire » son compoix, jusqu’à l’homologation de la matrice par cette cour souveraine.
Les conditions semblent donc réunies, à travers cette modeste gerbe de sources, pour se
demander comment on procédait, à l’échelle locale, pour élaborer le revenu cadastral de
chaque contribuable. Le calcul du revenu imposable constituait en effet la clef-de-voûte du
système fiscal d’une des plus grandes provinces du royaume. Pays d’États, le Languedoc,
dont l’assemblée des trois ordres consentait annuellement l’impôt au souverain, tirait un
certain prestige de la codification très stricte du jeu et des enjeux fiscaux6. Le cadre
réglementaire existant appelait, quant à la rédaction des compoix, une nécessité, celle de
calculer les revenus cadastraux de façon très rigoureuse7. Il faisait aussi apparaître un devoir
en filigranne, celui d’élaborer des revenus imposables les plus « justes » possibles, justes
fiscalement bien sûr.
Des enjeux clairement et solidement codifiés
L’élaboration d’un compoix par la communauté d’habitants languedocienne constituait,
sous l’Ancien Régime, un moment fort de la vie villageoise, moment de tensions et
d’équilibre. Les enjeux demeuraient forts évidemment car le nouveau cadastre à la faction
duquel on œuvrait servait à répartir l’impôt et son caractère public, une fois mis au net,
entraînait des contraintes tacites.
Le compoix : répartir la taille et bien plus
Il est important de répéter que le compoix constitue, en Languedoc, la pierre de touche de
l’ensemble de l’édifice fiscal royal, pour la plus grande partie de la fiscalité directe s’entend.
La taille présentait ici deux caractéristiques entremêlées : une nationale et l’autre provinciale.
À l’échelle du royaume, la taille formait un impôt de répartition dont la logique demeurait de
déterminer, à l’avance, quelle fraction du total paierait chacun. Ainsi le Languedoc contribuait
à un peu plus de 2 % de la taille du royaume, le diocèse civil de Mende à 1/18,5e de la taille
6 G. Larguier, « Fiscalité et institutions : le testament des Etats du Languedoc », Études sur l’Hérault, n° 4, 1983,
p. 41-46. 7 G. Larguier, « Technique et nécessité : la mesure de la terre en Languedoc, XIV
e-XVIII
e siècles », Cahiers de
métrologie, t. 20-21, 2002-2003, p. 37-50.
4
du Languedoc et la petite ville de Marvejols à 1/33e de la taille du Gévaudan
8. À l’échelle de
la province, la taille était aussi un impôt réel, c’est-à-dire qu’elle pesait sur l’ensemble des
terres roturières (dites « rurales ») et non sur les individus en tant que tels. Les terres nobles
ne contribuaient pas à la taille mais elles composaient très rarement plus du dixième de la
superficie du finage. Rares aussi étaient les terroirs ou les villages exempts de taille à d’autres
motifs – en général le bon plaisir du roi –, comme la châtellenie royale des Tours de Cabardès
(Montagne Noire) ou la seigneurie et de Grizac (Mont Lozère)9.
Les principes de réalité et de répartition de la taille amenaient donc doublement à la tenue
de matrices cadastrales. Il fallait absolument dresser, communauté par communauté, « l’état
civil » de la terre, c’est-à-dire distinguer les terres nobles des terres rurales du finage mais
aussi en identifier les propriétaires qui, par le simple fait de posséder un bien foncier,
endossaient le statut de contribuable à la taille. Il fallait en outre calculer le revenu imposable
8 É. Combes, La tariffe universelle des provinces de la France et des vingt deux dioceses du pays de Languedoc
avec la tariffe particuliere des villes & lieux du dioecese de Nismes…, Nîmes, J. Vaguenar, 1619, env. 150 p. ;
Commission nommée par délibération des États de Languedoc, Compte rendu des impositions et des dépenses
générales de la province de Languedoc d’après les départements & les états de distribution, Montpellier, J.
Martel aîné, 1789, 456 p ; J. Roucaute, « La répartition des tailles en Gévaudan au début du XVIIe siècle »,
Bulletin de la société d’agriculture, industrie, sciences et arts du département de la Lozère, t. LI, 1899, 2e partie,
p. 3-24. 9 B. Jaudon, S. Olivier, « Le destin d’un site : la colline des châteaux de Lastours du milieu du XIII
e siècle à la
fin du XXe siècle » in M.-É. Gardel, dir., Cabaret. Histoire et archéologie d’un castrum. Les fouilles du site
médiéval de Cabaret à Lastours (Aude), Carcassonne, C.V.P.M., p. 193-250 ; B. Jaudon, « Les contradictions
fiscales du Gévaudan au dernier siècle de l’Ancien Régime », in A. Follain, éd., Campagnes en mouvement en
France du XVIe au XIX
e siècle. Autour de Pierre de Saint Jacob, actes du colloque international d’histoire rurale
(Dijon, 23-24 mars 2007), Dijon, EUD, p. 275-287, 334-336.
5
de chacun en fonction de ses possessions, afin de déterminer à l’avance la quotité de chaque
contribuable10
. L’ensemble des revenus imposables des particuliers portés au compoix formait
le revenu imposable de la communauté : ainsi, lorsque la mande de la taille parvenait de
l’assiette diocésaine, chaque villageois savait déjà de quelle fraction de celle-ci il devrait
s’acquitter (figure n° 2). Poussé à son bout, le principe de répartition l’était assurément en
Languedoc, puisqu’il atteignait jusqu’à la porte de la maisonnée.
De plus, le compoix ne servait pas qu’à répartir la taille, puisque la quotité du Languedoc
s’alourdissait, pour le contribuable, à chaque étape des opérations de répartition. Ainsi le
montant du brevet était augmenté des frais de tenue des États de Languedoc, assez importants
et ensuite, de ceux de tenue de chaque assiette diocésaine, plus modestes. Au village enfin, la
communauté avait obtenu « de temps immémorial » le droit de s’imposer, en sus de la mande,
d’un certain nombre de dépenses ordinaires et imprévues déterminées par la Loi. Cela
amenait, depuis la fin du XVIIe siècle, la tenue rigoureuse de préambules explicatifs très
détaillés placés en tête des rôles de taille locaux, préambules dont un double était contrôlé par
l’assiette diocésaine11
.
Le revenu cadastral du contribuable (ou « allivrement ») pouvait aussi lui donner accès,
selon les époques et les lieux, à certaines pratiques économiques et sociales assez connues.
Dans le bas pays, l’accès temporaire du bétail aux champs moissonnés ou aux vignes
vendangées se faisait à proportion de « l’allivrement », nom donné au revenu cadastral, à tant
de bêtes par sous ou livres « de compoix »12
. Dans le haut pays, l’allivrement pouvait aussi
conditionner l’accueil à l’estivage des troupeaux transhumants ou le partage des nuits de
fumature13
. À Drigas (Grands Causses), de 1636 à 1751, les contribuables jouissent du droit
10
Belles explications à l’époque du Roi-Soleil par l’intendant Nicolas Lamoignon de Basville in F. Moreil,
L’intendance de Languedoc à la fin du XVIIe siècle. Edition critique des mémoires « pour l’instruction du duc de
Bourgogne », Paris, CTHS, 1985, p. 187-188 ou à la fin de l’Ancien Régime : J.-B. Denisart, J.-B Bayard, L.
Calenge, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence tant ancienne que moderne,
Paris, veuve Desaint, 1786, p. 32-33. 11
Comme explicité, par exemple, dans cette Ordonnance concernant les dépenses ordinaires & impreveuës,
capitaux & interests des dettes ; et le formulaire des preambules des rôlles des impositions des villes &
communautez de la province de Languedoc, 1701, 7 p., reprise en 1723, 1724, 1736... et conservées, parfois,
dans les papiers des communautés d’habitants. 12
É. Appolis, « La question de la vaine pâture en Languedoc au XVIIIe siècle », Annales historiques de la
Révolution française, 1938, p. 97-132. 13
B. Jaudon, J. Lepart et al., « Troupeaux et paysages sur le Causse Méjan (XVIIe-XX
e s.) » in P.-Y. Laffont,
éd., Transhumance et estivage en Occident des origines aux enjeux actuels, actes des XXVIe Journées
internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran (9-11 septembre 2004), Toulouse, Presses universitaires du
Mirail, p. 275-289 ; R.-J. Bernard, « Notes sur les nuits de fumade d’après le compoix et cadastre de Belvezet,
1630 », Revue du Gévaudan, n° 11, 1965, p. 211-228 ; estimation du revenu cadastral pour se répartir entre
contribuables les nuits de fumâture : Arch. dép. Lozère, E 841, compoix et répartition des nuits de fumature du
Chastel-Nouvel (Margeride), 1672, 267 f°.
6
d’accueillir pendant l’été des troupeaux venus de la plaine en fonction du revenu cadastral : ils
« peuvent tenir vingt bestes a layne estrangeres pour ch[ac]une livre en compoidz »14
.
On comprend aisément que la réalisation du compoix constituait un enjeu important pour
la communauté d’habitants, enjeu économique et social qui dépassait le simple cadre fiscal.
Un document qui se veut irréprochable
De là découle le soin méticuleux qui entoure les pratiques cadastrales, régulées et
encadrées de près par la Cour des Comptes, Aides et Finances de Montpellier. La cour
souveraine, créée dans la première moitié du XVIe siècle, réglait les litiges en matière d’impôt
et notamment en ce qui concernait la taille réelle et partant, les compoix15
. Dès les années
1560, plusieurs de ses magistrats s’inscrirent dans une longue tradition d’écriture de la
jurisprudence. Au XVIIIe siècle, on réédite toujours le Traicté des tailles et autres impositions
d’Antoine d’Espeisses, paru pour la première fois en 164316
. L’édition originale consacre de
longues pages à la procédure administrative à suivre pour élaborer le nouveau cadastre d’une
communauté mais aussi, de façon très éclairante, sur les grands principes à respecter pour
élaborer le revenu cadastral des contribuables17
. À la fin du XVIIIe siècle, les États
commandèrent à Jean Albisson, avocat, jurisconsulte et garde des archives de l’assemblée
depuis 1774, la rédaction des Loix municipales et économiques du Languedoc, œuvre
14
Arch. dép. Lozère, EDT 074 DD 1, règlements sur la dépaissance des ovins, 4 mars 1636, nf ; interdiction
définitive de la transhumance en 1751 (même dossier, nf). 15
P. Serres, Histoire de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Montpellier, Montpellier, F. Seguin, 1878,
218 p ; P. Vialles, Études historiques sur la Cour des Comptes, Aides et Finances de Montpellier, Montpellier,
Firmin et Montane, 1921, 336 p. 16
Rééditions en 1656, 1657, puis publication des Œuvres... principales de l’auteur en 1660, suivies de rééditions
complétées en 1685, 1750 et 1778 au moins. 17
J. Philippi, Edits et Ordonnances du Roy concernans l’autorité et iurisdiction des cours des Aides de France
sous le nom de celle de Montpellier, Montpellier, sn, 1561, sp et du même : Arrestz de consequence de la Cour
des Aides de Montpellier, recueillis, assemblez et adnotez par M. Jean Philippi conseiller du roy & president en
ladite Cour, Montpellier, Jean Gilet, 1597, 98 p. ; A. d’Espeisses, Traicté des tailles et autres impositions
Traicté des tailles et autres impositions, où sont contenues les decisions des matières des tailles, aydes,
equivalent, decimes ou dons gratuits, gabelles, guet & garde, imposition foraine, haut passage, rève,
fortifications & réparations, levées de chevaux & charriots, solde de cinquante mil hommes; estapes, munitions
& logemens des gens de guerre, impositions pour l’industrie, cabaux, meubles lucratifs, deniers à interest, à
rente ou à pension & bestail gros & menu & de la capitation. Le tout confirmé par loix ou par canon ou par les
ordonnances de nos roys ou par les advis des docteurs ou par des raisonnemens puisez de la source du droit ou
par les arrests des cours souveraines de ce royaume & notamment de la Cour des comptes, aydes & finances de
Montpelier, Toulouse, A. Colomiez, 1643, 344 p., p. 200-229 notamment.
7
monumentale en sept volumes et plus de 5000 pages : le tome V donne en 1784 la liste des
principaux textes législatifs en matière de compoix18
.
La faction d’un nouveau compoix, solidement encadrée, suivait donc plusieurs étapes mais
trouvait son origine dans un constat souvent identique : la matrice en service était périmée.
Deux raisons étaient alors avancées par la communauté pour refaire un compoix : la matière
imposable avait changé, la vétusté du registre devenait préjudiciable au bon département
annuel de la taille. Ce fut en ces termes que le conseil général des habitants de Bizanet
(Biterrois) demanda en 1711 la refonte de son cadastre « a cause des changem[en]ts qui sont
arrivés dans lesd[its] lieux par raport a l’estat present des terres et des maisons, soit parce que
les vieux compoix sont tellement alteréz et ambarasséz que ceux qui sont commis a la faction
des rolles ont beaucoup de peine a demelér l’alivrement de chaque contribuable pour faire
l’imposition avec egalité »19
.
Au XVIIIe siècle, cette délibération initiale du conseil général des habitants lançait la
procédure administrative de réalisation du nouveau compoix, aux nombreuses et coûteuses
étapes. Les interlocuteurs de la communauté d’habitants s’étaient alors multipliés : Cour des
Aides de Montpellier bien sûr, mais aussi assiette diocésaine et même Intendant, puisque
celui-ci pouvait seul autoriser ou non le village à contracter un emprunt pour régler les
émoluments des agents cadastraux. Presque toujours, la Cour des Aides donnait un accord
formel à la réalisation d’un nouveau compoix mais la communauté devait franchir bien des
obstacles administratifs pour aboutir à la mise en service d’un nouveau cadastre20
. À Celles
(Lodévois), on lança ainsi la procédure de réfection du compoix en 1753 mais elle n’aboutit
jamais, pour des raisons inconnues et alors que l’arpenteur avait été désigné21
.
Cela dit, une fois réalisés, les compoix languedociens du Siècle des Lumières semblent
irréprochables. Les documents conservés sont de grand format, environ 30 40-45 cm,
parfois très épais, notamment en milieu urbain : à Agde (plaine littorale) en 1720, le compoix
du Bourg, de la Cité et du finage occupe plus de 1900 pages22
. Les marges sont généreuses et
des pages sont laissées blanches entre deux « tails », afin d’enregistrer, si nécessaire, les
mutations foncières en face des parcelles concernées23
. L’écriture, très posée et appliquée,
18
J. Albisson, Loix municipales et économiques du Languedoc, Montpellier, Rigaud & Pons, 1780-1787, 7 vol.,
5320 p ; sur les compoix : t. V, 1784, p. 807-913 notamment ; sur l’auteur : L.-G. Michaud, dir., Biographie
universelle et moderne ancienne et moderne, Paris, C. Desplaces, t. I, 1854, p. 317-318. 19
Arch. dép. Hérault, 1 B 10970, compoix de Bizanet, 1713, f° 3 v°-4 r°. 20
A. d’Espeisses, Traicté des tailles..., op. cit., p. 200-203. 21
Arch. dép. Hérault, 2 E 25/141, étude de maître Joseph Domergue, notaire royal de Clermont-l’Hérault, f° 470
r°-471 r° (information aimablement communiquée par S. Olivier). 22
Arch. mun. Agde, CC 29-34, compoix d’Agde, 1720, 6 vol. 952 f°. 23
Tail : ensemble des biens d’un propriétaire.
8
permet de décrire trois ou quatre parcelles par page24
. La description parcellaire s’avère très
fouillée et se présente comme infailliblement explicative du revenu cadastral qu’elle porte, le
fameux allivrement.
La localisation du bien est double : au moyen d’un toponyme mais aussi de confronts, qui
viennent pallier l’absence presque systématique de plans parcellaires associés à la matrice25
.
La largeur des chemins confrontants est parfois précisée, ainsi que leur nom quand ils en ont
un, comme cette parcelle jouxtant « du couchant le chemin des Charbonniers ayant vingt pans
de largeur », à Saint-Geniès-des-Mourgues (garrigues) en 178726
. La nature de la mise en
valeur du sol est très fine depuis le milieu du XVIIe siècle, comme ce « castanet, rouvière et
issartiel [...] outre la rancarède » (châtaigneraie, bois de chênes rouvres et essart, outre
l’étendue rocheuse), à Saint-Julien-d’Arpaon (Cévennes) en 172027
. Cela est très vrai aussi
pour de toutes petites parcelles, comme ce jardin des faubourgs de Lodève en 1751, « jardin
24
Contre une dizaine, par exemple, dans les compoix des XVe et XVI
e siècles.
25 Bien qu’insistamment demandés par la Cour des Aides de Montpellier, les plans parcellaires accompagnant les
matrices sont rares : on en connaît dans la plaine pour Mèze en 1768 (aujourd’hui perdus mais référencés dans le
corps du compoix) ou Tressan en 1770 (arch. mun. Tressan, CC 3) ; les plans-terriers sont plus fréquents à cette
époque dans le même espace (S. Olivier, « La seigneurie et l’agriculture en Lodévois d’après deux plans-terriers
du XVIIIe siècle », in G. Brunel, O. Guyotjeannin, J.-M. Moriceau, éd., Terriers et plans-terriers du XIII
e au
XVIIIe siècle, actes du colloque de Paris (23-25 septembre 1998), Paris-Rennes, Mémoires et Documents de
l’École des Chartes, n° 62, Bibliothèque d’Histoire Rurale, n° 5, 2002, p. 397-411.). 26
Arch. dép. Hérault, 166 EDT CC 2, compoix de Saint-Geniès-des-Mourgues, 1787, f° 50 r°. 27
Arch. dép. Lozère, EDT 162 CC 1, compoix de Saint-Julien-d’Arpaon, v. 1720, f° xx.
9
avec arbres fruitiers dans lequel il y a une maison servant de logement au jardinier, joignant
un grenier a foin, pred, ollivette et rivage le tout contigu »28
.
Les exemples étant déclinables à l’infini, on ne peut manquer de souligner la très grande
qualité formelle – parfois même esthétique – des compoix languedociens du XVIIIe siècle.
Celle-ci, ajoutée à la rareté des procès, prouve la qualité foncière de ces cadastres qui
s’inscrivent alors au terminus de cinq siècles d’histoire de la fiscalité royale et municipale. De
tels efforts descriptifs s’expliquent surtout par la nécessité d’élaborer rigoureusement le
revenu cadastral des contribuables.
Une nécessité : la « table d’allivrement »
On appelle table d’allivrement la grille de calcul du revenu imposable élaborée par le
conseil général des habitants de la communauté. Cette étape de la procédure administrative
constituait sans nul doute le premier moment fort, pour les propriétaires, de la rédaction du
nouveau compoix, moment qui précédait de peu l’arpentage et la levée topographique des
biens.
Une mise au point délicate et sensible
On peut analyser l’élaboration de la table d’allivrement par le conseil général des habitants,
en présence du syndic des propriétaires forains et du commissaire « au compoix », comme le
point de tension et d’équilibre des opérations cadastrales. En effet, bien que l’arpenteur, les
deux estimateurs et les indicateurs étaient déjà choisis, les habitants se réunissaient à l’appel
des autorités municipales afin de fixer pour chaque catégorie culturale et bâtie un revenu
imposable à l’hectare29
:
« En laquelle table est dit à quel pied sera cotisée la sesterée de terre, soit labourable, pré, ou vigne,
& à quel pied celle qui est au premier, second, ou troisième degré ; comme aussi à quel pied seront
cotisées les maisons suivant leur assiette & contenance. Puis que cela touche les habitans du lieu en
seul, il est juste de prendre leur avis sur cela »30
.
On imagine volontiers que dans tel village de la plaine, en plein essor viticole, les
vignerons œuvraient à obtenir pour leurs vignes des revenus imposables moindres que ceux
28
Arch. dép. Hérault, 142 EDT 81, compoix de Lodève, 1751, f° 1 r°. 29
On emploie ici le mot hectare par souci de clarté mais les revenus imposable étaient fixés en livres, sous ou
derniers par mesure locale, ici la dextre, là la sétérée, de valeur métrique variable d’un lieu à l’autre (cf note n°
43). 30
A. d’Espeisses, Traicté des tailles..., op. cit., p. 206.
10
des propriétaires d’olivettes. À l’intérieur de chaque catégorie culturale – champs céréaliers,
vignes, olivettes, prés... –, le revenu imposable décroissait en fonction de la qualité présumée
du sol selon des « degrés », du premier au énième.
Il est impossible de savoir aujourd’hui, à travers les procès-verbaux de ces séances, si elles
étaient houleuses, bien réglées, longues, courtes, animées, si des personnages arrivaient à
influencer l’assemblée en leur faveur31
... Mais cette table finissait par être mise au point et
remise, en guise de cahier des charges, à l’équipe cadastrale qui, dès lors, travaillait plusieurs
semaines sinon plusieurs mois à encadastrer le finage, biens nobles compris, pour enregistrer
ceux-ci à part dans un Cahier des biens prétendus ou réputés nobles. Sur le terrain, l’arpenteur
mesurait les parcelles, les deux estimateurs jaugeaient la qualité des terres et notaient les
informations relatives à chaque parcelle, les indicateurs, en nombre variable, localisaient cette
dernière et en nommaient le propriétaire. L’opération étant publique, ces propriétaires
suivaient les agents cadastraux et parfois même, devaient confirmer les propos des
indicateurs, comme à Bessan (plaine littorale) en 1699, entre voisins, « l’un sur l’autre »32
.
Cela dit, le calcul de l’allivrement se faisait en cabinet, une fois la levée topographique
achevée : il s’agissait de multiplier la superficie par son revenu cadastral à l’hectare, tel
qu’indiqué dans la table d’allivrement. Pour le petit village de La Cadière (Cévennes), le
compoix de 1693, bien que très modeste (56 folios en tout) a nécessité dix jours de travail en
cabinet (cinq à six folios achevés par jour) pour faire des notes de terrain un registre foncier
mis au net, « exibé et montré ausd[its] habittans qui lont parcoureu exattement »33
.
Cela dit, la mise au point de la table d’allivrement pouvait provoquer certaines dissensions
dans les campagnes, pour des raisons variées. On peut néanmoins les regrouper autour de
l’idée que les transferts de charges fiscales entraînés par la refonte de la matrice cadastrale
allaient à l’encontre des intérêts particuliers et suscitaient des tensions. Le cas est d’une
grande clarté à Serverette (Margeride) où, dès 1781, la réalisation d’un nouveau compoix fut
retardée par une frange de propriétaires mécontents de voir la mémoire de l’état civil du sol
retrouvée et les terres fiscalisées autrement. Il faut dire qu’ici la matière imposable, sclérosée
et fragmentaire, n’avait plus été encadastrée depuis 1549 : la mise en service du nouveau
compoix attendit donc 178834
...
31
A. Follain, Le village..., op. cit., p. 258-264. 32
Arch. dép. Hérault, 31 EDT CC 5, compoix de Bessan, 1699, introduction, nf. 33
Arch. dép. Gard, E dépôt 148/5, compoix de La Cadière, 1693, 58 f°. 34
Arch. dép. Lozère, EDT 188 CC 1 et G 586, compoix double de Serverette, 1549, 85 et 87 f° ; arch. dép.
Lozère, EDT 188 BB 2, délibérations consulaires de Serverette, 1781-1788, f° 59 v°-145 r°, passim ; arch. dép.
Lozère, E 964, compoix de Serverette, 1788, 88 f°.
11
C’est en ville malgré tout que se rencontrent les plus gros problèmes. Bien qu’il reste
nécessaire d’étudier ce phénomène de manière approfondie, il semble bien que, toute
précaution gardée, au-delà d’un certain seuil de population, les enjeux économiques et
politiques bloquent l’encadastrement des bâtiments et des terres. Montpellier, capitale
provinciale, siège de la Cour des Comptes, Aides et Finances, bien qu’elle essayât, ne parvint
jamais à faire refaire son compoix au XVIIIe siècle, le dernier réalisé datant tout de même de
159135
. Les petites villes sont elles aussi touchées : à Montagnac (plaine littorale), on obtient
de faire refaire le cadastre en 1739 : celui-ci est mis en service en 178736
. À Mèze, la situation
s’avère plus complexe encore : le nouveau compoix est homologué en 1768 par la Cour des
Aides, qui avait autorisé sa rédaction en 1719, près de cinquante ans plus tôt37
. Et les contre-
exemples sont rares : Agde (plaine littorale) dispose sans heurts d’une nouvelle matrice en
1720, Lodève en 175138
... La résidence épiscopale d’une personnalité affirmée et par ailleurs
soucieuse du bien public comme monseigneur Jean-Georges de Souillac, évêque de Lodève
de 1732 à 1750 et par ailleurs président de l’assiette diocésaine de ce diocèse civil, entre-t-elle
en compte pour expliquer cela39
? Il est bien malaisé de se faire une idée.
Quelque difficile peut être sa mise au point, la table d’allivrement constitue cependant un
document public employé par des agents cadastraux dans le cadre d’une enquête publique.
Une grille « publique » de calcul du revenu cadastral
Elle est donc à ce titre placée au début du compoix, dans une longue introduction, parmi
les procès-verbaux relatant la plupart des étapes administratives de la réalisation de la matrice.
Mise au point, on l’a vu, au cours d’une délibération du conseil général des habitants de la
communauté, sa transcription est incluse dans le procès-verbal de cette délibération. C’est,
avec la levée topographique des biens, un des deux piliers des opérations cadastrales :
utilisées, dans les campagnes languedociennes depuis la seconde moitié du XVe siècle et dans
les villes depuis le premier tiers du XVIe siècle, les tables d’allivrement on formellement peu
35
Arch. mun. Montpellier, Joffre 299, 302, 305, 308, 311 et 314, compoix de Montpellier, 6 vol., 2136 f°. 36
Arch. dép. Hérault, 1 B 11028, compoix de Montagnac, 640 f° : introduction, nf. 37
Arch. dép. Hérault, EDT Mèze CC 3-5, compoix de Mèze, 1768, 3 vol., 679 f° : t. I, introduction, nf. 38
Arch. mun Agde, CC 29-34, compoix d’Agde, doc. cit. ; arch. dép. Hérault, 142 EDT 81, compoix de Lodève,
1751, 284 f°. 39
É. Apollis, Un pays languedocien au milieu du XVIIIe siècle : le diocèse civil de Lodève. Étude administrative
et économique, Albi, Impr. coopérative du Sud-Ouest, 1951, 675 p.
12
changé entre le début et la fin du XVIIIe siècle
40. En effet, lorsque la Cour des Comptes,
Aides et Finances de Montpellier autorisait la communauté à refaire son compoix, la lettre
d’autorisation reçue par la municipalité stipulait la nécessité de réaliser une table « par
degrés », pour le non-bâti comme pour le bâti.
Certaines tables d’allivrement, puisqu’elles étaient élaborées au cours d’une séance
publique du conseil général des habitants, posent de réels problèmes aux chercheurs. Dans le
cas du cadastre de Lodève de 1696, l’encadastrement des terres cultes et incultes suivait une
grille unique de calcul du revenu cadastral, décomposée en dix-sept degrés41
. « Des champs,
ollivettes, vignes, hieres, rebairals, chastanettes, hermes, bois de chaines, bouissières et autres
terres vagues et incultes a esté arresté quelles seront compéziées sur dix sept degreds » :
champs, olivettes, vignes, aires à dépiquer les céréales, rivages, châtaigneraie, hermes,
chênaies, espaces couverts de buis, l’inculte en général, toutes les occupations du sol sont
donc théoriquement soumises à 17 tarifs cadastraux par hectare42
. Dans les faits, il est
probable que certaines cultures étaient contenues dans des fourchettes de degrés, tout comme
l’inculte est vraisemblablement fiscalisé par les derniers degrés de la table. Cela demanderait
néanmoins de dépouiller intégralement ce compoix de Lodève et d’analyser attentivement la
classe cadastrale moyenne de chaque catégorie culturale ou inculte.
Toutefois, la seconde moitié du siècle passée, les tables d’allivrement telles que demandées
par la Cour des Aides auraient dû, pour chaque occupation du sol, décliner le tarif cadastral à
l’hectare en neuf degrés maximum : trois classes pour les bonnes terres, trois pour les
moyennes et trois pour les mauvaises. À Saint-Geniès-des-Mourgues, la table du compoix de
1787 prévoit ainsi trois tarifs pour les prés, irrigués ou non, de cinq sous deux deniers à trois
sous un denier par sétérée carrée43
. Champs céréaliers, vignes et olivettes sont divisées en
cinq classes : bon, moyen, faible, second degré du faible et troisième degré du faible, entre
deux sous sept deniers et six deniers la sétérée, selon une gradation fiscale variant du simple
au quintuple44
.
40
B. Jaudon, « Des recherches diocésaines aux compoix des communautés : un impact fort (vers 1430-1560) »,
court article mis en ligne sur le site « Terrae » de l’université de Toulouse II-Le Mirail : http://w3.terrae.univ-
tlse2.fr/spip/IMG/pdf/CR_reunion_compoix_Perpignan_03.06.pdf 41
Les degrés d’estimation du compoix correspondent à part entière aux « classes » des cadastres dits
napoléoniens. 42
Arch. dép. Hérault, 142 EDT 78, compoix de Lodève, 1696, 244 f° : introduction, nf. 43
La sétérée, unité de mesure des superficies, variait beaucoup d’un lieu à l’autre, en général entre un cinquième
et un quart d’hectare (P. Charbonnier, dir., Les anciennes mesures locales du Midi méditerranéen d’après les
tables de conversion, Clermont-Ferrand, Institut d’études du Massif Central, 1994, 281 p.). 44
Arch. dép. Hérault, 166 EDT CC 2, doc. cit. : introduction, nf.
13
Les compoix languedociens du XVIIIe siècle révèlent donc une élaboration très fine du
revenu cadastral, qui témoigne aussi d’une représentation collective fouillée des territoires
agraires et de leur productivité présumée. Ces savantes tables d’allivrement mises au point, les
terres encadastrées, il restait, comme on l’a dit, à multiplier les superficies des parcelles par le
degré d’imposition correspondant.L’estimation de la valeur fiscale du fond s’avère d’autant
plus rigoureuse que très fréquemment, une parcelle portant la même culture est déclinée en
plusieurs classes cadastrales, comme cette vigne à Boujan-sur-Libron (Biterrois) en 1725 :
« un vigne, muscat et maliol en broque [plantier de l’année] [...] contient la vigne trois cesterées
trois quartons deux dextres, le muscat une cesterée trois quartons neuf dextres, le maliol deux
quartons estimé [pour les] deux tiers [de la superficie] bon du faible [et] un tiers moyen du faible. Le
muscat moitié moyen de moyen, moitié faible de moyen. La vigne moitié moyen de moyen, moitié
faible de moyen. Fait tout de compoix [un revenu cadastral de] treize sols deux deniers »45
.
Cet exemple, parmi des dizaines de milliers, montre bien qu’en fait de parcelle, un
« article » ou « item » de compoix pouvait en réalité être composé de plusieurs parcelles
contigues, regroupées ainsi par les agents cadastraux. La précision descriptive de la nature du
bien est particulièrement approfondie, puisqu’une simple vigne est fiscalement distinguée
d’une autre plantée de muscat, considéré comme plus noble et partant, plus imposé à
l’hectare. Quant au plantier, encore improductif, son allivrement est évidemment plus faible.
Plus précise encore est l’estimation des classes cadastrales de chacune des trois vignes de cet
article. Le revenu imposable de ce dernier apparaît bien tel qu’en lui-même : un calcul public
et pour ainsi dire scientifique de la valeur d’un bien, hors de la pratique de tout arbitraire.Cela
dit, sur le terrain, plan parcellaire et compoix en main, sûr de l’identification d’une parcelle
actuelle à un article de compoix, les raisons de la ventilation d’un bien de petite superficie en
deux ou trois classes cadastrales restent incompréhensibles. En Provence, François-Xavier
Emmanuelli se heurte au même problème de l’impossibilité de pénétrer la logique
d’estimation de la qualité d’un fond par les agents cadastraux du XVIIIe siècle
46.
Les raisons invoquées dans les rapports d’arpentage placés eux aussi en tête des compoix
ne sont d’aucun secours, puisque, d’un bout à l’autre du Languedoc, les experts répètent
inlassablement la même formule, comme dans l’introduction du compoix de Généragues
(Cévennes) :
« Tant que nous a este possible avons tenu et observe les degres et cordes mantionnes en lad[ite]
table [d’allivrement] ayant heu et prins esgard a la scitua[ti]on aizance bontes comodittes &
incomodittes fertillictes et infertillictes et aux degres de bon moien & foible et rante annuelle que de
45
Arch. dép. Hérault, 1 B 10971, doc. cit., f° 9 r°. 46
Très belle étude de cas de M.-F.-X. Emmanuelli, « Cadastres en Provence : le cas de Bouc-Albertas (1627-
1834) », Provence Historique, fasc. 233, t. LVIII, juillet-sept. 2008, p. 273-318.
14
ch[acu]ne qualitte de terre peult porter et produire suivant la juste valeur dicelles et a toutes aultres
considera[ti]ons que avons juge estre juste et raizonnable de droict observer et tenir pour daultant mieux
treuver l’esgualitté et ayant exactement calcullé le presaige et allivrem[en]t »47
.
Cette concaténation rhétorique, reprise au mot près de la jurisprudence de la Cour des
Aides de Montpellier, a au moins le mérite de nous éclairer sur la philosophie de l’élaboration
du revenu cadastral. Si œuvrer à produire une table d’allivrement consensuelle est nécessaire
à la bonne rédaction du compoix, il existe un véritable devoir, face aux contribuables, de
calculer en outre de justes revenus cadastraux.
Un devoir calculer de « justes » revenus cadastraux
En fait de justice fiscale – cette chimère intemporelle –, la taille languedocienne se
caractérisait, au XVIIIe siècle, par le souci d’une recherche d’équité plus grande que dans
d’autres régions, encore que ce point devrait être nuancé par bien des contre-exemples48
. Le
conseil général des habitants de chaque communauté faisant refaire son compoix visait à une
péréquation interne à la communauté d’habitants. La solidarité face à l’impôt en pays de taille
réelle constituait en effet un élément fort de la concorde et de la cohésion politiques et
sociales microlocales.
Le maquis des tables d’allivrement : des pratiques empiriques !
Afin de pénétrer les logiques d’élaboration du revenu cadastral, il a été décidé d’adopter
deux pis-aller statistiques. Le premier concerne l’échantillonnage, composé des seize compoix
ruraux déjà dépouillés dans notre zone d’étude et pour lesquels la table d’allivrement était
conservée : il s’agit d’une limite « par la force des choses ». Le second, particulièrement
discutable, met en exergue le problème de la comparaison par l’utilisation d’indices. L’indice
100 de la valeur cadastrale des terres a été attribué à la seule culture qu’on rencontre des rives
de la mer Méditerranée aux terres d’altitude du Gévaudan : les champs céréaliers. Parmi ceux-
47
Exemple antérieur au XVIIIe siècle mais tout à fait significatif et qu’on peut retrouver mot à mot à la veille de
la Révolution, tiré des arch. dép. Gard, E dépôt Généragues CC 3, compoix de Générargues, 1635, 564 f° :
introduction, nf. 48
Nombreuses et éclairantes études de cas in A. Follain et G. Larguier, dir., L’impôt des campagnes. Fragile
fondement de l’État dit moderne (XVe-XVIII
e siècle), op. cit., 660 p., dont P. Charbonnier, « La taille vue des
collectes auvergnates : injuste ? oppressive ? », p. 335-378, sans oublier, dans une abondante bibliographie, E.
Esmonin, La taille en Normandie au temps de Colbert, 1661-1683, Paris, Hachette, 1913, XXX-552 p. et M.
Touzery, L’invention de l’impôt sur le revenu. La taille tarifée (1715-1789), Paris, Comité pour l’histoire
économique et financière de la France, 1994, XVII-618 p. Sur la prétendue justice de la taille réelle en
Languedoc : B. Jaudon, « Les contradictions fiscales du Gévaudan... », art. cit.
15
ci, l’indice 100 a été donné aux champs les plus fortement évalués par les agents cadastraux,
ceux appelés « premier degré du bon » ou « bon du bon » dans les tables d’allivrement. La
limite majeure de cette méthode à but comparatiste reste consubstantiellement liée à la variété
des céréales entretenues selon les finages, la nature des sols et l’altitude, mais aussi à la
grande variabilité des rendements céréaliers d’un point à l’autre de la zone d’étude. Il faut
donc se contenter de ces ordres de grandeurs les plus acceptables possibles et garder
constamment à l’esprit la défaillance statistique initiale de l’appareillage méthodologique.
La présentation rapide de deux cas permet de se demander plus encore quelles logiques
pouvaient bien prévaloir à l’élaboration du revenu cadastral. À Bessan en 1699, dont on a déjà
parlé, l’inculte est allivré entre les indices 5 et 10, les jardins potagers entre 100 et 200 et le
reste des terres cultivées entre 12,5 et 10049
. La même simplicité apparente se retrouve dans
les revenus cadastraux fixés pour Saint-Pierre-le-Vieux (Margeride) en 1714 : les champs,
pâtutages et bois plutôt bons sont fiscalisés dans une fourchette indicielle de 50 à 100, les
autres terres plutôt médiocres entre 20 et 4050
.
Mais plus les comparaisons sont nombreuses, plus la complexité augmente.
49
Arch. dép. Hérault, 31 EDT CC 5, doc. cit. 50
Arch. dép. Lozère, E 955, compoix de Saint-Pierre-le-Vieux, 1714, 146 f°.
16
Soit deux communautés localisées dans des finages étendus sur les garrigues et disposant
de compoix chronologiquement assez proches : Candillargues (1756) et Brouzet-lès-Quissac
(1773). À Candillargues, trois groupes fonciers ont été créés : les champs, vignes et olivettes
(indices 75 à 100), les vignes plantées de muscat (indices 100 à 125), les prés et les jardins
(indices 112 à 125). Ici, les revenus cadastraux restent assez homogènes mais l’inculte semble
avoir été oublié alors qu’il occupe de vastes pans du paysage51
. À Brouzet, l’espace fiscal est
divisé en cinq groupes fonciers : l’inculte (indices 3 à 25), les bois (indices 6 à 50), les
champs, vignes et olivettes (indices 11 à 100), les prés irrigués ou secs (indices 22 à 111), les
jardins potagers enfin (indices 89 à 133)52
. Deux villages, deux manières d’appréhender
l’espace fiscal et deux échelles d’imposition foncière très différentes l’une de l’autre : neuf
classes cadastrales et un rapport de 1 à 1,7 entre les deux classes extrêmes à Candillargues, 39
classes et un rapport de 1 à 48 à Brouzet...
De tels chiffres, si éloignés les uns des autres, pour des pratiques cadastrales semblant a
priori uniformisées, mettent à mal la notion même de logique. Ils soulignent toutefois que
chaque communauté élaborait son revenu cadastral à sa manière, c’est-à-dire appliquait à sa
représentation collective et consensuelle du territoire sa propre grille de fiscalisation de la
terre. On pourrait en rester là et regretter de ne pas étudier cette question pour la Provence, où
s’appliquait le règelement de 1724. Les Procureurs du Pays demandèrent aux Provençaux de
réaliser désormais des cadastres employant partout dans la province les mêmes unités de
mesure et les mêmes règles d’appréciation des revenus fonciers. Mais François-Xavier
Emmanuelli remarque que malgré la Loi, le maquis des pratiques cadastrales locales persiste
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle
53.
Après tout, chaque cadastre ne servait pour répartir la taille qu’à l’échelle de la commuauté
d’habitants et constituait un outil fiscal interne et utile à celle-ci seulement, exception faite des
propriétaires résidant à l’extérieur, les forains. Une analyse plus poussée des tables
d’allivrement offre néanmoins des éléments de compréhension des mécanismes d’élaboration
des revenus cadastraux languedociens.
Le rapport au conjoncturel : des pratiques logiques !
51
Arch. dép. Hérault, 50 EDT 10, compoix de Candillargues, 1756, 188 f°. 52
Arch. dép. Gard, C 1032, compoix de Brouzet-lès-Quissac, 1773, 36 f°. 53
M.-F.-X. Emmanuelli, « Cadastres en Provence... », art. cit.
17
L’univers du revenu cadastral non bâti est traversé par des invariants dans l’estimation des
mises en valeur du sol. Les seize tables d’allivrement employées ici font saillir une
hiérarchisation globale mais très nette des valeurs foncières :
le saltus obtient un indice moyen de 13 (1,7 à 40) et demeure fiscalisé, bien que peu
apprécié ;
la silva, précieuse aux ruraux, atteint un indice moyen de 41 (0,01 à 150) et talonne de
peu l’ensemble des terres cultivées ;
les cultures sèches montent à un indice moyen de 53 (1,3 à 125) ;
les cultures arrosées, fortement productives et rentables, qui plus est sous un climat
méditerranéen (même altéré), grimpent à un indice moyen de 123 (17 à 300).
En dehors de ces constantes, connues mais jamais mesurées, deux logiques coexistent. La
première est d’ordre économique et fait varier de manière subtile les revenus cadastraux à
l’hectare. Dans la plaine par exemple, tout entière en train de se tourner vers la viticulture
dans la seconde moitié du siècle, les vignes ne sont pas surfiscalisées à l’hectare. Cela autorise
vraisemblablement d’en mener la culture sans pour autant en voir les revenus rognés par le
prélèvement de la taille. Cela dit, des compoix du Biterrois, comme ceux de Thézan (1713),
Boujan-sur-Libron (1725) ou Abeillan (1768), fiscalisent plus fortement les bâtiments
vitivinicoles et les plantiers54
. La culture des oliviers plonge alors en plein marasme car, après
le Grand Hiver, les olivettes, même ruinées, restent soumises à la taille et encadastrées en tant
que telles :
« les champs, terres labourables meme celles qui sont complantées en oliviers auxquels on n’aura
aucun egard a cause de la perte d’iceux, en sera fait quatre degrés »55
.
En l’espèce, les propriétaires d’oliviers n’obtinrent de l’État aucun dédommagement pour
cas fortuit, même sous la forme de moins-imposé56
. Certaines cultures enfin, en raison sans
doute de leur excellente réputation et des bons revenus qu’elles apportent, sont nettement
surfiscalisées. À Tressan (Biterrois) en 1770, les nombreuses luzernes d’un terroir humide,
fauchées plusieurs fois par an dans une région manquant de fourrages, sont plus imposées que
les autres cultures, que le vignoble par exemple, pourtant en pleine extension57
. Dans le
54
Arch. dép. Hérault, 1 B 10970, compoix de Thézan-lès-Béziers, 1713, 111 f° ; arch. dép. Hérault, 1 B 10971,
compoix de Boujan, doc. cit. ; arch. dép. Hérault, 1 B 10966, compoix d’Abeilhan, 1768, 314 f°. 55
Arch. dép. Hérault, 1 B 10970, doc. cit., f° 4 v°. 56
S. Durand, « L’indemnisation des dommages aux oliviers en Languedoc de la fin du XVIIe siècle au début du
XIXe siècle », actes du colloque international de Montpellier : «L’olivier et l’identité des pays de l’Europe
méditerranéenne » (17-18 mars 2006), Liame, à paraitre. 57
Arch. mun. Tressan, CC 1, compoix de Tressan, 1770, 228 f° ; B. Jaudon et J.-L. Abbé, « Enjeux et gestion
des milieux humides. Les étangs asséchés de la vallée de l’Hérault au cours du dernier millénaire », Annales du
Midi, t. 119, n° 257, p. 27-40.
18
Lunellois après 1750, les vignes plantées en muscat ont un revenu cadastral à l’hectare plus
élevé que celui des simples vignes58
.
À cette logique économique s’ajoute une logique qu’on pourrait qualifier de
« physiocratique » : le choix des revenus cadastraux peut servir à cultiver plus de terres. Les
cadastres n’ont pas attendu – et loin s’en faut – la Déclaration sur les défrichements de 176659
.
On fiscalise l’inculte pour encourager la mise en valeur des réserves de productivité, comme
le dit le compoix de Mèze (plaine littorale) de 1768 : « les jonquasses, paturages et terres
incultes dont les fonds seroient bons a mettre en culture seront estimés sur 3 degrés »60
. Le
Traicté des tailles d’Antoine d’Espeisses le précisait dès 1643 en prenant l’exemple de la
maison ruinée, appelée « cazal », imposée car pour son propriétaire, du point de vue du fisc, il
« ne tenoit qu’à luy, qu’il ne la fit rebastir »61
.
Bien que les historiens languedociens demeurent prompts à se servir des compoix pour
écrire l’histoire économique et sociale de la province, mais aussi celle des paysages passés et
des rapports des sociétés anciennes à l’environnement, aucun n’a cherché à démêler l’échevau
des logiques d’élaboration du revenu cadastral62
. Si la question est en effet d’une rare
complexité, on voit bien à l’œuvre une juxtaposition de volontés locales qui font de chaque
table d’allivrement un véritable outil de politique fiscale adoptée en un temps donné de
l’histoire de la communauté d’habitants. Le seul vrai problème, le plus important pour être
honnête, reste la question du rapport entre les revenus cadastraux et la réalité du marché
foncier : en existe-t-il seulement un, si oui est-il quantifiable, peut-on même le mettre en
équation63
?
On ne manquera pas de livrer, à ce point de l’exposé et en guise de logogriphe, un résumé
des seize tables d’allivrement employées ici pour élaborer le revenu cadastral de quatre petites
villes (Agde, Lodève, Mèze et Montagnac) et douze villages (figure n° 5).
lieu date rapport entre Références
58
Comme à Candillargues : arch. dép. Hérault, 50 EDT 10, doc. cit. 59
L. Dutil, L’état économique du Languedoc à la fin de l’Ancien Régime (1750-1789), Paris, Hachette, 1911,
962 p. 60
Arch. dép. Hérault, EDT CC 3-5, doc. cit. : introduction, nf. 61
A. Despeisses, Traicté des tailles..., op. cit., p. 129. 62
S. Olivier, « L’environnement languedocien avant l’âge industriel. Vers une modélisation des paysages ruraux
anciens », in F. Neveu, coord., Jeunes chercheurs en Sciences humaines et sociales. 10 ans de recherche à la
MRSH de Caen, Caen, Cahiers de la MRSH, n° spécial, 2005, p. 123-135 et « Compoix, terriers et cadastres. Des
données quantitatives et spatiales sur l’environnement rural languedocien (XVIIe-XIX
e siècle) », actes de la table
ronde de l’université Paul Valéry-Montpellier III (octobre 2005), Liame, n° 14 : « Cadastres et paysage », 2007,
p. 63-82. 63
J. Heffer, « Les déterminants du prix de la terre. La prédominance du marché dans un comté du Missouri
(1860-1870) », Histoire & Sociétés rurales, n° 32, p. 81-108.
19
les évaluations
cadastrales extrêmes
à l’hectare :
de 1 à...
A.D. : archives départementales
A.M. : archives municipales
Agde 1691 16 A.M. Agde, CC 24-26, 3 vol., 1191 f°
Montaud 1692 500 A.D. Hérault, EDT Montaud CC 2, 174 f°
Saint-Bauzille-de-Montmel 1695 10000 A.D. Hérault, EDT Saint-Bauzille-de-Montmel CC 1, 221 f°
Lodève 1696 300 A.D. Hérault, 142 EDT 78, 244 f°
Bessan 1699 40 A.D Hérault, 31 EDT CC 3, 178 f°
Lédenon 1712 60 A.D. Gard, C 1051, 512 f°
Saint-Pierre-le-Vieux 1714 5 A.D. Lozère, E 955, 146 f°
Cournonsec 1747 40 A.D. Hérault, 87 EDT 4, 3 vol., 367 f°
Candillargues 1756 1,7 A.D. Hérault, 50 EDT 10, 188 f°
Lavérune 1758 18 A.D. Hérault, 134 EDT 7, 345 f°
Fourques 1768 2,5 A.D. Gard, C 1044, 314 f°
Mèze 1768 157,5 A.D. Hérault, EDT Mèze CC 3-5,
3 vol., 679 f°
Tressan 1770 120 A.M. Tressan, CC 1, 228 f°
Brouzet 1773 48 A.D. Gard, C 1038, 36 f°
Montagnac 1787 64 A.D. Hérault, 1 B 11028, 640 f°
Saint-Geniès-des-Mourgues 1787 10 A.D. Hérault, 166 EDT CC 2, 102 f°
Figure n° 5 : la variété des évalutions cadastrales
à travers quelques compoix du Languedoc du XVIIIe siècle
Le concept de politique fiscale, pour autant qu’il fut opératoire au XVIIIe siècle, a au
moins le mérite de souligner tout le raffinement des tables d’allivrement, subtiles non
seulement dans le nombre de classes cadastrales adoptées dans chaque cas, mais aussi dans
l’amplitude de la fourchette des tarifs employés pour imposer la terre.
Se demander comment on procédait à l’échelle locale pour élaborer les revenus cadastraux
dans le Languedoc du XVIIIe siècle relève donc, en grande partie, d’un défi intellectuel pour
l’heure isolé dans le champ historiographique de l’ancienne province.
On voit bien les autorités municipales, ainsi que les propriétaires résidents et forains,
« s’accorder » – pour reprendre les termes d’époque – afin de créer une table d’allivrement
nécessaire à fiscaliser l’espace. Mais rien ne filtre des procès-verbaux de ces assemblées des
très vraisemblables tensions qui les caractérisèrent, car l’objet des discussions cristallisait un
enjeu économique et social capital : une nouvelle donne de l’impôt.
Dans les villes en tout cas, mais les études comparatives font cruellement défaut à cette
époque pour les pays de taille réelle du royaume de France, élaborer le revenu cadastral
semble devenu une affaire d’une immense difficulté à résoudre. La question des transferts
induits de charges fiscales heurtait frontalement le fragile équilibre de la mosaïque
20
socioprofessionnelle et économique de l’espace urbain. Le problème de la réalisation d’un
nouveau cadastre y était-il devenu, selon les cités, parfaitement insoluble ? Oui, sans doute, ne
doit-on pas hésiter à répondre.
Songeons par exemple que le 26 février 2006, René André, député de la Manche, lors
d’une séance de l’Assemblée Nationale, interpella le gouvernement de Dominique de Villepin
sur la question de l’évaluation cadastrale des propriétés bâties. Jamais elles n’avaient été
modifiées et ne l’ont toujours pas été depuis 1970, malgré la promulgation d’une loi de
révision en 1991. Christine Lagarde, alors ministre déléguée au commerce extérieur, répondit
que les simulations réalisées à partir de 1991 avaient soulevé des problèmes trop « sensibles »
de transferts des charges fiscales, notamment en milieu urbain. Mais elle proposa une solution
miraculeuse dont l’État garde le secret séculaire : réaliser de nouvelles simulations64
...
64
Sur le site internet du Sénat, Carrefour Local : http://carrefourlocal.senat.fr/breves/breve967.html