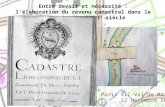Cycle Préparatoire Médecin-Ingénieur 2011-2012 Cours de résistance des matériaux
P-058: Ipeelee et le devoir de résistance
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of P-058: Ipeelee et le devoir de résistance
Ipeelee et le devoir de resistance1
Marie-Andree Denis-Boileau,* et Marie-Eve Sylvestre**
Cet article pose un regard critique sur l’art 718.2e) du Code criminel et surl’interpretation qu’il a recue de la part des tribunaux apres l’arret Ipeelee, sousl’angle du pluralisme juridique. Nous suggerons que l’interpretation proposee par laCour ouvre la porte a une forme de resistance du pouvoir judiciaire a l’egard de lasurrepresentation des personnes autochtones dans le systeme de justice criminelle etde la posture hegemonique de l’Etat canadien a l’egard des ordres juridiquesautochtones. En nous fondant sur une analyse exhaustive de 635 decisions depremiere instance et d’appel rendues apres l’arret Ipeelee entre 2012 et 2015, nousconcluons toutefois que cette approche innovatrice fait a son tour l’objet d’unegrande resistance de la part des juges. Nous discutons ensuite des principauxobstacles d’ordre pratique et epistemologique qui peuvent expliquer l’impact limitede cette approche en matiere de determination de la peine et suggerons que cetteresistance pourrait etre surmontee en soutenant a la fois l’innovation judiciaire et larevitalisation des systemes de droit autochtone.
——————————
In this article, the authors take a critical look at s. 718.2(e) of the CriminalCode and how courts have interpreted it after Ipeelee from a legal pluralismstandpoint. They suggest that the interpretation given by the Court opens the way toa form of resistance from the judiciary against the problem of Aboriginal over-representation in the criminal justice system and the hegemonic approach of theCanadian state with respect to Aboriginal legal orders. However, based on athorough analysis of 635 decisions rendered after Ipeelee by trial and appellatecourts between 2012 and 2015, the authors conclude that this innovative approachwas, in turn, met with significant resistance by judges. The authors finally addressthe main practical and epistemological hurdles that can explain the limited impactof that approach in sentencing and suggest that this resistance could be overcome by
1 Cet article a ete redige dans le cadre d’un projet de recherche sur la gouvernanceatikamekw enmatiere de violence conjugale et familiale en partenariat avec le Conseil dela nation atikamekw, dans le contexte duGrand partenariat « Etat et cultures juridiquesautochtones : un droit en quete de legitimite » (2013-2018) dirige par Ghislain Otis,titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la diversite juridique et les peuplesautochtones a la Section de droit civil de l’Universite d’Ottawa et finance par le Conseilde recherche en sciences humaines du Canada. Voir : <www.legitimus.ca>. Lesauteures tiennent a remercier Genevieve Beausoleil-Allard pour son precieux travail derecherche.
* LL.M., avocate et professeure a temps partiel, Section de droit civil, Universited’Ottawa.
* S.J.D., professeure titulaire et vice-doyenne a la recherche et aux communicationsSection de droit civil, Universite d’Ottawa.
P-058
promoting judicial innovation as well as the revitalization of the Aboriginal legalsystem.
* * *
Le 7 avril 2015, presque trois ans jour pour jour apres l’arret de la Coursupreme du Canada dans R. c. Ipeelee2, la Cour d’appel du Manitoba confirme lasentence de sept ans d’emprisonnement de John Charlette3.
John Charlette est un homme de 30 ans d’origine crie. Ne a Flin Flon auManitoba, il s’enfuit a l’age de six ans pour aller a Winnipeg ou il est recupere etpris en charge par la protection de la jeunesse qui le place dans plusieurs famillesd’accueil. Il n’a pas de contact avec sa culture autochtone en grandissant. Ilmontre des tendances suicidaires a plusieurs moments de sa vie4.
Le soir du drame, l’accuse arme d’un couteau prend un taxi et se promenependant plusieurs kilometres en faisant deux arrets dans des guichetsautomatiques pour retirer de l’argent, sans y parvenir. Au deuxieme arret, lechauffeur appelle les policiers et demande a Charlette de payer la course.L’accuse refuse et exige que le chauffeur lui donne son argent en le menacant aucouteau. Le chauffeur reussit a se sauver et Charlette se refugie dans la ruelle ouil est pourchasse par deux policiers arrives sur les lieux. Il les menace au couteaua plusieurs reprises en s’avancant vers eux. Il leur dit qu’il ne se rendra pas etqu’ils seront obliges de le tuer. Un des policiers tire deux fois sur l’accuse, quisurvit a l’attaque.
Apres un proces dans le cadre duquel il declare avoir eu l’intention decommettre un suicide en se jetant sur les policiers ce soir-la (« a suicide bycop »5), M. Charlette est finalement trouve coupable de vol qualifie, de deuxchefs d’agression armee contre un agent de la paix et de port d’arme dansun dessein dangereux. Le juge lui aurait impose une peine totale de huit ansd’emprisonnement, mais en raison du principe de totalite et des facteursGladue, il reduit la peine a sept ans. Bien que M. Charlette ait deja etecondamne par une cour de justice criminelle quarante-et-une fois, il s’agit desa premiere peine de penitencier.
* * *
La colonisation canadienne et la mise en œuvre de differentes politiquesgouvernementales prevoyant l’expulsion du territoire, la mise en reserve ainsi quel’assimilation des nations qui l’habitaient, ont eu des consequences devastatricessur les peuples autochtones. La politique des pensionnats canadiens instauree desle 19e siecle jusqu’au milieu des annees 1980 selon laquelle les enfantsautochtones etaient separes de leurs familles afin d’etre envoyes dans des
2 R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, 2012 CarswellOnt 4376, [2012] 1 R.C.S. 433, 280 C.C.C. (3d)265, 91 R.R. (6th) 1.
3 R. c. Charlette, 2015 MBCA 32, 2015 CarswellMan 163.4 Ibid au para 13.5 Ibid au para 3.
74 CANADIAN CRIMINAL LAW REVIEW [21 C.C.L.R.]
ecoles r es identiel les 6 , ont engendre de profonds traumatismesintergenerationnels7. Ces traumatismes sont lies au deracinement, maisegalement aux mauvais traitements et aux abus physiques, psychologiques etsexuels commis a l’endroit des enfants de ces generations. Ce faisant, cespolitiques coloniales ont contribue a la perpetration d’un « genocide culturel »,c’est-a-dire a la « destruction des structures et des pratiques qui permettent augroupe de continuer a vivre en tant que groupe »8. C’est ainsi qu’elles ont creeune rupture importante dans la transmission du droit autochtone, eninvisibilisant et niant l’existence des systemes juridiques autochtones9, ce qui aeu pour effet de reduire les capacites autoregulatrices des societes autochtonesd’une part, et d’accroıtre la dependance des autochtones aux systemes de justiceetatique d’autre part10.
Les etudes classiques sur le pluralisme juridique permettent de decrire et desituer les interactions et les enchevetrements entre le droit etatique et le droitautochtone11. Celles-ci peuvent etre envisagees et representees sur uncontinuum qui est forme a une extremite par la separation, caracterisee parla fermeture et l’independance complete des systemes de droit, et a l’autre, parla fusion ou la subordination, presupposant une volonte imperialiste de rejeterl’existence de tout systeme exo-etatique et ne constituant pas en ce sens unveritable pluralisme12. Entre ces deux extremes, on retrouve differents
6 L’objectif officiel poursuivi etait qu’il n’y ait plus « un seul Indien auCanadaqui n’ait pasete absorbe par la societe [canadienne blanche] » : Commission de verite et dereconciliation du Canada,Honorer la verite, reconcilier pour l’avenir, sommaire executifdu rapport final de la Commission, 2015, p. 57, referant a une declaration prononcee parDuncan Campbell Scott, sous-ministre des Affaires indiennes lors de sa comparutiondevant le comite special de la Chambre des communes charge d’examiner lesmodifications de 1920 de la Loi sur les indiens (L-2) (N-3) : Bibliotheque et ArchivesCanada, RG10, volume 6810, dossier 470-2-3, volume 7.
7 Sur la notion de traumatismes intergenerationnels: Marie-Anick Gagne, « The Role ofDependency and Colonialism in Generating Trauma in First Nations Citizens », in Y.Danieli, dir, International Handbook of Multigenerational Legacies of Trauma, PlenumPress, 1998, 355.
8 Commission de verite et de reconciliation du Canada,Honorer la verite, reconcilier pourl’avenir : Sommaire du rapport final de la Commission de verite et de reconciliation duCanada, a la p 1.
9 Mylene Jaccoud, « La justice penale et les Autochtones : d’une justice imposee autransfert de pouvoirs » (2002) 17:2 RCDS 107.
10 Mylene Jaccoud, « Peuples autochtones et pratiques d’accommodements en matiere dejustice penale au Canada et au Quebec » (2014) 36 Archives de politique criminelle 227.
11 Sally E.Merry, « Legal Pluralism » (1988) 22:5 Law& Soc’y Rev 869 a la p 872; JacquesVanderlinden, « Rendre la production du droit aux peuples », (1996) 62 Politiqueafricaine 83 a la p 86.
12 MireilleDelmas-Marty,Le pluralisme ordonne.Les forces imaginantes du droit, t 2, Paris,Seuil, 2006 a la p 13 ; Ghislain Otis, « Rencontre des cultures juridiques dans la toundrasubarctique : vers une nouvelle gouvernance fonciere au Nunatsiavut » (2009) 15:3Telescope 108 a la p 109.
IPEELEE ET LE DEVOIR DE RESISTANCE 75
processus d’internormativite a geometrie variable, selon que ceux-ci releventd’un « pluralisme de facade » ou strictement colonial, a une veritablereconnaissance de l’alterite juridique13. Ces interactions entre les systemes nesont ni fixes ni statiques. Santos parle de « zones de contact » aux confinsdesquelles se rencontrent et rivalisent des univers symboliques, des formes desavoir et des principes normatifs distincts14. Ces zones de contact sont deslieux hautement conflictuels ou les differents systemes juridiques, et leursrepresentants, menent une lutte constante dans le but de maintenir ou deredefinir leurs positions respectives15. Or, cette lutte ne se fait pas a armesegales. C’est particulierement le cas dans un contexte postcolonial ou lesparties entretiennent des rapports de pouvoir inegaux. Le role joue par lesacteurs a l’interieur de chacun de ces systemes juridiques prend donc uneimportance capitale.
Sur cet echiquier du pluralisme juridique, le Canada a generalement adopteen matiere penale une posture imperialiste de subordination consistant a imposerson systeme de justice et a nier les divers systemes de droit autochtones dans uneffort d’asseoir sa souverainete sur le territoire16. Cette domination n’a toutefoisjamais ete absolue, etant tantot temperee par une certaine resistance de la partdes peuples autochtones, et tantot par un certain nombre de concessions oud’accommodements de la part de l’Etat, soit en adaptant la pratique du droitpenal etatique ou encore en tentant d’incorporer certains elements de la justiceautochtone dans le systeme de justice penale. Or, force est de constater que cesmanifestations du pluralisme juridique relevent trop souvent d’un pluralisme defacade. Mais, est-ce qu’il doit necessairement en etre ainsi? Et quel est le role desacteurs au sein de ces systemes? Sont-ils condamnes a reproduire la logiquehegemonique exclusive du systeme de justice penale etatique ou leur est-ilpossible de resister et d’innover en reconnaissant et integrant les systemesjuridiques autochtones?
C’est dans ce contexte que nous proposons de jeter un regard critique surl’article 718.2e) du Code criminel, selon lequel le juge charge de la determinationde la peine peut tenir compte de « l’examen, plus particulierement en ce qui
13 Anne Fournier, « L’adoption coutumiere autochtone au Quebec : quete de reconnais-sance et depassement du monisme juridique » (2011) 41:2 RGD 703 a la p 724. Delmas-Marty distingue trois processus d’interaction entre les ensembles juridiques situes aucentre de ce continuum, soit la coordination, qui consiste en la coexistence des differentsordres juridiques, l’harmonisation, qui implique un certain rapprochement des systemessans pretendre a l’uniformite, et l’unification qui consiste a integrer les systemes : « Lepluralisme ordonne et les interactions entre ensembles juridiques », conferenceprononcee a l’Universite de Bordeaux.
14 Boaventura de Sousa Santos, Towards a New Common Sense. Law, Globalization andEmancipation, 3e ed, Londres, Butterworths – Lexis Nexis, 2002 a la p 472.
15 Voir aussi la notion d’espace social de Pierre Bourdieu, dans Distinction, Paris, Leseditions de Minuit, 1979.
16 Mylene Jaccoud, « Cercles de guerison et cercles de sentences : une justice reparatrice? »(1999) 32:1 Criminologie 79 a la p 81.
76 CANADIAN CRIMINAL LAW REVIEW [21 C.C.L.R.]
concerne les delinquants autochtones, de toutes les sanctions substitutives quisont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort cause auxvictimes ou a la collectivite »17, et en particulier sur l’interpretation qu’il a recuede la part des tribunaux canadiens depuis l’arret Ipeelee18 de la Cour supreme duCanada. L’article 718.2e) C.cr. s’inscrit dans une serie de mesures adoptees parl’Etat visant a attenuer l’impact de l’imposition du droit canadien auxAutochtones, au meme titre par exemple, que l’offre de services d’interprete etd’accompagnement judiciaires19, la creation de tribunaux specialises danscertaines provinces20, la mise en place de cercles de sentence et les programmesde mesures de rechange developpes en vertu de l’article 717 C.cr21.
Nous suggererons que l’interpretation proposee par la Cour dans Ipeelee etretenue par certains juges des cours provinciales constitue une forme deresistance du pouvoir judiciaire. Cette resistance s’exprime a l’encontre des peinesexcessives et a la surrepresentation des autochtones dans le systeme de justicepenale, mais egalement a l’egard du monisme juridique et de l’hegemonieetatique. Elle n’est pas la seule forme de resistance possible au sein du systemeetatique, mais en constitue neanmoins un incontournable porte-etendard22. Nousdemontrerons ensuite que cette approche innovatrice fait cependant a son tour
17 Cet article a ete modifie recemment lors de l’adoption de la Loi edictant la Chartecanadienne sur les droits des victimes et modifiant certaines lois, LC 2015, c 13. Entre 1996et 2015, il se lisait ainsi : « Le tribunal determine la peine a infliger compte tenu egalementdes elements suivants : e) l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables quisont justifiees dans les circonstances, plus particulierement en ce qui concerne lesdelinquants autochtones. »
18 R. c. Ipeelee, supra note 2.19 Depuis 1978, le gouvernement federal finance un programme d’assistance parajudiciaire
aux Autochtones : <http://www.justice.gc.ca/fra/fina-fund/gouv-gov/apc-acp/in-dex.html>. Dans le cas du Quebec, voir les Services parajudiciaires autochtones duQuebec : <http://www.spaq.qc.ca/>.
20 Les tribunaux specialises peuvent prendre differentes formes selon les provinces etterritoires : dans certains cas, comme en Ontario ou en Saskatchewan, des tribunauxGladue pour les autochtones ont ete specialementmis sur pied; dans d’autres cas, commeau Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et en Saskatchewan, des tribunauxcommunautaires a vocation specialisee (violence conjugale, toxicomanie) integrent lesprincipes Gladue, et finalement dans d’autres cas, les tribunaux reguliers sont mobilisestout en comptant sur du personnel specialement forme et sensibilise aux principesGladue (par ex. : Cour de justice duNunavut, Cour provinciale de Nouvelle-Ecosse). LeMinistere de la Justice du Canada denombrait 19 tribunaux specialises au debut desannees 2010 : Sebastien April et Mylene Magrinelli Orsi, Les pratiques provinciales etterritoriales liees a l’arret Gladue, Ministere de la Justice du Canada, 2013, en ligne :<http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc-csj/ajc-ccs/rr12_11> aux pp 3-5.
21 Par exemple les directives du Service de poursuites penales du Canada : <http://www.ppsc-sppc.gc.ca/fra/pub/sfpg-fpsd/sfp-fps/tpd/p3/ch08.html>.
22 DavidMilward etDebra Parkes, «Gladue : BeyondMyth andTowards Implementationin Manitoba » (2011) 35:1 Man LJ 84 a la p 107, suggerant que l’article 718.2e) peutcontribuer directement a la lutte contre la surrepresentation des Autochtones au sein dusysteme de justice canadien. Voir par ailleurs les programmes de mesures de rechange
IPEELEE ET LE DEVOIR DE RESISTANCE 77
l’objet d’une grande resistance de la part des juges. En nous fondant sur uneanalyse exhaustive de 635 decisions de premiere instance et d’appel rendues apresl’arret Ipeelee entre le 23 mars 2012 et le 1er octobre 2015, nous discuterons del’impact tres limite de l’approche proposee en matiere de determination de lapeine de contrevenants autochtones23. En d’autres mots, et l’affaire Charlette ledemontre clairement, l’article 718.2e) C.cr. continue d’etre un echec retentissantau pays et ce, malgre certains actes isoles de courage judiciaire24.
Nous tenterons ensuite d’identifier les principaux obstacles d’ordre pratiqueet epistemologique pouvant expliquer cet etat de fait et qui ressortent de l’analysede ces decisions et de la litterature. Nous proposerons ultimement que laresistance a l’innovation, exprimee par l’ecrasante majorite des juges, s’inscritaussi plus largement dans le contexte de la resistance du systeme juridique aupluralisme et a la remise en question du monopole de l’Etat canadien de punir.Or, celle-ci pourrait etre surmontee en partie en soutenant a la fois les efforts decertains juges creatifs, ainsi que ceux des communautes autochtones engageesdans la revitalisation de leurs systemes de droit en permettant une plus grandeprise en charge par celles-ci des conflits qui les affligent et une meilleurecoordination de ces efforts avec le systeme de justice25. En d’autres mots, a notreavis, l’article 718.2e) C.cr. et son interpretation ont cree une zone de contact ausein de laquelle les systemes juridiques peuvent se rencontrer en vue d’une plusgrande internormativite. Les acteurs que sont les juges ont un role essentiel ajouer a cet egard. L’objectif ultime que nous poursuivons est donc de susciter undialogue entre le systeme juridique etatique et les nations autochtones afin de leurdonner mutuellement des outils leur permettant d’innover et de mieux resister.
(art. 717 C.cr.) qui peuvent etre mis en place en amont, en vertu des programmes de nonjudiciarisation administres par les provinces.
23 Bien que nous soyons d’avis que les principes enonces dans les arrets Gladue et Ipeeleesont applicables dans d’autres domaines du droit (par exemple, lors de la mise en liberte,la designation d’un avocat en vertu de l’art 684C.cr., le changement de la cote de securited’un detenu, l’interdit de publication, la representativite du jury, la protection del’enfance, la liberation conditionnelle et l’extradition), nous n’avons retenu aux fins de lapresente analyse que les decisions portant sur la determination de la peine a proprementparler.VoirKentRoach, «OneStepForward,TwoStepsBack :Gladue atTenand in theCourts of Appeal », (2009) 54:4 Crim LQ 470 a la p 499.
24 En ce sens, cet article confirme un constat formule anterieurement par plusieurs auteurslors du 10e anniversaire de l’arret Gladue : Kent Roach, « Gladue at Ten — Editorial »,(2009) 54:4 Crim LQ 411, notamment au Quebec : Alana Klein, « Gladue in Quebec »,(2009) 54:4 Crim LQ 506.
25 Voir l’appel a l’action 50 du Sommaire du rapport final de la Commission de verite et dereconciliation du Canada, supra note 8 a la p 221 : « Conformement a la Declaration desNationsUnies sur les droits des peuples autochtones, nous demandons au gouvernementfederal de financer, en collaboration avec les organisations autochtones, la creationd’instituts du droit autochtone pour l’elaboration, la mise en application et lacomprehension des lois autochtones ainsi que l’acces a la justice en conformite avec lescultures uniques des peuples autochtones duCanada. »Nous reviendrons sur cet appel al’action.
78 CANADIAN CRIMINAL LAW REVIEW [21 C.C.L.R.]
1. LA RESISTANCE, ACTE I : IPEELEE, UNE FORME DERESISTANCE JUDICIAIRE A LA PUNITIVITE EXCESSIVE ET AUMONISME JURIDIQUE
L’arret Ipeelee de la Cour supreme du Canada a ete rendu pres de quinze ansapres ses predecesseurs Gladue26 et Wells27. Dans cette affaire, le juge LeBelconstate au nom de la majorite que la decision Gladue et l’article 718.2e) C.cr.n’ont pas eu les effets escomptes au sein du systeme de justice penale canadien,notamment en ce qui concerne la representation des populations autochtonesdans la population carcerale: en fait, la situation s’est au contraire deterioree28.
Le juge LeBel vient d’abord confirmer l’analyse developpee dans le premierarret. Ainsi, le juge charge de determiner la peine doit porter une attentionparticuliere a deux categories de circonstances dans lesquelles se trouvent lescontrevenants autochtones et qui se rapportent a la question ultime dedeterminer une peine juste et appropriee29:
1) Les facteurs systemiques et historiques distinctifs qui peuvent etre une desraisons pour lesquelles le contrevenant se retrouve devant les tribunaux(volet 1);
2) Les types de procedures de determination de la peine et de sanctions qui,dans les circonstances, peuvent etre appropriees a l’egard du contrevenanten raison de son heritage ou de ses liens autochtones (volet 2).30
Le juge LeBel va cependant encore plus loin en apportant des clarificationsnecessaires sur l’interpretation de l’article 718.2e) C. cr., ainsi que sur les liens quecette disposition entretient avec les autres principes de determination de la peine.De plus, il tente de repondre aux principales preoccupations exprimees dans lajurisprudence et la doctrine au cours des douze dernieres annees.
26 R. c. Gladue, 1999 CarswellBC 779, [1999] 1 R.C.S. 688, 133 C.C.C. (3d) 385, 23 R.R.(5th) 197.
27 R. c.Wells, 2000CSC10, 2000CarswellAlta 96, [2000] 1R.C.S. 207, 141C.C.C. (3d) 368,30 R.R. (5th) 254.
28 R. c. Ipeelee, supra note 2 aux paras 59 et 62. Selon Statistiques Canada, les adultesautochtones representent 24%des admissions aux services correctionnels provinciaux etterritoriaux et 26% des admissions en detention en 2013-2014. Ils representent en outre20% des admissions en detention dans les services correctionnels federaux. Les femmesautochtones representaient une proportion plus importante des femmes admises endetention apres condamnation en milieu provincial et territorial que celle observee chezles hommes (36%) : Statistiques sur les services correctionnels pour adultes au Canada,2013-2014, 22 avril 2015 : <http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2015001/article/14163-fra.htm#n15>.
29 Ibid au para 72.30 Ibid aux paras 59 et 72.
IPEELEE ET LE DEVOIR DE RESISTANCE 79
(a) Volet 1 : Les facteurs historiques et systemiques
Element important et de droit nouveau, le juge LeBel ancre la considerationdes facteurs historiques et systemiques dans le principe de proportionnalite31.Affirmant son caractere fondamental, il precise que « [q]uel que soit le poidsqu’un juge souhaite accorder aux differents objectifs et aux autres principesenonces dans le Code, la peine qu’il inflige doit respecter le principe fondamentalde proportionnalite. »32 Il mentionne que ces facteurs peuvent influer sur laculpabilite du contrevenant dans la mesure ou ils mettent en lumiere son degre deculpabilite morale33:
« Bien qu’on ne puisse que rarement — sinon jamais — affirmer a bon
droit que leurs actes n’etaient pas volontaires et ne sont donc paspassibles de sanction criminelle, leur situation difficile peut, en fait,attenuer leur culpabilite morale [. . .] « Peu d’etres humains peuvent
vivre une telle enfance et une telle jeunesse sans developper de gravesproblemes. »34 Ne pas tenir compte de ces circonstances contreviendraitau principe fondamental de determination de la peine — la propor-
tionnalite de la peine a la gravite de l’infraction et au degre deresponsabilite du delinquant. »35
Il indique que dans de telles circonstances, une sanction visant a traiter lescauses sous-jacentes de la conduite criminelle peut se reveler plus approprieequ’une sanction de nature punitive.
31 DansR. c. Ipeelee, ibid au para 36, puis dansR. c. Anderson, 2014 CSC 41, 2014 SCC 41,2014 CarswellNfld 166, 2014 CarswellNfld 167, [2014] 2 S.C.R. 167, 350 Nfld. P.E.I.R.289, 311 C.C.C. (3d) 1, 11 C.R. (7th) 1, 373 D.L.R. (4th) 577, 60 M.V.R. (6th) 1, 1088A.P.R. 289, [2014] 3 C.N.L.R. 267, 310C.R.R. (2d) 197, 458N.R. 1, [2014] S.C.J. No. 41(S.C.C.), au para 21, la Cour supreme precise que le principe de proportionnalite a unedimension constitutionnelle non seulement en vertu de l’article 12 de la Chartecanadienne des droits et libertes, mais egalement en vertu de son article 7. Elle revientcependant en arriere subsequemment dansR. c. Lloyd, 2016 CSC 13, 2016 SCC 13, 2016CarswellBC959, 2016CarswellBC960, 334C.C.C. (3d) 20, 27C.R. (7th) 205, 396D.L.R.(4th) 595, 385 B.C.A.C. 1, 482N.R. 35, 665W.A.C. 1, [2016]A.C.S.No. 13, [2016] S.C.J.No. 13 (S.C.C.) aux paras 38-47 et dans R. c. Safarzadeh-Markhali, 2016 CSC 14, 2016SCC14, 2016CarswellOnt 5652, 2016CarswellOnt 5653, 334C.C.C. (3d) 1, 27C.R. (7th)265, 396D.L.R. (4th) 575, 482N.R. 90, 347O.A.C. 1, [2016] A.C.S.No. 14, [2016] S.C.J.No. 14 (S.C.C.) aux paras 70-71.
32 R. c. Ipeelee, ibid, au para 37. Voir aussi R. c. Safarzadeh-Markhali, ibid au para 70.33 Ibid au para 73. Marie-Eve Sylvestre, « The (Re)Discovery of the Proportionality
Principle in Sentencing in Ipeelee: Constitutionalization and theEmergence ofCollectiveResponsibility » (2013) 63 SCLR 461.
34 R. c. Ipeelee, supra note 2 au para 73, citant R. c. Skani, 2002 ABQB 1097, 2002CarswellAlta 1636 par. 60.
35 Ibid au para 73.
80 CANADIAN CRIMINAL LAW REVIEW [21 C.C.L.R.]
(b) Volet 2 : Les types de procedures et de sanctions appropriees
Concernant le second volet, le juge LeBel precise que l’article 718.2e)C.cr. « ne se borne pas a confirmer les principes existants de determinationde la peine »36. En effet, ceux-ci sont inadaptes pour la plupart desdelinquants autochtones parce qu’ils « n’ont pas permis de repondre auxbesoins, a l’experience et a la facon de voir des peuples et communautesautochtones. »37
Citant le rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, lejuge LeBel constate « le « lamentable echec » du systeme canadien de justicepenale a l’endroit des peuples autochtones. Celui-ci decoule, a son avis, de cequ’« autochtones et non-autochtones affichent des conceptions extremementdifferentes a l’egard de questions fondamentales comme la nature de la justice etla facon de l’administrer »38. Les juges doivent donc reconnaıtre qu’en raison dela « presence de conceptions du monde foncierement differentes, l’imposition desanctions differentes ou substitutives peut permettre d’atteindre plusefficacement les objectifs de determination de la peine dans une collectivitedonnee »39. En ce sens, le second volet a trait a l’efficacite de la peine elle-meme40.
Les circonstances decrites dans les deux volets ci-dessus doivent etre fourniesau juge a l’aide d’un « rapport Gladue »41. Les juges doivent prendreconnaissance d’office des facteurs systemiques et historiques, mais lesrenseignements specifiques proviendront des avocats ou encore d’observationspresentees par la communaute autochtone interessee.42 En outre, le juge chargedu prononce de la peine « pourra et devrait, lorsque les circonstances s’y pretentet que cela est concretement possible, demander qu’on appelle des temoins enmesure de temoigner sur les solutions de rechange raisonnables. »43
36 Ibid.37 Ibid au para 74, citant R c Gladue, supra note 26 au para 73.38 Ibid au para 74, citant Canada, Commission royale sur les peuples autochtones (« CRPA
»), Pardela les divisions culturelles : Un rapport sur les autochtones et la justice penale auCanada, Ottawa, Ministre des approvisionnements et services Canada, 1996 a la p 336.
39 R. c. Ipeelee, supra note 2 au para 74.40 Ibid au para 74.41 Les rapports Gladue sont une forme de rapports pre-sentenciels (art. 721 C.cr.). Ils
s’inscrivent cependant dans une logique tout a fait differente. Alors que les rapports pre-sentenciels sont generalement bases sur une evaluation des facteurs de risques de recidiveque presentent certains contrevenants, les rapports Gladue permettent de contextualiserles gestes poses par les contrevenants a la lumiere de leurs experiences passees d’abus et dediscrimination et contiennent en ce sens considerablement plus d’information sur lasituation personnelle et familiale des contrevenants : Kelly Hannah-Moffat et PaulaMaurutto, « Recontextualizing Presentence Reports : Risk and Race », (2010) 12:3Punishment and Society 262, aux pp 265, 273, 275 et 278.
42 R. c. Gladue, supra note 26 au para 93 (point 7 du resume).43 Ibid au para 84.
IPEELEE ET LE DEVOIR DE RESISTANCE 81
(c) Les « erreurs » d’interpretation dans la periode post-Gladue
Finalement, le juge LeBel constate qu’au cours des dernieres annees, lestribunaux ont commis un certain nombre « d’erreurs », et que ce faisant, ilsont « considerablement restreint la portee et le potentiel reparateur de cettedisposition » et « compromis la realisation des objectifs recherches dansl’arret Gladue. »44
La premiere erreur commise par les juges consiste a avoir laisse entendre, atort, que le contrevenant devait etablir un lien de causalite entre les facteurshistoriques et la perpetration de l’infraction afin que le juge charge de ladetermination de la peine puisse tenir compte de ces facteurs (« exigence du liende causalite »)45. Le juge LeBel mentionne que le fait d’exiger un tel lien « refleteune mauvaise comprehension des effets intergenerationnels devastateurs desexperiences collectives vecues par les peuples autochtones. [Cela] imposeegalement aux delinquants un fardeau de la preuve que n’avait pas prevul’arret Gladue. » 46
Le second probleme, le plus important selon lui47, reside en l’applicationirreguliere des principes etablis dans Gladue lorsqu’il s’agit d’imposer une peinepour un crime grave ou violent48. Selon le juge LeBel, la jurisprudence insisteindument sur un passage de l’arret Gladue, reitere dans l’arretWells : « [d]e facongenerale, plus violente et grave sera l’infraction, plus grande sera la probabiliteque la duree des peines d’emprisonnement des autochtones et des non-autochtones soit en pratique proche ou identique, meme compte tenu de leurconception differente de la determination de la peine »49. Or, le juge charge dedeterminer la peine a l’obligation d’appliquer 718.2e) C.cr., peu importe lecrime.50 D’ailleurs, « [l]a notion d’infractions ‘‘graves” n’existe pas dans les textesde loi et ne fait l’objet d’aucun critere juridique.51 Il est aussi « illogique decomparer la peine a infliger au delinquant autochtone avec celle que se verraitimposer un delinquant hypothetique non autochtone, parce qu’un seuldelinquant se trouve devant le tribunal »52.
44 R. c. Ipeelee, supra note 2 au para 80. Voir egalement les constats formules par AlanaKlein pour le Quebec, supra, note 24 a la p 509 et suiv. et Kent Roach, supra note 23.
45 Ibid au para 81.46 Ibid au para 82.47 Ibid au para 84.48 Ibid.49 Ibid citant R. c. Gladue, supra note 26 au para 79 et R. c. Wells, supra note 27 aux paras
42-44.50 Ibid au para 85.51 Ibid au para 86, citant Renee Pelletier, « The Nullification of Section 718.2(e):
Aggravating Aboriginal Overrepresentation in Canadian Prisons » (2001) 39 OsgoodeHall LJ 469 a la p 479.
52 Ibid au para 86.
82 CANADIAN CRIMINAL LAW REVIEW [21 C.C.L.R.]
La troisieme erreur consiste a faire primer le principe de l’harmonisation despeines indique a l’article 718.2b) C.cr. et prevoyant l’infliction de peinessemblables pour des infractions semblables commises dans des circonstancessemblables, sur celui de l’article 718.2e) C.cr. Le juge LeBel est d’avis que laparite des peines ne peut etre interpretee de facon a contrecarrer l’effet reparateurde l’article 718.2e) C.cr. D’ailleurs, en contexte autochtone, le principe de paritepeut requerir l’imposition d’une peine differente precisement en raison du faitque les personnes autochtones se trouvent dans des circonstances particulieres53.Il conclut en citant le professeur Quigley selon lequel:
« L’uniformite occulte l’injustice. [. . .] Certes, il n’est que juste a priori
d’imposer la meme peine pour une infraction presque identique. Cepoint de vue se rapprocherait peut-etre davantage de la verite si nousvivions dans une societe plus equitable, plus homogene et plus cohesive
que la notre. Toutefois, dans une societe diversifiee sur les plansethnique et culturel, un meme traitement peut avoir un effet different.C’est ce que reconnaıt en fait la jurisprudence sur les droits a l’egalite
garantis par la Charte. Eviter de se preoccuper exagerement de ladisparite entre les sanctions imposees constitue donc un imperatifconstitutionnel. »54
(d) Ipeelee, une forme de resistance
C’est ainsi que l’art. 718.2e) C.cr. et l’interpretation qu’il a recue dans l’arretIpeelee constituent une forme importante de resistance judiciaire.
D’abord, ils servent de rempart judiciaire a l’encontre du recours al’emprisonnement et a l’utilisation de peines excessives, particulierement en cequi concerne les personnes autochtones. L’article 718.2e) C.cr. propose en effetun principe de moderation penale a contrecourant de la rationalite penalemoderne55 ainsi que des reformes legislatives des dix dernieres annees qui ont eupour effet de multiplier les peines minimales56, d’augmenter les peines maximales,
53 Ibid au para 79.54 Ibid au para 79, citant TimQuigley, « Some Issues in Sentencing ofAboriginal Offenders
», dans Richard Gosse, James Youngblood Henderson et Roger Carter, dir, ContinuingPoundmaker andRiel’s Quest : PresentationsMade at aConference onAboriginal Peoplesand Justice, Saskatoon, Purich Publishing, 1994, 269 a la p 286.
55 Selon Alvaro Pires, la rationalite penale moderne est une maniere de penser et deconstruire le systeme penal qui cree une association necessaire entre le crime etl’impositiond’unepeine afflictive.La theorie de laRPMrenvoie a la difficulte du systemejuridique « de penser le crime et le systeme penal sans appliquer a ces objets les categoriesde pensee produites et garanties par la rationalite penale elle-meme » et qui sontprincipalement composees par les theories classiques de la peine (de la retribution a ladissuasion), a l’exclusion de formes positives ou alternatives de resolution des conflits :Alvaro Pires, « La rationalite penale moderne, la societe du risque et la judiciarisation del’opinion publique », (2001) 33 Sociologie et Societes 179 a la p 184.
56 Sur l’impact des peines minimales sur l’augmentation de la surincarceration desAutochtones et l’article 718.2e) C.cr, voir David M. Paciocco, « The Law of Minimum
IPEELEE ET LE DEVOIR DE RESISTANCE 83
d’inviabiliser certaines peines alternatives, telles que l’emprisonnement avecsursis, et d’ajouter des circonstances aggravantes. Bien plus qu’un simpleprincipe, il constitue « une disposition reparatrice destinee a remedier au graveprobleme de surrepresentation des personnes autochtones dans le systeme dejustice penale et a encourager le juge a aborder la peine dans une perspectivecorrective»57.
Finalement, ils sont des formes de resistance au monisme juridique et aumonopole de l’Etat dans la resolution des conflits impliquant des personnesautochtones, notamment en raison du second volet de l’analyse de 718.2e) C.cr.,soit la possibilite d’incorporer des types de procedure et des sanctions quitiennent compte de l’heritage autochtone. Ce faisant, il ouvre la porte al’internormativite. Il exige des juges charges de la determination de la peine queceux-ci accomplissent cet exercice en adoptant une perspective differente, nonseulement parce que les peines imposees ne sont pas efficaces, mais surtout enraison du fait que les differentes nations autochtones ont des conceptionsdifferentes de la justice.
Bien que les deux aspects de l’analyse Gladue aient pose et posent toujoursdes difficultes aux juges de premiere instance58, le second volet est celui quidemeure le plus meconnu et le moins utilise par les tribunaux. Il est pourtantpossiblement le plus prometteur.
2. LA RESISTANCE, ACTE II : LES JUGES DE PREMIERE INSTANCEET LA REPRODUCTION D’UNE POSTURE HEGEMONIQUE
L’arret Ipeelee renferme un puissant appel a la creativite, mais aussi a laresistance judiciaire. Sur le plan empirique, on constate pourtant que la majoritedes juges de premiere instance et de cours d’appel sont particulierement reticents,voire resistants, a exploiter son potentiel innovateur. Bien que la Cour supremeait invite les juges a redoubler d’efforts, force est de constater que les pratiquesn’ont sensiblement pas change depuis 2012.
Dans la presente partie, nous presentons les resultats de notre analyse de 635decisions rendues dans les trois ans et demi qui ont suivi la decision de la Courdans Ipeelee (entre le 23 mars 2012 et le 1er octobre 201559) et qui traitent de ladetermination de la peine d’une personne autochtone et ce, afin de sonder ledegre de penetration de cet arret et de l’approche qu’il preconise par les juges depremiere instance de differentes juridictions. Nous demontrerons d’abord queplusieurs juges de premiere instance font preuve non seulement de resistance al’endroit des principes developpes dans Gladue et Ipeelee, mais egalement d’une
Sentences: Judicial Responses andResponsibility » (2015) 19:2 Can CrimLRev 173 auxpp 189-192.
57 R. c. Ipeelee, supra note 2 au para 59; R. c. Gladue, supra note 26 au para 93.58 Voir notamment Alana Klein, supra note 24.59 Les decisions se repartissent annuellement comme suit: 125 en 2012, 206 en 2013, 196 en
2014 et 108 en 2015.
84 CANADIAN CRIMINAL LAW REVIEW [21 C.C.L.R.]
certaine ignorance. Ensuite, nous ferons etat de cette resistance dans ladetermination d’une peine appropriee en distinguant celle qui se manifeste al’egard du premier volet de l’analyse ainsi que du second. Pour chacun de cesvolets, nous distinguerons les decisions qui demontrent de la resistance al’innovation et a l’approche proposee par la Cour supreme dans Ipeelee de cellesqui font preuve d’audace et de creativite.
Sur le plan methodologique, quelques precisions s’imposent. Nous avonsrecense et selectionne ces 635 decisions a l’aide de trois moteurs de recherche enutilisant divers mots-cles se referant a la determination de la peine de personnesautochtones, en anglais et en francais. Une fois repertoriees, les decisions ont etereportees dans une banque de donnees et analysees afin d’identifier l’applicationdes deux volets de l’analyse Gladue. La banque comprend 505 decisions depremiere instance, representant 80% des decisions, et 130 decisions de coursd’appel, soit 20%. Les provinces et regions du Canada ne sont pas egalementrepresentees dans notre echantillon. Par exemple, la Colombie-Britanniquecompte environ 20% des decisions tandis que le Quebec n’en compte qu’environ4%60.
Notre methodologie comporte aussi des limites importantes et evidentes.D’abord, la tres vaste majorite des jugements rendus en matiere criminelle nefont pas l’objet d’une decision ecrite et echappent donc a notre analyse. Parexemple, en 2013-2014, les tribunaux de juridiction criminelle du Quebec ontregle 46 128 causes ayant donne lieu a un verdict de culpabilite61. De ce nombre,il est difficile de savoir combien visaient des contrevenants autochtones. Danstous les cas, notre banque ne fait etat que de 25 decisions quebecoises rapporteessur une periode de trois ans. Ensuite, et dans le meme ordre d’idee, lajurisprudence ne fait pas necessairement etat des pratiques officieuses et souventinnovatrices utilisees par les acteurs sur le terrain et qui ont pu echapper a notrerecension. Elle ne tient pas non plus compte des programmes de mesures derechange mis en place dans plusieurs districts judiciaires. L’analyse qui suit devradonc etre completee par des entretiens et des observations qui seront realisessubsequemment.
Ceci etant dit, l’analyse des decisions ecrites nous est apparue incontournable :la jurisprudence, et particulierement celle des cours d’appel, a un impact evidentsur la determination des peines, et en particulier la « fourchette » des peines
60 Voici le nombre de decisions par province et territoire : Alberta : 72 (11,34%),Colombie-Britannique : 131 (20,63%),Manitoba : 68 (10,71%),Nouveau-Brunswick : 2,Nouvelle-Ecosse : 10 (1,57%), Ontario : 105 (16,53%), Quebec : 25 (3,94%), Saskatchewan : 94(14,80%), Terre-Neuve : 7 (1,1%), Nunavut : 21 (3,31%), Yukon : 51 (8,03%), etTerritoires du-Nord-Ouest : 49 (7,72%). Nous n’avons recense aucune decision de l’Ile-du-Prince-Edouard.
61 Ashley Maxwell, Statistiques sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes auCanada, 2013-2014, Statistiques Canada, 2015 : <http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2015001/article/14226-fra.htm#a1>, graphique 4. Les tribunaux de juridictioncriminelle du Quebec ont regle 62 844 causes en 2013-2014. Parmi celles-ci, 73,4% ontdonne lieu a un verdict de culpabilite.
IPEELEE ET LE DEVOIR DE RESISTANCE 85
applicable, mais egalement sur les representations que se font les juges del’univers des possibilites qui s’offrent a eux et a elles au quotidien dans leursinteractions avec les contrevenants autochtones. Nous cherchons a evaluerl’impact de la decision Ipeelee dans l’evolution de cette jurisprudence afin demieux comprendre les possibilites d’innovation.
Finalement, notons que les decisions portant sur des situations impliquant dela violence conjugale et/ou familiale ont fait l’objet d’une analyse specifique enraison du projet de recherche dans lequel cette analyse a ete effectuee. Notreechantillon contenait 126 decisions de ce type.
(a) Quand la resistance devient de l’ignorance ?
Avant de parler de resistance des juges a proprement parler, nous croyonsqu’il faut d’abord constater l’ignorance dont certains d’entre eux font preuve al’egard des principes enonces dans l’arret Ipeelee, ou du moins del’incomprehension qui semble subsister quant a leur caractere obligatoire62. Eneffet, d’entree de jeu, soulignons que plus d’une decision sur trois (227 decisions,35,75%) ne fait aucune mention de la decision Ipeelee et que 8% des decisions nementionnent ni la decision Ipeelee, ni Gladue63.
Ensuite, nous avons ete surprises de constater que 4 decisions sur 10, soit252, ne font pas mention de l’article 718.2e) C.cr. De plus, 61 decisionsconsiderent que cet article n’est pas applicable ou moins applicable dans lescirconstances de l’affaire, dont dans les cas de « crimes graves » sur lesquels nousreviendrons plus tard.
(b) La resistance au volet 1
Seules 66% des decisions dans notre banque, soit 418, font mention desfacteurs systemiques et historiques64. Pour celles-ci, nous avons analyse la facondont les juges les mobilisent. Nous examinons i) les motifs d’exclusion desfacteurs historiques et systemiques evoques; ii) le caractere satisfaisant ou nonsatisfaisant de leur analyse par les juges; et iii) les liens entre ces facteurs et leprincipe de proportionnalite.
62 Voir le constat similaire d’Alana Klein, supra note 24 a la p 521.63 227 decisions ne mentionnent pas Ipeelee (35,75%). De celles-ci, 50 ne mentionnent pas
non plus Gladue (7,87% de l’echantillon total) alors que 178 decisions mentionnentl’arret Gladue sans mentionner Ipeelee (28,03%). Il faut dire que la plupart de nosdecisions ont ete trouvees grace a l’utilisation du mot cle « Gladue ». A ce sujet, il existeune certaine disparite regionale, leQuebec et l’Alberta ayant les taux les plus eleves parmiles decisions qui ne mentionnent ni Gladue, ni Ipeelee: Quebec : 4/25 (16%); Ontario : 9/105 (8,57%); Manitoba : 5/68 (7,35%); Saskatchewan : 5/95 (5,26%); Alberta : 9/72(12,5%); Colombie-Britannique : 9/131 (6,87%); et Yukon : 6/51 (11,76%).
64 C’est donc dire qu’un tiers des decisions (215) ne les mentionnent pas.
86 CANADIAN CRIMINAL LAW REVIEW [21 C.C.L.R.]
(i) Motifs d’exclusion des facteurs historiques et systemiques
D’abord, nous avons releve que dans 15% de ces decisions (95), le juge aconsidere, de facon explicite, que les facteurs historiques et systemiquesn’etaient pas applicables ou etaient moins applicables en l’espece. Plusieursraisons sont evoquees. Tout comme ce fut le cas pour l’application de l’article718.2e) C.cr., dans plus de la moitie de ces cas (51), la principale raisonevoquee par les juges est la gravite de l’infraction65. A titre d’exemple, cesfacteurs ont ete ecartes dans la decision R. c. G. (C.)66. Selon le juge siegeantdans cette affaire, « the offence could not be more serious »67. L’accuse s’estintroduit par effraction chez la victime, l’a sauvagement battue, poignardee etagressee sexuellement. Il a ecrit « I had fun » sur le mur avec le sang de lavictime. Meme si le juge a considere que « [i]t is apparent that C.G. has beenaffected by issues relating to domestic violence, alcohol abuse, gangs »68, il aconsidere que dans les circonstances, cela n’avait pas de poids dans ladetermination de la peine: « I have concluded that neither this young man’sbackground nor his consumption of alcohol accounts for the explosion ofbrutality directed against a completely innocent woman. »69
Ces facteurs ont egalement ete ecartes dans R. c. Kayaitok70, une affaire demeurtre au deuxieme degre en contexte conjugal: « In sentencing aboriginaloffenders, a court must try to give the greater weight to the principles ofrestorative justice and less weight to principles of deterrence and denunciationand separation. However, in R. c. Wells, 2000 CSC 10, 2000 CarswellAlta 96,[2000] 1 R.C.S. 207, 141 C.C.C. (3d) 368, 30 R.R. (5th) 254, the Supreme Courtof Canada also cautioned that the principles in Gladue are less applicable formore violent offences. »71
La deuxieme raison la plus importante pour laquelle les facteurs ont eteconsideres moins applicables est l’absence de lien de causalite (40 decisions72). Lejuge etait d’avis que l’accuse avait des liens trop tenus avec une communaute
65 Voir par ex R. c. Q. (B.S.), 2013 BCPC 332, 2013 CarswellBC 3860; R. c. T. (E.), 2012SKQB169, 2012CarswellSask 296;R. c. O. (T.J.), 2015MBQB143, 2015CarswellMan462;R. c.McNabb, 2013 SKPC 208, 2013 CarswellSask 851; R. c. Richards, 2014 ONSC3866, 2014 CarswellOnt 8883 (S.C.J.); R. c. Gargan, 2014 NWTSC 62, 2014CarswellNWT 69.
66 R. c. G. (C.), 2013 MBPC 73, 2013 CarswellMan 752.67 Ibid au para 33.68 Ibid au para 34.69 Ibid au para 32.70 R. c. Kayaitok, 2014 NUCJ 11, 2014 CarswellNun 9.71 Ibid au para 43.72 Voir par ex R. c. Willier, 2013 ABQB 629, 2013 CarswellAlta 2038; R. c. Guimond, 2014
MBPC 37, 2014 CarswellMan 829, affirmed 2016 MBCA 18, 2016 CarswellMan 34, 26R.R. (7th) 295; R. c. Schmidt-Mousseau, 2015 MBPC 36, 2015 CarswellMan 391; R. c.Long, 2014 ONSC 38, 2014 CarswellOnt 900 (S.C.J.); R. c. Awashish, 2014 QCCQ 3303,2014 CarswellQue 4168; R. c. Sangris, 2014 NWTSC 23, 2014 CarswellNWT 25.
IPEELEE ET LE DEVOIR DE RESISTANCE 87
autochtone, qu’il n’avait « pas assez ete victime » des facteurs historiques etsystemiques ou encore qu’il n’y avait pas de lien entre le passe autochtone del’accuse et son crime. Par exemple, dans la decision Sangris73, le juge a considereque les facteurs historiques et systemiques n’etaient pas applicables en raison del’absence de lien entre ces derniers et la perpetration du crime:
« I spent a lot of time considering Mr. Sangris’ aboriginal status and inparticular his experience in residential school, which can only be
described as horrific. As I noted, his childhood was very difficult.Frankly, though, I find it difficult to relate this crime to the Gladuefactors. Mr. Sangris’ actions do not appear to have been driven by thesystemic Gladue factors that courts typically see. The nature of this
crime and the circumstances surrounding it lead me to the conclusionthat his motivation was not driven by factors like poverty or addictionor homelessness, but rather he was driven by sexual gratification. It was
planned and deliberate. The victim was lured. »74
Parmi les autres raisons pour lesquelles les juges ont considere les facteurshistoriques et systemiques moins applicables, notons le fait que l’avocat de ladefense n’ait fait aucune soumission a ce sujet ou que le juge manquaitd’informations afin de les appliquer (11 cas75), le fait que l’accuse ait fait le choixde la criminalite plutot que de s’eduquer ou de travailler (1 decision76), le fait quel’accuse y avait renonce (3 decisions77) et le fait que la securite du public devaitprimer sur les facteurs (11 decisions78). Cette derniere raison est principalementinvoquee dans le cas de delinquants dangereux ou a controler. Par exemple, dans
73 R. c. Sangris, 2014 NWTSC 23, 2014 CarswellNWT 25.74 Ibid au para 49.75 L’avocat n’a pas fait de soumission : voir par ex R. c. S. (W.), 2012 BCPC 310, 2012
CarswellBC 2711; R. c. Bear, 2012 SKQB 467, 2012 CarswellSask 947; R. c. Moosomin,2012 SKQB 386, 2012 CarswellSask 651; R. c. Pelletier, 2012 ONCA 566, 2012CarswellOnt 10665, 291 C.C.C. (3d) 279. Le jugemanque d’information :R. c. Atkinson,2012 YKTC 62, 2012 CarswellYukon 97; R. c. McKay, 2012 BCCA 477, 2012CarswellBC 3913;R. c.McPherson, 2013 BCPC 250, 2013 CarswellBC 2901; R. c. Boyd,2015 ONCJ 120, 2015 CarswellOnt 2971; R. c. Genest, 2014 QCCQ 8177, 2014CarswellQue 9069.
76 R. c. Cardinal, 2013 BCPC 282, 2013 CarswellBC 3142 au para. 33, reversed 2015 BCCA58, 2015 CarswellBC 318 : « I am very much taking into account the offender Cardinal’sAboriginal circumstances, and I am very much trying to abide by what the SupremeCourt of Canada says I should do. The history of Aboriginal life in Canada has beendismal. The background of Cardinal in the Aboriginal community has been dreadful.However, he has chosen a life of crime, perhaps to emulate his criminal uncles.Hehas nottaken advantage of educational opportunities that may have presented themselves; hehas not chosen to contribute to his community or the general community by way ofworking. He has instead chosen to live a life as a dangerous criminal. »
77 R. c. Clark, 2013 BCPC 143, 2013 CarswellBC 1719; R. c. Kauffeldt, 2013 ONCJ 311,2013CarswellOnt 7613;R. c. Lewis, 2012ONSC 5085, 2012 CarswellOnt 12002 (S.C.J.).
78 Voir par ex R. c. Papin, 2013 ABPC 46, 2013 CarswellAlta 800; R. c. Montgrand, 2014SKCA31, 2014CarswellSask 165;R. c.Captain, 2013MBPC61, 2013CarswellMan604;
88 CANADIAN CRIMINAL LAW REVIEW [21 C.C.L.R.]
R. c. H.79, une affaire d’inceste dans lequel l’accuse a ete declare delinquantdangereux, le juge affirme ceci:
« I have considered both the principle of less restrictive sanctions and
Mr. J.W.H.’s Aboriginal status, through s. 718(e) of the Criminal Codeand through consideration of the principles set out in R. c. Gladue.
I recognize that Mr. J.W.H.’s circumstances “are unique and different
from non-Aboriginal offenders.” Mr. J.W.H. suffers from severealcohol abuse issues. As noted, the wider social environment in whichMr. J.W.H. finds himself as an Aboriginal may have had a part inbringing Mr. J.W.H. before the courts. However, the issue remains
whether there is a reasonable possibility of eventual control of his riskin the community. »80
Si les motifs evoques ne nous sont que trop familiers, c’est qu’ilscorrespondent precisement aux « erreurs » identifiees par le juge LeBel dansIpeelee, demontrant ainsi toute la resistance qu’ils attirent. En effet, refuserd’appliquer les facteurs systemiques et historiques constitue clairement uneerreur de droit susceptible d’appel depuis Ipeelee81. Il est en de meme del’imposition d’un fardeau de prouver un lien de causalite82. Rappelonsfinalement que l’affaire Ipeelee et son compagnon, Ladue, portaientspecifiquement sur le cas des delinquants dangereux et a controler et que cecontexte ne saurait donc expliquer le traitement reserve a ces affaires83.
(ii) Traitement des facteurs historiques et systemiques
Nous avons ensuite etudie la facon dont les facteurs historiques etsystemiques sont consideres lorsque ceux-ci ne sont pas exclus d’emblee outout simplement non mentionnes (325 cas). Nous avons cree deux categories:analyse satisfaisante (128 cas) ou insatisfaisante (195 cas).
Nous avons considere « insatisfaisantes » les decisions ou le juge affirmaitprendre en consideration les facteurs, mais dans lesquelles il n’etait pas possiblepour le lecteur de comprendre en quoi ces facteurs avaient ete consideres et/ouquel etait l’impact de cette prise en consideration sur sa decision. Nous avons parexemple inclus dans cette categorie les decisions ou le juge declare « avoirconsidere » les facteurs, mais n’en fait aucune application specifique aux
R. c. Nickerson, 2014 NSPC 67, 2014 CarswellNS 650; R. c. H., 2012 ONSC 4561, 2012CarswellOnt 13427 (S.C.J.).
79 R. c. H., 2012 ONSC 4561, 2012 CarswellOnt 13427 (S.C.J.).80 Ibid aux para 93-94.81 R. c. Ipeelee, supra note 2 aux paras 84-85.82 Ibid aux paras 81-83.83 Dans Ipeelee, le juge Rothstein est dissident quant a l’application des facteurs Gladue
aux faits des affaires. Voir a ce sujet Nate Jackson, « The Substantive Application ofGladue in Dangerous Offender Proceedings: Reassessing Risk and Rehabilitation forAboriginal Offenders » (2015) 20:1 Can Crim L Rev 77 aux pp 80-83.
IPEELEE ET LE DEVOIR DE RESISTANCE 89
circonstances de l’accuse84. Par exemple, dans un de ces jugements presentantune situation recurrente dans notre banque, le juge ecrit: « Under s. 718.2(e), asentencing judge must take notice of systemic or background factors whichcontribute causally to crimes committed by aboriginal offenders. The SupremeCourt of Canada, in R. v. Gladue [. . .] requires consideration of such factors indetermining whether a custodial sentence is appropriate. »85 Toutefois, mis a partce passage, le juge ne les applique pas au cas de l’accuse.
Autre exemple, dans R. c. C. (R.)86, le juge declare: «I have taken intoaccount those Gladue considerations. There was not anything unusual; he had anormal childhood in the pre-sentence report. After the parents separated, hemoved in with his mother but had good contact with the Father, except that hewas sexually abused he said by his male cousins when he was six to eight. »87
Ainsi, malgre des abus sexuels ayant dure deux ans, le juge considere que l’accusea eu une enfance normale. Outre le fait qu’il mentionne avoir pris enconsideration les facteurs Gladue, il est impossible de voir comment il les aappliques. De la meme maniere, dans l’affaire Paul88, le juge ne fait qu’insistersur la gravite du crime et, bien qu’il mentionne l’importance de prendre enconsideration les facteurs historiques et systemiques, on ne voit pas l’application.Dans cet appel sur sentence rejete, la Cour d’appel cite ce passage de la decisionde premiere instance, ou nous constatons que le juge considere que l’accuse n’apas eu un passe difficile et ce, malgre le meurtre de son pere qui etait untrafiquant de drogues: « Mr. Paul is an aboriginal offender. His circumstanceswere that he was raised by a father who was a drug dealer and who wasmurdered. This is not to say that Mr. Paul’s upbringing was difficult. On thecontrary, the evidence is that he was raised in a loving family. »89
Par contraste, nous avons regroupe les decisions dans lesquelles le lecteurcomprend la maniere dont le juge a pris en consideration les facteurs et l’impactde ceux-ci dans la categorie « analyse satisfaisante ». Nous insistons sur le faitque le caractere satisfaisant de l’analyse ne decoule pas d’une application justedes facteurs systemiques, mais de la presence d’une analyse nous permettant deconstater que le juge a veritablement soupese ces facteurs dans l’exercice dedetermination de la peine. Cela n’etant pas toujours evident, nous avonsinterprete liberalement cette categorie et inclus les jugements dans lesquels nouspouvions minimalement reconnaıtre qu’il y avait eu application des facteurs.
Le tableau 1, ci-dessous, fait etat des resultats quantitatifs:
84 L’auteurNate Jackson constate lameme situation dans le cas des delinquants dangereuxautochtones : les considerations Gladue sont simplement mentionnees a la fin duprocessus de determination de la peine alors qu’elles devraient en etre le cœur : ibid a la p89.
85 R. c. Stone, 2012 SKQB 274, 2012 CarswellSask 558 au para. 39.86 R. c. C. (R.), 2013 ONCJ 736, 2013 CarswellOnt 18560.87 Ibid a la p 6.88 R. c. Paul, 2014 BCCA 81, 2014 CarswellBC 519.89 Ibid au para 26.
90 CANADIAN CRIMINAL LAW REVIEW [21 C.C.L.R.]
TABLEAU 1. FACTEURS HISTORIQUES ET SYSTEMIQUES
Facteurs historiques et systemiques Nombre de decisions(t = 635)
Pourcentage del’echantillon
Non mentionnes 215 33,86%
Consideres non applicables oumoins applicables
95 14,96%
Analyse insatisfaisante 196 30,87%
Analyse satisfaisante 127 20%
Impossible a determiner90 2 0,31%
C’est ainsi que les facteurs historiques et systemiques ne sont analyses demaniere satisfaisante que dans une decision sur cinq (20%)91. Ce chiffre diminuea 15% lorsqu’on analyse separement les decisions concernant les infractions deviolence conjugale et/ou familiale tel que reflete dans le tableau 2, ci-dessous.
TABLEAU 2. FACTEURS HISTORIQUES ET SYSTEMIQUES ETVIOLENCE CONJUGALE ET/OU FAMILIALE (VCF)
Facteurs historiques et systemiques(cas de VCF seulement)
Nombre de decisions(t = 126)
Pourcentage del’echantillon
Non mentionnes 34 26,98%
Consideres non applicables oumoins applicables
27 21,42%
Analyse insatisfaisante 45 35,71%
Analyse satisfaisante 19 15,08%
Impossible a determiner92 1 0,79%
Il ressort donc de ces statistiques que dans les cas de violence conjugale etfamiliale, les juges sont plus enclins a affirmer que les facteurs ne s’appliquent pasou moins93 (21,42% des cas comparativement a 14,96%). Dans plus de la moitiede ces cas, le juge exclut les facteurs (apres les avoir par ailleurs soupeses) pour
90 Decisions se penchant sur l’opportunite de renvoyer l’affaire a un cercle de sentence : iln’y a donc pas de decision sur le fond quant a la peine.
91 Voir par ex R. c. Shanoss, 2013 BCSC 2335, 2013 CarswellBC 3874; R. c. Benedict, 2014ONSC 6898, 2014 CarswellOnt 16759 (S.C.J.); R. c. Kawapit, 2013 QCCQ 5935, 2013CarswellQue 6159; R. c. Green, 2013 ONCJ 423, 2013 CarswellOnt 10710.
92 Ibid.93 Voir par exR. c.Donetz, 2013ABCA95, 2013CarswellAlta 315;R. c. Papin, 2013ABPC
46, 2013CarswellAlta 800;R. c. Long, 2014ONSC38, 2014CarswellOnt 900 (S.C.J.);R.c. Inuktalik, 2013 NWTSC 75, 2013 CarswellNWT 93.
IPEELEE ET LE DEVOIR DE RESISTANCE 91
des raisons liees a la gravite du crime ou a la protection du public94. De plus, lescas ou les facteurs sont analyses de maniere satisfaisante sont moins nombreuxque dans l’echantillon general.
(iii) Facteurs historiques et systemiques et principe de proportionnalite
Notons finalement que plus de la moitie des decisions ne font aucun lienentre le fait que l’accuse soit autochtone et le principe de proportionnalite ou nementionnent tout simplement pas ce principe95. En fait, seule une decision surcinq inclue reellement les facteurs historiques et systemiques dans l’analyse duprincipe de proportionnalite (135 decisions, 21,23%)96. Ce taux est relativementfaible si on considere qu’il s’agit du principe fondamental de la determination dela peine97.
De plus, la plupart des juges ne semblent pas saisir la nature de l’analyse aeffectuer lorsqu’il considere le principe de proportionnalite. Ils oublient parfoisque celui-ci comporte deux elements essentiels distincts: la gravite de l’infractionet le degre de responsabilite du contrevenant, ce dernier entretenant un lien etroitavec la culpabilite morale du condamne98. Les tribunaux ont parfois tendance aamalgamer la notion de gravite objective et celle du degre de responsabilite ouencore a privilegier carrement le premier element au detriment du second99.
94 17 sur 27. 16 cas pour la gravite et 3 pour la protection du public (2 decisionsmentionnaient la gravite et la protection du public comme raison). Voir par ex R. c. Q.(B.S.), 2013 BCPC 332, 2013 CarswellBC 3860;R. c. C. (J.A.V.), 2015 BCPC 218, 2015CarswellBC 2160; R. c. Gargan, 2014 NWTSC 62, 2014 CarswellNWT 69.
95 246 cas ne le mentionnent pas, 116 cas le mentionnentmais ne font pas de lien avec le faitque l’accuse est autochtone.
96 Voir par ex R. c. Edmonds, 2012 ABCA 340, 2012 CarswellAlta 1946; R. c. Knight, 2012MBPC 52, 2012 CarswellMan 348; R. c. Knockwood, 2012 ONSC 2238, 2012CarswellOnt 4286, 286 C.C.C. (3d) 36 (S.C.J.); R. c. Land, 2013 ONSC 6526, 2013CarswellOnt 14710 (S.C.J.); R. c. Bird, 2014 SKQB 75, 2014 CarswellSask 200, leave toappeal refused 2016 CarswellSask 378 (S.C.C.). Dans le reste des decisions, soit le lienentre les facteurs historiques et systemiques et le principe de proportionnalite est parfoismentionne mais n’est pas applique, soit le juge considere que vu les circonstances del’affaire, ce lien ne devrait pas etre fait, ou soit le juge considere que le principe deproportionnalite s’applique moins dans les circonstances.
97 R. c. Ipeelee, supra note 2 au para 37; R. c. Safarzadeh-Markhali, supra note 31 au para70.
98 R. c. Proulx, 2000 CSC 5, 2000 CarswellMan 33, [2000] 1 R.C.S. 61, 140 C.C.C. (3d) 449,30 R.R. (5th) 1 pars. 81-83 ;R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, 2015 CarswellQue 11715, [2015]3 R.C.S. 1089, 333 C.C.C. (3d) 450, 24 R.R. (7th) 225 au para 12 : « la severite de la peinene depend pas seulement de la gravite des consequences du crime, mais egalement de laculpabilite morale du delinquant. »
99 Deja en 2002, les professeurs Anne-Marie Boisvert et Andre Jodouin formulaient unetelle observation : « De l’intention a l’incurie : le declin de la culpabilite morale », 32R.G.D. 759. Voir aussi Marie-Eve Sylvestre, supra note 33. Il faut egalement admettreque laCour supreme semble parfois faire un amalgame similaire, et, ainsi, n’a pas envoyede directives constantes a ce sujet. Dans la recente decision R. c. Lacasse, ibid, le jugeWagner, au para 12, s’adresse au nom de la majorite en affirmant que « [p]lus le crime
92 CANADIAN CRIMINAL LAW REVIEW [21 C.C.L.R.]
Par exemple, dans R. c. Payou100, une affaire d’agression sexuelle, le jugeaffirme: « This was a very serious crime of violence. Mr. Payou’s conduct vis-a-vis this young aboriginal woman was despicable. His moral blameworthiness ishigh. His unique systemic or background circumstances as an aboriginal offenderbefore this Court cannot and does not diminish his moral culpability for thisserious crime of violence which is so prevalent in this jurisdiction. »
Ou encore dans l’affaire R. c. Paul101:
« Nor do I read Ipeelee as saying that the seriousness of the crimesbefore the court are not a proper consideration in a sentencing hearing.While Ipeelee says that factor does not create a shortcut to considera-
tion of aboriginal circumstances of an offender, it does not say that thegravity of the offence cannot be considered. Indeed s. 718.1 of theCriminal Code requires that a sentence be proportionate to the gravity
of the offence, and Justice LeBel refers to proportionality as the sinequa non of sentencing, ensuring that a sentence reflects the gravity ofthe offence. »102
Dans d’autres cas, les juges considerent le degre de responsabilite comme unecirconstance aggravante ne pouvant tout simplement pas concevoir comment nipourquoi l’application des facteurs historiques et systemiques pourrait servir adiminuer la culpabilite morale de l’accuse.
Par exemple, dans l’affaire Papin103, le juge affirme qu’aucun facteur nediminue la responsabilite morale de l’accusee104. Celle-ci avait pourtant eu unpasse « horrible »105, marque par la violence. Sa mere avait des problemes detoxicomanie, de violence et de criminalite. Appeles a intervenir, les services de
commis et ses consequences sont graves, ou plus le degre de responsabilite du delinquantest eleve, plus la peine sera lourde. » A cela, le jugeGascon, dissident, repond au para 129: « Mon collegue souligne que, suivant le principe de proportionnalite, plus le crimecommis et ses consequences sont graves, ou plus le degre de responsabilite du delinquantest eleve, plus la peine sera lourde (par. 12). Je nuancerais quelque peu ce propos. A monsens, le degre de responsabilite du delinquant ne decoule pas inevitablement et seulementde la gravite de l’infraction. En effet, la gravite de l’infraction et la culpabilite morale dudelinquant sont deux facteurs distincts, et le principe de la proportionnalite commandeun examen exhaustif de chacun de ces facteurs. » Le jugeGascon ajoute au para 131 qu’ «[a]insi, l’application du principe de proportionnalite peut creer une tension entre les deuxfacteurs, notamment lorsque la gravite de l’infraction milite fortement en faveur d’unepeine a un extreme de la gamme, tandis que la culpabilite morale du delinquant enquestion pointe dans l’autre direction. »
100 R. c. Payou, 2012 NWTSC 29, 2012 CarswellNWT 34.101 R. c. Paul, 2014 BCCA 81, 2014 CarswellBC 519.102 Ibid au para 34.103 R. c. Papin, 2013 ABPC 46, 2013 CarswellAlta 800.104 Ibid au para 195: « The psychiatric evidencemakes it clear that theOffender suffers from
no mental illness. Nor are there any other factors present which would diminish hermoral culpability. »
105 Ibid au para 206.
IPEELEE ET LE DEVOIR DE RESISTANCE 93
protection de la jeunesse l’avaient qualifiee de psychopathe en raison de soncomportement violent et abusif. La mere est decedee d’une surdose d’heroınealors que l’accusee avait 13 ans. Son pere a fait plusieurs sejours en prison. MmePapin a vecu dans un environnement extremement malsain106: temoin deplusieurs scenes de violence conjugale, elle a ete sujette a de la negligence et desabus physiques et sexuels alors qu’elle vivait dans la maison familiale107. A 5 ou 6ans, elle a ete agressee sexuellement par trois hommes lors d’une fete tenue a lamaison par ses parents108. Elle a vecu dans quelques familles d’accueil entre 6 et 8ans. A 10 ans, elle habitait dans un centre de traitement pour enfants victimesd’abus sexuels. Une evaluation psychologique effectuee lors de ses 11 ans revelaitqu’elle etait completement detachee de ses emotions. A 12 ans, apres avoir dejacommis plusieurs crimes, un psychiatre en etait venu a la conclusion que cetteenfant etait si blessee qu’il etait possible qu’aucun traitement ne fonctionne a sonendroit. A 13 ans, elle s’injectait de la drogue par intraveineuse et faisait unepremiere overdose. Elle a ensuite ete admise de nombreuses fois dans un centrede detention. Bien qu’aux dires du tribunal, « a significant number of Gladuefactors are directly applicable to the offender »109, le juge minimise l’impact deces facteurs sur la peine:
« Even though many significant Gladue factors are present in this case,
the actual impact that those factors will have on the ultimate sentence isslight. [. . .] there is ‘‘no automatic sentencing discount” for aboriginaloffenders particularly where the conduct of the offender was violent
and where protection of the public is paramount. [. . .] while Irecognized the hardships that the Offender has experienced as a resultof her Aboriginal background and her horrific upbringing, this has verylittle impact in the ultimate sentence which must be imposed in this
case. »110
Le juge met alors l’accent sur la dimension « gravite de l’infraction » tout enconsiderant le degre de responsabilite comme circonstance aggravante:
« In this case, I conclude that the gravity of the offence is at the highend of the spectrum. The stabbing resulted in three puncture wounds tothe chest of the victim and a significant loss of blood. It was only
through happenstance that the knife did not puncture any vital organsand that death or serious injury did not result. I also conclude that thedegree of responsibility of the offender is at the high end of the
spectrum. The psychiatric evidence makes it clear that the Offendersuffers from no mental illness. Nor are there any other factors presentwhich would diminish her moral culpability. »111
106 Ibid au para 22.107 Ibid.108 Ibid.109 Ibid au para 206.110 Ibid aux para 207-208.
94 CANADIAN CRIMINAL LAW REVIEW [21 C.C.L.R.]
Nous constatons donc que l’element « gravite » revient aussi frequemmentlorsque les jugements font une analyse satisfaisante des facteurs historiques etsystemiques que lorsque ceux-ci sont ecartes ou juges moins applicables.
Ceci etant dit, certaines decisions dont l’analyse a ete jugee satisfaisantemeritent d’etre soulignees. Elles font figure d’exception, mais pourraient tout dememe servir de modeles112. Par exemple, dans R. c. G. (D.)113, la Cour d’appelde Colombie-Britannique, la meme qui avait rendu jugement dans l’affaire Paul,a renverse la peine imposee en premiere instance en raison du fait que le juge depremiere instance n’avait pas pris en consideration la culpabilite morale del’appelant dans l’evaluation de son degre de culpabilite morale:
« The fundamental principle of sentencing is proportionality (s. 718.1),
which requires an assessment of the moral blameworthiness of theoffender. The historic and individual circumstances of an Aboriginaloffender are highly relevant to the assessment of moral blameworthi-
ness—an assessment that cried out to be performed in this case, but wasnot considered by the sentencing judge. »114
De facon similaire, dans R. c. Shanoss115, le juge souligne l’importance deprendre en consideration les facteurs historiques et systemiques dans l’analyse duprincipe de proportionnalite meme lorsque l’infraction est grave et l’accusedangereux. Dans cette affaire, le tribunal a declare l’accuse « delinquantdangereux » a la suite d’une agression sexuelle et lui a impose une sentence deprison a duree indeterminee:
111 Ibid au para 195.112 Les decisions suivantes sont a notre avis les plus interessantes de notre echantillon : R. c.
Tom, 2012 YKTC 55, 2012 CarswellYukon 65; R. c. G. (D.), 2014 BCCA 84, 2014CarswellBC531;R. c. Campbell, 2013MBPC19, 2013CarswellMan 136;R. c. G. (L.L.),2012 MBCA 106, 2012 CarswellMan 604, 292 C.C.C. (3d) 486; R. c. Knockwood, 2012ONSC 2238, 2012 CarswellOnt 4286, 286 C.C.C. (3d) 36 (S.C.J.); R. c. Kawapit, 2013QCCQ 5935, 2013 CarswellQue 6159; R. c. Cloud, 2014 QCCQ 464, 2014 CarswellQue742, 8R.R. (7th) 364, varied 2016QCCA567, 2016CarswellQue 8570, 28R.R. (7th) 310,reversed 2016 QCCA 567, 2016 CarswellQue 8570, 28 R.R. (7th) 310. A souligneregalement :R. c. Charlie, 2014YKTC17, 2014CarswellYukon 40, affirmed 2015YKCA3, 2015 CarswellYukon 6, 320 C.C.C. (3d) 479; R. c. Samson, 2014 YKTC 33, 2014CarswellYukon 59, affirmed 2015YKCA7, 2015CarswellYukon 18;R. c. Hansen, 2014BCSC625, 2014CarswellBC 1141;R. c. Joseph, 2013 BCPC199, 2013CarswellBC 2263;R. c.McCook, 2015 BCPC 1, 2015 CarswellBC 143;R. c. First Charger, 2013ABPC 193,2013 CarswellAlta 1436; R. c. Friday, 2012 ABQB 371, 2012 CarswellAlta 965; R. c. G.(T.), 2012 ABPC 251, 2012 CarswellAlta 1626; R. c. Gabriel, 2013 MBCA 45, 2013CarswellMan 249; R. c. Green, 2013 ONCJ 423, 2013 CarswellOnt 10710; R. c. Land,2013ONSC6526, 2013CarswellOnt 14710 (S.C.J.);R. c. Thorpe (July 3, 2012), ClementsJ., [2012] O.J. No. 6303 (S.C.J.); R. c. Snowboy, 2014 QCCQ 2420, 2014 CarswellQue3665; R. c. Benedict, 2014 ONSC 6898, 2014 CarswellOnt 16759 (S.C.J.).
113 R. c. G. (D.), 2014 BCCA 84, 2014 CarswellBC 531.114 Ibid au para 32. Voir aussi la conclusion du juge au para 39 : « The sentencing judge [. . .]
did not assess a proportional sentence in light of his moral blameworthiness. »115 R. c. Shanoss, 2013 BCSC 2335, 2013 CarswellBC 3874.
IPEELEE ET LE DEVOIR DE RESISTANCE 95
« In my view, it would be an error to limit the application of the Gladuefactors in a dangerous offender proceeding in order to prioritize
protection of the public as a sentencing objective. The uniquecircumstances of the Aboriginal offender must be given carefulconsideration in every sentencing. The fundamental principles of
sentencing in s. 718.1 and s. 718.2 apply with equal force to adangerous offender proceeding. The moral blameworthiness of theoffender is a fundamental consideration and the Aboriginal heritage of
an offender often has a direct and substantial impact on their moralculpability for the offence. A person who grows up in a culture ofalcohol and drug abuse is less blameworthy than a person who commits
a crime despite a positive childhood and upbringing. »116
Mis a part ces decisions prometteuses, mais exceptionnelles, nous sommesd’avis que les juges connaissent mal et/ou ne respectent pas les obligationsconstitutionnelles imposees dans l’arret Ipeelee et reproduisent de facon assezgeneralisee les memes erreurs de droit que celles specifiquement denoncees par lejuge LeBel. L’application du principe de proportionnalite et la consideration du «degre de responsabilite » semblent particulierement poser probleme. Nous yreviendrons lorsque nous discuterons des obstacles cognitifs et epistemologiques.Finalement, les juges demontrent une certaine incomprehension du contextecolonial, des traumatismes intergenerationnels decoulant de celui-ci et de leurimpact sur les problemes sociaux qui affligent les communautes, sur laquellenous nous pencherons aussi plus loin.
(c) La resistance au volet 2
Si l’on doit conclure que les juges de premiere instance resistent al’application du premier volet de l’analyse, que dire du second, sinon qu’il n’apratiquement pas retenu leur attention. Ce second volet constitue pourtant uneporte ouverte au pluralisme juridique et a la possibilite de penser la peineautrement, conformement aux enseignements d’Ipeelee. Or, on constate aussi unegrande resistance sur le plan empirique.
D’abord, le type de sanction impose ne semble pas avoir change. Comme ledemontre le tableau 3, dans 87,7% des cas, l’emprisonnement ferme est ordonne.En outre, dans plus de 60% des cas, des peines de longue duree (deux ans et plus)ont ete imposees, tel qu’illustre par le tableau 3.
116 Ibid au para 164. Voir aussi au para 183, ou le juge affirme qu’en l’espece, du a cesfacteurs, la culpabilite morale de l’accuse est amoindrie.
96 CANADIAN CRIMINAL LAW REVIEW [21 C.C.L.R.]
TABLEAU 3. PEINES.
Peine principale Nombre de decisions(t = 635)
Pourcentage de l’echan-tillon
Emprisonnement ferme. Moins de 2 ans. Deux ans et plus. Impossible a determiner117
5572183363
87,71%39,14%60,32%0,54%
Emprisonnement avec sursis 37 5,83%
Probation 18 2,83%
Amende 4 0,63%
Absolution 9 1,42%
Impossible a determiner118 10 1,57%
Notons aussi que les juges n’ont impose une peine d’emprisonnement apurger de facon discontinue que dans 17 cas119, soit moins de 3% des decisions,et qu’un nombre negligeable de decisions rapportent avoir impose une sanctionvisant a traiter les « causes sous-jacentes » de la conduite criminelle tel que lesuggerait le juge LeBel120.
117 Decisions d’appel ordonnant une peine d’emprisonnement ferme mais ne mentionnantpas la duree.
118 Cette categorie refere a des decisions pour lesquelles la peine n’est pas mentionnee ou ils’agit de decisions se penchant sur l’appel d’une designation de delinquant dangereux oud’une demande de renvoi a un cercle de sentence.
119 R. c. Simms, 2013 YKTC 60, 2013 CarswellYukon 60; R. c. P. (T.A.), 2013 ONSC 797,2013 CarswellOnt 2424 (S.C.J.), varied 2014 ONCA 141, 2014 CarswellOnt 2131, 307C.C.C. (3d) 506; R. c. Sowden, 2013 ONCJ 746, 2013 CarswellOnt 18652; R. c. Allen,2012 YKTC 36, 2012 CarswellYukon 47; R. c. Grandbois, 2013 ABPC 253, 2013CarswellAlta 1870; R. c. Hansen, 2014 BCSC 625, 2014 CarswellBC 1141; R. c. Auger,2013 ABPC 180, 2013 CarswellAlta 1164; R. c. Myette, 2013 ABCA 371, 2013CarswellAlta 2191; R. c. S. (R.R.G.), 2014 BCPC 170, 2014 CarswellBC 2269; R. c.Dustyhorn, 2014 ABPC 47, 2014 CarswellAlta 430; R. c. P. (T.A.), 2014 ONCA 141,2014 CarswellOnt 2131, 307 C.C.C. (3d) 506; R. c. Ambury, 2014 BCPC 344, 2014CarswellBC 4125;R. c. Daniels, 2014 SKPC 197, 2014 CarswellSask 715;R. c. Doxtator,2015 ONSC 4228, 2015 CarswellOnt 10051 (S.C.J.); R. c. B. (M.A.), 2014 ABPC 293,2014 CarswellAlta 2642; R. c. Mainville, 2015 ONSC 1931, 2015 CarswellOnt 4185(S.C.J.), leave to appeal refused 2015ONCA319, 2015CarswellOnt 6662;R. c. Schinkel,2014 YKTC 42, 2014 CarswellYukon 72, varied 2015 YKCA 2, 2015 CarswellYukon 3,320 C.C.C. (3d) 366; R. c. Schinkel, 2015 YKCA 2, 2015 CarswellYukon 3, 320 C.C.C.(3d) 366.
120 R. c. Ipeelee, supra note 2 au para 73. Voir par exemple : R. c. Sinclair, 2014 MBPC 13,2014 CarswellMan 134;R. c. Fleming, 2014 ONCJ 290, 2014 CarswellOnt 8292, 14 R.R.(7th) 187; R. c. Swanson, 2013 ONSC 3287, 2013 CarswellOnt 7623 (S.C.J.).
IPEELEE ET LE DEVOIR DE RESISTANCE 97
Dans les decisions sur la violence conjugale et/ou familiale, le pourcentagedes decisions ou l’emprisonnement est ordonne est legerement plus eleve,equivalant cette fois a 4,5 decisions sur 5, tel qu’illustre par le tableau 4.
TABLEAU 4. PEINES ET VIOLENCE CONJUGALE ET/OU FAMILIALE(VCF).
Peine principale(cas de VCF seulement)
Nombre de decisions(t = 126)
Pourcentage de l’echan-tillon
Emprisonnement ferme. Moins de 2 ans. Deux ans et plus. Impossible a determiner121
11349622
89,68%43,36%54,87%1,77%
Emprisonnement avec sursis 5 3,97%
Probation 5 3,97%
Absolution 2 1,59%
Impossible a determiner 1 0,79%
Ces statistiques renversantes demontrent bien que le principe de moderationprescrivant le recours aux sanctions substitutives dans l’article 718.2e) C.cr. nerecoit pas toute l’attention qu’il merite. Au contraire, l’emprisonnement sembleconstituer une peine de predilection lorsqu’il s’agit de personnes autochtones122.
Par contraste, le principe de moderation a ete mis de l’avant et applique defacon satisfaisante par les juges dans une decision sur cinq (130 decisions)123.
121 Decisions d’appel ordonnant une peine d’emprisonnement ferme mais ne mentionnantpas la duree.
122 Malgre le fait que ces peines ne soient pas representatives de l’ensemble des peinesimposees au Canada en raison de la petite taille de l’echantillon, notons que la peined’emprisonnement n’est pas la peine la plus imposee dans notre systeme de justice. Seuls36% des adultes juges dans les tribunaux de juridiction criminelle etaient condamnes aune peine d’emprisonnement en 2013-2014 et la duree mediane de cet emprisonnementetait de 30 jours. AshleyMaxwell, Statistiques sur les tribunaux de juridiction criminellepour adultes au Canada 2013-2014, Statistiques Canada, 2015 : <http://www.stat-can.gc.ca/pub/85-002-x/2015001/article/14226-fra.htm#a7>.
123 Voir par exR. c.Gambler, 2012SKPC60, 2012CarswellSask 264;R. c.Childforever, 2014ONSC 1067 (S.C.J.); R. c. Green, 2013 ONCJ 423, 2013 CarswellOnt 10710; R. c.Tororak, 2013 CarswellNfld 391 (Prov. Ct.); R. c. Colton, 2013 NWTSC 41, 2013CarswellNWT 47. Nous avons considere satisfaisantes les decisions dans lesquelles lejuge a mis de l’avant le principe de moderation de l’art. 718.2e) C.cr. et dans lesquelles ilest possible de comprendre pour le lecteur en quoi ce principe etait applique. Nousn’avons pas considere satisfaisantes les decisions dans lesquelles l’art. 718.2e) C.cr. etaitmentionne, mais sans que le juge fournisse d’explication quant a son application. Parmices decisions satisfaisantes, certaines sortent du lot au niveau de la creativite dont a faitpreuve le juge afin de donner une portee particuliere a ce principe, voir notamment :R. c.Prevost, 2015 BCPC 186, 2015 CarswellBC 1730; R. c. Simms, 2013 YKTC 60, 2013
98 CANADIAN CRIMINAL LAW REVIEW [21 C.C.L.R.]
Ensuite, nous ne comptons qu’une trentaine de decisions qui appliquent desprincipes de justice reparatrice124, et ce malgre l’accent mis par le juge LeBel surcet aspect.
Ensuite, la jurisprudence ne recele que peu d’ouverture a la culture et auxdivers systemes juridiques autochtones sur le plan de la procedure. Les decisionsen ce sens sont quasi inexistantes. Nous avons repere seulement sept decisionsdans lesquelles le juge tente d’adapter le type de sanction et la procedure al’heritage autochtone de l’accuse125. De ces sept decisions, nous en avons recensetrois dans lesquelles le juge fait appel a un cercle de sentence afin de prendre unedecision126 et une dans laquelle le juge refere le dossier de l’accuse a un cercle desentence afin que ce dernier prepare des recommandations127. Par contre, nousavons egalement identifie deux decisions dans lesquelles le juge a refuse lademande de l’accuse d’avoir acces a un cercle de sentence128. Finalement, dansune vingtaine de decisions, le juge exprime le souhait que l’accuse qui seraemprisonne ait acces a des programmes adaptes a la culture autochtone129.
Dans la jurisprudence, il n’y a donc que quelques cas isoles ou le tribunalincorpore des elements lies a l’heritage autochtone soit par le biais de certainesordonnances (probation, sursis) ou encore par le recours a des institutions,acteurs et processus autochtones, ou hybrides, c’est-a-dire constitues en partiepar les Autochtones, mais supervises par l’Etat canadien.
La decision R. c. Kawapit130 est un bon exemple. Dans cette affaire, M.Kawapit etait accuse de plusieurs infractions en lien avec la conduite
CarswellYukon 60; R. c. Knott, 2012 MBQB 105, 2012 CarswellMan 171; R. c. Cloud,2014 QCCQ 464, 2014 CarswellQue 742, 8 R.R. (7th) 364, varied 2016 QCCA 567, 2016CarswellQue 2745, 28R.R. (7th) 310, reversed 2016QCCA567, 2016CarswellQue 2745,28 R.R. (7th) 310.
124 Voir par exR. c. G. (D.), 2014 BCCA84, 2014CarswellBC 531;R. c. First Charger, 2013ABPC 193, 2013 CarswellAlta 1436; R. c. Gabriel, 2013 MBCA 45, 2013 CarswellMan249; R. c. Meechas, 2012 MBPC 53, 2012 CarswellMan 391; R. c. Clillie, 2013 NWTSC21, 2013 CarswellNWT 26;R. c. Thorpe (July 3, 2012), Clements J., [2012] O.J. No. 6303(S.C.J.).
125 R. c. Simms, 2013 YKTC 60, 2013 CarswellYukon 60; R. c. Tom, 2012 YKTC 55, 2012CarswellYukon 65; R. c. Kawapit, 2013 QCCQ 5935, 2013 CarswellQue 6159; R. c.McCook, 2015 BCPC 1, 2015 CarswellBC 143; R. c. McNabb, 2014 MBPC 10, 2014CarswellMan 94;R. c. Elliot, 2014 NSPC 110, 2014 CarswellNS 1011; R. c. Knight, 2012MBPC 52, 2012 CarswellMan 348.
126 R. c. Tom, 2012 YKTC 55, 2012 CarswellYukon 65; R. c. Kawapit, 2013 QCCQ 5935,2013 CarswellQue 6159; R. c. McNabb, 2014 MBPC 10, 2014 CarswellMan 94.
127 R. c. Elliot, 2014 NSPC 110, 2014 CarswellNS 1011.128 R. c. McDonald, 2012 SKQB 245, 2012 CarswellSask 579, varied 2013 SKCA 38, 2013
CarswellSask 210; R. c. K. (K.), 2015 NWTTC 16, 2015 CarswellNWT 59.129 Voir par exR. c. Friday, 2012ABQB 371, 2012 CarswellAlta 965;R. c. Cote, 2013 BCSC
2424, 2013 CarswellBC 3973, varied 2014 BCCA 475, 2014 CarswellBC 3951; R. c. S.(M.D.), 2014 BCPC 56, 2014 CarswellBC 921; R. c. Mathers, 2012 BCSC 1980, 2012CarswellBC 4138.
IPEELEE ET LE DEVOIR DE RESISTANCE 99
automobile131. Le comite de justice et de guerison de la communaute avait tenuun Cercle de sentence (« Cercle ») reunissant des membres du comite, l’accuse, safamille et la victime. A la suite de ce cercle, des recommandations ont ete emisessur la sentence qui devrait etre imposee a l’accuse. Le rapport mentionne que lecercle de sentence a contribue a retablir une connexion entre les individus affectespar la situation et a restaurer l’equilibre132. Il est egalement mentionne que lesparticipants au Cercle considerent que l’emprisonnement ne ferait qu’augmenterl’isolement de l’accuse et ne diminuerait pas les risques de recidive, puisque M.Kawapit n’aurait alors pas l’opportunite de travailler sur son estime personnelleni d’entamer un processus de guerison. Le rapport recommande plutot desmesures en ce sens. Chacune de ces mesures etait accompagnee d’annotationsexplicitant les raisons pour lesquelles la mesure etait pertinente pour l’accuse etrespectueuse de la vision crie de la justice. Par exemple, on suggere que l’accusepasse un certain temps dans la foret avec sa famille et un membre du comite dejustice afin de chasser et qu’a son retour, il prepare un repas traditionnel avec leproduit de la chasse133. Ultimement, le tribunal a impose une peine de probationde deux ans dont les conditions etaient exactement celles suggerees par le comitede justice134.
Cette decision fait figure d’exception dans la jurisprudence. Pourtant, au-dela des conclusions auxquelles arrive la juge dans cette affaire, il importe derevenir sur un certain nombre d’elements qui illustrent bien le degre de resistanceau pluralisme juridique qui est rencontre par les tribunaux. D’abord, nonsatisfaits du fait que la decision reponde aux prescriptions de l’article 718.2e)C.cr. et de la Cour supreme dans l’arret Ipeelee, la juge et le Comite de justiceinsistent tous les deux pour dire que les recommandations emises par le Cerclesont non seulement satisfaisantes pour les participants et la communaute, maisqu’elles sont egalement conformes aux objectifs et principes de determination dela peine, et en particulier aux objectifs de denonciation et de dissuasion135. Deplus, la juge tient a preciser qu’elle n’est pas liee par ces recommandations136 et
130 R. c. Kawapit, 2013 QCCQ 5935, 2013 CarswellQue 6159.131 Fuite causant des lesions corporelles, art. 249.1(3)(4)a) C.cr; conduite avec capacites
affaiblies causant des lesions corporelles, art. 255(2) C.cr. et deux chefs de conduite aveccapacites affaiblies, art 253(1)(a) et 255(1) C.cr.
132 Supra note 130 au para 26.133 Ibid.134 Ibid aux paras 26 et 99. Cette probation de deux ans a ete imposee sur le chef de « fuite
causant des lesions corporelles », les trois autres chefs d’accusation contenant une peineminimale obligatoire, la juge a ordonne la peine minimale sur chaque chef (1000$d’amende).
135 R. c. Kawapit, supra note 130 au para 26.136 Voir aussi R. c. Elliot, 2014 NSPC 110, 2014 CarswellNS 1011 par. 64: « Under all of
these circumstances, for the reasons stated, I am prepared to refer the matter to asentencing circle on all charges. It is self-evident that the recommendations, oncereceived, are not binding upon the Court. »
100 CANADIAN CRIMINAL LAW REVIEW [21 C.C.L.R.]
que bien qu’elle les accepte, elle ne fait pas pour autant preuve d’indulgenceenvers l’accuse. Elle rappelle qu’ «une peine axee sur l’approche corrective n’estpas necessairement un chatiment moins severe »137.
Ainsi, il nous semble clair qu’en affirmant la superiorite des principes etobjectifs de determination de la peine du Code criminel ainsi que le fait qu’il n’estpas lie par les recommandations, le tribunal maintient la subordination du droitautochtone au droit etatique. Par contre, la juge fait aussi de l’incorporationnormative en integrant des objectifs (reparation, guerison, equilibre) et desprincipes juridiques cris dans l’ordonnance de probation, ce qui tend areconnaıtre en partie l’existence et la legitimite des systemes de droitautochtone. Pour sa part, le Comite de justice a ete en mesure de mettre surpied un processus conforme au droit cri tout en tentant de le justifier dans lecadre normatif etatique. Il y a donc la une ouverture afin de reconnaıtre lacoexistence de differentes conceptions de la justice dans un etat pluriel.
(d) La resistance en appel
Les cours d’appel ont une responsabilite directe sur la reception et letraitement de l’article 718.2e) C.cr. Rappelons qu’il y a 130 decisions d’appeldans notre banque. Parmi celles-ci, nous avons repere 16 cas ou l’appel a ete logepar le poursuivant parce que celui-ci considerait que le juge de premiere instanceavait trop pris en consideration les principes de determination de la peine lies auxcontrevenants autochtones. Dans 7 cas sur 16 (43,75%), les cours d’appel ontdonne raison au poursuivant et renverse la decision de premiere instance enconsiderant qu’il y avait eu une trop grande prise en consideration desfacteurs138, alors que dans 9 cas sur 16 (56,25%), la Cour d’appel a confirmela decision de premiere instance (et donc maintenu la prise en consideration)139.
Par contraste, nous avons recense 97 decisions ou l’appel a ete loge par ladefense qui considerait que le juge de premiere instance n’avait pas prissuffisamment en consideration les principes. Or, les cours d’appel ont maintenula decision de premiere instance et considere que les principes avaient etesuffisamment consideres dans 78,35% des cas (soit 76 decisions)140, alors qu’ellesont renverse la decision de premiere instance et considere que les principes
137 Ibid au para 92, citant R. c. Gladue, supra note 26 au para 72.138 Voir par ex R. c. Crazyboy, 2012 ABCA 228, 2012 CarswellAlta 1269, 288 C.C.C. (3d)
459; R. c. Popowich, 2013 ABCA 149, 2013 CarswellAlta 450; R. c. Bauer, 2013 ONCA691, 2013 CarswellOnt 15520.
139 Voir par ex R. c. Awashish, 2012 QCCA 1430, 2012 CarswellQue 8133; R. c. Mikkigak,2014 NUCJ 24, 2014 CarswellNun 18; R. c. Chambers, 2014 YKCA 13, 2014CarswellYukon 85, 316 C.C.C. (3d) 44.
140 Voir par exR. c. Campbell, 2014BCCA235, 2014CarswellBC 2160;R. c. Ahnassay, 2015ABCA 134, 2015 CarswellAlta 640; R. c. Bigsorrelhorse, 2012 ABCA 327, 2012CarswellAlta 1929; R. c. Brookwell, 2012 ABCA 226, 2012 CarswellAlta 1241; R. c.Onnignak, 2013 QCCS 6937, 2013 CarswellQue 14401; R. c. Pepin, 2013 ONCA 168,2013 CarswellOnt 2969; R. c. Harp, 2015 ONCA 589, 2015 CarswellOnt 13112; R. c.Osborne, 2014 MBCA 73, 2014 CarswellMan 343, 314 C.C.C. (3d) 57.
IPEELEE ET LE DEVOIR DE RESISTANCE 101
n’avaient pas ete suffisamment consideres dans seulement 21,65% des cas (21)141.Ces resultats soulevent certaines interrogations. En effet, tant le poursuivant
que la defense sont soumis aux memes criteres d’autorisation lorsqu’ils font appelde la sentence, sauf en ce qui concerne les delinquants dangereux et acontroler142. De plus, les cours d’appel doivent faire preuve d’une granderetenue ne pouvant modifier la peine imposee en premiere instance que lorsquecelle-ci est « manifestement non indiquee »143. Or, il semble que les cours d’appelsoient plus susceptibles d’intervenir (et donc d’aller a l’encontre du principe deretenue judiciaire) lorsque l’appel est loge par le poursuivant et que celui-ci estd’avis que les juges de premiere instance ont trop considere l’application desprincipes developpes dans Gladue et Ipeelee.
Considerant le traitement frileux que reservent les juges de premiere instanceaux deux volets de l’analyse Ipeelee, cette reaction conservatrice des coursd’appel nous interpelle particulierement. Ces tribunaux devraient plutot faire lerelais de l’application du droit et soutenir l’innovation proposee dans Ipeelee.Leur hesitation a le faire, dans certaines provinces en particulier144, ont desconsequences systemiques fort importantes, notamment sur la definition du «corridor » ou de la « fourchette » dans le contexte de laquelle les peines doivent setrouver. En outre, le message ainsi envoye par certaines cours d’appel peut avoirune influence sur les juges de premiere instance qui, sur une base individuelle, sevoient confrontes a la possibilite que leurs decisions soient portees en appel etrevisees145.
141 Voir par ex R. c. Cochrane, 2013 BCCA 93, 2013 CarswellBC 1430; R. c. Lagimodiere,2013 BCCA 174, 2013 CarswellBC 1017; R. c. Courtorielle, 2013 ABCA 317, 2013CarswellAlta 1767; R. c. Gabriel, 2013 MBCA 45, 2013 CarswellMan 249; R. c.Nowegejick, 2012 ONSC 3463, 2012 CarswellOnt 7546 (S.C.J.); R. c. Alasuaq, 2012QCCA 1999, 2012 CarswellQue 11849; R. c. Pop, 2013 BCCA 160, 2013 CarswellBC1668; R. c. Gouda, 2013 ABQB 121, 2013 CarswellAlta 221.
142 Les articles 675(1)b) et 676(1)d) C.cr. enoncent respectivement les droits d’appel del’accuse et du poursuivant en matiere d’actes criminels. En matiere sommaire, ces droitssont enonces a l’art. 813 C.cr. En ce qui concerne les delinquants dangereux et acontroler, l’art. 759(1) C.cr. prevoit que l’individu declare delinquant dangereux ou acontroler peut interjeter appel de cette declaration sur toute question de droit ou de faitou tout question mixte de droit et de fait. Le procureur general, quant-a-lui, peutseulement interjeter appel de plein droit sur une question de droit, tel que prevu par l’art.759(2) C.cr. Parmi les 98 decisions portees en appel par la defense, 14 sont des appelsinterjetes par l’accuse de sa declaration de delinquants dangereux ou a controler. 12 deces appels ont ete rejetes.
143 R. c. Lacasse, supra note 98 au para 51; R. c. M. (L.), 2008 CSC 31, 2008 CarswellQue4418, (sub nom.R. v. L.M.) [2008] 2 R.C.S. 163, (sub nom.R. v.M. (L.)) 231 C.C.C. (3d)310, 56 R.R. (6th) 278 (S.C.C.) au para 14.
144 Il existe une certaine disparite regionale, telle que l’avait identifiee Kent Roach en 2009,supra note 23 a la p 498.
145 Andre Jodouin et Marie-Eve Sylvestre, Changer les lois, les idees, les pratiques :reflexions sur l’echec de la reforme de la determination de la peine, (2009) 50 Cahiers dedroit 519, a la p. 564
102 CANADIAN CRIMINAL LAW REVIEW [21 C.C.L.R.]
3. LES OBSTACLES A L’INNOVATION
L’analyse presentee dans la section precedente demontre que la resistanceproposee par la Cour supreme dans l’affaire Ipeelee a la surrepresentation desautochtones dans le systeme de justice penale et a l’hegemonie etatique est elle-meme largement sujette a de la resistance par les juges de premiere instance et lescours d’appel. Ceux-ci semblent etre generalement fermes a une veritablereconnaissance de l’alterite juridique et avoir de la difficulte a penser la peineautrement dans le contexte des contrevenants autochtones. Nous avons cherche amieux comprendre les raisons de cette resistance a l’innovation. Nous avonsidentifie trois grandes categories d’obstacles, soit des obstacles legislatifs, desobstacles pratiques et systemiques, et des obstacles cognitifs et epistemologiques.
(a) Les obstacles legislatifs
Soulignons d’entree de jeu l’importance des obstacles legislatifs qui envoientdes messages contradictoires aux juges. En effet, pour un jugement Ipeelee et unarticle 718.2e), on trouve une serie d’autres jugements et de dispositionslegislatives faisant la promotion de la responsabilite individuelle et de la necessitede denoncer et de dissuader le crime. Il en est ainsi particulierement de l’ajout depeines minimales obligatoires en lien avec plusieurs infractions, des modificationsa la suramende compensatoire et a l’emprisonnement avec sursis qui ont eu unimpact direct sur le pouvoir discretionnaire des juges et leur capacite d’innover. Ilest aussi utile de mentionner que l’article 718.2e) C.cr. a ete modifie par legouvernement conservateur a la suite de l’arret Ipeelee146.
(b) Les obstacles pratiques et systemiques
Par obstacle pratique et systemique, nous entendons regrouper toutes lesjustifications liees au manque de ressources, aux pratiques des acteurs et auxdifficultes concretes rencontrees par les juges sur le terrain alors qu’ils tentent demettre en oeuvre les principes enonces dans Ipeelee. Ce type d’obstacles revientconstamment dans la jurisprudence et prend une importance considerable auxyeux des acteurs judiciaires.
Les premieres contraintes evoquees sont celles liees a l’existence, lapreparation et la qualite des rapports Gladue. D’entree de jeu, mentionnonsque 15 ans apres l’arret Gladue, seulement une decision sur trois mentionne qu’unrapport Gladue a ete prepare dans le contexte de la determination de la peined’une personne autochtone, tel qu’illustre par le tableau 5:
146 Loi sur la Charte des droits des victimes, LC 2015, c 13, art 24. Cette modification estentree en vigueur le 22 juillet 2015.
IPEELEE ET LE DEVOIR DE RESISTANCE 103
TABLEAU 5. RAPPORTS GLADUE
Presence d’un rapport Gladue Nombre de decisions(t = 635)
Pourcentage
Pas de mention d’un rapportGladue
409 64,41%
Mention d’un rapport Gladue 226 35,59%
Impossible a determiner147 2 0,31%
Il faut dire que la situation differe considerablement selon les provinces et lesterritoires concernes148. Ainsi, les juges de la Saskatchewan et des Territoires duNord-Ouest n’ont mentionne avoir beneficie d’un rapport Gladue que dans 5 et6% des cas, respectivement, alors que les juges en Colombie-Britannique et auYukon en ont fait etat dans la moitie des decisions analysees, les juges del’Ontario dans pres de 60% des cas et les juges de la Nouvelle-Ecosse dans 80%des cas. Au Quebec, un peu plus du quart des decisions analysees mentionnent lapresence d’un rapport Gladue. Or, meme dans les provinces ou les juges ontbeneficie d’un rapport Gladue de facon plus importante, il subsiste une grandeincertitude quant a ceux-ci comme en temoigne le Conseil des premieres nationsdu Yukon : « At present, there is a high level of uncertainty around the provisionof Gladue Reports for Yukon Courts despite the fact that it is an Aboriginalpersons legal right to have Gladue information provided to the court and ademonstrated demand for Gladue Reports. »149 Un constat similaire a egalementete etabli en Colombie-Britannique150. Finalement, soulignons qu’aucun rapportGladue n’a ete produit au Nouveau-Brunswick et au Nunavut. Par contre,notons que les tribunaux du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest seconsiderent en quelque sorte comme des tribunaux specialises oeuvrantmajoritairement, voire exclusivement aupres des personnes autochtones etqu’ils possedent une connaissance generale plus poussee des communautesvisees. Ces tribunaux ont egalement mis sur pied differentes pratiques permettantd’incorporer des elements du droit autochtone: par exemple, nous savons que
147 Decisions d’appel tres courtes dans lesquelles la presence d’un rapport Gladue n’est pasmentionnee.
148 Voici les statistiques detaillees par province et territoire, presence de rapport Gladue :Quebec : 7 decisions sur 25 (28%); Ontario : 60 sur 105 (57,14%); Manitoba : 27 sur 68(39,7%); Saskatchewan : 5 sur 94 (5,32%); Alberta : 23 sur 72 (31,94%); Colombie-Britannique : 64 sur 131 (48,85%); Yukon : 26 sur 51 (50,98%); TNO : 3 sur 49 (6,12%);Nunavut : 0 sur 21; N-E : 8 sur 10 (80%); N-B : 0 sur 2; Terre-Neuve : 1 sur 7 (14,29%);IPE : aucune decision recensee
149 Yukon Gladue: research & resource identification project, Council of Yukon FirstNations, 2015 a la p 8.
150 Sebastien April et MyleneMagrinelli Orsi, Les pratiques provinciales et territoriales lieesa l’arret Gladue, supra note 20 a la p 9.
104 CANADIAN CRIMINAL LAW REVIEW [21 C.C.L.R.]
certaines cours de justice siegent en presence d’aınes et que ceux-ci participent auprononce de la peine.
Certains juges se plaignent ouvertement de la difficulte d’obtenir un rapportGladue. Le juge Monnin de la Cour d’appel du Manitoba decrit ainsi lafrustration vecue par plusieurs: « There is presently in this province either aconcerning disregard or a systemic impossibility to provide what is required forjudges to comply with the dictates of the Supreme Court. »151 D’autres juges sequestionnent plutot sur la qualite et l’objectivite des rapports152. Alors quecertains juges ne font que souligner le probleme153, d’autres entament parfoiseux-memes des demarches afin qu’un rapport digne de ce nom soit prepare154 oureduisent tout simplement la sentence155.
L’affaire Knockwood156 en constitue un excellent exemple. Dans cetteaffaire, l’accusee a plaide coupable le 10 aout 2011 a une accusationd’importation de cocaıne et le Tribunal a demande la preparation d’unrapport Gladue. Bien qu’un delai de six a huit semaines soit habituellementoctroye pour la preparation d’un rapport pre-sentenciel ordinaire, le juge a
151 R. c.G. (L.L.), 2012MBCA106, 2012CarswellMan604, 292C.C.C. (3d) 486 aupara 35.152 Voir par ex R. c. Stewart, 2012 YKSC 75, 2012 CarswellYukon 139.; R. c. B. (D.K.D.),
2013 BCSC 2321, 2013 CarswellBC 3884; R. c. L. (D.R.M.), 2012 BCPC 184, 2012CarswellBC 2215; R. c. Florence, 2013 BCSC 194, 2013 CarswellBC 298, affirmed 2015BCCA 414, 2015 CarswellBC 2822; R. c. L. (K.L.), 2012 BCPC 273, 2012 CarswellBC2430; R. c. Lawson, 2012 BCCA 508, 2012 CarswellBC 3956, 294 C.C.C. (3d) 369; R. c.Lewis, 2014 BCPC 93, 2014 CarswellBC 1386; R. c. McCook, 2015 BCPC 1, 2015CarswellBC 143; R. c. Paul, 2014 BCCA 81, 2014 CarswellBC 519; R. c. Corbiere, 2012ONSC 2405, 2012 CarswellOnt 5931 (S.C.J.); R. c. Long, 2014 ONSC 38, 2014CarswellOnt 900 (S.C.J.); R. c. Knockwood, 2012 ONSC 2238, 2012 CarswellOnt 4286,286 C.C.C. (3d) 36 (S.C.J.); R. c. Land, 2013 ONSC 6526, 2013 CarswellOnt 14710(S.C.J.); R. c. Raymond, 2014 ONCS 6845, 2014 CarswellOnt 17173(S.C.J.); R. c.Stoneham (November 29, 2012), Doc. 11-1254, [2012] O.J. No. 6447 (C.J.); R. c.Weizineau, 2014 QCCQ 8283, 2014 CarswellQue 9228; R. c. Gruben, 2013 NWTSC 59,2013 CarswellNWT 72.
153 Voir par exR. c. D. (M.), 2014 NLTD(G) 101, 2014 CarswellNfld 267 et R. c. Kanayok,2014NWTSC75, 2014CarswellNWT90.Voir aussiR. c. B. (D.K.D.), 2013BCSC2321,2013CarswellBC 3884 ;R. c. L. (D.R.M.), 2012 BCPC184, 2012CarswellBC 2215;R. c.Florence, 2013 BCSC 194, 2013 CarswellBC 298, affirmed 2015 BCCA 414, 2015CarswellBC2822;R. c.Lawson, 2012BCCA508, 2012CarswellBC3956, 294C.C.C. (3d)369 ;R. c. Lewis, 2014 BCPC93, 2014CarswellBC 1386 ;R. c. Paul, 2014 BCCA81, 2014CarswellBC 519; R. c. Gruben, 2013 NWTSC 59, 2013 CarswellNWT 72.
154 Par ex R. c. Karau, 2014 ONCJ 207, 2014 CarswellOnt 5601; R. c. Derion, 2013 BCPC382, 2013 CarswellBC 4091; R. c. Corbiere, 2012 ONSC 2405, 2012 CarswellOnt 5931(S.C.J.) ; R. c. Long, 2014 ONSC 38, 2014 CarswellOnt 900 (S.C.J.); R. c. Knockwood,2012 ONSC 2238, 2012 CarswellOnt 4286, 286 C.C.C. (3d) 36 (S.C.J.); R. c. Land, 2013ONSC 6526, 2013 CarswellOnt 14710 (S.C.J.).
155 Par ex R. c. Stoneham (November 29, 2012), Doc. 11-1254, [2012] O.J. No. 6447; R. c.Knockwood, 2012ONSC 2238, 2012 CarswellOnt 4286, 286 C.C.C. (3d) 36 (S.C.J.); R. c.G. (L.L.), 2012 MBCA 106, 2012 CarswellMan 604, 292 C.C.C. (3d) 486.
156 R. c. Knockwood, 2012ONSC 2238, 2012 CarswellOnt 4286, 286 C.C.C. (3d) 36 (S.C.J.).
IPEELEE ET LE DEVOIR DE RESISTANCE 105
octroye 12 semaines aux services concernes afin qu’ils puissent preparer unrapport Gladue adequat157. Les procureurs de la poursuite et de la defenseayant par la suite recu l’information que la province de Quebec n’etait pasoutillee pour preparer des rapports Gladue, ils ont accepte, d’un communaccord, qu’un rapport pre-sentenciel avec une « composante Gladue » soitprepare158. Le 25 octobre 2011, le Tribunal a finalement recu un « rapport pre-sentenciel » du Ministere de la Securite publique du Quebec. Le rapport dequatre pages et demi etait entierement redige en francais, bien que l’accusee,anglophone, ne maıtrisait pas cette langue. Le Tribunal a demande a ce que lerapport soit traduit, ce qui a ete fait le 9 novembre 2011. Cette journee-meme,l’avocat de la defense a demande un ajournement : l’accusee sentait quel’auteur du rapport avait ete presse, qu’elle etait punie pour son insistance avouloir obtenir un rapport Gladue, et que le rapport fourni ne contenait pasreellement de « composante Gladue », ce que le Tribunal a par ailleursreconnu159. Inquiete de ne pas etre traitee equitablement, l’accusee a demandede l’aide a un conseiller parajudiciaire qui l’a informee que la seule maniered’obtenir un rapport adequat etait qu’elle paie elle-meme quelqu’un pour lepreparer. Finalement, le ministere de la securite communautaire et des servicescorrectionnels ontarien a conclu une entente avec un organisme de servicesjuridiques pour autochtones de Toronto afin que ces derniers preparent lerapport Gladue pour l’accusee. Le rapport a ete depose le 6 mars 2012, soit 7mois apres le plaidoyer de Mme Knockwood.
Visiblement indigne de cette situation160, le juge Hill de la Cour superieure del’Ontario presidant a l’audition sur la peine — qui a finalement eu lieu le 10 avril2012 — n’a pas hesite a accuser l’Etat quebecois d’inconduite161. Il mentionneque bien qu’il puisse exister des disparites entre les differentes regions du pays auniveau du quantum des peines, l’article 718.2e) C.cr. et les principes emanant del’arret Gladue sont applicables partout au Canada162. Le juge Hill a reduit lapeine de l’accusee de huit ans a six ans de penitencier allant a l’encontre de lasuggestion commune des parties en raison des facteurs historiques et systemiquesayant eu un fort impact sur sa culpabilite morale, mais aussi et surtout en raisonde la negligence de l’Etat.
Par ailleurs, il y a lieu de se questionner sur le contenu des rapports Gladuequi sont produits. D’abord, soulignons a l’instar d’autres auteurs, qu’il estprimordial de preparer des rapports Gladue avec de veritables composantes
157 Ibid au para 7.158 Ibid au para 8.159 Ibid au para 70.160 R. c. Knockwood, 2012 ONSC 2238, 2012 CarswellOnt 4286, 286 C.C.C. (3d) 36 (S.C.J.)
par. 71 : « The outrageousness of this story is self-evident. A shameful wrong. Contemptfor the rights of Aboriginal Canadians. A denial of equality. »
161 Ibid au para 57.162 Ibid au para 56.
106 CANADIAN CRIMINAL LAW REVIEW [21 C.C.L.R.]
Gladue plutot que des rapports presentenciels ordinaires163. En effet, les rapportspresentenciels repondent souvent a des imperatifs specifiques de securitepublique et d’evaluation des risques poses par les contrevenants164. Cettelogique cadre mal avec celle qui doit prevaloir dans le cas de l’analyse desfacteurs historiques et systemiques et ne tient pas compte de la necessite de penserdifferemment la determination de la peine165. Finalement, alors que les rapportsGladue contiennent generalement des elements d’information concernant lesfacteurs historiques et systemiques, on constate qu’il y a tres peu d’informationsur les procedures et le type de sanctions appropries a l’heritage autochtone
Le manque de ressources est d’ailleurs egalement souleve comme un obstaclea l’imposition de sentences traitant les causes sous-jacentes de la conduitecriminelle et l’offre de sentences alternatives dans la communaute. Il est parfoisplus difficile pour les juges d’obtenir des informations concernant lescommunautes autochtones, leurs systemes de droit et les ressources disponiblesau sein de celles-ci que d’obtenir des informations sur l’impact negatif de lacolonisation, ce qui n’est pas peu dire166. C’est ainsi que le Conseil des premieresnations du Yukon est d’avis que : « The lack of resources to support offenders,particularly in communities outside Whitehorse, is perhaps one of the biggestchallenges facing the Yukon justice system»167, une conclusion confirmee par leVerificateur general du Canada168. Dans certains cas, les juges vont jusqu’a s’en
163 Selon Hadley Friedland, les rapports Gladue, dans leur forme actuelle, se concentrentpresqu’exclusivement sur les facteurs historiques et systemiques. Selon l’auteure, bienque la reconnaissance de ces derniers soit un objectif valide, les rapports Gladuen’accordent presentement aucune attention a l’autre objectif principal de l’arret Gladuequi est d’utiliser les traditions juridiques autochtones : « The imperative of a Gladueanalysis has largely been reduced, unquestioningly to ‘‘GladueReports”,which still focusprimarily on social context evidence, such as common historical experiences and socialdisadvantages, or even simply adding ‘‘Gladue factors”, upon request, to standard pre-sentencing reports, and is rife with practical problems of the costs, skills and time tocomplete them. It is arguable that a Cree justice process that applies Cree legal principlesto sentencing cases would more effectively and efficiently fulfill the intent behind theGladue imperative. » Indigenous Law Research Unit (Faculty of Law, University ofVictoria), Aseniwuche Winewak Justice Project Report: Creating a Cree Justice ProcessusingCree Legal Principles, parHadley Friedland, coordonnatrice de recherche, octobre2015 a la p 32.
164 Voir Nate Jackson, supra note 83 a la p 90.165 Kelly Hannah-Moffat et Paula Maurutto, supra note 41 a la p 264.166 AlanaKlein, supra note 24 aux pp 514 et suivantes, referant notamment aR. c. Amitook,
2006 QCCQ 2705, 2006 CarswellQue 3067; R. c. Diamond, 2006 QCCQ 2252, 2006CarswellQue 2535 etR. c. Pepabano, 2005CarswellQue 11839, reversed 2006QCCA536,2006 CarswellQue 3571.
167 Council of Yukon First Nations, supra note 149 a la p 48.168 Canada, Bureau du verificateur general du Canada, Rapport du verificateur general du
Canada a l’Assemblee legislative du Yukon— 2015 : Les services correctionnels au Yukon—Ministere de la Justice, Ottawa, Travaux publics et Services gouvernementaux, 2015 ala p 18.
IPEELEE ET LE DEVOIR DE RESISTANCE 107
remettre aux etablissements correctionnels pour offrir des services, alors qu’il vade soi qu’il ne s’agit pas la de leur mission principale et que ceux-ci sontegalement sous-finances a ce chapitre.169
D’autres contraintes pratiques viennent freiner les tentatives d’innovation.C’est le cas du volume de dossiers traites. Le Barreau du Quebec rapportaitrecemment que dans la communaute de Salluit dans le Nord-du-Quebec, 2 249dossiers en matiere criminelle ont ete ouverts entre 2003 et 2013. »170 Or, en 2013,cette communaute comptait 1 380 personnes171. Dans la meme veine, l’instabilitedes comites de justice au Nunavik est problematique : le maigre financementpour le fonctionnement de ces comites est un obstacle a l’embauche de personnelpermanent172. A notre avis, l’important volume de dossiers dans cescommunautes milite en faveur de l’adoption de programmes de mesures derechange developpes par les communautes.
Finalement, l’accueil mitige aux principes enonces dans Ipeelee peut aussietre le reflet de la compartimentation et confusion des roles au sein du systeme dejustice173, ainsi que de la deresponsabilisation des acteurs qui en decoule174.Certains juges semblent considerer que si les avocats ne leur ont pas fourni lesrenseignements necessaires, ils n’ont pas a faire de demarches en ce sens175, alors
169 R. c. Sikyea, 2013NWTSC13, 2013CarswellNWT14 par. 27, affirmed 2015NWTCA6,2015 CarswellNWT 39. Voir aussi Jonathan Rudin, « Commentary on R. v. Gladue »,Commentaire (1999), en ligne : <http://web.net/alst/Gladcom.htm> qui mentionnaitdeja en 1999 que les tribunaux auraient besoin de ressources afin de mieux connaıtre lespossibilites de sanctions non carcerales.
170 Rapport sur les missions du Barreau du Quebec aupres des communautes autochtones duGrand Nord quebecois, Barreau du Quebec, 2015 a la p 6.
171 Ibid.172 Presentement au Nunavik, le financement est de 382 900$ pour le fonctionnement de 10
comites de justice. Cela signifie que chaque comite de justice doit, avec 38 290$, louer unlocal et payer les tarifs substantiels d’Internet dans le Grand Nord en plus de payer unsalaire aux membres du comite de justice. Cette situation a amene Lyne St-Louis,responsable en matiere de justice a la societe Makivik, a emettre ce constat : «Coordinators are on contract basis temporary employees with no benefits. Theprecarious status offered is demotivating for few, and we always risk losing staff. » LyneSt-Louis, Nunavik Community Justice Program, 2015 [non publie] a la p 6.
173 Sebastien April et MyleneMagrinelli Orsi, Les pratiques provinciales et territoriales lieesa l’arret Gladue, supra note 20 a la p 10.
174 Soulignons que nous reconnaissons que le manque de ressources n’affecte pas seulementles juges, mais egalement les avocats de la poursuite et de la defense qui se voient souventcontraints dans l’accomplissement de leurs obligations.
175 Voir par exR. c. Smarch, 2013 YKTC 85, 2013 CarswellYukon 130;R. c. Beaulieu, 2015BCSC 354, 2015 CarswellBC 578; R. c. G. (D.T.), 2013 BCPC 156, 2013 CarswellBC1887; R. c. Isbister, 2014 BCPC 324, 2014 CarswellBC 4046; R. c. R. (J.), 2012 BCPC240, 2012 CarswellBC 2190;R. c. L. (K.L.), 2012 BCPC 273, 2012 CarswellBC 2430 ; R.c. McKay, 2012 BCCA 477, 2012 CarswellBC 3913; R. c. McPherson, 2013 BCPC 250,2013 CarswellBC 2901;R. c.White, 2013 BCCA 44, 2013 CarswellBC 262; R. c. Naistus,2014 SKQB 333, 2014 CarswellSask 691; R. c. Choken, 2012 MBPC 44, 2012CarswellMan 425; R. c. Harry, 2013 MBCA 108, 2013 CarswellMan 715, 309 C.C.C.
108 CANADIAN CRIMINAL LAW REVIEW [21 C.C.L.R.]
que d’autres considerent qu’il incombe autant a l’avocat de la poursuite et al’avocat de la defense qu’aux juges de s’assurer qu’il y ait suffisammentd’informations sur les circonstances particulieres de l’accuse176. Ainsi, ces jugesconsiderent de leur devoir d’appliquer les principes de determination de la peineappropries et prendront tous les moyens necessaires pour ce faire177. A l’inverse,certains juges sont d’avis que la responsabilite repose avant tout sur les epaulesdu poursuivant178 alors que d’autres se tournent vers la defense179. De nombreuxjuges expriment d’ailleurs explicitement un certain degre d’exasperation enversles avocats qui ne soumettent pas a leur avis suffisamment de preuve concernantces principes, et souhaiteraient que ceux-ci fassent preuve de plus de creativite acet egard180.
(3d) 76; R. c. Kennedy, 2012 MBPC 60, 2012 CarswellMan 584; R. c. Boyd, 2015 ONCJ120, 2015CarswellOnt 2971;R. c. D. (M.), 2014NLTD(G) 101, 2014CarswellNfld 267;R. c. Kanayok, 2014 NWTSC 75, 2014 CarswellNWT 90.
176 Voir par exR. c. Tom, 2012 YKTC 55, 2012 CarswellYukon 65 au para 76: « [T]he onusof ensuring sufficient information about an aboriginal individual’s particular circum-stances rests on all of us, Crown, defence, and the sentencing judge. In the absence of atrue Gladue Report, it is critical that pre-sentence reports contain some details about anoffender’s aboriginal status and circumstances. Where the pre-sentence report does notcontain sufficient relevant information, defence and Crown should be prepared to makesubmissions and, if necessary, call relevant evidence. »
177 Par exR. c. Cloud, 2014QCCQ464, 2014CarswellQue 742, 8R.R. (7th) 364, varied 2016QCCA 567, 2016 CarswellQue 2745, 28 R.R. (7th) 310, reversed 2016 QCCA 567, 2016CarswellQue 2745, 28 R.R. (7th) 310 ou le juge a renvoye l’avocat de la defense preparerses representations a deux reprises, ou R. c. G. (D.), 2014 BCCA 84, 2014 CarswellBC531 au para 10 : « The sentencing judge had a pre-sentence report and a psychologicalassessment, and although he requested a Gladue report, none was provided. After thesubmissions, he sent a memorandum to counsel asking if the First Nation wished to addanything to the proceedings, but both counsel declined to provide further information.The sentencing judge stated that it was not his place to direct the proceeding and opinedthat such informationwouldhavebeen veryhelpful for him to craft a restorative sentencerather than the ‘‘conventional sentencing options addressed in your submissions”. I notethat the sentencing judge has the power to order, on his own motion, the production ofevidence that would assist in determining the appropriate sentence (s. 723(3) of theCriminal Code). »
178 Par exemple, dans le jugement R. c. Swanson, 2013 ONSC 3287, 2013 CarswellOnt 7623(S.C.J.) aux para 24-25, le juge mentionne que la responsabilite de s’attaquer aux causessous-jacentes de la criminalite lors du processus de determination de la sentence, et nonpas simplement a leurs symptomes, repose en priorite sur les epaules des avocats de lapoursuite puisqu’il s’agit d’une question de justice.
179 Par ex R. c. Joamie, 2013 NUCJ 19, 2013 CarswellNun 23 au para 50: « It falls upondefense counsel, not the Court, to find a sentencing alternative to custody for citizens ofdiminished responsibility. It falls upon defense counsel, not the Court, to identify theresources needed to address the offender’s special needs. »
180 Par exR. c. Green, 2013 ONCJ 423, 2013 CarswellOnt 10710 au para 22: « The SupremeCourt of Canada in R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, 2012 CarswellOnt 4376, [2012] 1 R.C.S.433, 280 C.C.C. (3d) 265, 91 R.R. (6th) 1 devotes considerable time and effort to assistthose who actually chose to read the case, in making sense of aboriginal sentencing. »
IPEELEE ET LE DEVOIR DE RESISTANCE 109
(c) Les obstacles cognitifs et epistemologiques
Si les contraintes pratiques et systemiques ont un poids important auquotidien, celles-ci n’expliquent pas tout. Des obstacles epistemologiques etcognitifs, au sens ou l’entendait Bachelard, se dressent egalement sur le chemindes juges. Dans La formation de l’esprit scientifique181, Bachelard explique qu’il ya quelques « habitudes intellectuelles » qui entravent l’activite scientifique et lacreation. Ainsi, les idees utilisees le plus souvent ont tendance a se « valoriserindument » et a creer un obstacle a leur renouvellement182.
A ce chapitre, plusieurs auteurs ont demontre a quel point les juges ont de ladifficulte a concevoir la peine autrement que de facon afflictive, et en lien avec lestheories classiques de la peine (retribution, dissuasion, denonciation etrehabilitation en milieu ferme) qui constituent ce que Pires appelle larationalite penale moderne183. Par exemple, reprenant les propos de la Coursupreme dans Wells (mais repudies dans Ipeelee), plusieurs juges mentionnentqu’il ne faut pas croire que les autochtones ne croient pas en la denonciation et enla dissuasion184 ou encore que les objectifs de denonciation et de dissuasion nesauraient etre servis autrement que par la prison185.
Voir aussi R. c. Cloud, supra note 177 au para 6: « I should add that neither party wasaware of the requirements of Ipeelee and accordingly neither had prepared for a hearingto comply with the requirements imposed by it. ».
181 GastonBachelard,La formation de l’esprit scientifique—Contribution a une analyse de laconnaissance objective, Paris, 1934 reproduit dans Les classiques des sciences sociales a lap 19.
182 Margarida Garcia, « De nouveaux horizons epistemologiques pour la rechercheempirique en droit: decentrer le sujet, interviewer le systeme et “desubstantialiser” lescategories juridiques » (2011) 52:3-4 C de D 417 aux pp 428-429. Pour une mobilisationde ce concept dans le contexte du droit penal : Marie-Andree Denis-Boileau, Droit etscience : le point de vue de la Cour supreme du Canada sur l’expertise psychiatrique, thesede maıtrise en droit, Universite d’Ottawa, 2015 [inedite].
183 Alvaro Pires, supra note 55. Richard Dube, Margarida Garcia et Maira RochaMachado, dir, La rationalite penale moderne : Reflexions theoriques et explorationsempiriques, Ottawa, Les Presses de l’Universite d’Ottawa, 2013.
184 Par exR. c. Paul, 2014 BCCA81, 2014CarswellBC 519;R. c.W. (R.L.), 2013 BCCA50,2013 CarswellBC 268; R. c. Peters, 2014 MBPC 28, 2014 CarswellMan 292; R. c. LeeGabriel, 2012 QCCS 6026, 2012 CarswellQue 12909; R. c. Bourque, 2013 NWTSC 37,2013 CarswellNWT 43.
185 Par ex R. c. Schinkel, 2014 YKTC 42, 2014 CarswellYukon 72, varied 2015 YKCA 2,2015 CarswellYukon 3, 320 C.C.C. (3d) 366; R. c. Carlson, 2015 BCSC 1032, 2015CarswellBC 1657;R. c. C. (J.A.V.), 2015 BCPC 218, 2015 CarswellBC 2160;R. c. Kelly,2014BCSC2147, 2014CarswellBC 3409;R. c.McCook, 2015BCPC1, 2015CarswellBC143;R. c.Neel, 2014BCSC1989, 2014CarswellBC3130;R. c.H. (R.J.), 2013BCPC139,2013 CarswellBC 1723; R. c. S. (R.), 2014 BCPC 227, 2014 CarswellBC 3077; R. c.Merasty, 2012 SKQB 268, 2012 CarswellSask 486; R. c. Dick, 2014 MBQB 187, 2014CarswellMan 585, affirmed 2015MBCA47, 2015 CarswellMan 226;R. c. Bernard, 2014NSSC 463, 2014 CarswellNS 1054.
110 CANADIAN CRIMINAL LAW REVIEW [21 C.C.L.R.]
De plus, comme nous l’avons souligne lors de l’analyse des facteurshistoriques et systemiques, le concept de « gravite » du crime est de loin celuiqui empeche le plus les juges de donner toute sa portee aux prescriptions de laCour supreme. Notre analyse a en effet demontre que les juges de premiereinstance et d’appel continuent de mettre de cote les principes de l’arret Gladue enpresence de crimes « graves ». Toutes categories confondues, nous avons recense161 decisions sur 635, soit le quart des decisions (25,35%), dans lesquelles lesjuges invoquaient de facon explicite le concept de « gravite » comme frein al’analyse des principes enonces dans Ipeelee186. En outre, ceux-ci ont recoursdans une tres large mesure a des peines d’emprisonnement, notamment enpresence de situations de violence.
L’affaire R. c. Jacko187 est un bon exemple de la pregnance de ce concept. Lerecit du juge montre bien la gravite qu’il reconnaıt aux actes poses par l’accuseepuis le rejet de certains principes de determination de la peine, particulierement laprise en compte des facteurs historiques et systemiques et la recherche desanctions non carcerales. Ces facteurs historiques et systemiques deviennent, enfait, un facteur aggravant pour l’accusee.
Dans cette affaire, l’accusee a ete trouvee coupable de voies de fait sur unagent de la paix et de menaces de causer la mort ou des lesions corporelles pouravoir injurie, menace et crache dans les yeux, le nez et la bouche de deux agentsde la paix tout en affirmant avoir le VIH et l’hepatite188. Le juge de premiereinstance souligne certaines caracteristiques personnelles : l’accusee est agee de 50ans. Enfant, elle est confiee a l’orphelinat et adoptee en bas age par une mere luiayant inculque une education rigide. A 14 ans, elle quitte l’ecole, pour « desactivites ludiques en compagnie d’hommes plus vieux qu’elle »189. Elle developpealors une dependance a l’alcool et aux psychotropes et offre des faveurs sexuellesafin de pouvoir assouvir ces besoins. Elle est finalement placee par intermittenceen centres jeunesse jusqu’a sa majorite et finit par vivre en situation d’itinerance.
Mme Jacko a de nombreux antecedents judiciaires datant d’entre 1981 et1997. Toutefois, a partir de 1997, « ses agissements criminels se sont calmes », cequi coıncide avec la rencontre de son conjoint, decede en 2009. Pendant cetterelation, elle cesse de consommer, se trouve un emploi, complete son secondaire 5ainsi qu’une session d’etudes collegiales. Apres le deces de son conjoint, MmeJacko recommence a consommer de la drogue : n’ayant pas de famille ou d’amissur qui compter, elle affirme avoir perdu son guide. Faisant fi d’une periode destabilite de plus de douze ans, le juge decrit cette situation ainsi : « Il s’agit d’unefemme carencee qui s’est accrochee a un mode de vie malsain marque par la
186 Nous nous sommes limitees a la mention explicite de la gravite plutot que de denombrerles cas de crimes que nous jugions « graves ou violents » dans lesquels les juges refusentd’appliquer les principes afin de nous en tenir a l’evaluation subjective faite par lesacteurs eux-memes. Ipeelee, supra, note 2 au para 86.
187 R. c. Jacko, 2013 QCCQ 931, 2013 CarswellQue 1290.188 Ibid aux para 10-11.189 Ibid au para 17.
IPEELEE ET LE DEVOIR DE RESISTANCE 111
consommation ethylique et la frequentation des milieux criminalises etmarginaux. Suite au deces de son conjoint, elle mene une vie oisive, et retombedans ses habitudes de vie malsaine. On la decrit comme impulsive et ayant desvaleurs laxistes. Elle a de la difficulte a gerer sa colere. On indique egalementqu’elle a tendance a se victimiser. L’agent va jusqu’a dire qu’elle manifestecertains traits qui s’apparentent a des traits de personnalite antisociale. Elle estportee a tester continuellement les limites. On la dit dependante. »190
Lors du prononce de sa sentence, le juge affirme que la vie difficile del’accusee (sans mentionner les facteurs historiques et systemiques) n’est qu’un« critere parmi tant d’autres » et que « cette caracteristique ne mene pasautomatiquement a une reduction de peine. Plus le crime sera serieux, plus lapeine devant etre prononcee se rapprochera de celle decernee a un non-autochtone. »191 Or, le crime en question est justement tres grave a son avis: «Le crachat est un acte qui va au-dela de la violence, il demontre un manquetotal de respect, le mepris et la haine en plus d’etre degoutant au plus hautpoint. Pour un crachat sans consequence, notre Cour d’appel a deja dit qu’ils’agissait d’un comportement honteux et meprisable »192.
Il en vient finalement a la conclusion qu’en raison de cette gravite et du faitque « l’accusee presente un danger pour la collectivite en raison d’un risque derecidive eleve du notamment a sa dependance a l’alcool et du manque de soutienautour d’elle »193, une peine d’emprisonnement avec sursis ne serait pasappropriee: « Ce ne sont pas des visites a la maison de l’amitie ou quelquesautres ressources peu contraignantes que l’accusee va pouvoir mettre fin a sadependance. »194 Le juge a donc rendu une peine de 10 mois de prison et ce,malgre la presence evidente de facteurs historiques et systemiques ayant influencela dangerosite de Mme Jacko et susceptibles d’attenuer sa culpabilite morale195.Or, ici, plutot qu’etre presentes sous la forme d’une analyse de type Gladue, lapresence de ces facteurs nuit a l’accusee puisqu’elle influe sur son degre dedangerosite196.
Ayant observe l’incidence des « facteurs Gladue » sur le traitement desdemandes de delinquants dangereux a l’endroit des contrevenants autochtones,l’auteur Nate Jackson en arrive au meme constat197: les facteurs Gladue nuisentaux contrevenants. Celui-ci souligne que, dans le cas des delinquants dangereux,les tribunaux, lorsqu’ils se penchent sur la question de savoir s’ils imposeront oupas une sentence a duree indeterminee, sont guides principalement par deux
190 Ibid au para 15.191 Ibid au para 30.192 Ibid au para 13.193 Ibid au para 31.194 Ibid.195 R. c. Gladue, supra note 26 au para 69.196 Voir Nate Jackson, supra note 83 a la p 85.197 Ibid.
112 CANADIAN CRIMINAL LAW REVIEW [21 C.C.L.R.]
variables : le risque de recidive et les perspectives de rehabilitation198. Toutefois,le risque de recidive est influence substantiellement par « les facteurs systemiquesou historiques distinctifs qui peuvent etre une des raisons pour lesquelles ledelinquant autochtone se retrouve devant les tribunaux »199. En effet, plusieursoutils sont utilises afin de calculer le risque. Ceux-ci evaluent le niveaud’education, l’emploi, la maladie mentale, l’historique criminelle, l’abus desubstance en cours, les psychoses actives, l’instabilite, la reponse au traitement, lestress, le niveau de colere, l’hostilite200. Tous ces outils d’evaluation du risquefonctionnent en comparant le sujet a une base statistique. Or, cette basestatistique est determinee selon une premisse de neutralite ethnique et raciale, cequi la rend questionnable lorsqu’il est question de minorites201. La difficile realitedes autochtones fait en sorte qu’il serait difficile d’imaginer que ces derniersobtiennent un « bon » resultat a ces tests. Les autochtones sont doncautomatiquement desavantages202.
De la meme maniere, les perspectives de rehabilitation sont affectees demaniere significative par « les types de procedures de determination de la peine etde sanctions qui, dans les circonstances, peuvent etre appropriees a l’egard dudelinquant en raison de son heritage ou attaches autochtones. »203 Si uncontrevenant n’a jamais eu un traitement approprie et a donc echoue lesmultiples traitements qu’il a suivis, ses perspectives de rehabilitation serontconsiderees faibles204. En consequence, les contrevenants autochtones recoiventdavantage de sentence a duree indeterminee a cause des dommages causes par lecolonialisme, puisque ces dommages en viennent a etre les facteurs determinantspour motiver de telles decisions du tribunal. Selon Jackson, les vastesconnaissances sur le colonialisme et ses effets devastateurs doivent etre utiliseesafin de mettre a l’epreuve les hypotheses de depart en matiere de dangerosite205.
Un autre obstacle epistemologique et cognitif important a trait a la questionde la responsabilite individuelle206. Les juges ont largement tendance a faireabstraction du contexte historique et systemique qui afflige les autochtones eninvoquant le fait que ceux-ci ont choisi de commettre des infractions et doiventen etre tenus responsables. C’est ainsi qu’ils persistent a leur imposer le fardeaude prouver un lien de causalite entre les facteurs historiques et la perpetration del’infraction dans environ 6% des decisions de notre banque ou qu’ils refusent de
198 Nate Jackson, supra note 83 a la p 84.199 R. c. Gladue, supra note 26 au para 66.200 Nate Jackson, supra note 83 a la p 85.201 Ibid a la p 86.202 Ibid.203 R. c. Gladue, supra note 26 au para 66.204 Nate Jackson, supra note 83 a la p 88.205 Ibid a la p 91.206 Marie-Eve Sylvestre, « Rethinking Criminal Responsibility for Poor Offenders: Choice,
Monstrosity and the Logic of Practice » (2010) 55 McGill LJ 771.
IPEELEE ET LE DEVOIR DE RESISTANCE 113
considerer le contexte socioeconomique et culturel particulier dans ladetermination de la peine. Or, il convient a notre avis de remettre en questionle principe de la responsabilite individuelle en tenant compte notamment de laresponsabilite qui incombe a l’Etat dans ce contexte. A cet egard, notons lespropos du juge dans R. c. Land:
« One of the factors relied on by the Crown in asserting that the period ofparole ineligibility should be lengthened to 15 years is the moral
culpability ofMr. Land in brutally and relentlessly attackingMr. Doyon,an unsuspecting person who was minding his own business while on hisown couch in his own home. There is no doubt that such a crime cries outfor strong denunciation and forceful deterrence. However, surely society
writ large must share some of the moral culpability associated with thisterrible crime. How can we expect someone to be able to follow societalnorms when they, and their parents and grandparents, have so clearly not
been the beneficiaries of those same societal norms? How can someonewho, as a child, suffered the trauma just described, be expected to behavein the same way as someone who never suffered such trauma? How can
we expect a child raised in an environment of alcohol and drug abuse,physical and sexual violence, neglect, poverty, hunger, and instability togrow into a psychologically healthy adult with good impulse control and
judgment? »207
Finalement, certains juges emettent la preoccupation que « des sentences enapparence reduites pour les delinquants autochtones pourraient laisser certainscroire que les victimes autochtones meritent moins de protection »208, se referantici a un principe d’egalite formelle qui presuppose que les victimes autochtonessont effectivement mieux protegees par le systeme de justice penale, ce qui n’esteffectivement pas le cas209.
Pourtant, tant et aussi longtemps que les juges ne pourront pas surmonterl’obstacle de la « gravite » des infractions et que ceux-ci reporteront laresponsabilite des problemes sociaux qui affligent nos communautes sur les
207 Voir aussiR. c. Charlie, 2014 YKTC 17, 2014 CarswellYukon 40, affirmed 2015 YKCA3, 2015 CarswellYukon 6, 320 C.C.C. (3d) 479;R. c. L. (D.R.M.), 2012 BCPC 184, 2012CarswellBC 2215; R. c. Bird, 2014 SKQB 75, 2014 CarswellSask 200, leave to appealrefused 2016 CarswellSask 378 (S.C.C.); R. c. Knockwood, 2012 ONSC 2238, 2012CarswellOnt 4286, 286 C.C.C. (3d) 36 (S.C.J.).
208 Voir par exR. c. C. (S.D.), 2013 ABCA 46, 2013 CarswellAlta 144, 303 C.C.C. (3d) 336aupara 31 : «The sentencing judge observed that the victimof the offencewas alsoMetis.[. . .] He expressed concern that perceived reduced sentences for aboriginal offendersmight lead some (including victims) to conclude that aboriginal victims are lessworthy ofprotection. »
209 La population carcerale des autochtones au Canada n’a fait qu’augmenter depuis lesannees 1960,R. c. Ipeelee, supra note 2 au para 57. En parallele, les autochtones sont plussusceptibles d’etre victimes d’un crime que les non-autochtones, StatistiquesCanada,Lavictimisation avec violence chez les Autochtones dans les provinces canadiennes, 2009, parSamuel Perreault, no de catalogue 85-002-X, Ottawa, Statistique Canada, 11 mars 2011aux pp 7-9.
114 CANADIAN CRIMINAL LAW REVIEW [21 C.C.L.R.]
epaules des accuses, nous continuerons de voir croıtre le nombre de personnesautochtones judiciarisees et incarcerees au Canada. En effet, une grande partiedes infractions criminelles perpetrees dans ce contexte sont des infractions «graves » ou impliquant un certain niveau de violence, et dans la grande majoritedes cas les actes poses etaient volontaires et peuvent etre attribues auxcontrevenants qui ont ete condamnes. Or, en milieu autochtone, la violence ades racines profondes et est d’abord le fruit du colonialisme, de la politique despensionnats et du statut d’inferiorite dans lequel les maintient la Loi sur lesindiens. La violence s’inscrit aussi dans des dynamiques interpersonnelles,intercommunautaires et intergenerationnelles ou victime et agresseur sont desstatuts interchangeables. Le systeme de justice penale fait aussi partie integrantedu probleme. En faisant preuve d’incomprehension culturelle, d’ignorance del’histoire et en perpetuant la honte, l’humiliation et la culpabilite chez les peuplesautochtones, il contribue directement au cycle de violence210.
Il est vrai que si la Cour supreme dans Ipeelee est claire sur un certainnombre de principes, elle donne peu d’indication sur la facon dont il faut lesmettre en œuvre. Ainsi, a la lecture de ces jugements et face au refus obstine desjuges a eviter les « erreurs » identifiees dans Ipeelee, il nous apparaıt evident queplusieurs juges ne savent tout simplement pas comment operationnaliser lesfacteurs Gladue et Ipeelee. Certains juges l’affirment d’ailleurs explicitement dansleur decision : ils souhaiteraient avoir davantage d’explications211. D’autant plusque la Cour supreme indique qu’il ne s’agit pas d’accorder une reductionautomatique de la peine, mais qu’elle semble par ailleurs en arriver a ce resultatdans Ipeelee en reduisant les peines d’emprisonnement des principauxinteresse(e)s212. Devant ces contradictions, certains juges incluent simplementl’expression « facteurs Gladue » dans les circonstances attenuantes213, ou setournent a defaut de mieux vers une reduction de la peine imposee214.
210 Nous tirons ces constats preliminaires de nos entretiens effectues aupres de personnesatikamekw dans le cadre de notre projet de recherche.
211 Voir par exR. c. S. (E.H.), 2013 BCPC 48, 2013 CarswellBC 646 au para 36 : « I return,then, to the questionof how to factor in the issueof theDefendant’s aboriginal status, as Iam required to do. Imust confess that I have always found this issue to be elusive indeed,and no less so now that I have read and re-read the decisions in R. c. Gladue, 1999CarswellBC779, [1999] 1R.C.S. 688, 133C.C.C. (3d) 385, 23R.R. (5th) 197,R. c. Ipeelee,2012 CSC 13, 2012 CarswellOnt 4376, [2012] 1 R.C.S. 433, 280 C.C.C. (3d) 265, 91 R.R.(6th) 1 andR. c. W. (R.L.), 2013 BCCA 50, 2013 CarswellBC 268 while considering mydecision in this case. »
212 Voir Genevieve Beausoleil-Allard, dans ce numero.213 Par exemple, dans la decision R. c. Engel, 2013 SKPC 215, 2013 CarswellSask 924,
pratiquement aucun detail sur les « facteurs Gladue » ne sont mentionnes, l’expression «facteur Gladue » est toutefois un des elements de la liste des circonstances attenuantesapplicable au cas.
214 Voir par exR. c. Sauls, 2013 BCSC 2445, 2013CarswellBC 4001 au para 26 : « In keepingwith R. v. Gladue, it is incumbent upon me to use all available sanctions other thanimprisonment that are reasonable in the circumstances. That does not mean in this case
IPEELEE ET LE DEVOIR DE RESISTANCE 115
A notre avis, c’est qu’il ne faut pas comprendre l’article 718.2e) C.cr. et lesenseignements de la Cour comme edictant un principe de determination de lapeine parmi d’autres parmi lesquels on peut choisir selon les circonstances, maiscomme une invitation a penser non seulement la peine, mais l’ensemble duprocessus qui l’entoure autrement.
4. CONCLUSION
Malgre l’enthousiasme suscite par l’arret Ipeelee215, force est d’admettre que,trois ans plus tard, la resistance n’est le fait que d’une poignee de juges. Lamajorite, elle, resiste plutot a l’innovation.
L’affaire Charlette citee en introduction en est un exemple tragique. Danscette affaire, un rapport Gladue a ete produit, mais le juge semble l’avoir traitecomme un rapport presentenciel ordinaire en retenant surtout le risque tres elevede recidive que posait l’accuse plutot que les liens evidents entre son passe et sesbesoins profonds de services sociaux et de sante mentale. Le juge ne semble pasnon plus avoir accorde beaucoup d’importance aux facteurs systemiques : il nefait pas trop de cas du fait que Charlette ait quitte sa ville natale a l’age de sixans, et ait presente des signes de deracinement et d’acculturation profonds, maisinsiste sur le fait qu’il a grandi sans lien avec la culture autochtone, semblantinsinuer que l’accuse n’est peut-etre pas suffisamment autochtone. Puis, ilaccorde une reduction automatique de peine d’un an, appliquant une formulepurement mathematique plutot que de suivre un cadre d’analyse et de referenceradicalement different. En fait, il est meme possible de dire que Charlette a etevictime de discrimination dans cette affaire ayant obtenu une peine tres eleveedans la fourchette des peines en faisant abstraction des principes dedetermination de la peine les plus elementaires, comme la gradation des peines.Finalement, le juge n’a aucunement considere le deuxieme volet de l’analyse ouenvisage un processus ou une sanction substitutifs.
Plusieurs obstacles, d’ordre pratique, legislatif ou epistemologique, sedressent bien sur sur la route des juges. En fait, c’est un changement completde paradigme que semble vouloir suggerer Ipeelee. Dans ces deux volets, cet arretpousse le systeme de justice jusqu’a ses derniers retranchements. En ce quiconcerne le premier volet, les facteurs systemiques et historiques, il nous force a
that jail time is not appropriate, not at all. A significant period of incarceration, in myview, is necessary. But because of theGladue factors, I amgoing to impose a lesser periodof incarceration than would otherwise be the case if Mr. Sauls were not an aboriginaloffender. » Voir aussi R. c. Mathers, 2012 BCSC 1980, 2012 CarswellBC 4138; R. c. P.(D.A.), 2012 BCPC 390, 2012 CarswellBC 3375; R. c. Sauls, 2013 BCSC 2445, 2013CarswellBC 4001;R. c. Seidel, 2014 BCPC 230, 2014 CarswellBC 3057; R. c. C. (W.A.),2012 SKQB 415, 2012 CarswellSask 919; R. c. Atkinson, 2014 MBQB 17, 2014CarswellMan 34, leave to appeal refused 2014 MBCA 116, 2014 CarswellMan 770,varied 2015 MBCA 2, 2015 CarswellMan 2.
215 Jonathan Rudin, « Looking Backward, Looking Forward: The Supreme Court ofCanada’s Decision in R. v. Ipeelee » (2012) 57 SCLR 375.
116 CANADIAN CRIMINAL LAW REVIEW [21 C.C.L.R.]
remettre en question le principe fondamental de la responsabilite individuelle, ale contextualiser, a identifier des origines collectives aux conflits. Dans sonsecond volet, il remet en question l’universalisme de la justice penale etatique, laforcant a reconsiderer l’opportunite, mais egalement la legitimite de punircertaines personnes d’une certaine facon. Ce faisant, il nous force a reconsiderernos processus d’administration des conflits, nos objectifs et l’eventail de nossanctions.
Pourtant, tout n’est pas perdu, au contraire. Ipeelee cree une zone de contactou l’innovation et l’internormativite deviennent possibles. Pour ce faire, il faut anotre avis partir a la rencontre de l’alterite juridique. On doit cesser de parler desubordination ou encore d’adaptation ou d’accommodement au sein du systemede justice, mais parler plutot d’une reelle coordination ou de separationconcertee216.
Concernant le premier volet, notre analyse de la jurisprudence demontrequ’il n’y a eu aucune amelioration dans le recours a des sanctions noncarcerales entre 2012 et 2015 — le taux d’incarceration demeurant stable, de87% en 2012 a 88% en 2014 et 86% en 2015. Par contre, lorsque l’on compareles decisions dans lesquelles les juges ont pris en consideration les facteurshistoriques et systemiques (decisions jugees « satisfaisantes » dans notrebanque) et celles dans lesquelles les juges les ont juges « non applicables », neles ont pas mentionnes ou encore n’en ont fait aucune analyse (decisions jugees« insatisfaisantes » dans notre banque), les resultats sont tres interessants. Eneffet, tel que le revele le tableau 6 ci-dessous, les juges qui n’ont pas mentionneles facteurs, qui les ont juges inapplicables ou qui en ont fait une analyseinsatisfaisante, ont eu recours a l’emprisonnement dans respectivement 87%,97% et 96% des cas, alors que les juges qui en ont fait une analysesatisfaisante n’ont eu recours a l’emprisonnement que dans 70% des cas, untaux en deca de la moyenne observee pour l’ensemble des decisions (87%).
216 Voir par exValNapoleon, « Tsilhqot’in LawofConsent » (2015) 48UBCLRev 873. Cetarticle est en fait un exercice d’application des principes juridiques Tsilhqot’in au conflitregle par la Cour supreme dans le jugement Xeni Gwet’in First Nations c. BritishColumbia, 2014 CSC 44, 2014 CarswellBC 1815, (sub nom. Tsilhqot’in Nation v. BritishColumbia) [2014] 2 R.C.S. 257.
IPEELEE ET LE DEVOIR DE RESISTANCE 117
TABLEAU 6. EMPRISONNEMENT ET FACTEURS HISTORIQUES ETSYSTEMIQUES
Facteurs his-toriques et sys-temiques
Prison Sursis Probation Amende Absolution Autre217
Non men-tionnes(215 cas)
187(86,98%)
12(5,58%)
5(2,33%)
0 4(1,86%)
7(3,26%)
Juges inap-plicables oumoins applic-ables(95 cas)
92(96,84%)
1(1,05%)
2(2,11%)
0 0 0
Analyse insa-tisfaisante(196 cas)
189(96,43%)
4(2,04%)
2(1,02%)
0 0 1(0,51%)
Analyse satis-faisante(127 cas)
89(70,08%)
20(15,75%)
9(7,09%)
4(3,15%)
5(3,94%)
0
C’est ainsi que l’analyse des facteurs historiques et systemiques permet auxjuges d’innover davantage dans les sanctions imposees. Pour ce faire, les jugesdoivent bien comprendre les enseignements de la Cour supreme dans Ipeelee,c’est-a-dire, que ces facteurs sont intimement lies au principe de proportionnalitedes peines, enlever les virgules, et que cette analyse de la proportionnalite devraitexiger de considerer les facteurs historiques et systemiques comme circonstancesattenuantes dans l’evaluation du degre de responsabilite du condamne, et noncomme un facteur additionnel de risque. Cette analyse pourrait amener les jugesa remettre en question les fondements meme de notre systeme de justice, de laresponsabilite individuelle a l’evaluation de la gravite et de la dangerosite218.
Si cette analyse est necessaire, elle ne sera cependant pas suffisante pourrenverser les tendances lourdes qui affligent notre systeme de justice lorsqu’il estquestion des contrevenants autochtones. Pour y parvenir, il faut se tourner versle volet 2. Celui-ci invite l’Etat canadien a reconnaıtre l’existence des systemes dedroit autochtones. Ceux-ci ont ete fortement discredites et invisibilises lors de lacolonisation canadienne et doivent etre revitalises. Riches et complexes219, ilsforment des systemes juridiques complets et pluriels avec leurs valeurs et
217 Decisions sur la designation de delinquant dangereux ou a controler ou decisions danslaquelle la sentence n’est pas mentionnee.
218 Marie-Eve Sylvestre, supra note 33; Nate Jackson, supra note 83.219 Mentionnons par exemple qu’outre des principes d’entraide et d’harmonie, le droit crie
118 CANADIAN CRIMINAL LAW REVIEW [21 C.C.L.R.]
principes, leurs regles et leurs autorites legitimes, ainsi que leurs processus deresolution des conflits. En mettant de l’avant des conceptions differentes de lajustice, ceux-ci visent cependant a repondre a des problemes fondamentalementuniversels de securite et de paix220. Appuyees de chercheurs, notamment duIndigenous Law Research Unit dirige par Val Napoleon et son equipe al’Universite de Victoria, plusieurs communautes au Canada se sont engageesdans un tel processus221. Elles beneficient maintenant de l’appui de laCommission verite et reconciliation qui recommande que:
« Conformement a la Declaration des Nations Unies sur les droits despeuples autochtones », nous demandons au gouvernement federal definancer, en collaboration avec les organisations autochtones, lacreation d’instituts du droit autochtone pour l’elaboration, la mise en
application et la comprehension des lois autochtones ainsi que l’acces ala justice en conformite avec les cultures uniques des peuplesautochtones du Canada. »222
C’est un travail de reconstruction qui n’en est qu’a ses debuts. Conscientes etsoucieuses que celui-ci doit etre realise en tenant compte de la multiplicite desvoix (hommes et femmes, jeunes et aınes, etc.), les communautes creent desespaces d’echange et de deliberation sur les questions qui les preoccupent. Surleur route, ces communautes pourraient beneficier de l’appui des juges. Uncertain nombre de mesures concretes pourraient etre envisagees. D’abord, il estessentiel d’aborder les questions autochtones avec une certaine dose d’humilite.Comme l’ont deja souligne Healy et Vancise, la reconnaissance du fait que lesjuges doivent prendre connaissance d’office des facteurs historiques etsystemiques est une arme a double tranchant223. Elle ne saurait laisser croireaux juges qu’ils connaissent bien le contexte colonial canadien et sesconsequences : apres tout, ils sont eux aussi le produit de ce meme colonialisme.
Ensuite, conformement aux enseignements de la Cour supreme dans Ipeelee,les tribunaux devraient exiger que les rapports Gladue contiennent non seulementdes informations sur l’impact negatif des facteurs historiques et systemiques,mais egalement qu’ils servent a documenter les processus et les principes deresolution des conflits de la communaute visee. Lorsque les circonstances s’y
vise dans l’affaire Kawapit cite dans la partie II comprend egalement des pratiquesexclusives.
220 Voir Accessing Justice and reconciliation : Cree Legal Summary, Indigenous LawResearch Unit, 2012, en ligne : <http://indigenousbar.ca/indigenouslaw/wp-content/uploads/2012/12/cree_summary.pdf> aux pp 19-20.
221 Pour plus d’informations, voir le site web du « Indigenous LawResarchUnit », en ligne :<http://www.uvic.ca/law/about/indigenous/indigenouslawresearchunit>.
222 Voir l’appel a l’action 50 du Sommaire du rapport final de la Commission de verite et dereconciliation du Canada, supra note 8 a la p 221.
223 Voir notammentPatrickHealy andWJVancise, « JudicialNotice in Sentencing », (2002)65 Saskatchewan LR 97 qui sont d’avis que le contexte autochtone est trop complexepour qu’il fasse strictement l’objet de connaissance d’office.
IPEELEE ET LE DEVOIR DE RESISTANCE 119
pretent, les juges pourront demander que l’on appelle des temoins susceptibles deles appuyer en ce sens224. Finalement, lorsque les juges developperont despratiques innovatrices et auront recours a des sanctions substitutives, il estprimordial de le documenter dans un jugement ecrit afin de contribuer adevelopper une autre jurisprudence.
De leur cote, les provinces et leurs services de poursuite devraient aussis’engager resolument dans la conclusion d’ententes de coordination avec lesnations autochtones sans exclure d’emblee les cas « de crimes graves » puisque cefaisant, ils contribuent a alimenter le type de blocages epistemologiques etcognitifs qui entravent l’innovation penale. A cet egard, il existe au Quebec desexemples extremement positifs de concertation et de collaboration entre la justiceetatique et les systemes de droit autochtones dans un domaine connexe au droitcriminel. Les Atikamekw, par exemple, ont mis sur pied un systemed’intervention d’autorite atikamekw225 en matiere de protection de la jeunessequi leur permet depuis 2001 de gerer avec l’assentiment de l’etat, desproblematiques de negligence parentale et de protection de la jeunesse226. Poury parvenir, les Atikamekw appliquent la Loi sur la protection de la jeunesse etprotegent leurs enfants contre la maltraitance et la negligence parentale, maisleur approche, leur processus et leurs resultats sont bien differents et, dansl’ensemble, juges plus respectueux de leur systeme de droit. Un bon point dedepart consisterait donc pour les juges a se familiariser avec les travaux derecherche en cours dans les communautes visees par leurs activites et a mieuxconnaıtre les ressources disponibles au sein de ces communautes227.
Tel que l’affirment Silbey et Ewick, « resistance requires a consciousness ofopportunity »228. Ou, pour citer le philosophe francais Jean Salem s’appuyantsur Lucrece: « Quand une foule me pousse dans une certaine direction, je peuxtoujours opposer mon epaule pour tenter de lui resister. C’est a mes yeux unedefinition assez parfaite de la liberte. Chacun a toujours la possibilite de lefaire »229. Nous en appelons donc aux juges quebecois et canadiens. Le constat
224 R. c. Gladue, supra note 26 au para 84.225 Pour en savoir plus, voir le site inter net du systeme d’intervention d’autorite atikamekw,
en ligne : <http://www.atikamekwsipi.com/systeme_siaa>.226 Anne Fournier, De la Loi sur la protection de la jeunesse au systeme d’intervention en
autorite atikamekw (SIAA)—La prise en charge d’une nation pour assurer le bien-etrede ses enfants, (2016) 24 Enfances, Familles, Generations (a paraıtre).
227 Plusieurs communautes disposent de programmes de justice communautaire, parexemple, il existe un programme de justice communautaire (PJCA) au sein de lacommunaute atikamekw deWemotaci. Voir aussi par ex, sur la culture juridique crie, ledocumentAccessing Justice and reconciliation : Cree Legal Summary, supra note 220. Lesite internet du projet « Accessing Justice and Reconciliation », issu d’un partenariatentre le Indigenous Law Research Unit, l’Assocation du Barreau autochtone et laCommission verite et reconciliation : <http://www.indigenousbar.ca/indigenouslaw/>.
228 Patricia Ewick et Susan S. Silbey, The common place of law: stories from everyday life,Chicago, University of Chicago Press, 1998 a la p 183.
120 CANADIAN CRIMINAL LAW REVIEW [21 C.C.L.R.]
d’echec des arrets Gladue et Ipeelee ne doit pas etre vu comme une fin en soi.La resistance et l’innovation passent d’abord par un travail de concertation etIpeelee doit etre vu comme une opportunite de recommencer a s’attaquer auprobleme, mais differemment, plus astucieusement et de concert avec le milieude la recherche et les peuples autochtones.
229 Jean Salem, philosophe francais, vulgarise ainsi la vision de la liberte que mettait del’avant Lucrece un siecle avant Jesus-Christ dans De rerum natura, livre II : AudeLancelin et Marie Lemonnier, « Pourquoi je suis epicurien », Le nouvel Observateur (7aout 2008) 16. Voir aussi Jean Salem, Les Atomistes de l’Antiquite : Democrite, Epicure,Lucrece, Paris, Flammarion, 2013 a la p 211; Jean Salem, La mort n’est rien pour nous :Lucrece et l’ethique, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1990 aux pp 67-92.
IPEELEE ET LE DEVOIR DE RESISTANCE 121