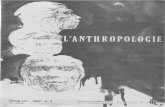Résistance du littéraire et détour du filmique ou la transposition filmique de l'épreuve au discours
“«Nous n’avions pas d’autre choix». Colonialisme et guerre de libération au Maroc à...
Transcript of “«Nous n’avions pas d’autre choix». Colonialisme et guerre de libération au Maroc à...
Collectanea Islamica
ISBN 978-88-548-5668-4 – DOI 10.4399/978885485668410
pp. 199-216 (novembre 2012)
“Nous n’avions pas d’autre choix.”
Colonialisme et guerre de libération au Maroc àtravers
les témoignages des protagonistes de la Résistance
Manuela Deiana
(University of Cagliari)
Introduction
Selon la perception de bon nombre de Marocains, comme cela a été
observé par l’historien Mohammed Kenbib, le Protectorat – imposé
en 1912 au Maroc par la France et l’Espagne dans le cadre de leurs
politiques coloniales – ne serait qu’un “simple accident de
l’histoire,” et ses quarante quatre ans constitueraient une sorte de pa-
renthèse dans la longue histoire marocaine au cours de laquelle les
structures et les institutions du pays seraient demeurées quasiment
intactes.1 En réalité, un phénomène qui a été à l’origine de boulever-
sements si profonds et irréversibles dans une société ne peut pas être
considéré comme une pure parenthèse dans l’histoire nationale d’un
pays, surtout quand il a provoqué une guerre de libération souvent
marquée par un caractère fratricide.
La présente contribution vise à donner un aperçu de la Résistance
armée au Maroc pendant les années 1953-1956 à travers les témoi-
gnages d’anciens résistants et des membres de l’Armée de Libération.
En particulier, on essayera de souligner l’importance d’avoir recours
1 Mohammed Kenbib, “Ecriture et réécriture de l’histoire con-temporaine du Maroc,” in
Mohammed Kenbib (éd.), Du protectorat à l’indépendance. Problématique du temps présent,
Publications de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines – Université Mohammed V
Agdal-Rabat, Rabat, 2006, p. 24.
200 Manuela Deiana
aux sources orales et, donc, de donner la voix aux vrais protagonistes
de ces événements tragiques qui ont signé la fin du régime colonial
dans l’empire chérifien.
1. Sources orales et écriture de l’histoire contemporaine du Maroc
Pendant les décennies suivant l’indépendance, la plupart des spécia-
listes marocains qui ont abordé ce sujet n’ont fait que très rarement ré-
férence aux témoignages oraux et aux souvenirs des nationalistes. Se-
lon Mohammed Zade cela doit être imputé au climat de tension qui
régnait dans le pays entre le régime et les mouvements d’opposition.
Comme il le rappelle, en fait, “les sentiments de déception qu’avaient
éprouvé les hommes de la résistance dans les premières années de
l’indépendance les a conduits à contribuer à la fondation de nouveaux
partis politiques. Certains d’entre eux ont même eu recours à l’action
armée contre le régime.”2 Dans ce climat, les militants étaient évi-
demment peu encouragés à partager leurs souvenirs.
Parmi les historiens qui ont consacré leurs recherches à l’histoire du
mouvement de libération marocain, il faut citer Abdelmajid Benjel-
loun,3 spécialiste du colonialisme espagnol et du mouvement nationa-
liste dans la zone nord du Maroc, et Zaki M’Barek, auteur de plusieurs
ouvrages sur l’histoire de la résistance armée et de l’Armée de Libéra-
tion.4 De plus, M’Barek a été très précieux pour ses conseils et les con-
tacts qu’il a fournis lors de quelques rencontres préparatoires au travail
de terrain conduit dans le cadre de la présente recherche. Un travail qui
2 Mohammed Zade, Résistance et Armée de Libération au Maroc (1947-1956). De l’action
politique à la lutte armée: rupture ou continuité ?, Haut Commissariat aux Anciens Résistants
et Anciens Membres de l’Armée de Libération, Rabat, 2006, p. 12. 3 En plus des nombreux articles parus dans la Revue d’Histoire Maghrébine, consulter les
ouvrages: Abdelmajid Benjelloun, Approches du colonialisme espagnol et du mouvement
nationaliste marocain dans l’ex-Maroc khalifien, Okad, Rabat, 1988; Idem, Pages d’histoire
du Maroc: le patriotisme marocain face au Protectorat espagnol, El Maarif, Rabat, 1993;
Idem, Le Nord du Maroc: l’indépendance avant l’indépendance. Jean Rous et le Maroc 1936-
1956, L’Harmattan, Paris, 1996. 4 En particulier les ouvrages Zaki M’Barek, Résistance et Armée de libération. Porté politique,
liquidation 1953 1958, Etei, Tanger, 1987; Idem, Le mouvement de libération marocain et
l’indépendance inachevée 1948-1958, Bouregreg, Rabat, 2009.
“Nous n’avions pas d’autre choix” 201
a permis de recueillir – sans aucune prétention de représentativité,
s’agissant d’une approche qualitative – les souvenirs directs de plu-
sieurs protagonistes de la Résistance dont certains rencontrés auprès du
Haut Commissariat aux Anciens Résistants et Anciens Membres de
l’Armée de Libération à Rabat.5
Dans le but de souligner l’importance de la dimension biogra-
phique, chaque interviewé a été laissé assez libre dans son récit, sui-
vant un modèle semi-structuré sur des questions concernant: la famille
et le milieu de naissance, la jeunesse, l’éducation reçue; les conditions
dans lesquelles il avait rejoint la Résistance, les rôles joués et les acti-
vités accomplies pendant la lutte; ainsi que son itinéraire après
l’indépendance et les sentiments qui ont suivi la démobilisation. En
conclusion, on demandait de faire un bilan de toute la période de la
Résistance et de l’indépendance à partir de sa propre expérience.
Le recours aux témoignages oraux en tant que source de documen-
tation supplémentaire a permis de démontrer le caractère pertinent de
cette approche méthodologique, qui se révèle encore plus souhaitable
pour certains événements historiques tels que les mouvements de libé-
ration nationale, pour les quels on entre en collision avec des pro-
blèmes inhérents à la disponibilité de documentation comme consé-
quence par exemple de la nature sécrète de la lutte. Dans le cas maro-
cain, en plus du principe de la clandestinité et l’exécution de con-
signes verbales, la formation des chefs des réseaux résistants, leur ni-
veau intellectuel et leurs origines socio-économiques ne pouvaient
qu’accentuer la caractéristique de l’oralité.6
A ce propos, il est nécessaire de rappeler Voices of Resistance de
l’américaine Alison Baker,7 une étude en langue anglaise malheureu-
5 A part la prise de notes au cours de plusieurs conversations informelles, il a été possible
réaliser six interviews qui ont été enregistrés avec deux magnétophones (dont un digital) après
avoir obtenu l’accord explicite de chaque témoin. Une transcription littérale le plus fidèle
possible de la version sonore a été rédigée par la suite. Trois interviews avec des membres du
Conseil National des Anciens Résistants ont eu lieu au siège du Haut Commissariat aux
Anciens Résistants et Anciens Membres de l’Armée de Libération à Rabat; deux ont eu lieu
dans un hôtel au centre ville de Rabat et une à Casablanca dans la maison du témoin. Les
entretiens se sont déroulés en français et en arabe dialectal marocain. 6 M’Barek, Le mouvement de libération marocain, p. 12. 7 Alison Baker, Voices of Resistance. Oral Histories of Moroccan Women, State University of
202 Manuela Deiana
sement négligée par les spécialistes francophones du domaine. Il s’agit
d’une remarquable tentative de recueillir les histoires orales des
femmes qui ont été protagonistes, voire pionnières, du mouvement na-
tional et de la résistance armée, dans une double rébellion contre
l’oppression colonialiste et contre l’attitude restrictive de la société
traditionnelle marocaine. En fait, considérant le rôle fondamental des
femmes marocaines qui sont de véritables storytellers dans la trans-
mission d’une riche tradition orale, l’auteur vise à souligner son inté-
rêt pour les femmes en tant qu’agentes et interprètes de l’histoire.8
2. La Résistance et l’Armée de Libération Marocaine
Malgré certains auteurs9 qui affirment que la résistance marocaine
avait éclaté au Maroc tout au long de la “pénétration pacifique” fran-
çaise et donc avant même l’établissement du régime du Protectorat en
1912, normalement on fait remonter l’origine de la résistance armée
marocaine (“Révolution du roi et du peuple”) au lendemain de
l’opération du 20 août 1953 contre le Sultan sīdī10
Mohammed ben
Youssef (Muḥammad b. Yūsuf), exilé avec la famille royale pendant
deux ans d’abord en Corse et ensuite à Madagascar.
Bien que les premiers noyaux armés étaient déjà actifs depuis
quelques années,11
cette date fut également prise en considération au
moment d’établir qui pouvait recevoir le titre et la carte de résistant
avec tous les privilèges que ça comportait. En fait, un décret signé par
le Sultan (ẓahīr; en dialecte marocain, ḍahīr) du 1959 précisait que la
qualité d’ancien résistant pouvait être attribuée, même à titre pos-
thume, à toute personne pour laquelle il est établi entre le 15 août
New York Press, Albany, 1998; voir aussi Idem, “Histoire et mythe: la résistance marocaine
racontée par les femmes,” in L’Armée Marocaine à travers l’histoire. Actes du colloque
Maroco-Européen du 13 au 15 octobre 1994, numèro monographique du Revue Maroc-
Europe, 7, 1994, pp. 313-332. 8 Baker, Voices of Resistance, p. 3. 9 Voir en particulier l’œuvre de l’historien Abdallah Laroui, Les origines sociales et
culturelles du nationalisme marocain (1830-1912), Maspero, Paris, 1977. 10 Sīdī est déformation dialectale de sayyidī (“mon seigneur”). 11 Zade, Résistance et Armée de Libération, pp. 135-149.
“Nous n’avions pas d’autre choix” 203
1953 (quelques jours avant la déposition du Sultan, quand la volonté
française de l’éloigner était déjà manifeste) et le 7 avril 1956 (au len-
demain de la révocation du traité de Madrid12
):
soit qu’elle a combattu au sein d'une unité de l’armée de libération; soit
qu’elle a été exécutée, tuée, blessée ou emprisonnée du fait de sa participa-
tion armée pour un but patriotique aux événements survenus pendant ladite
période; soit qu'elle a accompli, au sein d'une unité de résistance armée ou en
liaison avec celle-ci, un ou plusieurs actes de résistance susceptibles d'appor-
ter une aide efficace à la libération du pays et à la restauration de sa souverai-
neté.13
En outre, la qualité d’ancien résistant fut également attribuée à
toute personne pour laquelle il est établi qu’elle avait combattu au sein
d’une unité de l’Armée de Libération du Sahara Marocain durant la
période située entre le 8 avril 1956 et le 1er
avril 1960.
Pour remonter aux origines de la Résistance il faut rappeler que la
conception radicale de l’action politique ne trouva pas l’unanimité de
tous les nationalistes. La majorité des cadres du mouvement national
continuait à prôner la voie pacifique tandis qu’un group
d’intransigeants ne voyait désormais aucune alternative à la lutte ar-
mée. La Résistance ne fut en réalité “qu’une organisation parallèle, af-
filié au mouvement nationaliste où les pionniers de l’action armée et
les principaux chefs de réseaux y firent leur apprentissage politique.”14
Plus tard, elle trouva son évolution naturelle dans la constitution de
l’Armée de Libération Marocaine (A.L.M.) dont les premières opéra-
tions furent lancées dans la nuit du 1er
octobre 1955.
Grâce aux liens avec les couches sociales les plus déshéritées,
l’A.L.M. put donner à son action un caractère populaire à vocation reli-
gieuse. En fait, un des premiers communiqués annonçait:
12 Le traité hispano-français de Madrid fut signé le 27 novembre 1912 et imposait une zone de
influence espagnole dans le nord du Maroc, mieux connue comme le Protectorat espagnol,
ainsi qu’une autre zone d’influence à Ifni et Tarfaya dans l’extrême sud du pays. 13 Ḍahīr n. 1-59-076 du 1er ramadan 1378 /11 mars 1959, dans le Bulletin Officiel, n. 2421, 20
mars 1959. 14 M’Barek, Le mouvement de libération, p. 11.
204 Manuela Deiana
l’insurrection nationale bénie dans toutes les régions du Maghreb. Au nom de
Dieu le Tout Puissant, le Haut-Commandement au Maroc publie son premier
communiqué sur la lutte sacrée. Le but est: l’indépendance totale du Maroc et
de l’Algérie et le retour de Muḥammad ben Youssef sur son trône à Rabat.15
Comme l’a souligné M’Barek, la proclamation de la qualité de
ğihād attribuée à l’insurrection eût un lourd impact sur les soldats ma-
rocains intégrés dans l’Armée française. Si dans un premier moment
la Résistance s’était organisée en petites cellules clandestines n’ayant
aucune forme de communication parmi elles afin de maintenir le ca-
ractère secret et éviter le danger d’être découvertes par la police fran-
çaise, une fois constituée l’A.L.M. on commençait à inciter ces mêmes
soldats marocains au ralliement et à la désertion.16
La portée politico-
militaire de cette action fut indéniable car plusieurs furent, par
exemple, les cadres militaires marocains formés dans les écoles fran-
çaises qui décidèrent de rallier le maquis.
Dans la tentative de dessiner une géographie de la Résistance, il faut
préciser la place importante de la région de Casablanca en tant que
champ principal des actions armées (60%).17
La ville de Casablanca, en
particulier, où des masses d’autochtones fuyant la misère des cam-
pagnes s’amassaient dans les bidonvilles, où la crise de l’artisanat, le
chômage et l’inégalité des salaires créaient des conditions de vie déplo-
rables, fut le foyer central de la Résistance marocaine. Elle présentait un
terrain fertile pour les idées des nationalistes et devint une pépinière
15 Zaki M’Barek, “La désertion des soldats marocains de l’armée française à l’armée de
libération du Maghreb (A.L.M.): Rôle militaire, impact psycho-politique 1955-1956,” in
L’Armée Marocaine à travers l’histoire, p. 236. 16 L’incitation à la désertion se faisait à travers l’action directe, par personnes interposées et
par écrits (tracts, circulaires, lettres) faisant appel au ğihād sacré. “A nos frères musulmans
servant dans l’armée française, que le salut de Dieu plane sur vous! Sachez bien que vous êtes
musulmans et que nous sommes vos frères que la Patrie et l’Islam communient. La loi
islamique nous interdit de nous entre-tuer. C’est pourquoi nous vous écrivons pour vous
mettre au courant de ce que vous ignorez peut-être: Vous défendez notre ennemi et cherchez à
faire triompher l’apostasie sur l’Islam. (…) Si vous préférez mourir en bons musulmans,
rejoignez-nous sous la protection de Dieu et celle de l’Islam. Celui qui aura rejoint notre rang
se verra octroyer le grade de sergent,” Ibidem, p. 251. 17 Zade, Résistance et Armée de Libération, p. 158. La région de Casablanca comprenait les
villes de Casablanca, Azemmour, Fédala (Mohammedia), Mazagan (el-Jadida), Settat, et
encore les centres de Berchid, Oued-Zem, Khouribga, Beni-Mellal, Azilal.
“Nous n’avions pas d’autre choix” 205
pour les principales organisations des résistants, ce qui démontre le ca-
ractère essentiellement urbain du phénomène.
La zone espagnole au nord du Maroc avait une importance tout
aussi centrale. Celle-ci était devenue une sorte de base arrière de la
Résistance où les combattants recherchés par les autorités françaises
étaient accueillis comme réfugiés politiques. En fait, l’attitude de
l’Espagne à l’égard de la déposition de Moḥammed ben Youssef, dé-
cidée unilatéralement par la Résidence générale française, permit aux
nationalistes de poursuivre leur action et de faire de la zone nord – no-
tamment des villes de Tétouan et de Nador où avaient été formés les
premiers commandos – une base d’opération pour attaquer les régions
sous protectorat français. Si l’acheminement des armes vers la zone
française ne les gênait points, la constitution de commandos dans leur
zone ne manquait pas d’inquiéter les Espagnols. C’est pourquoi, à par-
tir du 2 octobre 1955, date du soulèvement du Rif, leur attitude chan-
gea brusquement. Les colloques d’Aix-les-Bains pour la négociation
de l’indépendance, éventualité fortement rejetée par l’autre puissance
protectrice, marquèrent la fin de la neutralité espagnole et un contrôle
plus strict sur les réfugiés marocains.
Un rôle fondamental fut joué aussi par la ville de Tanger grâce à
sa position et à son régime particulier de ville internationale, ce qui
permettait des contacts internationaux, la circulations de revues
étrangères et une marge de libertés publiques beaucoup plus vaste.
Depuis Tanger, on pouvait assurer la coordination entre les résistants
opérant dans la zone sous protectorat français et leurs camarades ins-
tallés à Madrid, à Tétouan et au Caire. Par le port franc de cette ville
on pouvait introduire les armes achetées en contrebande et les ache-
miner vers Casablanca.18
Rélativement à la typologies d’action il n’était pas nécessaire de
prendre les armes pour contribuer à la libération nationale, et cela fut
particulièrement vrai dans le cas des femmes. La participation de la
population à la Résistance pouvait revêtir plusieurs formes “de la plus
18 Ibidem, p. 157. Il est nécessaire de souligner aussi l’importance pour la lutte armée de la
région d’Oujda, située entre la frontière algérienne à l’est et la zone du protectorat espagnol
à l’ouest.
206 Manuela Deiana
efficace jusqu’à la plus simple qui consistait à ne rien dire et à ne rien
voir.”19
Même quand on ne pouvait pas être actifs ou en première
ligne, le silence et la complicité avec les combattants constituaient une
forme valide de résistance et de lutte: “l’aide matérielle, le mutisme
observé à l’égard des résistants, l’obéissance aux mots d’ordre, la
crainte, la suspicion.”20
Comme il résulte de l’étude détaillée de Mohammed Zade, les dif-
férentes composantes du mouvement de la Résistance au Maroc
avaient commis 4520 attentats au cours de la période citée, soit une
moyenne mensuelle de 145 actions.21
Le mois d’octobre 1955 fut de
loin le plus marqué par les opérations armées avec un pic de 321 at-
tentats. Zade partage les actions en quatre typologies: les assassinats,
les incendies, les attentats à l’explosif et les sabotages. Les assassinats
et les tentatives d’assassinats, exécutés avec des armes à feu, des poi-
gnards et des barres de fer, représentèrent la typologie la plus fré-
quente (près du 40% de toutes les actions commises). Les incendies
(30%) furent allumés principalement en été contre les fermes des co-
lons et des “collaborateurs” marocains. Les attentats (21%) étaient ac-
complis avec des engins fabriqués de façon artisanale par les résistants
eux-mêmes à l’aide des explosifs en grande partie dérobés des car-
rières (dans d’autres cas ils utilisaient des grenades d’origine étran-
gère). Les sabotages (8%) étaient commis contre les récoltes et les
équipements agricoles possédés par les colons et les Marocains fran-
cophiles, mais souvent aussi tant les équipements téléphoniques et
électriques que les voie ferrées devenaient des cibles.22
En ce qui concern es victimes, selon Zade, sur un total des 4520 at-
tentats commis, 4061 actions visèrent des personnes ou leurs biens
(90%), tandis que le restant, 459, entendait toucher les propriétés de
l’Etat. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, la plupart des vic-
times étaient des musulmans (43% par rapport à 38% de victimes eu-
ropéennes, 19% autres) parmi lesquels on comptait surtout les infor-
19 M’Barek, Résistance et Armée de libération, p. 13. 20 Ibidem, p. 17. 21 Zade, Résistance et Armée de Libération, p. 153. 22 Ibidem, pp. 154-156. Zade signale même les appels à la grève générale parmi les formes
d’action de la Résistance.
“Nous n’avions pas d’autre choix” 207
mateurs, les agents de police et les chefs de quartier. Dans le bilād (en
dialecte marocain, bled), les groupes armés s’étaient attaqués aux
qā’id et aux chefs des tribus qui avaient comploté contre le sultan. La
majorité des victimes musulmanes était constituée de gens du peuple
condamnés pour leur attitude face au conflit franco-marocain.23
La majeure partie des victimes européennes était des Français;
quant aux victimes juives la plupart étaient des marchands casablan-
cais.24
Les commerçants de toute confession étaient exposés à des at-
tentats pour avoir persévéré dans la vente du tabac et des produits im-
portés de France malgré les appels au boycott lancés par la Résistance
ou pour avoir ignoré la consigne de respecter le vendredi en tant que
jour férié.
Comme dans le cas de la participation, fort bien documentée, des
femmes à la guerre de libération algérienne, au Maroc aussi plusieurs
femmes participèrent activement à la Résistance armée: elles portaient
des messages et des armes d’une maison à l’autre et d’une ville à
l’autre, cachaient des résistants chez elles et les faisaient sortir clan-
destinement, les déguisant souvent avec un haïk,25
assuraient la sur-
veillance pendant les réunions, préparaient la nourriture et les vête-
ments pour les combattants cachés ou en prison.
Néanmoins Alison Baker souligne que, malgré l’importance de leur
action, les femmes n’eurent pas des rôles de direction ou de comman-
dement. Elles participèrent à la Résistance non pas parce que les
hommes les considéraient “comme des êtres capables et fiables, mais
parce qu’ils estimèrent utile de confier à quelques unes d’entre elles
des tâches bien particulières telles que transmettre des messages ou
transporter des armes.”26
En conséquence, après l’indépendance ces
femmes ont regagné le foyer et retrouvé leur rôle traditionnel, ce qui a
alimenté leur sentiment de profonde déception.
23 D’autres victimes étaient des imām qui avaient accepté de faire la prière au nom du
nouveau sultan Ben ‘Arafa (Muḥammad b. ‘Arafa b. Muḥammad), des juges de tribunaux, des
chefs de confréries, des prostituées, mais surtout des notables et des personnalités politiques
importantes. Ibidem, pp. 192-193. 24 Archives de l’Institut d’Histoire du Temps Présent (I.H.T.P.) de Paris, Fonds Roger Paret,
Carton 6, Dossier “Résistance marocaine.” 25 Le haïk (en arabe: ḥā’ik) est un vêtement féminin porté au Maghreb. 26 Baker, “Histoire et mythe,” p. 317.
208 Manuela Deiana
3. “Nous n’avions pas d’autre choix.” La Résistance racontée par
ses protagonistes
Pour commencer je voulais vous dire que moi je suis pas un idéologue, ni le
chef de la résistance ni un commandant en chef de l’Armée de libération, je
suis un militant de la base, j’ai participé à la libération de mon pays et à
l’émancipation du peuple marocain. Je suis né sous le protectorat, j’ai vécu
un petit peu les déboires qui ont jalonné le parcours du protectorat qui a duré
plus de 44 ans. Beaucoup de gens imaginent que le protectorat n’a rien fait,
moi je dis que le protectorat a fait pas mal de choses, mais pas dans l’intérêt
du Maroc, dans l’intérêt de la colonie française qui se trouvait ici au Maroc
dans tous les rouages.27
Avec ces mots Ghali Laraqi (Ġālī Lārākī) commence sa narration.
A travers ses souvenirs de jeune militant, il nous plonge dans
l’expérience des interdictions quotidiennes et des limites imposées à la
population marocaine par le régime colonial. Il dessine un cadre fait
de petits détails dans lequel “les nationalistes étaient toujours brimés,
toujours arrêtés, les jeunes n’avaient pas le droit d’aller dans des en-
droits fréquentés par les Français.”28
Un régime dans lequel protester
et réclamer les mêmes droits appris par la puissance protectrice était
difficile, voire impossible: “on ne voyait de porte de sortie que par
l’action.”29
Elevé dans une famille nationaliste de el-Jadida, à la fin
des années ’40, Laraqi rejoignit Tanger où, successivement, il lui fut
possible d’aider la Résistance grâce à une plus grande liberté et une
disponibilité des moyens de communication. Tel que beaucoup
d’autres militants, à la fin de 1955, il décida de continuer la lutte et
s’engagea à procurer des armes à l’étranger pour ce qu’il appelle
“l’intifāda” du peuple marocain.30
Mohammed Bachir Figuigui (Muḥammad Bašīr Fikīkī), un autre
militant de longue date et membre du Conseil National des Anciens
27 Interview de l’auteur avec Ghali Laraqi, Casablanca, 21 mai 2009. 28 Ibidem. 29 Ibidem. 30 Ibidem.
“Nous n’avions pas d’autre choix” 209
Résistants, fréquenta depuis son enfance à Figuig (Fikīk, une localité à
la frontière avec l’Algérie) une des “écoles libres” construites par le
mouvement national dans le but de diffuser ses idées dans le monde
rural. En 1947, à l’âge de 11 ans, il était déjà affilié au parti de
l’Istiqlāl et fut envoyé à Casablanca où il poursuivit ses études dans
une école nationaliste. Il raconte:
Il y avait l’interdiction de toute forme d’expression légale, ils ont interdit les
syndicats marocains, ils ont dissolu les partis politiques, ils ont arrêté les
journaux, ils ont interdit toute forme d’organisation politique. Le mouvement
national était devant le choix: se rendre, la disparition, ou bien recourir à
d’autres moyens de lutte. C’est pour ça que le parti de l’Istiqlāl, comme
d’autres partis aussi qui s’opposent, est passé à la clandestinité, parce qu’il
n’y avait plus de moyen de lutte hors de la clandestinité.31
Le problème du manque de choix face à la dérive du protectorat et
aux abus des Français est le leitmotiv qu’on retrouve dans tous les té-
moignages des anciens résistants. Aucun ne manque de réitérer que la
voie de la violence était désormais la seule qu’on pouvait parcourir, le
seul choix possible, étant donné que toute forme d’opposition légale
était carrément prohibée pour les marocains.
(…) il ne reste qu’un seul choix, c’est l’action violente; la lutte politique con-
tinue mais sous forme armée, c’est-à-dire le programme politique c’est tou-
jours le programme du mouvement national, ça veut dire l’indépendance du
Maroc, l’annulation de toutes les mesures exceptionnelles comme l’exil de
Muḥammad V, la création d’un gouvernement national, changer les relations
avec la France. La résistance n’a pas un autre programme, c’est la méthode
de travail, ce sont les moyens de travail qui ont changé. Beaucoup de cadres
politiques des partis se sont transformés en militants politico-militaires.32
De son côté, Thami Na‘amane (Tuhāmī Nu‘mān), lui aussi membre
du Conseil National des Anciens Résistants, a toujours conçu la Résis-
tance, non seulement en termes d’utilisation des armes et de la vio-
lence, mais surtout en tant qu’éducation et lutte contre
31 Interview de l’auteur avec Mohammed Bachir Figuigui, Rabat, Haut Commissariat aux
Anciens Résistants et Anciens Membres de l’Armée de Libération, 14 mai 2009. 32 Ibidem.
210 Manuela Deiana
l’analphabétisme. C’est pour cette raison qu’en 1945 il ouvrit une li-
brairie à Casablanca où il distribua des livres “interdits” aux jeunes de
la région ainsi que de Marrakesh et Fès:
فهمت أ نه كان خاص ناس يقرأو، وبعد ما بديت بمحاربة ألأ مية، فكرت أ نه خاصني ندير مكتبة ونفهم ألناس، من ناحية وطنية كان ناس خاصهم يقرأو، أتصلت ببعض ألناس وذرت مكتبة ، وكانت هذيك ألمكتبة هي أ سباب ألتكوين ألوطني وألتكوين ضد
كان حزب كتبة خرج كل شيئ )...(.ألأستعمار وتكوين ألمقاومة ، ومن هذأ ألمألأستقلال يصدر منشور أ سبوعي، هذأك ألمنشور يتفرق على ألجماعات لي عندوأ في
كنشدوأ ذأك ألمنشور تنقرأ وه ، باش نعرفوأ عن ألوضعية ألأستعمار فين ألمغرب كلها،ف وصلت وفين وصل ألكفاح، ونشوفوأ أ ش خاصوأ يدأر في ألكفاح، لأ نه فرنسا شدة بزأ
ألمحلات في أفريقيا، فافريقيا ألمستعمرة كان فيه طرف ديال بلجيكا طرق فرنسا، طرف أنجلترأ، وفرنسا عندها بزأف، عندها ألسنغال مالي ألمغرب ألجزأئر تونس، عندها بزأف ديال ألمستعمرأت حنا بذأك ألمنشور تنشوفوأ ألوضعية فين وأصلا، وبهذأك ألمنشور
دي مكتبة تيجيوأ ليها ألطلبة لي تبقرأو ألعربية من مرأكش وفاس تتناقش ألأفكار، أ نا عنوتنشوفوأ أ ش خاصوأ يدأر لأستعمار، أ نا أ صبحت تنجيب ألكتب من ألخارج كتب مهمة في ألعربية حيث كانوأ ألفرنسيين مانعين تاريخ يتقرأ ومانعين كتب ألعربية يجوأ من ألخارج
انا نجيبوأ منها لي بغينا، ألمهم كاين وأحد وحيت كانت طنجة دولية كان فيها حرية وك 01مرأت أ و 01أتصال مع ألطلبة وأ صبحت ألمكتبة مشهورة ، هنا أ نا تقبطت فوق من
مرة وأنا تنتقبط ، كانوأ تيكولوأ ليا فين قريتي نتيا، شكون لي كاليك دير مكتبة، وعلاش جيتي ودرتي مكتبة.
“J’ai compris qu’il fallait que les gens lisent et après avoir commencé la lutte
contre l’analphabétisme, j’ai pensé qu’il fallait que je monte une librairie et
que j’explique aux gens. D’un point de vue nationaliste, il fallait que les gens
lisent. J’ai contacté certaines personnes et j’ai fait une librairie. Et cette li-
brairie a été à l’origine de la formation nationaliste, de la formation contre la
colonisation et de la formation de la résistance. Tout est parti de cette librairie
(…). Le parti Istiqlal publiait un tract par semaine qui était distribué à toutes
les sections du parti dans le pays. On lisait ce tract pour savoir où en était la
situation de la colonisation et où en était la lutte, pour savoir ce qu’il fallait
faire pour la lutte. Parce que la France avait beaucoup de territoires (armées
?) en Afrique. Dans l’Afrique colonisée, il y avait la partie belge, la partie
“Nous n’avions pas d’autre choix” 211
française, la partie anglaise. Et la France avait beaucoup de pays, elle avait le
Sénégal, le Mali, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie. Elle avait beaucoup de co-
lonies, et nous, avec ce tract, on voyait le développement de la situation et les
idées étaient discutées. Moi, dans ma librairie, des étudiants qui étudiaient
l’arabe venaient de Marrakech et Fès et on discutait ce qu’il fallait faire
contre la colonisation. Du coup, moi j’ai importé des livres importants en
arabe, de l’étranger, à un moment où les autorités coloniales interdisaient la
lecture de livres d’histoire et interdisaient l’importation de livres en arabe de
l’étranger. A ce moment-là, Tanger était internationale et c’était libre et donc
on pouvait en importer ce qu’on voulait. Bref, on avait des contacts avec les
étudiants et la librairie est devenue célèbre. Là, j’ai été arrêté plus de 10 ou
15 fois et chaque fois on me demandait: où tu as appris à lire, qui t’a dit de
monter une librairie, et pourquoi tu es venu et tu as monté une librairie?”
“J’ai compris qu’il fallait que les gens lisent et après avoir commencé la lutte
contre l’analphabétisme, j’ai pensé qu’il fallait que je monte une librairie et
que j’explique aux gens. D’un point de vue nationaliste, il fallait que les gens
lisent. J’ai contacté certaines personnes et j’ai fait une librairie. Et cette li-
brairie a été à l’origine de la formation nationaliste, de la formation contre la
colonisation et de la formation de la résistance. Tout est parti de cette librairie
(…). Le parti Istiqlal publiait un tract par semaine qui était distribué à toutes
les sections du parti dans le pays. On lisait ce tract pour savoir où en était la
situation de la colonisation et où en était la lutte, pour savoir ce qu’il fallait
faire pour la lutte. Parce que la France avait beaucoup de territoires (armées
?) en Afrique. Dans l’Afrique colonisée, il y avait la partie belge, la partie
française, la partie anglaise. Et la France avait beaucoup de pays, elle avait le
Sénégal, le Mali, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie. Elle avait beaucoup de co-
lonies, et nous, avec ce tract, on voyait le développement de la situation et les
idées étaient discutées. Moi, dans ma librairie, des étudiants qui étudiaient
l’arabe venaient de Marrakech et Fès et on discutait ce qu’il fallait faire
contre la colonisation. Du coup, moi j’ai importé des livres importants en
arabe, de l’étranger, à un moment où les autorités coloniales interdisaient la
lecture de livres d’histoire et interdisaient l’importation de livres en arabe de
l’étranger. A ce moment-là, Tanger était internationale et c’était libre et donc
on pouvait en importer ce qu’on voulait. Bref, on avait des contacts avec les
étudiants et la librairie est devenue célèbre. Là, j’ai été arrêté plus de 10 ou
15 fois et chaque fois on me demandait: où tu as appris à lire, qui t’a dit de
monter une librairie, et pourquoi tu es venu et tu as monté une librairie ?” 33
33 Interview de l’auteur avec Thami Na‘amane, Rabat – Haut Commissariat aux Anciens
Résistants et Anciens Membres de l’Armée de Libération, 20 mai 2009.
212 Manuela Deiana
Bien que la Résistance eut atteint ses objectifs, c’est-à-dire le retour
de sīdī Muḥammad et l’annonce de la prochaine indépendance du Ma-
roc, plusieurs éléments de l’Armée de Libération ne pouvaient se dire
satisfaits par les conditions des pourparlers d’Aix-les-Bains. En 1955,
donc, une rupture ultérieure se profila au sein de la Résistance et de
l’A.L.M.: s’il y avait déjà eu une fracture entre les partisans de
l’action armée et ceux de l’action politique, maintenant ceux qui ac-
ceptèrent les accords stipulés par les nationalistes avec le gouverne-
ment français prirent des distances de plus intransigeants. Ces derniers
étaient profondément déçus du fait de voir le pays encore divisé, en-
core mutilé dans sa souveraineté et son territoire et soutenaient la lutte
à outrance.
Et je me suis posé la question: est-ce qu’il fallait continuer le combat ? Ou
bien il fallait admettre la situation qui se présentait ? Nus avons exigé le re-
tour de Muḥammad V et la déclaration de l’indépendance, il y a eu les deux
choses. Ce que vous avez demandé, on vous l’a accordé. Mais c’est la cons-
truction de tout ça qui n’était pas satisfaisant pour moi, pour tout le monde.34
De plus, de l’A.L.M. était considérée comme une force à craindre
par le parti de l’Istiqlāl. C’était une organisation dont il connaissait la
portée politique et le prestige, qu’il fallait mettre sous tutelle, une
force qui jouissait de la sympathie populaire et des armements que les
combattants rapportaient avec eux et qu’ils n’avaient aucune intention
de déposer. Cette force, il fallait la minimiser et la détruire à partir de
la concession de la carte de résistant à tous ceux qui en faisaient la re-
quête, plutôt qu’à ceux dont le rôle pouvait être reconnu. Tel est le cas
du colonel Driss Ben Boubker (Idrīs b. Abū Bakr), combattant de
l’Armée de Libération qui décida de continuer à combattre pour la li-
bération du Sahara marocain jusqu’au mois d’avril 1960 et ensuite in-
tégra l’Armée marocaine.
نشوف، علاش ألناس أنا أستقلال ديال ألمغرب لي بغيتوأ أ نا للمغرب ماشي هو هذأ لي كلي جابوأ ألأستقلال ماعتنوش بهم ألناس ديولنا، طلعوأ ألخونة وولأد ألخونة وألوطنيين
34 Interview de l’auteur avec Ghali Laraqi, Casablanca, 21 mai 2009.
“Nous n’avions pas d’autre choix” 213
ألناس لي ما ألمزورين وبعض ألمقاومين ألمزورين هم لي أستغلوأ، جاء ألأستقلال تمتعوأ بهأ دروأ حتى حاجة، كاينين بعض ألأخوأن لي عرفوأ كيفاش يقضيوأ ألغرض لرأسهم ودأروفليسات وأحد ثلاثة ألناس أو أ ربعة ألناس، لكن لي عندوأ ضمير ما غاديش يعود لأباس عليه من فلوس ألناس ومن فلوس ألمقاومة، وهذأ غادي يسجلوأ ألتاريخ بغينا ولأ كرهنا، أ نا مارأضيش على أستقلال ألمغرب، أ نا ما تنكولش يعطيوهم شي حاجة، ألأحترأم،
وقاموأ بالمقاومة وقاموأ بجيش ألتحرير على ألأ قل يحترمهم، أ نا أحترأم ألناس لي كافحوأ .لي قدأمك ما عندي وألوأ عندي فقط غير تقاعد ديال ألكولونيل
“Moi, l’indépendance que je voulais pour le Maroc, ce n’est pas celle qu’on
voit. Pourquoi les gens qui ont fait l’indépendance, on ne s’en est pas occupé.
Ce sont les traîtres et les enfants de traîtres, les faux nationalistes et certains
faux résistants qui ont profité. L’indépendance est arrivée et ceux qui n’ont
rien fait en ont profité. Il y a quelques frères qui ont su comment tirer la cou-
verture à eux et ils ont gagné de l’argent, ce sont trois ou quatre personnes.
Mais celui qui a une conscience ne peut pas se sentir bien avec l’argent des
autres et l’argent de la résistance. Et ça, l’histoire va le retenir, qu’on le
veuille ou pas. Moi je ne suis pas content de cette indépendance du Maroc. Je
ne dis pas qu’on leur donne quelque chose, mais le respect, le respect des
gens qui se sont battus et ont fait la résistance, qui ont constitué l’Armée de
Libération, qu’on les respecte au moins. Moi qui suis devant vous, je n’ai
rien, je n’ai que la retraite de colonel.”35
Les résistants étaient donc doublement déçus. Cet état d’âme
émerge clairement des souvenirs des anciens protagonistes de la résis-
tance, lesquels ont des propos amers de désillusion et de déception
pour s’exprimer au sujet de la fin du protectorat et de la construction
d’un Etat indépendant. Déçus par le fait de voir des ex-collaborateurs
de la France – tels que M’Barek sīdī Bekkaï (Mubārak sīdī al-Bakkāy)
ou le général Muḥammad Oufkir (Ūfkīr) lui-même, définis comme des
“traîtres” – au gouvernement ou dans des postes de haute responsabili-
té, certains parlent de l’indépendance comme d’une farce, d’une
“pièce théâtrale.”36
35 Interview de l’auteur avec Driss Ben Boubker, Rabat, Haut Commissariat aux Anciens
Résistants et Anciens Membres de l’Armée de Libération, 19 mai 2009. 36 Expression utilisée par Mohammed Louma pendant une interview avec l’auteur à Rabat, 14
214 Manuela Deiana
La politique suivie après l’indépendance malheureusement c’était presque
contre la révolution, ça veut dire cacher, faire oublier aux marocains la résis-
tance nationale; le modèle qu’on a choisi d’organisation de l’Etat après
l’indépendance c’est la continuation du modèle colonial sans Français, un
modèle “marocanisé” mais c’est le modèle colonial. Ça veut dire que les
fermes, l’agriculture, l’économie, sont les fermes du protectorat,
l’administration c’est la même administration mais avec des Marocains, ça
veut dire le modèle de gestion c’est le modèle colonial, pas celui des Maro-
cains. Il y a eu des changements mais pas un vrai changement.37
4. Les sources orales dans l’étude de l’histoire de la Résistance
armée au Maroc
Les sources orales sont souvent traitées comme des sources moins
fiables que les sources ordinaires et sont considérées comme des
sources “provoquées” car donner la parole au témoin, c’est solliciter
sa mémoire. Cet aspect est certainement vrai et les conditions de re-
cueil de cette mémoire-source et la relation qui s’instaure entre
l’historien ou l’enquêteur et le témoin revêtent une grande importance.
En fait, comme l’a remarqué Robert Frank, “en convoquant la mé-
moire de son prochain, l’enquêteur provoque la source et participe à sa
fabrication matérielle, en même temps que son interlocuteur, dans un
échange à la fois fécond et dangereux.”38
De plus, l’interviewé recons-
titue son passé ou son récit “à la lumière de la suite de son histoire, en
fonction de son présent.”39
Bien conscient de ces facteurs et de la nécessité de passer au
crible de la critique les souvenirs recueillis au cours du travail de ter-
rain, à travers cette étude on visait à remarquer la double valeur des
sources orales: la valeur biographique qui s’ajoute à la pertinence
mai 2009. 37 Interview de l’auteur avec Mohammed Bachir Figuigui, Rabat, 14 mai 2009. 38 Robert Frank, “La mémoire et l’histoire,” in Danièle Voldman (éd.), La bouche de la Vérité ?
La recherche historique et les sources orales, Cahiers de l’Institut d’histoire du temps présent –
I.H.T.P., 21 (1992). En ligne, <http://www.ihtp.cnrs.fr/spip.php%3Farticle233&lang=fr.html>,
consulté le 29 novembre 2010. 39 Ibidem.
“Nous n’avions pas d’autre choix” 215
historique. En fait, “l’enquête orale est un révélateur essentiel pour
aider à une reconstitution de l’atmosphère d'une époque car elle met
en relief une série de petits faits vrais qui tissent l'existence.”40
Cet
aspect s’est révélé beaucoup plus vrai pour le cas des anciens résis-
tants marocains puisqu’il a permis de faire la lumière sur des petits
détails vécus qui sont normalement négligés par l’histoire, comme
certains épisodes de la vie quotidienne de la population marocaine –
par exemple des jeunes militants au sein des partis politiques – à
l’époque du protectorat.
De plus, la technique des interviews a permis d’exprimer des sen-
timents cachés pendant des décennies. Exactement comme Zaki
M’Barek prévenait au début de la recherche, ce qui ressort des ren-
contres avec les anciens résistants est un sentiment d’amertume et de
déception très fort. Ils dénoncent à maintes reprises la répression et la
dévalorisation dont la Résistance et ses protagonistes ont fait les frais
au cours des années suivant l’indépendance, ce qui leur a laissé ‘un
goût amer.’ D’un autre côté, des interviews a émergé aussi la réticence
manifestée par certains anciens résistants à révéler des faits délicats ou
des vérités inconvenantes à propos du passé tels que les assassinats ou
la prise des biens des victimes tandis que d’autres parmi eux ne font
aucun mystère même de leurs actions les plus violentes.
Enfin, les entretiens informels ont comporté l’évocation silencieuse
et douloureuse des souvenirs les plus durs et les plus angoissants de
ces moments tragiques tels que les tortures subies. En fait, souvent
pendant les rencontres, ce sujet a été mentionné et successivement
passé sous silence, ce qui nous rappelle le caractère sélectif de la mé-
moire et le rôle de l’oubli en tant que forme privilégiée de
l’organisation de la mémoire car il peut être “soit involontaire, soit le
résultat d’un acte volontaire, l’occultation.”41
En conclusion, comme l’a remarqué Benjelloun,42
beaucoup de tra-
vail reste à faire pour atteindre une écriture complète de l’histoire de
40 Dominique Veillon, “Technique de l’entretien historique,” in, Voldman, La bouche de la
Vérité? En ligne, <http://www.ihtp.cnrs.fr/spip.php%3Farticle240.html>, consulté le 21 no-
vembre 2010. 41 Frank, “La mémoire et l’histoire.” 42 Abdelmajid Benjelloun, “Réflexions sur l’histoire de la Résistance marocaine face au
216 Manuela Deiana
la Résistance armée au Maroc pour laquelle il souhaite l’ouverture
d’un centre de recherche proprement dit au sein du Haut Commissa-
riat aux Anciens Résistants et Anciens Membres de l’Armée de Libéra-
tion. En tout cas, tout travail ne pourra pas se dire exhaustif indépen-
damment d’une mise en valeur et d’une divulgation des témoignages
directs des ancien résistants encore vivants.
processus de l’indépendance du Maroc (1953-1955),” Revue d’Histoire Maghrébine, 139,
2010, pp. 17-25.